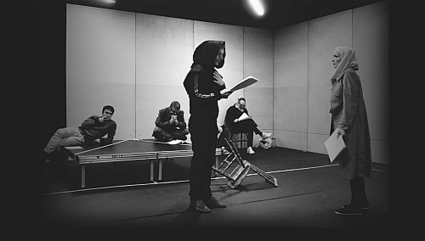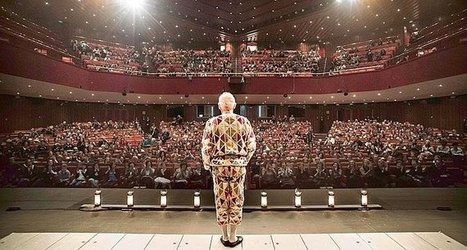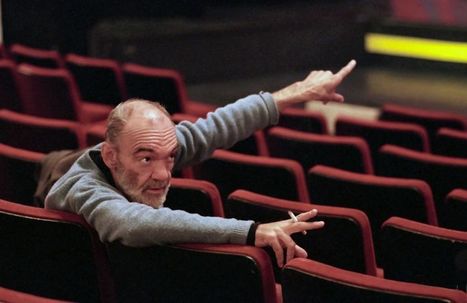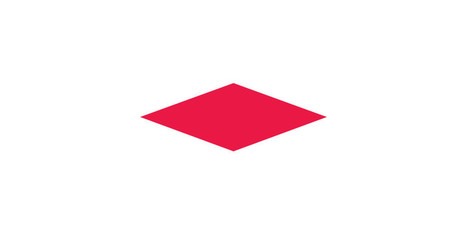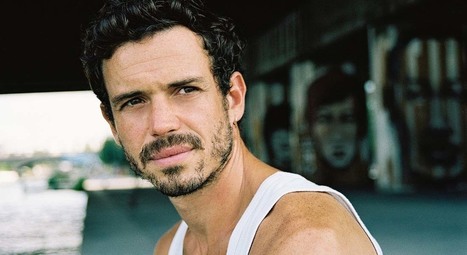Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2019 6:44 AM
|
Elle a dirigé la salle culturelle du Vivat pendant vingt-cinq ans. Un quart de siècle qu’Éliane Dheygere a accepté de survoler au gré de quelques souvenirs, bonheurs mais aussi regrets et coups de gueule. Attention, ça peut décoiffer…
Christelle Jeudy | 27/02/2019 Partager Twitter
Eliane Dheygere va quitter la direction du Vivat le 16 mars prochain, à l’issue d’une représentation du chorégraphe Thomas Lebrun et d’une fête « frites-bière ».
Demain son bonheur s’écrira à La Motte-Aubert, un village de Charente-Maritime où Éliane Dheygere va poser ses valises. Première étape d’une nouvelle aventure qui débutera le 16 mars, après une fête « frites-bière » à Armentières pour marquer son départ en retraite. Pas de nostalgie, ce n’est pas le genre de la maison sourit celle qui s’est vite passionnée pour la danse contemporaine. C’était à Valenciennes et à 11 ans, Éliane Dheygere mettait ses pas dans ceux d’Annick Crépin, sa professeure de danse. « On l’appelait la danseuse aux pieds nus. Elle a 92 ans aujourd’hui, conduit toujours sa voiture et va à la gym ». La preuve d’un beau tempérament sans doute contagieux qui propulse Éliane dans une école de danse à Paris, pour y apprendre à « chorégraphier, danser, enseigner… ».
Trois ans plus tard, c’est le retour dans le Nord puis la création de Danse à Lille en 1983, pour faire entrer la danse contemporaine dans les salles de spectacle. À l’Hospice Comtesse, « sans ordi ni internet, avec seulement 10 000 francs de budget et des flyers distribués dans les rues », un festival se monte et fait connaître des gens comme Philippe Decouflé ou Carolyn Carlson. Toujours, Éliane Dheygere s’est sentie « dénicheuse de jeunes artistes », avant de continuer au Vivat.
Le 2 février dernier, en mairie, Eliane Dheygere participait à la performance de Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord, sur le thème de l’Oubli.
Le Vivat, justement, créé en mars 1990, elle y arrive pour développer la danse en 1994. Et deux ans plus tard, alors que la salle culturelle affiche un gros déficit, on la propulse à la direction du lieu. Il y a plus de vingt ans, on y voyait déjà du théâtre avec les Fous à Réaction, mais aussi de la chanson, de l’opérette et même du jazz. Plus de têtes d’affiche qu’aujourd’hui, c’est certain. Éliane Dheygere se souvient de Jonaz, Lavilliers, Léo Ferré, Adamo, Moustaki, Jane Birkin, Brigitte Fontaine (lire par ailleurs). Et puis, elle crée le festival Vivat la danse, dont la 22e et dernière édition vient de se terminer. Dernière, vraiment ? La directrice confirme et croit savoir que son successeur, Stéphane Frimat, conservera un temps fort dédié à la danse « pour fêter les 30 ans du Vivat », donc pas tout de suite.
Au final, Éliane Dheygere se dit « très fière » de son bilan à la tête du Vivat. « J’ai multiplié par deux ou trois le budget des débuts et le nombre de salariés, les comptes sont positifs et on touche 10 % des Armentiérois, c’est pas mal »… « Un lieu comme le Vivat, c’est un espace de convivialité. De rencontre et de divertissement, oui, mais aussi de débat d’idées. Par moments, on a vu ce qui peut se passer quand les gens ne sont pas juste là car ils ont acheté une place », ajoute une directrice qui ne cache pas non plus avoir « manqué de moyens » pour monter des gros plateaux ou faire venir des vedettes.
Eliane Dheygere aura dirigé le Vivat pendant vingt-cinq ans. Le 16 mars, elle part en grandes vacances et passera le relais à Stéphane Frimat.
D’où une programmation égratignée ces derniers mois, « par des personnes qui ne la connaissent pas » regrette Éliane Dheygere… Et des disputes entre élus au sujet de la salle culturelle mais ajoute la directrice, « c’est bien qu’il y ait des disputes. Ça veut dire que le Vivat est important, que c’est un enjeu politiqu e ».
Pourtant, elle ne cache pas s’être sentie « déconsidérée, pas par ce qui a été dit mais par le fait qu’il n’y ait même pas eu d’effort de venir vers moi pour en discuter », et elle croit savoir que la future programmation va davantage « rassurer, avec des noms plus connus et moins de choses indéfinissables ». À venir donc…
Demain sera un autre jour, un autre temps, une autre vie, qu’elle va découvrir à la campagne, dans un éco-village où coexistent des agriculteurs, des écoles alternatives et… une salle de spectacles. Tiens, tiens.
Vingt-cinq ans de direction c’est…
En chiffres
- Plus de 250 000 spectateurs accueillis, plus de 600 résidences organisées, près de 270 chorégraphes invités à Vivat la danse et plus de 4 000 spectacles vus !
Quelques insolites moments
- Une balade en bateau aux Prés du Hem avec l’équipe du Vivat, suivie d’un petit naufrage.
- Dans Chandelier, Steven Cohen maquillé à outrance, remontant les marches du Vivat sur ses immenses talons hauts.
- Christine (de l’équipe du Vivat) allant chercher des cailles non vidées pour servir de cache-sexe à un artiste.
- Death is certain, un spectacle où les pompiers sont intervenus à la fin : la maison d’Hansel et Gretel, en pain d’épices, explosait et on n’avait pas prévenu le service incendie de l’EPSM.
- Le Mad-Madison géant en mairie d’Armentières avec ses 250 danseurs sous la houlette de Bérénice Legrand pour les 20 ans de Vivat la danse.
- Le bal des pompiers avec une résidence au centre de secours d’Armentières et une restitution au Vivat avec deux pompiers sur scène, dansant au ralenti les gestes de premiers secours.
- Catherine Lassue, chargée d’entretien, fermant les lumières au bar pour faire partir le public.
- Le grand jeu de piste chorégraphique à l’hôtel Joly, devant l’église, à la maison Debosque, à la Parqueterie de la Lys, etc.
Des artistes
- Adamo et sa femme aux petits oignons pour lui dans sa loge, c’est elle qui lui repassait ses chemises.
- Moustaki et ses ballerines de danse blanches.
- Brigitte Fontaine qui a adoré les tartes au Maroilles.
- La gentillesse d’Agnès Jaoui.
- Jane Birkin qu’on a dû aider à enfiler sa robe.
- Éric et Ramzy, trop sympas…
- Marcel et son Orchestre, il n’y avait plus de bière au bout de deux heures de concert.
- Dany Boon dans la salle, plaisantant directement avec Michel Boujenah pendant son spectacle.
Regrets et coups de gueule
- Ne pas avoir réussi à convaincre que l’art peut sauver des vies et faire tellement de bien à la pensée et au corps.
- Que des gens pensent que les habitants d’Armentières sont moins cultivés que ceux de la métropole.
- Que les mots intellectuel, complexité, pensée et art soient devenus négatifs.
- Que globalement, le repli sur soi prédomine sur l’envol.
- Que le négatif l’emporte sur le positif.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 5, 2019 6:42 PM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro le 04/03/2019 Sous la direction de Cyril Teste, la comédienne part à la recherche de John Cassavetes et de Gena Rowlands dans «Opening Night», film consacré aux mystères de l'art dramatique. Travail en cours.
De notre envoyée spéciale à Namur.
Que dire d'un spectacle qui se présente comme un travail encore en cours? Que dire de la précision apportée liminairement en une phrase projetée sur un écran: pas question de «mise en scène». Samedi soir dernier, à Namur, nous avons assisté à un «laboratoire public», septième séance.
Isabelle Adjani, spectatrice assidue, très au fait de la création théâtrale, a souhaité travailler sous la direction de Cyril Teste. Le metteur en scène a remarquablement réussi une transposition de Festen en 2017 et vient de signer, avec Louis Langrée, un passionnant Hamlet d'Ambroise Thomas, salle Favart.
Isabelle Adjani et Cyril Teste ont mis la barre très haut en choisissant Opening Night (Soirée de première), très long film de John Cassavetes
Isabelle Adjani et Cyril Teste ont mis la barre très haut en choisissant Opening Night (Soirée de première), très long film de John Cassavetes. Un film qui date de 1977-1978 et dans lequel sa femme, Gena Rowlands, comédienne somptueuse, était prise dans les vertiges de la scène et de la vie, à la recherche d'un personnage. Vertiges très pirandelliens doublés des paradoxes envoûtants repérés magistralement par Diderot et depuis toujours remis sur le métier. Cassavetes, comme Gena Rowlands et Ben Gazzara, était passé par l'Actor's Studio marqué par Lee Strasberg et ses méthodes.
Isabelle Adjani et Cyril Teste ne sont pas les premiers à tenter cette transposition. Ivo van Hove est passionné par John Cassavetes et il a mis notamment en scène Husbands et… Opening Night. La version vue à Namur, dans le superbe théâtre à l'italienne, ses tons perle et ses ors, son imposant lustre, ses fauteuils modernes et son excellent rapport scène-salle, n'est pas celle que découvriront les premiers spectateurs de France, après-demain, au Quai d'Angers, producteur principal de cet Opening Night qui réunit trois protagonistes: Isabelle Adjani, la comédienne Myrtle Gordon, son metteur en scène, Manny Victor, ici Morgan Lloyd Sicard (Ben Gazzara dans le film), son partenaire, Maurice Aarons (Frédéric Pierrot, John Cassavetes dans le film).
Saluts sous voilette
Au tout début d'Opening Night, surgit une toute jeune fille, fan éperdue d'amour de Myrtle qui, quelques minutes plus tard, meurt sous les roues d'un véhicule, devant le théâtre. Cette morte hante tout le film. Dans la proposition de Cyril Teste, elle est filmée, incarnée par Zoé Adjani, nièce au visage qui n'est pas sans évoquer celui de la star. Dans le film, les protagonistes sont très nombreux et il y a en particulier un personnage frappant, l'auteure de la pièce The Second Woman… Ici, rien de tel, mais des interruptions brusques du «vrai» metteur en scène, des adresses à la salle, des pleins feux sur les spectateurs, des incursions à l'orchestre, tout un arsenal de ruptures qui ajoutent au trouble. Et bien sûr le vidéaste qui suit l'action et cadre sans trembler les scènes, les visages, les corps, tandis que sur les côtés, on aperçoit les coulisses et la maquilleuse exécutant quelques raccords.
À force de chercher, de raturer, de reprendre en partant du premier scénario de Cassavetes, homme de théâtre et cinéaste épris d'improvisations, les artisans du spectacle sont parvenus à un format si elliptique et si bref que l'on est un peu décontenancé. Voix un peu éloignées par les micros, timbres un peu écrabouillés parfois - attention ! - le trio est très intéressant. Le charme ténébreux de Morgan Lloyd Sicard opère. La présence forte et très subtile de Frédéric Pierrot donne une profondeur aux affrontements comme aux esquisses et humeurs volatiles. Isabelle Adjani, en quête de l'inaccessible étoile, Gena Rowlands, Myrtle Gordon, en quête de «l'Actrice», est très touchante, vibrante dans tous les états très contrastés de Myrtle. Et lorsqu'ont lieu les saluts sous voilette, on rêve que ce ne soit pas fini…
«Opening Night», Le Quai, centre dramatique d'Angers, du 7 au 16 mars. Tél.: 02 41 22 20 20. Puis en tournée aux Célestins de Lyon, à Bonlieu-Annecy, au Théâtre de Nice, aux Bouffes du Nord à Paris, au Gymnase de Marseille.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 4, 2019 10:13 AM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro le 28/02/2019
L'adaptation de Verte de Léna Bréban au théâtre Paris-Villette enchante les jeunes et ravit les adultes.
CHRONIQUE - Marie Desplechin a écrit Verte pour les jeunes lecteurs. Léna Bréban en fait un spectacle savoureux et tonique.
Verte est contemporaine de Harry Potter! Une cousine à la française. Le livre de Marie Desplechin qui s'intitule, du nom de l'héroïne récalcitrante, Verte, parut en 1997, comme les premières aventures de notre binoclard préféré. Il fit grande sensation au Salon du livre de Montreuil, passionna les lectrices et les lecteurs, en herbe (verte) et aussi les adultes. Il existe même une version film de cette histoire en rien innocente: la petite fille, dont la mère et la grand-mère sont sorcières, rechigne un peu à suivre le chemin des sortilèges, des chaudrons qui bouillent, des manches à balai qui volent… Verte rêve d'être comme les autres. Et pour être complètement comme les autres, il faudrait qu'elle sache enfin qui est son père.
Avec «Verte», on a l'exemple d'un spectacle franchement très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats de rire des enfants ou les cris stridents qu'ils lancent sont un baume !
Rien de démonstratif dans le texte original. Il brasse des thèmes qui touchent la famille, l'origine, l'inscription dans une lignée, l'héritage. La liberté. En toute fantaisie et avec sensibilité. C'est dans le cadre du «Parcours enfance et jeunesse» du Théâtre de la Ville qu'est actuellement proposée cette adaptation savoureuse. Elle enchante les jeunes et ravit les adultes. La création a eu lieu en coproduction à l'Espace des arts de Chalon-sur-Saône, début février.
Le théâtre jeune public est un domaine difficile. De grands artistes s'emploient à lui donner du corps. On cite souvent Olivier Py et Emmanuel Demarcy-Mota qui ont un intérêt non feint pour ce public, pour ce répertoire. En quelques années, ils ont grandement contribué à affermir la qualité des productions. Avec Verte, on a l'exemple d'un spectacle franchement très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats de rire des enfants ou les cris stridents qu'ils lancent sont un baume!
Ces trois «j», joyeux, joli, juste, ne sont pas le fruit du hasard, mais du talent aussi malicieux que sérieux d'une équipe artistique formidable. À partir du Verte de Marie Desplechin, Alexandre Zambeaux et Léna Bréban, qui signe la mise en scène, ont concocté une version pour les planches aussi séduisante qu'un philtre de sorcière gentille…
Tout plaît ici! On crierait presque «bis!» à la fin, tellement on s'amuse de bon cœur. On s'amuse, mais on est conduit, en même temps, à réfléchir. Et sur des points douloureux d'identité. Qui est-on? Que devient-on? Rien ne pèse pourtant. La scénographie d'Emmanuelle Roy ressemble aux illustrations des albums et se déploie comme une merveilleuse machine à produire du théâtre. Et des effets. Si on dit sorcière, on dit sorcellerie et tours de magie, non?
Merveilleuse, humaine, inattendue, cette sorcière-là ne fait pas peur du tout et possède la grâce d'une fée. Julie Pilod est miraculeuse de vérité
Léna Bréban, comédienne que l'on a connue dès le conservatoire et que l'on ne cesse d'applaudir dans des registres très différents, est très fine, très aiguë, lorsqu'elle met en scène. Pas folle, elle a réuni des interprètes formidables.
On est plutôt dans un monde de femmes, mais il y a tout de même un garçon. Pierre Lefebvre est charmant et l'on comprend que Verte ait le cœur qui batte. Céline Carrère ne craint pas les excès d'autorité, d'expression, de rage de la mère de Verte. Elle se nomme Ursule. Elle a du coffre et Céline Carrère se régale de mimiques outrées et efficaces…
Dans l'histoire, il y a aussi la grand-mère. Une femme beaucoup plus équilibrée avec son physique doux et tendre à la Mamie Nova. Anastabotte, c'est son bizarre nom, est incarnée par une Julie Pilod méconnaissable sous sa perruque. Merveilleuse, humaine, inattendue, cette sorcière-là ne fait pas peur du tout et possède la grâce d'une fée. Julie Pilod est miraculeuse de vérité. Quant à Verte, c'est une interprète aussi douée que ses camarades. Rachel Arditi lui prête son heureuse vitalité. Délicieuse, vive, touchée, touchante. Bis! Oui, bis!
«Verte», Théâtre Paris-Villette (Paris XIXe), jusqu'au 3 mars. Tél.: 01.40.03.72.23. Durée: 1h15. Puis en tournée jusqu'en mai dans toute la France. Renseignements sur le site de l'Espace des arts de Chalon-sur-Saône.
Légende photo : L'adaptation de Verte de Léna Bréban au théâtre Paris-Villette enchante les jeunes et ravit les adultes. - Crédits photo : Julien Piffaud / Théâtre Paris Villette

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 3, 2019 10:33 AM
|
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog 2 mars 2019
Mesure pour Mesure de William Shakespeare, adaptation et mise en scène d’Arnaud Anckaert
On le rencontre dans les comédies ou les tragi-comédies de Shakespeare, ce Duc mélancolique, à la fois homme de bien, dépressif et un peu pervers : au fond des bois de Comme il vous plaira, sur l’île de La Tempête… Mais celui de Mesure pour Mesure doute de lui-même et s’interroge sur la force de la loi et sur l’exercice du pouvoir. Aussi, déguisé en moine, va-t-il, sous le prétexte d’un voyage diplomatique, observer comment le puritain Angelo, le bien-nommé, exerce la régence qu’il lui a confiée. Ça commence mal : Angelo fait condamner à mort Claudio pour “fornication“. Le pauvre garçon a juste été trop pressé de « connaître » sa fiancée… Pas d’excuse et pas de quartier, dura lex sed lex : la loi doit être appliquée à la lettre, et le prévenu sera exécuté dès le lendemain à l’aube.
Qui le sauvera ? Sa sœur, religieuse novice, tente de convaincre le Régent. Tentative risquée: le tyran a un désir d’elle aussi violent que sacrilège. Finalement, sous son masque de moine, le duc, confident de la jeune fille, trouve une solution audacieuse avec substitution de femme (comme dans Tout est bien qui finit bien) et de cadavre. Tout rentrera dans un ordre plus clément et plus juste, conforme à la loi du Monde et à celle de Dieu.
La pièce traite avec gravité du droit, de la justice, du pouvoir, de l’État, de la violence du désir et du péché. Rien que cela! Elle n’en est pas moins une comédie avec intermèdes bouffons et personnages secondaires de maquereaux et maquerelles: la face grotesque et libre des désirs aristocratiques cadenassés… Arnaud Anckaert place son spectacle sous les auspices du Surveiller et punir de Michel Foucault et prend de front ces questions de loi, de justice et de contrainte des corps. Il s’interroge sur la dangereuse obsession de pureté et sur la mainmise des hommes sur les les femmes, sur l’irruption et la folie du désir. Cette dernière question semblant beaucoup plus difficile à saisir et à traiter.
Les mots sont bien là mais les corps ne jouent pas. Dans un clair-obscur, des images fantasmatiques conventionnelles (un homme se fait fouetter et une religieuse relève sa robe sur son porte-jarretelles) ne suffisent pas à instiller le moindre trouble… Des clichés qui vont à l’encontre d’une mise en scène qui est, par ailleurs, d’une réelle honnêteté. «Je cherche, dit Arnaud Anckaert, à ce que la fabrication du théâtre soit invisible et concrète». Et ainsi fonctionne le spectacle : avec une sorte de saine naïveté. Personne ici ne fait le malin et il n’y a aucune concession à une flatteuse autodérision. Revers de cette naïveté : malgré la présence de comédiens solides, sincères et tout à leur tâche, l’interprétation reste courte et illustrative : rien ne déborde, ni en profondeur, ni dans les prolongements possibles du rôle. Dès lors, comment parler des débordements, en restant dans ces limites ? Même les clowns et bouffons restent ici presque sages.
Arnaud Anckaert est l’heureux metteur en scène en France d’auteurs britanniques importants comme Dennis Kelly. Devant Shakespeare, on le sent intimidé, freiné. Il utilise bien l’espace du théâtre d’Arras: entrées par la salle, plateau à deux niveaux, mais dans une simplicité sans véritable choix esthétique. Le spectacle pêche par une ambition contradictoire et finalement, par trop de modestie. Reste la pièce, étrange, passionnante qu’on entend bien, même avec les ailes et les griffes rognées.
Christine Friedel
Spectacle vu le 27 février, au Tandem, Théâtre d’Arras (Pas-de-Calais).
Le Manège à Maubeuge (Nord) le 8 mars. Comédie de Béthune (Nord) du 26 au 29 mars. Comédie de Picardie, Amiens (Somme) les 3 et 4 avril. Théâtre Romain Rolland, Villejuif (Val-de-Marne), le 6 avril. Théâtre Benno Besson à Yverdon (Confédération Helvétique, canton de Vaud), les 10 et 11 avril.
La Barcarole,Arques (Pas-de-Calais) le 21 mai. Château d’Hardelot (Pas-de-Calais), les 23 et 24 mai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 3, 2019 8:15 AM
|
Par Alexandre Demidoff dans LeTemps.ch 2 mars 2019 Au théâtre, le salut est souvent un spectacle en soi
Lorsqu’elle est réussie, la révérence finale des acteurs est un moment de vérité inoubliable où l’art et la vie s’entrelacent. Certains artistes en font une œuvre en soi. Feux croisés à propos d’un rituel
Un salut qui marque à vie. Ce dimanche lointain à Paris, Ferruccio Soleri incarne, masqué comme toujours, Arlequin dans Servitore di due padroni, la pièce de Goldoni. Depuis quarante ans, il jongle avec les assiettes, se fait fesser sous les candélabres, ensorcelle les foules, à Milan comme à Moscou. Giorgio Strehler, cet artiste orageux dont chaque spectacle est une toile de maître, lui a confié ce rôle en 1963. Ferruccio Soleri arlequine dans sa tenue losangée, comme un jockey se joue des obstacles à l’hippodrome. Il va vite, s’envole, pirouette. Dans mon fauteuil, je me sens ailé.
Mais vient le dénouement, cet instant où les acteurs tombent des nues, en ligne sur les planches de l’Odéon, cette arche d’or et de velours. Soleri s’avance, sec comme un cavalier, relève son masque et, stupeur, c’est un visage gris qui accueille l’ovation. L’artiste qui s’incline a près de 70 ans. Pendant près de deux heures, il n’avait pas d’âge.
Le salut au théâtre est l’instant de vérité. Des interprètes s’avancent au bord de la scène, comme on rejoint une frontière. Ils s’arrachent à la fiction, encore nimbés de son privilège. Ils reprennent possession de leur enveloppe civile, tout en jouissant de l’aura de leurs personnages. Double vie, double vérité, irréductibles, l’une et l’autre. Mais d’où vient ce rituel?
Il a son histoire, comme le rappelle l’essayiste Georges Banu, qui d’un livre à l’autre éclaire les pratiques de la scène. Au début, il y a Shakespeare, la foule en cercle et l’adresse finale des comédiens, celle-ci par exemple dans Le Songe d’une nuit d’été: «A tous bonne nuit de tout cœur./Si nous sommes amis, applaudissez très fort.» En ce temps-là, taper dans les mains, c’est aussi répandre la bonne nouvelle d’un spectacle réussi, note l’historien. La représentation ne se conçoit pas sans cette clôture. La foule des marquis et des perruches de cour a beau piailler, s’esclaffer, voleter pendant que Molière et ses acteurs exécutent leur comédie, la troupe finit toujours par s’incliner à la face du prince ou du Roi Soleil. Le salut est historiquement un hommage au commanditaire.
Est-ce à dire que le salut est un ballet en soi, une parade préméditée, rêvée, comme l’ultime phrase d’un roman? Les écoles divergent. Il y a ceux qui comme Giorgio Strehler à la belle époque du Piccolo Teatro à Milan, entre 1950 et 1990, en règlent le moindre clin d’œil. «C’était le cas en Suisse romande d’André Steiger», se souvient Philippe Macasdar, directeur du Théâtre Saint-Gervais à Genève. «Il demandait aux acteurs de changer de posture entre deux noirs. Il rappelait ainsi que le théâtre était jusqu’à sa limite un code.» A l’opposé, il y a ceux qui comme Antoine Vitez en France ne se soucient pas de parapher l’œuvre. «Benno Besson, lorsqu’il dirigeait la Comédie de Genève, était sur cette ligne, note encore Philippe Macasdar. Cela n’empêche pas les acteurs de vivre ce moment de manière très intense, comme à la première de L’Oiseau vert de Carlo Gozzi à Genève en 1982. C’était le premier spectacle de Besson comme directeur de la Comédie. Les répétitions s’étaient mal passées, les acteurs étaient furieux de porter le masque, l’ambiance tendue. Aux saluts, ils montrent leurs visages et la salle applaudit à tout rompre. Ils en étaient tout ébaubis, selon le mot de Besson, très amusé par la situation.»
Plus près de nous, Omar Porras, metteur en scène suisse d’origine colombienne, est un maniaque de la conclusion. «Quand je rentre au théâtre, la première chose que je fais, c’est saluer le plateau. Le salut est de l’ordre de la révérence. Je règle ce moment précisément. Je choisis celui qui entre en premier et appelle les autres. Les soirs de première, je veille à ce que toute l’équipe salue, de l’administratrice au maquilleur, pour manifester qu’un spectacle est l’histoire d’une tribu, celle en l’occurrence du Teatro Malandro.» Le directeur du Théâtre de Carouge Jean Liermier, lui, n’enjolive pas l’épilogue. «Comme Claude Stratz et André Engel, qui ont été mes maîtres, je commence à m’y intéresser la veille de la première. C’est un moment de blues, le spectacle ne vous appartient plus. Mes saluts ne sont jamais chorégraphiés. Ils doivent être simples et modestes. Le jeu est fini.»
Mais le salut n’est pas une fatalité. Au Japon, les acteurs de nô et de kabuki disparaissent à la fin de la fiction, note Georges Banu dans son livre L’acteur qui ne revient pas*. Ils emportent avec eux leur mystère. C’est le cas notamment du shite, cet interprète masqué qui figure le fantôme dans le nô. Et si le public applaudit, c’est «avec la conscience d’une transgression grave et en même temps avec le désir de témoigner, fût-ce discrètement, une satisfaction de nature esthétique. Les applaudissements plongent l’acte religieux dans l’ambiguïté.» Dans les années 1960, les Américains Julian Beck et Judith Malina attaquent l’ordre capitaliste à l’enseigne du Living Theatre, troupe qui fait une escale retentissante en 1968 à Genève. Leurs spectacles sont des poèmes éruptifs, des îlots d’insurrection. Comment imaginer que les acteurs saluent sur les braises, alors que c’est l’idée de frontière entre l’art et la vie qui est condamnée?
Qui oserait pourtant refuser aujourd’hui le cérémonial? Un acteur qui ne s’y plierait pas passerait pour un cuistre, observe Philippe Macasdar. «Le salut a la force d’une première communion, c’est un instant sacré», dit Omar Porras. Mais il est des spectacles qui appellent autre chose que cette effusion, nuance Georges Banu. «Je me rappelle un concert de Jessye Norman. A la fin, la salle était tellement émue qu’il y a eu un silence, comme une communion affective entre le public et l’artiste. Un imbécile a crié «bravo» et nous nous sommes tous sentis vexés. Le silence était une césure plus profonde que la mécanique des applaudissements.»
* «L’acteur qui ne revient pas», Folio essais.
,Alexandre Demidoff
Omar Porras, Metteur en scène, à propos du cérémonial final :
«Le salut, c’est comme une première communion. On célèbre le mystère du théâtre, le fait qu’il existe encore»

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2019 6:26 AM
|
REPRISE / TEXTE DE THOMAS BERNHARD / MES KRYSTIAN LUPA
Par Manuel Piolat Soleymat - publié dans La Terrasse le 28 février 2019 - N° 274
Le metteur en scène polonais Krystian Lupa est l’un des maîtres du théâtre mondial. Place des héros de Thomas Bernhard est l’une de ses pièces les plus impressionnantes.
Ils parlent ou ils se taisent. Donnent corps à de longs monologues. Se manifestent dans la simplicité d’activités quotidiennes : s’asseoir sur un banc, convoquer la mémoire et les propos d’un proche venant de mettre fin à ses jours, s’atteler au rangement d’un placard, prendre place autour d’une table à l’heure du repas, repasser une pile de linge… Dans des décors et des lumières (de Krystian Lupa) qui portent plus loin que leur apparent réalisme, les interprètes lituaniens** de Place des héros pèsent, jusque dans leurs non-dits, de tout leur poids humain. Lentement. Pleinement. Sans le début d’une coquetterie. La vie, lorsqu’elle s’exprime à travers une telle évidence, n’a pas besoin de frasques ou de traits de fantaisie. Elle se suffit à elle-même. Déploie une densité d’autant plus frappante que ses fondements échappent. Sa force, aussi, reste mystérieuse. Sa beauté surgit d’on ne sait où. Comme dans la plupart des créations du metteur en scène polonais, les fils de la temporalité se distendent et nous englobent. Ils nous emportent dans un monde qui outrepasse l’idée de réussite théâtrale.
La consistance des mots et des silences
Car cette version tout en élans contenus de la pièce testamentaire de Thomas Bernhard (l’écrivain autrichien a écrit Place des héros en 1988, un an avant sa disparition) est d’une amplitude hors norme. Centrée sur les impulsions souterraines que font naître les onze comédiens, la mise en scène de Krystian Lupa frappe comme une tornade sans pluie. Et sans vent. Une tornade sèche, en somme, sourde, qui vient pourtant réactiver de manière surprenante les traumatismes d’un passé qui se réinvente dans le présent. L’Anschluss. Les fantômes du nazisme. La décomposition morale et politique d’un peuple, d’une nation. « Les gens ne soupçonnent pas que la catastrophe peut arriver », dit l’un des personnages. Du XXème au XXIème siècle, le cinglant Thomas Bernhard fait ici plus que jamais figure de visionnaire. Il dénonce, pointe du doigt, apostrophe. Krystian Lupa, intime de cette grande écriture, explore la consistance des mots, mais aussi des silences. Il touche à l’invisible. A l’irreprésentable.
Manuel Piolat Soleymat
------------------------------------------------------------------------------------- Sur le site du Théâtre les Gémeaux : Entretien avec Krystian Lupa :
Thomas Bernhard écrit cette pièce dans un contexte particulier, celui de l’affaire Waldheim. Quel est le contexte de Place des Héros aujourd’hui ?
C’est la nouvelle marée de xénophobie et d’antisémitisme qui traverse l’Europe, le nouveau paysage de haine de la différence et de peurs qui se dessinent dans nos sociétés. Les aspects en sont légèrement différents selon les pays. Il est difficile de comprendre exactement les raisons de ce nouveau renfermement de la société face au progrès humaniste. Qu’est-ce qui entraîne chez un individu et une communauté d’individus un tel besoin de haine, et le besoin de chercher et de se donner un objet de haine ? Lorsque j’ai travaillé sur Place des Héros, j’étais témoin de cela en Lituanie. En même temps, il y a eu en Pologne une telle montée des agressions nationalistes et xénophobes qu’il devenait possible de s’identifier entièrement aux personnages de Place des Héros.
Il y a dans l’œuvre de Thomas Bernhard une interrogation sur la nation, le fascisme. Elle traduit une poursuite plus vaste de la vérité. Que vous inspire cette poursuite, ce travail incessant sur l’histoire, la mémoire, les origines, les héritages ?
C’est étroitement lié. Les prises de positions qui génèrent le fascisme naissent de la montée de l’hypocrisie ; s’exprime la terreur d’une « vérité » inventée et toxique, qui consacre uniquement la haine. Tout ce qui est autour, et donc justement la mémoire, l’histoire, l’héritage national et spirituel, s’obscurcit. L’obscurcissement du chemin vers la vérité n’est pas un phénomène propre uniquement à un groupe limité : la vague d’obscurcissement gagne aussi ceux qui cherchent à s’en défendre… C’est le thème le plus profond et le plus mystérieux de la dernière pièce de Bernhard. Les personnages portent en eux des pensées qu’ils sont incapables d’exprimer. Un tabou ? Une paralysie du processus intellectuel ? Les âmes et les cerveaux humains sont intoxiqués.
Vous avez-dit : « C’est en mettant en scène Place des Héros que j’ai ressenti pour la première fois cette nécessité d’arracher les personnages des griffes de l’auteur. » Selon vous, qui est le professeur Josef Schuster ?
Josef Schuster est une énigme du Sphinx qui, par son acte, a posé aux vivants, aux spectateurs et aux lecteurs une question à laquelle il n’y a pas de réponse mais à laquelle il faut répondre à tout prix. Josef Schuster, avec son énigme, devient une sorte de fantôme. Il devient un dibbouk ! Cité sans cesse, il continue d’habiter obstinément l’âme de son frère, de ses filles, de sa gouvernante Madame Zittel… Il survit comme un psychodrame récurrent et nécessaire. Le motif de départ semble être le testament : le testament du suicidé qui aspire à l’autodestruction. Une « extinction », encore une fois. Tout faire disparaître, l’œuvre de sa vie, le rituel funéraire, la mémoire : c’est impossible. Cela fait naître, justement, un revers, l’autre face de l’extinction : une existence perpétuelle entièrement dévouée à la nécessité de résoudre l’énigme du Sphinx, le refus de l’obscurcissement de la vérité qu’entraîne la haine qui règne partout. Cette haine s’infiltre dans nos âmes, nous ne sommes plus capables de nous en protéger. La mort de Josef initie dans les âmes des vivants un travail alchimique.
Parlez-nous de votre scénographie, de cette boîte qui enserre les comédiens comme dans un tableau, du traitement des couleurs.
Place des Héros de Bernhard, ce sont deux espaces – les pièces abandonnées d’un vieil immeuble (lors d’un déménagement) qui donne sur la Place des Héros, et le parc devant le Burghteater – qui se fondent en un même espace archétypal – l’entrelacement de la vie d’un être humain et d’un fétiche historique. J’ai tenté de retrouver cela à Vilnius, qui tout doucement est devenue dans nos recherches l’endroit de cet entrelacement.
Dans cette pièce, hantée par la mort, l’avenir semble condamné. Place des Héros est-elle une pièce nihiliste comme on le dit parfois ?
Bernhard n’a jamais été pour moi un auteur nihiliste, bien qu’on le considère facilement comme tel. En effet, la radicalité de sa critique semble ne pas laisser de place. Ce n’est pas grave. D’un autre côté, il y a la lutte acharnée d’un individu. Même le suicide du protagoniste participe de cette lutte. L’énergie de la contestation du narrateur, l’envolée rageuse du monologue jusqu’aux frontières de l’absurde, la traversée du mur de l’absurde et la lévitation dans l’espace de l’absurde, là où surgit le rire…! Non, non, c’est tout sauf du nihilisme.(…)
Vous dites : « Nos âmes ne sont plus utiles à personne… / Parce qu’en fait le rôle et le sens de nos consciences et de nos vérités / Sont probablement en train de disparaître. / Nos vérités ne sont plus utiles à personne. / Peut-être que le rôle de nos visions créatrices est de plus en plus restreint / Dans ce que produit le carnaval fou furieux / Des réalités politiques. » De ce point de vue vous êtes proche de Thomas Bernhard pour qui l’esprit a été réduit à néant par le provincialisme qui a vidé la culture de toute substance. Pour vous, quel peut-être le rôle d’un artiste dans la société d’aujourd’hui ?
En effet, dans la situation qui a émergé et s’étend actuellement en Pologne, les outils de pensée et la détermination de Bernhard deviennent crucialement actuels. Le chaos des critères de vérité et la dévaluation de tout dialogue humain dans notre espace public actuel dévaluent aussi le rôle qu’occupait l’artiste, celui de provocateur d’intuitions et de pensées. C’est donc soit la mort de l’artiste, soit encore une énigme du Sphinx qui pousse l’artiste à exister autrement. Une croisée des chemins…
Propos recueillis par Francis Cossu
Traduits du polonais par Agnieszka Zgieb
A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
Place des héros de Thomas Bernhard, mis en scène par Krystian Lupa
du Vendredi 22 mars 2019 au Dimanche 31 mars 2019
Les Gémeaux
49 avenue Georges Clémenceau, 92330 Sceaux
à 20h45, dimanche à 17h, relâche lundi. Tél :01 46 61 36 67. Spectacle en lituanien surtitré en français, vue lors du Festival d’Avignon 2016. Durée : 4h, entractes inclus.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2019 6:29 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde 1er Mars 2019
La comédienne, connue pour ses rôles à la télévision, irradie sur scène dans « Girls and Boys », de Dennis Kelly.
Le jour où Constance Dollé a quitté sur un coup de tête le lycée Fénelon, à Paris, où elle était en khâgne, elle a franchi sans le savoir le premier pas qui devait la conduire à stupéfier les spectateurs de Girls and Boys, qu’elle joue au Théâtre du Petit-Saint-Martin. Certes, elle n’a pas renoncé à la philosophie – elle a obtenu une maîtrise à la faculté –, mais elle n’a pas suivi la voie de son oncle, le philosophe Jean-Paul Dollé.
Le théâtre, qu’elle a commencé d’apprendre pour se distraire d’un chagrin, a peu à peu pris toute la place. Et il s’est définitivement imposé quand Constance Dollé a joué pour la première fois devant un public : « C’était au conservatoire du 10e arrondissement, se souvient-elle, il y avait des professeurs extraordinaires et, parmi les élèves, Vincent Macaigne, Clémence Poésy… Après, j’ai étudié au Cours Florent. »
Le soleil baigne la maison du 20e arrondissement où Constance Dollé vit avec sa famille. Elle a 45 ans et il se pourrait bien que Girls and Boys marque un tournant dans sa carrière. Non qu’elle soit inconnue, loin de là. Les amateurs de séries télévisées savent que c’est elle, Suzanne, la résistante communiste d’Un village français. Elle aussi, Sandrine, la mère des Revenants. Elle encore, Laurence, la journaliste de L’Affaire Villemin, ou Aurore de Baron noir, la militante déçue du Parti socialiste qui rejoint un Mélenchon joué par François Morel…
Constance Dollé, comédienne : « On me distribue souvent dans des personnages de femmes qui n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent »
« On me distribue souvent dans des personnages de femmes qui n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent, remarque Constance Dollé. Cela me va. J’ai grandi dans une famille très politisée, à gauche ou à l’extrême gauche, avec un vrai goût pour le débat public, le brassage d’idées. D’une certaine manière, un rôle ne m’intéresse pas s’il n’a pas quelque chose de politique. »
On comprend que la comédienne ait eu envie de créer en France Girls and Boys. Dans cette pièce, le Britannique Dennis Kelly (49 ans) aborde de nombreux sujets, dont la violence sociale, l’emprise des images, de l’inné et de l’acquis. Mais il le fait par la bande, à travers un monologue : une femme raconte comment elle a rencontré son mari dans la file d’attente d’un aéroport. Comment ils ont construit leur histoire, et elle, sa réussite professionnelle. Comment deux enfants leur sont nés. Et ce, jusqu’au « comment » le plus horrible qui soit pour la femme qui doit lui survivre : le meurtre des enfants par leur père, après qu’elle s’est séparée de lui.
Virtuosité
Et c’est là que Constance Dollé donne la mesure de son talent. Elle qui se voit « comme ces jongleurs qui font tourner en permanence leurs assiettes en évitant qu’elles s’arrêtent », jongle avec une virtuosité qui ne laisse de côté aucun registre. Quand on entre dans la salle du Théâtre du Petit-Saint-Martin, on la découvre attablée en compagnie de quatre spectateurs, ce qui rajoute encore à la difficulté de son interprétation, finement mise en scène par Mélanie Leray. Telles les comédiennes britanniques qu’elle aime, Kate Winslet, Olivia Colman, Emma Thompson…, elle s’abandonne à son personnage avec humanité, sans calcul. « Le théâtre, c’est la barre au sol qui permet aux comédiens de “muscler” leur métier », affirme Constance Dollé, qui a commencé par la scène avant de se consacrer à la télévision et au cinéma – elle a tourné en particulier dans Les Témoins, d’André Techiné (2007).
Dans les dix dernières années, cette comédienne qu’on ne reconnaît pas d’emblée, d’un rôle à l’autre, a renoué avec le théâtre. En restant toujours dans le circuit du privé, où elle vient de jouer Moi, moi, et François B., de Clément Gayet, avec François Berléand. Constance Dollé ne regrette pas un instant, mais elle avoue être « triste de ne pas jouer des auteurs comme Tchekhov ou Shakespeare, qui ne sont pas présentés dans le théâtre privé ». Qui sait si la roue ne va pas tourner ?
Girls and Boys, de Dennis Kelly. Mise en scène : Mélanie Leray. Avec Constance Dollé. Théâtre du Petit-Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, Paris 10e. Tél. : 01-42-08-00-32. Du mardi au vendredi à 19 heures ou à 21 heures, selon les semaines. Durée : 1 h 30.
Brigitte Salino
Constance Dollé dans « Girls and Boys », dans une mise en scène de Mélanie Leray, au Théâtre du Petit-Saint-Martin (Paris 10e). PASCAL VICTOR / ARTCOMPRESS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2019 10:05 AM
|
Par Jean-Adrien Truchassou dans Le Populaire du Centre - 21.02.2019
Le festival « Nouvelles Zébrures », qui se tiendra du 13 au 22 mars en grande partie à Limoges, s’inscrit dans le nouveau projet global des « Francophonies en Limousin ».
Nommé en juillet 2018 mais officiellement à la tête des « Francophonies en Limousin » depuis le 1er janvier dernier, Hassane Kassi Kouyaté n’a jamais caché avoir en tête de nouvelles et nombreuses perspectives. Dans les cartons depuis quelque temps déjà, un changement de nom devrait ainsi intervenir dans les prochains mois comme l’a confirmé le directeur du festival lors d’un point presse, ce mercredi.
« Les Francophonies en Limousin s’appelleront “Les Francophonies des écritures à la scène”, a-t-il confié. Elles auront désormais deux festivals par an. Un au printemps, « Nouvelles Zébrures » – mais nous sommes en train de travailler sur un nouveau nom également – autour des écritures et lectures francophones. Le deuxième, interviendra à la même période que les « Francophonies », à l’automne, et aura pour thème les arts du spectacle francophones. »
Interventions dans le milieu scolaire
Dans cette « année zéro » comme la qualifie Hassane Kassi Kouyaté, « Les Nouvelles Zébrures » auront donc la charge d’ouvrir, du 13 au 22 mars, ce nouveau chapitre pour les « Francophonies ». Malgré tout, leur philosophie, qui prône l’accès pour tous à la littérature et l’écriture, n’a pas changé.
« L’écriture est pour tout le monde et à tout le monde, selon le directeur des “Francophonies”. C’est un lieu d’évasion et de liberté extraordinaire et j’ai envie que le maximum de personnes y ait accès. »
Le nouveau directeur des Francophonies à Limoges, Hassane Kassi Kouyaté, dévoile son projet
Ainsi, en plus de la tente berbère, plantée dans le jardin de la Maison des Auteurs à Limoges, qui aura des airs d’épicentre de ces « Nouvelles Zébrures », le festival se veut encore une fois itinérant avec des interventions dans le milieu scolaire mais aussi des points d’entrée au niveau national et international (Bruxelles). Les premières bases d’un nouveau projet qui veut faire de Limoges « la place mondiale des francophonies. »
Le programme des « Nouvelles Zébrures »...
Mercredi 13 mars. A 16 heures. Partir (?) #1 - Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore. Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.
Vendredi 15 mars. A 20 heures. Stand-up poétique de David Paquet. Librairie Les Gens qui doutent à Limoges.
Samedi 16 mars. A 10 h 30. Table ronde sur le thème « La révolution numérique bouleverse-t-elle la création littéraire ? ». Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.
Dimanche 17 mars. De 9 h 30 à 17 h 30. Partir (?) #2 - Un dimanche dans les pas du zèbre. Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.
Mercredi 20 mars. A 14 h 30. Partir (?) #3 - Le pas d’après / Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas (Lectures). Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.
Vendredi 22 mars. A 18 h 30. La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma (Lecture). Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.
Jean-Adrien Truchassou Légende photo : Les auteurs à l’honneur, de haut en bas, de gauche à droite : Edouard Elvis Bvouma, Cameroun ; Sonia Ristic, Croatie-France (photo Bruno Klein/Divergence), David Angevin, France ; Dany Boudrault, Canada-Québec (photo Julie Artacho) ; David Paquet, Canada-Québec (photo Christophe Péan) ; Jérôme Richer, Suisse (photo Christophe Péan).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2019 5:32 PM
|
Publié par Courrier International d'après un article en allemand de la Süddeutsche Zeitung 19.02.2019
Une immersion dans la Russie stalinienne était promise aux visiteurs. Le projet DAU, qui a pris fin à Paris, le 17 février, a finalement viré à la débâcle. Ce qui n’étonne guère le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, très critique envers ce genre d’installation.
Un flop, du début à la fin. Le 17 février, l’expérience DAU a fermé boutique à Paris. Inaugurée dans le désordre et la désorganisation trois semaines plus tôt, cette installation immersive déclinée entre les Théâtres du Châtelet et de la Ville et le Centre Pompidou n’a pas convaincu, rapporte la Süddeutsche Zeitung. Sans doute le projet était-il vérolé depuis le début, commente le quotidien allemand. Il rappelle les débats et polémiques qui ont entouré la projection des films Dau, tournés entre 2009 et 2011 par le cinéaste russe Ilya Khrjanovski : “Les sept cents heures de rushs accumulées sur un institut de recherche soviétique [reconstitué pour l’occasion], dans lequel les acteurs ont été obligés de vivre à l’année comme des animaux de laboratoire, soumis à des expérimentations alcoolisées, à du harcèlement sexuel et à des violences, sont déjà assez problématiques.”
Exiger la soumission du spectateur
Que ces films servent ensuite de support à une pseudo-installation artistique, présentée comme une plongée dans la Russie stalinienne, et que le visiteur ne puisse y accéder qu’après avoir répondu à un questionnaire intime, ne fait qu’ajouter au malaise, poursuit le journal. À l’heure de dresser le bilan, il se livre à une critique radicale de l’entreprise : “Il faudrait peut-être prendre le temps d’examiner brièvement si le vrai problème ne trouve pas racine dans la promesse d’une ‘expérience immersive’”, écrit la Süddeutsche Zeitung.
Soulignant que la multiplication d’installations tablant sur la complicité du spectateur plutôt que sur sa capacité de discernement frise aujourd’hui “l’épidémie”, il assène :
La débâcle de DAU offre une bonne occasion de mettre en question une mode actuelle dans le monde des arts, qui semble d’autant plus discutable qu’elle est conçue pour ne pas être mise en question. Cela passe par des injonctions – il faut ‘s’ouvrir à’, ‘lâcher prise’ –, tout un jargon bavard qui, dans la pratique, devient un euphémisme pour réclamer un assentiment non critique ou, pour le dire autrement, exiger la soumission du spectateur.”
Une forme d’irresponsabilité assumée
DAU n’a à vrai dire pas inventé grand-chose. La même forme d’“anti-intellectualisme enthousiaste” a déjà donné naissance, aux États-Unis, à des expériences immersives taillées pour Instagram et Snapchat, comme le “Museum of ice cream”, un “musée” dédié à la crème glacée (dont nous vous avions parlé ici).
“Ce qui est vraiment surprenant, et aussi un peu douteux, c’est que cela puisse être vendu comme une expérience libératrice”,
enchaîne la Süddeutsche Zeitung, qui rappelle que, depuis des siècles, l’interprétation artistique a reposé sur la confrontation d’un sujet pensant à une œuvre. Or “les dernières fois que la raison et la critique ont été si violemment repoussées au nom de l’expérience, de l’émotion, de l’affirmation et de la participation jubilatoire des masses, le régime culturel de l’Allemagne était celui d’une dictature”.
Qualifiant l’immersion proposée de “piège idéologique”, le quotidien bavarois conclut son analyse en ces termes :
Il serait peut-être plus pertinent que l’art nous entraîne à développer une forme de conscience critique et distanciée au lieu de nous inciter à nous en dispenser. Peut-être l’immersion est-elle exactement ce qu’il ne faut pas faire. Et peut-être – ou plutôt certainement – est-ce une forme d’irresponsabilité assumée que de payer un billet d’entrée [pour ce genre d’installation], au lieu de réclamer le rôle d’acteur que nous devrions tous revendiquer.”
SOURCE
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG Munich www.sueddeutsche.de Créé en 1945, le “journal du sud de l’Allemagne” compte parmi les quotidiens suprarégionaux de référence du pays. De tendance libérale, il est un grand défenseur des valeurs démocratiques et de l’État de droit.[...]Lire la suite

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 8:27 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan Quand Yukio Ninagawa a mis en scène une adaptation fidèle du roman d’Haruki Murakami « Kafka sur le rivage », il ne savait pas que cela serait son dernier spectacle. Nous, on sait. De là provient peut-être la douceur nostalgique de son spectacle, peut-être aussi de l’auteur qui s’y connaît en vague à l’âme.
Tout glisse et s’émonde dans le monde, japonissime, des romans et nouvelles d’Haruki Murakami. Le rêve s’y apparente au réel et inversement, les morts cognent à la porte des vivants qui ne s’en étonnent pas et s’excusent de ne pas mieux les recevoir, il n’est pas rare qu’un fantôme s’assoie dans votre salon pour prendre le thé avec vous et se soucie de votre air fatigué mais nullement éberlué.
Une réminiscence sans fin
Les livres de Murakami aiment bien les intempéries, en particulier la pluie, car tout s’y mêle, à commencer par les larmes, comme cela arrive au visage d’un adolescent devenu homme en peu de temps, à la six-cent-trente-huitième et dernière page de Kafka sur le rivage (10/18, traduit du japonais par la précieuse Corinne Atlan). Dans Au sud de la frontière à l’ouest du soleil (10/18, même traductrice), c’est toujours un soir de pluie que Hajiman, le narrateur, voit arriver dans son bar Shimamoto-san, son amour d’enfance, perdue de vue pendant longtemps.
Le temps chez Murakami fait tout à l’affaire. Il n’en finit pas de s’étendre, de prendre ses aises, de s’enrouler sur lui-même à la recherche d’un point aveugle et d’enquiquiner le présent par tout ce qu’il charrie de remords, de doutes, d’occasions manquées, d’enfances trouées, de mystères non résolus.
« Ma vie s’est arrêtée à vingt ans. La suite n’a été que réminiscences sans fin, comme un long corridor tortueux plongé dans la pénombre, et qui ne mène nulle part. Pourtant, il fallait que je continue à vivre. Il fallait que j’accueille l’une après l’autre ces journées vides, que je laisse le temps se dévider en vain », dit la belle Mademoiselle Saeki qui a l’âge d’être la mère de Kafka Tamura qui, lui, vient de s’enfuir de chez lui à l’âge de quinze ans.
Ce sont là deux des personnages principaux de Kafka sur le rivage. Le troisième personnage, c’est Nakata, un monsieur sans âge, sans mémoire depuis un drame qui s’est déroulé alors qu’il était écolier, ne sachant ni lire ni écrire, mais parlant le langage des chats et dialoguant avec eux, vivant dans le présent mais pressentant les intempéries, y compris des pluies de poissons ou de sangsues.
« Je coucherai avec ma mère et ma sœur »
Tout le roman est construit sur une alternance des chapitres écrits à la première personne par Kafka Tamura et d’autres écrits à la troisième personne suivant le périple de Nakata. Les deux itinéraires finiront par se croiser dans la banlieue de Takamatsu, région du Shikoku, à la bibliothèque Komura : « on dirait un endroit oublié du temps ou un endroit qui retient son souffle pour ne pas être découvert », écrit Kafka Tamura sous la dictée de Murakami.
Comme dit Kafka à Sakura, la première et jeune personne qu’il rencontre sur la route qui le conduit à Takamatsu où il a rendez-vous avec son destin : « les rencontres de hasard sont importantes pour le bien-être des gens ». En la matière, les romans de Murakami n’ont de leçon à recevoir de personne, ils en ont même à revendre. Sakura est peut-être la sœur de Kafka Tamura et Mlle Saeki sa mère. Le « peut-être », c’est l’inépuisable ressac de l’écriture de l’écrivain japonais. Kafka fuit la maison paternelle (sa mère est partie avec sa sœur quand il avait quatre ans et depuis n’a jamais donné de nouvelles) en raison d’une « prédiction » dont il faudra attendre près de trois cents pages pour connaître la teneur œdipienne : « Un jour, je tuerai mon père de mes mains, et je coucherai avec ma mère et ma sœur. »
Pas simple d’adapter au théâtre ce dixième et foisonnant roman d’Haruki Murakami publié en 2002 et traduit en français trois ans plus tard. Le metteur en scène Yukio Ninagawa qui avait affronté bien des tragédies grecques et nombre de pièces de Shakespeare, était tout désigné. Kafka sur le rivage, présenté avant Paris au Barbacane de Londres et au Lincoln Center de New York, devait être son dernier spectacle créé en 2012 au Sainokuni Saitama arts theater. Ninagawa est décédé le 12 mai 2016 à l’âge de 80 ans sans pouvoir réaliser son rêve ; monter tout Shakespeare sous forme de série. Son spectacle clôt en beauté la manifestation Japonismes 2018.
Un ballet de cages de verre
Kafka sur le rivage est un spectacle à la hauteur du roman : ample et fort d’une impressionnante scénographie mouvante (Tsukasa Nakagoshi) magnifiquement éclairée (Motoi Hattori), une scénographie qui dans son mouvement sans cesse recomposé épouse le rythme de l’écriture de Murakami et suit fidèlement le roman, trop fidèlement parfois. Hélas aussi, en éludant ou en minorant les nombreuses scènes d’amour qui sont comme les points d’orgue des rencontres décisives du roman ; scènes qui sont, il est vrai, guère adaptables.
Tout un ballet de cages de verres mues par des hommes en noir comme dans le bunraku figurent les lieux du roman : du bureau de la bibliothèque au poste de police où Nakata va expliquer qu’il a tué un homme nommé Johnny Walker (!), du bus au café, de la chambre de Sakura à la rue. La nature, très présente dans le roman, occupe plusieurs cages de verre où poussent des arbres, des cages qui ne sont pas toujours utilisées pour le jeu mais viennent parfaire l’ambiance. Tout s’enchaîne en suivant le cheminement du roman, certaines scènes ne font que passer, d’autres s’attardent. Le charme vient de l’accord entre des paysages mouvants et le jeu jamais appuyé des acteurs, tout en discrètes volutes qui nous embarquent dans cette histoire qui semble ne jamais vouloir finir, où l’on va de surprise en surprise, de romance en romance, de certitude en incertitudes. « Il se passe beaucoup de choses autour de moi, dit Kafka Tamura. Certaines que j’ai choisies, d’autres non. Mais je ne perçois plus très bien la différence entre les deux. C’est-à-dire : même ce que je crois choisir de ma propre volonté me semble avoir été déterminé par avance. »
« Kafka sur le rivage » est le titre d’une chanson que l’on entend dès le début du spectacle mais c’est bien plus tard (le spectacle dure près de trois heures) que l’on fera le rapport entre cette mélodie et la jeunesse de Mlle Saeki, rôle interprété avec une grâce infinie par Shinobu Terajima. L’incroyable Nakata est, lui, interprété avec une confondante candeur par le désarmant Katsumi Kiba. C’est un jeune acteur, Nino Furuhata, qui tient le rôle de Kafka Tamura en sachant éviter tous les poncifs du jeune premier, il est bien secondé par Hayato Kakizawa, son double bienveillant surnommé le corbeau. Pas un roman de Murakami sans qu’un corbeau, tôt ou tard vienne se poser ici ou là pour voir ce qui s’y passe.
Au Théâtre national de la Colline, 19h30, jusqu’au 23 février. Il se murmure que Haruki Murakami assistera samedi à la dernière représentation mais, chut, ne le dites pas, c’est un secret.
Scène de "Kafka sur le rivage © Takahiro Watanabe HoriPro Inc

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 4:31 PM
|
"Une femme, sur le point d'être expulsée, rêve d’un séisme... la catastrophe advient, rêve ou réalité !?"
Un séisme..le chaos• Crédits : Stefano Montesi - Getty
Des lions gigantesques ouvrent la gueule, A travers les quartiers, Paradent dans les rues
Avalent des humains qui s'attardent dans les zones
N'est-ce pas fabuleux ?
Le monde qui s'effondre vers autre chose, Comme un gigantesque animal qui s'ébroue" S.G.
Une femme, sur le point d'être expulsée, rêve d’un séisme… Ainsi le chaos lui permettrait-il de se reconstruire un autre avenir, avec Mickel, son fils de 8 ans et demi. Or, la catastrophe advient. Le rêve est-il si puissant qu'il a recouvert la réalité ? Tout s’effondre. Dans la ville d’Eskandar, la nature reprend ses droits. Un zoo est laissé à l’abandon, des fauves s’échappent et attaquent celles et ceux qui n’ont pas pu ou voulu partir.
Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques qu’il porte régulièrement à la scène en compagnie de musiciens. Cinq de ses pièces ont été diffusées sur France Culture et la plupart font l’objet de mises en scène en France et à l’étranger. Il est artiste associé au Théâtre du Préau (Centre Dramatique de Vire), auteur associé aux Scènes du Jura (Scène nationale) et enseigne au département Écrivains dramaturges de l’ENSATT.
Réalisation : Laure Egoroff Conseillère littéraire : Céline Geoffroy Enregistré à l’ENSATT entre le 12 et le 16 décembre 2016
Avec les élèves comédiens de la 76ème promotion de l’Ensatt :
Charlotte Ngandeu, Jules Robin, Sacha Ribeiro, Matthieu Astre, Fabien Rasplus, Marie Menechi, Arthur Thibault-Starzik, Aude Rouanet, Anne Vigouroux, Maïté Lottin, Pierre-Emmanuel Brault, Alice Vannier
Création sonore : Antoine Richard avec les élèves créateurs sonores (de la 76ème promotion de l’Ensatt) : Anouk Audart, Claire Mahieux , Coline Menard , Margaux Burel , Robert Benz Prise de son, montage, mixage : Benjamin Perru, Emilie Couët Assistante à la réalisation : Laure-Hélène Planchet
Ce texte est issu du bureau de Lecture de France Culture et depuis il est paru en janvier 2017 aux Editions Espaces 34.
BIBLIOGRAPHIE
La bataille d'Eskandar
Samuel Gallet
Espaces 34, 2017

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 1:53 PM
|
« Sur la voie royale », de l’auteure autrichienne, mise en scène par Falk Richter, est présentée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Par Brigitte Salino dans le Monde Publié le 22.02.2019
Comme d’habitude, Elfriede Jelinek n’a pas attendu : dès l’annonce de l’élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016, elle s’est mise à écrire une pièce, Am Königsberg (Sur la voie royale), présentée jusqu’au dimanche 24 février à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, dans une mise en scène de Falk Richter, créée en 2018 à Hambourg. L’écrivaine autrichienne, Prix Nobel de littérature en 2004, vit recluse mais totalement connectée aux nouvelles du monde, auxquelles elle réagit vite, souvent avec une acuité saisissante, parfois avec moins de bonheur.
Seuls comptent les mots qui jaillissent comme des coups de gueule ou de butoir, des attaques répétées contre tout ce qui ne va pas
C’est le cas pour Sur la voie royale : même si Donald Trump n’est jamais appelé par son nom, mais sous celui de « roi » d’une ville qui pourrait être la Thèbes de l’Œdipe de Sophocle, c’est bien le président américain qui nourrit la colère d’Elfriede Jelinek, mais le président tel qu’on le percevait à son élection. Depuis, les actions qu’il a menées ont étoffé son portrait, et rendu la façon de l’aborder plus complexe que ce qu’on entend dans la pièce.
Cela dit, on retrouve dans Sur la voie royale la manière unique qu’a l’auteure d’écrire du théâtre : elle n’annonce pas de personnages et ne se préoccupe pas de l’action. Seuls comptent les mots qui jaillissent comme des coups de gueule ou de butoir, des attaques répétées contre tout ce qui ne va pas – en l’occurrence, la liste est longue : les gens jetés hors de leurs maisons à cause de la crise des subprimes, les migrants repoussés derrière des murs, le globe méconnaissable, la toile et ses pièges, les dégâts de la globalisation, la montée des populismes… Soit la violence du monde, qu’Elfriede Jelinek dépèce comme elle hacherait menu une viande. Rageuse, insolente, imprécatrice, son écriture est remontée par un ressort inaltérable : l’humour, qui va jusqu’à l’auto-dérision, l’auteure s’apostrophant elle-même.
Ilse Ritter, un trésor
Falk Richter rend hommage à cette écriture en la travaillant comme un corps qui rend dingue, – de cette dinguerie que l’on ressent face à ce qui nous dépasse. Au « comment en sommes-nous arrivés là ? » d’Elfriede Jelinek, il répond par une mise en scène où les styles les plus différents se catapultent, où les images se chevauchent, où les écrans se superposent. Cette sarabande ne laisse pas l’esprit du spectateur en repos : pris dans un tourbillon, il se retrouve dans la situation d’un Oedipe aveuglé par la violence contemporaine. « Nous sommes tous empêtrés dans le même destin sans le savoir », clame Elfriede Jelinek à travers les comédiens qui, eux, ne sont pas empêtrés dans leur jeu, loin de là.
Ils sont huit, et, parmi eux, il y a un trésor : Ilse Ritter. C’est pour elle, Kristen Dene et Gert Voss que Thomas Bernhard a écrit une pièce qu’il a appelée Ritter, Dene und Voss (Ritter, Dene et Voss), parce qu’il voulait honorer ces comédiens qu’il aimait. Connue en France sous le titre de Déjeuner chez Wittgenstein, cette pièce a été créée en Autriche en 1986. Ilse Ritter avait 42 ans. Aujourd’hui, elle en a 75, et c’est elle qui introduit et clôt Sur la voie royale. Sa voix douce impose le silence autour de chaque mot qu’elle énonce. Sa présence fragile renferme toutes les forces de vie. Il faut la voir, l’entendre. Aller à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, ne serait-ce que pour elle.
Am Königsweg (Sur la voie royale), d’Elfriede Jelinek. Mise en scène : Falk Richter. Avec Idil Baydar, Benny Claessens, Matti Krause, Anne Müller, Ilse Ritter, Tilman Strauss, Julia Wieninger et Frank Willens. Odéon-Théâtre de l’Europe, place de l’Odéon, Paris 6e. Tél. : 01-44-85-40-40. De 6 € à 40 €. A 19 h 30. Durée : 3 h 30. En allemand surtitré. Jusqu’au 24 février.
Brigitte Salino
Légende photo : « Am Königsweg » (« Sur la voie royale »), d’Elfriede Jelinek, mise en scène par Falk Richter à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. DECLAIR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 11:17 AM
|
Un Atelier de création de Mark Blezinger et Gaëlle Maidon
Réalisation Véronique Lamendour
Mixage Eric Boisset
Ecoutez l'émission en ligne sur le site de France Culture (1h)
« Vous êtes comme des étoiles qui se consument, des comètes…* »
Klaus Michael Grüber, paroles de répétitions pour Le Roi Lear
Klaus Michael Grüber (1941-2008) fut un metteur en scène européen majeur de théâtre et d’opéra. Une heure d’émission radio ne suffirait pas à raconter scrupuleusement cette grande traversée créative d’une vie, qui a tant inspiré ceux qui, de près ou de loin, ont croisé cet artiste unique, si grand et si modeste. Mais dans l’intensité d’une seule heure, nous tenons qu’il est possible de faire entendre et de faire résonner sa présence en une épiphanie sonore, en proposant un libre récit de son voyage dans le théâtre, récit prenant appui sur une trame narratrice à deux voix, celles des réalisateurs, se répondant l’une l’autre, échanges de paroles, appels aux évocations — et invocations… laissant libre cours aux associations d’idées et de souvenirs.
Nous évoquerons le mouvement de Klaus Michael Grüber, de l’atelier à la scène, son travail avec ceux qui furent ses plus proches collaborateurs, le travail de répétition avec les comédiens, connus et moins connus, nous évoquerons le silence de Grüber dans le temps de ses créations, la parole, le verbe poétique de Grüber en ses paroles de répétitions: « Oublie donc Shakespeare, tu le trouves par toi-même. Chez les grands écrivains, les grands artistes, on a souvent le sentiment de trouver les choses par soi-même… » (K.M.G., Le Roi Lear ).
Les auteurs Mark Blezinger et Gaëlle Maidon :
Mark Blezinger, photographe et réalisateur, fut assistant à la mise en scène auprès de Klaus Michael Grüber de 1985 à 1990. Il nota et conserva les paroles du metteur en scène lors des répétitions et a réalisé par la suite de nombreux entretiens avec des comédiens et des collaborateurs artistiques. Ces documents sont en partie édités dans l’ouvrage Klaus Michael Grüber… il faut que le théâtre passe à travers les larmes…
Gaëlle Maidon, architecte et docteur en études théâtrales, a « découvert » l’existence de Klaus Michael Grüber à travers la lecture d’un article de Bernard Dort « Le Mystère Grüber », qui l’inspira dans l’écriture de plusieurs textes et de sa thèse intitulée Le dépassement de la mise en scène et la question de la théâtralité dans l’itinéraire de Klaus Michael Grüber.
Précisions sur les documentaires et archives :
Répétition d’Hypérion de Maderna dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber : extrait du Magazine International de l’Art Lyrique, « Opéra n°18 », France 3, 1992 - émission de Claire Alby Newman réalisée par Gérald Caillat, Twincom Productions
> Bérénice dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber. Captation réalisée par Bernard Sobel, production Sodaperaga/La Sept, 1987
> La Mort de Danton dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber. Captation réalisée par Guy Seligman, production Sodaperaga/La Sept, 1990
Extrait des répétitions à la table avec Marcel Bozonnet et Klaus Michael Grüber pour Bérénice , enregistrement personnel réalisé par Leonidas Strapatsakis, Collection Comédie-Française, 1984
> Winterreise im Olympiastadion , film réalisé par Klaus Michael Grüber, Schaubühne de Berlin, 1977.
Klaus Michael Gruber en répétitions
Avec les voix, dans l’ordre de leur première apparition :
De Klaus Michael Grüber, Juliette Binoche et Denis Lavant dans les Amants du Pont-Neuf ,
De Michael Koenig et Bruno Ganz dans les Bacchantes ,
D’Angela Winkler dans Iphigénie,
Ellen Hammer, sa collaboratrice artistique et les peintres et décorateurs Antonio Recalcati, Gilles Aillaud et Eduardo Arroyo dans l’atelier,
De Willem Menne dans Winterreise im Olympiastadion
De Dominique Reymond dans la lecture de ses Journaux de répétitions avec Klaus Michael Grüber et Antoine Vitez ,
Des comédiens Jean Benguigui, André Wilms, Angela Winkler et Jeanne Moreau,
De Dominique Reymond, André Marcon et André Wilms dans la Mort de Danton ,
De Ludmila Mikael, Marcel Bozonnet et Richard Fontana dans Bérénice ,
De Léonidas Strapatsakis et Bernard Michel pour les répétitions et les décors de Bérénice ,
De Jean-Pierre Vincent, ancien administrateur de la Comédie française,
Des critiques de l’émission du Masque et la Plume du 1er juin 1975,
De Jean-Pierre Thibaudat pour la lecture de son article « Klaus Michael Grüber est grand » enregistré au TNS en 2011
Et enfin les voix des élèves du conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris lors des répétitions d’A propos des Géants de la montagne de Luigi Pirandello en 1998.
Pour les extraits sonores des films documentaires, captations et archives de travail, nos plus vifs remerciements vont à Christophe Rüter Film Produktion, à Claire Alby Newman et Gérald Caillat, à Bernard Sobel, Guy Seligman et Sodaperaga, à Bernard Michel, à Léonidas Strapatsakis et aux archives de la Collection Comédie-Française.
Merci aux voix qui ont traduit : Jean François Neollier, Véronique Lamendour, Gaelle Maidon et Mark Blezinger.
Les notes de répétitions, dans la traduction de Jean Torrent, sont empruntées a l’ouvrage Klaus Michael Grüber ...Il faut que le théâtre passe à travers les larmes..., portrait proposé par Georges Banu et Mark Blezinger , édité par les Editions du Regard, l’Académie expérimentale des Théâtres et le Festival d’Automne en 1993
La thèse de Gaëlle Maidon aura initié une série d’enregistrements avec les plus proches collaborateurs de Klaus Michael Grüber afin de tenter de constituer une mémoire de ce que fut l’atelier Grüber. Cette émission en est une trace.
Archives INA : Yves Gaillard
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 8, 2019 8:17 PM
|
Son spectacle « May B » est à l’affiche à l’Espace Cardin, et un film réalisé par son fils retrace la carrière de la chorégraphe.
Par Rosita Boisseau et Clarisse Fabre dans Le Monde Publié le 07 mars 2019
La peau ressemble à une croûte, le nez pend, l’oreille se dilate en chou-fleur, le dos est brisé, les épaules de travers. Tout sauf un corps de danseur et pourtant ! Cette silhouette humaine ravagée, qui patine sa vie à mini-saccades, est devenue le porte-manteau d’un best-seller de la danse contemporaine, May B, chorégraphié en 1981 par Maguy Marin, à l’affiche jusqu’au 12 mars, de l’Espace Cardin, à Paris.
Cette pièce crue, avec sa cohorte de dépenaillés qui se bouffent le nez, tend un miroir au tragique violent de la condition humaine
Paradoxe ? Plutôt deux fois qu’une. Lors de la création de ce spectacle, qui est le point de départ du documentaire Maguy Marin, l’urgence d’agir, réalisé par son fils, David Mambouch, en salle le 6 mars, le succès ne fut pas tout de suite au rendez-vous. Comme le rappelle régulièrement la chorégraphe, cette bouffée de danse-théâtre au parfum existentiel bien âcre soufflée par Samuel Beckett (1906-1989) était aux antipodes des codes spectaculaires profilés du moment et ne commença à plaire au public qu’après trois ans de représentations.
Le choc esthétique et émotionnel de May B, qui semble avoir été conçue il y a seulement quelques semaines tant sa vigueur féroce reste inentamée, frappe autant l’imagination qu’elle serre le ventre. Pour les spectateurs qui l’ont déjà vue, comme pour ceux qui la découvrent, cette pièce crue, avec sa cohorte de dépenaillés qui se bouffent le nez, tend un miroir au tragique violent de la condition humaine. Sur des musiques du carnaval de Binche et des lieder de Schubert, un refrain lancinant se faufile : « C’est fini, ça va finir. »
Jusqu’au bout du hurlement
Dans le film L’Urgence d’agir, de David Mambouch, 37 ans, dont Maguy Marin était enceinte lorsqu’elle créa la pièce, la chorégraphe déclare en évoquant la fin des années 1970 : « Il s’agissait de détourner la danse du seul endroit où elle allait, la reconnaissance des corps beaux, sveltes, sportifs, explique-t-elle. On s’était déjà débarrassé de nos corps de danseurs… » Et donc… May B, avec ses maigres, ses plus gros, ses vieux, ses jeunes qui déflagrent jusqu’au bout du hurlement.
May B, dont le titre rappelle le prénom de la mère de Beckett, a vécu mille vies. Le spectacle, qui additionne 750 représentations dans 46 pays, a vu défiler quatre-vingt-douze danseurs. Parmi eux, Alice Béneteaud, la fille de l’une des interprètes Cathy Polo, et les enfants de Maguy Marin, David Mambouch et Louise Mariotte. Parallèlement aux tournées de sa compagnie, aujourd’hui basée à Ramdam, à Sainte-Foy-lès-Lyon, Maguy Marin a accepté d’en confier des extraits à des non-professionnels par le dispositif Danse en amateur et répertoire. En 2018, elle a aussi transmis la totalité du spectacle à douze élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ainsi qu’à dix jeunes de l’école de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, installée dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, qui interpréta May B en 1981.
Les couches de passation de cette « pièce-établi » de Maguy Marin, selon David Mambouch, nappent ce documentaire poétique, portrait-parcours de la chorégraphe qu’est L’Urgence d’agir. Les photos des années 1970, les visages vieillissants racontent mieux que tout la vie d’une troupe qui fait la « traversée » ensemble. Le réalisateur montre sa mère, aujourd’hui, lisant un texte en forme de bilan. Etre artiste, dit-elle en substance, c’est réussir à fabriquer quelque chose ensemble, sans se noyer dans le groupe. « Quel est ce moment du monde que nous partageons ensemble ? »
Danser, c’est faire partie d’une collectivité. Le film tisse les liens entre les œuvres de la chorégraphe et l’évolution des politiques publiques. Pour prendre un exemple, Ah ! Ah !, n’a pas été créée pour rien en 2006, alors que la droite était au pouvoir et Nicolas Sarkozy en pleine ascension. Dans cette pièce qui est sans doute l’une des plus radicales de Maguy Marin, les interprètes sont assis, ne décollent pas de la chaise, sauf pour s’effondrer… en hurlant de rire. Danser ne se suffit pas seulement d’un jeu de jambes.
Lire la critique du spectacle « Ligne de crête » : Avec Maguy Marin, les humains dansent en rond dans l’open space
May B, de Maguy Marin. Espace Cardin, Paris 8e. Jusqu’au 12 mars.
Maguy Marin,l’urgence d’agir, de David Mambouch. En salle. Sur le Web : www.ocean-films.com/film/maguy-marin-lurgence-dagir
Légende photo :
Maguy Marin (à gauche au premier plan) lors d’une répétition de « May B » dans le documentaire de David Mambouch, « Maguy Marin,l’urgence d’agir ». LAURENCE DASNIERE / OCÉAN FILMS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 5, 2019 5:44 PM
|
Par Philipe du Vignal dans Théâtre du blog 27.02.2019
Qui va garder les enfants? de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux, mise en scène de Gaëlle Héraut
Le titre du spectacle reprend la phrase idiote et machiste de Laurent Fabius e (il ne pourrait plus se le permettre aujourd’hui: il se ferait insulter sur tous les réseaux sociaux), C’était en 2.006 quand Ségolène Royal avait posé sa candidature à la primaire socialiste comme François Hollande avec qui elle vivait. C’est une sorte de théâtre-documentaire, dit à la première personne mais aussi joué, que Nicolas Bonneau va développer en une heure et quelque. Pour parler de la place des femmes en politique dans la douce France d’aujourd’hui, de jeunes femmes ou moins jeunes, de gauche comme droite ou du centre, des élues de petites ou grandes communes, des anciennes ministres dont Nicolas Bonneau a recueilli les témoignages sur plus de deux ans.
C’est la matière même d’un spectacle inégal où son auteur semble parfois avoir du mal à placer le curseur entre un théâtre purement documentaire et un récit personnel où il parle de ses relations avec les femmes. Sur le plateau, un fauteuil, quelques paires d’escarpins qu’il chaussera parfois et dans le fond, un petit escalier en spirale encombré de chaises inutiles. Cela commence bien lentement par une sorte de parodie de la misogynie mais on discerne mal où Nicolas Bonneau veut en venir. Puis il interviewe en les jouant aussi : Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme sous la présidence de François Mitterrand, Christiane Taubira, Marylise Lebranchu, Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, Nathalie Kosciusko-Morizet, et une députée, Clémentine Autain mais aussi Virginie Lecourt, maire d’une petite commune (170 habitants) Saint-Junien-les-Combes, près de Bellac (Limousin). Il passa une journée avec elle sur le terrain : c’est sans doute le meilleur des sketches, à la fois bien construit et plein de vie.
Mais le spectacle tourne parfois au catalogue quand Nicolas Bonneau cite seulement la célèbre Olympe de Gouges qui écrivit en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Louise Michel, Rosa Luxembourg, ou encore Édith Cresson et Marine Le Pen. Le narrateur parle aussi d’Angela Merkel dont il admire beaucoup les stratégies pour écarter ses adversaires, ou encore Margaret Thatcher, l’intransigeante «dame de fer»…. Cela commence à faire beaucoup de monde! Qui trop embrasse, mal étreint, et aimer, c’est choisir, comme disaient nos grands-mères: ces vieux dictons restent valables. Par ailleurs, Nicolas Bonneau parle aussi souvent de sa famille et de Caroline, sa première amoureuse. Il avoue l’avoir bêtement quittée parce qu’il était jaloux qu’elle réussisse comme syndicaliste étudiante. Il la reverra mais, entre temps, elle aura aussi réussi à se faire élire députée et elle lui tiendra la dragée haute.
En passant Nicolas Bonneau rappelle -mais on se demande bien pourquoi- que Zeus avala Métis, son amante, et que la déesse Athéna sortit armée de la tête de Zeus. Il y aussi une chanson sur les femmes à l’Assemblée Nationale. Un sketch pas vraiment drôle et que l’on oublie vite. Bref, un spectacle avec de bons moments: Nicolas Bonneau a un talent indéniable de conteur… Mais on reste un peu sur sa faim; il y a des longueurs et l’ensemble n’est pas toujours passionnant. La faute sans doute à un texte parfois bavard et à une dramaturgie mal maîtrisée sur un thème casse-gueule; on a souvent l’impression que son auteur navigue à vue… Sa Caroline aura le dernier mot du spectacle avec un message qu’elle lui adresse, assortie d’une phrase de Groucho Marx: les hommes sont des femmes comme les autres… Bien vu.
Philippe du Vignal
Jusqu’au 31 mars, Théâtre de Belleville, 94 rue du Faubourg du Temple, Paris XI ème. T. : 01-48-06-72-34.
Photo :
© Richard Volante © Pauline Le Goff

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 3, 2019 6:08 PM
|
Où sont les femmes qui pourraient diriger le TNP ? Tribune publiée dans Libération du 4 mars 2019
Pourquoi si peu de candidatures féminines pour la direction de l’historique théâtre de Villeurbanne ? Ce texte signé par près de 200 personnalités du théâtre et adressé au ministre de la Culture propose un système de programmation paritaire.
Tribune. Est-ce qu’elles existent ? Parions que oui. Elles sont onze au moins, parfaitement identifiables. Peu importe les noms. Elles ont dirigé ou elles dirigent depuis plusieurs années un théâtre subventionné important. Elles répondent ainsi à l’un des critères formulés dans l’appel à candidatures pour la direction du Théâtre national populaire à Villeurbanne (Rhône) : elles ont, «idéalement, une expérience significative dans la direction d’un établissement culturel» (sic) ! Elles créent des spectacles, mènent leur chemin d’artiste, et, chacune à sa manière, expriment le monde d’aujourd’hui. Elles sont tenaces, déterminées, sensibles. Et bosseuses ! Elles seraient légitimes à aspirer à la direction d’une maison-théâtre splendide, un outil de travail ample, prestigieux, puissant. Elles seraient légitimes à vouloir écrire une nouvelle page du TNP, ce théâtre cher au cœur de toutes celles et tous ceux qui aiment le théâtre public et se reconnaissent héritières et héritiers de l’histoire de la décentralisation théâtrale en France.
Cependant, fin 2018, aucune n’avait adressé de lettre de candidature. Certaines n’en avaient aucun désir. Trop impliquées dans la vie des théâtres qu’elles dirigent actuellement ou trop désireuses de retrouver un air de liberté. Certaines ont pu y songer. Il y a eu des conversations, des échanges, des points de vue, des emportements, des petites phrases, autour de candidatures féminines possibles. Celles qui auraient pu penser qu’il était temps de se lancer dans une telle aventure, vous savez ce qu’elles ont entendu ? Que le risque était grand de ne faire que de la figuration ! Qu’il fallait éviter de servir d’alibi ! Que jamais une femme ne serait nommée à la direction du TNP ! Qui disait cela en décembre ? Tous et toutes, ou presque. Résultat, pas de candidature féminine légitime fin 2018, et décision du ministre de la Culture de prolonger la possibilité de faire acte de candidature jusqu’au 17 février. Depuis, nous ignorons encore si certaines ont finalement décidé d’entrer en lice… Il est temps de réfléchir aux raisons profondes de ce malaise.
Les femmes artistes ne sont-elles pas ambitieuses ? N’ont-elles pas la possibilité d’inscrire leur travail et un projet culturel et artistique large dans ce magnifique bâtiment au centre de Villeurbanne ? N’ont-elles pas les épaules pour diriger une institution de la taille du TNP ? Bien sûr que si ! Alors ? Qu’est-ce qui les empêche ?
Aux artistes souhaitant faire acte de candidature pour diriger, à partir du 1er janvier 2020, le Théâtre national populaire, il était demandé un bilan de leur diffusion sur les trois dernières saisons.
Normal ? Ou pas ? En tout cas, un vrai facteur discriminant, puisque toutes les études prouvent que les femmes sont, dès la sortie des écoles d’enseignement artistique supérieur, empêchées. Moins de subventions, moins de moyens de production, moins de diffusion, moins d’ouvertures… Tout va dans le sens du moins. Or, elles n’ont ni moins de talent, ni moins de courage, ni moins de désir. Attrapons le problème sous un autre éclairage : ce magnifique TNP, quel est donc son bilan sur les dernières saisons ? Quelles programmations ? Quel désir de faire apparaître sur l’une des trois scènes le travail des artistes femmes ? Avec une petite analyse des propositions offertes au public depuis cinq saisons, nous trouvons des chiffres terribles : quand 151 artistes hommes ont été soit l’auteur, soit le metteur en scène, soit les deux des spectacles programmés par le TNP sur les cinq dernières saisons, seulement 25 femmes ont été, soit l’auteure, soit la metteure en scène, soit les deux des spectacles programmés par le TNP sur les cinq dernières saisons. Soit 14 % de femmes et 86 % d’hommes.Après les rapports de Reine Prat, en 2006 puis 2009, sur l’absurde et injustifiable invisibilité des femmes dans le monde de la culture ; après les mouvements récents dits «de libération de la parole» et/ou #MeToo, ce serait beau, une artiste dirigeant ce grand théâtre public historique, une femme forte prenant la suite de Gémier, Vilar, Wilson, Planchon, Chéreau, Lavaudant, Schiaretti ! Et cela donnerait des ouvertures de fierté et des perspectives d’avenir aux petites filles et aux jeunes femmes rêvant de faire leur vie dans le monde du théâtre.
Où sont les femmes qui pourraient diriger le TNP ? Le 17 février, ignorant s’il y avait des candidates et quels seraient leurs projets, ignorant totalement qui dirigerait le TNP, nous avons voulu suggérer une façon simple de faire évoluer la situation : donner obligation, à tous ceux et toutes celles qui travailleront à un projet pour le TNP, de s’engager à programmer sans que le déséquilibre hommes-femmes ne puisse excéder 40 %-60 %, tant du côté des écritures que du côté des mises en scène. Et que cette obligation entre dans le contrat du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice du TNP. Et que cette innovation pour le TNP devienne une règle pour tous les futurs contrats de direction des théâtres publics, c’est-à-dire subventionnés avec l’argent des femmes et des hommes de ce pays. Un moyen simple à mettre en œuvre. Un outil efficace pour plus d’équilibre et d’ouverture. Un chemin pour échapper, pas à pas, à la prévalence masculine, si visible dans le monde de la culture.
Par Catherine Anne metteure en scène, directrice du Théâtre de l’Est-Parisien de 2002 à 2011.
Premières cosignatures :
Anne Alvaro comédienne
Marion Aubert dramaturge, actrice
Charles Berling et Pascale Boeglin-Rodier directeur et directrice de la Scène nationale Châteauvallon-Liberté
Bernard Bloch comédien, metteur en scène et auteur
David Bobée directeur du CDN Normandie-Rouen Julie Brochen directrice du théâtre de l'Aquarium de 2002 à 2008, directrice du Théâtre national de Strasbourg de 2008 à 2014
Irina Brook directrice du CDN de Nice
Catherine Corsini réalisatrice
Sophie Deschamps présidente de la SACD
Nicolas Frize compositieur
Brigitte Jacques-Wajeman directrice du Théâtre de la commune d'Aubervilliers (CDN) 1991-1997
Claire Lasne-Darcueil directrice du CNSAD
Catherine Marnas directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitiane
William Nadylam acteur et metteur en scène
Mariette Navarro autrice
Stanislas Nordey co-directeur du TGP à Saint-Denis de 1998 à 2001, directeur du TNS Pascal Rambert directeur du T2G-théâtre de Gennevilliers de 2007 à 2016...
… et plus de 200 signatures individuelles, et celles des associations HF AuRA, Bretagne, IDF. Texte, annexe des chiffres du TNP et liste des signataires à retrouver sur www.catherineanne.info/femmes-et-tnp/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 3, 2019 10:14 AM
|
Par Julia Vergely dans Télérama Publié le 03/03/2019.
Comédienne, metteuse en scène, écrivaine… Entre deux répétitions d’une adaptation du conte des frères Grimm, la trentenaire multi-tâche a accepté de partager ses souvenirs d’enfance et ses plus belles lectures de jeunesse. Sans oublier de revenir sur la genèse de son dernier livre pour ado “Home sweet home”.
On aurait pu aller la voir au Pérou, où elle s’est promenée en novembre dernier. Ou en Bretagne, où sa compagnie de théâtre L’Entente cordiale officie. Mais c’est finalement aux Abbesses à Paris, sous le soleil, délicieux mais inquiétant de février, que nous réussissons à croiser Alice Zeniter. A 33 ans, l’écrivaine ne semble pas avoir de temps à perdre, et c’est tant mieux. Elle cale notre café entre deux répétitions de Hansel et Gretel : le début de la faim, son adaptation du conte des frères Grimm, et la sortie de son nouveau livre pour ado, Home sweet home, écrit à quatre mains avec son ami Antoine Philias. Elle porte sa grande culture des livres en bandoulière, ravivant pour nous ses souvenirs de jeunesse.
Vos parents vous faisaient-ils la lecture quand vous étiez petite ?
Ma mère le faisait beaucoup. Elle nous lisait surtout, à mes sœurs et moi, des contes de fées dans des livres qui lui avaient appartenu petite, des vieux livres, presque des grimoirs, énormes ! Enfin, ils me paraissaient énormes surtout parce que j’avais 3 ans… On n’avait pas le droit de les toucher parce qu’ils étaient fragiles. Il y avait un côté sacré : maman tenait le livre, elle tournait les pages et nous devions juste écouter. L’objet en lui-même me paraissait archéologique. Mon père, lui, inventait des histoires à rallonge. Il avait créé deux héros, Bidi-Bidi et Bouda-Bouda, à qui il arrivait plein d’aventures ; ils partaient très souvent en voyage, dans des contrées exotiques et extraordinaires, avec un petit côté Pieds nickelés ou Dupont et Dupond.
Les premiers livres qui vous ont marquée ?
J’ai appris à lire à 4 ans parce que ma grande sœur me refaisait ses cours de CP grâce à une méthode, un peu contestable, de menaces avec des cannes des billard. Faut pas trop que je raconte ça ! Mais en réalité c’était drôle, en plus d’être très efficace. Donc j’ai commencé à lire toute seule très tôt : en plus des livres disponibles à la maison, on allait une fois par semaine à la bibliothèque, où on avait le droit de ratisser large. Avec ma grande sœur nous étions dans une compétition, celle qui lirait le plus de livres pour grands. Toutes mes années de primaire c’est un grand mélange : je m’attaque à des monuments — je lis Les Trois Mousquetaires dans la version intégrale, Les Misérables…, en ratant plein de détails d’ailleurs — et, à côté, je dévore des Je bouquine, Roald Dahl, mais j’adore aussi Tom-Tom et Nana. Entre 5 et 10 ans, je lis donc des choses dans des tranches d’âge qui rendraient malades tous les éditeurs, qui ne cessent de me demander aujourd’hui « c’est pour quel âge précisément ce livre » ? Dans mon enfance j’ai lu de tout dans un joyeux bordel, et ça ne m’a pas dérangée.
L’Histoire sans fin, de Michael Ende, m’a énormément marquée. C’est peut-être mon premier gros bouquin, qui demandait du temps. On le lit en parallèle avec ma grande sœur, on se partage un seul exemplaire et aucune d’entre nous ne supporte que l’autre l’ait ! On passe notre temps à se le voler, à se cacher pour pouvoir avancer sans que l’autre nous trouve… Le roman m’a marquée aussi en raison de ces conditions de lecture. C’était tellement trépidant.
“A propos de nombreux livres que j’ai lus enfant, je me demande si cela en vaut toujours la peine…”
Quels sont les livres que vos parents vous ont transmis ?
Ma mère a une grande passion pour le roman naturaliste du XIXe. Si j’ai eu Zola et Balzac dans les mains très tôt, c’est grâce à elle. J’ai lu l’intégrale du cycle des Rougon-Macquart au collège, parce que d’après ma mère c’était très grand. Mon père était très science-fiction et heroic fantasy. De lui me vient Le Seigneur des anneaux, que j’ai lu une dizaine de fois, Le Cycle de Dune, de Frank Herbert, Bradbury, Azimov… Ce sont deux traditions de la littérature très différentes, et d’ailleurs leurs livres ne se côtoyaient même pas dans la bibliothèque.
Dans ce même élan de transmission, quels livres faites-vous découvrir à des enfants ?
A propos de nombreux livres que j’ai lus enfant, je me demande si cela en vaut toujours la peine… Par exemple, Le Club des cinq ou Fantômette, Alice détective : c’était super ces bandes de copains, l’aventure, résoudre des enquêtes… ça me faisait très envie. Mais je pense que c’est horriblement daté. Le Club des cinq et les Gitans est probablement une œuvre à expurger ! Pourquoi le transmettre alors ? Même chose pour Les Quatre Filles du Docteur March, de Louisa May – roman que j’ai absolument adoré, il fait partie des grimoirs que ma mère m’a donnés –, je ne sais pas si je le donnerais à une petite fille ou un petit garçon aujourd’hui, à mon avis c’est très lourd, très patriarcal.
Avec vos sœurs vous passiez votre temps à amender et réécrire les histoires qui ne se passaient pas comme vous le souhaitiez…
Oui, beaucoup ! Surtout Les Trois Mousquetaires. D’abord parce qu’on préférait Aramis à D’Artagnan, donc il fallait lui donner une juste place, ensuite parce qu’il nous était insupportable que Constance Bonacieux meurt à la fin ! On réécrivait tout ça en se servant des Nouveaux Contes de fées de la comtesse de Ségur. On y trouvait des crapauds qui crachent du venin, des marraines bonnes fées, des princesses dans la forêt, et, surtout, des descriptions de robes… magnifiques ! Donc on piquait toutes les descriptions qui nous plaisaient et on les utilisait dans nos réécritures.
“On pensait écrire pour de jeunes collégiens, et puis l’âge cible s’est décalé de lui-même.”
Vous-même, vous écrivez des livres pour enfants. Comment cette envie vous est-elle venue ?
Par hasard. Plus j’écris, plus j’ai envie d’étendre les domaines d’écriture. En réalité, j’aime beaucoup l’écriture animalière et les animaux qui parlent ! Les histoires et les blagues avec des animaux… C’est un pan un peu débile de mon être – d’où le lion sur la couverture de L’Art de perdre (2017). Robin des bois est mon dessin animé préféré – méga classe le renard ! Donc évidemment, écrire une histoire avec des animaux me tentait, et c’est plus facile de le faire avec la littérature enfantine, sans paraître un peu bizarre. C’est comme cela qu’est né Un ours of course !, un spectacle musical qui est aussi sorti en livre CD. C’est après que j’ai réalisé que j’aimais ça.
Vous avez une passion pour le théâtre et vous y avez adapté Hansel et Gretel. Est-ce que la lecture à voix haute, enfant, a joué un rôle dans tout ça ?
Je n’ai jamais arrêté la lecture à voix haute. Mes parents nous ont raconté des histoires, ensuite on a perpétué cela avec mes sœurs et on n’a jamais arrêté. On continue de le faire, quand on part en vacances ensemble, pour tromper l’ennui à l’aéroport. Il y en a une qui met sa tête sur les genoux de l’autre et on se lit à voix haute des romans. J’ai instauré ça dans mon couple aussi. Lui a une petite fille à qui j’essaye d’apprendre que la lecture à voix haute n’est pas seulement un truc de bébé, ni quelque chose qui est circonscrit dans le temps où quelqu’un a une incapacité à lire. Maintenant qu’elle arrive à très bien lire, elle peut me lire des choses à moi aussi et ça devient un passage de relais. Le côté théâtral est évident : je me souviens lui avoir lu Momo, de Michael Ende, où il y a une scène avec quarante-cinq hommes de l’ombre. Elle m’a dit : « Fais toutes les voix. » Quarante-cinq ! On a épuisé rapidement toutes les tessitures possibles, les accents, les mélanges d’accents… Ça développe une certaine pratique.
Vous publiez mi-mars Home sweet home, un roman d’apprentissage pour adolescents, que vous avez écrit à quatre mains avec Antoine Philias. Encore une nouvelle corde à votre arc ?
Oui, on pensait écrire pour de jeunes collégiens, et puis l’âge cible s’est décalé de lui-même. Plus on écrivait, plus on réalisait qu’il y avait des aspects de la vie qu’on ne voulait pas laisser de côté, notamment la découverte de la sexualité, la question de la drogue, de l’argent… On s’adresse donc à des adolescents. Mais enfin je ne connais pas un enfant qui n’éprouve pas le besoin de retourner un bouquin pour voir l’âge indiqué et qui est fier de constater qu’il est plus jeune. Il faut bien que les éditeurs se couvrent… Par ailleurs, je suis très heureuse d’être publiée à L’Ecole des loisirs, j’ai lu beaucoup de leurs livres : les Marie-Aude Muraille, les Moka… J’adorais ça et c’est une jolie continuation, comme un retour aux sources.
“Je pense que je suis encore énormément une enfant.”
Est-ce qu’écrire pour les enfants est différent ?
La mécanique est la même : que j’écrive pour les adultes ou pour les enfants, je n’arrive pas vraiment à me représenter qui est le lecteur, donc je fais ce que je pense être bon. Je vais avoir tendance à travailler davantage le rythme et la musique pour les enfants, parce qu’il y a des choses qu’eux ne considèrent pas comme offensant – l’utilisation de la rime interne par exemple – alors que les adultes, si. Finalement, je me lâche plus quand j’écris pour les enfants. Je me laisse aller, sans snobisme, sans bouder certaines couleurs dans la palette.
Dans L’Art de perdre, il est plusieurs fois question d’une sortie soudaine et brutale de l’enfance. Vous avez vécu cela ?
Je pense que je suis encore énormément une enfant. J’ai été assez préservée dans le jeu social de toute obligation d’être une figure d’autorité. J’ai un copain auteur irlandais qui m’a dit un jour «Your inner child is all over the place » (« Ton enfant intérieur occupe tout l’espace »), et c’est vrai, mon enfant intérieur n’est pas du tout confiné à l’intérieur ! Enfant, j’avais l’impression que la sortie de l’enfance allait être très visible, qu’on pouvait dater le moment où on avait fini de grandir et de mûrir, et qu’ensuite c’était un petit plateau jusqu’à la vieillesse et la mort. Et ça me paraissait d’autant plus normal que la fiction enfantine avait construit ce type d’attente chez moi. Ecrire « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », c’est aussi dire qu’une fois qu’on s’est trouvé... plateau, stase, infinie immobilité. J’ai fini par comprendre qu’il n’y avait pas de plateau et qu’on ne peut pas dater une sortie de l’enfance. Depuis, je suis contre les fictions qui ont de fausses fins et qui construisent des perspectives de vie fausses pour les enfants. Je considère que c’est bidon, peut-être même délétère pour eux.
Hansel et Gretel : le début de la faim, les 7 et 8 mars 2019, à la Maison du Théâtre de Brest. A partir de 8 ans.
Hansel et Gretel : le début de la faim, collection Heyoka jeunesse, aux éditions Actes Sud- Papiers, avec des illustrations de Nicolas Zouliamis.
Home sweet home, d’Alice Zeniter et Antoine Philias, éd. L’Ecole des loisirs. A paraître le 13 mars. A partir de 13 ans.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2019 8:28 AM
|
Propos recueillis par Agnès Santi - Publié le 24 février 2019 dans La Terrasse - N° 274 LA FILATURE / THÉÂTRE DE VANVES / TEXTE DE COPI / MISE EN SCÈNE LOUIS ARENE
C’est à partir des angoisses de notre époque que les co-fondateurs du Munstrum Théâtre Louis Arene et Lionel Lingelser, rejoints par l’auteur et dramaturge Kevin Keiss, questionnent et réinventent le théâtre de Copi.
Comment votre collaboration et vos affinités se sont-elles construites ?
Lionel Lingelser : Notre première collaboration s’est tenue lorsqu’Alexandre Ethève, l’un des acteurs de la compagnie, a souhaité créer un seul en scène à partir de la bande dessinée Joe l’aventure intérieure de Grant Morrison. Kevin a écrit pour lui Je vous jure que je peux le faire (éditions Actes Sud), une pièce où le jeune héros transforme le deuil de son père. Puis Kevin a découvert notre univers et notre travail spécifique relié au masque. Il nous a confortés dans notre démarche qui à travers la poésie et l’étrangeté des corps questionne et donne sens au masque contemporain. Son regard et ses mots éclairent cette étrangeté, encouragent notre quête théâtrale. Ce qui est intéressant, c’est que notre recherche transforme la primauté des mots, tend à ce que le corps devienne narratif au-delà du sens même des textes.
« Jouer avec Copi, c’est militer pour sa survie, par pur plaisir. » Lionel Lingelser
Kevin Keiss : Notre complicité s’est mise en place de manière naturelle, très simple. En tant qu’auteur, je suis très sensible à l’esthétique des plateaux, sans doute grâce à ma formation à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg dans la section mise en scène et dramaturgie. Nous créons un langage commun où se conjuguent enjeux stylistiques et esthétiques, où s’accordent la direction d’acteurs, le jeu et les réalisations des divers corps de métier, pour que tous les signes sur scène fassent sens et créent une cohérence. Pour chacune de ses mises en scène, le Munstrum théâtre met en place une réinvention de la manière dont on peut jouer masqué aujourd’hui. C’est très motivant. Dans ces deux pièces de Copi, les personnages et leurs corps se métamorphosent par le langage. Dire quelque chose, c’est le faire exister sur scène, dans une dimension performative.
« Les personnages et leurs corps se métamorphosent par le langage. » Kevin Keiss
Louis Arene : Pour les textes de Copi, nous construisons une dramaturgie fondée sur les corps, la sensualité, la picturalité, et comme toujours le plaisir du jeu. 40° sous zéro, dont la tonalité tranche avec l’atmosphère sombre et très épurée de la pièce Le Chien, la nuit et le couteau de Mayenburg, déploie une sorte de cabaret vertigineux, avec une physicalité spécifique. Je suis d’autant plus heureux de la présence de Kevin que pour cette pièce je suis metteur en scène et comédien. Nous utilisons à nouveau le masque, comme une seconde peau, un artifice extrême pour une extrême sincérité. Assisté de Karelle Durand, Christian Lacroix, que j’ai rencontré lorsque j’étais pensionnaire à la Comédie-Française, a conçu les costumes, créant des figures totémiques sublimes et monstrueuses.
Pourquoi avoir choisi de porter à la scène ces deux pièces de Copi ?
L. A. : Lorsque j’étais au Conservatoire, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer me faisait mourir de rire ! Plus tard, avec Lionel, nous avons tous deux été comédiens dans la mise en scène de Philippe Calvario de la dernière pièce de Copi, Une Visite inopportune, écrite alors qu’il était en train de mourir du sida. C’est un texte magnifique où le rire dépasse la douleur. Ce que j’aime chez Copi, et qu’on retrouve dans les deux pièces que nous réunissons, c’est cette tension entre le kitsch et le sublime. Elles déploient des intrigues extravagantes, une folie démesurée, une férocité de feu et de glace ! Copi est un auteur cathartique, à l’écriture sensitive. Semblables à un tableau d’art abstrait, les pièces dépassent les enjeux du sens. Comme dans un champ de bataille né de la barbarie du monde, les pulsions de domination, possession ou cupidité s’exacerbent et se répètent. Nous fabriquons le moment théâtral comme une quête d’intensité, en utilisant des objets de récupération pour créer une sorte de projection poétique d’un monde d’après la catastrophe. Comme souvent, nous travaillons sur les tensions entre le comique et le tragique, l’ombre et la lumière, le sacré et le profane. Ces ambivalences font l’éloge du doute, peuvent mener à une sorte de transe libératrice.
« Copi est un auteur cathartique. » Louis Arene
L. I. : Si, trente ans après sa mort, Copi est assez peu mis en scène, c’est sans doute parce qu’il est de manière réductrice associé à l’imagerie queer, aux archétypes de « la folle ». Aujourd’hui, au-delà des revendications homosexuelles et des questions de genre, nous questionnons autrement ces personnages grotesques qui meurent, ressuscitent, interrogent la barbarie du monde dans une sorte de cérémonie sacrificielle, d’enquête irrésolue sans queue ni tête. Les acteurs disaient que jouer avec Copi, c’est militer pour sa survie, par pur plaisir, comme dans un jeu d’enfant. Copi affirmait à propos des personnages de L’Homosexuel que l’exubérance n’est pas l’ennemi de la pudeur et du mystère. C’est ce mystère que l’on veut aller chercher dans les personnages. Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Alexandre Éthève et François Praud nous accompagnent, dans une énergie et un souffle communs.
K. K. : Les deux pièces ont pour similitudes le huis clos, l’enfermement, l’éloignement – l’une en Sibérie, l’autre en Alaska -, l’obsession du départ. Et un froid extrême, ce qui oblige à une panoplie de combat ! Si elles s’insurgent contre la bourgeoisie et l’ordre établi, elles dynamitent aussi tous les codes et conventions du théâtre, et comme en écho à Victor Hugo dans la préface de Cromwell s’appuient sur le grotesque pour atteindre une forme de beauté. Elles vont jusqu’à faire émerger un univers post-dramatique où n’ont plus cours la narration, l’incarnation ou la psychologie, où sur des décombres le monde est à réinventer. Au-delà des mots et du sens, le théâtre s’affirme ici surtout par l’une de ses vertus les plus puissantes : le bonheur de jouer. Nous aimerions que les spectateurs aussi se connectent à ces sensations fortes, libératrices. Comme une fête de la vie.
Christian Lacroix Le costume comme rouage de la mise en scène « J’ai rencontré Louis Arene à la Comédie-Française et j’ai été très impressionné par son travail sur les masques de Lucrèce Borgia, pièce mise en scène par Denis Podalydès. J’ai été très heureux lorsqu’il m’a proposé de collaborer avec la compagnie sur des textes de Copi. Leur spectacle précédent, Le Chien, la Nuit et le Couteau, m’a emballé ! C’est un univers théâtral dont je me sens proche. Lorsque je suis costumier, je tiens à rester au service de l’univers du metteur en scène, à illustrer son imaginaire au plus près. Nous avons beaucoup échangé. Louis a une idée très précise des personnages et il faut ensuite confronter toutes nos envies aux possibilités de la scène. Cette mise en œuvre a été passionnante pour moi, et je l’ai découverte avec l’œil de Karelle Durand, sa costumière fidèle. Excès et sophistication Je suis assez âgé pour avoir vu Les quatre Jumelles à leur création au Palace par Jorge Lavelli, et j’ai aussi vu jouer Copi dans d’autres pièces. J’aime cette théâtralité entre excès et sophistication, ce raffinement exacerbé et cette grandiloquence jusqu’à l’absurde qui nous ravissaient dans les années 1970. Mais ce qui m’a convaincu dans l’approche de Louis Arene, c’est son œil d’aujourd’hui qui va au-delà de la manière « classique » dont on a abordé Copi. J’ai suivi jusqu’au bout les fantasmagories de Louis, jusqu’au moindre détail de couleurs ou de formes exacerbées. C’est un grand plaisir de pouvoir aller aussi loin. Dans un tel contexte, le costume de théâtre n’est pas seulement un vêtement, une parure, il devient un véritable rouage de la mise en scène, une part de la scénographie, en même temps qu’une sorte de pictogramme de chaque caractère ainsi sculpté dans l’espace. C’est plus qu’inspirant pour un costumier ! » Focus réalisé par Agnès Santi
A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
40° sous zéro, de feu et de glace de Copi, rencontre avec Louis Arene, Lionel Lingelser et Kevin Keiss
du Mardi 5 mars 2019 au Vendredi 8 mars 2019
La Filature à Mulhouse
20 Allée Nathan Katz, 68090 Mulhouse
Du 5 au 8 mars 2019 à 20h sauf le 7 à 19h. Tél : 03 89 36 28 28.
Théâtre de Vanves, 2 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves. Le 23 mars à 20h. Festival Artdanthé. Tél : 01 41 33 93 70.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2019 5:56 AM
|
Le matin, on incinérait l’irréductible acteur Serge Merlin. Le soir même, l’irréductible Alceste, incarné avec force par Lambert Wilson, reprenait le flambeau de la sincérité. Ainsi va la vie d’un critique, d‘adieu en découverte, faisant théâtre de tout, même de la vie, jusqu’à s’y perdre comme Célimène. En coulisse, un homme organisait le trafic des ombres : Frédéric Franck.
Après que l’on a entendu quelques pages du Dépeupleur dites, mugies plutôt, par la voix de Serge Merlin, cette même voix passa, sans coup férir, de la lecture à la rêverie, imaginant que ce texte de Beckett pourrait partir dans l’espace et « tourner autour de la terre comme Gargarine ». Ce propos de l’acteur mort et d’autres, plus surprenants encore, entraînèrent sourires et rires parmi les rangs du public nombreux venu lui dire adieu au cimetière du Père Lachaise, dans l’une des salles du crématorium. Pas de blabla maladroit balbutié les mains tremblantes, pas d’anecdote désopilante, pas de voix cassée par l’émotion. Il n’y eut que ça : sa voix. Bien qu’allongé dans son cercueil fermé, la voix vivante de l’acteur nous parlait, nous réconfortait, seule, orgueilleusement solitaire devant notre pauvre multitude. Au fond, derrière le cercueil en passe d'être lui aussi brûlé, son visage sans âge, immémorial, nous regardait (voir photo).
Un invité permanent
Mais ce n’est pas tout. Tandis que sa voix apaisait notre chagrin en décontractant nos mâchoires et nos gorges, au-dessus du cercueil, l’une des deux lampes qui l’éclairait se mit à vaciller. Je ne cessais de regarder cette petite ampoule, cette vibration de vie. Et, miracle ou misérable mirage, la lumière émise par la loupiote, par ses secousses inconstantes, ne tarda pas à suivre le rythme de la voix de Merlin, épousant ses vacillements discontinus, ses inflexions douces, ses envolées soudaines, son rire sauvage. Comme si, allant au-delà de cet adieu organisé avec tact par Michelle Kokosowski avec la complicité de Blandine Masson, Serge Merlin avait voulu faire, discrètement et malicieusement, théâtre de sa disparition. Un gag peut-être. Un signe, sans doute. Mais lequel ?
Les acteurs qui avaient côtoyé Merlin, la plupart des metteurs en scènes qui l‘avaient dirigé étaient là, mais des directeurs de théâtre (René Gonzalès, mort, étant excusé), il n’y en avait qu’un : Frédéric Franck.
Au Théâtre de la Madeleine, puis au Théâtre de l’Œuvre que Franck dirigea successivement (deux théâtres privés), Serge Merlin fut comme un invité permanent. Il y retrouva plusieurs fois les deux auteurs de son temps qui accompagnaient sa vie depuis longtemps : Samuel Beckett et Thomas Bernhard.
Après avoir dû quitter le Théâtre de la Madeleine, Frédéric Franck avait inauguré sa direction du plus modeste Théâtre de l’Œuvre avec Merlin dans La Dernière Bande de Beckett dirigé par Alain Françon. Faute d’avoir trouvé la gestion miracle accordée à ses exigences artistiques, il céda la place quatre ans plus tard après un dernier spectacle, La Dernière Bande encore, pièce interprétée cette fois par Jacques Weber dans une mise en scène de Peter Stein. Magnifique spectacle qui nous fit découvrir un Weber que l’on ne soupçonnait pas.
« Sous de vains compliments »
Aujourd’hui, Frédéric Franck ne possède plus de théâtre, il codirige le théâtre Montansier à Versailles, l’art du théâtre reste la passion de sa vie comme elle le fut pour son père. Il coproduit et initie, ici et là, des spectacles. Ce fut le cas au théâtre de la Porte Saint-Martin avec un Tartuffe mis en scène par Peter Stein. Ce dernier, initialement, avait songé à réunir Lambert Wilson dans le rôle de Tartuffe et Jacques Weber dans celui d’Orgon. Lambert Wilson, retenu par un film, dut renoncer. Mais l’envie de travailler avec Stein le taraudait. Franck a fait en sorte qu’ils se retrouvent aujourd’hui au Théâtre libre (ex Comédia) autour du Misanthrope de Molière et la force de l’interprétation de Lambert Wilson nous fait regretter qu’il n’ait pas pu tenir aussi le rôle de Tartuffe.
J’avais dit adieu le matin à Merlin et c’est lui qui me poussa à aller au théâtre le soir voir ce Misanthrope. J’avais quitté un homme solitaire et sincère le matin et j’en retrouvai un autre le soir avec Alceste. « C’est une vertu rare, au Siècle d’aujourd’hui », dira Eliante parlant de la sincérité d’Alceste. Merlin n’appartenait à aucune « famille » de théâtre, aucun clan, aucune troupe. Même sa vie, il la divisa en compartiments étanches. Il répugnait à participer aux rites de la société du théâtre, et comme il était d’une sincérité absolue, il se réfugiait souvent dans le silence. « Je veux que l’on soit homme, et qu’en toute rencontre / Le fond de mon cœur, dans nos discours, se montre ; / Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments / ne se masquent jamais, sous de vains Compliments », dit Alceste à Philinte dès la première scène du Misanthrope. Merlin, en d’autres mots, sans recourir aux alexandrins, ne disait pas autre chose. Il était comme Alceste d’une orgueilleuse solitude. Et souvent sombre comme l’est l’Alceste que propose Lambert Wilson.
Bien que portant (discrètement) un ruban vert, son Alceste est voué au noir. Outre son âme qui en broie, c’est la couleur qui colore toute sa personne : perruque, veste et manteau et jusqu’aux bottes. Costume qui contraste, à l’autre bout de la chaîne, avec ceux, hauts en couleurs bonbon des deux marquis, Acaste (Paul Minthe) et Clitandre (Léo Dussollier). Les costumes des trois femmes, Célimène (Pauline Cheviller), Arsinoé (Brigitte Catillon) et Eliante (Manon Combes) déplient d’autres subtilitésn ce qui n’est pas étonnant venant d’Anna-Maria Heinreich, collaboratrice habituelle de Peter Stein. Lequel, par ailleurs, sait donner l’importance qu’ils méritent aux petits rôles si souvent négligés tels ceux du Basque (Patrice Dozier) et de Dubois (Jean-François Lapalus), au demeurant, très bien interprétés comme les autres rôles.
Quant au décor, il est constitué d’un simple mur de bois pourvu de miroirs et de fenêtres qui ne s’ouvrent pas, devant des chaises, rien d’autre. Un décor somme toute spartiate signé Ferdinand Woegerbauer (autre collaborateur régulier de Stein) qui semble avoir eu Alceste pour conseiller (en sobriété), ce qui donne d’autant plus d’importance aux costumes qui sont comme le miroir des personnages.
Des mots et des lettres
Tout est dans le jeu, le mouvement des corps. Stein conçoit chaque acte comme un round, le passage au round suivant se fait par un noir prolongé sur fond de vent et d’orage grossissant d’acte en acte (seul effet sonore). Stein suit en particulier le fil des écrits qui traversent la pièce. Au premier acte, le sonnet d’une grande médiocrité écrit par Oronte (Jean-Pierre Malo) ; au second, l’ordre de comparaître devant un tribunal suite à l’affront fait à Oronte ; au troisième acte, le « mot de Lettre » que Célimène s’en va écrire et la preuve écrite qu’Arsinoé prétend tenir pour confondre la prétendue infidélité de Célimène ; au quatrième acte, une lettre écrite de la main de Célimène qui, aux yeux d’Alceste est la preuve de son infidélité (« je suis trahi, je suis assassiné » et la lettre de justice que Dubois, le valet d’Alceste, oublie au logis ; enfin, au cinquième acte, l’accumulation des lettres piquantes écrites par Célimène confondant le jeu de société auquel elle se livrait. C’est l’un des plus beaux moments mis en scène par Peter Stein : Célimène est assise, sonnée mais digne, les autres virevoltent autour d’elle, lui lancent les lettres à la figure. Dirigée par Peter Stein, Pauline Cheviller va à l’encontre de la coquetterie habituelle dont on affuble le rôle de Célimène, elle fait d’elle une jeune femme qui aime jouer tout simplement, s’amuse à écrire des billets et à se jouer des autres, avant de se rendre compte que les mots comme les regards peuvent humilier, voire tuer.
Flanqué de Philinte (Hervé Briaux), son ami social-démocrate qui sait l’art du compromis et du mensonge bien tempéré, Lambert Wilson, dirigé par Stein, fait du misanthrope Alceste, un personnage à la perruque filasse, un homme nerveux, toujours sur le qui-vive (il ne s’assoit jamais), quasi halluciné, presque nihiliste et parfois auto-analytique quand il constate que, malgré ses incartades, il aime encore Célimène. D’un bout à l’autre de la pièce, il refuse de pactiser avec une société qu’il exècre pour ses compromis, son paraître, son absence de sincérité. (hep, Macron, Il en a sous la semelle ce coquin de Poquelin, pas vrai ? Demande deux billets de faveur à ton ami Jean-Marc Dumontel, c’est lui le proprio du théâtre).
Célimène est trop jeune pour vouloir suivre Alceste dans son irréductibilité. Alors, dans un finale (digne de celui de Don Juan), non écrit par Molière, l’orage qui menaçait depuis la fin du premier acte éclate, le tonnerre s’en mêle, le mur se disloque et Peter Stein fait ouvrir une porte (la seule de la pièce) qui donne au fond de la scène sur un désert de dunes. Ce « Désert » où Célimène refuse d’« aller s’ensevelir », un désert d’Afrique où Serge Merlin passa son enfance et son adolescence avant de le quitter à jamais sans attendre vingt ans, l’âge de Célimène, emportant avec lui l’irréductibilité de son paysage natal.
Le Misanthrope, Théâtre libre, 4 boulevard de Strasbourg Paris Xe, 20h.
Scène du "Misanthrope" mis en scène par Peter Stein © Svebd Andersen

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2019 5:39 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde Publié le 25.02.2019 Le comédien, auteur et metteur en scène est à l’affiche de deux pièces, à Paris, dans lesquelles il jongle entre douze personnages.
Les semaines de Nicolas Devort ont des allures de marathon théâtral. Jusqu’au 17 mars, ce comédien joue sept jours sur sept à Paris et jongle entre douze personnages dans deux pièces contemporaines : Dans la peau de Cyrano au Théâtre du Lucernaire et Le Bois dont je suis fait au Théâtre de Belleville. La première – qu’il a écrite – raconte l’histoire de Colin, un collégien bègue qui va surmonter sa différence en incarnant le héros d’Edmond Rostand. Seul en scène, Nicolas Devort interprète tous ceux qui vont croiser la route de Colin : le professeur de français, la psychologue scolaire, les copains et les amies.
La seconde – coécrite et jouée avec Julien Cigana – met en scène une famille pleine de rancœur dans laquelle chaque membre va révéler sa nature profonde au moment où la mère sait sa fin de vie proche. Là encore, les comédiens parviennent à endosser, avec une agilité bluffante, le rôle des fils, des belles-filles, du grand-père, de la mère, du père.
« Un jour, le professeur de dessin industriel nous a fait travailler sur une pièce d’embrayage et nous a dit : “Ce sera ça, votre vie”. J’ai eu un coup de cafard »
Nicolas Devort arrive à notre rendez-vous dans un café parisien avec sa roue électrique. N’affichant ni stress ni fatigue, il dit en souriant : « J’ai de la chance de jouer autant. » Au Théâtre du Lucernaire, sa performance a la particularité d’attirer un public de 7 à 77 ans. Ecoliers, actifs, retraités, tous semblent se retrouver dans cette histoire drôle et touchante d’un gamin en quête de confiance en lui. Depuis sa création au Festival « off » d’Avignon, en 2013, Dans la peau de Cyrano cumule plus de 650 représentations à travers la France. « C’est notre première vraie exploitation parisienne », se réjouit le comédien. Suivra à nouveau une tournée avec des dates signées jusqu’en… 2020.
« On a tous un Colin au fond de nous », avance Nicolas Devort pour tenter d’expliquer le succès. Son itinéraire a radicalement bifurqué alors qu’il était étudiant en IUT de génie mécanique. « Un jour, le professeur de dessin industriel nous a fait travailler sur une pièce d’embrayage et nous a dit : “Ce sera ça, votre vie”. J’ai eu un coup de cafard. » Le garçon bien élevé qui se destinait à devenir ingénieur abandonne ses études, quitte Lyon pour Paris et s’inscrit au cours Florent. Le théâtre, il n’en connaît alors que quelques classiques, étudiés à l’école. Mais il a toujours aimé écrire des sketchs, des chansons, des poèmes. Animation de scènes ouvertes au Théâtre Trévise, petits rôles à droite à gauche, le jeune homme aux yeux bleus et au physique de jeune premier dit oui à tout. Et finit par monter, avec son amie Stéphanie Marino, la compagnie Qui va piano. Joli nom pour ce comédien qui va doucement – mais sûrement – se tracer un chemin sur les planches en prenant la plume.
Paternité
En 2005, la compagnie arrive, « la fleur au fusil », dans la cité des Papes avec un spectacle au titre improbable : Scènes de la vie extraordinaire en narrations anecdotiques et interludes fredonnés. « J’avais vendu ma moto, contracté un prêt, investi 16 000 euros pour jouer au Festival d’Avignon, et on s’est retrouvés devant une poignée de spectateurs », se souvient sans regret Nicolas Devort. Quelques années plus tard, la compagnie retente sa chance avec un spectacle jeune public, Molière dans tous ses éclats !, qui reçoit un très bon écho.
Plus tard, c’est lors d’une rencontre avec des lycéens, à l’issue d’une des nombreuses représentations en France, qu’est née l’idée de Dans la peau de Cyrano. « Nous parlions théâtre, et je découvre qu’ils ne connaissaient pas ce personnage, raconte Nicolas Devort. J’ai eu envie non pas de raconter l’histoire de Cyrano mais de donner envie de la découvrir. »
« J’ai eu envie non pas de raconter l’histoire de Cyrano mais de donner envie de la découvrir »
Puisant son inspiration dans Looking for Richard, d’Al Pacino(1996), pour l’approche pédagogique mais ludique d’un grand auteur, et dans Le Cercle des poètes disparus, de Peter Weir (1989), pour la dimension émancipatrice et le rapport bienveillant entre professeur et élèves, il met en scène un enseignant de français qui parvient à désacraliser et communiquer sa passion du théâtre pour amener ses élèves, et en particulier Colin, à se libérer d’eux-mêmes. C’est aussi à une forme de libération que Nicolas Devort et son complice Julien Cigana invitent le spectateur dans Le Bois dont je suis fait. Comment se délester d’une histoire familiale paternaliste pour parvenir à tracer sa propre route ?
Chacun père de deux enfants, les deux comédiens se sont retrouvés sur « la même volonté d’aborder la question de la paternité et du poids de l’héritage éducatif », explique Nicolas Devort. L’aventure de cette dernière création de la compagnie Qui va piano a, elle aussi, débuté à Avignon, où elle a été repérée par le directeur du Théâtre de Belleville. « Dans l’économie de notre compagnie, le “off” est incontournable. Grâce à ce festival, on décroche 90 % de nos dates de tournée », constate le comédien.
Bienveillance
Dans ces deux spectacles, on retrouve la même bienveillance pour des personnages spontanément familiers, le même décor minimaliste pour laisser place aux corps, et surtout la même mécanique consistant à passer d’un personnage à l’autre en une fraction de seconde grâce à une gestuelle et à des inflexions de voix millimétrées. « C’est comme une chorégraphie, illustre avec justesse le comédien. C’est complexe à mettre en place mais tellement agréable à jouer. » Cette jonglerie théâtrale bien rythmée fonctionne tout autant pour le « feel good show » Dans la peau de Cyrano que pour le récit familial doux-amer Le Bois doit je suis fait.
Porteur de ces deux jolies histoires et de la performance de se glisser tout au long de la semaine dans la peau de multiples personnages, Nicolas Devort, se dit, à 42 ans, un « comédien heureux ». On le comprend.
Dans la peau de Cyrano, de et avec Nicolas Devort, jusqu’au 17 mars, au Théâtre du Lucernaire, Paris 6e. (Le mardi, le spectacle est en anglais). Puis en tournée.
Le Bois dont je suis fait, de et avec Julien Cigana et Nicolas Devort, jusqu’au 25 mars, les dimanches à 20 h 30 et les lundis à 21 h 15, au Théâtre de Belleville, Paris 11e.
Légende photo :
Nicolas Devort à Paris, en 2016. DAVID ROUSSEAU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2019 6:11 PM
|
Par Nathalie Simon dans Le Figaro le 22/02/2019
ENQUÊTE - Certains mentalistes et prestidigitateurs utilisent de nouveaux outils pour créer des effets spectaculaires. D'autres misent sur les techniques ancestrales. Tour de piste.
Johnny Hallyday adorait solliciter des magiciens pour ses entrées en scène. En 1992, il épatait ainsi ses fans en surgissant sur la scène de Bercy suspendu dans les airs dans une cage d'ascenseur transparente. Un «numéro» qui avait d'abord été créé pour David Copperfield par le Français Jean Regil avec le concours de John Gaughan, un Américain fabricant d'équipements pour les magiciens. Il y a trois ans, Enzo «l'insaisissable» faisait apparaître un hélicoptère au Casino de Paris. Ces jours-ci, en Allemagne, les Ehrlich Brothers, Chris et Andreas, font jaillir une moto d'un iPad grandeur nature et disparaître des belles-mères. Pour ces rois de l'illusion, les nouvelles technologies sont une source majeure d'inspiration.
«On est dans l'air du temps, on s'adapte à ce qui est autour de nous», analyse le magicien humoriste François Martinez, qui utilise un drone dans Menteur?, son «one-man-show magique». Depuis qu'ils ont attiré près de 40.000 personnes à l'Arena de Francfort, les Ehrlich Brothers sont inscrits dans le Guinness des records. Ils inventent eux-mêmes leurs tours, Chris a un diplôme de pyrotechnicien. «Les magiciens pratiquent un art qui tient compte de l'époque dans laquelle ils vivent», confirme Thierry Collet, directeur du Magic Wip, à La Villette (Paris). Ce dernier fait feu de tout bois: il manie à la fois les cartes comme autrefois et, grâce à la technologie, se laisse enfermer dans une boîte transpercée par mille pointes acérées.
Art de l'escamotage
Selon lui, la «magie nouvelle», rapprochée, intimiste avec du close-up, et la «magie moderne» où l'accent est mis sur le spectaculaire «se complètent». «Notre cerveau différencie le réel et le numérique, comme au cinéma», assure Thierry Collet. «La magie nouvelle ne fait pas forcément appel aux nouvelles technologies, les attentes du public ne sont pas les mêmes», tempère Raphaël Navarro, membre de la Compagnie 14: 20. Les Ehrlich Brothers mêlent les deux avec bonheur, séduisant ainsi un public âgé de 7 à 99 ans. «Pour leur prochain spectacle, ils veulent faire voler une Lamborghini, ils s'entourent de personnes qui ont des approches techniques différentes», indique Hilde du Rochez, leur manager.
Cette course aux effets grandioses est cyclique. Le célèbre illusionniste français du XIXe siècle Robert-Houdin, qui a révolutionné la magie et était un inventeur curieux des sciences, pratiquait déjà l'art de l'escamotage. Elle a culminé dans les années 1980-1990 avec David Copperfield ou Dani Lary avant de revenir en force aujourd'hui. «Faire voler un objet ou deviner les pensées évolue en fonction des époques et des pays, mais cela reste. On choisit un “réel”, objet, animal ou image, et on le détourne», explique Raphaël Navarro. François Martinez renchérit: «Les effets spectaculaires doivent coller au personnage. Les gens ont envie de croire que c'est vrai, mais au fond d'eux, ils savent qu'il y a un truc ; mon travail est de créer le doute. Je suis dans l'échange, pas dans la démonstration de force.»
«Mon travail est de créer le doute. Je suis dans l'échange, pas dans la démonstration de force»
François Martinez
Malgré cette recherche de spectaculaire, la magie intimiste résiste. Avec succès. De jeunes magiciens comme Yann Frisch, champion du monde de magie depuis 2012, fascinent avec un simple jeu de cartes. Remarqué dans l'émission «La France a un incroyable talent», Gus démontre en toute simplicité comment on peut tricher au poker, et Scorpène manipule son monde avec ses dons de télépathie. Au fond, pour Thierry Collet notamment, l'important est que la magie nous relie à des mystères et «raconte une histoire».
Forts de cet objectif, Raphaël Navarro et ses partenaires remettent«au goût du jour» d'anciennes technologies comme celles de Héron d'Alexandrie, célèbre au Ier siècle pour ses automates, ses machines et ses effets spéciaux. «Les images en 3D de Star Wars existent depuis le XIXe siècle», rappelle Raphaël Navarro. L'imitateur-chanteur Michaël Grégorio a fait appel à la Compagnie 14: 20 pour s'entourer de «fantômes, chimères et mirages» dans Voix libres, son prochain spectacle au Théâtre du Rond-Point. L'artiste, qui imite Johnny Hallyday, Louis Armstrong ou Henri Salvador, entend «rendre l'irréel tangible et la réalité improbable» avec des experts en magie.
La mode du numérique
«Le public a l'impression qu'il s'agit de nouvelles technologies, mais elles sont parfois anciennes ou proviennent d'objets tout simples», observe Raphaël Navarro. «On peut mêler les deux», confirme François Martinez. Effectivement, le spectateur n'y voit que du feu : «On a intérêt à affirmer l'absence de signes technologiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas», remarque Thierry Collet. «C'est la mode d'utiliser les outils du quotidien, iPad, iPhone… Mais pas forcément pour produire des effets spectaculaires», ajoute Raphaël Navarro.
«La magie moderne est plus centrée vers l'intime, mais quelque part, l'émotion est assez similaire quelle que soit la magie, c'est juste le réel qui bascule»
Raphaël Navarro
Quelle que soit leur tendance, les magiciens, illusionnistes et autres prestidigitateurs s'accordent sur un point: l'essentiel est d'être surpris, ébloui et ému. «La magie moderne est plus centrée vers l'intime, mais quelque part, l'émotion est assez similaire quelle que soit la magie, c'est juste le réel qui bascule», assure Raphaël Navarro. «Il ne faut pas opposer la magie moderne et la magie nouvelle à un moment où on est en mal d'utopie», juge Thierry Collet. «Ce qui est beau, c'est que la magie et l'illusion nous parlent parfois plus que la réalité», signale justement Raphaël Navarro.«On veut transformer les adultes en enfants», lâchent Chris et Andreas Ehrlich.
Tandis que François Martinez conclut: «Quelles que soient l'échelle et l'économie dans la magie, on transporte le public. Comme en musique, seul l'instrument est différent.» Les nouvelles technologies n'ont pas que du bon, de nombreux magiciens déplorent ceux - certains s'en font une spécialité - qui dévoilent les «trucs» sur les réseaux sociaux. Comme le disent entre autres Thierry Collet et Raphaël Navarro, la magie repose d'abord sur le secret.
Légende photo : Wade in the Water, conçu par Raphaël Navarro, de la Compagnie 14: 20. - Crédits photo : Giovanni Cittadini cesi.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2019 10:47 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 23.02.2019 Attention, les sorcières reviennent !
Depuis quelques années, cette figure féminine venue du Moyen Age, qui symbolise la femme subversive, séduit à la fois le théâtre, le cinéma et l’édition.
« Walpurgis Sabbath », illustration d’Adolf Munzer en couverture du magazine « Jugend » (1909). MARY EVANS / RUE DES ARCHIVES
« Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ! » Le slogan a été lancé par les féministes italiennes des années 1970, mais il résonne aujourd’hui avec une force nouvelle. Car les sorcières sont partout : depuis quelques mois, cette figure féminine venue du Moyen Age, dans ce qu’elle concentre du regard porté sur les « bonnes » ou les « mauvaises » femmes, fait un retour fracassant.
A l’heure de #metoo et de la troisième vague féministe, le phénomène, que l’on voyait monter depuis plusieurs années, s’est cristallisé avec la sortie du livre de Mona Chollet, Sorcières. La puissance invaincue des femmes (Zones, 2018).
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Comment les sorcières sont devenues des symboles féministes
C’est le succès d’édition le plus inattendu de cet hiver 2018-2019 : déjà plus de 75 000 exemplaires vendus, un chiffre sans aucune mesure avec les précédents livres de l’auteure publiés aux éditions Zones. On s’offre l’ouvrage de Mona Chollet entre amies, comme un viatique sur la voie d’une libération qui, pour les femmes, est loin d’être terminée. « Rebelle obstinée, insaisissable » Il suscite des discussions enflammées mais il n’est pas le seul : le magazineL’Histoire, dans son numéro de février, consacre un dossier au sujet, sous le titre : « L’Inquisition contre les sorcières, un féminicide ? » De jeunes plasticiennes, commissaires d’expositions ou écrivaines, comme Camille Ducellier, Anna Collin ou Chloé Delaume, s’emparent du mythe, avec une dimension queer affirmée. Les ouvrages de la collection « Sorcières », ouvertement féministe, créée par Isabelle Cambourakis en 2015 aux éditions qui portent son nom, sortent du cercle des spécialistes, pour atteindre un plus large public. « Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure, note Mona Chollet. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. » En janvier 2018, quatre filles sorties de l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurelia Lüscher et Itto Mehdaoui, ont créé une pièce formidable, Le Monde renversé, qui déconstruit joyeusement et férocement la manière dont cette figure fantasmée de la sorcière médiévale continue à imprégner tout un imaginaire, avec les multiples conséquences que cela peut entraîner sur la vie des femmes. Depuis sa création, le spectacle ne cesse de tourner, un peu partout en France, et il poursuivra sa route pendant la saison 2019-2020. Pour ces jeunes femmes d’aujourd’hui, excellentes comédiennes qui n’avaient pas envie de rentrer dans le jeu du désir, souvent assez pervers, avec un metteur en scène qui est le plus souvent un homme, le personnage de la sorcière s’est imposé avec évidence. « C’est une figure populaire, qui concentre tous les sujets qui se nouent autour de la question de l’oppression des femmes : le corps, la sexualité, la maternité, le patriarcat, le développement du capitalisme », observent-elles. Article réservé à nos abonnés Lire aussi A Dijon, sabbat de sorcières médiévales et de sorciers africains « Etres démoniaques » Les filles du collectif Marthe (nom qu’elles ont donné à leur compagnie) se sont appuyées fortement, pour créer leur spectacle, sur un livre qui a fait date : Caliban et la sorcière, signé en 2004 (Entremonde, 2017) par une universitaire américaine d’origine italienne, Silvia Federici, qui fait le lien entre les féministes de la deuxième et de la troisième vague. La thèse, audacieuse et convaincante, est que l’oppression des femmes, sous couvert de chasse aux sorcières, accompagne la naissance du capitalisme dans l’Europe de la Renaissance. « La chasse aux sorcières constitua un tournant dans l’existence de femmes, analyse l’essayiste. Leur définition comme êtres démoniaques, et les pratiques atroces et humiliantes auxquelles tant d’entre elles furent soumises, laissèrent des traces indélébiles sur la psyché collective féminine et sur la perception que les femmes pouvaient avoir de leurs capacités. La chasse aux sorcières anéantit tout un monde de pratiques féminines, de rapports collectifs et de systèmes de connaissances, qui avait constitué le fondement du pouvoir des femmes dans l’Europe précapitaliste, ainsi que la condition de leur résistance dans la lutte contre le féodalisme. Un nouveau modèle de féminité émergea à la suite de cette défaite : la femme est l’épouse idéale, passive, obéissante, économe, taiseuse et chaste. » La raison en est à la fois simple et abyssale : le capitalisme naissant avait besoin du corps des femmes, comme de machines pour la reproduction des travailleurs. « La chasse aux sorcières institutionnalisa le contrôle de l’Etat sur le corps des femmes », conclut Silvia Federici. « Retournement du stigmate » La récupération du personnage de la femme maléfique par les jeunes féministes d’aujourd’hui, dans la lignée de leurs aînées – à commencer par l’écrivaine et militante américaine Starhawk, qui se revendique comme sorcière – rentre donc bien dans une stratégie de « retournement du stigmate » et d’empowerment(« émancipation ») féminin, souligne Isabelle Cambourakis. Elle cite une autre pionnière, la philosophe belge Isabelle Stengers, qui, dans son livre La Sorcellerie capitaliste (La Découverte, 2007), notait qu’« il s’agissait d’un devenir, d’une recréation de la puissance de penser et d’agir là où n’existaient jusque-là que des victimes ». Article réservé à nos abonnés Lire aussi « L’émancipation des femmes est une histoire sans fin » De là au glissement vers le queer, il n’y a qu’un pas que franchissent sans hésiter de jeunes artistes et activistes, pour qui la sorcière est aussi un emblème pour déconstruire et détourner les stéréotypes de genre. En 2010, la plasticienne, réalisatrice et militante écoféministe Camille Ducellier a fait le portrait de plusieurs de ces queer witches dans son film Sorcières, mes sœurs. On peut y voir Chloé Delaume (auteure notamment des Sorcières de la République, Seuil, 2016) ou Thérèse Clerc, autre pionnière du féminisme français, mais aussi les membres du collectif Urbanporn : en 2010, il avait fait parler de lui en repeignant en rose la statue de Jeanne d’Arc, à Lille, et en la recouvrant de slogans tels que « God save the queers » ou « Je ne suis pas la pucelle catho facho pour qui on me fait passer ». « Intersectionnalité » de différentes luttes Camille Ducellier envisage la sorcière comme une « alliée politique ». Non seulement parce qu’elle incarne la femme subversive par excellence, mais aussi en raison de ses liens avec la nature, avec des pratiques païennes et préchrétiennes qui ramènent à un besoin de rituels, de formes de spiritualité autres que strictement religieuses, face à une rationalité moderne qui, dans la jeune génération, apparaît de plus en plus comme ayant failli. Pour elle comme pour beaucoup d’autres, la sorcière est devenue la figure de l’« intersectionnalité » de différentes luttes : féministe, queer, anticapitaliste, écologiste… La chanteuse des Rita Mitsouko, Catherine Ringer, femme libre et forte s’il en est, avait déjà tout dit, en 2000, avec sa chanson La Sorcière et l’Inquisiteur : « La sorcière savait/Comment s’élever/Comment prier, comment soigner,/Empoisonner/Comment chanter/Et comment danser (…) Ils sont venus la prendre la nuit/Ils l’ont traînée par la chevelure/Jusqu’à la chambre de torture. » La suite de la chanson raconte comment la sorcière a séduit son inquisiteur, grâce à ses sortilèges. « Le Monde renversé », de et par Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurelia Lüscher et Itto Mehdaoui. Du 12 au 15 mars au Théâtre des 13 vents de Montpellier ; du 9 au 11 avril à la Comédie de Saint-Etienne ; les 9 et 10 mai à La Passerelle à Gap ; du 15 au 21 mai au Théâtre des Célestins de Lyon. « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », de Mona Chollet (Zones, 2018). « Caliban et la sorcière », de Silvia Federici (Entremonde, 2017). « L’Histoire », n° 456, février 2019 : « L’Inquisition contre les sorcières, un féminicide ? », 6,40 €. Editions Cambourakis, collection « Sorcières », avec notamment « Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique », de Starhawk (2015). Travaux de Camille Ducellier : Camilleducellier.com Liens vidéo : Queer Week : https://youtu.be/erR7RII8Cbw Le Monde renversé, spectacle théâtral du collectif Marthe (bande annonce) : https://youtu.be/nzjXH2a3VRg Isabelle Cambourakis, présentation de la collection Sorcières (littérature féministe) https://youtu.be/SwkRNgmMbBM Notre lien avec la Nature - Conversation avec Starhawk : https://youtu.be/BKeBcuDzqDE Chanson : La Sorcière et l'Inquisiteur par les Rita Mitsouko (2001) : https://youtu.be/Oiy9Cetg69c Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 8:00 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello Et ma cendre sera plus chaude que leur vie, d’après les carnets de notes de Marina Tsvetaeva, mise en scène de Marie Montegani
Et ma cendre sera plus chaude que leur vie, d’après les carnets de notes de Marina Tsvetaeva, adapté du recueil Vivre dans le feu présenté par Tzvetan Todorov, traduction de Nadine Dubourvieux (Editions Robert Laffont), mise en scène de Marie Montegani
Marina Tsvetaeva (1892-1941) rejoint les grands poètes russes du XX è siècle, reconnue en France tardivement dans les années 1980-1990, à côté des contemporains – Pasternak, Maïakovski, Mandelstam, Akhmatova -, essuyant les épreuves douloureuses du destin d’un pays, entre exaltation et tragédie.
Sa poésie est lyrisme, rigueur et éthique, goût pour la musique des mots– oralité et sonorité rythmique -, mettant à bas la tradition. Lyrique et passionnée, la femme de lettres s’est heurtée continuellement à l’engagement idéologique révolutionnaire.
Issue d’une famille d’intellectuels aisés, elle se consacre tôt à la poésie, subissant les privations de la Révolution et de la guerre civile, puis l’exil, vivant dès 1925 dans le milieu émigré parisien qui la rejette pour ses vues politiques et sa poésie exaltée.
L’indépendance et la solitude la placent à contre-courant de son époque, se disant elle-même révolutionnaire en s’insurgeant contre les Rouges. Elle passe sa vie dans le besoin, sans cesser d’écrire, éprouvant un malaise face au quotidien mesquin.
En étrangère, elle rentre en U.R.S.S. en 1939 et se suicide en 1941 après avoir vécu l’arrestation des siens, devenus rapidement prosoviétiques au moment de l’exil, sa fille Alia déportée et son mari, Serge Efron, membre du N.K.V.D., exécuté en 1941.
Les quinze carnets, que l’ouverture des archives de Marina Tsvetaeva a fait connaître au public en 2000, avec ses journaux, couvrent la période de 1913 à 1939.
Les Carnets révèle une écriture fragmentaire et inachevée – une poésie signée d’aphorismes, de formules provocatrices, de jeux de mots – lettres, poèmes et rêves.
Illuminée par la présence de sa fille Alia, elle exalte un émerveillement d’amour maternel exclusif qui va jusqu’à négliger la seconde fille Irina qui mourra de maladie.
L’Allemagne est le pays des poètes préférés – Goethe, Heine, Hölderlin. Elle voue une passion pour Boris Pasternak dont elle hésite à ce que son fils porte le prénom, et grâce à lui, entre en relation épistolaire avec Raine Maria Rilke en 1926 – reconnaissance mutuelle, passion pour l’inspiration poétique et amour expressif.
L’écriture signifie vivre, et cela dès « l’Age d’argent » russe – les deux décennies précédant la révolution de 1917 – une poésie à caractère autobiographique.
Cette poésie intense – feu intérieur et conviction enflammée -, un choix de vie existentiel attentif à l’âme qui vibre, est magnifiquement portée par l’art déclamatoire de la comédienne Clara Ponsot, dirigée par la metteure en scène Marie Montegani.
Au lointain, un écran vidéo où défilent des images à dominante bleue et sombre, extraites de Jamais la mer se retirede Ange Leccia – écume, vagues, flux et reflux- désigne le paysage à l’intérieur duquel se tient, assise sur une chaise, un carnet dans les mains jointes, l’actrice digne, robe sombre, dos droit et visage lumineux.
Il émane de Clara Ponsot une ferveur de vivre, un enthousiasme sensuel à distiller et à exprimer, à travers la voix d’abord et le port d’un corps ensuite, un goût affirmé pour l’art de dire – éprouver, sentir et ressentir – cette belle énigme d’être au monde.
Véronique Hotte
Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 – Paris, du 13 février au 6 avril, du mardi au samedi à 21h. tél : 01 45 44 57 34
Crédit photo : Xavier Cantat

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 2:59 PM
|
Enquête
Où en sont les scènes nationales : le projet (1/4)
PUBLIÉ LE 22.02.2019
Équipements phares de la décentralisation culturelle, les scènes nationales sont devenues l'un des principaux moteurs du dynamisme créatif des territoires. Premier volet de notre enquête sur ces lieux pluridisciplinaires : comment développer un projet culturel de territoire ? (1/4)
© MC2 Grenoble
A l'occasion de la 3e édition d' "Effet scènes", la manifestation qui met en lumière, jusqu'au 19 mars, le réseau des 74 scènes nationales, nous avons souhaité revenir sur l'engagement de ces piliers de la décentralisation culturelle, devenus l'un des éléments incontournables du dynamisme culturel des territoires. Cette semaine, premier volet de notre série sur ces équipements pluridisciplinaires : comment développer un projet culturel de territoire ? Le témoignage de Jean-Paul Angot, directeur de la MC2, scène nationale de Grenoble, président de l’Association des scènes nationales.
Le territoire de la MC2 est vaste car il s’étend de sa proximité immédiate aux quartiers de la ville-centre, du bassin grenoblois à l’ensemble du département de l’Isère. 86% du public identifié vient de celui-ci, 14 % vient des départements voisins Savoie, Drôme, Rhône, Ardèche, voire de Haute-Savoie. Ce public se répartit comme suit : 73% d’individuels et 27% de publics de groupes. Ils réservent en ligne à 31%.
Depuis janvier 2017, la MC2 est intégrée à la Métropole Grenoble-Alpes Métropole : 36% des habitants de la métropole sont grenoblois, 64 % vivent donc dans les 48 autres communes, c’est une clef de répartition que la scène nationale doit avoir en permanence à l’esprit. Ce sont 49 communes qui forment le bassin grenoblois, le public individuel de la MC2 en est à 80% issu (dont 45% de Grenoblois). Mais une analyse plus fine des spectateurs dits « en groupes » (établissements scolaires, associations...) rééquilibre fortement le rapport au territoire dans son ensemble puisque ceux-ci sont à part égale 48% isérois et à 48% métropolitains. C’est la traduction directe de l’ampleur des actions menées par les services des relations publiques et de la communication.
"Aller au delà de son attractivité naturelle"
L’axe prioritaire de la scène nationale MC2 est d’aller au-delà de son attractivité naturelle, qui concerne celles et ceux qui la fréquentent régulièrement. Il s’agit d’amplifier les démarches vis-à-vis d’un public qui doit avoir une information et un accès facilités, quelles que soient les distances culturelles, sociales ou géographiques qui les éloignent de notre bel outil.
La présence d'artistes contribue fortement à l’ancrage de la MC2, comme de l’ensemble du réseau des scènes nationales
Parce qu’elle est avant tout une grande maison de création, la présence régulière d’artistes génère des actions multiples, de la rencontre au bord du plateau aux ateliers de pratique, de résidence d’écriture, de parcours de jeunes spectateurs et de projet de création avec des praticiens amateurs. Égrener dans le détail ces actions et projets serait fastidieux et tiendrait de l’autojustification. Il nous faut ici remercier les artistes pour leur disponibilité car elles, ils contribuent fortement à l’ancrage de la MC2, comme de l’ensemble du réseau des scènes nationales.
"Plateforme, scolaires, itinérance : trois exemples d'actions"
Ville universitaire, forte de plus de 60000 étudiants, le terrain est propice, l’enjeu de taille. La nouvelle dimension de l’Université Grenoble-Alpes, dotée d’une Vice-Présidence Culture, confère aux acteurs culturels de la Métropole une responsabilité de réussir à mettre en œuvre une volonté commune et partagée. Un projet de plateforme numérique commune aux établissements culturels de la Métropole a reçu le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et de l’Université, qui finance une étude pour définir son contenu et les conditions de sa mise en place. L’initiative de ce projet est le résultat d’une collaboration étroite entre les deux scènes nationales du bassin grenoblois : l’Hexagone, scène nationale Arts Sciences de Meylan, et la MC2. Complémentarité de projets et conjonction d’actions fondent la relation étroite qui réunit ces deux établissements.
Les acteurs culturels de la Métropole Grenoble-Alpes ont la responsabilité de réussir à mettre en œuvre une volonté commune et partagée
L’action « Vive les vacances », dont la MC2 est partenaire, réunit les établissements culturels de la Métropole grenobloise afin de proposer des spectacles jeune public durant les vacances scolaires. La Rampe d’Echirolles, scène conventionnée pour la danse, et la MC2 coordonnent leur programmation danse et musique classique, facilitant l’accès de leur public respectif. Les liens forts avec le Musée de Grenoble, la Cinémathèque, l’Université inter-âges du Dauphiné permettent de multiples actions concertées.
Depuis 2004, année de sa réouverture, la MC2 a mis en place sur l’ensemble du département les « Tournées en Isère » : 4 à 5 spectacles sillonnent ainsi chaque saison les routes pour plus de trente représentations. Celles-ci s’accompagnent toujours d’une action de sensibilisation et d’incitation à fréquenter les salles de la MC2. Il s’agit d’aller vers, mais aussi de faire revenir.
"Tisser un lien fort avec les partenaires du territoire"
Faciliter l’accès au plus grand nombre n’est pas simplement affaire de stratégies et d’outils de communication, c’est aussi avoir la capacité de créer une relation directe avec le public potentiel. Les quatre personnes de l’équipe des relations publiques sont mobilisées pour atteindre ce but. Mais devant l’ampleur de la tâche, nous avons engagé auprès de nos spectateurs des actions spécifiques, incarnées par ce groupe particulier, les « Messagers spéciaux ». Ils ont pour tâche de mobiliser des personnes qui ne sont jamais venues à la MC2, de leur donner envie d’assister à des spectacles, de diffuser et de relayer la communication de la MC2 à son réseau. Ils sont à la fois des porte-paroles et des facilitateurs quant au choix et à la réservation. A ce jour, ce sont trente personnes de 18 à 50 ans et plus qui ont rejoint cette communauté.
Faciliter l’accès au plus grand nombre n’est pas simplement affaire de stratégies, c’est aussi avoir la capacité de créer une relation directe avec le public potentiel
Réussir cet ancrage, c’est avant tout tisser un lien fort avec les partenaires du territoire, sans hégémonie, et en complémentarité avec l’ensemble des acteurs culturels nombreux et vaillants sur ce « Territoire Dauphinois ».

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2019 1:41 PM
|
Petit par la taille, grand par le mythe, tel est le « Petit bonhomme en papier carbone »
23 FÉVRIER 2019 | PAR MATHIEU DOCHTERMANN dans Toutelaculture.com
Cette semaine la compagnie Le Théâtre de la Pire Espèce était de passage à Paris, au Théâtre aux Mains Nues, pour présenter Le petit bonhomme en papier carbone, une création de 2012 qui a peu été vue en France. Voyage en couleurs et en noir et blanc au travers des bobards de son héros Ethienne-avec-un-H, le spectacle se présente comme une exploration des mythologies familiales et du rapport père-fils. Le faux se mêle indistinctement au vrai sur la scène où le théâtre d’objets le dispute à l’incarnation du comédien, tandis que les dessins à l’encre noire illustrent l’action. Très entraînant, une vraie performance d’acteur !
On ne sait pas très bien ce que c’est, ni quand ça commence. On est au spectacle, c’est sûr : des rideaux dessinés en noir et blanc sur un cadre font comme un semblant de castelet, il y a un drôle de bonhomme debout derrière une table noire qui manipule des feuilles de papier, il y a un autre bonhomme au fond à jardin entouré de boutons et d’ordis qui s’occupe de la musique crachée par les enceintes.
Tout ça, salle allumée, pendant que le public s’installe.
Le premier bonhomme brandit tour-à-tour des feuilles sur lesquelles sont écrits des mots de bienvenue, ou tracés des dessins sur lesquels sont habilement rappelés la nécessité d’éteindre son portable, etc.
On sent d’emblée que cela se passera sur le ton de l’humour, que cela sera échevelé voir un peu bordélique, qu’il faudra s’attendre à ce que quelques conventions soient malmenées au passage.
Le premier bonhomme, c’est Francis Monty, du Théâtre de la Pire Espèce, que la France peut tout-à-fait envier à ses cousins québécois. Interprète principal du Petit bonhomme en papier carbone, il en est aussi l’auteur et le metteur en scène.
L’histoire d’Ethienne, c’est celle d’un enfant qui cherche son rapport avec son père, qu’il nous figure comme un homme-vache, aussi disert et aussi intellectuellement éveillé que le bovin qui sert à le représenter sur la table de manipulation. D’un enfant de 10 ans qui pourrait rivaliser avec les plus grands personnages d’affabulateurs, un Baron de Münchhausen en puissance. Dans la mythologie qu’il se construit, impossible de démêler le vrai du faux.
Certainement, il n’est pas né du lait de la Lune, tombé de son œil crevé un soir de tempête. Selon toute vraisemblance, son meilleur ami n’a pas fini par vivre dans un casier du collège transformé en laboratoire, et n’a pas mis au point un sérum de vérité. A-t-il réellement 56 frères ? A-t-il été transporté par la Lune jusqu’à la maison du vendeur d’assurances ? A-t-il, un jour, réussi a se faire passer pour Dieu en grimpant sur le toit du garage ?
Ce jeu de vrai-faux, ces constants jeux de double et jeux de dupes, sont absolument réjouissants, et ils permettent un détour métaphorique par les territoires de l’entre-deux-vérités pour ausculter un endroit ô combien fertile dans l’art et la littérature, la relation entre le père et son fils.
Au soutien de ce texte touffu, le jeu de Francis Monty ne pouvait pas être sur la réserve. Il ne pouvait s’agir d’autre chose que de mettre le turbo, à la hauteur du délire galopant du gamin, pour courir après les images et jouer avec la réalité. Branché sur du 440V, l’interprète en situation de solo se retrouve à glisser d’un personnage à un autre, en même temps qu’il a le rôle de narrateur… et qu’il est lui-même, par moment, Ethienne, avec sa capuche rabattue sur la tête.
Les personnages comme les décors sont convoqués avec la technique du théâtre d’objets : père figuré par une vache miniature en plastique, mère figurée par un élégant soulier à talon… Plus conteur que manipulateur, Francis Monty n’arrive pas toujours, dans l’intensité du jeu, à déplacer le focus de lui aux objets. Cela n’est pas terriblement gênant. L’intensité reste.
Pour compléter son arsenal, de nombreux dessins à l’encre noire sont aussi employés pour illustrer le récit, voir pour donner forme à certains personnages. Ethienne lui-même se retrouve parfois dans ce monde cartoonesque en deux dimensions. On ose dire que ces passages là sont très réussis, et qu’ils donnent une esthétique forte au spectacle, et qu’on regrette qu’ils soient presque absents dans la seconde moitié…
Pour venir à l’appui de ce texte haut en couleur et d’une interprétation qui ne l’est pas moins, et renforcer les effets comiques, le comparse Stéphane derrière son petit synthétiseur vient ajouter son grain de folie à une pièce qui n’en manque déjà pas. Ses appels au micro dans le personnage de la secrétaire du collège valent leur pesant de cacahuètes… Sa capacité à interagir en direct, à déplacer l’attention, à participer à malmener le quatrième mur (autant dire qu’il n’y en a pas, on aura plus vite résumé la situation), sont des atouts précieux.
Le jeu fait une utilisation intelligente de l’espace : initialement un peu trop concentré sur la table, il arrive à se déployer dans la dimension verticale, avec notamment des dessins accrochés au cadre, et en profondeur, l’utilisation à vue de la table d’accessoires à fond de scène y contribuant fortement. On regrette qu’il ne trouve pas le moyen de s’étendre sur les côtés.
Au final, un spectacle qui aurait peut-être pu être un peu resserré, mais qui est éminemment bien écrit, à la fois très drôle, très imagé, et très poétique. Comme une BD visuelle et sonore qui aurait débordé de ses cases pour mettre la pagaille sur une scène de théâtre.
Définitivement, il faut suivre de près les tournées de ce Théâtre de la Pire Espèce en France…
Texte, mise en scène : Francis Monty
Interprétation : Francis Monty et Étienne Blanchette
Musique originale : Mathieu Doyon
Assistance à la mise en scène : Manon Claveau
Scénographie : Julie Vallée-Léger
Dessins : Francis Monty et Julie Vallée-Léger
Collaboration à la création : Étienne Blanchette
Conseil lumières : Thomas Godefroid
Codirection technique : Nicolas Fortin
Codirection technique et direction de production : Clémence Doray
Visuels : © Eugène Holtz
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...