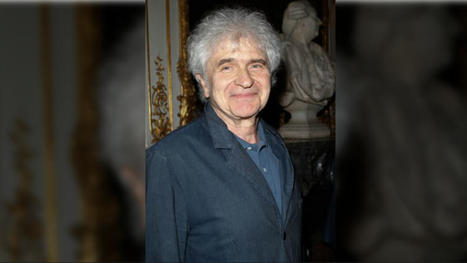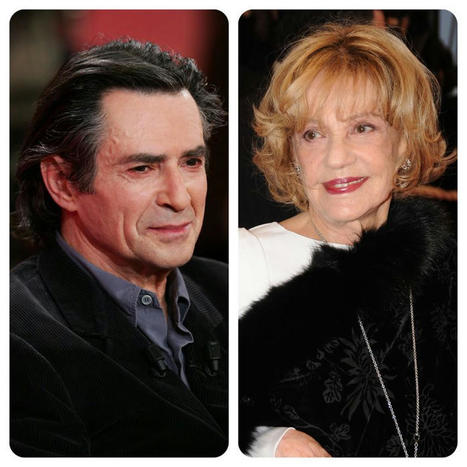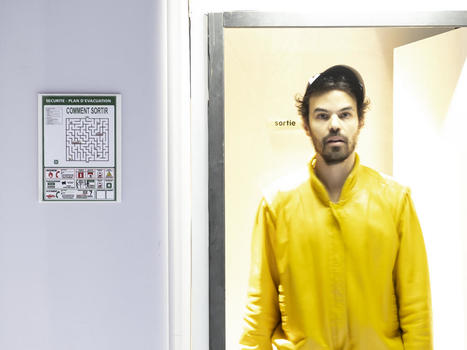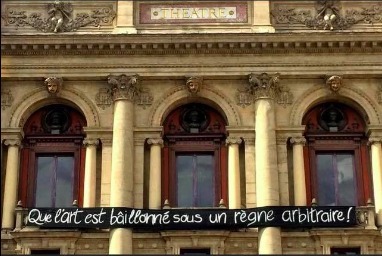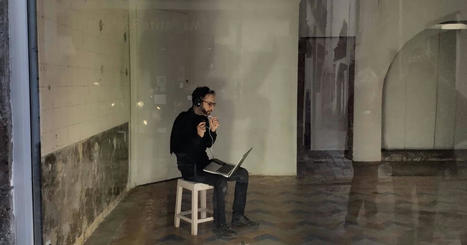Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 20, 2021 3:19 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 19 mars 2021 Dissection d’une chute de neige de Sara Stridsberg, traduction du suédois de Marianne Ségol-Samoy (éditions de L’Arche), mise en scène de Christophe Rauck.
Les reines régnantes et puissantes ne sont pas si rares en Europe, au-delà des britanniques notoires, ainsi la reine de Suède Christine, dernière représentante de la dynastie des Vasa, qui se fit couronner « roi » en 1650, six ans après avoir pris le pouvoir assumé par le chancelier. Toute reine est perçue comme épouse de roi, non détentrice du pouvoir souverain, sinon par délégation et provisoirement. Dans une perspective masculine gouvernée par les préjugés et les fantasmes, elle est figure de débauche, de Cléopâtre à Marguerite de Valois, la « reine Margot ». A l’opposé, froideur et puritanisme, se tient Elizabeth I ère d’Angleterre, « reine vierge » et redoutée. La pièce de Sara Stridsberg s’inspire de l’histoire de la reine Christine de Suède (1626-1689), enfant du roi Gustave II Adolphe, tué au champ de bataille en 1632. A six ans, elle accède au trône, élevée en garçon, elle gomme la féminité dans ses vêtements et son comportement. Solitaire anticonformiste, elle déroge aux conventions, refusant de se marier ou d’avoir un enfant. Refusant une identité duelle, elle est entière, perçue comme « anormale », selon les normes du corps social et religieux. Diplomate et mécène, passionnée des arts et des lettres, amie de Descartes, elle abdique à vingt-huit ans, en 1654, avant de se convertir au catholicisme et de quitter son pays pour Rome. La nation suédoise plutôt protestante juge qu’elle a trahi son pays. Et pourtant, en monarque qui rêve de rapprocher la vertu personnelle et la qualité humaine de la fonction royale, elle estime, tel Platon dans la République, qu’« il faudrait pour le bonheur des Etats que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes ». Cette opinion se vérifie dans ces étranges associations entre « despote éclairé » et penseur célèbre, Frédéric II et Voltaire, ou ici, la Fille Roi et le Philosophe, rappel lointain et cocasse de Descartes que la première a fait venir réellement d’Europe et qui s’ennuie dans le froid d’un exil hivernal et neigeux. Habib Dembélé dans le rôle, pantin mécanique et facétieux, singulier et provocateur, est excellent. Quand il lui demande si elle est homme ou femme, reine ou roi, l’élève dit avoir pris le meilleur des deux sexes. Il répond: « Je comprends. Vous voulez être une anomalie. Bien sûr. Vous voulez être quelque chose qui n’existe pas, mais j’ai peur que ce soit votre perte puisque, par définition, vous ne pouvez pas exister en dehors de… l’existence. Soit vous existez soit vous n’existez pas.. Alors vous allez à l’encontre du monde et de la théorie du monde, de tout ce à quoi nous croyons. » Une remarque d’humour : la maison royale est une anomalie – illusion aveuglant des peuples entiers. Le titre de la pièce de Sara Stridsberg, Dissection d’une chute de neige pose question; un signe de résistance, pour le clown-philosophe, signifiant « Que tout est possible. Que vous n’avez même pas à accepter la neige qui tombe dehors. Vous devez disséquer chaque idée, chaque chute de neige et la démonter en pensée, la couper en morceaux comme le corps mort sur la civière. » Une incitation à la réflexion, à la volonté de connaître, de raisonner et de ressentir – la vraie liberté. Entre Maeterlinck et le théâtre élisabéthain, note Christophe Rauck, artiste inspiré qui quitte la direction du Théâtre du Nord pour celle du Théâtre Nanterre-Amandiers, et dont la création de Dissection d’une chute de neige correspond à son départ de Lille, la prose poétique de Sara Stridsberg se penche sur le pouvoir au féminin, à partir de la figure historique suédoise sulfureuse. La sexualité, le rapport au pouvoir, la provocation, le féminisme, la question du genre, la solitude existentielle sont les thèmes de prédilection de la Fille-Roi, et ceux de l’auteure Sara Stridsberg. Atmosphère de conte : « Le temps est éternel, un non-temps. Peut-être le présent, peut-être est-ce un conte ou peut-être un siècle passé, froid et violent. Un royaume en Europe. Les derniers temps de pouvoir d’un souverain avant qu’il ne s’en aille. Fleuves figés, oiseaux qui meurent de froid en plein vol et qui tombent du ciel. Crasse. Maladies. Famine. Sang. Violence. Froid. Non-humains. » La pièce est une variation à sept personnages sur la Fille Roi, opposée au mariage et à l’enfantement, attirée par la chasse, l’érotisme, les livres, les étoiles, prête à déposer sa couronne. Dans la neige et sa blancheur glacée, un paysage d’arbres et de brumes, l’esprit vif et décidé, la Fille RoI de belle énergie arpente l’espace de la représentation du pouvoir royal au féminin. Marie-Sophie Ferdane dans le rôle de la figure souveraine est un personnage de conte, romanesque dans un monde imaginaire de fastes, d’héritages merveilleux et d’alliances prestigieuses -, portant une magnifique robe de princesse – costumes de Fanny Brouste – avec grâce et distance amusée. La scénographie d’Alain Lagarde, inventive et ludique, propose au regard une boîte rectangulaire blanche qui traverse la plateau de jardin à cour, mobile – avancées et reculs – face public, posée de biais ou perpendiculaire, elle contient la blancheur tombée du monde – volume neigeux -, l’espace même du palais de la souveraineté, ses appartements, comme jetés sur la Terre et dans la Nuit. La neige offre une vision et un imaginaire de sensations, de sentiments, d’images et de rêves inscrits dans le froid et la blancheur. Tombée en flocons, la matière plumeuse danse et tournoie : les mouvements des comédiens s’amusent de ce duvet immaculé et léger – promesse de pureté non souillée, fleurs blanches printanières, clair de lune et nuit, spectacle visuel et silence. Les « voyages d’hiver » du romantisme allemand – mélancolie, errance, froid, beauté, blancheur nocturne … La neige, représentation de la fragilité des choses du monde, enferme sa propre mort. La Fille Roi et son amante Belle, interprétée par Carine Goran, dont elle est amoureuse, et qu’elle oblige à se marier pour se détacher d’un amour coupable, dessinent des scènes intimes de joute verbale et de duel amoureux qui prennent toute leur mesure dans la blancheur de l’espace. La boîte dans laquelle les deux femmes évoluent souligne même des effets de flocons dans des miniatures de paysages sous verre, sous les lumières de Olivier Oudiou, la vidéo de Pierre Martin et les sons de Xavier Jacquot. Une image poétique splendide entre jeu et facéties. Toutefois, ce fond immaculé, page vierge ou toile d’un tableau, est propice aux taches de couleurs, comme l’exaltation du rouge sang des blessures du Roi Mort, le fantôme du père de la Fille Roi, héros mort à la guerre qui revient sur scène, l’éduque en homme et la soutient de ses conseils. Le Maître Roi est un soleil, une figure céleste que le comédien Thierry Bosc interprète en irradiant le plateau de ses apparitions lumineuses, fantôme vivant et tenace, portant ses blessures ensanglantées et la force sourde d’une voix posée de maître. Reconnaissant la grande guerrière en sa Fille Roi qui le dément, il explique : « Vous n’avez pas besoin de savoir pourquoi vous faites la guerre. Si vous tenez absolument à avoir une raison. La belle raison. La grande raison. Chaque état aspire à étendre son territoire. C’est tout à fait naturel. L’instinct du sang, la convoitise de la carte, de la terre, de l’homme, du coeur, du lion, du roi. Les belles lois de la guerre. » Par contre, la chasse est un passe-temps favori de la Fille Roi. Depuis le Moyen Age, elle est une initiation aux valeurs aristocratiques et leur illustration aux connotations courtoises : « La chasse est le jeu des forts, la lutte de l’homme contre la bête, de l’adresse contre la brutalité. Elle prépare à la guerre. Prouve qui peut son habileté, son courage, sa vigueur, son endurance. » ( René Maran, Batouala, 1921). La mère de la Fille Roi, Maria Eleonora, chassée par le Pouvoir, défend sa fille qui lui ressemble, incarnée par la détermination et la provocation séditieuse de la comédienne Murielle Colvez : « Elle n’est encore qu’une enfant. Elle a besoin de moi. Je ne crois pas qu’elle soit une guerrière. Je crois qu’elle est autre chose. Je ne sais pas quoi, mais elle est autre chose. Je crois qu’elle est quelque chose qui nous échappe encore. Peut-être le comprendra-t-on dans le futur. » Il est vrai que le Pouvoir est oppressant, exigeant, rigide, sévère, dictant sans faillir ses volontés et ses exigences, représenté par le comédien Christophe Grégoire au jeu percutant, froid, exsangue. Un jeune homme, Love, alcoolique, promis au mariage dès son enfance rêve d’épouser la Fille Roi pour régner à ses côtés. Quand il lui parle d’amour, celle-ci lui rétorque : « Vous aurez une armée, une couronne, une fortune. Ça ne vous suffit pas ? » Emmanuel Noblet exprime sa joie d’accéder au pouvoir, en dansant son désir vif de réussite personnelle déguisé en passion amoureuse. Quand le Philosophe, reprise malicieuse cartésienne, désorienté, comique et loufoque, apprend que son élève a peur de la catastrophe, il lui explique : « Avoir peur de la catastrophe signifie généralement que la catastrophe a déjà eu lieu. Ce que vous redoutez est déjà arrivé. Vous avez déjà abandonné le trône. Une fois cette pensée bien en vous, il est impossible de la chasser. » La Fille Roi et le Philosophe jouent à l’avant-scène au jeu des Reines, des dynasties royales dont la Fille Roi, à leur seul nom évoqué, doit décliner et faire le récit de leur brève souveraineté. Un délassement royal, un divertissement princier, une frivolité enfantine et un plaisir pour le spectateur. L’actrice aime jouer, court, s’essouffle, éprouve son habileté, se mesure à son petit Philosophe, manifestant une spontanéité et une vitalité scéniques, le signe d’une pulsion ludique. Christophe Rauck décrit l’héroïne : « Force et paradoxe, elle est fille par moment et Roi par d’autre; femme et amie, éclairée et despote, amante et amant, promise et promesse; elle est à la fois l’amour au masculin avec l’autorité du tyran et l’amour au féminin avec les interrogations que cela pose sur le désir et la passion de l’autre. Elle aime et est aimée d’une jeune femme, elle est promise à un homme qui ne l’aime pas d’amour, et la question ne se pose pas ». Jouant sur les sexes et les identités, la Fille Roi déplace le problème du pouvoir, et le Philosophe déclame : « Le doute est le commencement de la certitude. Vous, comme tous les autres, êtes condamnés à la liberté. Je suis désolé si cela vous accable. Et pour répondre à votre question : ce que vous faîtes est totalement dénué de sens. Nous nous trouvons à l’intérieur d’une machine qui travaille jour et nuit, indépendamment de nous. En gros, une reine n’est qu’une pierre. » La mise en scène lumineuse, servie par d’admirables comédiens, est un régal visuel et sonore, une invitation onirique à explorer non seulement l’écriture poétique et philosophique de Sara Stridsberg mais encore le décor enchanté et vivant d’un conte de fées mi-figue mi raisin, entre la neige, la chasse, la guerre, le jeu, l’amour, le pouvoir, la femme et l’homme – valeurs existentielles. Véronique Hotte Représentation professionnelle du 16 mars 2021 au Théâtre du Nord à Lille – Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-de-France. Tournée : Théâtre de Caen, les 18 et 19 novembre 2021. Théâtre des Amandiers-Nanterre, du 25 novembre au 18 décembre 2021. Dates à venir, Le Quai, Centre Dramatique National d’Angers, Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 20, 2021 9:30 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama le 19 mars 2021 Dans la capitale des Gaules, la politique culturelle se bâtit pas à pas, quitte à prendre aux institutions phares de quoi aider de petites structures moins nanties. Un rééquilibrage des priorités, porté par l’adjointe à la culture Nathalie Perrin-Gilbert, qui ne fait pas du tout l’affaire de l’Opéra national, dont la subvention se trouve amputée de 500 000 euros. S’il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Nathalie Perrin-Gilbert, c’est son absence de cohérence. Peu après sa prise de fonction, la nouvelle déléguée à la culture de Lyon, ville remportée par l’écologiste Grégory Doucet en juin 2020, a annoncé la couleur. « Sur un budget de 115 millions d’euros alloués à la culture, l’enveloppe pour la création n’est que de 1,8 million d’euros. Je veux très vite la monter à 3 puis à 5 millions. Nous allons donc réaffecter une partie des subventions attribuées aux institutions », avait-t-elle déclaré à Télérama en octobre 2020. Près de six mois plus tard, cette élue de gauche passe à l’acte et ampute l’Opéra national (qui n’a pas démérité) de 500 000 euros, pour rediriger cette somme vers de plus petites structures dont elle souhaite accompagner l’essor. Saluée en juillet 2020 pour avoir activé, en pleine crise du Covid, un fonds d’urgence de 4 millions d’euros pour la culture, Nathalie Perrin-Gilbert se retrouve aujourd’hui sur le banc des accusés : veut-elle la peau d’un art qui fait la fierté de la ville ? L’actuel directeur de l’Opéra, Serge Dorny (il cédera sa place en septembre 2021 au metteur en scène Richard Brunel) monte au créneau : « Cette coupe budgétaire est le fruit d’une vision politique qui commence à se répandre aujourd’hui avec quelques nuances. Elle oppose institutions, petites structures, associations, et semble préférer, dans le domaine culturel, les circuits courts et le localisme par rapport à l’ouverture et l’universalisme. » “Culture écolo” et “culture de droite” face à face Étienne Blanc, chef de file du groupe Droite, centre et indépendants dénonce, pour sa part, une idéologie verte qui veut affaiblir le rayonnement de la ville. L’Opéra payerait, déplorent certains, sa réputation de maison élitiste destinée à un public d’initiés. La guerre des tranchées fait rage, offrant un spectacle « navrant qui oppose d’un côté la culture écolo, c’est-à-dire un sectarisme anti-institutionnel et, de l’autre, la culture de droite qui monte au créneau dès lors qu’on touche à l’Opéra », regrette Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, magazine culturel local. Le face-à-face est tranchant. Or, la décision prise par l’adjointe à la culture semble, à l’en croire, répondre à une gamme infinie de nuances, d’ajustements, d’examens scrupuleux des urgences des uns et des autres. « Mon sujet n’est pas d’avoir un discours anti-institutions. J’ai toujours dit que nous avions besoin de nos grandes maisons, elles doivent être une locomotive de notre projet », avance-t-elle, bien convaincue que 500 000 euros en moins ne menacent en rien l’Opéra. “Dans un moment de difficulté tel que celui que nous traversons, sachant que les réserves de l’Opéra sont importantes, il faut savoir relativiser.” Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins Second bénéficiaire des subventions municipales (après le réseau des bibliothèques), l’Opéra verra ses aides passer de 18,5 millions à 18 million. Une goutte d’eau ? Pas vraiment, d’après Serge Dorny : « La baisse touche le budget variable disponible pour nos activités artistiques, culturelles et sociales. Pas le budget fixe de fonctionnement (salaires, énergie et fluides, maintenances, etc.). » Effective dès cette année, l’amputation pourrait contraindre le futur directeur, Richard Brunel, à revoir ses ambitions programmatiques à la baisse. « 500 000 euros en moins peuvent obliger à jouer des coudes », confirme Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre municipal des Célestins, qui néanmoins temporise : « Dans un moment de difficulté tel que celui que nous traversons, sachant que les réserves de l’Opéra sont importantes, il faut savoir relativiser. » Les Célestins ou l’Auditorium de Lyon doivent leur salut aux 100 000 euros que la ville leur a versés à chacun cet été. Le déficit créé par la perte de recettes fragilisait ces lieux très dépendants de leur billetterie. Forte d’une enveloppe qui constitue 19 % du budget de la ville de Lyon, Nathalie Perrin Gilbert jongle au gré des besoins du terrain et de ses convictions : « Je veux bâtir une proposition culturelle qui soutient la création, encourage l’émergence artistique, favorise la professionnalisation et accompagne certaines disciplines ou esthétiques un peu délaissées ces dernières années. » Dirigée par le réalisateur Claude Mouriéras, l’école publique de cinéma et d’audiovisuel La CinéFabrique fait partie des “petits” projets soutenus par la Mairie. CinéFabrique Le choix du soutien aux structures modestes À première vue, sa méthode tient du saupoudrage. Quinze mille euros ici, 30 000 euros là, 100 000 euros ailleurs. Mais en réalité, le procédé obéit à une ligne rigoureuse, pensée au cas par cas, et dont bénéficieront de modestes structures censées être, demain, les fers de lance d’un Lyon qu’elle veut revivifier. Le Théâtre des Clochards Célestes, l’École d’art circassien, la Compagnie de marionnettes MA, l’école La Ciné Fabrique, dirigée par le réalisateur Claude Mouriéras, ou encore la villa Gillet : ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ils portent en eux les aspirations de Nathalie Perrin-Gilbert pour qui la création, si elle s’exerce dans de prestigieuses institutions, a aussi le droit d’exister au sein de niches moins spectaculaires. Vision à courte vue ? Pas si sûr. “Nous serons attentifs au pourcentage d’artistes féminines sur les scènes, à la composition des conseils d’administration et des équipes de direction.” Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture Fidèle à ses engagements, l’élue brasse dans un même geste art, social et parité. Lyon a ainsi initié un budget dit « genré ». Budget « sensible au genre », précise-t-elle, comme il doit l’être « aux inégalités sociales ou à l’empreinte carbone ». En clair : la municipalité sera désormais vigilante sur la façon dont ses subventions trouveront leurs résonances concrètes : « Nous serons attentifs au pourcentage d’artistes féminines sur les scènes, à la composition des conseils d’administration et des équipes de direction. » Un pas après l’autre, la politique culturelle lyonnaise prend tournure, mue par une volonté de démocratisation tous azimuts. Au cœur du 8e arrondissement, l’un des plus pauvres de Lyon, va être construit le futur bâtiment dédié aux Ateliers de la danse, pour lesquels Dominique Hervieu (directrice de la Maison de la danse) a reformulé son projet (initialement prévu au musée d’Histoire naturelle Guimet) : « Les Ateliers, qui seront livrés fin 2023 ou début 2024, vont se situer à 500 mètres de la Maison de la danse. Dans ce quartier réhabilité, il y aura un gymnase, une piscine, une école, un parc. Des fonctions associant l’éducatif, le corporel et l’environnement qui ricochent pleinement avec le travail d’éducation artistique que je mène depuis toujours. Ce changement convient aux enjeux qui me paraissent aujourd’hui importants pour l’art et la création. » À Lyon, les symboles changent de nature, de carrure et d’allure. Pour un art plus et mieux partagé ? C’est le pari des maîtres d’œuvre écologistes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2021 8:17 PM
|
Par Sandrine Blanchard et Rémi Barroux dans Le Monde du 18 mars 2021 Des études scientifiques sont en cours, en France, pour prouver l’absence de sur-risque de contamination au Covid-19 dans les salles de spectacle, musées et cinémas.
Les épidémiologistes et virologues seraient-ils les meilleurs alliés du monde de la culture, qui réclame haut et fort la réouverture des musées, cinémas et salles de spectacle ? Alors que tous ces lieux sont interdits au public depuis cent quarante jours (sans compter le premier confinement du printemps 2020), les responsables culturels ne cessent de citer des études scientifiques, qui prouveraient l’absence de sur-risque de contamination au Covid-19, pour étayer leurs revendications. Et des médecins n’hésitent plus à s’associer au débat. Le 25 mars, c’est avec Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et l’urgentiste Patrick Pelloux que se tiendra l’« Assemblée des théâtres », au Rond-Point, à Paris, pour réclamer une « réouverture urgente des lieux de culture ». Le 4 mars, c’est avec l’épidémiologiste Antoine Flahault, professeur de santé publique et directeur de l’Institut de santé globale (université de Genève), que s’est tenue la première table ronde de la mission commune d’information du Sénat, consacrée aux conséquences des mesures de confinement sur les salles de spectacle. Le 11 mars, Constance Delaugerre, professeure de virologie à hôpital Saint-Louis à Paris, et le psychiatre Serge Hefez ont cosigné dans Libération, au côté de nombreux acteurs du monde culturel, une tribune demandant au gouvernement de soutenir les protocoles validés scientifiquement qui permettent, sans risque supplémentaire, de visiter un musée, d’assister à un spectacle ou à une séance de cinéma. Et enfin, dans son avis en date du 11 mars, intitulé « Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aiguës de l’épidémie », le conseil scientifique, chargé d’« éclairer la décision publique dans la gestion de la crise sanitaire » et présidé par l’immunologue Jean-François Delfraissy, classe les lieux culturels parmi les activités à « risque peu élevé ». « Leur fréquentation n’a pas été associée à un sur-risque d’infection [lorsqu’ils étaient ouverts en octobre 2020], peut-on lire dans ce document. Une réouverture serait ainsi envisageable, certes avec une extrême surveillance, en attendant la vaccination des personnes à risque, puis de la grande majorité de la population pour sortir enfin de cette crise sanitaire. » « Impact sur la santé mentale » L’autorisation de rassemblements reste toutefois très dépendante du niveau de circulation du virus. La remontée des taux d’incidence et l’explosion actuelle des taux d’occupation des lits de réanimation dans certaines régions, dont l’Ile-de-France, complique l’équation. « Les regroupements ne sont envisageables que dans des situations où l’épidémie est contrôlée », prévient le conseil scientifique, qui a établi un système de gradation des mesures en fonction de la sévérité de l’épidémie. Pour les lieux accueillant du public, ont été pris en compte la densité de population prenant part à l’événement, sa tenue en extérieur ou en intérieur, un public mobile ou statique, le niveau d’émission de gouttelettes par les participants (silencieux, chants ou cris), l’aération de l’espace et « l’éventualité que l’événement génère en marge de sa réalisation des rencontres privées (pot, repas, réunion d’amis) ». Les protocoles sanitaires (masques, distance physique…), les jauges et les réservations obligatoires permettraient, expliquent les scientifiques, de faciliter la tenue de ces événements. « Un certain nombre d’activités restent possibles, notamment en extérieur. Elles pourraient avoir un impact positif considérable sur la santé mentale des populations », ajoute le conseil. Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo : « Ce qui est grave, c’est d’associer les lieux culturels à des lieux de contamination » Début février, Roselyne Bachelot avait expliqué vouloir rouvrir d’abord les musées, puis les cinémas et enfin les salles de spectacle. La ministre de la culture évoque désormais une « réouverture groupée, au cours du deuxième trimestre ». « Je viens de démonter l’exposition “Anticorps”, qui n’aura eu que cinq jours de visibilité, c’est à hurler. J’aimerais savoir si je dois monter une exposition pour avril, interroge Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo, à Paris. Le seul passe-temps proposé actuellement est le shopping. Ce qui est grave, c’est d’associer les lieux culturels à des lieux de contamination. » Bertrand Thamin, président du Syndicat national des théâtres privés, lui aussi, ne décolère pas : « Dire que la culture est plus dangereuse que d’autres secteurs, alors qu’on reste assis, masqué, distancié, ça ne repose sur rien. » Depuis la mi-janvier, les organisations professionnelles de la culture ont établi, en lien avec la Rue de Valois, des protocoles sanitaires – un temps appelé « modèle résilient » – pour préparer la réouverture. Après deux mois de silence du ministère, de nouvelles réunions ont eu lieu, vendredi 12 mars, avec la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot et, c’est une première, son homologue du ministère de la santé. De cinq stades, le protocole envisagé est désormais passé à trois stades, étalés sur deux mois : jauge à 35 %, jauge à 65 %, jauge à 100 %, toujours avec port de masque. Mais, souligne, Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, « on ne sait toujours pas quels seraient les seuils sanitaires permettant de passer d’un stade à l’autre ». Celui des 5 000 contaminations par jour semblant, pour l’heure, inaccessible, faudra-t-il retenir le taux d’hospitalisation ? Et quid du couvre-feu, peu compatible avec des sorties culturelles ? Concerts tests prévus « Sur la culture, on assiste à une inversion du principe de la charge de la preuve. On doit prouver qu’il n’y a pas de contamination, alors qu’on n’a guère prouvé qu’il y en avait », s’offusque le professeur Eric Caumes. Et les projets de concerts tests prévus à Marseille, Paris, Montpellier et en Bretagne pourraient apporter davantage d’eau au moulin des acteurs culturels. « La communauté scientifique s’est sentie très investie dans l’idée qu’il fallait aider le secteur culturel », constate le professeur Pierre Tattevin, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, qui travaille au protocole du concert test avec le festival No Logo BZH, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). « Face aux grandes difficultés des acteurs culturels, on a eu envie de les aider », témoigne le docteur Marie-Christine Picot. Cette épidémiologiste au CHU de Montpellier supervise les deux concerts tests prévus en avril au Secret Place, un club de rock de trois cents places près de la ville héraultaise. Notre infographie : Couvre-feu, confinement, commerces ou bars fermés… Combien de jours de restrictions depuis un an ? Pour l’heure, toutes les études mises en avant par le monde culturel, dont ComCor de l’Institut Pasteur, ne documentent pas assez la surcontamination éventuelle dans ces lieux. « Nous n’avons la preuve de rien. Si on était sûr, on ne réaliserait pas le travail de recherche avec nos concerts tests, concède le professeur Tattevin. Même si tout le monde est assez persuadé de l’absence de sur-risque, ce n’est pas assez documenté. » Selon une étude, le risque de contamination serait deux fois moins important dans les salles de concert que dans un supermarché, et trois fois moins que dans des bureaux en open space Idem pour l’étude publiée le 15 février, réalisée par l’Institut Hermann-Rietschel de Berlin, qui porte plus spécifiquement sur le risque de contamination par aérosol, soit les microgouttelettes dans l’air, dans les lieux publics. Il y serait deux fois moins important dans les salles de concert que dans un supermarché, et trois fois moins que dans des bureaux en open space. Le 12 janvier, c’était l’Institut Fraunhofer Heinrich-Hertz qui publiait une étude sur la dispersion spatiale des aérosols et du CO2 dans les salles de concert. Elle montre que, correctement ventilées, elles ne sont pas des lieux de transmission plus importante du virus. Mais ces études n’établissent pas de réelles comparaisons randomisées. « En réalité, on ne dispose pas de grand-chose en termes de données scientifiques. On a besoin d’études avec des chiffres qui permettent de prendre des décisions massives, de documenter pour estimer les risques réels », assure le professeur Xavier de Lamballerie. Virologue à Marseille et directeur d’unité à l’Inserm, il travaille sur la préparation des deux concerts tests au Dôme, avec, à chaque fois, 1 000 spectateurs et un groupe test n’y allant pas de 1 000 personnes : « On veut un risque mesuré, sans hospitalisation à la clé, ce qui pose aussi la question de l’âge pour ces expérimentations. Il y aura un “tracing” et un suivi médical pendant un mois après le concert, le maître-mot, c’est la sécurité. » En salle ou en plein air Pendant ce temps, Roselyne Bachelot ne cesse de répéter que les festivals auront lieu au printemps et en été avec un protocole adapté : soit, au maximum, 5 000 spectateurs, tous assis, que ce soit en plein air ou dans une salle. Mais pourquoi ne pas différencier les situations en extérieur et en intérieur ? « Le plein air devrait être promu, a insisté, devant les sénateurs, le professeur Flahault. Si on a un masque, il n’y a pas de raison d’imposer d’être assis en extérieur. » Le professeur Eric Caumes distingue, lui aussi, clairement deux scénarios : l’extérieur, qui présente un risque quasi nul, et l’intérieur, avec un risque variable selon la situation, sport, musique… « Mais, explique-t-il au Monde, pour l’instant, en région parisienne, l’indoor est inenvisageable, et l’outdoor devient de moins en moins défendable au vu de la situation, avec des services de réanimation pleins. » Nombreux sont les scientifiques à partager la conviction que rien ne justifie le maintien de la fermeture des musées et des cinémas Quid d’une approche territorialisée des réouvertures, en fonction de la situation sanitaire ? « Le baromètre ne peut pas être seulement Paris, Paris, Paris, s’agace Nicolas Dubourg. Les théâtres publics dans les régions peu touchées par le virus ne peuvent même pas accueillir les scolaires. C’est absurde ! » Si une territorialisation semble quasi impossible pour les professionnels du cinéma qui raisonnent en « sortie nationale » de films, elle paraît tout à fait envisageable pour les musées et les monuments. D’ailleurs, nombreux sont les scientifiques à partager la conviction que rien ne justifie le maintien de la fermeture des musées et des cinémas. « Les expérimentations vont permettre de préciser les données scientifiques pour les concerts. En revanche, pour les cinémas et les musées, elles ne sont pas nécessaires, rien n’interdit leur réouverture, plaide aussi Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm. Mais je ne vais pas dire qu’il faut le faire maintenant alors que la situation sanitaire est en train de s’aggraver en Ile-de-France. » Jauges et ouvertures ailleurs en Europe En annexe de son avis, le conseil scientifique a dressé un comparatif avec d’autres pays européens. Ainsi, en Espagne, les musées sont accessibles avec une jauge de capacité maximale de 30 % à 50 % selon les régions, et les cinémas et théâtres sont ouverts avec une capacité maximale variable selon les régions. En Italie, les ouvertures dépendent des zones (blanche, jaune, orange et rouge). Là où le virus est le moins présent, tout est ouvert, alors que, en zone rouge et orange, les lieux culturels sont fermés, à l’exception des bibliothèques (sur rendez-vous). Au Royaume-Uni, tout est fermé, et une réouverture des musées est prévue pour le 12 avril. En Allemagne, enfin, l’autorisation de réouverture des musées est envisagée, selon les Länder, à condition que le taux d’incidence soit inférieur à 100. Illustration : BORIS SÉMÉNIAKO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2021 4:57 PM
|
Publié sur le site d'Artcena le 15 mars 2021 NOMINATION
À compter du 1er juillet, le metteur en scène et fondateur de la Compagnie Réseau lilas dirigera pour la première fois un Centre dramatique national, avec la volonté d’en faire un lieu accessible à tous les habitants du territoire. Depuis plusieurs années déjà, Cédric Gourmelon se préparait à prendre les commandes d’un Centre dramatique national. Non par ambition personnelle, mais avec l’envie de se placer au service d’autres artistes, notamment émergents. « Je considérais le CDN comme un outil afin de continuer à développer mon travail de metteur en scène, transmettre mon expérience à de jeunes talents et surtout accompagner leurs productions », explique-t-il. Après avoir postulé sans succès l’an passé au Théâtre de la Manufacture-CDN Nancy-Lorraine, Cédric Gourmelon se réjouit à l’idée de retrouver la ville de son enfance et plus encore de pouvoir défendre sur un territoire (celui de la Communauté d’Agglomération) essentiellement rural les valeurs de la décentralisation théâtrale auxquelles il reste profondément attaché. Secondé par sa fidèle complice au sein de la Compagnie Réseau lilas, Morgann Cantin-Kermarrec, le nouveau directeur s’est fixé pour priorité de renforcer le Pôle Production de la Comédie de Béthune et par là même « le rayonnement du CDN sur le plan national ». Les premiers destinataires de cet accompagnement en production seront les quatre artistes associés qu’il a appelés à ses côtés : Pauline Bayle, Louise Vignaud, Tommy Milliot et le jeune auteur et metteur en scène Thomas Piasecki dont la compagnie est établie dans la commune proche de Bruay-la-Buissière. Un choix qui éclaire la ligne artistique définie par Cédric Gourmelon : résolument théâtrale, centrée sur un théâtre de textes (dont les classiques du répertoire) et un théâtre de fiction parfois à la lisière du documentaire ou de la performance. « Ces artistes possèdent en commun d’être de grands directeurs d’acteurs, qui portent une attention particulière à la façon de faire entendre les textes », précise-t-il. Ils seront rejoints par trois metteurs en scène « compagnons » – Jean-François Sivadier, Tiphaine Raffier et Baptiste Amann – que Cédric Gourmelon estime essentiel de faire découvrir au public. Le deuxième volet de son projet concerne le soutien aux compagnies régionales émergentes, dans une double optique : favoriser l’implantation d’équipes artistiques (souvent davantage attirées par des métropoles) sur le territoire et leur permettre d’intégrer par la suite le réseau national. Grâce à la mise en place d’un dispositif d’incubateur, une compagnie bénéficiera d’un accompagnement adapté (aide à la structuration, coproduction, production déléguée…), gage de sa future autonomie. Parallèlement, de nombreuses autres seront accueillies en résidence. Enfin, le directeur de la Comédie de Béthune souhaite favoriser une présence artistique continue sur le territoire. « Le Pas-de-Calais est un département très peuplé, mais qui compte des zones dépourvues de lieux culturels. L’une des missions du CDN sera donc d’être tête de réseau pour dynamiser l’ensemble de l’Agglomération et du Département », souligne Cédric Gourmelon, qui s’appuiera sur les artistes associés, les compagnons et les compagnies émergentes (lesquelles pourront ainsi côtoyer leurs aînés dans des projets communs) pour programmer des formes en itinérance. Lui-même proposera prochainement un seul en scène autour de textes de Léo Ferré. Par ailleurs, en partenariat avec nombre de communes du territoire, des résidences longues (plusieurs mois) seront organisées dans des équipements municipaux, mais aussi des écoles, des hôpitaux, des EHPAD... Une formidable opportunité de tisser des liens avec les habitants, via des ateliers de pratique artistique, des spectacles participatifs, des collectes de témoignages ou encore des productions mêlant artistes professionnels et amateurs. Cédric Gourmelon n’exclut pas non plus la possibilité de créer des spectacles en décentralisation avant de les reprendre sur les scènes du Centre dramatique national. C’est donc un théâtre ouvert à la rencontre avec tous les publics, populaire et artistiquement exigeant, que le nouveau directeur de la Comédie de Béthune entend promouvoir durant son mandat. Cet ambitieux programme devra néanmoins composer avec un avenir très incertain. Cédric Gourmelon en est parfaitement conscient, partagé entre le désir d’« apporter un maximum d’espoir » et « la nécessité de faire preuve de réalisme, de responsabilité et de solidarité », au premier chef à l’égard des artistes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2021 10:22 AM
|
Par Laurent Vermorel dans le Midi Libre Publié le 18/03/2021 à 13:00 , mis à jour à 15:12
Les nouvelles sont rassurantes concernant Alain Françon, homme de théâtre en résidence à l’École supérieure d’art dramatique de Montpellier, attaqué à l’arme blanche, ce mercredi 17 mars, vers 10 h 45 dans l’Écusson. Quant à l'enquête, diligentée par les policiers du SRPJ de Montpellier, elle se poursuit pour tenter d'identifier l'auteur des faits, qui a pris la fuite.
Qui a agressé l'homme de théâtre Alain Françon, ce mercredi 17 mars, aux alentours de 10 h 45 dans les rues de Montpellier ? Vingt-quatre heures après les faits, la question reste en suspens. L'enquête, diligentée dans un premier temps par les policiers de la Sûreté départementale de l'Hérault et prise en charge, ce midi, par leurs homologues du SRPJ de Montpellier saisis par le procureur de la République, n'a, pour l'heure, par permis d'identifier l'auteur, qui a pris la fuite.
Blessure à l'arme blanche confirmée En revanche, ce que les enquêteurs ont confirmé, c'est que la blessure a bien été occasionnée par une arme blanche, sans connaître avec précision la nature de l'arme (couteau, cutter...). Selon les premières investigations, le metteur en scène, âgé de 76 ans, accueilli depuis la mi-février à l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique, a été agressé dans le secteur de la rue de l'Ancien-Courrier, alors qu'il allait retrouver ses étudiants de la promotion 2022 avec lesquels il travaille actuellement sur "Toujours la tempête" de Peter Handke. Une entaille profonde s’ouvrant en diagonale depuis l’oreille entaillée jusqu’à la trachée C'est là qu'il a été aperçu par une jeune femme, marchant, groggy et tout ensanglanté, en se tenant la gorge. Plusieurs commerçants ont alors prêté main-forte en attendant les secours. Selon plusieurs témoins, il présentait "une entaille profonde s’ouvrant en diagonale depuis l’oreille entaillée jusqu’à la trachée". Au vu de la gravité de sa blessure, il a été évacué aux urgences de Lapeyronie où il a été opéré avec succès. Toujours sous surveillance Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger, sous réserve bien entendu de complications post-opératoire. Il reste d'ailleurs sous surveillance, le médecin lui ayant délivré une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours ! Une agression qui a été condamnée par Michaël Delafosse ce mercredi soir. "Je condamne avec fermeté cet acte de violence gratuit et lâche et souhaite que son agresseur soit le plus rapidement possible appréhendé", a posté sur sa page Facebook le maire de Montpellier. Avant d'adresser "un message de pleine et entière solidarité au metteur en scène Alain Françon".

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 17, 2021 1:31 PM
|
Par France Bleu Hérault - franceinfo Publié le 17/03/2021 15:50 Mis à jour à17h50 Selon les premiers éléments de l’enquête, Alain Françon a parcouru à pied près de 300 mètres, en sang, depuis l’hôtel où il résidait.
Le metteur en scène de théâtre Alain Françon a été agressé à l’arme blanche mercredi 17 mars, en cours de matinée à Montpellier (Hérault), ont appris franceinfo et France Bleu Hérault de sources concordantes. Blessé à la gorge, il a été transporté à l’hôpital dans un état grave et placé en réanimation. Son état n'inspirait plus d'inquiétude mercredi soir.
L’agression a eu lieu en plein centre-ville, près de l’église Saint-Roch, vers 11h30. Alain Françon s’est écroulé devant une boutique. La gérante est intervenue et a découvert le metteur en scène en sang, toujours conscient, son écharpe serrée autour du cou comme pour juguler la profonde plaie. Ce dernier a perdu connaissance peu de temps après.
"Il ne semblait pas se rendre compte de sa blessure"
Selon les premiers éléments de l’enquête, avant de finir sa route devant ce magasin, Alain Françon a parcouru à pied près de 300 mètres en sang depuis l’hôtel où il résidait. Selon une source policière, il perdait tellement de sang que les enquêteurs sont remontés à son hôtel en suivant les traces de sang au sol. Plusieurs témoins affirment avoir vu le metteur en scène marcher, ensanglanté. "Il ne semblait pas se rendre compte de sa blessure", explique un policier à franceinfo. Depuis, la police technique et scientifique effectue des prélèvements dans le quartier. Les enquêteurs interrogent le personnel de l’hôtel où séjournait la victime. À ce stade, la piste terroriste est écartée.
Avant le premier confinement, Alain Françon était à l’affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il dirigeait les acteurs Catherine Hiegel, Noémie Lvovsky et André Marcon dans une pièce de l’écrivain autrichien Thomas Bernhard, qui fait resurgir les démons du nazisme : Avant la retraite. Cette pièce événement n'a pu se jouer que quelques jours en raison de l'épidémie de Covid-19.
Alain Françon, âgé de 76 ans, a notamment dirigé le Centre dramatique national de Lyon, puis celui de Savoie, au début des années 90, avant de devenir directeur du théâtre national de la Colline, à Paris, entre 1996 et 2010. Il a obtenu deux Molières de la mise en scène en 1995 (pour Pièces de guerre, d'Edward Bond) et en 2010 (pour La Cerisaie, d'Anton Tchekhov). Il donnait depuis la mi-février des cours à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier.
Légende photo :
Alain Françon, lors de la remise du Molière du meilleur metteur en scène de théâtre privé, le 23 mai 2016. (PATRICK KOVARIK / AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2021 11:33 AM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 15 mars 2021 Alors que l’effet boule de neige de l’occupation des théâtres à Paris et partout en France prend de l’ampleur, Nicolas Dubourg, président du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) et directeur du théâtre La Vignette de l’université de Montpellier, réagit aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 11 mars pour soutenir la culture. Il appelle en outre à une mobilisation le week-end du 20 mars. Avez-vous participé à la rencontre du 11 mars avec les organisations syndicales du secteur culturel, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ? Nicolas Dubourg - Comme je n’y étais pas convié, j’ai écrit à la conseillère de Jean Castex, Florence Philbert, afin de faire part de mon étonnement. Elle m’a répondu que cette rencontre ne concernait que les syndicats de salariés. Or, on avait déjà eu deux rendez-vous avec le Premier ministre à Matignon, en tant que représentants de lieux, et, à l’époque, les syndicats de salariés n’avaient pas été conviés et s’en étaient émus. La réponse avait alors consisté à leur dire : on parle de la question de la réouverture, des protocoles, de l’équilibre financier des maisons. En gros, ça ne vous regarde pas. De fait, aucun de ces points-là n’a été abordé le 11 mars. Les seules questions du jour étaient plutôt relatives à l’emploi, même si l’annonce sur les 20 millions d’euros d’aides supplémentaires pour la culture va aussi concerner des équipes artistiques, c’est-à-dire des entreprises… qui n’étaient pas conviées. 50 % des adhérents du Syndeac sont des équipes artistiques et sont concernés par cette annonce. Leur technique, c’est toujours de nous réunir à des moments différents pour nous dire la même chose. Par contre, le 12 mars, j’ai eu une réunion avec Sophie-Justine Lieber (la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot), Hélène Amblès (sa conseillère en charge de la création, du spectacle vivant et des festivals), ainsi que Marie Francolin (la directrice adjointe de cabinet, en charge du Covid-19 auprès du ministre de la santéà, ce qui était une première. Sophie-Justine Lieber nous a annoncé que le travail en interministériel s’accélérait actuellement pour essayer d’aboutir à un protocole simplifié. En janvier, le ministère avait parlé d’un protocole en cinq étapes : d’abord la phase zéro, soit la phase actuelle, où les théâtres ne sont ouverts qu’aux professionnels. La phase 1 est l’ouverture aux scolaires, la phase 2, 25 % de jauge ouverte au public, la phase 3, 50 %, la phase 4, 75 % et la phase 5, 100 %. A présent, on nous parle de trois étapes qui s’échelonneront à trois ou quatre semaines d’intervalle pour passer de 33 % à 75 %, puis à 100 % de remplissage des salles de spectacle. Mais quand on demande une date pour passer le premier cap, on n’a aucune réponse. Quid du couvre-feu à 18 heures ? Quid de la différenciation territoriale ? Ce n’est pas non plus la même chose si vous êtes dans le secteur privé ou public, on n’a pas le même rapport au remplissage des salles. S’agissant du secteur public, on a donc redit qu’on était prêts à ouvrir à condition d’avoir des aides, mais qu’il nous semblait fondamental de rouvrir les théâtres. On a juste eu confirmation que les festivals de l’été auront lieu. Ce à quoi on a répondu que, dans ce cas, leur protocole doit s’enclencher au moins six semaines en amont. Ils nous disent y travailler en nous rappelant que la situation sanitaire est loin d’être positive, surtout en Ile-de-France. Comment réagissez-vous à la déclaration de Roselyne Bachelot qui juge l’occupation des théâtres “inutile” et “ dangereuse” ? La posture de ce gouvernement est très étonnante. Jusqu’au 19 janvier, on était plutôt satisfaits du dialogue, dans la mesure où il y avait régulièrement des réunions au cours desquelles on posait les sujets sur la table et, une fois l’analyse partagée, des réponses étaient apportées. Pas toujours satisfaisantes, mais il y avait la fameuse clause de revoyure qui nous permettait d’espérer que, face à une mauvaise analyse, il y aurait un jour une bonne réponse. Le 19 janvier, après l’annonce du protocole en cinq points sur la question de la réouverture, on est rentré dans la phase : plus d’image, plus de son, et ce pendant quasiment deux mois. C’est proprement hallucinant. Avec d’autres syndicats, on a interpellé le gouvernement le 17 février avec une déclaration pour la réouverture de tous les établissements culturels recevant du public, signée par l’Association des régions de France, tous les présidents de régions, les maires et présidents des métropoles des plus grandes villes de France, en demandant au gouvernement de mettre en place ce protocole. On n’a eu aucune réponse. Le 4 mars, à la suite de cette manifestation à laquelle nous étions associés, la CGT a décidé de mettre en place sa modalité d’action : l’occupation de théâtres. C’était une surprise pour vous ? On n’était pas du tout informés. Mais lorsque la ministre de la Culture s’offusque aujourd’hui de l’occupation des théâtres, ce qui m’étonne surtout, c’est qu’elle ne l’ait pas anticipé. C’est ça qui est fou. Le nombre de courriers qu’on a envoyés à ce gouvernement et qui sont restés lettres mortes… On ne peut pas laisser dans un état d’ignorance absolu le seul secteur fermé depuis quasiment un an. Ils ne se permettraient jamais ça avec le secteur aéronautique ou avec l’industrie. Comment peuvent-ils nous mépriser à ce point-là ? Roselyne Bachelot a beau jeu de trouver la réponse du corps social trop forte. En tant que pharmacienne et ancienne ministre de la santé, elle sait très bien que quand le stimulus est puissant, la réponse du patient est forte. A moins qu’il ne soit totalement mort, le fait qu’il y ait une réponse immunitaire est plutôt bon signe…. Nous, on propose autre chose : le week-end du 20 mars, on appelle à organiser des assemblées générales où seront conviés des élus, des responsables de lieux, des intermittents, des artistes et le public. L'idée est de venir débattre, échanger sur la situation du secteur. On va inscrire sur toutes les devantures des théâtres une citation que Roselyne Bachelot avait volée à Pablo Neruda : “Le printemps est inexorable”, en dessous de laquelle on va écrire : “Feu vert pour la culture”, en français mais aussi en anglais (“#greenlightforculture”), car c’est un mouvement européen et cette problématique de fermeture des lieux de culture nous est commune. Elle témoigne du fait que la puissance publique se désengage massivement de la politique culturelle. Notre revendication traverse l’Europe et est porteuse d’une vision politique. Comment considérez-vous cette occupation des théâtres ? On est un syndicat d'employeurs et notre métier, c’est de faire fonctionner des théâtres. Nous les occupons donc par notre activité en permanence et ce sur quoi on se bat en ce moment, c’est précisément de pouvoir les réinvestir pour y travailler et y accueillir du public. Historiquement, la question de l’occupation consiste à bloquer l’activité. La CGT parle d’occupation mais je pense que le terme est mal choisi dans la mesure où la CGT et les intermittents se battent aujourd’hui pour faire fonctionner leur outil de travail, et non pas pour le bloquer. Notre position, c’est de nous battre pour la réouverture des théâtres et les modalités d’action que nous mettons en place ne sont pas là pour empêcher le travail, bien au contraire, mais pour pouvoir accueillir du public le plus rapidement possible dans nos établissements. Qu’en est-il de la prolongation de l’année blanche demandée pour les intermittents ? Quelles sont vos préconisations ? Il n’y a pas encore d’annonce puisqu’un rapport est attendu pour la fin du mois de mars. Le Syndeac a mis en place un outil de travail pour faire des propositions très concrètes, que nous finalisons ces jours-ci. Ce rapport doit faire une évaluation de la situation parce que l’année blanche est un système un peu aveugle. Cela s’adresse à tout le monde, quelle que soit la situation du salarié intermittent. Or, au bout d’un an, on a observé de grandes disparités avec des intermittents dont la rémunération s’est effondrée, littéralement. Certains vont avoir fait leurs heures, mais là où ils avaient d’habitude un cachet moyen à 200 euros, ils vont toucher le minimum syndical à 120 euros. Cela veut dire qu’au moment où ils vont calculer leurs indemnités journalières, non seulement ils auront perdu beaucoup de revenus cette année, mais ils auront en plus une perte de revenus sur l’année qui suit. On souhaite que cette perte de revenus soit compensée et maîtrisée par l’intermittent lui-même au lieu que lui soit imposé un système aveugle qui ne lui permet pas, in fine, de rester dans le secteur. L’année blanche, c’était simple à expliquer, mais là, c’est plus complexe et on sera en mesure de faire des annonces par rapport à nos propositions d’ici une ou deux semaines. >> A lire aussi : Samuel Churin : “Nous occuperons tous les théâtres de France” Sait-on comment vont être utilisés les 20 millions d’euros supplémentaires annoncés le 11 mars par rapport au plan de relance initial ? Ils vont servir en priorité aux équipes artistiques, notamment pour soutenir l’entrée dans la profession des jeunes compagnies. Il s'agit d'une revendication que l'on porte depuis le début : les dispositifs de relance doivent permettre de financer de l’emploi artistique ou technique. A travers le maintien des subventions, on maintient l’équilibre financier des structures, mais le plan de relance, lui, doit permettre de financer l’emploi. Quand la ministre avait annoncé en août dernier le plan de relance – les fameux 400 millions sur les deux milliards d’euros pour la culture -, elle avait indiqué qu’il était soumis à deux choses : d’une part, qu’il était évolutif et qu’on se reverrait si la crise durait. Cette annonce est donc justifiée et il devra sans doute y en avoir d’autres - c’est comme une clause de revoyure. D’autre part, elle avait annoncé que la manière de dépenser l’argent serait souple en fonction des problèmes à régler. Aujourd’hui, on a une connaissance assez partielle de la manière dont cette crise impacte les entreprises, les lieux, les compagnies. Nous demandons donc qu’à travers le mécanisme de la démocratie sociale et de la négociation avec les partenaires, on puisse régulièrement faire des points de suivi pour modifier ou pas les dispositifs mis en œuvre. Il est important de pouvoir faire évoluer la réponse à la problématique. Pour nous, cette annonce de 20 millions d’euros, c’est une manière de vérifier que l’engagement à ce fameux “quoi qu’il en coûte” perdure, dans le sens où l’on est le secteur le plus impacté par cette crise. Par ailleurs, on ne parle que de l’Etat, mais je peux vous dire que dans les régions et dans les villes, le maintien des subventions en 2021 n’est pas encore acquis. S’il commence à y avoir des désengagements de ce côté-là, cela va se faire d’une manière beaucoup plus silencieuse et avec des conséquences bien plus graves. Aujourd’hui, si vous prenez le bloc communal, les départements et les régions, elles financent la culture beaucoup plus que l’Etat. Vous pouvez très bien avoir un désengagement financier de la puissance publique qui passe inaperçu parce qu’il est porté par des acteurs qui sont fractionnés et politiquement invisibles. Alors, si les 20 millions qu’on nous annonce d’un côté, on les perd de l’autre, c’est fini. Comment voyez-vous arriver la saison des festivals ? Pourquoi insister à ce point sur la réouverture des théâtres ? Parce que l'on est un secteur particulier. Il va y avoir des problématiques très concrètes de disponibilité des plateaux, d’abord pour répéter, puis pour jouer. Les répétitions qui ont lieu en ce moment étaient soit déjà prévues, soit se sont rajoutées sans être corrélées à un calendrier de diffusion. On a besoin d’un calendrier pour réorganiser nos plannings de répétition de manière à être prêts le jour J. Deuxième point : les équipes. Elles sont laminées par la crise et elles appréhendent une reprise sur les chapeaux de roues. On souhaite une reprise progressive de l’activité. On a besoin de se réentraîner, les publics ont besoin de revenir. L’histoire des festivals est importante parce qu’elle nous permet de nous dire : si les festivals reprennent cet été, on demande que quatre semaines avant, les théâtres aient rouvert de manière à tester les choses, qu’on puisse reprendre les réflexes. On parle bien sûr d’une réouverture avec progressivité. Propos recueillis par Fabienne Arvers Légende photo : Nicolas Dubourg, président du Syndeac (Denise Oliver Fiero)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2021 6:40 PM
|
Occupation des théâtres depuis le 4 mars :
Etat des occupations en date du 15 mars 2021 L'occupation du théâtre de l’Odéon, un combat d'artistes "pour faire converger les luttes" article de France 24 ------------------------- Message de Stéphane Braunschweig, directeur de l'Odéon-Théâtre de l'Europe (15 mars 2021) : « Chères spectatrices, chers spectateurs, Voilà exactement un an que nous vivons au rythme des confinements et des couvre-feux, et voilà plus de dix jours que le théâtre de l’Odéon est occupé, à l’initiative de la CGT, par des professionnels du monde de la culture. L’extension du mouvement à de nombreux autres lieux traduit la vive inquiétude qui traverse actuellement tout notre secteur. Je partage cette inquiétude et soutiens pleinement la demande d’une prolongation del’«année blanche» pour les intermittents du spectacle. La possibilité de maintenir les processus de répétitions a permis à certaines équipes de travailler, mais combien sont-ils à avoir vu toutes leurs dates annulées depuis un an ? À l’Odéon, nous préparons, sans visibilité sur notre fin de saison, le programme de la saison prochaine, où nous essayons de reporter les nombreux spectacles annulés, tout en maintenant au maximum les nouveaux projets que nous avions. Mais il va sans dire que les annulations et reports de cette année vont impacter fortement la saison prochaine, et par un effet domino nous obliger à décaler à plus long terme certains de ces projets. Cela signifie, à l’échelle de tout le secteur du spectacle vivant, que de très nombreux projets vont soit disparaître complètement, soit être encore décalés d’une année ou plus. Et il n’est pas du tout certain que celles et ceux qui ont eu la chance de travailler cette année puissent faire leurs heures et recharger leurs droits la saison prochaine. C’est dans ce contexte que la prolongation de l’«année blanche», heureusement décrétée par le gouvernement en mai dernier, paraît indispensable. C’est ce dispositif qui a permis à de nombreux professionnels du spectacle vivant de se maintenir dans le régime de l’assurance chômage depuis un an, et qui doit leur permettre de passer le cap d’une année qui s’annonce encore très difficile, même si les théâtres reprennent enfin une vie plus ou moins normale. Il en va de la survie de nombreux artistes, techniciens et techniciennes intermittents, qu’ils ou qu'elles travaillent régulièrement dans les grandes institutions ou en compagnie. Je veux croire que la commission Gauron qui examine actuellement cette question prendra toute la mesure d’une situation que chaque nouveau jour de fermeture dégrade un peu plus. Il est évident que les intermittents du spectacle sont loin d’être les seuls à être gravement impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais personne ne doit rester au bord de la route. Espérons que nous retrouverons vite cette visibilité qui nous manque tant, et qui nous laisserait apercevoir enfin le bout du tunnel.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2021 3:12 PM
|
Par Marie Sorbier sur le site de son émission "Affaire en cours" sur France Culture - 15 mars 2021 Affaire en cours poursuit son tour d'horizon des institutions culturelles fermées au public mais toujours actives avec Edouard Chapot, co-directeur du Théâtre 14 à Paris.
Ecouter l'entretien avec Edouard Chapot (8 mn) La salle du Théâtre 14, à Paris.• Crédits : Carole Sertillanges Les institutions culturelles sont fermées depuis de longs mois. Alors que la colère et l'incompréhension montent, Affaire en cours continue son tour d'horizon des institutions fermées au public pour comprendre ce qui se passe derrière leurs portes closes. Après le Frac Bretagne et la scène nationale de Châteauroux, le Théâtre 14 à Paris. Au micro de Marie Sorbier, Edouard Chapot, co-directeur du théâtre avec Mathieu Touzé, explique comment le théâtre vit et poursuit ses missions malgré l'absence du public. Comme dans tous les théâtres, notre mission de service public est d'accueillir les spectateurs. Depuis novembre, nous sommes en incapacité de le faire, mais le théâtre continue à vivre. Nous l'avons transformé en une fabrique de théâtre et de pensée.
Edouard Chapot Fabrique de théâtre Le Théâtre 14 accueille des équipes en résidence pour des répétitions et propose des représentations professionnelles. Entre novembre et mars, le théâtre a accueilli exclusivement des créations. Une activité qui continue l'écosystème du spectacle vivant, et qui permet aux projets d’être vus, diffusés, et éventuellement tournés la saison suivante. A cela s'ajoutent des ateliers professionnels menés par le comédien et metteur en scène Marc Ernotte. Initialement prévus toutes les deux semaines, ces ateliers ont maintenant lieu chaque semaine, en raison d'une demande très forte de la part des comédiens. Ces ateliers, qui se tiennent dans différents lieux du 14ème arrondissement de Paris, leur permettent de maintenir des liens entre eux et d'entretenir leur pratique théâtrale. Fabrique de pensée Le Théâtre 14 profite du temps de la fermeture pour réfléchir à l'essence et à l'utilité mêmes du théâtres. Cette réflexion prend la forme de rencontres avec des autrices et auteurs, qui ont lieu dans la plupart des cas dans l'enceinte du théâtre, tout en étant retransmises en direct sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14. Des discussions "ciné-philo" sont également proposées, avec le philosophe et réalisateur Ollivier Pourriol. Ces discussions sont un moyen de penser le lien social qui a normalement lieu au théâtre, cette sociabilité particulière où l'on est ensemble sans forcément se parler, mais en regardant tous la même chose. Ollivier Pourriol parle de temps partagé, ce qui est ce qu'on a perdu aujourd'hui et que l'on essaye de retrouver aujourd'hui par les outils numériques.
Edouard Chapot On ne propose pas de captations de spectacles. On estime que le spectacle vivant est vivant, par définition. En attendant que les théâtres puissent réouvrir, on propose d'autres outils, notamment numériques, pour quand même se retrouver ensemble.
Edouard Chapot Une colère saine Aux yeux du directeur du Théâtre 14, la colère des intermittents et des étudiants qui occupent des théâtres en France, comme le Théâtre de l'Odéon et le Théâtre de La Colline, est saine et légitime. Il est légitime d'interroger la fermeture des lieux culturels qui, eu égard à toutes les autres ouvertures, est d'autant plus difficile à comprendre. Ces occupations permettent de poser le débat dans l'espace public. C'est une radicalité intéressante et nécessaire, d'autant plus que des groupes très différents occupent les lieux : la CGT, les étudiants, les intermittents.
Edouard Chapot Edouard Chapot estime nécessaire la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, dont le secteur d'activité est sinistré non seulement aujourd'hui mais à long terme. Si proposer des représentations professionnelles permet de répondre au court terme au problème de la diffusion, l'absence d'échéance d'ouverture finit par avoir raison des répétitions de spectacle. A quoi bon répéter un spectacle dont on ne sait quand il va pouvoir se jouer ? Même si on a l'autorisation de répéter, ça commence à s'essouffler. Avoir des échéances de réouverture, même à long terme, devient absolument indispensable. Si ça doit passer par l'occupation, je trouve ça très sain.
Edouard Chapot Une boîte à outils argumentaire Un colloque prendra place les 30 et 31 mars 2021 au Théâtre 14. Un moment destiné à construire une boîte à outils permettant de dire, dans le débat public, pourquoi le spectacle vivant est essentiel. Les arguments pour défendre cette perspective ne sont pas forcément évidents, dit Edouard Chapot. Selon lui, les arguments d'autorité soulignant le spectacle comme moyen de la rencontre ne suffisent pas dans le débat public. Ainsi, le colloque organisé au Théâtre 14 mêlera chercheurs, universitaires, médecins, personnalités politiques et philosophes pour aborder l'ensemble des facettes du spectacle vivant. Dans le respect des normes sanitaires, cet événement accueillera dans le théâtre un nombre de professionnels, et sera diffusé le 31 mars 2021 en direct sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14. Des extraits du colloque seront par la suite disponible sur le même site. Au programme de ce colloque figurent notamment cinq tables rondes : une qui réunira un thérapeute, un neurologue, un psychiatre, une autre portera sur l'utilité sociale de la culture, deux autres traiteront des aspects économiques de la culture et de ses financements publics, et une qui reviendra sur les liens entre territoires et culture. Entre chacune de ces réunions, des personnalités politiques et des artistes seront amenés à faire un retour d'expérience. Prêts à ouvrir demain Dans une perspective de vaccination à grande échelle, Edouard Chapot espère pouvoir réouvrir son théâtre dès début mai, avec des protocoles sanitaires stricts et des jauges réduites. En tout cas, nous sommes prêts. Le public n'attend que ça et nous, les équipes administratives, techniques et artistiques, nous tenons prêt pour ouvrir dès demain.
Edouard Chapot Je crois que la saison prochaine sera une saison de crise. Enormément de lieux pensent d'abord le report des spectacles, par solidarité avec les équipes artistiques. Si des changements et des transformations doivent se faire au niveau des systèmes de production et de diffusion du spectacle vivant, ce sera plutôt à partir de la saison 2022-2023. Il est certain que tout le monde se pose ces questions. Cela a mis en valeur une forme de surproduction des spectacles, et il s'agit maintenant de repenser à la fois cette production et les temps de visibilité.
Edouard Chapot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 7:36 PM
|
Avignon 2007 - Quartett écrit en 1981 est un palimpseste des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, couple de libertins maléfiques, déploient les artifices d'un jeu dont la visée est de détruire la civilisation en usant des moyens offerts par celle-ci Ecouter "Quartett" enregistré par Sami Frey et Jeanne Moreau (58 mn) Avec Jeanne Moreau et Sami Frey Quartett de Heiner Müller, écrit en 1981 est un palimpseste des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, texte mythique du siècle des Lumières, dans lequel la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, couple de libertins maléfiques, déploient les artifices d'un jeu dont la visée est de détruire la civilisation en usant des moyens offerts par celle-ci. Dans les années quatre-vingt, Heiner Müller qui s'entretenait régulièrement avec Jean Jourdheuil, traducteur et passeur de son oeuvre à l'ouest, lui confia qu'il aimerait bien voir un jour interpréter la marquise de Merteuil dans "Quartett", par Jeanne Moreau . Un souhait qui resta secret jusqu'au jour où Jean Jourdheuil , auquel France Culture avait confié un hommage à Müller en 2006, l'évoqua de nouveau. France Culture et le Festival d'Avignon ont décidé de réaliser ensemble ce rêve de Heiner Müller en proposant à Jeanne Moreau et à Sami Frey une lecture en public de cette pièce vertigineuse, pensée comme un incessant jeu de rôles, un étrange échange entre masculin et féminin et l'inscrire dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Celle-là même qui accueillit Jeanne Moreau, à ses tout débuts lors du premier festival avec Jean Vilar, en 1947, et plus récemment Sami Frey dans Nathan le sage. Traduit de l'allemand par Jean Jourdheuil et Béatrice Perregaux Une lecture proposée par Jean Jourdheuil Réalisation : Blandine Masson Heiner Müller grand écrivain, dramaturge et penseur allemand est mort le 30 décembre 1995 à Berlin. Publié aux Editions de Minuit Quartett de Heiner Müller est sorti en coffret chez Harmonia mundi en 2008 .

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 2:03 PM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans l'Oeil d'Olivier 10 mars 2021 Dans un TNS pas encore occupé par les élèves de l’École d’art dramatique, Stanislas Nordey et son interprète Cécile Brune répètent, salle Gignoux, Au Bord, un texte intime et politique de Claudine Galea. Insufflant la vie aux maux de l’autrice, les deux artistes sondent les profondeurs de l’âme humaine, sa capacité à évoquer l’indicible, sa résilience introspective. Un travail d’orfèvre en cours.
En ce début de mois mars où la France est toujours sous couvre-feu dès 18 heures, le pâle soleil d’hiver semble indécent. Ses rayons réchauffent les cœurs, les visages. Devant le TNS, quelques élèves de l’École traînent sur les marches, profitent de ces premiers beaux jours. Démarche décidée, pas assurés, Céline Brune, en grande discussion avec Stanislas Nordey et Claire Ingrid Cottanceau, traverse le parvis, entre dans le bâtiment et file vers les coulisses pour se changer et se préparer à monter sur scène. Bien que reporté à la fin juin en raison des restrictions sanitaire, le spectacle se prépare doucement, sûrement. Un théâtre en état de marche Quand on pénètre dans le foyer du TNS, une hôtesse guide et renseigne les visiteurs. Loin d’être à l’arrêt total, le lieu continue de vivre, de palpiter. « Par rapport au premier confinement où les théâtres étaient complètement fermés, souligne Stanislas Nordey, nous pouvons travailler, répéter, accueillir des compagnies qui n’avaient pas de lieux pour répéter, ce qui n’est déjà pas si mal. Toutefois, Il manque le public. Et c’est quand même énorme, car à quoi sert-il de faire notre métier si nous ne pouvons le montrer, le présenter. Les ateliers décors et costumes tournent à plein régime. La billetterie s’occupe de rembourser les places achetées au lieu d’en vendre. Par ailleurs, nous continuons à reporter, reprogrammer la plupart des spectacles que nous ne pouvons accueillir afin d’en sauver le plus grand nombre. » Faute de pouvoir ouvrir le bâtiment, le directeur des lieux tient à ce que le lien avec les différents publics soit maintenu. Les ateliers en milieu scolaire continuent à avoir lieu. Un monologue frappant Séduit par Au bord, qu’il lit dès sa sortie en 2010, Stanislas Nordey a très vite envie de l’adapter à la scène. « Clairement l’écriture de Claudine m’a sauté au visage, se souvient-il. Ce n’est pas tant le sujet, mais bien la plume de l’auteure, sa langue qui m’a attrapée. Je fonctionne toujours comme cela. Ce sont les mots qui me touchent et me donnent envie de m’emparer d’un texte. C’est d’ailleurs la première fois que je mets en scène un monologue pour un autre comédien. Je l’ai fait l’an passé pour moi-même avec Qui a tué mon père d’Édouard Louis, mais en général, je préfère les spectacles plus choraux. Alors que pour Au bord, il y a une vraie évidence. » Trouver l’actrice En 2004, le monde entier découvre l’horreur du traitement réservé aux prisonniers d’Abou Ghraib, suite à la publication dans de nombreux médias d’un certain nombre de photos montrant l’indicible. C’est celle d’une soldate américaine, condamnée depuis par la cour martiale, tenant en laisse un prisonnier nu et à terre qui marque l’esprit de Claudine Galea. Sous le choc, elle l’épingle sur son mur de travail. Des mois durant, quinze plus exactement, elle l’observe dans ses moindres détails. Hantée par cette image qui la fascine autant qu’elle la révulse, elle recommence plus de trente fois l’écriture d’Au bord avant que ne jaillisse du plus profond de ses entrailles une parole poétique, crue, introspective, intime autant que politique. « Pour incarner ce texte fort qui aborde l’enfance, les brimades d’une mère, la sexualité, le désir, la place de la femme dans nos sociétés machistes, explique Stanislas Nordey, il fallait trouver une comédienne puissante, capable de porter ces mots, de vivre avec, des mois durant, sans en avoir peur. Beaucoup ont refusé, ne se sentant pas à l’aise avec la liberté de ton du texte, sa complexité et la violence qu’il dégage. » Cécile Brune, une évidence Cécile Brune, tout juste évincée de la Comédie-Française, ainsi que le directeur du TNS sont de vieilles connaissances. Ils ont connu les mêmes bancs au Conservatoire. « Elle a fait partie de mes premiers spectacles en tant que metteur en scène, se souvient Stanislas Nordey, puis elle est rentrée au Français et nous n’avons plus travaillé ensemble. En 2013, elle s’est échappée de la place Colette pour interpréter Titania dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare que j’ai monté aux Amandiers à Nanterre. Quand j’ai su qu’elle était libéré à son corps défendant de ses obligations parisiennes, j’ai eu comme une révélation. Tout de suite, je me suis dit c’est elle, j’aurais dû y penser dès le départ. Pour insuffler la vie à la Parole de Claudine Galea, il fallait une artiste de sa trempe, capable de passer de la douceur à la puissance, une comédienne qui n’est pas froid aux yeux. » Un duo de choc Après quelques jours où il a fallu qu’ils se ré-apprivoisent, la complicité des jeunes années a ressurgi plus forte, plus intense. L’un à la mise en scène, l’autre au plateau, ils se comprennent, se complètent. Avec beaucoup de finesse, Stanislas Nordey donne la confiance nécessaire à la comédienne, victime de vertige. Debout sur une table, Cécile Brune n’est pas à son aise. Le texte coule difficilement. Elle perd sa concentration. La peur du vide, de glisser, bloque sa capacité à incarner les mots de l’auteure. Mais en grande artiste, elle prend sur elle. Après un faux départ, une bonne respiration, elle se glisse avec justesse dans la peau de la narratrice et fait vibrer les maux de l’autrice. Elle est cette femme face à sa feuille blanche, cette autrice en quête de sens, cet être blessé suite à une rupture amoureuse. Un moment hors du temps Ne pouvant présenter au public et préférant éviter les représentations pros, les deux artistes ne travaillent qu’en tout petit comité. Bien sûr, sa complice de longue date, Claire Ingrid Cottanceau est là en soutien. Son regard doux, sa rondeur naturelle sont les bienvenus. Ils sont du baume au cœur. La justesse de ses interventions vient parfaitement compléter le travail de direction de Stanislas Nordey et rassurer les doutes de Cécile Brune. Stéphane Daniel à la lumière et Emmanuel Clolus pour la scénographie sont aussi présents pour régler les derniers ajustements. C’est un travail d’équipe parfaitement rodé qui se joue dans la salle et sur scène. Fébrile, ne sachant pas quand la pièce pourra être créée véritablement, l’équipe cisèle dans la bonne humeur et la bel ouvrage, l’œuvre dense et coup de poing de Claudine Galea. Cette première plongée dans les répétitions d’Au Bord donne l’eau à la bouche. Retrouver Cécile Brune sur les planches fait partie de ces petites gourmandises qui réchauffent les cœurs. Sa présence et sa voix frappent toujours aussi juste, aussi net. Sous le regard de Nordey, elle donne au texte toute sa force et sa profondeur. Le spectacle en devenir ne demande qu’à trouver son chemin auprès d’un public, qui devrait sans nul doute être conquis. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Strasbourg Au bord de Claudine Galea, autrice associée au TNS
Répétitions en mars 2021 au TNS
Reporté du 23 juin au 3 juillet 2021 Tournée
du 24 mars au 18 avril 2021 à La Colline – théâtre national – Spectacle en cours de report Mise en scène de Stanislas Nordey
Avec Cécile Brune
Collaboration artistique – Claire Ingrid Cottanceau
Scénographie d’Emmanuel Clolus
Lumière de Stéphanie Daniel
Costumes de Raoul Fernandez Crédit photos © Jean Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 12:23 PM
|
Par Marie Sorbier dans AOC -11 mars 2021 Les projets contrariés naissent parfois des épiphanies. Le 16 janvier dernier, après un an de rêves avortés et d’incertitudes, Boris Charmatz présentait enfin sa Ronde dans un Grand Palais vide, totalement offert aux caméras et au ciel. Du lever du soleil rose flamboyant aux flocons de neige qui voilèrent quelques instants la verrière, l’espace tout entier semblait coïncider pour faire de ce moment unique un événement bien au-delà du cercle des aficionados de danse contemporaine. La représentation n’a lieu qu’une seule fois ; une boucle de vingt et un duos pour un peu plus de trois heures de spectacle répétés quatre fois, soit douze heures ininterrompues de l’aube à la nuit. publicité Peu importe alors la démesure des premières idées abandonnées, peu importe les compromis, les difficultés de répétitions, le chorégraphe parvient à créer un spectacle-monde, une chaîne contagieuse où les corps, humbles, se frayent un passage dans l’immensité de la nef. Un documentaire, « Boris Charmatz face au Grand Palais », sera diffusé en parallèle du spectacle pour raconter cet accouchement à rebondissement, mais en se voulant très didactique, il déflore un peu vite l’essence de ce qui advient au final. L’œuvre se suffit et ne nécessite pas d’exégèse tant elle sait s’exprimer avec force, humour et émotion par elle-même. Là se niche le coup de maître du chorégraphe, parvenir avec une forme exigeante à magnifier tous les corps en scène par la diversité des expressions et leurs confrontations à un environnement hors norme. Ce vaisseau déserté que le regard ne peut appréhender pleinement ressemble étrangement, en ce jour glacial de janvier, à cette chape invisible qui nous retient reclus depuis un an. On se sent dépassé, incapable d’en mesurer l’ampleur. L’ouverture, très intimiste, donne le ton : herses est l’un des premiers spectacles de Charmatz, qu’il danse ici avec Johanna Elisa Lemke, un des plus intimes et crus aussi. Deux corps nus qui luttent autant qu’ils s’étreignent, l’un servant toujours de sol à l’autre. On s’écrase, on prend le dessus et on se retrouve à plat, sur ce béton gelé. À l’autre bout de la boucle, le boléro 2 de la chorégraphe Odile Duboc et de sa complice Françoise Michel résonne comme une réponse, ce dernier duo, tout en douceur se laisse envelopper par la musique de Ravel sans être submergé. Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh, debout, imposant leur rythme non pas contre mais par-delà la puissance entrainante du Boléro, les âmes ont repris possession de leurs peaux. On notera la dentelle de ce montage chorégraphique, chaque transition étant pensée pour surprendre et faire sens, l’une arrivant en courant, l’autre dévalant l’escalier, Salia Sanou en chantant et Djino Alolo Sabin, pieds nus, la tête enrubannée dans un jean. Les gestes précis qui s’amplifient dessinent des reliefs géométriques qui entrent en écho avec l’architecture de l’écrin, béton et Art nouveau, le frisson se propage. Le spectateur le comprend vite, il ne s’agira pas d’occuper l’espace mais d’imposer délicatement des corps à corps, des rencontres, des ruptures, des dialogues entre les arts, entre les danses, d’humains à humains. L’érection du Grand Palais en 1900 correspond à la publication du roman sulfureux La Ronde d’Arthur Schnitzler, qui servira de fil dramaturgique. Le principe de ces duos emboîtés, l’un reste et l’autre s’en va, établit un pacte avec le spectateur, à la fois rassuré par le systématisme et avide de connaître le prochain artiste à entrer dans la danse. Car Boris Charmatz a réuni une distribution à faire pâlir d’envie n’importe quel grand festival au monde : danses contemporaine, classique, urbaine, théâtre, chant, musique s’entrechoquent, entre reprises de morceaux du répertoire et créations. Ainsi, le danseur et chanteur François Chaignaud en arlequin à pointes partage la lumière avec le trompettiste Médéric Collignon, les danseurs de l’Opéra de Paris croisent les acteurs en situation de handicap de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Marlène Saldana et Johan Leysen prennent la parole pour interpréter un extrait du roman de Schnitzler où le désir contamine les esprits. Et puis un frémissement, elle arrive majestueuse et austère, son aura la précède et la poursuivra tant elle a donné à la danse contemporaine des paysages à explorer. Anne Teresa de Keersmaeker, chorégraphe flamande associée dans les mémoires à la musique de Steve Reich comme à celle de Bach, les premières notes de piano pour le légendaire Fase, le violon qui s’emballe pour cette relecture de Partita 2 et nous voilà happés par la rigueur de cette grammaire chorégraphique qui hypnotise autant qu’elle offre matière à gloser. Les gestes précis qui s’amplifient dessinent des reliefs géométriques qui entrent en écho avec l’architecture de l’écrin, béton et Art nouveau, le frisson se propage. Comme le soulignait très justement Florian Gaité dans son essai Tout à danser s’épuise, paru récemment, la danse est essentiellement l’écriture d’une perte :
« Elle ouvre un espace où l’on fait ce que l’on veut de sa fatigue, donnant sa perte en spectacle pour mieux susciter le désir d’une autre économie corporelle. À chacun alors d’entrer dans la ronde et d’accepter l’idée : tout corps qui tend à vivre doit aussi consentir à perdre. »
C’est un cadeau pour les temps contemporains, une invitation à entrer dans le cercle pour nous tous, reclus mais pas repentis, LaRonde comme manifeste d’une révolution possible. La captation du spectacle réduite à moins de deux heures permet de revivre au plus près des interprètes cette folie organique, sans perdre à l’image le gigantisme de l’environnement dans lequel ils se battent. C’est une lutte, un passage de témoin, une abolition de la distanciation sociale qui contamine avec douceur nos yeux et permet de croire, le temps d’une danse, aux prochains jours heureux. La Ronde, de Boris Charmatz, filmée par Julien Condemine, le 12 mars à 20h50 sur France 5. Ndlr : Boris Charmatz a participé à une rencontre en live organisée par AOC et le Festival d’Automne (coproducteur de La Ronde) le vendredi 5 mars 2021. « Faire connaissance : pour une hybridation des arts et des sciences sociales », moment de discussion et d’échange entre artistes et chercheurs et chercheuses, est à (re)voir en ligne.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 12, 2021 6:30 PM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks - 8 mars 2021 Dans une mise en scène signée François Berreur, Marcial Di Fonzo Bo et Laurent Poitrenaux s’accordent à l’humour pince-sans-rire d’un Jean-Luc Lagarce résolu à témoigner en temps réel des années sida. Archéologie sensible d’une œuvre, Portrait Lagarce, ultimes ébauches renvoie avec une joyeuse ironie au Journal de Jean-Luc Lagarce en l’éclairant d’un montage d’extraits de ses pièces. Compagnon de route de cette époque pionnière, François Berreur nous rappelle que, avant de devenir l’un des auteurs français contemporains parmi les plus étudiés et montés au monde, Lagarce, mort du sida en 1995, mena une existence en forme de longue traversée du désert. “J’entrepris de ne raconter que ma propre impuissance à raconter, précisait Jean-Luc Lagarce. Et naturellement‚ cette impuissance‚ je fus impuissant à la raconter...” Le spectacle épingle la myriade des fins de non-recevoir qui menacent ses projets. Si le sentiment d’échec et le doute dominent, l’œuvre incomprise par ses pairs s’explore telle une mine de punchlines où l’humour et la lucidité de l’auteur imposent délicieusement leur loi. Laurent Poitreneaux, dans le rôle du dramaturge, et Marcial Di Fonzo Bo, dans ceux de l’ami, du confident ou du partenaire de jeu, lèvent le voile sur les coulisses de cet enfermement. Récit d’une moderne solitude, la pièce prend acte d’un temps où dire des vérités aussi politiques que bouleversantes sur le sida était renvoyé à une impudeur n’ayant pas sa place sur les plateaux. Portrait Lagarce, ultimes ébauches textes Jean-Luc Lagarce, collage et mise en scène François Berreur, avec Marcial Di Fonzo Bo et Laurent Poitreneaux. Théâtre de L’Athénée, Paris, avec La Comédie de Caen. En tournée – dates à préciser
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 20, 2021 12:57 PM
|
Un message d'Emmanuel Meirieu, metteur en scène
Je m’appelle Emmanuel Meirieu, je suis metteur en scène de théâtre. Le jeudi 4 mars, j’ai répondu à l’appel des insurgés de l’Odeon. Ils avaient hissé leur drapeau rouge au sommet du théâtre, ils dressaient le poing, Du bout de ma Bretagne, je l’ai entendu ici cet appel, sur ces réseaux sociaux. J’ai pris le premier train et ils m’ont fait l’honneur de m’accueillir. Ils m’ont offert un sac de couchage et un café chaud, et leur fraternité. 1 an que je crevais d’impuissance, de rage, de solitude, comme vous peut être. Citoyen déchu de son droit à travailler, sous-citoyen comme tous “ceux qui ne sont rien” en Macronie, les non-essentiel, les inutiles, les économiquement non viables. De ceux qui ne pèsent rien dans leurs tableurs Excel, quand ils évaluent le coût et le profit politique d’une vie humaine. Depuis 1 an, j’appelais à la désobéissance, à l’ouverture des théâtres coûte que coûte. J’ai fait quelques clandestines, ouvertes à tous, grâce au courage de directeurs de théâtre. Mais je criais, seul, dans le désert. Le jeudi 4 mars, j’ai répondu à l’appel des occupants de l’Odéon, parce que je voulais, plus que tout, qu’on réouvre les salles de spectacles. Je voulais qu’on me rende mon outil de travail, injustement confisqué, cadenassé. Et je voulais qu’on me garantisse mes droits à l’assurance chômage pour un an encore, en tant qu’artiste et technicien du spectacle. Et sur le balcon de l’Odeon, ce soir là, sous les drapeaux rouges, j’ai découvert des femmes et des hommes qui dressaient le poing pour une cause plus grande que la mienne. Ils refusaient que 800 000 de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Ils exigeaient travail et protection sociale pour toutes et tous, sur le toit ce théâtre que l’on dit public. Ils exigeaient le retrait de la réforme de l’assurance chômage. Aujourd’hui, devant toutes les scènes publiques de France, nous nous réunirons. “Le printemps est inexorable”, c’est le nom qui a été donné à cet événement, reprenant une citation de l’immense poète révolutionnaire Pablo Neruda, défigurée par notre Ministre de la Culture en conférence de presse. Pour appeler à la réouverture des théâtres et à « l’année blanche » pour les bénéficiaires d’un régime spécifique d’indemnisation chômage que l’on appelle les intermittents du spectacle. Un puissant mouvement social est né dans nos théâtres publics le jeudi 4 mars. Nous portons maintenant d’autres espoirs, d’autres colères, et c’est l’honneur de notre métier. Nos théâtres redeviennent des maisons du peuple et des travailleurs, c’était notre utopie. Celle de nos pères fondateurs. Ne laissons pas penser, pas un seul instant, pas une seule seconde, que nous nous désolidarisons de ce mouvement social pour réclamer la seule réouverture des salles et « l’année blanche ». Nos théâtres rendent leurs voix à tous les sans voix, tous les oubliés, les humiliés. Nous affichons nos valeurs de fraternité, dans chaque édito, chaque plaquette de saison, chaque spectacle. Ne les renions pas. C’est notre plus grand combat depuis la décentralisation. Ne luttons pas seulement pour être épargné de la foudre de Jupiter, car la foudre tombera sur d’autres. Et il n’y aura aucune place pour l’art et la culture dans une société de calculs égoïstes. Sinon, cette année blanche, et la réouverture de nos lieux d’art, ne seront que la dernière cigarette du condamné à mort. Quelques bouffes de plateau avant l’échafaud. Les salles rouvriront à 40 pour cent de leur capacité d’accueil, sous le poids de plomb des normes sanitaires. Les prix des places augmenteront, et fermeront les portes de nos théâtres au plus grand nombre. L’année blanche sera accordée, comme un fait du prince, et apparaîtra comme un privilège scandaleux. Mais si nous nous battons pour un idéal plus grand que nous , nous pourrons regagner notre droit au travail et à la protection sociale. Et quitte à citer le poète, autant le faire entier : « La vie des vieux systèmes a éclos dans les énormes toiles d’araignée du Moyen Age… Des toiles d’araignée plus résistantes que l’acier des machines… Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens qui ont pratiqué le changement, qui l’ont fait triompher, qui l’ont fait fleurir… Le printemps est inexorable ! » (Pablo Neruda)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 19, 2021 1:39 PM
|
par Julien Gester dans Libération publié le 19 mars 2021 à 10h46 Comment ça va, la culture ? Tous les jours ou presque, la newsletter «Libé Culture» demande à des artistes et acteurs du secteur des nouvelles de ce qu’ils fabriquent, tant bien que mal. Aujourd’hui, Valérie Massadian, cinéaste, qui nous parle depuis le théâtre parisien occupé. Cinéaste après avoir été notamment garagiste, mannequin ou scénographe, Valérie Massadian est l’auteure de deux beaux longs métrages, Nana et Milla. Depuis douze jours, elle prend part jour et nuit à l’occupation du théâtre de l’Odéon à Paris. «Quand l’occupation a commencé, j’ai eu une nuit d’hésitation avant de revenir à Paris pour m’y joindre, car je savais que ça avait été organisé par la CGT Spectacle et que j’ai une réticence vis-à-vis des syndicats – à qui je reconnais des acquis non négligeables mais aussi des lâchetés, certaines trahisons. Mais je suis aussi à un moment de vie où je considère que face à ce qui est en train de se construire, ou surtout de se détruire, à travers les lois délirantes pondues par ce gouvernement, il faut s’élever contre les effets extrêmement graves de la politique sur la vie de beaucoup de gens. Et cette occupation est pour moi cohérente avec les dernières batailles qui ont pu être menées socialement. «On fait deux AG par jour, matin et soir, avec une très belle écoute, autour de cette idée de parvenir à faire durer, à faire comprendre aux gens ce qu’on est en train de faire. C’est très riche, divers, nourri par des gens qui viennent dans les agoras avec leurs métiers très loin de ce qu’on peut connaître, leurs expériences. J’apprends énormément. Il y a toutes sortes de solidarités qui s’expriment, y compris d’endroits surprenants, parce qu’on arrive doucement à faire passer l’idée que ce n’est pas qu’un truc d’intermittents du spectacle. Il s’agit d’arriver à sortir de l’entre-soi, militant ou corporatiste, pour trouver un langage commun dans le rapport de force avec ce gouvernement. C’est vital. «Mais les réseaux sociaux, les médias, le gouvernement «font leurs courses» en fonction de ce qui les arrange et ça ne reflète pas ce qui se met en place à plein d’endroits, sur tout le territoire. Avec des vrais écarts entre des lieux qui ont accueilli ces occupations à bras ouverts, ou d’autres qui ont fait leur casting, ce qui a dépolitisé la chose. Quand certains directeurs de salles disent que tout ce qu’ils veulent c’est la réouverture, on n’est évidemment pas contre ici. Mais la réouverture seule, c’est la mort, ça laisse sur le carreau plein de gens, intérimaires, précaires, dans le secteur culturel comme ailleurs, tandis qu’on aligne les milliards d’euros pour les entreprises… Quand les revendications ont été présentées à Castex, il les a balayées une à une : “La réforme de l’assurance chômage ? C’est un autre dossier.” Alors que c’est indissociable ! «D’un côté, beaucoup considèrent la culture comme un truc de bourgeois, et on ne peut pas leur donner tort quand on voit que la plupart des gens du milieu ne se sont pas mobilisés contre les lois travail, la réforme des retraites, et semblent se réveiller maintenant qu’ils sont secoués par leur part de la crise. Je comprends la défiance que ça peut inspirer, faute de les avoir vus se bouger jusque-là. Et puis de l’autre côté, il y a ceux qui continuent à répéter leurs spectacles en disant au micro qu’ils nous soutiennent mais ne veulent surtout pas se mélanger. C’est mou, ça reste neutre, ça a peur pour ses fesses, parce qu’on a plus de pouvoir que les gens ici, parce qu’on a un nom, parce qu’on existe socialement dans la culture. C’est un étau qui me met très en colère, parce qu’il faudrait réunir tout le monde. Faire comprendre à tous ceux qui ne se sentent pas immédiatement concernés par les mesures terrifiantes qui se mettent en place que, non seulement qu’il faut être solidaires, mais aussi que tout le monde sera à un moment ou un autre affecté. «C’est la même chose que ce qu’il s’est passé avec les césars, l’an dernier avec Adèle [Haenel], ou cette année, avec Corinne Masiero et Jeanne Balibar – dont le discours était précieux et résumait si clairement tout. Ça va à certaines personnes mais la majorité dit que non, “ce n’est pas le bon endroit pour ça”. Va-t-il nous rester un endroit d’ailleurs ? (Rires)» Légende photo : Devant le théâtre de l'Odéon occupé, le 5 mars. (Francois Mori)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2021 5:25 PM
|
Par Philippe Noisette dans Sceneweb 7 février 2021 Carnets de création (7/28). Complice de Vimala Pons, Tsirihaka Harrivel se réinvente en homme-orchestre avec La Dimension, objet sonore et scénique. La sortie d’un album de musique d’abord, puis un spectacle “d’après” ensuite. Tsirihaka c’est un corps, souple et chorégraphique, autant qu’une voix, enchantée. Avec De nos jours (notes on the circus) du collectif Ivan Mosjoukine, on découvrait l’un, dans Grande, en duo avec Vimala Pons, on entendit l’autre. Depuis, on guette chaque pas de côté de Tsirihaka Harrivel, artiste attachant. Son actualité en cette fin d‘hiver ? « Ce sont des journées à travailler autour d’un spectacle qui s’appelle La Dimension d’Après. Comme son nom l’indique c’est un spectacle “d’après” : il est écrit “d’après” La Dimension, un album de musique que j’ai commencé à écrire à partir de 2017 et qui sortira fin février chez Teenage Menopause ; il est “d’après” l’histoire inventée de quelqu’un qui tomberait dans un bâtiment désaffecté (lui-même d’ailleurs serait désaffecté émotionnellement : il n’échouerait pas là par hasard) ; et il est “d’après”, et après, GRANDE- (le spectacle que j’ai imaginé avec Vimala Pons ma partenaire de création) : c’est un zoom sur la 28ème minute de ce spectacle. 2 choses émergent aujourd’hui donc (album et spectacle) qui forment une sorte de diptyque : La Dimension d’après/la Dimension…, et ce diptyque crée lui-même un autre diptyque avec le spectacle que prépare Vimala, Le Périmètre de Denver (2022). Voilà c’est tout plein de raisons, mais concrètement je ne répète qu’un spectacle basé sur une succession de coups ». De ce solo, mais pas seul – « nourri de lectures comme celle de Pacôme Thiellement ou de rencontres »-, Harrivel dit qu’il est « riche d’une part de moi. Avec Vimala, nous avons co-écrit nos spectacles pendant 10 ans. Avoir une respiration c’est essentiel ». Même si Vimala Pons n’est jamais (trop) loin qui le conseille sur des choses de fond. Comme nombre de créateur-interprète, Tsirihaka a vécu 2020 au (faux) rythme des confinements et autres contraintes. « J’ai été jusqu’ici en période d’écriture mono-tâche sur ce cycle de travail et la plupart des théâtres ont fait le maximum pour assurer les périodes de résidence (donc sans public). Ce qui est une chance absolue dans cette période négative. On va dire que les conséquences étaient moindres (de ce côté-là). Avec les personnes qui travaillent avec moi, on a dû surfer sur cette vague très aléatoire pour continuer à faire tous nos trucs. On se prépare maintenant à la non-création (?) d’un spectacle dans 3 semaines, ça sera surtout une manière pour nous de créer une ponctuation finale à cette période d’écriture avant de pouvoir un jour le présenter à pleins de gens. L’album de musique, La Dimension, sortira donc avant : il jouera vraiment son rôle de bande-son à l’envers. Les choses sont là et j’essaie de tenir les timings car c’est pour moi une manière de ne pas me sentir complètement impuissant face à ce qui arrive et cela permet de commencer à travailler sur les autres projets qui me tiennent à cœur et qui m’attendent ». Faudra-t-il penser autrement ce monde d’après, celui de la création en tout cas ? « Je ne sais pas quoi répondre…C’est quand même quelque chose tout ce qu’on se prend en pleine face en ce moment, on est obligé de l’affronter et il faudra bien trouver un moyen de transformer cette matière tristoune en quelque chose… ». La solidarité, notion essentielle lorsque l’on pense collectif, est dès lors un horizon possible pour les créateurs aujourd’hui. On pose la question à Tsirihaka Harrivel. « Je ne sais pas si c’est cela la question mais je répondrai que je sens autour de moi une nécessité de se regrouper, de s’organiser, de mutualiser les moyens et de créer pleins de microcosmes pour ne pas dépendre uniquement de ce qui peut se passer : préparer une défense. Bien sûr ce n’est pas nouveau mais cette satanée crise a accéléré cette tendance. C’est maintenant le futur, en fait. Il faut se ressouvenir qu’on va faire des choses et que c’est puissant de voir un spectacle (parfois) quand c’est autre chose qu’un avis -un peu comme ici- mais quelque chose écrit avec une langue nouvelle et une pensée qu’on aurait jamais pu imaginer. » Propos recueillis par Philippe Noisette – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2021 2:24 PM
|
Écoutez l'annonce du répondeur de notre location individuelle en attendant de nous avoir au téléphone Allô, bonjour, ici le Théâtre du Soleil Ecouter le message audio du répondeur Écoutez l'annonce du répondeur de notre location individuelle en attendant de nous avoir au téléphone
Allô, bonjour, ici le Théâtre du Soleil, Nous devons certainement le plaisir de vous entendre aujourd’hui au pavé publicitaire que vous venez de découvrir dans Le Monde annonçant notre spectacle : L’île d'or.
Ce pavé est comme une sorte de profession de foi et c’est donc avec joie et fierté que nous pouvons vous annoncer que nous commencerons le mercr#¥∅∂ §ð∑∫ juin à ᚜ɔɘh30 ! La location ouvrira le lundi‡Þ∴ᚑ mai. Et les conditions sanitaires requises pour être accueillies dans la salle seront les suivantes :
nous vous demanderons de \Ђɔɘɐɖדᚂ vos masques, de ð„ᚏᚗ ᚜ᚢЉЂב
distances ขกᚠᚇ⠇ ɚ\ de דᚂ᚜ᚗᚚ gel, de Ђɔɘɐɖ tests, ₢₥⌋₩∠⤈⊇∳ PCR, ᚥᚗ∅∂ § logiques ᚡข∩∭⌊∝╭⤄∇ vaccination.
Merci de votre de votre appel et de l’humour dont vous faites preuve en écoutant cette annonce qui reflète exactement notre situation à tous. Si vous saviez, cependant, comme nous sommes heureux de la certitude que nous avons de vous retrouver bientôt. Au mercr#¥∅∂ §ð∑∫ juin donc ! Nous comptons sur vous et nous vous attendons de pied ferme. Ariane Mnouchkine

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 17, 2021 6:02 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 17 mars 2021 Dans « Pourama pourama », Gurshad Shaheman racontait sa vie en trois parties et trois heures. Même durée, même structure pour « Les forteresses » où, sans un mot, il écoute trois actrices raconter la vie intime de sa mère et de ses deux sœurs lesquelles sont présentes sur la scène. De la chute du Shah à celle des illusions, du pouvoir des mollahs à celui des hommes. Magnifique et pénétrant. Dans les hauteurs de Téhéran, de part et d’autre des rives d’une étroite rivière aux allures de torrent, s’étagent des cafés-restaurants avec des terrasses sans chaises ni tables où de grands tapis, évidemment persans, ordonnent l’espace. On s’y assoit, on s’adosse. En famille, entre amis, en bandes de jeunes. La scénographie (Mathieu Lorry-Dupuy) du nouveau spectacle de Gurshad Shaheman Les forteresses fait explicitement référence à ces espaces. Occupant l’essentiel de la scène, des cadres en bois sont recouverts de ces tapis où les spectateurs peuvent s’asseoir, allonger leurs jambes. Plus tard on leur servira un thé dans un petit verre . On peut aussi choisir de s' asseoir dans un fauteuil et prendre place dans la salle du théâtre. De près, assis sur un tapis, on voyage à l’intérieur du dispositif , dans la salle, on a une appréhension globale de ce qui se joue sur le plateau. Où que l’on soit, c’est un dispositif juste pour faire ressurgir la mémoire de trois sœurs nées en Iran dans les années soixante, de façon délicate, même dans ses pans les plus sombres. Sur la scène entre les îlots de tapis déployés sur des socles légèrement surélevés, trois chaises, chacune sur un piédestal. Où, en longues robes légères sont assises trois plus ou moins jeunes actrices (Mina Kavani, Shady Nafar, Guilda Chahverdi) nées en Iran mais n’y vivant plus à demeure, voire ne pouvant plus y retourner. Chacune porte la voix d’une de trois sœurs (Jeyran, Shady, Hominaz), l’une des sœurs étant la mère de Gurshad Shaheman. Le spectacle est construit en trois parties, à l’issue de chacune, les actrices changent de chaise. Les trois sœurs sont également présentes sur scène. L’une vit en France, la seconde en Allemagne, la troisième vit toujours en Iran. On entrera par petites touches dans le pourquoi et le comment de ces itinéraires. Ce que disent, racontent ces trois voix, chacune portée chacune par une actrice, est le fruit de propos recueillis par Gurshad, et c’est à lui (le fils,le neveu) qu’elles s’adressent. Elles sont là, constamment, mais les trois sœurs ne jouent pas, ne parlent pas (deux d’entre elles na parlent d’ailleurs pas le français). Elles écoutent leur trois vies défiler par petits bouts, comme autant de petites fables.. Il leur arrive aussi de s’affairer, de cuisiner sur une longue table dressée au fond de la scène. Il leur arrive encore de venir une à une à l’avant-scène faire un petit tour, leur corps dialogue alors avec celui de leur fils, de leur neveu , la musique accompagnant les corps et les voix (musique Lucien Gaudion)< ; Ou bien encore, comme nous, elles écoutent Gurshad chanter, entre chaque partie, une chanson azéri. Les trois sœurs sont nées au début des années soixante à Miâneh, une petite ville de l’Azerbaïdjan iranien, entre Qazvin et Tabriz, où la langue d’usage n’est pas le farsi mais l’azéri, langue natale des trois sœurs et de Gurshad. Tel est le dispositif où vont se succéder, trois heures durant, les récits éclatés des trois sœurs, leurs trois voix, transcrites, traduites et reconstruites par Gurshad lequel, trois heures durant, regarde les trois sœurs, écoute les trois actrices. Un Gurshad observateur , spectateur muet, lui qui ne cessait de parler dans son premier spectacle aux soubassements autobiographiques, déjà en trois parties et trois heures, Pourama Pourama (lire ici). C’est d’ailleurs à peine si on le reconnaît (hormis ses yeux et son sourire) : plus de barbe abondante et non taillée, plus de longs cheveux en bataille, un corps qui demeure ondoyant et un look de chanteur de charme oriental légèrement moustachu Cette dissociation entre le corps des trois sœurs et les voix alternées, bordées d’un léger et délicieux accent, des actrices, -Gurshad invente là comme un étonnant bunraku oriental -, cet espace proustien, lit des réminiscences, éloigne irrémédiablement tout théâtre documentaire et ses pièges pour laisser la place à des contes du réel, où les situations les plus terrifiantes ( enfance volée, brutale séparation, arrestations en masse des étudiantes, prisons, humiliations, tortures, lapidation, mariage et divorce, misère de l’exil, etc.) semblent trouver un apaisement dans l’accouchement des récits parcellaires de ces vies faits et adressés au fils de l’une, au neveu des deux autres et mis en écriture par celui qui les a écoutés,. « L’aspect documentaire ou prosaïque du sujet m’intéresse bien moins que la force ou le souffle universel que ces récits peuvent atteindre » écrit Gurshad Shaheman C’est ainsi que l’intimité de ces femmes se déploie depuis la chute du Shah qu’elles saluent en femmes militantes de gauche espérant l’arrivée de la démocratie. Mais tout s’écroule très vite avec la montée en puissance des mollahs et de la « République islamique » aux règles imposées petit à petit : voile, reprise main des universités, fichage, etc.. « Jamais je n’aurai imaginé que le pays allait basculer du côté des intégristes » dit Jeyran. Mais aussi la puissance des pères, le mépris des frères, les mariage où l’homme demande la main de la jeune fille au père, sans lui avoir jamais parlé et à peine l’avoir regardée « Au moment de dire oui/ Je ne savais rien de lui/ Je ne savais même pas l’âge qu’il avait/ Tu le crois ça ? » et après le mariage le mari qui restreint les fréquentations de l épouse encore étudiante, la cloître. La vie intime et l’Histoire du pays vont de pair. Puis c’est la guerre Iran-Irak, les bombardements, la fuite hors des villes, les enfants en bas-âge qu’il faut nourrir, le lait et les couches qui manquent, la découverte d’un campement nomade, la solidarité des démunis. Mais cette énumération fausse la donne en prenant trop de champ : tous les récits de ces événements sont microscopiques, personnels,vus par le petit bout de la lorgnette domestique, à chaque sœur sa lorgnette. »J’aimerais vraiment tout te raconter/ Gurshad/ Mais c’est impossible/ Il y a des choses que je ne peux raconter à personne/ A personne/ Des choses qui me hantent dont je ne peux absolument pas parler Mon cœur est une forteresse de larmes/ Je ne peux pas l ‘ouvrir » dit l’une des sœurs. C’est la fin de la seconde partie . S’en suit une nouvelle chanson azéri chantée dans sa langue par Gurshad, qui commence ainsi : « Tu m’as jeté, Amour, dans les flammes/Mes larmes attestent à chaque instant de ma douleur ». Dans la troisième partie, Jeyran est déjà en France, Shady raconte sa difficile arrivée en Allemagne, Hominaz reste seule en Iran. Le père de cette dernière est mort, ses trois frères vivent à l’étranger et après le décès de Khâm-Maman (la grand-mère) ,sa mère part aussi . « Il ne restait plus personne ». Elle songe à partir, mais elle a un mari qui a fait de la prison pour escroquerie, cependant il est ni violent, ni infidèle, et puis, surtout, il y a ses enfants, sans eux, elle ne ne partirait pas. « A choisir ma prison, je préfère rester avec les miens » dit-elle. Mais elle est là devant nous, en France, écoutant ces mots dits par une actrice née là-bas dans ce pays d’où elle vient et retournera.. Tout avait commencé en juillet 2018 au festival d’Avignon où Gurshad présentait son seconde spectacle Il pourra toujours dire qu c’est pour l’amour du prophète (lire ici). Sa mère était là, la seconde sœur désormais naturalisée allemande avait fait le voyage et la troisième sœur était venue de Téhéran. Onze ans qu’elles ne s’étaient pas retrouvées ensemble, toutes les trois. « J’étais touché de les voir ensemble après toutes ces années, de constater combien leur lien restait solide malgré les revers du destin, les années de séparation et malgré des choix de vie parfois radicalement opposés » écrit Gurshad. Et c’est en les voyant ensemble déambuler dans les rues d’Avignon, qu’est née l’idée de ce spectacle Les forteresses qui réunirait les trois sœurs. Spectacle créé dans le cadre du Cabinet de curiosités du Phénix de Valenciennes du 9 au 11 mars au Manège de Maubeuge devant un public restreint de professionnels et journalistes. Prochaines et premières dates publiques les 12 et 13 oct à la Filature de Mulhouse, les 15 et 16 oct au CCAM, Scène nationale de Vandœuvre, les 21 et 22 janv 2022 au Festival Vagabondes à la Filature de Mulhouse, du 24 au 29 janv au TBNA de Bordeaux. D’autres dates devraient suivre. Légende photo : Gurshad Shaheman dansant avec l"une des trois soeurs © Agnès Mellon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2021 7:46 PM
|
Cie Non Nova - Phia Ménard EDITO : Les communiqués d’occupation des théâtres s’amoncellent sur les bureaux du Ministère de la Culture et de la Communication, j’imagine le cabinet rapproché de Madame la Ministre en émoi. La communication ayant pris le pas sur la culture, c’est une affaire de spécialistes du langage en surchauffe : Que dire ? Que le gouvernement fait tout son possible, que l’on aime les théâtres, les cinémas, les musées, et le monde de l’Art. Que l’éclaircie est pour « bientôt ». Qu’avec la campagne de vaccination, les mesures prises, nous serons bientôt de retour dans les festivals. La communication bat son plein car il ne semble rester au Ministère de la Culture que cette prérogative… C’était il y a un an, nous avions droit à la première d’une série de prises de parole du Président et du célèbre « quoi qu’il en coûte ». C’est dans l’absence du Président face à cette crise qu’il me semble important de voir que nous ne faisons plus partie des « essentiels ». Dans ce nouveau modèle de gouvernance, il est évident à présent que de manière décomplexée, une nécropolitique est en action et de façon opportune cette épidémie permet des usages, des règles, qui mettent les principes démocratiques aux oubliettes sous prétexte d’état de guerre. Il suffit d’une série de statistiques pour revendiquer de nouvelles règles édictées lors du rituel ministériel des « annonces du jeudi ». Une année s’est écoulée et ce n’est plus le « quoi qu’il en coûte » mais bien quoi qu’il « vous » en coûte qui est infligé au peuple, toujours coupable, toujours plus infantilisé. La Ministre craint que nous saccagions le patrimoine. Comprenez la vie de ces pierres si belles et fragiles, de ces portes vieillissantes, des moquettes et des ors qui pourraient disparaître ! Depuis la bâtisse fort belle de la rue de Valois, cette vieille pierre que la jeunesse n’envie pas, jamais plus ridicules ne pouvaient être les mots d’une Ministre face à l’appel des vivants. Je le redis haut et fort, le théâtre est une grotte, un trou noir, un mur des fusillés auquel des humains font face. Un lieu sans valeur vide, mais qui, une fois investi des humains et de leurs questions, convoque les émotions les plus intenses. Ce n’est pas un patrimoine mais un terrier des humeurs sans filtre, de l’adresse du direct, des clairs-obscurs. Le lieu où s’expriment l’indécence autant que la grâce d’un même geste sous les critiques d’un public consentant. Il y a patrimoine dans l’exercice du partage, du dialogue, de l’interrogation, dans l’étrange et l’inconnu qu’est une représentation. Dans le sang des artistes il y a des messagers d’intenses désirs, l’adrénaline qui décuple les émotions. Ce petit quelque chose d’immatériel qui nous empêchera toujours d’abandonner un peuple à la servitude du marché. Quatre mois de couvre feu, de métro, boulot, dodo et de menaces de confinement sans cesse affichées, et comme une sève remonte dans l’arbre, une clameur nous sort de la servilité. Le grondement s’étend et il ne s’arrête pas à des murs : réouverture des lieux de culture et de partage, prolongation de l’année blanche, retrait de la réforme de l’assurance chômage. Tout est clairement défini dans ces revendications légitimes. Mais le Président est loin, dans la campagne, à l’abri à l’Élysée barricadé, non loin d’un théâtre fermé, il se tait. Peut-être se souvient-il de son dernier soir au théâtre, exfiltré des Bouffes du Nord où il venait voir un spectacle bien nommé : La Mouche. Entend-t-il voler cette mouche, qui tourne autour de lui, celle qui trouble le sommeil, celle qui finit par obtenir l’ouverture d’une fenêtre tant elle est insaisissable ? Phia Ménard, Artiste, le 15 mars 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2021 7:06 PM
|
Par Stéphane Capron sur le site de France Inter 10 mars 2021 Le mouvement d'occupation des théâtres fait tache d'huile. Après l'Odéon à Paris, puis le TNS à Strasbourg, La Colline à Paris, le Théâtre Graslin à Nantes est occupé par des intermittents ou des étudiants en école d'art dramatique. Ils ont reçu le soutien de nombreux artistes, dont Ariane Ascaride. Ariane Ascaride fait partie des artistes qui réclament depuis plusieurs mois la réouverture des lieux culturels. Alors l'actrice soutient les artistes et techniciens qui occupent l'Odéon-Théâtre de l'Europe depuis jeudi dernier. "Comme je les comprends !", lance-t-elle. "Car cela fait un an que je suis en colère. Je commence à être un peu fatiguée. On joue la montre au gouvernement. On ne bouge, on ne dit rien, on laisse faire, on laisse les gens s'exciter et se mettre en colère, en attendant de voir comment cela va se passer. Mais cela fait un an que l'on est traités comme ça." "Nous continuons à être non-essentiels. Et que l'on ne me dise pas que le président de la République adore la culture. Si c'était le cas, il s'en préoccuperait." En plus de la réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires, les manifestants réclament, entre autres, une prolongation de l'année blanche pour les intermittents, son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers. Il y a urgence, pour la comédienne. "Il y a des intermittents qui sont en train de mourir, qui n'ont plus de quoi payer leur loyer, qui vont faire leurs courses dans les banques alimentaires. Et ces intermittents ne savent plus comment prouver leur existence, puisque tout est fermé." "Cela fait des mois que la jeunesse est sacrifiée" Au Théâtre de la Colline à Paris, ce sont des étudiants du Conservatoire national Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD), de l'École supérieure d'art dramatique (Esad) et de l'École du studio théâtre d'Asnières qui ont investit les lieux. Au Théâtre National de Strasbourg, 51 élèves en scénographie-costumes, jeu, mise en scène, dramaturgie et régie-création, ont décidé de s'installer 24h sur 24 dans les locaux du Théâtre, "jusqu'à une réponse concrète de l'État". Cette jeunesse bradée, Ariane Ascaride la défend : "Ils n'en peuvent plus et je les comprends. Vous imaginez avoir 20 ans aujourd'hui ? Cela fait des mois que la jeunesse est sacrifiée, et aujourd'hui elle le dit. Comment un étudiant en art dramatique peut-il visualiser son avenir ? C'est impossible." Et de poursuivre : "C'est un boulot énorme, ils travaillent tout le temps. Ils sacrifient d'autres choses. Et tout ça pourquoi ? De toutes façons, ils ne peuvent pas jouer". Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'est rendue samedi à l'Odéon et a promis de poursuivre les échanges. La CGT Spectacle a affirmé qu'elle poursuivait le mouvement et précise que cette mobilisation s'inscrit "dans le sillage de l'occupation des ronds-points", en référence au mouvement des "gilets jaunes". Pour Ariane Ascaride, c'est le début d'une prise de conscience. "Cela fait 40 ans que les politiques considèrent la création artistique et la culture comme du divertissement. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous racontons le monde. On le fait depuis Shakespeare." Légende photo: Ariane Ascaride soutient les théâtres occupés pour protester contre leur fermeture en période de pandémie © AFP / Patrick Fouque / Photo12

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2021 6:23 PM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 15 mars 2021 Cabaret de curiosités 2021, au Phénix de Valenciennes Ce festival consacré à la création contemporaine -une des manifestions-phares de la Scène Nationale- réunit des artistes émergents de toutes les disciplines. Cet immense paquebot rouge inauguré en 1998, est dirigé depuis 2009 par Romaric Daurier rejoint depuis deux ans par Camille Barnaud. Très ancrée dans les territoires du Nord, Le Phénix décentralise les spectacles de ce cabaret en plusieurs lieux dont Le Manège à Maubeuge et l’Espace Pasolini à Valenciennes. Cette année, la programmation est placée sous le signe de la Véhémence : «Le monde d’après se dessine déjà comme une ère vertigineuse de la véhémence, où l’art serait là pour dire ce qui est, au risque de déplaire et pour allumer des contre-feux face aux mises en scène outrancières de la sphère publique… » Ce Cabaret de curiosités reflète la diversité des propositions de la jeune scène contemporaine, pour partie accueillie au Campus Amiens-Valenciennes. Car le Phénix et la Maison de la Culture d’Amiens, désignés Pôles européens de création par le ministère de la Culture, se sont associés pour créer en 2018 un projet commun : accompagner ainsi les artistes de la région Hauts-de-France à l’échelle nationale et internationale, et inviter aussi des équipes étrangères. Cette année, le Cabaret présente douze propositions de différents formats, dont Jamais je ne vieillirai de Jeanne Lazar (voir Le Théâtre du Blog). En une journée, nous avons pu voir trois équipes. Just Desire, de Soren Evinson Dans une performance très physique, l’artiste catalan s’en prend à la société de consommation. Tel un pantin désarticulé, il s’agite dans un vide sidéral sous des éclairages spectraux, à la recherche d’un sens… Solitude d’une vie où on veut s’emparer de tout et n’importe quoi : vêtements rutilants qu’il décroche de patères, chaussures voyantes, voiture ou téléphone dernier cri… En espagnol et en anglais, Soren Evinson éructe un texte laconique et répétitif sur une musique atone. Le corps devient lui-même objet de son propre désir dans une sorte de transe narcissique. Le travail minutieux de la lumière et du son a une dimension cauchemardesque mais ce délire onaniste peine à convaincre… L’Enterrement de David B, conception d’Anne Lepla et Guick Yansen La compagnie 2 L a présenté un bref aperçu de sa création avec deux musiciens et un acteur. Sur un écran, l’éloge funèbre de David B. mort dans des circonstances dramatiques. Surnommé la Jardinière, cet avocat célèbre qui vivait la nuit sous les traits d’une femme, a été poussé sous un métro par sa petite amie transsexuelle. L’Enterrement de David B est issu d’un fait divers mais ne s’apparente pas au théâtre documentaire. Félix Jousserand, poète et slameur a écrit le texte de cette performance alliant texte et musique. Un aperçu prometteur mais nous n’avons vu que trente minutes de ce projet. Feu de tout bois conception d’Antoine Defoort Une forêt : arbres, buissons et tapis de feuilles mortes. Une «médiatrice fictionnelle» donne quelques clefs dramaturgiques. Les Pokemon, démons minuscules issus des mangas japonais, ont servi de référence. Tapis dans les recoins, ils donnent à qui les possède, des pouvoirs surnaturels. Il y a aussi les lunettes magiques qui détectent les extra-terrestres dans le film-culte de John Carpenter Invasion Los Angeles (1988). Chaque performance de l’Amicale, plateforme coopérative de production, relève du loufoque comme dernièrement Amis il faut faire une pause et La Sexualité des orchidées (voir le Théâtre du blog). Ici la fantaisie est une fois de plus à l’œuvre. Dans la forêt, deux amis se retrouvent et se racontent leurs aventures respectives: l’un a hiberné dans un caisson rempli de liquide amniotique pendant deux ans et reprend difficilement pied dans le monde réel. L’autre s’est lancé en politique, avec la Plateforme Contexte et Modalité (PCM) qui explore les ressorts de la communication médiatique, au service d’une campagne électorale. Antoine Defoort et son équipe se moquent à la fois des Bisounours qui, fuyant le modernisme, vont embrasser les arbres et des communicants de tout poil : Feu de tout bois, fustige gentiment la sphère politico-médiatique où la communication a pris le relais du débat démocratique. Avec quelques tours de «magie paradoxale» effectués à l’aide de « mnémo-projecteurs», les idées conflictuelles prennent corps sous forme de “logomorphes“ incongrus et s’affrontent, comme autant de Pokemons disséminés dans la nature… Une parodie truffée d’idées et d’images réjouissantes qui pétille d’intelligence mais après un démarrage prometteur se perd dans les fourrés. Nul doute qu’après cette première représentation, elle trouvera sa vitesse de croisière. Mireille Davidovici Représentation pour les professionnels vue le 10 mars au Phénix-Scène Nationale, boulevard Harpignies, Valenciennes (Nord). T. : 03 27 32 32 32. Feu de tout bois : le 10 avril, Le Vivat, Armentières (Nord). Les 27 et 28 avril, Chambéry (Savoie).
Du 24 mai au 13 juin, Carrefour du Théâtre (Québec). Les 18 et 19 juin, Théâtre national de Lisbonne (Portugal).
Et du 7 au 13 septembre, festival La Bâtie, Genève (Suisse).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 7:55 PM
|
par Ève Beauvallet dans Libération publié le 12 mars 2021 France 5 diffuse ce vendredi une captation du marathon de duos imaginé par le chorégraphe, présenté en janvier au Grand Palais. Le 16 janvier 2021, dans la nef du Grand Palais, finalement sans public, mais devant des caméras, douze heures durant, du petit matin à la tombée de la nuit, une vingtaine de duos se sont entrelacés. (Photo : Damien Meyer) Pour cette seule image, en ouverture du film, il faut coûte que coûte se brancher sur France 5 vendredi soir : celle de cet homme et de cette femme imbriqués l’un dans l’autre, microscopiques dans l’immensité des lieux, leur chair nue et délicate sur le béton froid et dur, leurs manières de devenir, tour à tour, le sol de l’autre, son indéfectible support. On dirait le premier couple de l’univers, ou le dernier à avoir survécu à la catastrophe. Décidément Boris Charmatz est chorégraphe mais c’est aussi un plasticien, vu l’art qu’il a de jouer des contrastes d’espace et de matières (la peau, la pierre, etc.). Le jour de janvier où les deux danseurs étaient filmés par d’énormes grues télescopiques, il neigeait silencieusement dehors, et sous l’immense verrière – la plus grande d’Europe (45 m2 de hauteur) – du Grand Palais à Paris, c’était l’impression d’un monde sous cloche où pouvait se jouer en secret ce truc parfaitement incongru aujourd’hui : danser ensemble, respirer l’air de l’autre. La Ronde, projet pharaonique du chorégraphe français, succession de duos en relais, chaîne humaine dansée de l’aube au coucher du soleil, nous parle de la persistance du désir et de la force nucléaire du toucher. Chaîne humaine dansée uniquement pour les caméras En janvier, le mois où tous les horizons étaient bouchés, nos yeux s’étaient écarquillés devant ce manifeste. Aujourd’hui, le voici donc rétréci en une captation chiadée d’une heure trente, précédée sur France 5 d’un documentaire en forme de making of retraçant l’épopée qui fut celle du projet sur une année, de sa mouture initiale (une «tempête de gestes» hyper rapide avec 400 danseurs dans la nef) à sa résurrection en format Covid-compatible (une chaîne humaine dansée uniquement pour les caméras). «Ça aurait du s’annuler 15 fois et c’est quand même maintenu», entend-on Charmatz s’émouvoir devant les caméras. Le projet lui a été commandé par le directeur du Grand Palais, Chris Dercon, pour célébrer la fermeture du bâtiment pour quatre ans de travaux. Et quand il a fallu abandonner l’idée de base, c’est dans l’histoire de cette «cathédrale républicaine» que Boris Charmatz s’est replongé. Une histoire de transmission du désir En 1900, l’année de l’inauguration du Grand Palais, Arthur Schnitzler publiait la Ronde, texte de théâtre dans lequel se succèdent des duos amoureux dans un principe de chaîne traversant toutes les classes sociales de l’époque. Une histoire de transmission du désir – écrite contre et en dépit de la transmission d’un virus (celui de l’époque s’appelle la syphilis) –, qui permet au chorégraphe de revisiter cet exercice fondateur de la danse qu’est le «pas de deux». Il est pris ici au sens élargi, les sources d’inspiration ayant pu jaillir du cinéma (le duo de vieux amoureux du film Amour de Haneke), ou de la performance (celle du tir à l’arc entre Ulay et Marina Abramovic). On sent ici le plaisir pris par Charmatz, parfait monteur, à reprendre certains grands classiques du répertoire et autres ready-made en les décalant (par de jeux de costumes, d’âge, ou de genre) puis en les ordonnançant de telle sorte qu’ils scintillent d’une plus grande diversité de couleurs. On garde ainsi pour longtemps l’énergie avec laquelle déboule dans la nef la démente Soa Ratsifandrihana pour un duo de krump avec Djino Alolo Sabin, avant d’être rejointe par l’immense chorégraphe dont elle est en fait l’interprète, Anne Teresa De Keersmaeker, pour la reprise de Fase, un duo de 1982 qui – ce n’est pas un hasard – parle lui aussi de la persistance obstinée du mouvement, réduit à ses principes essentiels. Boris Charmatz face au Grand Palais, à 20 h 55 sur France 5 (52 minutes), suivi de la captation «La Ronde» (90 minutes). Vidéo de présentation de La Ronde par Boris Charmatz ( 3 mn)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 5:39 PM
|
Par Thomas Corlin dans Libération du 15 mars 2021 Jouer en extérieur, dans des vitrines, face à un spectateur unique ou au travers d’un enregistrement audio… Depuis le début de la pandémie, les scènes institutionnelles lorgnent des dispositifs jusqu’alors cantonnés aux arts de la rue et aux marges. Seul sur la scène d’un théâtre vide, un spectateur suit dans un casque audio des instructions préenregistrées : des actions enfantines, quelques gestes, une petite sculpture à bricoler avec de l’aluminium. Dans les gradins face à lui, un autre spectateur le regarde, puis sort, toujours sous les indications de la bande audio, contempler les rues dehors, pour mieux réfléchir sur les origines du théâtre et la puissance de l’imagination. Créé à distance en juillet 2020 pour l’édition réduite du festival de théâtre de Santarcangelo di Romagna en Italie, Tu respires dans le jardin comme dans une forêt a été imaginé «dans l’urgence» par le tandem espagnol El Conde de Torrefiel, habitué à des formes scéniques bien plus copieuses – et provocatrices (Kultur posait par exemple une centaine de spectateurs devant des acteurs pornos en plein acte). «Nous voulions faire redécouvrir un lieu de spectacle vivant différemment, explique la moitié du binôme Tanya Beyeler, dont la voix guide la performance en toute douceur, questionner les fondements du théâtre. Les conditions étaient claires : les limitations de déplacement nous empêchaient d’être présents, il fallait donc déléguer la réalisation à l’équipe du festival, mais nous voulions malgré tout éviter la vidéo. Le théâtre est un vieux dinosaure qui a besoin d’une coprésence.» Crieurs publics En dépit de restrictions sanitaires toujours plus extravagantes, le dinosaure a malgré tout pu montrer sa tête çà et là depuis le début de la pandémie, que les lieux soient fermés ou non au public. Au Bateau Feu à Dunkerque, au Sorano à Toulouse, et un peu partout ailleurs, du théâtre a bien été joué, mais pas toujours comme on l’entend, dans un dispositif frontal scène-salle. A Annecy, la scène nationale Bonlieu a maintenu et prolongé sa «Grande Balade» annuelle, à l’été, semant une soixantaine de propositions sur 4 kilomètres de randonnée. Un peu partout, des crieurs publics sont réapparus dans les rues, et des théâtres du circuit généraliste se sont essayés à des formes en extérieur, normalement cantonnées aux arts de la rue. Pour Jean-Sébastien Steil, qui dirige la Fai-Ar (formation d’arts en espace public), ces initiatives sont stimulantes mais toujours marginales. «Le réseau du spectacle vivant n’a pas l’habitude de mettre en valeur ce type d’initiative, il y a donc eu peu de communication, regrette-t-il. Ces spectacles circulent d’habitude très peu dans les théâtres subventionnés, par manque d’expérience logistique et de repérage artistique. Certains lieux semblent avoir eu recours à l’extérieur comme s’il s’agissait d’une nouveauté, alors que c’est une pratique courante depuis des décennies.» La période a pourtant été fructueuse pour des artistes habitués aux dispositifs scéniques minimalistes. C’est le cas du GK Collective (1), connu pour ses performances pour spectateur unique, qui n’a presque pas connu d’arrêt d’activité. Succulente ironie, le logo de leur «Agence de rencontres sans risque», qui propose des entretiens avec un humain socialement programmable, arborait déjà des visages masqués. «Nous avons toujours travaillé sur l’anticipation, l’aliénation et la frontière entre réel et fiction, ainsi la distanciation et les masques s’intégraient naturellement à notre dramaturgie, observe sa directrice artistique Gabriella Cserháti. C’est comme si la pandémie nous avait rattrapés en mettant en lumière toutes nos thématiques.» Poupée vaudou Depuis toujours stimulé par le bricolage et la contrainte, l’artiste-chercheur en arts du spectacle Julien Daillère a lui aussi passé l’année à jouer avec les protocoles sanitaires et à explorer toute une gamme de médiums, à distance ou sur place. Son association La Marge heureuse recense toutes les expériences théâtrales menées en temps de crise, et conseille des lieux sur des formats actuellement diffusables. «Pour ma part, j’ai fabriqué toutes sortes de costumes ou de microscènes étanches, joué dans des vitrines, proposé des déjeuners séparés par un écran, mais c’est le téléphone que j’ai le plus exploité.» Son «Centre dramophonique national» (2) propose des «téléperformances» similaires à des rituels shamaniques, durant lesquels un spectateur se fait dicter des actions en direct telle une poupée vaudou devant d’autres spectateurs. Bien des lieux et des comédiens ont d’ailleurs joué avec le téléphone, comme le théâtre de la Ville à Paris mais aussi comme l’artiste Julien Bucci du Home Théâtre, dont le «Serveur vocal poétique» a été malencontreusement pris pour une proposition du ministère de la Culture après un tweet officiel, lui valant de multiples attaques – le distanciel ne protège hélas pas de tous les dangers. Que restera-t-il alors de cette étroite fenêtre de visibilité pour ces esthétiques de niche ? Du côté de la Fair-Ar, Jean-Sébastien Steil leur souhaite de meilleurs relais médiatiques pour l’été théâtral à venir, mais n’imagine aucun changement radical. «La vaste majorité des créations actuellement en cours ou en demande de subventions respectent des formats standards, dans l’espoir d’une véritable réouverture.» Naturellement, les spéculations fusent en cette période transitoire et inédite pour les arts vivants, mais seule une réouverture «en présentiel» des salles saura révéler ce que la Covid a fait au théâtre et à ses formes. (1) Le GK Collective jouera le 20 mars à Concarneau (médiathèque), le 9 avril à La Norville (salle Pablo-Picasso), les 22 et 23 mai à Capdenac (Derrière le hublot). (2) Rens. : www.cdn-leallo.fr Légende photo : Julien Daillère en «téléperformance» dans une vitrine de Clermont-Ferrand, en janvier. (Claire Valadou)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2021 1:50 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog 14 mars 2021 Guy-Pierre Couleau s’appuie sur l’adaptation de Peter Brook et dirige un groupe d’excellents interprètes conduits par Benjamin Jungers dans le rôle-titre.
Un privilège : aller au théâtre en ces temps de fermeture des salles et d’interdiction du large public. La Tragédie d’Hamlet s’est donnée au Théâtre 13-Jardin, très bien réhabilité, une salle où l’on reverra cette très bonne version en février prochain…
Guy-Pierre Couleau connaît l’espace du Théâtre 13-Jardin : on n’a jamais oublié son formidable Baladin du monde occidental, donné sur ce plateau presque circulaire, enveloppé des gradins. C’était il y a plus de vingt ans. Depuis, il a traversé bien des univers et dirigé dix ans durant (2008-2018) la Comédie de l’Est de Colmar, centre dramatique national. Il avait été comédien avant de se lancer dans la mise en scène. Il est rigoureux et fidèle. Il a construit, au fil du temps, une famille d’esprit, une troupe informelle et fertile. Après avoir monté La Conférence des oiseaux du regretté Jean-Claude Carrière, spectacle qu’il avait créé au Printemps des comédiens, dont le grand écrivain, chaman du sud, était co-fondateur et président, il a choisi la traduction de ce poète clairvoyant, traduction signée également Marie-Hélène Estienne d’après l’adaptation audacieuse qu’en fit Peter Brook, il y a bien des années. Peter Brook présenta cette Tragédie d’Hamlet en 2000, au Théâtre des Bouffes du Nord, avec Adrian Lester dans le rôle-titre. Sur le plateau en arrondi du Théâtre13-Jardin, des chaises dépareillées. Pas d’autres éléments scéniques hors un banc d’école et sous le premier tapis sombre, un autre, fond blanc et dessin noir dans lequel on peut deviner, si l’on veut, une tête de mort, que l’on dévoile au moment de la scène des acteurs (voir la photographie). Une scénographie de Delphine Brouard, animée par les lumières de Laurent Schneegans et le son et la musique de Frédéric Malle. Huit comédiens seulement pour, en deux heures vives, fluides et sans micro –une rareté de nos jours- donner la beauté et la complexité de la tragédie la plus célèbre et sans doute la plus jouée au monde. Les costumes de Camille Pénager sont du jour, dans une sorte de neutralité efficace. Le costard-cravate de Nils Ohlund, Claudius, suffit à fixer le personnage dans ses communes faiblesses. C’est le jeu qui dira la scélératesse. Hamlet lui aussi est ainsi. Mais il suffit d’une cravate desserrée, pour qu’il soit autre. De même pour la Gertrude d’Anne Le Guernec, un peu chic province sur ses talons aiguille…Le jeu dira son ambivalence. Et ainsi… On n’est pas certain que la charmante et douée, et touchante Sandra Sadhardheen soit avantagée par son costume, même s’il lui permet de danser le désarroi, le chagrin, la folie. Mais c’est un détail et l’équipe a forcément pris ces décisions pour des raisons solides. On l’a dit, ils sont seulement huit : Nils Ohlund, le traître Claudius est aussi le spectre. Polonius, le père d’Ophélie, Emil Abossolo M’Bo sera aussi le fossoyeur. Les très bons Thomas Ribière et Bruno Boulzaguet, fins et déliés, seront respectivement Guildenstern, le second acteur, Laërte, et Rosencrantz, premier acteur, autre fossoyeur. Horatio est porté par un Marco Caraffa, tout en discrétion et fidélité. Une adaptation souveraine, huit interprètes ligués dans l’excellence, et un metteur en scène qui possède l’art de raconter, d’approfondir sans jamais surligner, de guider sans enfermer, laissant à chacun sa liberté et l’expression de sa personnalité. C’est franchement un travail remarquable dont nous reparlerons lorsque la tournée débutera et qu’enfin les sourdes tutelles auront admis, comme le disent toutes les études les plus sérieuses, que les théâtres sont des lieux, comme les salles du cinéma, où le virus circule très peu et où les contagions et autres clusters sont inexistants. Chacun appellerait une analyse précise et participe à la force du spectacle. On est heureux de retrouver Benjamin Jungers qui mûrit sans vieillir et qui déploie ici, en toute subtilité, en partageant chaque scène, chaque mot, en ne quittant jamais le jeu avec ses camarades, son talent sûr et sa lumière. Bref, une formidable production, forte et vive, tout en retenue, sobriété : et pourtant ce travail est bouleversant d’intelligence et d’émotion. Spectacle vu au Théâtre 13-Jardin et que l’on devrait revoir le 30 septembre à Auxerre, le 9 novembre à Château-Gonthier, en hiver 2022 à Bagneux, du 8 au 19 février à Paris, au Théâtre 13-Jardin. Durée : 2h00. Légende photo : Scène des comédiens. Celle qui va mettre le méchant face à son crime. Photographie de Laurent Schneegans. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 13, 2021 5:40 PM
|
Fiction a à écouter sur le site de France Culture 13 mars 2021 Ecouter "Le bruit du monde" (58mn) "Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, est née le 18 juillet 1964 dans une famille pauvre. Ce n’est pas noté sur sa carte d’identité. Sur sa carte d’identité, Marilène n’est pas pauvre. Elle est seulement née le 18 juillet 1964 à Pouzauges. Elle peut tout devenir. Fermière. Chirurgienne. Pute de luxe. Ostéopathe. Secrétaire d’Etat. Bouchère. Professeure des universités. Pianiste professionnelle. Catcheuse. D’un point de vue strictement virtuel, Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, a un avenir aussi ouvert que les champs qui bordent la maison familiale. Même s’ils sont hypothéqués."
Marie-Hélène Coulanges grandit à Brigneau, un petit hameau de Vendée : lieu de l’enfance, des cabanes et des jeux, c’est aussi l’endroit où elle prend conscience de la pauvreté dans laquelle vit sa famille. Après un déménagement dans un autre village, il y aura les années de collège et puis de lycée… Le Bruit du monde est le récit d’une émancipation : quand la pauvreté et la honte creusent les blessures, enferment dans la peur et les doutes et obscurcissent toute perspective, comment parvenir à être soi et à trouver sa juste place dans la société.
Adaptation et réalisation : Christophe Hocké
Conseillère littéraire Céline Geoffroy
Avec Emilie Incerti Formentini
Création musicale : John Kaced
Prise de son, montage, mixage : Pierre Henry, Pierric Charles
Assistante à la réalisation : Laure Chastant
Le Bruit du monde est publié aux éditions Noir sur Blanc
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...