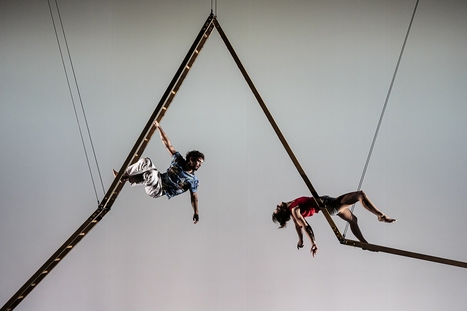Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2021 9:34 AM
|
Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore pour l'Oeil d'Olivier - 27 mars 2021 A l’affiche de Mithridate de Racine, mis en scène par Eric Vigner, diffusé récemment sur France Télévisions, et bientôt présenté au TNS, Yanis Skouta trace tranquillement son chemin. Sorti, il y a deux ans, de l’école du TNS, le jeune et volontaire comédien prépare actuellement avec la metteuse en scène Sophie Lagier, l’adaption de Genes 01 de Fausto Paravidino. Rencontre avec un artiste engagé et pugnace. Quel est votre premier souvenir d’art vivant ?
Je n’ai pas d’image de spectacle. En revanche, j’ai un lieu. C’est la grande salle de la Maison des Arts de Créteil. Je suis né et j’ai grandi à Créteil, et forcément ma première expérience a dû avoir lieu dans cette salle, puisque régulièrement on allait avec l’école y voir des spectacles. C’est une salle immense de 1100 places à peu près, disposées frontalement à la scène. Ce n’est pas l’image d’un spectacle que je retiens, mais l’image des grands escaliers de cette salle. Quand on entre par le haut et qu’on se tient devant la première marche, avec tout le public en bas et le brouhaha, c’est assez vertigineux. J’ai été ouvreur 4 ans dans ce théâtre quand j’ai commencé ma formation, et je ne me suis jamais lassé d’être là debout porte impair côté gauche, en haut des escaliers, au seuil de la représentation, quand le public s’agite et que la lumière se baisse.
Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur de l’art vivant ?
Il s’agit plus du moment où j’ai reconnu ce qui était là depuis toujours. Je venais de recevoir les résultats du concours de première année de médecine (oui, oui), et je n’étais pas assez bien classé pour le réussir du premier coup – moi qui ai toujours été en tête sans efforts, et sans passion. Cela voulait donc dire redoubler, pour ne pas forcément l’avoir, pour peut-être se réorienter, avoir perdu 2 ans etc… Et c’est en discutant de mon avenir avec ma mère qu’elle m’a dit « Et le théâtre, tu as toujours bien aimé, non ? »… Je suis resté choqué, en silence, un petit moment. Bien sûr j’avais depuis toujours l’appétit du jeu, j’avais fait du théâtre à 8 ans déjà, et puis au lycée… Mais en faire un métier ? C’était une évidence. C’est surtout une barrière sociale qui a sauté. Ce jour-là, j’ai vraiment écouté mon désir, plutôt que de suivre la voie héritée de mon milieu : bonne études – bon métier – sécurité.
Qu’est ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédien ?
Ce n’était pas un choix. C’était instinctif. C’était jouer. Je ne connaissais rien au théâtre. À partir du moment où j’ai pris ce virage, ça ne pouvait être rien d’autre que comédien. Et si je devais prendre une autre position que comédien, metteur en scène par exemple, ce serait jouer. Pédagogue, jouer. Assistant, jouer. Écrivain, jouer.
Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ?
Mis à part un spectacle d’école à 6 ans dont je ne me souviens plus très bien, mais où j’ai dû interpréter un nuage ou la mer, tu connais, c’était Le Procès du Loup. On juge le Grand-méchant Loup pour son crime. J’avais 8 ans, je faisais le juge. C’était un pur moment de joie, j’avais une énergie folle, je tapais comme un dingue avec le marteau « Silence dans la salle !… Et dans les spectateurs… ». Mais avant ce jour J, j’avais beaucoup trop de pression pour apprendre toutes les petites répliques… C’est un peu ce qui m’a fait ne pas reprendre l’année suivante.
Votre plus grand coup de cœur scénique – une pièce, une équipe, une personne, plusieurs personnes ?
Si je dois dire une claque majeure, ce serait La barque le soir de Claude Régy. Forcément ce genre de claque arrive quand on ne connaît pas encore tout à fait le théâtre. J’étais au début de mon apprentissage, j’avais pris quelques mois plus tôt la décision de ne faire que du théâtre. Je n’étais juste pas prêt. Ça a été une expérience profonde, et, en sortant, je regardais tout différemment. La pluie, la lumière des lampadaires dans la nuit… Je me suis dis « en fait le théâtre ça peut être ça aussi ? ». – Le fait qu’une pièce de théâtre soit aussi une expérience du corps. Ensuite j’ai lu tout ce que j’ai pu sur ce grand metteur en scène, et j’ai couru pour aller voir Intérieur et Rêve et folie. Je dirais que c’est à partir de cette œuvre que j’ai commencé à me construire théâtralement.
Après ça j’ai eu des beaux coups de cœur, mais peut-être que j’avais trop mûri pour me faire prendre comme pendant La barque le soir.
Tout de même il y a quelques spectacles qui m’ont bien marqué, 2666 de Julien Gosselin, Au pied du mur sans porte de Lazare, Clôture de l’amour de Pascal Rambert, Une Femme de Marcial Di Fonzo Bo, Le dernier spectacle de Jerôme Bel, What if they went to moscow ? de Christiane Jatahy, Passim de François Tanguy, Médée Matériau de Anatoli Vassiliev…
Quelles sont vos plus belles rencontres ?
Dans l’ordre je peux dire Sophie Lagier, qui a été mon intervenante tôt dans ma formation. J’y ai découvert mes auteurs, et un certain regard sur l’art plus largement.
Ensuite, et je dois l’admettre, principalement Stanislas Nordey, que j’ai rencontré lorsque j’ai intégré le programme Ier acte. C’est une personne généreuse, et, pour moi, un exemple en pédagogie. J’ai vraiment découvert dans ce qu’il nous a proposé ce que je cherchais jusque-là. Et après durant ma formation, ça a été Veronique Nordey, Bruno Meyssat, Loïc Touzé… d’autres évidemment. C’étaient des ateliers sans attente de résultats, inscrits dans un temps non productif. On avait un plateau, un cadre pour creuser et aller chercher des outils très spécifiques. Et pour fouiller, ça demande d’être vraiment à l’écoute de soi, et ça fait du bien. J’ai l’impression que tous les outils qui ont été acquis par sa propre expérience, dans la joie, non seulement sont très spécifiques à qui l’on est comme comédien, mais aussi sont ancrés pour toujours en nous.
En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?
En tout. Je ne fais essentiellement que ça, j’ai envie de ne faire que ça, pour l’instant bien sûr. Et heureusement, pour moi pratiquer, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, monter au grenier et sortir de la poussière les albums de famille.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
La lumière.
De quel ordre est votre rapport à la scène ?
Vital.
À quel endroit de votre chair, de votre corps situez-vous votre désir de faire votre métier ? Le ventre.
Et puis le cœur, la sensibilité. La gorge, la rage. Et les dents.
Pour mordre ou pour sourire, c’est selon. Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ?
Plein. Par pudeur je ne vais pas tous les citer, et puis comme ça, ça fait de la place à ceux que je ne connais pas encore, et aussi aux jeunes metteur·e·s en scène de ma génération.
J’ai aussi surtout envie de vivre des expériences d’équipes et de porter des écritures : Fosse, Duras, Müller, Racine, Rambert, Lemoine, Pellet, Galléa, Ndiaye… et d’autres. Et des plus contemporaines encore. Je crois que c’est important de prendre le risque de jouer et de donner sa chance à des écritures naissantes. C’est elles qui vont essayer de parler au plus proche de là, maintenant. C’est excitant.
Un peu à contre-pied, j’aimerais vraiment faire l’expérience de l’acteur chez François Tanguy.
Sinon j’aurais plus que tout, aimé jouer dans un film de John Cassavetes. C’est brut.
À quel projet fou aimeriez-vous participer ?
En rêvant dans mes moyens, je dirais un long projet fleuve à la Julien Gosselin, ou les 18 heures de Thomas Jolly. Et aller jouer dans un pays étranger, je ne l’ai pas encore fait.
Et fou fou, faire du théâtre dans l’espace, mais là le théâtre devient un prétexte.
Si votre vie était une œuvre, qu’elle serait-elle ?
Ouvrir la voix de Amandine Gay. Dans le processus d’être renvoyé à une image, alors qu’en réalité ton identité est profondément plus complexe et paradoxale. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore Mont vérité de Pascal Rambert
Printemps des comédiens
Domaine d’O

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2021 5:53 PM
|
Sur le site de l'émission de Pascal Paradou "De vive(s) voix" sur RFI - 23 mars 2021 Les théâtres sont fermés depuis le 30 octobre 2020. Seize départements sont de nouveaux confinés. Certains théâtres, comme l'Odéon, sont occupés par des comédiens pour protester contre la fermeture.
Ecouter l'entretien avec Denis Podalydès (29 mn) Qu'à cela ne tienne, salles de spectacles et comédiens se préparent à la réouverture... J'ai très mal supporté la réouverture puis la refermeture des salles Denis Podalydès nous parle de son spectacle à venir «La disparition du paysage». Théâtre : réduit à l’immobilité après un attentat dont il a été victime, un homme parle. Il se souvient de la déflagration, puis tout s’est volatilisé, dispersé. Le voilà devant une fenêtre à Ostende, livré, condamné à ses pensées, ses souvenirs, ses observations minutieuses. Il aperçoit un chantier important en train de s’édifier : on construit apparemment un haut mur qui, peu à peu, envahit l’espace de la fenêtre, cache la vue, obscurcit et enferme la chambre où il est. Pensées et souvenirs s’obscurcissent à leur tour. Invité : Denis Podalydès, comédien de théâtre et de cinéma. Sociétaire de la Comédie Française, il interprétera prochainement «La disparition du paysage», un texte écrit par l’écrivain Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2021 3:24 PM
|
Par Richard Schittly (Lyon, correspondant) pour M, le magazine du Monde 26 mars 2021 Le Théâtre national populaire est occupé depuis le 12 mars. Chaque jour, une cinquantaine d’artistes mêlent pratiques culturelles et militantes pour questionner l’avenir de la société dans la lignée du mouvement Nuit debout. En attendant une éventuelle « convergence des luttes »… Une poignée d’intermittents du spectacle a investi le Théâtre national populaire (TNP) à Villeurbanne, dans la foulée de l’occupation de celui de l’Odéon à Paris, dans un mouvement de protestation qui dépasse la seule question de la réouverture des lieux culturels. Depuis vendredi 12 mars, la vie s’organise à l’intérieur du bâtiment monumental au fronton élancé, hérité de l’architecture socialiste. Les assemblées générales se succèdent quotidiennement. Pas plus de cinquante participants à l’intérieur, par précaution sanitaire. Sinon, la réunion se tient sur le parvis, au milieu des gratte-ciels, du nom du quartier érigé au tournant des années 1930 au centre de la ville ouvrière, voisine de Lyon la bourgeoise. Le jour, une cinquantaine d’artistes occupent les lieux dans un roulement permanent. La nuit, une dizaine dort sur place, à tour de rôle. Parmi eux, Ophelia Llorens-Cornet, 24 ans, qui a passé trois nuits dans une loge, tout près des fantômes de Jean Vilar, Roger Blin, Antoine Vitez… « On a trouvé un moyen de revenir ! », ironise la jeune comédienne aux blonds cheveux en bataille. « Réinvestir ce lieu, c’est ouvrir une tribune populaire. On peut se demander quel monde on va vraiment réouvrir. » Ophelia Llorens-Cornet, comédienne Privée de toute production artistique depuis un an, la jeune femme, bien décidée à ne plus subir les événements, a choisi de retourner au théâtre par une porte dérobée. « Depuis des mois, j’ai la sensation de travailler dans le vide. Je répète, j’écris, je répète, je crée à l’infini, sans public. J’ai voulu sortir d’une bulle. Ici, je rencontre des galériens comme moi », confie Ophelia. La jeune artiste est sortie de l’école de théâtre Art en scène, fin 2019, à Lyon. Dans les mois suivants, elle a créé un spectacle fondé sur des témoignages de la guerre en Bosnie. Une histoire racontant le siège de Sarajevo par la voix d’orphelins. Puis, pour assurer sa subsistance, elle a enchaîné plusieurs petits boulots, dont celui d’ouvreuse… au TNP. Sa pièce n’a jamais pu être jouée. Dix dates ont été annulées à cause des restrictions. La crise sanitaire a cassé son calendrier et ébranlé un peu sa confiance. Issue d’une famille modeste, sans tradition militante, Ophelia n’affiche pas de convictions politiques précises. Elle ne sait pas si elle doit voter ni pour qui. Elle a suivi plusieurs manifestations récentes, pour la défense du climat, contre la loi de « sécurité globale », sans vouloir formuler de discours théorique. « Mon engagement se retranscrit surtout dans mes spectacles », résume la jeune femme. Son sentiment indéfini de révolte, intégré dans sa création naissante, l’a naturellement incitée à investir le TNP. L’ancien théâtre de la Cité, fondé en 1957 par Roger Planchon, devenu TNP en 1972, n’est-il pas le symbole de l’ouverture de la culture aux publics de toutes conditions ? « Réinvestir ce lieu, c’est ouvrir une tribune populaire. On peut se demander quel monde on va vraiment réouvrir », dit-elle. Sans RSA possible « C’est rassurant de se rassembler, tout est tellement flou autour de nous », confie aussi Haldan de Vulpillières, 24 ans, qui assiste aux assemblées générales du TNP depuis le jeudi 18 mars. Originaire de Marne-la-Vallée (Val-de-Marne), le jeune régisseur a suivi une prépa scientifique à Paris, puis la filière conception sonore de l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) de Lyon. Après sa sortie d’école, en octobre 2020, son premier contrat de deux mois, décroché au Théâtre national de Bretagne (TNB), a été annulé pour cause de Covid-19. En un an, Haldan a travaillé une petite semaine au Théâtre La Mouche, à Saint-Genis-Laval, non loin de Lyon. Depuis, le rideau reste désespérément baissé, sans RSA possible, puisque le revenu minimal est réservé aux plus de 25 ans. « C’est une année vide que je n’avais pas prévue. J’espère encore faire ce métier », témoigne Haldan, cherchant sa façon de participer au mouvement de protestation naissant : « C’est encore assez émergeant, pas trop coordonné. Pendant mes études, je n’étais pas très impliqué dans les questions politiques. Ce qui se passe en ce moment m’intéresse. » Le jeune homme a suivi une manifestation contre la loi travail, une autre pour la défense du climat et quelques journées des « gilets jaunes ». Il passe régulièrement au TNP pour se tenir au courant de l’évolution du mouvement. Chant des canuts A l’intérieur du grand théâtre de Villeurbanne, la brasserie est transformée en agora. Masque obligatoire, gel à disposition, tout est soigneusement organisé, avec le bienveillant assentiment du directeur, Jean Bellorini. Les syndicats CGT, SUD et Solidaires ont accroché leurs drapeaux dans l’entrée, en signe de soutien, accompagnant discrètement un collectif autogéré. Les roulements d’occupation des locaux sont affichés, des ateliers sont montés : actions, communication, artistique, assurance-chômage… Le collectif Rhizome, spécialisé dans le ravitaillement des collectifs en lutte, propose d’apporter des légumes. Le tout dans une ambiance à la fois festive et studieuse, spontanée, grave et incertaine, qui rappelle irrésistiblement Nuit debout, du nom du mouvement né de la protestation contre la loi travail, en 2016. Personne ne commande véritablement. A l’étage, devant les grandes baies vitrées, une chorale s’est formée. Ils sont une douzaine, en cercle, à entonner le chant des canuts, écho révolutionnaire des ouvriers de la soie. Dans la mezzanine baignée de lumière, tout autour d’eux, sont accrochés les portraits des grands acteurs du TNP – Jean Bouise, Guy Tréjean –, ses directeurs – Patrice Chéreau, Georges Lavaudant, Christian Schiaretti… Après la répétition, les chanteurs se fixent de nouveaux rendez-vous. Ils veulent s’inscrire dans la durée. « Au-delà de la défense du droit des intermittents, nous sommes dans un mouvement de protestation. » François Tramoy, auteur et chanteur Rouvrir les lieux culturels ? Oui, évidemment. Mais l’occupation du TNP va bien au-delà de cette question purement sanitaire. Si les artistes revendiquent la sauvegarde de leur statut d’intermittent, s’ils s’inquiètent de la réforme de l’assurance-chômage, ils interrogent surtout l’avenir d’une société qui, pour eux, a délibérément choisi d’oublier la culture en chemin. « Ça fait du bien d’ouvrir un nouvel espace. Tout le monde était bâillonné, le bec cloué par les contraintes. Au-delà de la défense du droit des intermittents, nous sommes dans un mouvement de protestation », dit François Tramoy, 45 ans, auteur et chanteur. A ses côtés, Syldie, 42 ans, approuve. Présente à la manifestation contre la loi de « sécurité globale », cette infirmière qui préfère rester anonyme, a suivi la petite délégation qui partait en direction de Villeurbanne. La professionnelle de santé se retrouve à l’intérieur du TNP aux côtés des artistes, avec la conviction qu’il faut « se soutenir dans la revendication d’une vie meilleure ». A l’écart, dans le grand hall, son ordinateur posé sur un guéridon, Ophelia parcourt l’iconographie de la révolte des canuts et celle de la Commune de Paris. Les images de barricades pourraient inspirer leur action, en puisant dans l’énergie des révoltes passées. Deux jours plus tard, pendant que les artistes occupent la place du TNP, elle décide de rejoindre une manifestation, « gilets jaunes » et black blocs, qui descend vers la préfecture. Le maigre cortège affronte rapidement les forces de l’ordre, au pied de la tour Part-Dieu. Explosions de grenade, fumées irritantes, Ophelia prend fébrilement des photos, à la recherche d’un passage entre la création artistique et la lutte sociale. Richard Schittly (Lyon, correspondant)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2021 1:45 PM
|
Article rédigé par franceinfo Culture avec agences
France Télévisions Rédaction Culture Publié le 26/03/2021 Le mouvement d'occupation, lancé au théâtre de l'Odéon à Paris le 4 mars, a été suivi par près de 100 salles à travers la France.
Au Théâtre de l'Odéon, on chante, on danse, on rit. Une scène qui peut sembler banale, si ce n'est que depuis trois semaines, ses acteurs occupent les lieux pour alerter sur la situation des précarisés du Covid.
Un petit air de déjà vu puisque l'Odéon a été occupé pendant un mois en mai 68, ainsi qu'en 1992 et 2016 pour protester contre une réforme du régime des intermittents. Mais le mouvement actuel, parti le 4 mars de ce théâtre national situé à Paris, a fait boule de neige avec près de 100 salles occupées à travers la France.
"On ne lâche rien"
Sur la façade, le message est clair : "On ne joue plus, on lutte", lit-on sur une banderole. "Plus de 500 heures qu'on occupe l'Odéon et on ne lâche rien", répètent la cinquantaine occupants du lieu interviewés par l'AFP jeudi. "Tant qu'ils (le gouvernement) ne répondent pas, nous serons présents sur tout le territoire, la mayonnaise prend", renchérit Rémi Vander-Heym, régisseur de théâtre et représentant syndical de 53 ans. Dans une ambiance bon enfant, on filme un clip musical sur une revendication phare : le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur le 1er juillet et qui menace de diminuer les allocations mensuelles des intermittents de l'emploi (guides conférenciers, employés dans la restauration, l'événementiel etc.). Dans le café à l'intérieur du théâtre, les brochures de spectacle - figées dans le temps depuis la fermeture des salles le 30 octobre - ont laissé la place aux revues de la CGT Spectacle. La statue de Corneille porte le drapeau de la confédération ; Racine, lui, brandit le prospectus "Occupation Odéon 2021". Une autre statue est affublée d'un gilet jaune. Camping et Agora Sur un chevalet de conférence, on note l'ordre du jour, qui comprend au quotidien deux assemblées générales et une "agora" à 14H00 devant des gens rassemblés sur la place de l'Odéon, parfois en musique et en danse. Samedi 27 mars, des musiciens, dont certains de l'Opéra de Paris, vont jouer devant le théâtre. On dort dans les loges et ailleurs, sur des matelas ou dans des sacs à couchage. Médicaments, nourriture, serviettes de bain et vêtements sont répartis sur les tables du café, une seule douche à partager, tours de garde 24h sur 24 et respect d'un protocole sanitaire, Covid oblige. Jamais plus d'une cinquantaine à l'intérieur, avec parfois de nouveaux venus qui prennent le relais. Des commissions d'approvisionnement et de communication ont été créées; il y a même une commission "inter-occupation" en charge des discussions avec les autres théâtres occupés. "C'est un peu se réapproprier les lieux publics, on est chez nous quelque part", affirme Marie-Noëlle Thomas, guide conférencière de 59 ans. Celle qui accompagnait les touristes au Louvre ou les châteaux de la Loire fait aujourd'hui "la visite guidée" de l'Odéon aux nouveaux venus pour leur expliquer les règles à observer. "Il y a des suicides" Mais au-delà de l'anecdote, la guide conférencière fustige la réforme qui selon elle va mettre "à genoux" ceux déjà précarisés par la crise sanitaire. "Dans notre secteur, il y a des gens qui ont vendu leur maison, il y a des suicides", affirme-t-elle. "J'ai obtenu un job comme gardienne de square, ça me permet de payer mes factures et (...) nourrir ma fille étudiante". Elle estime avoir de la chance en comparaison avec des collègues qui ont fait un "burn out". Spécificité française, le régime des intermittents concerne 120 000 artistes et techniciens indemnisés chaque année avec comme condition d'avoir travaillé 507 heures sur 12 mois. Emmanuel Macron leur a accordé une année blanche qui expire en juillet, mais ils réclament une deuxième année blanche, à cause de la prolongation de la crise. Quant aux millions d'euros versés pour la culture, les occupants estiment qu'ils ne profitent pas aux plus précaires. Et les intermittents de l'emploi, eux, ne bénéficient pas d'un régime spécial et s'estiment les grands perdants.
Les manifestants préparent des banderoles alors qu'ils occupent le théâtre de l'Odéon depuis le 4 mars, à Paris, le 25 mars 2021 (ALAIN JOCARD / AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2021 3:17 PM
|
Tribune publiée dans Le Monde 25/03/21 Alors que la tenue de l’édition 2021 est menacée, un collectif de députés et de professionnels du monde du théâtre, dont Irène Jacob, Agnès Jaoui et Jean-Michel Ribes, appelle, dans une tribune au « Monde », à penser le festival de demain pour qu’il soit en phase avec les évolutions de la société. Ce festival, où chaque théâtre conçoit sa programmation, concentre tous les enjeux artistiques et économiques de ses acteurs dans un temps réduit et dans un espace contraint par les remparts de la cité des Papes. Echappant aux idées généreuses de ses créateurs, il est devenu un marché, une foire, un ogre insatiable qui menace de dévorer ses propres enfants. Fruit d’un impensé politique depuis ses débuts, fonctionnant sans gouvernance, sans régulation, et selon les lois de l’économie de marché, ce festival est devenu un paradoxe : il concentre les aspirations d’auteurs et d’artistes qui inventent la culture de demain, et, pourtant, il semble passer à côté des débats et mouvements de fond qui transforment la société française. Comment une création artistique contemporaine peut-elle faire l’économie de penser son propre mode de production et de diffusion ? Qu’en est-il de l’impact écologique du festival, des conditions de travail des divers corps de métier qui œuvrent à son bon déroulement ? Que dire des hausses des loyers qui les rendent inabordables ? Pourquoi la diversité culturelle et sociale n’est-elle pas davantage représentée ? L’édition 2021 doit avoir lieu Si le festival n’est pas directement subventionné, de nombreuses compagnies sur l’ensemble du territoire sont soutenues par l’Etat et les collectivités pour pouvoir y participer. N’est-il pas temps de nous préoccuper de l’usage qui est fait de tout cet argent public ? L’enjeu n’est pas seulement celui du Festival « off » d’Avignon, mais au-delà, celui de la politique du spectacle vivant en France. L’annulation de l’édition 2020 pour cause de pandémie et les craintes qui pèsent sur l’édition 2021 rendent l’avenir du festival incertain. Elles sont l’occasion de renverser un système à bout de souffle et de le réinventer. Il en va de la survie du festival, et de la fierté pour les compagnies de pouvoir se produire à la hauteur de leurs exigences, et, pour les théâtres d’Avignon, de pouvoir y répondre. ≠≠ Pour nous, il est évident que le Festival d’Avignon « off » 2021 doit avoir lieu. Comment l’Etat peut-il imaginer que nous, artistes, techniciennes et techniciens, directrices et directeurs de compagnies et de théâtres, qui sommes des employés et des entrepreneurs de spectacles, ne serions pas conscients de la gravité de la situation actuelle et moins capables d’assurer les mesures sanitaires qui sont demandées par le gouvernement que les entrepreneurs et employés dans d’autres secteurs tels que ceux du commerce, de la grande distribution et de tous les autres secteurs d’activité actuellement ouverts ? « Déjà des propositions abondent, comme celle d’un label qualitatif “théâtre équitable” » Au sein des Etats généraux du « off » (Egoff), nous sommes 300 auteurs, comédiens, metteurs en scène, techniciens, administrateurs, directeurs de théâtres, responsables de compagnies, représentants de sociétés de droits d’auteur à avoir fait le même constat. Nous avons mis en place une organisation qui nous permet de penser le festival de demain, de façon horizontale et inclusive. Celui-ci sera issu d’une concertation collective, car nous croyons le dialogue indispensable à l’émergence d’une structure plus juste et plus solidaire. Préserver la diversité culturelle Déjà des propositions abondent, comme celle d’un label qualitatif « théâtre équitable », qui pourrait s’appliquer à des domaines aussi divers que les conditions d’accueil du public et des compagnies dans les théâtres, l’extension du festival hors des remparts du centre-ville et l’inclusion de tous les publics du Grand Avignon dans les projets des théâtres et des compagnies, l’engagement des compagnies sur le respect des conventions collectives, la lutte pour la transparence des comptes, la participation à l’encadrement des prix et à la régulation des pratiques. La question de la lutte contre le réchauffement climatique est également au cœur des débats, avec des réflexions sur la climatisation des salles, la mise en place de cantines bio et solidaires travaillant avec des producteurs locaux, ou encore la mutualisation des transports et du matériel technique des compagnies ou d’achats groupés pour les théâtres. Il appartient au ministère de la culture et aux collectivités territoriales locales interpellées à plusieurs reprises d’accompagner ce changement. Le chantier est vaste. Nous nous laissons trois années pour mener à bien une réflexion collective qui proposera un écosystème fondé sur la préservation d’une diversité culturelle, en adéquation avec les principes d’une économie sociale et solidaire. Avignon « off » est l’un des festivals les plus importants d’Europe. Nos propositions ont pour objectif d’en faire un événement exemplaire pour la diffusion du spectacle vivant en France et pour la politique culturelle européenne. Il est temps que tous les partenaires, publics et privés, participent à la réflexion pour faire de ce festival un des moteurs du changement. Parmi les signataires : Jean-Philippe Daguerre, auteur, comédien, metteur en scène ; Irène Jacob, comédienne ; Agnès Jaoui, comédienne, réalisatrice ; Sébastien Jumel, député GDR de Seine-Maritime ; Michel Larive, député LFI de l’Ariège ; Virginie Lemoine, autrice, comédienne, metteuse en scène ; Jean-Luc Mélenchon, député LFI des Bouches-du-Rhône ; Richard Ramos, député MoDem du Loiret ; Jean-Michel Ribes, auteur, metteur en scène,
directeur du Théâtre du Rond-Point ; Michèle Victory, députée PS d’Ardèche.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2021 9:34 AM
|
Sur la page de France Culture le 25 mars 2021
Journée spéciale Il y a tout juste trois semaines débutait à l'Odéon, à Paris, une vague croissante d'occupations de théâtres. Au coeur des revendications, la réouverture des lieux culturels, l’assurance chômage et l’indemnisation des intermittents. Avec aussi l'opportunité de penser, tester, l'avenir du théâtre.
Le Théâtre de la Manufacture à Nancy, le 22 mars 2021, est l'une des dizaines de salles occupées en France, essentiellement à l'appel de la CGT Spectacle. Parmi les revendications, la renaissance des lieux d’art, de culture, de pensée.• Crédits : Cédric Jacquot / L'Est républicain - Maxppp Une centaine de théâtres et de lieux culturels sont désormais occupés en France par des intermittents et étudiants, selon la CGT Spectacle qui a initié ce mouvement le 4 mars dernier au théâtre de l'Odéon, à Paris. C'est le cas au théâtre Graslin, dans le centre-ville de Nantes, depuis deux semaines : Écouter le reportage au théâtre Graslin à Nantes 1 MIN Ils sont une cinquantaine à occuper le théâtre Graslin de Nantes. Louis-Valentin Lopez y a passé une journée et une nuit. Outre une série de revendications, les participants à ces actions réfléchissent aussi aux transformations actuelles et futures du théâtre en temps de pandémie. Nous les avons interrogés un peu partout dans le pays et nous vous proposons de nombreux rendez-vous dans nos journaux à ce propos ce jeudi 25 mars. À Toulouse, le Théâtre de la Cité (pré)occupé avec la jeunesse par la création C’est un théâtre fermé aux spectateurs mais qui n’a jamais cessé de travailler depuis un an : le CDN de Toulouse, occupé depuis le 11 mars, est un lieu d’expérimentation pour les jeunes et de réflexion par les jeunes sur une réinvention de la création et de la rencontre avec le public : Écouter "On utilise des techniques de télévision pour réinventer une expérience de théâtre vivant. Ce n'est pas du cinéma ni du théâtre filmé." Reportage de Benoît Grossin. Et alors que des jeunes étudiants et "artistes émergent.e.s" sont mobilisés pour leur avenir et celui du spectacle vivant, il est aussi question dans le théâtre de réinventer la création, sa mission principale, en temps de pandémie : Écouter "On est obligé de réinventer notre lien avec le public" : Galin Stoev, directeur du Théâtre de la Cité Juan, 22 ans, en master d’écriture dramatique, à l’université Jean-Jaurès de Toulouse, est l'un des occupants. Très intéressé par la mise en scène, il considère que "c'est très difficile parce qu'une des questions les plus récurrentes et qui est une question très théâtrale, c'est : va-t-on avoir un espace pour travailler ? Comme nous n'avons pas d'espace et que nous sommes réduits à notre chambre. Notre chambre d'étudiant est petite, donc nous sommes un peu dans une sorte de paranoïa constante en se disant est-ce que j'attends de travailler ou est-ce que j'essaie de travailler maintenant ?" "Avec ce mouvement au Théâtre de la Cité, je commence à pouvoir créer un réseau avec d’autres élèves et d’autres artistes" : Juan, étudiant en master d’écriture dramatique Passer la nuit au Théâtre de la Cité est “une expérience de travail et de joie” pour Juan, en marge de sa formation à l’université Jean Jaurès de Toulouse. • Crédits : Benoît Grossin - Radio France À RÉÉCOUTER Réécouter Derrière ses portes fermées, le Théâtre 14 devient une fabrique de la pensée 8 MIN Le jeu à distance d'Emmanuel Noblet Comédien et metteur en scène, il reçu un Molière en 2017 pour un seul en scène dans Réparer les vivants, d'après le roman de Maylis de Kerangal. Très solidaire des théâtres occupés, il vient de terminer les répétitions d'une pièce mise en scène par Christophe Rauck au théâtre du Nord, le centre dramatique national de Lille. Au-delà de sa colère face à la fermeture des salles et aux conséquences sur les intermittents les plus précaires, il profite de la période pour inventer une nouvelle manière de proposer un vrai moment de théâtre à distance : Rouvrir ? Mais quasiment aucune étude sur le sujet en France La seule étude qui évoque les lieux culturels en France est celle de l'Institut Pasteur, publiée au début du mois de mars sur les lieux de contamination. Elle démontre qu'il n'y a pas eu de sur-risque d'infection dans les lieux culturels lorsqu'ils étaient ouverts en octobre dernier. A l'étranger, des études ou expérimentations ont été menées, notamment en Allemagne. D'après une étude de l'institut Hermann Rietschel de Berlin menée par le professeur Martin Kriegler et l'ingénieure Anne Hartmann, les théâtres, cinémas et musées sont des zones à moindre risque que les supermarchés ou les openspace. "La distanciation physique, le port du masque, le nettoyage des surfaces et des mains et une ventilation adaptée", respecter les mesures sanitaires dans les théâtres est tout à fait possible d'après Constance Delaugerre, professeure de virologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et signataire d'une tribune intitulée "Culture confinée, métros bondés : en finir avec la politique bipolaire" : Mais le risque n'est pas le même pour le personnel et les comédiens, amenés à interagir, notamment sans masque sur scène. Des tests réguliers et la vaccination pourraient donc être une solution. A l'heure actuelle, une réouverture reste malgré tout précipitée estime Constance Delaugerre, en raison de "l'incidence très élevée et des variants qui ont un taux de transmissibilité et de sévérité bien plus important". Cependant, une réouverture aurait pu être envisagée à des périodes où le taux d'incidence était moins important - par exemple sur la période décembre 2020-février 2021 - avec des protocoles sanitaires stricts ou pour évaluer les risques, comme cela a été fait dans d'autres pays. Pour la virologue, qui supervise le concert test qui devait être organisé en avril à l’Accor Hôtel Arena de Paris [la date pourrait être repoussée], un calendrier et des perspectives permettraient aux professionnels et au public de savoir quand les théâtres et autres lieux culturels rouvriront. Soit en se basant sur les expériences menées à l'étranger soit en mettant en place nos propres expérimentations. Ce mardi, la mission d’information du Sénat pour l’évaluation des effets des mesures de confinement ou de restrictions réunissait des représentants d’institutions culturelles internationales demeurées ouvertes. Joan Matabosch, le directeur artistique du Teatro Real de Madrid, y a expliqué que son institution a "mis en place en mai et juin un protocole sécurisé […] pour l’orchestre, pour le chœur", avec des "adaptations de la salle du théâtre, de répétition, de la fosse", etc. "Six épidémiologistes" suivent aussi le théâtre et font un point tous les 7 à 10 jours, précise Public Sénat.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2021 4:58 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan le 24 mars 2021 Sans être ouvertes au public, les Zébrures de printemps des Francophonies, consacrées aux nouvelles écritures et à leur traduction scénique, se sont tout de même tenues. Avec, en particulier, une nouvelle pièce de Guy Régis Jr et un retour sur la vie de Kateb Yacine par Mohammed Kacimi accompagné par la sublime Souad Massi Hassane Kassi Kouyaté, le nouveau directeur du festival des Francophonies de Limoges devenu « Les francophonies des écritures à la scène » entend proposer chaque saison des « zébrures d’hiver » puis des « zébrures de printemps » . C’était compter sans la Covid, mot phare d’une nouvelle langue internationale: le desesperanto. L’an dernier, les Zébrures de printemps n’avaient pas pu fleurir, la Covid les ayant mises sous cloche. Elles reviennent cette année dans une « seconde première édition » comme il est indiqué sur le programme aux pages, ici et là, tamponnées d’un sans appel : « annulé ». Malgré cela et malgré l’absence forcée de tout lieu de convivialité et de public, les Zébrures de printemps se sont ouvertes le 20 mars et dureront jusqu’au 28 mars, devant un public réduit à la peau de chagrin de quelques professionnels et journalistes . « Annuler c’est cesser de vivre » clame Hassane Kouyaté qui tenait à cette édition. Il est, par ailleurs candidat à la direction du Théâtre de l’Union et de l’école y attenant, rêvant de la synergie d’un vaste ensemble. Ce qui serait partiellement un retour aux sources, le festival étant né du Centre dramatique de Limoges lorsque Pierre Debauche le dirigeait. Au programme des zébrures printanières, dix textes inédits, certains bénéficiant de l’accueil et de l’aide de la maison des auteurs liée au festival, tous lus en scène avec un début de mise en scène rappelant les mises en espace de Théâtre Ouvert. Ces textes tous neufs seront présentés dans les lycées de la région, les spectacles en milieu scolaires étant autorisés, il y a là un « »vivier » où puiser « les spectateurs de demain » souligne Kouyaté. Pas de gros spectacles, clefs et réputation en main, venus d’Afrique, du Canada ou d’ailleurs francophones mais, plus modestement, un suivi d’aventures, depuis les balbutiements de l’écriture jusqu’au rendu scénique. « Ne pas faire beaucoup mais accompagner mieux », c’est le credo d’Hassane Kouyaté. Le premier week-end présentait une pièce venue de Suisse, Chaos, écrite et mise en scène par Valentine Sergo, premier volet d’un vaste ensemble autour d’une femme matrice nommée Hayat .A suivre , donc. Suivaient trois pièces haïtiennes : . Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus ! », la seconde pièce d’Andrise Pierre, une écriture en devenir ; Que ton règne vienne, la première pièce de Gaëlle Bien-Aimé bien connue à Port au Prince pour #JeSuisGaelle son stand-up évolutif en fonction de la situation, justement apprécié pour son ton caustique et humoristique . La troisième pièce venue d’Haïti, L’amour telle un cathédrale ensevelie est écrite par l’une des figures phares du théâtre haïtien, Guy Régis Jr. A Port au Prince il dirige et anime le Festival des quatre chemins (lire ici). Un auteur affirmé dont trois pièces sont publiées aux Solitaires intempestifs. Cette nouvelle pièce mêle le créole haïtien et le français, ce n’est pas la première fois que Guy Régis écrit en créole mais, à ma connaissance, c’est la première fois que les deux langues cohabitent dans une même pièce. D'ailleurs la pièce parle de la cohabitation entre une femme « La mère du fils intrépide » qui vit avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle, « le retraité mari ». La femme, mère d’un grand garçon, ayant suivi l’homme âgé dans son pays (non explicitement nommé). Dès le début, on est dans l’ambiance, électrique et vindicative d’une dispute domestique ; « Gifle-moi. Vas-y. Gifle-moi. Va crétin ! Chien ! » lance la femme. Son vieux mari propose de sortir pour respirer.. Elle refuse, veut enfin qu’ils se parlent, que ce qui est tu, ressurgisse. «Nous ne sommes pas en guerre mon amour » tente le vieil homme. « Je ne parle pas de guerre vieux cacochyme. Je parle de l’amour, de cet amour mort entre nous. De l‘amour telle une cathédrale ensevelie » réplique la femme. Une métaphore (qui reviendra plusieurs fois) parlante pour tous les haïtiens. Elle leur rappelle les désastres du tremblement de terre il y a plus de dix ans et la destruction de la cathédrale Notre Dame de Port au Prince aux pierres ensevelies.. D’un désastre l’autre, en quelque sorte. Le fils a arrangé le départ de sa mère auprès de cet étranger, une union arrangée via les réseaux sociaux.. « Tout ce que j’endure, tout cet effort, je le fais pour lui » dit "la mère du fils intrépide". Mais où est ce fils ? Qu’est-il devenu ? On est sans nouvelles depuis deux mois. Alors la pièce bascule du côté du fils (et du film car cette partie devrait être filmée). Il a fui son pays sur un boat people. Nous voici en haute mer, le fils a emporté pour tout bagage sa langue natale. Le créole haïtien envahit la scène, la barque chavire. Mort ? La pièce, bien mise en scène par Catherine Boskowitz, s’achève par un magnifique monologue de la mère dit par la non moins magnifique actrice Nathalie Vairac pour laquelle Guy Régis Jr a écrit cette pièce et à qui il l’a dédiée. Le dernier spectacle de ce premier week-end des Zébrures de printemps (un second et dernier week-end suivra le 27 mars) ne rentrait dans aucune case puisqu’il y était qu’est question d’une vie et non d’une pièce, d’un auteur mort et non vivant, mais quel auteur ! L’incasable et irréductible Kateb Yacine. Dans Sur les pas de Kateb Yacine,Mohamed Kacimi a eu la formidable idée de raconter la vie de l’auteur de Nedjma et de Mohammed prends ta valise en piochant dans les nombreux interviews que Kateb ( dont le mot veut dire, livre et écrivain) a donné et en les arrangeant. Un bon nombre d’entretiens entre 1958 et 1969 (année de sa disparition) ont été réunis par Gilles Carpentier sous le titre Le poète comme un boxeur (éditions du Seuil, éditeur principal de Kateb) à partir des archives de l’auteur déposées à l’IMEC. Kacimi a aussi puisé dans des films et des émissions de radio (France-Culture) aisément trouvables sur Internet. La seconde idée de Kacimi, tout aussi formidable, a été de demander à Souad Massi de ponctuer musicalement cette vie avec ses propres compositions portées sa voix enchanteresse. Un régal entre deux langues. Une triple complicité. Un enchantement. Kacimi avait effectué un premier montage pour Marcel Bozonnet lorsque ce dernier dirigeait la Comédie-Française. Une représentation avait eu lieu au Centre Culturel Français d’Alger en 2007. Bozonnet déclara alors dans la presse : « Pour moi, Kateb Yacine reste essentiellement un poète qui a connu les tragédies de ce siècle et qui les a traduites avec l’émerveillement et la violence d’un enfant resté amoureux de son enfance jusqu’à la fin de sa vie. Kateb Yacine est certainement l’une des plus grandes figures de la littérature algérienne » On ne saurait mieux dire. Ce qui frappe dans ce montage, c’est la sincérité profonde de Kateb Yacine, son esprit indépendance et sa solidarité avec les humbles. Un esprit libre qui déclare sans fard « l’armée a fait entrer les loups islamiques dans la bergerie algérienne au premier jour de l’Indépendance ». Lui qui avait quitté l’Algérie pour mieux y revenir un jour, revient après l’Indépendance. Il essaie de faire de la radio, du cinéma, d’écrire dans la presse, mais les portes se ferment. « J’ai compris alors qu’il était impossible de sortir de la triade Algérie, Arabe, Islam. Et que pour faire du théâtre il ne fallait parler ni du pouvoir, ni de la religion, ni du sexe. Ce qui revenait à dire qu’on pouvait monter des pièces pour ne rien dire. » Après le coup d’état du colonel Boumédienne en juin 1965, il prend sa valise, revient en France, finit non sans mal Le Polygone étoilé puis, noie sa tristesse en voyageant. Mais vient le moment où « le bordel algérien « lui manque.Etc. Bien sûr, Mohammed Kacimi commence par le commencement : l’enfance, la famille, l’éveil de la poésie et de l’engagement, les événements de Sétit et son arrestation, sa mère qui devient folle lorsqu'elle le croit mort, la rencontre amoureuse avec sa cousine Nedjma. Et ainsi de suite.. Quelle vie ! Mohamed Kacimi me choisit pas d’achever le périple par la mort du héros (en 69 à Grenoble) mais par une analyse et un appel qu’il partage assurément. «Si je devais laisser un testament, c'est ma haine des religions. Ce qui a esquinté le monde, ce qui m'a esquinté et ce qui vous esquinte aujourd’hui ce sont les religions. Ces trois religions monothéistes font le malheur de l'humanité (…) Le malheur de l'Algérie a commencé avec la religion. Nous avons subi les Romains et les chrétiens. Aujourd’hui nous subissons la colonisation arabo-islamique. » dit Kateb Yacine. Et de conclure : « Je vous le dis ce soir: si on ne se réveille pas, si on ne bouge pas nous allons y laisser notre liberté et notre peau. Debout alors, debout. Y a pas de bon dieu. Et si y a un bon dieu, c'est vous. Le bon dieu,c’est nous et rien d’autre, alors, debout, mes frères, débout...debout, debout.. »Et Souad Massi d’accompagner Kacimi à la guitare et de chanter dans la langue ancestrale des Kateb. Les Zébrures du printemps à Limoges, s'achèveront le 27 mars, sans autre public que celui, restreint, réunissant professionnels et journalistes. Légende photo : Kateb Yacine © Brigitte Enguérand

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2021 3:06 PM
|
Par Philippe Chevilley et Philippe Noisette dans Les Echos le 24 mars 2021 Olivier Py a présenté la programmation du 75e festival d'Avignon, espérant qu'elle puisse se tenir dans des conditions normales. Une édition de relance et de combat, forte d'une belle présence féminine et d'une affiche de gala dans la Cour d'honneur : « La Cerisaie », de Tchekhov, mise en scène par Tiago Rodrigues, avec Isabelle Huppert. Côté théâtre, des créations de Christiane Jatahy, Caroline Guiela Nguyen, Angélica Liddell ou Emma Dante. Côté danse, une « dream team » : Maguy Marin, Dimitris Papaioannou, Jan Martens, Dada Masilo, Marcos Morau… Le Festival d'Avignon est un des gros enjeux de l'été. Sa tenue dans des conditions à peu près normales sera le symbole d'un retour au théâtre, à la culture, à la vie. Si les conditions d'organisation du Off - avec ses 1500 spectacles, dont beaucoup dans des lieux exigus - restent un gros point d'interrogation, le festival « in » prévoit une 75e édition d'envergure. Olivier Py, son directeur, l'a qualifiée de « Festival exceptionnel » en présentant la programmation, mardi 24 mars. Au menu, quelque 46 spectacles durant 21 jours (du 5 au 25 juillet) mais aussi 40 lectures, 70 débats et deux expositions. Plus de 80 % des spectacles seront des créations, 29 seront (co) produits par le Festival. Et près de la moitié seront « portés par des femmes ». Si une jauge à 100 % est autorisée, c'est plus de 135.000 entrées payantes qui sont attendues (20.000 en plus qu'en 2019), auxquelles s'ajouteront 40.000 entrées libres. Deux autres scénarios sont envisagés : un jauge réduite pour tous les spectacles ou seulement pour les lieux fermés. Sur un thème assez général, « Se souvenir de l'avenir » qui interroge dans tous les sens notre futur incertain, l'affiche apparaît éclectique et particulièrement alléchante. En voici quelques extraits. Dans la Cour d'honneur du Palais des papes, aux gradins soigneusement rénovés, sera présentée en ouverture « La Cerisaie » de Tchekhov, mise en scène par le chaman portugais Tiago Rodrigues, avec en vedette Isabelle Huppert. La Brésilienne Christiane Jatahy, chantre du « théâtre-cinéma », proposera « Entre chien et loup », adapté de Lars von Trier, à Vedène, tandis que Caroline Guiela Nguyen, forte de sa sensibilité intimiste et onirique, présentera « Fraternité et conte fantastique », dans l'autre grande salle du festival, La Fabrica. Les retours d'Angelica et d'Emma Grande habituée du festival, la bouillante Espagnole Angélica Liddell sera à l'oeuvre avec ses « Histoire(s) du théâtre III » au titre éloquent : « Liebestod - L'Odeur du sang ne me quitte pas des yeux » (on ignore encore dans quel lieu). On découvrira le nouveau vagabondage poétique de Nathalie Béasse « Ceux-qui-vont-contre-le vent » au Cloître de Carmes. Réputée pour ses fables noires, la Belge Anne-Cécile Vandalem, (« Tristesse » et « Arctique ») installera son « Kingdom » dans la cour du Lycée Saint-Joseph. Au Cloître des Célestins, tout juste rouvert, Fabrice Murgia s'emparera d'un texte de Laurent Gaudé « La Dernière Nuit du monde ». Le collectif spectaculaire FC Bergman jouera « The Sheep Song » à Vedène. Adulée des festivaliers, l'Italienne Emma Dante offrira un bouquet de spectacles (« Misericordia », « La statuette de sucre, « La fête des morts ») au gymnase du Lycée Mistral. Pas de grande création prévue en revanche pour Olivier Py mais une présence quotidienne : il orchestrera le feuilleton théâtral au jardin Ceccano avec une variation shakespearienne : « Hamlet à l'impératif ! ». Enfin les 100 ans d'Edgard Morin seront fêtés dignement dans la Cour d'honneur le 13 juillet, sous la forme d'un dialogue avec Nicolas Truong. Rêve de danse La danse n'a pas été oubliée. La sélection de cette 75e édition a tout d'une « dream team » de saison. De Maguy Marin à Dimitris Papaioannou, de Jan Martens à Dada Masilo, la distribution est éblouissante. Certains spectacles sont des « rescapés » de 2020 comme celui de Jan Martens avec les 17 interprètes de Dance on Ensemble - son ballet « Any Attempt Will End In Crushed Bodies And Shattered Bones » s'intéresse aux mouvements de foule, aux corps en résistance. Un choc espéré. Maguy Marin revient à Avignon avec « Y aller voir de plus près » une forme resserrée, quatre danseurs et une multitude d'accessoires pour dire le mystère du vivant. Attendu l'année passée dans la Cour d'honneur, le Grec Dimitris Papaioannou sera bien présent cet été mais pour un duo avec Suka Horn, « INK », du côté de la Fabrica. C'est à l'Espagnol en vue Marcos Morau qu'il reviendra d'occuper la Cour d'honneur avec « Sonoma », variation sur les traditions dansées. La Sud-Africaine Dada Masilo dont le « Swan Lake » a remporté un succès fou déboule au Cloître des Carmes avec « Le Sacrifice », sa vision du « Sacre du printemps ». Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero, autrefois révélés par les Ballets C de la B, partagent le plateau le temps de « Lamenta » pour 9 interprètes grecs. Du côté des « indisciplinés » chers à Olivier Py, on retrouve le plasticien Théo Mercier qui, outre une exposition à la Collection Lambert, crée « Outremonde » performance annoncée comme un « paysage vivant ». Quant à Phia Ménard, elle donnera la suite de sa « Trilogie des contes immoraux (pour Europe) ». On a hâte d'y être… 75E FESTIVAL D'AVIGNON Spectacles Du 5 au 25 juillet Réservation par internet à partir du 5 juin, festival-avignon.com par téléphone à partir du 15 juin Philippe Chevilley et Philippe Noisette
Commenter
Isabelle Huppert vedette de « La Cerisaie » de Tchekhov dans Cour d'honneur. Elle sera dirigée par Tiago Rodrigues. (© Tobias SCHWARZ/AFP)
Par

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 2:59 PM
|
Par Clarisse Fabre dans Le Monde le 23 mars 2021 Installé au Théâtre des Amandiers de Nanterre, le cinéaste n’a cessé de faire évoluer sa création à cause de la crise sanitaire.
Vous sortez du RER A, à Nanterre (Hauts-de-Seine), vous traversez le parc André-Malraux et contournez le plan d’eau qui semble séparer la vie terrestre des enfers. Mais nul homme à la barque sur le Styx, la descente commence dans un petit sentier abrupt et humide menant à l’entrée des artistes du Théâtre des Amandiers… Vendredi 12 mars, 9 heures du matin. L’homme à la barbe (brune, foisonnante) qui officie entre scène et gradins se nomme Bertrand Mandico. Né en 1971, auteur d’une trentaine de courts-métrages et d’un premier « long » onirique, sensuel et fiévreux, Les Garçons sauvages (2018), avec des actrices dans les rôles masculins, le cinéaste a été invité par le directeur du Centre dramatique national (CDN), le metteur en scène Philippe Quesne, alors que dernier achevait son mandat aux Amandiers – Christophe Rauck lui a succédé le 1er janvier. Répondant à l’invitation de créer dans un théâtre, Bertrand Mandico a proposé une « relecture libre » et féminisée de Conan le Barbare, du nom du personnage imaginé dans les années 1930 par l’écrivain américain Robert E. Howard, et du film (1982) de John Milius. Un temps baptisée Conan la Barbare, la création s’appelle désormais Conan la Déviante. Plusieurs actrices incarnent l’héroïne à des âges différents : Claire Duburcq, Camille Rutherford, Sandra Parfait… « Ce sera “la” Barbare et non plus “le” : une femme qui se raconte au travers d’un spectacle depuis les enfers où elle règne, nostalgique de ses propres horreurs », explique Bertrand Mandico, qui entend « vider l’excès de virilité » de l’œuvre initiale, adaptée au cinéma avec Arnold Schwarzenegger. Féminiser, c’est érotiser, c’est aussi porter un regard décalé, dans une veine étrange ou burlesque, sur cette chaîne de barbaries perpétrées par les hommes depuis la nuit des temps. Bertrand Mandico tourne sur support pellicule et sublime ses scénarios guerriers par la grâce d’images ultra-stylisées, bricolées avec sa caméra super-16. Si l’on reconnaît son esthétique au premier coup d’œil, c’est parce qu’elle est traversée par un tissu d’influences qui n’appartiennent qu’à lui, du cinéma japonais érotique au poète, chanteur et réalisateur punk F. J. Ossang, de Jean Cocteau au cinéaste canadien Guy Maddin, de Federico Fellini à David Lynch. « Mise en abyme » L’équipe de Conan…, produit par Emmanuel Chaumet (Ecce Films) et Antoine Garnier (Orphée Films), a investi le Centre dramatique national de Nanterre en novembre 2020, jusqu’aux toilettes masculines et leur rangée de pissotières qui ont été taguées en noir, dans un style no future. Un petit nombre de collaborateurs, fidèles de Bertrand Mandico, participent à l’aventure, rejoints par quelques nouvelles venues, telle la dramaturge de théâtre Marion Stoufflet. Sur le grand plateau, on découvre aussi les vestiges du tournage de la veille, une compression de corps, plus ou moins démembrés, ainsi qu’une mare d’eau rougie sous le filtre d’un projecteur, que surplombe le trône de la « Reine des Barbares ». A quelques mètres, comme piquée sur un poteau, la tête reconstituée de Pacôme Thiellement, essayiste et vidéaste qui tient conférence – pour de vrai – dans le projet Conan, sous le nom de Lovecraft… Arrive sur le plateau Camille Rutherford, jambes fuselées, petit gilet en fourrure sur la poitrine nue. Regard noir et perçant, elle avance face caméra et manie son épée de la main gauche. Bertrand Mandico, cinéaste : « A chaque fois que le projet se complexifiait, mon réflexe a été un peu étrange : je me suis dit, on n’a qu’à faire un autre film. Donc j’ai multiplié les films » Au départ, le projet de Conan… mêlait un spectacle et un tournage, avec la perspective de performances ouvertes au public. Mais la persistance de la crise sanitaire a balayé le programme. « Quand on a compris qu’il serait impossible de faire venir des spectateurs, je me suis mis à travailler sur la mise en abyme de cette création, résume Bertrand Mandico. A chaque fois que le projet se complexifiait, sur le plan logistique ou financier, mon réflexe a été un peu étrange : je me suis dit, on n’a qu’à faire un autre film. Donc j’ai multiplié les films. » Il y en aura quatre au total, du moins à l’heure où ces lignes sont écrites. Un court-métrage a déjà été tourné, un projet de « long » est lancé, ainsi qu’un film en réalité virtuelle. Le 12 mars, nous assistons au tournage du quatrième opus, un film sur les performances qui n’ont pu avoir lieu devant le public. « L’adaptation filmique de ce qu’aurait pu être le spectacle », résume Bertrand Mandico, à propos de cette œuvre fantôme. « Bourreaux et victimes » Robe vintage et talons hauts, le comédien Christophe Bier sort de la loge de « maquillage ». Il incarne Octavia, une metteuse en scène qui fume des cigarettes longues et fines, et semble bien en peine de faire avancer son projet. « C’est un personnage mélancolique, voire dépressif. Si le cinéma est mort, elle n’a plus de raison d’être, la salle est vide », explique l’acteur en faisant référence au film de Rainer Werner Fassbinder, Prenez garde à la sainte putain (1971), l’histoire d’une équipe de tournage confrontée à de multiples difficultés. Lire la critique d’« Hormona » (en août 2015) : L’enfer de Bertrand Mandico Sa partenaire de jeu, Elina Löwensohn, se concentre avant de monter sur scène, dans son blouson orné d’une inscription cloutée dans le dos : « Rainer », tiens tiens… On la laisse filer à regret. Elle porte sur le visage un masque de chien métallique, et campe un personnage potentiellement menaçant. Dans les couloirs, Pacôme Thiellement passe une tête, la sienne cette fois-ci, en chair et en os. Il ne tourne pas ce jour-là, et veut bien parler de la « mélancolie » chez son ami cinéaste. « Bertrand travaille des variations sur le même thème : ce s1ont des humains qui, dans leur relation à la vie et à l’amour, sont toujours bourreaux et victimes. Dans Conan, on part des temps barbares mythiques, et on arrive à notre époque : il y a l’Europe, des militaires qui sont des sortes de proto-nazis. On est dans un méta-monde, on ne sait pas si les personnages sont morts ou vivants. » Nul ne sait quand se terminera l’odyssée des quatre films. La résidence aux Amandiers a pris fin mercredi 17 mars, en attendant le tournage du long-métrage, avec un casting « en mutation », à l’image du tentaculaire projet Conan. Lire les critiques de « Boro in the Box » et « Living Still Life » (en juillet 2014) : Le surréalisme salvateur de Bertrand Mandico Clarisse Fabre Légende photo : Julia Riedler et Camille Rutherford sur le tournage du film de Bertrand Mandico, « Conan la Déviante » au Théâtre des Amandiers à Nanterre (Hauts-de-Seine). MARTIN ARGYROGLO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 6:09 AM
|
par Stéphane Roland dans Libération publié le 23 mars 2021 Premier de cordée, le théâtre fondé par Brecht, le Berliner Ensemble, a rouvert deux soirs, avec un protocole sanitaire très rigoureux, dont la mise en place de tests antigéniques compris dans le prix du billet. Entre deux répliques, le comédien ose une petite remarque personnelle sur la scène. «Ahhhhh, c’est vraiment trop chouette le théâtre !», lâche-t-il en aparté, visiblement ému par tant de spectateurs. Les bravos et les applaudissements pleuvent dans salle du Berliner Ensemble à Berlin. «Quel privilège d’être là ce soir !», confie un spectateur, habillé pour l’occasion d’un masque à paillettes. Après cinq mois de fermeture, le «BE» a rouvert des portes pour seulement deux soirées exceptionnelles, avec une pièce de Benjamin von Stuckrad-Barre, adaptée à l’ambiance schizophrénique du moment : Panique cardiaque (Panikherz), sur le thème de la dépendance à la drogue et la perte de contact avec la réalité. «Les billets ont été vendus en quatre minutes», s’est félicité Oliver Reese, le directeur du BE. Le théâtre fondé par Bertolt Brecht a ouvert le bal, vendredi 19 mars, au projet pilote de la mairie de Berlin, unique en Allemagne, qui doit prouver en deux semaines que la culture peut – pouvait – fonctionner pendant la pandémie. Initié par le maire-adjoint à la culture et à l’Europe, Klaus Lederer (Die Linke, gauche radicale), le résultat de cet essai grandeur nature, qui s’achèvera le 4 avril, doit permettre d’imaginer une réouverture des salles et surtout un fonctionnement sans interruption jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Le principe est simple : le prix du billet comprend un test antigénique le jour de la représentation. Testé de frais le matin, sur rendez-vous à partir de 8 heures dans cinq centres partenaires, vous ne pouvez entrer dans le théâtre qu’avec une attestation de résultat négatif et une pièce d’identité. Les examens biologiques sont payés par la mairie. Le lancement du projet-pilote, auquel participent les scènes les plus prestigieuses de la capitale (dont la Volksbühne et les opéras Staatsoper et Deutsche Opera) a été un événement en Allemagne, annoncé au JT de la télévision publique (ARD). Pas de vestiaire, pas de pause, pas de bar, pas de bretzels à l’entrée et port du masque obligatoire pendant la représentation... Un siège sur deux est inoccupé (350 spectateurs ce soir-là), ce qui assure une distance de sécurité d’environ d’un mètre dans cette salle déjà très étroite. «Regardez la hauteur du plafond, lance Oliver Reese. Notre système d’aération nous permet de renouveler l’air de la salle plusieurs fois par heure.» Avec les zoos et les bordels Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? «Le gouvernement allemand n’a aucune fantaisie. Il est obsédé par le taux d’incidence. Quand il remonte, on ferme. Quand il redescend, on rouvre», critique Marc Grandmontagne, directeur de la Fédération des théâtres et des orchestres allemands (Deutscher Bühnenverein). «Impossible de planifier quelque chose au delà de trois mois», ajoute Oliver Reese. «Le gouvernement nous a catalogués dans le registre des activités loisirs avec les zoos et les bordels [autorisés en Allemagne, ndlr]. Il était urgent de différencier les théâtres», peste le directeur du BE. «Les entreprises continuent de fonctionner. Et nous ?» demande-t-il en regrettant que le lobby de la culture soit «trop fragmenté» pour faire pression sur le gouvernement. La culture n’a jamais été une priorité pour les responsables politiques des Länder (les 16 régions allemandes sont compétentes pour la culture). Fin février, ce sont les salons de coiffure qui ont été le centre des préoccupations du deuxième déconfinement (stoppé cette semaine par la remontée du taux d’incidence). Les capilliculteurs ont eu l’honneur d’ouvrir les premiers, le 1er mars, deux semaines avant tous les autres, sous la pression de l’opinion publique. «L’estime qu’on porte à la culture en Allemagne n’était pas aussi grande qu’on se l’imaginait. Ce fut un choc», déplore Marc Grandmontagne. «La culture joue un rôle mineur dans cette crise», confirme Oliver Reese. Les directeurs de salles ont pourtant tout fait pour démontrer qu’il était beaucoup plus facile de s’infecter dans les transports en commun que sur un siège de théâtre. Plusieurs études ont confirmé que les grandes scènes étaient équipées de système d’aération efficaces. Début novembre, un test sur les aérosols a été effectué par l’Institut Heinrich-Hertz au Konzerthaus de Dortmund, une salle de concert moderne de 1 500 places. Tout le monde était là : le public, les ingénieurs de la ventilation, représentants du ministère de l’environnement (compétent), experts de l’hygiène... «L’analyse des données a permis de conclure que le risque de transmission des infections par les aérosols est pratiquement nul. Les théâtres et les salles de concerts ne sont pas des lieux d’infection», insiste Raphael von Hoensbroech, le directeur du Konzerthaus. Pour assurer une sécurité maximale, l’institut a néanmoins préconisé un remplissage de la salle à 50% en raison de la circulation des spectateurs dans les couloirs. «Mais, théoriquement, le système d’aération et le port du masque obligatoire permettent de remplir la salle à 100%», assure le rapport. L’exemple du festival de Salzbourg «Tous les experts répètent que la situation est sûre dans les salles. Mais les responsables politiques ne réagissent pas», déplore Marc Grandmontagne qui fait référence à l’opéra de Madrid qui n’a jamais fermé et surtout au festival de Salzbourg qui a maintenu l’événement alors que les Allemands annulaient. Les Autrichiens ont tout modifié cet été en dernière minute : programmation, réduction du nombre de places... Avec un concept bien réfléchi (pas de pause, pas de gastronomie, désinfection, aération, liste de contacts des spectateurs, etc.), l’édition 2020 a pu accueillir plus de 76 000 spectateurs contre 250 000 en temps normal. Pas un seul cas d’infection n’a été recensé, selon la direction. En attendant le passeport vaccinal, une solution qui «pourrait ouvrir des perspectives» selon Marc Grandmontagne, la question des capacités des centres de test reste le principal souci des salles de spectacles. Samedi, la Philharmonie a accueilli 1 000 personnes qu’il a fallu tester dans la journée. C’est la crainte de Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin, l’un des théâtres d’avant-garde les plus en vue d’Europe (qui ne participe pas au projet). «Je serais ravi si cela pouvait marcher. Mais cinq centres de test pour toute la ville c’est trop peu», estime-t-il.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 4:30 AM
|
Par Léa Iribarnegaray dans Le Monde 23/03/2021 Il était passionné de théâtre avant même d’avoir vu sa première pièce. Ce fils d’un ouvrier et d’une femme de ménage est, à 26 ans, l’un des plus jeunes pensionnaires du théâtre tricentenaire. La Relève. Tous les mois, « Le Monde Campus » rencontre un jeune qui bouscule les normes. Après une longue année de disette, nous avions rendez-vous à la Comédie-Française. Dans la vie réelle : place Colette, au cœur du 1er arrondissement de Paris. On nous avait même dit de passer par l’entrée du personnel, « sur le côté, vers les colonnes de Buren ». Et patatras. Comme toutes les autres, la porte du Théâtre-Français resterait fermée. Notre interviewé, Birane Ba, était débordé. On se contentera d’un pantouflard coup de téléphone. Malgré la crise, le comédien a conservé un emploi du temps de ministre, à mille lieues du chômage technique. Ce mardi-là, Birane Ba est à Beynes (Yvelines), sur le tournage d’une série pour OCS – Les Sentinelles, de Jean-Philippe Amar. L’artiste aux dents du bonheur se sait très privilégié. Jeune recrue de 26 ans au sein d’une institution publique vieille de plus de trois siècles, Birane Ba est pensionnaire de la Comédie-Française depuis le 25 février 2019 – il récite la date comme une poésie. Alors encore étudiant au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, le garçon s’est vu offrir un salaire fixe et l’équivalent d’un CDI – chaque année, la Troupe peut décider de le débarquer ou de lui proposer de devenir sociétaire pour cinq ans, renouvelables sans limite. En septembre 2018, Birane Ba avait déjà été engagé au « Français » en tant qu’« artiste auxiliaire » pour interpréter Octave dans Les Fourberies de Scapin de Molière, par Denis Podalydès ; et le rôle-titre dans Bajazet de Racine, par Eric Ruf. « Etre payé pour faire rêver les gens, c’est un rêve absolu. C’est notre devoir de continuer à faire voyager le public » « Etre payé pour faire rêver les gens, c’est un rêve absolu, lâche celui qui, en temps de pandémie, se sent investi d’une mission. C’est notre devoir de continuer à faire voyager le public. En tant que comédien engagé par l’Etat, c’est mon travail, mon engagement, de donner du rêve malgré tout. » Depuis le premier confinement, sa « Maison » ne s’est d’ailleurs jamais arrêtée de tourner. Dès le 30 mars 2020, différents programmes ont été lancés en ligne : « La Comédie continue ! », suivi de « La Comédie continue, encore ! », puis « La Comédie reprend », et enfin « Comédie d’automne » début novembre. Bien sûr, après un triste anniversaire de fermeture des théâtres, Birane Ba évoque quelques « coups durs, espoirs et désillusions ». « Quand on répète sans savoir si on pourra se confronter au public, on a l’impression de ramer et de ne jamais voir le bord », dit-il. Il aimerait retrouver les gens « sur un vrai plateau », loin de la « barrière » de la vidéo. Entendre résonner « leurs rires, leurs pleurs, leurs allées et venues… ». « Un bosseur formidable » Pour « Comédie d’automne », Birane s’est tout de même invité à des sessions du « Théâtre à la table » : sans costume ni décor, une équipe prépare en cinq jours la création d’une pièce, filmée et diffusée le samedi à 20 h 30 sur les réseaux sociaux. On le découvre alors en Don Sanche, l’amoureux de Chimène dans la tragi-comédie de Corneille, Le Cid. Ancien joueur de foot, Birane Ba a également failli transpirer en participant à la 62e lecture d’A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust : soir après soir, les Comédiens-Français s’y relaient dans un « mini-marathon ». Il faut dire que Proust, ce n’est pas son truc. Même s’il aime « malaxer les mots », Birane Ba préfère « les petits formats ». « Je suis prêt à lire un poème d’Hugo chaque soir pour moi, parce que je sais qu’il y a une fin !, assume-t-il. La lecture, ça se cultive… Je n’ai pas pris le pli depuis petit et ça me demande un effort ». Le jeune homme « admire ceux qui ont un rapport au livre » – objet qu’il sacralise. Lui avoue lire avant tout « sous la contrainte du travail, rarement pour le plaisir ». « Il y a chez ce jeune acteur un mélange étonnant de joie et de profondeur, qui en fait une promesse pour des répertoires très différents », Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française Cela ne l’empêche pas d’être un « bosseur formidable », selon les termes d’Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française. « Il y a chez ce jeune acteur un mélange étonnant de joie et de profondeur, qui en fait une promesse pour des répertoires très différents ». D’ailleurs, Birane Ba le répète à l’envi : « Tout n’est pas arrivé d’un seul coup. » Non, le jeune pensionnaire n’a pas partagé sa loge avec Laurent Lafitte en un claquement de doigts. Il a gravi les échelons un à un, convaincu d’avoir un parcours on-ne-peut-plus-classique. Le garçon a pourtant grandi bien loin de la place Colette et des théâtres parisiens. Son enfance, il l’a passée en Normandie, à Vernon (23 000 habitants), dans le quartier de la Poterie, entre Rouen et Paris. Arrivé après six grandes sœurs, Birane était attendu comme le messie par ses parents, tous les deux Sénégalais et musulmans. Il garde un souvenir ému de « l’insouciance et l’amusement », des centres aérés en forêt, des campings à Merville-Franceville… continuant de chérir cette « part enfantine » du jeu avec ses « blagues à deux balles », « précieuse pour le métier ». Même si, faute de temps, il a fini par lâcher ses flows de rap et la PlayStation. Son père, ouvrier à la fonderie de Saint-Marcel à Vernon, s’est reconverti au moment de la fermeture des usines : avant de prendre sa retraite, il était « adulte relais » (médiateur) pour le quartier. Sa mère, femme de ménage, s’est surtout occupée des enfants. Quelle fierté pour eux de découvrir Birane grimé en Octave – son « pote imaginaire » –, sur les planches de la Comédie-Française ! « Voir ma mère dans ce lieu, si ancré dans l’histoire de la culture française, elle qui ne connaît rien à Molière mais qui en même temps a tout compris… C’était fort de sens pour moi », observe celui qui est le cinquième comédien noir de l’institution, et qui se contente qu’on le lui rappelle. « C’est magnifique de faire venir des gens qui n’en ont pas l’habitude. Ils ont un rapport au théâtre moins intellectuel, plus immédiat. Je trouve ça très beau et ça nous fait redescendre un peu. » Tenter sa chance S’il n’était question ni de Racine ni de Brecht à la maison, c’est au collège que Birane Ba a rencontré sa passion. Après la lecture d’un poème en 6e, son professeur de français, monsieur Morio, lui conseille de s’inscrire au club de théâtre : « Je me souviens de notre première représentation à la cantine. J’étais comme un poisson dans l’eau. J’ai su que c’était ça que je voulais faire. » Birane promet de décrocher de meilleures notes en français pour intégrer une 2de option théâtre au lycée d’Evreux. Interne, on l’emmène voir la première représentation de sa vie… à la Comédie-Française, cela ne s’invente pas. Mais le garçon rentre à Vernon l’année d’après : « Je ne me sentais pas un bagage assez costaud pour faire un bac littéraire », défend-il, ravi de retrouver le cocon familial et de pouvoir s’inscrire au conservatoire municipal. Son bac ES en poche, il file à Rouen pour suivre un BTS en commerce international, tout en travaillant dans une boutique de téléphonie. Cette fois, Birane Ba découvre le conservatoire régional : « J’enviais ceux qui étaient en cursus professionnel, ils avaient ma vie rêvée… Je ne voyais pas l’intérêt de mon BTS, j’ai fini par me donner deux ans pour tenter ma chance. » L’étudiant boursier valide son diplôme, et c’est à Paris que tout s’enchaîne. Il entre dans la classe libre du Cours Florent avant d’intégrer, au bout d’un an, le conservatoire national, puis de partir, au bout d’une autre année, en tournée avec la troupe du « Français ». A 26 ans, Birane Ba est actuellement l’un des trois plus jeunes pensionnaires de la Maison de Molière, née en 1680. « La jeunesse est la condition même de notre ancienneté, souligne Eric Ruf. Dans notre théâtre, des comédiennes et des acteurs d’une vingtaine d’années travaillent avec des comédiens et des actrices de plus de 80 ans. Le réveil est mutuel, constant, condition d’une évolution permanente des pratiques et des pensées. » S’il dit les alexandrins à sa manière, Birane Ba sait que sa génération forme désormais la richesse et la diversité du théâtre. Il incarne avec brio la devise de la Comédie-Française – « Simul et Singulis », être ensemble et être soi-même. D’abord impressionné, Birane réalise que les autres comédiens aussi veulent s’amuser : « Chacun à son poste, on s’envoie des passes et on joue. On forme une équipe : si quelqu’un trébuche, on va l’aider. Et pour marquer, il faut rendre le public heureux ». Photo de Birane Ba © Stéphane Lavoué

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 21, 2021 9:44 AM
|
Christophe Rauck a donc fait ses adieux au Théâtre du Nord en tant que directeur – il dirige le lieu et l’École professionnelle supérieure d’art dramatique depuis 2014 et part pour les Amandiers de Nanterre – avec une adaptation de la pièce de Sara Stridsberg sur la reine Christine de Suède (1626-1689). Avant de tourner à l’automne prochain, cette sublime mise en scène a joué les 16, 17 et 18 mars à 15h pour un public de professionnels et d’étudiants. Nous y étions et vous en rapportons quelques fragments de flocons… Il y a beaucoup de vie sous une petite pluie fine devant le Théâtre du Nord lorsque nous y arrivons mardi 16 mars dans l’après-midi. Le Théâtre est en état de siège d’autant plus affirmatif, paisible et joyeux que les étudiants passent des examens et jouent pour leurs professeurs. Au même moment, le directeur qui a tellement marqué le lieu propose pour un public de professionnels sa dernière création à ce poste : la pièce de la plus jeune membre jamais élue à l’académie du prix Nobel, l’auteure suédoise Sara Stridsberg. Caustique, féministe et complexe, son univers saisit et fait froid dans le dos, qu’il s’agisse de brosser le portrait de Valérie Solanas (lire notre critique du roman La fabrique des rêves, ici et son adaptation scénique, là) ou pour brosser le portrait de la figure forte féminine de la cour de Suède immortalisée par Greta Garbo dans le film éponyme de Rouben Mamoulian (1933). La reine Christine donc, s’est retrouvée en 1632 seule héritière de son père Gustav II Adolphe, tué à la guerre à l’âge de 6 ans. En l’absence d’héritier mâle, c’est elle qui règne. On la saisit au moment où elle passe à l’âge adulte et au moment du couronnement, isolée, sa mère partie vivre dans des contrées plus ensoleillée, et bataillant pour ne PAS se marier et surtout ne pas donner au royaume un héritier mâle. Cette reine rebelle était connue pour s’habiller en homme, aimer chasser et philosopher et refuser toutes les conventions. Sara Stridsberg la dépeint comme un monstre froid, manipulant les autres par perte d’elle-même, et refus d’une condition féminine terminant forcément par la mort en couches. Froid, c’est ce que le public ressent immédiatement ; le froid beau et scintillant de la neige, sur une scène noire cendre, avec dessus un grand bocal de lumière et de plumes blanches où évolue l’héroïne. Étonnamment, elle porte une vraie robe de princesse, soyeuse, vieux rose et à corset. Et pourtant le texte nous la présente toujours comme Roi/Reine, refusant d’épouser le veule et mou (mais gentil et aimant love) pour préférer le corps mince de sa suivante, Belle. De temps en temps, elle sort de sa cage enneigée pour discuter avec le fantôme ensanglanté de son père, où sortir de sa boîte « le philosophe » qui pose toutes sortes de questions de genre et dont elle finit par se séparer quand la leçon sur les destins des princesses de Suède est lumineuse pour tous… Le texte est cru et parle de genre avec quelque chose qui oscille entre le classicisme d’un théâtre psychologique ou de l’absurde, et l’aspect très contemporain d’un féminisme à la fois affirmé et complexe. La mise en scène est d’autant plus glaçante qu’elle est féérique et Christophe Rauck arrive génialement à nous mettre mal à l’aise avec une beauté presque aussi pure qu’un flocon de neige (musique de Bach, scénographie à couper le souffle de Alain Lagarde, et lumières divines de Olivier Oudiou). En Fille du Roi – Reine Christine – Roi-Reine, Marie-Sophie Ferdane livre une performance d’actrice époustouflante : effrayante, fragile, habitée, perdue, elle campe parfaitement la lutte avec l’animalité et le destin de son personnage qui demeure malgré tout l’archétype d’une femme fatale… Autour d’elle, les autres comédiens s’activent entre grâce et grincement comme des allégories baroques menaçantes du pouvoir, de l’amour, de la mort et de la sagesse. Le tout forme une ronde qui nous encercle et sait nous charmer et nous terroriser à la fois. Dissection d’une chute de neige est une tragédie indémodable qui nous saisit avec violence et clarté. À voir les 18 et 19 novembre prochains à la Comédie de Caen, du 25 novembre au 18 décembre au Théâtre des Amandiers et puis à Angers, Villeurbanne et Lorient. Captation sur France Culture , le 25 avril à 20h, dans l’émission Fictions/ Théâtre et Cie. Dissection d’une chute de neige, de Sara Stridsberg, mise en scène : Christophe Rauck, avec Thierry Bosc, Murielle Colvez, Habib Dembélé, Marie-Sophie Ferdane, Carine Goron, Christophe Grégoire, Emmanuel Noblet, 2h10. Visuels : © Simon Gosselin Yaël Hirsch Co-responsable de la rédaction, Yaël est journaliste (carte de presse n° 116976), docteure en sciences-politiques, chargée de cours à Sciences-Po Paris dont elle est diplômée et titulaire d’un DEA en littérature comparée à la Sorbonne. Elle écrit dans toutes les rubriques, avec un fort accent sur les livres et les expositions. Contact : yael@toutelaculture.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 20, 2021 7:53 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 19 mars 2021
Sous le titre « Le feu, la fumée, le soufre », Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin ont - fidèlement et librement - adapté « Édouard II » de Christopher Marlowe. Geslin signe seul la mise en scène et la scénographie. Claude Degliame habite le rôle-titre mais il faudrait citer toute la troupe de cette sombre, sensuelle et sanglante fête théâtrale.
Au titre de sa pièce Édouard II, Christopher Marlowe avait ajouté un long sous-titre : « ou le règne trouble de la mort pitoyable d’Édouard II, roi d’Angleterre, et la chute tragique de l’orgueilleux Mortimer ». Bruno Geslin et Jean-Michel Rabeux donnent comme titre à leur traduction et adaptation Le feu, la fumée , le soufre. Tout en gardant le long sous-titre dont ils suivent l’ordonnance : le spectacle commence par la mort cruelle du roi Édouard II, empalé sur un brûlant tison d’argent sur ordre de Mortimer lequel pensait bien régner en devenant le précepteur du nouveau et très jeune roi, Édouard III, mais ce dernier ordonnera à la toute fin de la pièce la décapitation de « l’orgueilleux Mortimer » et enverra sa mère à la tour de Londres. Tout naît de la nuit A force d’être délaissée par son mari le roi Edouard II qui n’a d’yeux que pour un jeune homme d’origine française nommé Gaveston, la reine Isabelle avait fini par se jeter dans les bras de l’épris Mortimer et d’être passivement complice de son forfait. La mort violente ouvre et ferme le ban de ce spectacle sombre, flamboyant de noirceurs où tout n’est qu’intrigues et trahisons dans un monde en décomposition, comme incendié. Le trône n’est plus qu’un vieux fauteuil qui suit le popotin du king comme son ombre. Dans un paysage déglingué fait de pieux calcinés, d’échafaudage d’on ne sait quoi et d’un ponton en bois, seuls éléments à peu près stables qui tiendront lieu de refuge, d’observatoire, de tribune, de cache précaire, Bruno Geslin qui signe seul la mise en scène, est aussi celui qui a conçu cette scénographie éclatée et faiblement éclairée à dessein. Tout naît de la nuit, celle des corps désirants, celles des rêves et rancœurs inassouvis et d’abord celle des cauchemars qui se poursuivent après le réveil dans la vie même. Cependant, dans cette grande pièce élisabéthaine, nous sommes au théâtre comme il se doit et jusqu’au trognon : cette scénographie est d’abord une formidable machine à jouer. C’est une pièce pleine de barons, d' ecclésiastiques, de serviteurs zélés et de seconds couteaux pas toujours sûrs : rien que des hommes. Seule femme (dans la pièce il existe un autre rôle féminin, mineur, il a été supprimé dans l’adaptation ): la reine Isabelle (fille du roi de France). Le rôle est interprété par un acteur comme c’était l’usage au temps de Marlowe, Olivier Normand qui chante également merveilleusement et le prouve. Il était dans la distribution de Chroma de Derek Jarman (qui a adapté Édouard II au cinéma et plane comme une ombre amie sur le spectacle) mis en scène par Bruno Geslin (lire ici). A l’inverse, le roi Édouard II est tenu par une femme, la grande Claude Degliame,avec une dignité hiératique qui ne tient qu’à un fil, celui de la vie de son personnage qui finira cassé dans une brouette avant l’issue fatale. Degliame est complice, on le sait, de bien des spectacles de Jean-Michel Rabeux. Une autre actrice, la jeune et talentueuse Alysée Soudet que l’on a pu voir dans Angélus Novus, Anti Faust de Sylvain Creuzevault (lire ici) et dans Crime et châtiment mis en scène par Nicolas Oton ( lire ici) tient le rôle de Gaveston, le « mignon » dont est follement épris le roi, puis celui du fils de ce dernier, le jeune prince et bientôt roi Édouard III. Elle donne à ces ces personnages une dense animalité. Trente rôles pour dix Les autre rôles sont tenus et bien tenus, par de bons comédiens, tous ou presque jouent plusieurs rôles (dix acteurs et actrices pour une trentaine de rôles). Bruno Geslin a eu mille fois raison de confier le rôle de Mortimer à Arnaud Gélis, acteur phare de la troupe permanente de Bulle Bleue à Montpellier, avec laquelle, pendant trois ans, Geslin a mené un projet Fassbinder (lire ici et ici) avec Jacques Allaire et Evelyne Didi. Citons les autres barons et contes « notables gras du bide, châtrons bouffis d’orgueil » comme leur lance Gaveston dans l’adaptation plutôt libre de Geslin-Rabeux : Julien Ferranti (Kent), Jacques Allaire (Lancastre), Lionel Codino (Warwick), sans oublier l’étonnant Luc Tremblais (l’Archevèque), tous engoncés dans leur prétention et les costumes enveloppants signés Hannah Sjödin. Citons et saluons enfin le travail musical de Benjamin Garnier et Alexandre Le Hong (« Mont analogue ») et les lumières subtiles de Dominique Borrini.
Bien que marié à la fille du roi de France, le roi Édouard délaisse son épouse et ses responsabilités à la tête du pays, amoureux qu’il est du jeune Gaveston, auquel il donne titres et provinces à tour de bras et se fout de savoir que les Français ont envahi la Normandie. Bref, le royaume d’Angleterre manque de gouvernance et de clairvoyance, les barons s’affolent, s’arrangent pour bannir le mignon mais ce dernier, très riche, risque de lever des troupes, on le rappelle, il revient et les barons finissent par faire ce qu’ils n’avaient pas penser à faire plus tôt : ils le tuent. Dès lors la machine à trucider va tourner à plein régime, broyant le roi, les barons, Mortimer et d’autres au fil de bien des péripéties, de chasses à l’homme et de coups fourrés,. Pas un roi, pas un baron, pour rattraper l’autre: à chacun sa monstruosité. Outre le renversement narratif évoqué plus haut (la fin placée au début), l’adaptation a musclé bien des répliques en les raccourcissant et coupé nombre de fins de scène avec le même objectif. Bruno Geslin et Jean-Michel Rabeux ont aussi mêle leur plume à celle de Marlowe, en particulier en renforçant la partition de Gaveston et, par là même, en recentrant le sous-bassement homosexuel de la pièce. Ainsi, on entend Gaveston dire à haute voix son testament et son adieu au monde (rien de tel chez Marlowe) juste avant de mourir sous nos yeux à coups de pelle alors que chez Marlowe on fait seulement et brièvement le récit de cette exécution (sans pelles). Mieux, dans l’adaptation, bien que mort, Gaveston parle encore : « Dieu, que les arbres sont beaux ! Et la mer ! Par l’Enfer, par Belzébuth ! Lucifer ! Maledicat domenus. Que Dieu soit maudit ! Bon d’iou que j’ai froid » , finissant par « Tout brûle ! L’enfer est bleu comme un orage, c’est si beau ». Alors, exténué, Gaveston s allonge et un sanglier vient renifler son corps . Extraordinaire moment .Plus tard la reine Isabelle, proposera à son fils devenu le très jeune Édouard III (rôle tenu par l’actrice qui interprète Gaveston) d’aller « chasser la biche dans le parc ». « Non, le sanglier » répondra Édouard III. Il est d’autres ajouts judicieux comme cette litanie des pairs exécutés lue par Spencer. Ou ces derniers mots de la pièce prononcés par Édouard III alors qu’il vient de condamner sa mère : « N’enfante pas. Édouard ! N’enfante pas !». S’adresse-il à son défunt père ou à lui-même ? ! Belle ambiguïté. Comme l’affiche du spectacle, la mise en scène exalte le beauté des corps d’hommes, jeunes et nus et, parallèlement use à répétition du mot « couilles » qui passe de bouche en bouche, en particulier celles du roi et de Lancastre. Par exemple le roi: « vous complotez, barons de mes couilles »; et Lancastre: « nous le [Gaveston] traînerons par les couilles jusqu’au billot » (Marlowe se contente des oreilles). Etc. Arrêtons-nous là. Vous l’aurez compris, Le feu, la fumée, le soufre d’une sombre splendeur est aussi un spectacle diablement couillu. Spectacle vu en janvier au Théâtredelacité de Toulouse devant un public restreint de professionnels et de journalistes. Il devait être créé dans ce théâtre du 12 au 14 janvier puis partir en tournée jusqu’à la fin de la saison: le 28 janv au Parvis, scène nationale de Tarbes, les 9 et 10 fév à l’Archipel, scène nationale de Perpignan, les 17 et 18 fév à la Comédie de Caen, les 24 et 25 fév à l’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle, du 9 au 11 mars au Tandem, scène nationale d’Arras-Douai. Toutes ces représentations ont dû être annulées Les 30 mars au 1er avril au Théâtre de Nîmes se tiendront deux représentations "professionnelles "(réservées aux programmateurs et aux journalistes). La présence du spectacle en juin au Printemps des comédiens de Montpellier est annulée pour cette année. Légende photo : Claude Degliame dans le rôle d'Edouard II © Gilles Vidal
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2021 4:37 PM
|
TRIBUNE par Un collectif de personnalités du théâtre Quartiers d’Ivry, Théâtre du Nord, Nanterre Amandiers, Comédie de Saint-Etienne et Comédie de Béthune : les nouvelles directions sont masculines. Le gouvernement réaffirme son conservatisme en écartant les artistes femmes de la direction des lieux culturels publics. Alors que les théâtres occupés crient la détresse des scarifié⋅es de la crise sanitaire à l’oreille d’un gouvernement sourd, à trois mois des élections régionales et départementales, les nominations à la tête des centres dramatiques nationaux (CDN) pleuvent. La seule femme aux commandes dans ce jeu de chaises musicales semble être la ministre elle-même : aux Quartiers d’Ivry, au Théâtre du Nord, à Nanterre Amandiers, au Théâtre 14, à la Comédie de Saint-Etienne, à la Comédie de Béthune… Un cortège d’hommes succèdent à des hommes ou s’interchangent, sans aucune surprise. De rares femmes passent entre les mailles du filet, à l’image de la metteuse en scène Julie Deliquet, au Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis depuis mars 2020. A la tête des directions régionales aux affaires culturelles (Drac), quatre femmes sont aussi nommées, chargées de révéler, promouvoir, subventionner des talents… essentiellement masculins, à en croire les chiffres de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture. Des femmes seront donc mises dans l’ombre au service d’hommes dans la lumière. Les stéréotypes, dans les milieux de l’art, ont des dents de fer, ils broient l’espoir de laisser émerger d’immenses talents relégués à leur genre. Les chiffres sont têtus, et nous ne pouvons rester muettes, quand seuls 33% des établissements culturels et 16% des centres chorégraphiques nationaux (CCN) sont dirigés par des femmes, quand 69% des subventions de l’Etat aux œuvres de théâtre vont à des hommes. A la tête des 100 plus grandes entreprises culturelles : 91 hommes et neuf femmes en 2020, plus bas qu’en 2019, 2018, 2017… Et à la direction des dix plus hauts lieux du spectacle vivant : une femme en 2020… contre deux en 2019 (1). Les instances de consécrations répliquent le tropisme : Ariane Mnouchkine est l’exception du Molière de la mise en scène depuis 2010 [avec Mathilda May, récipiendaire en 2019, ndlr]. Tonie Marshall a été la première et demeure la seule réalisatrice à avoir obtenu un césar, et Jane Campion l’unique primée de la palme d’or dans l’histoire du festival de Cannes, en 1993. Des intruses et des exceptions Des voix s’élèvent pourtant pour renverser l’ordre établi. L’association HF œuvre depuis 2009 à promouvoir l’égalité homme/femme dans la culture et l’art, mais reçoit en retour des déclarations de principes suivies de peu d’effets. Faut-il donc, encore, rappeler combien de fois, nous, metteuses en scène, réalisatrices, compositrices, nous sommes senties intruses ou au mieux exceptionnelles, dans des milieux où seuls des hommes paraissent avoir accès à la légitimation et la consécration ? Est-il nécessaire de se remémorer combien d’autrices ont vu reléguer l’originalité de leurs textes à la «faiblesse» du sexe ? A combien de comédiennes, conquérantes, fortes, audacieuses a-t-on confiné le talent au seul critère de l’âge, d’une peau habile à prendre la lumière, ou trop sombre pour incarner une jeune première ? L’art ni le talent ne peuvent tolérer d’être assignés à résidence, mais en souffrent aujourd’hui, doublement : la crise sanitaire en étouffe l’expression, tandis que le gouvernement réaffirme son conservatisme en écartant les artistes femmes de la direction des lieux culturels publics. Plusieurs hommes parmi les nommés sont tout aussi doués que les candidates. La voix de ces hommes devrait, aujourd’hui, s’élever plus haut que leurs intérêts. On dresse, impatientes, l’oreille à ceux qui auront le courage de parler et d’agir avec nous, au nom de l’art. Equilibrer la représentation d’artistes femmes et hommes à la direction des lieux culturels, c’est légitimer le travail et le talent d’artistes candidates. C’est cesser de considérer les femmes artistes au mieux comme des exceptions, au pire, comme des intruses. C’est démocratiser la culture et diversifier les publics, par l’opportunité de programmations singulièrement à l’écoute de jeunes talents féminins et divers. Que défendront les élu·es demain ? Les petits intérêts entre amis ou le rayonnement culturel de notre pays ? Que souhaitons-nous, collectivement, citoyen·nes, acteur·rices publiques, artistes ? L’inertie de la création, là où tournent partout les mêmes noms, ou un renouveau des formes artistiques et des acteur·rices culturel·les ? Nous demandons aux futur·es élu·es régionaux et départementaux de mettre en œuvre les principes affirmés mais peu appliqués de l’Etat. Ils en ont les outils, en premier lieu démocratiques : Publier des statistiques sexuées sur toutes les structures culturelles locales qui distribuent et reçoivent l’argent public ; soumettre l’attribution de subventions aux associations culturelles à des délibérations collégiales et attentives au respect de la parité ; se soucier d’abord et avant tout de récompenser le talent au lieu de promouvoir les réseaux ; valoriser le matrimoine afin d’offrir des modèles d’identification mixtes et équilibrés. Il est temps de considérer l’artiste avant la femme, de reconnaître le talent avant de préjuger du sexe. En 2021, il est urgent de faire respirer nos œuvres et d’entendre nos voix, d’écrire l’histoire de l’art avec celles qui n’en sont pas que les muses ou les sacrifiées, mais les pionnières. Premières signataires : Diane Chavelet, autrice, chercheuse, metteuse en scène Catherine Boskowitz, metteuse en scène, plasticienne, comédienne Anne Monfort, metteuse en scène Leyla-Claire Rabih, metteuse en scène Soutenues par : Hakim Bah, auteur, metteur en scène Nicolas Bouchaud, acteur, metteur en scène Paul Balagué, metteur en scène Caroline Marcilhac, directrice de Théâtre Ouvert Elise Vigier, comédienne, metteuse en scène Gérard Watkins, auteur, metteur en scène, comédien Dieudonné Niangouna, auteur, metteur en scène, comédien Anne Théron, autrice, metteuse en scène, réalisatrice Célie Pauthe, metteuse en scène, directrice du CDN de Besançon-Franche-Comté Stanislas Nordey, metteur en scène, directeur du Théâtre national de Strasbourg Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie Julie Deliquet, metteuse en scène et directrice du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis Alban Richard, chorégraphe, directeur du centre chorégraphique national de Caen en Normandie Cédric Gourmelon, metteur en scène, futur directeur de la Comédie de Béthune Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue, chercheuse, ENS Paris-Saclay Julie Desmidt et Bertrand Krill, coprésident⋅es de l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles Liste complète des signataires (1) Tous ces chiffres sont ceux de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, rendus publics le 7 mars 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2021 5:12 PM
|
26 MARS 2021 | PAR ANAËLLE PADÉ dans Toutelaculture.com
Malgré les difficultés actuelles rencontrées par le monde du spectacle, La ménagerie de Verre demeure un lieu de vie, d’expérimentation, de création pour les artistes. Le festival « Etrange Cargo » en est la preuve. Ce mercredi 24 mars, à 15h, il accueillait la création de Yuming Hey et Mathieu Touzé.
La réunion de deux talents Ces deux artistes qui se sont rencontrés lors de leurs études théâtrales à l’Ecole Départementale de Théâtre de l’Essonne ont fondé ensemble le collectif Rêve Concret. Bien qu’ils poursuivent des projets différents – Mathieu Touzé prend la direction du Théâtre 14 et Yuming Hey sort du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – ils se réunissent cette année autour du texte Que font les rennes après Noël ? d’Olivia Rosenthal dans une création intitulée Une absence de silence. Un spectacle scindé en deux tableaux Le metteur en scène, Mathieu Touzé, dit que « La rencontre au plateau du texte d’Olivia Rosenthal et de la danse raconte cette reconquête de soi et du monde. » La reconquête dont il est question dans ce spectacle est celle de notre intuition, de notre instinct, aliénés par la domestication dont nous sommes victimes et que nous infligeons aux animaux. La dichotomie entre corps et esprit, instinct et raison, humanité et animalité est présente tout au long du texte, « Votre corps et votre esprit vivent deux vies parallèles », « Le désir d’humanité est équivalent au désir d’humanité », et se retrouve également dans la mise en scène grâce à deux tableaux, deux mouvements qui illustrent cette opposition. Un premier mouvement : la part d’animalité Il faut saluer l’ouverture de ce spectacle, ce premier tableau fascinant et dérangeant qui étire le temps, qui fait redécouvrir la potentialité bestiale de notre corps. Il n’y a aucune parole. Les danseurs, Laura Desideri, Jeanne Alechinsky, Yacouba Sissouko, Yanou Ninja, Zion Garçon, Marlon Valmary et l’interprète du texte, Yuming Hey, pénètrent dans la salle obscurcie. Ils avancent à quatre pattes, reproduisent avec grande justesse le comportement, les déplacements, l’attitude d’une meute de lions. C’est impressionnant ! La souplesse de leurs corps, la cambrure de leur dos dénaturent la démarche de l’homme civilisé qui se veut rigide, droite, bipède. Ils sont simplement vêtus de sous-vêtements noirs. Peu à peu, Yuming Hey se relève, il est rejoint par les autres danseurs, ils avancent lentement dans marche hypnotique. Le mariage comme symbole de la domestication C’est dans ce deuxième mouvement que le travail des costumes réalisés par Estelle Deniaud – qui s’est occupée aussi de la scénographie – sera le plus mis en valeur. Dans ce passage, la domestication est associée au mariage. Nous assistons à un mariage qui se joue des codes de la cérémonie. Le blanc est de mise mais la sobriété de la robe, son élégance est remplacée par une forme bien plus excentrique : mini-jupe ornée de plumes, chaussures à talons avec paillettes, corsets, cuissardes, … Les danseurs, qui incarnent les invités de cette cérémonie débridée, traversent le plateau avec la démarche assurée et marquée des défilés de mode, les uns à la suite des autres. Ils font « le show » avec des danses qui mêlent le contemporain et le voguing. Cependant, la superficialité des vêtements et des attitudes sera vite balayée au profit d’un retour à l’état de nature. Ils laissent tomber leurs fioritures à terre, redonnent à leur corps une nudité propre à l’état sauvage. Une mise en scène qui soutient l’agressivité et la violence du texte La violence du texte est amplifiée par des procédés d’écho : les danseurs forment un chœur anarchique, murmurant et chuchotant des bribes de phrases. De plus, les effets sonores reprennent certaines phrases percutantes. C’est aussi l’interprétation de Yuming Hey qui donne un ton particulier au texte en le mêlant à des rires moqueurs et inquiétants, en accélérant le rythme de sa parole au cours de certaines digressions ou en créant un effet de contraste entre la lenteur de son corps et le débit ininterrompu de sa parole. Les moments de pause tendent à valoriser le texte. Après une lente traversée du plateau, Yuming Hey offre son visage dur et inquiétant au public, une larme coule sur sa joue et trahit son humanité. Le texte, par son adresse constante au spectateur avec l’utilisation du « vous », provoque une sensation d’inconfort qui, par l’interprétation de l’acteur, est intensifiée. Une création visuelle de Justine Emard fait office de transition entre ces deux tableaux. Sur des rideaux blancs sont projetés une pléthore de vidéos imbriquant des sujets divers : actualité, publicité, vidéos amateurs, extraits de films, clips musicaux… Les images se succèdent, défilent à toute vitesse, forment un kaléidoscope de ce qui constitue l’humanité. Le sensation de malaise est encore renforcée par ce vertige face à cette déferlante de contenus et par la voix de Yuming Hey qui ne cesse de marteler « Vous avez peur » Un écho à l’imaginaire de la SF Au début du spectacle, des ombres pénètrent dans l’obscurité, la fumée opacifie les corps et les rend indistincts. Les contours sont flous, on est presque effrayé de les voir s’approcher de nous, peupler le plateau. La particularité de la scène – une grande profondeur de champ et un plafond très bas – alimentent cette ambiance anxiogène. Le plateau est plongé dans la brume. On pourrait penser que ce sont des insectes, de grandes araignées qui envahissent le plateau. Cette image rappelle le film Premier Contact de Denis Villeneuve dans lequel les extraterrestres sont représentés par des êtres mystérieux dont la forme nous est inconnue. Est-ce un hasard si l’image qui clôture ce spectacle procure la même sensation de fascination et de mystère propre à la SF ? Les corps des acteurs, marchant au ralenti, sont dos au public et se dirigent vers une lumière aveuglante et blanche, qui découpent leurs silhouettes en des ombres énigmatiques. La création « Une absence de silence » est dotée d’une véritable richesse visuelle. Les contrastes, qui se retrouvent à la fois dans les corps et dans la mise en scène, prolongent le discours du texte par des procédés scéniques et théâtraux. Tantôt les corps sont rigides, leur déplacements robotiques, tantôt ils sont fluides et libérés. On passe d’une obscurité mystérieuse à une lumière aveuglante, d’un son indistinct et sourd à une musique techno et rythmée. Seul le texte traverse toutes ces fluctuations dans une tonalité hachée, parfois accélérée, mais qui participe, encore, à la dimension hypnotique et mystérieuse de la mise en scène. Anaëlle Padé / Toutelaculture.com Visuel :© Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2021 2:21 PM
|
Par Simon Gourru dans Le Parisien - 60 / 25-03-21 Fermée depuis plusieurs mois à cause de la crise sanitaire, la Faïencerie veut garder le lien avec son public. Elle enregistre actuellement ses spectateurs pour un projet de création sonore sur le thème de l’attente. Le 25 mars 2021 à 16h10 C'est un confinement qui dure depuis plus d'un an pour le théâtre de la Faïencerie. Privées de leur public, lasses de ne communiquer que pour des reports et des annulations, les équipes de la structure ont voulu rebondir autrement avec « En attente », un projet de création sonore dans lequel les spectateurs sont au premier rang. Vingt entretiens réalisés avec un panel de spectateurs du théâtre sur le thème de l'attente qui, une fois montés par Cathy Blisson, l'artiste en charge du projet, seront diffusés via un canal qui reste encore à définir. Jusqu'au 31 mars, des anonymes piochés dans le vivier des fidèles de la Faïencerie se succéderont pour prendre la parole face à un micro installé dans la loge des artistes. «Plus le temps passe, plus le lien se distend» « Nous intervenons encore dans les écoles, les associations ou les centres pénitentiaires mais nous sommes coupés du public, regrette-t-on à la Faïencerie. Plus le temps passe, plus le lien se distend. Alors, nous avons voulu savoir comment ils vivaient cette attente, pas forcément par rapport au Covid, mais plus sur le rapport à la culture. » Suivant un protocole de questions précises établi par Cathy Blisson, l'entretien dure une vingtaine de minutes. Une première partie sur l'attente, par exemple la façon dont ces spectateurs appréhendent les quelques heures avant une pièce, une autre où il leur est demandé de s'imaginer dans un théâtre vide et de trouver comment il occuperait le lieu. « Le but est qu'ils puissent se projeter dans des situations réelles ou imaginaires, détaille l'artiste. Une partie de l'équipe sera également interviewée pour croiser les paroles et recréer un lien humain coupé depuis plusieurs mois. » «On partage des moments forts avec des personnes que l'on ne connaît pas» Une plongée dans l'intimité du spectateur qui dévoile sa relation au théâtre. « On partage des moments forts avec des personnes que l'on ne connaît pas, apprécient les équipes du théâtre. Comme ce monsieur qui attend avec impatience que les lumières s'éteignent pour vivre les quelques instants qui le séparent du début de la pièce. Ou cette dame qui attend toujours que les applaudissements commencent avant de suivre le mouvement. » Jenifer, elle, est plutôt du genre impatiente. « C'est stressant d'attendre, à chaque fois je n'ai qu'une envie, que ça commence », lâche cette Creilloise de 28 ans qui participait, ce mardi, à l'expérience. Habituée des lieux, elle a accepté tout de suite de prêter sa voix au projet. « Je ne me rappelle même plus la dernière fois que je suis venue, souffle-t-elle. Et ça me manque, comme tout ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2021 7:49 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération publié le 25 mars 2021 Six étudiantes en écoles d’art dramatique vont défendre, ce jeudi, les revendications de leurs pairs auprès du ministère. Si leurs demandes sont proches de celles des syndicats, elles tiennent à porter la voix de la jeunesse dans cette crise, qui a permis de développer une convergence des luttes et de rompre leur isolement. Donc, elles seront six étudiantes, représentantes de différentes écoles d’art dramatique publiques et privées, et de toutes disciplines – jeux, mise en scène, dramaturgie, danse, musique – à porter non seulement les revendications, mais aussi des idées de sortie de crise au ministère de la Culture, cet après-midi. C’est Roselyne Bachelot qui aurait dû recevoir la délégation, mais elle passera la main à deux membres de son cabinet, Hélène Orain, adjointe au directeur général à la création artistique, et Noël Corbin, délégué général au territoire, à la transmission et à la démocratie culturelle. Six étudiantes qui «occupent» aujourd’hui des théâtres de Besançon à Paris, en passant par Strasbourg ou Lyon. Des jeunes femmes, car ils et elles ont remarqué que pour l’instant la parole est majoritairement portée par des hommes. Et sous l’égide d’aucun syndicat. «Puits sans fond d’invisibilité» «On tient à notre spécificité étudiante», explique Coline, élève dans un conservatoire d’arrondissement, qui «occupe» le théâtre de la Colline à Paris depuis une dizaine de jours. «On est peut-être des électrons libres, mais c’est aussi notre force. On n’a pas l’habitude du combat politique, on commet des erreurs mais on préfère que ce soit les nôtres.» Pour autant, leurs revendications ne sont pas diamétralement différentes de celles présentées par la CGT spectacle. Celles qui portent sur la jeunesse sont simplement plus détaillées. Coline en fait l’inventaire : «Le secteur culturel est archi embouteillé et les programmations de toutes les scènes bondées durant les années qui viennent. Du coup, on réfléchit à comment on pourrait être accompagnés pour ne pas sombrer dans un puits sans fond d’invisibilité.» L’une des solutions, que proposeront les étudiants, est que tous les théâtres subventionnés aient l’obligation de constituer des mini-troupes de comédiens, scénographes et metteurs en scène, composées de jeunes gens fraîchement sorties des écoles, ce que font déjà d’ailleurs, comme on le fait remarquer, le Centre dramatique national de Tours, et celui de Toulouse et de Dijon. «Mais ils ne sont vraiment pas nombreux ! On aimerait que ce soit généralisé à toute la France. Et qu’un pourcentage des subventions soit sanctuarisé pour la jeunesse. C’est impossible aujourd’hui de porter un projet s’il n’est pas soutenu par nos pairs, un festival ou une scène.» Autres nécessités : que tous les élèves en art dramatique aient le même statut d’étudiant en bonne et due forme, afin d’avoir accès, le cas échéant à une bourse, à Pôle emploi, etc. Et qu’ils aient, durant les premières années de leur vie professionnelle, un accès facilité au régime de l’intermittence. Il est probable que la tutelle lâche la bride sur certains points. Mais est-ce suffisant ? «Non, répond sans hésiter Coline, car nous aussi, nous demandons l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage qui va accroître encore le nombre des précaires, la prolongation de l’année blanche pour les intermittents, et bien sûr l’ouverture des lieux culturels.» Elle réfléchit : «Mais nous ne hiérarchisons pas nos demandes. Car tout se tient.» «Chacun doit pouvoir prendre la parole» Coline explique que le mouvement étudiant s’est élargi petit à petit vers une convergence des luttes. Les premiers jours de l’occupation, ils étaient partis de leur difficulté au quotidien, de ce qu’implique la rivalité des écoles, et du bonheur inédit de se retrouver sans que ces appartenances ne créent de tension. Dans ce métier où la rivalité n’est pas un vain mot, tout d’un coup, «on s’est découvert ensemble». Avant d’être «occupante», Coline a participé aux petits rassemblements sur le parvis de la Colline. Le troisième soir, elle avait son sac de couchage et elle est restée à l’intérieur. Le groupe ne dépasse jamais trente personnes, en roulement «car on n’a pas envie d’être la voix de trente personnes, mais cela implique une remise à niveau pour chaque nouvel entrant» et chacun se fait tester tous les deux jours pour éviter de transformer le théâtre à cluster. Depuis le début, les étudiants de la Colline – appelons-les ainsi – car de fait, ils prennent des cours accélérés sur le fonctionnement des institutions culturelles, organisent des assemblées générales d’au minimum quatre heures car «chacun doit pouvoir prendre la parole». Toutes les décisions – revendications comprises – sont votées et acceptées et à la majorité. Les scènes occupées par les étudiants se relient par zoom et votent également entre elles les décisions prises dès lors qu’elles ont un impact national. Impossible de décrocher, le sommeil est rare, «à propos des revendications, par exemple, on n’a jamais fini d’en parler avant 3 heures du matin». Tandis qu’à 7 heures, le théâtre s’éveille avec l’arrivée, non du livreur de lait, mais des équipes de sécurité. Le mot même «occupation» lui semble impropre : «L’équipe de la Colline nous a ouvert le théâtre en nous disant : ”Vous êtes ici chez vous, mais n’hésitez pas à nous solliciter.” Elle nous donne accès à deux douches, et à du matériel – une grosse enceinte, des imprimantes, des prises, des livres. Des petites choses mais tellement importantes !» Depuis l’épidémie de Covid, Coline a eu cours durant seulement deux mois et la jeune fille n’avait aucun contact avec ses pairs des autres écoles. Elle est épuisée mais heureuse d’avoir rompu avec l’isolement. L’extraordinaire a lieu : «On sait que, même si on ne se revoit plus jamais, on appartiendra toute notre vie à cette génération qui aura vécu avec ces convictions et ces rêves. Les écoles sont en constante compétition, les concours mettent une pression terrible entre les élèves. Et tout d’un coup, ça n’a plus aucune espèce d’importance.» Une chose plus «essentielle» les soude. isolement. Légende photo : Des étudiants en art dramatique devant le Théâtre de la Colline lors de son occupation, le 9 mars. (Thomas Coex/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2021 9:50 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 25/03/21 Olivier Py a présenté, mercredi 24 mars, les spectacles qui composeraient le « in », prévu pour se tenir du 5 au 25 juillet dans la Cité des papes. Une édition de haute tenue et internationale, en dépit du contexte de crise sanitaire.
« On y croit ! » : c’est le message principal envoyé par Olivier Py, ainsi que par toutes les tutelles, mercredi 24 mars, lors de l’annonce du programme du 75e Festival d’Avignon, prévu pour se dérouler du 5 au 25 juillet. On a d’autant plus envie d’y croire que le programme dévoilé par le directeur du festival est de haute tenue, sans en rabattre, malgré le contexte sanitaire, sur l’exigence artistique ni sur la dimension internationale de la manifestation créée par Jean Vilar en 1947. L’ouverture de cette édition résolument féminine, féministe et diverse, dont le thème est « Se souvenir de l’avenir », a été confiée à deux femmes puissantes. Isabelle Huppert fera son grand retour dans la Cour d’honneur du Palais des papes, en jouant dans La Cerisaie, de Tchekhov, sous la direction du Portugais Tiago Rodrigues. La metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy proposera Entre chien et loup, création inspirée par Dogville (2003), de Lars von Trier. Du côté des grands artistes étrangers, on retrouvera également l’Espagnole Angélica Liddell, avec L’odeur du sang ne me quitte pas des yeux ; la Sicilienne Emma Dante, avec deux créations, Misericordia et Pupo di zucchero ; le Sud-Africain Brett Bailey, avec Samson ; les Belges Anne-Cécile Vandalem, avec Kingdom, et du groupe FC Bergman, avec The Sheep Song ; le Hongrois Kornel Mundruczo, avec Une femme en pièces. Diversité Moins connus, et donc à découvrir, le Rwandais Dorcy Rugamba et le Sénégalais Felwine Sarr s’associent pour proposer Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir, d’après René Char et Frantz Fanon. Le jeune Palestinien Bashar Murkus doit venir de Haïfa avec une proposition intitulée Le Musée. Le Grec Pantelis Dentakis mêle vidéo et marionnettes miniatures pour adapter La Petite Fille dans la forêt profonde (2008), de Philippe Minyana. Une même diversité se retrouve chez les Français. Caroline Guiela Nguyen est conviée avec Fraternité, conte fantastique, premier volet d’un cycle théâtral ; Laëtitia Guédon met en scène Penthésilé.e.s - Amazonomachie, de Marie Dilasser. Le jeune et très doué Baptiste Amann retrouve Avignon, d’où il vient, avec sa trilogie Des territoires. Laurent Gaudé a écrit La Dernière Nuit du monde (Actes Sud, 72 pages, 11 euros), dont s’empare Fabrice Murgia. Eva Doumbia propose Autophagies (Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers)… Nicole Garcia joue Marie NDiaye, dans Royan. La professeure de français (Gallimard, 2020). Lola Lafon et Chloé Dabert se retrouvent autour du Mur invisible (Actes Sud, 1992), fantastique texte de Marlen Haushofer. Victoria Duhamel exhume une opérette oubliée d’Offenbach, Le 66 ! Inclassables On compte aussi un certain nombre d’« indisciplinaires » ou d’inclassables : Théo Mercier avec Outremonde, à la fois une exposition et un spectacle ; Nathalie Béasse, avec Ceux-qui-vont-contre-le-vent ; Mylène Benoit, avec Archée ; Phia Ménard, avec La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) ; Madeleine Louarn et son ensemble Catalyse d’acteurs handicapés, avec Gulliver, le Dernier Voyage. On pourra découvrir une troupe de jeunes gens réunis sous le nom de Nouveau Théâtre populaire, proposant Le Ciel, la Nuit et la Fête, soit Le Tartuffe, Dom Juan et Psyché, de Molière. Désormais incontournables dans la programmation du « in », les spectacles jeune public, le spectacle itinérant, prévu pour tourner dans toute la région, et le feuilleton théâtral sont bien au rendez-vous – un feuilleton dont se charge Olivier Py, avec Hamlet à l’impératif !. La danse est aussi présente dans cette édition qui voit notamment le retour de Maguy Marin, avec Y aller voir de plus près. Sont aussi au menu Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen, avec Lamenta ; la Sud-Africaine Dada Masilo, avec Le Sacrifice ; Jan Martens, avec Any Attempt Will End in Crushed Bodies… ; Dimitris Papaioannou, avec Ink. Enfin, c’est le chorégraphe espagnol Marcos Morau qui a été choisi pour la deuxième création dans la Cour d’honneur, Sonoma. On y croit ! Il y a un an : Coronavirus : le Festival d’Avignon dans l’expectative Fabienne Darge Légende photo : Olivier Py, directeur du Festival, tient la conférence de presse de présentation du programme du 75e Festival d’Avignon, le 24 mars 2021. ARNOLD JEROCKI/DIVERGENCE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2021 5:41 PM
|
Par Nadja Pobel dans Le Petit Bulletin | Mercredi 24 mars 2021 Cirque | L’un des grands projets culturels des prochaines années sur le territoire métropolitain, la Cité Internationale des Arts du Cirque portée par la compagnie MPTA et l’école de cirque de Lyon, devrait, selon toute vraisemblance, s’implanter à Vénissieux — et non à Saint-Genis-Laval comme prévu initialement. Explications.
Le constat est ancien et cruel pour les circassiens de la région : il n'y a pas assez de lieux d'entraînement et de pratique. La France, de manière globale, en manque. Seule La Grainerie à Toulouse répond à cette demande. Un espace d'entraînement dans La Chapelle de La Cascade (en Ardèche), seul Pôle National de Cirque en Auvergne-Rhône-Alpes, est bien prévu — mais les travaux n'ont pas encore commencé. Pire, le confinement a accentué ces besoins car ces artistes sont aussi des athlètes qui ont besoin d'entretenir leurs corps. Le récent festival Circa qui s'est déroulé à Auch à l'automne a vu se multiplier les blessures : les artistes n'ont pu suffisamment s'exercer en amont. Julie Tavert, acrobate formée à Lyon puis passée par le Graal qu'est le CNAC (Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne) dit n'avoir pas du tout su où aller lors des six premiers mois de la crise sanitaire.
L'école de cirque de Lyon implantée dans l'enceinte de la MJC Ménival est elle trop à l'étroit et jongle avec des contraintes anormales à ce niveau d'exigence : « les élèves doivent s'arrêter à 17h pour laisser place aux adhérents de la MJC. Idem le mercredi après-midi. Ils n'ont pas de salle d'entraînement, pas de salle de cours, il y a des problèmes de vestiaires alors que cette formation devrait se faire à plein temps » nous détaille Nadège Cunin, sa directrice. Difficile aussi d'exercer certains agrès, notamment aériens, au point que le ministère de la Culture et la Fédération française des écoles de cirque n'ont prolongé leur agrément que parce que le projet de Cité Internationale des Arts du Cirque est dans les cartons, depuis deux ans maintenant. Cette accumulation de problèmes n'a pas pour autant empêché que les douze élèves de la promotion 2018-2020 ne signent avec brio leur sortie en juin dernier : six ont intégré une école nationale supérieure (trois au Lido, trois au CNAC), un est en année préparatoire de l'académie Fratellini, un autre à l'ESAC de Bruxelles, un s'est orienté vers la musique jazz au CNSMD à Fourvière, deux ont été admis dans la pépinière barcelonaise du Central del Circo pour développer leurs projets professionnels et le douzième élève opte pour un temps de pause et de réflexion quant à la suite. Et septembre dernier, pour les douze places offertes de la toute nouvelle promotion, encore 160 candidats se sont présentés malgré la crise sanitaire. « C'est légèrement moins qu'il y a deux ans car les étudiants hors Union Europénne n'ont pas postulé, faute de visibilité sur leurs déplacements possibles » analyse Nadège Cunin. C'est donc cette école préparatoire (une des neuf du territoire national) qui prendra place dans la future Cité Internationale des Arts du Cirque (l'appellation est provisoire) avec aussi une part réservée aux pratiques amateur. Voici pour la part formation et pratique de ce projet qui comprend encore un volet dédié à la création (un lieu de résidence et de recherche) ainsi qu'un troisième volet lié à un possible tiers-lieu, en fonction de l'implantation, ouvert à d'autres pratiques que la filière cirque comme de l'agriculture urbaine, de l'éducation populaire, du coworking... Direction le Grand Parilly à Vénissieux Portée et pensée par l'école de cirque de Lyon et la compagnie MPTA du trampoliniste Mathurin Bolze (aussi organisatrice du festival utoPistes), cette Cité Internationale des Arts du Cirque a le soutien de la DRAC, de la Métropole, et verra — au moins partiellement — le jour sous la mandature de son président Bruno Bernard. Ce sera très probablement à Vénissieux sur le site du Puisot du projet Grand Parilly, à côté d'Ikéa et de Leroy-Merlin. « Il y a une dernière parcelle qui n'a pas été complément attribuée, dans sa partie nord-est, la plus proche du métro » déclare Cédric Van Styvendael, vice-président en charge de la Culture à la Métropole. Ce n'est cependant pas encore totalement fixé car « d'autres villes ont fait état d'un souhait. La ville de Vénissieux a fait part de son intérêt, mais n'a pas non plus validé définitivement sa réponse ». Mais aucun autre nom de municipalité n'est avancé par le maire de Villeurbanne. Le comité de copilotage du 2 avril devrait permettre d'y voir plus clair. Autour de la table seront réunies les tutelles : DRAC, Métropole, Région et aussi la Ville de Lyon car l'école de cirque est pour l'instant implantée dans la capitale des Gaules — elle fait partie du réseau Scènes Découvertes — et parce que de nombreux équipements culturels de la Ville de Lyon accueillent le festival de cirque utoPistes. Sera aussi abordée le 2 avril la question du montage financier pour la partie investissement « et on va aussi commencer à aborder la question du fonctionnement qui n'est pas neutre ici » précise Cédric Van Styvendael. La Métropole a d'ores et déjà inscrit une ligne budgétaire de 2M€ à la PPI (projet pluriannuel d'investissement) pour engager cette entreprise : « ça ne veut pas dire que notre participation se limitera à ce montant ». « Une chose est sûre : on fera ce projet » affirme Cédric Van Styvendael. La nouvelle n'est pas anodine pour l'équipe qui y travaille depuis 2019. Longtemps envisagée à Saint-Genis-Laval, sur la ZAC Vallons des Hôpitaux, au pied de la prolongation de la ligne B du métro, la Cité Internationale des Arts du Cirque n'a pourtant jamais été inscrite dans les plans de cette ZAC à venir, déposé dès 2019 sans la partie cirque, comme le rappelle Marion Floras, membre de la compagnie MPTA, en charge de la coordination artistique du festival utoPistes et chargée de développement de cette opération. « En début d'année, des arbitrages des services d'urbanisme de la Métropole ont conclu que cette ZAC s'équilibre écologiquement sans nous et qu'il serait impossible de nous y inclure ». Par ailleurs, « l'enquête publique sur la ZAC a aussi montré la volonté des habitants de préserver des zones vertes à cet endroit » relate-t-elle. De ces deux ans d'étude, il ne restera donc rien ? « Si !, affirme Marion Floras, nous allons interagir avec beaucoup de territoires métropolitains dont Saint-Genis-Laval fait bien sûr partie — et le modèle économique global, les besoins techniques se transposent. Les financeurs principaux de cette étude (DRAC, Région, Métropole), et dans une part beaucoup plus minoritaires les villes de Saint-Genis-Laval et Lyon, nous ont permis de réaliser cette phase 1 avec 56 000€ — soit l'embauche, pendant dix-huit mois, d'un assistant maître d'ouvrage, d'un architecte programmiste, et un cabinet d'étude pour nous aider sur le modèle économique. Ce n'est pas perdu ! Avec la structure culturelle de Saint-Genis-Lavel, La Mouche, on travaille aussi sur une sorte de préfiguration : recherche, entraînement, workshop, rencontres professionnelles avec l'école, les artistes… ». Cédric Van Styvendael recontextualise, alors que les couloirs bruissent d'une décision politique visant à contrecarrer la maire étiquettée centre droit de la ville, Marylène Millet : « on ne déconstruit rien à Saint-Genis-Laval. Aucune validation n'avait été faite quant à une implantation à cet endroit ». Dans l'un et l'autre cas, l'accessibilité simplifiée par une station de métro est importante car cette Cité a vocation à rayonner bien au-delà de la Métropole, au niveau national et international. Chapiteau compris L'espace requis nécessite 10 000m² (dont une partie en espace vert) pour notamment accueillir deux salles qui pourront servir à des fins de diffusion de spectacle, mais dont ce ne sera pas la vocation première — l'entraînement et la formation étant prioritaires. « Des temps forts à destination de l'émergence seront peut-être proposés mais il ne s'agit en aucun cas de bâtir une saison » précise Marion Floras. Des spectacles du festival utoPistes y trouveront aussi logiquement leur place. Définir un programme technique sera l'enjeu de la phase 2 d'études qui débutera dans la foulée de la réunion de copilotage début avril. Un espace d'accueil de 3000m² (compris dans la totalité énoncée) sera aussi inclus pour que puisse s'y édifier, de temps à autre, les chapiteaux de taille modeste des troupes invitées et aussi que les étudiants s'exercent : « ils ne peuvent le faire que lors des rencontres de la Fédération régionale des arts du cirque pour l'instant, selon Nadège Cunin. Or ils doivent apprendre à monter un chap' ». Par ailleurs, « il est important de les former à travailler en circulaire aussi ». Si seulement 20% des créations de cirque contemporain se font aujourd'hui sous chapiteau, cet élément est l'ADN de cette discipline et certaines compagnies majeures comme le Cirque Trottola n'envisagent pas leur pratique sans la piste ronde. « On ne peut pas exclure les écritures circulaires dans un projet dédié à la filière cirque » insiste Marion Floras. Et pourquoi ne pas imaginer alors, que la parcelle voisine du Parc de Parilly, équipée en arrivées électriques et d'eau pour accueillir les grands chapiteaux lors des Nuits de Fourvière, puisse compléter ce dispositif lors des grands événements ? Bartabas et le Cirque Plume y ont déployé leurs immenses tentes ces dernières années. Avec cette Cité Internationale des Arts du Cirque, non seulement la Métropole peut poser le premier acte fort de sa politique culturelle et peut-être sera-t-il possible de voir s'ériger ici un deuxième Pôle National de Cirque dans la région, ce label national créé en 2010 par le ministère de la Culture qui rassemble actuellement quatorze structures. À Lyon, pour travailler le cirque, il y a donc pour l'instant « l'école qui manque de place et des lieux institutionnels pour des résidences et puis rien » résume la circassienne Julie Tavert, citant la Maison de la Danse et les Subs où elle a pu créer fin septembre un one shot des Femmes de Crobatie. « Mais le cirque, ce sont d'abord des espaces. Nous avons besoin d'une surface au sol assez grande » dit-elle. « Hormis à Toulouse et Paris, nous manquons de lieux pour créer des dynamiques de rencontres. Le festival des utoPistes le permet mais c'est très temporaire. Cette Cité Internationale des Arts du Cirque pourrait pérenniser cela, des temps de rencontres, d'humanité, de démocratisation du cirque auprès du grand public ». Nadja Pobel
Photo : © Brice Robert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2021 4:40 PM
|
Propos recueillis par Cristina Marino dans Le Monde - 23 mars 2021
Le metteur en scène a tenté de mener à bien son projet fleuve à visée familiale, « Une épopée », en dépit des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.
Le comédien, marionnettiste et metteur en scène Johanny Bert, 40 ans, a plus d’une quinzaine de spectacles à son actif, avec sa compagnie Le Théâtre de Romette, fondée en 2001 au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Le dernier en date, Une épopée, est le fruit d’un long processus de création entamé il y a trois ans, et rendu compliqué par l’irruption du coronavirus, en mars 2020. Lire la rencontre avec Johanny Bert (au Festival d’Avignon, en juillet 2019) : « La marionnette, une façon d’être moi sans être moi » Comment est né le projet d’« Une épopée » ? J’ai exploré dans mes créations à la fois les formes pour adultes et celles destinées à un jeune public. Je suis très intéressé par le partage entre l’enfant et l’adulte de cette expérience particulière qu’est la découverte d’un spectacle sur scène. Au départ d’Une épopée, il y a ce désir de faire vivre en famille une aventure hors du commun dans un théâtre : enfants et parents viennent voir ensemble le même spectacle, qui s’étale sur une journée entière. Avec, bien sûr, un propos adapté à ces différents publics. Le processus de création a commencé il y a environ trois ans par un important travail d’écriture avec quatre auteurs et autrices [Arnaud Cathrine, Thomas Gornet, Gwendoline Soublin et Catherine Verlaguet] à qui j’ai demandé de réfléchir avec moi sur cette commande spécifique d’une épopée contemporaine. Nous avons d’abord essayé de dégager des thématiques communes, récurrentes dans les épopées, comme la figure du héros, la défense de grandes causes, les guerres, le mélange entre réel et merveilleux… Puis nous avons cherché un sujet qui pourrait toucher les familles d’aujourd’hui, et, très vite, la question climatique s’est imposée. Réchauffement de la planète, pollution, gestion des déchets… Autant de préoccupations qui touchent les enfants dans leur quotidien. Comment le Covid-19 a-t-il modifié votre processus de création ? Une fois achevé ce travail d’écriture préalable, qui a duré plus d’un an et demi, nous devions entamer les répétitions, et c’est là qu’est arrivé le premier confinement, en mars 2020, qui nous a bloqués pendant trois mois. Nous n’avons pu commencer ces répétitions qu’en juin, et nous avons répété d’arrache-pied pendant tout l’été, grâce au soutien des lieux partenaires de notre création, comme Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque [Nord], où je suis « artiste compagnon » depuis 2018, le Théâtre Paris-Villette et La Cour des Trois Coquins à Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme], où est implantée ma compagnie, Le Théâtre de Romette. Je tiens à souligner le rôle essentiel de ces structures durant cette période si compliquée. Après un été passé en répétitions, nous avons pu jouer deux fois seulement Une épopée sur scène, à Dunkerque. Ensuite, toutes nos dates de tournée ont été annulées. A l’occasion de ces deux uniques représentations, l’accueil du public a été très positif, les enfants [à partir de 8 ans] se sont vraiment laissé embarquer dans l’histoire. La longueur d’Une épopée, composée de quatre parties d’une heure entrecoupées de plusieurs pauses (goûter et pique-nique partagés), et même d’une sieste acoustique en début d’après-midi, n’a posé aucun problème, même pour les plus jeunes spectateurs. Tout s’est déroulé dans un esprit festif, joyeux. Cela a été assez frustrant artistiquement pour toute l’équipe d’Une épopée – sept comédiens et comédiennes sur scène, avec un musicien-compositeur multi-instrumentiste qui joue la partition en live, plus toutes les personnes qui interviennent en régie ou qui ont travaillé en amont sur les marionnettes, les décors, les costumes – de devoir tout arrêter. C’est pourquoi nous essayons de réfléchir à de prochaines séances de répétitions, c’est important pour nous de garder le spectacle actif dans les corps et dans les têtes pour pouvoir être prêts à le rejouer dès la réouverture des théâtres. Que pensez-vous de la fermeture actuelle des lieux culturels ? Lors du premier confinement, comme beaucoup de gens, j’ai accepté l’idée que la culture n’était pas une priorité en période de pandémie… Mais je pense aussi que nous avons, en tant qu’artistes, un rôle à jouer dans le débat public, une fonction importante dans la société. Il est extrêmement dommageable, me semble-t-il, de couper totalement les gens, et surtout les plus jeunes, de tout ce qui est art, échange, partage, communication. Je suis actuellement sur un nouveau projet de création itinérante, Le Processus, à partir d’un texte inédit de Catherine Verlaguet sur le thème du désir amoureux et de l’avortement. Avec une comédienne, nous allons faire des lectures dans les collèges et lycées, ce qui nous permet de recueillir les réactions des élèves et de discuter avec eux autour de ces sujets du désir, de la première fois… C’est passionnant et très instructif, cela permet aussi de faire vivre la culture de manière différente. Plus d’informations sur le site consacré au spectacle Une-epopee.com et sur le site du Théâtre de Romette Theatrederomette.com Cristina Marino Présentation vidéo du projet d'Une épopée, par Johanny Bert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 3:42 PM
|
Sur le site de l'émission Affaires culturelles, animée par Arnaud Laporte - 23 mars 2021 Le 4 mars a paru aux Editions du Tripode Lettres non écrites, un recueil de lettres issues du spectacle du même nom créé par David Geselson en 2017. L’occasion pour lui de revenir au micro d’Arnaud Laporte sur ses méthodes d’écriture et sa conception du travail de mise en scène.
Ecouter l'entretien (55 mn) Un théâtre qui se nourrit de son époque Dans son théâtre, David Geselson met en scène des histoires individuelles qui croisent l’Histoire, utilise l’intime comme porte d’entrée sur des questionnements politiques et interroge les héritages des générations qui nous ont précédés. Ainsi dans En route Kaddish (2014) il met en question, à travers l’histoire de son grand-père, le conflit israélo-palestinien et le désir de se trouver une terre. Puis, après avoir mis en scène dans Doreen (2016) l’amour d’André Gorz et son épouse Dorine Keir, il met en scène dans Le Silence et la peur (2020) l’histoire de Nina Simone et à travers elle, quatre siècles de domination coloniale aux Etats-Unis. Un important travail de documentation Le travail de David Geselson est donc marqué par un important travail de documentation préalable à l’écriture de ses pièces. Il multiplie les lectures, récolte des témoignages et va même jusqu’à se rendre en Israël pour plonger dans l’univers de son grand-père pour En route Kaddish (2014). Nourries également par des temps collaboratifs de recherche au plateau, ses pièces proposent ensuite une mise en fiction de cette matière documentaire. Un théâtre qui met en lien Pour Lettres non écrites (2017), David Geselson joue un rôle d’écrivain public en rencontrant des spectateurs afin que ceux-ci lui partagent leur histoire, et qu’il leur écrive une lettre qu’eux-mêmes n’ont jamais réussi à produire. Par le biais de ce processus d’écriture, David Geselson propose donc un théâtre qui permet tisser des liens, de même qu'il s’appuie sur la mise en scène pour créer une proximité entre la scène et la salle. Son actualité : Lettres non écrites, recueil issu du spectacle du même nom a paru le 4 mars aux Editions du Tripode.
David Geselson jouera également dans la nouvelle création de Tiago Rodrigues, Le Choeur des amants au mois de mai au Théâtre des Bouffes du Nord.
Voir la vidéo de la lecture complète de Lettres non-écrites, par plus de 40 comédiens à la Maison de la Poésie le 13 mars 2021

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 10:19 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 23 mars 2021 Intermittents, précaires et étudiants sont toujours installés dans le théâtre parisien, et quelque 70 autres en France. Si le Conseil national des professions du spectacle a été repoussé pour cause de Covid de la ministre de la Culture, la prochaine édition est attendue de pied ferme par les occupants. En fin de journée, les «occupants» de l’Odéon ont eu la visite surprise de l’écrivain Edouard Louis, qui a été ouvreur dans ce même théâtre durant ses années étudiantes. Il est ravi d’organiser un café littéraire sur le parvis pour discuter de son nouveau livre à paraître aux éditions du Seuil, Combats et métamorphoses d’une femme – peut-être jeudi prochain, la date n’est pas encore complètement fixée, et la rencontre sera bien sûr ouverte à tous. Cette même semaine, le journaliste David Dufresne projettera Un pays qui se tient sage, dans le foyer du théâtre avec quelques protagonistes de son documentaire. Ne pas tenter d’entrer, la jauge est strictement réduite à 42 places, et les spectateurs dorment sur place. Egalement au registre des questions d’agenda, on ne sait pas encore quand se tiendra le Conseil national des professions du spectacle (CNPF) que Roselyne Bachelot devait présider aujourd’hui. Comme on pouvait le deviner, elle a dû faire faux bond pour des raisons de santé. Cette instance créée par Jack Lang et dédiée aux sujets sociaux dans le secteur culturel, se réunit environ une fois par an quand les vents sont calmes, et autant de fois qu’il le faut, lorsqu’il y a tempête. «On attendait beaucoup de cette réunion, la première sous l’égide de Roselyne Bachelot, qui engage tous les représentants des syndicats des employeurs et des salariés, et qui sont en général l’occasion d’annonces, explique le secrétaire général de la CGT spectacle et occupant actif de l’Odéon, Denis Gravouil. Il était prévu que je parle le premier. J’aurais réexpliqué la revendication du mouvement en cours qui est d’assortir l’ouverture des salles à un véritable plan de reprise et de politique culturelle.» Nulle déception cependant, car «la réunion d’aujourd’hui était démonétisée par les annonces-aumônes de Castex du 11 mars dont il était prévu à l’ordre du jour qu’on nous les réexplique». Conclusion lapidaire : «L’annulation pour cause de Covid, donne donc à Mme Bachelot une seconde chance de mieux préparer ce CNPF et de le reporter à une date un jour où elle aura enfin des choses à nous annoncer.» En attendant, les occupations des théâtres par des intermittents, précaires, et étudiants continuent et s’accroissent à un rythme soutenu – on en dénombre 74 ce lundi contre 62 ce week-end. Photo : Cha Gonzalez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2021 4:58 AM
|
Par Caroline Châtelet dans Sceneweb - 23/03/2021 La metteuse en scène Alexandra Tobelaim a pris la direction du NEST – CDN à Thionville en janvier 2020, quelques semaines avant le début du premier confinement. Entre les périodes d’ouvertures et de fermetures, elle a maintenu ses créations, en attendant de les présenter au public. Ayant pris la tête du NEST – Centre dramatique national de Thionville en janvier 2020, la metteuse en scène Alexandra Tobelaim fait partie de ces directeurs de lieux (comme Thomas Jolly au Quai, à Angers ou, encore Julie Deliquet au Théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis) à n’avoir vécu que quelques rares périodes arrachées à la pandémie d’ouverture au public. Interrogée, la directrice évoque, outre les étranges sentiments d’attente et d’incomplétude suscités par cette situation, une frustration. Cette dernière est autant liée aux incertitudes pesant sur la réouverture aux publics, qu’à l’état dans lequel celles-ci installent – entravant les réflexions à plus long terme. « La situation actuelle nous demande tellement de gestion au quotidien que j’ai parfois l’impression que nous sommes tout le temps en train d’éteindre des feux, plutôt que de vraiment construire », confie Alexandra Tobelaim. Mais cette drôle d’année a aussi permis de consolider des convictions, dont celle du lien puissant avec les spectateurs. « Je me suis rendue compte à quel point ce sont les spectateurs qui nous portent, nous galvanisent. Ce sont eux qui nous permettent de nous ressourcer et de retrouver le sens de ce que l’on fait. » Défendant la nécessité de maintenir un dialogue, même différent que celui « de l’en commun autour d’un spectacle », la directrice et son équipe proposent d’autres formes d’approche du théâtre. Expérimenté dès le début du premier confinement, les lectures par téléphone (menées avec la compagnie O’Brother) sont de ces rendez-vous explorant la relation singulière et individuelle entre un spectateur-auditeur, un artiste et une œuvre. De ces projets aussi modestes qu’ingénieux qui déplacent et ouvrent l’imaginaire. Le printemps étant inexorable, Alexandra Tobelaim espère comme tant d’autres une réouverture prochaine des lieux culturels. « Je n’en suis pas encore à faire le deuil de cette première saison. J’ai l’impression qu’elle est encore devant nous, avec cet espoir qu’elle puisse se dérouler sur un temps plus condensé en reprogrammant les spectacles jusqu’en juin et juillet. C’est dans ce temps suspendu, déroutant en ce que les créations continuent d’être répétées sans être visibles par les spectateurs, que la directrice et metteuse en scène a fait le choix d’organiser des représentations professionnelles. Une décision qui ne coulait pas de source initialement, mais qui lui a permis d’avoir la sensation de mettre un terme à la création de son dernier spectacle, Abysses – qui aurait du voir le jour en novembre dernier. « Je n’en pouvais plus de l’avoir « à l’intérieur », j’avais besoin qu’il voit le jour pour me libérer d’une partie de moi. Émilie Capliez [co-directrice et metteuse en scène de la Comédie de Colmar, ndlr] a une belle formule à ce sujet : elle dit que c’est « comme un parpaing sur l’estomac ». Et depuis hier [date de la représentation pro, ndlr] j’ai retrouvé une sorte de calme, je sens que quelque chose a été digéré. L’acte théâtral se posant à l’endroit de la rencontre avec les spectateurs, tant qu’elle n’a pas eu lieu, le spectacle n’existe pas. » Écrite par l’auteur dramatique italien Davide Enia – dont Alexandra Tobelaim avait déjà monté en 2012 Italie-Brésil 3 à 2 – la pièce, découverte par l’entremise du traducteur de Enia, réunit au plateau le comédien Solal Bouloudnine (déjà interprète dans Italie-Brésil 3 à 2) et la musicienne Claire Vailler Tandis que cette dernière se tient en fond de scène côté jardin, Solal Bouloudnine est à l’avant-scène, endossant la parole de Davide Enia. Dans une narration à la première personne, l’auteur-conteur entremêle et embrasse dans un seul geste dans Abysses le récit de ses relations avec son père, de la maladie de son oncle et de son expérience au long cours auprès de sauveteurs et d’associations sur Lampedusa. L’île italienne dont la position géographique stratégique lui vaut d’être l’un des points d’entrée vers l’Europe pour des migrants en provenance d’Afrique du Nord constitue le lieu comme le sujet d’Enia – ceux pour lesquels il importe de trouver les justes mots. Avec son dispositif minimal – le récit étant ponctué ou soutenu par des chansons (issues d’un répertoire traditionnel italien) interprétées par Claire Vailler – Abysses est tout entier dédié à la parole. C’est celle-ci qui est au cœur du dispositif scénique, comme du récit, c’est celle-ci qui relie les protagonistes. Si parfois les mots manquent (au père d’Enia, de caractère taiseux, comme à Enia traumatisé par ce qu’il a vu et entendu de la part de réfugiés), la nécessité de les trouver, les écrire, les donner à entendre, travaille toute la pièce. Face aux violences du drame humanitaire le langage révèle sa capacité réparatrice et salvatrice. Encore parfois un peu fragile dans son interprétation – Solal Bouloudnine devant trouver son juste rythme sur la totalité du spectacle – Abysses révèle un texte poignant par sa justesse et sa manière de tisser ensemble des vies éloignées les unes des autres. Avec sa mise en scène scrupuleusement respectueuse du texte, son interprétation sincère, l’ensemble porte cet entrelacement d’histoires, d’expériences et de regards sans jamais tomber dans la simplification ni l’obscénité. Et nous rappelle que la compréhension de l’altérité passe aussi par l’appréhension et le dépassement de ses propres abysses intimes. Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr Abysses se jouera à huis clos les 29 et 30 mars aux Plateaux sauvages, à Paris et les 1er et 2 avril au Théâtre d’Angoulême. En attendant une tournée en 2021/2022.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 21, 2021 5:01 PM
|
Au moins une soixantaine de salles françaises sont occupées par des étudiants et précaires protestant contre la politique culturelle et sociale du gouvernement. Les différentes mobilisations prêchent la convergence des luttes, créant des ponts avec des agriculteurs à Millau, des migrants à Marseille ou des écologistes à Chambéry. par Anne Diatkine, Annabelle Martella, (à Gennevilliers), Grégoire Souchay, (à Millau), Maïté Darnault, correspondante à Lyon, Stéphanie Maurice, correspondante à Lille et Samantha Rouchard, correspondance à Marseille publié le 21 mars 2021 à 20h30 L’Odéon-Théâtre de l’Europe a été le premier à être «occupé» le 4 mars, rejoint depuis par au moins 61 lieux. Le décompte est difficile à faire – il se murmure que certaines petites scènes choisissent d’afficher une banderole «occupée» afin d’éviter précisément de l’être ! Il ne faut pas croire cependant qu’il n’y a qu’une seule manière d’investir ces espaces scéniques désespérément fermés depuis si longtemps. Il faut distinguer la situation spécifique de l’Odéon de celle, par exemple, des étudiants qui «habitent» leur école au Théâtre national de Strasbourg, soutenus par l’équipe salariée et sa direction, ou encore des occupations, plus ou moins acceptées, par les directions des théâtres qui négocient en bonne intelligence les espaces alloués, participent aux débats et à l’intendance. Celles où les portes restent ouvertes à tous de celles dont les occupants interdisent l’entrée pour des raisons sanitaires, mais privilégient comme mode de lien avec le quidam de l’inviter à des petites performances quotidiennes dehors, sur le parvis des salles – c’est le cas notamment au Théâtre de la Colline à Paris, investi uniquement par des étudiants. La hiérarchie des revendications varie aussi d’un lieu à l’autre. Le succès de l’action doit-il se mesurer uniquement à la progression du nombre de lieux occupés ? Tentative de tour d’horizon d’un mouvement en cours d’invention, à la faveur d’un samedi déclaré journée d’action partout en France. A Paris, «le groupe est addictif» Donc ils sont toujours là, une quinzaine de jours après leur entrée musclée, sans concertation avec la direction de l’Odéon, dans l’imposant bâtiment du théâtre à l’italienne et symbole de l’occupation des scènes depuis 1968. Des intermittents du spectacle ou des travailleurs précaires exclus du régime de l’intermittence, rejoints parfois par des conférenciers, un cheminot ou du personnel de l’hôtellerie. Un tiers des occupants sont syndiqués à la CGT spectacle. Leur nombre a été fixé et il est stable : 42. Ce qui implique que chaque fois que quelqu’un quitte le théâtre, une autre personne y entre dormir, pas deux ou trois. Les relèves se font à des horaires fixes, à 9 heures et à 18 heures – pas question d’entrer ou sortir à un autre moment, une exigence de la direction qui s’est trouvée débordée par une cinquantaine d’entrants, le 7 mars, laquelle causa une interruption temporaire totale de travail (ITT) de deux semaines au gardien. Au 2, rue Corneille, depuis, une bande noire au sol matérialise la frontière entre l’entrée dévolue aux occupants, et celle réservée aux salariés et à l’équipe en répétition – en l’occurrence du Ciel de Nantes de Christophe Honoré, qui sera joué en 2022. «Si bien que, même quand on nous apporte des denrées alimentaires, on doit se pencher pour les attraper. Heureusement, on s’entend bien avec les vigiles», remarque la cinéaste Valérie Massadian, présente depuis une douzaine de jours. On le perçoit vite, la cohabitation est nettement plus tendue avec les salariés. A l’intérieur, dans les espaces dévolus aux occupants – le foyer, une salle de répétition, le beau salon d’apparat, la bibliothèque, et une douche unique car «toutes les loges sont utilisés par l’équipe en répétition, et qu’il est impossible en période épidémique que les flux se croisent», explique l’administratrice de l’Odéon, Bethânia Gaschet, c’est le calme et la fluidité qui frappent. Chaque occupant est chargé d’une fonction précise et la journée est bien rythmée entre «l’agora» à 14 heures menée du haut des terrasses sur le parvis du théâtre, les AG quotidiennes, l’intendance. «S’ennuyer ? Ah non, le groupe est addictif.» L’extinction des feux a lieu à minuit, si l’on peut dire, puisque l’énorme lustre continue d’éclairer la salle, manière de dissuader les occupants qui ont investi les corbeilles du théâtre de s’aventurer dans les travées. Ce lundi aura lieu le Conseil national des professions du spectacle, qui devait être présidé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avant qu’elle n’annonce avoir contracté le Covid-19. Autre date importante : la remise du rapport Gauron, le 31 mars, sur la situation des intermittents. Il y a peu de chance néanmoins que l’occupation lève le camp, c’est-à-dire que les objectifs soient atteints. A l’Odéon, comme dans un certain nombre d’occupations, il s’agit en premier lieu d’obtenir l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage qui devrait entrer en vigueur en juillet, en plus d’une prolongation et d’un élargissement de l’année blanche et des droits sociaux pour les précaires. La réouverture des salles n’est «en aucun cas un but isolé», répètent les plus vieux comme les plus jeunes. Dès lors, comment «faire tache d’huile» alors même que l’occupation du théâtre importune essentiellement sa direction ? Comment maintenir un sursaut d’intérêt dans l’opinion publique branchée sur la progression du virus ? Et comment expliquer, puisque les revendications sont pour beaucoup analogues à celles développées dans la tribune publiée le 10 mai dans Libération, qui interpellait le président de la République sur le sort des intérimaires laissés sur le carreau que les occupants de l’Odéon ne soient rejoints par aucun des signataires ? La direction du théâtre a expliqué qu’elle ne recourrait pas à l’évacuation par la force. Bethânia Gaschet, qui fait la médiation entre les occupants et la direction, en convient : la porte de sortie n’est pas encore visible. Quant aux occupants, tous affirment qu’ils ne sont qu’au début d’une insurrection populaire. A Chambéry, «promis, Roselyne, on n’abîme pas la peinture» A Chambéry, l’occupation de la scène nationale de l’Espace Malraux est partie d’une farce. Le week-end dernier, des techniciens de la salle de spectacle Saint-Jean, à La Motte-Servolex, commune périphérique de l’agglomération savoyarde, ont accroché une banderole en soutien au mouvement initié au théâtre parisien de l’Odéon : «Promis, Roselyne, on n’abîme pas la peinture.» «Il y a eu un gros effet d’annonce sur La Motte-Servolex, ça nous a donné des ailes, explique Amélie Piat, comédienne intermittente du spectacle. Le lundi suivant, il y a eu un regroupement à la MJC, la direction de l’Espace Malraux était là et a donné son accord pour qu’on entre dans les lieux.» Mardi, une centaine de personnes étaient présentes pour la première assemblée générale à 11 heures. Pas d’occupation à La Motte-Servolex donc, mais sa bannière dédicacée à la ministre de la Culture a bien servi d’étincelle. Et vendredi midi, c’était au tour de celle de l’Espace Malraux d’être hissée sur le fronton : «Si j’étais pas mort, j’en serais», signé Molière. Cette veille de week-end, l’AG a été avancée à 9 heures pour permettre aux occupants d’aller grossir les rangs de la manifestation de Youth for Climate, annoncée à 10 heures. La convergence des luttes, c’est le thème de la palabre qui s’enclenche après quelques vocalises d’une chanteuse lyrique, «juste au cas où certains dorment encore» sur les matelas posés à quelques mètres. Chapka et après-skis roses, visière bardée de stickers, Amélie Piat circule parmi une quarantaine de personnes pour faire tourner le bâton de parole – une ventouse à WC, un plumeau vert fluo ou une brosse pour la vaisselle selon l’interlocuteur. Des usagers d’un centre social en difficulté financière et un représentant de la CGT Savoie présentent à tour de rôle leur combat. Pour faire enfler la mobilisation, sont aussi évoqués des rapprochements avec un collectif contre la répression policière et un autre contre les violences sexistes. Un participant propose de contacter les restaurateurs et les tenanciers de bars «en souffrance», chez qui nombre d’artistes se produisent d’ordinaire. Un autre explique vouloir composer un texte s’insurgeant contre la création d’un pass sanitaire et l’instrumentalisation des données personnelles qu’il pourrait susciter. L’idée d’une scène ouverte sur le parvis de l’Espace Malraux est approuvée, pour donner des représentations quotidiennes, «offrir un moment aux gens». Amélie Piat opine : «Pour faire de l’art, il faut des artistes. On aimerait beaucoup les voir profiter de ce qu’on essaie de lancer.» Seule une poignée de compagnies locales, des étudiants et de jeunes précaires se réclamant de la «bamboche» se relaient pour l’heure dans la mini-ZAD en intérieur. «On désobéit en étant là, mais comment faire pour être soutenus ? interroge Amélie Piat. Tout ça se pense, se construit.» A l’Espace Malraux de Chambéry, lors d’une AG vendredi. (Pablo Chignard) Loïc Suchet, technicien audiovisuel intermittent, reste encore sur sa faim de débats : «Je suis là pour parler de la réforme de l’assurance chômage, pour réfléchir et discuter de solutions, mais ça n’a pas encore été abordé.» Jusqu’à quand la parenthèse festive peut-elle durer ? «La question sanitaire va devenir une ligne de démarcation», suppute Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux. L’AG touche à sa fin, direction la manif. Un trio de percussionnistes, sapés en garçons de café, se démènent face à une trentaine de lycéens de Youth for Climate tout en déhanchés. La caisse claire : «Est-ce qu’il y a des jeunes ? ! — Ouaaaais ! — Est-ce qu’il y a des précaires ? ! Ouais, vous allez tous le devenir !» A Lille, pour «la convulvence des luttes» Des tartes offertes par le syndicat Solidaires, des tracts appelant à la mobilisation pour le procès des 186 salariés licenciés de la multinationale agroalimentaire Cargill, mardi : à Lille, sur la scène du beau théâtre qu’est le Sébastopol, c’est la volonté de convergence des luttes qui domine. «La convulvence des luttes», rectifient, en chœur, les occupants du jour, samedi midi, ravis d’avoir supprimé «verge» du mot. Corinne Masiero, dont les fesses dénudées aux césars ont mis la colère de la culture sur le devant de la scène, en est : «C’est bien les néologismes, on nous demande pourquoi et ça fait réfléchir sur le changement de notre société, souligne-t-elle, un brin narquoise. Mais surtout, ça nous a fait marrer hier soir à la réunion de ceux qui dorment et bossent ici.» Et il n’y avait pas que les gens du spectacle à tenir le théâtre : la moitié d’entre eux venait d’autres sphères, «étudiants, précaires, chômeurs», détaille Marine (1), 32 ans, constructrice de décors. Raphaël, au RSA, a participé à une AG mercredi, et est venu passer deux nuits sur place ce week-end. «Ce gouvernement est en train de changer tous les fondamentaux de la France, et met de plus en plus de gens en situation de précarité», estime-t-il. A la pointe du combat, l’abandon de la réforme de l’assurance chômage : une fiche explicative, laissée sur la «tractable», détaille les inquiétudes, avec des petits crobards : «Si par exemple vous avez travaillé un mois sur deux, votre indemnité sera divisée par deux.» «C’est l’occasion qui fait le larron, remarque Emmanuel (1), ingénieur son de 34 ans. Vous avez des lieux qui sont vides, et le monde de la culture est une caisse de résonance : les intermittents, on les écoute, ils sont présents dans les médias, présents dans les rues.» Samedi matin, sur la Grand-Place de Lille, ils étaient justement une quinzaine d’artistes de rue, les seuls à mettre de la vie dans une ville confinée. «Incroyable, de la musique en vrai !» rit jaune une participante. Chacun est venu avec sa chaise pliante, de plage ou d’enfant pour s’asseoir au soleil et parler d’un théâtre qui se sent oublié. «Nous touchons le moins d’aides, alors que nous avons le plus de spectateurs, note Camille Faucherre, de l’association la Générale d’imaginaire. Nous vivons une vraie saison blanche. Nous ne demandons pas à recommencer demain, mais filez-nous une date, même à long terme, comme cela, on s’organise.» Un étudiant en théâtre passe en coup de vent et en voisin, il occupe le Théâtre du Nord avec sa promo. Au départ, c’est celui-là qui devait être le centre de la contestation mais comme les auditions de jeunes comédiens s’y tenaient, les mobilisés se sont délocalisés au Sébastopol. Une affiche y décompte les lieux occupés en France, au 18 mars, «62 clusters de mécontentement», plus de 80 samedi, assure Marine. Leur prochaine AG, «ouverte à tous», se tient ce lundi à midi. A Millau, «je ne pensais pas qu’après avoir occupé l’Odéon en 68, j’y serais encore !» Dans l’Aveyron, le printemps a encore ses quartiers d’hiver. La faute au virus, brutalement sous les feux de la rampe, depuis l’apparition cette semaine de clusters à l’hôpital et dans les écoles du coin. Alors, «par choix de responsabilité», toute action prévue ce samedi a été annulée, mais l’occupation du Théâtre de la Maison du peuple, lancée depuis une semaine par des «intermittents du spectacle et de l’emploi», se poursuit à Millau. Et ce, dans un strict respect des normes sanitaires : masques, distanciation lors des réunions, jauge maximale de veilleurs nocturnes «entre six et douze personnes pour qu’il y ait quand même une vraie occupation», détaille Adrien, intermittent, avec fiche de rappel dans l’éventualité d’un cas de Covid déclaré – aucun pour l’instant. En parallèle, l’activité des salariés du théâtre et les résidences se poursuivent dans la bonne entente. Seule une employée du hall d’entrée, plus exposée, vient de passer en télétravail. Cette rigueur, ils la tiennent depuis le début. Y compris quand le 23 janvier, par surprise, le Collectif des non-essentiels rouvrait le théâtre avant tout le monde pour partager le temps d’un après-midi un brin de culture. «Une opération réussie mais avec un écho limité», estime Philippe Fayret, administrateur du Millau Jazz Festival. Il est fier de rappeler que c’est dans cette ville que fut lancé l’appel au «printemps inexorable», aujourd’hui repris en chœur partout ailleurs. Ici aussi, on réclame le retrait de la réforme de l’assurance chômage et le maintien des droits mais la lutte agrège autour des professionnels du théâtre toute une galaxie revendicative aux multiples casquettes : les syndicats CGT et Solidaires mobilisés pour les emplois dans l’industrie, les soignants en grève, les gilets jaunes mais aussi la Confédération paysanne et les opposants à la loi «sécurité globale». Toutes les générations sont là, même les plus jeunes, comme Yanis, en terminale option théâtre dans un lycée public, qui doit déjà «se battre pour avoir le maintien de ses heures» de spécialité. «Le monde qu’on me propose ne me va vraiment pas.» A ses côtés, plusieurs retraités travaillent sur des archives. «Je ne pensais pas qu’après avoir occupé l’Odéon en 68, j’y serais encore !» s’amuse Annie, ancienne intermittente et gilet jaune revendiquée. Pour elle, ce lieu de la Maison du peuple est hautement symbolique. Car c’est d’ici que partaient les grèves des ouvriers du cuir des années 20, eux qui conquirent avec dix ans d’avance le droit aux congés payés. Cent ans plus tard, elle déplore qu’il n’y ait «plus de lieu pour se réunir et échanger librement, c’est pour ça qu’on a pris les ronds-points». D’autres ont en tête des questions plus immédiates, comme Juliette, régisseuse, qui se bat pour récupérer des droits à la maternité et à la maladie «mais aussi pour en conquérir de nouveaux». A l’AG du jour, on souffle après une semaine intense mais s’ouvre déjà l’horizon des idées : RIC, salaire à vie, rôle des élus. Pour Vincent, de la compagnie Création éphémère, «maintenant qu’on a les conditions matérielles pour réfléchir, il faut que ça sorte et que la parole se propage». A Marseille, «on milite pour une culture moins élitiste» C’est le Théâtre du Merlan (ZEF), implanté au cœur des quartiers Nord de Marseille (14e), qui a ouvert le bal des occupations dans la ville, avec pour étendard un photomontage de Roselyne Bachelot, enfourchant, tout sourire… un merlan. Le 12 mars, à l’initiative de la CGT spectacle et du Syndicat national des arts vivants (Synavi), une vingtaine d’intermittents a décidé de dormir entre les murs de la scène nationale. Christophe et Magali, la cinquantaine, éclairagiste et comédienne, étaient présents dès la première nuit. «Pour nous, c’était évident d’occuper le Merlan, parce que notre lutte dépasse la réouverture des théâtres. On milite pour une culture moins élitiste, ouverte à toutes et à tous», insiste Magali, dont le masque est marqué d’un «culture en danger» barré et frappé du logo de la CGT. Les deux intermittents sont syndiqués. C’est le cas d’une majorité des artistes et techniciens qui occupent le lieu, bien souvent des militants de longue date qui tentent de faire converger leur lutte avec celles du territoire, comme celle du McDo de Saint-Barthélémy. «On espère que ces occupations vont faire tache d’huile, afin que toutes les luttes en profitent.» Sur le Vieux-Port, le centre dramatique national (CDN) de la Criée a lui aussi été investi, dès le 15 mars. Sa directrice, l’autrice et metteuse en scène Macha Makeïeff, a choisi d’ouvrir les portes de son théâtre aux étudiants de l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes et de Marseille (ERACM). Afin d’«entendre la jeunesse […]» et d’écouter «leur espérance», se targue la cocréatrice des Deschiens à longueur d’interviews. Dans un premier temps, les militants du ZEF voient d’un mauvais œil les jeunes «castés» du CDN. «On n’avait pas envie d’avoir une image de collabo ou de gentils chouchous et que ça desserve le combat», explique Sophie, comédienne de 27 ans. Dès le lendemain, les étudiants décident alors d’ouvrir les portes au plus grand nombre. Refusant de se laisser instrumentaliser par les administrateurs, ils publient un communiqué cinglant sur leur page Facebook, montrant qu’ils ne sont pas dupes des effets de communication de la direction. «On refuse d’être récupérés par qui que ce soit», martèle Sophie. Contrairement au ZEF où la direction a été plutôt généreuse quant à l’accueil, à la Criée, seul le hall a été ouvert aux occupants. Les matelas ont été installés au premier étage. Les loges, qui auraient pu offrir des espaces plus intimes et plus calmes, leur restent fermées. Deux douches leur sont accessibles depuis peu, sur un temps restreint. «Mais aujourd’hui, on a gagné l’utilisation de la machine à laver !» ironise Johanna, 30 ans, comédienne. Si ces jeunes ont choisi d’occuper la Criée, c’est surtout pour le symbole : «Les CDN sont des lieux de pouvoir. Et être ici, c’est s’approprier un outil de travail qui nous appartient mais auquel on se sent étrangers le plus souvent», souligne Johanna. Depuis quelques jours, ils accueillent en plus neuf migrants délogés. «On ne pouvait pas les laisser dehors, alors que nous dormions au chaud, justifie Sophie. Car si on veut sauver le monde du spectacle, on ne lutte pas que pour ça. On remet aussi à plat un schéma de société et de domination. Et on ne reverra pas nos revendications à la baisse.» Forts de leur rébellion contre la direction de la Criée, ils ont fini par gagner la confiance des militants du ZEF avec lesquels ils feront AG commune dès ce lundi soir, pour accroître leur force de frappe dans les semaines qui viennent. A Gennevilliers, «le théâtre a une mission sociale» Dans ces rues où on ne s’arrête jamais en temps de pandémie, une voix fait se masser autour d’elle, sur le parvis du Théâtre de Gennevilliers (T2G), une cinquantaine de personnes. Elles entourent le chant pénétrant d’une jeune femme accompagnée de joueurs d’oud et de marimba. Ce concert, improvisé en pleine rue un samedi après-midi (apparition presque surréaliste alors que les concerts debout sont proscrits depuis près d’un an) par des étudiants du conservatoire de musique de la commune, a lieu à la faveur de l’occupation du T2G. Depuis lundi, le théâtre est occupé par une quarantaine d’apprentis comédiens de l’Esca du Studio d’Asnières, école supérieure qui se trouve à 500 mètres de là. Soutenus par la direction du T2G, ils s’inscrivent dans le sillage d’autres lieux culturels occupés en revendiquant l’abandon de la réforme de l’assurance chômage, la prolongation de l’année blanche pour les intermittents ou encore un plan d’accompagnement des élèves à la sortie de leurs études pour leur permettre d’accéder à l’emploi. Après trois années à l’Esca, Eugénie est au chômage depuis près de six mois et ne peut pas prétendre à l’intermittence, n’ayant jamais pu ouvrir ses droits : «Je ne peux pas non plus faire de petits boulots, les restaurants étant fermés. Il me reste quoi ? La reconversion ? La lutte au sein de l’occupation du T2G, c’est aussi montrer que nos métiers sont essentiels et qu’il faut que la possibilité de vivre d’une activité artistique demeure.» Comme ses camarades, Eugénie défend un mouvement qui se «veut fondamentalement politique mais passant par des actions artistiques». Hors de question pour eux d’être affiliés à un parti ou à un syndicat même s’ils sont en lien avec la CGT spectacle, présente dans de nombreux théâtres. Ils veulent parler en «leur propre nom» et recréer du lien avec les habitants. «Le théâtre n’est pas un lieu de marchandisation mais a une mission sociale», rappelle Ulysse, en dernière année à l’Esca. Montrant le slogan sur la devanture du bâtiment («Sans vie sociale, il n’y a pas de société»), ils réfléchissent à des manières de se produire dans l’espace public, d’investir pourquoi pas le marché des Grésillons à côté, pour recréer des espaces de rencontres et de débats. Ces occupations étudiantes ressemblent pour l’instant peu à celles des universités en 2018. Covid oblige, l’entrée du T2G est strictement réglementée et une dizaine d’élèves seulement peuvent y rester dormir. En discussion constante avec la direction qui accueille le mouvement, et le soutient ouvertement, sans pour autant s’y associer, les étudiants respectent les contraintes logistiques du CDN qui reste un espace de travail et de répétitions : «L’occupation émane des étudiants même si, bien sûr, il existe de nombreux points de rencontre entre nos revendications et les leurs, rappelle Juliette Wagman, directrice adjointe du T2G. Nous travaillons en bonne intelligence avec eux et accueillons leurs questionnements.» Le théâtre «est occupé par roulement» et les apprentis comédiens ne peuvent pas accueillir des étudiants d’autres écoles et horizons, qu’ils enjoignent néanmoins à investir leurs lieux d’étude car «c’est en occupant le maximum d’endroits qu’on changera le rapport de force avec le gouvernement». (1) Les prénoms ont été modifiés. Légende photo : Au T2G (Théâtre de Gennevilliers) pendant son occupation. (Stéphane Lagoutte/Myop pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 20, 2021 8:44 PM
|
FRANCE 5 - VENDREDI 12 MARS À 20 H 55 - SOIRÉE SPÉCIALE Voir La Ronde de Boris Charmatz en replay (1h30) « La nef du Grand Palais, c’est un bijou d’architecture, un bâtiment qui était prévu pour être éphémère et qui est fragilisé. Il va être fermé pendant quatre ans. Et moi, j’adore ce bâtiment, j’ai envie de m’inscrire dans cette histoire-là. On m’a demandé de faire un événement pour sa clôture et j’ai toujours pensé que la danse y avait vraiment sa place alors qu’on est dans une cathédrale… » Le chorégraphe Boris Charmatz est seul sous la plus grande verrière d’Europe, en train de se laisser imprégner par cet espace gigantesque et sublime. Il rêve, il imagine, il se projette. Il y crée, le 16 janvier, à huis clos, dans le cadre du Festival d’automne, la performance intitulée La Ronde, collection de duos contemporains, néoclassiques et classiques, sous influence de la pièce éponyme d’Arthur Schnitzler. Lire le portrait : Les foules en mouvements de Boris Charmatz Sous la caméra de Claire Duguet et Sophie Kovess-Brun, qui coréalisent ce documentaire-portrait sur le chorégraphe et son énorme projet, on suit Charmatz entre Paris et Bruxelles, où il habite, dans la préparation de cet événement extraordinaire que la crise sanitaire va contraindre sans l’éteindre. On revient aussi sur la carrière de cette personnalité de la scène du spectacle vivant repérée depuis le milieu des années 1990. Boris Charmatz a déstabilisé le mouvement en le juchant sur un échafaudage pour Aatt enen tionon (1996), l’a déshabillé pour libérer le corps collectif dans Herses (une lente introduction) (1997), l’a secoué pour en faire jaillir des milliers d’éclats contradictoires dans 10 000 gestes (2017). Scène-paysage Pour La Ronde, que l’on découvre après, Boris Charmatz a invité une vingtaine d’artistes-chorégraphes dont des interprètes classiques de l’Opéra national de Paris, des comédiens handicapés de la troupe de l’Oiseau-Mouche, basée à Roubaix, des artistes-complices comme Anne Teresa De Keersmaeker, Emmanuelle Huynh mais encore Salia Sanou et François Chaignaud. Entre pas de deux déjà écrits et même repérés comme celui extrait du ballet Don Quichotte, et d’autres improvisés, une vingtaine de séquences vont se relayer. Lire l’enquête (en 2017) : La danse participative, selon Boris Charmatz Après le Turbine Hall de la Tate Modern à Londres, ou le tarmac de l’ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin, la nef du Grand Palais est une nouvelle expérience de scène-paysage sidérante pour Boris Charmatz. Le lieu est démesuré ; le vide palpable, où le regard se perd, se faufile, s’accroche, s’évade sans jamais épuiser la majesté de l’espace. Entre danse et théâtre, les interprètes y marchent à grands pas, s’y cognent, s’étreignent, faisant résonner autrement l’architecture. Le silence dilate le geste ; la musique, de Steve Reich à Bach en passant par Ravel, y claque. Pendant douze heures, du petit matin au coucher du soleil, La Ronde, ici réduite à une heure et demie, se reconfigure sans cesse dans une chaîne de pas de deux envoûtante. Le cycle de la vie emporté avec fougue par la danse. Lire le reportage (en 2017) : A Berlin, Boris Charmatz fait danser le tarmac Voir le teaser vidéo (1 mn 30) Boris Charmatz face au Grand Palais, documentaire de Claire Duguet et Sophie Kovess-Brun (Fr., 2020, 52 min), suivi de La Ronde, ballet enregistré au Grand Palais à Paris en janvier 2021. Rosita Boisseau « La Ronde », une création du chorégraphe Boris Charmatz, au Grand Palais à Paris, en janvier 2021. DAMIEN MEYER/AFP
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...