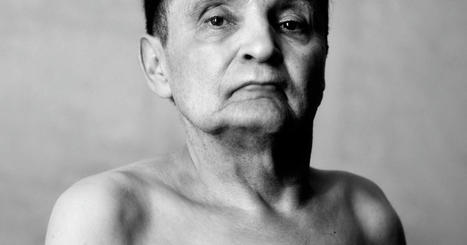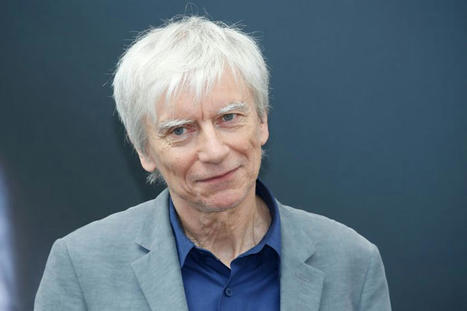Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2021 11:40 AM
|
Propos recueillis par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 16 mai 2021
« Je ne serais pas arrivé là si… » C’est dans le cinéma du village breton de son enfance que le metteur en scène acquiert la conviction qu’il sera « cinéaste ou rien ».
Cinéaste, metteur en scène au théâtre et à l’opéra, écrivain, Christophe Honoré, 51 ans, cultive la transversalité. La crise sanitaire a stoppé, cet hiver, sa création Le Côté de Guermantes, à la Comédie-Française mais son film, Guermantes, sortira le 15 septembre. Sa nouvelle pièce, Le Ciel de Nantes, sera présentée, cet automne, au Théâtre des Célestins, à Lyon. Je ne serais pas arrivé là si… …Si, tout simplement, il n’y avait pas eu un cinéma à Rostrenen, mon village d’enfance au cœur de la Bretagne [dans les Côtes-d’Armor]. J’avais 11-12 ans, les vendredis et samedis soirs, entre copains et copines, on allait tous au Ciné Breiz. C’était le lieu où on pouvait se rouler des pelles ! Qu’importait le film. Il y avait deux séances. Je me revois négocier avec mes parents l’autorisation de rester à celle de 22 h 30. Ils ne comprenaient pas mais me laissaient faire parce que le cinéma était proche du lotissement où nous habitions. Soudain, je découvrais des films qui échappaient au lot des comédies populaires, qui résonnaient en moi de manière plus solennelle. C’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser vraiment au cinéma, avec, par exemple, Paris, Texas, de Wim Wenders. C’est toujours étrange de se demander pourquoi, à 12 ans, on peut se fixer une sorte de ligne d’arrivée : ce sera cinéaste ou rien. Je suis surpris de la prétention et de l’entêtement de l’enfant que j’étais. En dehors de ces séances de cinéma, quelle saveur votre enfance avait-elle ? J’ai eu une enfance très préservée, protégée, à la fois très douce et assez ennuyeuse. Au collège, avec ma prof de français, nous faisions un journal et, évidemment, la chronique ciné m’avait été dévolue. Je devais sûrement citer des films dans mes rédactions ! Je prenais très à cœur cette critique mensuelle, j’avais l’impression d’être un passeur ! Mais, très vite, la question a été : comment s’échapper ? Tout en ayant déjà le sentiment de ne surtout pas vouloir trahir. Pourquoi « trahir » ? Quand on veut partir de quelque part où tout se passe bien, forcément les gens qui restent ont tendance à vous le reprocher, à vous dire : qu’est-ce qui te manque ? Lorsque j’ai commencé à parler de cinéma à mes parents, ils étaient effrayés. Je voyais dans leurs yeux une espèce de compassion, comme s’ils se projetaient dans mes futurs échecs. Pour eux, cela leur semblait insensé, donc il fallait gentiment m’en détourner. Au collège, en bon élève, je faisais tout pour plaire à mes parents et à mes professeurs. Mais au lycée, deux mois après ma rentrée en seconde, mon père est mort dans un accident de voiture. J’avais 15 ans, tout s’est effondré : c’était l’irruption d’une tragédie dans une enfance assez idyllique, un mélodrame car mes parents venaient d’avoir mon petit frère. Lire aussi - Christophe Honoré : « Ce temps imposé est un temps empoisonné » De cette idée d’invincibilité − qui me pesait parce que j’avais l’impression qu’il ne pouvait rien se passer dans ce petit village − surgit quelque chose de terrible, une explosion de vie mais qui, finalement, était aussi romanesque. Soudain, quelque chose pouvait advenir. Qu’est-ce que cette mort a changé ? Tout. Après la disparition de mon père, je me suis tout autorisé. On ne peut pas s’empêcher − surtout quand un tel événement survient à l’adolescence − de se dire que ça vous donne un élan. J’ai eu l’impression de ne plus devoir rien à personne. Ni à ma mère, ni à ma famille. Puisque la vie se comportait mal, il n’y avait pas de raison que je me comporte bien, en bon élève. Cette disparition m’a, à la fois, énormément construit et énormément détruit. Aujourd’hui, je n’ai plus la même analyse de cet événement que je pouvais avoir à 20 ou 30 ans. Quand j’ai commencé à écrire ou à faire des films, je voyais cela comme une fierté envers mon père, une manière de dire : tu vois, je m’en suis sorti, je peux faire du cinéma. Maintenant que je vieillis, je suis beaucoup moins persuadé qu’on se répare. Le manque, la violence de l’absence et l’injustice demeurent. Peut-être aurais-je été un meilleur cinéaste, plus fort et moins fragile, s’il était resté vivant. Je ne me dis pas : je me suis autorisé à rêver de cinéma parce que je n’ai pas eu à affronter mon père. Ça, c’est de la psychologie de bazar. La résilience, un des mots qui m’énerve le plus, je n’y crois pas. C’est une manière d’aveugler les gens et de s’aveugler soi-même. Après la disparition de votre père, quelle tournure a pris la vie avec vos frères et votre mère ? Quand mon père est mort, ma mère avait 36 ans. Elle se retrouvait seule avec trois enfants à charge et sans vraiment de métier. Elle avait aidé mon père, prothésiste dentaire, mais, comme beaucoup de femmes d’artisans, elle n’avait ni statut, ni fiches de salaire. Il fallait faire front ensemble. J’étais présent mais j’ai un peu laissé faire mon grand frère. Il y avait aussi l’homosexualité qui advenait à ce moment-là. Puis la jeunesse a repris le dessus et ma mère s’est bien débrouillée dans sa manière de prendre les choses en main. Quelques mois après la mort de mon père, avec mon grand frère, nous avons créé l’association le Théâtre du zénith. Avec des amis, on montait des pièces dans la salle des fêtes du village. J’avais mis en scène La Musica, de Duras en première partie et mon frère faisait ensuite Le Père Noël est une ordure. A l’issue de la représentation, des gens allaient voir ma mère et lui disaient : « Ton aîné il s’en sort bien, par contre, le petit, il n’a pas l’air d’aller mieux ! » Quand vous découvrez votre homosexualité, en parlez-vous à votre mère ? Non. J’estimais que cela ne concernait pas ma famille. Pendant mes années lycée à Carhaix [Finistère], je me suis affranchi du milieu familial. Comme beaucoup d’ados, j’ai eu une double vie. Cette période était plutôt joyeuse, pas du tout traumatisante, pleine de rencontres. Je ne me posais pas la question d’appartenir à une minorité. J’avais d’autres angoisses liées au danger du sida. Se découvrir homosexuel dans les années 1980, c’était penser, d’une manière assez naïve, qu’on n’y échapperait pas. Les campagnes de prévention ont été efficaces. On a fait très attention. Hétéros comme homos. Je détestais cette expression de « groupe à risque ». C’est une charge très lourde quand vous commencez, à 16-17 ans, à vous interroger sur votre identité. Mais le fait d’avoir vécu une tragédie familiale m’a permis de relativiser. Dans un sens, je savais ce qu’était le malheur, la catastrophe était déjà arrivée. Revenons à votre cinéphilie. En dehors du Ciné Breiz, comment s’est-elle construite ? J’aimais beaucoup passer l’été à Nantes, chez ma grand-mère maternelle : elle me laissait faire ce que je voulais, je me goinfrais de films chaque jour. Grâce à une rétrospective, j’ai découvert Jacques Demy [né en 1931 à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, et mort en 1990]. J’étais rassuré : on peut devenir cinéaste en étant Breton ! Je me reconnaissais dans sa manière de filmer les hommes et de rêver le cinéma depuis un territoire provincial très simple. Ça me touchait énormément. Aujourd’hui, je l’ai élu comme parrain imaginaire. Et puis, très jeune, j’ai commencé à lire les Cahiers du cinéma et les critiques dans les quotidiens. Il y a beaucoup de films que je n’ai jamais vus et que je n’ai que lus. Malgré une telle passion, vous ne ferez pas d’école de cinéma… Ma mère s’y opposait. J’avais, en cachette, envoyé un dossier pour l’école de cinéma de Bruxelles, la seule directement accessible après le bac. Quand j’ai annoncé à ma mère que j’étais pris pour passer l’oral, elle m’a dit : « Non, tu restes là. » Pourquoi ? Parce que, pour elle, j’étais assez fou comme ça ! Je peux la comprendre : ça l’angoissait, elle pensait que je n’y arriverai jamais, que les gens de notre milieu ne font pas ces métiers-là, que ce serait déjà formidable si je pouvais devenir ingénieur. Mais, artiste, il ne le fallait pas, c’était trop dangereux. Et puis, même si on n’en parle pas, la manière dont ma vie sensuelle s’organisait ne lui plaisait pas forcément. Donc, je n’ai pas eu le choix : ce fut Rennes mais j’ai réussi à aller en fac de lettres. La vie étudiante était festive mais j’ai perdu mon temps. J’ai déserté la fac, je passais mes journées au cinéma et je commençais à écrire. Je comprenais que je n’aurai jamais de licence, que je ne ferai jamais la Femis [Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son, à Paris] et que je devrai trouver une autre solution. C’est aussi l’époque où je me suis beaucoup investi dans un mouvement d’éducation populaire, les Ceméa [Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active]. Je suis devenu directeur de colos et je dirigeais des structures d’accueil pour des enfants défavorisés. Cela me plaisait, je me sentais utile. Cette période a aussi été très importante dans ma formation politique. J’étais plongé dans des débats idéologiques – l’accès à la culture, l’éducation comme pilier de l’égalité des chances, etc. – très formateurs et qui restent essentiels. Est-ce après cette expérience que vous allez écrire pour la jeunesse ? Oui, ce n’est que grâce à ça. En tant qu’animateur et directeur de centres de vacances, j’ai suivi une formation de littérature jeunesse. Je lisais tout, de la comtesse de Ségur aux ouvrages contemporains, ça me passionnait. En arrivant à Paris, l’idée que mon premier livre serait pour la jeunesse s’est imposée. Qu’est-ce qui a déclenché votre arrivée à Paris, en 1995 ? La lassitude de ma mère, qui a cédé : « Tu as le droit à un an à Paris. » A 24 ans, j’avais fait tous les excès, profité de ma vie étudiante, je pouvais envisager cette année très sérieusement. Il fallait absolument qu’il se passe quelque chose. Mais je ne connaissais personne à Paris. Très vite, je me suis mis à écrire Tout contre Léo, mon premier livre pour enfants. Parallèlement, grâce à une amie, j’ai été pris comme stagiaire pour le festival Premiers plans d’Angers [consacré aux premières œuvres cinématographiques européennes]. J’écrivais les fiches de tous les films, j’adorais ça. Claude-Eric Poiroux, délégué général du festival, m’a embauché et envoyé au Festival de Cannes. Là, ça a été la révélation. J’ai commencé un journal de bord de cinéphile que j’ai envoyé à Serge Toubiana, alors rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Une semaine plus tard, il me demandait de venir à son bureau. Au même moment, j’adressais mon livre Tout contre Léo à Geneviève Brisac, éditrice à L’Ecole des loisirs. Elle aussi m’a proposé un rendez-vous. Serge Toubiana m’a offert une chronique mensuelle « Le billet du spectateur ». Quant à Geneviève Brisac, elle a publié mon livre et m’a encouragé à en écrire un autre. Franchement, j’ai eu beaucoup de chance. Lire aussi: « Plaire, aimer et courir vite », une sonate du désir et de la mort Vous deviez être euphorique… Je voulais surtout rattraper le temps perdu. J’ai beaucoup publié à l’Ecole des loisirs. Geneviève Brisac a été essentielle, c’est la première qui m’a regardé en tant qu’artiste et m’a encouragé à écrire un roman, L’Infamille [Editions de L’Olivier, 1997]. C’est vraiment elle qui m’a donné l’autorisation de devenir romancier. Pour les scénarios aussi, j’ai attendu qu’un producteur me le demande. Quand vous êtes autodidacte, vous vous sentez imposteur. Je me suis beaucoup isolé. J’avais, au fond de moi, l’idée que c’était un scandale social que je sois à Paris. Cinéma, théâtre, opéra, littérature… Vous ne vous êtes jamais interdit de passer d’une discipline à l’autre… Au début, j’ai cru que c’était un problème et, très honnêtement, ça l’est forcément parce que vous progressez moins vite ! Quand j’ai créé, en 2012, la pièce Nouveau Roman, j’ai compris que c’était ma manière d’être contemporain, de brouiller la définition de ce que j’étais. Cette incertitude-là, cette impureté, me semblait correspondre à quelque chose de moderne. C’est ma réponse au désordre que je ressens autour de moi. Et de manière pratique, ça me repose. L’alternance vous permet de passer outre vos découragements. Par la suite, j’ai travaillé sur une même idée, autour la transmission et de la mémoire : le livre Ton père, le film Plaire, aimer et courir vite, la pièce Les Idoles. Là, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui commençait à créer du sens. Peut-on dire que ce triptyque a pour origine La Manif pour tous et une injure homophobe punaisée sur la porte de votre domicile ? Disons que La Manif pour tous, ce surgissement d’une homophobie claire et assumée qui refuse toute idée de famille pour les homosexuels, a accéléré les choses. Ayant une fille, je me suis dit : tu t’es aveuglé, tu as cru qu’il n’y avait pas de problème mais tu as refusé de voir le problème. D’où ce triptyque. Mais je n’ai eu de cesse d’interroger ce qui m’avait éduqué et formé, la Nouvelle Vague, le Nouveau Roman. D’où vient ce désir d’enfant ? Adolescent, dès que j’avais une petite copine, je voulais lui faire un enfant ! C’était une obsession ! Heureusement, elles étaient plus matures que moi ! Quand j’ai compris quelle serait ma sexualité, j’ai absolument refusé que cela m’enferme dans une impossibilité d’avoir des enfants. C’était essentiel. La naissance de ma fille m’a donné une énergie de travail et un désir d’être dans la vie. Vos films sont allés à Cannes, vos opéras à Aix-en-Provence, vos pièces à Avignon et à la Comédie-Française, qu’est-ce que cela vous inspire quand vous repensez à vos rêves d’adolescent ? Ça me semble toujours un peu fou ! C’est étrange, mais j’ai l’impression que ces projets, je les fais toujours depuis ma chambre d’adolescent de Rostrenen avec le sentiment que tout peut se terminer très vite. Sans doute est-ce pour cela que je suis vite angoissé si je n’ai pas un ou deux projets en cours. Je me sens encore très ado dans ma manière de travailler. J’ai encore besoin de mouvement. Le monde est tellement chaotique, incertain, violent… Les donneurs de leçons me terrifient, d’autant que ce sont souvent des leçons réactionnaires. Je ne crois pas que les artistes comprennent mieux que les autres ou qu’ils sont des témoins privilégiés. En revanche, ils peuvent, dans ces moments-là, affronter leur intimité. C’est ça qui domine tout ce que je fais. « Guermantes ». Sortie en salles le 15 septembre. « Le Ciel de Nantes », création prévue à l’automne 2021 au Théâtre des Célestins, à Lyon. Retrouvez tous les entretiens de la série « Je ne serais pas arrivé là si… » de « La Matinale » ici. Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2021 9:40 AM
|
Sur la page de l'émission En sol majeur, au micro de Yasmine Chouaki sur RFI - 15 mai 2021 La migration a plusieurs visages aujourd’hui. Celui du déplacement géographique, étant le plus identifié. Mais le déplacement de l’identité (racisée ou genrée) mitonne à petit feu sur notre Aujourd’hui. L’un de ces visages est assis (ou assise peut être) dans le fauteuil d’En Sol Majeur. écouter l'entretien (48 mn) Silhouette immense, laissant tomber en cascade une longue tresse de plus de 2 mètres, je sens que notre invité va me laisser me dépatouiller avec le féminin et le masculin, débrouille-toi ma fille avec cette créature du XXIème siècle, artiste compagnonne au TnBA (Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine). Notre invité queer est un cérébral qui s’entête. Il s’entête dans un corps à corps théâtral, expérimentant les mythes, les spectres, les muses, la souffrance et la jouissance. Vanasay Khamphommala, roi et reine de l’intersection nous arrive donc avec sa voix de haute-contre, son attachement aux philosophes Michel Foucault et Paul B Preciado et son histoire franco-laotienne... Les choix musicaux de Vanasay Khamphommala : Tarek X (Gérald Kurdian) I’m a somebody Haendel, Natalie Dessay Per te lasciai la luce

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 15, 2021 1:00 PM
|
Par Martine Pesez dans le Berry Républicain - 15 mai 2021 Alors que le déconfinement s’amorce, Olivier Atlan et son équipe préparent leurs cartons. Ils seront les premiers à investir, dès le mois prochain, la nouvelle Maison de la Culture de Bourges, dont le chantier s’achève à Séraucourt. « On touche au but ! » Oui, ça y est presque. À partir du 7 juin, Olivier Atlan, directeur de la Maison de la Culture, et son équipe, pourront prendre possession de leurs nouveaux bureaux. Et, pour la première fois depuis dix ans, ces bureaux - équipés avec du mobilier conçu et réalisé par l’atelier décor - seront tous au même endroit. Tous nos articles sur la MCB2 Hors les murs depuis fin 2011 Du jamais vu, pour ainsi dire, depuis l’arrivée d’Olivier Atlan à la tête de la scène nationale berruyère. Si l’on excepte cette brève période, de septembre à novembre 2011, où il s’est posé dans l’ancienne Maison de la Culture, à Bourges, il a toujours connu le hors-les-murs. Un cerf, une biche, un mouton bientôt sur les toits de Séraucourt, à Bourges
« Cela devait durer deux-trois ans, se souvient-il. Pour ce qui me concerne, cela aura duré huit saisons… » Il se félicite d’avoir pu, malgré la dispersion, « conserver la cohésion de l’équipe », mais se réjouit de la voir enfin réunie.
« Dans quelques jours, l’équipe technique va commencer le transfert du matériel vers le nouveau bâtiment, précise-t-il. On pourra commencer le déménagement le 7 juin ; le 11, le plus gros du Pré-Doulet sera dans la nouvelle Maison. Tout ne sera pas terminé, mais nous aurons accès à la partie bureaux, loges et stockage du matériel. Il y aura tout à installer : nous n’aurons pas de connexion internet, par exemple ! » OLIVIER ATLAN (Directeur de la Maison de la Culture) Le point sur le chantier de la future Maison de la Culture de Bourges Et pas question de recevoir qui que ce soit avant que la commission de sécurité ait donné son feu vert. « C’est la raison pour laquelle on garde les locaux du Pré-Doulet jusqu’en septembre. Pour le stockage, on se laisse une marge de sécurité jusqu’à la fin de l’année. » L’inauguration s’étendra sur le mois de septembre Une fois dans les murs, le plus gros restera encore à faire. « On va avoir énormément de boulot pour être en capacité technique d’accueillir des spectacles. Il faudra tout tester, les réseaux, le matériel, la lumière, le son, l’informatique… » De quoi occuper l’équipe technique pendant quelques bonnes semaines. Ensuite, en septembre, tout ouvrira en même temps : salles de spectacle, cinéma, restaurant. Une cérémonie officielle sera organisée à la mi-septembre - « on attend confirmation pour la date, cela dépendra des invités ». La ministre de la Culture, sûrement ; le président Macron, qui sait ? Mais pour les habitants, c’est un mois inaugural qu’Olivier Atlan annonce. « L’objectif est que la population s’approprie ce nouveau bâtiment le plus vite possible, qu’il devienne un lieu de vie, souligne-t-il. Tout ce qui sera fait pendant ce mois y contribuera. » « L’objectif est que la population s’approprie ce nouveau bâtiment le plus vite possible, qu’il devienne un lieu de vie. Tout ce qui sera fait pendant ce mois inaugural y contribuera. » Dotée de ce nouvel outil, la Maison de la Culture continuera ses actions de décentralisation dans le département, mais s’attachera tout de même, au moins pendant les deux prochaines saisons, « à faire fonctionner ce bâtiment à plein. On va essayer de l’ouvrir sept jours sur sept, avec des week-ends complets, plus de spectacles accueillis. Il faudrait qu’il y ait toujours de la lumière… » Place Séraucourt, à Bourges, les salles de spectacle de la nouvelle Maison de la Culture prennent forme [photos] Entre 2 Murs Contrairement à l’habitude, le programme de la saison 2021-2022 ne sera pas dévoilé avant le mois d’octobre. Mais la période de déconfinement s’ouvre à propos pour permettre à la Maison de la Culture de tourner symboliquement la page.
Une programmation intitulée Entre 2 Murs devait débuter le 18 mai. Elle commencera avec un jour de retard, le 19. « Je ne voulais pas que la saison s’achève à l’auditorium et qu’on se retrouve en septembre dans la nouvelle maison. »
D’où cette séquence de spectacles destinée à faire le lien, et qui, finalement, se prête plutôt bien aux contraintes sanitaires, avec ses jauges réduites.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 15, 2021 9:57 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 14 mai 2021 Crédit photo de couverture : Jean-Louis Fernandez. Parages 09 – La Revue du Théâtre National de Strasbourg – numéro Spécial Claudine Galea. Diffusion et distribution : Les Solitaires Intempestifs en partenariat avec SODIS et theadiff.
Pour illuminer la force transgenre – théâtre, roman, radio, ouvrages pour la jeunesse – d’une oeuvre prolifique, la revue convoque auteurs, artistes de théâtre et de cinéma, chercheurs : une pluralité d’approches et de témoignages pour saisir une écriture de l’intime, intense et décapante, qui interroge l’expérience d’être au monde, hantée par la violence des pulsions et du désir, la soif de libération, les blessures de l’enfance et de l’adolescence (Quatrième de couverture). Claudine Galea est à l’honneur de la revue Parages n°9 dont le rédacteur en chef Frédéric Vossier livre un entretien avec l’autrice – « Se retourner sur la langue » -, à propos de l’acte d’écrire. Sont évoquées les questions de paysage mental, de rapport organique et noueux à la langue. Claudine Galea dit ne plus croire à « l’adresse », notamment au théâtre : « On écrit sans destinataire. La destination a lieu si l’écrit parle aux autres. Cela ne peut pas se décider tout seul, toute seule. C’est une reconnaissance réciproque. La littérature est sans adresse, et les textes pour la scène font (pour moi) partie de la littérature. Ecrire vient d’avant soi et va ailleurs que soi. L’adresse est là, incluse ou forclose. Forclos, l’écrit n’atteindra personne. » (p.19) Sont publiés, à cette occasion, deux incipit de deux textes inédits : Nul soleil autre que le tien (d’après Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, d’une part et d’autre part, En allant vers Off Limits, un texte en cours d’écriture qui exhume la trace perdue d’Arthur Adamov et de son légendaire Off Limits, soit le chantier d’un nouveau déblaiement. On a plaisir à lire La vie de côté (été 2020), une correspondance écrite entre l’autrice et le « classique contemporain » Philippe Minyana, un échange sur ce qu’« écrire » veut dire. Ainsi, quelques lignes significatives de l’écrivain : « Bon, il ne faut pas se prendre au sérieux. Le syndrome Duras. Mais je suis sensible aux émotions que tu décris. Je les connais. Nous sommes des anxieux qui avons peur des changements de saison; qui avons peur du monde; l’effroi des événements qui font l’histoire; en ce moment, cette incertitude; l’écriture est sans doute liée à ça. A l’inconfort d’être au monde. Relire Cioran. L’écriture comme preuve d’une survie possible; tenir bon, pour ne pas se laisser aller. Se signaler. Être lu. Être relié. On a aimé les livres. On veut entrer dans des livres… » ( p.54) Suit une Conversation électronique sur l’écriture et la jeunesse de Philippe Dorin, Claudine Galea, Sylvain Levey et Nathalie Papin, auteurs pour la jeunesse, qui livrent par courriels leur réflexion sur le sens, l’exigence et la valeur d’une littérature pour les petits, les moyens et les plus grands. Claudine Galea clôt à sa manière sincère ces échanges par mails : « Ce qui me frappe, c’est la légèreté, que je devrais peut-être appeler allant ou élan, quand on écrit pour les enfants. Je me permets le ON parce que je ressens cela chez chacun de vous, à vous lire. N’y va-t-on pas avec autant d’allégresse parce que la joie que les enfants mettent à recevoir, à accueillir, est première ? Joie, excitation, curiosité, et aussi effronterie, malice. Je me sens moins seule quand j’écris vers l’enfance. Et vous ?… (p.63) Des auteurs autres encore évoquent la violente secousse que représente l’oeuvre de Claudine Galea : Au-dessous de l’image portfolio de Philippe Malone, Une Mère normale Une Fille sublime de Pauline Peyrade où elle s’adresse à Claudine Galea, évoquant « sa méthode ». Elle découpe, extrait, expose et commente des morceaux de l’oeuvre, évoquant des relations d’«hainamoration » (Lacan), entre les mères et les filles : un hommage-éclairs. Suit Un désenfantement de Christophe Pellet, et encore Variations autour de corps minéraux de Marina Skalova. Des artistes témoignent de la façon dont ils ont traversé les textes de Claudine Galea : Je reviens de loin / Serre moi fort (voyage aller-retour) du cinéaste Mathieu Almaric qui sort en 2021 un film Serre-moi fort, d’après le texte de 2003 de Claudine Galea, Je reviens de loin. Le cinéaste témoigne à la fois de l’éclat de son bouleversement et de son approche cinématographique. Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, signe de son côté, La Solitude du coureur de fond, faisant référence au texte de l’autrice en majesté de Parages 09, texte intitulé Au bord – soit la découverte d’une énonciation radicale impulsée par l’impudeur d’une réflexion politique, exploration des profondeurs inavouables de nos vies intimes. « Auteur, autrice, écrivain, écrivaine, le débat fait rage aujourd’hui et c’est bien. Cependant quand je titre cet article, après maintes corrections, j’en reviens toujours au coureur de fond. C’est mystérieux pour moi, mais ce qui traverse cette oeuvre toujours en perpétuel questionnement (cette quête infinie du lieu juste où écrire, ce remuement formidable, ce doit être épuisant), c’est une façon délibérée et joyeusement déplaisante d’échapper au genre, dans tous les sens du terme… » (p.113) Quant à la comédienne Cécile Brune, dont les propos sont recueillis par Frédéric Vossier, acquiesçant à la proposition de Stanislas Nordey d’incarner la parole frontale d’Au bord, alors en pleine préparation et répétitions, elle raconte dans Descente à nu le chemin du texte en elle. Stanislas Nordey la évoqué un texte dur, âpre, sans concession qui pourrait heurter la bien-pensance. L’incarnation de cette parole risque d’être éprouvante. Prévenue, Cécile Brune écrit : « Pour en revenir à la fameuse photo du Washington Post, celle qui est au centre du texte et qui montre une soldate tenant en laisse un prisonnier irakien, il se trouve qu’elle sidère l’autrice au point de l’inhiber dans son écriture… On trouve une écrivaine face à la difficulté physique et morale d’écrire… Cette photo fonctionne comme un révélateur…Claudine est donc obligée de revenir à la photo, à sa difficulté d’écrire à partir et à propos de cette photo en essayant de comprendre ce qui fait échec à l’écriture, ce qui est resté bloqué, le poids des relations avec sa mère, le noeud d’un rapport passionnel avec son ex-compagne. Tout cela est relié au leitmotiv de la laisse. Le maître-mot du texte. Et cela fait miroir avec soi : on a tous en nous une part de la laisse, une part de la soldate, une part du supplicié. C’est une réflexion qui part de l’observation de l’atrocité brute de la torture et qui se heurte à la découverte de l’attirance/répulsion pour la soldate. Cela conduit à réinterroger le désir sexuel, la prédisposition à un sadomasochisme latent, enfoui, au fond de soi. » (pp.118/119) Le metteur en scène Jean-Michel Rabeux se penche sur l’oeuvre de Claudine Galea, livrant Neurones miroirs, l’expérience d’un « foudroyage », à la façon de Derrida, le choc explosif d’un démantèlement des fondations, à partir de deux textes, Au bord et Un sentiment de vie (éditions Espaces 34) – expérience radicale. Il crée le premier en 2013, et crée le second à l’automne 2021. A propos d’Au bord, un extrait de Jean-Michel Rabeux : « Pour aller là, le texte interpelle l’enfance, parce que ce qui nous fait écrire, ou jouir, ou peindre, ou mettre en scène, dans ce sens-là c’est pareil, ce qui, secrètement, nous fait agir, ce sont les cicatrices de nos douleurs ou de nos merveilles enfantines. Nous tous, je veux dire que tous les êtres humains répondent de ces cicatrices, le reste c’est de la construction pour y échapper, pour domestiquer, pour survivre. Alors le texte se tourne vers la mère, il se tourne vers le père, il les convoque, les remémore. Ils semblent bien, les géniteurs, devoir répondre de cet au-bord-des-lèvres. » (p.124) A propos d’Un sentiment de vie de Claudine Galea, quelques lignes encore du même metteur en scène : « Dans Au bord, elle affronte le féminin du familial, ici c’est le masculin surtout. Elle se penche sur son père. Un père pied-noir, militaire de trois guerres, 39-45, Indochine, Algérie. Un père réac quoi, mais si doux. Une mère communiste, beaucoup moins douce, « l’un viscéralement anticommuniste l’autre viscéralement anticolonialiste (…) Le militaire ne frappait pas l’antimilitariste oui ». Waouh ! Ce n’est pas comme on lit dans les journaux ! Pas vraiment mainstream. On attendait l’inverse, peut-être… » (pp.125/126) Relevons encore le post-scriptum de Jean-Michel Rabeux : « Autrice, mot d’usage courant du Moyen Âge à la Renaissance pour désigner une femme de lettres. Il est interdit par l’Académie Française à la fin du XVII ème siècle. Il vient du latin autrix, il est récurrent chez Saint-Augustin, auctor est son masculin. En français, il est le féminin d’auteur, comme actrice est le féminin d’acteur, lectrice celui de lecteur, etc. celui d’etc… » (p.127) Critique de théâtre, Chantal Boiron mène un entretien avisé avec la comédienne Claude Degliame sur l’oeuvre de Claudine Galea, « Une histoire qui regarde chacun ». L’actrice talentueuse interprétait en 2014 à la MC93 de Bobigny Au bord de Claudine Galea dans la mise en scène de Jean-Michel Rabeux. Claude Degliame s’apprête à interpréter sous la conduite de celui-ci, en septembre 2021 au Théâtre de la Bastille à Paris, une autre pièce de la même autrice, Un sentiment de vie (Editions Espaces 34). Claudine Galea, commente-t-elle, « parle à chacun, de nos plongeons, de nos morceaux sensibles de vie, de nos corps qui tombent et se relèvent, du monde quoi ! Alors, ça donne vraiment envie à l’actrice que je suis de prêter ses jambes, sa bouche, son souffle, son âme, de servir de relais. On ne peut pas y arriver, mais on se relève quand même, c’est le jeu. Une danse, dit-elle. » (p.135) Le chorégraphe n+n Corsino et Claudine Galea signent Dancing Conversation – portfolio. La comédienne Marie-Sophie Ferdane écrit Claudine/ Patti/ Claudine : l’actrice incarne sur les scènes la parole de l’adolescente du Corps plein d’un rêve,depuis 2016. Elle joue ainsi Sept Vies de Patti Smith, une mise en scène de Benoît Bradel, directeur artistique de la compagnie Zebraka qui a adapté le texte pour en proposer une partition théâtrale et musicale. Marie-Sophie Ferdane révèle avec humour l’expérience de cette incarnation vive qui dévoile la genèse et la puissance du désir. Claudine Galea, apprend-on, est certes née à Marseille, mais sa naissance véritable a eu lieu à Ensuès-la-Redonne, le village dans lequel elle a entendu pour la première fois Patti Smith, à l’anniversaire d’une copine. « Vous croyez vivre, et puis un jour tout d’un coup, la lumière se fait sur le vertige de la vie, l’infini de ses possibles. C’est mystérieux, un peu terrifiant, et cela change le cours de votre vie à jamais. C’est Claudel, derrière son pilier d’église, c’est Claudine qui entend chanter Patti, c’est beaucoup de jeunes gens, la première fois qu’ils osent monter sur une scène et qu’ils découvrent dans ce noir soudain, dans cette disparition du monde réel, le chant infini qu’ouvre le théâtre. », écrit Marie-Sophie Ferdane. (p.147) Marguerite Gateau, réalisatrice à Radio France, évoque son compagnonnage artistique avec Claudine Galea, Claudine et le Bel Echange – une collaboration radiophonique de vingt ans, la révélation d’une dimension littéraire à part. La directrice des Editions Espaces 34, Sabine Chevallier, éditrice fidèle qui publie le théâtre de Claudine Galea depuis 2003 avec Je reviens de loin, est interviewée par Chantal Boiron : Claudine Galea ou le Corps-à-corps avec l’écriture. Journalistes et chercheurs sondent la profondeur d’une oeuvre complexe, intense et furieuse, parfois amorale mais lumineuse : Juliette de Beauchamp, dramaturge, Philippe-Jean Catinchi, critique littéraire, Sylvain Diaz et Sabine Quiriconi, enseignants-chercheurs en études théâtrales. Enfin, Jean-Luc Nancy, philosophe que la question du tragique au théâtre ne laisse pas indifférent, offre avec générosité une réflexion scénique de Au Bord, l’oeuvre-Gorgone de l’écrivain, Notes pour imaginer une mise en scène de Au Bord de Claudine Galea : « La première imagination concerne, bien sûr, la distribution. Il est pour moi nécessaire qu’il y ait deux comédiennes; d’une part, il y a deux moments distincts du texte, le premier en lignes, phrases ou alinéas détachés comme des vers (paradoxalement, cela ressemble à un chœur de tragédie bien qu’il n’y ait qu’une voix); page 20, commence le second moment, long monologue serré sans ponctuation ni passage à la ligne (sauf vers la fin). D’autre part, la voix, certes unique malgré cette rupture entre les deux moments, ne cesse pas de s’adresser à elle-même, de parler d’elle (« je pense que je… », « je suis celle qui… »), bref de se dédoubler comme d’ailleurs toute voix le fait dès qu’elle résonne… De manière générale, l’écriture de Claudine Galea est rythmique, faite de scansions brèves. C’est une succession d’arsis et de thesis – pour prendre la vieille terminologie prosodique, de temps levés et de temps posés. Tout près de la fin, ici, elle écrit : Je pense que c’est un vertige / Je pense que j’écris pour ne pas tomber. Toute écriture, peut-être, toute mise en forme (en scène, en acte, en oeuvre) est faite pour ça. Mais pas tout le temps sur le même mode. Ces lignes, cette scansion viennent au bout de ce texte. Il aura fallu sentir tout le temps le risque de la chute. C’est aussi pourquoi j’imagine qu’il pourrait être juste que la comédienne debout (chacune à son tour) vacille un peu parfois et se tienne au mur… » (pp.212/213) Une actualité Claudine Galea que la revue Parages commente, explore et analyse avec soin, pertinence et rigueur. Ainsi, Au Bord sera créé au TNS le 21 juin 2021 (du 21 au 29 juin, relâche le 24 juin) par Stanislas Nordey, et repris en avril 2022. Autre texte et autre mise en scène, Un Sentiment de vie (éditions Espaces 34) est créé le 20 septembre 2021 au Théâtre de la Bastille par Jean-Michel Rabeux, avec Claude Degliame et Nicolas Martel, et par Emilie Charriot, en allemand, le 17 octobre 2021 au Theater Basel (Bâle, Suisse), puis en français au TNS lors de la saison 2021-22, avec Valérie Dréville, actrice associée au TNS. Au cinéma, le film Serre-moi fort de Mathieu Almaric, adapté de la pièce Je reviens de loin (éd. Espaces 34), sort à l’automne 2021. Véronique Hotte Parages 09 – La Revue du Théâtre National de Strasbourg – numéro Spécial Claudine Galea. Diffusion et distribution : Les Solitaires Intempestifs en partenariat avec SODIS et theadiff.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2021 7:07 AM
|
Par Amélie Blaustein Niddam dnas Toutelaculture.com 7 mai 2021 La première aurait dû avoir lieu le 4 novembre 2020, mais le second confinement a empêché la pièce fleuve, quatre fois deux heures, de voir le jour. C’est finalement le 7 mai que les programmes du Festival d’Automne ont été distribués et que, dans la Commune occupée, l’histoire du théâtre a pu être merveilleusement racontée. Occuper et jouer C’est donc devant les occupants de la Commune et devant les professionnels que le metteur en scène proposait l’intégralité de son spectacle Théories et pratiques du jeu d’acteur (1428-2020). Une bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur-chapitres 1 à 28. À projet fleuve, titre fleuve mais titre clair ! C’est cela que fait Kurvers, dans les corps et les voix de Evelyne Didi, Camille Duquesne, Julien Geffroy, Michèle Gurtner, Mamadou M Boh, Caroline Menon-Bertheux et Yoshi Oida : raconter, transmettre de façon thématique l’histoire de l’art de l’acteur. Discours de la méthode Le procédé scénographique est emprunté à Jérôme Bel dont Maxime Kurvers fut l’assistant. Comme son maître, il dresse des portraits d’artistes, leur donne la parole dans un espace vide prêt à être rempli de corps et de mots. Ici, le procédé est légèrement différent puisque ce sont des portraits d’œuvres qui sont portés sur la scène. Chaque livre est choisi par l’acteur ou l’actrice en collaboration avec Maxime Kurvers dans un procédé souvent proche de la conférence. Et dans une introspection, le livre et l’interprète ne font qu’un et, bien évidement, chaque chapitre nous permet de rencontrer un acteur ou actrice. Etre en scène Nous avons eu la chance de pouvoir « lire » les chapitres 1 à 14, en deux fois deux heures, avec une pause fort agréable dans le grand jardin attenant au théâtre, cela se note ! Quand nous quittons La Commune, deux autres temps sont à venir. Ne vous attendez pas à une histoire du théâtre, ce n’est pas le sujet même si vous allez en découvrir beaucoup sur par exemple la place qu’à eu Lecoq dans la réhabilitation de la commedia dell’arte qui, on le découvre grâce à la leçon magistrale de Julien Geffroy dans un jeu d’Arlequin inoubliable, était elle oubliée au milieu du XXe siècle ! Je/Jeu Quel que soit le chapitre, finalement la seule question est la place du je dans le jeu. Il y a ce chapitre à hurler de rire campé par la clownesque Michèle Gurtner devenue l’autrice américaine Stella Adler. Nous basculons en un clip de boucle d’oreille, une perruque et beaucoup d’attitude dans le théâtre juif new-yorkais où l’imagination prend le pas sur l’expérience intime. Evelyne Didi, en partant de Diderot sur la question de la maîtrise des émotions, raconte comment gérer une scène quand le réel se rappelle à vous. En 1983, elle perd une dent en plein spectacle, the show must go on, elle se démerde, demande de la colle, continue et intègre tout cela au jeu ! L’immense Yoshi Oida vient lui même porter son livre, L’acteur flottant et explique comment « avoir l’air frais », comme « une fleur », quelque soit l’âge et l’état. Camille Duquesne, elle, excelle en ancien français comme dans la corporalité de la méthode Meyerhold où elle mènera tout le groupe dans un moment qui dit qu’en matière de théâtre le corps compte plus que le contenu des mots. Cela on le comprendra aussi dans le chapitre de Caroline Menon-Berteux sur l’acteur et sa sur-marionnette de Gordon Graig. Là, nous sommes dans la beauté pure et dans l’idée, très Régy, que c’est de l’ombre que viendra la lumière. Schizophrénie de l’instant Ce qui est séduisant, sensible et fascinant ici c’est la schizophrénie de l’instant. Cela va vite sept chapitres en deux heures. Cela veut dire que l’interprète doit, en quelques minutes, nous installer dans une autre histoire, dans un autre geste. Mamadou M Boh nous montre par l’exemple que pour bien jouer, il faut être vrai, c’est-à-dire, ne pas jouer. Tous sont incroyables car tous sont différents et chacun amène son bagage, ses choix, ses parcours. Meyerhold écrit, et Evelyne Didi raconte que c’est sa phrase préférée : « Le mouvement est la base de toute manifestation théâtrale, c’est-à-dire de toute manifestation collective ». Il y a évidement souvent de la beauté dans Théories et pratiques du jeu d’acteur, beaucoup de virtuosité. Il y a l’affirmation que le corps, que le mouvement est une parole. Et que l’imagination, qu’elle puise sa source dans la réalité ou dans la fiction, peut remplir la scène. Il n’est pas inutile, surtout en ce moment, de rappeler que jouer c’est sérieux, c’est un métier, dur. Essentiel quoi. Quant aux dates de représentations publiques, normalement le spectacle doit être repris au Festival d’Automne. À suivre. Visuel ©Willy Vainqueur

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2021 4:44 AM
|
Propos recueillis par Fabienne Darge (Lausanne (Suisse), envoyée spéciale du Monde) 14 mai 2021 Vincent Baudriller, le 5 mai 2021, à Lausanne (Suisse). ILKA KRAMER L’ancien codirecteur du Festival d’Avignon revient, dans un entretien au « Monde », sur les leçons, numérique et écologique, à tirer de la crise liée au Covid-19.
Après avoir dirigé le Festival d’Avignon en compagnie d’Hortense Archambault de 2004 à 2013, Vincent Baudriller, 53 ans, est à la tête du Théâtre Vidy de Lausanne, plaque tournante de la création européenne, depuis 2013. Les antennes toujours pointées vers le futur, il analyse les leçons – numérique et écologique, notamment – à tirer de la crise due au Covid-19, alors que son théâtre, comme beaucoup d’autres institutions culturelles suisses, a rouvert, jeudi 22 avril, dans le cadre strict d’une jauge de spectateurs limitée à cinquante personnes. Le Théâtre Vidy est un poste-clé de la création scénique européenne. Quels vont être les effets de la crise sur cette création ? Il faut d’abord dire que le paysage européen est très contrasté, entre les pays du nord de l’Europe – l’Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse… – où les aides publiques ont permis à la culture subventionnée de traverser la crise, et ceux du sud de l’Europe – Italie, Espagne, Grèce – où les aides sont moindres voire inexistantes, et où il va y avoir de gros dégâts économiques et sociaux sur la culture. Va-t-il y avoir au niveau européen un embouteillage de créations similaire à celui qui va se produire en France, avec ses conséquences : ralentissement de la production, diffusion limitée des spectacles ? L’embouteillage va en effet avoir une dimension européenne, mais il va lui aussi être vécu différemment selon les zones. Dans toute l’Europe de l’Est, en gros de Berne à Moscou en passant par l’Autriche et la Pologne, les théâtres fonctionnent avec des troupes permanentes et un système de répertoire, ce qui va leur permettre de continuer sans trop de problèmes. En Europe de l’Ouest, de Lausanne à Londres en passant par Madrid ou Lisbonne, où on rassemble des équipes pour monter des spectacles, ce sera plus compliqué : la nécessité de récupérer nombre de spectacles créés pendant la crise va entraîner ce fameux embouteillage qui va ralentir l’activité de création pendant trois saisons. Beaucoup de projets vont être reportés ou abandonnés, et bien entendu ce sont les plus fragiles qui seront le plus durement touchés. Les aides sont donc d’une importance capitale, et notamment le dispositif de l’année blanche pour les intermittents du spectacle, crucial pour une grande partie de la profession, en France et par ricochet en Europe. Lire aussi : Intermittents du spectacle, un prolongement de l’année blanche et des « filets de sécurité » pour 2022 Quelles réflexions retirez-vous de cette période sur les relations entre le spectacle vivant et le numérique ? On a été profondément empêchés dans ce qui est l’essence même du théâtre, c’est-à-dire la réunion d’êtres humains qui respirent ensemble dans un même espace et une même temporalité. Il fallait réagir, augmenter notre créativité, notre capacité à nous adapter. A Vidy, on a donc fait pas mal de choses sur le partage digital du théâtre, sans jamais oublier que le partage digital du théâtre, ce n’est pas le théâtre. C’est la grosse différence avec la performance, où le film de la performance fait œuvre : les films de Marina Abramovic, par exemple, sont exposés dans des musées, et ils font œuvre. Un film de théâtre ne fait pas œuvre, c’est fondamental de le comprendre. Une fois cela dit, on a décidé d’assumer comme on le pouvait notre mission de service public de la culture, pour arriver à garder le lien avec les spectateurs. Et quand on est complètement fermés, cela passe par le numérique. On a essayé de faire du sur-mesure, en s’ajustant en permanence, entre le streaming, les captations diffusées en direct, les spectacles sur Zoom, la mise en ligne de spectacles importants de l’histoire du théâtre, et le partage de débats et de conférences… Cette ouverture sur le numérique vous a-t-elle permis de toucher de nouveaux publics ? Oui, très nettement. Au niveau du partage du théâtre et de la médiation, le numérique permet d’amplifier le travail avec les publics qui ne peuvent pas venir facilement au théâtre, dans les écoles, le milieu carcéral, les hôpitaux… Sur Contre Enquête, spectacle de Nicolas Stemann inspiré du livre de Kamel Daoud, relecture postcoloniale de L’Etranger de Camus, cela a ainsi permis aux enseignants de réaliser tout un travail préparatoire avec leurs élèves. On poursuivra ce type de travail à l’avenir, quand le théâtre aura vraiment rouvert. Je pensais que le public allait peut-être commencer à en avoir assez de ce rapport digital au théâtre, mais ce n’est pas le cas, quelque chose s’est créé là qui peut stimuler la qualité des captations de théâtre, et participer de ce qui a toujours été mon but : l’extension du domaine du théâtre, amplifier la capacité du théâtre à faire parler et réfléchir. Vidy a pris, depuis quelques saisons déjà, un net virage écologique, à la fois au niveau de sa programmation et du fonctionnement même du théâtre. Pourquoi fallait-il selon vous absolument prendre ce virage ? Comme beaucoup de monde aujourd’hui, j’éprouve le sentiment qu’il faut profondément réinterroger et revoir le fonctionnement de la société, l’économie, les modes de vie, en fonction des perspectives, de plus en plus claires, concernant les dégradations de vie futures sur notre planète. Je trouvais que l’on ne parlait pas suffisamment de ces questions sur les plateaux. Je me suis dit qu’il fallait mobiliser bien plus sur cette question, et cette réflexion globale est devenue centrale dans la vie à Vidy. D’autant que nous entamions en cette saison 2020-2021 un vaste chantier de rénovation du théâtre. Quand on construit un nouvel équipement, il est fait pour durer quelques années, et on se demande ce que ce sera, un théâtre, dans vingt ou trente ans – et ce que ce sera, de vivre dans trente ans. Comment incite-t-on les artistes à travailler sur ces questions ? On leur passe commande ? Il s’agit plus de stimulation que de commande, et de regrouper des artistes qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années, comme l’auteur Frédéric Ferrer, avec son Atlas de l’anthropocène, ou la metteuse en scène britannique Katie Mitchell, qui a été la première artiste de théâtre de dimension internationale à mettre la question de la durabilité au cœur de sa pratique. On a aussi décidé d’aider des artistes qui se disaient intéressés par ces questions mais pensaient manquer des outils nécessaires pour les aborder. On a inventé un cycle, « Imaginaires des futurs possibles », où des artistes comme Laetitia Dosch et François Gremaud ont rencontré régulièrement des universitaires et penseurs comme Dominique Bourg, Cynthia Fleury, Bernard Stiegler ou, plus récemment, Vinciane Despret. Comment le théâtre peut-il articuler le local et le global, alors qu’il est devenu international, et que nombre de spectacles tournent dans le monde entier ? Cette interrogation est au cœur d’un autre de nos projets, appelé « Théâtre durable ? ». Il est né de discussions avec Katie Mitchell, donc, et avec le chorégraphe Jérôme Bel, qui ont déclaré qu’ils ne voyageraient plus en avion. Or leurs spectacles tournent dans le monde entier. Et il ne s’agit pas non plus de se replier sur soi-même : le théâtre a besoin de circuler, de la rencontre avec l’autre. Katie Mitchell et Jérôme Bel, qui vont tous deux créer un spectacle à Vidy la saison prochaine, ont donc imaginé une formule intéressante. Ils vont rester chez eux, et penser un spectacle qui va être créé par une équipe locale à Vidy – acteurs, dramaturge, techniciens. Et ce spectacle va faire l’objet d’un script, une partition comme on en écrit plus souvent dans le domaine de la danse. Ce script servira de base à d’autres équipes européennes, qui le mettront en musique avec leurs propres acteurs, dramaturges et techniciens. Le spectacle voyagera, mais pas les artistes qui le créent. Le projet est en train de prendre de l’ampleur, avec treize théâtres associés sous la houlette du Théâtre de Liège, lui-même porteur d’un projet intitulé « Théâtres en transition ». Cette réflexion sur l’écologie théâtrale amène-t-elle de nouvelles formes ? Oui, notamment grâce au rapport qui change entre le théâtre et le vivant, et donc entre le théâtre et l’espace naturel et l’animal. Ce n’est pas pour rien qu’on nous appelle un art vivant : le théâtre interroge cette question du vivant, du présent, de la coprésence. On travaille en étroite collaboration avec le ShanjuLab, un lieu inédit dirigé par Judith Zagury, qui explore les manières de faire participer des animaux à des spectacles. Cette collaboration a notamment permis à Laetitia Dosch de créer Hate, son spectacle avec un cheval, et à Stefan Kaegi d’imaginer Temple du présent, création avec un poulpe. En ouverture de la saison prochaine, on emmènera le public au ShanjuLab, situé dans un village à une vingtaine de kilomètres de Lausanne, pour un projet de coexistence entre humains et animaux. Fabienne Darge(Lausanne (Suisse), envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 13, 2021 4:03 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 12 mai 2021 Photo : François Clavier et Claude Guedj © Claire HALOUCHER Servie par deux formidables acteurs, pour son troisième spectacle, Pauline Masson adapte avec tact « Le Vieux Roi en son exil », récit autobiographique de l’écrivain autrichien Arno Geiger resserré sur l’histoire d’un couple que forme un fils, Arno, et son père, August, atteint de la maladie d’Alzheimer. « Puis, un jour, ce devait être vers 2004, il cessa d’un coup de reconnaître sa propre maison. Cela se produisit avec une vitesse surprenante, frappante, de sorte que nous ne pûmes d’abord y croire. Longtemps nous refusâmes d’accepter que notre père pût avoir oublié quelque chose d’aussi évident que sa propre maison. A un moment, je ne supportais plus ses instances et ses supplications, il répétait toutes les cinq minutes qu’on l’attendait à la maison, c’était intolérable. Alors je l’entraînais dans la rue et lui annonçais: La voici, ta maison ! » Ainsi dans Le Vieux Roi en son exil, l’écrivain autrichien Arno Geiger parle-t-il de son père sur lequel il voit progresser la maladie d’Alzheimer. Après avoir mis en scène Les Epiphanies (lire ici), poème d’Henri Pichette réputé injouable et d’ailleurs peu joué depuis sa création par Gérard Philipe et Maria Casarès, puis adapté Entre ciel et terre, le roman de l’Islandais Jón Kalman Stefánsson (lire ici), Pauline Masson, resserrant le texte initial, s’offre un nouveau tête-à-tête d’une belle intensité entre un fils, Arno, et son père, August. Rôles respectivement interprétés avec force par François Clavier et Claude Guedj. La scénographie, volontairement non réaliste, dit simplement le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur des lieux et des êtres. Le fils est aussi le narrateur qui nous raconte la vie rude de son père né en 1926 dans une famille de paysans de dix enfants où seul « l’Ancien avait droit à du miel, sauf le dimanche où c’était miel pour tous ». A 18 ans, il sera envoyé sur le front de l’est, fait prisonnier par l’Armée rouge, rêvant de revenir à la maison, maison où bien plus tard, quitté par son épouse après trente ans de vie commune et de nombreux enfants bientôt, malade, il dira vouloir être dans sa maison tout en y étant déjà. Le fils est tour à tour le récitant, l’observateur et le partenaire du père, lequel se dérobe, là et pas là, insaisissable, désarmant. Ce qui nous vaut d’étonnants et drôlatiques dialogues dignes du théâtre de l’absurde. Comment retrouver ce père qui est devenu autre, qui se dérobe au point d’apparaître parfois comme un étranger ? Comment renouer ? Comment atteindre une complicité qui n’avait peut-être jamais existé entre ces deux êtres ? C’est cette quête, finalement victorieuse mais précaire, que nous raconte le spectacle. A travers cette vie d’un vieil homme qui perd ses repères, Geyser entend dire « la maladie du siècle », un siècle qui a vu ses bases voler en éclats, « tous piliers effondrés ». La détresse de l’un engendre celle de l’autre, cependant leur union façonne leur force commune. L’éloignement les rapproche. L’empathie va grandissante bien que trouée, friable et fragile, elle est une conquête, par delà la démence, elle aussi grandissante. Vient le moment où, après dix ans, frères et sœurs décident de mettre le vieux père en maison de retraite. Le fils vient le voir. « Ces heures-là s’étirent, et j’ai le temps de prêter attention à bien des détails. Rares sont ceux qui échappent à ma vigilance, j’ai l’esprit net et lucide, toutes les choses affluent en moi, précises, comme si une vive lumière m’entourait soudain. C’est une singulière configuration. Ce que je donne à mon père, il ne peut pas le retenir. Ce qu’il me donne, je le retiens de toutes mes forces. » Spectacle créé début mai lors de deux représentations données devant un public de professionnels au Théâtre municipal Berthelot à Montreuil où il sera repris la saison prochaine lors d’une tournée en cours de construction.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 12, 2021 1:38 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama le 12 mai 2021 Fermé depuis octobre et occupé par les intermittents en lutte, le Théâtre de l’Odéon s’apprête à rouvrir le 19 mai prochain avec la reprise de “La ménagerie de verre”, de Tennessee Williams. Jauge réduite, programmation limitée, occupation des lieux… son directeur nous confie ses doutes et espoirs pour réussir le déconfinement. Le 19 mai au soir, Isabelle Huppert revient à l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour reprendre La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, un spectacle interrompu par le premier confinement. Le directeur Stéphane Braunschweig se prépare donc à une réouverture... que l’occupation de son théâtre par les intermittents pourrait bien perturber. Êtes-vous prêt à ouvrir le 19 mai, date où le public pourra enfin revenir dans les salles de théâtre ?
Nous le sommes. Nous nous préparons depuis un mois, c’est le temps qu’il nous a fallu pour tout mettre en œuvre. Quel est l’impact de la jauge d’accueil, fixée dans un premier temps à 35 % ?
Nous reportons à l’Odéon-Berthier (Paris 17e) le spectacle de Célie Pauthe, Antoine et Cléopâtre. Une jauge à 35 % n’aurait permis d’accueillir que 150 personnes, un nombre trop faible. En revanche, nous reprenons dans le 6e arrondissement La Ménagerie de verre, mis en scène par Ivo van Hove. Nous pouvons accueillir 290 personnes sur un total de 840. Ça en vaut la peine. Nous avons modifié les placements pour respecter l’écart des deux sièges. La Ménagerie de verre affiche complet sur cette jauge réduite. La location a été prise d’assaut par un public avide de revenir. À l’Odéon occupé, la culture entre en résistance N’est-ce pas frustrant d’afficher si vite complet ?
C’est mieux que de répéter pour rien pendant des mois. En tant que théâtre public, nous devons ouvrir. Nous recevons des subventions pour que les spectacles soient joués. Ces subventions nous permettront d’amortir les déficits induits par les jauges faibles. Ce n’est pas le cas des théâtres privés dont l’ouverture est rendue complexe, voire impossible, par ces limitations. Trois spectacles se joueront à l’Odéon jusqu’à la date du 10 juillet. Pourquoi ne pas avoir ouvert tout l’été ?
C’est inenvisageable. Depuis septembre, nous avons préparé cinq créations au lieu des deux ou trois que nous effectuons d’habitude. Les équipes permanentes arrivent au bout des heures qu’elles doivent accomplir dans l’année. “Un gros embouteillage se profile.” La crise a-t-elle modifié la saison 2021-2022 ?
Nous avons tenté de reporter le plus possible les spectacles annulés et de maintenir au maximum les nouveaux, en veillant à un bon équilibre entre les uns et les autres. Un gros embouteillage se profile. Si on veut soutenir l’emploi et la création, on ne peut pas se contenter de décaler la saison écoulée vers la prochaine. Pour cette raison, il y aura dans nos murs plus de spectacles qu’à l’ordinaire. Et un projet (celui de Tiphaine Raffier) que nous proposerons au théâtre Nanterre Amandiers. Faut-il encourager ce type de collaboration entre théâtres franciliens ?
Ce serait bien. À cette nuance près que la plupart des lieux sont dans des situations d’embouteillage. Ce n’est pas simple d’y trouver des créneaux disponibles, d’autant plus qu’à l’Odéon, nous programmons sur des durées de trois à quatre semaines. Une régulation peut avoir lieu à l’horizon de la saison 2022-2023, en pariant sur une évolution positive de la crise sanitaire. Les conséquences de l’interruption se feront sentir au moins sur toute l’année prochaine. Allez-vous adapter les formules d’abonnement pour un public susceptible de réserver au tout dernier moment ?
Nous ne changeons rien. À l’automne 2020, nous avons constaté que les gens prenaient leurs places tardivement. Mais à partir du moment où la couverture vaccinale aura produit ses pleins effets, et sous réserve d’un surgissement de variants récalcitrants, nous reviendrons dans un système normal. Seul un retour du « stop and go » pourrait compliquer la tâche. Les annonces d’Élisabeth Borne, ministre du Travail – prolongation de l’année blanche pour les intermittents jusqu’au 31 décembre 2021 et abaissement du nombre d’heures pour les primo-arrivants souhaitant accéder au régime – vous paraissent-elles suffisantes ?
Elles sont positives même si pas complètement satisfaisantes. Un geste clair a été fait pour protéger notre secteur. Néanmoins, il sera compliqué pour les jeunes d’intégrer le marché du travail dans la situation actuelle. Une difficulté qui guette par ailleurs l’ensemble des intermittents. Si une grande majorité des techniciens du spectacle pourra travailler, qu’en sera-t-il des artistes aux projets singuliers ? Le Théâtre de l’Odéon est occupé depuis mars par des intermittents. Comment allez-vous faire le 19 mai ?
Quarante-deux personnes occupent le théâtre jour et nuit. Lorsque j’ai appris que nous pourrions ouvrir, je leur ai expliqué que leur présence, telle qu’elle se déroule aujourd’hui, était incompatible avec une entrée des spectateurs. Les occupants ont investi l’ensemble des espaces du public, notamment le grand foyer. Je leur ai demandé de le quitter pour une autre salle. Option qu’ils ont rejetée et à laquelle ils ont répondu en suggérant de n’ouvrir que l’orchestre au public afin que eux puissent rester dans le foyer. J’ai refusé. Cela limiterait à 100 personnes le nombre des futurs spectateurs. La situation est donc bloquée. “Traiter les directeurs de nantis, c’est un discours habituel.” Avez-vous le sentiment d’être seul pour gérer ce dilemme ?
Je le suis. Comme le sont tous les directeurs de lieux, même si les cas de figure diffèrent des Centres dramatiques nationaux aux Scènes nationales en région. En ce qui concerne un théâtre national comme l’Odéon, l’État est notre tutelle. Il a fait des propositions qui vont dans le bon sens. Le problème des occupations est qu’elles portent des revendications qui vont au-delà du secteur du spectacle vivant. Il serait injuste que des exigences, sur lesquelles nous n’avons pas prise, bloquent les spectacles. La lutte sociale doit désormais trouver d’autres formes. Qui peut vous aider à dénouer le problème ?
Si j’ai bien compris ce qu’a dit la ministre de la Culture, c’est aux directeurs de lieux de prendre leurs responsabilités… La CGT Spectacle, à l’origine du mouvement, devrait, elle aussi, se montrer responsable dans un moment tel que celui-ci. Ne craignez-vous pas qu’une division dresse les uns contre les autres directeurs de théâtre et intermittents ?
Traiter les directeurs de nantis, c’est un discours habituel qui oublie le fait que nous sommes là pour redistribuer l’argent public. Nous ne sommes pas des nantis. Certes, nous avons le pouvoir de programmer, mais nous partageons les plateaux avec les artistes. J’ajoute que les moyens qui nous sont alloués ne sont que minoritairement dédiés aux productions des directeurs metteurs en scène.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2021 5:00 PM
|
Sur la page de franceinfo Culture le 11 mai 2021 Légende photo : "Roméo et Juliette" par la troupe de la Comédie-Française (VINCENT PONTET) France Télévisions a confirmé mardi que la cérémonie des Molières n'aurait pas lieu cette année, en raison de la crise sanitaire, mais le groupe va programmer cinq soirées du 31 mai au 4 juin pour mettre le théâtre à l'honneur. Le groupe public, diffuseur historique des Molières, avait indiqué fin mars à l'AFP qu'il n'y aurait pas a priori de cérémonie cette année. Un scénario que son organisateur, Jean-Marc Dumontet, espérait éviter, mais qui a été confirmé mardi. "Nous avons dû renoncer cette année à la cérémonie des Molières", a annoncé dans un dossier de presse Michel Field, directeur culture et spectacles vivants du groupe public, tout en confirmant le retour de ce rendez-vous culturel en 2022, année où l'on célébrera les 400 ans de la naissance de Molière. "7 ans de réflexion", "Papy fait de la résistance", "Les Chatouilles" Concernant les cinq soirées dédiées au théâtre sur les chaînes du groupe, France 3 ouvrira le bal le 31 mai avec "7 ans de réflexion", au théâtre des Bouffes Parisiens. France 2 suivra le 1er juin avec "Papy fait de la résistance" écrit par Martin Lamotte et Christian Clavier; et le 2 juin la plateforme France.tv proposera "Les Chatouilles ou la danse de la colère" d'Andréa Bescond et Eric Métayer.
"Roméo et Juliette" et "Le Petit-Maître corrigé" de la Comédie-Française Deux soirées dédiées à des pièces de la Comédie-Française sont également prévues : "Roméo et Juliette" et "Le Petit-Maître corrigé" le 3 juin sur la chaîne éphémère Culturebox; avant "Fables" et "Fanny et Alexandre" le 4 sur France 5. Les théâtres sont fermés en France depuis fin octobre, mais pourront rouvrir le 19 mai avec un siège sur trois disponible, et jusqu'à 800 personnes par salle maximum.
Article rédigé par

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2021 5:35 AM
|
Par Gérald Rossi dans L'Humanité - Lundi 10 Mai 2021
Avec moins de spectacles à l’affiche, le festival se tiendra du 7 au 31 juillet, selon un protocole sanitaire précis, a souligné le président d’AF&C, Sébastien Benedetto..
Avignon doit retrouver en juillet l’ambiance bouillonnante et souriante de son festival de théâtre. Ainsi, le off aura lieu du 7 au 31 juillet. C’est ce qu’a confirmé Sébastien Benedetto, le nouveau président de l’association Avignon Festival et Compagnies (AF&C), qui fédère ce off et publie le catalogue de tous les spectacles à l’affiche. Ce rendez-vous annulé l’an dernier pour cause de pandémie « sera difficile à tenir, mais il est vital pour le spectacle vivant », dit-il. En 2019, le festival avait attiré environ 300 000 festivaliers. Cette fois, des dispositions sanitaires particulières seront mises en place, a insisté le président qui, en janvier, a pris la suite de Pierre Beffeyte, démissionnaire. La volonté des compagnies invitées à « jouer le jeu » Deux principales dispositions seront mises en œuvre, explique Sébastien Benedetto : « Une jauge limitée à 60 ou 70 % de la capacité de chaque salle, afin de respecter la distanciation physique, et des créneaux de quarante à quarante-cinq minutes pour permettre le nettoyage et l’aération des salles entre deux spectacles. » Il est aussi question d’éviter aux compagnies successives de se croiser, de même pour les publics. Des dispositions particulières seront aussi mises en place dans les rues, pour faciliter la formation de files d’attente. Ces dispositions, établies par AF&C avec les services de la ville et le préfet de Vaucluse pourront s’accompagner d’autres mesures, comme la mise en place de sens uniques pour les piétons dans certaines rues, mais cela n’est pas encore tranché, ainsi que d’autres sujets comme l’installation de centres de dépistage, voire la nécessité d’un « passe sanitaire ». D’ores et déjà, des théâtres, tel Artéphile, qui a proposé aux compagnies qu’il accueille de jouer un jour sur deux afin de permettre au maximum d’entre elles de se produire, annoncent clairement leur volonté de « jouer le jeu », en respectant les principes énoncés. Même si certains tentent de revendiquer une « liberté de moyens face à ces critères sanitaires ». Sur le plan financier, le ministère de la Culture a débloqué l’an dernier « un fonds de soutien » de 800 000 euros. « Des aides sur l’emploi et pour les compagnies sont prévues », explique Sébastien Benedetto, précisant que « tous ces soutiens seront attribués selon des critères clairs et précis (…), on essaie d’aider tout le monde, mais il est inutile de faire le forcing », a-t-il prévenu. Le ministère devrait préciser ses dispositifs financiers prochainement. De son côté, Cécile Helle, la maire (PS) de la cité des Papes, insiste sur « l’urgence de pouvoir obtenir du ministère des réponses claires et précises tant du point de vue des protocoles sanitaires, des conditions d’accueil que des aides financières ». En 2019, 129 salles et lieux de spectacle du off ont accueilli environ 1 600 spectacles. Cette fois, on ne devrait guère dépasser « le millier, dans une centaine de salles » précise d’ailleurs Nikson Pitaqaj, directeur délégué du off. Plusieurs directeurs, comme Serge Barbuscia, du Théâtre du Balcon, appellent à réfléchir au futur face à une croissance constante. Guy-Pierre Couleau, président du syndicat national des metteurs en scène, tout en disant ne pas « masquer ses inquiétudes », se réjouit indirectement de cette baisse, évoquant une « reprise en main plus humaine ». Reste à savoir quel public sera au rendez-vous.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2021 9:45 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde 10 mai 2021 Légende photo : Des dizaines de professionnels (programmateurs et directeurs de salles) sont venus au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) pour assister à des lectures et performances, jeudi 6 mai 2021. PIERRE PLANCHENAULT A quelques jours de la réouverture, le 19 mai, les responsables de la scène culturelle de la ville ont hâte de retrouver le public tout en restant soucieux pour les mois à venir.
Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) a rouvert avant l’heure. Jeudi 6 et vendredi 7 mai, la première édition du Focus Festival, imaginée avant la pandémie et la fermeture des lieux culturels, s’est tenue. Malgré tout. Comme une sorte d’avant-première pour patienter jusqu’à la date tant attendue de la réouverture au public, mercredi 19 mai. Seule différence par rapport au projet initial : les portes de ce centre dramatique national (CDN) n’ont été ouvertes qu’aux professionnels. Des dizaines de programmateurs et directeurs de salles ont pu assister à des lectures, performances, esquisses de spectacles présentées par des artistes « compagnons » du TnBA, comme Baptiste Amann, ou issus de l’école supérieure du théâtre, tels que le collectif Les rejetons de la reine. « Nous avons hésité à maintenir ce rendez-vous, mais il y a eu une émulation dans l’équipe, nous avons tant besoin de ces retrouvailles ! », se réjouit la directrice du CDN, Catherine Marnas. Comme en écho à ce renouveau du spectacle vivant, le comédien Jérémy Barbier d’Hiver, en ouverture de son projet Mine de rien, fait dire à son personnage : « C’est bon de se voir, de se regarder, ça fait exister. » Lire aussi Pour la culture, une réouverture dans la défiance A Bordeaux, que ce soit dans les institutions publiques ou les établissements privés, les théâtres clament : « On est prêts ! » Prêts à renouer avec le public, à appliquer de nouveau les gestes barrières, à tourner cette page douloureuse d’une culture à l’arrêt. Mais tous ne rouvriront pas le 19 mai. Soit parce que la jauge imposée à 35 %, doublée d’un couvre-feu à 21 heures, n’est économiquement pas tenable et peu attirante quant à l’ambiance dans les salles, soit parce qu’il a fallu adapter la programmation aux conditions sanitaires et faire des compromis financiers. Heureux mais soucieux Si le TnBA reprendra, dès le 19 mai, le déroulé de sa programmation avec Un ennemi du peuple, d'Isen, mise en scène de Jean-François Sivadier, et Exécuteur 14, d’Adel Hakim, par Antoine Basler, il ne pourra pas, en revanche, accueillir As Comadres, d’Ariane Mnouchkine, les comédiennes brésiliennes n’ayant pas le droit de voyager. L’Opéra de Bordeaux débutera, quant à lui, le 30 mai avec Carmen, l’essentiel en version concert. Côté théâtres privés, beaucoup préfèrent attendre la jauge à 65 % et le couvre-feu à 23 heures le 9 juin : la salle du Femina accueillera, le 22 juin, le nouveau spectacle de l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré, et les théâtres Victoire, Molière et Trianon reprendront leurs comédies et autres pièces de boulevard la semaine du jeudi 10. « Pour fêter notre retour nous avons opté pour une formule qu’on pourrait appeler “facile, simple et pas chère” », résume Olivier Lombardie, administrateur général de l’Opéra de Bordeaux. Soit, pour 8 euros, un best of de Carmen en une heure, par l’Orchestre national de Bordeaux dans le bel auditorium. « Pour des raisons budgétaires mais également techniques, il était trop tard pour maintenir la production initiale de Carmen en version scénique au Grand-Théâtre avec 120 personnes sur le plateau, explique Olivier Lombardie. Il y a encore quinze jours, je pensais qu’on annulerait jusqu’à septembre. » Olivier Lombardie administrateur général de l’Opéra de Bordeaux : « Pour fêter notre retour, nous avons opté pour une formule qu’on pourrait appeler « facile, simple et pas chère » A quelques jours de la reprise, les responsables de la scène culturelle bordelaise naviguent entre plusieurs sentiments : heureux de rouvrir leurs portes mais sonnés par l’année qu’ils viennent de passer et soucieux face à l’avenir. Les souvenirs de cette période totalement inédite affluent. « On a fait un travail de Pénélope, certains spectacles ont été reportés quatre fois », témoigne Catherine Marnas, dont la saison 2020-2021 s’est résumée à dix-neuf représentations au lieu des cent quatre-vingts prévues. Tous gardent en mémoire le « coup de massue » du 15 décembre 2020, lorsque le premier ministre, Jean Castex, annonça la levée du deuxième confinement mais le maintien de la fermeture des lieux accueillant du public. « On l’a appris en regardant la télévision, il y avait une grande colère, une incompréhension alors que nous avions déjà une jauge réduite et une application stricte des gestes barrières », se souvient la directrice du TnBA. « Une chape de plomb s’abattait. On fermait le service public de la culture sans que cela ne suscite beaucoup de réactions. On s’est mis à s’interroger sur notre place, notre fonction dans la société », rapporte Olivier Lombardie. « On avait mal à l’âme. O.K., il fallait limiter les flux, mais pourquoi ce tout ou rien, tous les commerces ouverts, tous les lieux culturels fermés ? On avait la sensation d’être mis sous l’escalier comme un enfant puni », regrette Xavier Viton, ancien artiste lyrique devenu codirecteur de trois théâtres privés en centre-ville (le Victoire, le Molière, le Trianon), cumulant quelque 600 places. Mais, ajoute-t-il, « grâce aux aides, nos lieux sont restés debout ». Que leurs structures soient ou non subventionnées, les directeurs de lieux bordelais interrogés reconnaissent que les mesures de soutien (chômage partiel, fonds d’urgence, fonds de solidarité…) ont permis de surmonter la crise. « En mars 2020, nous avons créé l’Association des théâtres privés en régions pour faire entendre notre voix et cela a porté ses fruits pour obtenir des compensations », constate Xavier Viton, dont les lieux fonctionnent en autoproduction et font appel essentiellement à des artistes de la région. Au Théâtre Fémina, qui dépend du groupe Fimalac, la salle de 1 000 places est louée à des productions dans le cadre de tournées. « L’absence de visibilité a poussé tourneurs et producteurs à reporter leurs dates à la rentrée », explique la directrice, Malika Josse. Sur les quarante-cinq spectacles prévus en avril-mai-juin au Fémina, seuls trois ont été maintenus. « Maintenir l’excellence » « Combien de personnes dois-je embaucher pour septembre ? », s’interroge désormais la directrice, dont le lieu fonctionne, habituellement, avec dix intermittents techniciens et des dizaines d’étudiants pour des jobs d’ouvreurs. « Pendant la crise, mon responsable de billetterie est devenu menuisier et mon régisseur chauffeur-livreur », confie-t-elle. Au CDN et à l’Opéra, le travail a continué avec les équipes permanentes. Répétitions, accueil de compagnies en résidence, multiplication des interventions en milieu scolaire, captations. « En décembre, La Sylphide a été jouée dix-sept fois sans public. Il était fondamental de maintenir l’excellence des danseurs, musiciens et choristes de la maison », insiste Olivier Lombardie. Cette période a aussi été celle de la réflexion : quelle organisation pour l’après-crise, quels choix de programmation ? « J’ai envie d’être optimiste, on ne pourra jamais se passer du spectacle vivant mais il faut se réinterroger sur la façon dont on produit les spectacles, et multiplier les initiatives pour aller chercher les publics non acquis », défend l’administrateur général de l’Opéra. La saison 2021-2022 s’annonce « plus riche » à cause des nombreux reports de spectacles mais aussi « plus compliquée » à établir budgétairement. Prudent, le TnBA ne sortira qu’en septembre la plaquette de sa nouvelle saison. « Sur les reports, nous donnerons la priorité aux compagnies indépendantes, très impactées par la crise, et maintiendrons des créations », indique Catherine Marnas. En attendant, le CDN a fait le choix de réduire sa pause estivale : il sera ouvert jusqu’à fin juillet, proposera des spectacles en plein air pour tout public et reprendra dès le 24 août. Xavier Viton, directeur de théâtres privés : « Il va falloir aller chercher les spectateurs, les convaincre de faire à nouveau ce qui était jusqu’à présent interdit » Mais la crainte majeure est celle de l’attitude du public. Sera-t-il au rendez-vous de la réouverture ou frileux ? D’autant que mai-juin est, traditionnellement, la moins bonne période pour la fréquentation du spectacle vivant. « Il va falloir aller chercher les spectateurs, les convaincre de faire à nouveau ce qui était jusqu’à présent interdit », résume Xavier Viton. « Et à la rentrée, quels seront les protocoles, y aura-t-il encore de la distanciation ? », s’interroge Malika Josse, pour qui les mises en vente des dix-sept spectacles prévus en septembre tournent au casse-tête. En attendant, « l’humeur a changé depuis quelques jours, on sent une dynamique, une envie de montrer, de transmettre, de rompre avec la privation sociale qu’on a vécue », perçoit Dimitri Boutleux, le nouvel adjoint écologiste à la mairie de Bordeaux, chargé de la culture. Elu en pleine pandémie, cet urbaniste-paysagiste reconnaît avoir été, depuis un an, « en formation accélérée : les circonstances nous ont fait entrer dans le dur des dossiers et pas dans les petits-fours et les représentations extérieures ». Egalement président de la régie de l’Opéra de Bordeaux, deuxième employeur culturel en France avec ses quelque 400 salariés, l’adjoint dit vouloir faire de cette institution « un pôle de ressources et de synergie ». Le 19 mai, il ne sera pas au spectacle mais passera sa journée dans les musées bordelais. « Une ombre plane » Bon nombre de responsables l’assurent : la crise aurait favorisé le dialogue entre les structures et les élus, et entre secteur public et secteur privé. « La direction régionale des affaires culturelles nous a conviés à sa prochaine visioconférence avec les opérateurs culturels, C’est la première fois ! », se réjouit Xavier Viton. Les artistes eux, n’ont qu’une hâte : jouer. Mais, ressent Simon Delgrange, membre du collectif Les rejetons de la reine et ancien élève de l’école supérieure de théâtre de Bordeaux, « une ombre plane ». « Beaucoup ont continué à créer, la grande question est celle de l’embouteillage. Y aura-t-il des projets sacrifiés ? » Un poignard dans la poche, le projet très prometteur présenté par le collectif au Focus Festival du TnBA est prévu pour la saison… 2022-2023. Créer, produire et diffuser un spectacle reste un processus « de longue haleine », constate le jeune comédien. Et le temps perdu est difficilement rattrapable.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 9, 2021 2:38 PM
|
Par Ève Beauvallet dans Libération - 7 mai 2021 Légende photo : Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez dans «l'Etang» de Gisèle Vienne, au théâtre Vidy-Lausanne. (Estelle Hanania) Attendu de longue date, le spectacle de Gisèle Vienne avec la comédienne et Ruth Vega Fernandez pousse le spectateur à s’aventurer dans un royaume d’ambiguïtés, à questionner ses perceptions et à se confronter au tabou de l’inceste. Au fin fond du rêve dans le rêve, au sous-sol du subconscient, là où trois secondes durent trente ans, il y a une grande pièce avec une armoire noire à double fond. Derrière la porte de l’armoire, une petite boîte secrète attend d’être ouverte. Nous voilà dedans. La blancheur et le vide, ici, projettent une lumière illimitée et aveuglante. Les molécules d’air n’ont pas leur pesanteur habituelle. Le son est déréglé, certains mots créent une réverb de dingue. Les gens parlent à vitesse normale mais leur corps semble bouger dans une matière épaisse comme des sables mouvants. Ce «white cube» est magnifique et effrayant, il contient une maquette échelle réelle de chambre d’adolescent. On doit être quelque part dans les années 90, puisque Adèle Haenel, dans la boîte, porte un survêtement Sergio Tacchini, un sweat Fila et écoute de la techno hardcore style gabber néerlandais. Elle a l’air complètement défoncée. Et le spectateur aussi puisqu’il a probablement atterri dans son cerveau en pleine activité, une boîte à fantasmes qui pue le shit et l’éther, et qui tente de se remémorer un épisode clé. La serrure est dure à trouver : dans quelle strate du passé a t-on bien pu tomber ? L’histoire qu’on nous raconte dans la boîte blanche, une histoire d’inceste, probablement, c’est un fantasme, une fiction, un rêve ou la réalité ? Fritz /Adèle, l’adolescent, est-il un enfant violé ? Ou est-il un menteur ? Regardez-le, ce taré, il jouit quand il pense à sa sœur. Et puis il a fait semblant de se suicider pour tester le degré d’amour de sa mère. C’est bien la mère, au fait, cette bombe incendiaire, cette brune hollywoodienne, l’actrice Ruth Vega Fernandez, qui circule lentement autour de Fritz comme un satellite ? A moins que ce ne soit la sœur, ou même… Adèle Haenel regarde la créature de cinéma avancer lentement vers elle, la reconnaît enfin, effrayée : «Mais, c’est le père qui parle, là ?!» Dans l’Etang, pièce sans doute la plus attendue de la saison passée, et empêchée par les circonstances qu’on sait, les fantômes adorent se déguiser. A moins que ce ne soit plutôt la psyché collective, celle de toute une société, qui s’obstine à leur coller des masques pour mieux les dissimuler. Notre propension à camoufler la merde, et les conditions réunies pour qu’elle surgisse enfin, sont précisément le sujet de ce spectacle chatoyant comme un bonbon Haribo et violent comme un shoot. Elles lui inspirent surtout sa forme très ludique, dans laquelle les sons, les couleurs, la vitesse des mouvements et la trajectoire des mots disjonctent pour mimer les mécanismes de la perception. Le court-circuit produit une œuvre parmi les plus intenses et parfaitement sophistiquées de sa créatrice, Gisèle Vienne, cette metteure en scène, chorégraphe, marionnettiste étrange – à laquelle le Festival d’automne, à Paris, consacrera un grand portrait dès septembre – qui veille depuis des années sur un royaume fantastique un peu délaissé, celui de l’ambiguïté et des zones grises, des perversions et des désirs inconvenants. Iconographie Hammer Au cinéma, ce royaume a un prince glaçant, Michael Haneke. Le froid polaire de sa caméra n’a rien du baroque horrifique de Gisèle Vienne, mais il ne posait pas des questions si éloignées de l’Etang dans Caché (2005), film qui traitait d’un tabou national – non pas l’inceste mais le massacre d’Algériens en France en 1961 – et qui lui aussi, comme son titre l’indiquait, parlait surtout du regard. Sur le mode du jeu du chat et de la souris entre auteur, acteurs, spectateurs, voyeurs, c’était un dispositif de dissimulation et de révélation qu’on nous présentait. Il y a un autre référent que Gisèle Vienne semble ici révérer, et il est signé par un autre seigneur du royaume, côté théâtre cette fois, Romeo Castellucci. Ceux qui eurent la chance de voir le traumatisant et sublimissime Purgatorio (2008), repenseront sûrement à ce qui reste pour nous comme le plus grand chef-d’œuvre sur l’inceste (malheureusement jamais cité ces derniers mois sur le sujet). Le metteur en scène italien y posait la question du pardon – «L’insupportable, c’est que la victime puisse pardonner au bourreau», écrivait-il. Il jouait surtout sur la dissociation entre l’action visible sur scène dans le petit kammerspiel et celle, terrifiante, qui était dissimulée en hors-champ. Avec l’Etang, Gisèle Vienne s’assoit donc dans ce voisinage, en déposant sur la couronne ses réminiscences de cinéma bis et d’iconographie Hammer. Dans la pièce, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez suivent une partition très technique. Elles incarnent, jouent, métamorphosent ou fantasment plusieurs voix d’une même famille – ce qui leur a demandé de bosser la ventriloquie, cet art de la dissociation savante que la metteure en scène a souvent mis au service de petits contes détraqués comme Jerk, son «tube» traumatisant écrit avec l’écrivain Denis Cooper. Elles ressemblent à la fois à des personnages hyperréalistes – le phrasé de l’ado est tout à fait contemporain – et à des figures abstraites, marchant dans un ralenti extrême. Sur le plateau blanc comme un cauchemar, les deux comédiennes nous poussent à regarder sous les masques, mais elles nous invitent aussi à aller voir sous le texte. Car l’Etang est adapté d’une œuvre de fiction méconnue de Robert Walser. Mais la pièce l’articule en fait à deux sous-textes, produits à près d’un siècle d’écart. Poupées gigognes au carré Le premier, c’est la destinée intrigante du texte dramatique l’Etang, probablement écrit en 1902, qui n’avait pas vocation à être publié et encore moins mis en scène. C’est une œuvre privée, en forme de pièce de théâtre, que l’écrivain suisse Robert Walser a écrite pour sa sœur Fanny, auprès de qui il aurait toujours joué le rôle de conteur. Elle n’a révélé l’Etang que bien après sa mort. «Cette pièce de théâtre, qui n’en est peut-être pas une, explique Gisèle Vienne en note de présentation, m’apparaît comme la nécessité d’une parole trop difficile à exprimer sous une autre forme.» Certains s’étonnaient aussi qu’elle fut le seul texte que Robert Walser ait écrit en dialecte suisse-allemand. Un texte crypté, dit-on, dans lequel il est question d’un fils, Franz, qui simule un suicide pour conquérir sa mère, et que les commentateurs de l’œuvre de Walser ont vu comme l’évocation du tabou de l’inceste. La «vraie» mère, elle, dépressive, meurt alors que l’écrivain n’a que 16 ans. Le second sous-texte est celui des coulisses du spectacle. Gisèle Vienne a commencé à travailler sur l’Etang en 2016, avec la comédienne Kerstin Daley Baradel. Deux ans plus tard, Adèle Haenel rejoint le projet – une «rencontre artistique extrêmement importante pour l’une et pour l’autre, et le début d’une longue collaboration, on l’espère», précise Gisèle Vienne. En juillet 2019, la «chère amie et collaboratrice» Kerstin mourait prématurément. Encore quelques mois et Adèle Haenel, à la faveur d’un témoignage mondialement relayé, décidait d’ouvrir grand une petite boîte longtemps maintenue fermée, dénonçant dans Mediapart les agressions sexuelles qu’elle aurait subies du réalisateur de son premier tournage, et appelait à mettre à plat la fabrique du pouvoir et les mécanismes du patriarcat. Puis, fin 2020, alors que l’Etang n’en finissait pas d’être reporté, une autre sœur dévoilait au public un secret dont un frère n’avait pu se libérer. Camille Kouchner publiait la Familia Grande et obligeait toute une société à chercher au fond de l’armoire quel démon la dévorait. La pièce, elle, fut finalement donnée pour la première fois en public la semaine passée dans le fief du producteur Vincent Baudriller (le Théâtre Vidy-Lausanne), celui qui révéla au grand public Romeo Castellucci et Gisèle Vienne lorsqu’il codirigeait le Festival d’Avignon. Et c’est ainsi qu’une clé lancée au début du XXe siècle semblait enfin trouver sa serrure en 2021. Comme si le spectacle de Gisèle Vienne avait attendu un inter-texte ou un contexte pour achever sa forme de poupées gigognes au carré. L’une d’elles semblait nous interpeller, à l’heure où les salles françaises s’apprêtent à rouvrir : au fait, quel genre de spectacles nous a ou ne nous a pas manqué ? Quel genre de théâtre nous pousse à mieux regarder ? L’Etang, de Gisèle Vienne, d’après Robert Walser, les 15 et 16 juin à Douai, du 23 au 25 juin à Grenoble, les 5 et 6 juillet à Reims, les 8 et 9 juillet à Nancy, du 8 au 18 septembre à Paris dans le cadre du Festival d’automne (puis en tournée).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 9, 2021 1:50 PM
|
Par Anaïs Héluin dans France Culture le 7 mai 2021 Directrice de la fiction à France Culture, Blandine Masson met en récit l’histoire du genre radiophonique auquel elle se consacre depuis 25 ans. Aussi personnel que documenté, Mettre en ondes – La fiction radiophonique paru chez Actes-Sud Papiers, ce passionnant témoignage aborde notamment les rapports étroits que la fiction radiophonique entretient depuis ses origines avec le théâtre. Comme à peu près tous les médias et moyens de communication modernes et contemporains, le théâtre se sert régulièrement de la radio. Nul besoin en effet de creuser bien loin dans notre mémoire de spectateur – à moins qu’elle n’ait été très endommagée par une trop longue période sans spectacles – pour y exhumer des souvenirs de pièces traitant d’émissions radiophoniques réelles ou fictives. Ou encore de créations basées sur des techniques d’enregistrement ou de diffusion radiophoniques. En lisant le premier chapitre de Mettre en ondes – La fiction radiophonique de Blandine Masson (Actes Sud), « La scène invisible », nous revient par exemple le souvenir du petit tracteur qui, dans On traversera le pont une fois rendus à la rivière (2018) de l’Amicale de Production, faisait office de studio de radio à un agriculteur à la retraite et à son neveu. Leurs expérimentations radiophoniques étranges donnaient lieu à la fois à une émission diffusée sur les ondes, « Le Bruit des Combrailles », et à un spectacle réjouissant, inventif. On se rappelle encore de la création d’une autre compagnie belge, le Raoul Collectif, en 2016 au Festival d’Avignon. Dans Rumeurs et petits jours, un petit groupe de passionnés de l’antenne se révoltait d’en être privé. Là encore, la distance entre radio et théâtre était source sur scène d’un humour, d’un bricolage joyeux et libre. D’un mélange de jeu et de bruitages, présent aussi dans un autre de nos souvenirs théâtraux : celui de Zai zai zai zai, adaptation par la compagnie du Théâtre de l’Argument de la bande dessinée éponyme de Fabcaro. Dans cette pièce, la radio n’est plus le sujet, elle est la forme de la pièce : alignés devant une table, comédiens et bruiteurs équipés de casques font du théâtre exactement comme on fait de la radio. Ou font théâtre du processus d’enregistrement d’une fiction radiophonique, genre dont Blandine Masson retrace l’histoire dans son livre à partir de son expérience personnelle, depuis sa découverte en 1995 du métier de réalisatrice de fictions radiophoniques jusqu’à aujourd’hui. La radio, un art total Directrice de la fiction à France Culture depuis 2005, Blandine Masson se présente dans son livre comme l’héritière d’une histoire qui commence en 1924, année de diffusion de la première pièce radiophonique. En ouvrant son récit par un retour à ces origines, l’auteure met en avant la profondeur des relations entre théâtre et fiction radiophonique. Nos souvenirs de théâtre convoquant la radio ne sont sans doute pas si nets pour rien. « Tout au long de leur histoire mouvementée », dit-elle, « les hommes et les femmes de radio n’ont eu de cesse de vouloir divorcer du théâtre et en même temps de s’en rapprocher ». Jusqu’à ce que, récemment, les relations s’apaisent et donnent naissance à un dialogue ouvert, fertile pour les deux disciplines dont Blandine Masson, fille de comédienne – les pages qu’elle consacre à sa mère sont parmi les plus belles de son livre –, est l’une des meilleures incarnations. « J’ai souvent moi-même oscillé entre théâtre et radio, suivant les mêmes mouvements d’attirance et d’éloignement, mais toujours attachée aux acteurs, aux voix et au pouvoir magique des mots. J’ai senti très vite que le monde sonore pouvait tout absorber, tout réinventer et enchanter », écrit-elle. Les pages de Mettre en ondes regorgent en effet de noms d’artistes de disciplines diverses, qui tous ont plus ou moins longtemps, avec plus ou moins de passion, participé à l’histoire de la radio. Parmi toutes ces femmes et ces hommes que cite avec amour Blandine Masson, il y a le metteur en scène Jacques Copeau qui en pleine Seconde Guerre Mondiale participe avec un certain Pierre Schaeffer – un « intellectuel, polytechnicien, artiste, musicien, metteur en scène » – à la naissance d’un nouvel art : la « mise en ondes ». Soixante ans après, la directrice de la fiction à France Culture affirme que les « concours insensés » imaginés par les deux hommes pour permettre à la fiction radiophonique de s’affirmer « ont déterminé la bizarrerie, l’originalité et le statut atypique de ce métier tel qu’il existe encore à Radio France ». Cela malgré la grande transformation qu’il a connu récemment, en 2010, avec l’arrivée du podcast qui a permis la « sortie de la nuit radiophonique ». Hommage au maître du silence D’entre toutes les personnes à qui elle rend hommage dans son livre, il en est un qui revient plus régulièrement que les autres. Il s’agit Alain Trutat (1922-2006), homme de radio qui discrètement, en « silence » – ce mot fut d’ailleurs le dernier mot qu’il prononça, trois fois, rapporte Blandine Masson – a engagé en tant que directeur du service des dramatiques de France Culture un tournant qui a sans doute sauvé le genre auquel l’auteure de Mettre en ondes se consacre depuis maintenant 25 ans. C’est lui qui rebaptise « fictions » les émissions appelées jusque-là « dramatiques », affirmant ainsi définitivement leur autonomie par rapport au théâtre. Ce qui, loin de séparer les deux arts, redonne sens et force à une relation qui, du fait de quelques personnalités des deux bords – parmi lesquelles Lucien Attoun, qui crée « Théâtre Ouvert » à Avignon en 1971 à la demande de Jean Vilar – fut pleine de rebondissements. Recrutée en 1995 comme réalisatrice de fiction à France Culture par Alain Trutat, qui cultive chez elle l’art de l’écoute, Blandine Masson réussit avec son livre à rendre hommage au passé tout en regardant vers l’avenir. Déclaration d’amour à un métier méconnu, Mettre en ondes est de ces livres qui suscitent ou confirment une vocation. En s’affirmant maillon d’une histoire qui a commencé avant elle et qui continuera de se développer après, Blandine Masson met au goût du jour ce qu’elle appelle la « méthode Trutat » : « celle de la modestie vis-à-vis des plus anciens et du passé ». Après cette lecture, qu’une hâte : retrouver le chemin du musée Calvet à Avignon, où France Culture pose depuis 1996 ses micros pour toute la durée du Festival. On repensera alors à l’amitié presque secrète entre le directeur du Festival d’Avignon Alain Crombecque et Alain Trutat, qui parlait amoureusement d’Avignon comme d’un jardin : « Il faut y aller pour y planter, y montrer des fleurs. France Culture en Avignon, c’est comme une radio qui naît dans un jardin. C’est une parole que l’on expose dans un jardin et que l’on capte ». C’est de cet Avignon sauvage et partageur, audacieux, que l’on rêve aujourd’hui après une année d’arrêt. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr Mettre en ondes – La fiction radiophonique, Blandine Masson, Actes-Sud Papiers, 224 p., 18 €.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2021 11:31 AM
|
Publié dans Sceneweb le 16 mai 2021 Les artistes ont patienté 7 mois pour retrouver le public, et n’ont pas arrêté de travailler, de répéter, de se préparer pour cette rentrée printanière 2021 avec leurs équipes. Voici nos 20 têtes d’affiche pour une rentrée particulière. Tamara Al Saadi autrice et metteuse en scène de Brûlé.e.s dans le cadre du festival A vif au Préau CDN de Vire (du 25 au 29 mai). Révélée par le Festival Impatience, dont sa première création Place est lauréate en 2018, l’auteure, comédienne et metteure en scène franco-irakienne Tamara Al Saadi questionne avec sa compagnie La Base les mécanismes d’intégration et d’assimilation. Avec sa forme originale, Brûlé.e.s aborde l’âpreté de l’adolescence et de la violence sociale en nous immergeant dans l’énergie de ses échanges. Bachir, Marwan, Fatou, Reza et Tara se retrouvent enfermés dans leur collège après les cours. Si les quatre premiers font partie de la même bande, ce n’est pas le cas de Tara, traitée comme un bouc émissaire. Nacera Belaza chorégraphie L’onde à la MC93 (du 20 au 22 mai). Nacera Belaza aborde de manière frontale la question du rituel qui trouve sa source dans les danses traditionnelles et les pratiques millénaires, mais à sa manière, en plongeant les danseuses dans d’incessantes vibrations et un bain sonore mouvementé. Comme dans les danses anciennes ritualisées qui la fascinent, où chacun.e engage tout son être, L’Onde unit les danseuses dans un état de communion quasi hypnotique, les enracine, révélant à notre regard une autre manière de percevoir les corps dansants. Une vibration se propage de corps en corps, un frémissement, un mouvement infini. Naéma Boudoumi autrice et metteuse en scène de Daddy Papillon, la folie de l’exil à La Tempête (du 19 au 23 mai). Dans Daddy Papillon, la folie de l’exil, Naéma Boudoumi fait appel au cirque, au théâtre et à la danse pour dessiner le monde intérieur d’un immigré. Avouant être « la fille d’un père sujet à l’hallucination et à la bouffée délirante », l’artiste confirme ce qui n’est dans Daddy Papillon que sous-entendu : la dimension très personnelle de ce spectacle. Son rôle réparateur pour Naéma Boudoumi, qui éclaire sa difficulté à choisir entre un récit linéaire de l’exil et une évocation plus poétique. Entre une histoire ancrée dans le contexte franco-algérien, avec les tragédies et les non-dits que l’on connaît, et une histoire plus ouverte. Chiara Bersani chorégraphie Seeking Unicorns aux RCI 93 (les 27 et 28 mai). Chiara Bersani est une artiste italienne travaillant dans le domaine des arts de la scène. Son premier travail chorégraphique, Family Tree, a reçu plusieurs prix, dont le Perspective Dance Award 2011. Atteinte d’une forme modérée d’ostéogenèse imparfaite, elle s’intéresse à la signification politique d’un corps en interaction avec la société, notamment avec la série Political Bodies débutée en 2013. Dans Seeking Unicorns, performance intense, l’artiste italienne réhabilite la licorne, créature imaginaire et fabuleuse, mais aussi symbole de fragilité et jouet de nos représentations. Chiara Bersani qui mesure 98 cm, fait partie des personnes qu’on appelait jadis les « nains ». C’est terminé : « Je prends la responsabilité de dessiner l’image que le monde aura de moi », affirme-t-elle, dédiant son solo à l’insaisissable figure de la licorne. Rébecca Chaillon dans Dépressions avec Mélanie Martinez Llense – Les SUBS (du 20 au 22 mai). Depuis une dizaine d’années, Rébecca Chaillon crée avec sa compagnie Dans Le Ventre des spectacles centrés sur les paroles et les corps féminins. Des performances engagées, féministes et décoloniales. Pour la réouverture des Subs à Lyon, elle présente avec Mélanie Martinez Llense, Dépressions. Coupé par les vents violents des inégalités qui déferlent dans le monde actuel. Rugir, tonner, se déchaîner, mugir, gronder…Ces X-woMen comptent bien se défaire de l’étranglement dans lequel leur cou est serré. Avec l’audace et la transgression des codes – théâtraux et sociétaux – qui caractérisent leur travail, Rébecca Chaillon et Mélanie Martinez Llense se donnent toutes entières sur scène, n’hésitant pas à mettre leur corps à rude épreuve. Ouragan en prévision ! Céline Champinot met en scène Les Apôtres aux cœurs brisés dans le cadre du Festival Théâtre en Mai au Théâtre Dijon Bourgogne (du 22 au 25 mai). Dans la continuité des deux premiers volets de sa trilogie, Vivipares (Posthume) et La Bible, vaste entreprise de colonisation d’une planète habitable, Céline Champinot, artiste associée au TDB depuis 2017, secoue les idées reçues et déconstruit les mythologies, avec le ton impertinent et joyeux qu’on lui connaît. Avec finesse et folie, Les Apôtres aux cœurs brisés bouscule les codes du théâtre, floute les frontières entre les époques et les personnages aux obsessions mystiques. Un spectacle à l’univers pop et décalé porté par cinq prodigieuses comédiennes. Sonia Chiambretto autrice et metteuse en scène de Paradis au Théâtre Ouvert (du 25 au 27 mai). Une nouvelle vie débute pour Théâtre Ouvert, dans ses locaux de l’Avenue Gambetta. Jusqu’à la fin juin, la programmation est en accès libre (sur réservation). On pourra y découvrir la nouvelle création de Sonia Chiambretto, Paradis. Tout a commencé en bas de chez moi. La ville où j’habite accueillait le temps d’un week-end la crème des romanciers à succès. Des micros avaient été installés sur chaque place pour des lectures publiques, ou des entretiens. En marchant, je suis tombée sur un garçon syrien qui voulait prendre la parole. Il ne parlait ni français, ni anglais. J’ai tout de même compris qu’il voulait parler dans un micro. Il préparait sur son ordinateur ce qu’il voulait dire. Il venait de Syrie et c’était un moment de grand chaos. Évidemment il n’a jamais eu le micro. Il ne comprenait pas pourquoi, et moi non plus. C’est le point de départ d’une amitié et d’une enquête rocambolesque : pendant deux ans je me suis acharnée à essayer de sauter par-dessus la barrière de la langue, pour enfin comprendre ce qu’il voulait nous dire ce jour-là. Tünde Deak met en scène D’un lit l’autre aux Plateaux Sauvages (du 22 au 29 mai). Tünde Deak a travaillé en résidence la saison passée pour explorer différents enjeux du spectacle avant sa création : aspects littéraires et travail préparatoire pour les créations sonores et vidéos. Une question commune se pose : comment Frida, empêchée, alitée, paralysée peut prendre de la place, sa place, alors même qu’elle ne peut pas bouger ? Dans D’un lit l’autre, Céline Milliat-Baumgartner incarne une émouvante Frida. Hospitalisée, elle se souvient de sa vie, de ses créations, de chansons qu’elle invente. À ses côtés sur scène, la danseuse et acrobate argentine Victoria Belen lui répond. Simon Falguières met en scène Le nid de cendres à La Tempête (du 19 au 23 mai). « Le Nid de cendres est l’histoire d’une rencontre entre mon écriture et une famille de jeunes comédiens talentueux. Elle est écrite pour eux, pour leurs voix ». L’auteur à peine trentenaire s’attache à faire entendre dans sa fable l’écho de notre présent, mêlé aux histoires millénaires des contes. Et embarque le public à chaque représentation dans une fête théâtrale. Une aventure commencée il y a quatre ans dans la classe libre du cours Florent que le metteur en scène Simon Falguières a intégré à 25 ans parce qu’en tant qu’auteur, il lui manquait de ne pas « jouer ». C’est l’acte théâtral rêvé de dix-sept jeunes artistes qui se retrouvent autour du poème dramatique d’un auteur contemporain et auquel ils travaillent depuis quatre ans. Marie-Sophie Ferdane dans La 7e vie de Patti Smith au Théâtre 14 (du 1er au 5 juin). 1976. Claudine Galea. Patti Smith. L’une a seize ans, l’autre trente. L’une grandit dans la banlieue de Marseille, l’autre s’émancipe à New-York. L’une dévore la vie, l’autre la cherche. Et soudain une après-midi, sur la côte Bleue, la rencontre arrive immanquablement. La grâce d’une voix traverse le corps de l’autre et à partir de ce jour une histoire va relier ces deux femmes comme deux âmes sœurs. 2008. Pour le raconter, Claudine Galea invente une pièce radiophonique Les 7 vies de Patti Smith pour France Culture puis écrit un roman Le corps plein d’un rêve. 2016. Benoît Bradel et Aurore Lebossé s’emparent du roman de Claudine Galea et composent avec elle une partition textuelle et musicale incarnée par Marie-Sophie Ferdane. Claudine Galea autrice à la une de Parages 09 – la revue du TNS, parution le 3 juin. Parages consacre son prochain numéro à l’écrivaine Claudine Galea pour qui la littérature, quels que soient la forme ou le genre, est la mise à jour de l’inavouable, de l’enfoui, un engagement écrit, troublant et fructueux, de ce que l’expérience a d’impossible à vivre et à raconter. Deux de ces pièces font l’actualité de la rentrée. La 7e vie de Patti Smith au Théâtre 14 (voir plus haut). Et Au bord au TNS Elle se livre dans un entretien avec Frédéric Vossier pour dévoiler en profondeur le fait pur et simple de l’écriture. Nous publions une correspondance écrite qu’elle a menée durant l’été 2020 avec le « classique contemporain » Philippe Minyana. Dans un échange électronique, elle partage avec des auteur·rice·s pour la jeunesse, Philippe Dorin, Sylvain Levey et Nathalie Papin, une réflexion sans guide sur le sens d’écrire pour les petits, les moyens et les moins grands. Des auteur·rice·s ont participé à ce numéro en vue d’expliquer pourquoi et comment cette œuvre était terriblement marquante : Philippe Malone, Christophe Pellet, Pauline Peyrade, Marina Skalova. Isabelle Huppert dans La Ménagerie de Verre – Théâtre de l’Odéon (du 19 mai au 9 juin) Avant de jouer cet été dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon dans La Cerisaie, dans la mise en scène de Tiago Rodriguez, Isabelle Huppert retrouve les planches dès le 19 mai pour la reprise de La Ménagerie de verre avec une jauge réduite à 35%. Au parti-pris onirique souvent utilisé pour embarquer cette pièce où les souvenirs succèdent au souvenir, comme un enchevêtrement de rêves brisés, Ivo van Hove a répondu par un réalisme flottant qui, sans être totalement naturaliste, tire le quotidien de la famille Wingfield du côté du vécu. Dans un ersatz d’habitation souterraine, qui accentue encore l’impression de huis-clos, Amanda s’impose comme une southern belle tyrannique et étouffante. Denis Lavant dans L’image à l’Athénée (du 26 mai au 5 juin) On ne le disputera pas : mieux vaut une “foirade” de Beckett que la réussite de quelqu’un d’autre. En marge des romans et des grandes pièces, on trouve dans l’œuvre quelques menus trésors qui révèlent peu à peu un paysage mental. Poursuivant leur compagnonnage au long cours avec Samuel Beckett entamé avec Cap au pire, Denis Lavant et Jacques Osinski feront entendre L’Image, et quelques magnifiques “foirades”. Un spectacle conçu “comme un impromptu, un moment musical où il s’agit de saisir une beauté fugace.” Cécile Laloy chorégraphie IE – Famille à La Comédie de Saint-Etienne (du 26 au 28 mai) Au sein d’une même famille, des événements incompréhensibles et parfois violents se répètent inlassablement. Mués par des émotions explosives, les corps semblent comme condamnés à extérioriser une souffrance qui refuse de dire son nom. À l’initiative d’une femme, qui ne s’exprime qu’avec ses mains, les secrets vont se mettre à transpirer et ce que l’on a pris soin de taire, peu à peu se dévoiler. Pour mener cette enquête passionnante sur l’atavisme générationnel, la chorégraphe Cécile Laloy met en place un détonnant tableau familial composé de quatre danseur.euse.s (dont un enfant), d’un musicien multi-instrumentiste et d’une comédienne interprète en langues des signes. Muriel Mayette-Holtz met en scène la Trilogie Goldoni au Théâtre National de Nice (du 20 au 29 mai) Muriel Mayette-Holtz met en scène la trilogie Les Aventures de Zelinda et Lindoro, une comédie romanesque qui tricote et détricote les contradictions amoureuses. Les deux protagonistes Zelinda et Lindoro s’aiment depuis toujours mais ils sont contraints de cacher leur liaison et se réfugient chez Don Roberto, pour travailler à son service. Construit comme un feuilleton, nous suivons les personnages à travers leur quotidien et les nombreuses épreuves qui les malmènent. Stanislas Nordey met en scène Le soulier de satin à l’opéra Garnier (du 21 mai au 13 juin) et Au bord au TNS (du 21 au 29 juin) et joue dans Mithridate au TNS (du 31 mai au 8 juin) L’infatigable directeur du Théâtre National de Strasbourg est sur tous les fronts. Sa mise en scène de la version opératique du Soulier de Satin d’après la pièce de Paul Claudel, sur la partition de Marc-André Dalbavie fait la réouverture de l’Opéra national de Paris. Ce nouvel opéra est la troisième des créations mondiales commandées par l’Opéra national de Paris composant le cycle sur la littérature française. Puis il sera sur la scène de son théâtre, au TNS, le 31 mai pour incarner le rôle-titre de Mithridate de Racine. Le metteur en scène Éric Vigner voit dans cette œuvre crépusculaire le dernier sursaut d’un homme hanté par sa disparition et celle du monde hellénistique, dont il est le dernier rempart. À l’heure de notre mort, quel regard porte-t-on sur notre vie, qu’avons-nous transmis ? Robyn Orlin avec Camille Biennale en ouverture des Nuits de Fourvière (1er et 2 juin) puis à Chaillot pour sa nouvelle création (17 et 18 juin) La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin retrouve la chanteuse Camille dans sa nouvelle création. Un concert performance saisissant d’émotions. Elle confronte son univers à celui de Camille, chanteuse virtuose et inclassable flirtant volontiers avec le folk, le R’n’B, les percussions corporelles façon Bobby McFerrin et même la danse – qu’elle pratique pieds nus. Puis inspirée par l’univers chamarré et politique des rickshaws zoulous, Robyn Orlin sera à Chaillot avec sa nouvelle création pour huit jeunes danseurs de la Moving into Dance, qui fut l’une des premières compagnies de danse non raciale de Johannesbourg, elle met en scène derrière les parures des rickshaws la « sale histoire » de leurs conditions de vie d’alors. La souffrance, l’ironie, la beauté et la dignité traversent cette œuvre forte, monument dédié à ces travailleurs noirs. Thomas Quillardet – met en scène deux spectacles adaptés d’après des scénarios d’Éric Rohmer à La Tempête (du 1er au 20 juin) et Ton Père au Monfort d’après le roman de Christophe Honoré (du 17 au 28 juin) Comment traduire la douce mélancolie rohmérienne sur un plateau de théâtre ? Un vers de Rimbaud Où les cœurs s’éprennent donne son titre au premier diptyque réuni par Thomas Quillardet Le Rayon vert et Les Nuits de la pleine lune. Pour La Tempête, un autre scénario de Rohmer sera également présenté, L’Arbre, le maire et la médiathèque joué par les mêmes acteurs. Une création hors cadre spectacle joué en extérieur au parc Floral. Grâce à un dispositif en quadrifrontal, recouvert d’une moquette verte, le metteur en scène cherche, avant toute chose, à capter et à cultiver l’attention de ses spectateurs, au long d’un geste artistique d’une sobriété renversante. Tel un chef d’orchestre, le narrateur – quasiment dépersonnalisé pour tendre vers une forme d’universalité – chemine dans l’espace autant que dans sa vie, et invoque les personnages rencontrés au gré des glissements de son récit. Leyla-Claire Rabih met en scène Traverses au Théâtre Dijon Bourgogne dans le cadre du Festival Théâtre en mai (du 21 au 23 mai) TRAVERSES est un projet documentaire et intimiste autour des migrations syriennes et de la diaspora. Il naît d’interviews menées par l’équipe à travers l’Europe (Liban, Grèce, France …). Lors de ces rencontres, seules les mains ont été filmées, rendant à la fois plus intimes et universels les témoignages collectés. Entre théâtre, performance, et projections, l’équipe raconte autant qu’elle se raconte, dans un dispositif en archipel qui se décline en fonction des lieux. La Syrie est secouée depuis 2011 par des événements tragiques dont les ondes de chocs dépassent très largement ses frontières. D’origine syrienne, je suis traversée intimement par ces événements et ils se sont imposés dans mon travail artistique. Depuis 2017, plusieurs volets de recherche dans différents pays traversés par la vague de migrants de l’été 2015 (ateliers de pratiques théâtrales auprès de demandeurs d’asile, de réfugiés, interviews) ont permis de construire un corpus de témoignages, de parcours, de narrations, de documents sonores et visuels. Fanny Soriano chorégraphie Fractales au Théâtre de la Cité Internationale (du 19 au 24 mai) Au sein d’un univers en constante mutation, constellation faite d’éléments sortant de terre, suspendus ou pendulaires, rayonnent cinq individus. Par le langage du cirque et du mouvement dansé, mettant en exergue le potentiel physique décuplé offert par un corps acrobate, ils accompagnent la lente métamorphose de l’environnement dont ils font partie intégrante. Après Hêtre (2015) et Phasmes (2017), Fractales décline un nouveau volet du travail de recherches de la compagnie Libertivore, autour de la place de l’homme au sein de la Nature en le confrontant cette fois à l’inconstance d’un paysage en transformation.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2021 8:19 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 17 mai 2021 Le dramaturge et chorégraphe allemand, qui a notamment travaillé avec Pina Bausch, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à 72 ans. Il avait su faire de sa malformation une force dans ses spectacles. «L’avenir des corps m’intéresse beaucoup, à travers la génétique, par exemple: un corps comme le mien n’existerait plus. On en aurait fini avec les corps hors normes.» (1) Est-ce cette émotion particulière qu’on venait chercher chez ce chorégraphe du temps, de la mémoire, de la trace ? La nostalgie de ce qui a déjà disparu mais surtout le pressentiment de ce qui bientôt n’existera plus ? Raimund Hoghe est mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à 72 ans. L’émotion, sur les réseaux sociaux, s’exprime à l’échelle internationale, dans le milieu du théâtre et de la danse, chez tous ces «voyeurs» à qui Raimund Hoghe a un jour offert un luxe : «Il existe une théorie affirmant que les spectateurs veulent voir sur scène des corps auxquels ils peuvent s’identifier. Avec mon corps, cette identification n’a plus lieu d’être, personne n’a envie d’avoir mon corps. Donc le spectateur est renvoyé à son propre corps, comme un voyeur.» Portraitiste talentueux Le corps de Raimund Hoghe a grandi sans jamais grandir dans l’Allemagne d’après-guerre. Né d’un père qu’il n’a pas connu, enfant malade dans un pays dévasté, privé des rares médicaments qui auraient pu soigner sa «malformation», sa colonne vertébrale s’est courbée en une bosse qu’il portera à vie et exposera sur scène. Non comme un geste d’ «empowerment» comme les normalisent désormais les conférences Ted, mais dans une adresse au public moins défiante, plus vulnérable, et surtout plus cryptée. Il aurait posé moins de problèmes à la société allemande, pensait-il, s’il s’en était clairement mis au banc. S’il avait mendié dans les rues, par exemple, et n’était pas devenu ce qu’il fut : un portraitiste talentueux pour le quotidien Die Zeit d’abord, dans lequel il raconte des parcours en dehors des normes, ceux de petites gens comme de célébrités. Puis gardien des secrets de la chorégraphe Pina Bausch, dramaturge au Tanztheater de Wuppertal pendant la décennie 80-90, celle de Nelken (1982) et de ces jeux de séduction cruels dans les pétales d’oeillets roses. De Pina Bausch, il disait : «Comme elle, je suis obsédé par l’amour. Je ne me suis jamais senti digne d’être aimé.» Enfin, il devint plus tard l’ordonnateur de sa propre étrangeté, dont il fit la caisse de résonance de l’histoire d’un pays, cette Allemagne détestée pour continuer à confondre, en était-il persuadé, la différence et la laideur. Parfois, on a pensé qu’il fut pour l’Europe ce que Kazuo Ōno et son butô (danse de mort) fut pour le Japon post-Hiroshima. L’acteur et auteur Peter Radtke, handicapé par la «maladie des os de verre» a dit un jour à Raimund Hoghe : «On va au théâtre pour regarder et non pour détourner les yeux.» Il y aura donc ce premier solo, créé à 45 ans, tissé autour de la figure de Joseph Schmidt, ténor juif allemand persécuté par les nazis et qui mesurait la taille du chorégraphe, 1m54. La pièce s’intitulait Meinwärts, «Vers moi-même», comme un engagement à se rendre à soi. Sa silhouette difforme, quasi mythologique, apparaissait à la lisière du plateau comme extraite d’un plan de Pasolini. Pasolini dont Raimund Hoghe découvrait au début des années 80 les dessins, et avait conservé ses mots : «Le cri du silence muet», «avide d’amour», «au-delà de toutes ténèbres», «cette quantité monstrueuse de tendresse desespérée», et cette ligne qui sonne aujourd’hui comme un épitaphe, «jeter son corps dans la lutte». Petits indices En France, Jean-Marc Adolphe le programme au Théâtre de la Bastille, Laurent Goumarre au Festival Montpellier Danse. Le public découvre autre chose qu’un freak ou un personnage de conte. Il serait sans doute sorti de la salle si Raimund Hoghe avait pris le plateau comme une thérapie. Certains spectateurs sont restés, et ont appris peu à peu à regarder dans l’obscurité. Celle d’un plateau minimaliste ponctué de petits indices (un petit mouchoir blanc, une ombrelle), orné de rituels minuscules et lents. Celle d’un paysage bizarre où rôdent davantage des créatures que des personnages, des figures que des danseurs, des apparitions que des actions. A lire aussi : article du 1er févr. 1997 Il prenait, disait-il, des musiques qu’il trouvait belles (la Callas souvent), des objets et des corps qu’il trouvait beaux, et les plaçait tout contre son corps, qu’il trouvait laid. Dans Quartet, en 2015, deux héroïnes d’antan, une femme brune et une femme blonde – presque celles de Mulholland Drive – semblaient remonter le cours du temps, sur des vieux tubes de salle de bal des années 50. A l’occasion de cette création, présentée au festival Montpellier Danse, la danseuse Marion Ballester, la blonde, nous disait de lui : «Il invite à à envisager le corps comme porteur de traces, comme quelque chose d’archaïque, de fondamental. [Avec lui, c’est] un autre rapport à la durée, un hors temps.» En avril 2020, il aurait du présenter à la Ménagerie de verre à Paris son dernier spectacle, Musique et mots pour Emmanuel, un solo créé pour Emmanuel Eggermont, danseur et chorégraphe avec qui il avait notamment créé l’Après midi (2008). Une autre pièce revisitait un ballet de Nijinski, Sacre (2004), un rituel de mise à mort où il n’y avait ni victime ni sacrifié, mais deux êtres qui s’aidaient mutuellement pour enrayer leur destinée. Eve Beauvallet - Libération (1) Entretien donné en 2002 au Frankfurter Rundschau.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 15, 2021 10:06 AM
|
Sur la page de l'émission de Chloé Cambreling "L'invité(e) Culture" sur France Culture, le 15 mai 2021 Le comédien et metteur en scène Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France - Centre dramatique national.• Crédits : Fred Durgit - Maxppp À quelques jours de la réouverture des lieux culturels, entretien avec le comédien Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France - Centre dramatique national, président de l’Association des Centres dramatiques nationaux et membre du Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle. écouter l'émission (30 mn) Nous sommes à quatre jours de la réouverture des bars, des restaurants, mais aussi des théâtres. Tous ne rouvriront pas, pas tout de suite en tout cas, car certains manquent de moyens pour s'adapter, s'organiser. Pour les théâtres qui vont rouvrir, il va parfois falloir faire avec les mouvements d'occupation qui se poursuivent. En même temps, de nombreuses questions émergent : comment repartir et pour faire quoi ? Suffit-il d'accueillir de nouveau le public pour le retrouver ? Qu'est ce qui, ces derniers mois, nous a manqué ? Le comédien, metteur en scène, Robin Renucci, dirige le Centre dramatique national itinérant des Tréteaux de France. Il préside l’Association des Centres dramatiques nationaux et est membre du Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle. Il est notre invité ce matin. Avec la fermeture des théâtres, il nous a manqué la relation physique à l'autre : avec la voix, le son, qui ne passent pas par des outils techniques, avec des humains qui projettent les mots de poètes, des auteurs. La bataille des imaginaires à mener est plus importante que jamais. Notre imaginaire a été confiné, réduit à des outils. Ces outils sont intéressants, ils proposent beaucoup d'images. Mais cette relation physique qui fait que l'humain parle à l'humain est essentielle : la voix, l'échange symbolique du langage entre nous est ce qui nous fait humain. ---------------------- _Dès l'école, il faut promouvoir l'éducation artistique, multiplier les expériences esthétiques à tous les âges et à tous les niveaux de la formation. Il s'agit aussi de renforcer le soutien à la création artistique et de favoriser la plus large participation à la vie culturelle : cela demeure un enjeu démocratique majeur. La culture n'est pas une matière consommable à laquelle il suffirait d'avoir accès, ni un secteur économique qui se contenterait de vendre des biens. Elle est une relation au monde qui vise à la production de valeurs, d'idées, de langage. Encore faut-il pouvoir la vivre pleinement, de manière intime et partagée. ------------ Ce n'est pas parce que l'on n'a pas la connaissance de la culture qu'on n'est pas plein de culture. Et nous rencontrons, dans le cadre des Tréteaux de France, des communautés chargées de culture. _(...) L_a division aujourd'hui de nos sociétés, se joue entre ceux qui peuvent parler, qui peuvent dire et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir nommer. Quand on n'a pas les mots, on a la pulsionnalité : on se sent démuni et c'est là qu'on devient violent. Cette capacité de résoudre les conflits par l'échange, la parole, cela s'apprend dès l'enfance, en famille, et les gens qui viennent à nous comprennent très vite, au delà du théâtre, qu'il s'agit de citoyenneté. Pour aller plus loin :

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2021 7:30 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération le 14 mai 2021 Les occupants du théâtre du ZEF, le 20 mars à Marseille. (Yohanne Lamoulère/Libération) Après six mois de report des créations, plusieurs responsables s’impatientent et craignent que les représentations ne puissent se tenir. Qui ouvrira, qui n’ouvrira pas, et pour montrer quoi ? Le problème peut sembler simple. Dans un grand nombre de théâtres, il est insoluble. Sur le site du Théâtre de l’Odéon, son directeur Stéphane Braunschweig cosigne un appel à lever les occupations avec Macha Makeïeff (centre dramatique national de la Criée, à Marseille), Serge Dorny (Opéra national de Lyon) et Muriel Mayette-Holtz (théâtre national de Nice). Leur conclusion : «Nous n’imaginons pas que ceux qui portent comme mots d’ordre la défense du secteur culturel de notre pays, le retour à l’emploi de dizaines de milliers d’artistes et de techniciens et techniciennes, puissent s’opposer aux réouvertures.» Le temps presse. A l’Odéon, nul ne sait encore si les représentations de la Ménagerie de verre, qui affichent complet du 19 mai au 9 juin, pourront se tenir. Ni même celles de Berlin, mon garçon, un monologue de Marie NDiaye écrit à la demande de Stanislas Nordey, plusieurs fois reporté. Ou les très attendus Faith, Hope, and Charity d’Alexander Zeldin qu’on aurait dû voir lors du dernier Festival d’automne et Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza, mis en scène par Aristide Tarnagda, dramaturge burkinabé. «Ça fait des mois et des mois qu’on annule des spectacles. On passe des heures à caler des reports. J’ai besoin que ces spectacles se jouent car sinon, ils sont morts», lance Stéphane Braunschweig, un brin excédé. Faire venir des acteurs du Burkina Faso et d’Angleterre, payer la mise en quatorzaine de dix jours que le contexte pandémique impose… au risque qu’ils soient bloqués. Le directeur de l’Odéon a proposé aux occupants une présence en alternance : «Ils occuperaient le théâtre jusqu’à 16 heures avant de partir pour nous laisser accueillir le public jusqu’à 18 heures.» Le point d’achoppement est celui de la nuit, la direction refusant que les occupants reviennent dormir dans les locaux. «Irrecevable», estiment ceux qui ne peuvent laisser les théâtres ouvrir tranquillement sans perdre tout moyen de pression. Conserver une tribune Certes, numériquement, les théâtres occupés sont en perte de vitesse. Mais ils sont de plus en plus visibles. Et les occupants entendent bien conserver «une tribune», pour obtenir l’abrogation définitive de la réforme de l’assurance chômage et un plan de relance fort pour la culture. Certains lèvent le camp après de longues négociations en échange d’un autre lieu de réunion que les pouvoirs publics concèdent à leur laisser. C’est toute l’ambiguïté de ces occupations dont certaines furent accueillies par des équipes d’abord solidaires… A la tête du Tandem à Douai, Gilbert Langlois se souvient des premiers étudiants arrivés dans l’Hippodrome (nom de l’une des salles) : «On avait noué un dialogue sur la question des artistes dans la société. Puis soudain sont arrivés d’autres gens, qui voulaient camper jour et nuit. Mais je n’avais pas les moyens d’assurer une surveillance nocturne à demeure. L’occupation a pris fin dans un contexte tendu.» Le gardiennage coûte cher : «Pour un mois, dans les 90 000 euros. Tant mieux pour les vigiles, mais aucun théâtre n’avait prévu de placer ses subventions dans la sécurité», glisse, mordant, un administrateur. Le Théâtre de la Cité à Toulouse, évacué par les forces de l’ordre, peut se targuer de souhaiter la bienvenue à son public avec pas moins de quinze pièces qui s’échelonnent du 19 mai au 21 juillet prochain, dont X par le collectif OS’O du 26 au 29 mai. Si tout va bien… Les occupants chassés ont d’ores et déjà annoncé qu’ils bloqueraient l’ouverture du théâtre le 19 mai. Peut-être en compagnie du Grand Cerf bleu, le collectif qui devait présenter ce soir-là sa dernière création.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2021 5:42 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello, 13 mai 2021 Je suis encore en vie, un spectacle muet de Jacques Allaire. Très librement inspiré de la vie de Nadia Anjuman poétesse afghane battue à mort par son mari et de Syngué Sabour de Atiq Rahimi (prix Goncourt)
Le spectacle de Jacques Allaire, Je suis encore en vie, compose un diptyque sur l’aliénation avec Les Damnés de la terre d’après l’œuvre de Frantz Fanon, création qu’on a pu voir en novembre 2013 au Tarmac. Aujourd’hui, Je suis encore en vie s’attache particulièrement aux destins et exils des femmes fuyant les oppressions : guerres, régimes politiques, religions ou familles. À l’origine du spectacle, s’imposent divers écrits féminins sur les maltraitances ou répudiations physiques ou symboliques subies – la Vietnamienne Duong Thu Huong, la Rwandaise Esther Mujawayo, la Bangladaise Talima Nasreen, la Franco-Algérienne Souâd Belhaddad. Mais l’inspiration vient d’abord du roman d’un écrivain franco-afghan, Atiq Rahimi, Singué sabour (Pierre de patience). Ce Prix Goncourt 2008 est écrit par un homme à la mémoire de Nadia Anjuman, poétesse afghane sauvagement assassinée par son mari. Or, la mise en scène de Jacques Allaire s’installe sur la scène comme la métaphore théâtrale de la « pierre de patience », la signification en perse de Singué sabour, cette pierre magique que l’on pose devant soi pour déverser sur elle ses malheurs et ses misères, tout ce qu’on n’ose pas révéler aux autres. Comme une éponge, la pierre absorbe les confidences amères jusqu’à ce qu’elle éclate dans la délivrance. Sur le plateau scénique, une femme d’un pays de religion musulmane – interprétée par la comédienne tunisienne Anissa Daoud, robe longue écarlate et voile noir en attente de prière sur les épaules, veille son mari, joué par Jacques Allaire, étendu sur sa couche et sous assistance respiratoire. Aux musiques lancinantes et brumeuses un peu systématiques dans leurs montées ou descentes pathétiques, s’ajoutent des pleurs de bébé, des grondements de guerre et des bruits secs de déflagrations qui dessinent un univers sonore de mal-être, une ambiance d’effroi. La femme est désespérément seule, dans une position de prière, le tasbih égrené à la main, assise près du corps de son homme gisant sur son lit de douleurs. Elle ne semble guère davantage heureuse quand elle se penche sur le berceau de son enfant. Une silhouette de théâtre d’ombres, telle l’héroïne de Persépolis, le film inspiré de la b.d. autobiographique de la Franco-Iranienne Marjane Satrapi. À quoi pense cette femme si connotée sociologiquement par sa confession ? Les spectateurs devinent par empathie ses incertitudes et son sentiment d’abandon. Parfois, tombe du ciel, comme par magie, un livre, des confidences littéraires ou de la poésie, qu’elle lit avec un plaisir manifeste, une occasion pour elle d’ouvrir les ailes d’un imaginaire bridé. L’épouse a au préalable recouvert le visage de son mari pour qu’il ne sache rien des transgressions cachées ni des interdits bafoués. Et pour illustration d’une citation d’Artaud en exergue du roman Singué sabour : « Du corps par le corps avec le corps depuis le corps et jusqu’au corps », la représentation bascule soudainement de la passivité consentie de la femme à une révolte absolue, activement physique. Pour plus d’aisance dans les mouvements, la femme se dévêt et s’approprie le corps inerte de son mari, le déplaçant laborieusement et le poussant de ses jambes et de ses pieds, le renversant sur le sol, l’éloignant ou bien le rapprochant à sa guise. Dans une violence déterminée et contrôlée – un solo chorégraphié -, la femme fait face à la difficulté de faire revivre ou mourir son compagnon. Enfin, elle redépose sur sa couche le corps inconscient. Puis les événements basculent, et l’homme réveillé reprend les rênes ostensibles du foyer, prières et lectures du Coran, dont le livre oscille sur une cordelette, à la place même du livre intime de sa femme. Pour elle, plus aucune liberté, mais les coups et une mort assurée sans la moindre grâce. Tout est dit tragiquement sans mot. Véronique Hotte Mercredi 26 mai (générale) à 18h, jeudi 27 à 19h, vendredi 28 à 19h, samedi 29 à 18h, dimanche 30 à 16h. Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val de Marne, Manufacture des Œillets 1 place Pierre Gosnat 94200 – Ivry-sur-Seine. Tél : 01 43 90 11 11.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 13, 2021 3:54 PM
|
par Samantha Rouchard, correspondance à Marseille pour Libération publié le 13 mai 2021 Légende photo : Le 20 mars, quelques jours après le début de l'occupation du Théâtre de la Criée. Cela fait désormais deux mois que des militants y vivent. (Yohanne Lamoulère/Libération) Au centre dramatique national, occupé depuis le 15 mars, le climat, déjà délétère en mars, s’est dégradé à mesure que la réouverture se profilait. Pour les militants, voici venu le temps du blocage. «Sans le blocage, sans l’sabotage, pas de révolution ! La Criée occupée, c’est comme un poing levé !» Sur le Vieux-Port de Marseille, devant les portes grandes ouvertes du Théâtre de la Criée, deux jeunes comédiens reprennent en chœur les paroles de leur nouvelle chanson de lutte créée, en quelques minutes, par une dizaine de visiteurs venus les soutenir. Depuis le 15 mars, ce centre dramatique national (CDN), comme plusieurs autres lieux de culture en France, est occupé en permanence par une trentaine de personnes. «En deux mois, nous sommes devenus le symbole de la convergence des luttes», souligne Basile, comédien de 24 ans, présent depuis le départ. Et dès le début ici, le dialogue entre occupants et direction fut houleux. En effet, l’autrice et metteuse en scène Macha Makeïeff, directrice de la Criée, a dès le départ été accusée par les militants de vouloir «caster» ses occupants en choisissant d’accueillir uniquement des étudiants «proprets» d’écoles de cinéma de la région. Dès le 16 mars, refusant d’être «instrumentalisés», ces derniers ont ouvert les portes de l’établissement à toutes celles et ceux à même de soutenir la fronde, ainsi qu’à des précaires et des migrants. Trois heures de négociations S’est installée depuis, entre les occupants et la direction du théâtre, «une petite guerre silencieuse», explique l’un d’eux. Samedi 1er mai, elle s’est intensifiée : la grande salle du théâtre, dont l’accès leur était interdit pour sanctuariser le travail artistique, a été réquisitionnée de force par les occupants. Un moment «fort» dans leur lutte, raconte Basile : «Il nous a fallu cinq jours pour nous organiser et récupérer les codes des cadenas. Le 1er mai, forts de la manifestation, nous nous sommes retrouvés à 550 présents pour pousser les portes et nous réunir en assemblée générale.» Depuis, le grand plateau sert de lieu de vie en journée et de chambre à coucher la nuit. Mercredi, des lycéens en grève y débattaient à quelques mètres des matelas gonflables et des sacs de couchage. «Fin d’une culture de classe», annonçait une banderole adossée au balcon. «Même pour nous, comédiens, la Criée, de par sa programmation, est un lieu élitiste, ouvert à une petite strate de la population», tacle un occupant. Suite à leur action, tous ont redouté l’évacuation – comme ce fut le cas vendredi 7 mai au Théâtre national de Bretagne. Pour préparer la contre-attaque, «on avait mobilisé une soixantaine de personnes en soutien mais au final, seules la direction et la mairie sont venues», explique-t-on. Trois heures de négociations ont suivi. Résultat : le grand plateau leur reste ouvert mais la scène fermée. Surtout, les occupants ont obtenu l’assurance commune de la direction et de la mairie que les forces de l’ordre n’interviendront pas pour les déloger. «Les militants de la Criée se sont fait la réputation de ceux qui ouvrent d’abord et dialoguent ensuite», sourit Basile. Macha Makeïeff, elle, a été contrainte d’annuler les répétitions prévues et craint désormais pour le maintien de sa programmation. «Une solution digne, paisible et intelligente» Les occupants de la Criée n’en resteront pas là. Comme ailleurs en France, où le spectre des blocages pointe sérieusement son nez jusqu’à menacer la tenue du festival d’Avignon en juillet, les militants comptent bien s’opposer à la réouverture du théâtre le 19 mai : «Ce ne sont pas les quelques miettes promises par le gouvernement qui vont nous faire partir», insiste Johanna, la trentaine, en lutte depuis mi-mars. «Nous avons conscience que cela peut diviser et nous rendre impopulaire mais c’est notre seul levier», poursuit Basile. Macha Makeïeff, de son côté, voit rouge. Déni ou fol espoir, le «temps de l’occupation» est pour elle terminé. Et ses yeux inquiets sont rivés sur mercredi prochain. «Il est venu le temps de la réouverture. Toute mon équipe est prête. Et toute mon énergie est là», explique-t-elle. Avec les théâtres publics de l’Odéon à Paris, celui de Nice et l’Opéra de Lyon, la direction de la Criée a publié un communiqué appelant à lever les occupations. Et le texte de préciser : «La lutte sociale, quelle que soit sa légitimité, ne saurait à notre sens empêcher la reprise de la vie culturelle.» Pour Macha Makeïeff, «ajouter de l’empêchement à l’empêchement qui contraint depuis un an serait une erreur historique. Je ne participerai pas à la désespérance […]. Je ne me vois pas annuler. Mon attitude est radicale. Il faut que l’on récupère notre outil de travail !» A l’heure où les évacuations sont redoutées, la directrice de la Criée martèle qu’elle souhaite trouver collectivement «une solution digne, paisible et intelligente». Même affirmation du côté de la ville de Marseille, propriétaire du lieu. «A la Criée, l’occupation prend une autre tournure. Et des questions sanitaires, de sécurité, de respect des lieux et des artistes qui veulent reprendre, se posent», insiste Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture (PCF). Il a demandé à la préfecture la tenue d’une table ronde dans les jours prochains réunissant tous les protagonistes, dont l’Etat et la CGT spectacle, afin que «tout le monde revienne à la raison», insiste l’élu. Mais Basile, Johanna et les autres le réaffirment : ils ne sont pas près de lever le camp.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 12, 2021 3:38 PM
|
Sur la page de l'émission d'Olivia Gesbert, La Grande Table, sur France Culture le 12 mai 2021 Légende photo : Jean-François Sivadier à Paris le 26 novembre 2015• Crédits : Loic Venance - Getty Dans "Italienne Spectacle et Orchestre", dont la captation sera diffusée sur France 5 le vendredi 14, Jean-François Sivadier fait rentrer son public dans le processus de création d'un opéra, La Traviata. Un spectacle très drôle qui interroge : comment créer le beau dans un spectacle ? écouter l'entretien en ligne (27mn) Italienne Scène et Orchestre, dont la captation par Philippe Béziat sera diffusée sur France 5 le vendredi 14 mai, est une pièce créée par Jean-François Sivadier en 1996 au Cargo à Grenoble. Elle s'appelle d'abord Italienne avec Orchestre avant qu'une deuxième partie (devenue la première dans l'ordre du spectacle) ne vienne la compléter en 2003. Elle a été reprise en 2018 par la MC93 qui s'est associée à la Compagnie des Indes pour en proposer une captation, essentielle en temps de pandémie et de fermeture des théâtres. Le plaisir qu’ont les acteurs à se retrouver, à retrouver le plateau, est immense. La rencontre avec le public était un manque physique pour les acteurs. (Jean-François Sivadier) Ce spectacle était le premier que j’ai mis en scène, et il mettait déjà en scène la relation extrêmement privilégiée entre les acteurs et le public. Avec Italienne, on a un dialogue direct, non pas avec le plus grand nombre, mais avec chaque personne dans la pièce. (Jean-François Sivadier) Malgré cette fermeture et l'impossibilité pour les acteurs de ce produire devant un public, Sivadier, en chef d'orchestre hilarant, et son acolyte de toujours, Nicolas Bouchaud, qui joue les metteurs en scène au bord de la crise de nerf, intègrent le public dans le processus de création. Ils proposent, non seulement de lever le rideau sur les coulisses de l'opéra et du spectacle, et sur les soucis techniques et logistiques constants, les relations difficiles entre artistes, mais aussi d'intégrer le public à la création, en le plaçant sur scène ou en fosse, à la place des musiciens sous la baguette du chef. Les personnages du chef d'orchestre et du metteur en scène sont inspirés d'archétypes qui sont parfois réels. Mais j’ai eu la chance de travailler avec des chefs d’orchestre avec qui tout s’est toujours bien passé, sauf une fois. [...] La petite guerre décrite dans Italienne entre le chef et le metteur en scène existe parfois, mais je ne l’ai pas vécue. (Jean-François Sivadier)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2021 5:18 PM
|
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte, "Affaires Culturelles" sur France Culture Le 12 mai paraîtra Le juge et son fantôme aux éditions des Equateurs, un ouvrage dans lequel le comédien Philippe Duclos dialogue avec le personnage qu'il interprété durant quinze ans, le juge Roban de la série Engrenages. L’occasion pour lui de revenir, au micro d’Arnaud Laporte, sur son parcours.
écouter l'émission (54 mn) Une carrière au théâtre Dès son adolescence, Philippe Duclos dont le père est artiste de music-hall, est attiré par la vie d’artiste et sa liberté. Mais ce n’est qu’en commençant le théâtre que naît réellement sa vocation de comédien. Il entre en effet au Cours Florent en 1967, puis commence sa carrière dans les années 1970 auprès du metteur en scène Daniel Mesguich, ancien élève d’Antoine Vitez. Ces années d’effervescence pour le théâtre sont très marquantes pour Philippe Duclos qui poursuit sa formation intellectuelle et sa formation de comédien. Au cours de cette longue collaboration avec Daniel Mesguich qui se poursuit jusque dans les années 2000, Philippe Duclos interprète de nombreux classiques : Voltaire, Marivaux, Shakespeare, etc. Il a également travaillé auprès de metteurs en scène comme Alain Ollivier, Marc Paquien, Laurent Fréchuret, Célie Pauthe ou encore sa fille, Julie Duclos qui, en 2020, a mis en scène un Pelléas et Mélisande transposé dans un univers contemporain, d’après Maurice Maeterlinck. Le cinéma : petit et grand écran Philippe Duclos mène également une carrière au cinéma. A 40 ans, il joue dans La Sentinelle d’Arnaud Desplechin (1992) où il y tient le rôle d’un médecin. Par la suite, il interprète des rôles similaires, des figures d’autorités : proviseur, inspecteur, rédacteur en chef, dans des films de Patrice Chéreau, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard, Claude Chabrol ou encore Christophe Honoré. Mais c’est le petit écran qui fait connaître Philippe Duclos au grand public. Duclos et le juge Roban En 2005 en effet, commence la série Engrenages, dans laquelle il interprète – et ce jusqu’en 2019 – le juge Roban, un rôle qui marque profondément sa carrière. Son ouvrage Le juge et son fantôme s’appuie sur le journal de son personnage fictif et sur son carnet d’acteur. Il y retrace ces quinze années de travail, à travers un dialogue entre le personnage et son interprète. Philippe Duclos a également enseigné le théâtre : au lycée Lamartine à Paris, au Théâtre Gérard Philipe à Saint Denis puis au Conservatoire. Son actualité : son ouvrage Le juge et son fantôme, journal d’un personnage et de son acteur, paraîtra le 12 mai aux éditions des Equateurs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2021 4:30 PM
|
par Anne Diatkine publié dans Libération le 11 mai 2021 Légende photo : Lors d'une répétition de la troupe Pre-O-Coupé au théâtre de la Garance, scène nationale de Cavaillon, le 3 février. (Clément Mahoudeau/AFP) A huit jours de la réouverture tant espérée, les professionnels du spectacle restent dans le flou. Outre des jauges d’ores et déjà incompatibles avec une reprise des salles privées sans de lourdes pertes, des incertitudes demeurent, tant sur les programmations possibles que l’application stricte ou non du couvre-feu. Ils sont prêts, ils n’attendent que ça, cela fait sept mois qu’ils rêvent de ce moment où les acteurs retrouveront le plateau devant un public. Enfin tous ceux qui peuvent se permettre de ne remplir une salle qu’à 35 %, ce qui exclut d’office la très grande majorité des théâtres privés dont le modèle économique repose sur la vente des billets. Comme beaucoup d’entre eux, le théâtre de la Porte-Saint-Martin, «qui reçoit zéro subvention», ne rouvrira ses portes ni en mai ni en juin, même si les jauges remontent à 65 %. «Tout est beaucoup trop instable. Donc on va attendre septembre.» Septembre pour montrer quoi ? Pour la première fois depuis qu’il dirige ce théâtre, Jean Robert-Charrier ne le sait pas. Enfin, il a bien une petite idée, mais lundi 10 mai, rien de certain. «Pourquoi ne pas s’associer avec des scènes subventionnées, qui subissent un tel engorgement de spectacles qu’elles ont des difficultés à les reporter ? La seule note positive de cette crise serait qu’elle nous permette d’imaginer de nouvelles formes de collaboration entre scènes publiques et privées.» Une alliance qui n’a rien d’évident. Les théâtres privés reposent sur des aimants à public, des têtes d’affiche. C’est d’ailleurs l’autre raison pour laquelle la plupart passent leur tour. Leurs vedettes sont prises. Jean Robert-Charrier s’est résolu à éteindre définitivement la Carpe et le Lapin, de et avec Vincent Dedienne et Catherine Frot, joué seulement 24 fois, malgré un taux de remplissage à 100 %. Avant la retraite, la pièce de Thomas Bernhard, montée par Alain Françon et interrompue à l’automne dernier après quatorze représentations, ne sera reprise qu’en janvier pour cause d’indisponibilité des acteurs. «J’y tiens absolument. On était sur une pente ascensionnelle. On a eu le temps de voir que le bouche-à-oreille fonctionnait.» Entre-temps, Alain Françon a failli perdre la vie à la suite d’une agression au couteau, fin mars à Montpellier. Il va mieux. «Le sort s’acharne» En théorie, la reprise des activités se présente plus simplement dans les théâtres subventionnés. Contrairement au premier confinement, les répétitions n’ont jamais cessé, et la plupart des scènes vont rouvrir en suivant le fil de leur programmation, tout en y intercalant quelques pièces annulées. Faut-il boucher tous les interstices et raccourcir le nombre de représentations de chaque spectacle ? Jean-Marie Hordé, à la tête du théâtre de la Bastille, ne le croit pas. «Ce serait faire une croix sur le bouche-à-oreille et la maturation progressive des pièces qui, comme toute entité vivante, a besoin de temps pour prendre place. L’abondance de spectacles sur des séries très courtes dessert les œuvres. Une diffusion trop rapide ne laisse aucune mémoire.» En cas d’annulation, il discute avec chaque compagnie dans le détail, et la Bastille les indemnise. «Il faut tout de même rappeler que si ce gouvernement ne parle pas de culture, il nous a soutenus financièrement de manière efficace. Aucun théâtre public n’est en faillite.» La Bastille rouvrira bien le 19 mai, d’abord avec Que faut-il dire aux hommes ? de Didier Ruiz, puis avec Je suis le vent de Jon Fosse, par les compagnies TG Stan et Discordia, un spectacle arrivé presque par surprise. En revanche, Coriolan de François Orsini, d’après Shakespeare, déjà trois fois annulé, très attendu, a dû être reporté sine die. «Comme le sort s’acharne, l’un des acteurs principaux est à l’hôpital…» Le Ruiz et le Jon Fosse sont deux pièces très courtes, de moins de deux heures, ce qui permet de jongler avec un couvre-feu à 21 heures. A huit jours de l’ouverture tant attendue, et en attendant les annonces de Jean Castex mardi soir, les directions ne savent toujours pas si les spectateurs auront le droit de braver le couvre-feu, leur ticket servant «d’horodatage» selon le néologisme du président de la République lors de l’allocution télévisuelle du 24 novembre. Si bien qu’un certain nombre de théâtres s’emploient à préparer une ouverture imminente qu’ils ne peuvent annoncer. Arnaud Antolinos, secrétaire général au théâtre de la Colline, est circonspect : «Bien malin celui qui peut affirmer aujourd’hui la date exacte à laquelle son théâtre rouvrira. L’ouverture est soumise à une autorisation préfectorale qu’aucun d’entre nous n’a reçue. L’annonce est politique.» Effectivement, à quelques jours du dégel, la Comédie française informe… ne pas connaître sa date précise de réouverture. Et n’est guère plus diserte sur le reste : «Nous serons en mesure d’annoncer notre programmation à partir du moment où nous saurons précisément dans quelles conditions nous pouvons accueillir du public, ce qui n’est pas encore le cas.» Les acteurs ont cependant reçu un mail le 9 mai, les informant que les représentations se tiendront le week-end, en matinée, avec notamment une nouvelle mise en scène du Bourgeois gentilhomme par Valérie Lesort et Christian Hecq. Elles devraient se poursuivre avec Mais quelle comédie, la création chantée et dansée de Marina Hands et Serge Bagdassarian qui aurait dû égayer notre Noël. «C’est de la haute couture» La Maison de Molière est pourtant dans une situation hautement favorable : les acteurs sont sur place, le théâtre n’est pas occupé par des intermittents et précaires en protestation contre la réforme de l’assurance chômage, et même s’il ignore la programmation, le public se précipitera sur la billetterie dès que celle-ci ouvrira. Que se passe-t-il lorsqu’il s’agit de faire venir de Pologne une dizaine d’acteurs dont certains sont nonagénaires, que le spectacle dure plus de quatre heures et que les représentations devraient avoir lieu en soirée et en semaine ? Est-ce vraiment raisonnable de déplacer tout ce monde pour le faire jouer en polonais un mardi, à 16h30 avec l’espoir que le spectacle se termine pile à 20h45, afin que les rares spectateurs n’écopent pas d’une amende ? Exit, la première mondiale de l’Odyssée, la nouvelle création de Krzysztof Warlikowski qui devait avoir lieu à la Comédie de Clermont pour accoster ensuite en juin au Printemps des comédiens, à Montpellier, deux entités coproductrices. Des répétitions de plus d’un an, un acteur principal qui meurt, un spectacle plusieurs fois annulé, dont l’existence dépend en grande partie de sa réception à l’étranger. La mort dans l’âme, les programmateurs ont capitulé. Un déchirement pour Jean Varela, le directeur du Printemps des comédiens qui, face à tant d’incertitudes, a dû annuler dans la foulée les dernières créations de Krystian Lupa, Romeo Castellucci, Rimini Protokoll, Julien Gosselin… Un renoncement dû moins au virus qu’à l’absence d’informations sur le protocole d’ouverture. Toutes les directions le répètent : «On ne sait toujours pas si on est autorisé à faire un entracte. Ni comment on doit placer les spectateurs. Ni si les précautions sanitaires sont compatibles avec l’accueil du public quand le théâtre est occupé. On est placé dans une expectative pour le moins inconfortable.» Face à ce flou, les scènes qui programment des petites formes paraissent en meilleure posture. Julie Deliquet, à la tête du théâtre Gérard-Philipe, a développé une stratégie pour crawler entre les imprévus. Elle ouvre donc son théâtre le 19, avec la reprise de Désobéir, de Julie Berès, qui peut aussi être montré dans les établissements scolaires en cas de pépin. «Et si ce n’est pas possible de le monter en milieu scolaire, la compagnie répète son prochain spectacle chez nous…» Mais le public ? Comment peut-il savoir à quel spectacle il aura accès si la plupart des théâtres jugent toute communication prématurée ? Fériel Bakouri, qui dirige Points communs, la seule scène nationale du Val-d’Oise, à Cergy-Pontoise, garde l’œil vissé sur le taux d’incidence et le sésame du décret préfectoral. Elle n’est pas dupe que les ouvertures promises s’accordent «avec la volonté de ne pas contrarier la population en pleine période électorale régionale et départementale». Elle ouvrira le 19 mai avec l’Absence de père de Lorraine de Sagazan d’après Tchekhov, puis Rémi de Jonathan Capdevielle. Pour le premier, «les réservations sont prises depuis l’automne et la jauge est pleine. C’est de la haute couture. On rappelle chaque spectateur un à un, pour savoir qui viendrait, qui cède sa place…» Tout en précisant à chaque fois que oui, on est très heureux de revoir chacun. Mais sans certitude. Le tout nouveau directeur de Chaillot, Rachid Ouramdane, invite quant à lui exceptionnellement le public à assister aux représentations des nouvelles créations de Carolyn Carlson et Léo Lérus sur réservation, et aussi à aux répétitions du prochain spectacle de la chorégraphe australienne Stephanie Lake.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2021 3:29 PM
|
Par Louis Borel dans Le Monde 10 mai 2021 Légende photo : A la Cartoucherie de Vincennes (Val-de-Marne), samedi 8 mai. LOU NICOLAS L’événement gratuit et en plein air Le soleil se partage a devancé, samedi 8 mai, la prochaine réouverture des salles de spectacle, dans les limites posées par les restrictions sanitaires.
Un couple de quadragénaires au vélo rouge et blanc s’approche, intrigué. Sous leurs lunettes de soleil, ils observent d’un œil attentif les corps qui s’agitent et les mines qui réagissent. « C’est Platonov ! », murmure avec enthousiasme un membre de l’auditoire en leur indiquant la scène. Sur le carré de pelouse central de la Cartoucherie, à Vincennes (Val-de-Marne), habituellement prisé des pique-niqueurs et des joueurs de ballon, des comédiens de la compagnie Immersion interprètent le chef-d’œuvre de Tchekhov. Devant un public. L’occasion, encore banale il y a plus d’un an, prend une tournure événementielle – pandémie oblige, le quatrième mur se dresse pour la première fois en huit mois. L’adaptation signe le coup d’envoi du festival Le soleil se partage, qui a profité du flou sanitaire en plein air pour programmer ce week-end des 8 et 9 mai ainsi que celui des 15 et 16 mai plusieurs pièces dans ce lieu emblématique du théâtre français. Quelque deux cents spectateurs curieux ou passionnés, essentiellement des jeunes informés de l’événement par Facebook ou Instagram, se sont gaiement installés dans le respect des gestes barrières. Ils applaudissent à tout rompre. « Quel plaisir d’avoir accès à la culture après autant de temps ! », jubile une spectatrice venue fêter ces retrouvailles avec un groupe d’amis. « Retrouver un public et pouvoir partager notre travail nous rappelle pourquoi on crée », pose Elina Martinez, reconnaissante. Dans un charmant bosquet attenant au terre-plein de Platonov, la metteuse en scène a présenté, samedi 8 mai, dans l’après-midi la première de Furies, un texte grinçant sur des personnages de femmes meurtrières. Après une standing ovation inattendue, elle salue la « réceptivité » de l’audience à cette représentation aussi engagée qu’interactive. « Constater à nouveau que ce qu’on joue fait naître des émotions chez le spectateur est tellement agréable », poursuit la comédienne Apolline Clavreuil. « Il n’y a pas d’acteur sans public : ce duo est irremplaçable », s’emballe Léna Allibert, qui complète avec Marion Astorg et Fanny Montpeyroux la compagnie « Pourquoi sont-elles veuves ? ». Au début de mars, alors que s’éternise l’annonce de la réouverture des salles de spectacle, l’idée de cet événement inédit naît précisément du désir de recommencer à se produire. Benjamin Grangier est étudiant en troisième année à l’Ecole supérieure d’art dramatique de Paris. Il participe à l’occupation des théâtres, mais ne s’y retrouve pas. Les revendications du secteur s’avèrent nombreuses, trop changeantes. Plutôt que de protester, lui préfère jouer. Il n’est pas le seul. Avec Mattéo Gaya, Angèle Garnier, Elina Martinez, Théo Navarro, d’autres comédiens en fin de cursus rencontrés à La Colline (Paris 20e), il décide d’alerter Ariane Mnouchkine de leur brûlante volonté. La metteuse en scène leur assure qu’ils pourront investir l’espace extérieur de la Cartoucherie. « C’était simple. Elle a senti notre envie et nous a fait confiance », raconte avec gratitude Benjamin Grangier. Un plateau à 360 degrés Un appel à projets est lancé, qui vise à sélectionner de jeunes créations. Au sein du petit comité informel nouvellement fondé, « on voulait qu’il y ait de tout, que ce soit le moins élitiste possible, précise le jeune homme à l’allure longiligne et à la voix grave. Que toutes les écoles soient représentées, que tout le monde ait sa chance. » Pas question, pour autant, de faire de la politique. « On préférait sortir des revendications de La Colline, éviter les amalgames pour construire quelque chose de pleinement artistique, tranche Benjamin Grangier. On a décrété qu’on serait ici des artistes, pas des militants, qu’il n’y aurait pas de pancartes, pas de discours, mais tout dans les spectacles. » Sur les plus de cent candidatures envoyées, seulement une vingtaine a été retenue pour une représentation unique. Le jury improvisé a privilégié les propositions les plus adaptées aux contraintes de l’espace et de la durée. « Le volume sonore ne doit pas être trop élevé pour ne pas effrayer les chevaux du centre équestre à côté, précise l’organisateur. La première pièce initialement prévue comprenait quarante minutes de musique très forte, si bien qu’on a dû l’annuler. » Annabelle Zoubian, qui met en scène Platonov, imagine un plateau original à 360 degrés, où le public vient encercler dans le respect des consignes sanitaires les acteurs sur l’herbe de la Cartoucherie. Elle réduit aussi la représentation, qu’elle imagine durer quatre ou cinq heures, à son premier acte d’une heure quarante. Tigran Mekhitarian, metteur en scène et comédien, une semaine avant l’adaptation moderne de son Don Juan, examine le lieu, soucieux : « Si je me mets ici, ma voix part dans tous les sens… Si je me mets là, on ne m’entend pas ! » Il se réjouit toutefois que le texte de Molière, « qui parle d’arbres, de rochers, où les personnages se promènent tout le temps dans les bois », ait lieu en extérieur, à Vincennes. « On va de toute façon prendre les contraintes à bras-le-corps », enchaîne-t-il. Et la Cartoucherie ressemble subitement à un laboratoire de la jeune création contemporaine, combative, bouillonnante, ambitieuse. « Je pense que c’est un moment particulier pour les sortants d’école, nous qui sommes en train de démarrer. Il y a de la frustration, de la solitude, de la colère, témoigne Marie Mahé, qui a présenté dimanche 9 mai Notre ADN. Mais l’art est nécessaire et on a envie de le défendre à tout prix, de créer du lien, de donner à entendre des choses pour faire grossir le cœur des gens. » A la fin de la représentation de Platonov, à laquelle elle a sobrement assisté, Ariane Mnouchkine esquisse un sourire ému. Elle qui a toujours défendu une conception à la fois familiale, démocratique et exigeante du théâtre, ne dit pas autre chose. « Ces jeunes ne se sont pas laissés désenchanter, envenimer par la situation actuelle. Ils ont su faire de la contrainte un outil, glisse-t-elle. C’est la meilleure façon de lutter. » Louis Borel

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2021 8:29 AM
|
Par J.-P. Léonardini dans l'Humanité - 10 mai 2021 Diane Scott, psychanalyste, est rédactrice en chef de la Revue Incise, qui sort une fois l’an. En 2019, paraissait, aux Éditions Amsterdam, son brillant essai, Ruine. Invention d’un objet critique (1). Elle publie aujourd’hui S’adresser à tous, ample et très précieuse réflexion sur (le) théâtre et (l’)industrie culturelle (2). Fortement étayé sur des pilotis historiques, depuis les lendemains immédiats de 1789, lorsque des pièces s’écrivaient et se jouaient quasiment au jour le jour à destination d’un peuple en effervescence à éclairer tant bien que mal, jusqu’à maintenant, quand l’industrie culturelle vise un public escompté « grand » par principe, Diane Scott explore les étapes des mutations successives qui ont conduit au concept englobant de culture. Chemin faisant, elle passe au crible les enjeux idéologiques et politiques recélés, au fil du temps, par le glissement de la notion de théâtre du peuple vers ce qu’elle identifie comme ses « avatars modernes » : théâtre civique, populaire, public, etc.
Au XIXe siècle, le fait que « le peuple se pense comme la vérité de la nation est un énoncé qui imprègne le théâtre ». Sont ensuite cités à comparaître les « promoteurs-précurseurs » d’un théâtre du peuple : Maurice Pottecher à la nostalgie forestière, parfois Rousseau (lui prêchant néanmoins la fête civique), Michelet (tenant du roman national en scène), suivis dans l’ordre chronologique par Romain Rolland et, plus tard, Gémier, Dullin issu de Copeau, Vilar… L’adresse à tous, jadis initialement projetée, ne s’est-elle pas progressivement ossifiée en mythe ? À ce point, Diane Scott constate que « le capitalisme met un jeton dans la machine ». Aujourd’hui, « le public se donne comme une hypothèse concrète du peuple ». À la question « Qu’est-ce que le peuple ? », la culture industrielle répond par sa reformulation qui contient en même temps la réponse : « Qu’est-ce que le populaire ? » D’où ce constat : « L’industrie culturelle construit un “grand public” qui produit un effet-de-peuple, une nouvelle forme d’organisation humaine qui se reconnaît en un même objet de consommation globalisée, sans cesse renouvelé. » On ne peut ici analyser en détail l’approfondissement dialectique en jeu dans un tel ouvrage, jusqu’aux conséquences néfastes des politiques en cours. À la fin, la boucle de la pensée est intuitivement ourlée sur « art et politique = peuple », depuis Joséphine, cette énigmatique nouvelle de Kafka.
« Le public se donne comme une hypothèse concrète du peuple. »
(1) Il en était rendu compte dans une chronique du 17 juin 2019. (2) S’adresser à tous, Éditions Amsterdam/ les Prairies ordinaires, 159 pages, 16 euros.
la chronique théâtrale de jean-pierre léonardini

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 9, 2021 2:29 PM
|
Document radiophonique conçu par William Karel, sur la page des Fictions de France Culture le 9 mai 2021 "Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble" écrivait Simone Veil. Aujourd'hui, comment enseigner la Shoah alors que les témoins disparaissent ? Le documentariste William Karel utilise un procédé inédit pour créer une oeuvre forte à partir de témoignages de la Shoah.
Ecouter La Diaspora des cendres (1h45)
Photo prise par William Karel• Crédits : © William Karel
Entre 1992 et 2021, j’ai réalisé quinze films sur la Shoah, de La Rafle du Vel d’Hiv (avec Blanche Finger) à La Diaspora des cendres. J’ai rassemblé une grande quantité de documents dont seule une toute petite partie était utilisée. C’est en classant ces documents qu’il m’a semblé que l’on pouvait faire un « documentaire » uniquement avec cette matière, lequel a pris forme pour la radio d’une part et pour la télévision d’autre part.
Dans La diaspora des cendres, il n’y a ni commentaire ni témoin, ni historien. Uniquement les voix de comédiennes et comédiens lisant des textes, en les croisant, en les opposant – ceux des victimes et ceux des bourreaux : nombreux journaux intimes, billets jetés des trains par les déportés, lettres de prisonniers juifs, de sonderkommandos, de SS, circulaires ministérielles, notes de service des responsables d’Auschwitz, réclamations à propos de problèmes techniques, lettres de soldats allemands à leur famille, documents cachés par les survivants des ghettos, extraits de livres, coupures de presse de revues communautaires, lettres de Juifs à leurs familles à l’étranger, etc. Des lois de Nuremberg de 1935 à la fin de la guerre en 1945, elles racontent les premières mesures du régime nazi, le port obligatoire de l'étoile, l’exclusion, la peur, la vie dans les ghettos, les premières arrestations, les exécutions publiques, les déportations, les chambres à gaz, l'extermination.
William Karel
William Karel
Avec Mathieu Amalric, Valérie Dréville, Elsa Lepoivre (de la Comédie-Française), François Marthouret, Denis Podalydès (de la Comédie-Française)
Conseiller artistique : Guillaume Poix
Réalisation : Sophie-Aude Picon Note de Sandrine Treiner, directrice de France Culture : Lorsque William Karel m’a écrit parce qu’il souhaitait me parler d’un projet qu’il ne concevait, à ce moment, que pour la radio, j’ai senti, avant même d’en connaître tous les contours, que nous allions mettre en œuvre un projet qui ferait date. J’ai écouté ce grand cinéaste me raconter comment il avait retracé, patiemment, méticuleusement, fiévreusement aussi, fragment par fragment, cette histoire de la Shoah, collective et pourtant, ligne à ligne, à la première personne du singulier, pour constituer un immense récit, à vrai dire, inépuisable, un texte unique composé de milliers de bribes de textes, de toutes origines. William Karel avait entrepris de composer un récit possiblement infini, en ce sens qu’il ne connaîtrait pas de fin, à moins de parvenir à intégrer au corps du manuscrit toutes les traces que la mémoire et l’Histoire avaient semées sur le chemin de la catastrophe. En nous le confiant, il acceptait par là-même de lui donner un terme – au moins provisoire.
La Diaspora des Cendres, qui emprunte son titre à un article important rédigé en 1981 par Nadine Fresco pour La Nouvelle Revue de psychanalyse, retrace le cours de l’Histoire dans toutes ses dimensions, sans commentaire, dans la vérité nue des traces écrites de l’époque. Par quel miracle du sens, cette œuvre en fragments s’entend-elle comme un texte unique ? Là est tout le travail de l’auteur de la composition, et de ses interprètes. Là est tout le pouvoir de la voix seule. Il y a eu des films documentaires – dont ceux de William Karel, des films de fiction, des livres d’histoire et des romans, des témoignages, des articles et des poèmes. Sur l’Histoire de la Shoah, La Diaspora des Cendres constitue un nouvel apport, provoquant un effroi et une émotion particulières. C’est à ce titre que cette œuvre sonore et radiophonique constitue un évènement dont je suis très fière que France Culture en soit la productrice pour les auditeurs d’aujourd’hui comme de demain.
Merci à William Karel de sa confiance et de sa présence à toutes les étapes du travail, à Fabienne Servan-Schreiber de nous avoir mis en contact, à Blandine Masson d’avoir orchestré la mise en œuvre du projet, à Sophie-Aude Picon de l’avoir réalisé, aux comédiens de s’être relayés pour lire les fragments de manière si sobre et si juste de sorte de conserver au travail de composition de William Karel toute sa puissance. A Nadine Fresco, pour La Diaspora des Cendres. Sandrine Treiner Note d’intention de Sophie-Aude Picon
Grâce au travail de William Karel, au tressage de témoignages de toutes origines, nous avons pu enregistrer cette Diaspora des cendres, paroles éparses écrites par des anonymes ou par des noms qui résonnent en nous, ce patchwork dont les pièces composent un souvenir commun, pour partager une fois encore, cette mémoire qui nous unit et nous divise. Nous avons tenté de faire que l’inouï soit audible, écoutable, essayé de ne jamais tomber dans la complaisance ou le pathétique, et cherché la juste distance pour vous donner à entendre ces voix, dans leur singularité et leur humanité, leur cruauté et leur humilité, pour qu’elles continuent à habiter la mémoire des vivants. Né en Tunisie, William Karel fait ses études à Paris, avant de partir pour une dizaine d'années dans un kibboutz israélien. En 1981, de retour en France, il travaille durant près d'une dizaine d'années en tant que reporter-photographe pour les agences de presse Gamma ou Sygma. Dès 1988, il décide de troquer son appareil pour une caméra et se lance dans la réalisation de documentaires. Il signe le stupéfiant Jamaïque/FMI : Mourir à crédit (1994), coproduit par Arte où il démonte et expose, par le biais d'une mécanique rigoureuse, le rôle joué par le Fond Monétaire International et sa mise en place d'une politique économique de libre marché dans la situation d'endettement extrême à laquelle est soumis le pays. Enchaînant avec Contre l'oubli, Mourir à Verdun (1996) le documentariste en profite aussi pour achever ses portraits d'écrivains (Albert Cohen, Primo Levi...) initiés pour la collection cathodique Un siècle d'écrivains. Par la suite, Karel se lance dans un triptyque consacré à la politique française, et en particulier à trois de ses figures emblématiques : Jean-Marie Le Pen dans Histoire d'une droite extrême (1998), François Mitterrand dans Mitterrand, un mensonge d'État (2001) et Valéry Giscard d'Estaing dans VGE, le théâtre du pouvoir (2002). Devenu un spécialiste des affaires d'état, il poursuit par la suite ses investigations jusqu'aux États-Unis avec Les Hommes de la Maison Blanche (2000), un voyage passionnant au cœur des arcanes de la diplomatie américaine, Dark Side of the Moon (Opération Lune, 2002), un faux documentaire (docu-menteur) sur la conquête spatiale et Hollywood, CIA : Guerres secrètes (2003) et Le Monde selon Bush dressant le bilan de la politique du gouvernement du 43e Président des États-Unis. Il reçoit en 2003 le prix Europa pour l’ensemble de son œuvre. Suivront quelques fictions, notamment La fille du juge (2005), Poisson d’avril (2006), et Meurtre à l’Empire State building (2007) ainsi que plusieurs documentaires comme 1929. La Grande Dépression (2008), Mais qui a tué Maggie ? (2008), Gallimard, le Roi livre (2009), Philip Roth, sans complexe (2010), Barack Obama. Au cœur de la maison blanche (2012), François Mitterrand. Que reste-t-il de nos amours ? (2015), Hillary Clinton. La femme à abattre (2016), Des mots pour le dire. Les écrivains israéliens (2017), Salman Rushdie. La mort aux trousses (2018), La mort en face – Le pogrom de Lasi (2019), et Le Monde selon Trump (2020). Avec Blanche Finger, il a notamment réalisé Albums d’Auschwitz (2011), Israël-Palestine, une terre deux fois promise (2017) et la série documentaire Jusqu’au dernier : La destruction des Juifs d’Europe (2014).
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...