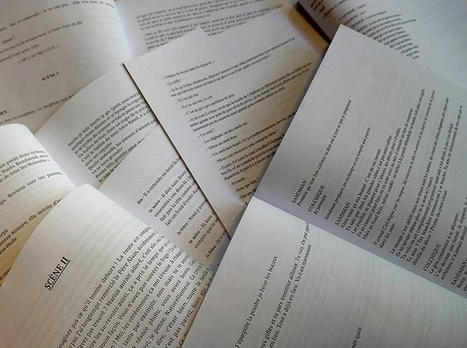Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 8, 2021 7:51 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 5 nov. 2021 Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.
Notre Histoire, conception, écriture et mise en scène de Stéphane Schoukroun et Jana Klein.
Notre Histoire interroge l’antisémitisme et nos identités troubles à travers le prisme d’une relation amoureuse réellement vécue, ici et maintenant, lui et elle vivant ensemble depuis dix ans. Précisons d’emblée – et les interprètes de cette autofiction scénique ne se privent pas de le répéter -, Stéphane Shoukroun est Juif Séfarade tandis que Jana Klein est Allemande. Quand ils se rencontrent en 2008, apprend-on du locuteur lui-même plutôt disert et fort éloquent, il croit la jeune fille Juive ashkénaze. Par-delà ce quiproquo, ils s’aiment et ont une enfant. La fillette de neuf ans qui s’initie à interroger le monde oblige implicitement ses parents à un check-up identitaire. Notre Histoire tente de mettre en jeu leur mémoire approximative en la confrontant à la question de leurs origines, de la Shoah et d’un antisémitisme persistant, une plongée dans l’altérité. Un spectacle pour deux interprètes et deux Intelligences Artificielles, des IA domestiques, ALEXA et SIRI, les comédiens exposent leur mémoire et leurs constructions autofictionnelles au récit à faire. Amusement, jeu et élaboration constructive du scénario même de leur histoire, en direct et en live. La scénographie de la plasticienne Jane Joyet ne laisse pas indifférent, un capharnaüm improbable de bâches transparentes étalées ou roulées en boules, une installation plastique de voiles recelant de petits trésors privés – cailloux et objets souvenirs -, dont se sert le duo pour se raconter. Un écran diffuse des images ensoleillées d’enfance et de fillette qui nage. Ils aimeraient parler à leur enfant de leurs identités respectives, de la Shoah, avant l’enseignement du collège. Les deux interprètes se livrent à une quête mémorielle passionnée, reprenant les débuts de leur rencontre, la volonté de Stéphane de vouloir à tout prix visiter Berlin, la ville quittée par Jana, qu’il ne connaît pas, mais dont il sait prendre la mesure d’une ville aujourd’hui estudiantine et festive. Visite, entre autres, du Musée Juif de Berlin – deux millénaires d’histoire des Juifs en Allemagne. Jana ne peut pas manquer d’évoquer le film Allemagne année zéro (1948) de Roberto Rossellini, ou bien des images macabres de fin de guerre dévastée dans une ville à feu et à sang. Détenteurs des mêmes valeurs d’humanité et d’échange, ils s’engagent pour celles-ci sans faillir. Ils font théâtre de leur vie – et théâtre dans le théâtre – cette mise en abyme les constitue acteurs et metteurs en scène de leur expérience de couple, choisissant des instants privilégiés à mettre en exergue : le croisement initial dans la loge d’un théâtre, puis leur reconnaissance mutuelle à Avignon, la grossesse de Jana, le prénom à choisir, la circoncision, les traditions, les croyances. Stéphane a téléphoné à sa mère pour lui dire qu’il n’irait pas à Juan-les-Pins en vacances mais à Berlin. Il visite plus tard le quartier juif de Prague car la mère de Jana vit à Prague et lui révèle l’histoire de son père tchèque résistant, interné à Dachau – on ne l’apprend qu’à la fin du spectacle. L’engagement des deux comédiens est entier, jouant de l’humour et du recul pour affronter l’Histoire tragique du XX è siècle, et en désigner encore les monstres. Inventant la scène, ils jouent à recueillir le témoignage imaginaire du grand-père paternel de Jana, soldat dans la Wehrmacht. Le récit se déploie entre authenticité des instants vécus et recomposition fictionnelle. Stéphane Schoukroun et Jana Klein restent eux-mêmes, à la fois acteurs et personnages, ils s’amusent ostensiblement de cet à peine double-jeu, ce presque rien entre présence scénique et présence à soi, traversant leur histoire et les questions existentielles dans l’humour et le raisonnement. Délicatesse, points de vue nuancés, coups de gueule de Stéphane et bouderie de Jana avant de chanter façon Marlene Dietrich. Tous deux adhèrent exactement aux questions de notre temps. Une représentation passionnante, tels des acteurs accueillant des amis à la maison et se racontant, attentifs à leurs invités comme à eux-mêmes – clins d’œil tendres et écoute de l’autre. Véronique Hotte Du 17 au 27 novembre 20h30 2021 au Monfort Théâtre, Etablissement artistique de la ville de Paris, 106 rue Brancion 75015 – Paris. Tél : 01 56 08 33 88.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 8, 2021 4:44 AM
|
Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 7 nov. 2021 Mis en scène par le directeur du lieu Jacques Vincey, les huit comédien.nes de l’ensemble artistique du Théâtre Olympia – Centre Dramatique National de Tours s’emparent de Grammaire des mammifères de William Pellier. Tous excellents, ils mettent en lumière une écriture riche et singulière que l’on s’étonne de si peu connaître. Bien qu’écrivant pour le théâtre depuis 1984, et publié depuis 2004 aux Éditions Espace 34, William Pellier est un auteur que l’on ne cesse de découvrir. La première raison est que la douzaine de textes théâtraux qu’il a écrits ont très peu été montées. Dans sa préface de Grammaire des mammifères (2005), la dernière pièce publiée de William Pellier, un certain Michel Cornavin – à ne pas confondre avec l’universitaire Michel Corvin, spécialiste du théâtre du XXème siècle dont les nécrologies (il nous a quittés en 2015) nous apprennent qu’il était également agrégé de grammaire – évoque une mise en scène de Thierry Bordereau présentée en 2011 au Théâtre de la Manufacture, lors du Festival off d’Avignon. Il y en aura peu d’autres. Sans doute en partie pour la raison évoquée par le mystérieux préfacier : à la lecture, Grammaire des mammifères paraît « bégayer, piétiner à force de répétitions ». Il peut sembler écrit dans « une langue confuse, agaçante de coquetterie, un formalisme gratuit et abscons ». Conçue pour les comédiens, de telle sorte qu’ils puissent « inventer la vie sur scène » – c’est cette fois l’auteur lui-même qui s’exprime, dans la postface de son livre –, c’est sur scène que se révèle véritablement l’écriture de William Pellier. À condition de trouver comment la dompter : les mammifères qui la peuplent ne sont pas domestiqués. Ou alors ils l’ont été il y a trop longtemps pour que cela soit encore visible à l’œil de l’observateur extérieur, du spectateur. Jacques Vincey, qui découvre l’auteur pendant une audition du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire (JTRC) – dispositif d’insertion professionnelle unique en France, créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’État, de la Région et du Théâtre Olympia – Centre Dramatique National de Tours ou « T° » pour les intimes –, se mesure à l’animal théâtral avec les huit jeunes comédiens de son ensemble artistique, composé pour l’essentiel des artistes du JTRC. Subtile approche. Nommons ces artistes avant que leurs identités ne soient emportées dans la Grammaire bien perturbée de William Pellier : Alexandra Blajovici, Garance Degos, Marie Depoorter, Cécile Feuillet, Romain Gy, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc et Nans Mérieux. Eux-mêmes se présentent d’ailleurs à nous dès le hall du théâtre dans une sorte de profession de foi envers l’auteur, que l’on apprend être « né le 19 mai 1963 à Ambilly / fils de John Pellier son père et de Danielle Pellier née Bernaz sa mère ». Le responsable de ces lignes chercherait-il à nous faire rattraper notre retard concernant son cas, il ne s’y prendrait pas plus mal : après quelques déclamations limpides, l’introduction devient bazar, cacophonie. Au diapason des répliques, les corps se heurtent, s’empêchent les uns les autres d’aller jusqu’au bout de la direction qu’ils semblaient sur le point d’emprunter. C’est dès lors clair, s’il est le roi de la Grammaire des mammifères, l’acteur l’est indépendamment de tout personnage. Il l’est même en quelque sorte « contre » cette entité qui a la peau dure, malgré toutes les atteintes qui lui ont été et lui sont encore portées, et dont s’amuse William Pellier en mêlant ces souvenirs de coups et blessures à des références tout autres, issues souvent d’autres disciplines. « Borges ou Borges ou Borges je ne sais pas comment vous le dite il n’y a rien à dire » déboule par exemple on ne sait comment en milieu d’un bavardage qui n’a pour autre thème que l’absence de sujets à partager entre humains du XXIème siècle. Plus tard, dans une sorte de mini-vaudeville, un certain William compare les mots d’un Docteur avec ceux de Yasmina Reza, ce à quoi une certaine Ana réplique – pas de malentendu, c’est là le seul endroit de la pièce où les répliques sont associées à des prénoms – : « Ou du Philippe Delerm Avez-vous lu (Gorgée) x 2 La petite gorgée de minufcule La gorgée Vous savez minufcule Gorgée de minufcule ». La Grammaire des mammifères n’est pas de celles qu’on enseigne aux enfants : plutôt que de structurer la pensée, elle en fait jaillir les failles, elle y déniche les incohérences. Pour donner formes à ce matériau qui ne cesse d’échapper en empruntant sans cesse des voies différentes, Jacques Vincey a fait appel à la « complicité » de deux autres artistes : le dramaturge et chanteuse baroque Vanasay Khamphommala, qu’il connaît bien pour avoir beaucoup travaillé avec lui, et le danseur et chorégraphe Thomas Lebrun. Leur intervention est sensible à la manière dont les registres d’expression se succèdent, et souvent se superposent dans la pièce. On passe ainsi facilement d’une scène où les comédiens vêtus de costumes herbus évoquent la possibilité d’une sorte d’orgie – jamais réalisée – dans une porcherie, à une étrange leçon d’anatomie appliquée à un « protagoniste » dont les nombreuses apparitions semblent vouloir nous rappeler ce que fut un jour le théâtre et ce qu’il ne peut plus être. Sans nous dire ce qu’il peut devenir. Sans doute cette Grammaire, qui ne contient que la moitié environ du texte intégral, aurait-elle pu être plus aventureuse encore. Elle adopte régulièrement des formes connues – une émission télé, un groupe de parole, une comédie familiale… –, qui ont tendance à limiter les possibles offerts par le texte, dont l’auteur dit : « il faut imaginer qu’au-delà du bavardage des dizaines d’événements s’entremêlent : rencontres, complots, alliances, flirts, repas, expériences, jeux, comme si les comédiens jouaient sur deux tableaux dissociés, mais qui se reflètent l’un dans l’autre : l’un fait de ce qu’ils disent, l’autre de ce qu’ils font. Enfin un rôle muet, égaré au centre de ce bavardage, n’est pas à exclure ». Les huit comédiens nous donnent toutefois la folle mesure du texte qu’ils servent. Et suscitent l’envie d’en poursuivre l’exploration. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr La Grammaire des mammifères Texte William Pellier (Editions Espaces 34) Mise en scène Jacques Vincey En complicité avec Vanasay Khamphommala, dramaturge et chanteuse et Thomas Lebrun, chorégraphe Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Assistanat scénographie Léonard Adrien Bougault Lumières Diane Guérin Son Alexandre Meyer Costumes Céline Perrigon Vidéo Blanche Adilon-Lonardoni et Maël Fusillier Avec Alexandra Blajovici, Garance Degos, Marie Depoorter, Cécile Feuillet, Romain Gy, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc, Nans Mérieux Production Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia
Coproduction Centre chorégraphique national de Tours avec la participation du dispositif Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire Durée : 2h15 Théâtre Olympia – Centre Dramatique National de Tours Du 3 au 13 novembre 2021 Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine Du 1er au 4 décembre 2021

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 7, 2021 7:49 AM
|
Par Ariane Bavelier dans Le Figaro - 5 nov. 2021 DÉCRYPTAGE - Fermée depuis six ans, l’institution aurait dû rouvrir en 2019. aujourd’hui, on parle de l’automne 2023. Comment en est-on arrivé là ?
Six saisons que les deux théâtres, fleurons de la ville de Paris, sont dans la tourmente. Le Théâtre de la Ville, en octobre 2016, puis le Châtelet, en mars 2017, fermaient l’un et l’autre pour travaux, avec 26 millions chacun. Ils devaient rouvrir en 2019. Chose faite pour le Châtelet, qui cependant n’a plus de directeur artistique depuis l’éviction de Ruth MacKenzie, le 28 août 2020. La maison reste gouvernée par son directeur général, Thomas Lauriot dit Prevost: «Une période de sous-régime», reconnaît le cabinet de Carine Rolland, adjointe au maire en charge de la Culture, qui lancera «le jour venu un appel à projet international». À LIRE AUSSIÀ Paris, le Théâtre de la Ville cultive le sens de la fête Au Théâtre de la Ville, le directeur, Emmanuel Demarcy-Mota, reste à la manœuvre, mais la date de la réouverture est sans cesse repoussée. La mairie indique aujourd’hui une livraison des travaux entre janvier et mars 2023, avec une réouverture au public à l’automne. «Je préfère ne donner aucune date», dit Stéphane Roux, l’architecte de l’agence Blond & Roux, en charge du projet, qui a remporté le concours pour le Théâtre de la Ville le 11 juillet 2015. Un excellent professionnel, impliqué parallèlement dans la musique, et dont l’agence a fait ou refait les théâtres d’Annecy, d’Antony, d’Arras, de Brest, de Dunkerque. Elle avait également signé le projet pour feu la salle modulable de l’Opéra Bastille. Mais sur certains chantiers, il faut bien reconnaître que le destin s’acharne. À l’évidence, celui du Théâtre de la Ville. « Jusqu’ici, je me suis tu sur le retard des travaux, et je l’assume. Le responsable des travaux, c’est la mairie » Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville Comment en est-on arrivé là? Le plus inimaginable, dans cette configuration, c’est le silence. Imaginerait-on que Bastille et Garnier soient ainsi en berne et que personne ne s’insurge? Imaginerait-on Gérard Violette, le précédent directeur, héritier de Jean Mercure, installé sa vie durant à la barre du Théâtre de la Ville et qui avait, entre autres génies, celui des tempêtes, se taire devant la si longue fermeture de «son» Théâtre de la Ville? «Jusqu’ici, je me suis tu sur le retard des travaux, et je l’assume. Le responsable des travaux, c’est la mairie», dit Emmanuel Demarcy-Mota, qui lui a succédé en 2008. Il procède ainsi à rebours du Théâtre du Châtelet, où le personnel était resté dans les murs et où le directeur technique, relayé auprès de la mairie par le bouillant Jean-Luc Choplin, campait sur le chantier nuit et jour et invectivait le maître d’œuvre pour tenir les délais. Enfant de la balle et metteur en scène, Demarcy-Mota préfère surfer sur les difficultés que de défier le gros temps. Avec une grâce et une intelligence infinies, il plaide, convainc, séduit et finalement construit. L’opération lancée en 2015 prévoit une rénovation partielle de l’intérieur, comme pour le Châtelet. Mais entre le Châtelet et le Théâtre de la Ville, rien de commun. Une pollution à l’amiante très importante Le Châtelet a bénéficié de travaux tous les vingt ans. Rien n’a été fait au Théâtre de la Ville depuis sa création, en 1968. «On savait depuis 2005 que le chantier serait délicat», dit Demarcy-Mota. Délicat ? Blond & Roux dessine le nouveau projet. Les deux théâtres, construits place du Châtelet par Davioud en 1862, sont jumeaux. Le Châtelet a gardé sa salle à l’italienne. Le Théâtre de la Ville, naguère appelé Sarah-Bernhardt, a été restructuré avec un gradin frontal par Fabre et Perrottet en 1968. «On voyait un gros travail sur la salle, la scène et les espaces d’accueil. C’est sur ces derniers que se concentre la préoccupation actuelle des théâtres de faire vivre leur lieu dans la journée. Au Théâtre de la Ville, si la relation scène-salle est très réussie, l’espace d’accueil est conforme à la vision des années 1960: un endroit où contenir une billetterie et rassembler le public avant le lever du rideau», explique l’architecte. Qui propose de repousser les deux grands escaliers au lointain du hall pour y voir naître un espace plus ouvert, capable d’accueillir des manifestations et de s’adapter aux normes de sécurité avec des sorties de secours quai de Gesvres et avenue Victoria. Ce geste révélera le dessous du gradin en béton décoré d’or par François Morellet. À l’étage, l’espace de la mezzanine sera reconfiguré pour que le Théâtre de la Ville regarde son jumeau du Châtelet. Mais Valentin Fabre, né en 1927, et Jean Perrottet, né en 1925, sont les Michel-Ange des théâtres populaires voulus par Jean Vilar puis Jack Lang. Toute leur vie, ils ont transformé les salles à l’italienne en salles frontales. Ils invoquent vivement leur droit d’auteur. La discussion animée dure toute l’année 2016. En 2017, Blond & Roux commence à travailler sur le bâtiment. Ils le savaient pollué au plomb et à l’amiante, mais pas à ce point-là! La pollution se niche partout. Le plomb stoppe le chantier Sur le chantier du théâtre d’Annecy, ils ont recouvert ces pollutions d’une toile pour les contenir. À Paris, l’Inspection du travail et la caisse régionale d’Assurance-maladie d’Île-de-France exigent qu’on la supprime jusqu’au dernier gramme. Les deux organismes demandent également que le cintre manuel soit remplacé par une machinerie motorisée. Fin 2018, après un premier appel d’offres infructueux, le chantier est enfin prêt à être lancé. Début 2019, le plomb l’arrête encore. 2020 sera l’année du Covid. «Aujourd’hui, on avance bien mais je reste très prudent. Il y a peut-être encore du plomb», dit Stéphane Roux. Emmanuel Demarcy-Mota, que l’on questionne sans cesse sur la date de réouverture, reste muet. Cependant, d’une main, il profite du plomb pour qu’on lui façonne le théâtre de ses rêves: on revoit les bureaux, on installe une salle sous la Coupole, une autre au rez-de-chaussée. De l’autre, tout feu tout charme, il orchestre le déploiement de son «théâtre de la ville hors les murs» depuis l’Espace Cardin, où il est installé avec ses équipes et où on lui a rénové la grande salle et aménagé une seconde. «Le “hors les murs”, c’était un moyen d’élargir la diversité du public et d’augmenter la part des jeunes. Quand Gérard Violette m’a confié la direction, il y avait 80 % d’abonnés. J’ai voulu qu’on passe à 50-50. J’ai aussi voulu que le personnel se sente à l’aise et que le théâtre continue à accueillir les grands artistes internationaux. Entre le théâtre, la musique et la danse, nous travaillons sur plus de cent programmes par an», dit-il. Une saison passe. Six, et bientôt sept, ou huit, c’est long. Chaque année, Demarcy-Mota cherche où ses spectacles pourraient le mieux se déployer. Ses deux salles à l’Espace Cardin ou au Théâtre des Abbesses comptent de petites jauges. Voilà deux saisons, il avait loué le 13e Théâtre. «Le plus difficile, ce sont les grands plateaux. Il y a la Villette, Chaillot et le Châtelet. L’an prochain, j’en cherche pour Hofesh Shechter, Anne Teresa de Keersmaeker, un opéra de William Kentridge, la Schaubühne avec Simon McBurney, un théâtre musical de Kirill Serebrennikov, et Le Sacre de Pina Bausch avec des danseurs africains. Et Chaillot sera en travaux à partir de janvier», détaille-t-il. L’homme est obligé de démarcher ses pairs, plus ou moins obligés eux-mêmes de pratiquer l’accueil. La formule est avantageuse: on partage les recettes et les frais. «J’ai plus de dix lieux partenaires. Je juge quelle salle conviendrait le mieux à telle ou telle production et j’en parle aux directeurs. Ça, je le vois bien chez vous. Il faut beaucoup d’agilité. Au Châtelet, je propose les spectacles de danse en rapport avec de la musique, à Chaillot les chorégraphes qui les intéressent, la Villette est très fraternelle. Avec Ribes, au Rond-Point, je développe la notion d’auteur contemporain dans la danse», dit Demarcy-Mota. Une perte de visibilité pour le Théâtre Pareille politique use un peu. Elle lui a valu le sobriquet de «Cardinal de Cardin», ou d’«Emmanuel Dieumerci Estlà». Au début, les théâtres, subventionnés ou non par la ville de Paris, étaient heureux d’accueillir cette programmation hors les murs. «Lorsque nous avons ouvert, avoir sur notre brochure des spectacles du Théâtre de la Ville nous a amené du public», avoue Laurence de Magalhaes, au Monfort Théâtre. «Emmanuel est plus généreux et plus juste que ses paroles. On n’a quand même pas besoin qu’on nous explique comment travailler!», s’agace cependant un directeur de théâtre. À force, l’identité du Théâtre de la Ville hors les murs perd de sa lisibilité, d’autant que Demarcy-Mota, aussi directeur du Festival d’automne, trouve pour le même genre d’artistes internationaux, certes programmés sous forme de «portraits», un accueil dans des théâtres de Paris et d’Île-de-France. La confusion avec le Châtelet est totale: sur quinze programmes donnés sur sa scène cette année, sept viennent du Théâtre de la Ville, soit deux fois plus que dans les autres théâtres partenaires. Même chose la saison prochaine. Les mauvaises langues prédisent que l’un des deux théâtres finira absorbé par l’autre. «Il n’en est pas question», martèle Carine Rolland. À LIRE AUSSIThéâtre public, théâtre privé: rivaux mais pas trop Budget de l’opération? Parti à 26 millions d’euros, le Châtelet a terminé à 35. Et au Théâtre de la Ville? «L’enveloppe ne tient plus, on sera nettement au-delà. On gère de manière très responsable, confie Carine Rolland. Plusieurs directions de la mairie sont sur le sujet.» Un art consommé du grand flou qu’elle voudrait rassurant mais qui ne l’est pas du tout. L’adjointe en charge de la Culture a pourtant fait ses classes en marketing et communication. Ariane Bavelier - Le Figaro

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 6, 2021 6:39 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 7 nov. 2021 Ilka Schönbein derrière la marionnette de la chatte dans « Voyage chimère », par le Theater Meschugge. MARINETTE DELANNÉ L’artiste allemande est en tournée en France avec sa dernière création librement inspirée du conte des frères Grimm, « Les Musiciens de Brême ».
Ilka Schönbein ne parle pas beaucoup, ni sur scène ni dans la vie, ou, plus exactement, elle recherche souvent le mot juste, l’expression adéquate. Et quand elle ne les trouve pas, elle préfère laisser s’exprimer son corps, qu’elle prête depuis toujours à ses créatures, ou mettre au premier plan la musique, omniprésente dans son œuvre. Rencontrée en octobre à l’occasion d’une série de représentations de sa dernière création, Voyage chimère, au Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette, à Paris, l’artiste, née en 1958, à Darmstadt, en Allemagne, explique comment ce sont toujours les marionnettes, souvent faites de bric et de broc, à partir d’objets de récupération, qui sont à l’origine d’un nouveau spectacle. Ainsi, pour Voyage chimère, librement inspiré du conte des frères Grimm, Les Musiciens de Brême, elle raconte : « Il y avait, dans mon atelier, deux ou trois marionnettes qui traînaient, qui n’avaient pas encore trouvé leur place dans un spectacle, qui attendaient le bon moment pour sortir de l’ombre. Ce sont elles qui ont choisi le conte, et non l’inverse. » C’est pourquoi le chat des frères Grimm est devenu, chez Ilka Schönbein, une vieille chatte (rescapée d’un précédent spectacle) et le coq une poule, aux côtés de l’âne et du chien, pour former le quatuor animalier du récit. Le public est entraîné dans une danse macabre sur fond de chansons et de morceaux de musique interprétés en direct par deux complices Et, comme toujours dans les spectacles d’Ilka Schönbein, on est bien loin de l’univers coloré et joyeux des contes pour enfants (Voyage chimère s’adresse aux plus de 10 ans). Les quatre animaux en question sont en effet réduits à l’état de squelettes ‒ des crânes et des pattes, auxquels Ilka Schönbein donne habilement vie avec son corps, en particulier ses jambes, maquillées de façon différente pour chaque personnage. Le résultat d’une existence de misère au service des hommes, marquée par les mauvais traitements et l’exploitation à outrance. Le public est entraîné dans une danse macabre sur fond de chansons et de morceaux de musique interprétés en direct par les deux complices de la marionnettiste, Alexandra Lupidi (au registre vocal impressionnant, pouvant passer d’un chant populaire italien à un air d’opéra en allemand) et Anja Schimanski (également responsable de la création et de la régie lumière). Ambiance de cabaret La réussite de Voyage chimère tient beaucoup à cette ambiance de cabaret, de revue musicale, où chacun des quatre protagonistes est appelé à monter à tour de rôle sur une sorte de roue centrale tenant lieu d’estrade (ou d’échafaud) et à se produire dans un numéro « de la dernière chance », avant de partir pour Brême ou, plus certainement, dans l’au-delà. Car la mort est présente au détour du chemin, comme souvent chez Ilka Schönbein. D’autant plus dans cette création née en pleine pandémie, alors que le trio était en résidence artistique au Monteil (Cantal), en mars 2020. « Cette première résidence devait durer seulement une semaine, explique la marionnettiste et metteuse en scène. Mais, avec l’arrivée du Covid-19 et le premier confinement, elle a duré près de deux mois, ce qui nous a donné un temps précieux, avec Alexandra et Anja, pour travailler sur le spectacle. » Un spectacle fascinant à l’humour noir, et parfois grinçant, à découvrir à l’occasion de quelques (trop rares) représentations dans l’Hexagone en novembre, car comme le souligne Ilka Schönbein, beaucoup de théâtres, en France et en Allemagne, ont déjà rempli leur programmation pour la nouvelle saison avec les reports des dates annulées pour cause de pandémie en 2020-2021, ce qui rend compliqué, pour les compagnies, de trouver encore des créneaux libres pour se produire sur scène dans les mois à venir. Voyage chimère, par le Theater Meschugge. Avec Ilka Schönbein (création et manipulation des marionnettes, mise en scène), Alexandra Lupidi (création musicale et musique de scène) et Anja Schimanski (création et régie lumière, musique de scène). Les 16 et 17 novembre au Théâtre des quatre saisons, à Gradignan (Gironde) ; le 19 novembre au festival Marionnettissimo, à Tournefeuille (Haute-Garonne) ; les 29 et 30 novembre à l’Espace Jéliote, à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Cristina Marino

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2021 9:50 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 5 novembre 2021 Le magicien et metteur en scène signe une fable initiatique, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu’au 20 novembre.
Balayez les feuilles mortes à la pelle comme le veut la saison, et vous risquez soudain de vous retrouver perdu en pleine forêt, pelotonné sous votre doudoune, à l’écoute des bêtes sauvages. Ce chavirage spatio-temporel saisissant électrise le spectacle Le Bruit des loups, du magicien et metteur en scène Etienne Saglio, à l’affiche jusqu’au 20 novembre du Théâtre du Rond-Point, à Paris. En une seconde, un paysage fait effraction sur le plateau et foudroie l’imaginaire. Rêve et cauchemar, entre caresse et chair de poule, cette fable initiatique noue serré les peurs et terreurs enfantines. Ses émerveillements, aussi. Le Petit Poucet copine avec le mini-Chaperon rouge ; l’ogre et la mère-grand ont des faux airs du monstre de Frankenstein ; les souris dansent, évidemment, lorsqu’elles ne se font pas attraper par la queue. Les contes et les comptines se coursent pendant que le loup rôde. Entre deux coups de tonnerre, un malicieux renard parade et joue les running gags pour détendre l’atmosphère. Cohésion du mirage Ce plongeon en apnée dans l’irrationnel fonctionne à plein grâce aux mille et un stratagèmes illusionnistes finement entrelacés par Etienne Saglio. Jongleur et expert en magie nouvelle, mouvement artistique apparu au début des années 2000 qui dope le spectacle vivant, il convoque ici toute l’armada de l’écriture scénique magique. Entre subterfuges à l’ancienne, comme les chausse-trapes, et nouvelles technologies, un dispositif complexe de marionnettes, prestidigitation, projections d’images, hologrammes et autres trouvailles optiques interagit avec trois personnages. Si l’envie de distinguer le vrai du faux surgit au détour d’une apparition incongrue, elle s’évanouit vite devant la cohésion du mirage qui se profile. L’animal en chair et en os ou la bestiole empaillée se confondent, l’enfant et l’homme adulte se glissent sous la même peau. Tout semble réel et irréel, et inversement, et peu importe, au fond. Le trouble des sens et des perceptions, exacerbé par une bande-son tempétueuse, que provoque Le Bruit des loups, est d’autant plus aigu qu’il a lieu au théâtre. Si l’on y retrouve, comme souvent dans les pièces de magie nouvelle, le vertige du cinéma et des effets spéciaux, il est majoré par le vivant parfois très cru du spectacle, où les trucages opèrent en temps réel. La souris trempée dans l’huile prend alors une saveur particulière. Ecrit par Etienne Saglio, artiste-associé au Théâtre du Rond-Point, en complicité avec la dramaturge-anthropologue Valentine Losseau, Le Bruit des loups offre aussi un écrin à une vision onirique de la nature. Le Bruit des loups, de et avec Etienne Saglio. Théâtre du Rond-Point, Paris 8e. Jusqu’au 20 novembre, à 20 h 30, le dimanche à 15 heures. Relâche le lundi. De 12 € à 38 €. Rosita Boisseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 7:44 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 4 nov. 2021 Dans son nouveau seul-en-scène intitulé « Un soir de gala », le comédien et humoriste interprète un tourbillon de personnages illustrant l’époque actuelle.
Qu’écririons-nous si l’on devait envoyer une carte postale à l’adolescent qu’on a été ? C’est par cet exercice formidablement nostalgique que débute le nouveau spectacle de Vincent Dedienne. La scène plongée dans le noir, le public se concentre sur la voix douce du comédien et humoriste et, déjà, le charme opère. Grâce à ses histoires désopilantes et à sa faculté de susciter une mélancolie joyeuse, Vincent Dedienne capte son auditoire dès les premières minutes de son Soir de gala. Un joli titre pour un one-man-show enchanteur. Quand les projecteurs s’allument, on le découvre, costume noir et chemise blanche, assis devant un piano à queue. « Je ne sais pas jouer de piano. Enfant, je rêvais parfois d’être chanteur, mais en regardant mon visage dans la glace, lucidement, j’ai bifurqué vers l’humour. » Ce sera donc une sorte de piano-voix sans musique, juste avec le pouvoir des mots. Tourbillon de personnages Contrairement à son premier seul-en-scène, S’il se passe quelque chose (2014) – autoportrait drôle et émouvant qui lui valut le Molière de l’humour en 2017 –, Un soir de gala nous emmène dans un tourbillon de personnages dont le narcissisme, l’égoïsme ou la bêtise reflètent une époque à tendance schizoïde. Pour Vincent Dedienne, l’heure n’est plus aux confessions, mais davantage au regard décalé sur le monde. Vincent Dedienne a le goût des mots, il en a même inventé un, « la chagreur », pour mesurer le degré de chagrin de s’éloigner de l’enfance C’est un régal de le voir incarner un journaliste d’une chaîne d’info en continu, speed et cynique, un comédien minaudier mélangeant sans scrupule interview et placements de produits, une agente de voyage persuadée d’avoir affaire au recherché Dupont de Ligonnès, une petite fille à haut potentiel désespérée par le remariage de son père, ou encore une bourgeoise snob et prétentieuse s’épanchant auprès de sa femme de ménage (« Je m’emmerde tellement que je suis à deux doigts de vous aider. ») Le piano, au gré des personnages, sert de pupitre, de table ou d’assise et, entre certains sketchs, l’humoriste glisse quelques états d’âme sur le temps qui passe et cette nostalgie qu’il a chevillée au corps. Vincent Dedienne a le goût des mots, il en a même inventé un, « la chagreur », pour mesurer le degré de chagrin de s’éloigner de l’enfance. C’est son « pays natal », et il reste « inconsolable d’y être exilé ». « Ce n’était pas mieux avant, mais c’était plus lent », résume joliment ce comédien attachant. Tendre, poétique et absurde On dit souvent que le deuxième spectacle, surtout quand le premier fut un succès, est le plus difficile. En quelques années, Vincent Dedienne, formé à l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de La Comédie de Saint-Etienne, a acquis une belle notoriété, tour à tour chroniqueur singulier à la radio et à la télévision, comédien de talent au théâtre (Le Jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, mis en scène par Catherine Hiegel), au cinéma (L’Etreinte, de Ludovic Bergery, en 2021) et dans la série télévisée humoristique La Flamme. En renouant avec son rêve de jeunesse, faire rire sur scène, l’artiste séduit à nouveau, sans se copier, mais en gardant sa patte, celle d’un humour à la fois tendre, poétique et absurde, qui n’est pas fait de punchlines mais de situations, de réflexions et de dérision. Quel humoriste peut, dans un même spectacle, faire entendre la voix enveloppante d’André Dussollier, évoquer les noms de Micheline Dax, Sim ou Laurent Terzieff, inventer un personnage de « redresseur de chansons françaises » et s’avouer, à 34 ans, « vieux depuis qu’[il est] jeune ». Il n’a jamais eu les goûts de son âge, et c’est ce qui le rend à la fois irrésistible et émouvant. Sur l’affiche de ce Soir de gala, Vincent Dedienne, au sommet d’un plongeoir, regarde en bas, la veste à moitié retirée, prêt à sauter. « Pourquoi on saute ou pas ? », s’interroge-t-il sur scène. « A 20 ans, on saute parce qu’on a envie de vivre, à 50 ans, on hésite parce qu’on a peur de mourir. » Lui est entre les deux, et sent bien que plus les étés passent, plus il met du temps avant de plonger d’un rocher. Les spectateurs, eux, plongent avec plaisir dans son univers et rient de ses personnages tantôt monstrueux, tantôt pathétiques. Ce Soir de gala est une réjouissance, un remède à la mélancolie et à une époque pas jolie-jolie. Un soir de gala, écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et Anaïs Harté. Mise en scène par Juliette Chaigneau, avec Vincent Dedienne. En tournée : les 6 et 7 novembre à Grasse (Alpes-Maritimes), le 13 à Dunkerque (Nord), le 14 à Bruxelles, le 20 à Martigues (Bouches-du-Rhône), le 21 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 27 à Angers (Maine-et-Loire), etc. Du 22 décembre au 29 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Sandrine Blanchard Légende photo : Vincent Dedienne dans « Un soir de gala », le 1er octobre 2021, à Colombes (Hauts-de-Seine). CHRISTOPHE MARTIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 6:37 PM
|
Bros
Conception et mise en scène Romeo Castellucci
Théâtre des Salins, Martigues
le 27 octobre 2021
Critique publiée dans l’Insensé Alors, Ovo aut Pollo ? L’Œuf ou La Poule ? Telle serait la question pour Castellucci comme pour toute métaphysique transcendantale en quête désespérée de l’origine : on sait la formule aussi vaine que stérile, mais il faut « croire » (puisqu’il semble que là est l’enjeu chez ce metteur en scène) que la vacuité est un terrain de jeu possible quand on a le goût du désespoir. De quoi s’agit-il ? De savoir ce qui est à l’origine de l’obéissance. Est-ce les forces de l’ordre qui rendent obéissant — ou le devoir d’obéissance qui engendre les forces de l’ordre ? Et par-delà, la Loi Divine, paradigme de tout ordre, ou cause ultime et première ? Le Sacré, modèle ou généalogie ? Vastes questions qu’on parcourra ici en un peu plus d’une heure, au pas de course, et sous la matraque d’une trentaine de pseudo-acteurs déguisés en flics des années 30’, vrais gens à qui on assènera les ordres dans l’oreillette qu’ils exécuteront comme on exécute un prisonnier. Au pas de course, donc, comme dans ces manifs quand on est poursuivi par la maréchaussée qui s’estime agressée par la foule — décidément, la poule et l’œuf. Ces questions, il est donc fatal que Castellucci ne fasse que les effleurer, et sans doute ce n’était pas même son projet. Quel était-il, alors ? Dans la pure levée de ces images, peut-être, impressionnantes et pesantes, lourdes de l’imagerie judéo-chrétienne et gréco-romaine. Mais quand la métaphysique est un prétexte à fabriquer des images, elle n’est que ce bavardage de salon qu’on reçoit à distance, surtout quand on n’est pas de ce salon, ou seulement comme pique-assiette. Ça commence quand on entre dans la salle des Salins. On nous tend le programme et on nous propose des boules quiès. Peut-être que tout est là déjà. Oui, au moment où on s’installera, deux lourdes machines feront un boucan du diable, et le vrombissement sera à peine tolérable — autour de moi, on ne tardera pas à enfoncer dans les oreilles ce qui rendra le son plus acceptable, comme pour l’entendre à distance et dans le confort moelleux des dites protections. Il y aurait là comme un symptôme : la violence, oui, mais sans la douleur ; la saturation sensible, mais reçue avec soin. La neutralisation des affects jusqu’à rendre neutres tous affects ? Après les ballets des machines, qui n’auront hurlé que pour installer ce climat de peur (anesthésié) et nous avertir que nous entrons dans un monde automatisé, puissant et hostile — l’image, pure, de sa propre image au service d’elle-même : chez Castellucci, l’image se confond avec sa légende —, il entre. L’image, par contraste avec la machine, est saisissante : celle d’un corps vieilli que la démarche pénible rend plus vieux encore, visage épuisé, drap jeté sur lui, bâton à la main qui le soutient à peine. Une pure image de prophète, c’est justement ce qu’il est. Il lancera sa plainte au-delà de nous-mêmes, les mots de la Bible, celle du Livre de Jérémie — atroces et sublimes mots qui prophétisent la destruction des peuples impies ou désobéissants. Nous y sommes. La désobéissance qui appelle à la sanction. Mais désobéissance de quoi, de qui ? La langue de Jérémie n’est pas seulement lointaine, venue du fonds des âges et des cultures, elle est aussi littéralement étrangère — c’est en roumain que l’acteur la lâche sur nous, ou par-dessus nous, avec force gestes suppliants, à l’adresse plutôt du Dieu vengeur de l’Ancien Testament. Nous, en face ? On est moins destinataire de la parole que d’un jeu, outré et spectaculairement sublime, ostentatoire dans sa diction — et peut-être est-ce contre nous que les mots se disent ? On ne sait pas ; on regarde : on est déjà en dehors, de ce côté étranger des mots, devant l’image seulement. Puis il se tait ; s’éloigne. Entre peu à peu une foule de policiers à l’allure policière, costume plutôt que corps, avec force moustache, et matraque, insignes, casquette, et tout l’attirail. On nous a prévenus — avec les boules quies, le programme, tout aussi explicites dans ses intentions —, il s’agit en fait d’acteurs amateurs, des gens ramassés autour du théâtre à qui on a fait signé un contrat, plusieurs règles du jeu dont toutes se résumeraient à une seule : obéir, quoi qu’il en coûte. Munis d’une oreillette qui leur crache des ordres, ils devront se soumettre, c’est le jeu. Et justement, le jeu, au sens de l’espace vide qui rend possible le mouvement, sera réduit au minimum : ils feront les gestes qu’on leur dit, quoiqu’il se passe des autres ou d’eux. Succèderont donc pendant une heure et demie des tableaux, littéralement tableaux vivants, voire des tableaux véritables — cadre amené cérémonieusement sur scène d’un singe, de Beckett, d’un paysage… —, et les « acteurs » de contrefaire ce qu’on leur dit. Postures figées de grandes images (le Serment des Horaces par David ; une ou deux Pietà ; un radeau de la Méduse…) ; gestes répétitifs relevant de leur fonction (plus ou moins : tabasser dans le vide) ; parfois quelques gestes chorals… Qu’est-ce à dire ? Devant l’image, on est comme devant un cadavre : on se tait et on rêve. On tente de travailler. On fait des liens, on traduit. Et le spectacle, muet, impose un bavardage épuisant, au sens où il s’épuise lui-même dans le vertige vain de sa signification. Je ne cesserai pas, jusqu’à la fin, de traduire les ordres visuels en mots, et les mots d’ordre en intentions ; je me perdrai dans cette suite verbeuse de mots qui recouvrent l’image, et les oreillettes, invisibles, finissent par prendre toute la place et par tout occulter. Dispositif partout, expérience nulle part. On formule des hypothèses. Ainsi, entre Jérémie et les flics, il y aurait un lien de causalité. La tradition judéo-chrétienne aurait donné naissance, par perte de vue de son objet, et automatisation, à cette aliénation qu’incarnent les forces de l’ordre. Et de là une levée à l’allégorie : nous sommes, nous-mêmes, image de ces forces de l’ordre, obéissant à leur égard et à tous égards, obéissant aux ordres invisibles, lois morales, lois tout court. Autres hypothèses : il n’y aurait pas tant causalité qu’entrelacement. La parole divine répandue comme un sac (ou comme le sang d’une victime de bavure policière) se mêle aux gestes des flics, aux ordres, aux gestes de mise à bas qui dressent. Une autre encore : tout est violence, ou plutôt brutalité, et plus encore l’ordre quand il essaie de se maintenir — ainsi de Dieu réclamant la destruction des cités maudites, faisant le vide autour de lui. L’idéal de Dieu et de la Police est une place nette d’où se dégage l’odeur de l’encens ou des gaz lacrymogènes. On se perd longtemps dans ces rêveries inoffensives. Il y a surtout, partout, où qu’on porte les yeux, le poids désespérant — car plein d’espoir — de la transcendance. Les ordres viennent d’en haut, c’est bien connu, et c’est le dieu caché cher aux Jésuites qui les délivrent ; les tableaux sont pleins jusqu’à la gorge de références culturelles venues elles-aussi d’en haut. Il y a le regard de Beckett qui contemplent tout cela, d’en haut lui aussi, le pauvre, le poète des clowns aux pieds douloureux, celui qui chante tous ceux qui tombent, et qui est réduit ici à une note de bas de page universitaire. Cette plénitude bavarde dans le vide silencieux accable : elle n’est pleine que d’elle-même. Et elle se révèle vide. Peu à peu, l’indifférence se transforme malgré tout en gêne, politique et honteuse. Les flics n’ont que des flics sous la main, alors quand ils cognent, ce sont d’autres flics, et ils s’aspergent le crâne de faux sang. Ou ils se menottent les uns les autres (« comme je vous ai menottés » ?). Mais où sont les corps massacrés sous les coups véritables ? Où sont Zyed et Bouna, et Adama Traoré ? Et Zyneb ? Des ombres qu’on frappe encore et qu’on ne se donne pas la peine de lever. Oui, aujourd’hui, jeter sur un plateau des flics violents d’en haut d’une eschatologie chrétienne n’est pas seulement lâche, c’est d’une certaine manière se rendre complice des brutalités en refusant de voir ce qui la structure, socialement, et politiquement. La police tue, et pas seulement des ombres et des images : en faire l’économie sidère, révolte. Il y a longtemps que Castellucci récuse toute portée politique de son travail — le retour de bâton est édifiant. Vers la fin du spectacle, quelque chose, certes, affleure, qui s’émancipe du spectacle et de son arrogante transcendance. Deux scènes insoutenables, qu’aucune boule quiès ne peut cette fois neutraliser. C’est d’abord une scène de torture, littéralement : après avoir allongé un homme, on jette, sur le visage recouvert d’un drap, trois jerricans d’eau. Reconnue comme traitement cruel et inhumain, la technique de Waterboarding a été largement utilisée par les États-Unis dans sa « guerre contre le terrorisme » — de tels actes ont été documentés par les victimes, qui témoignent du sentiment de mort interminable. Cette technique est d’autant plus efficace qu’elle ne conduit jamais à la mort, mais au sentiment qu’on va mourir. On appelle cette torture le simulacre de noyade. Le mot lui-même renvoie au procès théâtral, à son processus. L’homme, à quelques mètres de nous, meurt dans le simulacre de sa mort, car il possède ce sentiment indubitable et faux — il sait qu’il ne va pas mourir ; et les autres qui l’entourent, qui le maintiennent violemment, le savent aussi. Cependant cette pensée ne le quitte pas, et nous non plus. On ne fait rien. On regarde, on est là pour cela. Plus tard. Tous les flics s’éloignent, quittent le plateau, et rejoignent la salle, les travées latérales d’où ils observeront l’un des leurs soudain se jeter sur le sol, et longuement convulser. Puis l’applaudissent, avant de le rejoindre — d’à leur tour, convulser, tous, longuement. Oui, c’est un seuil ; si, ici, la représentation est manifeste, elle l’est dans la mesure où s’accomplit un acte qui s’arrache de tout discours, se fabrique avec les corps de ceux qui, devant nous, au présent, traversent l’expérience d’une dépossession. On pourrait rattacher ces images à la pesanteur d’un propos — dire que la torture est l’apanage des policiers ; qu’ils font convulser leurs prévenus (lecture pauvrement littérale) ; ou que ces tableaux figurent un mécanisme de représentation : de notre mort intérieure face à l’obéissance ou de la convulsion de notre humanité (lecture bêtement allégorie) —, il n’en demeure pas moins deux images, telles qu’en elles-mêmes, qui attaquent au plus près la représentation, performance de ce qui excède toute image. Évidemment, le spectacle se rétablit. On fait venir un enfant, on tend des inscriptions en latin [1], on pose la question : la poule ou l’œuf ? L’enfant, qu’on habille comme le prophète, sort décoré d’un insigne qui le rend l’un des flics. Ainsi, se résout l’énigme : les enfants sont élevés comme des flics, c’est pourquoi on apprend l’obéissance, et que l’obéissance apprend à être obéissant. L’enfant, fils du prophète et son devenir, enfant de Dieu et père de Darmanin : Ita Missa est. À un petit garçon de cinq ans, je posai la question, le lendemain. « La Poule, ou l’Œuf, qui en premier ? » Il me répondit sans hésitation : le fermier. L’enfance nous sauvera des Pères.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 9:06 AM
|
Par Marie-Hélène Soenen dans Télérama 5 nov. 2021 Thierry Dupont est acteur dans une troupe de théâtre professionnelle composée de personnes en situation de handicap. En avant-première du festival Les Étoiles du documentaire, organisé par la Scam les 5, 6 et 7 novembre, regardez ce documentaire magique sur la liberté créative signé Anouk Burel. Sur notre site du 3 au 9 novembre inclus. Ancienne grande reportrice pour le magazine Envoyé spécial dix ans durant, Anouk Burel a eu un coup de foudre pour la Compagnie de l’Oiseau-Mouche lors d’un tournage à Roubaix. Cette compagnie de théâtre professionnelle singulière forme depuis 1978 des personnes en situation de handicap au métier de comédien. En 2019, Anouk Burel s’est immergée pendant plusieurs semaines dans la vie et les répétitions de la troupe et épouse, dans son très beau documentaire Le monde est un théâtre, la vision du pétillant Thierry Dupont, 50 ans, comédien depuis plus de trente ans. Elle met en lumière avec tendresse le vent de liberté créatrice apporté par ces personnes dotées d’une riche intériorité au métier de comédien. Comment vous êtes-vous intéressée à la Compagnie de l’Oiseau-Mouche ?
Je suis allée plusieurs fois à Roubaix pour Envoyé spécial. J’y ai notamment passé des semaines en immersion à la CAF [La Vie sur un fil, en 2015, ndlr]) et réalisé le portrait d’un médecin de famille [Le Médecin des oubliés, reportage pour lequel Anouk Burel a été finaliste du prix Albert-Londres en 2018, ndlr]. Pendant un tournage, j’ai découvert le restaurant de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, tenu par des personnes en situation de handicap. J’ai immédiatement eu envie de faire un film sur cette compagnie, qui fut la première à former professionnellement des personnes en situation de handicap. Quels sont ses principes directeurs ?
Ces femmes et ces hommes subissent au quotidien une marginalisation et une exclusion très puissantes. On dit qu’ils sont « différents », « bizarres », « pas normaux »… Or, ce qu’on appelle communément « un handicap », une faiblesse, dans notre société, est considéré comme une forme de génie artistique entre les murs de ce théâtre roubaisien. Le handicap devient la particularité de chacun, un rapport au monde singulier, riche et précieux. La compagnie de L’Oiseau-Mouche se repose sur leur créativité, et je trouve cette idée brillante. Thierry Dupont en studio. «Thierry, c’est Thierry. Peu importe le mot qui a été posé scientifiquement sur la façon dont il perçoit le monde.» Babel Doc Comment avez-vous eu l’idée de confier la narration à Thierry Dupont, pilier de la compagnie et personnage principal du documentaire ?
Thierry a une personnalité très attachante, il est toujours heureux, toujours positif ! Surtout, ce qui m’a fascinée, d’un point de vue cinématographique, ce sont les techniques improbables qu’il a inventées pour apprendre ses rôles. Thierry ne sait ni lire ni écrire, mais il arrive pourtant à mémoriser des textes de théâtre classique comme Phèdre ou Le Roi Lear en faisant des dessins, qui sont comme des hiéroglyphes, un autre langage. J’ai choisi Thierry pour cette poésie. Il aime aussi beaucoup improviser, il peut se mettre à chanter au milieu d’une phrase, il invente sans cesse des mots… Souvent, les films sur les personnes en situation de handicap adoptent un point de vue extérieur. J’ai voulu renverser le regard, faire rentrer le spectateur dans sa perception du monde et raconter sa particularité de l’intérieur. Thierry voit réellement le monde comme un théâtre. Pour lui, sa collègue Marie-Claire, c’est Marilyn Monroe. Il la voit vraiment comme ça. Jonathan, c’est Zeus ! Un passant qui porte son sac dans la rue « joue le rôle » de quelqu’un qui porte son sac… Cela peut faire sourire, mais c’est très profond, quand on y réfléchit. Shakespeare le disait : « Le monde entier est un théâtre, Et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. » Et si Thierry, comédien, perçoit le monde comme un théâtre, alors cela veut dire qu’il y a sa place. À 50 ans, il exerce depuis trente ans au sein de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. C’est un véritable lieu d’épanouissement. Certains n’auraient jamais cru pouvoir devenir acteurs, et ils y ont trouvé un sens à leur vie. Concrètement, comment a-t-il élaboré la voix off ?
J’ai réalisé une très longue interview audio de lui, d’une durée de six ou sept heures. Je l’ai fait parler de tout, de son enfance, de son rapport au théâtre… Je l’ai retranscrite et j’ai restructuré un récit, en reprenant ses mots. Je lui ai relu, et il y a apporté ses corrections. Puis il est venu en studio enregistrer sa voix à Paris. Au cours de l’interview, il m’a dit : « Je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. » À l’image, j’ai transformé cette interrogation en un aparté, comme dans la commedia dell’arte, quand Arlequin s’adresse directement au public. « Qu’est-ce que vous pensez de nous, les spectateurs ? » J’aime cette technique théâtrale, qui permet de souligner le rapport entre le comédien et son public. “Ce que nous appelons handicap, est-ce vraiment « quelque chose en moins » ?” Votre film démontre que ce ne sont pas les personnes en situation de handicap qui sont « limitées », mais bien notre regard.
Si l’on pense en termes de création, leur espace mental est bien plus vaste que le nôtre, extrêmement normé, encombré de barrières sociales. Le metteur en scène Michel Schweizer le dit très bien dans le documentaire : « La notion de handicap, je peux l’élargir et me demander, moi, à quel point je suis handicapé par rapport à l’imaginaire, au laisser-aller, au lâcher-prise. » Bien sûr, ce genre de sensibilité, de rapport au monde, peuvent être handicapants dans la vie de tous les jours. Mais ce n’est pas qu’un fardeau, c’est aussi un don. Le terme « handicap » sous-entend que ces personnes auraient quelque chose en moins, de dysfonctionnel. Je le trouve d’une grande violence. Depuis qu’elles sont enfants, ces personnes sont définies par des termes négatifs. J’aimerais que le film aide à repenser cela. Ce que nous appelons handicap, est-ce vraiment « quelque chose en moins » ? Thierry : “La peinture, c’est comme un théâtre de couleurs.” Extrait du documentaire. Babel Doc Pourquoi jugeons-nous une personne qui voit le monde différemment ? Pourquoi considérons-nous que notre point de vue a plus de valeur que le sien ? Sommes-nous capables d’ouvrir notre esprit ? La direction du théâtre n’a jamais voulu me dire de quelle maladie mentale ou psychique souffrent les comédiens. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais de semaine en semaine, en restant auprès d’eux, j’ai réalisé que ça n’était vraiment pas important. Une fois que nous nous débarrassons des étiquettes que nous collons sur les gens, ils sont tout simplement eux-mêmes. Thierry, c’est Thierry. Peu importe le mot qui a été posé scientifiquement sur la façon dont il perçoit le monde. Si la vidéo ne s’affiche pas, veuillez accepter les cookies (cliquez sur ce lien si besoin) “Le monde est un théâtre ”, d’Anouk Burel
Thierry Dupont, 50 ans, est un pilier de la compagnie de théâtre roubaisienne L’Oiseau-Mouche, qui forme des personnes en situation de handicap au métier de comédien. Dans son langage imagé, il raconte en voix off son rapport vital à l’art de la scène. « Pour moi, le monde entier est un théâtre », dit-il d’emblée. Ses camarades de jeu, il les décrit comme autant de personnages qui peuplent son monde intérieur. Dolorès est « la fille du soleil », Frédéric, « l’homme-stylo ». Le metteur en scène, Michel Schweizer, « un magicien, Merlin l’enchanteur »…
Si les témoignages de ces sept comédiens sont si émouvants, c’est qu’ils permettent de mesurer l’importance de la pratique théâtrale et du travail de la compagnie dans leurs vies. Toute la troupe laisse libre cours à sa fantaisie, réinvente le monde et repousse sans cesse ses supposées limites grâce à l’amour du théâtre. Filmé avec une grande tendresse, le sémillant Thierry ne sait pas lire, mais apprend ses textes en les dessinant. Son imagination et sa liberté créative apparaissent sans bornes.
Anouk Burel interroge subtilement le regard posé par notre société sur le handicap. Musique veloutée quasi féerique, digressions inattendues et fabuleuses lors d’une excursion à la bibliothèque ou au musée, aparté malicieux de Thierry, qui s’adresse soudain à nous face caméra… Dans ce film aussi joyeux que poétique, la réalisatrice s’applique à mettre en images toute la magie de ces êtres à part et à nous embarquer dans leur belle et immense intériorité. M.-H.S. À voir
Festival Les Étoiles du documentaire, vendredi 5 (à partir de 14h30), samedi 6 et dimanche 7 novembre, Forum des images, 2, rue du Cinéma, Paris 1er. Toutes les informations sur le site du festival : www.festivaldesetoiles.fr.
Accessible sur présentation de la Carte Festival, gratuite sur réservation sur www.forumdesimages.fr à partir du 25 octobre. Ou à retirer sur place.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2021 3:30 PM
|
Publié dans le Figaro avec AFP 2/11/2021
La CCI Formation Saint-Lô dans une prestation autour de l'enchantement, le 11 mai 2021. Capture d'écran Youtube - Apprentiscène
Depuis 2002, le programme dispensé par Les Alternateurs, une entreprise sociale et solidaire, a permis à plus de 10.000 jeunes de mieux appréhender leur travail et leur sociabilité.
Reprendre confiance en soi, savoir s'exprimer clairement, apprendre à travailler en équipe, gérer son temps, anticiper et prendre des initiatives : le théâtre a bien des vertus, notamment en termes d'insertion professionnelle des apprentis, de tout métier, dans leur savoir être en entreprise. «Les Alternateurs, entreprise sociale et solidaire, n'ont de cesse que d'essayer d'accomplir cette mission à son échelle et portée par toute l'énergie de ses équipes engagées et au travail» revendiquent Olivier Mothes et Pascal Sandoz, fondateurs de la formation, sur le site d'Apprentiscène. Depuis près de vingt ans, ils ont permis à plus de 10.000 jeunes de se former, pour mieux appréhender leur travail et leur sociabilité. Des metteurs en scène et des scénaristes dispensent vingt heures de formation de théâtre aux apprentis, divisés en groupes de cinq à sept personnes. Quatorze heures d'ateliers sont dispensées au sein des CFA, en fonction du planning des apprentis. Les six restantes sont consacrées à la répétition sur scène. À l'issue de la formation, ils concrétisent leurs efforts sur les planches d'une grande salle prestigieuse. Cette année, six représentations sont programmées au théâtre Marigny du 18 au 25 novembre, où différents domaines seront évoqués : commerce, industrie ou encore transport. Plus de 500 apprentis de 16 à 28 ans se donneront la réplique. Le spectacle, composé de quinze saynètes, est ouvert au public sur réservation, pour la modique somme de cinq euros. «Maintenant, je suis plus ouverte» À Paris, Aminata, Hopkins et Jonathan, apprentis dans la vente, se préparent au grand jour. Ils écoutent attentivement Emmanuelle Dupuy, la metteuse en scène. Tous sont en deuxième année de CAP «employé polyvalent de commerce» et ont choisi d'intégrer le programme d'Apprentiscène. «Il nous reste deux répèt'», mais «pas de panique», les rassure d'emblée la metteuse en scène, Emmanuelle Dupuy. Dynamique et pleine d'enthousiasme, cette femme impliquée dans le projet depuis 19 ans, tourne dans différents CFA pour ces formations auprès d'apprentis dans la cuisine, le BTP mais aussi la coiffure. Son groupe a choisi de plancher sur le thème du racisme ordinaire. Ils travaillent six saynètes, issues pour partie de séances d'improvisation : un contrôle d'identité musclé, un quiproquo devant un centre commercial, ou encore une scène de recrutement avec des questions inappropriées sur les origines. Entre chaque brève, les jeunes doivent déclamer une citation sur le racisme, les préjugés, la discrimination. Le texte est adapté au fil de l'eau par les jeunes. Philippe, apprenti vendeur dans une grande surface, veut par exemple retirer le terme «feignasse», craignant d'oublier des mots «s'il y en a trop». L'enseignante concède, tout en lui faisant gentiment remarquer qu'elle ne lui fait tout de même pas «jouer Hamlet». D'abord un peu hésitants sans leur texte sous les yeux, les jeunes sont plus à l'aise au fil des répétitions. Certains redoutent «un petit peu» de se retrouver face à des centaines de spectateurs, à l'instar d'Aminata. Mais la jeune vendeuse en boulangerie ne regrette pas de s'être inscrite. «Avant, j'étais plutôt calme et réservée. Et maintenant, je suis plus ouverte», dit-elle. Philippe, qui assure comme son camarade Kalvin, ne pas être inquiet, trouve aussi que «ça change du quotidien» et que «c'est sympa».

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 6:23 PM
|
Par Cassandre Leray dans Libération le 29 octobre 2021 Depuis juin 2020, le groupe Audiens accompagne les victimes de violences sexistes et sexuelles dans la culture, soit bien avant l’émergence de #MeTooThéâtre. Des militantes dénoncent le manque de communication et d’implication du ministère. Des années ont beau s’être écoulées depuis l’explosion du mouvement #MeToo, la même question se pose après chaque scandale : que faire une fois la parole libérée ? Les militantes du collectif #MeTooThéâtre, qui a vu le jour le 7 octobre, le martèlent : elles ne veulent pas s’arrêter au recueil de témoignages. Le constat a déjà trop été fait, et ce dans chaque branche de la culture. Elles attendent des actions concrètes, à commencer par une véritable prise en compte de la parole des victimes. «Il faut que l’on sache vers qui se tourner quand on subit des violences», insiste Marie Coquille-Chambel, membre du collectif. Depuis un peu plus d’un an, Audiens, le groupe de protection sociale du monde de la culture, de la communication et des médias, tente justement de répondre à cette attente. Créée en juin 2020, une cellule dédiée aux professionnels du spectacle vivant et enregistré, mais aussi du jeu vidéo, vise à recueillir les témoignages des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le secteur (1). «Notre rôle, c’est d’accueillir la parole des victimes et de les aider à déposer plainte si elles le souhaitent», explique Carla Ballivian, pilote de la cellule. «Le secteur n’accepte plus l’impunité» Concrètement, les personnes qui appellent sont orientées soit vers un accompagnement psychologique, soit vers une assistance juridique – ou les deux – en fonction de leurs souhaits. Mise en place à l’initiative des partenaires sociaux du monde de la culture, la cellule s’adresse aussi bien aux intermittents qu’aux salariés en poste fixe, et la confidentialité est garantie. Pour Carla Ballivian, ce travail a avant tout pour but d’envoyer un message clair : «Le secteur n’accepte plus l’impunité.» A l’autre bout du fil, les professionnels à l’écoute disposent quant à eux d’une «connaissance solide du secteur de la culture» absolument indispensable, selon la pilote de la cellule. Car le monde culturel, de par sa structure, enferme bien souvent les victimes dans le silence. Entre «l’importance du réseau» pour trouver du boulot et la notoriété dont jouissent certaines personnes mises en cause, difficile, voire impossible de témoigner : «C’est un milieu dans lequel tout se sait, alors les victimes ont peur d’être stigmatisées et de ne plus pouvoir travailler si elles parlent», relève Carla Ballivian. Pas de communication du ministère Depuis son lancement, la cellule a reçu environ 115 appels, dont 53 % pour dénoncer «des actes ou des agressions physiques», précise Carla Ballivian. Des chiffres loin de coller à l’ampleur des violences dans le secteur culturel, que ce soit dans le cinéma, la musique ou le théâtre. Il faut dire que le ministère, qui finance pourtant le dispositif à hauteur de 250 000 euros, ne «communique absolument pas à ce sujet. Il y a encore énormément de personnes qui ne savent même pas que ce numéro existe malgré son importance», regrette Marie Coquille-Chambel. D’ailleurs, «le ministère n’a pas fait de communiqué de presse» au lancement de la cellule, abonde Carla Ballivian. Et «pas un seul non plus depuis le #MeTooThéâtre, alors que c’était l’occasion de rappeler l’existence de cet outil», reprend la membre du collectif. Aline César, copilote du groupe «Egalité Diversité» du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) : «[La cellule] permet de sortir les victimes de l’isolement, de la culpabilité, et de qualifier les faits. Mais ce n’est pas suffisant», affirme-t-elle, pointant le manque d’implication du ministère. En effet, les informations recueillies par la cellule ne sont pas transmises au cabinet de Roselyne Bachelot. Si pour Carla Ballivian, «les victimes pourraient avoir peur de parler si le nom de la personne qu’elles accusent était remonté au ministère», selon Aline Cesar, c’est justement là que ça coince. Puisque le ministère n’a pas connaissance des informations recueillies, «il leur est impossible de se saisir de ces affaires et de lancer des enquêtes internes ou des signalements», regrette-t-elle. Résultat : «Les mis en cause restent à des postes haut placés, et il ne se passe rien.» Selon la syndicaliste, une remontée et un recoupement devraient être systématiques afin d’éviter que le poids de la procédure pèse uniquement sur les épaules des victimes. Même discours du côté du collectif #MeTooThéâtre, qui soutient qu’il faut aller plus loin encore. «Il faut que des signalements soient faits, que le ministère communique sur cette cellule et renforce ses liens avec elle… énumère Marie Coquille-Chambel. Tout simplement qu’il y ait un positionnement fort du ministère de la Culture.» Aussi bien concernant les violences dans le théâtre que dans l’ensemble du secteur culturel, reprend la critique et militante : «Il est temps que la sphère politique s’empare de ces questions.» Malgré nos sollicitations, le ministère de la Culture n’a pour l’instant pas répondu à nos questions envoyées le… 12 septembre. (1) Stop violences sexistes et sexuelles : 01 87 20 30 90.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 11:48 AM
|
Par Chantal Guy dans Lapresse.ca (Montréal) le 21/10/21 Il y a 10 ans, on n’était pas loin de trouver que le Québec était une société trop émotive, puritaine ou liberticide parce que la polémique faisait rage autour de la venue au Canada de Bertrand Cantat, ex-leader du groupe Noir Désir, condamné pour avoir battu à mort sa compagne Marie Trintignant en 2003. Il était à l’affiche de la pièce Des femmes montée par Wajdi Mouawad, d’après trois œuvres de Sophocle, Les Trachiniennes, Antigone et Électre.
À l’époque, le débat avait tourné autour de l’importance de la réhabilitation et de la liberté créatrice du metteur en scène, qui s’était réfugié dans un mutisme pendant deux semaines, laissant Lorraine Pintal, la directrice du TNM, le défendre dans les médias. Devant l’ampleur du tollé, Bertrand Cantat n’était pas monté sur scène, ni au festival d’Avignon, où Jean-Louis Trintignant, père de Marie, était aussi au programme. Le fait que le gouvernement de Stephen Harper, détesté par le milieu des arts, se soit mêlé de l’affaire en menaçant de ne pas donner de permis de séjour à Cantat n’avait pas aidé à calmer les esprits. Quand Wajdi Mouawad avait finalement pris la parole, il avait dénoncé un opportunisme politique. Il avait aussi reconnu son erreur de ne pas avoir anticipé cette polémique et que si les choses étaient à refaire, il n’aurait rien changé, mais aurait mieux expliqué son projet. Nous sommes en 2021. Wajdi Mouawad, directeur du théâtre national de La Colline à Paris, a choisi de faire appel à nouveau à Bertrand Cantat pour signer la musique de sa pièce intitulée Mère. Et c’est maintenant en France que la polémique enfle, alors que le milieu théâtral est précisément en train de vivre son moment #metoo depuis quelques semaines. Le directeur a aussi programmé pour la saison 2022 une pièce de Jean-Pierre Baro, visé par une plainte pour viol classée sans suite, mais qui avait mené à sa démission de la direction du Centre dramatique national d’Ivry. Quel timing, quand même. Cette fois, Wajdi Mouawad ne pourra pas dire qu’il n’a pas vu venir la tempête, et on se demande s’il a appris quoi que ce soit de ce qui s’est passé en 2011 ou s’il est sourd au changement de culture qui a lieu depuis une décennie à propos de la violence faite aux femmes. À bien y penser, est-ce que Bertrand Cantat est le seul musicien sur la planète avec lequel il pouvait collaborer pour cette pièce ? Est-il à ce point génial que le dramaturge est prêt à se jeter encore dans la fosse aux lions ? En tout cas, il tient son bout et refuse d’annuler Cantat et Baro. Dans une lettre publiée sur le site du théâtre de La Colline, il explique : « Les combats pour l’égalité entre les femmes et les hommes et celui contre les violences et le harcèlement sexuel sont en train de transformer durablement nos sociétés. Si j’y adhère sans réserve, je ne peux en aucun cas appuyer ni partager le sacrifice que certains font, aux dépens de la justice, de notre État de droit. Pour ma part, il est hors de question de me substituer à la justice. » Il dit aussi refuser d’adhérer à un mouvement qui, « sans même en avoir conscience, reprend à son compte les scories d’un catholicisme rance ressassant jusqu’à la nausée le péché originel conduisant à l’effroyable notion de “dette infinie” selon l’expression de Deleuze » et évoque « une forme contemporaine d’inquisition ». « À cette dictature qui ne dit pas son nom, je ne m’associerai jamais. Et que l’on ne vienne surtout pas m’opposer, à moi, la notion de victime. Victime je l’ai été. Je n’ai en ce sens aucune leçon à recevoir de quelque curé que ce soit. » Lisez la lettre complète S’assumer En 2003, quand tous les médias débarquaient à Vilnius, où s’est déroulée l’agression de Marie Trintignant, j’ai bien failli succomber à cette vision romantique d’un amour passionnel qui avait tourné à la tragédie un soir de beuverie. Or, on a appris beaucoup de choses depuis sur cette affaire, à laquelle se sont ajoutées des révélations plus que troublantes sur Cantat. Le rapport d’autopsie de Marie Trintignant, révélé en 2019, est affreux à lire. On parle de coups répétés, d’hématomes sur le visage et le corps, les os du nez éclatés, les nerfs optiques presque détachés, et six heures d’attente avant d’appeler les secours. Dans quelques enquêtes journalistiques, des membres de l’entourage du chanteur ont fini par admettre que Cantat s’était montré violent plusieurs fois avec les femmes. Sans oublier le suicide en 2010 de sa conjointe qui l’avait soutenu dans la tourmente, Krisztina Rády, mère de ses deux enfants, six mois après avoir laissé un message sur le répondeur de ses parents où elle disait que Cantat la violentait. Ça fait beaucoup pour un type qui aurait « payé sa dette » à la société avec quatre ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant, mère de quatre enfants. Ce qui s’est passé depuis dix ans, ce sont plusieurs épisodes #metoo, le mot « féminicide » qui s’est implanté dans le vocabulaire, et la prise de parole des femmes qui ne reculeront pas. Wajdi Mouawad apparaît comme un homme de convictions profondes, ce qui est tout à son honneur. Il semble par contre oublier le droit de réaction aux propositions artistiques, qui a toujours existé. Il assume ses choix, mais qu’il ne soit pas étonné s’il y a plus de manifestantes à sa première que de spectateurs. C’est toujours le public qui décide, et le public a changé lui aussi. Pour ma part, je demeure attachée aux idées de réhabilitation et de liberté créatrice. Bertrand Cantat a le droit de vivre sa vie, mais je ne suis pas obligée d’aller l’applaudir. Wajdi Mouawad a le droit de l’embaucher, mais qu’il en accepte les conséquences. En 2011, j’avais trouvé son idée à la fois douteuse et audacieuse, je me disais que dans le contexte de l’œuvre de Sophocle, elle pouvait peut-être avoir du sens. En 2021, je vois surtout une provocation pour le moins insensible.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2021 10:31 AM
|
par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 29/10/21 Ce sont là les premiers mots de la pièce de Jean-Luc Lagarce « Les règles du savoir vivre dans la société moderne ». L’auteur l’avait créée avec Mireille Herbstmeyer. Marcial di Fonzo Bo reprend le flambeau avec Catherine Hiegel. Un régal d’impertinence. « (Idée d’un spectacle, j’en reparlerai )» note, entre parenthèses, Jean-Luc Lagarce, dans son Journal, le 13 janvier 1988. Il vient de lire (c’est un gros lecteur, un insatiable, un curieux) un ouvrage réédité mainte fois depuis sa première édition à la fin du XIXe siècle, signé par une prétendue baronne Staffe : Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. On y énonce, par le menu, toutes les règles à suivre aux différentes étapes de la vie et bien d’autres choses. Le fils d’ouvrier protestant Lagarce se plaît à lire ces règles vouées à être lues en priorité par la bourgeoisie catholique française. Il n’en reparle pas tout de suite mais quelques années plus tard. Henri Taquet (disparu en mai 2019 à l’âge de 87 ans) était alors le dynamique directeur du Granit de Belfort. Il aimait bien le régional Jean-Luc (basé à Besançon) et lui avait proposé d’écrire chaque années librement les éditos de la plaquette de saison plutôt que de s’adonner lui même à cet exercice souvent fastidieux. Lagarce écrit donc des éditos qui n’en sont pas, ne parlent pas des spectacles de la saison mais de la vie, du théâtre, de l’écriture, ce qui lui passe par la tête. Ces textes exquis figurent aujourd’hui dans le recueil Du luxe et de l’impuissance. Taquet lui fait d’autres propositions, des stages par exemple. Et un jour il lui demande si cela lui dirait d’écrire une pièce qui se jouerait en appartement. Une mode, alors naissante, lancée par Pierre Ascaride. Le pudique Jean-Luc n’est pas très chaud pour ce genre d’intrusion, mais n’ose dire non à cet homme aimable et attentionnée. Il se souvient alors de cette « idée » qui lui est venue quelques années plus tôt. Un contrat est signé en mars 1992, et c’est ainsi que nous arrivent en janvier 1993 Les règles du savoir vivre dans la société moderne. Comme on s’en doute, les phrases de la baronne sont revues, augmentés et corrigées par Lagarce qui aime de temps à autre, écrire dans les mots d’un autre comme il l’avait fait et le fera encore avec Kafka. Il coupe, ajoute, insiste, fait des détours, réitère, travaille le rythme, les modulations. Du pur Lagarce. Il jubile, on le devin , en réécrivant la dite baronne. Et c’est parti : naissance, baptême, fiançailles, mariage… des règle s de plus en plus surannées et ce n’en est que plus drôle., Tout finit par la mort écrit celui qui est atteint par le sida et sait qu’il ne vivra pas « éternellement ». C’est une pièce à la fois extravagante et on ne peut plus simple : la « dame », unique personnage, s’adresse au public. Taquet est satisfait mais cherche en vain un metteur en scène pour présenter la chose en appartement. Lagarce décide finalement de monter la pièce lui-même mais dans un théâtre, avec l’actrice toute désignée, celle qui est à ses côtés depuis le début : Mireille Herbstmeyer. La première a lieu au Granit de Belfort. Le spectacle va beaucoup tourner. Après la mort de Jean-Luc Lagarce, son héritier littéraire, son ami de longue date, François Berreur la mettra par deux fois en scène, avec, toujours, « la Herbstmeyer » comme l’appelait Jean-Luc. Je me souviens, un soir à Montbéliard, avoir vu ce spectacle avec, à mes côtés, les parents de Lagarce. Tout cela est loin. Berreur et « la Herbstmeyer » ont fait du chemin, et quels chemins !.Lui comme éditeur et à ses heures metteur en scène. Elle comme actrice, actuellement dans Le condor (lire ici). La pièce, elle, vit sa vie, chérie par les cours de théâtre et les troupes amateures, traduite en plusieurs langues, etc. Et voici que Martial di Fonzo Bo, le directeur de la Comédie de Caen, et l’actrice Catherine Hiegel (ex doyenne de la Comédie-Française ) qui se connaissent bien, s’associent pour offrir un nouveau tour de piste à cette pièce aussi simple qu’invraisemblable. Du pain béni (restons dans le registre catho) pour l’actrice qui se régale de la moindre phrase et du metteur en scène qui, l’ayant bien coachée pour bien la connaître, n’a plus qu’a organiser la soirée en trois mouvements. La folie de la Herbstmeyer était aussi intérieure qu’inquiétante. Tout à l’inverse, Catherine Hiegel apparaît faussement sage (robe noire, col blanc), mais très vite diablement bouffonne, foldingue, laissant la folie douce du personnage s’installer par paliers. Autant de façons de propager le rire corrosif de Lagarce. Les deux actrices évitent le piège de la conférencière. Mireille Herbstmeyer, cheveux tirés, martiale dans des regards assassins, Catherine Hiegel, cheveux en bataille, toujours en mouvement avec des changements de voix et de regards sidérants, des reconfigurations multiples avec ou sans bouquets de fleurs, cahier de texte et, basse continue : une ironie dévoratrice. Elle bondit dans chaque mot. Assis dans le fond de la salle, le fantôme de Jean-Luc Lagarce applaudit. Théâtre du Petit Saint-Martin, 19h ou 21h en alternance, du mardi au samedi.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2021 11:43 AM
|
Publié par Sceneweb le 29 octobre 2021
Suite à la tribune de Jean-Pierre Baro publiée la semaine dernière, et après un premier droit de réponse de son avocate, la plaignante, qui n’avait jamais pris la parole a souhaité rompre le silence.
Me voilà aujourd’hui tenue de choisir entre continuer à rester en retrait de l’espace médiatique comme je m’y tiens depuis que j’ai déposé plainte contre monsieur Jean-Pierre Baro en 2018, ou prendre la parole publiquement, ce dont je me suis toujours abstenue malgré ses diverses prises de parole depuis lors.
Suite au récit offensant produit par monsieur Jean-Pierre Baro ces derniers jours sur le média Sceneweb, et repris ensuite par d’autres médias et par nombre de personnes du milieu du théâtre, récit entendant faire revenir la honte dans mon camp, je me vois dans l’obligation de prendre la parole.
Ceci afin de répondre à certains points précis de son récit mensonger, me mettant en scène à renfort de détails permettant non seulement de m’identifier, mais également d’accéder à la fameuse « version des faits tels qu’ils se sont déroulés » de monsieur Jean-Pierre Baro, sa parole outrageante ayant ainsi le loisir de s’étaler de manière publique, plus de trois ans après que j’ai saisi la justice et vu ma plainte classée sans suite, faute d’éléments permettant de suffisamment caractériser l’infraction.
Monsieur Baro aurait pu dire son innocence en rappelant le droit, puisqu’il est présumé innocent. Il avait le choix de le redire sans user d’un procédé visant à réaffirmer publiquement la puissance de sa parole écrasante contre celle à qui la justice demande des preuves qu’elle n’est jamais en mesure de fournir.
N’est-ce pas ce qui est exigé des présumées victimes, l’obligation de n’outrager personne par leur parole dans l’espace public sans avoir les preuves de ce qu’elles avancent ?
Les règles de l’état de droit s’imposent à tous et pas uniquement aux victimes présumées.
Ce plan de communication comporte plusieurs objectifs, et je ne répondrai ici qu’à celui qui vise à me nuire personnellement par des mensonges éhontés.
Les autres objectifs de ce plan de communication, intervenant dans le contexte de la programmation de monsieur Jean-Pierre Baro par le Théâtre national de la Colline et des réactions que cela a suscitées, ne me concernent pas. Qu’il soit clair ici que ma lettre ne vise en aucun cas à prendre position à ce sujet.
En 2018, j’ai déposé plainte, m’engageant dans un processus long et qui m’a énormément coûté, en temps, en énergie mentale et psychique, et financièrement.
Après que la plainte a été classée sans suite, un journaliste a relayé partiellement son contenu, aux côtés de deux autres témoignages – témoignages n’ayant fait l’objet d’aucune enquête à ce jour.
Monsieur Baro feint d’avoir oublié ces autres témoignages, s’autorisant, en réponse à l’article de ce journaliste, ce récit qui s’attelle à produire un discours qui vise à ne faire exister qu’un seul des témoignages en l’isolant, le mien. Le seul témoignage porté devant la justice, donc le seul au sujet duquel il puisse prétendre avoir été « innocenté » par « le Procureur de la République », ce qui est juridiquement faux.
En effet, sur le courrier du procureur de la République que j’ai reçu en 2019, il est écrit : « Ce classement ne signifie pas que vous n’avez été victime d’aucun fait, mais qu’en l’état les éléments recueillis ne permettent pas de justifier les poursuites pénales. Je vous informe que cette décision pourra être revue si de nouveaux éléments venaient à être rapportés »
Que monsieur Baro affirme avoir été innocenté est un mensonge. Mon avocate l’a signalé par droit de réponse au lendemain de la parution de ce récit, droit de réponse publié en préambule de son communiqué, sur Sceneweb.
Que j’ai été une collaboratrice de monsieur Baro et que nous ayons travaillé ensemble durant des années est un fait. Personne n’a jamais prétendu le contraire et je peux ici le réaffirmer. Répéter cela, comme pour se justifier, ne vient en rien attester que les faits que j’ai dénoncés n’ont pas existé ou qu’ils se sont déroulés tels que monsieur Baro le prétend.
Qu’il écrive qu’il n’y ait eu « aucune hiérarchie entre nous » et que monsieur Baro n’ait eu « aucun ascendant sur [moi], ni par [sa] position, ni par [sa] notoriété » au moment des faits que je dénonce est inexact.
Monsieur Baro était l’un des artistes portés par ce bureau de production, j’étais une assistante de production en Contrat à Durée Déterminée. Il n’est pas besoin d’étayer mes propos d’études sociologiques pour avancer qu’un metteur en scène, artiste, ayant déjà mis en scène des spectacles, occupe dans l’échiquier socio-professionnel une place supérieure à une assistante de production sortie d’étude et en premier poste.
On précisera que la relation de monsieur Baro avec les co-directeurs qui m’avaient recrutée était nettement antécédente à celle que j’avais avec eux. Sa compagnie était cliente et partenaire de ce bureau, tandis que j’en étais salariée en CDD depuis moins d’un an.
Monsieur Baro insinue que j’aurais décidé de ne pas candidater au TQI à ses côtés parce « qu’entre temps [j’]étais devenue directrice » du bureau de production. C’est faux puisque je l’étais déjà depuis 3 ans, à savoir depuis 2015.
Cette décision de ne pas candidater est justement en lien avec les faits que j’ai dénoncés, et visait à me protéger.
Aujourd’hui, je pourrais me tourner vers la justice à nouveau, me constituant partie civile, afin de demander qu’un juge d’instruction soit saisi des faits pour lesquels j’ai déposé plainte.
Ce faisant, je m’engagerais -onze ans après les faits que je dénonce, trois ans après m’être adressée à la justice comme je le devais, sans obtenir que ces faits soient jugés dans un second parcours du combattant (de la combattante, devrais-je dire), à nouveau coûteux en énergie, en force mentale, psychique, en temps de vie, et enfin en frais de justice que je n’ai pas à ma disposition.
Malgré tout ce que je lis, je n’ai jamais regretté d’être entrée dans ce commissariat ce jour là. Parler m’a libérée. Croire en la justice -aussi perfectible soit-elle- et lui faire confiance, aussi. Lorsque l’agent qui a pris ma déposition m’a raccompagnée vers la sortie, il m’a dit « en tous cas, quoi qu’il advienne maintenant, vous pourrez vous regarder dans une glace le matin et vous dire que vous avez fait ce que vous aviez à
faire ».
En tout état de cause, et quelque soit la suite donnée à cette dénonciation, je devais prendre la parole aujourd’hui.
Il importait d’indiquer au lectorat de la tribune de monsieur Baro que ce plan de communication est façonné d’inexactitudes tant sur un point de droit fondamental que sur de nombreux points qui ficellent son récit.
Il était essentiel que soit clarifié qu’un classement sans suite n’est rien d’autre que l’impossibilité pour la justice à ce jour de tenir compte d’une parole qui ne peut se démontrer.
C’est une injure d’affirmer qu’il en est autrement, et il est indécent de se prévaloir d’un innocentement juridique inexistant.
Tout cela en réclamant que les autres n’agissent que dans le cadre de la loi, sans en respecter soi-même les bases.
Que la justice ne soit pas en mesure de tenir compte de ma parole est une chose, que monsieur Jean-Pierre Baro en profite pour raconter n’importe quoi à mon sujet en est une autre, et ce n’est pas tolérable. Pas dans un état de droit.
Le présent communiqué vise uniquement à répondre à cette inversion des positions qui devient insoutenable pour moi qui demeure depuis 3 ans dans le plus strict silence.
La plaignante, en réponse au communiqué de monsieur Jean-Pierre Baro, le 27 octobre 2021.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 8, 2021 5:23 AM
|
Par Stéphane Capron pour France Inter - 3 nov 2021 Trois ans après "Kanata", la troupe du Théâtre du Soleil retrouve les planches avec "L'Île d'Or", une création collective en harmonie avec Hélène Cixous et dirigée par Ariane Mnouchkine. Repoussée à cause de la Covid-19, la pièce est l'un des évènements de cette rentrée automnale. Ariane Mnouchkine accueille les spectateurs à la Cartoucherie de Vincennes © Radio France / Vincent Josse "L'Île d'Or", spectacle retardé d'un an, est un grande fresque comme la metteuse en scène a l'habitude d'en créer avec sa troupe. Un spectacle qui s'est créé dans le plus grand secret. De cette Île d'Or, ce que l'on peut juste vous dire, c'est qu'Ariane Mnouchkine et son autrice Hélène Cixous, sont allées puiser l'écriture dans la tradition du théâtre japonais. "C'est une île, elle existe et elle est aussi imaginaire", explique la metteuse en scène. "Elle se situe quelque part dans les mers japonaises. Où est-ce que l'on va emmener les spectateurs ? On va les emmener là où nous nous sommes transportés nous-mêmes : dans un cauchemar, une insomnie, un rêve. Quelque chose qui est de l'ordre à la fois du désir et de l'effroi et qui nous permet de réaliser des voyages nécessaires et impossibles, si impossibles dans la réalité. Il n'y a que le théâtre qui permet ces voyages profonds." "La pandémie n'a rien inventé" Cette Île d'Or est une création très attendue, parce qu'elle aurait dû voir le jour l'année dernière. Et la pandémie a tout bousculé dans l'organisation du théâtre du Soleil. Quand le confinement a été décrété le 17 mars 2020, la troupe allait commencer à répéter. "Cela a été compliqué mais pas vraiment une catastrophe. Car maintenant, on joue. Mais ça a bousculé tout le monde, pas seulement nous." Quand on a commencé à imaginer ce spectacle de voyage autour du Japon, on ne savait pas du tout qu'un monstre allait déferler sur la terre et éclairer beaucoup de choses d'une lumière différente des choses qui existaient déjà. La pandémie n'a rien inventé, elle a juste éclairé des choses qui étaient tapis dans l'ombre et que nous laissions dans l'ombre parce qu'elles sont peut être trop terribles à considérer. La pandémie a été comme une espèce de fusée éclairante. Le spectacle a été ébranlé et secoué par ce qui se passait, pas seulement par la pandémie, d'ailleurs. Peut-être par d'autres monstres ?" "Je crois à la force thérapeutique du théâtre" A 82 ans, et après la pandémie, Ariane Mnouchkine n'a rien perdu de son "appétit pour le théâtre" poursuit la créatrice du Théâtre du Soleil. "Nous avons été atteints par cette pandémie mais il faut prendre sur soi pour en sortir et ne pas céder à cette crainte qu'on nous a inculqué et qui parfois était légitime. J'admire les gens qui, au lieu de rester devant leur télé, recommencent à sortir pour reprendre contact avec l'art, la musique, le théâtre, le cinéma. C'est à ce prix que la vie reprendra." "Je crois en la force thérapeutique du théâtre. Je pense que ça doit faire du bien. Le théâtre, ça doit donner des forces, même au prix d'une lucidité parfois cruelle. Je pense que la catharsis, ça existe et que le public doit sortir du théâtre en se sentant mieux que lorsqu'il y entre. Il doit se sentir plus plus fort, plus confiant, bouleversé, ému. Quand on a cette chance d'aimer son métier comme nous l'aimons, le désespoir serait coupable. On n'est pas payé pour désespérer !" Un retour aux sources pour Ariane Mnouchkine Chaque création du Théâtre du Soleil est un évènement, attendu par le public avec une grande impatience. Des dizaines de billets ont déjà été vendus. 80 personnes ont travaillé pendant 3 ans sur ce spectacle qui est comme un retour aux sources pour Ariane Mnouchkine qui avait découvert la tradition du théâtre japonais au début de sa carrière. Cette Île d'Or est un hommage à tout. A tous les âges de la vie, à tous les gens qui nous ont enseigné quelque chose. C'est un hommage à tous nos maîtres japonais, indiens, ou occidentaux. Parfois, je regarde le spectacle, je me dis que c'est comme un rêve. Toutes les fées se sont penchées sur nos berceaux, toutes les fées, toutes les muses. On a beaucoup appelé nos muses.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 7, 2021 7:15 PM
|
Publié sur le site de France Culture dans le cadre des Fictions "Les poètes ont buté l’amour au coin d’un bois. Et c’est mieux pour toujours." Stanislas Rodanski Ecouter la fiction radiophonique tirée du spectacle "Le rosaire des voluptés épineuses" de Stanislas Rodanski mise en scène Georges Lavaudant Un homme soliloque, écouté distraitement par un barman aussi méticuleux que facétieux nommé Carlton. Cet homme parle de l’empoisonnement de « Madame » ; il semble revenir de son enterrement dans une ville luxueuse (Megève ? Chamonix ?). Est-ce un mythomane, un meurtrier, un poète raté, un acteur pris dans le jeu des miroirs ? Une femme arrive. « La Dame du lac. » Ce pourrait être tout aussi bien la Mort. Héroïne de série B évoluant avec sophistication, elle vient rejouer le rôle de son amie, empoisonneuse qui a elle-même succombé au poison. S’est-elle suicidée ? A-t-elle été victime d’un meurtre érotique ? « Je lui ai fait boire la tasse », dit Lancelot (sic). Rituel enfantin ou jeu sado-masochiste ? Cherchez la femme- ne cherchez pas l’histoire. – Ça chemine, ça serpente, ça s’égare, ça se mord la queue – les fulgurances éclatent comme des obus inoffensifs. On passe du roman de gare aux écrits surréalistes les plus purs. Texte d’aventure ou aventure du texte ? Il ne reste plus qu’à s’abandonner à une écoute flottante et rêveuse, et laisser les mots se déposer sur vos paupières comme des flocons silencieux. Quatre fragments de textes tirés d’autres œuvres viennent compléter, éclaircir (obscurcir ?) ce Rosaire et la vie de cet écrivain trop méconnu : Stanislas Rodanski "de Shangri-la" Georges Lavaudant Mise en scène Georges Lavaudant
Réalisation radiophonique Pascal Deux
Création sonore Jean-Louis Imbert
Avec Frédéric Borie (Lancelot), Élodie Buisson (La Dame du Lac), Clovis Fouin Agoutin (Rodanski à 20 ans, gangster n°2), Frédéric Roudier (Carlton), Thomas Trigeaud (gangster n°1), Ariel Garcia-Valdès (lecture des didascalies)
Equipe technique Chef opérateur : Ivan Charbit
Opérateur : Antoine Hespel
Assistante à la réalisation : Manon Dubus
Conseillère littéraire Caroline Ouazana
Enregistré en juin 2021 au Théâtre des 13 Vents à Montpellier Merci au théâtre des 13 Vents de Montpellier et à Juliette Augy-Bonnaud
Georges Lavaudant est au micro de Blandine Masson, il nous raconte sa rencontre avec l'auteur Stanislas Rodanski
Note d’intention de Georges Lavaudant Comme très souvent avec Rodanski, qui à ma connaissance n’a jamais écrit de véritables pièces de théâtre, nous nous trouvons confrontés à plusieurs énigmes qu’il nous faut déchiffrer – parfois même accepter de laisser irrésolues. En apparence, nous sommes dans un hôtel/palace/tombeau (chez Rodanski, ne biffez jamais les mentions inutiles). Un dandy/criminel/poète du nom de Lancelot (comme le valet de trèfle) vient d’empoisonner/pousser au suicide une amie/amante portée sur le mensonge et les jeux érotiques. Bientôt on frappe à la porte. Apparaît alors la Dame du Lac, sorte de double ou d’ombre de la précédente, venue pour jouer son rôle. Mais c’est aussi, bien évidemment, la Mort, une mort aux multiples masques. S’ensuivent quelques échanges décalés, des réponses incertaines, des jeux de mots, des sommations, tout un attirail verbal évoquant des paysages enneigés ou retraçant la figure de la défunte (« Imago »). Tout cela à travers de longues phrases enroulées sur elles-mêmes comme des serpents se mordant la queue, sous le regard amusé et en la présence manipulatrice d’un serviteur : Carlton (« la voix de son Maître »). Tout ce beau monde, après l’apparition inopinée de deux gangsters, finira par s’enfuir pour la "Villa des mystères" qui, comme son homonyme pompéienne, réserve bien des surprises. Bien sûr, ce résumé ressemble à un mauvais fait divers, à la description d'un trip onirique ou à un scénario de série B, un genre que prisait particulièrement Rodanski. Il ne serait rien sans la langue somptueuse, elliptique, surréaliste de celui qui, tel Pessoa et d’autres, emprunta de multiples identités pour mieux brouiller les pistes. Mais derrière ces jeux de miroirs, ce dandysme de façade, ces chausse-trappes ironiques, il y a une vraie douleur, pudique, distanciée. Douleur de la naissance, douleur de la séparation de ses parents, expérience malheureuse de la déportation en camp de travail près de Mannheim, de la folie. Et douleur d'une Histoire tragique et aveugle, avec en toile de fond la menace jamais apaisée de l'extermination.
Georges Lavaudant, avril 2016 Note de Daniel Loayza "Il faut parfois expier le crime du monde." S.Rodanski Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1954, Rodanski a ponctué sa vie en deux moitiés définitives : vingt-sept ans hors de l'asile puis vingt-sept ans au-dedans, jusqu'à sa mort en 1981. Quelques amis ne l'oublient pas. Dès 1966, les publications de textes devenus introuvables ou d'inédits se succèdent. Parmi ces derniers, Le Rosaire des voluptés épineuses clôt le recueil Des Proies aux chimères (1983). De quand date ce texte ? Rodanski le destinait-il à n'être connu qu'à titre posthume ? Est-il sûr qu'il soit achevé, ou ne se présente-t-il qu'à l'état de fragment ? Nous n'en savons rien. Les vingt-sept pages qu'il occupe dans le volume des Écrits (Christian Bourgois, 1999) ne répondent à aucune question. Au contraire, l'énigme elle-même y devient un personnage. L'énigme ne se résout pas. On peut tout au plus l'éprouver. On peut répondre à son appel, autrement dit la suivre, accompagner sa fuite. Tout le texte de Rodanski s'inscrit et se défait dans son sillage. Chemin faisant, le poète sème d'étranges lieux : grands hôtels, chartreuse, autostrade et statues mégalithiques de l'île la plus lointaine, collines bleues à l'horizon, jardin endormi sous la neige, Villa des Mystères... Quelque part dans ce « dédale », la voix de Lancelot commence une phrase que la Dame achève pour lui « dans une chambre à coucher monumentale ». Un dialogue se noue, qui n'en est pas tout à fait un, entre un personnage et celle qu'il rêve peut-être, à la fois présente, passée et encore à venir ou à revenir, sous plusieurs noms : Dame du Lac, Bella Donna ou Imago. Peut-être qu'il l'a tuée ou la tuera, elle ou une autre, à force de lui faire jouer la mort. Peut-être que vie et mort échangent leurs masques, de même que rêve et raison, douleur et volupté renoncent à toute opposition trop simple. Est-on dans une cérémonie, dans un rituel tenant du sacrifice, du supplice, de la prise de voile ? Ce qui se bâtit, on croit l'entrevoir, c'est un lieu hors du monde trop plat et de la vie qui « a le style d'un télégramme », outre-monde ou "autre vie" où la Dame peut enfin se dire « merveilleusement solitaire avec ta morne voix de spirite en transe » – où elle et Lancelot seront "aussi isolés que les politiciens qui discutent la paix au Pays du Matin Calme". Isolés : dans une île, à l'abri. Dans l'asile d'un texte, nus dans leurs corps de mots, soustraits aux atteintes de ce qu'on appelle l'existence. A suivre un extrait de la fiction "Les scènes imaginaires". En 2019, Georges Lavaudant, était l'invité de France Culture sur le plateau de l'Odéon théâtre de l'Europe, pour un entretien avec Arnaud Laporte. Entouré d'acteurs, de son choix Astrid Bas, Isabelle Adjani, Pascal Reneric, André Marcon et Ariel Garcia Valdes, Georges Lavaudant nous avait fait partager à la fois sa bibliothèque et son monde imaginaire de metteur en scène. selon le principe de la collection il avait choisi des textes qui avaient comptés pour lui ou d'autres qu'il venait de découvrir et les avait offert à ces acteurs. Entrons dans l'univers du metteur en scène, avec un texte de Marguerite Duras lu par Isabelle Adjani

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 6, 2021 7:33 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 5 nov. 2021 A Bright Room Called Day….Une chambre claire nommée jour, texte de Tony Kushner, traduction de Daniel Loayza, mise en scène de Catherine Marnas. L’œuvre de Tony Kushner revient sur les scènes françaises avec un véritable engouement, rehaussée d’une urgence tonique puisqu’elle a l’audace de parler de notre temps présent, mettant au jour, en passant, nos actualités déconcertantes. En 1994, Brigitte Jaques créait en France au Festival d’Avignon Angels in America, un drame fleuve (1991) de Tony Kushner, adapté en mini-série et dont la pertinence sociologique et artistique propulsait l’auteur sur toutes les scènes internationales. Quelques vingt-cinq ans plus tard et même un peu plus, le cinéaste Arnaud Desplechin monte aujourd’hui au théâtre Angels in America à la Comédie-Française. Antérieure à Angels in America, la pièce que monte Catherine Marnas, directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine et directrice de l’étsba – Ecole supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine -, A Bright Room Called Day… Une chambre claire nommée jour, date quant à elle, de 1984, étrangement pertinente, politiquement. Elle est traduite en français par Daniel Loayza pour une première mondiale de la nouvelle version car Tony Kushner évoque, dès 2019, la figure de Donald Trump, réactualisant le propos initial en remplaçant le nom de l’ancien acteur président Reagan par celui du nouvel animateur de téléréalité devenu chef de gouvernement. La mise en scène de Catherine Marnas joue du réalisme et de l’onirisme, de la petite et grande Histoire, de Hitler à Donald Trump, tissant des liens d’une époque à l’autre. Un soir de Nouvel An 1932, dans une fête, des jeunes gens issus de milieux artistiques « éclairés et avisés », des actrices, un réalisateur de cinéma, prennent de haut l’ascension fulgurante de Adolf Hitler, un pantin, une caricature qui échouera… Les espace-temps sont superposés, les périodes historiques sont données à voir de front et de manière simultanée puisque la maîtresse de cérémonie de ce show théâtral n’est autre qu’une jeune femme « anarcho-punk », micro en main, et qui chante à l’occasion, mais qui surtout explique et déplie l’Histoire en proposant au public une série de photos emblématiques de la période qui va de 1928 à 1938. Déroulant patiemment une Histoire inavouable, la narratrice, new-yorkaise contemporaine, associe Reagan à Hitler, un raccourci dont on fera grief à l’auteur. Sophie Richelieu, stature élancée et moulée dans un pantalon de cuir éloquent, est hissée encore sur des talons hauts, en phase avec son temps, décidée et ironique. L’interprète mène la danse, sûre de sa démonstration historique, pleine de colère. Des clichés en noir et blanc qui font froid dans le dos, sont suspendus, des photos sur un écran longitudinal placé haut : saluts hitlériens, le portrait du Führer qu’on accroche partout, des cris de foule silencieux qu’on peut entendre en les imaginant. L’auteur et la metteuse en scène partagent cette vision de « glissements progressifs », propres aux démocraties, vers des valeurs d’extrême-droite. Et ces glissements, ces dérives, ces lâchetés ou ces semi-consentements ne concernent pas toujours les « autres », mais tous, autant que nous sommes, légers et changeants, tels certains anciens socialistes allemands alors passés au nazisme. Les divisions de la gauche allemande, raconte-t-on, ont favorisé l’arrivée de Hitler au pouvoir, alors que le mouvement communiste berlinois était sous la férule soviétique. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier, en pleine Grande Dépression : le fascisme n’est pas qu’un épouvantail qu’on brandit pour faire peur, une menace, une Apocalypse, il participe de notre non-engagement quotidien, pleutre et pusillanime. Gurshad Shaheman – double de l’auteur Tony Kushner – pénètre sur la scène et s’adresse au public, comme à la chanteuse au micro, expliquant pourquoi il voudrait bien changer tel passage dans le drame ou bien introduire telle variante significative. Entre la scène et la salle, le plateau et les rangées de spectateurs, il attend, efficace. Tonin Palazzotto est un diable de théâtre, une performance métaphorique du Mal. Agnès Ponthier, militante communiste, est convaincante, camarade fidèle à un mouvement d’obédience sincèrement collective, belle résistante prenant des risques. Bénédicte Simon qui joue la Vieille et une militante communiste est dévolue à la scène, mimant l’engagement politique ou hurlant les exactions et horreurs commises. Les comédiens Simon Delgrange – celui-ci interprète aussi un militant communiste -, Annabelle Garcia et Yacine Sif El Islam, incarnent des jeunes gens de leur temps, attirés par l’éclat d’une réussite personnelle, mais vivant mal en leur for intérieur les garanties politiques douteuses qui leur sont réclamées en échange, traîtres à eux. Quant à Julie Papin – Agnès -, elle porte en elle l’authenticité de ces mêmes repères de démocratie occidentale, sympathisante communiste qui cède son appartement aux camarades devenus clandestins, aimant son pays et ses amis, et ne voulant pas fuir Berlin – ville alors symboliquement ouverte -, à la différence de ceux-ci fuyant, par obligation, le nazisme pour telle appartenance politique, juive, homosexuelle. Nouvelle Antigone des temps obscurs, elle dit « Non » et résiste sur place, ne pouvant ne plus croire à ce qui l’a toujours fait tenir debout – sa foi existentielle en l’être. L’actrice émouvante et tenace accorde à sa figure emblématique force et aura. Véronique Hotte Les 18 et 19 novembre 2021 TNBA au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (Garonne). Du 23 novembre au 5 décembre 2021, du mardi au samedi à 20h30, dimanche 5 décembre à 15h, relâche les 28 et 29 novembre au Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 – Paris. Tél : 01 44 95 98 00. Le 8 décembre au Nest- CDN Transfrontalier de Thionville Grand Est (Moselle). Les 14 et 15 décembre 2021 à la Comédie de Caen – CDN de Normandie (Calvados). Du 4 au 6 mai 2022 au Théâtre Olympia, CDN de Tours (Indre-et-Loire).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2021 7:47 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 5 nov. 2021 Fidèle complice de Patrice Chéreau, ex-directeur de l’Ecole nationale des arts déco et de la Villa Médicis à Rome, le grand scénographe revient sur son parcours dans une autobiographie. Pour «Libération», il évoque ses débuts, ses amitiés fondatrices mais aussi les traumas et les manques, notamment celui de sa mère, emprisonnée à la Libération. Si on était dans un western, Richard Peduzzi serait le dernier des Mohicans, celui qui reste envers et contre tout, quand tous les autres ont disparu. Il a participé aux plus grandes aventures théâtrales de son temps, signé tous les décors des spectacles de Patrice Chéreau depuis les années 70 jusqu’à sa disparition en octobre 2013, fabriqué ceux de l’incandescente Reine Margot entre autres films, et conçu parmi les plus belles scénographies de Luc Bondy. On pourrait supposer qu’il est un homme de pouvoir, puisqu’il a été à la tête de la prestigieuse Ecole des arts décoratifs de 1990 à 2002, qu’il a quittée pour le poste ultra-convoité de directeur de la Villa Médicis, à Rome, «bateau suspendu dans le ciel de Rome, à la beauté enlisante» nous expliquera-t-il. Si sa vie ressemble malgré tout à une conquête, l’essentiel fut au théâtre, et plutôt dans une cage de scène, où il continue de réinventer le monde et s’apprête à signer la scénographie de Don Carlos monté par Vincent Huguet, début 2022. Rencontre chez lui, au premier étage d’un appartement lumineux, à l’occasion de la sortie de Je l’ai déjà joué demain, chez Actes Sud, une exploration autobiographique où Richard Peduzzi exprime une incompréhension non feinte : Pourquoi tant de chances ? Comment devient-on artiste plutôt que gangster où ses errances auraient pu l’ensevelir ? Est-ce qu’une image manque dans votre album de photos ? Des photos de mes parents ensemble, je n’en connais aucune. Des photos de ma mère, je n’en possède pas. J’ai bien des souvenirs d’elle à différentes époques de sa vie, de son physique, de son regard, mais ce sont des traces fugitives. C’est peut-être l’ensemble de la culture qui a commencé par constituer un immense manque, et m’a conduit dans une exploration et un besoin de découvertes jamais assouvis. Pour l’autodidacte, l’ensemble du monde est une image fuyante, un mirage. Rien ne constitue jamais un savoir solide. Parfois on est submergé, car il n’y a aucun ordre dans ce qu’il apprend, il n’y a pas d’étapes, pas de progression. On tente d’apprivoiser les savoirs, mais il y a des gouffres et des chausse-trappes même dans le vocabulaire. Les mots peuvent manquer parce que je n’ai pas suivi les cours que les autres ont suivis. J’ai eu une éducation tourmentée qui m’a donné d’autres forces et d’autres images, d’autres modèles et attirances parfois dangereuses. Vous êtes peut-être le premier et le seul scénographe dont le nom résonne aux oreilles même de ceux qui n’entrent jamais dans un théâtre. Vous avez contribué à des spectacles qui sont devenus mythiques. Vous avez été directeur de l’Ecole des arts déco pendant dix ans, puis à la tête de la Villa Médicis. Pourquoi cette relation si tremblée à la connaissance et à l’art ? J’ai très peu été à l’école. En sixième, j’avais déjà décroché complètement de la scolarité. J’ai grandi auprès de mes grands-parents, deux couples aux règles et aux modes de vie antagonistes. A Verneuil-sur-Avre, mes grands-parents paternels étaient des ouvriers artisans, très catholiques. Mon grand-père était chauffagiste, il fabriquait lui-même ses tuyaux. J’adorais traîner dans son atelier qui rappelait certains films de Méliès. Ma grand-mère passait son temps à l’église. Mais parfois des crises d’angoisse, d’étouffement m’accaparaient, et j’obtenais le droit d’aller rejoindre ma famille au Havre où mes grands-parents maternels tenaient un bar. Je passais des soirées à regarder des scènes qui étaient comme extraites de films. Les balles perdues n’étaient pas rares. La journée, le soir, j’errais avec des délinquants plus âgés que moi qui m’apprenaient la vie. Je m’étais lié d’amitié avec un géant qui me racontait son voyage clandestin depuis un pays lointain d’Afrique caché dans un container. C’était extraordinaire de marcher avec lui au bord de l’eau, de dénicher des pierres sauvages dans chaque recoin des jetées. Avec lui, j’étais en terrain inconnu, et complètement chez moi. Je me suis beaucoup servi de ces images de ville détruite et merveilleuse quand j’ai commencé à faire des décors. Pourtant, le même sentiment d’asphyxie m’obligeait à repartir à Verneuil où j’espérais trouver la paix. Entre mes deux familles, il y avait un mouvement d’essuie-glace permanent, je me sentais à part, ne faisant partie ni de l’une ni de l’autre. Je ne savais pas d’où je venais, et je sentais confusément qu’il était inutile de poser des questions. Où étaient vos parents ? Je ne pouvais pas me représenter où était ma mère. Je suis né juste avant la fin de la guerre, et j’avais à peine deux ans lorsque ma mère a été incarcérée, pour avoir eu une aventure avec un jeune officier allemand tandis que mon père a été arrêté par la Gestapo après être entré dans la Résistance. Elle et moi, on ne se connaissait qu’à travers les barreaux du parloir. On ne s’était jamais touchés. Cette absence de contact, c’était quelque chose d’ultra-manquant, bien plus que son image absente. Il fallait traverser un dédale avant d’arriver au parloir, pour une brève rencontre avant qu’elle ne reparte vers sa cellule. J’avais une dizaine d’années quand elle est sortie de prison. J’étais dans une pension religieuse à Bolbec, pas à mon aise, quand un jour, ma grand-mère m’annonce que ma mère va venir me voir. Au loin, je distingue une femme très belle, que je vois pour la première fois en pieds, mais j’ai l’impression étrange qu’elle arrive vers moi en reculant. Elle était en larmes. Je lui dis : «Ça y est, on va vivre ensemble maintenant.» «Non, tu sais, je dois partir pour Toulouse… J’ai l’intention de refaire ma vie. J’ai rencontré quelqu’un.» J’ai eu une sorte de vertige. Rien de tout cela n’allait. Plus tard, lorsque vous devenez scénographe, vous ne cessez de construire sur le plateau des murs vertigineux, avec des percées sur un dehors inaccessible. Quels liens entre la cage de scène et la cage d’un parloir ? La première permet-elle de magnifier la seconde ? Je ne quitte jamais la cage. C’est le lieu où je crée mes évasions, il s’agit toujours de traverser les murs, et derrière le ciel, il y a un mur encore. J’aime beaucoup cette phrase de Faulkner, dans Lumière d’août : «Le type cherchait à s’évader. Mais lui comme l’aigle n’avaient pas compris que l’univers tout entier n’était qu’une simple cage.» Comment êtes-vous passé de jeune garçon tout à fait perdu, à scénographe le plus doué de son temps ? Comment la bascule a-t-elle été possible ? Heureusement, j’aimais dessiner. C’est cette nécessité qui m’a tenu et servi de colonne vertébrale, même dans les moments les plus incertains. Vers 16 ans, je suis parti à Paris, où mon père, à bout, avait accepté de me louer une chambre au mois dans un hôtel à Saint-Germain-des-Prés. J’avais comme ancrage familial sa très jeune sœur, ma tante, qui m’emmenait aux musées et pour la première fois au théâtre. Je m’y ennuyais énormément. Je fermais les yeux pour écouter le texte, car les décors en carton-pâte brouillaient tout ce que je comprenais des acteurs et du récit. Grâce à elle, je suis entré à l’Académie Malebranche, dans l’atelier du sculpteur Charles Auffret. Plus qu’à dessiner, Auffret m’a appris à regarder. C’était une sorte de filet de secours, car la nuit, j’allais de plus en plus loin dans toutes sortes de débauches stupéfiantes. Qu’est-ce qui vous a permis de ne pas sombrer, sans retour possible, dans la drogue ? Etrangement, ma rencontre avec Patrice Chéreau. Dans les années de perdition, je me racontais une histoire comme peuvent s’en raconter les mômes de 16 ans : «Tout ça, ces couleurs, ces aventures… c’est pour apprendre à mieux peindre. Je m’en servirai bien un jour.» Je passais mes nuits dans la rue, je voyais bien que c’était désastreux mais aussi que mon goût pour la peinture était indemne. Vers 18 ans, au moment où je cherchais à arrêter complètement la débandade des drogues, j’ai connu une jeune fille au Café de l’Odéon, Marianne Merleau-Ponty. Ça m’ennuyait d’être constamment aux abois financièrement. Sa mère, un jour, m’a lancé : «Richard, il faut que vous trouviez le moyen de gagner votre vie avec la peinture. Vous devriez aller voir un jeune homme qui s’appelle Patrice Chéreau, à Sartrouville.» J’avais commencé un stage chez un grand costumier, que j’ai vite interrompu, le jour où il essaya de m’employer comme coursier. J’avais le sentiment de perdre mon temps, car pendant que j’étais chez lui, je ne dessinais pas. Tout le monde accepte les petits boulots ! Vous aviez donc une grande aspiration et exigence à l’égard de vous-même pour les refuser ? J’étais dans un état de désespérance plein d’espoirs. Finalement, je vais à Sartrouville, je vois la place du marché où des grands types chevelus peignaient dans le froid des décors à même le sol sur le perron. L’horreur ! Ça ne me faisait pas du tout envie. J’entre quand même dans le théâtre où sur le plateau, je découvre toute une machinerie, des poulies, qui me rappelaient des illustrations de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. De ce fatras, un jeune homme qui avait dormi sur place, émerge, et va à ma rencontre comme si on reprenait une conversation. «Vous êtes peintre ? Mon père aussi.» J’ai l’intuition qu’on ne va plus se quitter. On ne se ressemblait pas, Patrice Chéreau était savant, il avait tout lu, il avait fait d’excellentes études dans un excellent lycée. Et notre amitié a duré quarante-cinq ans. Un contrepoint entre lui et moi s’est créé. Cela s’appelle une rencontre. Une rencontre qui m’a sauvé la vie. Vous qui pensiez ne pas aimer le théâtre, vous tombez amoureux de la scène vide, et découvrez un espace où le temps passe différemment… Le théâtre arrête le temps. Une cage de scène, c’est une boîte où l’on raconte le monde. Et dans cette boîte, j’ai commencé par transposer tout ce que j’avais vu dans mon enfance. Le Havre et sa beauté détruite étaient présents dans les premiers décors que j’ai signés, le Massacre à Paris de Christopher Marlowe. J’avais mis de l’eau, des quais, le palais de la Renaissance en ruine sur la scène… Déjà des très hauts murs et des lignes de fuite. Vous ne referiez pas ce type de décor aujourd’hui ? Non pas du tout. J’aimais les enluminures tirant vers le baroque même lorsqu’il s’agissait d’une architecture industrielle. J’aimais les chapiteaux, les colonnes… Aujourd’hui, plus ça va, plus je gomme, plus le décor est abstrait. Pour Don Carlos, l’opéra de Verdi qui sera créé à Bâle en février 2022 et mis en scène par Vincent Huguet, j’ai réfléchi en fonction du Covid, c’est-à-dire en coûts de production. On ne peut plus faire des décors monumentaux, qui nécessitent des dizaines de machinistes pour les actionner afin d’obtenir un effet qui ne dure que dix minutes. Il faudrait mettre à plat l’histoire de la scénographie depuis l’antiquité en passant par le XVIe siècle. On s’apercevrait que les techniciens ont beaucoup appris des marins. Pour Don Carlos, j’ai conçu un décor extrêmement léger, mobile, avec des toiles, qui lorsqu’elles se rassemblent, paraissent être des blocs très lourds. Alors qu’elles ont la légèreté de feuilles de papier qui s’envolent. Quand vous avez commencé en 1968, vous mettiez des éléments du monde extérieur qui venaient sur le plateau… C’est-à-dire de l’eau, des arbres, et même leur odeur. Pour la Dispute, j’avais même imaginé une architecture et une forêt qu’on aperçoit au loin, derrière les murs, avec de vrais arbres et de vraies feuilles. Or les feuilles meurent très vite dès qu’un arbre est déraciné. J’avais obtenu l’aide d’un sourcier dans la région de la Vienne, qui savait traiter les arbres à chlorophylle, de manière à ce qu’ils restent vivants une dizaine de jours sur le plateau. A l’époque, ce qui m’amusait, c’est d’être au plus proche de la nature. Aujourd’hui, ce qui m’amuse, c’est de donner l’impression qu’on est dans la nature alors que l’espace est dépouillé. Derrière ces murs, avez-vous jamais retrouvé votre mère ? Non. Je n’ai jamais vraiment su pourquoi elle avait été arrêtée, pourquoi elle avait fait dix ans de prison. Elle aurait dû en faire encore plus. Je crois qu’elle avait été soupçonnée de balancer des informations. Il n’y a jamais eu de preuves. Je n’ai jamais cherché à savoir ce qu’elle a fait. Tout ce que je sais est qu’elle est passée à côté de sa vie, qu’elle a été meurtrie à jamais par son incarcération, même si elle a eu des enfants par la suite. Bien plus tard, je l’ai rencontrée à Paris dans un hôtel, elle n’était vraiment pas bien. Puis à la toute fin, quand je dirigeais les Arts déco, mon assistante m’informe qu’elle avait reçu un message d’une clinique qui me demandait beaucoup d’argent car ma mère n’avait pas payé l’établissement. J’ai demandé à la voir. On m’a dit que ce n’était pas possible, qu’il fallait que j’attende qu’elle retrouve la forme. J’ai compris par la suite qu’elle était déjà morte depuis quinze jours au moment de l’appel et que c’est pour cette raison que je ne pouvais pas la rencontrer. Seul mon fric était requis. En somme, vous avez perdu votre mère peu de temps après votre naissance, et vous l’avez reperdu à sa mort ? Oui. Et je m’en suis vraiment aperçu à sa disparition… Quand on a envie de voir sa mère, qu’on ne la connaît pas, que ses propres enfants ne la connaissent pas, on a beau être adulte, il y a un manque terrible. Je redoutais le jour où j’allais apprendre sa mort sans jamais l’avoir connue. Vous disiez que la cage de scène vous a d’abord permis de transposer votre enfance. Que mettez-vous sur le plateau de vos images intimes ? Les terrains vagues du Havre, je m’en suis servi énormément. J’ai même conjugué les images du Havre et de New York. Elles m’intéressent moins maintenant. Je les ai en moi, ces images. J’adore les ports. Mais aujourd’hui, je suis plus attiré par les jeux entre les couleurs. Dans Don Carlos, le décor n’est qu’en rouges, mais ils sont tous différents. Je joue avec les vibrations des couleurs. Ce qui m’attire de plus en plus, c’est ce mouvement immobile, ce dialogue entre les murs qui semblent dire avant que je n’arrive : «On était tranquille, il n’y avait pas de décor.» Vous avez eu une chance folle. Comment la comprenez-vous ? Inexplicable ! J’étais sur un fil. J’avais le choix entre gangster ou artiste selon le bord où je chutais. Pourquoi tout d’un coup, Jack Lang m’appelle pour me proposer d’être directeur de l’Ecole des arts déco alors que je suis extrêmement malade et qu’on me donne très peu de jours à vivre ? Quand j’étais étudiant, j’avais passé le concours d’entrée à cette école et j’ai été éjecté. J’étais défoncé aux amphétamines et aux acides et au lieu de dessiner, je passais d’un truc à l’autre, j’avais des hallucinations. Et hop, la cloche a sonné. J’ai toujours commencé par tout refuser. Même la Villa Médicis, j’ai d’abord dit «non», lorsque le poste m’a été proposé sans que je candidate. Pénélope, mon épouse, et mes enfants Antonine et Nicolas, étaient atterrés que je ne montre pas plus d’enthousiasme. Ce sont eux qui m’ont poussé à accepter. Un autodidacte a toujours le sentiment d’être un usurpateur. Luc Bondy, l’autre metteur en scène avec lequel vous avez beaucoup travaillé et noué une amitié forte, est mort deux ans après Patrice Chéreau… Le choc que j’ai eu quand Luc est mort. Le sol tremblait… Il y a quarante-cinq ans, on m’avait dit : «Je te préviens, ce jeune metteur en scène souhaite te rencontrer, mais il est très malade, il va certainement mourir demain.» Je refuse de l’appeler parce que j’avais peur de m’attacher à lui. Quand je le vois enfin, Luc avait une énergie telle que je comprends qu’il va tous nous enterrer. On a travaillé ensemble, mais jamais de la même manière qu’avec Patrice. Luc était jaloux à mort, mais joyeusement. Le pire a été lorsqu’on a monté ensemble le Temps et la Chambre de Botho Strauss à Berlin en 1989. Patrice assiste à la représentation. Il me chuchote : «C’est magnifique, c’est super.» Il appelle Luc, le félicite. Dans la nuit même, Patrice me demande qu’on monte immédiatement la même pièce à Paris. Lui aussi était jaloux. Que reste-t-il de toutes les grandes mises en scène auxquelles vous avez participé ? Rien, il ne reste rien. Il y a un oubli vertigineux de cette période où le théâtre était d’une exigence folle. On pouvait voir en Europe et la même année, des mises en scène de Strehler, Vitez, Chéreau, Bondy, Gruber, Mnouchkine, Peter Brook. Rien de rien ? Il reste la mémoire subjective. Il reste des archives. Mais une mise en scène n’est pas transmissible. J’évite de prendre des références dans l’histoire du théâtre quand je commence des recherches pour concevoir des décors. Et cependant, il y a des fils. Je pense à Edward Gordon Craig, par exemple, ce décorateur du XIXe siècle que j’ai découvert il y a peu. Pour moi, imaginer des décors de théâtre, c’est construire ma peinture. Ce que je fais sur le plateau, ce sont bien sûr des décors qui servent une pièce, des acteurs, etc., mais aussi et avant tout des peintures en volume. Je fais en sorte que mes dessins préparatoires soient aboutis comme s’ils portaient leur propre finalité. Ensuite, cela m’amuse de les transformer en architecture. Chaque jour, je suis dans mon atelier, et en travaillant avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, je contemple une aube nouvelle. Je l’ai déjà joué demain de Richard Peduzzi, éd. Actes Sud, 223 pp., 25 euros. Légende photo : Dans l'atelier du designer, scénographe et peintre Richard Peduzzi, à Montmartre, Paris, le 3 novembre 2021. A droite, un portrait de Patrice Chéreau accompagne l'hôte des lieux. (Adrien Selbert/Vu pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2021 8:23 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog du 5 nov. 21 Artiste exceptionnel, il appartient à la famille des « nouveaux magiciens ». Avec Le Bruit des loups, il nous conduit dans une forêt profonde. Des arbres monumentaux, des hommes, des animaux, d’étranges lueurs…Magnifique et impossible à raconter ! l avait appris, seul, le jonglage avant de fréquenter plusieurs écoles de cirque et de trouver sa voie en suivant un stage de « magie nouvelle » sous la direction du virtuose Raphaël Navarro. Depuis, Etienne Saglio signe régulièrement des spectacles. Des chapiteaux de cirque, il a glissé peu à peu vers le théâtre. Le Bruit des loups est un sommet de son art et l’on ne s’étonne pas qu’il lui ait fallu des années pour le mettre au point. Voici le long et fin Etienne Saglio, aux prises avec un végétal un peu entêté…Photographie Prisma Laval. DR. Au début, on est dans une pièce au carrelage noir et blanc et l’on pense à Alice aux Pays des merveilles. N’en disons pas trop : un jeune homme long, fin, délié, se bat avec les feuilles d’un arbre qui semble doué d’une vie particulière… Rideau et voici que surgit un animal, long, fin, délié lui aussi –mais ce n’est pas Etienne Saglio !- un animal dressé sur ses petites pattes et qui souvent reviendra. Un miracle de grâce, d’intelligence, de magie… Soudain, comme Alice basculant dans le terrier du lapin, nous voyons se lever devant nous une forêt aux arbres immenses. Une forêt profonde dans laquelle nous allons voir surgir des animaux, des loups, mais pas seulement. Comment ça marche ? C’est tout le génie d’Etienne Saglio… Toute description plus précise abîmerait cette merveille de plongée dans un monde onirique qui rappelle les contes pour enfants et nous enchante. Un géant, incarné par Guillaume Delaunay, surgit. Inquiétant, bien sûr, mais pas méchant…Deux autres artistes participent en alternance au spectacle : Murielle Martinelli, comédienne chez Pauline Bureau ou Joël Pommerat, notamment. Le jour où nous avons vu le spectacle, c’est Bastien Lambert qui était présent. Musicien et réalisateur, il joue au théâtre comme au cinéma et participe ici à notre trouble, comme l’enfant qu’il semble être… Un univers à la Lewis Carroll…et des atmosphères enchantées. Des images dont on ne sait pas si elles sont des illusions ou non… Inutile de préciser que des virtuoses ont mis leurs talents au service de ces mirages miraculeux : Valentine Losseau et Raphaël Navarro, Alexandre Dujardin pour la lumière Humour, rêveries, angoisse, images superbes, beauté, générosité, tout ici enchante. En dire plus serait idiot. Félix Tréguy et Pascal Tréguy, les coachs des animaux, Emile, Boston, il y a aussi des vidéastes, un compositeur, un as du son, etc…une bonne quinzaine d’artistes et techniciens très précis, sans doute heureux de participer à ce spectacle unique. Courez au Rond-Point et sachez qu’une longue tournée suit. De décembre à juillet. Au moins. Armelle Héliot Théâtre du Rond-Point, grande salle Renaud-Barrault, à 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h00. Relâche exceptionnelle le 11 novembre. Durée : 1h15. Tél : 01 44 95 98 21. www.theatredurondpoint.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 7:31 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 4 nov. 2021 Présentée à La Criée de Marseille, avant une tournée nationale, la formidable pièce de Molière, transposée dans les années 1960, a du mal à accrocher le spectateur. Les Tartuffe sont partout, depuis quelques années. La pièce de Molière, formidable machine de guerre contre les faux dévots et l’hypocrisie, n’en finit plus de séduire les metteurs en scène. Il est vrai que les chefs-d’œuvre de ce calibre ne sont pas si nombreux dans notre patrimoine national, et que la pièce peut renvoyer à bien des préoccupations contemporaines. Aujourd’hui, c’est Macha Makeïeff qui, en son Théâtre de la Criée, à Marseille, livre sa vision de Tartuffe, laquelle arrivera, en décembre, au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, avant de tourner tout au long de la saison. Et, dès le lever de rideau, on reconnaît la patte de la metteuse en scène et plasticienne dans le superbe décor années 1960, aux couleurs acidulées, qu’elle a imaginé pour la pièce. Et dès le lever de rideau, ou presque, on voit aussi que quelque chose ne fonctionne pas, derrière la jolie façade du salon design d’Orgon, ce bourgeois bien tranquille tombé sous l’emprise de Tartuffe, au point de tout lui abandonner : sa femme, sa fille, ses biens et sa maison. C’est comme si Macha Makeïeff n’arrivait pas à attraper la pièce, et à guider ses comédiens dans un sens précis. Des comédiens qui jouent de manière inégale, et dont certains, notamment Jin Xuan Mao dans le rôle-clé de Cléante, ont du mal à se mettre en bouche la langue de Molière, rendant certains passages incompréhensibles. Sens du burlesque Le spectacle n’est pas désagréable, il est, par moments, porté par le sens du burlesque de Macha Makeïeff, mais il n’accroche pas, restant, dans le fond, assez terne, sans pousser les curseurs ni de la noirceur ni du comique de la pièce. On peine à déceler la raison qui a poussé la directrice de La Criée à monter Tartuffe. Si l’on en croit les documents qui accompagnent la représentation, c’est notamment la question de l’emprise, de la prédation, du consentement, qui l’a intéressée, mais sans que ces enjeux s’incarnent réellement. Qui est Tartuffe ? Difficile à dire, au vu du personnage assez lunaire que compose Xavier Gallais. Une sorte de gourou, organisant des messes noires sous l’œil de corbeaux empaillés ? Certes, et cela a été maintes fois souligné, le faux dévot est avant tout une surface de projection, un révélateur des névroses de la famille d’Orgon, son protecteur. Mais encore faut-il que le personnage existe, théâtralement parlant. C’est d’autant plus dommage que Macha Makeïeff avait signé, en 2015, un réjouissant Trissotin ou Les Femmes savantes, où se réunissaient ses talents pour la composition visuelle et le burlesque à la Tati, et une lecture finement féministe de la pièce. Ce regard, on le retrouve dans le traitement du personnage d’Elmire, que joue avec une forme de liberté désespérée, et beaucoup de piquant, Hélène Bressiant. De même que l’on retrouve l’amour de Makeïeff pour les personnages secondaires et muets, comme la bonne Flipote, interprétée par Pascal Ternisien en un joli clin d’œil aux Deschiens. Mais ces petites touches ne suffisent pas, et Molière part dans le décor. Tartuffe, de Molière. Mise en scène : Macha Makeïeff. Théâtre de la Criée, à Marseille. Jusqu’au 26 novembre. Mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20 heures, mercredi à 19 heures, dimanche à 16 heures,. De 10 € à 25 €. Puis à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, du 1er au 19 décembre, et en tournée de janvier à mai 2022, à Nice, Angers, au TNP de Villeurbanne, à Toulon, Rennes, Bayonne, Créteil, Amiens et Caen. Fabienne Darge (Marseille, envoyée spéciale) Légende photo : Elmire (Hélène Bressiant) et Tartuffe (Xavier Gallais), lors d’une répétition de « Tartuffe », de Molière, mis en scène par Macha Makeïeff, au Théâtre national de La Criée, à Marseille, le 30 octobre 2021. PASCAL GELY/HANS LUCAS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 6:23 PM
|
Publié sur le site d'Artcena, le 3 novembre 2021
La Commission de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques s'est réunie les 2 et 3 novembre pour désigner les lauréats de cette session automne 2021. Découvrez les 25 textes lauréats !
- Souterrain de Raphael Bocobza
- FORTUNE - Récits de littoral #2 de Jennifer Cabassu et Théo Bluteau
- Les Bâtards et les Tigres de Alexandre Debrun
- Utopie\viande de Alexandre Horreard
- Gisèle, Marie-Claire, Michèle... et les autres de Barbara Lamballais et Karina Testa
- Soox Méduse de Laurent Leclerc
- RETOURNEMENT de Agnès Marietta
- A l'écart de Sylvain Milliot
- La Permanence des rêves de Catherine Morlot
- Auto-interview de Stanislas Nezri
- Le Dernier Voyage (AQUARIUS) - Episode 1 de Lucie Nicolas
- Nos Volontés - une journée dans les limbes de Irène Seye
- No ou le pactole de Rachel Simonin
- Tu te souviens des phrases de Marina Skalova
- Erreur 404 de Azilys Tanneau
- Sit Jikaer (ou la peine perdue) de Grégoire Vauquois - La loi du plus fort de Dominik Busch, traduit de l’allemand par Silvia Berutti-Ronelt et Jean-Claude Berutti
- Ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture de Jens Raschke, traduit de l’allemand par Antoine Palévody
- Qui ne dit mot d’Evan Placey, traduit de l’anglais par Adélaïde Pralon
- ROSA 08'46 de Naïsiwon El Aniou, Alice Herbreteau et Claire Thevenin - On a tué les lapins de Marine Bedon
- Et si je ne suis pas sage qu’allons-nous faire de Iva Brdar
- Le temps des abeilles de Lucie Fanzini
- Vers le Spectre de Maurin Ollès
- Regina santa de Mathilde Segonds

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 3, 2021 11:50 AM
|
Par Fabienne Darge (Caen, envoyée spéciale) 3 nov 2021
Georges Lavaudant signe une mise en scène élégante et profonde de la tragédie de Shakespeare
Quand un Roi Lear de belle facture se présente, il ne faut pas le rater. Chef-d’œuvre d’entre les chefs-d’œuvre de Shakespeare, pièce monstre, pièce monde, elle est de celles qui travaillent le métier de vivre en humain avec une profondeur inégalable. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, où le Théâtre de la Ville se délocalise pour l’occasion, Georges Lavaudant signe une version empreinte d’élégance et d’intelligence, avec Jacques Weber dans le rôle-titre, et une distribution de haut niveau. Georges Lavaudant recentre la pièce sur ce qui en fait le cœur : une tragédie de la filiation Ce n’est pas une mise en scène révolutionnaire, mais trempée dans une modernité déjà classique, d’obédience brechtienne, ce qui implique que la distance et l’humour sont aussi au rendez-vous. Le plateau ne s’encombre pas de décor ou d’accessoires illustratifs et inutiles, pour laisser toute la place aux acteurs, aux relations entre les personnages, à l’implacable mécanique qui va entraîner une tragédie en cascade, mais aussi le dépassement de cette tragédie par une forme de maturité, certes chèrement acquise, mais d’autant plus bouleversante. Sur le plateau quasiment nu, à la belle ambiance nocturne, on découvre donc Lear dans le grand marchandage qu’il est en train d’opérer avec ses héritières. Le vieux roi a décidé de se retirer du pouvoir et de diviser son royaume entre ses trois filles. Pour cela, il adopte une méthode simple : celle qui l’aime le plus aura la plus grosse part du gâteau. Sommées de déclarer – ou de déclamer, comme des comédiennes – leur amour, les deux aînées se livrent à la flagornerie la plus éhontée. Tandis que la cadette, Cordélia, s’en tient à une réponse simple et honnête – elle aime son père comme un père, ni plus, ni moins –, qui déclenche la colère de Lear. Formidable troupe d’acteurs Toute la tragédie naît donc du narcissisme et de l’aveuglement de Lear, qui vont l’entraîner loin sur le chemin de la folie, de la dépossession et, in fine, d’une forme de reconquête de soi. Georges Lavaudant recentre la pièce sur ce qui en fait le cœur : une tragédie de la filiation. Comme Hamlet, Le Roi Lear met en scène un monde « hors de ses gonds », un monde qui craque de toute part parce que quelque chose s’est grippé dans le mécanisme familial. L’amour parental et l’amour filial, pervertis, sont à l’origine de malheurs incalculables, pour l’entourage de Lear comme pour celui du comte de Gloucester, son double plus ou moins inversé. Le choix de Jacques Weber – acteur plus hugolien que shakespearien – pour incarner Lear, pouvait surprendre, mais ce choix démontre sa pertinence au fur et à mesure de l’avancée du spectacle. Dans la peau de Weber, Lear, plus bouffi d’orgueil que mauvais bougre, est avant tout un comédien, pour ne pas dire un bouffon, qui ne fait pas vraiment la distinction entre son petit théâtre intérieur et le monde réel. Autour de lui se déploie une formidable troupe d’acteurs, à commencer par François Marthouret, comédien tout en sobriété et subtilité, qui, dans le rôle de Gloucester, offre un contrepoint passionnant avec Jacques Weber. Thibault Vinçon, dans le rôle clé d’Edgar, le fils banni qui va retisser les fils de l’humanité et de la dignité, est aussi intense qu’émouvant. Grace Seri est une étonnante Régane, comme manipulée par le mal. Quant à Manuel Le Lièvre, acteur souvent prodigieux, dans les spectacles de Valère Novarina notamment, il n’avait pas encore vraiment trouvé son Fou lors des premières représentations du spectacle, à Caen, où nous l’avons vu, mais on peut parier que ce n’est qu’une question de temps. Limpidité parfaite Ainsi va cette mise en scène tout en fluidité, qui s’appuie sur la traduction nette et sans fioritures de Daniel Loayza et assume les clins d’œil au style des années 1980, notamment dans les superbes costumes de Jean-Pierre Vergier. Les enjeux de la pièce y sont déroulés avec une limpidité parfaite. C’est la troisième fois que Georges Lavaudant s’attaque au Roi Lear depuis les années 1970 et on sent que sa connaissance de la pièce est profonde, intime. Et dans ce chemin parcouru sur la lande en compagnie de Lear, le mystère représenté par Cordélia a de toute évidence particulièrement retenu son attention. Qui est-elle, cette Cordélia que joue Bénédicte Guilbert, loin de tout cliché, comme une femme forte, droite, et même un peu rugueuse ? Cordélia qui aime son père mais refuse de « faire théâtre » avec ce sentiment de le monnayer, Cordélia qui dit non à l’amour mal placé, narcissique, de son père. Il résonne fort, aujourd’hui, ce non-là. Le Roi Lear, de William Shakespeare (traduit de l’anglais par Daniel Loayza). Mise en scène : Georges Lavaudant. Théâtre de la Ville hors les murs au Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin, Paris 10e. Tél. : 01-42-08-00-32. Du mardi au samedi à 19 heures, dimanche à 15 heures, jusqu’au 28 novembre. De 12 à 41 euros. Puis à Vesoul le 7 décembre, et en tournée en 2022. Fabienne Darge(Caen, envoyée spéciale) Légende photo : « Le Roi Lear », de Shakespeare. (c)JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 7:43 PM
|
Yuming Hey, le sens du collectif par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 30 oct. 21 Extrait de l'article "Lyna Khoudri, Wet Leg, Yuming Hey… qui sont les visages du mois de novembre ? " Au théâtre, on l’a découvert dans les spectacles de Pascal Rambert, Stéphane Braunschweig ou Stanislas Nordey. Un visage magnétique, une silhouette fluide que Robert Wilson retient en lui donnant le rôle de Mowgli dans Jungle Book, créé en 2019 avec CocoRosie – et repris au Théâtre du Châtelet cet automne. Il fut aussi, la même année, l’un des personnages-clés de la série Osmosis d’Audrey Fouché, une dystopie sur les futurs codes amoureux confiés à un algorithme. Avec Mathieu Touzé, jeune directeur du Théâtre 14, rencontré à l’EDT91 (École départementale de théâtre de l’Essonne),Yuming Hey fonde le collectif Rêve concret et crée des spectacles avec une troupe d’acteur·trices rencontré·es au sein du dispositif 1er Acte, initié par Stanislas Nordey pour favoriser la mixité sur les scènes nationales. Aujourd’hui, c’est à nouveau auprès de Pascal Rambert qu’on le retrouve dans 8 ensemble (aux Bouffes du Nord en novembre), une création pour jeunes comédien·nes à qui le metteur en scène a demandé : “Comment te vois-tu en 2051 ?”, avant d’écrire la pièce. “Pour moi, Pascal écrit comme une partition de musique”, analyse Yuming Hey. À l’acteur d’en déchiffrer le rythme interne pour en délivrer son sens et sa saveur. Jungle Book de Robert Wilson et CocoRosie, du 30 octobre au 20 novembre, Théâtre du Châtelet, Paris.
8 ensemble de Pascal Rambert, les 5 et 6 novembre, Bouffes du Nord, Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 2:13 PM
|
Un podcast de critique théâtrale sur Radio Bellevue Web (RBW)
le 25 octobre 2021 Au sommaire de l'émission Festival Sens interdits à Lyon Ecouter le podcast Avec Nadja Pobel du Petit Bulletin de Lyon, Eléonor Kolar du blog L'Alchimie du verbe, Nicolas Blondeau du Progrès de Lyon et Frank Langlois de Scènes Magazine ont parlé des spectacles du Festival Sens Interdits : Fuck Me, de Marina Otero, De ce côté, de et par Dieudonné Niangouna, Le bonheur mis en scène par Tatiana Frolova, Feroz de Danilo Llanos, Space invadores de Nona Fernández, mise en scène Marcelo Leonart. La Faute de François Hien mis en scène par Angélique Clairand et Eric Massé, Love de Alexander Zeldin, Poing de Pauline Peyrade mis en scène par Siegrid Reynaud, Intras Muros Alexis Michalik, Lovetrain 2020 de Emanuel Gat, C’était un samedi de Dimitris Hadzis / Joseph Eliyia, mis en scène Irène Bonnaud, Laboratoire Poison de Adeline Rosenstein. Un Hamlet de moins mis en Nathalie Garraud textes Olivier Saccomano. Annonce de la venue à Lyon de : Christiane Jatahy avec Julia et Entre chiens et loups, La Peur de François Hien, Ivres Ivan Viripaev, mis en scène d’Ambre Kahan.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2021 5:31 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog 29 octobre 2021 En souvenir d’un ancien amour, un homme prête une maison qu’il ne peut se résoudre à vendre à des femmes artistes qui en font leur atelier temporaire. Dans « les femmes de la maison », Pauline Sales interroge la société au cours des soixante-dix dernières années, en convoquant la figure de la femme artiste. Une mise en abime qui fait la part belle aux actrices. La pièce s’ouvre sur l’intérieur d’une maison baigné par un clair-obscur : un rocking-chair, un lit, une table, une chaise, un lavabo et trois fenêtres d’où provient la lumière de la lune. Nous sommes dans les années quarante en banlieue parisienne. Une femme quitte un homme pour un autre. Elle est photographe. Afin de lui permettre de vivre pleinement son art, il lui offre la maison et l’épouse en guise d’adieu. Bien des années après, il la rachète discrètement lorsqu’elle la met en vente. Incapable de l’habiter ou de la vendre à son tour, Joris décide d’en faire un lieu de résidence avant l’heure, réservé aux femmes artistes – elles sont peintres, plasticiennes, autrices –, en échange d’une œuvre laissée à la fin du séjour, de quelques règles à suivre et de la présence d’une femme de ménage qui veille sur la maison mais aussi sur ces locataires de passage. Trois temps, trois histoires, vont habiter cette maison, autant de trajectoires qui tentent de s’émanciper par la création artistique, et qui se font le reflet de la société de leur époque – tour à tour les années cinquante, soixante-dix et aujourd’hui –, en étant traversé par les grandes questions que chacune soulève. Treize rôles, trois actrices, un acteur. Pour incarner les personnages de sa nouvelle pièce, Pauline Sales fait appel à des comédiens avec qui elle entretient un lien particulier. Dans sa note d’intention, elle précise que les acteurs sont « principalement ce qui motive mon désir de mise en scène[1] ». Ainsi, retrouve-t-on dans le rôle de Joris Vincent Garanger, avec qui l’autrice et metteuse en scène a dirigé le Préau – Centre dramatique national de Normandie – Vire durant dix ans et avec qui elle a fondé la compagnie A l’envi. Chaque actrice joue plusieurs rôles. Hélène Viviès, Olivia Chatain et Anne Cressent incarnent à leur manière les trois époques. La pièce a pour point de départ l’exposition éponyme « Womanhouse[2] » qui s’est tenue en Californie au début des années soixante-dix à l’initiative des artistes Judy Chicago et Miriam Shapiro, cofondatrices du « Feminist art programm » au California Institute for the Arts. Les deux artistes ont largement inspiré les personnages de la deuxième partie de la pièce. La maison, c’est celle abandonnée du 533 North Mariposa Avenue à Hollywood, Los Angeles, en Californie. Chicago et Shapiro ont investi les dix-sept pièces qui la composent avec leurs étudiantes et des artistes femmes locales, proposant des performances, installations et autres projets artistiques qui interrogeaient la construction politique de l’espace domestique et son enfermement forcé. L’exposition-manifeste dure moins d’un mois[3] mais va marquer un tournant décisif dans l’histoire de l’art féministe. Au début de la pièce, Germaine, personnage derrière lequel on devine la photographe Germaine Krull, répond à la jeune femme de l’agence immobilière, avec qui elle vient d’avoir une légère altercation : « Ne faites pas ça, pas seulement, des enfants, débrouillez-vous pour faire autre chose ». Dans les années cinquante, Simone, mariée et mère de deux enfants, s’en prend à elle-même, s’invective, se couvre violemment d’insultes : « Merde merde merde, connasse connasse connasse, la matinée est foutue, tu ne déjeuneras pas, grosse truie, pour la peine ». Elle tente de s’émanciper et de trouver son indépendance artistique. « La figure de la femme émancipée devait recouvrir celle de la femme traditionnelle, combiner les deux visages[4] » écrit Simonetta Piccone Stella dans son étude sur la vie des femmes dans les années cinquante. Deux décennies plus tard, sur la côte pacifique des États-Unis, Miriam, bientôt rejointe par Judy, transforme la maison en « womanhouse ». Enfin, à notre époque, trois écrivaines[5] trouvent refuge dans la résidence pour échapper à l’instrumentalisation dont font aujourd’hui l’objet les femmes artistes après avoir longtemps été niées. Invisibilisées jusque très récemment, elles deviennent aujourd’hui prisées, recherchées. On n’en finit pas désormais de célébrer les artistes décédées du XXème siècle, de leur rendre hommage en découvrant leur travail artistique. Bien souvent, elles sont les compagnes, les épouses d’artistes masculins célèbres. Au-delà de ces artistes, il y a d’autres femmes, celles qu’on ne voit généralement pas, dédiées aux travaux d’entretien et de ménage de la maison. « Elles œuvrent pour que d’autres s’émancipent, elles révèlent parfois le fossé qui les sépare » écrit très justement Pauline Sales. « A qui et pour qui œuvrons-nous en tant qu’artiste ? » s’interroge-t-elle. « En fait, il n’y a que les femmes pour faire croire à l’homme » réalise Annie qui s’occupe de l’entretien de la maison californienne. Seul homme de la pièce, Joris fait figure de gardien de la maison. Homme sans âge exprimant sa masculinité loin des stéréotypes, il reste le plus souvent silencieux et tente de passer inaperçu. Une fois n’est pas coutume, son sexe est ici minoritaire. Il traverse le temps en spectateur privilégié de la vie de ces femmes, plus rarement en acteur. À la fois bienveillant et paternaliste, il est attentif à la décolonisation, processus qu’il semble mieux comprendre que les femmes de la maison. Dans la seconde partie, il incarne aussi Christiane, la dernière femme de ménage de la maison. Auxiliaire de vie malgré elle, elle est l’un des visages des classes populaires d’aujourd’hui. Personnage à part entière, la maison elle-même évolue avec les époques, dans le temps mais aussi dans l’espace. Elle est ainsi un pavillon de banlieue parisienne dans la France de l’après-guerre, puis une maison « for women only » dans le sud de la Californie – « alors on déménage sans même s’en rendre compte »constate Joris. « On se déplace » lui répond Annie –, et enfin, une bâtisse isolée quelque part en France dans les années 2020. Elle se fait le miroir de ce qui se joue de l’époque et de ses enjeux féministes. Les conditions spécifiques à la création engendrent un huis clos à chaque fois renouvelé qui résonne étonnamment avec les confinements successifs que nous avons traversés. « Les femmes de la maison » n’a rien d’une pièce documentaire, encore moins d’un manifeste. De manière sensible et fictionnelle, Pauline Sales explore, à travers un regard porté sur la condition des femmes artistes, seules ou en collectif, féministes ou pas, le rapport au patriarcat, la sororité et ses rivalités, les questions de classe et d’origine, le lien entre intime et politique. Il est bien difficile de construire une parole commune, bien éprouvant de créer, surtout dans l’enfermement d’une résidence d’artiste. Pourtant, il n’en reste pas moins que le propriétaire de la maison est un homme. Certes, il ne rentre dans aucun des stéréotypes classiques du mâle dominant mais « Joris n’est pas Jésus » comme le rappelle Miriam. Omniprésent, traversant les époques et le XXème siècle, il est celui qui rend les choses possibles, le mécène. Cet état n’en finit pas de surprendre. Quelle signification donner à cette présence masculine, qui plus est seul personnage à traverser la pièce de bout en bout ? Sans doute que plus qu'une pièce féministe, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes que l'écriture de Pauline Sales cherche ici à atteindre. [1] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de Pauline Sales, texte d’intention, dossier de presse, janvier 2021. [2] Voir à ce propos Miriam Shapiro, « The education of women as artists: project Womanhouse », Art Journal, vol. 31, n° 3 (spring 1972), pp. 268-270. [3] Du 30 janvier au 28 février 1972. [4] Simonetta Piccone Stella, « Pour une étude sur la vie des femmes dans les années 1950 », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 16 | 2002, 245-269. [5] On devine dans ses trois personnages Amélie Nothomb, Paul B. Preciado et Pauline Sales elle-même qui ne s’épargne pas en écrivaine d’âge mur quelque peu dépassée par les questions féministes actuelles, faisant preuve d’une bonne dose d’autodérision. Les femmes de la maison, texte et mise en scène de Pauline Sales © TGP CDN de Saint-Denis LES FEMMES DE LA MAISON - Écriture et mise en scène Pauline Sales. Avec Olivia Chatain, Anne Cressent, Vincent Garanger, Hélène Viviès. Scénographie Damien Caille Perret. Création lumière Laurent Schneegans. Création sonore Fred Bühl. Costumes Nathalie Matriciani. Coiffure, maquillage Cécile Kretschmar. Régie son Jean-François Renet ou Fred Buhl. Régie générale et lumière François Maillot. Habilleuse et entretien perruques Nathy Polak. Spectacle créé le 11 janvier 2021 au Théâtre de l'Ephémère, scène conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines, Le Mans. Vu le 22 juillet 2021 au TNBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Du 20 au 23 octobre 2021 • Théâtre de L’Ephémère – Le Mans
Du 26 au 29 octobre 2021 • La Comédie de Reims
30 novembre 2021 • Théâtre Jacques Carat – Cachan
14 décembre 2021 • Scènes du Jura - Scène nationale
Du 11 au 22 mai 2022 • TGP – Centre Dramatique National de Saint-Denis Photo © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2021 8:41 AM
|
Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks - 7 octobre 2021 Thomas Quillardet met en scène les coulisses de la création des JT de la Une, de 1987 jusqu’en 1992, pour raconter l’impact de la privatisation de la chaîne sur le traitement de l’information. Une fresque historique rigoureuse. L’idée a le mérite de piquer la curiosité. En janvier 2017, Thomas Quillardet s’est mis en tête d’écrire et de porter pour la scène une fresque théâtrale sur la privatisation de TF1, en se focalisant essentiellement sur la fabrique des sacro-saints JT. Ambitieux objectif consistant à raconter, au travers de la vie d’une rédaction, la course effrénée aux audiences, la naissance d’un certain sensationnalisme télévisuel, le positionnement de la chaîne en faveur des puissances, et, en filigrane, les convergences idéologiques entre la gauche et la droite dans les années 1980. Véritable topos cinématographique et sériel, les coulisses journalistiques intéressent peu les dramaturges et metteur·euses en scène. La nervosité permise par le montage, les gros plans et les mouvements caméras collent à l’atmosphère surchauffée d’une salle de rédaction. Mais quid du théâtre ? 1986 Il faut un certain temps d’adaptation pour s’habituer au rythme du plateau de Thomas Quillardet. Mais c’est précisément ce tempo lent qui permet de se défaire des clichés du genre. Le·la spectateur·trice pénètre dans la salle de rédaction de la Une quelques mois avant son rachat par Martin Bouygues. Les rumeurs de la privatisation d’une chaîne bruissent ; ce sera la Deux, peut-être la Trois… Jamais la Une ! Pendant ce temps, l’un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl vient d’exploser. Le gouvernement assure que le nuage radioactif ne contaminera pas l’hexagone, ce qui semble douteux. Sur scène, dix comédien·nes incarnent à tour de rôle rédacteur·rices en chef, présentateur·trices et stagiaires se confrontant aux éternels dilemmes journalistiques : quelle place accorder à l’émotion ? À quel moment prendre le risque de la rapidité ? Comment traiter les affaires du propriétaire ? Thomas Quillardet est extrêmement bien renseigné. Il a beaucoup lu, interviewé les acteur·rices de l’époque, et la vie de la rédaction qu’il dépeint sonne juste. Les journalistes actuel·les remarqueront que les conférences de rédac ont peu changé ; les chef·fes de service se disputaient déjà leur pré carré comme des enfants, la culture était déjà évacuée en cinq minutes en toute fin de réunion, les correspondant·es se livraient déjà des disputes féroces pour dérocher les postes les plus prestigieux, les CDD étaient déjà prolongés à l’infini… Certaines scènes historiques – plus ou moins connues – sont reconstituées avec précision : l’audition de Francis Bouygues devant la CNCL, le débat Mitterrand-Chirac de 1988, la confrontation Tapie-Le Pen en 1989… Le verbe est savoureux, l’incarnation amusante, et dans ces moments-là, le choix du théâtre est pleinement justifié. La vie d’un stagiaire Un bémol tout de même. Aussi rigoureuse soit-elle sur le plan factuel, cette télévision française manque de point de vue pour être absolument convaincante. Thomas Quillardet a eu la bonne idée de suivre, au début de la pièce, un stagiaire qui gravira les échelons. Mais ce personnage-clé est trop fantomatique pour constituer un véritable ancrage narratif. C’est dommage, le spectacle était presque parfait. Une télévision française, de et mis en scène par Thomas Quillardet, avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoît Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone, En tournée. Du 12 au 13 octobre au L’Azimut, Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry, le 16 octobre au Théâtre de Chelles, du 21 au 22 octobre au Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le 26 novembre à l’Avant-Seine – Théâtre de Colombes, du 1er au 2 décembre au Théâtre de Sartrouville Yvelines, du 5 au 22 janvier au Théâtre de la Ville Paris… En tournée jusqu’à fin février 2022.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...