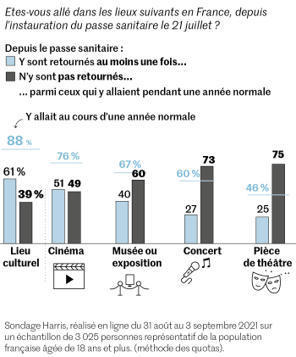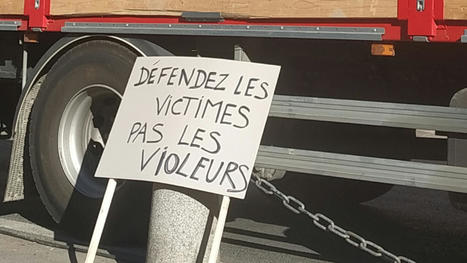Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2021 8:41 AM
|
Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks - 7 octobre 2021 Thomas Quillardet met en scène les coulisses de la création des JT de la Une, de 1987 jusqu’en 1992, pour raconter l’impact de la privatisation de la chaîne sur le traitement de l’information. Une fresque historique rigoureuse. L’idée a le mérite de piquer la curiosité. En janvier 2017, Thomas Quillardet s’est mis en tête d’écrire et de porter pour la scène une fresque théâtrale sur la privatisation de TF1, en se focalisant essentiellement sur la fabrique des sacro-saints JT. Ambitieux objectif consistant à raconter, au travers de la vie d’une rédaction, la course effrénée aux audiences, la naissance d’un certain sensationnalisme télévisuel, le positionnement de la chaîne en faveur des puissances, et, en filigrane, les convergences idéologiques entre la gauche et la droite dans les années 1980. Véritable topos cinématographique et sériel, les coulisses journalistiques intéressent peu les dramaturges et metteur·euses en scène. La nervosité permise par le montage, les gros plans et les mouvements caméras collent à l’atmosphère surchauffée d’une salle de rédaction. Mais quid du théâtre ? 1986 Il faut un certain temps d’adaptation pour s’habituer au rythme du plateau de Thomas Quillardet. Mais c’est précisément ce tempo lent qui permet de se défaire des clichés du genre. Le·la spectateur·trice pénètre dans la salle de rédaction de la Une quelques mois avant son rachat par Martin Bouygues. Les rumeurs de la privatisation d’une chaîne bruissent ; ce sera la Deux, peut-être la Trois… Jamais la Une ! Pendant ce temps, l’un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl vient d’exploser. Le gouvernement assure que le nuage radioactif ne contaminera pas l’hexagone, ce qui semble douteux. Sur scène, dix comédien·nes incarnent à tour de rôle rédacteur·rices en chef, présentateur·trices et stagiaires se confrontant aux éternels dilemmes journalistiques : quelle place accorder à l’émotion ? À quel moment prendre le risque de la rapidité ? Comment traiter les affaires du propriétaire ? Thomas Quillardet est extrêmement bien renseigné. Il a beaucoup lu, interviewé les acteur·rices de l’époque, et la vie de la rédaction qu’il dépeint sonne juste. Les journalistes actuel·les remarqueront que les conférences de rédac ont peu changé ; les chef·fes de service se disputaient déjà leur pré carré comme des enfants, la culture était déjà évacuée en cinq minutes en toute fin de réunion, les correspondant·es se livraient déjà des disputes féroces pour dérocher les postes les plus prestigieux, les CDD étaient déjà prolongés à l’infini… Certaines scènes historiques – plus ou moins connues – sont reconstituées avec précision : l’audition de Francis Bouygues devant la CNCL, le débat Mitterrand-Chirac de 1988, la confrontation Tapie-Le Pen en 1989… Le verbe est savoureux, l’incarnation amusante, et dans ces moments-là, le choix du théâtre est pleinement justifié. La vie d’un stagiaire Un bémol tout de même. Aussi rigoureuse soit-elle sur le plan factuel, cette télévision française manque de point de vue pour être absolument convaincante. Thomas Quillardet a eu la bonne idée de suivre, au début de la pièce, un stagiaire qui gravira les échelons. Mais ce personnage-clé est trop fantomatique pour constituer un véritable ancrage narratif. C’est dommage, le spectacle était presque parfait. Une télévision française, de et mis en scène par Thomas Quillardet, avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoît Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone, En tournée. Du 12 au 13 octobre au L’Azimut, Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry, le 16 octobre au Théâtre de Chelles, du 21 au 22 octobre au Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le 26 novembre à l’Avant-Seine – Théâtre de Colombes, du 1er au 2 décembre au Théâtre de Sartrouville Yvelines, du 5 au 22 janvier au Théâtre de la Ville Paris… En tournée jusqu’à fin février 2022.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2021 4:16 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 28-10-2021 Crédit photo : Ina Segghezi. Kolik, texte de Rainald Goetz, traduction de Ina Segghezi (troisième partie de la trilogie Guerre de Rainald Goetz, 1986), un projet d’Antoine Mathieu, mise en scène d’Alain Françon. Rainald Goetz, né en 1954 à Munich, après avoir suivi des études de médecine et d’histoire, exerce son métier de neurologue dans une clinique psychiatrique avant de se consacrer à l’écriture. Auteur à Berlin, il signe des textes virtuoses d’une contemporanéité âcre et acerbe. Chroniqueur de nos temps incertains, instigateur enthousiaste ou critique, Rainald Goetz témoigne d’une écriture tendue vers l’observation du quotidien – une exploration intérieure sensible à la présence de son propre corps et à la recherche scientifique, philosophique, artistique et historique. Avant Kolik aujourd’hui, avec l’acteur Antoine Mathieu, Alain Françon a créé Katarakt de Rainald Goetz, traduit par Olivier Cadiot, en 2004 avec Jean-Paul Roussillon, au Théâtre de la Colline. Kolik est la troisième partie de la trilogie Guerre de Rainald Goetz, publiée en 1986. Dans une époque arrivée au terme de ses illusions, Kolik retrace l’errance ultime d’un personnage, l’inventaire d’une vie dont les mots bruts résonnent étrangement d’une perte irréversible de sens. La pièce convoque la physique, la musique, la philosophie, la foi, la sexualité, l’alcool et la décomposition, un compte-rendu extrême à l’ultime instant de vie avant la mort. Le texte interroge le langage et la violence. Ina Seghezzi a retraduit Kolik avec Antoine Mathieu et Alain Françon. Pour le comédien, Kolik raconte une décomposition, un effondrement – homme ou civilisation. La performance propose au spectateur un face à face dans l’instant qui engage son corps, son être, une mise en présence, une pensée du monde – la rencontre peut-être avec un Autre. Le texte relate l’expérience d’une vie éprouvée comme un conflit âpre, bouleversée et renversée. Sur un plateau nu incliné – belle scénographie épurée de Jacques Gabel – que l’obscurité baigne, en alternance avec les lumières de Léa Maris qui éclairent un sac de couchage avec capuche – combinaison de survie pour qui vit dans la rue, sans domicile fixe, jeté brutalement tel un déchet. Est-ce la représentation de l’autre à qui s’adresser – la dernière instance – ou son image déchue ? Le fauteuil sur lequel est assis l’interprète et qu’il renverse à plaisir, affalé sur son socle ou l’un de ses côtés, désigne l’état intime de renversement et de chute que ne cesse d’éprouver le locuteur. Celui-ci, une bouteille à la main, en lève régulièrement le goulot à la bouche – un élan compulsif. Pourquoi ? Ordre, rigidité, exigence et haine de la société et de l’homme sont mis à mal : la vie préfère l’abandon au temps – cette liberté de laisser aller ce qui advient sans d’autres contraintes. « Le Je est un Je à la force de la force… » Sentir son corps et l’écouter, nul ne peut en échapper. Autour de lui, le patient scrute la crasse, métaphore d’une ignorance grossière qu’il rejette. La saleté couvre tout, la peau, le linge, le sol, les murs et les objets, et la condition existentielle fraye avec sentiment de l’ordure dans une appréhension de soi malpropre et misérable. Comment ne pas ressentir l’obscénité du monde, l’indélicatesse des êtres, la grossièreté d’une vie quotidienne méprisable et dévolue à l’effroi d’une solitude douloureuse ? Les mots sonnent et résonnent dans le vide du plateau et de l’existence, selon la progression des chapitres de Kolik. Dans le métier de vivre, la douleur est la reine des émotions, bien avant celle du plaisir, le symptôme du dérèglement de l’harmonie du corps, si jamais celle-ci a pu exister un jour. Émotion morale ou physique, celle-ci n’est vaincue que par le surgissement d’une autre encore plus forte. « Sans l’espoir d’une douleur plus grande, je ne pourrais supporter celle du moment, fût-elle infinie. La douleur peut être littéralement insupportable, et dans ce cas seule la disparition du corps semble capable de l’annihiler. » (Cioran, Syllogismes). La mort ne serait-elle que la seule issue ? Nul n’échappe à la souffrance injuste – mal sans remède dans la lutte pour la préservation de soi. Silhouette longiligne sombre, visage expressif d’un long questionnement existentiel, Antoine Mathieu porte Kolik dans cet effort intense et tendu pour exister et enfin se tenir hors de soi. La performance du comédien s’accomplit dans une justesse précise et tonique, le temps de la danse d’une ombre macabre et de l’invective d’un corps et de mots qui claquent sur la scène. Véronique Hotte Du 9 au 27 novembre, au Théâtre 14, 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris – theatre14.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2021 6:26 PM
|
par Gilles Renault, envoyé spécial à Laval pour Libération Spectacle imaginé dès 2016, l’ambitieux «Bruit des loups» est construit comme un conte initiatique en symbiose avec les forêts de l’enfance. C’est l’auteur américain, Robert Harrison, qui signe l’incipit : «Dans les religions, les mythologies et les littératures occidentales, la forêt se présente comme un lieu […] où les perceptions se confondent, révélant certaines dimensions cachées du temps et de la conscience. En forêt, l’inanimé peut soudain s’animer, le dieu se change en bête […] la ligne droite forme un cercle, le familier cède la place au fabuleux.» Ainsi, surgit, sous le regard ébahi d’enfants, voire plus encore, d’adultes refusant de céder leur peu d’illusions restantes au diktat des effets spéciaux numériques, le Bruit des loups, création théâtrale XXL du magicien Etienne Saglio, née au terme de trois années de gestation, suivie d’une exploitation contrariée par la pandémie. Apparue en septembre 2019 à Nantes, l’œuvre arrive donc finalement à Paris, au Rond-Point, un an et demi après la date initialement fixée. Juste le temps de décharger le gros camion blanc rempli jusqu’à la gueule, dans lequel voyagent tous les décors et accessoires qu’une équipe composée de douze personnes, dont sept techniciens, devra ensuite méthodiquement agencer – le monde de l’illusion, poussé à ce point de sophistication artisanale, ne tolérant guère l’approximation. Conséquence de ce teasing inopiné, il y a eu de quoi faire trépigner d’impatience celles et ceux qui, épatés par le Soir des monstres ou les Limbes – moments de grâce énigmatique considérés comme des pièces de référence dans le domaine – se sont entichés d’un artiste considéré, au même titre que Yann Frisch ou Raphaël Navarro, comme un des fers de lance de la magie nouvelle, courant réformateur, comme son nom l’indique, apparu au début du XXIe siècle. Forêt propice à la fantasmagorie Spectacle à ce jour le plus construit, éclectique, et coûteux d’Etienne Saglio, le Bruit des loups renvoie aux souvenirs d’une enfance en symbiose avec la nature, passée dans un village de la campagne rennaise à construire des cabanes dans les arbres et à observer les moindres tressaillements de la flore environnante. Largement de quoi sustenter cette «pensée magique d’avant l’âge de raison» qu’étaieront plus tard tels cinéastes (Tim Burton, Hayao Miyazaki, Alice Rohrwacher), romanciers (Lewis Carroll, Jean Hegland), chercheurs ou intellectuels (l’historien Michel Pastoureau, les anthropologues Philippe Descola et Lucienne Strivay). «On pourrait penser, écrit celui qui fit ses gammes dans le jonglage, que notre métier – avec notre connaissance de l’art des trucages et du subterfuge – nous entraîne vers plus de rationalité. Mais c’est tout l’inverse qui se produit! A force de travailler sur la porosité de la frontière entre le réel et l’imaginaire, nous sommes complètement atteints. Cette saveur de l’enchantement et du mystère nous pose dans la vie et dans le réel. Plus nous avançons et plus la vérité du monde nous semble être la magie.» Le texte est extrait de Bruissements, making of corrélé (puisqu’expo mitoyenne installée dans les théâtres où se joue la pièce) qui retrace avec force croquis, story-boards, dessins et photos le cheminement du projet. Lequel, sur scène, suit pas à pas la trace du conte initiatique, autour d’un homme qui, littéralement, retombe en enfance, passant du cadre très géométrique d’un intérieur (jouant avec les échelles) singularisé par un sol en damier noir et blanc, à une forêt propice à la fantasmagorie. Embardées cauchemardesques Porté par un art consommé de l’escamotage, le récit – «hyper facile d’accès mais exigeant dans les détails» de l’aveu même de l’auteur –, puise à la source de l’églogue une inspiration qui, pour autant, ne s’interdit pas des embardées cauchemardesques, sinon phobiques, à la lisière de l’aliénation. Sans trop divulguer les détails d’un casting suggérant un plaisir possiblement régressif, on précisera juste que, chemin faisant, il y sera notamment question d’un géant, d’un ficus, d’une balançoire, d’un cerf, d’une hermine, d’une souris, d’un écureuil, d’un facétieux «Goupil», créature drolatique ressuscitée (un renard taxidermisé en 1932, transformé en écharpe et promu «bateleur» par l’artiste qui l’a acheté 60 euros sur LeBonCoin.fr) et d’un loup. Et que si, comme on le sait, la vérité est souvent ailleurs, le canidé, lui, existe bel et bien (à l’heure où les parlementaires sonnent le glas des animaux sauvages dans l’univers du cirque...). Formé pour le cinéma, il s’appelle Emile et, bien que rompu à l’exercice, Etienne Saglio a tout de même la crainte qu’en marge des représentations, il s’intéresse de trop près aux non moins authentiques rongeurs qui, en coulisses, sillonnent le théâtre. Le Bruit des loups, d’Etienne Saglio, théâtre du Rond-Point, du 3 au 20 novembre, et en tournée (Maubeuge, Genève, Nice...)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 26, 2021 6:07 PM
|
Enquête par Cédric Pietralunga, Fabienne Darge, Rosita Boisseau et Sandrine Blanchard dans Le Monde le 26 octobre 2021 Près d’un Français sur deux ne s’est pas rendu dans un lieu culturel depuis le 21 juillet, alors qu’ils étaient 88 % avant la pandémie de Covid-19. C’est le résultat d’une étude commandée par le gouvernement, qui vient appuyer le sentiment ressenti par les professionnels.
C’est l’étude que tous les professionnels de la culture attendaient. Mais elle ne va pas les rasséréner. Mercredi 27 octobre, Roselyne Bachelot devait dévoiler les résultats d’une enquête commandée par le gouvernement sur le comportement des Français en matière de sorties culturelles, dix-huit mois après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ses conclusions, que Le Monde a pu consulter, sont édifiantes : près d’un Français sur deux ne s’est pas rendu dans un lieu culturel depuis l’instauration du passe sanitaire le 21 juillet, alors qu’ils étaient 88 % à le faire avant l’épidémie, et près d’un tiers assurent qu’ils fréquenteront désormais moins les lieux culturels. Cette étude, réalisée début septembre par l’institut Harris Interactive, apporte pour la première fois une vue d’ensemble sur les sorties culturelles post-crise, au-delà des chiffres de fréquentation brandis par les uns et les autres. Depuis le 21 juillet, seulement 51 % des personnes allant au cinéma habituellement au moins une fois par an, sont retournés en salle. Pis, à peine plus d’un tiers (40 %) des familiers des musées ont repris le chemin des expositions, quand ceux des monuments historiques l’ont fait à 45 %. Mais l’hémorragie est surtout palpable dans le spectacle vivant. Ainsi, seulement 27 % des amateurs de musique disent avoir assisté à un concert depuis la mise en place du passe sanitaire, tandis que les amoureux des planches n’ont été que 25 % à retourner au théâtre. Les chiffres sont à peine plus élevés pour la danse (31 %) et le cirque (28 %). De la même façon, près des trois quarts des Français qui se rendaient à un festival au cours d’une année normale n’y sont pas retournés cet été. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Les salles de cinéma cherchent désespérément leur public cinéphile Du mal à trouver un public Ces chiffres, même s’ils proviennent d’un sondage réalisé début septembre et peuvent avoir déjà évolué, viennent appuyer le sentiment ressenti par les professionnels depuis la rentrée. Si un certain nombre de Français ont retrouvé le chemin des théâtres, des cinémas ou des musées, on est encore loin des niveaux de fréquentation d’avant l’épidémie. « Cette étude confirme en tout point ce que l’on vit, estime Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins, à Lyon. Depuis la rentrée, on a perdu 40 % du public, sur les abonnements comme sur la billetterie. Pour un théâtre municipal comme le nôtre, avec 25 % de ressources propres, les conséquences sont importantes : si cette baisse se confirme, cela représentera 800 000 euros en moins dans le budget de la saison. » De fait, nombre de spectacles, films ou expositions ont du mal à trouver leur public. Au cinéma, si les grosses affiches tirent leur épingle du jeu – Dune (2,75 millions de spectateurs), Mourir peut attendre (2,58 millions), BAC Nord (2,1 millions) –, les films indépendants souffrent en salles. Tralala des frères Larrieu aura bien du mal à franchir la barre de 100 000 entrées (75 000 aujourd’hui). Le film de François Ozon, Tout s’est bien passé, devrait lui enregistrer autour des 250 000 entrées. Dans des genres différents, Les Amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet (59 000 entrées) et L’Origine du monde de Laurent Lafitte (226 000 entrées) confirment la difficulté pour de nombreux films à trouver leur public. Dans les musées et les monuments, la situation est tout aussi préoccupante. Certes, la fréquentation a augmenté ces derniers mois, après l’effondrement de l’an dernier (− 72 % de visiteurs au Louvre en 2020, − 76 % au château de Versailles, − 56 % au Mucem de Marseille…) et certaines expositions font le plein, comme celle consacrée à l’Américaine Georgia O’Keeffe au Centre Pompidou ou au Russe Ilya Répine au Petit Palais, mais le nombre de visiteurs reste en moyenne inférieur de 30 % à 50 % à celui d’avant-crise. « L’année 2021 risque de ressembler à celle de 2020, s’inquiète François Saint-Bris, propriétaire du Clos Lucé, troisième château de la Loire le plus visité après Chambord et Chenonceau. Avant la crise, on avait par exemple 30 % de visiteurs étrangers, on ne devrait pas en avoir plus de 10 % cette année. » Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins : « On sent chez les spectateurs une volonté de limiter les risques, de sécuriser leur soirée » Dans les théâtres, la situation est plus hétérogène. Selon les salles et les pièces à l’affiche, on passe d’un lieu plein comme un œuf comme celui de Paris-Villette pour L’Etang, de Gisèle Vienne, à l’affiche en septembre lors du Festival d’Automne, à des moitiés de jauges au Théâtre national de la danse de Chaillot, pour Ineffable de Jann Gallois, du 22 septembre au 1er octobre, ou Planet (wanderer) de Damien Jalet, qui a néanmoins fait salle comble sur les quatre dernières de ses 11 représentations de septembre. Lire aussi Article réservé à nos abonnés En 2022, pour la première fois de son histoire, le budget de la culture dépassera la barre des 4 milliards d’euros « Le public a tendance à privilégier les valeurs refuge, les noms connus, les spectacles qui ont déjà été joués et qui ont eu du succès, note Pierre-Yves Lenoir. Chez nous à Lyon, la pièce “La Vie de Galilée” de Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky, avec Philippe Torreton, est en tournée et marche très bien. En revanche, avec “Love”, d’Alexander Zeldin, pourtant un des spectacles majeurs de ces dernières années, cela a été très difficile : ce n’est pas encore un nom connu du grand public, le spectacle est en anglais surtitré, c’est une écriture d’aujourd’hui… On sent chez les spectateurs une volonté de limiter les risques, de sécuriser leur soirée. » Eviter les lieux fréquentés « Des noms comme ceux du chorégraphe William Forsythe ou de la star du flamenco Israel Galvn, remplissent vite tandis qu’on rame pour les jeunes artistes, abonde Michèle Paradon, la directrice artistique de l’Arsenal, un ensemble de salles de spectacles consacrées à la musique classique et à la danse contemporaine à Metz. Nous avons perdu 30 % d’abonnements et ce n’est parfois que deux ou trois jours avant une représentation qu’on voit si le spectacle va marcher. Cela nous oblige à communiquer de plus en plus à travers les réseaux sociaux. Nous demandons aussi aux artistes, très mobilisés, de participer un peu plus à la promotion de leurs productions. » La situation est d’autant plus inquiétante qu’une part importante des Français se montre toujours réticente à revenir dans les lieux culturels. Selon l’étude du ministère, 52 % des personnes interrogées disent éviter les lieux fréquentés comme les musées ou les salles de spectacle, de peur d’attraper le virus du Covid-19, et 74 % affirment toujours privilégier les loisirs de plein air aux sorties culturelles. Le passe sanitaire constitue « un frein psychologique parce qu’il donne l’image que les salles de spectacle restent des lieux dangereux, regrette Sébastien Beslon, directeur du théâtre L’Européen à Paris, dont la fréquentation est bonne depuis la rentrée. Nos spectateurs s’entassent dans le métro pour venir, mais arrivés chez nous, doivent montrer leur passe. C’est un peu lunaire quand même ». Plus alarmant encore pour le secteur, 24 % des Français – et même 32 % des moins de 35 ans – assurent qu’ils privilégieront désormais les moyens numériques pour accéder aux contenus culturels ! Lire aussi Article réservé à nos abonnés Le plan de relance pour la culture, conçu en 2020 et bien engagé, ne suffira pas S’adapter pour ne pas disparaître Même si personne n’envisageait un retour rapide à la vie d’avant, cette étude démontre que les lieux culturels vont devoir s’adapter s’ils ne veulent pas disparaître. La Cour des comptes l’a dit sans ambages le mois dernier, dans trois « audits flash » consacrés au secteur. « Les plus grands opérateurs (…) vont devoir approfondir une réflexion, déjà engagée depuis les premières fermetures administratives, sur des évolutions nécessaires de leur modèle économique », peut-on lire dans l’étude consacrée aux musées et monuments. « Croire que le monde d’avant va revenir et qu’on va pouvoir continuer à bâtir les mêmes budgets est une illusion », confirme un haut fonctionnaire du ministère de la culture. Certains lieux ont d’ailleurs pris les devants et déjà modifié leur façon de travailler. Le Théâtre national de Chaillot a ainsi supprimé ses abonnements cette saison, qu’il a remplacé par des cartes donnant accès à des tarifs réduits. Une décision prise après une étude menée avant la crise sanitaire mais qui prend tout son sens aujourd’hui. « Nous avons tous pris d’autres habitudes pendant la pandémie, et l’organisation du temps, avec le télétravail, est différente, constate Agnès Chemama, directrice des productions et des tournées à Chaillot. Les gens aujourd’hui veulent être libres de changer leur soirée comme ils l’entendent, même si cela nous rend tributaires d’achats à la dernière minute. » Cédric Pietralunga, Fabienne Darge, Rosita Boisseau et Sandrine Blanchard / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 11:23 AM
|
Par Pauline Weiss dans Marie-Claire - Publié le 11/10/2021 Le hashtag #MeTooTheatre a été lancé sur Twitter par la Youtubeuse Marie Coquille-Chambel, le 7 octobre. Les témoignages se comptent désormais par milliers. Un compte Instagram a depuis été créé et une première action publique est prévue le 16 octobre.
"J’ai été violée par un comédien de la Comédie-Française pendant le premier confinement, pendant que je faisais un malaise. Il est toujours membre de la Comédie-Française, même si la direction est au courant d’une plainte déposée. #metootheatre"
Le premier tweet a été publié le 7 octobre. Depuis, le hashtag #MeTooTheatre compte des milliers de témoignages, quatre ans après la naissance du mouvement #MeToo dénonçant les violences sexuelles systémiques et l'omerta régnant dans le milieu du cinéma.
Plus de 5000 témoignages
Marie Coquille-Chambel, vidéaste et critique de théâtre sur Youtube, a tweeté jeudi 7 octobre au soir. Elle accuse un membre de la Comédie-Française de l'avoir violée. "J’invite toutes les personnes harcelées sexuellement, agressées ou violées dans le milieu théâtral à témoigner avec le hashtag #MeTooTheatre", a-t-il continué dans un second tweet.
En juin 2020, la jeune femme avait déjà brisé le silence en affirmant avoir été frappée à trois reprises par son ancien compagnon, un pensionnaire de la Comédie-Française. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis de deux ans probatoires par le tribunal correctionnel de Paris.
Quelques minutes plus tard, les témoignages se comptaient par centaines, puis par milliers. Ils avoisinent les 5000 à la date du 11 octobre. Tous dénoncent les violences sexistes et sexuelles dont elles ont été victimes ces dernières années.
J'ai dépensé tellement d'énergie à devoir repousser les propositions de vieux metteurs en scène.
"J'ai dépensé tellement d'énergie à devoir repousser les propositions de vieux metteurs en scène quand j'étais une très jeune actrice, je ne veux pas que mes sœurs vivent ça. #metootheatre", écrit l'une d'entre elles. "J'étais assistante de mise en scène avec un metteur en scène que je devais surveiller pour pas qu'il harcèle ou agresse nos 6 comédiennes mineures. #MeTooTheatre", abonde une autre.
Ces témoignages interviennent alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nancy contre Michel Didym, metteur en scène et ancien directeur du théâtre de la Manufacture à Nancy, accusé de viol, précise Libération. D'autres femmes dénoncent des comportements sexistes répétées.
"Hier, le #MeTooTheatre a éclaté. Soutien à toutes les victimes. Nous vous croyons, vous n’y êtes pour rien, vous êtes courageux.se. Il est temps de mettre fin à l’impunité qui plane au sein du monde théâtral", a réagi dès le lendemain le collectif féministe #NousToutes.
La militante et conseillère à la mairie de Paris Alice Coffin a elle aussi apporté son soutien au mouvement et s'engage à en faire un sujet politique : "Immense soutien et admiration à toutes les personnes qui témoignent pour #MeTooTheatre . J’interviendrai en Conseil de Paris la semaine prochaine à ce sujet, n’hésitez pas donc à m’envoyer en DM ou pas tout sujet particulier que vous souhaiteriez voir mentionner publiquement."
Action publique le 16 octobre
Face au succès du mouvement lancé sur Twitter, un compte Instagram a été créé. Il met en avant certains témoignages recueillis et annonce également une "première action politique et publique du #metootheatre", le samedi 16 octobre, à 11 heures. Des témoignages peuvent être envoyés anonymement par messages privés ou sur mouvementmetootheatre@gmail.com.
Une mobilisation avait eu lieu début mars 2021 devant le Cours Florent afin de dénoncer le "silence" de l'école. Plusieurs élèves évoquaient des comportements sexistes et violences sexuelles à la suite d'un appel lancé par Les Callisto, une association luttant contre les violences dans les écoles du spectacle vivant, sur un blog de Mediapart. L'école privé avait réagi par communiqué, estimant n'avoir "rien à cacher".
Lancé il y a un an, le compte Instagram Paye ton rôle recueille aussi les paroles des victimes de violences dans le monde du théâtre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 10:32 AM
|
Communiqué de presse Publié le 25.10.2021
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, donne son agrément à la nomination de Peggy Donck à la direction du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), à la suite de la décision du directoire, réuni le 21 octobre 2021 sous la présidence de Frédéric Durnerin.
Peggy Donck est directrice de production de la compagnie XY. Fondée en 2005 à l’initiative d’Abdel Senhadji et de Mahmoud Louertani, cette compagnie est devenue une équipe artistique de référence dans le paysage de l’acrobatie française et internationale.
Peggy Donck avait été précédemment directrice de production de la compagnie « Un Loup pour l’Homme » et du collectif AOC, ainsi que secrétaire générale de « Hors les Murs », Centre National de Ressources pour le Cirque et les Arts de la Rue.
Sa vision de l’art, sa compréhension des différents enjeux de l’ensemble de la filière du cirque et sa connaissance des artistes de toutes les disciplines lui permettront de donner aux artistes circassiens en devenir les outils pour créer les esthétiques du cirque de demain.
Peggy Donck prendra ses fonctions le 1er Janvier 2022 à la suite de Gérard Fasoli, directeur du CNAC depuis 2013 qui a fait valoir ses droits à la retraite. Roselyne Bachelot-Narquin salue l’action sans relâche menée par ce dernier pour maintenir le CNAC à un haut niveau d’exigence artistique et pédagogique.
Le CNAC, créé en 1985 par le ministère de la Culture, est un établissement supérieur de formation, de ressource et de recherche dédié au cirque contemporain.
Près de 400 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus de la formation d’excellence dispensée par l'école supérieure du CNAC : l’Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque (ENSAC). Ces artistes sont aujourd'hui des acteurs majeurs de la scène artistique internationale.
Centre de formation tout au long de la vie, mais aussi centre de ressources et de recherche de référence internationale, le CNAC défend les valeurs de l'esprit circassien, parmi lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre.
Le CNAC est une institution ancrée sur son territoire et ouverte aux artistes, aux chercheurs ou aux professionnels des arts du cirque et du spectacle vivant comme au grand public. Il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique, scientifique et technique, pour se mettre plus encore au service de son secteur, et plus largement du spectacle vivant.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 7:21 AM
|
Par Rosita Boisseau (Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), envoyée spéciale) le 25 octobre 2021 légende photo : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, le 12 mars 2018, au Prato, à Lille. FRANCOIS PASSERINI La compagnie, en tournée, monte des spectacles où les clowns et les animaux sont des figures totems.
« Moi qui n’aime pas trop la techno, je me suis lâchée en voyant tous les jeunes danser comme des fous », s’exclame, épatée, la metteuse en scène et acrobate Camille Decourtye, de la compagnie Baro d’evel. « On a même eu du mal à les arrêter et faire la fermeture », s’amuse Blaï Mateu Trias, son compagnon, codirecteur de la troupe. Auréolés d’un brin de soleil matinal, adossés à leur camionnette, les deux artistes commentent leur folle soirée de la veille. Jeudi 14 octobre, leur duo Mazut (2012), assorti d’un concert et d’un atelier de sérigraphie, a fait salle comble et tanguer le public du Théâtre de la Cité à Toulouse. Lire aussi la critique : Reprise : le cirque Baro d’Evel à Lyon Cette soirée de fête donne la saveur de l’univers hautement singulier de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « Nous défendons le mélange des genres, précisent-ils. Un des interprètes qui collabore avec nous raconte que son premier souvenir de Baro d’evel a été de nous voir en train de fabriquer un mur de papier de 80 affiches collées les unes sur les autres. » Ce couple multi-outillé dit rêver d’« un art total sans hiérarchie, qui commence avant le spectacle et se poursuit après, avec la nécessité de relier le quotidien et le travail ». Tissant naturellement, au milieu d’animaux, l’acrobatie, la danse, le chant, la musique, les arts plastiques, ils relient les techniques par un fil existentiel fragile, pariant sur la rencontre avec l’autre et l’équilibre des forces en présence. « Nous nous mettons à nu et passons par des états pas possibles, reconnaît Camille Decourtye. Les questions intimes que l’on met en jeu ne sont évidemment jamais résolues sur scène mais participent de la nécessité de nos créations. » Répétitions dans la cave à vin En tournée depuis le 5 octobre avec trois pièces, Baro d’evel, qui signifie « Bon Dieu, bon sang ! » et encore « branquignol » en manouche, s’offre une année non-stop de diffusion dans toute la France et à l’étranger. « On est tous remontés à bloc, affirme Blaï Mateu Trias. Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, permettre à une équipe de remplir les salles par monts et par vaux est une chance. » Avant de prendre la route jusqu’en juillet 2022, ils révisent leur planning dans leur Cave, une ancienne coopérative de vins située près de Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), à quarante-cinq minutes de Toulouse. Ce lieu de répétitions « beau comme un vieux paquebot » avec vue dégagée sur les Pyrénées se veut aussi un grand projet collectif. Chaque premier vendredi du mois, un film, une conférence sont proposés gratuitement. « Nous y accueillons d’autres troupes, commente Camille Decourtye en nous guidant dans les différents étages. On va y créer un espace de recherche entre environnement et société, avec des spectacles mais aussi des ventes de produits locaux… On va planter une vigne dans le champ d’à-côté, faire du vin et on a même songé y ouvrir un garage. On sait combien la voiture est importante en milieu rural. » En contrebas, les caravanes et les trois semi-remorques attendent le départ. Impossible de coller une étiquette sur Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « On ne veut pas être identifiable, ni être résumé à une seule chose » Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias sont visiblement prêts à repeindre le béton à la démesure de leurs désirs. « Avec nos deux filles Taïs et Rita, depuis la création de Baro d’evel en 2006, nous avons longtemps vécu en nomades, insiste Blaï Mateu Trias. Choisir de nous sédentariser nous a donné envie de nouveaux rapports avec les gens. Chez nous, tout le monde met la main à la pâte. Les tâches ingrates ne sont pas déléguées à certains. La Cave incarne notre démarche, celle d’un art du débordement et de l’instable à la vie comme à la scène. » Et dans les prés. Trois chevaux, une quinzaine de pigeons, le corbeau Gus ainsi que le chien Patchouka, cités à égalité avec les acrobates dans les génériques des pièces, font partie de la compagnie. « Nous défendons la liberté des animaux dans nos spectacles. Ce sont des passeurs de mondes que nous ne voyons plus. Grâce au quotidien partagé avec eux, fait de jeux, de soins, nait peu à peu un langage commun que l’on retrouve sur le plateau. » Le cirque est le point de rencontre de ces deux personnalités. Véhéments et somptueux performeurs, ils se croisent en 1996 lors du concours d’entrée au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne (Marne). Elle, cavalière et gymnaste, a grandi dans une ferme avec ses parents instituteurs et au milieu d’enfants de la DASS avec lesquels elle partageait ses randonnées à cheval : « Nous étions proches de la nature mais au sein d’une société qui se répare auprès des animaux. » Lui est catalan, fils du clown Jaume Mateu « Tortell Poltrona », également créateur de l’association Clowns sans frontières. « Je suis clown moi-même mais plus influencé dans mon travail par les arts plastiques et en particulier les peintres catalans Tapies, Miró, Barcelo ou Frédéric Amat » , ajoute Blaï Mateu Trias. Un penchant qui se déploie dans les scénographies, proches d’installations ou de tableaux vivants, activés en direct par les interprètes. Affirmer sa foi dans le vivant Impossible de coller une étiquette sur Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « On ne veut pas être identifiable, ni être résumé à une seule chose. » Pour preuve, Mazut, virage dans leur parcours, bulle d’absurde délicieusement insaisissable. Il suffit de deux tables pour emporter le duo dans la spirale de la folie douce sauvée par l’amour. Tandis que la maison en papier prend l’eau, elle se colore en direct de coulées de peinture. Là, créé en 2018, dessine en noir et blanc les fissures intimes d’un homme et une femme. « Aucune pièce ne se ressemble, dit Blaï Mateu Trias. Mais on enfonce le même clou : les thèmes de la chute, de l’empêchement, de l’autre, qu’il soit enfant ou animal. Quant au rire, il est toujours présent. Les clowns et les animaux sont nos figures totems et nos guides. » En salle, sous chapiteau ou dans la rue, Baro d’evel malaxe la poésie de la matière, de l’argile au fil électrique, en affirmant sa foi dans le vivant. Les parois calcinées de Falaise (2019), grosse production pour 8 acrobates, un cheval et des pigeons, peuvent bien s’effondrer et le plateau se couvrir de cailloux, la tribu se relève encore et toujours pour recoller les morceaux. « Nos spectacles se veulent des cérémonials, glissent-ils. On leur dédie notre vie. » En complicité avec le musicien espagnol Raül Refree, Camille Decourtye écrit actuellement des chansons pour un nouvel opus tandis que Blaï Mateu Trias poursuit ses progrès en céramique. « On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais on verra bien. » Baro d’evel, en tournée. Mazut, du 4 au 13 novembre, MC 93, Bobigny ; 26 et 27 novembre, Malakoff. Falaise, 3 et 4 décembre, Val-de-Reuil ; 9, 10, 11 décembre, Saint-Quentin en Yvelines. Là, du 18 au 21 novembre, MC 93, Bobigny… Barodevel.com Rosita Boisseau (Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 24, 2021 6:49 PM
|
Publié dans le Figaro, avec AFP - 24 octobre 2021 Fou de théâtre passé par la télévision et le cinéma, cet amoureux des grands classiques s'est éteint à l'âge de 96 ans.
Il était l'un des derniers réalisateurs mythiques de l'âge d'or de la télévision. Le réalisateur et metteur en scène Marcel Bluwal, figure emblématique du conservatoire d'art dramatique de Paris, est décédé samedi à l'âge de 96 ans, a appris l'AFP dimanche auprès de son agent. L'homme de théâtre est décédé «paisiblement samedi matin» à Paris, a précisé son entourage. «Mon chagrin est immense, je lui souhaite un beau voyage, il a été un homme essentiel», a écrit sur Facebook l'actrice Ariane Ascaride, qui a été son élève. À LIRE AUSSIL'œil de l'INA : comment Marcel Bluwal et Michel Piccoli ont déconfiné Dom Juan «Un pionnier, tellement il a ouvert de champs possibles pour la télé. Il a montré combien elle peut être très belle et très exigeante», a écrit sur son compte Twitter le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. Un homme «intelligent et courageux», «un modèle», a également loué sur Twitter l'écrivain Philippe Labro. «Merci Marcel pour votre engagement, merci au nom de tous les auteurs», a complété sur Twitter la Société des auteurs et compositeurs dramatiques(SACD), dont il avait été à la tête à la fin des années 1990. Né à Paris le 26 mai 1925, de parents juifs polonais immigrés, Marcel Bluwal, a passé une partie de la guerre, 26 mois, caché chez le professeur de piano de sa mère. Après avoir suivi l'enseignement de l'École technique de la photo et du cinéma de la rue de Vaugirard, il entre en 1949 à la télévision, qui, aimait-il dire, était née la même année que lui (la première démonstration publique d'un système de télévision date de 1925, à Londres). Ses premières réalisations sont des émissions enfantines (Jeudi après-midi) puis il se lance dans l'adaptation télévisée de chefs-d’œuvre du théâtre et de la littérature. Un adaptateur en chef Lui qui se fait une haute idée de la mission culturelle de la télévision dépoussière sur les planches les plus grands auteurs : Le barbier de Séville, Le mariage de Figaro, Le jeu de l'amour et du hasard, Les frères Karamazov... Avec plusieurs dizaines d'adaptations à son actif, son nom est, depuis, resté attaché à l'âge d'or de la télévision des Buttes-Chaumont, aux côtés de Stellio Lorenzi (Jacquou le croquant), Jean Prat ou encore Claude Santelli. À LIRE AUSSI Dom Juan et Roméo et Juliette, des classiques revus et réadaptés avec passion Son adaptation du Dom Juan de Molière, tourné en 1965 avec Michel Piccoli et Claude Brasseur, en décors naturels vides de présence humaine, a marqué l'histoire de la télévision et est encore cité comme modèle d'adaptation d'une pièce pour le petit écran. «Je ne me suis jamais senti ni gourou ni intello», déclarait-il à Libération en 1994. «L'année d'après (Dom Juan, ndlr) d'ailleurs, j'ai enchaîné avec Vidocq, qui était le symbole de la vulgarité. Vous pensez: un feuilleton!». Ce Vidocq, avec Bernard Noël puis Claude Brasseur et Danièle Lebrun (qui deviendra sa femme), avait également remporté un succès considérable. Claude Brasseur (Sganarelle) et Michel Piccoli (Dom Juan) en 1965, dans l'adaptation de Dom Juan par Marcel Bluwal, d'après la pièce de Moliere. Gusman/Leemage Boxer avec le fantôme des auteurs Le théâtre télévisé n'était cependant pas son unique amour. Dans les années 1950, première véritable décennie de la télévision française, Marcel Bluwal propose, parallèlement aux dramatiques, la série Si c'était vous (1957), saluée par la critique, composée d'œuvres de fiction fondées sur des sujets sociaux, tels que les problèmes de logement d'un jeune couple, la fugue d'un adolescent... Dans les années 1980 et 1990, il réalise notamment Mozart, une série de 9 heures sur la vie du compositeur, Thérèse Humbert avec Simone Signoret, Les Ritals adapté du livre de Cavanna... À LIRE AUSSIMarcel Bluwal : la vie du pionnier de la télé racontée dans un livre Puis Marcel Bluwal délaisse le petit écran, pestant contre une télévision devenue «un bête robinet à images». Au théâtre, il a signé plusieurs mises en scène remarquées, dont notamment Le Misanthrope (1968), Dom Juan revient de guerre (1975), Les fausses confidences (1982). Il a remporté en 2007 le Molière de la meilleure adaptation pour A la porte de Vincent Delecroix, avec Michel Aumont. Dans les années 1980, il a également réalisé plusieurs mises en scène d'opéra en Allemagne (Cosi fan tutte, La Flûte enchantée...). Ses incursions au cinéma - comme Carambolages avec Louis de Funès (1963) ou Le plus beau pays du monde (1998) avec Claude Brasseur - ont été plus modestes et ont reçu un accueil mitigé. Très engagé à gauche, membre du PCF de 1970 à 1981, Marcel Bluwal avait conservé jusqu'au bout sa fougue et son enthousiasme. Sur un plateau, «il a toujours l'air d'être sur un ring. Il boxe avec l'idée, avec le fantôme de l'auteur, avec l'acteur...», disait de lui Claude Santelli. En 2008, après 13 ans d'absence à la télévision, il a dirigé la mini-série À droite toute consacrée à la montée de l'extrême droite en France durant les années 1935-1937 à travers la formation de la Cagoule, organisation clandestine qui fomentait le renversement de la République.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 24, 2021 5:13 PM
|
Une compilation de trois posts publiés sur Facebook et Sceneweb entre le 20 et le 23 octobre 2021 Gérard Watkins Un post publié sur Facebook le 20 octobre 2021 Vu ce que j’ai lu hier soir sur le portail du Théâtre de la Colline, je voudrais ici juste réaffirmer mon soutien total à #metoothéâtre, et répondre ainsi à l’injonction de non seulement soutenir, mais aussi faire de la voix. Ce que je n’ai pas trop l’habitude de faire. C’est une chose de rappeler à l’ordre une idée de la Justice, et son importance, (sans rappeler au passage une inefficacité historique dans ce domaine), s’en est une autre d’humilier celles qui donnent de la voix, et les victimes qui dénoncent ce qu’elles ont subies, rassemblées ici en un mouvement. Je trouve insoutenable de lire cet amalgame entre le “catholicisme rance” et des femmes qui ont le courage de dénoncer ce qu’elles ont subies comme violences. Insoutenable cette dramaturgie qui les lie à l’inquisition (Elles n’ont physiquement torturé personne, elles) Et au lynchage (Elles n’ont jamais sorti de couteaux, elles) #metoothéâtre est là pour mettre un terme aux violences. Quelles qu’elles soient. Il y a autant de formes de violences dans le théâtre que dans les violences conjugales. Violences sexuelles, psychologiques, physiques, économiques, administratives. Auxquelles on pourrait rajouter artistiques, dramaturgiques, etc… Une longue liste. Ce qu’il y a de formidablement positif dans tout ce que j’ai pu lire, dans les textes-soutiens du mouvement, c’est cette volonté de mettre une fin à tout ça, et tout ce qui en découle. Jusqu’au harcèlement moral que peuvent aussi subir des hommes, les rapports de pouvoir qui n’ont pas lieu d’être. Tout ça. Violence comme anti-chambre de l’injustice. Leur apport, et ce que cela va entrainer, est un bienfait. Une bénédiction. Exprimer un regret de non-dialogue par une insulte est pour le moins curieux, et destiné à la clash-culture, et laisser libre cours au « Backlash » comme j’ai pu lire en lire sur les réseaux. Un déferlement « d’empathie pour le bourreau », qui est un phénomène en soi, une forme de mécanisme de déni à l’œuvre, que j’ai pas mal rencontré dans mes recherches sur les violences conjugales (Un directeur de théâtre sur trois à qui je parlais du projet en 2015 me disait « mais les femmes aussi frappent les hommes ») Clash-culture donc. Pour infos je ne participe pas au débat sur Facebook. Ni à la clash culture. Je ne répondrais pas aux commentaires. J’écris ces mots dans l’espoir d’un contre poison. Mettre un terme au backlash et son apparente fatalité. Pour reprendre cette merveilleuse réplique que j’ai entendu dans le fabuleux 7 minutes de Stephano Massini mis en scène par Maëlle Poésy, dans la bouche de l’hallucinante Véronique Vella, « Est-ce qu’on peut me dire pourquoi, dans ce putain de bordel de monde, à chaque fois qu’il y a quelqu’un qui s’oppose, on dit qu’c’est lui qui a un problème ? » ( remerciements à Véronique au passage pour la citation exacte.) Et je trouve enfin délirant de lire ces mots de fin « Dommage » Pour reprendre la parole de Sarah Kane quand on la traitait de « sick », elle avait répondu « Sick ? Who are you calling sick ? » Là on pourrait dire « Dommage ? Mais qu’est-ce que tu appelles « Dommage ? » » Gérard Watkins ------------------------------------------------------------------------------------------------ Julie Pilod Je suis loin d’avoir lu tout ce qui s’est dit et écrit ces derniers temps .je m’en excuse .juste je m’interroge. Je m’interroge. Comment l’article d’une journaliste d’un grand quotidien national peut en déclenchant un mouvement nommé MeToo théâtre conduire quatre théâtres à déprogrammer un spectacle dans lequel de nombreuses personnes sont engagées un mois avant les représentations ? Pour rappel des faits ,une plainte pour viol a été déposée à l’encontre du metteur en scène de ce spectacle en novembre 2020 soit il y a un an pour des faits survenus il y a huit ans. L’article de presse en question est sorti le 1er octobre 2021, le lendemain d’une garde à vue ou ce même metteur en scène a été confronté à la plaignante. À l’issue de cette garde à vue il n’a pas été mis en examen, l’enquête préliminaire se poursuit. Je tiens ici pour avoir été personnellement contactée par cette journaliste en août dernier à retranscrire sa manière de procéder : « Bonjour, Je suis journaliste pour Libération . Je me permets de vous contacter car j’enquête actuellement sur Michel Didym suite à la plainte pour viol qui a été déposé à son encontre. J’ai depuis reçu plusieurs témoignages dénonçant des violences sexistes et sexuel. J’ai vu que vous aviez récemment travaillé avec lui et j’aurais souhaité vous poser quelques questions à ce sujet, par téléphone selon vos disponibilités. Je me permets de préciser que l’anonymat et bien entendu possible et garanti si vous le souhaitez. N’hésitez pas à me joindre par téléphone au ——si vous avez la moindre question. Et si vous êtes d’accord, pourrions-nous nous appeler dans les jours prochains ? Merci par avance pour votre retour bonne journée. X » Cette forme journalistique n’est-elle pas une incitation à la dénonciation ? Des insinuations pour obtenir les témoignages voulus ? Je tiens à préciser que j’ai répondu à cette journaliste que pour avoir travaillé depuis de nombreuses années avec ce metteur en scène, je n’ai absolument rien à lui reprocher dans son comportement envers moi.Elle n’a absolument pas tenu compte de ma réponse dans son article. Je ne suis pas juge pour décider si cet homme est coupable des faits qui lui sont reprochés. Est-ce de cela dont il s’agit quand je lis l’analyse d’une philosophe et psychanalyste sur le mouvement MeToo à propos d’une autre affaire ? « C’est à une entreprise d’un tout autre ordre qu’elle ( une journaliste) se livre, qui s’apparente dans ses procédés aux pratiques des tribunaux d’Inquisitions, lorsque les enquêteurs ecclésiastiques sollicitaient les dénonciations (…). Sollicitations insistantes ayant pour conséquence de parvenir à « impliquer un village tout entier » peu à peu convaincu que le diable est effectivement apparu : en l’occurrence par exemple que X est bien le « violeur « que l’enquêtrice « sais » qu’il est. ». Pour citer encore cette philosophe : »Dans le champ judiciaire ,les témoins ,à charge ou à décharges,Interviennent dans le cadre réglé d’une procédure, lorsqu’il s’agit d’établir la validité d’une accusation ou au contraire (pour les témoins de la défense )de l’invalider. Leur parole, si véridique soit elle, ne dispense aucunement de la recherche d’indices de toute nature, et autant que possible d’éléments matériels de preuve. Lorsque ces éléments manquent, comme c’est souvent le cas s’agissant d’accusation de viol ou d’agression sexuelle plus ou moins caractérisée, davantage encore lorsque les faits allégués sont anciens, le recoupement des témoignages, la confrontation entre la plaignante et l’accusé, le recueil d’éléments et d’indices ayant une valeur probante aussi fiable que possible, tous ces dispositifs tentent, avec un succès malheureusement souvent mitigé, de pallier ce défaut de preuves.Par ailleurs, dans un état de droit tout au moins, l’accusé a droit un procès équitable, les droits de la défense ne sont pas comme dans les procès de type stalinien des droits purement formels, mais doivent être scrupuleusement respectés, et les témoins lorsqu’ils parlent à la barre le fond sous serment. Pourquoi ?Parce qu’il importe que soit ainsi assuré la véracité de leur discours–sachant que, bien sûr, ils peuvent, même en toute bonne foi, se tromper.Par exemple, il peut arriver qu’ils mésinterprètent une situation dont il n’auront eu qu’une vue partielle.Le faux témoignage, dans ce cadre–mais même au cours d’une enquête diligentée par un juge–est sévèrement puni. Plus sévèrement encore que la dénonciation calomnieuse.Cela parce que le parjure alors constitue non pas seulement une atteinte aux personnes, mais aussi et d’abord une atteinte à la justice, c’est-à-dire à l’institution à laquelle il revient de garantir et de protéger les droits des personnes .De toutes les personnes, accusés–et coupables ou condamnés -compris. » Sans MeToo, de nombreuses femmes n’auraient jamais osé dénoncer certains abus, harcèlements, chantages. Et je sais combien il est difficile, de porter plainte dans le cas d’agressions sexuelles. J’ajouterais, que je trouve terrible qu’on salisse l’image d’un festival comme la Mousson d’Eté qui représente pour moi un espace immense de liberté pour les autrices, auteurs, actrices, acteurs, traductrices , traducteurs, pédagogues, universitaires, techniciennes, techniciens, metteuses en scène, metteurs en scène, j’en oublie… Je trouve aussi très délicat quand quelqu’un dans une interview parle de concomitance entre la libération de la parole dans l’église et celle dans le mouvement MeToo théâtre. Les dénonciations d’agressions sexuelles commisent sur des mineurs par 2900 pédocriminels ces 70 dernières années et les dénonciations d’abus dans le monde du théâtre? Abus de pouvoir et abus sexuels , est-ce la même chose ? Je m’interroge . Julie Pilod ----------------------------------- Arthur Daniel : "Wajdi Mouawad, ne caricaturez pas le mouvement #MeTooThéâtre" La tribune publiée par Wajdi Mouawad suite aux déclarations de Roselyne Bachelot sur la présence dans son équipe artistique de Bertrand Cantat, condamné pour avoir assassiné la comédienne Marie Trintignant, et Jean-Pierre Baro, visé par une plainte pour viol classée sans suite, dans la programmation du Théâtre National de la Colline endosse une rhétorique qui n’est pas anodine et à laquelle il convient de répondre de manière argumentée. Ce que propose le comédien Arthur Daniel, dans sa tribune. Cette rhétorique s’inscrit dans un contexte médiatico-politique qui a pour but de faire passer certaines luttes d’aujourd’hui (antiracistes, féministes, LGBTQI+ notamment) pour ce qu’elles ne sont pas. Le spectre idéologique de cette opposition pétrie d’inquiétudes réunit beaucoup de gens et créent des coalitions pour le moins surprenantes : de la majorité présidentielle à une partie de la gauche jusqu’à l’extrême-droite, la lutte contre le désormais « wokisme » et les luttes intersectionnelles est devenue la nouvelle marotte de tout un champ idéologique et intellectuel. Sur ces sujets, le discours rétorqué aux personnes qui se soulèvent est souvent le même. C’était il y a quelques mois l’accusation « d’islamo-gauchisme », c’est aujourd’hui « l’idéologie woke » qui en irrite plus d’un. Et, qu’on le veuille ou non, faisant appel aux mêmes outils lexicaux, c’est avec ce spectre idéologique très large que fraternise aujourd’hui Wajdi Mouawad. Cette réponse est malheureusement un festival de caricatures, de lieux communs et d’anathèmes. Tout d’abord, faire passer les militant.e.s, témoins et/ou victimes qui ont témoigné à travers #MeTooThéâtre pour des juges, c’est adopter un renversement rhétorique caricatural déjà utilisé lors de #MeToo en 2017. On entendait : « justice rendue sur les réseaux sociaux », « tribunal populaire », « horde assoiffée de vengeance », mise au ban de la présomption d’innocence… Aujourd’hui, avec Wajdi Mouawad : « sacrifice de l’État de droit », « dictature qui ne dit pas son nom », « la foule qui lynche », etc… Les mêmes éléments remâchés, en plus pompeux. Au-delà de ces raccourcis , il s’agit de dire et redire l’essentiel : accorder un pouvoir judiciaire relevant d’une autorité étatique et verticale à des militant.e.s et/ou victimes qui appellent à une prise de conscience, à des mesures fortes et un changement de paradigme global, c’est leur donner un pouvoir qu’évidemment ils et elles n’ont pas. Qui a parlé de censurer telle ou telle œuvre du côté de #MeTooThéâtre ? Qui a dit qu’il fallait se substituer à la justice ? Qui a parlé de piétiner l’État de droit ? Tordre ainsi le discours de ses adversaires relève d’une entreprise de disqualification massive. C’est aussi dire en creux : vous ne faites pas partie du champ démocratique, je ne vous écouterai donc pas. Ensuite – et c’est plus grave –, amalgamer ces personnes qui s’insurgent avec des intégristes catholiques, c’est un raccourci grossier qui consiste à faire accroire l’analogie suivante : des fondamentalistes religieux qui sévissent entre autres à travers la censure de la nudité et du blasphème utiliseraient donc les mêmes procédés que des militant.e.s qui demandent qu’advienne une réelle prise de conscience collective sur la prégnance des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du théâtre. Là encore, plate entreprise de disqualification. Amalgamer ainsi, c’est accréditer l’idée aberrante que lutter contre les violences sexuelles dans le milieu du théâtre, c’est faire preuve de conservatisme et de rigorisme moral alors qu’on parle bien d’un changement anthropologique majeur Le contraire même du conservatisme. Plus déroutant encore : assimiler à une « forme d’inquisition » des interrogations légitimes sur la présence de tel ou tel artiste au sein d’une institution, c’est, en plus de faire un parallèle historique bancal, tuer dans l’œuf le débat démocratique mais c’est surtout faire preuve d’une réaction d’une virulence incompréhensible – à moins de la mettre sur le compte de la colère et de la susceptibilité, comme cela arrive souvent dans ce genre de controverses. C’est si dommage de manquer une occasion d’écoute, de dialogue. Justement, le dialogue. Il est dit qu’il n’est plus possible de nos jours, que nous vivons dans le temps de l’absence de nuance. M. Mouawad, que n’avez-vous organisé un débat avec les militant.e.s MeTooThéâtre dans ce lieu que vous dirigez où peuvent poumonner les beaux principes de la démocratie tels que le débat contradictoire et l’échange d’idées ? Vous décrétez, avant même que quoi ce soit ait eu lieu, que le dialogue n’est pas possible. Vous le fermez donc de votre propre chef. Que l’on soit en désaccord, c’est une chose stimulante en soi. Que l’on fasse de ce désaccord une liste d’invectives et de raccourcis pour fermer la porte à tout échange, c’est cela qui, encore une fois, est dommage. Pour quelqu’un dont le métier est d’être au cœur de la langue, que ce soit en tant que metteur en scène ou écrivain, une telle bévue faite d’imprécisions et de ressentiment ne peut susciter qu’une profonde stupéfaction. On a rarement vu réponse aussi virulente adressée à des militants et militantes dont l’objectif premier, principal, urgent – rappelons-le ! – est que cessent les violences sexistes et sexuelles, en l’occurrence dans le milieu du théâtre. Pensons aux témoignages des vingt femmes témoins ou victimes des agressions et viols dont le metteur en scène Michel Didym est accusé. Cet article de Libération de la journaliste Cassandre Leray a permis de faire émaner le #MeTooThéâtre, prise de parole essentielle pour des comédien.nes, technicien.nes, administratrices etc… victimes de la violence masculine sous toutes ses formes. C’est dans ce cadre qu’y ont été abondamment décrits les « préjugés sexistes, cette culture du viol sous-jacente, cette zone grise insidieuse et cette absence de réflexion autour du consentement » comme le dit le Collectif. Des rapports de séduction où est torpillé tout professionnalisme, du harcèlement, du chantage au rôle, l’omerta qui protège les agresseurs, tout un lot d’atteinte et d’agression sexuelle qui vont parfois jusqu’au viol et qui constitue la violence systémique amplement dépeinte par celles et ceux que vous répudiez. C’est de cela dont on parle. Pas d’autre chose. M.Mouawad, vous êtes dans une position de pouvoir, non ces personnes qui s’insurgent. Vous avez le pouvoir de changer les choses, un peu. A l’échelle de ce petit milieu du théâtre. N’ayez pas peur, ne caricaturez pas. Les choses changeraient un peu, énormément qui sait, si vous écoutiez et regardiez du côté des aspérités, des récits et des propositions précises faites par #MeTooThéâtre et non des discours gonflés d’amertume. Frantz Fanon ne disait-il pas dans Peaux noirs, masques blancs : « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge !» ? Interroger, n’y a-t-il rien de plus éminemment théâtral ? Écouter et regarder, n’est-ce pas un des gestes fondamentaux de l’artiste ? Arthur Daniel ---------------------------------------------------------------------------- Références : ___________________________________________ Aurore Evain 20 octobre 2021 ( post Facebook) Mon texte en soutien au #metootheatre... des paroles d'inquisitrice, monsieur Wajdi Mouawad ? "Merci à celles qui ont œuvré à cette tribune. J’aurais tellement aimé avoir vingt ans parmi vous. J’aurais tant aimé lire ces mots à ma vingtaine. A l’époque, ils n’existaient pas. On avançait en silence, chacune dans notre coin, se croyant seule à ne pas comprendre sa condition de comédienne, se taisant pour ne pas être exclue du jeu, ou bien finissant par quitter l’arène, se pensant inadaptée, mauvaise, pas faite pour le métier. Cette tribune n’existait pas, alors, jeune comédienne échappée des conservatoires et de la Sorbonne nouvelle, je suis partie à la recherche de notre Histoire. Comprendre pourquoi mes camarades du premier sexe pouvait à la fois être considérés comme de bons comédiens et viser déjà la mise en scène, l’écriture, être invités à réfléchir leur art. Pourquoi nous jeunes comédiennes, il fallait avancer masquées : jeunes, jolies, sensibles, très sensibles, séduisantes, pas trop intelligentes, ou alors une intelligence instinctive, animale, qui ne nuirait pas à notre carrière d’actrice. D’actrice-muse. D’actrice-glaise. Comprendre pourquoi des femmes n’avaient pas pu monter sur la scène avant des siècles. Et découvrir soudain la révolution que fut l’apparition des comédiennes en Europe. C'est de Mnémosyne, la déesse de la Mémoire que naquirent les neuf Muses, c'est de la mémoire retrouvée que peut ressusciter le matrimoine d’hier : il ouvre la voie au matrimoine de demain, à des artistes puissantes, qu’on ne pourra plus humilier et réduire à des corps disponibles. Je voudrais ici en témoigner, pour celles qui doutent, celles qui arrivent, celles qui cicatrisent. Il n'est pas possible d'évoquer ici toutes les conséquences esthétiques, économiques et culturelles qu'entraîna l'arrivée des actrices au XVIème siècle. Mais retenons au moins ceci, qui va à l'encontre des idées reçues façonnant notre imaginaire de la comédienne, et qui nous occupe aujourd’hui. Qui occupe nos corps, qui bride nos cerveaux. Il faut le savoir : l'actrice constitua une figure libératrice pour la société (et aujourd’hui encore, plus que jamais) ; elle fut plébiscitée (ou combattue) en tant que présence dissidente et transgressive. Entre Eve et Marie, mère et putain, l'actrice imposa sur scène et hors scène une figure de femme réelle. Entre adulation et condamnation morale, elle mit au point des stratégies d'intégration, qui consolidèrent la profession d'acteur en Europe et bouleversèrent les codes esthétiques. L'actrice fut donc une actrice incontournable du théâtre moderne et de sa professionnalisation. Face à ce constat, un étonnement, une colère : pourquoi aucune mention de cette apparition dans les cours d'histoire du théâtre en France ? Entre autres parce que s'écrit ici une histoire émancipatrice de la comédienne inimaginable au regard des discours traditionnels sur cette dernière. Alors que nous avons été constamment renvoyées à la figure de la prostituée, de la courtisane, de la fille facile, d'un corps à disposition, s'y raconte une contre-histoire : celle de femmes qui, en devenant actrices, en signant un contrat de professionnalisation avec une compagnie, vont adopter ce métier pour sortir de la prostitution. Pour ne plus vendre leur corps, mais leur image. Loin des histoires d'alcôve et de coucheries où elles furent cantonnées, les premières actrices furent avant tout – et on l’oublie toujours - des femmes lettrées, sachant lire et écrire ; au cœur de la Renaissance italienne, elles fascinaient autant par leur beauté physique que par leur intellect. Leurs qualités d'actrice étaient indissociables de leurs prestations poétiques. Pour n’en citer qu’une : Isabella Andréini, de la compagnie des Gelosi, la plus digne représentante de cette première lignée de comédienne, invitée par toutes les Cours d'Europe, membres de l'Académie des Intenti, l'actrice la plus célèbre de son temps, et l'une des premières autrices de théâtre. Sa pastorale Mirtilla, publiée en 1588, traduite en français en 1602, est aujourd’hui qualifiée de « protoféministe ». Pensée donc pour toutes les Marilyne qui, quelques siècles plus tard, ont été transformées en blondes idiotes, et à toutes les suicidées qui ne l’ont pas supporté. Partir à la recherche de ces modèles et comprendre l'histoire de leur effacement fut pour moi salvateur. Cela consista à mettre littéralement des mots sur une histoire. Actrice Autrice. Deux mots qui se sont croisés au XVIIème siècle, au coeur des premiers dictionnaires. Disparut autrice quant apparut actrice. Apparut actrice quand le mot acteur, se limita au sens de « comédien » Un appauvrissement sémantique qui survint quand la profession se féminisa... ; disparut autrice quand la fonction « auteur » se dota d’un prestige littéraire et social et qu'une nouvelle génération de femmes de lettres fit son apparition. Coïncidence ? Au commencement était l'autrice, à la fin ne resta que l'actrice, réduite à être la voix d'un auteur. Il faut raconter à la jeunesse cette autre histoire : celle d'une figure d'artiste, puissante, non réduite à son statut sexuel, à la fois actrice et autrice, à une époque où les deux mots étaient encore enchevêtrés. Au regard de cette histoire, il n'est guère étonnant que le mouvement Metoo ait été lancé par des actrices, toujours en lutte contre cette assignation réductrice à leur corps et à leur sexe. Il faut raconter aux hommes que les créatrices eurent des ennemis, mais aussi beaucoup d’alliés parmi eux, qui sont autant de modèles à suivre aujourd’hui. A côté des leviers politiques indispensables à mettre en place pour asseoir l'égalité des femmes et des hommes, il est nécessaire de s’attaquer aux violences symboliques, toutes aussi redoutables, car invisibles. Elles se logent dans nos représentations imaginaires, constituées de ce que l’on nous transmet, via l’éducation, le langage, les livres, les films, les œuvres d’art... Et nous les transmettons à notre tour, consciemment ou inconsciemment. Tout cet imaginaire est traversé par des siècles de domination masculine, qui ont abouti à une représentation du monde puissamment genrée et inégalitaire : aux hommes le génie, aux femmes le domestique ; aux hommes, l’autorité, aux femmes, la douceur et la soumission. Cela se décline à l’infini. Et chaque être humain est enfermé dans cette cage, qu’elle lui corresponde ou pas. Le matrimoine permet de renverser cet ordre patriarcal du monde, de remettre en question ce qui s’écrit et se dit depuis des siècles dans les livres d’histoire, les anthologies, sur les bancs d’école ou d’université, dans les conservatoires, les écoles de théâtre. Il permet de déconstruire la fabrique de l’Histoire, et d’agir aux racines de l’inégalité, en rendant caduques ces violences symboliques. Il offre des modèles aux femmes, leur permet de se sentir plus fortes, aptes à participer à l’histoire de demain, comme elles ont participé à celle d’hier, malgré l’effacement dont elles ont fait l’objet. Le matrimoine permet aux hommes d’être en filiation avec des figures féminines, et enfin, de dégenrer nos constructions imaginaires (de les déranger aussi...). C’est là la puissance du matrimoine, de son histoire. C’est là la puissance des mots. De cette tribune. Nommer. Dire. Rendre audible ce qui était inaudible, rendre visible ce qui était invisible, retourner le vieil ordre du monde, quitte à faire trembler les réactionnaires d’antan et d’aujourd’hui, quitte à raviver cette vieille peur médiévale d’un monde à l’envers. C'est la bataille contre nos idées reçues, reçues depuis l'enfance. Et nous allons la gagner. Nous aussi. Hélène Cixous écrivait en 1977 : « Il faut toujours qu’une femme soit morte pour que la pièce commence. Le rideau ne se lève que sur sa disparition ; à elle la place du refoulé, tombeau, asile, oubli, silence. On ne la trouve que perdue, en exclusion ou dans une salle d’attente. Elle n’est aimée qu’absente, abîmée. Fantôme ou trou fascinant. Dehors : hors d’elle-même aussi. Voilà pourquoi je n’allais pas au théâtre : pour ne pas assister à mon enterrement...» En 2021, il est temps d’aller au théâtre pour assister à notre renaissance." Aurore Evain (comédienne, historienne)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2021 11:32 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 21 octobre 2021 Légende photo : Le chorégraphe et danseur Boris Charmatz à Paris, le 21 octobre 2020. SÉBASTIEN DOLIDON Le chorégraphe doit inventer un avenir à la compagnie créée autour de la grande figure de la danse allemande, morte en 2009 C’est le danseur et chorégraphe Boris Charmatz qui prendra la direction du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, compagnie historique de premier plan créée en 1973 par l’artiste allemande, à Wuppertal (Allemagne), à partir de septembre 2022. Cette nomination, annoncée officiellement jeudi 21 octobre par le conseil d’administration de la troupe, entend relancer la trajectoire de cette institution qui, depuis la mort fulgurante de Pina Bausch en 2009, se cherche un nouvel avenir, entre répertoire et création. Autant dire que la charge et la responsabilité qu’endosse l’artiste français, personnalité-phare de la scène contemporaine depuis le milieu des années 1990, est aussi lourde qu’excitante. « C’est un immense honneur mais surtout un vrai risque et une aventure très riche en émotions déjà, commente Boris Charmatz, joint par téléphone avant la conférence de presse. Je suis heureux mais j’ajoute un petit “p” devant le mot car je me sens aussi un peu peureux devant ce qui m’attend. Il va falloir pas mal d’humilité pour endosser ce poste avec 60 personnes devant soi, dont 32 danseurs, ainsi que les spectacles de Pina, qui sont pour moi des trésors immatériels de l’humanité, à conserver et à transmettre. » Lire le portrait : Article réservé à nos abonnés Les foules en mouvements de Boris Charmatz Directeur du Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes, de 2009 à 2018, actuellement installé dans les Hauts-de-France avec sa nouvelle structure baptisée Terrain, Boris Charmatz a été contacté il y a six mois par la Commission de recherche spécialement mise en place et composée d’experts, de représentants de la ville de Wuppertal, du Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie et de l’Ensemble Pina Bausch. Il n’a pas hésité longtemps. « Comment dire non à un projet pareil ?, dit-il. Nous avons tout de même pas mal discuté autour de différentes propositions. Inviter un artiste représente un bouleversement total, une nouvelle vision pour la compagnie, la ville.. .Bien sûr, les œuvres de Pina vont continuer à faire partie du répertoire, mais il s’agit de retrouver une liberté créatrice pour inventer le XXIe siècle. Une place première va être donnée au présent et au futur pour avoir une chance de faire des gestes qui comptent. » Culture allemande dans son ADN Boris Charmatz prend la suite d’une série de directeurs qui ont maintenu avec vaillance et passion les 44 pièces, dont un nombre maximal de chefs-d’œuvre, de Pina Bausch. D’abord prise en main par l’interprète historique Dominique Mercy et Robert Sturm, assistant de la chorégraphe, de 2009 à 2013, par Lutz Förster, danseur emblématique, de 2013 à 2016, puis par Adolphe Binder, entre 2017 et 2018, et enfin par Bettina Wagner-Bergelt, de 2019 à 2022, la troupe a développé, parallèlement à la diffusion des spectacles de Pina Bausch, quelques collaborations avec des metteurs en scène contemporains dont le grec Dimitris Papaioannou et le norvégien Alan Lucien Oyen. « Je ne viens pas de la danse-théâtre et je n’ai pas de filiation directe avec Pina, précise Boris Charmatz. Mais la culture allemande fait partie de l’ADN de ma famille. J’ai baigné dans la littérature et la poésie allemande. Ma mère était professeur d’allemand ; mon père est juif d’origine allemande et mon arrière-grand-père est mort à Auschwitz. Enfant, je passais mes vacances d’été à Berlin. Je viens d’ailleurs d’intervenir au Mémorial de la Shoah, à Paris. » Pour le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Boris Charmatz entend mettre « la création dans l’espace public au cœur de la transformation de la troupe ». Il compte vite ouvrir un quatrième studio de travail, en plein air, sans toit ni mur, enraciné dans la ville, comme il en déploie depuis quelque temps. Il évoque aussi un axe franco-allemand qui relierait les deux régions, les Hauts de France et le Land Nordrhein-Westfalen. « L’Europe n’est pas assez une Europe de la culture, et le projet européen a commencé sur nos territoires, avec la communauté du charbon et de l’acier, après la guerre… », insiste-t-il. Boris Charmatz, qui est nommé pour huit ans, jusqu’en 2030, sera aussi partie prenante de l’élaboration du Pina Bausch Zentrum, actuellement en cours de construction, qui sera inauguré en 2026. Rosita Boisseau .

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2021 9:32 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 octobre 2021 Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.
Fuir le fléau d’Anne-Laure Liégeois, avec des textes de Valérie Cachard, Philippe Lançon, Jean-Marc Royon, Valérie Manteau, Leslie Kaplan et Scholastique Mukasonga. Et les acteurs Vincent Dissez, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Isis Ravel, Norah Krief et Alvie Bitemo. Et dans la version alternative, avec les textes d’Olivier Kemeid, Jacques Serena, Rémi de Vos, Rébecca Déraspe, Leslie Kaplan, Marie Nimier et Thierry Illouz. Et les comédiens Olivier Broche, Lorry Hardel, Nelson-Rafael Madel, en alternance. Confinement puis dé-confinement, fin d’hiver et printemps 2020, la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois, artiste associée à la Maison de la Culture d’Amiens, n’a cessé de nourrir le rêve de voir les théâtres continuer à être visités par les spectateurs, et « que pour eux résonnent les mots d’auteurs contemporains dits par des comédiens bien vivants ». Heureux hasard, elle avait mené un temps d’écriture en août 2017 à la Villa Médicis autour du Décaméron de Boccace : des jeunes gens fuyaient la peste de Florence en se racontant des histoires sur les collines environnant la ville . La conceptrice invente un parcours répondant aux contraintes sanitaires, interroge des auteurs – un rappel du cadre structurel de Boccace – , selon la commande ainsi énoncée : « Où l’on raconte une histoire sur ce que l’on fuit pour le fuir mieux. » Le spectacle est construit depuis le 31 août 2020 durant deux résidences : l’une à la Grande Halle de La Villette, l’autre à la Scène nationale de Châteauroux. Avec Alvie Bitemo, Vincent Dissez, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Lorry Hardel, Norah Krief, Nelson-Rafaell Madel et Isis Ravel, Fuir le fléau témoigne de sentiments exacerbés. La représentation décline six lieux à l’intérieur de la Maison de la Culture d’Amiens qui correspondent à six groupes de spectateurs, choisis selon la couleur de leur billet et répartis équitablement : le groupe emprunte, l’un, des escaliers qui descendent sous le plateau de scène pour atteindre une petite salle de remise et réparation de matériel technique; un autre groupe monte dans les étages près d’une terrasse largement éclairée, d’autres encore accèdent à telle pièce confidentielle à côté de la scène ou près de la salle – un jeu de cache-cache enfantin. La relation de proximité entre l’acteur et les spectateurs du groupe est privilégiée : les uns les autres se voient de près, comme ils n’en ont pas l’habitude : découverte sincère de l’acteur. Qu’est-ce qu’un fléau ? Une arme contondante – manche court terminé par une chaîne au bout de laquelle était attachée une boule hérissée de clous. Un instrument à battre les céréales – deux bâtons liés bout à bout par des courroies, l’un plus long – le manche -, l’autre plus court -le battoir. Ou bien la pièce rigide d’une balance, mobile dans un plan vertical et qui joue le rôle de levier, ou encore la barre de fer mobile destinée à fermer les deux battants d’une porte ou d’une persienne. Rien ici ne nous intéresse, quoique les histoires de fermeture de portes relèvent du confinement. Le fléau qui aimante l’attention est cette calamité qui s’abat sur une population – fléau de la guerre, de la peste, de la nature, avalanche, inondation, raz de marée, fléaux sociaux, alcoolisme, drogue. Aussi la pandémie de la « Covid 19 » de nos récentes années en cours a-t-elle revêtu des allures de cataclysme, catastrophe, désastre et malheur innommable. Camus écrit dans La Peste (1947) : « Nos concitoyens (…) ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais rêve qui va passer. » Fuir le fléau, c’est donc le surmonter, l’éluder, le mettre loin à distance grâce à l’imaginaire. En cette seconde soirée à la Maison de la Culture d’Amiens, Vincent Dissez dit avec sensibilité et tact le texte grave de Valérie Cachard, auteure libanaise née à Beyrouth. La ville lui semble un espace enfermé dans les conflits – le spectateur pense aussi à la catastrophe de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Les rues sont jalonnées de files d’attente – pharmacie, banque, boulangerie -, alors qu’un sentiment de violence prédomine dans l’accablement de l’attente – effroi. Le Liban, Suisse du Moyen-Orient, deviendrait-il un nouvel Afghanistan ? se demande le narrateur. L’acteur quitte les lieux, enclenchant une musique enregistrée, laissant le public dans l’attente avant qu’un autre acteur ne surgisse. Olivier Dutilloy dit avec une conviction intérieure un texte de Philippe Lançon. Journaliste et romancier, blessé lors d’un attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, Lançon a subi une lourde intervention chirurgicale au niveau du visage, une vingtaine de passages au bloc dont treize opérations pour la mâchoire. ( Le Lambeau, Prix Femina 2018) Avec Olivier Dutilloy, on retrouve le personnage-narrateur et auteur faisant le récit d’un confinement dans sa maison de campagne – mise en abyme de la sensation d’emprisonnement et de repli dans son propre corps. L’interprète va et vient, agité, de l’espace principal où il vit, à la cuisine, en passant par un couloir extérieur sur le sol duquel il marche pieds nus, quel que soit le temps. A la cuisine, il se penche sur le plan de travail, baisse la tête et l’enserre dans un étau. Soit la vision récurrente – réinventée et transposée – d’un fléau personnel, que l’utilisation d’un accessoire de cuisine symbolise, « l’épluche-con » et rend plus cruel encore. L’ustensile sert à éplucher la peau : souvenirs douloureux d’une réfection en travail et éveil lucide et patient à soi. Surgit Anne Girouard, le sourire rayonnant dans le plaisir de ce partage scénique, qui raconte – expérience oppressante – un texte de l’auteur et comédien Jean-Marc Royon. Elle emprunte la posture d’une habitante d’un quartier délaissé de la ville qui entend dans son appartement le voisin du dessus faire du bruit, rentrer tard, ivre ou/et shooté, après avoir déambulé le jour dans la rue. Le confinement a accéléré le sentiment de réclusion de la narratrice et toute « aération » est devenue impossible. Restent les boules Quiès. La plaignante se sent peu à peu prisonnière de cet intrus qui dérange sa vie, misérable locataire qui ne sait pas sa présence. Compte-rendu de la détresse des laissés-pour-compte et de la réalité des petits trafiquants. Enfin, tout s’arrangera. Plus tard, Isis Ravel à l’air malicieux dit un texte de l’autrice Valérie Manteau, journaliste, éditrice, vivant entre Marseille, Paris et Istanbul. La voilà bloquée dans un pays africain, se demandant si elle rentre en France ou reste près de son amoureux alors qu’elle entend, à la radio, que la France est « en guerre ». Boire un verre en terrasse avec ses amis, rien n’est meilleur. Et la question se pose : faut- il tout quitter d’un bonheur enfin trouvé pour devoir repartir « chez soi et les siens » ? Et Norah Krief, boute-en-train fidèle, dit un texte de Leslie Kaplan, décrivant la ville de Paris devenue silencieuse car désertée par ses habitants : ni passants, ni badauds, ni promeneurs… Ou bien, s’il y en a un ou deux qui se croisent sur un trottoir urbain, ils s’écartent d’emblée, s’évitent et se nient. La comédienne se moque de cette réalité triviale, rendant compte avec cœur de l’insolite et n’oubliant jamais la musique, s’amusant et riant avec le public rassemblé près d’elle. Elle écoute sur un pont un air de violon triste et joyeux qui arrête sa balade : belle rencontre avec le musicien. Quant à la railleuse et sémillante Alvie Bitemo, elle dit un texte de Scholastique Mukasonga, racontant ses aventures capillaires en temps de confinement, quand les coiffeurs sont fermés. Un récit baroque sur l’art des coiffures africaines que pourtant, petite, l’école niait puisqu’elle engageait les petits filles, comme les petits garçon, à garder tête rasée. Pourquoi ? Hygiène contre les pouls ? Volonté d’éradiquer toute expression existentielle, libre et libertaire, du comportement ? L’ actrice se moque de ses propos et de ceux des autres avec bonheur, privilégiant l’esprit de jeu. Un théâtre près de soi, à l’écoute scène-salle et inversement, quand on sait que l’autre est soi. Véronique Hotte Les 18 et 19 octobre 2021 à la Maison de la Culture d’Amiens (Somme). Du 10 au 12 janvier 2022, au Volcan – Le Havre (Seine-Maritime). Du 13 au 15 janvier, à L’Azimut Antony Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 20, 2021 7:17 AM
|
Propos recueillis par Olivier Frégaville -Gratian d'Amore dans L'Œil d'Olivier - 20 octobre 2021 Tout juste promu de l’École du Nord, Louis Albertosi foule actuellement les planches du Théâtre Nanterre-Amandiers, dans le Henri VI de Shakespeare mis en scène par Christophe Rauck. Après trois années à Lille, le comédien revient sur son jeune parcours et livre quelques-unes de ses impressions sur le métier, sur cette expérience incroyable. Qu’est-ce que vous a donné envie de devenir comédien ? Louis Albertosi : J’ai d’abord appris à jouer du violoncelle ; c’est par la musique que ça a commencée. C’était mon activité « extra-scolaire », qui me rendait assez heureux, surtout quand il s’agissait de faire de la musique de chambre, de jouer à plusieurs. Mais très vite, je me suis imaginé devenir réalisateur – c’était mon envie « professionnelle » en tout cas. Cela m’est très longtemps resté en tête. Mais une amie en classe de troisième faisait du théâtre dans une petite troupe amateur dans le Val d’Oise (où je vivais), elle m’a invité à venir, insisté même (je l’en remercie), et l’essai a été très joyeux, alors j’y suis resté. J’ai très vite découvert que j’avais un appétit énorme de ça, du théâtre, et surtout, que je n’y perdais pas la musique. En aimant et faisant du théâtre, j’aimais, je faisais toujours de la musique, ou même du cinéma. Je découvrais cet aspect art « total »… Et puis j’ai découvert l’opéra, Wagner, Rameau, et suis enfin allé voir des spectacles avec le lycée, notamment le très marquant Perturbation de Thomas Bernhard, qui passait à Pontoise, mis en scène par Krystian Lupa et avec une distribution exceptionnelle. Très progressivement, l’idée concrète de devenir comédien a supplanté l’envie d’être réalisateur. Après le bac, j’ai été au conservatoire du XXe arrondissement de Paris, avec Pascal Parsat, et ça a magnifiquement fait grandir l’appétit dont je parle. Puis j’ai passé le concours de l’école du Nord… Pourquoi avoir choisi l’école du Nord ? Louis Albertosi : Deux choses m’ont particulièrement attiré vers l’école du nord. D’abord l’idée de partager trois ans d’études avec des élèves auteurs, autrices ; l’idée de voir naître des écritures contemporaines et d’accompagner ces naissances. J’avais notamment vu les maquettes des pièces des auteurs de la promo 5, qui allait sortir, et ça m’avait beaucoup marqué. Et aussi le fait que le parrain de promotion allait être Alain Françon, dont je découvrais justement le travail. J’ai eu un vrai choc en voyant son Mois à la campagne, de Tourgueniev. Jamais je n’avais entendu un texte comme ça. C’est donc bien l’idée du texte, des textes, qui me paraissait être au centre de la pédagogie de l’école. Un musicien dirait la « partition »… J’ai deviné que c’était le bon lieu. Et puis j’ai bien sûr visité Lille, et la ville me plaisait. Quels ont été les moments forts ? Louis Albertosi : Il y en a eu tant ! Je vais faire des choix, c’est forcément injuste. Travailler avec Alain Françon a été une expérience merveilleuse. On l’a fait deux fois en trois ans. Il nous faisait travailler sur des pièces qu’il avait déjà montées. L’expérience sur Toujours la tempête de Peter Handke, notamment, a été passionnante. Et aussi le moment des maquettes des pièces des auteurs, en deuxième et troisième année. Là, nous « créions » vraiment des rôles. C’était tellement heureux ! Et puis, j’ai découvert une affinité puissante pour l’écriture d’un des élèves auteurs, Nicolas Girard-Michelotti. L’école est aussi là pour créer des rencontres. Et encore, tous les stages avec Cécile Garcia Fogel, qui ont été infiniment précieux… Vous êtes dans Henri VI, comment se sont passé les répétitions avec Christophe ? Louis Albertosi : Christophe a eu l’intelligence de se faire accompagner de Cécile Garcia Fogel pour monter le spectacle. En plus d’avoir beaucoup joué Shakespeare, c’est celle avec qui nous avons le plus travaillé à l’école, celle qui nous connaissait le plus « au boulot », tandis que Christophe nous avait vus comme spectateur à chaque sortie d’atelier. Leurs deux regards se complétaient. Le texte est tellement dense, et long ! Il fallait se donner les moyens de travailler vite. Nous avons eu huit semaines pour répéter, ce qui est en fait extrêmement court pour une pièce de quatre heures (dans notre version), avec seize acteurs et actrices avec des problèmes et des atouts tous évidemment très différents. Et puis Shakespeare, c’est le diapason de la difficulté ! Parce que, peut-être, le plus grand auteur de théâtre. Mais on s’est aussi donné les moyens de s’amuser, c’est-à-dire tout bêtement, d’avoir un plateau tournant, de la fumée, de la voltige, de la vidéo, de la batterie, etc. Le travail était acharné, parfois laborieux, mais nous étions sans cesse en prise avec ces choses festives. Les interventions du danseur et chorégraphe Philippe Jamet ont été très utiles aussi, pour régler des scènes collectives, ou des mouvements précis. Il faut dire que le plateau, s’il tourne, reste nu ! Il oblige à avoir une corporalité rigoureuse, comme Shakespeare oblige l’incarnation. Le corps était aussi au centre du travail. Quel rôle jouez-vous ? Et qu'est-ce qui vous plait dans cette incarnation ? Louis Albertosi : J’ai la chance de jouer le rôle-titre, Henry VI. Se voir offrir un grand rôle shakespearien en sortant de l’école, à vingt-trois ans, c’est un défi merveilleux. J’avais pu esquisser un travail sur le rôle lors d’un atelier mené par Cécile en janvier 2021. Et je vois aussi ce cadeau comme une marque de confiance, de sa part d’abord, qui a en grande partie fait la distribution, mais aussi de Christophe, qui l’a validée. Et on peut difficilement faire parcours plus large et plus beau : Shakespeare montre le couronnement d’un tout jeune roi jusqu’à son assassinat dans la tour de Londres. Au plateau, on voit trente ans passer en quatre heures ! Christophe me donnait comme indication, très récemment, « sois courageux ». C’est exactement ça. Il peut y avoir quelque chose d’ingrat aussi, dans ce personnage dont l’humanisme, ou le pacifisme peut parfois tenir de la passivité. Il faut être fin, tout en faisant attention de garder le jeu épique demandé par le plateau nu et le texte de Shakespeare. Mais quelle joie de jouer un roi qui préfèrerait être un berger, un roi écœuré par le pouvoir. Il y a une pensée politique magnifique dans les tragédies historiques de Shakespeare. La poésie et la pensée se conjuguent, sont consubstantielles. On devient plus grand qu’on est lorsqu’on incarne ça – et c’est une idée très chère à Christophe. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore Henri VI de Shakespeare
Théâtre Nanterre-Amandiers
7 Av. Pablo Picasso
92000 Nanterre
Jusqu’au 24 octobre 2021 Mise en scène de Christophe Rauck
Collaboration artistique de Cécile Garcia Fogel
D’après la traduction de Stuart Seide
Avec Louis Albertosi, Mathilde Auneveux, Adèle Choubard, Maxime Crescini, Orlène Dabadie, Simon Decobert, Constance de Saint Rémy, Joaquim Fossi, Nicolas Girard-Michelotti, Antoine Heuillet, Pierre-Thomas Jourdan, Solène Petit, Noham Selcer, Rebecca Tetens, Nine d’Urso & Paola Valentin
Lumières d’Olivier Oudiou
Son de Sylvain Jacques
Costumes de Fanny Brouste
Travail du corps de Philippe Jamet Crédit portrait © Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 19, 2021 5:20 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 19 octobre 2021 Photo : Scène de Henri VI © Simon Gosselin D’un côté « Henry VI » de Shakespeare », un spectacle fleuve de la promotion 6 sortante de l’École du Nord, mis en scène par Christophe Rauck. De l’autre « Le bonheur » un spectacle alerte du théâtre KnAM venu de l’extrême orient russe, mis en scène par Tatiana Frolova. En commun l’art de faire du théâtre avec presque rien. Sauf l’essentiel : des mots, des voix et des corps qui frappent fort.. Henry VI de Shakespeare est une pièce-continent, une épopée monstrueuse rarement montée dans son intégralité. Or c’est cette somme -cent cinquante personnages - qui ouvre la salle éphémère (qu’on voudrait pérenne tant on s’y sent bien) du théâtre de Nanterre-Amandiers en attendant la fin des travaux (deux ans à tout le moins)..Quel beau signe que de faire sortir de sa torpeur ce théâtre devenu quasi moribond en faisant le pari de la jeunesse. Le nouveau directeur de Nanterre -Amandiers ,Christophe Rauck, avec raison, y fait venir sa mise en scène du spectacle de sortie de la promotion 6 de l’école du Théâtre Nord qu’il avait recruté et accompagné jusqu’à son terme en juin dernier lorsqu ‘il était en poste à Lille. Un spectacle fleuve mené à bien en compagnie de Cécile Garcia Fogel (collaboration artistique), Philippe Jamet (travail du corps), deux piliers de l’école avec Lucie Pollet (directrice des études) jusqu’au changement de direction. Hormis deux (désormais anciens comme les autres) élèves retenus ailleurs par des tournages et des répétitions (Suzanne de Baecque et Oscar Lesage), ils sont tous là y compris des auteurs de la promotion sortante: Louis Albertosi, Mathilde Auneveux, Maxime Crescini, Adèle Choubard, Orlène Dabadie, Simon Decobert, Joaquim Fossi, Nicolas Girard-Michelotti, Antoine Heuillet, Pierre-Thomas Jourdan, Solène Petit, Constance de Saint Remy, Noham Selcer, Rebecca Tetens, Nine d’Urso, Paola Valentin. Tous vaillants, inventifs, volontaires, souvent surprenants, tenant le cap tout au long des cinq heures que dure le spectacle (trois pièces en enfilade), conçu comme une course de fond. La traduction utilisée est celle de Stuart Seide qui avait mis en scène Henri VI en 1993 au Théâtre de Gennevilliers et l’année suivante au Festival d’Avignon. Vingt ans plus tard, au Théâtre National de Bretagne, le jeune Thomas Jolly reprenait le flambeau avec sa compagnie La Piccola famila, dans une traduction de Line Cottegnies et vingt et un actrices et acteurs le plus souvent peu ou pas connus. Des panneaux expliquant la généalogie étaient accrochés au fond du plateau et une exquise actrice venait à chaque entracte nous rappeler les épisodes précédents et ce qui se préparait aidant le public à s’y retrouver dans le spectacle qui durait 13h dans sa version intégrale. Contre 5 à Nanterre. La pièce commence à la mort du roi Henri V et s’achève avec celle violente de son successeur, le roi Henri VI devenu souverain à l’âge de 9 ans, assassiné à la tour de Londres par le futur roi Richard III. Shakespeare , un siècle après, raconte sans trop s’éloigner des faits pour l’essentiel des pans sanglants et tourmentés de l’histoire d’Angleterre. C’est le temps de la Guerre des roses entre les York et les Lancastre, de Jeanne La pucelle faite prisonnière, etc. Un temps de guerres, de haine (contre les Français, contre les rivaux), d’alliances de circonstances, de trahisons, de luttes incessantes pour le pouvoir, de mariages et d’amitiés stratégiques, de morts violentes. Bref, comme disent les critiques de théâtre, on ne s’ennuie pas un instant. Le théâtre est à la fête à Nanterre avec ses épées de pacotille qui sont parfois des cannes der golf (comme chez Thomas Jolly), ses canons portatifs à fumée, son petite rideau rouge et, seul accessoire durable et convoité, un trône solitaire qui va et vient sur le plateau. Pas de décor mais un double plateau tournant judicieusement utilisé. Mais encore une beau travail de costumes (Fanny Brouste), de lumières (Olivier Oudiou ) et de son (Sylvain Jaques). Christophe Rauck et Cécile Garcia Fogel qui ont suivi de près tous ces actrices et acteurs durant trois ans, les ont parfaitement distribués.Luis Albertosi dans le rôle écrasant et comme lunaire d’Henri VI, Mathilde Auneveux dans celui de la Reine Marguerite, Simon Decobert -Warwick, Nicolas Girard Michelotti -Somerset, Antoine Heuillet - Gloucester, Pierre-Thomas Jourdan - York, Paola Valentin – Jeanne d’Arc. Certains et certaines comme Noham Selcer, Adèle Choubard, Orlène Dabadie, Solène Petit ou Nine d’Ursa se régalent et nous régalent en interprétant trois ou quatre rôles, voire plus. Filmés en gros plans , micro en main des envoyés spéciaux au cœur des batailles, nous donnent des nouvelles du front. Une bâche en plastique suffit pour enrouler un mort ou un agonisant. Ça file à toute allure, ça dépote, ça bouge bien. Cette histoire lointaine nous parle aussi par ricochet de ce qui nous entoure, car comme toujours chez Shakespeare l’histoire présente est prise dans la nasse du passé. On peut voir dans ce ballet macabre peuplé d’intrigues et d’intrigants une métaphore exacerbée ce que nous vivons actuellement et médiocrement à six mois des prochaines élections pour le trône présidentielles : intrigues de palais, courtisans et prétendants, alliances de circonstance, manque de grandeur, avancées masquées, postures poltronnes, épouvantails en veux tu en voilà encore etc. Loin de ce spectacle médiocre, cet Henri VI haletant est une réjouissante réussite La Russe Tatiana Frolova avait déjà créé le Théâtre KnAM depuis dix ans lorsque Christophe Rauck créa compagnie en 1995 après avoir parfait sa formation au Théâtre du Soleil et découvert la Russie où il reviendra plus d’un fois .La suite fut simple et belle pour lui : remarqué dès son premier spectacle, le voici bientôt à la direction du Théâtre du peuple à Bussang, puis à celle du théâtre du Nord et aujourd’hui à celle du Théâtre de Nanterre-Amandiers. Un parcours exemplaire. Frolova, elle, vient d’une petite ville au fin fond de l’Extrême est de la Russie, loin, très loin de Moscou, à des milliers de kilomètres, et des fuseaux horaires qu’une seule main ne suffit pas à compter. Elle vient de Komsomolsk-sur-Amour, nom doublement fallacieux car la ville pas été construite par les Komsomols (jeunesse communistes) mais par les zeks, les prisonniers du Goulag, et l’amyr (dites amour) le nom du fleuve qui traverse la ville est une mot de la langue nanaî dont la polysémie est nullement glamour.. Les deux capitales (Moscou et Saint Petersbourg) ignorent ce qui se passe dans ces coins perdus de Russie hormis les très grandes villes et quand on veut faire du théâtre mieux vaut partir. Tatiana Frolova n’ est pas allé loin, elle a étudié le théâtre à Khabarovsk, grande ville de la région (forte des plus riches musées ethnologiques du monde), après quoi elle est revenue chez elle à Komsomolsk. Ne voulant pas s’engluer dans l’académisme poussiéreux et mortifère du théâtre dramatique de sa ville, elle a préféré fonder le sien. Un geste courageux et téméraire à moins de vingt cinq ans. C’était en 1985, au temps de l’URSS, un théâtre indépendant (mot toujours honni en Russie) , une exception sans doute rendu possible car loin de tout, loin du pouvoir central et même régional. C’est après la perestroïka et la fin de l’URSS qu’on entendra parler dans les années 90 du teatr KnAM (Komsomolsk na AMyr). La petite troupe (cinq personnes) avait bricolé un théâtre au pied d’un immeuble gris et triste comme en compte tant la ville (sinistrée depuis la chute de l’URSS qui a vu l’effondrement de son industrie obsolète). Un petit théâtre de 24 places fait main, petit mais chaleureux, comme une flamme de vie au cœur de cette ville où tout (les rues, les parcs, l’eau du fleuve) semble fatigué. La petite troupe commence par monter des pièces du répertoire russe et étranger, Le fait qu’il y ait une troupe à Komsomolsk en dehors des structures officielles, est déjà un miracle. Il dure encore trente cinq ans après. Trois des cinq membres fondateurs - outre Tatiana Frolova, Dmitri Bocharov et Vladimir Dmitriev -sont toujours là. Un virage s’est produit au milieu des années 2000 lorsque Tatiana Frolova a perdu sa mère. Elle décide de lui consacrer un spectacle. « j’ai essayé de raconter, à travers l’histoire de la vie d’une femme simple, la vie de toute une génération « effacée », « mutilée par la guerre et les répressions» Tout l’Extrême orient russe fut un haut lieu du Goulag. Le passé y pèse lourd, les mémoires demeurent tourmentées et souvent hantées par le passé soviétique. Dès lors, le KnAM se tourne vers la vie et délaisse le répertoire. Les spectacles s’inspirent de textes de Dostoïevski, de Kafka qui dialoguent avec des témoignages recueillis par la troupe. Une guerre personnelle en s’inspirant du livre éponyme du journaliste russe Arkady Babtchenko parle sans fard des guerres en Tchétchénie, un autre spectacle traite des prisons russes en s’appuyant sur des lettres et des témoignages, etc. Du théâtre documenté mais non documentaire car tous ces spectacles sont embrasés par leur puissance esthétique, une magie faite de bouts de ficelle. Les derniers spectacles du KnAM se recentrent sur la ville de Komsomolsk et de ses habitants. Comment on y vit, comment on y survit, comment on y meurt d’ épuisement, de tristesse, comment les morts pèsent sur le présent, comment aussi la mythologie et les croyances des petits peuples de la région s’infiltrent dans l’espace post soviétique. Et comment on résiste. Tout cela est présent dans leur nouvelle création, Le bonheur, qui n’est plus une idée neuve dans ce bout du monde mais une vieille chandelle qui s’éteint tout le temps et qu’on essaie chaque jour de rallumer. Il n’y a pas une histoire, une intrigue dans les spectacles du KnAM mais un étourdissant patchwork de témoignages, et de scènes comme oniriques, des bouts de destin, d' images rescapées de l’enfance des habitants de Komsomolsk dont ceux des acteurs et des actrices du KnAM, les trois historiques et ceux qui les ont rejoint : Irina Tchernoussova, German Iakovenko et Ludmila Smirnova, tous né.e.s dans la région et y vivant. Dans Le bonheur, on parle de Gagarine (durable fierté) , de Poutine et de Navalny, les temps se mêlent, le passé hante toujours le présent en Russie. L’un de leurs spectacles précédents avait pour titre Je suis, les suivants auraient pu s’appeler « Nous sommes ». Le Bonheur, spectacle au titre à la fois paradoxal, ironique et frondeur, a été crée la semaine dernière au CDN de Besançon, important coproducteur (la troupe a pu bénéficier de trois semaines de répétition sur place) .il est à l’affiche du festival Sens Interdits où le KnAM a ses habitudes. Il y avait présenté en 2017 Nous ne sommes pas encore nés, spectacle qui constitue un puissant diptyque avec Le bonheur. Le credo du spectacle est semblable à celui de l’ Henry VI de Rauck : des corps et des mots d’abord. Pour cette petite troupe du bout du monde occidental, cela ne vas pas sans une ingéniosité sans pareille à faire merveille d’une bâche en plastique transparent (élément commun avec Henry VI), d’un seau de terre brune, d’une tasse ébréchée, de photographies de tués et de tueurs, d’une pluie d’étoiles qui ne sont pas rouges mais argentées et d’un double usage de la vidéo comme capteur de témoignages et comme agent poétique. Le KnAM est une des troupes qui a poussé le plus loin l’usage poétiques et la maîtrise technique des nouvelles caméras miniatures. Au fil des témoignages, le Faust de Goethe et celui de Gounod s’invitent à Komsomolsk sur Amour, des morts reviennent nous parler (« Aujourd’hui,, après ma mort, je veux déclare que je n’ai jamais été un traître, mais j’ai tout signé sous la torture »), plusieurs se souviennent de la fin de l’URSS en 1991 et aujourd’hui assistent, tristes et médusés, à son retour poutinesque Tous s’accrochent au théâtre comme à une bouée, espérant peut-être ou plutôt jouant à espérer qu’elle les fera dériver vers un monde meilleur. Pour eux le théâtre est un rempart, voire le seul, contre le désespoir et la barbarie. Le bonheur, c’est, par exemple, ce que dit Ira, la comédienne la plus âgée ::
« Je ne suis pas comédienne, mais je connais ces personnes depuis plus de 35 ans...
Je suis née moi aussi à Komsomolsk-sur-Amour, et comme tous les enfants de ma génération, j’ai
grandi avec l’obsession de la conquête spatiale... : il y avait des fusées comme ça à tous les coins
de rue et on jouait aux cosmonautes...
En regardant cette fusée aujourd’hui, je me dis qu’elle ressemble beaucoup aux barreaux d’une
prison, de cette prison qu’était notre ville, filiale du Goulag...
D’ailleurs, regardez, ce mirador ressemble lui aussi à une fusée...
C’est difficile de vivre dans une ville construite sur des os, dans un pays où l’humain est sacrifiable,
jetable...
Mais malgré cela, j’ai appris à être heureuse.
Je me demande toujours : « Qui suis-je ? Une femme ? Une mère ? Une artiste ? ».
Et je voudrais dire : « Je suis une rivière. Je suis l’eau »... Henri VI, le spectacle a été créé le 14 sept au Théâtre de l’Idéal à Tourcoing, il est donné au Théâtre éphémère de Nanterre Amandiers jusqu’au 24 oct : mer 19h30 premier épisode, second épisode le jeudi à 19h30, intégrales les ven à 18h, sam et dim à 15h. Chaque épisode 2H, intégrale 4h45 entractes compris. Le bonheur a été créé au CDN de Besançon (producteur délégué du spectacle) du 12 au 16 oct, le spectacle sera donné au Théâtre des Célestins à Lyon dans le cadre du festival Sens interdits du 23 au 30 octobre puis en tournée : les 3 et 4 nov Festival euro-scene Leipzig; le 9 nov, Théâtre de Choisy-le-Roi ; les 12 et 13 nov Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds ; du 18 au 20 nov La Manufacture ,CDN de Nancy ; les 25 et 26 nov Fabrique de Théâtre, Bastia ; le 30 nov, Théâtre des 4 saisons, Gradignan.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2021 11:43 AM
|
Publié par Sceneweb le 29 octobre 2021
Suite à la tribune de Jean-Pierre Baro publiée la semaine dernière, et après un premier droit de réponse de son avocate, la plaignante, qui n’avait jamais pris la parole a souhaité rompre le silence.
Me voilà aujourd’hui tenue de choisir entre continuer à rester en retrait de l’espace médiatique comme je m’y tiens depuis que j’ai déposé plainte contre monsieur Jean-Pierre Baro en 2018, ou prendre la parole publiquement, ce dont je me suis toujours abstenue malgré ses diverses prises de parole depuis lors.
Suite au récit offensant produit par monsieur Jean-Pierre Baro ces derniers jours sur le média Sceneweb, et repris ensuite par d’autres médias et par nombre de personnes du milieu du théâtre, récit entendant faire revenir la honte dans mon camp, je me vois dans l’obligation de prendre la parole.
Ceci afin de répondre à certains points précis de son récit mensonger, me mettant en scène à renfort de détails permettant non seulement de m’identifier, mais également d’accéder à la fameuse « version des faits tels qu’ils se sont déroulés » de monsieur Jean-Pierre Baro, sa parole outrageante ayant ainsi le loisir de s’étaler de manière publique, plus de trois ans après que j’ai saisi la justice et vu ma plainte classée sans suite, faute d’éléments permettant de suffisamment caractériser l’infraction.
Monsieur Baro aurait pu dire son innocence en rappelant le droit, puisqu’il est présumé innocent. Il avait le choix de le redire sans user d’un procédé visant à réaffirmer publiquement la puissance de sa parole écrasante contre celle à qui la justice demande des preuves qu’elle n’est jamais en mesure de fournir.
N’est-ce pas ce qui est exigé des présumées victimes, l’obligation de n’outrager personne par leur parole dans l’espace public sans avoir les preuves de ce qu’elles avancent ?
Les règles de l’état de droit s’imposent à tous et pas uniquement aux victimes présumées.
Ce plan de communication comporte plusieurs objectifs, et je ne répondrai ici qu’à celui qui vise à me nuire personnellement par des mensonges éhontés.
Les autres objectifs de ce plan de communication, intervenant dans le contexte de la programmation de monsieur Jean-Pierre Baro par le Théâtre national de la Colline et des réactions que cela a suscitées, ne me concernent pas. Qu’il soit clair ici que ma lettre ne vise en aucun cas à prendre position à ce sujet.
En 2018, j’ai déposé plainte, m’engageant dans un processus long et qui m’a énormément coûté, en temps, en énergie mentale et psychique, et financièrement.
Après que la plainte a été classée sans suite, un journaliste a relayé partiellement son contenu, aux côtés de deux autres témoignages – témoignages n’ayant fait l’objet d’aucune enquête à ce jour.
Monsieur Baro feint d’avoir oublié ces autres témoignages, s’autorisant, en réponse à l’article de ce journaliste, ce récit qui s’attelle à produire un discours qui vise à ne faire exister qu’un seul des témoignages en l’isolant, le mien. Le seul témoignage porté devant la justice, donc le seul au sujet duquel il puisse prétendre avoir été « innocenté » par « le Procureur de la République », ce qui est juridiquement faux.
En effet, sur le courrier du procureur de la République que j’ai reçu en 2019, il est écrit : « Ce classement ne signifie pas que vous n’avez été victime d’aucun fait, mais qu’en l’état les éléments recueillis ne permettent pas de justifier les poursuites pénales. Je vous informe que cette décision pourra être revue si de nouveaux éléments venaient à être rapportés »
Que monsieur Baro affirme avoir été innocenté est un mensonge. Mon avocate l’a signalé par droit de réponse au lendemain de la parution de ce récit, droit de réponse publié en préambule de son communiqué, sur Sceneweb.
Que j’ai été une collaboratrice de monsieur Baro et que nous ayons travaillé ensemble durant des années est un fait. Personne n’a jamais prétendu le contraire et je peux ici le réaffirmer. Répéter cela, comme pour se justifier, ne vient en rien attester que les faits que j’ai dénoncés n’ont pas existé ou qu’ils se sont déroulés tels que monsieur Baro le prétend.
Qu’il écrive qu’il n’y ait eu « aucune hiérarchie entre nous » et que monsieur Baro n’ait eu « aucun ascendant sur [moi], ni par [sa] position, ni par [sa] notoriété » au moment des faits que je dénonce est inexact.
Monsieur Baro était l’un des artistes portés par ce bureau de production, j’étais une assistante de production en Contrat à Durée Déterminée. Il n’est pas besoin d’étayer mes propos d’études sociologiques pour avancer qu’un metteur en scène, artiste, ayant déjà mis en scène des spectacles, occupe dans l’échiquier socio-professionnel une place supérieure à une assistante de production sortie d’étude et en premier poste.
On précisera que la relation de monsieur Baro avec les co-directeurs qui m’avaient recrutée était nettement antécédente à celle que j’avais avec eux. Sa compagnie était cliente et partenaire de ce bureau, tandis que j’en étais salariée en CDD depuis moins d’un an.
Monsieur Baro insinue que j’aurais décidé de ne pas candidater au TQI à ses côtés parce « qu’entre temps [j’]étais devenue directrice » du bureau de production. C’est faux puisque je l’étais déjà depuis 3 ans, à savoir depuis 2015.
Cette décision de ne pas candidater est justement en lien avec les faits que j’ai dénoncés, et visait à me protéger.
Aujourd’hui, je pourrais me tourner vers la justice à nouveau, me constituant partie civile, afin de demander qu’un juge d’instruction soit saisi des faits pour lesquels j’ai déposé plainte.
Ce faisant, je m’engagerais -onze ans après les faits que je dénonce, trois ans après m’être adressée à la justice comme je le devais, sans obtenir que ces faits soient jugés dans un second parcours du combattant (de la combattante, devrais-je dire), à nouveau coûteux en énergie, en force mentale, psychique, en temps de vie, et enfin en frais de justice que je n’ai pas à ma disposition.
Malgré tout ce que je lis, je n’ai jamais regretté d’être entrée dans ce commissariat ce jour là. Parler m’a libérée. Croire en la justice -aussi perfectible soit-elle- et lui faire confiance, aussi. Lorsque l’agent qui a pris ma déposition m’a raccompagnée vers la sortie, il m’a dit « en tous cas, quoi qu’il advienne maintenant, vous pourrez vous regarder dans une glace le matin et vous dire que vous avez fait ce que vous aviez à
faire ».
En tout état de cause, et quelque soit la suite donnée à cette dénonciation, je devais prendre la parole aujourd’hui.
Il importait d’indiquer au lectorat de la tribune de monsieur Baro que ce plan de communication est façonné d’inexactitudes tant sur un point de droit fondamental que sur de nombreux points qui ficellent son récit.
Il était essentiel que soit clarifié qu’un classement sans suite n’est rien d’autre que l’impossibilité pour la justice à ce jour de tenir compte d’une parole qui ne peut se démontrer.
C’est une injure d’affirmer qu’il en est autrement, et il est indécent de se prévaloir d’un innocentement juridique inexistant.
Tout cela en réclamant que les autres n’agissent que dans le cadre de la loi, sans en respecter soi-même les bases.
Que la justice ne soit pas en mesure de tenir compte de ma parole est une chose, que monsieur Jean-Pierre Baro en profite pour raconter n’importe quoi à mon sujet en est une autre, et ce n’est pas tolérable. Pas dans un état de droit.
Le présent communiqué vise uniquement à répondre à cette inversion des positions qui devient insoutenable pour moi qui demeure depuis 3 ans dans le plus strict silence.
La plaignante, en réponse au communiqué de monsieur Jean-Pierre Baro, le 27 octobre 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2021 3:40 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 28-10- 2021 Les acteurs du secteur entendent alerter sur leurs difficultés de plus en plus grandes rencontrées depuis le début de la pandémie. Une lettre ouverte signée par des personnalités politiques, maires et députés, a été envoyée à Roselyne Bachelot. Les arts de la rue sont dans le rouge. Alors que le spectacle vivant reprend peu à peu des couleurs avec une foule de productions rentrées parfois au chausse-pied dans les programmations des théâtres, ce secteur reste en rade. Sur une initiative de Pierre Mathonier, maire (PS) d’Aurillac, ville emblématique pour son festival international de théâtre de rue créé en 1986, annulé en août 2020, puis en 2021, une lettre ouverte signée par une soixantaine de personnalités politiques, maires et députés, a été envoyée le 23 septembre à la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Elle entend alerter sur les difficultés de plus en plus grandes rencontrées par les artistes, qui contrairement aux autres, n’ont pas repris le chemin du travail comme ils l’espéraient cet été, la haute saison pour eux. En lien avec les treize Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public (Cnarep), lieux de création et de diffusion apparus il y a une dizaine d’années sur tout le territoire, cette lettre décline les multiples raisons qui ont mis progressivement les troupes des arts de la rue, au nombre de 1 000 avant la pandémie, sur la touche. Depuis mars 2020, les réglementations dans l’espace public, déjà complexes en raison des mesures Vigipirate apparues suite aux attentats de 2015, se sont ainsi durcies par le biais des interdictions et des mises en places de jauges. Cela a touché certains formats comme les déambulations et les grosses productions rassemblant une foule de centaines, voire de milliers de personnes. « Il faut rappeler que la question du plateau se pose très différemment pour les artistes de rue et c’est ce qui fait leur singularité, souligne Mathieu Maisonneuve, directeur de l’Usine, Cnarep à Toulouse. Il n’est pas question de poser une estrade dehors en reconfigurant une salle de théâtre en extérieur. Cela a été le cas depuis six mois avec une majorité de propositions enfermées dans les cours des immeubles, les parkings et les parcs. La force des arts de la rue est d’imaginer de nouvelles relations aux gens en s’appropriant autrement et librement les rues et l’espace public. » Parallèlement, l’obligation du passe sanitaire, qui « touche très fortement la profession et la diffusion des spectacles », a aussi entraîné l’annulation de nombreux rendez-vous, dont cette plaque tournante qu’est Aurillac. « Cela fait trente-cinq ans que la ville s’ouvre au mois d’août pour les artistes, le plus souvent intermittents, en accueillant quelque six cents compagnies qui remplissent ici leurs carnets de diffusion, commente Pierre Mathonier. Ils n’ont pas pu le faire depuis deux ans et se trouvent donc très fragilisés. Certains ne pourront pas présenter leurs créations avant l’été 2022 et nombreux sont ceux qui ne tiendront pas jusque-là. » Diversité des réglementations Il est par ailleurs rappelé la diversité des réglementations et de leurs applications par les préfectures. « L’interprétation différenciée des textes réglementaires, qui peuvent d’ailleurs sembler très disparates selon les départements, a créé une grande confusion et une réelle iniquité territoriale pour ceux qui œuvrent dans l’espace public. » Les acteurs de ce secteur demandent donc la création « d’une instance nationale composée de représentants des arts de la rue et des ministères de la culture et de l’intérieur, mais aussi d’experts indépendants » pour étudier en concertation les conditions du maintien des manifestations. Parallèlement, de nouveaux moyens financiers pour repenser les formats des œuvres ont été demandés. Pierre Mathonier souligne également combien la précarisation du secteur bouleverse des enjeux fondamentaux, dont celui de l’art offert au plus grand nombre et gratuitement dans l’espace public, périurbain et en milieu rural. « Les arts de la rue participent profondément à la vie culturelle, économique et sociale de nombre de villes, insiste-t-il. Il est indispensable que puisse se concrétiser un soutien politique et d’urgence de l’Etat. » Un rendez-vous avec la Direction générale de la création artistique et le cabinet de la ministre est évoqué. Rosita Boisseau Légende photo : La compagnie des « Frères Troubouch » en représentation lors du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac, en août 2018. THIERRY ZOCCOLAN / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2021 10:36 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 27 octobre 2021 La comédienne est « géniale » dans la pièce de Jean-Luc Lagarce « Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne ». « Elle est géniale ! », s’exclament ceux qui ont vu Catherine Hiegel jouer Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, de Jean-Luc Lagarce (1957-1995). Et c’est vrai. L’adjectif « génial », souvent employé à la va-vite, prend ici le sens qu’en donne le Larousse : « qui fait l’admiration de tous ». Personne ne conteste le talent de Catherine Hiegel, que Patrice Chéreau considérait comme une des plus grandes comédiennes – il l’a dirigée dans Quai ouest, de Bernard-Marie Koltès, à Nanterre, en 1986, quand elle appartenait encore à la troupe de la Comédie-Française, qu’elle a quittée en 2009. Depuis, Catherine Hiegel joue dans le théâtre public ou le théâtre privé, sans faire de hiérarchie, et la voilà cet automne dans la salle du Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris. Lire aussi : Catherine Hiegel, « L’immense vague réactionnaire me fait peur » Elle interprète seule un texte qui est un régal de drôlerie et de vacherie. Jean-Luc Lagarce l’a écrit en 1992, à la suite d’une commande du Théâtre Granit, à Belfort, qui cherchait des pièces à jouer dans des appartements. L’auteur s’est souvenu d’un manuel qu’il avait eu entre les mains, des années plus tôt : Usages du monde - Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, de la baronne Staffe (1843-1911), qui n’était ni baronne, ni Staffe. Elle s’appelait Blanche Soyer, venait d’une famille de la bourgeoisie militaire des Ardennes, et vivait, célibataire, à Savigny-sur-Orge (Essonne). Comme la baronne Nadine de Rothschild, qui a publié en 1991 Le Bonheur de séduire, l’art de réussir. Le savoir-vivre du XXIe siècle (Robert Laffont), la baronne aimait donner des conseils, et le public aimait lire ses livres, en tout cas les acheter, quitte à les oublier ensuite dans des bibliothèques où ils seraient retrouvés un jour par hasard, et feraient le bonheur d’un lecteur comme Jean-Luc Lagarce. Ce que la baronne Staffe ignorait, c’est l’usage que l’auteur ferait de son manuel. Un usage un peu pervers, certes, mais délicieux pour le lecteur ou le spectateur d’aujourd’hui. Jean-Luc Lagarce a taillé dans le vif des Règles du savoir-vivre dans la société moderne, en ne retenant que les étapes essentielles : naître, se marier, mourir. Pour réussir les trois, c’est simple : il suffit de se plier à deux principes. Un : l’existence se réduit au respect de règles strictement définies. Deux : les femmes trouvent leur bonheur dans la sujétion aux hommes. Si la baronne ne plaisante pas, Jean-Luc Lagarce rit sous cape. Il prend ses aises, accommode le texte à son style et à son esprit : il répète certains passages à l’envi, il en coupe d’autres jusqu’à l’absurde, et introduit des incises où éclate son ironie, souvent mordante. Sans état d’âme L’unique personnage de la pièce s’appelle La Dame. Mireille Herbstmeyer fut la première à la jouer. Elle créa Les Règles du savoir-vivre… en novembre 1994, sous la direction de Jean-Luc Lagarce, qui s’étonna, dans son journal (publié par Les Solitaires intempestifs), du triomphe, le soir de la première. Les auteurs ne sont pas toujours les mieux placés pour mesurer l’impact de leurs pièces, et Jean-Luc Lagarce ne savait pas qu’il léguait une pépite aux générations à venir. Au Petit Saint-Martin, Catherine Hiegel est dirigée par Marcial Di Fonzo Bo, le directeur de la Comédie de Caen, qui mise avec justesse sur la sobriété : trois longues tables à roulettes, que la comédienne pousse sur le devant du plateau, selon les chapitres du manuel. Catherine Hiegel traite la mort comme elle le ferait d’une question ménagère Catherine Hiegel porte un pantalon et une tunique noirs avec un grand col blanc. Elle apparaît ainsi moins Dame que gouvernante, dans la tradition de celles qui terrorisaient les élèves des pensionnats pour jeunes filles de bonne famille. Dès les premiers mots, elle attaque, en regardant le public droit dans les yeux : « Si l’enfant naît mort, est né mort, il faut quand même, tout de même, déclarer sa naissance… » L’effet est immédiat, la salle éclate de rire, à cause du ton de Catherine Hiegel : elle traite la mort comme elle le ferait d’une question ménagère. Et la mort tient sa place dans la pièce de Jean-Luc Lagarce : elle accompagne toutes les circonstances pointées dans Les Règles du savoir-vivre…, et revient sous la forme, hilarante à force de répétition formaliste, de « mort toujours possible, envisageable ». La Dame est sans état d’âme, et Catherine Hiegel excelle dans ce registre. Jusque dans ses rires, qui ressemblent à des claques. Jusqu’à la cruauté, qu’elle dépèce. Aidée de gros manuels, qu’elle ouvre selon les chapitres – celui du mariage est fermé par un tulle blanc –, elle donne ses ordres comme un général. Il faut l’entendre commenter la signification des prénoms ou la signature d’un contrat de mariage. Il faut la voir mimer la surprise feinte de l’annonce de fiançailles ou l’amour courbatu de noces d’or. Il faut aller la voir, tout simplement : Catherine Hiegel est « géniale » ! Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, de Jean-Luc Lagarce. Avec Catherine Hiegel. Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo. Théâtre du Petit Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, Paris 10e. Tél. : 01-42-08-00-32. Jusqu’au 31 décembre, à 19 heures ou à 21 heures. 27 €. Le texte est publié par Les Solitaires intempestifs (59 p., 7,50 €). Brigitte Salino

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 2:13 PM
|
Une tribune de Sabine Prokhoris publiée dans Marianne 23/10/21 Le refus de Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline, de déprogrammer Bertrand Cantat et Jean-Pierre Baro a créé une polémique dans certains milieux féministes. Sabine Prokhoris, philosophe, psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages, dont le récent « Le Mirage #MeToo » (Le Cherche midi), explique pourquoi il a raison de ne pas céder. Sous l’étendard de #MeToo théâtre, dernier avatar du mouvement planétaire né il y a quatre ans dans le sillage de l’affaire Weinstein, les attaques bruyantes et les pressions venues de tout bord se multiplient à l’encontre de l’auteur/metteur en scène et actuel directeur du Théâtre de la Colline Wajid Mouawad – y compris de la part de la ministre de la Culture, qui a cru bon sur France Inter d’exprimer sa réprobation. Le péché de Wajid Mouawad ? Il est double : avoir proposé à Bertrand Cantat, qui a purgé la peine de prison à laquelle il a été condamné pour le meurtre de Marie Trintignant (sous la qualification de violences ayant entraîné la mort), d’écrire la musique de sa prochaine pièce ; programmer une création du metteur en scène Jean-Pierre Baro, objet en 2019 d’une plainte pour viol, classée sans suite au terme d’une procédure judiciaire régulière qui l’a innocenté. DICTATURE DE #METOO De la façon la plus ferme Wajid Mouawad, refusant de se laisser intimider, a fait savoir qu’il ne céderait pas à ces injonctions de censure, qui en rappellent d’autres, comme celles qui visèrent il y a quelques années Kanata, la pièce de Robert Lepage programmée par Ariane Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil, et Les Suppliantes d’Eschyle mises en scène par Philippe Brunet. « Appropriation culturelle » scandaleuse avaient vociféré les activistes – docilement obéis par la quasi-totalité des producteurs de Kanata qui se retirèrent du projet. « Racisme » au motif d’un supposé « blackface » des acteurs pour Les Suppliantes, dont la représentation eut finalement lieu – sous protection policière – quelques mois après avoir été empêchée par la force. Cette fois, c’est la redoutable dictature de #MeToo, sûre de sa légitimité absolue confortée par nombre de commentateurs – et, plus inquiétant, par la démission intellectuelle et politique des institutions et des plus hautes autorités de l’État –, qui veut s’exercer. Et au nom du hashtag désormais sacré, voici que renaissent, sans aucun frein, les chasses aux sorcières anciennes, ou plus récentes (maccarthysme, épurations politiques en régimes non démocratiques). « C’est l’homme de théâtre qui donne ici à tous une impeccable leçon de droit » Dans un communiqué aux termes soigneusement pesés, Wajid Mouawad indique notamment ceci : « Si j'adhère sans réserve aux combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes et à celui contre les violences et le harcèlement sexuel, je ne peux en aucun cas appuyer ni partager le sacrifice que certains font, aux dépens de la justice, de notre État de droit. » C’est l’homme de théâtre qui donne ici à tous une impeccable leçon de droit : la juste cause des violences faites aux femmes ne saurait justifier qu’un activisme militant dopé par les réseaux (a)sociaux impose ses diktats délétères à l’État de droit, selon des méthodes justicières dignes des procès d’Inquisition. Bertrand Cantat a payé sa dette à la société, qui l’a jugé selon les règles de la procédure pénale. Il est quitte. Sauf à envisager la peine comme une vengeance éternelle que nulle expiation ne saurait jamais assouvir – « Ni oubli, ni pardon » proclame un slogan du collectif Les Colleuses – il a le droit d’exercer son métier. Jean-Pierre Baro a été reconnu innocent par la justice. Pour autant, sous la pression des personnels du Théâtre des quartiers d’Ivry qu’il dirigeait, et des associations militantes, il s’est trouvé contraint à la démission, sans pouvoir compter sur le moindre soutien du ministère de la Culture. Aujourd’hui, les équipes de la Colline indignées ne veulent pas avoir à le croiser, non plus que Bertrand Cantat. DÉFENDRE L'ÉTAT DE DROIT Les propos de Wajid Mouawad, d’une parfaite clarté, viennent faire pièce à la confusion et à la violence croissantes entretenues par la communion fanatique dans la religion #MeToo. Car non, une accusation ne vaut pas preuve. Non, des dénonciations en foule sous influence de slogans simplistes ivres de pseudo-concepts – « culture du viol », « emprise », « oppression systémique »,… –, ne sont pas des « révélations », jusqu’à ce que la justice ait établi les faits, selon les règles de la procédure pénale. Non, la présomption d’innocence n’est pas une insulte faite aux plaignantes. Non, la condamnation à la mort sociale à l’égard d'un coupable ayant accompli sa peine, marque d’infamie imprimée au fer rouge qui s’abat aussi sur quiconque aura été décrété « porc », ne saurait faire partie des sanctions prévues dans l’arsenal juridique d’une nation civilisée. Ces rappels salutaires, que l’on aurait aimé entendre dans la bouche de Madame Bachelot, ont cependant suscité d’étranges commentaires. Nous en retiendrons ici quelques-uns, emblématiques. « Ces remontrances au nom du Bien et de la Cause des victimes appellent quelques remarques » Wajdi Mouawad, accusé de « créer la controverse », ou encore de « balancer du kérosène dans la grande vague de contestation #MeToo théâtre », en choisissant des « invités infréquentables » (sic), « brandit comme un manifeste » les principes de l’État de droit, a-t-on pu lire. D’autre part, il lui a été reproché de n’avoir pas cherché à pondérer ces principes (assurément contraignants, et aux yeux des activistes expression d’un droit « patriarcal ») par un « positionnement moral » qui aurait dû le conduire à davantage de « retenue ». Ces remontrances au nom du Bien et de la Cause des victimes – reconnues ou autoproclamées, c’est tout un pour #MeToo – appellent quelques remarques. En premier lieu, ceci : qui « crée la controverse » ? Wajid Mouawad ? Ou les activistes et groupes de pression de #Metoo théâtre, au mépris de l’État de droit et, au passage, de la liberté de création ? « Que les principes de l’État de droit se voient ainsi ravalés au rang d’outils de propagande, voilà la distorsion » D’autre part, peut-on sérieusement écrire que rappeler les principes fondamentaux de l’État de droit équivaut à les « brandir comme un manifeste » ? Ces principes vaudraient-ils donc en l’occurrence comme de simples slogans ? Nous nous trouvons là face à deux des fonctionnements caractéristiques du mouvement : l’inversion, et la distorsion. Que les principes de l’État de droit, garantissant l’égalité de tous devant la justice, se voient ainsi ravalés au rang d’outils de propagande – une énormité tranquillement assenée –, voilà la distorsion. L’inversion ensuite : selon cette logique parfaitement perverse, le fautif, c’est Wajdi Mouawad, au motif qu’il entend respecter le droit, et le fait savoir. Le monde à l’envers, mais telle est la nouvelle normalité à l’ère de MeToo. Enfin, on observera que ces indignations destructrices du contrat démocratique opèrent en jouant la morale contre le droit. Là encore un des leitmotive du discours de MeToo, destiné à assurer son hégémonie incontestable : ainsi la philosophe Manon Garcia soutient-elle que certes il y a une définition pénale du viol, mais qu’il faut y ajouter une « définition morale » (plus « vraie » sans doute). À quand un ministère de la Promotion de la Vertu de Prévention du Vice, où pourraient harmonieusement fusionner le ministère de la Culture et celui de la Justice, sous la férule de #MeToo ? Relisons, en guise d’antidote contre l'aveugle tentation de jours si sombres, La (trop actuelle) Lettre écarlate, de Nathaniel Hawthorne. -------------------------------------------------------- Le point de vue de Gérard Watkins (auteur, metteur en scène, acteur) Vu ce que j’ai lu hier soir sur le portail du Théâtre de la Colline, je voudrais ici juste réaffirmer mon soutien total à #metoothéâtre, et répondre ainsi à l’injonction de non seulement soutenir, mais aussi faire de la voix. Ce que je n’ai pas trop l’habitude de faire. C’est une chose de rappeler à l’ordre une idée de la Justice, et son importance, (sans rappeler au passage une inefficacité historique dans ce domaine), c’en est une autre d’humilier celles qui donnent de la voix, et les victimes qui dénoncent ce qu’elles ont subi, rassemblées ici en un mouvement. Je trouve insoutenable de lire cet amalgame entre le “catholicisme rance” et des femmes qui ont le courage de dénoncer ce qu’elles ont subies comme violences. Insoutenable cette dramaturgie qui les lie à l’inquisition (Elles n’ont physiquement torturé personne, elles) Et au lynchage (Elles n’ont jamais sorti de couteaux, elles) #metoothéâtre est là pour mettre un terme aux violences. Quelles qu’elles soient. Il y a autant de formes de violences dans le théâtre que dans les violences conjugales. Violences sexuelles, psychologiques, physiques, économiques, administratives. Auxquelles on pourrait rajouter artistiques, dramaturgiques, etc… Une longue liste. Ce qu’il y a de formidablement positif dans tout ce que j’ai pu lire, dans les textes-soutiens du mouvement, c’est cette volonté de mettre une fin à tout ça, et tout ce qui en découle. Jusqu’au harcèlement moral que peuvent aussi subir des hommes, les rapports de pouvoir qui n’ont pas lieu d’être. Tout ça. Violence comme antichambre de l’injustice. Leur apport, et ce que cela va entrainer, est un bienfait. Une bénédiction. Exprimer un regret de non-dialogue par une insulte est pour le moins curieux, et destiné à la clash-culture, et laisser libre cours au « Backlash » comme j’ai pu lire en lire sur les réseaux. Un déferlement « d’empathie pour le bourreau », qui est un phénomène en soi, une forme de mécanisme de déni à l’œuvre, que j’ai pas mal rencontré dans mes recherches sur les violences conjugales (Un directeur de théâtre sur trois à qui je parlais du projet en 2015 me disait « mais les femmes aussi frappent les hommes ») Clash-culture donc. Pour infos je ne participe pas au débat sur Facebook. Ni à la clash culture. Je ne répondrais pas aux commentaires. J’écris ces mots dans l’espoir d’un contre poison. Mettre un terme au backlash et son apparente fatalité. Pour reprendre cette merveilleuse réplique que j’ai entendu dans le fabuleux 7 minutes de Stephano Massini mis en scène par Maëlle Poésy, dans la bouche de l’hallucinante Véronique Vella, « Est-ce qu’on peut me dire pourquoi, dans ce putain de bordel de monde, à chaque fois qu’il y a quelqu’un qui s’oppose, on dit qu’c’est lui qui a un problème ? » ( remerciements à Véronique au passage pour la citation exacte.) Et je trouve enfin délirant de lire ces mots de fin « Dommage » Pour reprendre la parole de Sarah Kane quand on la traitait de « sick », elle avait répondu « Sick ? Who are you calling sick ? » Là on pourrait dire « Dommage ? Mais qu’est-ce que tu appelles « Dommage ? » » Publié par Gérard Watkins sur Facebook, 20 octobre 2021

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 12:02 PM
|
Par Nathalie Simon dans Le Figaro - 25 oct. 2021 Photo : Marilyne Canto Celine Nieszawer/Leextra via Leemage PORTRAIT - Héroïne d’«Alex Hugo», la comédienne enchaîne les séries, comme «H24» et «L’Île aux 30 Cercueils», et sera très présente au cinéma en 2022. Le beau visage et le regard pétillant de Marilyne Canto sont connus, son nom moins. Même si on l’arrête parfois depuis qu’elle joue la commissaire Dorval dans Alex Hugo, la série à succès de France 3. Depuis quatre ans, elle est la seule femme à diriger «quatre hommes» au cours des enquêtes. Une policière déterminée, exigeante, honnête, mais aussi «sensible», à l’instar de son interprète brune. «J’adore les scènes où on se dispute, je la trouve excellente! s’enthousiasme Samuel Le Bihan, qui tient le rôle-titre. Elle est ma supérieure, je suis un électron libre, mais on poursuit un objectif commun: arrêter les méchants. Marilyne est très joueuse et blagueuse, à l’écoute. On est en connexion, c’est pour cela que je fais ce métier.» Devant et derrière la caméra L’intéressée pourrait affirmer la même chose. En janvier, elle sera l’ex- petite amie de Bernard Campan dans Presque, le film que l’acteur a réalisé avec Alexandre Jollien. «Il fallait quelqu’un de poids qui accepte de jouer juste deux scènes, explique l’ancien membre des Inconnus. On a comme une ressemblance frère et sœur, tout est simple avec Marilyne, elle est ouverte et aime l’esprit de groupe. Pour elle, le film passe avant son intérêt personnel, c’est une personne humaine et humble.» «J’ai toujours été bien traitée, je fais du mieux que je peux!», confie sa sœur de cinéma en souriant. Cette passionnée pleine d’énergie défend des projets qui lui tiennent à cœur. Le public lui doit d’ailleurs des courts-métrages tel Fais de beaux rêves récompensé par un César (2005). Et un premier «long», Le Sens de l’humour, portrait d’une mère, elle-même, confrontée à la perte d’un être cher, tourné avec son mari Antoine Chappey (2013). Prochainement, elle sera une aide à domicile dans la série L’Île aux 30 cercueils d’après l’œuvre de Maurice Leblanc sur France 2. L’histoire très écrite et la distribution -Virginie Ledoyen et Martine Chevallier-, l’ont séduite. Grande admiratrice de Michel Piccoli - «il parlait plus des films que de ses rôles» -, Marilyne Canto intervient régulièrement à la Femis, à la CinéFabrique de Lyon et au Conservatoire de Paris dans le cadre d’ateliers sur la direction d’acteur. Ce métier a quelque chose de joyeux, de la vie, il est enrichissant. Marilyne Canto Devant ou derrière la caméra, elle aime le travail bien fait et l’accomplit avec sérieux, sans se prendre au sérieux. «Ce métier a quelque chose de joyeux, de la vie, il est enrichissant. Je passe de la montagne, pour Alex Hugo, à la Palestine», lance-t-elle enjouée. Pour Arte, elle a en effet réalisé Faire la paix, un documentaire avec Ofer Bronchtein, le président du Forum international pour la paix au Proche-Orient (en accès libre sur la chaîne). «On parle plus de la guerre que des ONG et de leur mission pacifique», observe la réalisatrice engagée à sa façon. Les larmes lui viennent aux yeux quand elle évoque H24, une série de courts-métrages écrits, réalisés et joués par des femmes sur les violences qui leur sont faites (sur Arte le 23 octobre). «Il y a encore beaucoup à faire, on témoigne, mais cela nous ramène à notre impuissance», souffle-t-elle. Déjà enfant, Marilyne Canto éprouve le besoin de s’exprimer. «Je voulais d’abord être danseuse, précise-t-elle, je séchais l’école pour aller au cinéma, j’avais déjà envie de scène, la réalité me semblait plus intéressante que la fiction.» Ses parents, une mère commerçante esthète et un père dans le transport, n’étaient «ni pour, mais ni contre» le fait que leur fille emprunte la voie théâtrale. «Passe ton bac d’abord», lui conseillent-ils néanmoins. «J’ai eu la chance qu’ils me laissent libre de choisir. Ils ont vite compris qu’il y avait une nécessité, je me faisais remarquer par mes rires, je prenais un peu trop de place…», se souvient l’actrice. Qui s’illustrera d’abord dans le célèbre Hôtel de la plage, de Michel Lang (1978). Elle s’aperçoit qu’elle n’a pas trop de mal à jouer dès qu’elle entend «Moteur!». Enchaîne les films et les téléfilms, le théâtre aussi. Jouer les commissaires comme les juges Marilyne Canto a un don. Elle réussit la classe libre du cours Florent du premier coup. Échoue au concours d’entrée du Conservatoire (où elle enseigne aujourd’hui), mais intègre le TNS, le Théâtre national de Strasbourg. «Au théâtre, on apprend à travailler, il y a tout un processus de création, on parle un peu plus fort qu’au cinéma, on a plus le trac.» Cette mère de deux garçons joue Silvia dans La Double Inconstance de Marivaux, sous la direction de Jacques Lassalle. «J’ai souvent eu des rôles de femmes changeantes, travesties, insolentes», s’amuse-t-elle. Animée d’une curiosité pour le monde qui l’entoure, la comédienne n’arrête pas. Elle aime «chercher», suivre ses envies et faire confiance à des metteurs en scène divers. Ramzi Ben Sliman et Valeria Bruni Tedeschi ont pensé à sa douce détermination pour leurs prochains films. À son tour, Marilyne Canto sera bientôt une «guest» dans Petits meurtres entre amis. Et, cette fois, c’est elle qui est suspectée de meurtre. En 2022, l’actrice sera incontournable. Comme dans L’Ivresse du pouvoir de Claude Chabrol, elle endossera le rôle d’une juge aux côtés de Roschdy Zem pour le long-métrage de Thierry de Peretti, Enquête sur un scandale d’État (sortie le 9 février). «Comme pour la commissaire d’Alex Hugo, les metteurs en scène doivent se dire: “Celle-là, avec son mètre soixante, elle est capable de faire preuve d’autorité!”», plaisante-t-elle.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 9:47 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 25 octobre 2021 La Libanaise Chrystèle Khodr met en scène et en mots la mémoire de deux actrices de son pays, Hanane Ajj Ali et Randa Asmara. Jouant ensemble pour la première fois, elles racontent le Liban par le prisme de leur métier Elles arrivent vers nous du fond du plateau et prennent place près des premiers rangs de spectateurs chacune sur sa chaise, plus trad , elles se lèveront. Elles vont nous parler de quoi ? De théâtre. Ce sont deux actrices. L’une porte un ensemble veste-pantalon serré y compris les cheveux retenus par un bandeau qui met en évidence la souplesse et la vélocité de son corps très expressif. L’autre porte des vêtements plus amples et plus vaporeux qui masquent le corps mais porte notre attention sur son ample chevelure, et son visage. Tous les Libanais les connaissent au moins de nom. Ceux qui allaient au théâtre à Beyrouth dans dans les années 70 ont engrangé bien des souvenirs en leur compagnie. Venant de deux pôles du théâtre opposées ou presque, elles n’ont jamais joué ensemble, voici réunis sur scène pour la première fois, Hanane Hajj Ali et Randa Asmar.
Cette idée aussi simple que belle – réunir ensemble deux actrices que tout ou presque a séparé - on la doit à leur cadette Chrystèle Khodr. Née en 1983, elle vit et travaille à Beyrouth et entretient des relations suivies avec le festival Sens interdits à Lyon et son directeur,, Patrick Penot. Ce n’est pas la première fois qu’elle est invité à montrer son travail au festival. Je me souviens en 2017 y avoir vu le passionnant Titre provisoire, déjà le fruit d’une rencontre (lire ici). Dans un pays et une capitale, largement endommagés par la guerre, les attentats, l‘explosion du port de Beyrouth, une pratique du pouvoir délictueuse pour ne pas de dire mafieuse, une monnaie en chute libre, le théâtre a un rôle à jouer. Ne serait-ce que celui d’exister, de ne pas baisser les bras, de faire à tout le moins acte de présence, ce qui est déjà un acte de résistance. Dans Augures, les deux actrices reviennent sur leur passé, s’échangent des souvenirs sans nostalgie, même quand elles égrènent les noms des théâtres disparus ces trente dernières années au Liban, reconvertis en commerces ou durablement fermés, elles le font comme le reste, en jouant, en s’amusant à jouer, le pathos n’est pas leur fort, elles se font aimables passeuses de mémoire, Alors, à travers le corps sautillant de son épouse Hanane Hajj Ali , revient la figure de Roger Assaf, souvent venu en France dans les années 70 et 80 avec sa troupe Al-Hakawati (conteur en arabe) , figure d’un théâtre militant, pro-palestinien.. Aujourd’hui, Assaf ne signe plus de grands spectacles mais reste sur la brèche, un incurable activiste. Il a même ouvert un blog sur Mediapart où il n’a écrit qu’un article en mai dernier s’adressant à « Chère dame », à savoir « la sainte la République laïque française » pour lui lui adresser quelques saillants reproches quant aux position de la Dame vis-à-vis des Palestiniens. Figure d’une génération plus jeune et non moins active, Chrystèle Khodr a longuement interrogé les deux actrices, bien plus âgées qu’elle, avant de leur écrire une partition sur mesure et surtout de les réunir, jetant un pont entre elles et elle, et œuvrant à leur naissante complicité, le temps d’un spectacle, Augures, a été créé à Beyrouth en mai 2021, après la crise du Covid 19. Au Festival Sens interdits, le spectacle a été joué deux fois au Théâtre de la Croix Rousse. Le même soir on pouvait voir le spectacle grec C’était un samedi (lire ici) , le lendemain un spectacle russe, Le bonheur (lire ici) ainsi qu’ un spectacle venu du Kosovo En cinq saisons, un ennemi du peuple (lire ici). Il était triste, que ces artistes venus de partout et souvent ne se connaissant pas, n’aient pas pu se croiser jusque tard le soir sous la tente blanche (lieu d’exposition, de conversation, d’exposition, bar d’un côté, librairie de l’autre) dressée les dernières éditions sur place, devant le théâtre des Célestins .Ce n’est pas le cas cette année. Je vous laisse deviner pourquoi. Tournée: Théâtre La Vignette, dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée initiée par le Théâtre des 13 Vents à Montpellier le 12 nov; Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine le 14 nov; Friche la Belle de Mai – En partenariat avec Les Bancs Publics – Marseille le 16 nov; La Comédie de Reims les 27 et 28 janv; NTGent – Gand (BE) les 3 et 4 fév.
Photo : Scène de "Augures" © Chrystèle Khodr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2021 5:14 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 22 octobre 2021 Avec ce « Cabaret de l’exil », l’âme du Théâtre équestre Zingaro semble renouer avec ses premiers grands spectacles des années 80. Mais le rire macabre se teinte d’une véritable angoisse, au fil d’un époustouflant spectacle. C’est un maître. Un maître écuyer, mais un maître en pensée, un shaman. Bartabas a toujours été à la rencontre de ceux qui savent les secrets du monde, du Tibet au Golgotha, de l’Inde du sud au Mexique, de l’Afrique du Nord aux steppes du Nord. Il a lu. Beaucoup lu. Il a accumulé un savoir profond. Il n’en fait jamais étalage. Il a côtoyé des êtres tournés vers les mystères de l’homme, du monde, de la nature. Il a vu des paysages, il connaît les vibrations du monde. Et tous les chevaux de la terre. Bartabas est un athlète, un cavalier exceptionnel. Un être tramé de spiritualité. On en a profondément conscience en découvrant ce Cabaret de l’exil. Il renoue avec la troupe après les Entretiens silencieux et Ex Anima. Il renoue avec le « cabaret », lui qui ne voulait plus que sa troupe d’hommes, de femmes et de chevaux se nomme ainsi, mais prenne le nom de « théâtre ». Il revient apparemment en arrière, mais sans faire volte-face. Il avance. Il est devant. Et tellement devant nous qu’on a le sentiment, malgré le rire, les images sublimes, l’imagination colorée, que Bartabas voit quelque chose de très sombre à l’horizon de nos vies On avait deviné, en découvrant les affiches dans les couloirs du métro, un grand lustre, un corbillard et des serviteurs bien stylés et chenus, qu’il serait question de naguère. Ce corbillard, conduit par un beau cheval, transporte des bouteilles aux armes de Zingaro (le fameux sagittaire musicien). Des bouteilles de vin chaud que les privilégiés de l’espace à petites tables pourront déguster avec les biscuits à la cuiller, vieille tradition de la maison, elle aussi. Lorsque l’on pénètre sous la belle charpente, après être passé par une partie des écuries, un troupeau d’oies nous attend et patiente auprès d’une forge à soufflet. Deux hommes dont l’un frappe un fer…A la fin, les cloches, à toute volée, marqueront les adieux à un monde singulier. Photo d’Alfons Alt. Tout se ressemble, mais rien n’est semblable. Il y a des apparitions qui rappellent d’anciens morceaux : les cavaliers portant des oiseaux qui déploient leurs ailes larges, la mariée et son fiancée, les envols, les galops enivrants, les acrobaties magistrales, une grande mule et un petit âne, des scènes cocasses, des images très mélancoliques. Une dizaine de cavaliers virtuoses, étourdissants, admirables. Pas de sarcasmes, ici, mais par-delà le rire, quelque chose de triste qui dit le présent, les menaces de guerre au loin. La couleur musicale induit la nostalgie, jusqu’au chagrin : un orchestre de musique Klezmer, avec instrumentistes et chanteuse très doués, très investis, des textes d’Isaac Bashevis Singer dits en yiddish et en français par Rafaël Goldwaser, le chant déchirant de Shalom Katz, et dix-sept chevaux, tous plus beaux les uns que les autres, et soignés, et cabochards, et une mule, un âne, un baudet. Au royaume de Bartabas, comme en une patrie très aimée qui nous berce, nous émerveille, mais nous éveille au monde, aussi. Attention : le parking qui jouxtait l’espace de Zingaro est anéanti par les projets du « Grand Paris ». Plus moyen de se garer facilement. Prenez le métro : ligne 7, station Fort d’Aubervilliers et arrivez en avance pour profiter d’un accueil aussi chaleureux que celui du Soleil, à partir de 19H00 en soirée et 16h00 le dimanche. Théâtre équestre Zingaro, 176 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers. Métro : Fort d’Aubervilliers. Du mardi au samedi à 20h30, sauf le jeudi, relâche. Dimanche à 17h30. Durée : 1h45. Tarifs : 21 à 52€. Tél : 01 48 39 54 17 www.zingaro.fr www.fnacspectacles.com Légende photo : Les mariés s’envolent…Photographie d’Alfons Alt.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 24, 2021 5:31 PM
|
Editorial de Michel Guerrin rédacteur en chef dans Le Monde 22 octobre 2021 Les réserves exprimées par la ministre de la culture sur la collaboration prévue entre le Théâtre de La Colline et le chanteur rompent avec l’attitude de ses prédécesseurs. Un changement de jurisprudence qui interpelle les acteurs de la culture, observe dans sa chronique Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ». Chronique. Roselyne Bachelot a la formule cash, même devant une question périlleuse. Lors de la « Matinale » de France Inter, le 18 octobre, en confiant son « regret » de voir le Théâtre de la Colline, à Paris, proposer un spectacle dont la musique est signée Bertrand Cantat, elle sait qu’elle relance une polémique mille fois creusée depuis dix ans. Deux camps s’affrontent à nouveau, dont la ligne de partage est moins politique que générationnelle : les plus âgés campent sur le droit, les jeunes sur leur idée de la justice. Les gardiens de la loi, les avocats Henri Leclerc et Marie Dosé par exemple, répètent que Bertrand Cantat, condamné non pour meurtre ou assassinat mais pour avoir porté des « coups mortels » sur l’actrice Marie Trintignant, en 2003, a purgé sa peine ; sa libération conditionnelle en 2007 est devenue totale en 2010. Il peut dès lors travailler, comme tout citoyen. Il est libre de composer une musique pour la pièce Mère, écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad, qui commence le 19 novembre à La Colline. Et le public est libre d’y assister ou pas. Lire aussi Le directeur du Théâtre national de la Colline refuse de déprogrammer Bertrand Cantat D’autres, au contraire, les proches de Marie Trintignant et des mouvements féministes en tête, voient en Cantat, de par sa notoriété, un symbole qui, par décence, devrait s’abstenir de donner des concerts – une forme de célébration –, s’imposer la discrétion, voire le silence perpétuel. Primauté de la création A sa libération, Bertrand Cantat préfère ressortir son habit de rockstar, malgré des indignations. Tout change en 2017 avec la déflagration Harvey Weinstein, qui donne naissance au mouvement #metoo. Le chanteur devient un symbole des violences faites aux femmes. Des concerts sont annulés, d’autres perturbés par des manifestants. Ce dernier se victimise, lâche cette phrase à ses opposants : « Il n’y a aucune limite à quel point je vous emmerde. » Le suicide, en 2010, de son épouse et des accusations de violences, classées sans suite par la justice, obscurcissent un peu plus le personnage. En 2018, la ministre de la culture, Françoise Nyssen, déclare pourtant que Cantat a le droit de « vivre sa vie » d’artiste. Cette dernière s’inscrit dans la ligne du ministère depuis quarante ans : la primauté de la création dans le cadre de la loi. En disant le contraire, Roselyne Bachelot, outre qu’elle s’assoit sur le droit, impose un changement de doctrine dans le quinquennat d’Emmanuel Macron. La rupture est d’autant plus forte que le musicien ne sera pas présent sur la scène de La Colline. Sa disparition comme créateur est donc posée. Plus largement, les lieux publics sont invités à l’autocensure pour éviter les sujets qui fâchent. Lire la chronique : Article réservé à nos abonnés « Cantat demande une deuxième chance, comme pour les autres. Mais il n’est pas comme les autres » Roselyne Bachelot colle au climat actuel. Elle répond sur Cantat avec un autre sujet en tête : la pression – légitime – qu’elle subit sur l’égalité des sexes dans la culture et le fait que la grande majorité des plaintes pour violences faites aux femmes se heurte à la question de la preuve. Elle répond aussi aux quelque 200 personnes qui, à la demande du tout frais mouvement #metoothéâtre, viennent de manifester à côté du ministère pour dénoncer l’omerta dans le monde de la scène. Lire aussi Article réservé à nos abonnés #metootheatre : 200 personnes rassemblées à Paris pour alerter sur les violences sexistes et sexuelles Dans une lettre publique du 20 octobre, l’Observatoire de la liberté de création, qui réunit une quinzaine d’associations, comme la Ligue des droits de l’homme ou la Société des réalisateurs de films, dénonce un amalgame : la ministre doit mettre son énergie à combattre les « prédateurs sexuels » dans la culture, pas à stigmatiser un créateur qui a droit au rebond. Réfute l’idée de « dette infinie » La réaction de Wajdi Mouawad surprend également par sa fermeté. Le patron de La Colline, qui, en 2011, avait déjà demandé à Cantat de composer la musique de son spectacle Des femmes, d’après Sophocle, mais aussi d’incarner le chœur antique sur scène, préfère les imperfections de la justice d’Etat aux groupes sociaux érigés en procureurs. Il réfute l’idée de « dette infinie » (Gilles Deleuze). Il ajoute : « Je ne croyais pas qu’au pays des droits de l’homme je doive défendre la présence d’un citoyen libre dans l’enceinte d’un théâtre public. » Ces mots sont liés à son histoire : un Libanais qui, fuyant la guerre civile alors qu’il a 10 ans, grandit au Canada, où il fait une première carrière, avant de débarquer en France. « Que l’on ne vienne pas m’opposer la notion de victime. Victime, je l’ai été. » Il va plus loin, faisant de Cantat un révélateur d’une société où monte une « forme contemporaine d’inquisition » et où la foule « lynche ». « Inaudible » Mouawad estime, au contraire, que tant qu’un artiste n’est pas mis en cause dans une procédure judiciaire il peut le programmer. C’est ainsi qu’il invitera, en 2022, le metteur en scène Jean-Pierre Baro, visé par une plainte pour viol, qui a été classée sans suite en 2019. Ce dernier, se sentant « blacklisté » depuis, vient du reste de publier un communiqué : « Combien d’années devrais-je passer sans exercer mon métier pour purger une peine à laquelle je n’ai jamais été condamné ? » Wajdi Mouawad interpelle enfin l’Etat : s’il estime que son attitude heurte les principes républicains, il démissionnera. On imagine que sa position embarrasse jusqu’à ses opposants. Car l’artiste est respecté, de tous les combats pour la tolérance et l’égalité – Roselyne Bachelot l’a reconnu. Mais, dans les faits, il est isolé. Il se sait « inaudible » dans la société actuelle. On ne voit pas qui, à la tête d’une importante institution culturelle, endosserait aujourd’hui son discours – en privé, oui. Le silence est plus commode, tout comme de laisser l’époque et les réseaux sociaux faire le tri entre le bien et le mal. Un débat a lieu au sein du Théâtre de la Colline, où la position de Mouawad provoque des crispations. C’est une bonne chose. Mais parce que les questions soulevées débordent largement du cas Cantat, croisant le droit, la morale, les violences faites aux femmes et la liberté de création, c’est partout ailleurs que ce débat doit avoir lieu. Lire aussi Bertrand Cantat toujours au centre de la discorde Michel Guerrin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 23, 2021 7:47 PM
|
Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - 22 oct. 2021 Chloé Dabert, directrice de La Comédie de Reims, et Thomas Jolly, son homologue du CDN d’Angers, commentent cinq propositions extraites de la tribune du collectif à l’origine du hashtag #MeTooTheatre publiée par “Libération” le 13 octobre dernier. Le mouvement #MeTooTheatre, qui a surgi ces derniers jours sur les réseaux sociaux, a mis au jour la nécessité, dans ce milieu, d’un travail d’inventaire sur les violences sexuelles et morales à l’égard des femmes. Une tribune du collectif à l’origine du hashtag a détaillé, le 13 octobre dernier, dans Libération, une dizaine de mesures à prendre d’urgence. Nous avons soumis cinq d’entre elles à l’analyse de deux responsables de centres dramatiques nationaux récemment nommés. Chloé Dabert, 45 ans, dirige La Comédie de Reims depuis janvier 2019. Thomas Jolly, lui, est à la tête d’une double structure depuis janvier 2020 : le Centre dramatique national d’Angers et Le Quai, établissement culturel qui l’abrite. Chacun réagit ici avec sa sensibilité. Tous deux observent ce mouvement avec intérêt et affichent une volonté de prendre à bras-le-corps la question de la place des femmes. Et témoignent du travail déjà accompli en ce sens. Si leurs positions se complètent le plus souvent, elles divergent aussi de manière subtile. Voici les cinq propositions qu’ils commentent. Lancement d’une enquête nationale et quantitative sur les faits de violences sexuelles et sexistes dans la profession. Chloé Dabert : Une telle enquête est indispensable pour mesurer l’ampleur des faits, car, pour le moment, on ne la connaît pas. La jeune génération des directeurs et des directrices à laquelle j’appartiens prend très au sérieux cette question des violences sexistes et sexuelles. Thomas Jolly : Au-delà des histoires tristement dramatiques que pourrait révéler une telle enquête, il faudra aussi considérer les comportements misogynes et toutes les injustices provoquées par des attitudes patriarcales qui imprègnent trop souvent nos métiers. Sensibilisation des équipes des théâtres et des écoles aux violences sexuelles et sexistes, nomination d’un référent. C.D. : À La Comédie de Reims, qui est aussi une entreprise, je suis chaque jour vigilante. J’ai l’intuition parfois de ne pas laisser passer certaines choses, mais cela ne suffit pas. Nous devrions, nous employeurs, être mieux préparés. Le Syndeac [syndicat représentant les structures subventionnées, ndlr], dont je suis adhérente, nous a proposé des formations en 2018 et 2019. La pandémie a tout interrompu, elles reprendront en 2022 dans toutes les régions. Une nécessité : si des personnes harcelées venaient à me parler, aurais-je bien tous les mots pour répondre ? Nommer un référent dans chaque institution serait une bonne décision, en particulier dans les écoles de théâtre. T.J. : La sensibilisation existe déjà dans nos maisons via les CSE [comité social et économique, ndlr], qui ont aussi pour mission la prévention du harcèlement moral et sexuel. Mais je m’interroge, du coup, sur la profondeur de leur formation et sur leur capacité à écouter de telles souffrances, de la part des salariés de l’entreprise comme des équipes artistiques accueillies. Comme le milieu (directions ou équipes des théâtres) ne cesse de se rencontrer sur beaucoup de sujets, il faut vite qu’on ajoute ce point à nos discussions : comment inventer les meilleurs dispositifs pour accompagner au mieux la libération de la parole. Le mouvement #MeTooTheatre, qui a surgi ces derniers jours sur les réseaux sociaux, a mis au jour la nécessité, dans ce milieu, d’un travail d’inventaire sur les violences sexuelles et morales à l’égard des femmes. Une tribune du collectif à l’origine du hashtag a détaillé, le 13 octobre dernier, dans Libération, une dizaine de mesures à prendre d’urgence. Nous avons soumis cinq d’entre elles à l’analyse de deux responsables de centres dramatiques nationaux récemment nommés. Chloé Dabert, 45 ans, dirige La Comédie de Reims depuis janvier 2019. Thomas Jolly, lui, est à la tête d’une double structure depuis janvier 2020 : le Centre dramatique national d’Angers et Le Quai, établissement culturel qui l’abrite. Chacun réagit ici avec sa sensibilité. Tous deux observent ce mouvement avec intérêt et affichent une volonté de prendre à bras-le-corps la question de la place des femmes. Et témoignent du travail déjà accompli en ce sens. Si leurs positions se complètent le plus souvent, elles divergent aussi de manière subtile. Voici les cinq propositions qu’ils commentent. Lancement d’une enquête nationale et quantitative sur les faits de violences sexuelles et sexistes dans la profession. Chloé Dabert : Une telle enquête est indispensable pour mesurer l’ampleur des faits, car, pour le moment, on ne la connaît pas. La jeune génération des directeurs et des directrices à laquelle j’appartiens prend très au sérieux cette question des violences sexistes et sexuelles. Thomas Jolly : Au-delà des histoires tristement dramatiques que pourrait révéler une telle enquête, il faudra aussi considérer les comportements misogynes et toutes les injustices provoquées par des attitudes patriarcales qui imprègnent trop souvent nos métiers. Sensibilisation des équipes des théâtres et des écoles aux violences sexuelles et sexistes, nomination d’un référent. C.D. : À La Comédie de Reims, qui est aussi une entreprise, je suis chaque jour vigilante. J’ai l’intuition parfois de ne pas laisser passer certaines choses, mais cela ne suffit pas. Nous devrions, nous employeurs, être mieux préparés. Le Syndeac [syndicat représentant les structures subventionnées, ndlr], dont je suis adhérente, nous a proposé des formations en 2018 et 2019. La pandémie a tout interrompu, elles reprendront en 2022 dans toutes les régions. Une nécessité : si des personnes harcelées venaient à me parler, aurais-je bien tous les mots pour répondre ? Nommer un référent dans chaque institution serait une bonne décision, en particulier dans les écoles de théâtre. T.J. : La sensibilisation existe déjà dans nos maisons via les CSE [comité social et économique, ndlr], qui ont aussi pour mission la prévention du harcèlement moral et sexuel. Mais je m’interroge, du coup, sur la profondeur de leur formation et sur leur capacité à écouter de telles souffrances, de la part des salariés de l’entreprise comme des équipes artistiques accueillies. Comme le milieu (directions ou équipes des théâtres) ne cesse de se rencontrer sur beaucoup de sujets, il faut vite qu’on ajoute ce point à nos discussions : comment inventer les meilleurs dispositifs pour accompagner au mieux la libération de la parole. Création d’une charte déontologique signée par la direction et les professeurs des écoles. Lutter contre la banalisation des relations intimes et sexuelles entre enseignants et élèves. C.D. : Signer une charte est symbolique, donc c’est un geste fort ! On formalise l’importance que l’on accorde au sujet. On s’engage. Ce n’est pas compliqué à mettre en place, faisons-le ! Dans le cadre pédagogique, où les jeunes interprètes sont en pleine construction, c’est encore plus important de cadrer les choses, de préciser que personne ne doit profiter de sa situation de professeur pour séduire des élèves. “ Le mouvement #MeTooTheatre, qui a surgi ces derniers jours sur les réseaux sociaux, a mis au jour la nécessité, dans ce milieu, d’un travail d’inventaire sur les violences sexuelles et morales à l’égard des femmes. Une tribune du collectif à l’origine du hashtag a détaillé, le 13 octobre dernier, dans Libération, une dizaine de mesures à prendre d’urgence. Nous avons soumis cinq d’entre elles à l’analyse de deux responsables de centres dramatiques nationaux récemment nommés. Chloé Dabert, 45 ans, dirige La Comédie de Reims depuis janvier 2019. Thomas Jolly, lui, est à la tête d’une double structure depuis janvier 2020 : le Centre dramatique national d’Angers et Le Quai, établissement culturel qui l’abrite. Chacun réagit ici avec sa sensibilité. Tous deux observent ce mouvement avec intérêt et affichent une volonté de prendre à bras-le-corps la question de la place des femmes. Et témoignent du travail déjà accompli en ce sens. Si leurs positions se complètent le plus souvent, elles divergent aussi de manière subtile. Voici les cinq propositions qu’ils commentent. Lancement d’une enquête nationale et quantitative sur les faits de violences sexuelles et sexistes dans la profession. Chloé Dabert : Une telle enquête est indispensable pour mesurer l’ampleur des faits, car, pour le moment, on ne la connaît pas. La jeune génération des directeurs et des directrices à laquelle j’appartiens prend très au sérieux cette question des violences sexistes et sexuelles. Thomas Jolly : Au-delà des histoires tristement dramatiques que pourrait révéler une telle enquête, il faudra aussi considérer les comportements misogynes et toutes les injustices provoquées par des attitudes patriarcales qui imprègnent trop souvent nos métiers. Sensibilisation des équipes des théâtres et des écoles aux violences sexuelles et sexistes, nomination d’un référent. C.D. : À La Comédie de Reims, qui est aussi une entreprise, je suis chaque jour vigilante. J’ai l’intuition parfois de ne pas laisser passer certaines choses, mais cela ne suffit pas. Nous devrions, nous employeurs, être mieux préparés. Le Syndeac [syndicat représentant les structures subventionnées, ndlr], dont je suis adhérente, nous a proposé des formations en 2018 et 2019. La pandémie a tout interrompu, elles reprendront en 2022 dans toutes les régions. Une nécessité : si des personnes harcelées venaient à me parler, aurais-je bien tous les mots pour répondre ? Nommer un référent dans chaque institution serait une bonne décision, en particulier dans les écoles de théâtre. T.J. : La sensibilisation existe déjà dans nos maisons via les CSE [comité social et économique, ndlr], qui ont aussi pour mission la prévention du harcèlement moral et sexuel. Mais je m’interroge, du coup, sur la profondeur de leur formation et sur leur capacité à écouter de telles souffrances, de la part des salariés de l’entreprise comme des équipes artistiques accueillies. Comme le milieu (directions ou équipes des théâtres) ne cesse de se rencontrer sur beaucoup de sujets, il faut vite qu’on ajoute ce point à nos discussions : comment inventer les meilleurs dispositifs pour accompagner au mieux la libération de la parole. Création d’une charte déontologique signée par la direction et les professeurs des écoles. Lutter contre la banalisation des relations intimes et sexuelles entre enseignants et élèves. C.D. : Signer une charte est symbolique, donc c’est un geste fort ! On formalise l’importance que l’on accorde au sujet. On s’engage. Ce n’est pas compliqué à mettre en place, faisons-le ! Dans le cadre pédagogique, où les jeunes interprètes sont en pleine construction, c’est encore plus important de cadrer les choses, de préciser que personne ne doit profiter de sa situation de professeur pour séduire des élèves. “Notre nouvelle génération de directeurs et de directrices sait maintenant comment épauler les femmes artistes.” Chloé Dabert T.J. : Si une charte est signée, cela permet une prise de conscience générale. Donc d’identifier dès le début une situation problématique. Éviter la banalisation des relations intimes entre profs et élèves ? Bien sûr… D’ailleurs, mon principe à moi est de ne pas confondre ma vie amoureuse et ma vie professionnelle. Mais on ne peut exclure le fait que, parfois, les gens tombent amoureux ! Il est alors important de clarifier la question du consentement, toujours au cœur de ces affaires. La charte peut aider à cela : en informant, en éduquant. Sur les gestes, par exemple, qui, dans le cadre du travail, pourraient être mal interprétés. Au cours d’une répétition, un metteur en scène produit par Le Quai a demandé récemment à une actrice la permission de poser la main sur son épaule. Les changements de méthode sont en cours… Les limites sont parfois si ténues entre la complicité artistique et d’autres sentiments. D’autant qu’au sein des équipes il faut que l’on éprouve le désir de travailler ensemble. Mise en place de la parité à la direction des institutions (théâtres nationaux, centres dramatiques, scènes nationales et écoles d’art) et préférer pour cela la nomination des femmes à leur direction jusqu’à l’obtention de la parité. C.D. : L’ACDN [association qui regroupe les 38 centres dramatiques nationaux, ndlr] compte 47 % de femmes à la tête des lieux, en intégrant à ses statistiques les directions bicéphales et la nomination récente de Pauline Bayle au Centre dramatique national de Montreuil. Dans ce réseau – je ne parle pas des cinq théâtres nationaux [la Comédie-Française, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le Théâtre national de Strasbourg, Chaillot-Théâtre national de la danse, Le Théâtre national de la Colline], où plus aucune direction n’est féminine –, on y est presque ! C’est encourageant. Pourquoi le chemin a-t-il été si long ? Parce qu’il a fallu attendre qu’une politique se mette en place. À partir de 2012-2014, l’idée a émergé plus nettement et j’ai fini moi-même par en bénéficier étape après étape : être accompagnée – seule ou en compagnie –, pouvoir montrer son travail et disposer peu à peu de moyens de productions de plus en plus importants afin d’accéder aux grands plateaux. Notre nouvelle génération de directeurs et de directrices sait maintenant comment épauler les femmes artistes dans leur développement afin qu’elles puissent elles-mêmes devenir responsables de centre dramatique après y avoir été artistes associées. À La Comédie de Reims, aujourd’hui, sont soutenues les metteuses en scène Delphine Hecquet et Marie Rémond aux côtés de Christophe Honoré et de Thomas Quillardet. En plus de Caroline Guiela Nguyen, qui représente, elle, un collectif. Mais une femme doit pouvoir se dire ensuite qu’elle a été nommée pour des raisons artistiques. Empêcher les nominations d’hommes jusqu’à l’obtention de la parité me semble une solution compliquée à envisager. En faisant cela, on opposerait les artistes entre eux. “Si l’on redonnait l’envie aux jeunes générations de candidater, la parité s’organiserait sans doute de manière automatique.” Thomas Jolly T.J. : La parité ? On en parle depuis longtemps et l’on n’en est pas loin. Mais tout cela est si lent que passer en force n’est pas une mauvaise idée. Retarder encore l’égalité de situation risque de créer de l’injustice supplémentaire à l’égard des femmes. Alors entre deux injustices (car ne plus nommer d’hommes pendant quelque temps en est bien une), je préfère éviter la première. Par ailleurs, si l’on redonnait l’envie aux jeunes générations de candidater à la direction de ces théâtres subventionnés, la parité s’organiserait sans doute de manière automatique. Création d’un label national pour les lieux programmant 50 % de projets portés ou écrits par des femmes, ou produisant 50 % de projets portés par des femmes. C.D. : La programmation est paritaire à La Comédie de Reims. Une évidence pour moi. Or l’idée d’un label pourrait faire croire, au contraire, que cette parité est exceptionnelle. On n’en a pas besoin pour faire passer l’idée qu’il est naturel que les femmes dirigent les centres dramatiques et qu’elles y soient programmées et produites à parts égales. On y travaille déjà au quotidien. Peut-être notre réseau devrait-il mieux communiquer sur son action. Notre art en témoigne pourtant : de mon côté, j’œuvre depuis des années à raconter des histoires de femmes, à montrer sur scènes des récits écrits par des femmes. T.J. : Exemple concret du changement générationnel : avec les conseillers du théâtre, nous avons conçu cette dernière saison sans y penser. À la fin, on a vérifié : elle était paritaire ! Preuve que si l’on met des jeunes gens à la tête des institutions la question sera vite réglée. Créer un label pour récompenser, aux yeux du grand public, les théâtres les plus vertueux ? Mon premier réflexe serait de répondre non. Ou alors en créer un pour à peine un ou deux ans, comme un petit stimulus symbolique qui rappellerait la nécessité de résorber les inégalités. Et surtout d’ouvrir nos scènes à des imaginaires qui pointent des faits de société et rendent compte de tous les débats en cours. Afin qu’elles reflètent la réalité du monde dans la parité comme dans la diversité.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2021 9:44 AM
|
Publié dans Sceneweb le 21 octobre 2021 Depuis le début de la semaine, la programmation du Théâtre national de la Colline fait débat. Après la déclaration de Roselyne Bachelot disant « regretter » que Bertrand Cantat, condamné à plusieurs années de prison pour le meurtre de sa compagne en 2003, ait créé la musique de la prochaine création de Wajdi Mouawad, puis l’annonce de la programmation du spectacle Un qui veut traverser dans la mise en scène de Jean-Pierre Baro, créent l’émoi au sein du mouvement #meetootheatre qui s’est réuni ce week-end pour une première manifestation. Après la tribune de Wajdi Mouawad exposant ses arguments, le metteur en scène Jean-Pierre Baro a souhaité donné son sentiment. Nous publions ici son communiqué de presse. L’association de mon nom avec le mouvement #metoo ou à des personnes reconnues coupables de violences envers les femmes est grave et relève d’une injustice intolérable : je suis innocent. Par cet amalgame, je suis transformé en coupable. Je prends donc la parole pour rétablir les faits car je refuse que mon nom soit instrumentalisé. Mon nom n’est pas à votre disposition. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Un combat aussi essentiel que celui de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences et toute forme de harcèlement ne saurait se passer d’une exigence de véracité des faits. Étant aujourd’hui livré à des amalgames accusateurs, je me vois ici dans l’obligation d’exposer mon intimité et les faits tels qu’ils se sont déroulés. En septembre 2018, deux mois après ma nomination à la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry, une femme avec qui je collaborais depuis huit ans a déposé plainte contre moi pour une relation que nous avions eue, un soir, en 2011. Après un spectacle où nous étions allés ensemble, je l’ai raccompagnée chez elle en scooter à son domicile où elle m’avait invité à venir boire un verre du vin que nous avions acheté ensemble sur le chemin. Dans le salon de son appartement, nous avons eu une conversation autour de nos vies intimes. Puis nous avons eu une relation sexuelle dans sa chambre. Nous sommes ensuite retournés dans le salon, où nous avons continué à échanger avant de se quitter au petit matin. Je n’ai ce soir-là exercé aucune forme de violence ni de pression. Cette relation je l’ai vécue comme totalement consentie. Rien, ni ce soir-là ni par la suite, ne m’a permis d’imaginer un instant qu’il put en être autrement. Ce n’est que sept ans plus tard que j’ai appris qu’elle considérait ne pas avoir désiré cette relation. Au moment des faits, j’avais 33 ans et j’étais un metteur en scène totalement inconnu, à peine sorti de l’école. Elle avait elle-même 26 ans et travaillait dans un bureau de production comme administratrice. Nous étions deux jeunes gens à nos débuts professionnels. Il n’y avait aucune relation hiérarchique entre nous, je n’étais pas son supérieur, n’avais aucun ascendant sur elle, ni par ma position, ni par ma notoriété et, pendant 10 ans, nous avons grandi ensemble professionnellement. Elle a travaillé au montage de toutes les productions de mes spectacles. Elle m’a accompagné dans le choix et la pensée de chacun de mes projets, juste qu’à candidater à mes côtés à la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry avant de se raviser. Elle était entre temps devenue la directrice du bureau de production qui s’occupait de ma compagnie. Je l’ai, tout au long de notre collaboration, toujours considérée et appréciée car nous étions dans un dialogue constant auquel elle prenait part avec détermination. L’annonce du dépôt de sa plainte m’a stupéfait d’autant que nous avions continué à travailler en parfaite harmonie. Suite à cette plainte, j’ai été placé en garde à vue par les services de police. Une enquête a été menée, une confrontation organisée, des témoins entendus et j’ai fait l’objet d’une expertise psychiatrique. A l’issue, le procureur de la République a décidé de m’innocenter de l’accusation qui avait été portée contre moi. Ce n’était pas un classement d’opportunité. Pas un classement politique. Pas un classement pour prescription. Non, le dossier a été classé sans suite car les faits dénoncés n’étaient pas constitués. En 2019, alors que l’affaire était déjà classée sans suite, une rumeur et des propos rapportés dans le blog d’un critique de théâtre a engendré un déchaînement médiatique contre moi dans une absence totale de vérification des faits et sans un minimum de travail journalistique. Cet acharnement médiatique a abouti à ma démission de la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry. Il m’était en effet devenu impossible d’assurer ma fonction dans ces conditions. Selon vous, que ma présence dans la saison du Théâtre national de la Colline révolte, combien d’années devrais-je passer sans exercer mon métier de metteur en scène pour purger une peine à laquelle je n’ai jamais été condamné ? A combien d’années d’exil loin des plateaux estimez-vous ma peine ? Sur combien de partenaires souhaitez-vous encore exercer votre chantage pour me faire disparaître ? Cessez d’exercer des pressions sur les femmes et les hommes qui croient en mon travail artistique et le partagent, au prétexte que ce serait nier la nécessité du combat pour l’égalité homme-femme et contre toutes formes de harcèlement que d’accueillir Jean-Pierre Baro. Quiconque aurait quelque chose à me dire, à me reprocher, qu’il le fasse aujourd’hui, devant la justice et j’y répondrai. Ceci fait, je veux ensuite pouvoir travailler et présenter mes créations au public. Jean-Pierre Baro
Le 21 octobre 2021
----------------------------------------------------------- Le droit de réponse de la plaignante, publié dans Sceneweb le 27 octobre 2021
Suite à la tribune de Jean-Pierre Baro publiée la semaine dernière, et après un premier droit de réponse de son avocate, la plaignante, qui n’avait jamais pris la parole a souhaité rompre le silence.
Me voilà aujourd’hui tenue de choisir entre continuer à rester en retrait de l’espace médiatique comme je m’y tiens depuis que j’ai déposé plainte contre monsieur Jean-Pierre Baro en 2018, ou prendre la parole publiquement, ce dont je me suis toujours abstenue malgré ses diverses prises de parole depuis lors.
Suite au récit offensant produit par monsieur Jean-Pierre Baro ces derniers jours sur le média Sceneweb, et repris ensuite par d’autres médias et par nombre de personnes du milieu du théâtre, récit entendant faire revenir la honte dans mon camp, je me vois dans l’obligation de prendre la parole.
Ceci afin de répondre à certains points précis de son récit mensonger, me mettant en scène à renfort de détails permettant non seulement de m’identifier, mais également d’accéder à la fameuse « version des faits tels qu’ils se sont déroulés » de monsieur Jean-Pierre Baro, sa parole outrageante ayant ainsi le loisir de s’étaler de manière publique, plus de trois ans après que j’ai saisi la justice et vu ma plainte classée sans suite, faute d’éléments permettant de suffisamment caractériser l’infraction.
Monsieur Baro aurait pu dire son innocence en rappelant le droit, puisqu’il est présumé innocent. Il avait le choix de le redire sans user d’un procédé visant à réaffirmer publiquement la puissance de sa parole écrasante contre celle à qui la justice demande des preuves qu’elle n’est jamais en mesure de fournir.
N’est-ce pas ce qui est exigé des présumées victimes, l’obligation de n’outrager personne par leur parole dans l’espace public sans avoir les preuves de ce qu’elles avancent ?
Les règles de l’état de droit s’imposent à tous et pas uniquement aux victimes présumées.
Ce plan de communication comporte plusieurs objectifs, et je ne répondrai ici qu’à celui qui vise à me nuire personnellement par des mensonges éhontés.
Les autres objectifs de ce plan de communication, intervenant dans le contexte de la programmation de monsieur Jean-Pierre Baro par le Théâtre national de la Colline et des réactions que cela a suscitées, ne me concernent pas. Qu’il soit clair ici que ma lettre ne vise en aucun cas à prendre position à ce sujet.
En 2018, j’ai déposé plainte, m’engageant dans un processus long et qui m’a énormément coûté, en temps, en énergie mentale et psychique, et financièrement.
Après que la plainte a été classée sans suite, un journaliste a relayé partiellement son contenu, aux côtés de deux autres témoignages – témoignages n’ayant fait l’objet d’aucune enquête à ce jour.
Monsieur Baro feint d’avoir oublié ces autres témoignages, s’autorisant, en réponse à l’article de ce journaliste, ce récit qui s’attelle à produire un discours qui vise à ne faire exister qu’un seul des témoignages en l’isolant, le mien. Le seul témoignage porté devant la justice, donc le seul au sujet duquel il puisse prétendre avoir été « innocenté » par « le Procureur de la République », ce qui est juridiquement faux.
En effet, sur le courrier du procureur de la République que j’ai reçu en 2019, il est écrit : « Ce classement ne signifie pas que vous n’avez été victime d’aucun fait, mais qu’en l’état les éléments recueillis ne permettent pas de justifier les poursuites pénales. Je vous informe que cette décision pourra être revue si de nouveaux éléments venaient à être rapportés »
Que monsieur Baro affirme avoir été innocenté est un mensonge. Mon avocate l’a signalé par droit de réponse au lendemain de la parution de ce récit, droit de réponse publié en préambule de son communiqué, sur Sceneweb.
Que j’ai été une collaboratrice de monsieur Baro et que nous ayons travaillé ensemble durant des années est un fait. Personne n’a jamais prétendu le contraire et je peux ici le réaffirmer. Répéter cela, comme pour se justifier, ne vient en rien attester que les faits que j’ai dénoncés n’ont pas existé ou qu’ils se sont déroulés tels que monsieur Baro le prétend.
Qu’il écrive qu’il n’y ait eu « aucune hiérarchie entre nous » et que monsieur Baro n’ait eu « aucun ascendant sur [moi], ni par [sa] position, ni par [sa] notoriété » au moment des faits que je dénonce est inexact.
Monsieur Baro était l’un des artistes portés par ce bureau de production, j’étais une assistante de production en Contrat à Durée Déterminée. Il n’est pas besoin d’étayer mes propos d’études sociologiques pour avancer qu’un metteur en scène, artiste, ayant déjà mis en scène des spectacles, occupe dans l’échiquier socio-professionnel une place supérieure à une assistante de production sortie d’étude et en premier poste.
On précisera que la relation de monsieur Baro avec les co-directeurs qui m’avaient recrutée était nettement antécédente à celle que j’avais avec eux. Sa compagnie était cliente et partenaire de ce bureau, tandis que j’en étais salariée en CDD depuis moins d’un an.
Monsieur Baro insinue que j’aurais décidé de ne pas candidater au TQI à ses côtés parce « qu’entre temps [j’]étais devenue directrice » du bureau de production. C’est faux puisque je l’étais déjà depuis 3 ans, à savoir depuis 2015.
Cette décision de ne pas candidater est justement en lien avec les faits que j’ai dénoncés, et visait à me protéger.
Aujourd’hui, je pourrais me tourner vers la justice à nouveau, me constituant partie civile, afin de demander qu’un juge d’instruction soit saisi des faits pour lesquels j’ai déposé plainte.
Ce faisant, je m’engagerais -onze ans après les faits que je dénonce, trois ans après m’être adressée à la justice comme je le devais, sans obtenir que ces faits soient jugés dans un second parcours du combattant (de la combattante, devrais-je dire), à nouveau coûteux en énergie, en force mentale, psychique, en temps de vie, et enfin en frais de justice que je n’ai pas à ma disposition.
Malgré tout ce que je lis, je n’ai jamais regretté d’être entrée dans ce commissariat ce jour là. Parler m’a libérée. Croire en la justice -aussi perfectible soit-elle- et lui faire confiance, aussi. Lorsque l’agent qui a pris ma déposition m’a raccompagnée vers la sortie, il m’a dit « en tous cas, quoi qu’il advienne maintenant, vous pourrez vous regarder dans une glace le matin et vous dire que vous avez fait ce que vous aviez à
faire ».
En tout état de cause, et quelque soit la suite donnée à cette dénonciation, je devais prendre la parole aujourd’hui.
Il importait d’indiquer au lectorat de la tribune de monsieur Baro que ce plan de communication est façonné d’inexactitudes tant sur un point de droit fondamental que sur de nombreux points qui ficellent son récit.
Il était essentiel que soit clarifié qu’un classement sans suite n’est rien d’autre que l’impossibilité pour la justice à ce jour de tenir compte d’une parole qui ne peut se démontrer.
C’est une injure d’affirmer qu’il en est autrement, et il est indécent de se prévaloir d’un innocentement juridique inexistant.
Tout cela en réclamant que les autres n’agissent que dans le cadre de la loi, sans en respecter soi-même les bases.
Que la justice ne soit pas en mesure de tenir compte de ma parole est une chose, que monsieur Jean-Pierre Baro en profite pour raconter n’importe quoi à mon sujet en est une autre, et ce n’est pas tolérable. Pas dans un état de droit.
Le présent communiqué vise uniquement à répondre à cette inversion des positions qui devient insoutenable pour moi qui demeure depuis 3 ans dans le plus strict silence.
La plaignante, en réponse au communiqué de monsieur Jean-Pierre Baro, le 27 octobre 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 20, 2021 4:58 PM
|
Savannah Macé dans La couleur des planches - 19 oct. 2021 Cette rentrée théâtrale est aussi celle de Christophe Rauck qui a quitté le Théâtre du Nord pour prendre la direction du Théâtre des Amandiers de Nanterre, en pleine crise sanitaire. En travaux jusqu’en 2022, c’est dans une salle éphémère très stylisée que le metteur en scène nous présente son adaptation d’Henry VI, de William Shakespeare, le spectacle de sortie de la Promotion 6 de l’École du Nord. Après Thomas Jolly et son marathon de 18 heures, Christophe Rauck s’empare de cette épopée qu’il remet entre les mains de comédiens, qui malgré leurs jeunes âges, nous embarquent vigoureusement dans ce voyage sans répit. Un vent de tradition et de modernité souffle sur la scène et révèle d’indéniables talents. Resituons l’œuvre shakespearienne qui traverse un demi-siècle d’Histoire et nous berce de 12 000 vers à travers 15 actes. Le roi Henry V vient de mourir et le royaume d’Angleterre pleure son souverain sur fond de guerre de Cent Ans. Débute alors le règne d’Henry VI, enfant puis jeune garçon dévot et doux, mal préparé à la ruse et à la brutalité des manœuvres politiques de son entourage. Tandis que les batailles se succèdent en France contre une armée menée par Jeanne d’Arc, les divisions et rivalités se multiplient à la Cour anglaise. Dans un climat de perpétuelle méfiance et de conflits entre seigneurs, la Couronne, de plus en plus convoitée, est fragilisée par le mariage raté d’Henry VI et par les émeutes populaires menées par Jack Cade. Le roi perd ses meilleurs alliés et serviteurs. L’avidité et l’orgueil prennent le pas sur le dévouement et la bonté. Affaibli, le roi est finalement déposé, puis restauré, balloté par les conséquences de la guerre civile entre les maisons d’York et de Lancastre, qui se durcit sous le coup de volontés aux appétits inflexibles. La barbarie s’installe au cœur d’un royaume d’Angleterre souffrant. La paix revient, à moins qu’elle ne soit qu’un simulacre… Pour simplifier la scénographie qui n’est pas encore définitive, Christophe Rauck utilise le même mécanisme que dans son adaptation de Départ volontaire, de Rémi De Vos. Seul un plateau tournant, un écran et un gradin constituent le décor de cette grande scène. Tout au long du spectacle le plateau s’habille de différents éléments ; un rideau de velours rouge et un harnais tomberont des cintres, un cheval forain arrivera des coulisses, les ducs joueront au golf et de la fumée se répandra encore et encore. La tournette au sol permet de créer des effets esthétiques originaux et des luttes d’influences ingénieuses. L’espace qui semble vide au départ est suffisamment habité par les conspirations, les péripéties et les états d’âmes des 150 personnages. C’est toute une humanité qui se déploie devant nous. Un véritable Théâtre de la vie dans lequel le pouvoir est central. Chacun est prêt aux mensonges les plus vils, aux trahisons les plus pernicieuses et aux meurtres les plus lâches pour prendre la place de ce jeune roi fragile et trop sincère qu’est Henry VI. Une mise en scène rythmée à la partition sans failles ressort de la collaboration entre Christophe Rauck et Cécile Garcia Fogel. Les entrées et les sorties sont millimétrées, les épisodes s’enchainent sans relâche et le souffle ne retombe jamais. Le metteur en scène apporte la dose nécessaire de légèreté et d’humour salvateur à travers une modernité qui passe par l’usage de la vidéo. En miroir de notre société envahit par les médias qui relayent la moindre actualité, des personnages s’improvisent journalistes du 18e siècle. À l’instar des chaînes d’informations en continu, nous retrouvons une reporter sur le terrain des manifestations, qui ne sont pas sans nous rappelées les émeutes populaires de notre 21e siècle ! Seize comédiens endossent tous les rôles et se parent des contradictions et des paradoxes humains qui parcourent la pièce. Ils relèvent tous ce défi avec détermination et panache mais trois d’entre eux tirent leur épingle du jeu. Joaquim Fossi comédien physique, offre à John Talbot un costume grotesque et une attitude malhabile qui dévoilent une touche de dérision bienvenue. Il est un Duc de Suffolk délicieusement fripon et ambitieux. Antoine Heuillet étonne par la maturité, l’engagement et la conviction qu’il apporte à Humphrey de Lancastre Duc de Gloucester. Un être dont la poigne évidente laisse parfois apparaître une belle sincérité. Quant à Paola Valentin, il suffit de fermer les yeux pour se laisser traverser par sa voix sulfureuse et éraillée. Elle porte une parole à travers la sainte et conquérante Jeanne d’Arc à laquelle elle offre le feu sacré.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 19, 2021 10:50 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 19 oct. 2021 Crédit photo : Jean-Louis Fernandez
Théorèmes, librement inspiré du roman Théorème traduit par José Guidi (Gallimard) et du texte Qui je suis de Pier Paolo Pasolini, traduit par Jean Milleli (Arléas), adaptation et mise en scène de Pierre Maillet. Le roman Théorème est inclassable, écrit en parallèle au tournage du film mythique éponyme, et que devait prolonger encore une pièce de théâtre en vers qui ne verra finalement pas le jour. En tout cas, le film est le révélateur d’une époque qui est est en train de « basculer » dès 1968. L’inventif Pierre Maillet prend le relais en portant à la scène le film/roman – défi délibéré donné. Pasolini (1922-1975) déclenche le scandale – poésies, romans, films, vie privée. Il est attaqué en justice pour offense à la religion et par la gauche laïque qui le soupçonne de piété religieuse. Michel Cournot épingle L’Evangile selon Saint-Mathieu (1964), projeté en avant première, à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame. Dans le spectacle de Pierre Maillet, on entend le critique ressuscité vociférer, installé dans la salle et se levant de son siège pour sortir en claquant la porte. En prologue, le passionné et solaire Pierre Maillet, metteur en scène de Théorème – conte philosophico- érotique, selon ses mots - revient sur la vie du poète politique maudit, via les propos recueillis de Qui je suis. Autour du narrateur, évoluent des jeunes gens bruyants et heureux de vivre, les fameux ragazzi chers au cœur et à l’œuvre du poète engagé et intransigeant. Ces gars-là impulsent le mouvement – danse, esprit facétieux et plaisir d’un présent immédiat. Après mai 68, Théorème choque moins : la société « bouge » et l’auteur est devenu respectable. Porcherie (1970) et Salo ou les Cent Vingt journées de Sodome (1976) sont plus dérangeants : la bourgeoisie se délite, lâche ses possessions – usine livrée aux ouvriers, tel le père de Théorème – et « perd ses mœurs ». Théâtre dans le théâtre, les révélations s’accomplissent dans une boîte transparente – belle scénographie de Nicolas Marie – dont la façade vitrée face public fait effet de miroir. Se jouent comme dans un écrin les scènes emblématiques d’une initiation sexuelle autant qu’existentielle. Dans la famille de la haute bourgeoisie milanaise, surgit un jour un invité qui séduit l’un après l’autre les membres de la famille et leur servante. Cet Ange blanc – l’Invité – leur fait physiquement l’amour : « C’est pas grave ! », puis repart. Un geste émancipateur et déroutant pour les sujets touchés, pourrait-on dire, tant les dévoilements de soi-même sont violents et fulgurants. La servante s’en va, seule détentrice d’une lettre de ce semblant de Dieu car celui-ci a reconnu en elle cette parenté sociale de servitude et d’humiliation. Chacun réagit à sa manière à cette séduction : la servante devient faiseuse de miracles, le fils s’attache à la réalisation d’une vocation artistique – écriture ou peinture -, la fille alterne les comportements entre passivité maladive et excitation incontrôlée, la mère nymphomane séduit les jeunes gens, le père mis à nu part pour le désert, littéralement, et abandonne ses biens… Si le film n’offre aucun commentaire à ces comportements, le spectacle apporterait ses réponses. Le titre de Théorème pose une relation de nécessité, entre une situation initiale, caractérisée par son arbitraire violent et les effets « logiques » de cette situation. Gilles Deleuze évoque quelque chose comme un problème, de résonance et raisonnement mathématiques puisqu’il « fait intervenir un événement du dehors (…) qui détermine le cas » (L’Image-temps, 1985). Quel serait le théorème de Pasolini ? Pour s’accomplir, il faudrait en passer par la séduction y compris homosexuelle, renoncer aux biens terrestres car les voies du divin sont imprévisibles. Le film porte un message non limpide, comme le suggère plaisamment le petit rôle du facteur confié à Ninetto Davoli, l’acteur fétiche du cinéaste, qui va et vient en jouant sur le plateau scénique. « Et tout le monde, dans l’attente, dans le Souvenir, Comme apôtre d’un Christ non crucifié mais perdu, a son destin. C’est un théorème; et chaque destin est un corollaire. Les destins sont ceux que tu connais, ceux de ce monde où toi, avec ton désagréable sourire anticommuniste, et moi, avec ma haine infantile anti-bourgeoise, sommes frères : nous le connaissons parfaitement ! » Beau, ténébreux, insolent, l’Ange-messager est doté d’une énergie sexuelle, mais pas seulement, inépuisable entre élan et nonchalance, qui a le pouvoir, non de dominer le monde, mais de le changer. Une leçon scandaleuse qui déroge aux deux grandes idéologies de l’Italie de l’époque, le christianisme et le marxisme, puisqu’elle dénie tout pouvoir à la foi comme au travail, pour l’accorder à une vertu innée, élitiste, incontrôlable. (Jacques Aumont, Encyclopedia Universalis). Pour parvenir à Dieu la voie la plus sûre n’est pas la plus directe, mais un étrange détour. D’autres lectures sont laïques : l’usine donnée aux ouvriers par leur patron représente une conversion politique gauchiste : la vie ne saurait être que la possession matérielle… Le « virage » sexuel pris par le fils et le père est une conversion brusque. Et certains « élus » deviendront hystériques, d’autres resteront sans voix, d’autres se convertiront. Sur la scène, reviennent les images de chœurs de pauvres gens – population sous le regard attentif de Pasolini. Remercions les comédiens investis, amusés, amusants et pleins de foi en la vie et le théâtre : Arthur Amard (Pierre), Valentin Clerc et Simon Terrenoire (les Ragazzi), Alicia Devidal (Odette), Luca Fiorello (Ninetto), Benjamin Kahn (L’invité), Frédérique Loliée (Lucia), Pierre Maillet (L’auteur), Thomas Nicolle (le Médecin), Elsa Verdon (Emilia), Rachid Zanouda (Paolo). Quant à la grande Marilù Marini (Emilia), elle instille sa poésie à ce spectacle un peu trop bruyant, l’écho sonore d’une vision approximative de survol et de clichés répétitifs sur l’œuvre littéraire, poétique et existentielle de Pier Paolo Pasolini. Les musiques d’une époque surfent de leur côté, de Christophe à David Bowie, de Peer Raben à Gloria de Missa Luba. La vertu sincère de la mise en scène fait en sorte qu’on redécouvre l’œuvre d’un génie poétique. Véronique Hotte Du 18 au 20 octobre, Comédie de Caen – CDN de Normandie. Du 10 au 13 novembre, Théâtre National de Bretagne à Rennes. Les 3 et 4 mars 2022, Comédie de Colmar – CDN. Les 15 et 16 mars 2022, Théâtre de Nîmes. Du 12 au 14 avril 2022, Théâtre Sorano de Toulouse.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...