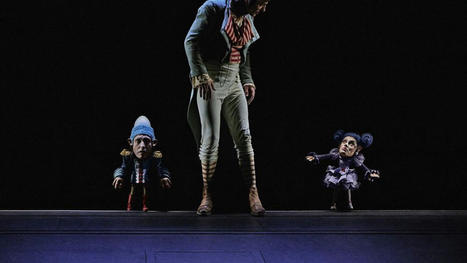Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 2022 1:32 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 25 janvier 2022 Elle était discrète et très talentueuse. Comédienne, elle chantait à la perfection et était une lectrice précise et harmonieuse. Elle s’est éteinte il y a quelques jours. On l’avait connue dans les premiers spectacles signés par son frère, Daniel Mesguich. On se souvient d’elle, encore au conservatoire et jouant dans Candide, dans Le Prince travesti. Elle se nommait Catherine Berriane. Sa famille a annoncé sa mort dans les colonnes du carnet du Monde il y a quelques jours. Chagrin. Elle avait beaucoup de talents et des dons. Ses professeurs, Marcel Bluwal, Pierre Debauche, appréciaient ce grand tempérament. Elle avait pris ses premiers cours à Marseille, auprès d’Irène Lamberton. Et, alors qu’elle était entrée au CNSAD, elle avait pris des cours de chant lyrique avec Bernadette Val. Ses premiers spectacles datent de 1974. Son premier récital de 1984, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Longtemps, elle a chanté. Avec Francesca Solleville, avec Colette Magny, au Tourtour ou à la Fête de l’Huma, à Monte Carlo ou à la Vieille Grille, à l’Espace Rachi. Sur le plateau de la Comédie-Française : lorsque son frère monta La Vie Parisienne ou, un peu plus tard, La Tempête. Elle chanta du Monteverdi. De la chanson réaliste au plus délicates des compositions lyriques, son timbre, sa discipline, sa sensibilité faisaient merveille. Un chemin à la télévision, au cinéma, notamment auprès de Jean-Pierre Mocky, qui aimait les fortes personnalités. Au théâtre, son chemin s’est souvent confondu avec celui de Daniel Mesguich qui admirait sa personnalité, sa présence, sensuelle, tendre, spirituelle, capable de dessiner des femmes plus âpres. Racine et plus tard Corneille, Wedekind, Shakespeare, Pirandello, Kleist, Tchekhov, Clarisse Nicoïdski, entre autres. Avec Jean-Claude Penchenat, elle joua du Goldoni et avec Myriam Tanant, du Buzzati. Elle aura énormément joué et chantait, lu pour la radio ou des spectacles. On ne l’oubliait pas. Armelle Héliot Légende photo : LE BEL INDIFFERENT – SUIVI DE LA CHARLOTTE DE JEHAN RICTUS – De Jean COCTEAU – Mise en scene : Daniel MESGUICH – Avec : Catherine BERRIANE, Florent FERRIER – Le Lucernaire – Le 05 janvier 2010 – Photo : Pacome POIRIER/ WikiSpectacle (avec nos remerciements)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 24, 2022 12:32 PM
|
par Luc Le Vaillant dans Libération - 24 janvier 2022 Légende photo : Rebecca Marder, à Paris le 11 janvier. (Lucile Boiron/Libération) La prometteuse pensionnaire de la Comédie-Française quittera, dès 26 ans, la maison de Molière pour se consacrer au cinéma où elle fait déjà impression dans le premier film de Sandrine Kiberlain, «Une jeune fille qui va bien». Il est étonnant de voir surgir quelqu’un qui a l’âge de vos enfants et qui, déjà, impose sa chance. Il est surprenant de réaliser qu’une débutante mène le bal, qu’elle embrasse l’aube d’été plutôt que de se contenter d’en être la promesse, qu’elle fait une entrée frappante dans la carrière quand ses aînés y sont encore. Il est revigorant de s’asseoir face à Rebecca Marder, comédienne de 26 ans, dans un bistrot du XIe arrondissement de Paris, au cœur d’un quartier où elle réside et qui lui correspond, endroit lancé et bigarré, contemporain et festonné des ridicules sans lesquels il n’est pas de tendances durables, ni d’opinions crédibles. Rebecca Marder est une enfant de la balle particulière. Elle a jonglé avec les mots et les rôles sans qu’on l’y encourage vraiment, apparaissant à l’écran à 5 ans, croisant enfant les routes de Louis Garrel et Mélanie Laurent, Sandrine Testud et Gad Elmaleh. Sa mère, excellente critique de théâtre à Libération et ailleurs, connaît trop la bohème artiste et l’immangeable vache enragée, pour lui cacher la difficulté d’y arriver. Pourtant, Rebecca l’accompagne au spectacle dès son âge tendre, s’endormant sur les strapontins, pelotonnée dans les manteaux abandonnés. Son père, contrebassiste et auteur de musique de films, est plus complaisant avec ce désir flambant, l’inscrivant à toutes les activités culturelles qui lui plaisent. Bonne élève intéressée par la philo, elle interrompt son hypokhâgne pour accéder au TNS de Strasbourg. Presque aussitôt, elle abandonne ce lieu convoité pour entrer à la Comédie-Française, estomaquée par l’impromptu de sa réussite mais ne boudant pas sa chance. Elle en devient la plus jeune pensionnaire depuis Isabelle Adjani. La comparaison a ses raisons. Les yeux sont d’un bleu plus clair, moins aigue-marine. Le teint est d’une même pâleur tétanisée, avec rouge venant aux joues, sans jamais monter au front, et la chevelure moins sombre. Chez Marder, il y a sans doute plus de volutes qui volettent, de bruissement d’ailes et d’inconscience écervelée, quand Adjani couvait des tempêtes, débordait de bourrasques, fendillait des angoisses. Jean Chevalier, son partenaire dans la pièce Fanny et Alexandre, y ajoute une certaine parenté avec Anouk Grinberg, «pour le côté enfantin dans le jeu». Et de préciser : «Rebecca, qui est capable de se concentrer en deux minutes, est d’une facilité troublante. Elle a un rythme qui met tout en mouvement autour d’elle. On a l’impression d’être face à un oiseau insaisissable.» Après un septennat au Palais-Royal où elle a rencontré son compagnon Benjamin Lavernhe, elle quitte ce refuge d’excellence qui est aussi un couvent et confine au sacerdoce. Elle part emplie de gratitude pour le temps gagné et les défis relevés, mais soucieuse de se mettre à son compte, au cinéma comme dans l’écriture. Elle dit : «Le Français, c’est un cadre, mais c’est aussi une famille. D’ailleurs, quand on est dans les murs, on dit : «Je suis dans la maison». J’ai envie de découvrir qui est Rebecca sans la particule de la Comédie-Française. Cette remise en question me fait peur, mais il s’agit de savoir si j’ai l’énergie d’initier les choses, sans qu’on me donne la becquée.» Eric Ruf, l’administrateur actuel, a beau libéraliser les règles et permettre plus d’allers-retours avec le dehors, l’exigence reste forte. Il faut tenir tous les emplois dans un répertoire où l’on compte plus de soubrettes que de jeunes premières. On n’est souvent qu’un maillon de la chaîne, jouant les utilités en alternance, donnant de maigres répliques. Marder se souvient d’un vaudeville de Feydeau où elle soignait une seule entrée avant de vite se faire proprement… égorger. Sandrine Kiberlain en a fait l’héroïne de son premier long métrage et lui prête «la beauté de Gene Tierney et la maladresse de Diane Keaton» (1). En retour, Rebecca Marder se félicite de «n’avoir jamais été aimé comme ça». Dans ce récit à la fois fantaisiste et onirique, Marder est une apprentie comédienne qui prépare le conservatoire dans les années 40. Insouciante, elle se laisse aller à la passion des initiations et à l’enthousiasme des premières fois alors qu’alentour la menace gagne et que les juifs sont tenus de porter l’étoile jaune. Les parallèles sont intenses pour celle qui se produit encore dans la Cerisaie et aime que, comme chez Tchekhov, on pleure en riant. Si côté maternel, on est catholique et paysan de Dordogne, du côté paternel, ses devanciers sont des juifs partis de Russie et d’Ukraine pour immigrer aux Etats-Unis. Son grand-père était avocat dans le Bronx. Sa grand-mère, «qui portait la culotte», défilait contre la guerre du Vietnam. Rebecca n’est pas croyante, mais a fait une crise mystique au début de l’adolescence et a insisté pour étudier le talmud pendant quelque temps. Si elle a la double nationalité, son père et elles ont refusé de retourner aux Etats-Unis pendant le mandat de Trump. Elle taira son vote de 2017, mais on parierait volontiers que c’était Hamon-Macron. Elle dit «avoir envie de lutter contre les faux prophètes». Et se voit ambivalente «à la fois très concernée et assez dépolitisée». Une camarade du Français la raconte au contraire «engagée, convaincue, sûre de ses idées, et n’hésitant pas à prendre la parole face à la troupe». Il est bluffant de réaliser que l’actrice qui nous fait face, qui parle haut pour le plus grand profit du maigre voisinage et bat des bras tant qu’elle pourrait envoyer valser son verre de Perrier, qui connaît des milliers d’alexandrins mais truffe son propos des «trop bien» de sa génération, est l’une de celles qui succèdent à Sarah Bernhardt. La faramineuse boiteuse est l’une des rares à être revenue en gloire à la Comédie-Française, destin peu commun qui, un jour lointain, tentera peut-être Rebecca Marder. Il est enrichissant de réaliser que si les salaires de la jeunesse du Français sont modérés, disons 2 000 euros mensuels de fixe à l’échelon 2, sans oublier les «feux», ces suppléments liés au nombre de représentations effectuées, l’argent à engranger importe moins que la rutilance des mondes à conquérir. Au cinéma, Olivier Dahan, Noémie Lvovsky ou François Ozon lui offrent déjà des rôles importants. Enfin, il est amusant d’aller glaner goûts et couleurs afin de pouvoir ajouter à ce portrait des touches de banalité et des pointillés de quotidienneté. On commence par la dissocier d’une quasi homonyme Rebecca Mader, actrice britannique. On s’aperçoit ensuite qu’elle lit Sylvia Plath et Nathalie Sarraute, et aussi Delphine Horvilleur, qu’elle admire Nadja, l’héroïne d’André Breton, qu’en matière de romans l’amour l’intéresse plus que l’aventure, que Chanel l’habille parfois même si elle n’est égérie que d’elle-même et qu’avoir grandi dans le quartier chinois de Paris lui fait apprécier «ha kao crevettes, phô de bœuf et raviolis vapeur». (1) Version Fémina du 16 janvier. 10 avril 1995 Naissance à Paris. 2001 Premier film. 22 juin 2015 Entrée au Français. 26 janvier 2022 Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain. En Juin Quittera le Français.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 24, 2022 6:16 AM
|
Par Sandrine Blanchard (Lyon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 22 janvier 2022
La journaliste Giulia Foïs et le metteur en scène et comédien Etienne Gaudillère, lors de la représentation de « Grand Reporterre », le 20 janvier 2022, au Théâtre du Point du Jour, à Lyon. THÉÂTRE DU POINT DU JOUR Le projet confronte les regards d’un metteur en scène et d’une journaliste féministe sur les réactions aux agressions sexuelles dans le secteur culturel.
La « règle du jeu » est simple et affichée à l’attention des spectateurs : un(e) metteur(se) en scène, un(e) journaliste, un sujet d’actualité, une semaine de répétitions. Quand le rideau s’ouvre, jeudi 20 janvier, au Théâtre du Point du Jour, sur les hauteurs de Lyon, le fond de scène est recouvert, en grand format, de publications ayant agité récemment le débat public : s’y côtoient Le Consentement, de Vanessa Springora (Grasset, 2020), la couverture des Inrockuptibles célébrant le retour musical de Bertrand Cantat, des « unes » de Libération telles que « Césars, le grand fossé », mettant face à face les visages de Roman Polanski et d’Adèle Haenel, etc. « Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? », vont alors s’interroger le jeune metteur en scène et comédien Etienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs, spécialiste des questions féministes, dans une « mise en pièce de l’actualité » sur les violences sexuelles et le mouvement #metoo. « Il s’agit davantage d’une performance que d’un spectacle », expliquent Angélique Clairand et Eric Massé, codirecteurs depuis trois ans du théâtre contemporain du Point du Jour. Soucieux de construire une programmation qui « questionne le réel », ils ont eu l’idée de mêler vision artistique et expertise documentaire, en demandant à des metteurs en scène et à des journalistes de croiser leurs regards et leur temporalité. Le projet a pour nom Grand Reporterre et se développe, depuis janvier 2020, à raison de deux propositions par saison. Soucieux de construire une programmation qui « questionne le réel », les codirecteurs du Point du Jour, ont eu l’idée de mêler vision artistique et expertise documentaire Après s’être penché sur la désobéissance civile, le cyberféminisme, les mouvements de protestation citoyenne non violente et les enjeux des industries énergétiques face aux impératifs de développement durable, ce nouveau Grand Reporterre, cinquième du genre, s’interroge sur la nécessité de séparer l’homme de l’artiste et de son œuvre. Le choix de ce sujet revient à Etienne Gaudillère. Artiste associé au Théâtre du Point du Jour, ce trentenaire a éprouvé le besoin de se questionner sur son positionnement face aux multiples accusations médiatisées de violences faites aux femmes. « Quand les directeurs m’ont proposé de travailler sur un “Grand Reporterre”, quelques jours plus tard Polanski recevait le César du meilleur film pour J’accuse, lors de cette saisissante cérémonie où Adèle Haenel quittait la salle. J’ai réalisé que je ne m’étais pas rendu compte de l’ampleur de l’affaire », explique en introduction Etienne Gaudillère. Puis il interpelle le public : « Qui a vu J’accuse de Polanski ? Qui refuse de le voir ? Qui pense qu’il ne faut rien dire tant que la justice n’a pas fait son travail ? Qui considère qu’il faut séparer l’homme de l’artiste ou l’œuvre de l’homme ? Qui se dit comme moi : je me sens un peu paumé dans toutes ces histoires ? » Militantisme assumé Pour mener à bien cette performance, le metteur en scène a tenu un journal de bord tout au long de ses recherches et des sursauts de l’actualité qui n’ont pas manqué (#metoothéâtre, affaires PPDA et Nicolas Hulot, etc.), et a surtout fait appel à Giulia Foïs. L’animatrice de l’émission « Pas son genre » sur France Inter et autrice de Je suis une sur deux (Flammarion, 2020), essai autobiographique sur le viol qu’elle a subi à l’âge de 20 ans, a tout de suite accepté l’aventure : « Cette exploration théâtrale est une autre manière de sensibiliser le public. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés #metoothéâtre : « Prendre la parole représente le risque d’être blacklistée » Sur scène, elle interprète son propre rôle, éclairant avec faits et chiffres les interrogations et les réflexions d’Etienne Gaudillère. Leur échange est entrecoupé de saynètes illustrant les polémiques suscitées par les accusations portées dans le milieu culturel. Deux comédiens, Marion Aeschlimann et Jean-Philippe Salério, s’emparent des tribunes de Catherine Deneuve (« Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle », publiée par Le Monde le 9 janvier 2018) et de Virginie Despentes (« Désormais on se lève et on se barre », parue dans Libération le 1er mars 2020), confrontent leurs points de vue – « Tu es comédienne, tu galères un peu, un jour où on te propose un casting pour un grand rôle dans un film de Polanski, tu fais quoi ? » Puis se disputent sur « la zone grise entre désir et consentement », et discutent du sort des œuvres une fois l’artiste accusé : « On garde ou on jette ? » « Là, on mélange tout, réagit Giulia Foïs, il ne faut pas effacer mais expliquer. » Au fur et à mesure de cette « mise en pièce », la neutralité de la question initiale laisse place à des certitudes et à une forme de militantisme assumé. A l’issue de son cheminement, Etienne Gaudillère considère que « le flou n’existe pas ». Reprenant la chanson Basique d’Orelsan, il martèle : « Pourquoi on ne sépare pas l’homme de l’artiste quand l’artiste n’est pas connu ? » ; « Dénoncer le tribunal médiatique dans les médias, c’est n’importe quoi » ; « Dans “présumé innocent”, on n’entend jamais le mot “présumé” » ; « Y a pas plus faux de dire “qui ne dit mot consent” ». C’est, selon lui, « simple, basique ». Et ça clôt le débat. Grand Reporterre. Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, dimanche 23 janvier au Théâtre du Point du Jour à Lyon et les 13, 14 et 15 avril au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Sandrine Blanchard (Lyon, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2022 7:04 PM
|
Par Sophie Granel pour FranceTvInfo.fr, le 23 janvier 2022 Nicolas Martel et Huming Hey dans "Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution". (France 3 Aquitaine) "Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution" raconte le destin tragique d'une hermaphrodite décrétée homme par l'état civil au 19e siècle. La pièce jouée au Théâtre national Bordeaux Aquitaine est une adaptation des mémoires de cette pionnière transgenre qui a mis fin à ses jours à la veille de ses trente ans.
C'est une histoire méconnue et pourtant terriblement d'actualité qui se joue jusqu'au 22 janvier au Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA). Au milieu du 19e siècle, Herculine Barbin naît femme. En réalité hermaphrodite, elle sera réassignée homme vingt ans plus tard. Un traumatisme dont elle ne se remettra pas. Herculine, devenue Abel se suicide en 1868. Un siècle plus tard, le philosophe Michel Foucault exhume et publie ses mémoires. Un texte aujourd'hui adapté au théâtre avec la pièce Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution. Un témoignage puissant et bouleversant qui remet en question "le système binaire homme/femme bien avant notre époque". La metteuse en scène Catherine Marnas a été bouleversée par l'histoire d'Herculine Barbin. Ses mémoires, publiées en 1978 par le philosophe Michel Foucault sous le titre Herculine Barbin dite Alexina B., sont comme "une bouteille à la mer" lancée depuis l'au-delà. À l'heure où le combat pour le droit à la différence se poursuit, le destin de cette femme à qui l'on a imposé un sexe résonne de manière particulière. Personne ne lui a demandé son avis Yuming Hey comédien "Jamais on ne lui a demandé, veux-tu être assignée femme ou homme", témoigne Yuming Hey, qui joue Herculine dans la pièce. "Dans ses mémoires, on sent le poids de la fatalité quand l'État civil choisit pour elle. Elle en souffre énormément".
Une souffrance que le jeune comédien, récemment propulsé sur le devant de la scène par son rôle de Mowgli dans l'adaptation du Livre de la Jungle de Bob Wilson, a fait sienne. Jouant de son androgynie, Yuming Hey est une Herculine plus vraie de nature. Sur scène, un décor de dortoir aux draps immaculés et des projections vidéos renforcent encore le côté fantomatique de ce personnage extraordinaire surgi du passé pour témoigner au présent. Vidéo de présentation Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution, au TNBA à Bordeaux jusqu'au 22 janvier.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 21, 2022 10:05 AM
|
Publié par Libération le 19 janvier 2022 Le décès de l’acteur double césarisé, notamment connu pour son interprétation d’Yves Saint-Laurent, a suscité une vague d’émotions au sein de l’industrie cinématographique. Mais aussi chez les politiques. Sidération et état de choc dans le milieu du cinéma et bien au-delà. Peu après l’annonce de la mort de Gaspard Ulliel, décédé à 37 ans des suites d’un accident de ski en Savoie, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Louant un «acteur d’exception» à la carrière plurielle. Emmanuel Macron a exprimé ce mercredi soir sa «grande tristesse» face au décès de l’acteur, saluant une «icône de l’élégance française». Dans un communiqué, l’Elysée met en avant un «acteur de télévision depuis l’enfance, de cinéma ensuite, de théâtre parfois, icône de l’élégance française, il éblouissait tous les objectifs et occupait le haut de l’affiche depuis plus de deux décennies». «Le Président de la République et son épouse déplorent la disparition brutale de cet acteur talentueux dont le regard bleu était une signature du cinéma français», ajoute le texte. Plus tôt dans la journée, l’acteur Guillaume Canet a posté une photo de son ami sur son compte Instagram, avec pour seule légende un sobre «Gaspard», accompagné d’un émoji cœur noir. Même émoji du côté du directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel, qui se dit «infiniment triste». Pierre Niney, qui avait également interprété le couturier Yves Saint-Laurent dans un biopic concurrent, à quant à lui fait part de son émotion sur Twitter et dans une story Instagram : «Le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent.» Sans oublier d’envoyer ses pensées à la famille du défunt. Le patron du groupe Canal +, partenaire historique du cinéma français, Maxime Saada a exprimé son choc en rappelant le brio avec lequel l’acteur «savait nous émouvoir et nous faire rire, nous toucher». «Gaspard Ulliel et le cinéma s’aimaient éperdument» La classe politique a, elle aussi, largement réagi à la disparition de l’acteur de 37 ans, lauréat du César du meilleur acteur en 2017 pour son rôle remarqué dans Juste la fin du monde, du réalisateur canadien Xavier Dolan. Par un tweet, le Premier ministre, Jean Castex, a salué un grand amoureux de cinéma. «Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument, écrit-il. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.» La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, loue «sa sensibilité et l’intensité de son jeu [qui] faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception». Dans un court message, le maire EE-LV de Grenoble, Eric Piolle adresse «toutes [ses] condoléances à la famille et aux proches» de l’acteur. Tout comme le député LR Eric Ciotti ou la députée LREM Yaël Braun-Pivet. «Un destin brisé trop tôt», écrit la parlementaire accompagnant son message d’une photo du double césarisé. Quelques minutes plus tard, la maire de Paris Anne Hidalgo et candidate PS à l’élection présidentielle, salue la jeunesse et le talent du comédien : «Nous perdons un immense acteur qui aura inspiré tant de réalisateurs. Sa présence manquera au cinéma français», ajoute-t-elle.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 21, 2022 6:54 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 21 janvier 2022 - Légende photo : Lars Edinger dans « Richard III », de Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, lors d’une représentation à Berlin, en 2015. ARNO DECLAIR Le metteur en scène Thomas Ostermeier et le comédien Lars Eidinger présentent au Théâtre des Gémeaux la pièce de Shakespeare sous la forme d’un « laboratoire ouvert au public ». Toutes les places étaient vendues pour Richard III, de Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, avec Lars Eidinger dans le rôle-titre, qui devait être joué au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux (Hauts-de-Seine), du 20 au 30 janvier. Les gens voulaient découvrir ou revoir ce spectacle-phare de la Schaubühne de Berlin, qui avait triomphé au Festival d’Avignon, en 2015, puis à l’Odéon, à Paris, en 2017. Mais, à une semaine de la première, le conseil de la Schaubühne a mis un veto à sa venue. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés A Avignon, un roi boiteux règne sur la Cité des papes Ce théâtre, un des plus prestigieux d’Allemagne, a un fonctionnement démocratique participatif unique, hérité de son histoire. Excepté la direction, dont fait partie Thomas Ostermeier, l’ensemble de ceux qui y travaillent (à l’administration, à la technique ou dans la troupe, 220 personnes environ) élit neuf représentants qui forment le Betriebsrat (le conseil d’établissement), lequel prend, après concertation, les décisions importantes. « En matière de santé, et uniquement dans ce domaine et dans celui de la sécurité au travail, le conseil peut opposer un veto », explique Thomas Ostermeier dans la salle du Théâtre des Gémeaux. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La passion Shakespeare, selon Thomas Ostermeier En ce mercredi 19, ils se préparent donc pour un Richard III très particulier qu’ils vont proposer vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier, sous la forme d’Improvisation autour de Richard III, en remplacement du spectacle initial. « Je ne contreviens pas à l’avis du conseil de la Schaubühne, qui s’est rangé à l’avis de ceux, très peu nombreux, qui ont pris peur en voyant que les chiffres de contamination étaient trois fois plus élevés en France qu’en Allemagne, note le metteur en scène allemand. Mais Lars et moi, qui sommes sur les routes depuis des mois, lui pour ses tournages, moi pour préparer la mise en scène du Roi Lear qui sera créé à la Comédie-Française en septembre, nous nous sommes dit qu’il fallait faire quelque chose pour le public français. Annuler dix représentations sold out, c’est une catastrophe. » « Une responsabilité particulière » Si la troupe berlinoise s’était déplacée à Sceaux, 37 personnes seraient venues. Pour l’Improvisation autour de Richard III, ils ne sont que six. « Ceux qui avaient peur sont restés à Berlin et nous représentons la troupe en France », poursuit Thomas Ostermeier. « C’est l’occasion de réaliser une chose que nous avons toujours eu envie de faire : du théâtre très minimaliste. Richard III s’y prête. » Deux musiciens (l’Allemand Henri Maximilian Jakobs et le Français Blade Alimbaye) accompagneront sur la scène l’acteur et le metteur en scène, qui sera dans son rôle, jouant parfois certains personnages. Pour 20 euros (tarif unique), le public pourra, privilège rare, entrer dans le laboratoire d’une création. « On lui proposera des scènes, il pourra intervenir, on lui demandera son avis. Cela durera une heure et demie, puis il y aura un entracte, suivi d’une discussion générale. » Thomas Ostermeier insiste : « Je me sens une responsabilité particulière envers le public qui a du mal à retrouver les salles, en ce moment. Il faut être là pour ceux qui viennent, malgré la pandémie. A la Schaubühne, nous n’avons annulé aucune représentation. Si un acteur est malade, on le remplace. Et nous avons décidé de ne pas prendre de vacances l’été dernier. » Et d’ajouter : « Les théâtres avaient rouvert en juin, pour moi, c’était impossible de s’arrêter un mois plus tard, après un an et demi de fermeture. Nous avons pu jouer parce que le conseil a donné son accord. » La démocratie participative, toujours. Improvisation autour de Richard III, Théâtre des Gémeaux, Sceaux (Hauts-de-Seine). Vendredi 21 et samedi 22 à 20 h 45 ; dimanche 23 janvier à 17 heures. Durée : 2 h 45. Brigitte Salino

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2022 5:21 PM
|
Par Catherine Pacary dans Le Monde - 20 janvier 2022 Légende photo : Au fond sur la scène, la comédienne Joëlle Sevilla (à droite, assise) et le réalisateur Eric Guirado (à gauche, debout), avec, de dos, des élèves de l’école d’acteurs, Acting Studio, au Mascarille - L’Autre Théâtre lyonnais, à Lyon, le 14 juin 2021. LATO SENSU PRODUCTIONS/FTV Eric Guirado s’est intéressé à la manière dont les pièces du dramaturge sont jouées à Lyon, ville dans laquelle il séjourna, de 1646 à 1658. « Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris mais Molière est né à Pézenas. » Célèbre, cette affirmation, qui aurait été prononcée en 1947 par Marcel Pagnol, se prolonge ce soir d’une interrogation : Molière aurait-il été différent s’il n’était pas passé par Lyon ? En ce mois de commémorations des 400 ans de la naissance, le 10 janvier 1622, de celui qui est souvent considéré comme le fondateur (posthume) de la Comédie-Française, il est difficile de sortir du lot. L’Autre Molière y parvient, à condition d’adhérer aux postulats de ce documentaire de niche. Diffusé dix jours après l’excellent numéro de « Secrets d’histoire », déjà sur France 3 (« Molière et ses mystères », où Stéphane Bern développe les zones d’ombre – l’origine du pseudonyme, l’absence de manuscrits, la possibilité qu’une partie de ses pièces aient été écrites par Pierre Corneille…), celui proposé par France 3 Auvergne - Rhône-Alpes en prend le contre-pied. Le réalisateur natif de Lyon Eric Guirado part d’une réalité peu connue : Molière a séjourné entre 1646 et 1658 dans la ville qui inventera en 1808 Guignol, y a monté L’Etourdi ou les Contretemps – dont le héros s’appelle… Mascarille, personnage typique de la commedia dell’arte. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Molière a tout organisé pour qu’on fantasme sa figure » Justement, la comédienne Joëlle Sevilla vient d’ouvrir son théâtre, baptisé… Mascarille - L’Autre Théâtre lyonnais. Elle tient le premier rôle dans ce documentaire. Cette passionnée dirige par ailleurs une école d’acteurs qu’elle a fondée en 1999 à Lyon. Version résolument pop Le film fait le pari d’immerger le téléspectateur au plus près des élèves et des acteurs. Ce qui devrait ravir les amateurs de théâtre. Joëlle Sevilla justifie ses partis pris artistiques par les mots de Lee Strasberg, de l’Actors Studio à New York : « Je ne comprends pas pourquoi les Français jouent Molière comme jouaient à son époque les ennemis de Molière. » Aussi la professeure reprend-elle inlassablement ses élèves pour « réveiller Molière », quitte à user d’un vocabulaire qu’elle juge sûrement plus convaincant : « Scapin n’est pas un bourrin » ; « Si on ramène Alceste à un problème de couple, c’est mort »… Parce que, au fond, Molière n’a jamais voulu « emmerder les spectateurs », lance-t-elle. Une modernité qui n’avait pas échappé à sa consœur marseillaise Macha Makeïeff, autrice d’une version résolument pop des Femmes savantes à La Criée, en 2019. Aux côtés de Joëlle Sevilla, l’historien Georges Forestier, biographe de Molière, éditeur de ses œuvres complètes dans « La Pléiade » (et déjà présent dans le « Secrets d’histoire » du 10 janvier). A charge pour lui de parcourir les traboules et de présenter les lieux et les documents qui attestent de la présence de la troupe de Molière dans l’ancienne capitale des Gaules. Quelques épisodes théâtraux sont ainsi rappelés, comme l’influence du Jeu de paume sur la conception des salles, l’existence de personnages récurrents ou encore la bonne interprétation du monologue à la fin des Précieuses ridicules. Une pièce révolutionnaire assure l’historien, convaincu que si son auteur existait aujourd’hui il serait « un stand-upeur ». Molière, homme du peuple et non homme de la cour de Louis XIV à Versailles, s’en trouve définitivement dépoussiéré. « L’année Molière », une série en cinq épisodes

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2022 6:26 AM
|
Par Anthony Palou dans le Figaro - 19 janvier 2022 Orgon, incarné par Denis Podalydès, assiste à la trahison de Tartuffe (campé par Christophe Montenez), avec sa femme, Elmire, interprétée par Marina Hands. Jan Versweyveld/Comédie-Française CRITIQUE - À la Comédie-Française, le metteur en scène belge adapte la première version censurée de la pièce de Molière transcendée par une remarquable distribution maison. Cette version «originale» du Tartuffe sied au metteur en scène belge comme un costume trois actes sur mesure. Nous avions toujours lu, vu Le Tartuffe ou l’Imposteur, voilà, à la bonne heure, Le Tartuffe ou l’Hypocrite, joué une seule fois devant Louis XIV et la cour le 12 mai 1664, puis interdite. Nous n’entrerons pas ici dans les détails de cette censure si longue en rebondissements. Allons au fait, à l’adaptation d’Ivo van Hove, à la salle Richelieu, qui, l’autre soir, était bondée, de l’orchestre au poulailler. Dès le début, cette impression de se retrouver dans un curieux chantier, un champ de bataille. Une scène en désordre, sombre. Peu à peu, le décor prend forme, alors que les servants d’Orgon déshabillent un homme, le plongent dans une baignoire, le lavent. Un duel digne du Far West Nous assistons à la toilette d’un ressuscité. Une musique répétitive, obsédante signée Alexandre Desplat rythme l’opération. Elle sera omniprésente, douce et soudainement imposante, pendant tout le spectacle. Le type dans la baignoire doit être un clochard. Bientôt, revêtu d’un costume cravate, le voilà transformé en homme respectable à la beauté vénéneuse: il est Tartuffe, prêt à endosser sa nouvelle vocation, celle du faux dévot hypocrite. Sur le sol, une grande feuille de papier blanc: elle sera l’espace, l’arène où la tragicomédie se jouera. En d’autres termes, Ivo van Hove vient de planter son style rude et brutal. Du plafond, comme tombés du ciel, des lustres désormais éclairent somptueusement le plateau spectral… mais revenons à l’intrigue. Quelques semaines plus tard, Mme Pernelle (Claude Mathieu), la mère bigote, nous vante les qualités de Tartuffe: «C’est contre le péché que son cœur se courrouce, et l’intérêt du ciel est tout ce qui le pousse.» De son côté, Damis, le fils d’Orgon (Julien Frison), mène la fronde contre l’intrus dans la maison ou plutôt le ver dans le fruit. Lorsque Dorine, la suivante (Dominique Blanc, quelle actrice!, quelle présence!), se délecte de la langue de Molière, les mots coulent en sa bouche comme la rivière. Ainsi, quand elle déclare, se fichant de son maître, Orgon, marabouté par le scélérat, elle est tout simplement étourdissante: «Enfin il en est fou ; c’est son tout, son héros ;/ Il l’admire à tous coups, le cite à tous propos ;/ Ses moindres actions lui semblent des miracles,/ Et tous les mots qu’il dit sont pour lui des oracles.» Orgon, justement. Denis Podalydès excelle dans la peau de ce pauvre type béat se débattant dans le chaos familial. Son lent débit posé l’impose immédiatement. Il se montre une fois encore un grand acteur. Orgon/Podalydès réussit ce tour de force d’être ridicule sans l’être, oscillant entre l’amour - car, au-delà de la fascination, il s’agit bien de cela - qui le lie à Tartuffe et sa fatigue provoquée par le harcèlement de ses proches. Sans doute le spectateur retiendra-t-il une des dernières scènes, celle où Orgon, planqué sous le plancher, sort sa tête d’ahuri, témoin de la trahison de Tartuffe essayant quasi en slip de trousser sa femme, Elmire. Cette dernière est interprétée par Marina Hands. Dans ce rôle de belle tourmentée délaissée, on ne lui reproche rien. Ses jambes sont pleines d’esprit et ses lèvres tremblent à merveille. Irrésistibles dans sa gorge, ces mots: «Ah! de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.» On comprend Tartuffe lorsque, devant tant de convoitise, il lance cette célèbre réplique, les nerfs à vif et le corps bouillant: «Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme.» Christophe Montenez est un hypocrite au magnétisme fou. Un côté Nuit du chasseur. Il a «les yeux revolver», comme dit la chanson. Inquiétant, démoniaque, abject et veule, il tartuffe à merveille, entre rut bestial et flagellation. Ses confrontations avec Damis sont à haut débit. Les deux hommes s’affrontent en un duel digne du Far West - inutile de dire que le spectateur ne s’ennuie pas. N’oublions pas Cléante, le beau-frère d’Orgon, qui ne fait pas dans la fausse eau bénite. Pour ce rôle, Ivo van Hove a choisi Loïc Corbery, bonne pioche. Son tête-à-tête musclé sur le libertinage avec Orgon nous replonge dans nos chères années de lycée. Ce Tartuffe ou l’Hypocrite est d’une irrésistible noirceur comique. Ainsi la mort de Mme Pernelle est-elle un moment d’anthologie. Si la pièce commence par la toilette du SDF Tartuffe, elle se termine par la toilette de la défunte bigote. Et le décor, peu à peu, se déconstruit, les lumières s’amenuisent, la scène s’enténèbre. Sur un écran, le spectateur aura pu lire, telle une enseigne lumineuse, cette indication: «Fin de partie.» Si d’autres metteurs en scène, qui ont cru adapter Tartuffe, auraient mieux fait d’aller cueillir des pâquerettes, Ivo van Hove, servi par des comédiens d’exception, a bel et bien réussi son pari. Son travail est d’une belle couleur vert arsenic. Tartuffe ou l’Hypocrite, à la Comédie-Française (Paris 1er), jusqu’au 24 avril.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 19, 2022 12:27 PM
|
Rediffusion d'un portrait de l'acteur par Alexandra Schwartzbrod publié par Libération le 23 octobre 2004 Légende photo : Gaspard Ulliel en septembre 2004. (Jean-François Baumard) L’acteur français est mort ce 19 janvier 2022 dans un accident de ski à l’âge de 37 ans. Nous republions son portrait paru en dernière page de «Libération» en 2004. C’est peut-être ce doberman qui, en le griffant à la joue lorsqu’il avait 6 ans, lui a transmis un peu de ses gènes. Gaspard Ulliel en a gardé une drôle de cicatrice sous la pommette gauche. Un guillemet laissé ouvert. Une encoche qui se plisse quand il sourit et lui donne alors, selon l’humeur et la lumière, quelque chose d’animal. Un côté enfantin ou inquiétant. Parfois les deux, et c’est encore plus troublant. La caméra adore. Quand sa gueule d’ange balafré apparaît, elle bouffe l’écran. Ce n’est pas un hasard si ce comédien d’à peine 20 ans se retrouve ces jours-ci en haut de l’affiche de deux films. Un long dimanche de fiançailles, la dernière production de Jean-Pierre Jeunet (le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) et surtout le Dernier Jour de Rodolphe Marconi, un film intimiste, sombre, oppressant comme un ciel d’orage, qu’il porte sur ses épaules de bout en bout. Comme Laurent Terzieff ou Lambert Wilson avant lui, ce jeune homme a une sorte de grâce dangereuse, efflanquée. Sa mère, Christine, raconte que sa passion du cinéma remonte à ce soir de 1988 quand, pour regarder un film en paix, elle l’a assis à ses côtés devant la télé. C’était Jules et Jim. Il avait 4 ans. Coup de foudre pour Jeanne Moreau. Trop joli pour être vrai. Mais il confirme. La suite est plus banale. Fils unique de parents stylistes, Gaspard passe son enfance entre l’école et l’appartement familial, dans le centre de Paris, où il dessine pendant des heures. Sans problèmes majeurs. «On n’a jamais eu une vie conventionnelle, on a des relations très sympas», dit Christine. Un proche valide : «Gaspard a un lien étonnant avec sa mère. Comme s’il poursuivait chaque jour avec elle une conversation entamée à sa naissance.» C’est une amie de celle-ci qui lui propose d’intégrer l’agence de comédiens qu’elle vient de créer. Il a 11 ans. Après deux mois de castings, il obtient son premier (petit) rôle dans un téléfilm. Et il enchaîne. Seule contrainte : pas plus de deux tournages par an afin de préserver ses études. Passons sur son premier vrai rôle au cinéma dans Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc. A part l’exploit de basculer Charlotte Rampling sur un lit défait, rien de bouleversant. On le devine plus qu’on ne le remarque. «Pourtant, j’avais quarante jours de tournage, autant que Charlotte Rampling !» Le détonateur, c’est Téchiné. Dans les Egarés, Gaspard Ulliel incarne Yvan, un délinquant en cavale qui, pendant l’Exode, prend en charge deux enfants et leur mère, une veuve belle et sombre incarnée par Emmanuelle Béart. Pour ce rôle, il frôle le césar du meilleur espoir masculin. Tête rasée, cicatrice en avant, concentré de force et de souffrance, il traverse l’histoire comme une bête blessée, incroyablement présent et touchant. Il a à peine 18 ans. Une révélation. Depuis, il est resté gravé sur un coin de notre rétine. Rencontre dans un restaurant parisien où il aime traîner l’après-midi parmi les livres (qu’il lit peu), «pour écouter du jazz». Plus frêle qu’à l’écran. On le voyait félin, il a les cils et le cou d’un faon, une bouche comme une corne de gazelle. Il évoque, en fumant des Lucky Strike, le tournage du Téchiné, pas loin de «l’enfer». «André parle peu, il donne juste des bribes… Or, je comptais sur ses conseils. Au final, il a réussi à m’emmener exactement là où il voulait.» Avec Emmanuelle Béart, le contact est, dit-il, passé dans la seconde. Une chance. La fin du film voit le jeune Gaspard sodomiser la belle dans une scène d’une brutalité brûlante. Il l’évoque sans gêne. «Pendant les répétitions, j’étais en caleçon, Emmanuelle en body, tout allait bien. L’angoisse est arrivée la veille du tournage, je n’en ai pas dormi. Les premiers instants sont les plus difficiles, on est nus. Après, c’est comme quand on se jette dans le vide, on oublie. Sauf qu’à un moment, André m’a glissé à l’oreille : “Avant de la sodomiser, il faut que tu craches dans tes doigts.” Sur le coup, cela m’a paralysé, j’ai trouvé ça très vulgaire.» Son père, Serge, raconte : «Ils ont tourné cette scène le dernier jour. Le lendemain, je suis allé le chercher à l’aéroport. Gaspard était tout fier car Emmanuelle, dans l’avion, s’était endormie sur son épaule. Il m’a dit : “Tu vois, ça crée des liens !”» Après le bac, il s’inscrit à la fac de cinéma à Saint-Denis. Arrête au bout d’un an. «Cela a élargi ma culture cinématographique mais sinon, c’était décevant. Pas assez de pratique.» La vidéothèque lui a permis de découvrir certains cinéastes tels Chris Marker, et de revoir Bergman, Kurosawa ou Tarkovsky qu’il adore, comme Vincent Gallo et Gus Van Sant. Il confesse que la fac lui manque un peu. C’était un repère. «Après un tournage, c’est bizarre. On travaille de façon intense et soudain tout s’arrête, le vide absolu. Il faut trouver des choses pour combler, ça peut être angoissant.» Il fait de la photo, sa passion, mais cela ne lui suffit pas. Voir ses ongles rongés. Tout semble lui réussir mais ce n’est pas si simple. Il vient de rompre avec une copine qu’il avait depuis deux ans et demi. «Quand on s’investit dans un tournage, c’est difficile d’être ailleurs aussi.» Et, sur les cinq projets qui étaient inscrits sur son agenda, quatre ont été annulés faute de moyens. Il s’inquiète pour les traites du petit appartement qu’il vient d’acheter, à deux rues de celui de ses parents. Espère beaucoup que les essais pour le prochain film de Sofia Coppola seront concluants (il rêve de travailler avec des cinéastes étrangers, notamment asiatiques). Fait de la musculation chaque jour pour gagner 6 kg de muscles, exigence de son prochain tournage prévu en avril. Il dit qu’il n’est pas dans une logique commerciale et qu’il vient de refuser une dizaine de propositions. Son grand rêve reste d’écrire des scénarios et de les mettre en scène. «Je sais que c’est un travail énorme, qui nécessite une rigueur incroyable. Je ne me sens pas encore prêt.» Il s’est tout de même mis à l’écriture d’un projet. Dans Un long dimanche de fiançailles, il joue Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou), disparu en 1917 dans les tranchées, que la jeune femme refuse de croire mort. Un rôle tout en souffrances, en silences. «Jeunet, contrairement à Téchiné, travaille beaucoup en amont, tout est “story-boardé”, j’ai appris plein de choses sur ce cinéma-là», dit-il. Rien à voir avec le Dernier Jour, un scénario que le réalisateur avait dans ses tiroirs et qu’il a réécrit pour lui. Beau film sur l’adolescence et le refus du mensonge, avec une Nicole Garcia troublante. «Quand j’ai rencontré Gaspard, j’ai su que c’était lui. Je lui dois beaucoup. Il a donné au film une lumière, un ton… C’est quelqu’un qui prend de l’épaisseur dans la durée, on a envie de laisser traîner la caméra sur lui», raconte Rodolphe Marconi. Pour lui, «Gaspard est un ciel bleu traversé de nuages qui n’éclatent jamais. Un garçon étrange, difficile à percer. Il a sûrement une fêlure, le jour où ça va s’ouvrir, ça va faire mal…» Et s’il était un animal ? Gaspard Ulliel répond : «Un reptile, bête très sereine, qui concentre son énergie.» Gaspard Ulliel en 6 dates 25 novembre 1984: Naissance à Neuilly-sur-Seine. 1995: Une femme en blanc (téléfilm). 2001: Embrassez qui vous voudrez, de Michel Blanc. 2003: Les Egarés, d’André Téchiné. 27 octobre 2004: Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet. 3 novembre 2004: Le Dernier Jour, de Rodolphe Marconi.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 6:38 PM
|
Par Emilie Grangeray dans Le Monde - 18 janvier 2022 Six de ses comédiens, dont Eric Ruf, son administrateur général, reviennent sur les fondements et les piliers de cette belle maison, qui célèbre cette année les 400 ans du « patron ». Avec érudition toujours, et humour aussi. MYCANAL – À LA DEMANDE – ÉMISSION Alors qu’une partie de la troupe de la Comédie-Française était à l’arrêt en ce début d’année, variant Omicron oblige, et alors que l’on fête les 400 ans de la naissance du « patron » – c’est ainsi, ici, que l’on nomme Molière –, Antoine de Caunes a réuni autour de sa table six comédiens et comédiennes de cette maison (saluons la parité honorée : Suliane Brahim, Claïna Clavaron, Marina Hands, Birane Ba, Denis Podalydès et Eric Ruf). Mais, d’abord, un tour de table et un peu d’histoire. Les plus anciens – Denis Podalydès et Eric Ruf – s’y collent avec érudition et humour. Notamment quand l’Antoine (de Caunes), jamais à court de potacherie et après avoir rappelé que la ruche est l’emblème de la Comédie-Française, laisse un Eric Ruf désarçonné au moment où il lui décoche un : « Alors, ça fait de vous la reine ? » C’est que le comédien, scénographe et metteur en scène est aussi, depuis 2014, l’administrateur général de la maison. Ou plutôt « l’organisateur de ce bordel », rebondit celui qui manie le verbe avec un talent plus que certain. Et de rappeler que la Comédie-Française, c’est quelque neuf cents représentations par an, que jamais, sauf au mois d’août, il n’y a relâche, et que quelque soixante comédiens y butinent donc du soir au matin. La troupe, le répertoire et l’alternance Née, sur ordonnance royale de Louis XIV, le 21 octobre 1680 – sept ans après la mort de Molière en 1673 –, de la réunion de la troupe de l’hôtel de Bourgogne et de la troupe du Roy de l’hôtel Guénégaud (les comédiens de Molière), la maison repose sur trois piliers : la troupe, composée de pensionnaires engagés par l’administrateur et pouvant devenir, après la première année, sociétaires, sur proposition du comité d’administration ; le répertoire, soit aujourd’hui quelque 3 500 textes (avec lesquels, se réjouit Eric Ruf, « on a la chance, le luxe verbal, de boxer ») ; et enfin l’alternance : une même semaine, jusqu’à cinq pièces différentes peuvent être proposées. Mais l’alternance concerne aussi les comédiens : la troupe jouant jusqu’à huit pièces simultanément sur les trois plateaux de la Comédie-Française (Richelieu, le Vieux-Colombier, le Studio-Théâtre), plusieurs comédiens sont distribués sur un même rôle. Une alternance parfois difficile à vivre, tout comme l’est la devise de la troupe : Simul et Singulis (être tout à la fois ensemble et soi-même). Vient alors, parfois, la tentation de quitter la Maison, comme a pu le souhaiter Marina Hands avant d’y faire son retour – elle joue, en ce moment, Elmire dans Le Tartuffe ou l’Hypocrite, version originelle, interdite après la première représentation de 1664, et hautement attendue dans la mise en scène d’Ivo van Hove. Profession Comédie-Française, animé par Antoine de Caunes (Fr., 2022, 60 min). Sur MyCanal jusqu’au 28 février. Emilie Grangeray

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 10:38 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 17 janvier 2022 Légende photo : Océane Caïraty, dans le parking de son immeuble à Paris (20e arrondissement), le 21 décembre 2021. BAUDOUIN POUR « LE MONDE » « Promesses de 2022 » (12/12). Douze artistes à suivre. Ancienne joueuse professionnelle de foot, la jeune comédienne sera à l’affiche de six spectacles cette année. Heureuse qui comme Océane a fait un beau voyage… La jeune femme a franchi la distance abyssale qui la séparait de ses rêves, enfoncé les défenses adverses de la reproduction sociale et des préjugés de classe. Et là voilà aujourd’hui, comédienne épanouie, à l’affiche de pas moins de six spectacles en cette année 2022, sans compter un petit rôle dans Les Olympiades, le film de Jacques Audiard. On retrouvera sa haute silhouette élégante, son charme et sa douceur tout d’abord dans La Cerisaie de Tchekhov, mise en scène par Tiago Rodrigues, où elle joue Varia, la fille adoptive de Lioubov Andreevna, incarnée par Isabelle Huppert. Le spectacle a fait l’ouverture du Festival d’Avignon en juillet dernier dans la Cour d’honneur du Palais des papes et Océane Caïraty s’est dit qu’elle avait eu raison de suivre le chemin de son désir. Ce chemin commence dans un quartier HLM de Saint-Denis de La Réunion, où les enfants vivent dehors et jouent au foot, filles comme garçons, tous les jours. Océane Caïraty se souvient d’« une enfance heureuse, pleine d’aventures et libre ». Elle se rappelle aussi de son désir, « obsessionnel », de larguer les amarres et d’aller vers cette France métropolitaine qui faisait miroiter ses mirages via la télévision. Et des DVD de films de Bollywood, qu’elle regardait en boucle. Courir après ses rêves, ce sera d’abord, pour elle, courir après un ballon. Repérée dès son entrée en club à La Réunion, Océane Caïraty connaît un parcours fulgurant dans un football féminin qui, au cours de ces années 2000, se professionnalise et accède à la reconnaissance. A quinze ans, elle se retrouve pour cinq ans dans le milieu bien particulier des jeunes sportifs de haut niveau et devient défenseuse centrale de l’équipe de l’Olympique lyonnais, plusieurs fois championne de France. La jeune femme aurait pu s’en tenir à cette vie somme toute facile, pour elle qui, à l’époque, joue au foot les doigts dans le nez, sans effort particulier. « Et puis un jour, je suis allée voir une exposition sur les métiers du cinéma et je me suis dit que c’était ce dont j’avais toujours rêvé, être actrice ». « Manger du théâtre » Elle monte à Paris où elle « coche toutes les cases de la galère ». Et finit par tomber sur le Théâtre de la Colline et son programme 1er Acte : un dispositif particulier, mis en place par Stéphane Braunschweig et Stanislas Nordey en 2014, visant à donner un coup de pouce, une chance d’accéder aux scènes du théâtre public, à des jeunes se sentant en dehors du cercle, souvent « issus de la diversité », comme on dit aujourd’hui. Tout s’est alors enchaîné avec une forme d’évidence, à commencer par l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), où elle a « mangé du théâtre par tous les bouts » pour « rattraper [son] retard ». Océane Caïraty y fait deux rencontres décisives : celle de la comédienne et formatrice Véronique Nordey (1939-2017), qui l’encourage à jouer Racine, et celle du regretté Jean-Pierre Vincent, décédé en novembre 2020, qui travaille L’Orestie avec ses élèves, les ramenant ainsi aux origines du théâtre et fait d’Océane une superbe Athéna, noble et sculpturale. « Comme je n’aime pas beaucoup le réel, être conviée par des réalisateurs à l’intérieur de leurs fictions me met en joie » Depuis, elle n’a pas arrêté. Elle a joué avec Stéphane Braunschweig, Arthur Nauzyciel, Pascal Rambert ou l’auteur et metteur en scène Lazare, passant en souplesse d’un univers à l’autre. « Ce qui me plaît par-dessus tout, c’est de rentrer dans l’univers d’un metteur en scène, de développer ma partition à l’intérieur d’un cadre, plus que la construction de personnages, note-t-elle. C’est un peu comme si on me lâchait dans un parc d’attraction en me disant “vas-y, joue !” Comme je n’aime pas beaucoup le réel, être conviée par des artistes à l’intérieur des fictions qu’ils inventent me met en joie. » Vers plus de diversité Et puis Océane Caïraty accompagne, avec le calme et la sérénité lumineuse qui la caractérisent, le vaste mouvement en cours pour ouvrir le théâtre français vers plus de diversité. « Je suis bien placée pour savoir qu’un comédien noir peut aujourd’hui aussi bien jouer des rôles du répertoire, universels, sans que sa couleur de peau fasse sens, que se faire le porte-parole d’auteurs et de récits qui n’avaient pas voix au chapitre jusque-là », constate-t-elle. Elle se dit aussi heureuse de jouer Tchekhov ou Alexandre Dumas que d’incarner la parole de l’écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano ou celle de la jeune dramaturge afro-caribéo-britannique debbie tucker green. De la première, la jeune comédienne porte Ce qu’il faut dire, un ensemble de trois chants poétiques et politiques mis en scène par Stanislas Nordey. De la seconde, elle joue Mauvaise, une pièce montée par Sébastien Derrey. Les deux spectacles tournent au long de cette saison, où l’on la verra un peu partout sur les scènes de France. Avant, peut-être, qu’elle ne réalise son rêve ultime : incarner les héroïnes shakespeariennes de Comme il vous plaira ou de La Nuit des rois. Lesquelles lui iraient comme un gant, avec son jeu fluide et aérien. « Promesses de 2022 », une série en douze épisodes Douze portraits de jeunes artistes à découvrir en ce début d’année. - Sofia Teillet, comédienne
- Paula Luna, actrice
- Emilie Gleason, autrice de bande dessinée
- Pilani Bubu, chanteuse
- Le duo Ittah Yoda (formé par Virgile Ittah et Kai Yoda)
- Guy2Bezbar, rappeur
- Ymane Chabi-Gara, plasticienne
- Maxime Chamoux, musicien, scénariste et journaliste
- Adélaïde Ferrière, percussionniste
- Mellina Boubetra, danseuse
- Léon Volet, acrobate
- Océane Caïraty, comédienne

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 4:11 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 17 janvier 2022 Au théâtre de la Colline, Isabelle Lafon parvient à faire entendre l’autrice en montrant seulement ses interlocuteurs. Un spectacle qui interroge la notion de basculement. C’est un pari tout à fait inédit : faire entendre Marguerite Duras, non par ses textes, fussent-ils les moins connus, mais par son écoute. L’attraper non par ce qu’elle a dit, scandé, affirmé ou écrit, mais en restituant des rencontres avec des enfants de la Ddass, des mineurs dans une bibliothèque à Harnes, dans le Pas-de-Calais, à qui elle lit deux poèmes de Michaux, la stripteaseuse Lolo Pigalle, ou encore avec l’écrivain et journaliste Pierre Dumayet, inventeur du premier magazine littéraire télévisuel, Lectures pour tous. La montrer par ses interlocuteurs en somme. C’est un spectacle ultra-sympathique, bourré de chemins de traverse, de fausses-vraies digressions, d’imprévues, de péripéties, qui ne sanctuarise pas la grande autrice, mais s’ancre sur sa curiosité sans limite, et sa manière de densifier le quotidien, de le mettre en relief. L’air de rien Sur scène, il n’y a quasiment pas de décors, et surtout pas Duras. Une table, des dossiers, des archives et trois acteurs, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon et Pierre-Félix Gravière, aux prises avec ce fouillis de papiers. Au tout début, avant que le spectacle ne commence et que les spectateurs ne se taisent, ils tentent d’entrer sur le plateau discrètement, en catimini, pour regarder la salle. Mais voilà, dit en substance la metteuse en scène Isabelle Lafon, il suffit de leur présence pour que les spectateurs fassent le silence, que leurs conversations masquées restent en suspens, que les rôles se rigidifient. «Mais non, nous prévient-elle, le spectacle n’a pas encore commencé, vous pouvez continuer à parler. On est entrés en avance sur le plateau.» Peine perdue, on fait silence. Les Imprudents – titre qui fait écho au premier roman de Duras paru chez Plon en 1943, les Impudents – est donc un spectacle sur la bordure, le basculement : peut-on entrer dans la fiction l’air de rien, en toute discrétion ? Peut-on glisser dans les paroles de Duras comme sur un toboggan, en parlant d’abord de soi, d’un steak «au côté vert» acheté malencontreusement ou de sa chienne ? Ou dans la peau d’un autre sans prévenir, en cachette ? Les trois acteurs commencent donc à jouer leur propre rôle, le spectacle s’ouvre sur une échappée, une confidence, le plaisir ambigu d’Isabelle Lafon de devenir «Madame Margo», grâce à son chiot, un setter, au bois de Vincennes, puisque les maîtres s’appellent entre eux par le nom de leur chien… Le glissement se poursuit dans la façon qu’ont Johanna Korthals Altes et Pierre-Félix Gravière d’esquisser dans leur corps la pléiade d’interlocuteurs de Duras, d’un mineur à des adolescents, ou passant par un intellectuel à une stripteaseuse grâce à des mini-modifications de voix, de postures, de gestes, jusqu’à une hallucination finale : oui, c’est bien Duras qui est là, à Neauphle, au bord de la route devant sa maison. Isabelle Lafon ne la singe pas, mais la fait apparaître jusque dans le grain de la voix qu’elle a perdue à la toute fin de sa vie. Son chiot est entré dans la maison. Comment s’appelle-t-elle ? Isabelle Lafon n’ose répondre à l’écrivaine. Le théâtre, art de donner chair aux fantômes, qui fait vivre pour de vrai des conversations on ne peut plus réelles qu’on croirait issues d’insomnies. Les Imprudents, conçu et mis en scène par Isabelle Lafon, à la Colline, à Paris, jusqu’au 23 janvier.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 17, 2022 6:36 PM
|
Par Nathalie Simon dans Le Figaro - 17 janvier 2022
Valérie Lesort met en scène Le Voyage de Gulliver, au théâtre de l’Athénée
. Fabrice Robin
ENTRETIEN - Au théâtre de l’Athénée, à Paris, la comédienne plasticienne adapte Le Voyage de Gulliver. Retour sur un parcours à succès.
Valérie Lesort parle du Voyage de Gulliver, de Jonathan Swift, son «bébé». Enfant de la balle, l’artiste avignonnaise signe l’adaptation libre du texte, le met en scène avec son compagnon, Christian Hecq, et joue en alternance le rôle de la reine Cachaça.
LE FIGARO. - Quelle est l’origine du projet? Valérie LESORT. - On est un peu des spécialistes d’adaptations d’œuvres qui ne sont absolument pas théâtrales, les plus compliquées possibles! On cherche des œuvres où le visuel peut intervenir en plus du travail du corps, qui est la marque de fabrique de Christian (Hecq). L’écriture tourne beaucoup autour de la contrainte technique. Pour Le Voyage de Gulliver, c’est moi toute seule, mais on reste dans notre univers. Nous avions fait Monsieur Herck pour Canal+, un petit bonhomme hybride. C’était la première fois que nous travaillions ensemble. Christian avait également collaboré avec Philippe Genty - notre maître - pour son spectacle Boliloc, sur le même dispositif. On a adoré ces petits personnages. Ensuite, j’ai fait Petite balade aux enfers, une adaptation d’Orphée et Eurydice de Gluck pour l’Opéra Comique avec des marionnettes hybrides. Le Voyage de Gulliver a été le plus compliqué. Pourquoi? Ce que vous voyez sur scène n’est rien par rapport à tout ce qu’on fait derrière. Par exemple, quand je danse sous les traits de la reine Cachaça, c’est quelqu’un d’autre qui manipule mes jambes. On a intérêt à bien s’entendre (en riant). On fait ce qu’on veut. Ou on manipule les mains, ou les pieds, ou on ouvre les rideaux, ou on transporte les décors. On est tout le temps en train de ramper derrière le plateau. Petit à petit, on perfectionne le dispositif du théâtre noir. C’est une usine à gaz Valérie Lesort C’est bien de travailler avec la même équipe. On se suit, on apprend, on grandit ensemble, que ce soit avec la plasticienne Carole Allemand ou Pascal Laajili pour les lumières. Petit à petit, on perfectionne le dispositif du théâtre noir. C’est une usine à gaz. Pourquoi avoir choisi Le Voyage de Gulliver? Écrite en 1726, l’histoire est géniale, elle parle de la bêtise humaine, des guerres, du pouvoir absolu et d’intolérance, qui sont malheureusement toujours d’actualité. Ces différends autour d’œufs à la coque entre les Petitsboutiens et les Grosboutiens et la scène où Gulliver fait pipi sur le château pour éteindre l’incendie sont dans le roman. Moi, j’ai inventé le dénouement avec les œufs sur le plat et les rôles féminins, j’ai l’impression que la femme n’existait pas à l’époque! J’ai juste tiré les fils de l’œuvre originale. Je tenais à ce qu’il y ait des images de Gulliver attaché, de Gulliver qui tire les bateaux… Le jeu d’acteurs arrive en dernier. On est rigolos avec nos costumes, mais je voulais un double niveau de lecture, pour les adultes, pas seulement les enfants. Il y a de la cruauté, et la musique de Dominique Bataille apporte une tonalité sombre. J’ai aussi écrit les chansons sur les musiques de Mich Ochowiak, qui avait adapté celles de Lully pour Le Bourgeois gentilhomme. Pour une fois, vous êtes quasiment seule aux commandes… Oui, j’ai mis du temps à exister, on revient de loin. Là, c’est davantage mon bébé que celui de Christian. En plus, je joue dedans. J’ai le sentiment qu’être sur scène fait qu’on est plus dans la lumière. Pourquoi avez-vous choisi de jouer la reine Cachaça? C’est un hasard. J’ai une formation de comédienne, mais ce n’est pas mon métier principal. Ça a commencé avec le Cabaret horrifique, que j’avais monté à l’Opéra Comique. J’ai fini par y jouer parce qu’il n’y avait personne pour faire les bruitages. On a écrit La Mouche avec Christian. Je me suis retrouvée à interpréter Marie-Pierre, mais je ne l’avais pas écrit pour moi. J’ai repris goût à la scène. En plus, j’ai été nommée aux Molières. Cachaça, c’est mon fantasme absolu, surtout la chanson. J’ai toujours rêvé de faire un truc à la Marilyn et à la Zizi Jeanmaire. Même si je mesure 50 centimètres! Je joue en alternance avec Emmanuelle Bougerol. J’ai d’autres mises en scène, comme Marilyn, ma grand-mère et moi, actuellement au Théâtre du Petit Saint-Martin, et, en mai, je monterai La Périchole à l’Opéra Comique. Je m’ennuyais en cours, je n’ai pas réussi à former une famille théâtrale et me suis reconcentrée sur le travail de plasticienne Valérie Lesort Comment êtes-vous devenue plasticienne et metteuse en scène? Ma grand-mère était comédienne, mon grand-père scénariste-réalisateur, ma mère critique de théâtre et mon père est bricoleur, il avait des ateliers. De son côté, il y avait aussi des graveurs. Le théâtre est venu petit à petit. C’était plutôt les effets spéciaux, les monstres de cinéma qui m’attiraient. Mon premier choc, c’est Thriller, de Michael Jackson, vers 8, 9 ans. J’ai vu La Mouche plusieurs fois, L’Exorciste, Freaks… Je suis fan aussi du «Muppet Show». J’étais cancre à l’école, sauf en dessin, musique et français. J’ai fait une école de maquillage, à Aix. Je viens d’un village qui s’appelle Gréasque. À 19 ans, j’ai travaillé sur Le Hussard sur le toit, de Jean-Paul Rappeneau, j’ai rencontré le grand maquilleur Daniel Parker. Il m’a proposé de venir dans ses ateliers pour me former. Je suis partie à Londres et ai travaillé dans les studios de cinéma de Shepperton. Après, je suis allée au Portugal pour l’Exposition universelle, puis je suis revenue à Paris, où j’ai travaillé pour les «Guignols», Karl Zéro… Mais il y avait un manque. J’ai été comédienne, j’ai trouvé ça atroce! On dépend du désir de l’autre, et se retrouver à 25 ans dans des castings pour vendre une pizza… Je m’ennuyais en cours, je n’ai pas réussi à former une famille théâtrale et me suis reconcentrée sur le travail de plasticienne. La rencontre avec Christian Hecq a été un déclencheur artistique? Oui, on s’est rencontré en 2004 dans Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes, je fabriquais les accessoires. On est tombé amoureux plus tard, en 2010. On n’avait pas l’intention de travailler ensemble, mais, un jour, Canal+ lui a demandé un programme court. J’ai donné l’idée de la marionnette hybride. On a commencé à écrire et à réaliser tous les deux. Éric Ruf, devenu administrateur général de la Comédie-Française, a dit qu’on pouvait lui suggérer des idées de création. J’ai pensé à Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne. Ça a été ma première mise en scène, je me suis rendu compte que c’était ce que je voulais faire. En 2018, Olivier Mantei nous a contactés pour mettre en scène Le Domino noir à l’Opéra Comique (grand prix de la critique du meilleur spectacle lyrique, NDLR). Il m’a fait confiance ensuite pour monter Ercole amante. Après, il y a eu Le Bourgeois gentilhomme. Plus on a du succès, plus on subit la pression Valérie Lesort N’êtes-vous pas désormais attendue par le public et les critiques? Oui, ce n’est pas rassurant! Plus on a du succès, plus on subit la pression. Ce qui nous émeut, c’est le retour à l’enfance. On n’a pas d’autre prétention que le divertissement, que le spectateur s’évade, et de faire des spectacles pour tous. J’adore inventer des trucs artisanaux et faire croire à des choses magiques, comme la barque de Gulliver ou l’éléphant que les gens voient débarquer dans Le Bourgeois gentilhomme. J’aime que les choses soient plus grandes que la vie. Propos recueillis par Nathalie Simon / Le Figaro
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 2022 5:23 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 25 janvier 2022 Légende photo : Scène "Le jeu des ombres" © Pascal Victor Valère Novarina a écrit « Le Jeu des Ombres » à partir du mythe d’Orphée et d’Eurydice. Une commande de Jean Bellorini qui associe son adaptation de la pièce à l’ « Orfeo » de Monteverdi. Un spectacle de haute intensité. ll n’est pas si fréquent que des metteurs en scène (et encore moins des directeurs de théâtre) passent commande d’une pièce à un auteur ou une autrice. Applaudissons donc Jean Bellorini d’avoir commandé à Valère Novarina une pièce autour du mythe d’Orphée et Eurydice, mythe qui nous a déjà valu, au fil des siècles, une liste respectable de chefs d’œuvre en tous genre. En voici un de plus : Le Jeu des Ombres. Il y a longtemps , avant même que Novarina ne soit un auteur connu, Marcel Maréchal, cet amoureux d’un théâtre du verbe, lui avait déjà commandé un Falstafe (une adaptation libre de Shakespeare), alors qu’il était à la tête d’un théâtre lyonnais comme Bellorini s’apprêtait à l’être du TNP lorsqu’il a passé commande. La pièce et le spectacle portent le même titre, mais on ne saurait les confondre. Quand Novarina a livré son texte au long cours (268p, édité chez POL comme toute son œuvre), il a laissé une liberté totale d’adaptation au metteur en scène. Si Bellorini a donc très librement adapté le texte ( en y coupant des scènes , en en assemblant d’autres qui ne l’étaient pas, en changeant des noms de personnages-par exemple « les personnages de la pensée » que sont le Déséquilibriste, le Déléatur, et Le Décupleur, deviennent les trois Enfants de la colère , etc.), c’est aussi que son projet, comme la plupart de ses spectacles, avait d’entrée de jeu une visée musicale : associer l’Orfeo de Monteverdi (dont le texte du livret est projeté) à la partition sonore de Novarina. Et en y ajoutant des compositions originales signées Sébastien Trouvé, Jérémie Poirier-Quinot, Jean Bellorini et Clément Griffage Un dialogue entre La Dame de pique (Eurydice) et Le Valet de carreau (Orphée) ; non repris dans l'adaptation scénique (on aurait frisé le pléonasme), résume bien le rôle de la musique dans le spectacle: « La dame de pique. La parole existe-t-elle avant la pensée ? Le valet de carreau. Peut-être. La musique, très certainement. La dame de pique. Et qu’est-ce qu’elle vous dit ? Le valet de carreau. Elle n’accompagne pas le drame, elle le délivre ; elle frôle, elle va parfois jusqu’où s’ouvre l’espace, jusqu’où joue la pensée. » Sous le même titre Le Jeu des Ombres, on peut donc voir et entendre un riche spectacle de Jean Bellorini, et lire (au besoin à voix haute) une pièce, non moins riche, de Valère Novarina. Le spectacle aurait dû ouvrir le festival d’Avignon dans la Cour du Palais des papes, il y a deux ans. La manifestation ayant été annulée pour cause de pandémie, le spectacle a été créé quelques mois plus tard à la Fabrica d’Avignon lors d’un semaine d’art automnale. Le voici présentement programmé durablement au TNP de Villeurbanne dont Jean Bellorini a pris la direction et où le spectacle a été de nouveau mais brièvement répété. Une tournée suivra. Les Ombres du titre sont celles du monde d’en bas, des enfers (à un moment les flammes rayent le plateau d’un grand trait de feu), mais aussi celle des coulisses, du théâtre où veillent une théorie de servantes sur un piano où repose comme un songe nocturne. Le spectacle est ainsi traversé de visions aussi intuitives que fulgurantes. Bellorini n’explique rien, au mieux il suggère. Il faut se laisser porter par les mots et les notes , leur enchaînement, leur dialogue fécond eqntres les musiques et le livret de Monteverdi et les mots de Novarina. Ainsi L’Homme hors de lui explique à son pote Orphée : »Dans notre langue (si tu veux bien, comme les Latins, ne pas distinguer le u du v) ,il y a a un anagramme du mot DIEU, c’est le mot VIDE. Dans toutes nos phrases Dieu est un vide, un mot en silence, un trou d’air, un appel qui permet à l’esprit de reprendre souffle ». A Orphée qui demande une explication, L’Homme hors de lui se lance alors dans une énumération de définitions de Dieu allant d’Alain de Lille à Jean l’Evangéliste, en passant par Bossuet, Leibnitz, le Coran, Voltaire, Nietszche, Dostoïevski, Lacan, Rimbaud, Breton, Baudelaire, Mallarmé, Gainsbourg, Epicure, Leiris, Novarina («Dieu est la quatrième personne du singulier ») et des dizaines d’autres. Moment exaltant, délirant, performatif, moment d’inventaire, spécialité de la maison Novarina, très attendue par ses fidèles lecteurs. A l’issue de quoi, Orphée déclare : « Il y a donc un mot qui Le désigne dans notre langue, mais ce n’est qu’un mot...Aucun mot ne le saisit. Ce qui lui est le plus proche, ce n’est pas son nom, ce n’est pas l’un de ses neuf-cent nonante-neuf noms, c’est la parole même. » Avec raison, Jean Bellorini a coupé une longue séquence très personnelle où, pendant que Pluton et Hécate dialoguent, surgissent un à un les morts de Novarina, à commencer par son défunt acteur fétiche Daniel Znyk. Puis, acteurs ou pas, tous très chers, tous disparus comme Michel Baudinat, Anne Wiazemsky mais aussi Alain Cuny, Paul Otchakowsky, Michel Corvin, Tsilla Chelton , Christine Fersen, Clément Rosset et bien d’autres. Dans la distribution du spectacle on note la belle présence d’une actrice novarinienne historique: Laurence Mayor. Bref, on se perd forcément (et c’est bien ainsi) dans ce dédale de mots et de musiques aux pentes escarpées, mais l‘Orfeo de Monteverdi, nous tient la main. Novarina en profite pour imaginer un dialogue (qui n’est pas dans le spectacle) entre l’actrice Julia Bartet (célèbre pour son interprétation de Bérénice, modèle de Proust pour la Berma, elle se retira du théâtre en pleine gloire) et Robert le Vigan (acteur explosif et bondissant, ami de Céline et collaborateur, il trouvera refuge en Amérique latine) : « Julia Bartet. Lorsque Orphée eut assez pleuré Eurydice sur terre, il voulut descendre dans le monde des ombres, par le Styx. Traversant des simulacres de peuple et des fantômes sans sépulture, il rejoignit Perséphone et celui qui règne sur l’abominable royaume des ombres. Alors, pour accompagner sa lyre, il chanta. Robert Le Vigan. Les quatre membres d’Orphée sont dispersés ça et là. C’est toi, fleuve de l’Hèbre ! Qui reçoit sa tête- et sa lyre. Et voici qu’emportée par le courant, sa lyre fait entendre de tristes accords ; et voici que sa langue -séparée de son corps, privée de sentiment -murmure encore une mélodie plaintive – et les rives y répondent par les plaintes de l’ écho ». Et c’est qui demeure dans le spectacle de Bellorini : les plaintes de écho , la musique « qui déploie sans rien dire la beauté du temps » comme dit La Mesure. Ainsi Monteverdi et Novarina dialoguent-ils sous la baguette du maestro Bellorini dans « la discordanse des temps ». Le spectacle s’achève avec Orphée. Un jour où , seul, il joue de la trompe « dans un bois splendide », « onze cent onze » oiseaux « vinrent se pacifier » à ses pieds. Alors, il les nomme, un à un : « la limnote, la fuge, l’hypille, le ventisque, le lure, le figile, le lepandre, le ramble, l’entrève... ». Jusqu’au dernier. Le texte de Novarina continue le temps d’une dernière scène qui s’achève par un dernier inventaire. Jean-Pierre Thibaudat Le Jeu des ombres, un spectacle de Jean Bellorin. Au TNP jusqu’au 31 janv. Puis du 10 au 12 fév à la Comédie de Clermont-Ferrand, les 18 et 19 fèv, au Grand théâtre d’Aix en Provence, du 9 au 20 mars aux Gémeaux de Sceaux, du 24 au 26 mars au Quai d’Angers, du 31 mars au 3 avril à la Criée de Marseille, du 20 au 21 avril à l’Opéra de Massy, les 10 et 11 mai à la Scène Nationale de Bayonne, le 15 juillet au festival de Chateauvallon. Le Jeu des ombres, un texte de Valère Novarina. Publié aux Editions POL, 268p 17€

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 24, 2022 9:52 AM
|
par Ève Beauvallet dans Libération 24 janvier 2022 Légende photo : «Elles vivent» est la comédie de l’ambivalence assumée, où cohabitent la dérision de la sylvothérapie et le secret espoir qu’elle nous montre la sortie. (Matthieu Edet) A quelques semaines de la présidentielle, l’artiste belge rafle la mise avec sa farce de politique-fiction. Le stand de tir spécial «Présidentielle 2022» est ouvert. Sur place, la noble famille du théâtre public a prévu de déballer, comme toujours, les grands textes du répertoire pour montrer à quel point Shakespeare nous alertait déjà sur l’ascension de Zemmour. Un peu plus loin, les sempiternels «snipers» de l’humour politique Stéphane Guillonesques ou Christophe Alevêcoïdes sont déjà installés, là, sur vos colonnes Morris, avec leurs stand-up «au vitriol» visant tous dans la même direction, avec tous les mêmes mitraillettes automatiques rutilantes. On allait donc rejouer la même partie. «Smiley poussin» Et soudain, l’outsider Antoine Defoort (Germinal, Un faible degré d’originalité…) est arrivé pour relancer les dés, avec son esthétique pistolets à eau et canards en plastique, ses nouilleries ambiance Bastien Vivès ou Fabcaro, son look d’étudiant en web design fan des Lapins crétins, son amour du théâtre méta-malin et de la lol-distanciation, ses croquis volontairement bidon, mais aussi un solide bagage théorique en sciences du langage et de l’infocom qui lui permet de créer aujourd’hui Elles vivent, le seul grand spectacle sur la politique qu’on vous suppliera d’aller voir en ce moment. Nous sommes ici dans le futur et le futur est très rigolo à traiter au théâtre si l’on aime, comme Antoine Defoort, les effets spéciaux «low-tech» évidemment pourris. Dans ce futur, on se souvient, à coups d’hologrammes faits maison, des idéaux portés lors des dernières élections par un petit parti devenu grand. Voici donc l’histoire des espoirs et des renoncements du jeune think tank politique PCM (Plateforme contexte et modalités) qui entendait réinventer les modalités du débat démocratique et faire en sorte qu’enfin, les gens «s’écoutent». Elles vivent ne parle donc jamais du fond, mais du contexte d’énonciation et de réception du message. Dans la salle de réunion, on brainstorme : faut-il en passer par la création de pancartes «smiley poussin» à brandir sur les plateaux télé face à l’adversaire, pour lui certifier que l’on est prêt à «prendre soin» et à «recueillir» sa parole ? A croire que non, puisque le PCM, traumatisé par la violence du jeu médiatique, perdra finalement les élections et se transformera trois ans plus tard en école de magie paradoxale. Novlangue bullshiteuse Ont-ils été, et sont-ils encore, «ridicules» avec leur «bisounourserie» comme l’affirmait l’infâme Erwan Dubreucq, leur adversaire politique ? On ne saura jamais vraiment. Et c’est précisément cette indécision vis-à-vis de la cible qui donne à la farce de politique-fiction une mélancolie si belle. La dernière fois qu’un auteur de comédie s’est saisi avec autant d’acuité qu’eux de la novlangue bullshiteuse du développement personnel – ce monde plein de rituels de soin où l’on accueille la parole –, c’était Blanche Gardin dans sa série la Meilleure Version de moi-même. C’était une satire sans ambiguïté, avec une cible claire – ce qu’elle tient pour l’hypocrisie du militantisme «woke» – moquée avec surplomb. Tout au contraire, Elles vivent est la comédie de l’ambivalence assumée, où existent simultanément la dérision de la sylvothérapie et le secret espoir qu’elle nous montre la sortie. On rit beaucoup ici des séances de deep-mindfulness en forêt de Fontainebleau, mais sans être jamais tout à fait sûr que ne réside précisément ici le remède qui puisse enfin nous sauver du merdier. C’est dire si on est tous paumés. Elles Vivent d’Antoine Defoort, jusqu’au 27 janvier au CentQuatre à Paris, à Dunkerque en mars, à Bordeaux en avril.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 24, 2022 5:51 AM
|
Par Le Figaro avec AFP - 24 janvier 2022 Photo : capture d'écran Instagram @joelPommerat Couple en mal d'enfant, amour de jeunesse... Le metteur en scène décline les pathologies de l'amour interprétées par des détenus. Ni décors ni costumes pour cette représentation imaginée dans des endroits «où le théâtre n'est pas attendu». Du théâtre revenu à l'essentiel: avec Amours 2, présenté en avant-première ce week-end à Marseille, Joël Pommerat poursuit, hors les murs de la prison mais dans une économie de moyens intacte, le travail engagé depuis 2014 avec des détenus purgeant de longues peines. Des chaises pour tout accessoire, un simple interrupteur rythmant la succession des scènes en guise d'éclairage et, tenant lieu d'horizon, une seconde pièce hors-champ qui devient comme un espace de fuite pour les personnages et d'où émanent bruits de coups ou sons d'ébats. Tentation de l'amour de jeunesse croisé par hasard, couple en mal d'enfant, amitié mise à mal par un souvenir: les pathologies de l'amour se déclinent en une série de saynètes dans lesquelles les mots pesés et incisifs de Joël Pommerat tiennent, avec leurs interprètes saisissants de justesse, le premier rôle. Un dépouillement d'abord dicté par les contraintes logistiques inhérentes à la détention après deux précédents spectacles, Désordre d'un futur passé en 2015 et Marius en 2017, qui étaient «extrêmement ambitieux et lourds sur un plan technique», explique Joël Pommerat. «Donc Amours a été fait dans cette forme très légère, très dépouillée, sans décor, sans costumes» puisqu'il fallait faire «un objet le plus discret et simple possible» afin de continuer à travailler dans le milieu carcéral, poursuit-il. À LIRE AUSSIUn conte de Noël, Contes et légendes, Une histoire d’amour... Les spectacles de la semaine «la plupart des gens avec qui on a construit cette équipe ne sont jamais allés voir un spectacle de théâtre» Joël Pommerat, auteur et metteur en scène Amours 2 ne conserve qu'une dizaine de textes, tirés de trois précédents spectacles de Joël Pommerat, pour cinq à six comédiens quand la première version en comptait environ le double. Parmi eux, deux anciens détenus: Redwane Rajel, qui a déjà joué sous la direction d'Olivier Py au Festival d'Avignon, et Jean Ruimi, l'homme à l'initiative de la troupe formée à la prison d'Arles. Ils sont accompagnés de trois comédiennes professionnelles. «La plupart des gens avec qui on a construit cette équipe ne sont jamais allés voir un spectacle de théâtre. Donc on a fabriqué du théâtre en toute innocence, en toute virginité», raconte Joël Pommerat, 58 ans, dont chacune des créations fait salle comble à Paris. À LIRE AUSSIJoël Pommerat, l'amour, il n'y croit pas «Dans le fond, c'est ça qui m'a retenu, cet engouement. Les gens avec qui on a bossé, ce sont les plus gros travailleurs que j'ai rencontrés. Des passionnés et des amoureux du travail», confesse-t-il, décrivant une expérience loin de l'entre-soi théâtral, ce «petit monde de gens qui se ressemblent». Pour la tournée, qui devrait débuter en septembre, Joël Pommerat imagine jouer Amours 2 dans une boucherie, un casino, un gymnase, une paroisse même. «À partir du moment où on arrive à faire une configuration comme celle-ci, à peu près, on peut jouer n'importe où . Le grand principe, c'est de garder cette intimité: faire du théâtre pour un petit nombre de spectateurs pour pouvoir aller le plus possible dans la proximité», ajoute-t-il. N'importe où sauf peut-être sur un plateau de théâtre: «C'est bien d'être à un endroit neutre où le théâtre n'est pas attendu». Le Figaro avec AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2022 8:31 AM
|
Par Fabienne Darge (Angers, envoyée spéciale) dans Le Monde (22 janvier 2022) Légende photo : Clémence Boissé, Théo Salemkour et Damien Marquet, dans « Le Dragon », au Quai, à Angers, le 17 janvier 2022. NICOLAS JOUBARD Au Quai d’Angers, le metteur en scène tire de la pièce d’Evgueni Schwartz une satire jouissive de la servitude volontaire.
Il crache du feu et flamboie sans vergogne, ce Dragon que met en scène Thomas Jolly. Pour sa première création en tant que directeur du Quai, le centre dramatique national d’Angers, le jeune metteur en scène surdoué signe un spectacle réjouissant et fédérateur, qui mêle le show et la fable politique, et a emballé le public lors de la première, le 18 janvier. Thomas Jolly y montre une nouvelle fois sa capacité à réinventer un théâtre populaire pour aujourd’hui, sans céder sur une forme d’exigence. Sa première bonne idée est d’être allé retrouver cette pièce merveilleuse et rarement montée sous nos latitudes. Le Dragon a été écrit en 1944 par le journaliste, écrivain et dramaturge russe Evgueni Schwartz (1896-1958). Celui-ci n’était pas trop en odeur de sainteté auprès des autorités soviétiques, et ce, depuis les années 1930, quand il avait signé des pièces inspirées de contes d’Andersen qui faisaient clairement référence à la réalité de son pays sous la coupe de Staline. Politique et satirique Héros de guerre pour avoir participé, en 1941, à la défense de Leningrad, il ne s’est pas tenu tranquille pour autant et, en 1944, il a écrit Le Dragon, qui a été aussitôt interdit après sa première représentation, la même année. Il faut dire que, sous couvert du conte, le Russe faisait feu aussi bien en direction du nazisme que du stalinisme. L’amusant, dans l’affaire, c’est que Schwartz et son Dragon ont été réhabilités après la guerre par les brechtiens français, notamment le metteur en scène Benno Besson, qui signe la version française sur laquelle s’est appuyé Thomas Jolly (en la retravaillant par endroits). Lire aussi Thomas Jolly, metteur en scène : « Quand ma grand-mère est entrée pour la première fois sur le plateau, j’ai pleuré à torrents » Il était une fois, donc, une ville sur laquelle régnait, depuis quatre siècles, un terrible dragon à trois têtes. Quand tout commence, les habitants ont renoncé depuis bien longtemps à combattre le monstre et lui paient un lourd tribut, lui offrant la plupart de leurs ressources. Chaque année, ils lui sacrifient également une jeune fille, qui meurt de dégoût après la nuit de noces. Cette année-là, c’est la noble et douce Elsa, la fille de l’archiviste de la ville, qui a été choisie. Elle s’est résignée à son sort, comme toutes les autres. Mais voilà qu’arrive dans la cité un homme providentiel, « héros professionnel » répondant au nom de Lancelot. Le preux chevalier défiera le dragon et le terrassera. Une fois le monstre abattu, la monstruosité n’a pas disparu pour autant. Elle a seulement changé de visage Si la pièce s’en était tenue là, elle aurait pu être une œuvre épique édifiante, charmante mais sans grand intérêt. C’est sa deuxième partie qui lui donne toute sa profondeur et sa dimension politique et satirique. Car, une fois le monstre abattu, la monstruosité n’a pas disparu pour autant. Elle a seulement changé de visage. L’hydre n’a plus trois têtes mais cent, mais mille. Le mal est en chacun. Le dragon, d’ailleurs, avait prévenu Lancelot : « L’âme humaine est vivace. Coupe le corps d’un homme en deux, il crève. Mais, si tu lui taillades l’âme, il ne meurt pas. Il devient docile. Tu ne rencontreras jamais nulle part des âmes comme celles qui végètent dans ma ville : des âmes culs-de-jatte, des âmes manchotes, sourdes, muettes, des âmes damnées. (…) Des âmes trouées, des âmes vendues, des âmes brûlées, bossues, châtrées, et surtout corruptibles, toutes ! Des âmes mortes ! » Théâtralité superlative Mais l’héroïsme aussi, de ce fait, change de visage et s’adapte. On ne racontera pas la suite. Dans ce Dragon se niche une magnifique réflexion sur la servitude volontaire, le fantasme de l’homme providentiel, la fin du courage et les voies pour retrouver le goût du combat. Et c’est un bonheur que de (re)découvrir une pièce pareille, à l’heure où tant d’œuvres prétendument politiques, platement réalistes et bêtement dénonciatrices, donc inutiles, sont produites. L’arme du fantastique, du merveilleux, de la métaphore a sa puissance, un peu trop oubliée de nos jours. Et ce Dragon est bien entendu du pain bénit pour Thomas Jolly, qui lui permet de déployer une théâtralité superlative et jouissive. Il y a toujours un côté grand spectacle assumé chez le metteur en scène, mais on est bien au théâtre, et les effets spéciaux, s’il y en a, relèvent d’un artisanat, donc d’une poésie, et pas de la grosse machine hollywoodienne. Ce qui n’empêche pas le spectacle de lancer des clins d’œil du côté de Harry Potter, de Tim Burton et de La Famille Addams. Les costumes, les maquillages, l’atmosphère un peu gothique, la musique de Clément Mirguet, les lumières d’Antoine Travert, le superbe décor, à la fois caverne aux livres et parchemins et antre du dragon, signé Bruno de Lavenère : tout concourt à cette fantaisie noire et onirique, autant que débridée. Idem du côté des acteurs, dans ce théâtre de troupe où brillent pourtant de belles individualités, à commencer par Hiba El Aflahi dans le rôle d’Elsa, qui porte ce personnage de jeune fille cheminant sur la voie de sa libération – et de celle des autres – avec beaucoup d’émotion et d’intensité intérieure. Le Lancelot de Damien Avice, lui, déjoue avec humour les codes du héros romantique. Même si certains comédiens poussent un peu loin le curseur du burlesque délirant, à l’image de Bruno Bayeux dans le rôle du bourgmestre (mais il le fait très bien), c’est toujours un plaisir de voir un ensemble tel qu’on en voit rarement sur les plateaux aujourd’hui. Avis aux grincheux, le ventre est toujours fécond d’où peut sortir la bête immonde d’un théâtre désespérément naturaliste. Mais Thomas Jolly est là pour enfourcher le dragon échevelé d’un art dramatique flamboyant, qui n’a pas dit son dernier mot face aux assauts des séries et du cinéma à grand spectacle. Le Dragon, d’Evgueni Schwartz (traduit du russe par Benno Besson), mise en scène de Thomas Jolly. Au Quai, centre dramatique national d’Angers, jusqu’au 25 janvier. Tournée jusqu’à fin avril, au Théâtre national de Strasbourg, du 31 janvier au 8 février, puis Charleroi (Belgique), Martigues (Bouches-du-Rhône), Grenoble, La Rochelle, Rouen, Paris (Grande Halle de La Villette), du 27 au 30 avril, et Lille. Fabienne Darge(Angers, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 21, 2022 8:30 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 21 janvier 2022 Légende photo : « Seras-tu là ? », de Solal Bouloudnine, présenté dans le cadre du festival Fragments, au Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris, en 2019. MARIE CHARBONNIER Avec « Seras-tu là ? », le comédien nous embarque dans la chambre d’un enfant des années 1990 pour un spectacle drôle et original qui est aussi un hommage au chanteur Michel Berger. On a tous une mort brutale d’artiste qui nous a marqués. Pour certains ce fut Coluche, pour d’autres Daniel Balavoine, pour Solal Bouloudnine, c’est Michel Berger. Quand le chanteur meurt, le 2 août 1992 à Ramatuelle (Var), d’une crise cardiaque après une partie de tennis, le petit Solal, 6 ans, passe des vacances juste à côté de chez lui. « Je ne le connaissais que par ses mélodies. Je me souviens des pompiers, de la police, des journalistes, des fans. Ce jour-là, je suis sorti de l’enfance, j’ai pris conscience du concept de finitude, c’était horrible », raconte sur scène l’enfant devenu comédien. Désormais âgé de 36 ans, Solal Bouloudnine soigne son angoisse maladive de la mort, renforcée depuis qu’il est devenu père, dans un solo drolatique et poignant. Titré Seras-tu là ?, en hommage à l’une des plus belles chansons de Michel Berger, cette autofiction cocasse a la particularité de commencer par la fin et de se terminer par le milieu. Sans doute parce que, au milieu de la vie, on en comprend mieux le début. Solal Bouloudnine, comédien : « Ce spectacle, c’est un rêve d’enfant qui se réalise » Difficile à suivre ? Sur le papier peut-être mais, en spectacle, ce procédé délirant fonctionne à merveille. Dans un décor de chambre d’enfant en grand désordre, Solal Bouloudnine, habillé en tennisman, le polo tout tâché et le visage barbouillé de crème solaire, mime le joueur et l’arbitre d’une partie imaginaire. Soudain, sont projetées les images d’archive du journal de FR3 annonçant la mort de Michel Berger. « Essaie de vivre, essaie d’être heureux ça vaut le coup. Joue, joue !!! », hurle le comédien au gamin qu’il a été. « Ce spectacle, c’est un rêve d’enfant qui se réalise », confie ce trentenaire au sourire doux et au débit de mitraillette. Petit, il était le genre de gamin qui, à la maison, passait son temps à imiter sa famille juive – « J’avais des parents charismatiques », dit-il –, mais aussi les hommes politiques qu’il voyait à la télé. Il rejouait les sketches de ses idoles, les humoristes Elie Kakou, Pierre Palmade, Les Nuls, Les Inconnus… « Je prenais même en otage les mariages et les bar-mitsva ! », se souvient-il. A l’école, quand la maîtresse lui demandait « Que veux-tu faire plus tard ? », il répondait inlassablement : « Des spectacles. » Alors, de guerre lasse, ses parents l’ont inscrit, à 6 ans, à un cours au Badaboum théâtre à Marseille. Sorte de journal intime Mais, chez les Bouloudnine, on aurait préféré que le petit dernier arrête ses clowneries et suive les pas des hommes de la famille. Père chirurgien digestif, deux grands frères devenus psychiatres, Solal est destiné à embrasser la carrière de médecin, parce que dans ce secteur « y aura toujours du travail » insiste le paternel. « Heureusement, mes frères m’ont soutenu et lui disaient : “Laisse-le faire ce qu’il veut” », raconte Solal. Alors ce sera le conservatoire de Toulon, puis l’admission à l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes (ERAC), où il rencontre ses « meilleurs potes », parmi lesquels Baptiste Amann, Olivier Veillon, Maxime Mikolajczak. Avec eux, Solal Bouloudnine s’exerce au théâtre expérimental au sein du Collectif l’Institut de recherches menant à rien (Irmar), coécrit et co-met en scène Spectateur : droits et devoirs, collabore avec l’auteur et metteur en scène Bertrand Bossard, joue dans la troupe des Chiens de Navarre (notamment Les Armoires normandes, 2015) et dans la trilogie Des territoires de Baptiste Amann. Autant d’expériences qui ont nourri l’univers de Seras-tu là ?, sorte de journal intime où se mélangent adresse directe au public et personnages pittoresques formidablement interprétés. Le comédien jure que sa quête a simplement été « d’écrire quelque chose le plus sincère possible sur nos angoisses, en faisant rire et pleurer » Il lui a fallu trois ans pour aboutir à ce spectacle. Trois ans à travailler avec son coauteur Maxime Mikolajczak, à s’amuser à déconstruire le récit en pensant à des films qu’ils avaient adoré, comme Retour vers le futur (1985), de Robert Zemeckis, ou Mulholland Drive (2001), de David Lynch. Et puis, pour concrétiser ce projet, il a fallu persuader les professionnels. « J’ai été très marqué de constater à quel point l’idée de créer un spectacle d’humour, un one-man-show faisait peur dans le théâtre public. » Tout s’est bien terminé. Présenté dans le cadre du festival Fragments, le travail de Solal Bouloudnine a convaincu plusieurs centres dramatiques et scènes nationales. Après sa programmation à l’été 2021 aux Plateaux sauvages à l’occasion du festival Paris l’été, Seras-tu là ? bénéficie cette année d’une belle exposition dans la capitale et en région. Le comédien jure que ce spectacle n’est pas « une thérapie », que sa quête a simplement été « d’écrire quelque chose le plus sincère possible sur nos angoisses, en faisant rire et pleurer ». En nous embarquant dans cette chambre d’enfant des années 1990, en osant se grimer, se déguiser, en étant foutraque quand il le faut, en jouant avec une fougue déconcertante, Solal Bouloudnine réussit son pari. Il est drôle, touchant, original et parvient à renvoyer les spectateurs à leur propre jeunesse et à ce qui les a construits. Parmi les passages les plus truculents de ce solo inclassable, citons l’hommage à son père, qui, par son métier, « a passé sa vie à défier la fin ». Désormais, grâce à Seras-tu là ?, son fils, lui, vit un vrai moment de bonheur et surmonte sa peur de la fin. Seras-tu là ? », de Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, avec Solal Bouloudnine, mise en scène : Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon. Du 22 au 30 janvier au théâtre Le Monfort (Paris 15e), du 8 au 18 février au Théâtre 13 (Paris 13e) et en tournée (les 1er et 2 février au Théâtre national de Nice, le 3 février à Scène 55 à Mougins, etc.). Voir le teaser vidéo (très drôle !) Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 21, 2022 4:51 AM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 21 janvier 2022 Pour son premier grand spectacle en tant que directeur du Quai d’Angers, le metteur en scène s’attaque à cette pièce méconnue d’Evgueni Schwarz. Epopée politico-fantastique, elle se transforme, sous sa houlette, en show sous stéroïdes. Utiliser des figures mythiques, mythologiques, voire fantastiques, pour dire le contemporain. Le procédé n’est pas nouveau, et a même le vent en poupe, mais il est poussé chez Evgueni Schwartz à son paroxysme, dans un mélange, à première vue surprenant, entre créatures médiévales et régimes autoritaires, du XXe comme du XXIe siècle. Assez peu connu en France, son Dragon a pourtant été monté par des metteurs en scène de renom, tels Antoine Vitez et Benno Besson, mais également, plus récemment, par Christophe Rauck. Et c’est au tour de Thomas Jolly, pour sa première grosse production en tant que directeur du Quai d’Angers, de s’inscrire dans cette belle lignée, de s’emparer de ce texte plus sulfureux qu’on ne le croit a priori – assez, en tous cas, pour donner des sueurs froides au pouvoir soviétique qui l’a censuré juste après sa première représentation, en 1944, à Moscou, et ce jusqu’en 1962 –, à un moment particulier où les dragons menacent, un peu partout à travers le monde, de sortir de leur tanière. Celui décrit par Evgueni Schwartz règne en maître, depuis maintenant 400 ans, sur une ville dont le dramaturge russe se plaît, pour la rendre encore plus universelle, à taire le nom. Du haut de sa montagne, le monstre tricéphale voit tout, entend tout, contrôle tout, et asservit chacun. Gourmande en vaches, mais aussi en légumes de saison, la créature a instauré un rituel pour le moins cruel, mais accepté, avec une certaine indifférence, par la population : chaque année, il exige qu’une jeune fille de son choix lui soit remise pour l’épouiller et lui gratter les écailles, jusqu’à mourir de dégoût. Elsa, la fille de l’archiviste Charlemagne, est la prochaine sur la liste et elle s’est déjà résolue, fataliste, à son triste sort, prévu pour le lendemain. C’est alors que Lancelot, un héros professionnel, chargé de débarrasser le monde des monstres, débarque. Entiché de la jeune femme dès le premier regard, il se met en tête de défier le dragon ; ce que la créature à trois têtes accepte volontiers, certaine, dans un premier temps, de son invincibilité. Mais liquider le monstre suffira-t-il à libérer la ville du mal ? Rien n’est moins sûr. Car le dragon, et c’est là toute la subtilité du texte de Evgueni Schwartz, a des relais. À commencer par le bourgmestre, idiot utile du village, son fils, érigé en porte-parole de la créature, mais aussi les masses qui, par leur docilité, se sont sans difficulté converties à l’idéologie du monstre. Charlemagne, sa fille et quelques artisans exceptés, Lancelot n’est pas accueilli en libérateur, mais comme un traître qui va semer le chaos. Façon pour Evgueni Schwartz de souligner que les peuples ont bel et bien leur avenir entre leurs mains, et qu’ils sont en partie responsables de leur sort, duquel ils peuvent devenir des victimes consentantes. D’autant que ce conte, qui entendait, tout à la fois, dénoncer le nazisme et le stalinisme, ne verse pas dans le manichéisme. Les intentions de ce Lancelot-là sont moins vertueuses que celles du chevalier de la Table ronde, et le dragon est sans doute plus faible que ses soutiens ne le pensent. Il faut dire que, comme dans tout bon régime autoritaire, tout est organisé pour entretenir l’illusion de la toute-puissance : le culte du chef, la surveillance de tous par tous, le bourrage de crânes, la haine des étrangers – ici des « romanichels », voués aux gémonies en raison de leur nomadisme. À cette pièce d’un genre proche de l’heroic fantasy, Thomas Jolly donne les allures d’une épopée sous stéroïdes, d’un grand spectacle, voire d’un grand show. Malgré quelques embardées humoristiques appuyées qui viennent affaiblir, car alléger par trop, la noirceur et la profondeur du propos, il parvient parfaitement à exposer les enjeux du texte de Evgueni Schwartz, et notamment à montrer la versatilité, la bêtise et le comportement moutonnier des masses face à des tyrans qui, parfois, à l’image du bourgmestre, ne sont pas aussi intouchables qu’elles ne le croient. A l’avenant, son adaptation de la fin de la pièce, où le pouvoir d’agir semble davantage entre les mains de la jeune Elsa que dans celles du héros conquérant, se révèle hautement pertinente, et contemporaine, car elle lui permet d’enjamber, sans trahir le texte, ce topos du retour de l’homme fort, libérateur, à qui tous, et surtout toutes, doivent se soumettre. Constamment à la relance, capable d’imprimer un rythme d’enfer – en dépit de quelques trous d’air dus à certaines longueurs textuelles –, sa mise en scène survitaminée a, malheureusement, les défauts de ses qualités, et de son audace, et frôle le passage en force. Conçue pour en mettre plein la vue, tout est mobilisé à cet effet : la musique tonitruante, les lumières tapageuses, le décor imposant – qui l’oblige à imaginer des intermèdes façon Henry VI lors des changements majeurs. Habituelle chez Thomas Jolly, cette grammaire scénique est assumée, et efficace, mais elle frise, dans ce Dragon, à intervalles réguliers, le trop-plein, au détriment du texte, parfois étouffé, et du jeu des comédiens qui, sans ne manquer ni d’énergie, ni d’esprit de troupe, sont contraints, pour se faire entendre, de pousser le curseur, quitte à se mettre dans le rouge. A la manière de ces héros que l’impératif de flamboyance conduit, bien souvent, à l’épuisement. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Le Dragon
de Evgueni Schwartz
Texte français Benno Besson
Mise en scène Thomas Jolly
Avec Damien Avice, Bruno Bayeux, Moustafa Benaïbout, Clémence Boissé, Gilles Chabrier, Pierre Delmotte, Hiba El Aflahi, Damien Gabriac, Katja Krüger, Pier Lamandé, Damien Marquet, Théo Salemkour, Clémence Solignac, Ophélie Trichard et, en alternance, Mathis Lebreton, Adam Nefla ou Fernand Texier
Collaboration artistique Katja Krüger
Scénographie Bruno de Lavenère
Lumières Antoine Travert
Musique originale et création son Clément Mirguet
Costumes Sylvette Dequest
Accessoires Marc Barotte, Marion Pellarini
Consultante langue russe Anna Ivantchik Production Le Quai CDN Angers Pays de la Loire
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, La Comédie – CDN de Reims, Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France, La Villette – Paris
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national Durée : 2h40 Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
du 18 au 25 janvier 2022 Théâtre National de Strasbourg
du 31 janvier au 8 février Palais des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique)
les 18 et 19 février Les Salins, Scène nationale de Martigues
les 10 et 11 mars MC2: Grenoble
du 23 au 25 mars La Coursive, Scène nationale de La Rochelle
les 30 et 31 mars CDN Normandie-Rouen
les 8 et 9 avril La Villette, Paris
du 14 au 17 avril Théâtre du Nord, CDN de Lille
du 27 au 30 avril

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2022 8:56 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 20 janvier 2022 Légende photo : Catherine Hiegel, au cloître Toussaint, à Angers, lors du Festival d’Anjou, le 23 juin 2021. CHRISTOPHE MARTIN La comédienne subjugue dans la pièce mise en scène par Alain Françon, partition follement virtuose de Thomas Bernhard qu’elle joue tout en nuances, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris.
« Il n’y a rien de plus fort que de jouer un monstre. Et, évidemment, rien de plus fort que de ne pas le jouer comme un monstre… » Sur la scène du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, Catherine Hiegel est Vera, personnage d’Avant la retraite comme seul l’auteur autrichien Thomas Bernhard pouvait en écrire : démesuré, obsessionnel, théâtral jusqu’au vertige. Et l’on a beau savoir qu’elle est, à 75 ans, l’une de nos plus grandes actrices, la Hiegel subjugue dans cette partition follement virtuose, qu’elle joue tout en nuances. Peu d’actrices, comme elle, peuvent habiter un plateau de théâtre comme un royaume où elles imposent leurs lois mystérieuses et impalpables, comme un champ magnétique où leur corps, leur voix, leur être profond tissent l’air ambiant de résonances profondes. Avant elle, il y a eu Christine Fersen, camarade de Hiegel à la Comédie-Française pendant trente ans, il y a eu Jeanne Moreau dans Le Récit de la servante Zerline, mis en scène par Klaus Michael Grüber en 1986. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Théâtre : « Avant la retraite », le carnaval des monstres de Thomas Bernhard Une reine de la scène, donc, qui, pourtant, a collectionné les rôles de servantes, depuis le début, chez Molière, Marivaux, Goldoni ou Genet. « On a longtemps été prisonniers des emplois, au théâtre, et mon physique n’était pas celui d’une jeune première, observe-t-elle. Mais cela ne m’a pas gênée : ces rôles sont souvent plus complexes que les autres, ils sont remplis de zones d’ombre passionnantes. » « Remuer les ondes de la conscience humaine » La Hiegel a aussi joué les rebelles, les insoumises, les femmes « à côté », les Mère Courage, chez Koltès, Brecht, Copi ou Lagarce. Elle a accueilli la proposition que lui a faite Alain Françon de jouer Vera avec une joie de combattante, elle qui adore Thomas Bernhard, dont elle a monté elle-même les Dramuscules, en 2013. « Bernhard, c’est du grand théâtre, formidablement écrit. Mais, surtout, je trouvais qu’il était important de jouer ce texte, à l’heure où les idées d’extrême droite reprennent de la vigueur partout dans le monde. On a besoin d’auteurs comme Brecht ou Bernhard, qui viennent remuer les ondes de la conscience humaine. » Comment aborder Vera, cette femme qui profère des obscénités antisémites sur un ton badin, et couche avec son nazi de frère, à qui elle sert de bonniche, de mère et d’amante ? « C’est un monstre, mais c’est une victime, aussi – une victime consentante… Il y a une humanité ordinaire à trouver là-dedans. C’est plus effrayant justement, parce que cela s’inscrit dans une banalité. Les gens dangereux ont souvent une forme de bonhomie, d’ailleurs », constate Catherine Hiegel. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Au Théâtre du Petit-Saint-Martin, Catherine Hiegel en hilarante baronne des bonnes manières Loin de travailler le personnage en force, la comédienne lui a donné beaucoup d’enfance, une forme de folie douce qui le décale et le rend d’autant plus saisissant et profond. « Il y a chez elle quelque chose qui s’est arrêté, une nostalgie du temps passé, cette idée du “c’était mieux avant” que l’on rencontre souvent chez les gens d’extrême droite », analyse-t-elle. Lire aussi : Catherine Hiegel, « L’immense vague réactionnaire me fait peur » Nulle nécessité, pourtant, d’entrer en empathie avec son personnage, de le tirer vers soi, dans le grand art théâtral de Catherine Hiegel. « Je ne me sens rien de commun avec cette femme, rien. Je n’ai pas de porosité avec le personnage, et je n’ai pas besoin d’en avoir. J’ai toujours pensé qu’on était des montreurs, nous, les acteurs. » Montreuse de monstresse, voilà un rôle qui sied à la perfection à Catherine Hiegel. Fabienne Darge Théâtre : « Avant la retraite », le carnaval des monstres de Thomas Bernhard Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, Alain Françon signe la mise en scène de ce huis clos ravageur à l’écriture étourdissante. Par Fabienne Darge / Le Monde 19 janvier 2022 Qu’il est féroce, qu’il est drôle et terrible, ce carnaval des monstres ! Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, Alain Françon met en scène Avant la retraite, de Thomas Bernhard. Et c’est un spectacle magistral – un de plus pour Françon, qui vient par ailleurs de signer une magnifique Seconde Surprise de l’amour, de Marivaux, qui tourne en France jusqu’à la fin du printemps. Avec Avant la retraite, écrit en 1979, on est dans la veine la plus satirique et la plus politique de Bernhard, qui, inlassablement, s’est élevé contre la dénazification inachevée de son pays, l’Autriche, et celle de sa voisine, l’Allemagne. La pièce d’ailleurs s’inspire d’un personnage réel : Hans Karl Filbinger, ministre-président du Land de Bade-Wurtemberg de 1966 à 1978, année au cours de laquelle il avait dû démissionner, après des révélations sur son activité de juge dans la marine sous le nazisme. L’ironie de l’histoire, c’est que Filbinger était aussi l’homme qui s’en était pris au grand metteur en scène Claus Peymann – principal promoteur des œuvres de Bernhard en Allemagne –, exigeant qu’il quitte la direction du théâtre de Stuttgart en le traitant de « sympathisant du terrorisme ». Finalement, c’est Filbinger qui dut mettre fin à sa carrière, et non Peymann. Farce macabre De ce contexte historique, Thomas Bernhard a fait son miel pour tirer une de ces farces macabres dont il avait le secret, portée par un travail sur le langage absolument étourdissant. L’ensemble de ce huis clos ravageur se passe dans l’appartement chic, gris et froid de Rudolf Höller, président de tribunal en République fédérale d’Allemagne. Rudolf y vit avec ses deux sœurs, Clara et Vera. Ce sont elles que l’on découvre, d’abord, sur la scène du théâtre. La première est infirme, clouée sur son fauteuil roulant. La seconde virevolte, primesautière, joyeuse, et s’active en vue de la préparation de la petite fête prévue ce soir-là. On est le 7 octobre, et, tous les 7 octobre, la famille Höller célèbre l’anniversaire du dirigeant nazi Heinrich Himmler, mentor et idole de Rudolf. Vera mène ses préparatifs tambour battant, repassant l’uniforme complet d’Obersturmbannführer SS de Rudolf, cirant les hautes bottes à tige noire, veillant à ce que le champagne soit à bonne température. Thomas Bernhard orchestre le retour orgiaque du passé dans le plus actuel des présents avec une ivresse satirique qui pourrait être grossière si elle n’était portée par un esprit aussi brillant et aussi percutant. Très vite, on comprend que Vera n’est pas seulement la sœur et la bonniche de son frère, mais aussi son amante enamourée. Tandis que Clara, qui ne partage pas les idées de Rudolf et de Vera, fait figure de souffre-douleur : qualifiée de terroriste par les deux monstres, impotente, impuissante, elle n’a que l’arme de la parole à leur opposer. Alain Françon met en scène sans jamais forcer le trait. Son talent est d’autant plus éblouissant qu’il ne se voit pas Comme toujours chez Thomas Bernhard, c’est d’abord la langue qui éblouit, et son humour noir. Cette langue qui épouse la psyché obsessionnelle des personnages, leur enfermement dans une endogamie, en des monologues où l’autre n’a aucune place. Et son humour qui pousse l’imagination du pire dans ses retranchements les plus délirants, et lui fait inventer des scènes incroyables. A l’image de celle où Vera et Rudolf contemplent leur album de photos du temps du nazisme comme s’il s’agissait de simples souvenirs de famille, et évoquent la « solution finale » sur un ton badin et nostalgique. Une forme de nazisme bonhomme, en quelque sorte. Pour eux, c’était le bon temps, et ils n’en éprouvent aucune honte, aucune mauvaise conscience. Ils n’ont aucun doute sur le retour prochain de leurs « valeurs » : « Tout va dans notre sens/il n’y en a plus pour très longtemps/et finalement nous avons aussi une foule d’autres/politiciens de premier plan/qui ont été national-socialistes. » Comme toujours, c’est d’abord à partir de la langue de Bernhard qu’Alain Françon a travaillé, pour cette pièce qu’il met en scène sans jamais forcer le trait. Le talent du metteur en scène est d’autant plus éblouissant qu’il ne se voit pas. C’est un travail tout en finesse, sur la justesse de chaque instant : justesse musicale, justesse du sens, des relations entre les personnages, des rapports de domination et des rôles familiaux. Trio de comédiens inattendu La pièce n’en est que plus dérangeante et glaçante, d’autant qu’Alain Françon s’est surpassé dans la direction d’acteur, avec un trio de comédiens inattendu qui fait des étincelles. A la cinéaste Noémie Lvovsky, néophyte sur les plateaux de théâtre, revient d’incarner Clara, la sœur infirme. Son jeu est moins maîtrisé que celui de ses camarades, et c’est justement ce qui raconte une humanité, une fragilité lumineuses et bouleversantes. André Marcon, comédien de forte présence, est un Rudolf massif, minéral, comme déjà croulant sous son uniforme : un roc en train de se fissurer, pathétique, défait sous les rodomontades qui tournent à vide, une baudruche en train de se dégonfler. Mais celle qui éblouit littéralement, que l’on ne quitte pas des yeux une seconde tant elle nous tient en son pouvoir, c’est Catherine Hiegel, dans le rôle de Vera. Il faut la voir, frétillant comme une collégienne, avec ses tresses blondes de Gretchen, proférant les pires horreurs avec fraîcheur et allant. Elle règne sur ce cérémonial morbide avec ce qui est, peut-être, la caractéristique des vrais monstres : leur innocence, leur incapacité à discerner le bien du mal. Avant la retraite, de Thomas Bernhard (traduit de l’allemand par Claude Porcell, L’Arche éditeur), mise en scène d’Alain Françon. Théâtre de la Porte-Saint-Martin, 18, boulevard Saint-Martin, Paris 10e. Du mardi au vendredi à 20 heures, samedi à 20 h 30, dimanche à 16 heures, jusqu’au 2 avril. De 12 € (visibilité réduite) à 43 €. Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 19, 2022 6:58 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 19 janvier 2022
De gauche à droite : Damis (Julien Frison), Orgon (Denis Podalydès) et Tartuffe (Christophe Montenez) dans « Le Tartuffe ou l’hypocrite », de Molière, mis en scène par Ivo va Hove à la COmédie-Française, salle Richelieu, à Paris, en janvier 2022. JAN VERSWEYVELD En ouverture de la saison Molière, le Belge Ivo van Hove s’empare de la version non censurée de la pièce dans une mise en scène efficace mais sans mystère à force d’effets faciles.
A trop vouloir en mettre plein la vue avec un Tartuffe choc, la Comédie-Française a-t-elle porté sur les fonts baptismaux un Tartuffe en toc ? On se pose la question, au sortir de ce Tartuffe ou l’hypocrite, mis en scène par le Belge Ivo van Hove, qui inaugure les festivités moliériennes dans la maison. Choc et chic, le spectacle s’avance avec un argument de vente massif : le texte ici représenté serait celui de la pièce originelle signée par Molière, avant la censure par Louis XIV, et telle que reconstituée, selon les méthodes de la « génétique théâtrale », par le grand spécialiste de Molière qu’est Georges Forestier. C’est donc un Tartuffe différent, plus court, plus percutant, plus cruel que celui que l’on a l’habitude de voir. Il s’intitule Le Tartuffe ou l’hypocrite, et non plus Le Tartuffe ou l’imposteur. Il est débarrassé du Ve acte de la pièce, souvent considéré comme artificiel, et des scènes entre les deux jeunes amoureux, Mariane et Valère. On aurait donc ici la pièce dans sa pureté native, dans sa violence, dans le regard au rasoir porté par Molière sur des dévots – qui pour l’être, dévots, n’en sont pas moins hommes, avec leurs turpitudes, comme le dit Tartuffe lui-même. C’est l’aspect le plus intéressant de cette soirée que de découvrir cet objet en forme de petite bombe, où s’exprimerait sans concession un Molière dressé contre l’hypocrisie. Le hic, c’est la manière dont Ivo van Hove le met en scène, avec une efficacité incontestable mais aussi nombre de facilités et d’effets qui finissent par former un spectacle clinquant et sans mystère. Les décalages opérés par Ivo van Hove contraignent les acteurs à des acrobaties de jeu qui brouillent le sens Alors voilà : Tartuffe est un SDF que le bon bourgeois Orgon sauve de la rue et de la misère, pour l’installer dans sa confortable demeure. Le jeune homme va s’y nicher comme un bernard-l’hermite et embobiner non seulement son sauveur mais aussi son épouse, Elmire. C’est un des décalages opérés par Ivo van Hove, que de montrer une Elmire consentante, qui non seulement ne résiste pas aux avances de Tartuffe mais les accueille avec joie. Outre que ces décalages peuvent être sujets à caution – recueillir un miséreux vous exposerait à la ruine et au malheur –, tout autant que le regard, de plus en plus gênant au fil des années, porté par Ivo van Hove sur les personnages féminins, malmenés ou caricaturés, ils contraignent les acteurs à des acrobaties de jeu qui brouillent le sens. A cela s’ajoutent des tics de mise en scène dont on peine à saisir la nécessité, comme les ponctuations sonores omniprésentes, à la japonaise, ou le découpage du spectacle à coups de surtitres géants genre « Molière pour les nuls ». Troupe brillante C’est un peu triste, parce que le spectacle est très bien joué, comme il se doit depuis quelques années à la Comédie-Française où la troupe est brillante. Du moins les comédiens font très bien ce que leur demande le metteur en scène. Christophe Montenez, devenu un des grands acteurs de cette troupe, s’offre avec tout son talent à ce Tartuffe fourbe, doucereux, à la fois victime et bourreau. Marina Hands met toute sa puissance de jeu au service d’une Elmire frustrée et sauvage. Loïc Corbery est, comme toujours, d’une finesse parfaite en Cléante, celui qui tente de ramener tout le monde à la raison. Dominique Blanc est une formidable Dorine qui seule parvient à arracher des rires à la salle. Dominique Blanc est une formidable Dorine qui seule parvient à arracher des rires à la salle La déception, hélas, vient de Denis Podalydès : son Orgon est à ce point inexistant que l’on ne sait qu’en dire. Est-il tartuffié par culpabilité, haine de soi, fragilité psychique, homosexualité refoulée ? Mystère. La question du rapport à la foi et du besoin de croire est ainsi largement évacuée de cette mise en scène. L’ensemble de la soirée donne un peu l’impression que la Comédie-Française a eu besoin d’un affichage fort, à l’ouverture de cette saison anniversaire, en hissant le pavillon d’un Molière « moderne ». Mais au théâtre, la vraie modernité est celle du regard plus que de l’habillage et ce Tartuffe en costume-cravate et mini-jupe de satin noir entre au final bien peu en résonance avec notre époque. Comme si, à trop vouloir tordre le bâton, le vrai substrat de la pièce s’était perdu et par conséquence les liens que peut tisser le spectateur, dans cet art, le théâtre, où le passé sert d’éclaireur au présent. Fabienne Darge / Le Monde ------------------ Autre critique du spectacle "Le Tartuffe ou l'hypocrite", publiée dans Libération le 24 janvier 2022 : A la Comédie-Française, un «Tartuffe» truffé de lourdeurs Vantée comme sauvage, la mise en scène inédite de la pièce de Molière par Ivo Van Hove, trop simpliste, fatigue et agace. par Lucile Commeaux / Libération publié le 24 janvier 2022 Dans une Comédie-Française dépouillée – fond de scène noir et cintres à vue – gît un homme sous une pile de couvertures, vite déshabillé puis lavé par les personnages, tandis qu’on installe diligemment le décor du spectacle : du métal, des lumières froides, du noir encore. On s’active pour jouer une pièce apparemment inédite : un Tartuffe d’avant le Tartuffe, celui qui avait en 1664 tant choqué que Molière avait dû s’y reprendre à deux fois. Le texte est plus court, trois actes seulement resserrés sur le trio formé par Orgon, sa femme Elmire et son ami Tartuffe, sans le deus ex machina chassant dans l’ultime version ce faux dévot qui entendait détruire les liens familiaux. Un texte concentré et sec dont on pouvait attendre, dans le système désormais bien huilé du Belge Ivo Van Hove, une représentation actuelle et radicale. C’est en effet un Tartuffe plein de fureur auquel on assiste. Les corps de la troupe du Français sont tendus en permanence vers l’affrontement ou vers l’étreinte, les costumes et robes noirs toujours en passe d’être arrachés, pour qu’advienne ce qui, dans le fond, intéresse spectacle après spectacle Ivo Van Hove : la pulsion – ce mécanisme archaïque qui anime les êtres et compromet leurs sociétés. En écho évident à son adaptation des Damnés avec la même troupe de la Comédie-Française en 2016, il active la référence au cinéma italien, et fait de Tartuffe un monstre pasolinien incarné par Christophe Montenez, bombe sexuelle qui se flagelle au cuir, et explose un couple interprété par Marina Hands et Denis Podalydès à coups de hurlements et de soupirs sonorisés. Vaguement accessoirisé Passée l’esbroufe des premiers effets, on s’agace vite. Les nappes électroniques (signées Alexandre Desplat – luxe totalement inutile) irritent plus qu’elles ne tendent. Irrite aussi cette propension du spectacle à expliciter et souligner lourdement les ressorts et retournements dramatiques. Pour qu’on comprenne bien que toute la question de Tartuffe est de voir – voir ce qui est bon, et ainsi «du faux avec le vrai faire la différence» – une lumière flashe à chaque début d’acte, et s’affichent en fond de scène des commentaires, assénés comme des cartons dans un film muet. Sauf que le film n’est pas muet, et on fatigue à chercher sous les cris et l’agitation la finesse et la complexité de la langue de Molière. Que la version choisie soit plus simple semble arranger le simplisme du spectacle. Il finit par écraser tous ses enjeux, faisant d’emblée de Tartuffe un monstre, quand la faute, dans la dramaturgie de Molière, circule toujours opportunément, indécise à se fixer. Surtout, en choisissant de réduire le fanatisme de son personnage à une simple posture sulfureuse, le spectacle rate complètement le coche d’une quelconque efficacité dans la réflexion politique. Il cantonne la représentation de la radicalité – au cœur de cette pièce sans doute plus qu’aucune autre de Molière – à une pure question individuelle et psycho-sexuelle. Tartuffe ne veut dans le fond que posséder le corps de la maîtresse de maison, et la double scène de leurs étreintes dans ce décor noir éclairé au néon évoque désagréablement le tournage d’un mauvais film érotique. Le comique insufflé par Denis Podalydès tombe à plat, le trio vire au vaudeville vaguement accessoirisé et complètement hors contexte. De ce texte premier, vanté comme pur et sauvage, on n’a finalement pas vu grand-chose, sinon de vains rituels d’apparat, qui vident totalement Tartuffe de sa substance, en croyant sans doute le réactualiser. Le Tartuffe ou l’hypocrite mis en scène par Ivo Van Hove, à la Comédie-Française jusqu’au 24 avril. « L’année Molière », une série en cinq épisodes Le Tartuffe ou l’hypocrite, de Molière. Mise en scène : Ivo van Hove. Comédie-Française, salle Richelieu, place Colette, Paris 1er. Jusqu’au 24 avril, à 14 heures ou à 20 h 30, en alternance. De 5 € à 42 €. Puis en ouverture des Nuits de Fourvière, à Lyon, en juin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 6:59 PM
|
Par Léa Simonnet dans Manifesto 21 - 18 janvier 2022 Photo : © Erwan Fichou
En 1995, le réalisateur Paul Verhoeven essuie une vague titanesque de critiques suite à la sortie de son film Showgirls. Entre un déficit béant au box-office et les diatribes alignées dans les colonnes éditoriales, rien ne laissait présager que son long-métrage pourrait un jour acquérir le statut de film culte incompris par son époque. Aujourd’hui, c’est Marlène Saldana et Jonathan Drillet, épaulé·es de Rebeka Warrior, qui s’offrent le plaisir d’adapter ce trésor exhumé, sur les planches.
Musique et théâtre sont-elles vraiment des disciplines distinctes ? Ne doivent-elles pas, lorsqu’elles cohabitent, s’accorder à partager le même espace, la même valeur ? On n’a que trop entendu les pianos pleurer et les guitares se distendre chaque fois qu’il a fallu créer une atmosphère angoissante sur scène, ou tirer quelques larmes à un public fébrile. Qu’à cela ne tienne, le procédé est efficace. Les larmes ont coulé, le cœur a battu. Mais sorti du contexte, le morceau en valait-il la peine ? Quand elle compose la bande originale de Showgirl, Rebeka Warrior compose un EP. Un objet artistique indépendant, aussi léché que n’importe quel projet personnel. Sa musique est brute, réfléchie, irrévérente, texturée. Elle se reçoit par salves, fait rompre les barrages, les amarres, les clivages. Rebeka Warrior est partout à la fois – Sexy Sushi, Mansfield.TYA, KOMPROMAT – et s’aventure cette fois jusqu’aux planches. Encore une fois, rien n’est laissé en coulisses, la musique est jetée toute entière dans la gueule ouverte du public, attendant qu’on y plante les crocs. Marlène Saldana glisse sa patte dans les morceaux comme dans les manches de son grand manteau et endosse avec brio ce rôle de chanteuse-actrice, l’une ou l’autre, les deux à la fois. C’est sa voix qui conte l’épopée moderne d’une danseuse écorchée par la réalité de son rêve. Showgirl est un exemple de la pluralité des formes théâtrales et des disciplines engagées dans une création. Jeu, danse, chant, musique. L’intelligence de la compagnie aura été de les réunir, sans les aplanir. C’est une comédie musicale, une performance, une pièce, un concert. Showgirl brouille les lignes et c’est exactement ce qui fait sa réussite : la beauté du désastre, la netteté du bordel, la précision de la fête. Le mantra, c’est jouer pour gagner, c’est la destruction du bon goût et l’adoubement du kitsch. Jouant sur l’emphase, mais sans tomber dans le gouffre de la mauvaise parodie, Marlène Saldana délivre une prestation hilarante, touchante, puissante. La pluralité de cette création existe aussi dans la réécriture, largement affranchie de son original, qu’en font Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Librement adapté du scénario initial du film de Verhoeven et suivant en apparence le parcours de son personnage principal, Nomi Malone, le spectacle dérive rapidement sur le véritable miroir de cette histoire : celle de son interprète, Elizabeth Berkley, dont la carrière fut injustement brisée par l’échec cuisant de cette seule production ; et celles de toutes les actrices, d’avant et d’aujourd’hui, submergées par les attentes irréalistes et irréalisables qu’on projette sur elles dans l’industrie du show-business. Pratiquement seule – sauf lors des quelques apparitions de Jonathan – mais entourée de tous ces personnages qu’elle incarne les uns après les autres, Marlène déambule dans ces décors bariolés. Ces objets scéniques opulents semblent être autant d’accessoires et partenaires de jeu. Elle se débarrasse des sourires débordants des comédies musicales façonnées à la bonne humeur de Broadway pour faire tourner la recette à un cynisme non moins hilarant. Et fait naître, sous les yeux médusés de l’audience, un Las Vegas tordant et rayonnant, chimérique et creux ou débordant de magnificence, artificiel ou bien glorieux et vivant, selon ses humeurs et ses avatars. Avec la sortie du clip de « La Valise », le spectacle s’offre aujourd’hui une nouvelle dimension. On y voit Marlène, dans le décor du spectacle, faire du lip sync sous l’œil d’une caméra malicieuse qui brouille les couleurs. Comme une annexe, une bande-annonce ou un spin-off, cette vidéo donne encore du relief à cette performance multi-artistique. Jolie façon d’annoncer que Showgirl fait aussi ses bagages pour parcourir la France ; et donner un aperçu de ce qu’il vous sera alors donné de voir. Léa Simonnet Voir le clip "La Valise" : Rebeka Warrior feat Marlène Saldana - La Valise Showgirl
22 janvier 2022 – Poitiers – TAP
2 mars 2022 – Orléans – Scène nationale d’Orléans : Soirées performances
Du 5 au 7 avril 2022 – Reims – Comédie de Reims
20 et 21 avril 2022 – Caen – CCN et Comédie de Caen
29 avril 2022 – Roubaix – La Condition Publique : La Rose des Vents hors les murs
Pour les Parisien·nes, il faudra attendre 2023 pour une programmation à Chaillot… patience.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 5:14 PM
|
Par Marek Ocenas dans son blog - 18 janvier 2022 Légende photo : Le Tartuffe ou l’Hypocrite, mise en scène par Ivo van Hove, Comédie-Française 2022 © Jan Versveyweld Pour inaugurer la saison Molière mise en œuvre à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de cette incontournable figure de théâtre français, l’administrateur de la Comédie-Française Éric Ruf a fait appel à Ivo van Hove pour l’inviter à créer Le Tartuffe dans sa version de 1664 en trois actes (>). Le metteur en scène néerlandais, pour lequel c’est la troisième création présentée à la Comédie-Française, après Les Damnés et Electre/Oreste, séduit à nouveau les spectateurs par la précision et la finesse avec lesquelles il remodèle les personnages bien connus de la grande comédie en cinq actes. Grâce à une distribution brillantissime, il retourne l’histoire de la famille d’Orgon tout en explorant les non-dits passionnels et pulsionnels d’un texte comique tempéré à cet égard suivant les bienséances classiques.
Le texte de la prétendue version de 1664 est en réalité le fruit des travaux de recherche menés par Georges Forestier, qui a tenté de la reconstituer en s’appuyant à la fois sur des témoignages d’époque et sur la méthode de la génétique théâtrale, exposée autrefois dans son ouvrage Essai de génétique théâtrale : Corneille à l’œuvre (1996). Il s’agit en effet d’isoler les étapes dans l’invention de l’action dramatique à partir d’un dénouement souhaité, ce que représente, dans le cas de la tragédie, le sujet de la pièce, le plus souvent exprimé par le biais d’une phrase extraite d’un ouvrage antique (« Titus renvoya Bérénice », Suétone). Cette démarche permet de comprendre ce qui relève de l’amplification ou de l’enrichissement de l’action dramatique pour une pièce déroulée en cinq actes. Il paraît, suivant cette démarche et les témoignages d’époque, que Molière aurait repris Le Tartuffe ou l’Hypocrite en trois actes, interdit en 1664 après seulement trois représentations données à l’occasion des festivités de L’Île enchantée, pour le transformer, vers 1667, en une grande comédie en cinq actes : pour ce faire, il aurait introduit, dans l’intrigue initiale d’une farce type de « trompeur trompé », une intrigue amoureuse fondée sur le procédé traditionnel d’un amour contrarié par les intérêts d’un père. De la version reconstituée de 1664, présentée à la Comédie-Française, l’intrigue amoureuse entre Marianne et Valère ainsi que les deux personnages qui la portent ont précisément été retirés : au lieu de s’achever sur une promesse de mariage, ce Tartuffe débouche sur la seule révélation de l’hypocrisie du personnage faussement dévot. Quoi qu’il en soit de la méthode génétique et de l’exactitude du texte de 1664, Ivo van Hove ne fait pas partie de ces metteurs en scène dont les recherches consistent en des reconstitutions historiques ou historicisées : sans surprise, il situe l’action de sa version du Tartuffe à une époque contemporaine qui nous rappelle insidieusement le cadre temporel de ces pièces où Yasmina Reza expose la violence des conflits interpersonnels, comme elle le fait par exemple dans Le Dieu du carnage. Les comédiens sont ainsi habillés d’élégants costumes bourgeois d’aujourd’hui en fonction de leur âge et de leur statut social tenu dans la maison d’Orgon. Si les personnages masculins portent des costumes cravates classiques, la confection de l’habillement des personnages féminins est plus nuancée, amplement révélatrice du rôle de leur féminité dans l’action, comme si le costumier An d’Huys voulait faire un clin d’œil aux propos subversifs de Dorine sur la fausse prude évoquée lors de la joute verbale avec Mme Pernelle : un tailleur sombre pour Dominique Blanc dans le rôle de la servante, un ensemble pantalon et haut pour Claude Mathieu dans celui de Mme Pernelle, et une robe courte, fermée par un simple ruban-ceinture, pour Marina Hands qui incarne une séduisante Elmire. Ivo van Hove entame par-là un précieux travail d’interprétation dramaturgique tout en rompant clairement avec la tradition de ces Tartuffes pensés à cheval entre deux époques : le sien s’inscrit résolument dans une intemporalité moderne qui dépoussière l’historicité du texte pour en révéler des tensions passionnelles à valeur universelle. La scénographie ne prétend à aucune reconstitution mimétique du salon de la maison d’Orgon : l’espace scénique reste éminemment théâtral pour camper les personnages dans une sorte d’arène passionnelle. Au lever du rideau, des figurants aménagent sans ambages le plateau dont on voit le fond noir et des constructions métalliques rangées en file, pendant qu’Orgon et Dorine lavent un Tartuffe barbouillé et mal vêtu, tout juste récupéré sous un tas de couvertures par son protecteur inconditionnel. Le temps de ce bain salutaire, éclairé par une série de torches qui réactivent sans détour des fantasmes scabreux, amplement stimulés par la nudité de Christophe Montenez entièrement déshabillé, les figurants disposent ainsi plusieurs praticables au fond de la scène pour construire une plate-forme métallique, dont on descend sur le devant de la scène par un large escalier. De façon symbolique, ils collent sur le plateau un grand carré de papier blanc, entouré peu après par six lustres suspendus qui changent à chacun des trois actes : c’est au milieu de ce carré que Mme Pernelle grondera avec une aigreur prononcée sa bru, son petit-fils, Cléante et Dorine, c’est à ce même endroit qu’on verra çà et là deux chaises ou une table ronde. Sans aucune recherche d’illusion théâtrale, cette scénographie décalée se plaît ainsi à circonscrire un espace de jeu pour mettre en évidence sa théâtralité fondamentale propice à un effervescent combat de passions. Celle-ci se trouve par ailleurs relevée par un éclairage tamisé qui souligne que l’action déroulée nous laisse entrer dans un sous-texte méconnu de lectures scolaires. L’action scénique mise en œuvre par Ivo van Hove redynamise le texte fondé avant tout sur des échanges verbaux, sur ces joutes oratoires qui opposent le plus souvent les personnages à travers des tirades ciselées selon les règles de la rhétorique classique. Il y parvient brillamment en maniant adroitement toute une palette de tonalités qui infléchit la teneur des propos et la posture des personnages, en mêlant en sourdine une certaine forme de bestialité pulsionnelle à une sensualité parfois débridée. Tout l’art d’Ivo van Hove et des comédiens qu’il dirige tient à cet équilibre frappant qui maintient les deux extrêmes dans une tension permanente qui explose à des moments bien choisis, à la suite de ces passages empreints d’une sérénité troublante. Le spectateur n’est pas dupe de certaines postures quasi angéliques, celles de Tartuffe ou d’Orgon, pour sentir sourdre en eux une passion refoulée qui ne manque pas de s’exprimer avec une intensité saisissante dans un accès de violence étrangement maîtrisé, aux confins d’une sourde cruauté. Il le perçoit par exemple dans l’interprétation du personnage de Cléante réputé pour sa nature conciliante : si Loïc Corbery l’incarne avec un sang-froid suspect, il sait placer avec justesse ces moments de colère où Cléante s’emporte brusquement pour dénoncer avec éclat les absurdités les plus patentes, que ce soit face à Orgon à la fin du premier acte ou face à Tartuffe au début du troisième. Les deux scènes qui réunissent Tartuffe et Elmire sont d’autre part marquées par un jeu de séduction délirant dont les à-coups traduisent superbement les pulsions des deux personnages attirés instinctivement l’un vers l’autre. Chaque comédien crée un personnage contrasté en proie à une volonté de puissance plus ou moins prononcée qui trahit ses désirs ou aspirations frustrés : le but semble ici de mettre en évidence cet inconscient bouillonnant, inconnu de l’âge classique, pensé ainsi en terme de passions. Claude Mathieu crée une Madame Pernelle infernale qui terrorise d’emblée la famille sans aucun sentiment de pitié. Denis Podalydès, dans le rôle d’Orgon, paraît en revanche animé par des émotions plus douces, notamment dans les scènes avec Tartuffe qu’il chérit avec un angélisme parfois déconcertant, même s’il ne manque pas, lui aussi, de montrer sa colère contre son fils Damis, incarné par Julien Frisson avec une impulsivité éclatante qui le conduit à une rixe ouverte avec le faux dévot. Si Cléante de Loïc Corbery frappe par une certaine froideur qui confère à ses convictions mondaines mesurées une résonance étonnante, Dominique Blanc donne à sa Dorine une attitude assurée et un ton mordant qui attestent de sa lucidité narquoise, mais aussi de sa position privilégiée occupée dans la maison d’Orgon. Marina Hands, dans le rôle d’Elmire, paraît submergée par une passion dévorante qui la pousse, malgré quelques protestations de façade, dans les bras de Tartuffe : elle crée un personnage amplement sensuel en soulignant brillamment son instabilité sentimentale qui la conduit des pleurs à un abandon à peine voilé. Christophe Montenez, enfin, dans le rôle de Tartuffe, s’empare de son personnage en mêlant subtilement des moments de maîtrise de soi à une certaine forme de folie palpable autant dans ses regards détournés que dans sa voix volontairement dérangée : son Tartuffe semble tourmenté par une passion refoulée au point de trahir par moments sa bestialité mal dissimulée, dès lors que cette passion se trouve tant soit peu stimulée par des frissons charnels d’une Elmire sensible à son charme. Le travail d’Ivo van Hove sur Le Tartuffe ou l’Hypocrite est absolument remarquable par ses partis pris dramaturgiques qui dévoilent des passions latentes des personnages dont le paraître est d’ordinaire soumis au respect des bienséances classiques. Sa mise en scène ne bascule cependant pas dans une perversité gratuite ni dans un sadisme déplaisant : Ivo van Hove a su la concevoir avec une retenue aussi raffinée que fragile à tout instant, tout en poussant les limites de la violence passionnelle à une élégance déroutante qui bouleverse les lectures et représentations traditionnelles de cette pièce de Molière. https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/le-tartuffe-ou-lhypocrite#

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2022 9:43 AM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 17 janvier 2022 Nouveau coup de maître du couple Valérie Lesort - Christian Hecq avec cette adaptation hybride (théâtre-marionnettes) du chef-d'oeuvre de Jonathan Swift. Un voyage ensorcelant au coeur du petit peuple de Lilliput, plein d'illusion, d'humour et de chansons. A découvrir au théâtre de l'Athénée, puis en tournée dans toute la France. Après avoir convoqué la mer, son poulpe et ses poissons à la Comédie-Française pour « 20.000 lieues sous les mers » , fait virevolter « La mouche » aux Bouffes du Nord, le duo Christian Hecq-Valérie Lesort confronte « Gulliver » au petit peuple de Lilliput sur la scène de l'Athénée. Le couple magique a imaginé un théâtre hybride ultra-expressif. Seul Gulliver est à taille humaine, les Lilliputiens incarnés par sept comédiens virtuoses, dont la tête est posée sur un corps de marionnette, n'excèdent pas 50 cm. Grâce à un jeu habile de castelet, de toiles peintes, et au procédé du « théâtre noir » côté lumières, l'illusion est parfaite. Une heure quinze durant, le pauvre médecin naufragé se débat avec ces êtres minuscules, dirigés d'une main de fer par un empereur tyrannique et pusillanime. Esclavagisé, transformé en bête de somme, puis en héros quand il parvient à neutraliser la flotte du royaume rival de Blefuscu, Gulliver est accusé de trahison, après avoir refusé d'anéantir le peuple ennemi. Finalement, il saura réconcilier les deux parties qui s'écharpaient sur la façon d'ouvrir les oeufs à la coque et regagnera son pays sur une chaloupe. Mini-comédie musicale Valérie Lesort a signé l'adaptation du chef-d'oeuvre de Jonathan Swift (1726) en se concentrant sur le premier voyage de Gulliver (le roman en compte quatre). Son texte, vif et drôle, respecte la volonté satirique de l'auteur, cultive l'absurde préfigurant Jarry (le couple impérial évoque le Père et la Mère Ubu) et flirte gentiment avec le présent, au gré de chansons malines, rock, folk et salsa. Car « Le voyage de Gulliver » est aussi une mini-comédie musicale - dont l'acmé est la danse « sexy » de l'impératrice Cachaça… Entre l'enchantement du décor et des marionnettes, la richesse de la bande-son, l'humour des dialogues et le traitement subtil du propos (sur la folie du pouvoir), Lesort et Hecq signent un nouveau sans-faute. Les spectateurs de 7 à 77 ans trépignent aux saluts. Ensorcelés par ce réjouissant voyage, ils sont presque ébaubis de découvrir les acteurs hybrides à leur vraie taille. Small is big, small is beautiful ! LE VOYAGE DE GULLIVER d'après Jonathan Swift Adaptation de Valérie Lesort Mise en scène de Christian Hecq et Valérie Lesort Paris, Théâtre de l'Athénée, jusqu'au 28 janvier. www.athenee-theatre.com Puis grande tournée dans toute la France. Durée : 1 h 15 Philippe Chevilley

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 17, 2022 6:38 PM
|
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires Culturelles" sur France Culture - 17 janvier 2022 Légende photo : Christian Hecq, Sociétaire de la Comédie Française• Crédits : Fabrice Robin Sociétaire de la Comédie Française et metteur en scène, Christian Hecq puise son jeu dans un art du mouvement inspiré par sa pratique de la marionnette et du mime. A l'occasion de son nouveau spectacle "Le voyage de Gulliver", il revient sur son parcours au micro d'Arnaud Laporte. Ecouter l'entretien (55 mn) Nouvelle création en duo avec Valérie Lesort, Christian Hecq revient avec Le voyage de Gulliver, librement inspiré de Jonathan Swift, et présenté en janvier au l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris puis en tournée dans toute la France. De l'astrophysique au théatre-physique Né en 1964 en Wallonie, Christian Hecq, se passionne d'abord pour l'astrophysique et les énergies douces. Fils d'un père chirurgien et d'une mère gymnaste passionnée par la danse et le théâtre, il découvre dans son enfance le cinéma muet et la marionnette. Après un an de faculté en sciences physiques marqué par une grande tristesse, il passe le concours de l'Insas à Bruxelles. Dès sa sortie de l'école, il est immédiatement recruté par Le Théâtre royal du Parc et le Varia. Il joue de tout avec des metteurs en scène belges majeurs tels que Michel Dezoteux, Isabelle Pousseur, Charlie Degote. On lui confie le rôle de Grégoire Samsa, dans La Métamorphose, de Kafka. A la frontière En 1989, l’Ève du meilleur jeune acteur belge. Il joue également avec Yves Beaunesne dans Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz en 1998. C’est au-delà des frontières géographiques ou artistiques qu’il exerce ses talents multiples, aussi bien sur la piste, avec Achille et Léonie chez Alexandre Bouglione, duo burlesque sélectionné pour représenter la Belgique au 20e Festival du cirque de demain, que sur les planches avec Benno Besson dans Le Cercle de craie caucasien de Brecht, Daniel Mesguich dans sa propre pièce Boulevard du boulevard puis L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais d’Hélène Cixous et Dom Juan de Molière, Jacques Nichet dans Domaine ventre de Serge Valletti ou encore Jean-Michel Ribes dans Musée haut, musée bas. Il s’initie à l’art de la marionnette avec Philippe Genty et Mary Underwood. C’est durant la tournée internationale de Boliloc, en 2008, qu’il entre dans la troupe de la Comédie-Française, dont il devient le 525e sociétaire le 1er janvier 2013. Il y enchaîne depuis les rôles, jouant Monsieur Orgon dans Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par Galin Stoev, Sosie dans Amphitryon de Molière par Jacques Vincey... Son interprétation de Bouzin dans Un fil à la patte de Feydeau mis en scène par Jérôme Deschamps lui vaut le Molière du meilleur comédien en 2011. Tandem créatif Pour le petit écran, il conçoit avec Valérie Lesort une série de programmes courts pour Canal , Monsieur Herck Tévé – une marionnette hybride qu’il interprète lui-même. Tous deux prolongent cette aventure au sein de la Troupe en y créant, en 2015, 20 000 lieues sous les mers, une adaptation pour acteurs et marionnettes du texte de Jules Verne dans lequel Christian Hecq interprète le capitaine Nemo. Hors Comédie-Française, il met en scène en février 2018 avec Valérie Lesort Le Domino noir d’Auber à l’Opéra de Liège puis à l’Opéra-Comique (spectacle ayant reçu le grand prix de la critique du spectacle lyrique 2018). En 2019, il met en scène avec Valérie Lesort Ercole Amante de Cavalli à l’Opéra-Comique (spectacle qui reçoit le Grand Prix de la critique 2020). Toujours en 2019, ils créent ensemble La Mouche, librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan, aux Bouffes du Nord (Christian Hecq reçoit le Molière du comédien dans un spectacle public 2020).En 2021, ils signent ensemble un Bourgeois gentilhomme à la Comédie française. Ses actualités : - Spectacle : Le voyage de Gulliver du 11 au 28 janvier au Théâtre Louis-Jouvet L'Athénée à Paris, une libre adaptation du roman de Jonathan Swift par Valérie Lesort, et mit en scène Christian Hecq et Valérie Lesort. Avec David Alexis, Valérie Keruzoré, Valérie Lesort / Emmanuelle Bougerol, Thierry Lopez, Laurent Montel, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin / Renan Carteaux.
En tournée en 2022 : 1 au 11 février Théâtre des Célestins, Lyon / 18 au 19 février Equilibre et Nuithonie, Fribourg, Suisse / 23 au 26 février Théâtre National de Nice / 2 au 6 mars Théâtre de Caen / 10 et 11 mars La Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne / 15 mars Théâtre Edwige Feuillères, Vesoul…. - Livre : Le beau livre Jouer ! de Christian Hecq et Valérie Lesort, photographies de Fabrice Robin, paru en septembre 2021.
- Spectacles : Christian Hecq sera à la Comédie-Française du 21 février au 3 avril dans "Le Malade imaginaire" mis en scène par Claude Stratz, puis du 7 mai au 21 juillet dans "Le Bourgeois gentilhomme" qu'il met en scène avec Valérie Lesort.
- Spectacle : En décembre 2022, il mettra en scène avec Valérie Lesort "La Petite Boutique des Horreurs" à L'Opéra Comique.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...