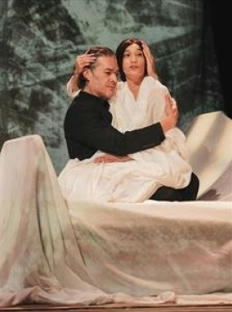Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 6:08 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 18 nov. 2022 Au Théâtre 14, le jeune acteur incarne superbement le personnage intersexe d'Herculine Barbin qui consigna son calvaire dans ses mémoires avant de se suicider en 1868. Collant au texte, redécouvert par Michel Foucault dans les années 1970, la metteure en scène Catherine Marnas orchestre un spectacle sensible, qui questionne le genre avec subtilité. Yuming Hey est un comédien « fluide » à tous égards. Au théâtre, on l'a vu en Mowgli dans le « Jungle Book » de Bob Wilson, en « bad boy », puis en vieil homme atteint d'Alzheimer ou en femme en colère dans les spectacles de Mathieu Touzé. A la télé, il a incarné Billy, la créature androgyne de la série de SF « Osmosis », et on le verra bientôt en influenceur dans « Emily in Paris ». Ce jeune artiste solaire qui transcende les genres sait tout jouer, sait tout faire. La metteure en scène, directrice du TNBA, Catherine Marnas, a eu la bonne idée de faire appel à lui pour incarner le rôle-titre de son spectacle « Herculine Barbin », créé en janvier dernier à Bordeaux et aujourd'hui à l'affiche du théâtre 14 à Paris. Herculine/Abel Barbin est née, femme, en 1838, et morte, homme, en 1868. Elle s'est suicidée, n'ayant pas supporté le changement de sexe, imposé après un examen médical à 22 ans montrant qu'elle développait des organes des deux sexes. Son calvaire est consigné dans ses mémoires, écrites dans les derniers mois de sa vie. Redécouvert par Michel Foucault en 1978, le texte a été réédité par ses soins. Judith Butler s'inspirera des travaux du philosophe français pour élaborer ses théories sur le genre Yuming Hey se coule à merveille dans la psyché tourmentée de son personnage intersexe, dans ses mots et ses envolées enflammés. Jamais il ne force le trait. Porté par sa technique imparable et par son intelligence du texte, il cultive la distance adéquate, surfe sur le fil de l'émotion sans verser dans le pathos. Et quand il quitte ses habits de femme pour ceux d'un garçon, il évite de surjouer les contrastes. Maintenant la dimension androgyne du personnage. Il reste sans faillir Herculine, transgenre pour le meilleur (ses émois de jeune fille, ses passions adolescentes) et pour le pire (l'opprobre, la solitude). Liberté et complétude Catherine Marnas a renoncé à son idée première d'introduire des matériaux contemporains dans son spectacle, pour se concentrer sur le texte fascinant d'Herculine. Dans un décor onirique, fait de projections mouvantes, elle confronte Yuming Hey à un autre comédien, Nicolas Martel, tour à tour narrateur, double ou protagoniste (prêtre, médecin). Le pas de deux devient fascinant quand l'ange (ou diable) gardien porte Yuming/Herculine dans ses bras ou entonne un chant d'une voix céleste. Derrière le martyre de l'homme et femme au corps incertain, s'exprime alors toute la beauté de l'être aspirant à la liberté et à la complétude. Par la magie du théâtre et la grâce d'un duo d'acteurs d'exception, le genre s'affranchit des théories et devient questionnement charnel, primal et existentiel. HERCULINE BARBIN Mis en scène par Catherine Marnas Paris, Théâtre 14 www.theatre14.fr Jusqu'au 3 décembre Puis en tournée. Philippe Chevilley

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 7:50 AM
|
par Anne Diatkine dans Libération - 18 nov. 2022 A partir d’archives, d’entretiens écrits ou audiovisuels, la comédienne Raphaëlle Rousseau signe un premier spectacle émouvant et singulier où elle entreprend un dialogue plus que réel avec l’actrice de «Peau d’âne». Raphaëlle Rousseau, jeune comédienne tout juste sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne, qu’on a pu découvrir cette rentrée dans Mes Parents de Mohamed el-Khatib, réussit l’impossible : elle ressuscite Delphine Seyrig. Par une imitation ? Non, ce serait risiblement triste et tristement gênant. L’actrice, qui signe avec Discussion avec DS son premier spectacle, crée les conditions d’une apparition de manière à ce que toute une salle hallucine collectivement et sans aucun effort la présence de celle qui ne se disait pas diva, et qui revient cette saison sur toutes les scènes de France et de Navarre, probablement en raison de son acuité et de son hyper contemporanéité avec l’ère #MeToo. Ce à quoi on assiste est d’autant émouvant que singulier : la naissance sur scène d’une actrice à travers une autre, absente, adulée, puis incorporée, au point qu’il devient indécidable, dans la deuxième partie, de savoir d’où provient cette voix si familière sur le plateau, sans effet d’écho, sans aucun micro, de quel corps il émane «pour de vrai» comme disent les enfants. Delphine Seyrig est alors avec nous, devant nous. Elle s’exprime, elle bouge, elle dialogue avec sa cadette qui a pris sa place dans un au-delà, peut-être située dans les cintres du théâtre – et il y a de l’humour dans ce paradis. Les deux s’écharpent un peu, notamment sur la maternité, on éprouve alors le manque qui a probablement étreint Raphaëlle Rousseau : celui de ne pas pouvoir approfondir la conversation, d’être constamment soumise à la rude limite des traces, un manque que toute personne qui a perdu un proche connaît, quand le dialogue imaginaire entre deux voix intérieures mute en monologue, rendant saisissant l’absence. Doutes et questions essentielles Car, et c’est une autre qualité du spectacle, la jeune autrice n’a réécrit qu’à la marge les propos de Delphine Seyrig. Elle a composé son texte grâce à la collecte d’une foule d’archives, d’entretiens dans la presse écrite ou de prestations radio ou audiovisuelles, procédant par imprégnation et en ne s’éloignant jamais des rives de son vocabulaire. Autrement dit, chaque parole, chaque tournure phrase, y compris dans leur légère désuétude, apparaît vraisemblable, quasi vérifiable. Ce faisant, la rencontre a lieu. Dans Peau d’âne de Demy, à chaque difficulté insoluble, Catherine Deneuve convoquait la fée Seyrig, qui transperçait alors un plafond en papier peint pour lui venir en aide. D’une certaine façon, la débutante Raphaëlle Rousseau procède de même : sur l’autel «mexicain» qu’elle lui a construit, elle éprouve l’impérieux besoin d’appeler l’actrice pour discuter avec elle de ses découragements, doutes et questions essentielles à propos de son art. Il est fort logique que le spectacle débute par un coup de fil au répondeur de Pôle emploi section intermittence. Une apparition ? «Je ne suis pas une apparition» répète Seyrig dans le monologue cultissime de Baisers volés, qui consent à la toute fin du spectacle à le rejouer, dévoilant dans un même geste sa cadette. «Elle s’est mise à m’accompagner» Raphaëlle Rousseau surgit dans un café et on s’étonne presque que la jeune femme parle avec sa propre voix, plutôt grave. C’est tardivement qu’elle a fait connaissance avec «l’inconnue célèbre» comme Duras nomme Seyrig dans un portrait paru dans Vogue, elle était déjà apprentie comédienne dans la classe libre du cours Florent, et la rencontre se fit d’abord à travers des entretiens. Non, elle n’a pas eu besoin de l’imiter pour la faire vivre, c’était comme si sa voix, ses mouvements étaient entrés en elle et ne demandaient qu’à ressortir. «Je ne comprends pas très bien ce qui s’est passé. Elle s’est mise à m’accompagner. Si j’avais choisi Jeanne Moreau, j’aurais sans doute eu besoin de travailler.» Raphaëlle Rousseau a fait quelques détours avant de reconnaître que si elle n’essayait pas d’être actrice, elle passerait à côté de sa vie. Ou plutôt, elle n’a jamais eu de doute sur ce qu’elle souhaitait faire, mais elle a eu besoin de commencer par deux années de classes prépa littéraires puis trois années «passionnantes» au Celsa, section communication. Cinq ans d’études donc, avant de passer le concours de la classe du cours Florent – elle y étudie pendant deux ans –puis celui de l’école du TNB où le cycle est de trois ans. «Dix ans pour devenir comédienne, mon père me dit toujours que je pourrais être chirurgienne aujourd’hui !» s’amuse-t-elle. Pourquoi oublie-t-elle le désir d’être actrice pendant quelques années ? «Je n’avais plus le corps de mon âme» Raphaëlle Rousseau a grandi à Luzargues, un village de 502 habitants dans l’Hérault, et prend ses premiers cours de théâtre à la MJC de la petite ville avoisinante. C’est d’abord le café-théâtre qui l’attire, et quand sa prof lance, à Montpellier, les Tremplins du rire, c’est tout naturellement qu’elle fait participer l’adolescente de 14 ans, qui écrit elle-même ses sketchs et dont les one man shows font hurler de rire les adultes. «C’était un peu particulier, parce que j’étais enfant. Pendant deux ans, j’ai été en première partie des humoristes les plus connus.» Tout se passe au mieux jusqu’à ce que ça tourne très mal. «Je faisais l’ouverture des Nuits de l’humour. A la fin du premier soir, le directeur vient me voir : “Ce que tu fais, c’est de la merde. Moi je vais t’écrire des sketchs, tu vas comprendre.”» Un mois plus tard, la jeune fille reçoit effectivement des textes, ils ne parlent que de régimes, de tromperies. Elle les lui renvoie, stupéfaite. C’est seulement aujourd’hui qu’elle analyse ce qu’elle qualifie de traumatisme : «Les sketchs de mes 14 ans fonctionnaient, car j’avais le corps de mon humour, j’étais une enfant. A 16 ans, j’étais encore cette enfant mais j’avais l’air d’une femme, il n’y avait plus le même horizon d’attente.» L’adolescente arrête alors radicalement de jouer. «Un schisme s’était ouvert sous mes pieds. Je n’avais plus le corps de mon âme. Cela me semblait irréconciliable.» Selon elle, c’est la ferveur des cours au TNB qui a permis cette réconciliation des années plus tard. Parallèlement à propre spectacle, Raphaëlle Rousseau joue dans Tenir debout de Suzanne de Baecque, autre jeune comédienne autrice qu’elle a rencontrée dans la classe libre de Florent. Elle sait aujourd’hui pourquoi il lui a fallu d’autres constructions avant de revenir à sa vocation. «J’ai choisi d’être actrice pour me relier à des absents que j’ai aimés, à des gens que j’aime et qui ne sont plus là, et à ceux qui n’existent peut-être pas encore, mais qui sont déjà là, imaginairement» nous écrit-elle dans un texto. Ce que montre fort bien son premier spectacle. Discussion avec DS au théâtre de l’Athénée (75009) jusqu’au 20 novembre. Légende photo : «Discussion avec DS» de et avec Raphaëlle Rousseau. (India Lange)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 7:16 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 14 nov. 2022 Bouleversant lamento, en français et en créole, sur l’exil et la perte, ainsi nous vient « L’amour telle une cathédrale ensevelie » de Guy Régis Jr ,seconde partie d’une trilogie destinée à la scène pour laquelle le compositeur et guitariste haïtien Amos Coulanges a composé des mélodies entêtantes, inoubliables. C’est un fleuve torrentiel de colère et de douleurs qui se jette dans l’océan du désespoir où voguent des barques surchargées d’infortune. Au bout l‘espoir, le pays mythique, le « Kanada » du chant créole, la loterie du destin, le fils dont on est sans nouvelle qui, sous un toit de Montréal un soir de pluie, exaspère le couple de circonstance que forment le vieil homme blanc et celle qu’il est allé chercher là-bas, la femme noire, aujourd’hui esseulée, éplorée en quête du fruit de ses entrailles parti en mer pour la rejoindre et dont elle est sans nouvelles. Surgit alors le puissant lamento des Boat-people dont sont multipliées les images vidéo (Dimitri Petrovic) de rafts surchargés d’êtres en perdition et souvent se renversant, alors s’élève un chant choral d’un beauté et d’une force sidérantes, éclairé et pimenté en contre point par la dispute verbale et domestique entre « La Mère du fils intrépide » et Le « Retraité mari ». Ainsi nous vient L’amour telle une cathédrale ensevelie de Guy Régis Junior, second volet de sa Trilogie des Dépeuplés. Le premier volet Étalé deux pieds devant étant celle du père, le troisième Et si à la mort de notre mère étant celui de la mère, le second, on l’aura compris, est celui du fils. Un fils quittant Haïti, l‘île maudite et adorée jamais nommée, pour l’au-delà des mers, la terre promise, le Kanada chanté en créole. La parole et le chant, l’homme et la femme, le français et le créole, l’espoir et le désespoir, la haine et la rage tout s’entremêle dans ce lamento de la perte (pays, amour, identité, enfant) et de l’exil, ce chant des larmes, ces gouttes d’eau perdues entre les vagues énormes de l’océan noir et les pluies en rafales cinglant les vitres. Dans son avant-propos à sa Trilogie, Guy Régis dit avoir « côtoyé de près » ces gens qui « arrêtent » le cours de leur vie en la laissant derrière eux « dans l’espoir de la revivre » ailleurs, autrement. Ainsi son père que Guy Régis Jr a vu partir quand il avait douze ans. « Quand je l’ai revu (à New York), j’en avais trente » et son père était devenu citoyen américain. Pendant toutes ces années sans nouvelles de lui , « il m’arrivait de penser qu’il était mort et que ma mère, qui espérait fortement son retour (pour venir nous chercher) nous le cachait ». Ainsi les pièces sont-elles accouchées, à la fois dans la douleur et dans « l’espoir possible » écrit Guy Régis. Quand on entre dans la salle, sur l’écran nous accueille le lancinant et obsédant mouvement des sombres vagues de l’océane guitariste et compositeur Amos Coulanges s’assoit bientôt sur le côté et commence. Cet opéra-lamento doit beaucoup à ce grand compositeur haïtien sollicité par Guy Régis Jr pour mettre ses mots en chant. Longtemps ses airs nous poursuivront au sortir du Théâtre de la Tempête où le spectacle est repris dans une intense proximité avec le public, alors qu’ à sa création au Francophonies de Limoges le mois dernier, la scène du Théâtre de l’Union semblait un peu trop vaste et le public trop loin. Outre le couple pivot et complice que forment Guy Régis Jr et Amos Coulanges. il faut citer tous ceux dont l’ensemble fait puissamment corps : Nathalie Vairac (impressionnante mère) , Frédéric Fahena - en alternance avec François Kergoulay- le retraité canadien, tendrement pugnace), Derilon Fils (le fils parti en mer, comédien et chanteur ténor), Deborah-Menelia Attal (soprano), Aurore Ugolin (mezzo soprano), Jean-Luc Faraux (basse-baryton). Ecoutez-les tous : « Kanada ! Kanada ! Kay manman m prale. Nan jip manman m poum tounen al chwe.Manman pye bannann. Nanpye manman m.La pou m mouri. Lanmou o ! Lanmou ! Lanmou kraze miyèt mòso! Mezanmi lanmou kraze farinay ! Lanmou kite monte byen wo tankou katedral disètlongè » (Canada ! Canada, ! Je veux retrouver ma mère. Dans sa jupe que je veux échouer. Maman une bananeraie. Dans ses pieds. Là que je dois finir ma vie. L’amour ô ! L’amour ! L’amour s’est écrasé en miettes ! Mes amis l’amour s’est pulvérisé en poussières ! L’amour monté bien haut telle une cathédrale inatteignable.) Théâtre de la Tempête (Cartoucherie) , du mar au sam 20h30, dim 16h30 jusqu‘au 11 décembre. Le texte de « La trilogie des Dépeuplés » de Guy Régis Jr est publié aux Editions Les solitaires intempestifs, 254p, 17€ Légende photo : Scène de "L'amour telle une cathédrale ensevelie" © Christophe Pean

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 17, 2022 9:21 AM
|
Propos recueillis par Guillemette Odicino pour Télérama
Publié le 02/09/22 mis à jour le 07/09/22 Pure tragédienne sur les planches, on l’a vue grave ou drôle au cinéma, chez Sautet, Blier, Bonello ou celui qui l’a fait naître au théâtre, Patrice Chéreau... Seule sur scène, la comédienne reprend avec bonheur “La Douleur”, adapté de Marguerite Duras, son monologue fétiche depuis vingt ans, dans la mise en scène originale de Chéreau. Elle a les yeux de Bette Davis. Et un rire perlé, qui éclate à tout bout de champ pendant l’interview. Qu’on se le dise, Dominique Blanc est une jeune fille de 66 ans rigolote, même si des rôles dramatiques, au cinéma, et surtout au théâtre, en ont fait l’une de nos plus grandes comédiennes, auréolée de quatre Césars et quatre Molières et désormais même au programme du bac 2023 ! Merveilleuse lesbienne libérée dans Milou en Mai, de Louis Malle (1991), gouailleuse môme caoutchouc dans Indochine, de Régis Wargnier (1992), elle reste inoubliable pour son interprétation d’une jalouse -obsessionnelle dans L’Autre, de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic (2008), qui lui valut la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise. Au théâtre, sa carrière est éblouissante, d’Une maison de poupée, d’Ibsen (1998), aux Liaisons dangereuses, jusqu’au récent Angels in America, mis en scène par Arnaud Desplechin à la Comédie-Française, qu’elle a intégrée sur le tard, et en majesté. Sur les planches, c’est avec Chéreau que tout commença, que tout devint d’une intensité sans égale, grâce à une Phèdre mémorable, et La Douleur, adapté de Marguerite Duras, un texte devenu comme une seconde peau, qu’elle reprend au TNP de Villeurbanne à partir du 28 septembre. Cette rentrée est la sienne puisqu’elle sera aussi à l’affiche de L’Origine du mal, le thriller familial et capiteux de Sébastien Marnier (5 octobre), et sur le petit écran dans une série glaçante adaptée d’un roman de Franck Thilliez, Syndrome E. Libre, émue, primesautière, la comédienne se souvient de tout, y compris de drôles de rendez-vous manqués. En fait, la tragédienne est un clown blanc. Vous reprenez La Douleur pour la cinquième fois. Pourquoi au TNP de Villeurbanne, cette fois ?
C’est là que j’ai connu Patrice Chéreau. La boucle est bouclée. Je voulais le faire en amont de 2023 et des dix ans de sa mort. Je serai dirigée par Thierry Thieû Niang, son ami chorégraphe, dans la mise en scène d’origine de Patrice. La Douleur est le texte de ma vie. Pour moi, c’est comme un motif de peinture qui évolue au fil du temps, de mon émotion, de ma technique, de mon parcours de femme, et sur lequel je dois revenir sans cesse. En quoi ce texte vous est-il essentiel ?
Avril 45, l’ouverture des camps de concentration, comment oublier ça ? Comment oublier la Shoah ? Je suis effarée de la façon dont on oublie l’histoire aujourd’hui. Et puis, il y a ce thème théâtral si intense : une femme, seule chez elle, qui attend, qui espère. Comment l’avez-vous découvert ?
En 2003, je joue Phèdre, mis en scène par Patrice. Le climat de répétition a été euphorique, mais jouer à l’Odéon pendant six mois, c’est trop, et j’en sors brisée. D’autant que j’enchaîne avec un rôle d’héroïnomane dans Un couple épatant - Cavale - Après la vie, la trilogie de Lucas Belvaux. Ensuite, je ressens un énorme vide, j’erre d’agent en agent, et je ne reçois aucune proposition. L’homme de ma vie me conseille d’appeler Patrice, qui, me voyant perdue, décide que nous allons nous envoyer des textes et essayer d’inventer quelque chose ensemble. C’est Thierry Thieû Niang qui trouve le texte de Duras. Dès que je le lis, je le sais : ce sera ça et rien d’autre. Je propose à Patrice de me mettre en scène dans un décor minimaliste : juste une femme qui attend, une table, une chaise. La première est prévue en Catalogne dans un tout petit théâtre. Nous partons avec Patrice et Thierry une semaine en avance : répétition tous les après-midi, et tous les soirs, au dîner, Patrice me parle de son enfance. Le samedi de la première arrive, et soudain je panique : je n’y arriverai jamais ! Et je décide de me tirer en douce ! Comme s’il avait deviné, Patrice ne cesse de m’appeler : « Qu’est-ce que tu fais ? Tu es dans ta loge ? Thierry va t’apporter à manger. Tu ne bouges pas, hein ? » Je suis restée, j’ai joué, c’était merveilleux. Ce soir-là, je suis née, à nouveau. Chéreau vous a sauvée ?
Il avait dû réaliser qu’il m’avait un peu abandonnée pendant les représentations de Phèdre. Les Américains lui avaient prêté une grande villa avec une grande piscine en Californie pour écrire un film. Il rêvait de son Napoléon avec Al Pacino. Il était parti et m’avait laissée dans une grande solitude avec Phèdre sur les bras. Avec La Douleur, c’est comme s’il avait réparé son absence. Comment l’avez-vous rencontré ?
Je faisais partie de la première année de Classe libre du cours Florent, avec deux professeurs, Francis Huster et Pierre Romans, un immense pédagogue dont nous étions tous amoureux, les garçons comme les filles. Avec Pierre, nous montons un spectacle sur Tchekhov pendant trois soirs à l’Espace Cardin, et, le premier soir, Chéreau est là. Au mois de septembre 1980, il laisse un message sur mon répondeur et je crois que c’est une blague ! Il me donne rendez-vous chez lui, où, quasiment aussi intimidé que moi, il me propose de jouer plein de petits rôles dans Peer Gynt, d’Ibsen, au TNP de Villeurbanne, avec Maria Casarès, Didier Sandre et Gérard Desarthe. Ce sera une année de rêve : j’ai 25 ans, je me sens plus à l’aise, nous rions beaucoup, et je crois que ça lui plaît, car, déjà, autour de lui, commence le ballet des courtisans. Je n’ai jamais fait partie de sa cour. “Ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte.” Ni de son école au sein de son théâtre à Nanterre…
Jamais. Pour une raison toute simple : d’après Pierre Romans, Patrice pense à moi pour Les Paravents, de Genet, mais il ne me prendra pas si je présente l’école. Et en effet il m’a appelée pour jouer une petite pute à la fin des Paravents. Puis, à Nanterre, j’enchaîne avec Terre étrangère, sous la direction de Luc Bondy, où je joue la maîtresse de Michel Piccoli. Lors de la première lecture, pour laquelle Luc avait demandé que nous sachions déjà nos textes, Michel tient sa brochure à la main : il n’a pas eu le temps de l’apprendre. Cela m’agace, je lui arrache les feuilles des mains et je les balance ! Michel a adoré mon culot. Dans les coulisses, il vient vers moi : « Dominique, si je fais quoi que ce soit qui vous dérange dans cette scène où nous sommes censés nous toucher, il faut me le dire, car je ne voudrais surtout pas être grossier ou intrusif. » Cet homme était une merveille. Il était l’élégance, l’éthique, l’engagement, l’utopie. Il était mon ami. Quelle petite fille étiez-vous ?
Née à Lyon, numéro quatre d’une famille de cinq enfants. Mon père était gynécologue-obstétricien mais il a fini par arrêter les accouchements car, travaillant jour et nuit à l’hôpital, au dispensaire et en cabinet privé, il allait y laisser sa peau. Un jour, j’ai osé dire que, d’une certaine manière, en tant qu’interprète, moi aussi je mettais au monde des êtres. Il n’a pas aimé cette comparaison ! À quel moment naît l’envie de jouer ?
Ma mère a un amour fou pour le cinéma italien, que nous regardons à la télévision. Les comédiennes italiennes sont à l’origine de ma passion : des tempéraments incroyables, et des physiques si différents, de Sophia Loren à Giulietta Masina, qui semblent dire que tout est possible. À l’adolescence, je suis mal dans ma peau, je me sens différente de mes frères et de ma sœur. Je convaincs ma mère de m’inscrire dans un cours d’art dramatique. “Lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse.” C’est le déclic ?
Rapidement, ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire de Lyon. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte. C’était violent : une fenêtre de liberté que je n’imaginais même pas s’était entrouverte pour se refermer d’un coup. J’ai passé mon bac scientifique et commencé des études d’architecture. Cent étudiants dont seulement une dizaine de filles et deux Antillais dans une école aux locaux en préfabriqué. Et un prof de géométrie qui déclarait que sa matière était « trop difficile pour les filles et les Noirs ». En deuxième année, pour tenter d’améliorer l’ambiance et les locaux, nous décidons avec des copines de prendre en otage le directeur de l’école. Pardon ?
Absolument ! Mortes de peur, nous sommes entrées dans son bureau, avons fermé à clé, et lui avons signifié sa prise d’otage et nos revendications. Il avait un frigo avec une bouteille de champagne à l’intérieur. Après avoir bu son champagne, nous ne savions plus quoi faire et l’avons relâché assez vite ! Évidemment, nous n’avons obtenu aucune amélioration, et mon dossier pour continuer mes études à Paris n’est jamais arrivé à destination… Mais à Paris, vous tentez le cours Florent ?
Quand je m’y rends pour la première fois, je suis outrageusement maquillée, je porte une jupe à fleurs et de gros sabots et je me retrouve au milieu d’une jeunesse dorée qui passe des scènes pour rigoler. Pour être acceptée, je présente Dans ma maison, de Jacques Prévert, et je suis tellement engagée physiquement dans mon interprétation que les autres élèves sont atterrés ! Mais François Florent trouve ça intéressant. Pour que je me sente plus à l’aise, il me propose de venir aux cours du soir, avec des gens plus âgés. Et, pour pouvoir payer mes cours, je deviens la femme de ménage du Cours. Au bout de six mois, Florent me donne les clés : c’est moi qui ouvre les salles le matin et les ferme le soir. Quelle fierté ! Sauf que lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse… Seul Florent croyait en moi : « Passe les concours, tu ne les auras pas, mais au moins ils verront ta gueule. » En effet, je n’ai ni Conservatoire, ni Rue Blanche, mais j’ai rencontré Chéreau. Lire aussi : Dominique Blanc : “Le seul qui pouvait m’aider à m’en sortir était Patrice Chéreau”44 minutes à regarder À vos débuts, vous avez connu une drôle d’expérience avec Jean-Luc Godard…
Je suis engagée comme figurante dans deux tableaux de Passion [1982]. Pour « Le bain turc », je dois être assise au bord de la piscine et Godard me demande de soupeser mes seins en rythme avec le Requiem de Mozart ! Puis j’apprends que finalement je ne fais plus le tableau de « La jeune fille à l’ombrelle » car il a réalisé que je suis blonde. Je ne veux pas perdre mon cachet. J’ose contester, il finit par céder. J’aurais dû me méfier… Nous sommes le 31 décembre 1980 aux studios de Boulogne, c’est un énorme travelling, j’ai une perruque et un chihuahua dans les bras qui essaie de me mordre le sein. Le directeur de la photographie, Raoul Coutard, derrière la caméra, me crie dessus, et Godard s’y met aussi. Une journée de terreur à la fin de laquelle je dis ma façon de penser à Godard et combien c’est scandaleux de m’avoir maltraitée ainsi. Le lendemain, son assistant m’appelle pour me dire que le maître continue à travailler sur le scénario et qu’il veut que je vienne en Suisse car il écrit pour moi ! J’ai refusé, il ne faut pas exagérer. “La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit.” La 5 octobre, vous serez à l’affiche de L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, dans un rôle de matriarche étrange…
Cette femme a une part de folie, qui s’exprime par le syndrome de Diogène, la collectionnite aiguë. J’ai tenu à avoir des ongles comme des griffes, car, avec Jacques Weber, nous formons un couple de vieux fauves qui va être réveillé par le personnage qu’incarne Laure Calamy. Ils ont tous un grain dans cette famille. La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit. Vous serez aussi bientôt dans la série Syndrome E, sur TF1.
Le rôle est fantastique : cette chirurgienne est une méchante à 400 %. Encore plus folle que la mère de L’Origine du mal ! Comme il est réjouissant d’imaginer un passé, des traumatismes à ce genre de personnage… Pour mon premier jour de tournage, j’étais très concentrée sur le texte, mais la réalisatrice, Laure de Butler, m’a conseillé de prendre du plaisir avant tout, ce qui n’a pas été si courant dans mon parcours de comédienne. C’est-à-dire ?
Très vite, au cinéma, on m’a collé la couleur du tragique. Peut-être à cause de mon premier vrai rôle, l’alcoolique de La Femme de ma vie, de Régis Wargnier [1986]. Ensuite les cinéastes ne m’ont plus vue que comme une femme déprimée ou suicidaire ! Pourtant, juste après, quand je jouais Georgette dans Quelques Jours avec moi, de Claude Sautet [1988], j’étais très rigolote, n’est-ce pas ? Mais vous aimez la tragédie ?
Évidemment ! Je suis fascinée par les destins tragiques. Quand, au début de La Douleur, Marguerite Duras dit que « la douleur est l’une des choses les plus importantes de ma vie », je m’y retrouve. Sans doute parce que j’ai eu tant de mal à m’imposer. J’avais le sentiment qu’il n’y avait pas de place pour moi dans ce métier. À mes débuts, lors d’une audition, le metteur en scène Jacques Rosny m’avait conseillé de m’orienter vers… les arts martiaux ! Et toutes ces réflexions inouïes que j’entendais sur mon physique : on ne sait pas où vous ranger, vous avez un corps de femme sur un visage d’enfant… Et vous entrez à la Comédie-Française en 2016…
La revanche à 60 ans ! Et c’est grâce au Phèdre de Chéreau que j’avais joué treize ans plus tôt avec deux immenses comédiens de la Comédie-Française, Michel Duchaussoy et Éric Ruf, qui restera mon Hippolyte à jamais. Quand le merveilleux Éric est devenu l’administrateur général du Français, il m’a proposé d’intégrer la troupe dans l’Agrippine de Britannicus. Je n’en revenais pas ! Moi qui avais toujours été boudée par les instances officielles et avais tracé ma route toute seule, voilà qu’il m’offrait le collectif, et pas n’importe lequel. “J’espère mourir sur scène. Comme Molière. Ou au moins dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ?” Aviez-vous le trac ?
Je me retrouve dans l’arène avec soixante comédiens en pleine activité. Seule manière de se mettre dans le bain ? Travailler. Seul le travail vous apprend à connaître les gens. Pendant cinq ans, j’ai enchaîné les rôles. La tête dans le guidon. Au cinéma, je n’ai pu tourner que Réparer les vivants [2016], où je jouais un toubib, et Patients [2017], pour Grand Corps Malade, où je jouais… un toubib. Puis, en janvier 2021, vous êtes nommée sociétaire.
J’ai pleuré pendant la cérémonie… Toute la troupe au complet, masquée à cause du Covid, mais qui vous applaudit à tout rompre pendant dix minutes. Bouleversant. Vous sentez-vous sanctuarisée ?
Depuis mon entrée au Français, qui m’a donné une nouvelle visibilité, le cinéma et la télévision semblent me rêver autrement. Et puis, sans le Français, je n’aurais peut-être jamais travaillé avec Christophe Honoré. La vieille marquise de Villeparisis dans Le Côté de Guermantes est si comique ! Ni avec Arnaud Desplechin, que je chassais depuis mon coup de foudre pour son film La Sentinelle [1992]. J’avais traîné dans les restaurants qu’il fréquentait, mais je n’avais jamais osé l’aborder. Avez-vous peur de vieillir ?
J’ai mes premiers cheveux blancs, et mon projet est de les garder. Et personne ne touchera jamais à ma figure. Je suis trop curieuse de savoir quelle tête j’aurai à 80 balais. J’aimerais juste ne pas avoir un goitre à la Balladur ! Que faites-vous quand vous ne jouez pas ?
Je suis… pénible. Si je devais cesser de jouer, je voyagerais. Mais je ne pourrai jamais arrêter. La formule peut paraître pompeuse, mais je ne suis jamais autant moi-même que sur une scène. J’espère y mourir. Comme Molière. Et si ce n’est pas sur scène, au moins que ce soit dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ? De quoi rêvez-vous pour la suite ?
J’aimerais rire. Avec les années, j’ai envie de comique et de burlesque. Travailler avec Roberto Benigni, par exemple. Sortir le clown qui est en moi. Mais, en attendant, avec La Douleur, je ne souffre de rien. Propos recueillis par Guillemette Odicino / Télérama DOMINIQUE BLANC EN QUELQUES DATES
25 avril 1956 Naissance à Lyon.
1986 La Femme de ma vie, de Régis Wargnier, premier grand rôle au cinéma.
1995 L’Allée du roi, téléfilm de Nina Companéez.
1999 Troisième César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Ceux qui m’aiment prendont le train, de Patrice Chéreau.
2001 César de la meilleure actrice pour Stand-by, de Roch Stéphanik.
19 mars 2016 Entrée à la Comédie-Française.
A voir : La Douleur de arguerite Duras, à L'Athénée - Théâtre Louis-Jouvet du 23 novembre au 11 décembre
https://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/la-douleur.htm
Photo Yann Rabanier pour « Télérama »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 17, 2022 4:26 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 17 nov. 2022
L’un est fermé pour travaux depuis plus de six ans, et l’autre accuse un déficit d’au moins 5 millions d’euros. Lire sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/17/le-theatre-de-la-ville-et-le-chatelet-deux-scenes-parisiennes-a-la-derive_6150238_3246.html
La place du Châtelet est à la dérive. D’un côté, des échafaudages masquent la façade du Théâtre de la Ville, en travaux depuis plus de six ans, alors qu’il aurait dû rouvrir en 2019. Personne ne comprend pourquoi, beaucoup crient au scandale face à la fermeture d’une salle majeure de la capitale, propriété de la Mairie de Paris. Emmanuel Demarcy-Mota, le directeur du théâtre, et ses équipes, ont trouvé refuge à l’Espace Cardin quand les travaux ont commencé, en 2016. Chaque année, ils bâtissent une saison hors les murs, en travaillant avec différentes scènes de Paris et d’Ile-de-France. Ils arrivent à conserver leurs spectateurs (environ 200 000), ce qui est remarquable. Mais certains de leurs habitués leur demandent s’ils reverront un jour le Théâtre de la Ville. Quant à eux, ils aimeraient voir le bout d’un tunnel qui paraît sans fin. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « C’est violent, je ne suis pas une criminelle » : Ruth Mackenzie conteste son éviction de la direction du Théâtre du Châtelet En face, la situation n’est pas meilleure, pour des questions de gouvernance. Le Châtelet, autre fleuron de la Mairie de Paris, est sans direction artistique depuis le renvoi de Ruth Mackenzie, en août 2020. Son codirecteur, Thomas Lauriot dit Prévost, est resté en place jusqu’en juillet, sans imposer sa marque. Privé d’identité, le Châtelet est devenu un garage. La programmation saute de Rone à Mahler, le public ne sait plus où il en est. Il en vient à déserter. A cela s’ajoute un trou financier évalué par les plus optimistes à 6 millions d’euros, qu’il va bien falloir combler, d’une manière ou d’une autre. Les spéculations vont bon train, dans l’attente de la nomination d’un ou d’une directrice artistique, prévue pour décembre. Contrairement au Châtelet, régulièrement rénové depuis 1980, le Théâtre de la Ville n’a pas fait l’objet de travaux depuis sa révolution de 1968, qui l’a complètement transformé. Valentin Fabre et Jean Perrottet ont cassé la salle à l’italienne et dessiné un gradin en béton qui plonge sur la scène et offre aux 1 100 spectateurs une vision jugée plus démocratique. Après Jean Mercure, qui l’a inauguré, ce nouveau Théâtre de la Ville a été dirigé par Gérard Violette, à qui Emmanuel Demarcy-Mota a succédé en septembre 2008. « Dès mon arrivée, j’ai entamé des discussions avec la Mairie sur des travaux de rénovation et de mise en conformité – électricité, cage de scène, accueil du public… – qui s’imposaient, relate-t-il. Nous nous sommes mis d’accord pour une rénovation partielle, donc pour ne pas détruire le théâtre une nouvelle fois. » Procédures sanitaires spéciales En 2014, un appel à candidatures d’architectes est lancé. Il est remporté par l’agence Blond et Roux, très active dans le domaine culturel. En septembre 2016, le théâtre est fermé. En 2017 commence la phase de désamiantage et de curage du plomb. Puis la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile-de-France (Cramif) entre dans le jeu. En vertu d’une de ses missions – prévenir les risques professionnels –, elle demande d’installer un cintre informatisé. Le cintre est la partie supérieure de la scène où se trouve la machinerie permettant d’activer les décors, la lumière et le son. Au Théâtre de la Ville, sa manipulation est manuelle, ce que la Cramif juge préjudiciable à la santé des techniciens. « On quitte alors la rénovation partielle, et il faut voter un nouveau budget », explique Emmanuel Demarcy-Mota. Premier retard annoncé. Lire l’entretien avec Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost : Article réservé à nos abonnés Réouverture du Théâtre du Châtelet : « L’accès à tous, en particulier les familles, est notre fil rouge » Le deuxième s’appelle « DAU ». La Mairie de Paris soutient ce projet trouble d’immersion dans l’univers soviétique imaginé par le Russe Ilya Khrzhanovskiy, qui marque la réouverture du Châtelet, en janvier 2019, après deux ans et demi de travaux. Elle met à sa disposition le Théâtre de la Ville. Des trous sont creusés dans les murs, et dans le parquet de la Coupole, la salle de répétition, sous les combles. De nouvelles zones de plomb sont mises au jour, qu’il faut traiter. A ce moment-là, la réouverture du Théâtre de la Ville est prévue pour 2021. Mais, troisième cause, le Covid bloque tout à partir de mars 2020. Quand les travaux reprennent, en juin, l’entreprise Colas, qui les mène, doit respecter des procédures sanitaires spéciales liées au plomb, qui prennent du temps. Colas fait alors savoir qu’il lui faudra non pas dix-neuf, mais vingt-quatre mois. Nouveau planning, nouveau retard. Et ce n’est pas fini. La Mairie décide de faire ravaler la façade, ce qui n’était pas dans le projet. Son coût est financé par la publicité posée sur les échafaudages. Pour le reste, il faudra intégrer l’augmentation du prix des matériaux induite par la guerre en Ukraine. Prévu pour 25,95 millions d’euros, le budget total sera « de l’ordre de 40 millions d’euros », selon Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris chargé de la construction publique et du suivi des chantiers. « Les travaux, c’est toujours long, plaide-t-il, et il est courant, voire systématique, qu’ils s’avèrent plus complexes dans un théâtre. » Sa défense, accréditée par Carine Rolland, adjointe d’Anne Hidalgo chargée de la culture, peine à convaincre. « De grandes ambitions » Certes, le chantier du Théâtre de la Ville est celui de la malchance. Mais son retard ne saurait s’expliquer sans des dysfonctionnements pointés par les professionnels, en off. « Personne ne se parlait vraiment, résume l’un d’eux. Il n’y avait pas de concertation entre les différents acteurs du chantier, les gens se tiraient dans les pattes, ça partait dans tous les sens. » Quand on évoque le calendrier non tenu, Jacques Baudrier renvoie à Stéphane Roux, l’architecte, lequel aurait volontiers donné son point de vue. Mais la Mairie de Paris ne l’a pas autorisé à nous parler. « C’est très dangereux, la mutualisation ou la synergie. Une identité doit se préserver à tout prix » – Xavier Couture, président des conseils d’administration des théâtres de la Ville et du Châtelet Fin octobre, Carine Rolland assurait que la réouverture du Théâtre de la Ville aurait lieu en septembre 2023, et que le bâtiment serait livré en mars. Emmanuel Demarcy-Mota espère que ce nouveau calendrier sera tenu pour pouvoir réinstaller l’ensemble des équipes, rôder l’outil et planifier les spectacles. Au Théâtre du Châtelet, un chantier d’un autre ordre est en cours. Le sort des deux théâtres est lié. Président du conseil d’administration du Théâtre de la Ville depuis 2018, Xavier Couture a été nommé à la présidence de celui du Châtelet en février. Cet ancien directeur de l’antenne de TFI est l’homme-clé de la place du Châtelet, pour laquelle il a, dit-il « de grandes ambitions. » « Je ne trouve pas normal que Xavier Couture soit président des deux CA », tacle Jean-Luc Choplin, qui a dirigé le Châtelet de 2004 à 2017. A son départ, la Mairie de Paris a choisi Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost. Très vite, leur direction a posé problème. « DAU » a été un échec public et financier, une polémique interne a tourné au vinaigre, et Ruth Mackenzie a été brutalement renvoyée. Depuis, le Châtelet va à vau-l’eau. Le premier objectif de Xavier Couture est de lui redonner une direction artistique. Il a lancé un premier appel à candidats qui devait aboutir en septembre, puis un deuxième qui aurait dû aboutir autour du 15 novembre. La nomination vient d’être une nouvelle fois reportée à décembre. Déficit Xavier Couture argue le manque de temps des membres du comité de sélection, où l’on trouve Alice Coffin, Ariel Weil, Natacha Valla, Sophie Lacoste, Carine Rolland, Dominique Bluzet… Sur la quarantaine de candidats, cinq ou six restent en lice. Les noms ne sont évidemment pas publics, mais la rumeur dévoile ceux d’Olivier Py, de Marc Minkowski ou de Myriam Mazouzi. Quel que soit l’élu, il aura fort à faire. L’appel à candidature demande qu’il soit un as administratif, qu’il ait un projet artistique musical large et ouvert à tous les publics, et qu’il fasse un énorme travail au niveau des finances – un euphémisme. Des personnalités de haut niveau ont renoncé à se porter candidates pour cette raison : qui voudrait hériter d’un trou dont Xavier Couture concède lui-même qu’il se situe de « 5 à 8 millions d’euros » ? Quarante mètres séparent le Châtelet du Théâtre de la Ville, où les salaires sont estimés à 30 % de moins Ce déficit a été creusé par l’absence d’économies faites pendant les travaux du Châtelet, de 2015 à 2018, où tout le personnel a été payé au régime plein, et de l’argent engagé dans des projets à venir. A cela s’est ajouté l’échec « DAU », l’absence de recettes pendant le Covid et, d’une manière structurelle, une masse salariale importante. Quarante mètres séparent le Châtelet du Théâtre de la Ville, où les salaires sont estimés à 30 % de moins. Cet écart s’explique par le tournant vers le lyrique qu’a pris le Châtelet dans les années 1980, quand Jacques Chirac, alors maire de Paris, a décidé de faire de son théâtre un concurrent de l’Opéra Bastille, ouvert en 1989. En 2020, une négociation a été entamée pour remettre à plat la convention collective, très favorable aux 110 employés. Elle n’a pas abouti. La subvention, elle, s’est érodée dans les dernières années. De 18 millions d’euros, elle est passée à 15,3 (contre 11,1 pour le Théâtre de la Ville), mais elle continue à faire du Châtelet l’institution culturelle la mieux dotée par la Mairie de Paris. « Avec cette subvention à la baisse et une situation qui va être tendue dans les années à venir, je suis obsédé par la recherche de nouvelles sources de financement, avoue Xavier Couture. Je compte beaucoup sur ma grande gueule pour attirer le mécénat. » « Une épine dans le pied » Certes, mais pour attirer les abeilles, encore faut-il que le miel soit délicieux. Qui aurait envie de s’engager dans un théâtre d’accueil ? Au Châtelet, la programmation est assurée par un chargé de production dont ce n’est pas le métier. Des spectacles récents ont pris le bouillon, comme Le Roman de Fauvel ou Le Vol du Boli, et la reprise de la comédie musicale 42nd Street, pour les fêtes, s’annonce très acrobatique. Il lui faut atteindre plus de 4 millions d’euros de recettes pour être à l’équilibre, et pour cela vendre 70 000 places à des tarifs surprenants pour un théâtre public (109 euros pour les plus chères). Consciente du problème, la Mairie de Paris a demandé au Théâtre de la Ville de soutenir le Châtelet, en présentant dans sa salle cinq à six spectacles par an. Ils trouvent leur public, et Xavier Couture s’en réjouit, tout en y voyant « une épine dans le pied qui brouille l’identité du théâtre ». Mais laquelle ? La Mairie de Paris a écarté deux solutions radicales qui auraient pu être envisagées pour sortir de l’impasse financière : la vente pure et simple, et la délégation de service publique (DSP), qui aurait mis le théâtre à la main d’un grand groupe ou d’un mécène. Mais on voyait mal la Mairie, même endettée à plus de 7 milliards d’euros, se séparer d’un de ses plus beaux fleurons. Une autre hypothèse a été envisagée : la mutualisation du Théâtre de la Ville et du Châtelet. Pas simple, ne serait-ce qu’en raison des écarts de salaire. Elle est repoussée par Xavier Couture : « C’est très dangereux, la mutualisation ou la synergie. Une identité doit se préserver à tout prix. Mon expérience dans le privé me l’a appris. » Emmanuel Demarcy-Mota plaide pour une piétonnisation de la place qui créerait un lien entre les deux théâtres « Un plan d’économies a été mis en place par Frédéric Ivernel, l’administrateur général du Châtelet » (et ancien cadre de TFI, lui aussi), poursuit Xavier Couture. Il précise que « les grandes lignes sont tracées pour 2022, 2023 et 2024 », et qu’elles ne peuvent être rendues publiques tant que la nouvelle direction artistique n’est pas nommée. On reste donc dans l’expectative et le flou. Tout comme pour la question de la place du Châtelet. Depuis qu’il dirige le Théâtre de la Ville, Emmanuel Demarcy-Mota plaide pour une piétonnisation de cette place qui créerait un lien entre les deux théâtres. Xavier Couture reprend cette idée à son compte, en l’élargissant. Il évoque des discussions avec Carine Rolland, qui devraient mener à « la création d’une entité de la “Place du Châtelet” , une structure à déterminer (…). Cela se fera dans l’affirmation de deux projets artistiques, différents et complémentaires, et en envisageant aussi le développement, sur l’espace urbain de la place elle-même, d’une série d’activités à même d’attirer tous les publics ». On ne voit pas très bien à quoi pourrait ressembler et servir cette structure, ni à quoi ressemblerait la place. Il est question depuis longtemps qu’elle soit interdite aux voitures, avec des couloirs de bus côté Théâtre de la Ville. Mais l’ampleur des travaux en cours dans la capitale et l’exaspération des Parisiens ont convaincu la Mairie de reporter à la prochaine mandature, au moins, cette piétonnisation. Restent deux théâtres sur la place. Et en mauvaise passe. Brigitte Salino Légende photo : Le théâtre du Châtelet, à Paris, le 28 janvier 2022. EDMOND SADAKA/SIPA

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 6:49 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - 16 nov. 2022 « Avons-nous vraiment besoin d’un vrai sexe ? » s’interrogeait le philosophe Michel Foucault, auteur de la préface qui introduit le récit édifiant d’Herculine Barbin, hermaphrodite que la médecine et la justice firent basculer du féminin au masculin sans se soucier des conséquences dévastatrices que cette assignation allait engendrer. Devenue Abel aux yeux de la société, Herculine se suicide en 1868. À 29 ans. Non sans avoir écrit ce qu’il en fut de sa vie, de l’amour ; de l’insouciance, du bonheur peu à peu rattrapés, puis anéantis par le vent mauvais du destin. C’est cette trajectoire tragique que met en scène Catherine Marnas en réveillant cette figure du passé. Et en la propulsant dans un présent où la jeunesse n’hésite plus à revendiquer la liberté de choisir son genre. Ou celle de ne pas le choisir. Sur un plateau blanchi, nappé de vidéos immersives, deux comédiens (Yuming Hey et Nicolas Martel) ressuscitent Herculine, unique et double, fille et garçon, à qui fut imposée une identité et une seule. Un spectacle d’actualité, c’est peu de le dire.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 11:50 AM
|
Publié sur le site d'ARTCENA - 15 novembre 2022 SOUTIEN
La Commission de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques s'est réunie les 7 et 8 novembre 2022 à ARTCENA pour désigner les nouveaux lauréats. Découvrez sa sélection ! Littérature dramatique - Notre vallée de Julie Aminthe
- 65 rue d'Aubagne de Mathilde Aurier
- Justice 67 de Frédéric Barriera et Guillaume Mouralis
- Des châteaux qui brûlent de Arno Bertina et Anne-Laure Liégeois
- La Maison de Phèdre de Pascale Breton
- Dans ses yeux de Marie-Pierre Cattino
- VIVE de Joséphine Chaffin
- Suturé·es de Laurie Guin
- Méd(l)ée, aube et crépuscule d'une idole de Hugo Martinez
- Luna de Aymeric Mourrad
- Derrière les lignes ennemies de Lucas Samain
- Second souffle de Madeline Serurier
- L'horizon des événements de Frédéric Sonntag
Traduction - S'il y avait de la lumière de Francesca Garolla, traduit de l’italien par Olivier Favier
- Le cercle autour du soleil de Roland Schimmelpfennig, traduit de l’allemand par Robin Ormond
- Killology de Gary Owen, traduit de l’anglais par Kelly Rivière
Encouragements - Ma vie d'ogre de Olivia Barron
- La Faim aux yeux de Mélissa Bertrand
- TRIANGLE de Blanche Cabanel-Seo
- Il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi de Alexandra Cismondi
- Move on over or we'll move on over you (l'atelier des Black Panthers) de Stéphanie Farison
Félicitations aux autrices et auteurs lauréats !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 15, 2022 5:49 PM
|
Critique de Louis Juzot dans le blog Hottello - 15 nov. 2022 Et puisque départir nous fault, conception et mise en scène de Cécile Feuillet avec la complicité de Pauline Marey-Semper. Cie Marée Basse. Et puisque départir nous fault, conception et mise en scène de Cécile Feuillet avec la complicité de Pauline Marey-Semper. Direction musicale Nikola Takov, scénographie Frank Echantillon, Cécile Feuillet, Diane Mottis et Julien Puginier, création lumière Simon Fritschi, Création sonore Marion Cros, décor et costumes Valy Montagu. Un radeau grandeur nature est au centre d’un dispositif bi-frontal, construit de bric et de broc comme le théâtre du même nom de François Tanguy. Mais la comparaison s’arrête là car l’univers poétique qui aurait pu se former progressivement autour de l’objet mythique reste encalminé. La metteuse en scène, Cécile Feuillet, en appelle pourtant à Tadeusz Kantor :« Chez ce dernier, les matières scénographiques sont brutes ; le « sur-objet » est qualifié comme « troisième type d’acteur », tout comme notre radeau constitue un personnage à part entière » . Or, passer de la théorie à la pratique comporte bien des écueils… Le scénographie et le radeau sont fort beaux – saluons Frank Echantillon, Cécile Feuillet, Diane Mottis et Julien Puginier – , c’est d’ailleurs peut-être l’erreur de fond car il agit comme un totem qui domine le jeu des acteurs et dissout la parabole existentielle et poétique que le spectacle pourrait distiller. Cécile Feuillet est un capitaine crochet ou un pirate des Caraïbes qui est sensé diriger la manœuvre, omniprésente et autoritaire comme sa parure et son positionnement initial à la Kantor l’indiquent. Chacune des autres « clownes » a choisi un personnage, empoté en général, jeu de clown oblige, sauf pour le visage qui traduit un peu d’émotion. L’une est placide et recrache de temps en temps de l’eau, le genre poisson. L’autre est une naïade qui peut se transformer en tête de proue, le genre sirène aguicheuse. Les trois dernières sont l’une, marin pêcheur en tenue de travail, l’autre, moussaillon sautillant et enjoué, et la dernière, soutière virile mais rafistolée d’attelles diverses. Elles se livrent à des parodies d’occupation en fonction de leur personnage, comme la « clowne -poisson » qui pêche tranquillement en pleine tempête. Elles font sourire par moments par leurs élucubrations et facéties autour du totem radeau ; et sous leurs costumes dépenaillés se cachent Pauline Marey-Semper, Anaïs Castéran, Jade Labeste, Alice Rahimi et Mathilde Weil. Il faut attendre le dernier tiers du spectacle pour voir s’animer et brinquebaler le radeau et ses occupants avec la tempête. Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault a inspiré ces images tempétueuses, comme le récit cruel des survivants du dit radeau. La vérité historique est bonne à rappeler, la frégate « La Méduse » s’est échouée en 1816 sur des bancs de sable, à cause de l’impéritie de son commandant, un noble royaliste nommé à la Restauration, dont l‘incompétence a conduit à tragédie, devenant un symbole politique négatif et répulsif pour les Républicains. Jules Vernes n’est pas loin et un poulpe géant vient digérer le radeau et ses occupants dans un final d’après le déluge, retour au calme et mort des participants. Quand le sur-objet tue le spectacle, La Méduse porte bien son nom qui pétrifie les marins et, il faut le dire, rend le spectateur perplexe et dubitatif après le naufrage. Louis Juzot Du 14 au 26 novembre, lundi, mardi 20h, jeudi, vendredi 19h, samedi 18h, dimanche 15 h, Théâtre de la Cité Internationale, 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Tél :01 85 53 53 85 theatredelacite.com Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 14, 2022 6:12 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog 14 nov. 2022 Dirigée par Thierry Thieû Niang qui avait signé, avec Patrice Chéreau, la première mise en scène de ce texte de Marguerite Duras, la comédienne va plus loin encore dans l’expression sensible et sobre de ce récit. C’est au Théâtre Jean-Vilar de Suresnes, très grande salle, que nous avons revu La Douleur. Près de 650 places, une grande salle, une très grande salle où le spectacle ne s’est donné qu’un soir après le TNP (dans le petit théâtre), lieu de la recréation et dans quelques villes de région, avant L’Athénée, du 23 novembre au 11 décembre. Avouons que lorsque l’on a vu plusieurs fois un travail, du vivant de son metteur en scène, on craint toujours un peu que quelque chose se soit affaibli. Mais Thierry Thieû Niang était à égalité dans la direction, la conception. C’est même lui qui avait pensé à La Douleur pour que Patrice Chéreau fasse travailler Dominique Blanc, après les mois, les six mois, qu’elle avait passés à incarner Phèdre en 2003. La Sociétaire de la Comédie-Française (elle a obtenu un congé de quatre mois) parle de ce moment avec une sincérité complète dans les documents remis aux spectateurs, la feuille de salle. Ainsi peut-on comprendre comment un grand rôle, un rôle de légende, un spectacle qui rencontre le succès, peut détruire un interprète. Le laisser exsangue. Disons-le, malgré une sonorisation un peu trop puissante en ouverture –après on s’habitue- le spectacle revivifié par les années et par la douleur du deuil de la mort de Patrice Chéreau, le 7 octobre 2013, bouleverse encore plus. Le développement des mouvements nous est apparu encore plus précis et l’on avait oublié la pomme coupée et non mangée, clin d’œil d’alors à la pomme pelée par Jeanne Moreau dans La Servante Zerline. C’est toujours étrange, le souvenir que laisse un spectacle. On se souvient plus des émotions, du texte, du jeu, que des infimes détails de la mise en scène, parfois. On se souvient de la présence même de Patrice Chéreau, au tout début. Maintenant, Dominique Blanc est seule. De profil gauche, devant une petite table, face à une rangée de chaises, assez loin. S’agit-il d’une conférence ? Gilles Bottachi a réglé avec finesse les lumières. Il réussit à nous permettre de saisir les nuances, même si l’on est un peu éloigné du plateau. On imagine qu’à l’orchestre et à la corbeille de l’Athénée, on sera dans une sorte d’intimité. Les autres balcons sont moins confortables pour une vision du visage… On connaît Dominique Blanc depuis ses tout débuts, de la classe Libre de chez François Florent, avec Francis Huster et Pierre Romans, jusqu’à Peer Gynt en 1981. Pierre Romans l’avait dirigée dans un Tchekhov, à l’Espace Cardin. Chéreau avait vu et quelque temps plus tard, il l’appelait. Sans doute n’avons jamais rien raté des incarnations de cette comédienne d’une humanité, d’une personnalité, larges. Un grand caractère. Mais doit-on avouer que l’on a été époustouflé par cette nouvelle version de La Douleur. Comme chacun, Dominique Blanc a vieilli. Comme chacun, nous savons que ce que raconte La Douleur ne doit pas s’effacer. Jamais. Il y a eu des polémiques sur le texte. De quand datait-il vraiment ? Mais qu’importe ? Marguerite Duras, elle-même, avait jeté le trouble : « J’ai retrouvé ce Journal dans deux cahiers des armoires bleues de Neauphle-le-Château. Je n’ai aucun souvenir de l’avoir écrit. Je sais que je l’ai fait, que c’est moi qui l’ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, je revois l’endroit, la gare d’Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce Journal. Quand l’aurais-je écrit, en quelle année, à quelles heures du jour, dans quelle maison ? Je ne sais plus rien. La Douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d’une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m’a fait honte. » Etrange aveu. Mais essentiel car c’est cela aussi que l’artiste exceptionnelle qu’est Dominique Blanc prend en charge. Au plus profond d’elle-même, sans démonstration aucune et avec une légèreté apparente fascinante, elle nous fait tout comprendre. Elle prend en charge le récit, l’histoire, l’Histoire et la douleur. La vraie douleur. L’épouvantable douleur que rien ne saurai effacer, pas même le retour de celui dont on n’a pas de nouvelles et qui pourtant reviendra, au bord du gouffre de la mort. Le texte de La Douleur est publié chez P.O.L. Armelle Héliot Voici les dates de la tournée : • le 18 novembre 2022, Théâtre d’Aurillac • le 20 novembre 2022, Scènes du Golfe, Théâtre Anne de Bretagne – Vannes • du 23 novembre au 11 décembre 2022, L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet – Paris • du 13 au 18 décembre 2022, Théâtre des Bernardines – Marseille • le 23 mai 2023, Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains • les 30 et 31 mai 2023, La Coursive – Scène Nationale La Rochelle • les 2 et 3 juin 2023, Théâtre National de Nice • du 6 au 8 juin 2023, MC2 de Grenoble

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 14, 2022 8:41 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 14 nov. 2022 On se souvient de « Cerisaie » d’exception signées Strehler, Brook ou Langhoff, on se souviendra à jamais de la mise en scène que co-signent Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou. En s’enfonçant dans la dernière pièce de Tchekhov, entre deux langues avec une troupe mixte japono-française plus que magnifique, ils nous entraînent loin, pénétrant dans des zones de la pièce peu explorées. C’est l’ultime, la plus belle et la plus déchirante des pièces de Tchekhov. On a beau la relire, la revoir, elle apparaît plus riche, plus complexe, plus désarmante que la dernière fois. Quand Satoshi Miyagi, le metteur en scène et directeur du SPAC (Shizuoka Performing Arts Center), a proposé à Daniel Jeanneteau de faire entrer Tchekhov au répertoire du SPAC, son choix s’est vite porté sur la dernière pièce de Tchekhov, La Cerisaie. Avec la figure centrale et complexe de Lioubov (intense, immense et bouleversante Haruyo Hayama), l’héritière de la cerisaie percluse de dettes, et, en opposition, celle nouée du plus jeune Lopakhine (Philippe Smith aux délicates nuances), l’ancien serf devenu riche qui, avant la fin de la pièce achètera la cerisaie pour l’abattre et y faire des lotissements. Un monde s’achève sous nos yeux. A elle, le passé et l’amour ; à lui, le futur et les affaires. A eux, à tous, le temps qui passe et qu’on peine à retenir. Autour des deux pôles que sont Lioubov et Lopakhine, une cohorte de personnages auxquels Tchekhov offre une ampleur affirmée et magnifiée par la mise en scène. De la jeune bonne Douniacha (Miyuli Yamamot) au vieil étudiant Trofimov (Aurélien Estager) et au très vieux Firs (Axel Bogousslavski au Japon et Stéphanie Beghain à Gennevilliers en attendant le rétablissement d’Axel). D’Ania (Sayaka Watanabe, joliment virvoltante), la fille de Lioubov, à Varia (Solène Arbel extraordinairement intense, qui, tout en noir, fait elle aussi le deuil de sa vie), sa fille adoptive. C’est elle qui a gardé les clefs et a veillé sur la bonne marche de la propriété pendant les cinq ans d’absence de Lioubov et de sa suite dont son frère Gaev (imposant Kazunori Abe) et la gouvernante et magicienne Carlotta (impeccable Nathalie Kousnetzoff)... comme un nuancier de destins et de sensibilités. Ils sont tous présents en scène dans le spectacle, plus encore peut-être que dans la pièce. Derrière eux, au fond, merveilleuse proposition de Mammar Benranou, défile un ciel de droite à gauche, cisaillant le mouvement du temps jusqu’au couperet de l’arrêt quand on apprend que Lopakhine a acheté la Cerisaie. Quelle pièce ! Quel spectacle d’une intensité rare et qui doit beaucoup à ce jeu entre deux langues et même, pour certains, deux façons de jouer, le tout tenant d’une haute alchimie. Créée au Japon, cette Cerisaie vient au T2G que dirige Daniel Jeanneteau. Jeanneteau a plusieurs fois mis en scène des pièces étrangères au Shizoka et monté ces mêmes pièces en France. Ainsi La Ménagerie de verre de Tennessee Williams d’abord au Japon puis en France ou Les Aveugles de Maeterlinck d’abord en France puis au Japon. C’est la première fois qu’un même spectacle réunit les acteurs de la troupe du Shizuoka et des acteurs français qui ont souvent joué avec Jeanneteau. Prenons la première scène. Elle se passe dans la chambre des enfants (elle a a gardé ce nom), ce qui paraît invraisemblable mais justement, cela donne son tempo au mouvement du temps chaviré de la pièce. Le jour se lève. « On est déjà en mai, les cerisiers sont en fleur, mais il fait froid, le brouillard du matin couvre la cerisaie », précise Tchekhov (traduction André Markowicz et Françoise Morvan, utilisée pour le spectacle). Dans la pénombre, Lopakhine tient un livre à la main. Entre Douniacha tenant une bougie. « Il est arrivé, le train. Quelle heure est-il ? » demande Lopakhine en français. Et Douniacha lui répond en japonais : « Bientôt deux heures » (sous-titré en français). Le théâtre qui s’y connaît en la matière s’accommode fort bien de cet artifice, il en fait même son miel. L’armoire de la chambre d’enfant (centrale dans la mise en scène de Strehler) est ici une simple structure en métal où passe l’air, un signe, aurait dit Barthes qui aurait aimé ce spectacle. Pas d’espace défini. Peu d’accessoires hormis quelques vêtements, les valises de l’arrivée et celles du départ, un guéridon pour le thé, exit l’éternel samovar. Tout est dans les corps, les voix, le mouvement des êtres, le temps, obsédant, entre hier et demain. Et la cerisaie ? Elle est là où nous sommes, nous spectateurs, elle flotte dans l’air, impalpable et désirable. C’est vers nous que regarde Lioubov lorsqu’elle voit sa mère en robe blanche marcher dans la cerisaie. A l’opposé, quand Lopakhine revient après avoir acheté la cerisaie, et convoque des musiciens, tout se passe au fond du plateau et en contrebas. On ne voit pas les musiciens, mais au loin on voit les personnages danser lentement... une danse d’adieu, un rituel de deuil. Il y a aussi ce moment sidérant où Tchekhov, à la fin de l’acte II, fait entrer en scène un passant qui feint de chercher le chemin de la gare, avoue avoir faim, et réclame quelques kopecks. Lioubov qui n’a pas de monnaie lui donne un louis d’or et il sort. Scène inutile, dirait-on peut- être dans un cours de creative writing. C’est tout le contraire. L’échange qui suit entre Lioubov et Varia le prouve, sanctionné par un Lopakhine qui cite Hamlet. Ou encore ce leitmotiv attaché à Gaev que jouer au billard démange, petite virgule avec laquelle Jeanneteau et Benranou concluent le spectacle avant de laisser Firs (que l’on croit à l’hôpital) seul dans la maison, à bout de vie. Un pièce complexe, « très difficile « disait Stanislavski. Il faut s’y enfoncer comme le font Jeanneteau et Benranou sans s’y perdre et sans négliger la moindre réplique, car Tchekhov est le maître du pas de côté et du mine de rien. L’aller-retour permanent entre le français et le japonais sous le regard de la langue russe initiale, renchérit ce mouvement permanent de la pièce dans une sorte d’allégresse un peut triste, juste ce qu’il faut. Le « charme » de la pièce, disait Stanislavski, réside dans « un arôme inexprimable, caché au plus profond. Pour sentir cet arôme, il faut pour ainsi dire prendre la fleur avec la motte et contraindre les pétales à s’ouvrir. Mais cela doit se faire de soi-même, sans violence, faute de quoi la tendre fleur sera froissée, se fanera ». Et c’est exactement ce qui se passe dans cette Cerisaie entre Shizuoka et Gennevilliers. Jean-Pierre Thibaudat Théâtre de Gennevilliers jusqu’au 28 nov puis du 8 au 14 déc au Théâtre des Treize Vents (Montpellier). Légende photo : Scène de "La cerisaie"; © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 13, 2022 4:30 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 10 novembre 2022 La comédienne est magnifique dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, présentée au Petit Saint-Martin, à Paris, jusqu’au 8 janvier.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/10/theatre-catherine-hiegel-dans-music-hall-misere-et-grandeur-d-une-fille-sur-les-routes_6149379_3246.html
Double bonheur au Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris : Catherine Hiegel joue deux pièces de Jean-Luc Lagarce (1957-1995). La première, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, a été créée la saison dernière (Le Monde du 28 octobre 2021). Elle est reprise, avec une nouvelle création, Music-hall, elle aussi mise en scène par Marcial Di Fonzo Bo, le directeur de la Comédie de Caen. Après leur présentation à Paris, en alternance, jusqu’à mi-janvier, les spectacles partiront en tournée. Ils seront alors présentés dans la même soirée. Les deux sont courts, autour d’une heure, et aussi réussis l’un que l’autre, chacun dans son registre. On en sort heureux comme on peut l’être en écoutant les mots de Jean-Luc Lagarce joués par l’une de nos plus grandes comédiennes, une Jacqueline Maillan qui aurait passé quarante ans à la Comédie-Française, comme l’est Catherine Hiegel. Son art fait merveille, soit qu’elle joue une baronne dictant, au tournant du XXe siècle, les règles du savoir-vivre, de la naissance à la mort, soit qu’elle interprète une femme intemporelle d’aujourd’hui jouant sa vie dans des music-halls de seconde zone. Jean-Luc Lagarce a écrit ces pièces en 1988 et 1994. Ce ne sont pas celles qui lui ont valu la plus grande reconnaissance, comme Juste la fin du monde ou Derniers remords avant l’oubli. Mais ce sont des pépites, très souvent jouées autour du monde. Music-hall est bercée par les paroles qui introduisent De temps en temps, la chanson d’André Hornez et Paul Misraki chantée par Joséphine Baker : « Ne me dis pas que tu m’adores/ Embrasse-moi, de temps en temps/ Un mot d’amour, c’est incolore/ Mais un baiser, c’est éloquent. » Répétition mélancolique d’un désir Ce qui est éloquent, dans la pièce, c’est la répétition mélancolique d’un désir : entrer en scène, d’une démarche « lente et désinvolte », prendre place sur un tabouret, et chanter en racontant des anecdotes, en compagnie de deux hommes. Il y a des lustres que la femme, qui n’a d’autre nom que « La Fille », le fait, avec deux « Boys », dont les premiers ont été son mari et son amant. D’autres ont suivi qui, eux aussi, sont partis, sans crier gare, lassés par cette vie que La Fille aurait rêvé mener d’avions en transatlantiques, et qui l’a conduite à Montargis, dans le Loiret, « le trou du cul du cul de la fin du monde », quand ce n’est pas sur des chemins caillouteux, valise à la main. Le regard de Catherine Hiegel ne triche pas. Il tranche dans le vif, comme sa manière d’être Mais cette vie, c’est la sienne, et La Fille s’y accroche comme à son tabouret, accessoire indispensable de son « art ». Elle serait misérable si Jean-Luc Lagarce ne faisait passer sa tendresse pour les petites tournées, qu’il a lui-même beaucoup pratiquées à ses débuts à Besançon, dans le Doubs, avec ses amis de sa compagnie, La Roulotte. Marcial Di Fonzo Bo, lui, a une tendresse pour le music-hall, ce monde où les paillettes masquent la rudesse. Il signe une très jolie mise en scène, juste, qui rend l’illusion et ses mirages, et met très bien en valeur les trois acteurs de Music-hall. L’un des deux Boys, Pascal Ternisien, est grand, et il a un petit air désinvolte à la Philippe Noiret. L’autre, Raoul Fernandez, est plus petit, et il maîtrise l’abattage des meneurs de revue. Tous les deux sont en frac, avec des visages blancs, des lèvres rouges et des plumeaux s’il le faut. Ils entourent avec une ironie désabusée La Fille, Catherine Hiegel, donc, moulée dans une longue robe noire ouverte jusqu’au haut de la cuisse, qui a été dessinée par une légende des costumes, Mine Vergès, autrice, entre autres, de robes pour Joséphine Baker. Evidemment, le visage de Catherine Hiegel est maquillé à outrance, des paillettes d’argent cernent ses yeux, ses cheveux sont crantés. Mais son regard, lui, ne triche pas. Il tranche dans le vif, comme sa manière d’être. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Avant la retraite » ou la folie douce de Catherine Hiegel Catherine Hiegel ne joue pas la coquette, elle balance ses gestes et ses mots en femme qui en connaît un rayon sur la vie. Elle en devient dure, mais dans cette dureté passe l’éclat du défi : vous ne m’aurez pas avec votre compassion ou votre mépris, semble-t-elle dire, parce que, quoi que vous en pensiez, je fais ce qui me plaît, et c’est moi qui entre en scène et chante « Ne me dis pas que tu m’adores ». En play-back, mais peu importe. Jouée par Catherine Hiegel, cette vie de Music-hall ne l’est pas, en play-back. Elle vous regarde droit dans les yeux. Magnifique. Music-hall (jusqu’au 8 janvier) et Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne (du 26 novembre au 18 janvier), de Jean-Luc Lagarce. Mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo. Avec Catherine Hiegel. Théâtre du Petit Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, Paris 10e. De 15 € à 27 €. Petitstmartin.com ; dates de tournée sur Comediedecaen.com Brigitte Salino Légende photo : Raoul Fernandez, Catherine Hiegel et Pascal Ternisien dans « Music-hall », au Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris, le 22 septembre 2022. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 12, 2022 7:16 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 12 novembre 2022 Parfois la personnalité d’un être se révèle à sa mort. Ce fut le cas pour le père de l’écrivain, metteur en scène, comédien. Un grand peintre qui était aussi un escroc. Lorsqu’Igor Mendjisky avait monté Le Maître et Marguerite, il y a déjà plus de quatre ans, le jeune artiste parlait de son projet suivant : écrire la vie de son père, peintre célèbre dont il venait de découvrir qu’il avait menti toute sa vie, et qu’en plus, il était un escroc sans scrupule. Un sacré défi. A l’époque, ce jeune artiste ultra-doué et audacieux, chef de troupe et personnalité puissante, disait que la pièce porterait sur la mort de son père. Des années plus tard –les suspensions du Covid ont retardé la création- on découvre un spectacle formidable, aussi drôle que bouleversant, magistralement construit, conduit, dirigé, joué. Et le « personnage » vers lequel se cristallisent toutes nos émotions de spectateurs, c’est Ilia. Lui, Igor. On pourrait analyser longuement ce grand travail. Disons d’abord, tout simplement, que c’est le seul spectacle dont on a envie que tout le monde le voie ! On sort de là en se disant : enfin une création très originale, très exigeante, très grave, très universelle, très drôle souvent et merveilleusement mise en scène et interprétée : trois heures –entracte compris- qui passent comme un souffle et sont enthousiasmantes. On ne fera pas ici un article précis car il faut aller vite et convaincre le plus de monde possible de se rendre aux Bouffes du Nord ! Il y a d’abord, et c’est lui qui commence et c’est lui qui finit, l’intelligence profonde d’Igor Mendjisky, son charme d’adolescent indissociable de sa maturité, sa présence, son autorité, sa poésie. Cette poésie, c’est celle de son écriture. Il a pris une décision très fertile : il tourne un film en Russie sur son père. Cette mise en abyme ne met aucune distance entre ce qu’il nous montre et ce qu’il nous raconte… Il a une audace, une insolence, formidables. Voyez-le portrait de sa mère incarnée avec une merveilleuse énergie par Juliette Poissonnier derrière des lunettes noires…Le père, le père vieux, élégant, tel un Commandeur imposant, est porté par Jean-Paul Wenzel, la génération des artistes libres de naguère, touchant, tranchant, avec cette voix des années TNS 70, qui rappellent soudain André Wilms, mais qui est sa voix, unique. Wenzel, auteur et père d’une fille ardente : bref un père qui porte de tendres héritages…Ce père-là est un fantôme que seul voit Ilia… Le père jeune est omni présent. Il est très interventionniste ! Guillaume Marquet est précis et il faut le voir, après l’entracte, secouer les spectateurs ! Il y a la fratrie d’Ilia/Igor : son père s’est marié trois fois et chaque fois, des enfants sont nés. Antoine, Pierre Hiessler, Olia, Esther Van den Driessche, Macha, Alexandrine Serre (que nous avons vue, elle est en alternance avec Raphaèle Bouchard), et n’oublions pas Hortense, Hortense Monsaingeon et l’essentiel Yuriy Zavalnyouk, dans la partition de Dédale… Ne disons pas tout. Le bonheur de ce spectacle est d’être sans arrêt étonné, ému et de rire beaucoup malgré le profond tragique de ce spectacle. Les Couleurs de l’air, est une remontée dans le temps, une plongée dans un puits sombre. Ce chagrin, cette souffrance, font naître l’un des meilleurs spectacles de ce début de saison. Trois générations d’artistes. Des peintres d’abord, le grand-père, le père. Et lui, Igor Mendjisky, homme d’écriture, de théâtre, d’image, raconte une partie de son chemin…Unique, très personnel et pourtant, par la scène et son équipe artistique excellente : dramaturgie, Charlotte Farcet, scénographie Claire Massard avec Igor Mendjisky, lumières Stéphane Deschamps, vidéo et son, Yannick Donet, musique de Rémy Charpentier, costumes May Katrem et Sandrine Gimenez. Théâtre des Bouffes du Nord, du mardi au samedi à 20h00, dimanche à 15h00. Tél : 01 46 07 34 50. www.bouffesudnord.com Jusqu’au 19 novembre. Puis, le 26 novembre au Théâtre de Saint-Maur. Du 11 au 15 janvier, aux Célestins de Lyon.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 10, 2022 7:46 AM
|
Par Marie Sauvion dans Télérama Comme chaque année, l’Aafa dresse le bilan de la présence à l’écran d’actrices de plus de 50 ans. Et comme chaque année, le résultat est sans appel : seuls 7 % des rôles leur sont attribués, contre 16 % côté hommes. Les feuilles tombent, les études aussi, bref c’est l’automne, saison des mornes bilans. Comme chaque année depuis sept ans, l’Aafa (Actrices et acteurs de France associés) s’est livrée au relevé minutieux et un tantinet déprimant des actrices coincées dans le fameux « tunnel » des plus de 50 ans. Verdict ? Rien ne change. « Sur l’ensemble des films français sortis en 2021, pointe l’association, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. En 2020 c’était 9 % ; en 2019, 8 % ; en 2016, 6 % ; et en 2015, 8 %. » La part des emplois attribués aux acteurs de plus de 50 ans, en revanche, atteint 16 % en 2021, soit plus du double. Ils ont le droit de vieillir, quand elles ont le devoir de disparaître. La nouveauté, c’est que, cette fois, l’Aafa s’est demandé si les réalisatrices étaient plus engagées que les réalisateurs. Mauvaise surprise : avec 8,5 % des rôles donnés par des femmes à des actrices de plus de 50 ans, contre 7 % par des hommes, la réponse est non. Sachant que ces chiffres sont, cependant, à mettre en relation avec une autre étude, émanant de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui rappelle que les femmes ne représentent toujours qu’un quart des cinéastes européens… Rien ne change (bis). “J’ai joué la mère de Guillaume Canet alors que nous n’avons que onze ans d’écart !” L’Aafa, en tout cas, pointe systématiquement le déséquilibre entre la population française, où une personne majeure sur quatre est une femme ayant atteint la cinquantaine, et sa représentation à l’écran. Une approche comptable qui a ses limites – en quoi le cinéma serait-il tenu de « représenter » la société ? –, mais qui fait bien d’interroger nos imaginaires. Et embraye sur une question non moins essentielle : filmer les femmes à tout âge, d’accord, mais comment ? L’exemple de Dominique Blanc, extraordinaire en panthère névrotico-vénéneuse dans L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, donne à la fois matière à penser… et à espérer. “Il faudrait plus de films permettant aux actrices de jouer avec leur vieillissement”6 minutes à lire Marie Sauvion Légende photo : La formidable Dominique Blanc, 66 ans, entourée de Céleste Brunnquell et Laure Calamy, dans « L’Origine du mal ». Avenue B Productions - Laurent Champoussin
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 9:12 AM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - 18 nov. 2022 Choisi pour concevoir les cérémonies des jeux Olympiques, Thomas Jolly a préféré quitter la direction du Centre dramatique national d’Angers. En interne, on lui reprochait notamment ses ambitions de spectacles démesurés. À tort ? À l’heure où une jeune génération de metteurs en scène – recélant force talents – renâcle à diriger des centres dramatiques nationaux (CDN), la récente démission de Thomas Jolly de son mandat au Quai, CDN des Pays-de-Loire, à Angers, pose des questions auxquelles il faudra répondre. Thomas Jolly ne pouvait en effet mener à bien deux missions qui – à des échelles différentes – participent du rayonnement culturel de la France : œuvrer et créer sur le territoire grâce au CDN, versus concevoir les cérémonies des JO 2024 pour représenter l’Hexagone sur les écrans du monde entier. Lire aussi : “Starmania” : un opéra rock qui résonne de façon troublante avec l’actualité 4 minutes à lire Comme pour Starmania (dont il avait signé le contrat de mise en scène avant son recrutement au Quai), il n’a pas résisté à cette nouvelle opportunité de créer de grands spectacles populaires. Doit-on le lui reprocher ? Évidemment non, même si l’on regrette que son expérience au sein du centre dramatique, commencée début 2020, en pleine pandémie, soit si brutalement interrompue. Mais on peut aussi trouver injustes les critiques qui le ciblent en interne, relatées dans l’enquête de Libération du 15 novembre dernier. Les moyens de mûrir leurs ambitions Il ferait des spectacles démesurés pour se mettre en avant ? Jusqu’à preuve du contraire, les trente-huit centres dramatiques nationaux existent pour donner aux artistes les moyens de mûrir leurs ambitions. S’il faut désormais préférer le modèle de la compagnie pour prendre des risques et monter des coproductions audacieuses, l’avenir de ces maisons de théâtre public risque d’être très… confidentiel. Novice dans son costume de directeur, Thomas Jolly a sans doute commis des erreurs, mais il appartient à une génération tentée par de multiples expériences, qu’elles soient scéniques (théâtre, opéra), médiatiques ou cinématographiques, comme pour Caroline Guiela Nguyen dont on attend toujours l’officialisation de la nomination à la tête du Théâtre national de Strasbourg. Et le ministère de la Culture devra sans doute reformuler le contrat de confiance pour déclencher, chez ces jeunes artistes, le désir de postuler. Lire aussi : Thomas Jolly démissionne du CDN d’Angers : “Je ne voulais pas qu’on me reproche de cumuler”2 minutes à lire Légende photo : Le metteur en scène Thomas Jolly, à Paris le 3 novembre 2022. Photo Joel Saget/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 7:35 AM
|
Par Fabienne Darge (Lyon et Dijon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 17 novembre 2022 Trois spectacles signés par de jeunes comédiennes rappellent les engagements artistiques et féministes de ces deux figures du cinéma.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/17/theatre-delphine-seyrig-et-carole-roussopoulos-deux-insoumuses-bien-vivantes-sur-scene_6150367_3246.html Allez, on rembobine ! On appuie sur le bouton retour arrière, on repart vers ce que l’on appelle souvent, un peu vite, la « parenthèse enchantée » des années 1970, et surtout vers deux figures féminines qui ont marqué l’époque : l’actrice Delphine Seyrig (1932-1990) et la réalisatrice Carole Roussopoulos (1945-2009). Les deux femmes étaient amies. Elles inspirent, en cet automne, trois spectacles tous signés par des femmes, et tous très réussis : Rembobiner, par le collectif Marthe ; Discussion avec DS, de Raphaëlle Rousseau ; Delphine et Carole, de Marie Rémond et Caroline Arrouas. A cela, il faut ajouter Jeanne Balibar, qui, dans son spectacle Les Historiennes (que nous n’avons pas vu), évoque également Delphine Seyrig. L’actrice de Resnais, de Duras ou de Truffaut a tout pour jouer le rôle de bonne fée des féministes de la nouvelle génération, avec son mélange d’engagement et d’élégance. Mais ce regain d’intérêt a des raisons plus profondes, à l’heure de la vague #metoo, des interrogations sur le male gaze (« regard masculin ») et sur la manière dont le cinéma a contribué à stéréotyper les rôles féminins. Delphine Seyrig a été l’une des premières à s’interroger et à s’exprimer sur ces questions. Combats sociaux Carole Roussopoulos aussi est une pionnière. En 1968, elle est la deuxième personne en France (après… Jean-Luc Godard, avec qui elle partage la nationalité suisse) à faire l’acquisition du tout premier enregistreur vidéo portable disponible pour le grand public : la Portapak de Sony. Cette caméra légère et mobile, elle va l’utiliser comme un formidable outil pour donner la parole à tous les combats sociaux et féministes du temps – pour donner, surtout, une visibilité à des femmes qui n’en avaient pas, qu’elles fussent agricultrices ou assistantes maternelles. Dans les trois spectacles, le politique, l’intime et le ludique se mêlent, indissolubles Les trois spectacles distribuent de manière différente ces deux figures. Rembobiner est surtout centré sur Carole Roussopoulos ; Discussion avec DS, comme son nom l’indique, exclusivement sur Delphine Seyrig ; Delphine et Carole met en scène les deux femmes à égalité, et leur amitié. Du premier, on pourrait dire qu’il est plus politique, le deuxième est plus intime, et le troisième plus ludique. Mais dans les trois, le politique, l’intime et le ludique se mêlent, indissolubles : ce sont de jeunes actrices qui prennent la parole, et leur métier, ce qu’il implique à la fois de réflexion et de jeu, est au cœur même de ce qu’elles ont à dire. Avec Rembobiner, les filles du collectif Marthe – un groupe d’actrices affûtées et talentueuses, qui ont fait parler d’elles quand elles ont signé, en 2018, Le Monde renversé, un spectacle sur la figure de la sorcière – ont trouvé un dispositif qui, dans sa simplicité, fonctionne à merveille : il rend vivants Carole Roussopoulos et les nombreux « personnages » auxquels elle a donné une existence. On ne verra pas sur scène les images tournées par la réalisatrice. Il s’agit ici de rejouer, et donc de remettre au présent, aussi bien le travail de Roussopoulos que les figures venues du réel qu’elle a filmées. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le Collectif Marthe, quatre comédiennes unies dans l’incertitude Ces « personnes-personnages » sont incarnés par une seule actrice (Aurélia Lüscher le soir où nous avons vu la pièce), qui change de costumes et de postiches à toute vitesse pour incarner aussi bien une ouvrière en grève chez Lip qu’un jeune homosexuel dans une réunion du Front homosexuel d’action révolutionnaire. Sur le devant de la scène, une autre actrice (Marie-Ange Gagnaux), aux manettes d’une petite régie, se met en scène comme la metteuse en scène-intervieweuse. Le spectacle ne fait pas que rembobiner, il redonne du corps et de l’urgence, avec une énergie joyeuse, aux combats filmés par Roussopoulos, du droit à l’avortement, dans Y a qu’à pas baiser (1971), à celui de choisir librement son métier, dans Ça bouge à Mondoubleau (1982). Avant de retomber, comme les deux autres, sur cette question de l’actrice comme symptôme parfait d’un système patriarcal. Et c’est là que l’on retrouve Delphine Seyrig, avec son film Sois belle et tais-toi (sorti en 1981), dans lequel, dès 1975, elle donne la parole à une vingtaine de ses camarades, sur ce que la condition de comédienne révèle de la condition féminine en général. Ici, c’est Jane Fonda qui parle, et cela dépote. Représentation des femmes Le spectacle de Raphaëlle Rousseau, Discussion avec DS, s’ouvre sur une ambiance beaucoup plus secrète. Sur le petit plateau, la jeune actrice-autrice, qui est sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne en 2021, a installé un autel à la mémoire de son idole, avec bougies et photos de la divine Delphine dans ses plus grands rôles. A partir de là, elle met en place un cérémonial un peu vaudou, non dénué d’humour par ailleurs, où elle joue avec finesse de la qualité d’absence/présence de Seyrig, et des allers-retours entre incarnation et désincarnation. Raphaëlle Rousseau ne ressemble pas à Delphine Seyrig, elle prend bien soin d’ailleurs de se montrer beaucoup plus terrienne, triviale que l’image, assez éthérée, que l’on peut avoir de l’actrice. Mais peu à peu, devant nous, elle devient la déesse DS, sans pourtant l’imiter directement. Comme si Seyrig prenait possession de son corps et de son esprit, en une mise en abîme, magnifiquement organique, de ce métier de comédienne. Tout son spectacle, très bien pensé, écrit et joué, dessine une subtile réflexion sur ce métier d’actrice dans lequel Raphaëlle Rousseau s’engage, sur sa beauté, sa fragilité et ses pouvoirs – dont Seyrig est bien une incarnation, puisque sa figure continue à être agissante aujourd’hui. Avec Delphine et Carole, on se retrouve, de manière plus réaliste, dans le joyeux foutoir d’un appartement des années 1970. Le spectacle met en scène l’amitié entre les deux femmes, à partir de leur rencontre en 1974, où Seyrig était venue suivre un stage donné par Roussopoulos sur l’utilisation de la Portapak. Il s’inspire, notamment, d’un documentaire de Callisto McNulty, Delphine et Carole, insoumuses (2019), qui montre bien comment les deux femmes ont avancé ensemble dans leur réflexion sur la représentation des femmes, et sur la nécessité de prendre en main cette représentation par elles-mêmes. Lire aussi : « Delphine et Carole, insoumuses » : pétroleuses et vidéastes engagées Ce matériau est un formidable terrain de jeu pour ces deux excellentes actrices que sont Marie Rémond et Caroline Arrouas, qui s’amusent à entrer et sortir de leurs personnages, et à recréer la liberté et l’impertinence de l’époque. Mais, rapidement, le spectacle se décale, là aussi, ouvre des failles temporelles pour glisser vers notre époque, et nous dire en substance que les choses n’ont peut-être pas tant changé que cela depuis les années 1970. Les deux belles « insoumuses » n’ont pas fini d’inspirer toutes celles qui veulent être actrices de leur destin. Rembobiner, par le collectif Marthe. En tournée de mars à mai 2023 et sur la saison 2023-2024. Collectifmarthe.fr Discussion avec DS, de et par Raphaëlle Rousseau. Au Théâtre de l’Athénée, Paris 9e. Jusqu’au 20 novembre. Athenee-theatre.com Delphine et Carole, de et par Marie Rémond et Caroline Arrouas. Théâtre Dijon-Bourgogne. Jusqu’au 19 novembre. Tdb-cdn.com Tournée jusqu’en juin 2023, notamment au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Du 19 au 27 janvier. Theatre-quartiers-ivry.com Fabienne Darge (Lyon et Dijon, envoyée spéciale) Légende photo : « Discussion avec DS », de et avec Raphaëlle Rousseau, au Théâtre de l’Athénée, à Paris, le 2 novembre 2022. INDIA LANGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 5:29 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 16 nov. 2022 A travers cinq personnages qui ne font qu’un, le metteur en scène raconte le destin d’une famille libanaise bouleversée par l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. Le brio de la mise en scène et le foisonnement de trajectoires font oublier quelques lourdeurs d’écriture. par Anne Diatkine publié le 16 novembre 2022 à 18h04 Puisque la pièce dure six heures et trente minutes entractes compris, elle laisse le temps d’admirer l’extraordinaire brio de la mise en scène et la fluidité de la scénographie, tout en fustigeant la lourdeur explicative de certaines scènes et finalement d’apprécier cette même pesanteur car on acquiert au fil de la représentation la certitude que Wajdi Mouawad ne nous y engluera pas. Enfin pas complètement. Compliqué ? Tentons de le dire autrement : comme dans cette dernière création, les cinq avatars de Wadji Mouawad nommés Talyani Wakar Malik font l’expérience de se trouver au même moment dans cinq lieux différents. Il arrive qu’on éprouve quasi simultanément un sentiment profond d’adhésion face au foisonnement des trajectoires et à l’intimité qu’elles propulsent, et un autre tout aussi vif de rejet, qui tient en grande partie au débordement de l’écriture : parfois redondante avec des passages scatologiques qu’on biffe et des personnages qui multiplient les interjections, s’appuient sur des béquilles, type «mais putain», expression d’une colère qui convient à un certain nombre d’entre eux bloqués dans des situations inextricables, mais moins justifiées, par exemple, dans la bouche de l’attachée de presse dont le portrait pourrait être plus nuancé et différencié. En haleine Dès qu’on se fait la réflexion que tous les personnages parlent de la même manière, la pièce nous abandonne. Dès qu’on regarde les acteurs, elle nous aimante. Car dans les raisons d’aimer, il y a évidemment Jérôme Kircher, génial dans sa version de Talyani Wakar Malik, abject homme puissant et cependant pas dupe de son abjection, neuro chirurgien qui traite les femmes en objet et qui a abandonné ses enfants. Ou encore Norah Krief en Layla la sœur, qui réussit l’exploit de dialoguer simultanément avec plusieurs versions de Talyani Wakar Malik sans que le spectateur ne s’embrouille les pinceaux. Il faudrait citer toute la distribution, mais notons également Julie Julien, qui tient en haleine une salle comble avec un exposé sur la physique quantique, ou encore Raphaël Weinstock – le grand frère – et Jérémie Galiana – l’enfant secret. La pièce est composée de sept journées, qui elles-mêmes se subdivisent en plusieurs parties, avec pour centre nodal une famille renvoyée à son histoire lors de l’explosion qui éventra Beyrouth le 4 août 2020. Comme dans Mère, Wajdi Mouawad revisite son enfance plongée dans la guerre civile et ce moment fatidique, le 22 août 1978, quand il quitta le Liban avec sa soeur et son frère et leur mère, pour trois mois, c’était juré, le temps que la guerre finisse disaient les parents, qui hésitaient entre Paris et Rome, avec une petite préférence pour l’Italie et surtout pour le premier vol venu. Ce sera Paris. Mais que se serait-il passé si… S’ils étaient restés au Liban. Si au bout de cinq ans, la France leur avait accordé la nationalité française ? S’ils l’avaient quittée pour le Texas comme prévu plutôt que d’échouer à Montréal ? Si son père n’était pas resté seul à Beyrouth pour gagner la vie de la famille. «Chaque exilé, chaque enfant adopté se pose ce genre de question», dit l’un des cinq alter ego de Wajdi Mouawad, en l’occurrence peintre (joué par le metteur en scène lui-même, et fort bien), auteur d’un triptyque conçu avec des matières organiques – sang, sperme, salive, cendre, on n’est jamais dans la complète légèreté – qui mordra une journaliste s’étant introduit dans une zone interdite et c’est assez drôle. Rubik’s Cube Toutes les scènes sont limpides. Elles s’agrègent les unes aux autres comme dans le Rubik’s Cube que tient l’enfant au début de la représentation. C’est l’agencement de l’ensemble qui peut générer des malentendus, mais ça n’a pas tant d’importance si le spectateur invente de faux liens de parenté et s’obstine à imaginer que le neuro physicien abjecte ou le condamné à mort texan sont frères. Fait notable et questionnant : Wajdi Mouawad s’invente des destins meurtriers. Mais pourquoi faut-il que son seul avatar plutôt gentil – le chauffeur de taxi – s’échappe de la mémoire ? Et fait exceptionnel : une salle archi comble, plutôt jeune, et qui reste comble jusqu’aux saluts triomphaux. Racine carrée du verbe être, texte et mise en scène de Wajdi Mouawad, au théâtre de la Colline jusqu’au 30 décembre. Possibilité de voir la pièce en entier le week-end – ce qu’on conseille – ou en deux parties en semaine. Légende photo : Maïté Bufala, Anna Sanchez, Richard Thériault, Merwane Tajouiti, Jérémie Galiana dans «Racine carré du verbe être» de (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 6:27 PM
|
Propos recueillis par Olivier Frégaville Gratian d'Amore dans l'Oeil d'Olivier - 5 nov. 2022 Au théâtre 14, dès le 15 novembre 2022, le ténébreux comédien reprend au côté de Yuming Hey, Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, pièce adaptée par Catherine Marnas du journal intime du premier hermaphrodite français à avoir couché sur le papier son histoire et des écrits de Michel Foucault. Présence poétique autant que romantique, Nicolas Martel habite la scène et donne chair avec une belle authenticité aux différents personnages qu’il incarne. Rencontre. Quel est votre premier souvenir d’art vivant ?
Le Boléro, chorégraphié par Maurice Béjart et dansé par son interprète fétiche, Jorge Donn au Palais des Congrès de Paris. Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur de l’art vivant ?
Ce serait plutôt qui, quelqu’un, mon maître de CM2, monsieur Bernardeau qui aimait la poésie. Il nous demandait d’apprendre des poèmes et de venir les réciter sur l’estrade, devant le tableau noir. Qu’est-ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédien ?
Le désir illusoire de vouloir vivre plusieurs vies, d’être plusieurs. Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ?
Nous nous aimons tellement, écrit et mis en scène par Jean-Michel Rabeux ! Dans lequel je donnais la réplique à Claude Degliame. J’avais 23 ans. Votre plus grand coup de cœur scénique ?
Alors, entonnes, projet franco-mexicain dirigé par Catherine Marnas à Mexico et qui a radicalement bouleversé ma vie. Quelles sont vos plus belles rencontres ?
Revoir aujourd’hui des amis éloignés depuis 10, 15, 20 ans. Retrouver les mêmes personnes sur différents projets. En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?
Je crois tout simplement se sentir le passeur d’une histoire, d’un texte, d’une chanson, d’une danse. Qu’est-ce qui vous inspire ?
La confiance. De quel ordre est votre rapport à la scène ?
Amoureux. À quel endroit de votre chair, de votre corps, situez-vous votre désir de faire votre métier ?
Les entrailles, le plexus solaire. Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ?
Thomas Lebrun, le chorégraphe, mais ce vœu va se réaliser en 2023. À quel projet fou aimeriez-vous participer ?
Sauver la planète. Si votre vie était une œuvre, quelle serait-elle ?
J’aimerais pouvoir répondre comme Simone Signoret qui disait que si elle devait refaire sa vie, elle ne changerait rien, absolument rien, et qu’il faudrait la croire quand elle le dit, j’aimerais pouvoir répondre comme elle, mais … Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution d’après Herculine Barbin dite Alexina B. publié et préfacé par Michel Foucault
création au TnBA janvier 2022

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 7:02 PM
|
Propos recueillis par Manon Charbonnier dans Rue89 Strasbourg - 15 nov. 2022 Dans son sixième long métrage, Valéria Bruni Tedeschi retrouve la fougue de ses années de formation au théâtre de Nanterre, dirigé alors par Patrice Chéreau. Rencontre avec une réalisatrice à l’image de son film : drôle et intense Valéria Bruni Tedeschi poursuit sa veine autobiographique en se penchant cette fois sur ses années de formation au théâtre des Amandiers, auprès de Pierre Romans et de Patrice Chéreau, directeur du théâtre de Nanterre de 1982 à 1990. La réalisatrice filme, au plus près des corps et des visages, ces jeunes exaltés par leur amour du jeu, cette excitation de se savoir au bon endroit au bon moment, avec des personnes qui leur ressemblent et qu’ils admirent. Stella (Nadia Tereszkiewicz) et ses camarades ont une rage de vivre et de jouer. Dans cette école hors des codes, ils brûlent les planches et la chandelle par les deux bouts, découvrant l’amour, la drogue, la paternité, le sida… Comme elle sait si bien le faire, aidée de ses deux amies Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy, Valéria Bruni-Tedeschi alterne scènes intensément dramatiques et humour noir. Partie de ses souvenirs et de ceux de ses anciens camarades de l’époque – parmi eux Agnès Jaoui, Vincent Pérez, Marianne Denicourt, Bernard Nissille, Thibault de Montalembert ou Bruno Todeschini – elle a recréé une formidable troupe de comédiens, dont il y a fort à parier, comme leurs ainés, que l’on va en entendre beaucoup parler. Rencontre avec l’un deux, Oscar Lesage et Valéria Bruni Tedeschi Rue89 Strasbourg: Pourquoi raconter cette histoire maintenant ? Valéria Bruni Tedeschi : Je pense qu’il y a un temps juste pour raconter une histoire autobiographique. On m’a déjà dit, il faut attendre 7 ans, là j’en ai mis 30 ! Mais je n’y serais pas arrivé avant, si c’est trop proche c’est difficile. Est-ce que vous avez retrouvé les sensations vécues à l’époque? Je ne me pose pas la question par rapport à l’époque, de savoir si cela reflète ce que j’ai vécu. En revanche, c’était jubilatoire de vivre ce film avec ces acteurs-là, je suis très heureuse de les voir à l’écran et je trouve que c’est déjà pas mal. Je suis très amoureuse de cette bande que nous avons constituée avec Marion Touitou, la directrice de casting. Ils ne sont pas exactement fidèles à l’idée des personnages que nous nous faisions en écrivant le scénario car, en les rencontrant, nous sommes partis sur d’autres choses. Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir eu cette énorme envie de les filmer en me levant le matin. Vous avez répété un mois avant de commencer le tournage. Cela a permis cette liberté de jeu, cette énergie qui émane de ce groupe de comédiens ? Oui, nous avons pris le temps de nous connaître, il fallait inventer un langage commun. Pendant le casting, nous avions déjà travaillé ensemble, je voulais plus de répétitions encore mais ce n’était pas possible donc j’ai fait un casting très long pour commencer les répétitions secrètement… Ensuite j’ai travaillé pour constituer un groupe, avec à l’intérieur, des méthodes de travail adaptées à chacun d’entre eux. C’est comme dans un pays, avec plusieurs dialectes: il faut trouver un langage commun mais aussi travailler la spécificité de chacun. En Italie, il y a beaucoup de dialectes… C’est bien cette image non ? Je viens de la trouver! Comment Valéria a-t-elle travaillé avec vous Oscar ? Oscar Lesage : On a beaucoup cherché ensemble. Et surtout, elle nous parle constamment pendant les prises, entre deux répliques ! Ah bon, comme Patrice Chéreau, que l’on voit travailler ainsi dans le film ? Mais ce sont des répétitions de théâtre ! Cela a dû être terrible pour l’ingénieur du son et le montage ! Valéria Bruni Tedeschi : François Waledish, le chef opérateur son, était furieux, plus que d’habitude ! Lors de la fête de fin de tournage, il avait une sorte de rage contenue et il m’a dit qu’il ne travaillerais plus jamais avec moi et qu’il n’avait plus envie de faire de cinéma. J’étais absolument désolée. Finalement il est revenu sur cette colère une fois qu’il avait digéré le tournage. Je lui ai dit que de toutes façons, je ne l’aurais jamais laissé faire ! J’aime travailler avec les mêmes personnes, je suis un grande fidèle, dans la vie comme au travail. Un peu comme une araignée qui tisse sa toile, une vieille araignée maintenant, je m’entoure des gens que j’aime, même les gens morts ! C’est pour ça que je travaille avec mon ex, mon actuel… mon futur (rires), ma mère, ma fille, mon amie comédienne Valéria Golino… Ma mère, je ne la vois pas beaucoup, alors j’en profite pour tourner avec elle, j’adore ma mère, je n’ai pas dû passer toutes les étapes psychanalytiques mais c’est comme ça, je l’adore. Oscar Lesage : Pour revenir à la façon de diriger de Valéria, j’ai le souvenir d’une urgence: chaque scène est cruciale, il n’y a pas de petites scènes et aucune prise n’est pareille. Elle apporte des idées tout le temps. D’ailleurs, il y a d’autres scènes magnifiques qui ont été coupées au montage, c’était très riche. Elle nous pousse à toujours surprendre l’autre. Tu ne joues jamais « assis dans un pouf » si je peux m’exprimer ainsi. Valéria Bruni Tedeschi : La version longue fait 4h30… Je leur ai promis que je leur montrerai bientôt. Avec Anne Weil, on a sans cesse cherché un équilibre entre l’histoire d’amour et les scènes de groupe. Si on restait trop sur l’histoire d’amour, on se plombait, si on restait trop sur le travail du groupe, on risquait de perdre le spectateur. En dehors de l’énergie de ce groupe, j’ai été surprise par leur insolence vis à vis de leurs « maîtres » Patrice Chéreau et Pierre Romans. Vous n’étiez pas impressionnés par ces figures tutélaires ? Je crois qu’on était tous assez courageux oui. Avant tout, Patrice et Pierre cherchaient des personnalités pour leur théâtre. Qu’est-ce qu’une personnalité ? C’est un être humain qui décide d’avoir le courage de ne pas être conventionnel. Pour ce film, j’ai aussi cherché des personnes émouvantes, plus que de bons comédiens. J’ai le goût de la vérité, elle m’excite. Bien sûr, comme tout le monde, parfois je me plie à certaines règles mais quand je le fais, je m’ennuie. Vous portez un regard qui m’a semblé très juste, sur les comportements toxiques de certains personnages : la drogue, la drague, la violence… La seule vraie critique que je fais sur ce qu’il s’est passé à l’époque, concerne la drogue. Le fait que ceux que nous admirions tant se droguent devant ou avec nous, qui étions presqu’encore des enfants, je ne pouvais pas ne pas le critiquer. Il y a une responsabilité quand on travaille avec des jeunes. Mais c’était une école extraordinaire et Patrice et Pierre, tous les deux, étaient des génies. En ce qui concerne l’attitude de Patrice avec les jeunes garçons, c’était de la drague, mais, à l’époque, ce n’était pas grave. On n’avait pas les mêmes codes qu’aujourd’hui, il faut absolument remettre les éléments dans leur contexte. Ce n’était pas grave parce qu’il n’a jamais fait de chantage. Il se trouve qu’il aimait les jeunes garçons et plutôt les jeunes garçons hétérosexuels ! » À la fin de l’entrevue, Valéria Bruni Tedeschi confie qu’elle n’a pas envie que des polémiques ternissent son film ou l’image de Patrice Chéreau, mais le film est suffisamment intelligent pour répondre par lui-même. Toute la beauté de Les Amandiers est justement de ne pas cacher les contradictions et les ambiguïtés de chacun.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 6:30 PM
|
Propos recueillis par Sandra Onana pour Libération - 15 nov. 2022 La cinéaste, qui s’est replongée pour son film dans ses années à l’école des Amandiers de Nanterre, revient sur la façon dont elle a dirigé ses acteurs et sur les rapports qu’entretenait le metteur en scène Patrice Chéreau avec sa troupe. Le théâtre comme question de vie ou de mort, bourrasque libertaire, emporte le septième long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi, qui revisite sa jeunesse à l’école des Amandiers sous la direction orageuse du metteur en scène Patrice Chéreau. Rencontrée début septembre dans une chaleur d’été indien, la cinéaste prend un plaisir sensible à raconter la création de ce radieux film de troupe. Vous n’hésitez pas à maltraiter vos alter ego de fiction quand vous les jouez. Le regard posé sur Nadia Tereszkiewicz, qui vous interprète, est plus tendre. Parce que vous déléguez ce rôle à une autre actrice ? C’est vrai que c’est un alter ego inspiré de moi jeune, mais ça m’aurait bloqué de travailler en y pensant. J’essaye de filmer l’actrice que j’ai en face de moi. Je n’ai pas voulu tenir compte des gens réels dont les personnages étaient inspirés, et surtout pas laisser à Louis Garrel la responsabilité de réinventer Chéreau. Une fois la réalité fictionnée, ce n’est plus mon autobiographie, cela devient aussi celle de mes coscénaristes Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy. Si l’on garde les noms de Patrice Chéreau et de Pierre Romans [le directeur de l’école, ndlr], c’est pour notre bon plaisir, parce qu’ils sont «musicalement» légendaires pour nous. Comment dirigiez-vous vos acteurs pour qu’ils réinventent leurs rôles ? J’ai essayé de les faire travailler sur leur solitude, leurs désirs profonds, leurs tragédies enfantines, leurs nécessités d’adulte… Je les ai dirigés comme j’essaye de me diriger, et comme j’ai été dirigée par les gens qui m’ont nourrie d’une approche émouvante et intelligente. Plus que pour mes autres films, j’ai maintenu la communication avec eux en leur parlant pendant les scènes, je leur faisais le monologue intérieur de leur personnage entre les dialogues… L’ingénieur du son était très mécontent ! C’était une façon de travailler très différente avec chacun. Comme avec plusieurs enfants, on ne les éduque pas de la même manière. Dans vos films, les metteurs en scène sont montrés comme des terreurs… Pas vous ? Comme actrice, je suis robuste, j’ai un âge où je peux supporter des expériences variées. Mais en tant que metteure en scène, la maltraitance n’est pas du tout un truc qui m’intéresse. Le maximum de ma perversion peut consister à dire «cette scène, on n’y arrive pas, on laisse tomber…», et dire «action !» quand je vois l’acteur s’écrouler. Sur ce tournage, j’ai parfois laissé Louis Garrel travailler seul avec les acteurs. Ce qui m’intéressait avec Louis en Chéreau, ce n’était pas seulement Louis l’acteur, mais Louis metteur en scène. L’élève jouée par Léna Garrel, saquée par Chéreau, évoque la violence du favoritisme dans une troupe… Y a-t-il chez vous la culpabilité d’avoir été l’élue ? Complètement. Etre aimée le plus possible me plaisait et m’angoissait. Je cherchais ce rôle de chouchoute sans me sentir à l’aise dedans. Cela m’intéresse moins de filmer une jeune femme qui est choisie pour un rôle, que de regarder celle à côté qui s’en va en pleurs. Etre l’élue et se sentir imposteur, c’est l’histoire de ma vie. On trouve toujours une façon inconsciente de se le faire payer. On tombe malade, on s’arrange pour rater la chose d’après… En jouant une femme heureuse pour Claire Denis dans Nénette et Boni, j’ai compris que le bonheur porte toujours en lui l’éventualité, presque l’obligation de le perdre. Ces dernières années, on a beaucoup déconstruit la vision romantique d’un art qui brouillerait les frontières entre la vie et le jeu, les rapports de séduction et de prédation. En est-on guéri ? C’étaient des années où le travail était dangereux, ambigu. Je critique d’ailleurs le fait qu’une école ait pu laisser circuler de la drogue entre les maîtres et des jeunes gens… Aujourd’hui, les rapports ne peuvent plus s’embrouiller. Je trouve le mouvement féministe et #MeToo nécessaires et vitaux, mais ils ne peuvent pas nous faire renoncer à nous, être humains, aux passions, aux désirs, à la noirceur, aux impulsions. Et donc au fait que dans un travail artistique, si les frontières avec la vie ne se brouillent pas un peu, on n’arrive pas bien à raconter les choses. Un metteur en scène qui désire un acteur, on peut bien dire que ce n’est pas bien moralement… il se passe quelque chose. Et sur un plateau, il faut qu’il se passe quelque chose. Montrer les faces obscures de Patrice Chéreau ne vous faisait pas peur ? Au départ, j’étais trop respectueuse du scénario, c’était un peu lisse. Chéreau aimait les défauts des êtres humains, les angles, les choses qui grincent… Il aurait détesté être représenté comme un metteur en scène bien élevé. Raconter son génie et sa face obscure n’était pas une mince affaire, mais on a besoin d’irrespect dans ce travail. On a utilisé ses écrits, qu’avait lus Pascal Greggory dans son spectacle [Ceux qui m’aiment, ndlr], et Louis a fait sa cuisine secrète de son côté. Vous auriez osé faire ce film s’il avait été vivant pour le voir ? Je pense, mais j’aurais été inhibée. Tout comme j’ai souffert de son manque, j’aurais souffert de sa présence. Mais j’aurais été plus contente, parce que j’aimerais mieux qu’il soit vivant. Je n’ai jamais cessé de faire des films en me disant qu’il allait les voir. Faire le casting de cette troupe, c’était comme revivre les auditions pour les Amandier, en passant de l’autre côté ? Exactement, on s’est retrouvé à constituer un groupe, des alchimies de physiques, d’énergies, de couleurs. C‘était une école qui ne prenait pas des êtres conventionnels, qui préférait les natures aux bons acteurs et aux bonnes actrices. Quand Sofiane Bennacer nous a envoyé sa première vidéo, j’ai eu l’impression que Chéreau l’aurait tout de suite pris. L’utopie portée dans cette école survit-elle toujours ailleurs ? Je ne sais pas si c’est une utopie, plutôt une manière de rester dans l’émerveillement. Cela existe encore bien sûr, sauf que nous, on se jetait à corps perdu dans l’avenir. Aujourd’hui, les jeunes gens ont la même énergie vitale, le même besoin d’aimer follement, mais la société leur insuffle une peur de l’avenir, une obligation de savoir leur plan de carrière, s’ils vont avoir un agent… Comme s’ils avaient un parent intérieur qui les grondait. Nous, on était sauvages dans la vie. D’ailleurs, j’ai fait un film où on ne voit pas les parents. Le majordome prédit à Stella, votre personnage, que devenir actrice la rendra folle… Cette prophétie s’est réalisée pour vous ? Folle, je ne sais pas ce que ça veut dire. J’ai des endroits de folie, ou plutôt de souffrances. Ma famille, mes amis, la psychanalyse, mes enfants me donnent une obligation de sagesse. Travailler sur un scénario ou un montage me donne des rambardes de sérénité. La folie pour moi est dans la vie. Je serais devenue folle si je n’avais pas fait ce métier. Légende photo : Valeria Bruni-Tedeschi à Paris, le 12 septembre. (Martin Colombet/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2022 11:39 AM
|
Par Grégoire Biseau dans Le Monde - 16 novembre 2022 PORTRAIT D’étonnants concours de circonstances ont mené Micha Lescot à incarner Pierre Romans, le complice de Patrice Chéreau au théâtre de Nanterre, dans le film « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi, en salle le 16 novembre. Un rôle à la mesure de la passion viscérale de l’artiste de 48 ans pour le théâtre. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/11/16/les-amandiers-micha-lescot-ou-les-caprices-du-destin_6150063_4500055.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2MkF_-_P6zAFUPIY3FZI7845pC2Nz38So7TH6zgUTfN8nfJxhp0uwZCiA#Echobox=1668578736
L’alignement des planètes, ce n’est pas une vue de l’esprit, une tocade pour lecteurs en mal d’horoscope, ou juste une idée romantique évanescente qui nous donne la vague impression d’être relié à un tout qui nous dépasse… Non, l’alignement des planètes, cette sensation, étrange et rassurante, que les choses se font parfois presque malgré nous, ça existe. En tout cas, Micha Lescot le croit. Il en a été un témoin privilégié. Etre là au bon endroit, exactement au point de croisement de plusieurs routes, empruntées il y a déjà longtemps sans vraiment savoir à l’époque où elles pouvaient bien mener et si elles avaient vocation un jour à se couper, voilà ce que ressent l’acteur de 48 ans, ce matin ensoleillé d’octobre, à la terrasse d’un café du 19e arrondissement de Paris, où il aime donner rendez-vous. Figure assez mystérieuse Micha Lescot est en promotion pour Les Amandiers, le magnifique film autobiographique de Valeria Bruni Tedeschi, qui raconte la vie exaltée et fiévreuse de la deuxième promo de l’école de théâtre de Nanterre, créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au début des années 1980, et dont sont sortis, entre autres, Vincent Perez, Marianne Denicourt, Eva Ionesco, Agnès Jaoui… et bien sûr Valeria Bruni Tedeschi. Micha Lescot y incarne Pierre Romans, le directeur de l’école, le complice de Patrice Chéreau, figure assez mystérieuse et plutôt méconnue qui a travaillé dans l’ombre du génial et parfois tyrannique metteur en scène. « Quand Valeria me parle pour la première fois de son idée, je l’encourage à fond, sans même penser à jouer dans son film, raconte Micha Lescot. Tout m’intéressait dans cette histoire. Tout. J’étais totalement à bloc. » Quand le comédien sort du Conservatoire national d’art dramatique de Paris, en 1993, la fameuse promotion des Amandiers s’est déjà éparpillée sur les plateaux de théâtre et de cinéma depuis sept ans. Pierre Romans est mort depuis trois ans, la même année 1990, Patrice Chéreau quittait la direction du théâtre de Nanterre. Le metteur en scène fait alors office de maître indépassable du théâtre contemporain français. « Pour un jeune acteur comme moi, Chéreau, c’était la référence, le fantasme absolu. » A deux reprises, Micha Lescot a failli jouer sous sa direction, mais d’autres engagements l’ont contraint à renoncer. Syndrome de l’imposteur Courant 2020, Valeria Bruni Tedeschi lui fait passer une audition pour le rôle de Pierre Romans. Micha Lescot est alors en train de répéter le rôle de Charles dans Quai ouest, la pièce de Bernard-Marie Koltès, que Patrice Chéreau avait justement montée avec les élèves de cette promotion en 1986. Autre alignement de planètes : pendant la période du confinement, il a accepté, pour la première fois de sa vie, de diriger un atelier de jeunes comédiens, au Théâtre national de Bretagne, à Rennes (TNB). « Cela m’a énormément plu », s’étonne celui qui dit se trimballer depuis toujours un syndrome de l’imposteur, alors qu’il n’a jamais cessé de travailler sous la direction des plus grands metteurs en scène, et a presque toujours bénéficié des éloges de la critique. « J’étais vraiment chez moi. Tout se mélangeait, la fiction avec la réalité. » Micha Lescot Bref, à peine professeur, voilà qu’on lui demande d’en incarner un à l’écran. A ses apprentis comédiens, il annonce qu’un casting va avoir lieu pour constituer la fameuse promotion des Amandiers. Dans la première scène du film, Pierre Romans-Micha Lescot, fait donc passer une audition à Adèle, personnage inspiré d’Eva Ionesco, interprétée par la jeune actrice Clara Bretheau, son ancienne élève, qu’il a encadrée un an auparavant au TNB. Une mise en abyme parfaite. « J’étais vraiment chez moi. Tout se mélangeait, la fiction avec la réalité », sourit-il. En cette fin d’année 2022, Micha Lescot ne sortira pas des Amandiers. De la mi-septembre et jusqu’à la fin octobre, il y incarnait Richard II, sous la direction de Christophe Rauck, le nouveau patron du théâtre de Nanterre. Un succès critique et public. Ce Richard II, présenté à Avignon, n’est, lui aussi, pas tombé par hasard. A la sortie du conservatoire, Micha Lescot en avait déjà joué deux scènes, au Festival d’Avignon pour un hommage à Jean Vilar, sous la direction de Gérard Desarthe. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Cannes 2022 : Valeria Bruni Tedeschi et les années Amandiers, époque bénie du théâtre Le même Desarthe qui avait joué dans le Richard II monté et interprété par Patrice Chéreau en 1970. « Depuis, je m’étais toujours dit que si je devais jouer un Shakespeare, ce serait celui-là. » Son père, l’acteur Jean Lescot, lui avait d’ailleurs lancé ce défi : « Tu seras un vrai acteur quand tu auras joué un grand rôle de Shakespeare. » La boucle est donc bouclée. Le voilà tout à la fois acteur et professeur de théâtre dans la peau de Pierre Romans, au Théâtre des Amandiers. Pierre Romans était un personnage énigmatique. « Les élèves l’adoraient. il avait un côté sombre et lumineux à la fois, même s’il déconnait tout le temps. La frontière entre le professeur et les élèves était parfois très mince », poursuit Micha Lescot. Pour ajouter à sa part de mystère, Romans avait une main gonflée, dont personne ne sait très bien à quoi il la devait. On l’appelait « l’homme à la grosse main ». Comme cet accessoire coûtait cher à fabriquer tous les jours, Micha Lescot a joué une partie du film la main dans la poche. La vérité nous oblige à préciser que, pour cause de travaux, le tournage du film à l’été 2021 ne s’est pas déroulé dans le bloc de béton gris du théâtre de Nanterre, mais à la Maison des arts et de la culture de Créteil. « Mon nom est totalement faux. Pendant longtemps, je n’ai pas vraiment su comment je m’appelais. Autant dire que ça a beaucoup intéressé mes psys. » Micha Lescot Longtemps, Mischa Wajsbrot pour l’état civil – le nom signifie « pain blanc » en polonais –, a prêté aux plateaux de théâtre sa longue silhouette drolatique pour des personnages éthérés, aériens et poétiques. Ni tout à fait masculin mais pas vraiment féminin. Somnambulique, il a toujours aimé marcher sur la crête de l’entre-deux. Sans âge et sans nom. Lui et son frère David ont en effet hérité, enfants, du nom d’acteur de leur père, Lescot. Et Mischa a perdu un « s » en cours de route. « Mon nom est totalement faux. Pendant longtemps, je n’ai pas vraiment su comment je m’appelais. Autant dire que ça a beaucoup intéressé mes psys », sourit-il. Se retrouver à former un duo avec son ami Louis Garrel, qui interprète Patrice Chéreau dans le film, était une autre évidence. « Notre couple a immédiatement fonctionné. » Les deux compères se connaissent depuis plus de quinze ans. C’est Louis Garrel qui lui fait rencontrer le metteur en scène Luc Bondy. Micha Lescot le remplace dans La Seconde Surprise de l’amour, de Marivaux, en 2007. Il jouera le rôle deux cents fois. « Ce sera ma deuxième naissance », dit-il. Luc Bondy monte avec son acteur devenu fétiche cinq pièces en huit ans (Ivanov, Tartuffe…). Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La bande du Théâtre des Amandiers : Chéreau en majesté Malgré leurs vingt-six ans d’écart, il devient plus qu’un maître, un ami intime. « Je le voyais presque tous les jours. Et avec Louis on formait une sorte de trio. » Les deux acteurs lui ont souvent rendu visite à l’hôpital, où le metteur en scène à la santé fragile avait l’habitude de faire de nombreux séjours. Le 28 novembre 2015, une nouvelle fois hospitalisé, Luc Bondy s’éteint. « Je me voyais travailler avec lui toute ma vie… et ça m’allait très bien comme ça. » Fractures des vertèbres Cette année 2015 a été un autre alignement de planètes. D’une nature beaucoup moins gaie. D’abord, il perd son père, puis, le 30 mai, fait une chute de 5 mètres du haut d’une échelle alors qu’il est en train d’interpréter Eddy Bellegueule, dans une adaptation du roman d’Edouard Louis, sur la scène de la Comédie de Valence. De ses multiples fractures des vertèbres, il ressortira avec 2 centimètres en moins, quatre mois d’arrêt et un violent choc post-traumatique. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Cannes 2022 : « Les Amandiers », Valeria Bruni Tedeschi dans son théâtre d’émotions Et quelques mois après la mort de Luc Bondy, la psychanalyste qui le suivait depuis douze ans décède d’une mort brutale. « Un enchaînement incroyable de malheurs. » Le pire aura peut-être été le très long et pénible procès entamé contre la Comédie de Valence. Sept ans après l’accident, et après avoir gagné au pénal, il vient, la semaine dernière, de signer un protocole au civil. « Ça y est, je peux dire que maintenant, cette histoire est vraiment derrière moi. » Il en garde juste une peur qui peut surgir n’importe quand, pas seulement en haut d’une échelle ou sur un plateau de théâtre. « J’ai eu beaucoup de mal à me rassembler, à me reconstituer, même si j’arrivais quand même à travailler… Aujourd’hui, j’ai l’impression que j’ai réussi à transformer cet accident en quelque chose qui fait partie de moi. » Il se souvient que Gérard Desarthe, un des acteurs fétiches de Patrice Chéreau, lui avait dit à la sortie du conservatoire : « Il faut maintenant que tu vives ta vie. » « à l’époque, je n’étais pas trop sûr d’avoir compris ce qu’il voulait me dire. Mais aujourd’hui, je sais. » Les Amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi, avec Louis Garrel, Micha Lescot, Nadia Tereszkiewicz… 2 h 06. En salle le 16 novembre. Grégoire Biseau Légende photo : Micha Lescot, à Paris, le 19 octobre 2022. MICKAEL VIS POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 15, 2022 6:33 AM
|
Par Philippe Lançon dans Libération - 15 novembre 2022 Dans une lente et pathétique succession de clichés baroques (la vie à mort, l’amour à mort), le nouveau spectacle de la metteuse en scène et comédienne espagnole noie ses rares réussites dans l’ennui et la banalité. Quand on va à la messe, surtout quand c’est long, mieux vaut être croyant. Quand on va à la corrida, surtout quand c’est moyen, mieux vaut être aficionado. Si on n’est ni l’un ni l’autre, il est difficile d’être enchanté par le nouveau spectacle d’Angélica Liddell, Liebestod. Cette lente et mal rythmée succession d’images saintes insolites, de clichés baroques, de pantomimes médiocres, rappelle tantôt un film d’Almodóvar première période, tantôt un spectacle de patronage, tantôt les merveilleuses chapelles sanguinolentes et surchargées de la cathédrale de Burgos. Placé sous le signe de Cioran, de Rimbaud, de Bataille, du torero Juan Belmonte (qui révolutionna la tauromachie à 20 ans et se tira une balle dans la tête par désespoir d’amour à 70) et de la mort d’Yseult, le tout est destiné à crier que la vie doit accueillir la mort dans des noces de sang, que l’artiste est un chasseur solitaire, qu’on crève du manque d’amour et que l’absence de sacré, en multipliant les minables, les assis, les amateurs précoces de droits sociaux et de plan épargne-retraite, prépare la fin du monde (du monde humain, en tout cas). Bref, «la seule façon de se libérer de la mort est de la désirer.» Liddell l’a déjà souvent et bien mis en scène, ce vieux cri tragique et mystique à la Lorca. Cette fois, malgré quelques épiphanies visuelles, c’est bancal. Le Golgotha au bistrot On est dans une arène, bordée par d’immenses rideaux orange. D’abord, trois tableaux, sur lesquels se lève et s’abat successivement le rideau de scène. Le premier plonge aussitôt dans l’univers de Liddell, son éclat sauvage et ambigu. Un géant barbu et brun, aux cheveux longs, torse nu et en jupe violette, moitié prêtre moitié bourreau, tient onze chats en laisse. On reverra les chats, plus tard, autour d’un cadavre, dans une niche en verre posée sur un catafalque. L’image des chats en laisse, immobiles, comme dressés, a sans doute une source précise : si Liddell suit librement ses intuitions, elle ne prend pas élan au hasard. Peu importe, une atmosphère est installée. Ces chats répandent peut-être la sensualité, le mystère, l’éternité. La bonne vieille église les tient peut-être en laisse, comme des fantasmes. Cocteau disait qu’il n’y a pas de chats policiers. Et il aimait la corrida, qui va débuter un peu plus tard. Mais d’abord, après une autre image évoquant le monolithe de 2001, l’Odyssée de l’espace, le film de Kubrick (Kubrick dont les musiques de film sont omniprésentes avec les airs de Bach, de flamenco et de Wagner), voici la messe. Liddell en robe noire s’assied à côté d’une petite table ronde. Elle siffle un ballon de rouge, rompt le pain, nettoie ses genoux qu’elle ensanglante, tamponne son vagin, gémit, c’est la cène sur scène et le Golgotha au bistrot ; puis, accompagnés par la musique tonitruante, cinq hommes silencieux arrivent du fond par le callejón. La prêtresse les oint au pinard. A Avignon, ils portaient des bébés : c’est un baptême. Ici, point de nourrissons : la Commission des enfants du spectacle, a-t-on annoncé au début, a refusé. Pourquoi ? Laissons ça aux enquêteurs pour nous concentrer sur la critique – laquelle est soudain saisie par le col en entendant Liddell hurler cette phrase (citée de mémoire) par-dessus un flamenco virulent : «La vengeance des critiques ne fera jamais office de plaisir des dieux.» Ni des yeux, c’est bien vrai. C’est pathétique et ça n’en finit pas L’eau est changée en vin et la messe en corrida. Sur scène, un grand taureau debout, immobile et noir. Il est mort, paraît vivant. Il a un châle noir sur la croupe. Tout à l’heure, elle enlèvera le châle pour s’en couvrir, comme d’une cape, et on verra le gros zizi de l’animal. L’équivalent d’un viol, d’une mise à mort, d’une résurrection ? Pour l’instant, c’est le quart d’heure des passes : l’artiste gigote et minaude devant la bête empaillée. C’est pathétique et ça n’en finit pas : une mauvaise danse solitaire trop arrosée, un samedi soir, quand la danseuse tente d’échapper sans talent à sa vie frustrée. «Olé !» crie sarcastiquement un homme dans la salle. Mais le taureau ne bouge pas. Comme on s’ennuie, on imagine : que se passerait-il si la bête ressuscitait, là, sur scène ? Si la réalité trouait le spectacle et l’artiste ? Ou bien : que se passerait-il si la salle était remplie de militants anti-corrida, genre Aymeric Caron ? Ils auraient tous les droits, sauf celui de sortir, sous peine d’être encornés : folie d’un lâcher de taureau dans les rues autour de l’Odéon, à l’heure où Parisiens et touristes jouissent aux terrasses du réchauffement climatique. Quel happening ! Trois singes mélancoliques Maintenant, Liddell cite des passages de Sur les cimes du désespoir, un petit coup de Cioran et ça repart. Elle tourne autour du taureau avec un encensoir, deux bœufs écorchés tombent du ciel et y remontent, elle caresse et étreint la bestiole dévitalisée, puis, comme toujours dans ses spectacles, vient l’heure de l’homélie féroce : ce long monologue qui livre la morale de l’histoire et des images qu’on a vues, qu’on verra, tout en la parodiant. Liddell projette ses pulsions et ses tentations, mais elle écrit trop bien pour qu’on les prenne soit au premier degré, soit au second. «Tu en as marre d’écrire pour des femmes et des pédés…», «Tu permettrais tous les massacres pour sauver un Caravage…», «Comble-les d’ennui et tu seras maîtresse de leur horreur…», «Le public est devenu moderne, Angelica… Le public en a marre de toi.» Ce n’est ni vrai ni faux. C’est égocentrique, manipulateur, facile, difficile, ridicule, beau, pénible, drôle, ici, ailleurs. Elle conjure, elle s’amuse, elle hurle, elle pleure, à la recherche de la jouissance et du temps perdu. Le plus beau moment est celui où sur le grand rideau tombant apparaît le splendide tableau par le peintre autrichien Gabriel von Max de trois singes mélancoliques. Le taureau finit à terre. Un mutilé apparaît, une jambe et un bras en moignons, porté sur scène par le géant barbu en jupe violette. Elle le prend dans ses bras, comme un homme, comme une poupée, comme Jésus. Yseult meurt, l’homme désespérément aimé s’appelle Heysel, comme le stade du même nom, à Bruxelles, où l’effondrement d’une tribune fit 39 morts et plus de 400 blessés, mais c’est peut-être sans rapport, et comme disait Cioran : «Elançons-nous vers le tourbillon antérieur à l’apparition des formes !» Liebestod texte et mise en scène d’Angélica Liddell au théâtre de l’Odéon (75006), 20 heures, jusqu’au 18 novembre. Légende photo : Sur scène, un taureau a un châle noir sur la croupe. Bientôt, la comédienne enlèvera le châle pour s’en couvrir et on verra le gros zizi de l’animal. (Christophe Raynaud de Lage/ Festival d'Avignon)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 14, 2022 10:55 AM
|
Par Eric Demey dans Sceneweb - 14 novembre 2022 Dans le cadre du festival des théâtrales Charles Dullin, Jean Boillot porte au plateau un texte de Metie Navajo mêlant problématiques contemporaines et réalisme magique. Sur fond d’un Mexique heurté de plein fouet par les effets de la modernité, la rencontre de deux jeunes femmes traverse les traditions et leur destruction, à la recherche d’une nouvelle voie. Un spectacle tissé de délicatesse et d’originalité. C’est un drôle de récit qu’offre là l’autrice Metie Navajo. Une histoire où les époques se télescopent. Le monde « techno-moderne », les déracinés mayas et une anachronique famille d’une communauté mennonite – chrétiens austères à la manière des amish – se côtoient à travers deux personnages féminins principaux. Cécilia, une jeune femme, fille de paysan mexicain, d’origine maya, qui vient d’enterrer sa grand-mère, et Amalia, la plus grande des deux sœurs d’une famille mennonite, que le désir de s’inventer une liberté taraude. Vu la situation du père de Cécilia – paysan qui se fait accaparer ses terres par ceux venus d’Europe, subit la déforestation, la monoculture de soja transgénique élevé au glyphosate et l’arrivée d’un train pour favoriser le tourisme – on se croit un moment lancé dans un plaidoyer (légitime) pour le respect des populations autochtones maltraitées par l’irrésistible avancée de la mondialisation capitaliste. Mais l’on s’aperçoit très vite que l’essentiel est ailleurs. Où exactement, c’est difficile à dire. Cette terre entre deux mondes est un spectacle en apesanteur, hybride jusque dans son titre, imprégné du réalisme magique cher à l’Amérique centrale . Une histoire d’aujourd’hui s’y déploie dans un hors temps mâtiné de passages oniriques créant une atmosphère à la fois familière et originale. Au plateau, Jean Boillot fait jouer ses interprètes dans un cadre blanc qui tranche avec un fond de scène baigné de nuit, où trône l’imposant pied d’un arbre destiné à subir le sectionnement d’une impitoyable tronçonneuse. En couleurs mexicaines, Cécilia hantée par le fantôme de sa grand-mère en quête d’une meilleure sépulture va chercher du travail dans la famille mennonite. Cette famille qui concourt à s’accaparer les terres auparavant partagées par les autochtones est incarnée par trois femmes d’âges différents, en tenues identiques dont l’austérité ne parvient pas à contenir tout désir de vivre. Notamment chez Amalia qui malgré les interdictions de sa mère entre en contact avec Cécilia et se lie même d’amitié avec elle. Rencontre entre deux communautés à la marge tandis que la modernité ne cesse de progresser à coups d’expropriations, de narcotrafics et d’assèchement des terres, le spectacle mêle les langues ancestrales dans leurs sonorités uniques, les étranges pépiements du père de Cécilia destinés à faire venir la pluie, le costume traditionnel de la grand-mère défunte à un ailleurs, un aujourd’hui qu’on ne voit jamais mais qui avance comme un bulldozer sur les jeunes femmes et leur région. Même s’il utilise des motifs connus, le récit n’en reste pas moins toujours surprenant par ce mélange qu’il opère entre les genres. Un dénuement ultra soigné, raffiné, une simplicité éloquente, la précision des interprètes, un travail sonore d’une grande beauté, la sobriété tranchante des dialogues donnent au récit une grande netteté dans l’atmosphère mystérieuse d’un conte d’aujourd’hui. Un entre-deux de plus qui permet à de très belles images d’imprimer la mémoire du spectateur jusqu’à une fin étrange qui réaffirme le rôle primordial des femmes dans cette histoire. Des thématiques contemporaines qui s’entrelacent et éclairent la situation d’un pays souvent méconnu dans des résonances qui le dépassent, la terre entre les mondes est un spectacle politique et poétique parfaitement abouti, jamais démonstratif, tout en affleurements et en sensibilité. Eric Demey – www.sceneweb.fr La terre entre les mondes
texte Métie Navajo
publié aux éditions Espaces 34
mise en scène Jean Boillot
assistant à mise en scène Philippe Lardaud
conseil dramaturgie David Duran Camacho
scénographie Laurence Villerot
création lumière Ivan Mathis
costumes & maquillages Virginie Breger
création sonore Christophe Hauser
régie générale Perceval Sanchez
direction de production Nadja Leriche
avec Millaray Lobos Garcia, Giovanni Ortega, Lya Bonilla, Stéphanie Schwartzbrod, Sophia Fabian, Christine Muller Production : La Spirale, conventionnée par le ministère de la Culture.
Co-Productions : Bords 2 Scènes –Vitry Le François, Théâtre Jean Vilar –Vitry sur Seine, Espace Marcel Carné –Saint Michel sur Orge, CDN de Sartrouville
Avec le soutien en résidence : NEST – Nord Est Théâtre – CDN transfrontalier de Thionville – Grand Est, Studio Théâtre de Vitry sur Seine.
Et avec le soutien de La Région Grand –Est et du Département du Val de Marne – Aide à la création et Artcena. Durée 1h50 Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine
du 8 au 11 novembre 2022 NEST Thionville
Du 16 au 18 novembre 2022
Théâtre en Bois Bords 2 Scénes, Vitry le François
Le 1er décembre 2022 EMC, Saint-Michel sur Orge
le 8 décembre 2022

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 13, 2022 6:44 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - 14 nov. 2022 À Vidy-Lausanne, Steven Cohen reçoit dans son boudoir, espace intime empli de ses souvenirs et d’animaux empaillés. Tel un sanctuaire, le boudoir est aussi le lieu des conflits intérieurs, l’espace mental. Cloué au sol par la conscience des malheurs du monde, l’artiste à la fragilité du papillon, au corps transfiguré par la contrainte, poursuit son douloureux chemin vers la liberté. Bouleversant. Performeur, chorégraphe et plasticien installé en France, Steven Cohen est né et a grandi en Afrique du Sud à une époque où le pays était encore placé sous le régime de l’Apartheid[1]. Dans son travail, il envisage le corps comme un objet scénographique pour mieux révéler ce qui se trouve à la marge, relégué dans les zones périphériques de la société, un espace qu’il connait bien en tant qu’homme blanc, sud-africain, juif et queer. Il met ainsi en scène son propre corps imprégné de récits intimes, point de départ d’une exploration des grâces et disgrâces de l’humanité. Créature à la fois solaire et lunaire, homme-femme dont on ne sait s’il est fée ou sorcière, il s’invente des identités fluides et hybrides qui trouvent leur origine dans des contraires qui, ensemble, se tiennent. Chez lui, la zone de travail est envisagée comme une sorte de territoire très large qui s’affine au fur et à mesure que le projet se développe, avance. Sa pièce précédente, « Put your heart under your feet… and walk », répondait à la question aussi douloureuse qu’insoluble de comment vivre après la mort de l’être cher, prenant la forme d’une cérémonie d’adieu qui se muait petit à petit en célébration de l’énergie vitale et en profession de foi artistique. Sa nouvelle création, « Boudoir », spectacle-installation, apparait comme l’aboutissement de ses précédentes pièces, la somme de toutes ses préoccupations. « Je vais exposer ce que j’ai collecté en libérant ce qui s’est accumulé en moi sous la forme d’une installation/performance[2] » explique Steven Cohen. « Boudoir est une collection, dans tous les sens du terme : un lexique, un salon, une exposition, une somme d’éléments disparates qui forment un tout autonome, une affaire privée accueillant des inconnus, une autobiographie aussi. C’est enfin une apothéose de ce que j’ai fait et créé encore, dans le sens d’une convergence des différents aspects de mon travail de performances, d’actions publiques et d’œuvres plastiques ». Situé entre le salon et la chambre, le boudoir est, dans une maison bourgeoise, la pièce dédiée aux causeries féminines, contraire de l’espace public, très majoritairement masculin. Si, jusque-là, Steven Cohen performait sur scène ou dans l’espace public, il reçoit ici les spectateurs dans son antre privé au charme désuet, rempli de souvenirs, objets et meubles divers, tableaux, candélabres, animaux naturalisés parfois habillés. Chacun s’apparente à un fragment de mémoire qui renvoie à une vie collective passée. Conserver la mémoire Avant d’arriver au boudoir du titre, trois films se succèdent, s’enchevêtrent parfois. Ces enregistrements vidéo d’actions réalisées dans l’espace public, au sein de lieux symboliques ou mémoriels, ont été faits spécifiquement pour le spectacle. Ainsi le premier film, tourné à Johannesburg en Afrique du Sud, prend place dans un lieu dédié à la taxidermie, immense fabrique d’animaux empaillés où l’on croise moins le chat domestique que le trophée de chasse, médaille suprême pour qui pratique la chasse aux gros animaux sauvages : le safari, activité extrêmement lucrative, reconduite chaque année par des pays comme le Zimbabwe, la Namibie ou l’Afrique du Sud. Bien que cette dernière ait promis de mettre un terme aux game farms qui élèvent en captivité des lions, des éléphants et autres spécimens destinés essentiellement à la chasse de loisirs, elle ne compte pas interdire cette pratique. « Le gouvernement sud-africain a accordé, ce vendredi 25 février, des permis annuels de chasse et d'exportation pour des dizaines d'animaux sauvages, dont dix rhinocéros noirs en danger critique d'extinction et dix léopards. Il a également permis la chasse de dizaines d'éléphants, autorisée par les lois internationales sur le commerce des espèces menacées[3] » rapportait il y a quelques mois La dépêche du Midi. La manne que représente l’activité, pratiquée par quelques ultra-riches étrangers, autorise tous les sacrifies y compris l’extinction d’une espèce. C’est dans cette atmosphère étrange d’illusion de cadavres ramenés à la vie, dans ce paradoxe absolu de morts-vivants, qu’apparait Steven Cohen. Si la séquence est quasiment dépourvue d’humains, ils sont pourtant présents dans chacune des images qui la compose, à travers l’activité de taxidermiste qui conditionne le film. La seule présence humaine directe s’incarne dans un gros plan sur des mains noires en train de délimiter le contour d’un œil de zèbre. À l’évidence, ces mains ne travaillent pas pour elles-mêmes. Nous sommes ici clairement dans un lieu de mort. Steven Cohen se situe dans un entre-deux. De par son identité même, il est à la fois du côté des oppresseurs et de celui des opprimés, du côté des animaux par son empathie qui le voit chausser des pâtes animales, et en même temps, du côté des bourreaux lorsque les rouleaux de la Thora, qu’il porte sur la tête, sont souillés par le sang et se déchirent. Humain entre sa base animale et sa tête qui figure l’esprit par l’écriture, il fait le lien entre les deux en rappelant que le bourreau finira par être la victime et la victime le bourreau. Immigrée juive lithuanienne, la grand-mère de Steven Cohen faisait partie de la classe privilégiée blanche au temps de l’Apartheid pendant que ses coreligionnaires étaient victimes du plus important génocide de l’histoire de l’humanité. L’effroyable beauté du monde Pour Steven Cohen, les chaussures, qu’il invente à plate-forme de plus en plus complexe, sont le lieu de la souffrance, comme si la difficulté à tenir debout était la condition sine qua non pour atteindre la beauté. En déséquilibre permanent, il se tient sur le fil qui sépare le sublime du grotesque. Bientôt, dans le boudoir, il s’attachera les chevilles à des chaussures montées sur deux immenses globes et tentera ainsi d’avancer tant bien que mal vers son horizon d’homme libre. Pour l’heure, le second film a pour décor le Konzenstrationslager Natzweiler, au lieu-dit du Struthof. Unique camp de concentration français[4], installé dans les contreforts vosgiens de l’Alsace, sur le site d’une ancienne station touristique, il est encore aujourd’hui absent des livres d’histoire. Le film coupe littéralement le premier en deux en étant projeté au milieu du « Taxidermiste ». On passe d’images documentaires du Struthof à la représentation de Seven Cohen allongé dans ce qui rappelle la forme d’un four crématoire, mettant le feu à son jupon. Le boudoir est une façon pour Steven Cohen de se tenir au plus près du public. Il l’expérimente pour la première fois dans l’espace du théâtre. Les objets exposés dénotent une omniprésence des signes de la violence et des guerres au XXèmesiècle, du vivant à travers les animaux empaillés, de la religion et de l’histoire de la colonisation. Quatre non-dits qui composent les bases de la société occidentale actuelle. « À travers ces objets, que l’assemblage rend hybrides, queer à leur tour, se reflètent des préoccupations éthiques liées à la vie contemporaine : l’épuisement des ressources naturelles et la fragilité des équilibres vivants, la domination des espèces, les questions de classe et l’injustice sociale, la suprématie blanche et la discrimination raciale, la persécution religieuse, la discrimination de genre, la domination cis et la masculinité toxique pleine de bravade mais qui rétrécit comme le plastique près d’une flamme[5] » précise-t-il. Le boudoir n’est autre que l’intériorité quotidienne de l’artiste, son espace mental, ce qu’il se refuse d’oublier et ce sur quoi nous sommes assis. Que sont les animaux naturalisés si non des objets pour se séduire soi-même ? À ce titre, deux culs de babouin font office de trophées inversés. Au Struthof, il y avait une petite chambre à gaz expérimentale testée sur quatre-vingt-six prisonniers d’origine juive. À la mémoire de l’horreur se substitue ici la mémoire de l’oubli. Le film sur le Struthof se termine sur l’image d’un gisant noir. C’est une vision presque similaire qui ouvre le troisième et dernier film. Steven Cohen est allongé nu sur la tombe de sa mère. Son corps à la pâleur extrême apparait comme le pendant inversé du gisant du Struthof. L’histoire complexe de sa famille en fait le témoin privilégié des affres du monde. « Rassembler des fragments d’animaux empaillés, des accessoires contraignants, des costumes-objets. Des corps prothèses pour des êtres composites. Porter le poids mort. Supporter le vivant. Restreindre et redéfinir le mouvement, gêner et entraver la danse. (...) Rapprocher les contraires, du vivant et du mort, de l’humain et de l’animal, du féminin et du masculin. Explorer les ambivalences de l’affreux et du sublime, du sacré et du profane, de la douceur et de la cruauté. Affronter les paradoxes. Surmonter la contrainte du poids des corps morts. Être en quête d’un langage brutal, gauche et élégant[6] » écrit Steven Cohen à propos de « Boudoir ». La souffrance qu’il s’inflige est quelque chose de très humain, faisant de lui l’être qui est en train de naitre. Entrer dans le boudoir de Steven Cohen, c’est prendre conscience du monde et de ses ambivalences. Triste et beau à la fois, mélancolique et poétique, trivial et sacré, le monde intérieur de Steven Cohen possède la mélancolie d'une grue de paradis. Guillaume Lasserre [1] Politique nationale de « développement séparé » des populations dans des zones géographiques séparées selon le critère racial ou ethnique. Introduite en 1948 en Afrique du Sud par le Parti national, elle ne sera abolie que le 30 juin 1991. Voir Antoine J. Bullier, « Apartheid : l’écriture d’une histoire 1940-1990 », Palabres, Écritures et histoire en Afrique du Sud, vol. 5, n°1, 2003, pp. 53-73. [2] Entretien avec Steven Cohen, propos recueillis par Éric Vautrin, juin 2022. [3] « L'Afrique du Sud autorise des permis de chasse pour tuer des rhinocéros en danger d'extinction et des léopards », La dépêche du Midi, 25 février 2022, https://www.ladepeche.fr/2022/02/25/lafrique-du-sud-autorise-des-permis-de-chasse-pour-tuer-des-rhinoceros-en-danger-dextinction-et-des-leopards-10135026.php [4] De 1941 à 1945, cinquante-deux mille déportés, de plus de trente nationalités différentes, sont conduits à Natzweiler et dans ses camps annexes. Environ dix-sept mille d’entre eux périssent dans la nébuleuse Natzweiler dont trois mille cinq cents dans le camp souche. Voir à ce propos Robert Steegmann (préface de Pierre Ayçoberry ), Le Struthof : KL-Natzweiler Histoire d'un camp de concentration en Alsace annexée 1941-1945, Strasbourg, Kalédiscope-La Nuée bleue, 2005. [5] Entretien avec Steven Cohen, op.cit. [6] Reproduit dans la feuille de salle du Théâtre Vidy-Lausanne où le spectacle a été créé. BOUDOIR - Conception, scénographie et performance Steven Cohen. Costumes Clive Rundle, Steven Cohen. Vidéo Richard Muller. Montage vidéo Baptiste Evrard, Steven Cohen. Lumière Yvan Labasse. Photo John Hogg, Allan Thiebault. Administration Compagnie Steven Cohen Samuel Mateu. Création à Vidy : Production Anouk Luthier. Communication Pauline Amez-Droz. Régie générale Véronique Kespi. Accessoires Séverine Blanc. Régie vidéo Victor Hunziker Jad MakkiL Régie lumièr Natacha Gerber Jean-Daniel Bur. Régie son François Planson. Production Théâtre Vidy-Lausanne Cie Steven Cohen. Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings. Coproduction Mousonturm Frankfurt - Théâtre National de Bretagne, Rennes - TAP Théâtre et Auditorium de Poitiers - Les Spectacles vivants, Centre Pompidou - Festival d’Automne à Paris - Les Halles de Schaerbeek - BIT Teatergarasjen - DRAC Nouvelle-Aquitaine. Avec le soutien de Collectif FAIR-E/CCN de Rennes et de Bretagne. Avec les équipes techniques, administratives, de production et de développement des publics & communication du Théâtre Vidy-Lausanne et de la Compagnie Steven Cohen. Spectacle créé le 3 novembre 2022 au Théâtre de Vidy-Lausanne. Du 3 au 16 novembre 2022 (création), Théâtre Vidy-Lausanne
Avenue Gustave Doret
CH - 1007 Lausanne Du 24 au 26 novembre 2022
Centre Pompidou / Festival d'Automne à Paris Du 13 au 15 décembre 2022
Théâtre national de Bretagne Du 20 au 22 janvier 2023
Théâtre national Wallonie-Bruxelles Légende photo : Boudoir de Steven Cohen © Allan Thiebault

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 13, 2022 4:16 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 13 nov. 2022 La nouvelle création du metteur en scène libano-québécois fait un triomphe au Théâtre de la Colline, à Paris
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/13/racine-carree-du-verbe-etre-de-wajdi-mouawad-une-piece-a-l-efficacite-indiscutable-mais-qui-n-evite-pas-les-cliches_6149676_3246.html La critique est un exercice solitaire. On le ressent plus que jamais quand une œuvre rencontre un public enthousiaste mais vous laisse, en tant que journaliste, totalement sur le bas-côté de la route, incapable de vous agglomérer à l’élan collectif. Ainsi en a-t-il été, pour nous, avec Racine carrée du verbe être, la nouvelle création de Wajdi Mouawad, le directeur du Théâtre de la Colline, à Paris. Le spectacle dure six heures, à voir en version intégrale, le week-end, ou en deux parties, en semaine. Et il triomphe, avec un public qui se lève comme un seul homme à l’issue des représentations. Avec cette pièce fleuve, l’auteur libano-québécois revient aux racines de sa vie et de son œuvre : le Liban, la guerre, l’exil, la question de la filiation et celle de l’identité. Tout part de sa propre histoire, lui qui a dû quitter le Liban à l’âge de 9 ans, en 1978, avec sa famille, pour venir vivre en France d’abord, puis au Québec. A partir de là, Wajdi Mouawad s’invente une série d’avatars, avec pour matrice métaphorique cette constante mathématique qui fait de la racine carrée de 2 un nombre irrationnel, possédant un nombre infini de chiffres après la virgule. De ces infinis possibles, il extrait cinq projections de lui-même, de ce qu’il aurait pu devenir, au gré des grains semés par le hasard. Son premier double est un neurochirurgien italien, homme détestable qui a abandonné ses enfants et passe sa vie dans des hôtels de luxe avec de jeunes prostituées. Le deuxième, un chauffeur de taxi parisien, qui se retrouve à accompagner un botaniste à la Gilles Clément et de jeunes activistes écologiques dans leur combat. Le troisième a les traits d’un plasticien québécois, homosexuel et misanthrope, confronté à une polémique sur l’une de ses œuvres. Le quatrième, qui a une boutique de vêtements à Beyrouth, se retrouve pris dans le chaos de l’explosion du 4 août 2020 dans la capitale libanaise. Le cinquième, enfin, attend son exécution dans le couloir de la mort d’une prison texane, après avoir assassiné un couple vingt ans auparavant. Rhétorique du pardon On voit par là que Wajdi Mouawad embrasse bien des sujets de ce qui fait notre monde. La construction de sa pièce est tout à fait virtuose, l’exercice mathématique parfaitement exécuté, avec ces cinq histoires en parallèle qui finissent par se mêler et se développer de manière rhizomateuse. Idem pour la mise en scène qui, aidée par la scénographie mobile d’Emmanuel Clolus, passe d’un univers à l’autre avec fluidité. Le trait est souvent un peu gros, dans ce spectacle qui n’évite pas les clichés Le problème, c’est ce que les personnages, auxquels on n’a pas le temps de s’attacher par ailleurs, et les situations nous disent. Et là, de même que sur la direction d’acteurs, Wajdi Mouawad ne fait pas toujours dans la dentelle. Le trait est souvent un peu gros, dans ce spectacle qui n’évite pas les clichés. Ainsi les mères ont tendance à être forcément hystériques, les sœurs forcément dévouées − c’est leur rôle, n’est-ce pas ? −, les artistes forcément torturés, et les enfants dont les parents ont été massacrés forcément remplis d’empathie pour leurs meurtriers. La rhétorique du pardon développée dans le spectacle, provenant d’un substrat chrétien sans doute, apparaît bien naïve au regard de la réflexion autrement plus complexe sur la justice traditionnellement proposée par la tragédie depuis les Grecs. Que dire aussi de la représentation − toujours délicate au théâtre − hyperréaliste et appuyée des scènes de sexe, de l’insistance un peu gênante dans la manière de montrer la violence à l’égard des femmes ? Que dire, encore, du « viol » (le mot ici est-il bien employé ?) d’un père par sa fille, tel qu’il est mis en scène ? Wajdi Mouawad semble avoir oublié l’existence de la métaphore et du mystère, qu’il maniait si bien dans sa trilogie composée de Littoral, Incendies et Forêts. La dimension métaphorique est prise en charge par les mathématiques, mais, au-delà de cet affichage brandi en étendard, elle apparaît comme assez gratuite, un habillage chic, une caution intellectuelle. Du côté des acteurs, on est également partagé tant certains d’entre eux surlignent leur jeu. Jérôme Kircher, qui partage l’incarnation de ses avatars avec Wajdi Mouawad lui-même, et Norah Krief sont formidables. Et dans la jeune garde éclatent les talents de Jade Fortineau, Jérémie Galiana, Julie Julien et Maxime Le Gac Olanié. Racine carrée finit par apparaître comme une machine théâtrale d’une efficacité indiscutable, mais où, malgré les qualités de la pièce, l’émotion, à force d’être convoquée comme si elle était une obligation, peut décider d’aller se faire voir ailleurs, dans des biotopes où on l’aura laissée s’épanouir avec plus de délicatesse. Racine carrée du verbe être, de et par Wajdi Mouawad. Théâtre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, Paris 20e. Tél. : 01-44-62-52-52. En version intégrale ou en deux parties, jusqu’au 30 décembre. Fabienne Darge Légende photo :
« Racine carrée du verbe être », de et par Wajdi Mouawad, au Théâtre national de la Colline, à Paris, le 3 octobre 2022. SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 12, 2022 5:31 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 12 novembre 2022 Préférant se consacrer aux cérémonies olympiques et à d’autres projets, le metteur en scène a quitté jeudi l’institution, en proie à des tensions sociales et financières comme le reste des centres dramatiques nationaux. En interne, certains employés semblent soulagés du départ du directeur. Solaire au soir du 8 novembre, Thomas Jolly accourt sur le plateau de Starmania pour recevoir, comme le showman Luc Plamondon et la gigantesque équipe réunie sur la Seine Musicale à Paris, un accueil triomphal. Sa veste semble alors à l’image de sa carrière : elle brille de cent facettes et de mille feux. Sitôt bouclée la recréation de l’opéra rock, le virevoltant «petit prince du théâtre public» – comme l’écrivaient certains – s’attellera au défi herculéen des deux ans à venir : la direction artistique de quatre cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques, activité prenante auquel l’intéressé doit se consacrer parallèlement à la mise en scène d’un Roméo et Juliette de Charles Gounod en juin 2023 à l’Opéra national de Paris. Une grande valse de levés de rideaux, donc. Il fallait bien que l’un d’eux se referme définitivement. Au lendemain de la première de Starmania, ce metteur en scène quadragénaire à l’ascension spectaculaire annonçait par mail à ses équipes sa démission du Quai d’Angers. Le sort de cet établissement culturel d’une quarantaine de salariés que Thomas Jolly dirigeait depuis plus de deux ans était laissé en suspens depuis sa nomination pour Paris 2024 fin septembre. Il suscite depuis plusieurs mois de vives inquiétudes à en croire le dernier rapport d’orientation budgétaire et plusieurs salariés de la maison contactés par Libération. Depuis début 2020, en effet, Thomas Jolly n’était plus seulement le metteur en scène médiatique célébré par une partie du public pour ses marathons théâtraux (Henry VI, Richard III), il était aussi le patron du seul centre dramatique national (CDN) des Pays-de-la-Loire. Une institution où il fut nommé quelques mois après sa déconvenue au Théâtre national populaire de Villeurbanne : son nom n’avait «même pas» été retenu en short-list pour la direction de ce CDN, s’était-il indigné sur les réseaux sociaux en dépit de la clarté de l’avis de consultation réclamant «une expérience significative dans la direction d’un établissement culturel». Ainsi Thomas Jolly atterrissait-il à Angers pour son baptême du feu en tant que patron d’institution. La ville était ravie de voir son navire amiral incarné par ce jeune chouchou des webtélés, célébré pour ses «œuvres monstres» (dixit le ministère) l’esthétique baroque, notamment programmées par Olivier Py au Festival d’Avignon. Le Quai d’Angers, avec un budget annuel de 7 à 8 millions d’euros, a pour mission première de produire et coproduire des spectacles : ceux du directeur Thomas Jolly mais aussi d’autres artistes, accueillis en résidence, engagés dans les actions de démocratisation, impliquant la plus grande diversité possible d’usagers dans la vie du théâtre. Au vu de la stagnation des fonds publics et de l’augmentation des coûts de fonctionnement, au vu des défis écologiques, de la crise de diffusion post-Covid, de la mutation des pratiques du public, de la concurrence des plateformes, la tâche est immense. «C’est mieux pour tout le monde» Pour l’assurer, cumuler comme Thomas Jolly les casquettes de metteur en scène et de commandant de bord est obligatoire : le cahier des charges des 38 CDN du territoire, label indissociable de l’histoire de la décentralisation théâtrale d’après-guerre, implique de nommer un artiste au gouvernail… mais rien n’est dit du cas exceptionnel d’un directeur amené à s’absenter aussi longtemps que lui de son fauteuil, Starmania, Opéra et JO cumulés. Fin septembre, donc, la valse des pronostics s’ouvrait à Angers : leur jeune directeur cumulerait-il les fonctions ? Retrouverait-il son poste au Quai après les Jeux olympiques ? Si oui, choisirait-il lui-même son intérim ? Situation clarifiée. De loin, le retrait de Thomas Jolly ferait l’effet d’une fusée se délestant de ses propulseurs. Mais la démission fut son dernier scénario, il évoque son départ définitif comme un crève-cœur mais l’intérim lui paraissait «trop fragilisant» pour le théâtre. Son départ sera effectif d’ici trois mois. Et au Quai, en interne, le monde est stone ? Comme d’autres de ses collègues interrogés par Libération, un employé semble plutôt soulagé : «C’est mieux pour tout le monde, détaille-t-il. [Thomas Jolly] part l’esprit libre vers d’autres projets d’exception et permet au théâtre de se relancer sur un autre projet même s’il laisse une équipe épuisée côté RH et des perspectives financières difficiles.» Ces derniers mois, les rapports se sont en effet tendus entre le jeune directeur et une partie de l’équipe du Quai. Entérinant une satanée loi de Murphy qui voudrait que l’arrivée d’une nouvelle équipe artistique à la tête d’un CDN aille rarement sans un conflit social plus ou moins préoccupant. Le 11 octobre, soit trois semaines après l’annonce de la nomination aux JO, un rapport d’orientation budgétaire pour 2023 était présenté en conseil d’administration devant les partenaires publics du théâtre et s’alarmait : «Le Quai entre dans une spirale qui risque de lui coûter la part la plus importante de son activité.» Coûts de production importants des pièces (grands plateaux et décors, technique importante), difficulté à les vendre à l’extérieur, à trouver les partenaires désireux de coproduire, à les rentabiliser… «Il nous est impossible de produire ou coproduire sur nos fonds propres un futur spectacle pour ce second semestre 2023», note le rapport. Seule pourrait s’envisager la reprise du Dragon, une autre pièce de Thomas Jolly. Le risque de «décrochage» a, précise le document, été «souvent évoqué» précédemment. Mais ce problème serait «contextuel» et non inhérent à son projet, rétorque le directeur qui a contesté les formulations du document devant les partenaires publics : «J’ai en effet décidé de mettre en place trois nouvelles productions de jeunes metteuses en scène qui ont été portées principalement par le Quai, c’est vrai. En sortie de Covid, elles n’ont pas eu la diffusion escomptée (comme beaucoup d’autres), poursuit Thomas Jolly. Je ne veux pas dire qu’il faut jeter l’argent par les fenêtres mais si la solution c’est de monter des seuls en scène – comme on me l’a dit au Quai –, il y a un souci dans les CDN.» Ruissellement du glamour Lors du dernier conseil d’administration, l’ambiance autour de la table était d’autant plus «glaciale», nous relate-t-on, que le rapport mentionnait en conclusion la «tension sociale» montante dans la maison. Sans plus développer par écrit ce que les membres du comité social et économique (CSE) faisaient remonter au directeur lors de leur dernière réunion début octobre : un document que nous avons pu consulter pointe, entre autres, l’«entre-soi décisionnel» qui serait celui de l’équipe dirigeante, son absence «d’appui sur l’équipe historique». En pomme de discorde, cette phrase figurant sur l’ordre du jour, que l’artiste-directeur nous répète aujourd’hui de mémoire, et qui l’a «violemment blessé, dit-il, car elle remet en question mon éthique, mon projet, mon engagement dans le service public : “Le sentiment que Thomas Jolly utilise le Quai pour son image personnelle et pas pour un projet de service public”». L’artiste a refusé de répondre au CSE, demandé une «médiation extérieure» et a ensuite reposé le sujet «dans une volonté de concorde et d’apaisement» devant l’ensemble de l’équipe lors d’une réunion ultérieure. S’ensuivait, le 14 octobre, une lettre des salarié·e·s, signée à 80 % de l’effectif, renouvelant au directeur leurs «inquiétudes au regard de la situation globale du Quai» et réaffirmant «la légitimité du CSE en tant que représentant» de leur parole. Thomas Jolly, conscient de son «aura médiatique», croit au ruissellement du glamour qui l’entoure sur ces institutions fragilisées. Il soupire de lassitude, s’estime frustré de n’avoir «jamais pu [s]’expliquer avec eux sur ce sujet» et enchaîne : «L’institution, ce doit être un outil et non pas un cadre. J’ai peut-être manqué de pédagogie mais il y a aussi de la résistance au changement.» Depuis, l’ambiance serait «très délicate», confiait un salarié en début de semaine : «Thomas est à Paris sur Starmania, le secrétaire général est en arrêt maladie depuis trois semaines et le directeur adjoint aux productions vient lui aussi de se mettre en arrêt.» Thomas Jolly est loin d’être le seul artiste-directeur à avoir vécu des tensions sociales dans un CDN. Fin 2019, le Monde revenait en longueur sur la multiplication des conflits dans ces maisons où se «livre en coulisse un combat à couteaux tirés entre la liberté de création et le droit du travail». D’un côté, des artistes-directeurs de passage légitimement désireux de réinventer les institutions ; de l’autre, les équipes permanentes des théâtres légitimement irritées de n’être (parfois) pas assez écoutées. Combien sont-ils, ces metteurs en scène propulsés du statut de chef de compagnie à celui de directeur de PME, se cassant les dents à leur arrivée sur les principes de management et de gestion des ressources humaines ? Thomas Jolly voulait faire mentir le sort : «J’ai pris ce poste à Angers parce que j’en avais marre d’entendre ces discours sur l’institution, aussi parce qu’elle est attaquée sur ces motifs par la droite et de plus en plus de mairies. Je voulais anticiper ces problèmes, qu’on se parle…» Système de nomination jugé «absurde» Derrière ces tensions enflant dans l’ombre de la préparation des JO et de Starmania, un problème structurel revient ainsi sur le devant de la scène. Il touche au système de nomination à ces labels jugé «absurde» par une partie du secteur et au cahier des charges «disproportionné». Déficit d’accompagnement de l’artiste en poste, manque de tuilage avec l’équipe sortante, budget artistique de plus en plus limité, responsabilité parfois baroque… «Je suis le responsable unique de la sécurité des 26 000 m² du bâtiment, moi Thomas Jolly !» En 2019, lors de son départ du CDN de Nanterre-Amandiers, Philippe Quesne s’indignait de son côté : «Il faudrait peut-être arrêter de nommer des gens six mois avant leur prise de poste. Pour ma part, j’ai eu trois mois avant de dire bonjour à une équipe de 60 personnes !» Pour une directrice adjointe d’établissement culturel, «il faudrait a minima officialiser des candidatures mixtes : continuer de nommer des artistes à ces postes, bien sûr, mais en s’assurant qu’ils soient correctement épaulés par un intendant. A l’heure actuelle, et c’est officieux, les tutelles permettent à l’artiste d’arriver en poste avec le numéro 2 de son choix…» Mais encore faut-il savoir le choisir. Thomas Jolly, pour sa part, a confié la direction de la production du Quai d’Angers à un de ses acteurs et assistant à la mise en scène, formé au management culturel à l’université mais primo-arrivant à un tel poste. Un employé du Quai torpille : «Comment peut-on faire pareille erreur de casting ? Comment voulez-vous que cet acteur ait le réseau de coproducteurs suffisant ?» D’autres adoucissent, pointant la «jeunesse» de leur équipe de direction et une arrivée «compliquée par le Covid». La plupart en conviennent au Quai : responsabilité revient aussi aux tutelles de prendre davantage soin du système de nomination et du cahier des charges de ces maisons. Contacté par Libération à plusieurs reprises, le ministère de la Culture n’a pas donné suite à nos sollicitations. De son côté, Thomas Jolly renouvelle son «soutien absolu» à son adjoint et pointe les projets «merveilleux» que l’équipe et lui sont parvenus à mener en dépit de la crise : «[Je sais] que je ne me ferai pas des amis : L’institution va mal, elle est même mourante. Les directeurs sont cadenassés par le cahier des charges, les équipes se tendent. Pourtant, il faut absolument la faire vivre.» Eve Beauvallet Légende photo : Thomas Jolly va s’atteler à la direction artistique de cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques. (Anthony Dorfmann)
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...