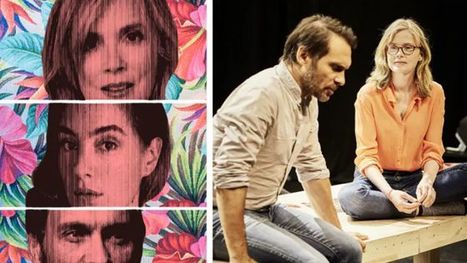Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 5:44 AM
|
Critique d'Anne Diatkine publiée dans Libération - 25/11/2022 La pièce minimaliste de Fanny de Chaillé multiplie les niveaux de lecture, et réussit le tour de force de satisfaire les attentes des spectateurs les plus néophytes comme des plus aguerris. Est-il possible de s’adresser à des enfants dont un certain nombre ne sont sans doute jamais allés au théâtre et à des adultes avertis sans privilégier ni les uns ni les autres ? Peut-on construire un spectacle qui invente une (autre) histoire du théâtre, qui emporte tout autant des enfants de dix ans et des adolescents que des adultes avisés, mais pas toujours aux mêmes endroits et pour les mêmes motifs, et ne nécessite aucun savoir préalable pour l’apprécier ? Qu’est-ce qui différencie fondamentalement un public d’enfants et un public d’adultes ? Et qu’appelle-t-on «histoire du théâtre» ? Le hasard nous conduit à voir la merveille modeste – les accessoires de décor tiennent en une petite valise, costumes compris – de Fanny de Chaillé un mercredi à 15 heures au CDN de Montreuil avec la nouvelle directrice du festival d’automne Francesca Corona – spécimen s’il en est de public avisé – dans une salle remplie de scolaires – une classe de CM1 de huit et neuf ans, une autre de première et de terminale. Les plus petits réagissent un peu comme à un spectacle de marionnettes, ils retiennent leur souffle, bougent telle une vague, crient lorsque les quatre acteurs se battent «pour de vrai», sur un plateau totalement dénué de décors. Les plus grands sont très attentifs – sauf une jeune femme à nattes qui ne cesse de s’affairer sur son portable lumineux, mais on s’apercevra à la sortie qu’elle n’est pas élève mais accompagnatrice. Références et indices Les acteurs éprouvent-ils les passions qui habitent leurs personnages ? Qu’est-ce qui nous permet de croire à une situation que l’on sait pourtant illusoire ? Et à quoi pense-t-on lorsqu’on est spectateur ? Le grand plaisir du spectacle est de donner corps à ces questions immémoriales sans qu’elles apparaissent naïves ou théoriques grâce aux quatre formidables (jeunes) acteurs Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala et Valentine Vittoz, déjà repérés dans Chœur. Oui, il y a bien une part didactique, mais les informations s’insinuent dans la trame sans forcing, au détour d’une phrase ou d’une situation. A chaque fois, c’est par le jeu que les acteurs escaladent un sujet-obstacle et grimpent de rocher en rocher sans achoppement ni effet de catalogue. Probablement, le spectateur adulte ne pourra s’empêcher de chercher les références qui se nichent dans cette histoire du théâtre qui se construit sous nos yeux : cette actrice volontaire qui semble parler dans le poste et qui considère que son heure de gloire n’a que trop tardé, n’est-ce pas Jeanne… Moreau ? Et l’intervieweur condescendant, obséquieux dans son ironie, c’est bien sûr… François Chalais. Ce même spectateur s’attache à tous les indices, se cramponne aux accents, à la gestuelle, au vocabulaire suranné ou aux modes de domination, car l’histoire du théâtre est aussi celle des manières d’exercer le pouvoir. Il attend Vilar, Vitez, Brook, Chéreau, tandis que l’enfant aura tendance à s’identifier frontalement aux acteurs, car comme eux, il passe son temps à jouer et à croire à son jeu. On souhaite bonne chance à l’adulte : Fanny de Chaillé est bien trop maline pour ne pas déjouer l’écueil du best of et de la panoplie. L’un des atouts de ce spectacle tient à sa simplicité : éliminer tout le superflu, comme diraient Grotowski ou Peter Brook, afin que ne restent que les acteurs et leurs questionnements intimes. Leur âge a une certaine importance, car on n’imagine pas la même histoire du théâtre selon que les spectacles et les noms devenus mythiques ont un jour accompagné notre présent, ou qu’ils ont toujours appartenu à une époque révolue et aujourd’hui rêvée. Fanny de Chaillé dit avoir élagué les trois quarts du matériel amené et improvisé par les acteurs, comme on coupe des costumes à même les modèles afin de mieux se concentrer sur l’ordonnance du récit. Il lui serait possible de faire surgir une dizaine d’autres histoires du théâtre avec les mêmes acteurs, ce qu’elle n’exclut pas d’entreprendre. Mais ce pourrait être avec d’autres acteurs réunis eux aussi dans Chœur actuellement en tournée, qui à leur tour apporteraient leur propre matériel, mémoires, histoires. Ou comment, sans le prévoir, sans s’en douter, la plus minuscule des pelotes mène à une fresque sans fin. Anne Diatkine / Libération «Une autre histoire du théâtre», de Fanny de Chaillé. Jusqu’au 27 novembre au CDN de Montreuil, du 29 novembre au 3 décembre à Chaillot, puis grande tournée. Légende photo : «Une autre histoire du théâtre», de Fanny de Chaillé. (Marc Domage )

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:40 PM
|
Enquête de Cassandre Leray dans Libération - 27 nov. 2022 Au surlendemain de la publication de l’enquête sur les accusations visant Sofiane Bennacer et leurs conséquences sur le tournage du film, «Libération» apporte de nouveaux éléments. Des «rumeurs». C’est en ces termes que les producteurs des Amandiers et sa réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi évoquent ce que d’autres autour du film qualifient d’alertes. Suite à la parution de notre enquête, le 24 novembre, les réactions s’enchaînent. Patrick Sobelman d’Agat Films et Alexandra Henochsberg d’Ad Vitam production – les deux sociétés qui produisent les Amandiers – le répètent : «A aucun moment la production ne savait avant de l’engager», a martelé le premier sur France Inter vendredi. Avant d’ajouter que, une fois découverte l’existence d’une plainte, «il était absolument impossible d’arrêter le tournage et de virer Sofiane, pour une raison très simple : nous n’avions aucune base juridique pour faire ça». Dans un long communiqué publié samedi, les deux producteurs du film le certifient : «Il n’y a pas de scandale les Amandiers», en référence à la une de Libé de vendredi. Climat d’omerta Dans nos pages, une partie de l’équipe du film affirme que la production et la réalisatrice ont «protégé» l’acteur Sofiane Bennacer, alors qu’ils auraient été alertés d’accusations de violences sexuelles à son sujet. Ils racontent les coulisses du tournage des Amandiers à l’été 2021, dans un climat d’omerta, que la production réfute, alors que plusieurs témoignages décrivent ce sentiment d’être «enfermés dans ce secret dont il ne fallait pas parler», selon une technicienne. Une alternante raconte même que «[Valeria Bruni-Tedeschi] nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements». Une plainte pour viol contre Sofiane Bennacer a été déposée le 5 février 2021 par Romane (1), une de ses ex-petites amies, soit plusieurs mois avant le début du tournage. Trois autres anciennes compagnes de Sofiane Bennacer ont depuis été entendues par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg chargée de l’enquête, et deux d’entre elles décrivent des faits de viol. Outre sa mise en examen pour «viols» et «violences», le comédien a été placé sous statut de témoin assisté pour des faits de «viol sur conjoint», précise la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. La magistrate ajoute que «d’autres [plaintes] ont été recueillies au cours de l’enquête préliminaire puis sur commission rogatoire». Lui conteste systématiquement les faits, aussi bien auprès de Libération que sur son compte Instagram. Au cœur du débat, plusieurs questions : qui était en possession de quelles informations, et à quel moment ? Plusieurs jours après la parution de notre enquête, nous faisons le point et révélons de nouveaux éléments. Une comédienne «forcée» à auditionner Selon nos informations, une première alerte à l’égard de l’acteur Sofiane Bennacer aurait été formulée fin mars 2021. A l’époque, les auditions pour le film les Amandiers sont en cours. Anna (1), étudiante à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS) – où Sofiane Bennacer a aussi étudié avant de démissionner en février 2021 – tente elle aussi sa chance pour le long métrage. Dans la même promotion que Romane, elle connaît les accusations portées à l’égard de Sofiane Bennacer. Lorsqu’elle apprend qu’elle devra donner la réplique au comédien pour la suite des essais, elle refuse, et dit à l’assistante de casting qu’il est «accusé de violences sexuelles». Elle ne donne pas plus de précisions, et nous indique qu’elle a été «forcée» à auditionner avec le comédien malgré tout. La production, tout comme Valeria Bruni-Tedeschi elle-même, le reconnait : des «rumeurs» circulaient bien concernant le comédien, et ce avant le début du tournage. Le duo de producteurs explique avoir entendu parler d’une «rumeur concernant une soirée avec son ancienne petite amie du TNS, qui aurait mal tourné avec un comportement violent de Sofiane». Ces échos leur viennent dès le mois de «février ou mars», alors que le casting «commençait à se resserrer sur Sofiane». «Fin mai», d’après la production, décision est alors prise de joindre Stanislas Nordey, directeur de l’école du TNS. Contacté, Stanislas Nordey confirme cet appel : «J’ai dit que c’était deux jeunes gens qui étaient en couple, avant le début de l’école. J’ai dit que Sofiane était venu me dire qu’il était accusé à tort de viol, qu’on a convoqué la jeune fille qui nous a dit qu’elle confirmait les accusations.» Le directeur du TNS décide toutefois de ne pas mentionner la plainte de Romane, dont il avait connaissance, arguant qu’il se devait de respecter «le secret de l’enquête». La production, de son côté, dément fermement avoir entendu Nordey parler de «viol», et déplore que celui-ci ne leur ait pas parlé de la plainte. Il aurait seulement évoqué une «histoire» et aurait traité le sujet «à la légère». Selon Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, il est pourtant possible de faire état de l’existence d’une plainte sans contrevenir au secret de l’enquête «en respectant l’anonymat des plaignantes et sans donner des informations sur les faits». «Agressée physiquement, moralement, verbalement» Pour la production, «sur le seul fondement d’une rumeur», rien n’empêchait d’engager Sofiane Bennacer. Une position fermement défendue par Valeria Bruni-Tedeschi dans un communiqué diffusé vendredi : «J’ai été impressionnée artistiquement par Sofiane Bennacer dès la première seconde du casting de mon film et j’ai voulu qu’il en soit l’acteur principal malgré des rumeurs dont j’avais connaissance», écrit la réalisatrice. «Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui», souligne-t-elle encore. Sur la même ligne, Valeria Bruni-Tedeschi et les producteurs assurent n’avoir découvert l’existence d’une plainte pour viol que deux jours après le début du tournage, le 5 juin 2021. Un témoignage contredit cette version. Mathilde (1), l’une des jeunes femmes mettant en cause Sofiane Bennacer pour des faits de violences sexuelles et physiques dans notre enquête, a elle aussi tenté d’alerter l’équipe du film. Le 16 mai 2021, elle contacte une des actrices du film via Facebook. Dans un échange, elle écrit que «Sofiane est accusé de viol» et que «le procès est en cours et n’a pas encore été classé». Elle ajoute qu’elle aurait, elle aussi, «été agressée par Sofiane. Physiquement, moralement, verbalement» et qu’elle aurait «reçu un appel d’une autre fille qui souhaitait [lui] raconter son histoire, si proche de la [sienne]». Une semaine plus tard, la comédienne lui répond : «Oui, la production est au courant et la réalisatrice a quand même décidé de l’embaucher.» Et ajoute : «J’ai parlé à la réalisatrice et j’ai exigé que le procès de Sofiane et son accusation de viol soient connus par toutes les filles du tournage […] et elle nous a donc réunies pour nous en parler […] Vu ma position, je ne sais pas quoi faire de plus.» Nous sommes le 24 mai 2021, les répétitions sont en cours mais le tournage n’a pas encore commencé. Dans un communiqué paru à la suite de notre enquête, le duo de producteurs répète malgré tout avoir découvert l’existence d’une plainte pour viol alors que le tournage était déjà entamé. Et explique avoir échangé avec Valeria Bruni-Tedeschi à ce sujet : «Mettant en avant la présomption d’innocence, celle-ci n’envisage pas de continuer le film sans ce comédien. Nous n’avons alors que peu de solutions : à ce stade, rien dans le droit du travail ne nous permet de justifier son licenciement, il pourrait se retourner contre nous.» «Rien à redire» Un dilemme dont les producteurs avaient déjà fait part. Que faire pour l’employeur face à un salarié qui est accusé et fait l’objet d’une plainte mais qui n’est pas jugé et donc présumé innocent ? La juriste Catherine Le Magueresse – sans commenter le cas précis des Amandiers – estime qu’il n’est pas impossible pour un employeur de mettre fin au contrat d’un salarié suite à la découverte d’une plainte contre celui-ci. «Un licenciement pour cause réelle et sérieuse est envisageable», argumente-t-elle. «La dissimulation de l’existence d’une plainte pour viol par un candidat constitue un manquement au devoir de loyauté et de bonne foi. Dans un contexte de moindre acceptation sociale des violences sexuelles, elle est en outre susceptible de nuire à l’employeur qui pourrait être suspecté d’indifférence sur ce sujet.» Faire marche arrière et changer l’un des principaux rôles d’un film n’est pas sans conséquence pour un projet d’une telle ampleur. Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman expliquent ainsi que, s’ils avaient mis un terme au contrat de Sofiane Bennacer, ils auraient aussi dû «arrêter le tournage et licencier les 89 salariés sur le plateau sans justifications légales valables». Pour Catherine Le Magueresse, «il est certain qu’une telle situation est compliquée. Mais dans une ère post MeToo, il est difficilement envisageable de ne pas agir. Ce n’est pas seulement une question de droit, mais une question de morale». Les producteurs auraient alors fait avec les «armes» dont ils disposaient, expliquent-ils: convocation de Sofiane Bennacer afin de lui demander de prendre un avocat, présence quotidienne sur le plateau de tournage… Ils affirment également avoir échangé avec l’une des coprésidentes du collectif 50/50 – sans se souvenir de son nom –, qui leur aurait indiqué qu’elle ne voyait «rien à redire» quant aux décisions prises. Contacté, le nouveau conseil d’administration du collectif explique que si les producteurs ont contacté l’une des anciennes présidentes, «c’est à titre privé et non au nom du collectif». Et tient à préciser : «Il est extrêmement choquant que de pareils agissements continuent de prendre place au sein des domaines du cinéma et de l’audiovisuel, qu’un régime de silence soit encore en faveur dans certaines productions, que des tournages se déroulent en présence de personnes qui représentent un danger pour leurs collègues.» (1) les prénoms ont été modifiés. Légende photo : Louis Garrel, Valéria Bruni-Tedeschi, Sofiane Bennacer et une partie de l'équipe des «Amandiers» lors de la montée des marches du Festival de Cannes, le 22 mai. (David Boyer/ABACA)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:10 PM
|
Enquête de Cassandre Leray publiée dans Libération le 24/11/22 «Libération» a recueilli les témoignages de jeunes femmes qui mettent en cause le comédien à l’affiche des «Amandiers» de Valeria Bruni-Tedeschi. Elles décrivent des violences sexuelles et physiques, et l’accusent d’avoir fait pression sur elles, les menaçant de nuire à leur carrière. Il a été mis en examen pour «viols et violences sur conjoint». Les Amandiers sont partout. Sur les panneaux d’affichage, dans les kiosques à journaux et sur les devantures des cinémas. Le film, qui figurait en compétition officielle au Festival de Cannes au printemps, est sorti en salles le 16 novembre sur près de 250 écrans, solidement soutenu par une importante campagne de promotion et un relais critique enthousiaste (y compris dans nos colonnes) sur cette peinture du climat délétère qui régnait dans la légendaire école de théâtre dirigée par Patrice Chéreau dans les années 80. A l’affiche du nouveau long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi, le visage de Sofiane Bennacer. Malgré son rôle central, il est resté absent des plateaux radio et télé. Et pour cause. En octobre, l’acteur a été mis en examen pour «viols et violences sur conjoint» par un juge d’instruction de Mulhouse, comme l’a révélé le Parisien mardi 22 novembre, une information confirmée à Libération par la procureure Edwige Roux-Morizot. En réaction à ces informations, l’Académie des césars a décidé de retirer Sofiane Bennacer de la liste des 32 révélations pour la cérémonie de 2023. Plusieurs anciennes ex-compagnes entendues par les gendarmes Le parquet avait initialement requis un mandat de dépôt, pour «éviter toute pression au regard de témoins ou potentielles victimes non encore entendues». L’acteur a finalement été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Il lui est ainsi interdit de se rendre dans les villes de Strasbourg, Mulhouse et Paris ainsi qu’en région parisienne, zones géographiques correspondant aux lieux de domiciliation de témoins et plaignantes. Sofiane Bennacer a également l’interdiction de rencontrer sa «compagne» − selon le terme de la procureure − Valeria Bruni-Tedeschi, entendue dans le cadre de l’enquête, ainsi que l’ensemble des plaignantes et témoins du dossier. Romane (1) a déposé plainte pour «viol» contre Sofiane Bennacer le 5 février 2021 au commissariat de Strasbourg. Dans sa plainte, que Libération a pu consulter, l’étudiante alors âgée de 23 ans raconte avoir été violée à plusieurs reprises par le comédien entre 2018 et 2019, pendant qu’elle était en couple avec lui. Trois autres anciennes compagnes de Sofiane Bennacer ont été entendues par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg chargée de l’enquête, et deux d’entre elles décrivent des faits de viol. Outre sa mise en examen pour «viols» et «violences», le comédien a été placé sous statut de témoin assisté pour des faits de «viol sur conjoint», précise Edwige Roux-Morizot. Elle ajoute que le comédien a été mis en examen à la suite d’une première plainte, puis que «d’autres ont été recueillies au cours de l’enquête préliminaire puis sur commission rogatoire». Pendant huit mois, Libération a enquêté, après de nombreuses alertes de plusieurs militantes féministes concernant Sofiane Bennacer. Nous avons pu rencontrer Romane et recueillir les témoignages de deux autres femmes. Elles l’accusent de violences sexuelles et physiques. Sofiane Bennacer dément fermement les accusations portées par Romane et affirme qu’elle aurait «quémandé des témoignages» auprès d’ex-compagnes. Libération a recueilli la parole de deux femmes qui mettent en cause le comédien, par ailleurs visé par d’autres plaintes. «Il la dévalorisait constamment» Lorsque l’on rencontre Romane dans un café strasbourgeois en février 2022, un peu plus d’une année s’est écoulée depuis le dépôt de sa plainte, mais l’instruction n’est pas encore ouverte. Une tasse de café dans les mains, la comédienne en formation à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS) pèse chacun de ses mots. Elle l’affirme à plusieurs reprises : «Je n’ai pas du tout envie de le détruire.» La comédienne craint aussi des représailles du comédien, qui l’aurait déjà menacée au cours de leur relation : «Il connaît du monde dans le milieu, il disait toujours “si je veux détruire quelqu’un je le fais direct” ou ”quand je serai une star, je te le rendrai, mais si t’es pas avec moi t’es contre moi”.» Si elle ne souhaite pas s’exprimer médiatiquement à ce jour, nous avons pu consulter la plainte déposée par la comédienne. Celle-ci fait état de plusieurs viols au cours de sa relation avec Sofiane Bennacer, entre 2018 et 2019. Une relation d’emprise au cours de laquelle des violences psychologiques auraient eu lieu est également dépeinte. Romane rencontre Sofiane Bennacer à l’été 2018, alors que tous deux entament une formation au théâtre de la Filature, une classe préparatoire aux concours des écoles de d’art dramatique à Mulhouse. S’en est suivie une relation amoureuse. Leïla (1), comédienne de 25 ans et camarade de promotion à Mulhouse, se souvient de «crises de violence» dont elle a été témoin. Notamment une, en pleine répétition : «J’entendais hurler, j’ai vu [Sofiane] choper [Romane] par le bras pour la forcer à faire ci ou ça. Il lui donnait des ordres.» Avec du recul, elle estime que Romane était «très fortement sous l’emprise de Sofiane. Il la dévalorisait constamment, j’ai remarqué qu’elle avait perdu beaucoup de poids…» Au fil du temps, elle devient peu à peu l’une des confidentes de Romane. A l’été 2020, plus de six mois avant que la plainte ne soit déposée, cette dernière racontait déjà à Leïla «que leurs rapports sexuels étaient méga violents, […] qu’il la forçait». «Petit à petit, Romane a pris conscience de plus en plus de choses» Au printemps 2019, Sofiane Bennacer met fin à la relation. Il entre à l’école du Théâtre national de Strasbourg, tandis que Romane reste étudier à Mulhouse. Un an plus tard, Romane est à son tour admise au TNS. En juin 2020, peu avant la rentrée, elle parle pour la première fois de ce qui s’est passé avec Sofiane Bennacer à sa meilleure amie Claudia (1). Contactée par Libération, cette dernière, proche de Romane depuis le lycée, se souvient de l’échange. Elle confirme avoir recueilli les confidences de son amie, bien avant qu’une plainte ne soit déposée ou que le comédien ne soit casté pour le premier rôle des Amandiers. «Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir peur d’une autre personne comme ça. Petit à petit, Romane a pris conscience de plus en plus de choses, dont les violences sexuelles.» En janvier 2021, Romane confronte Sofiane Bennacer à sa sortie des cours et lui décrit les violences qu’elle aurait subies au cours de leur relation. Dans la foulée, Sofiane Bennacer se rend auprès de la directrice des études du TNS pour dénoncer les «accusations diffamatoires» de Romane, selon l’administrateur de l’établissement, Benjamin Morel, contacté par Libération. Romane, qui n’envisageait pourtant pas de faire remonter les faits au sein de l’école, est convoquée. Face à la direction, elle maintient ses propos. Le 5 février 2021, Romane dépose plainte, fait dont la direction de l’école confirme avoir été informée. Sofiane Bennacer, de son côté, démissionne du TNS le 19 février 2021. L’établissement précise à Libération avoir procédé à un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code pénal – qui oblige tout fonctionnaire ou toute autorité à dénoncer à la justice un crime ou délit dont il aurait connaissance – le 31 mars 2021. Une information confirmée par le parquet de Mulhouse. Si Romane a porté plainte contre Sofiane Bennacer, alors qu’elle n’en avait pas l’intention initialement, c’est parce qu’elle a découvert qu’elle n’était «pas seule». En janvier 2021, après avoir confronté Sofiane Bennacer, elle contacte plusieurs ex-compagnes de l’acteur. En quelques jours, elle reçoit des témoignages dépeignant un vécu similaire au sien : ces femmes lui décrivent des violences psychologiques, parfois physiques, mais aussi des violences sexuelles. Auprès de Libération, deux d’entre elles affirment avoir été violées par le comédien en 2019. Débordée par ces récits, Romane porte plainte. Encore aujourd’hui, la jeune femme martèle sa volonté de «laisser la justice mener son travail», refusant ainsi que des détails de son témoignage soient relayés dans la presse – raison pour laquelle l’enquête de Libération n’avait pas encore été publiée. Ses avocats, Anne Lassalle et Grégoire Mehl, déplorent la parution d’articles dans la presse «révélant des informations sur le contenu de sa plainte ainsi que son identité sans son consentement», qui contraignent la plaignante à «supporter la médiatisation» : «Romane a été très choquée et ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet qui fait l’objet d’une instruction.» «C’est la première fois que je raconte tout à quelqu’un» Pour Anaïs (1), 24 ans, une autre femme mettant en cause l’acteur, parler serait une manière de s’assurer que Sofiane Bennacer «ne puisse pas recommencer». Elle est étudiante en art à Mulhouse lorsqu’elle rencontre le comédien, début 2019. A l’époque, Anaïs traverse de graves problèmes familiaux et pense que boire un verre lui changera les idées. Par peur de rentrer seule à pied en pleine nuit, elle accepte d’aller chez Bennacer, qui «insiste». Une fois chez lui, le jeune homme commence «à la toucher et l’embrasser» et la «pénètre avec sa main». «Je disais non, j’enlevais sa main, il souriait et la remettait, décrit Anaïs. C’est du viol. A partir du moment où j’ai clairement exprimé le non et qu’il le faisait quand même, c’était comme si je ne pouvais rien faire.» Ce soir-là Sofiane Bennacer aurait également pénétré la jeune femme avec son sexe sans préservatif, sans son consentement. Elle ne le revoit jamais et plonge dans une «profonde dépression». Contactée par un gendarme dans le cadre de l’enquête ouverte après la plainte de Romane, elle décide de ne pas porter plainte, de peur que sa famille apprenne ce qui lui est arrivé. Aujourd’hui encore, elle confie n’avoir presque jamais parlé de cette histoire à ses proches, tant elle avait «honte». «C’est la première fois que je raconte tout à quelqu’un», dit-elle, se refusant à témoigner dans le cadre de la procédure judiciaire pour l’instant. Mathilde (1), elle non plus, n’a pas souhaité porter plainte. Elle a toutefois témoigné dans le cadre de l’enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Si elle accepte de parler à Libération, c’est pour dénoncer un «système» qui dépasse son histoire personnelle et la «protection» dont Sofiane Bennacer a bénéficié en travaillant sur le tournage du film les Amandiers. Au cours de l’été 2019, l’étudiante en art voit Sofiane Bennacer épisodiquement à Paris. Elle décrit des violences sexuelles répétées : «Sur le fait de vouloir ou pas vouloir, sur le fait de se protéger ou non, sur comment ça doit être fait, on n’a pas le choix. Si je disais non, soit il l’ordonnait physiquement soit il jouait sur la culpabilisation.» Preuve de son trouble et de ses craintes, elle prend même l’habitude «d’envoyer sa géolocalisation à ses amis» avant de rejoindre Sofiane Bennacer. «Plusieurs fois, il m’a étranglée ou a été violent avec moi.» «C’est un des moyens de pression les plus forts qu’il ait utilisés» Quand la jeune femme décide de mettre un terme à sa relation avec Sofiane Bennacer, quelques mois après leur rencontre, elle craint immédiatement qu’il ne s’en prenne à sa carrière : «C’est un des moyens de pression les plus forts qu’il ait utilisés», souligne Mathilde, âgée de 24 ans au moment des faits. A l’époque, elle travaille sur un projet artistique important pour lequel Sofiane Bennacer la soutient. Quand elle lui annonce vouloir cesser de le fréquenter, l’acteur l’aurait alors menacée : «Il m’a dit que si mon projet fonctionnait, c’était grâce à son réseau, qu’il allait tout faire péter.» Un récit qui fait écho à celui de Romane. Alors que les deux jeunes femmes évoluent dans le milieu culturel, l’acteur aurait joué de ses contacts pour faire pression sur elles, dans un milieu où la peur d’être blacklisté est omniprésente. Libération a retrouvé la trace de trois autres femmes qui accusent Sofiane Bennacer de violences sexuelles, psychologiques ou physiques. Elles n’ont pas souhaité s’exprimer dans cette enquête. Nous avons également recueilli les témoignages de plusieurs anciens camarades de promotion de Sofiane Bennacer, qui retracent le parcours du comédien. Plusieurs comédiens et comédiennes ayant croisé son chemin le décrivent en des termes similaires : l’une parle d’un homme «charismatique» et ayant régulièrement recours à «l’intimidation», tandis qu’un ancien camarade de Mulhouse dépeint Sofiane Bennacer comme une personne «agressive», avec un côté «manipulateur» et qui aurait tendance à «prendre les femmes pour des objets». Contacté par Libération dès le mois de mai, Sofiane Bennacer s’est exprimé dans un long mail dans lequel il dément formellement les accusations de Romane. Il affirme qu’elle serait allée «quémander de témoigner» contre lui auprès de plusieurs ex-compagnes, «en leur disant qu’il y avait déjà six filles qui avaient porté plainte contre moi, chose qui est complètement fausse». Des accusations qu’il a réitérées sur son compte Instagram mercredi. Libération a pourtant pu consulter des messages envoyés par Romane aux jeunes femmes ayant fréquenté Sofiane Bennacer. Aucun ne fait état de ces éléments. Concernant les deux autres témoignages le mettant en cause pour des faits de violences sexuelles et physiques, à propos desquels Libération lui a transmis plusieurs questions, le comédien est resté vague mais affirme qu’il n’a «jamais violé ni frappé personne». Contactée par Libération, son avocate, Jacqueline Laffont, n’a pas souhaité répondre à nos questions à ce stade. Dans un SMS envoyé mercredi à Libération, Sofiane Bennacer se dit «innocent» avant d’ajouter : «Je défendrai toujours les femmes de ces actes horribles.» (1) Les prénoms ont été modifiés. ----------------------------------------------------- Enquête Libé Sur le tournage des «Amandiers», «on avait l’impression d’être enfermés dans ce secret» Au sein de l’équipe, certains avaient eu vent dès les auditions d’accusations de violences sexuelles visant l’acteur Sofiane Bennacer. Des techniciens et alternants racontent l’omerta sur le plateau. par Cassandre Leray dans Libération publié le 24 novembre 2022 Le temps de quelques minutes, l’omerta vole en éclats. Lundi 5 juillet 2021 au petit matin, Margot (1) découvre des lettres tapissées sur la Maison des arts de Créteil. Pendant la nuit, des militantes féministes ont collé des messages sur les abords du théâtre, occupé par le tournage du film les Amandiers. «Production complice» sur un camion ou «un loup dans la bergerie» dans les escaliers… Sur les façades du bâtiment, d’autres phrases en lettres noires sur papier blanc : «Une plainte en cours ils n’en ont cure.» Puis un message nominatif : «Sofiane Bennacer acteur-violeur.» Les mots ciblent le jeune acteur qui incarne le premier rôle masculin du nouveau long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi, les colleuses ayant appris qu’il est visé par une plainte pour viol déposée en février 2021 par une ex-petite-amie, Romane (1). Margot sait immédiatement à quoi ils font allusion. La technicienne de 26 ans a découvert les accusations à l’égard du comédien quand elle a commencé à travailler sur le tournage, en juin 2021. Discrètement, elle prend une photo des collages avec son smartphone. Très vite, la régie décolle les lettres des décors, mais Margot se sent soulagée : «Le monde extérieur nous voyait d’un coup, alors qu’on avait l’impression d’être enfermés dans ce secret dont il ne fallait pas parler.» Valeria Bruni-Tedeschi réunit l’équipe du film et se lance dans un discours pour défendre son acteur, absent, parlant de «présomption d’innocence». Margot ne l’écoute que d’une oreille. Pour elle, trois mots résument cette scène : «Une honte absolue.» Pendant huit mois, Libération a plongé dans les coulisses du long métrage, interrogeant une trentaine de personnes dont une quinzaine de professionnels sur le tournage. Nombre d’entre eux accusent la production et Valeria Bruni-Tedeschi d’avoir «protégé» Sofiane Bennacer en connaissance de cause. «Une rumeur» Que savaient vraiment les producteurs et la réalisatrice des accusations visant Sofiane Bennacer, avant et pendant le tournage ? Dès les auditions, une comédienne crache le morceau, fin mars 2021. Anna (1) passe le casting des Amandiers. Elle est au courant pour Sofiane Bennacer : elle connaît la plaignante, Romane, dont elle est camarade de promotion à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS). Le jeune comédien était aussi étudiant au TNS avant d’en démissionner en février. Quelques semaines après que Romane a confirmé à la direction du théâtre avoir été violée par Sofiane Bennacer lorsqu’ils étaient en couple, avant leur entrée au TNS. L’établissement précisera d’ailleurs à Libération avoir fait un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code pénal fin mars 2021. Lorsqu’Anna apprend qu’elle devra donner la réplique à Sofiane Bennacer lors de son audition, elle appelle l’assistante de casting pour expliquer pourquoi elle refuse : «J’ai dit qu’il était accusé de violences sexuelles.» Contactés par Libération en mai, Alexandra Henochsberg, d’Ad Vitam Production, et Patrick Sobelman d’Agat Films – les deux sociétés qui produisent les Amandiers –, confirment avoir entendu parler d’une «rumeur concernant une soirée avec son ancienne petite amie du TNS qui aurait mal tourné avec un comportement violent de Sofiane». «Fin mai 2021», décision est prise d’appeler Stanislas Nordey, qui dirige le TNS. Un appel confirmé par le directeur du théâtre qui aurait alors expliqué que le comédien était accusé de «viol». La production dément l’avoir entendu parler de viol. En plus d’avoir omis l’existence de la plainte, le directeur n’aurait pas non plus mentionné le signalement au procureur, assurent les producteurs à Libération : «A ce moment-là, on n’a aucun autre moyen de savoir s’il y a plainte ou pas. C’était lui notre interlocuteur.» Sofiane Bennacer est embauché car, «sur le seul fondement d’une rumeur, rien ne nous empêchait» de l’engager. Le tournage débute le 3 juin 2021. Le long métrage raconte l’histoire de comédiens de 20 ans fraîchement acceptés au sein de l’école des Amandiers, à Nanterre (Hauts-de-Seine), fondée à la fin des années 80 par deux figures du théâtre français : Patrice Chéreau et Pierre Romans. En haut de l’affiche, les acteurs Nadia Tereszkiewicz et Sofiane Bennacer. Le film raconte leur histoire d’amour, inspirée de la relation entre la réalisatrice et le comédien Thierry Ravel, mort d’overdose. «Confiance totale envers son casting» Ce 3 juin, Coline (1), 21 ans, débarque pour son premier jour de travail. Peu de temps avant, elle a appris par des amies que Sofiane Bennacer était accusé d’agression sexuelle. Dès son deuxième jour, l’étudiante à la CinéFabrique – une école de cinéma lyonnaise – décide de s’en ouvrir auprès de ses collègues, dont plusieurs camarades de promotion, eux aussi présents sur le projet. Une première rencontre a lieu entre les cinq alternants de son école et les producteurs. «Ils disaient qu’ils avaient eu vent de rumeurs et qu’ils ne se sentaient pas légitimes à refuser à quelqu’un de travailler à cause de rumeurs», résume Nina (1), en alternance à la technique. Sauf que Coline n’en démord pas. Elle mène sa propre enquête, contacte une amie, étudiante au TNS, retrouve la trace de Romane et découvre qu’elle a déposé plainte pour viol. Deux jours plus tard, Coline déballe tout ce qu’elle sait : il ne s’agit pas d’une simple «rumeur d’agression sexuelle» mais d’une «plainte pour viol». Impensable de maintenir Sofiane Bennacer dans son rôle : les alternants le disent très clairement à la réalisatrice. «On lui a expliqué que ce n’était pas un taf anodin, qu’il y allait avoir une répercussion médiatique et que c’était valider le fait d’engager des mecs accusés de violences sexuelles, relate Elise (1), alternante. Valeria a été très claire : elle nous a dit qu’elle était en accord avec son choix, que, pour elle, il n’y avait aucun problème.» Devant l’ensemble de l’équipe technique et en l’absence de Sofiane Bennacer, comme chaque fois que son cas sera abordé sur le tournage, la réalisatrice assure avoir une «confiance totale envers son casting». «Elle nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements, ajoute Elise. C’était une bonne claque dans la gueule de voir comment les choses se passent dans ce milieu-là.» Coline tente le tout pour le tout. Ne supportant pas l’omerta, elle pense organiser une grève sur le tournage mais se rabat sur une réunion avec les actrices. Une seule osera se présenter. La coupe est pleine. Coline finit par quitter le plateau. Elle lâchera même complètement le cinéma : «Je préfère être au chômage que bosser pour des personnes comme ça.» Louise (1), stagiaire de 22 ans au montage, va suivre la même trajectoire : elle démissionne après un mois, même si elle sait que sa décision signe probablement la fin de sa carrière dans le cinéma. Peur d’être blacklisté Deux démissions puis le silence. Sur le plateau, le sujet Bennacer passe en sourdine. Le tournage se poursuit sans encombre jusqu’au jour des collages féministes. Mais, malgré les accusations qu’il nie en bloc, le «coup de cœur» de Valeria Bruni-Tedeschi, comme on dit autour d’elle, reste en place. La réalisatrice «souhaitait absolument travailler avec lui», raconte Matthieu (1), technicien quadragénaire. Sur le plateau, ne subsistent que des chuchotements entre collègues. Certains «outrés», «mal à l’aise», d’autres détachés, car «on est là pour faire notre travail avant tout», estime Matthieu. Plusieurs jeunes femmes se font la promesse d’éviter l’acteur autant que possible. «Il ne pouvait que le sentir, une bonne partie des jeunes de son âge ne lui parlait jamais», souligne Margot, technicienne. Du début à la fin du tournage, la ligne de Valeria Bruni-Tedeschi ne va jamais varier : la «présomption d’innocence». «Je comprends qu’on ne puisse pas condamner quelqu’un sans décision de justice, commente Hugo (1), régisseur. Mais on n’avait pas à subir le fait de travailler avec lui sans savoir.» D’autant que l’enquête judiciaire est alors en cours, rappelle Nina, alternante à la technique : «S’il avait purgé sa peine, ce serait différent. Mais là, la justice n’a pas été rendue.» «Valeria disait que c’était aussi le sauver lui, lui donner une chance et le propulser dans ce milieu, et qu’elle croyait en son talent», se souvient Noémie (1), de l’équipe caméras. Cette quadragénaire perçoit comme une fracture dans l’équipe : les anciens d’un côté, de l’autre la «nouvelle génération» qui a vu la naissance de #MeToo et est allée demander des comptes. «Avec les techniciens de mon âge, on se disait : “On n’est pas d’accord, mais on est là pour travailler, alors on ferme un peu les yeux.”» La décision de maintenir ou non Sofiane Bennacer sur le film était entre les mains de trois personnes : les producteurs et la réalisatrice. Contacté par Libération, le duo Henochsberg-Sobelman admet s’être retrouvé dans une situation «extrêmement compliquée à gérer», découvrant la plainte pour viol deux jours après le début du tournage, comme tout le monde. La production l’aurait alors convoqué afin de lui demander de prendre un avocat et d’aller «de lui-même se confronter à la justice». Même s’ils l’avaient voulu, argumentent les producteurs, il aurait été impossible de se séparer de l’acteur : «Le droit ne nous permet pas de licencier un employé sur ces allégations, il pourrait légitimement nous attaquer en justice.» «Valeria a embarqué tout le monde dans cette histoire» Valeria Bruni-Tedeschi, que Libération a relancée plusieurs fois afin de fixer une rencontre, n’a pas donné suite à nos demandes à ce jour. Plus d’un an après le tournage, elle a été entendue en octobre comme témoin dans l’enquête judiciaire visant Sofiane Bennacer. Dans un mail adressé au journal en mai dernier, juste avant la projection des Amandiers à Cannes, elle racontait avoir été elle-même «victime de violences dans [s]on enfance». «Je connais la souffrance de ne pas être entendue. Mais je ne crois pas que le combat pour les droits des femmes et des plus démunis doive s’accommoder de la violation de la présomption d’innocence», écrivait-elle. Quid de l’équipe ? Aurait-elle dû quitter le plateau ? Le dilemme est grand entre l’évidente nécessité de «gagner des sous», le «tremplin professionnel» que ce tournage représentait et la peur d’être blacklisté. Claquer la porte, c’était risquer «d’enterrer sa carrière», selon la formule de Romain (1), apprenti technicien qui, à moins de 30 ans, en tire une triste leçon professionnelle : «Si on fait passer l’éthique en premier, je crois que ce n’est pas possible de travailler dans ce milieu.» Aucun doute : s’il part, il sera remplacé en un claquement de doigts. Toutes et tous le savent. Certains ont «honte», regrettent de n’avoir rien dit. «Valeria a embarqué tout le monde dans cette histoire sans mettre les gens au courant, lâche Alicia (1), la trentaine et technicienne. Quand on a découvert les faits, on était déjà engagés.» D’autres racontent aussi l’attachement au film et à sa réalisatrice. L’une des actrices, Lucie (1), la vingtaine, revoit les centaines de candidats évincés au fil des semaines d’auditions. «On a réussi à arracher une place dans ce film qui nous faisait rêver. Partir ou rester, c’est une question de l’ordre du sacrifice, déclare la jeune femme. Je ne vois pas pourquoi des actrices devraient sacrifier leur carrière pour des acteurs accusés de viol.» Pour Agathe (1), qui joue aussi dans les Amandiers, «c’est Sofiane qui n’aurait pas dû faire ce film». Aujourd’hui, Lucie et Agathe, les deux seules actrices à avoir répondu à Libération, ont une peur : que «ce qu’a fait Sofiane nous éclabousse tous». «Pour moi, ce n’est pas du tout normal de l’avoir recruté, s’énerve Agathe. Mais ce n’est pas parce qu’on est restés que nous sommes des complices.» Cassandre Leray, Libération (1) Les prénoms ont été changés.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2022 6:53 PM
|
Propos recueillis par Arnaud Pagès dans Retronews, le 26/09/2022
Selon la chercheuse Véronique Lochert, « il y a toujours eu une interrogation sur la légitimité morale et sociale des femmes à aller au théâtre ». Retour sur une forme de domination oubliée bien qu’évidente depuis le début des spectacles vivants.
Véronique Lochert est normalienne, agrégée de lettres modernes, et maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université de Haute-Alsace. Ses travaux portent sur l'étude du public féminin qui fréquentait les théâtres en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. En collaboration avec les historiennes Marie Bouhaïk-Gironès et Mélanie Traversier, ainsi qu'avec les spécialistes des études portant sur le théâtre Céline Candiard, Fabien Cavaillé et Jeanne-Marie Hostiou, elle vient de publier Spectatrices ! aux éditions du CNRS, une enquête inédite mettant en lumière les traces que les femmes ont laissées à travers l'Histoire dans les salles de spectacle. Propos recueillis par Antoine Pagès – RetroNews : Comment avez-vous travaillé sur le sujet des femmes au théâtre ? Sur quelles sources vous êtes-vous appuyés, puisque vous remontez jusqu'à l'Antiquité ? Véronique Lochert : Pour nous, il s'agissait de rappeler que les femmes ont fait partie intégrante du public qui se rendait aux représentations du spectacle vivant, et ce depuis les origines de ce type de manifestation. Pendant longtemps, cette présence a été négligée, et même oubliée. Il s'agissait donc de la rendre sensible et visible, et d'interroger le rôle que ces femmes ont pu jouer dans le développement de la pratique théâtrale, et dans la forme même que les spectacles ont pris à travers le temps. Pour cette raison, la question des sources a été le point central de cette enquête. Comme l'on peut s'en douter, les traces laissées par ces femmes varient énormément en fonction des époques auxquelles nous nous sommes intéressées. Une des choses qui nous a le plus frappé, c'est que bien qu'il nous semblait plus difficile de trouver des sources antiques ou médiévales documentant les pratiques des spectatrices, les spécialistes des XIXe et XXe siècle nous ont dit qu'ils avaient également eu du mal à mettre la main sur des éléments d'information pour révéler ce que les femmes ont pu ressentir au spectacle ! De ce fait, pour remonter le fil des siècles, il nous a fallu exploiter des archives très variées et prendre en considération tout ce que nous pouvions trouver. Pour l'antiquité, il y avait les sources archéologiques, à savoir les bâtiments et les salles de spectacle qui sont parvenus jusqu'à nous. Cette architecture des théâtres est un repère important tout au long de l'histoire du spectacle vivant pour comprendre le statut des spectatrices : elle nous indique où celles-ci étaient placées, et par extension, comment elles étaient considérées. Ensuite, il y avait toute une série de sources textuelles : l'iconographie, la presse, les écrits, les mémoires, les correspondances... Cette grande variété de documents a compensé la rareté des traces laissées par les spectatrices elles-mêmes. Il nous a fallu multiplier les investigations pour essayer de trouver quelques indices sur ces femmes. Comment expliquer que la présence des spectatrices ait été systématiquement minorée, quelles que soient les époques ? Cet effacement est incontestable. Ce qui a donné l'impulsion à cette étude, c'est justement cela. Les femmes ont été invisibilisées alors qu'elles font partie du public depuis toujours, et qu'à certaines époques, elles ont même été mises en valeur en devenant un élément très sensible de la représentation théâtrale. On se rendait alors au spectacle pour les voir, pour les admirer tandis qu'elles étaient assises aux places les plus en vue. Cependant, dans l'histoire du théâtre, la tendance générale a toujours été de gommer leur présence, comme si elles dérangeaient. Ce que nous avons mis en lumière, c'est qu'il existe un certain nombre de constantes qui se sont dessinées au fil de cette longue histoire. Ainsi, il y a toujours eu une interrogation sur la légitimité morale et sociale des femmes à aller au théâtre, avec en conséquence un certain contrôle, une pression sociale plus ou moins affirmée selon les époques, mais qui visait toujours à encadrer le comportement des spectatrices. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage avait pour but de réparer cet oubli à une époque où l'on parle de plus en plus des lectrices, et où l'on a déjà beaucoup travaillé sur les autrices. Dans quelle mesure cette place des spectatrices a-t-elle évolué au fil des siècles ? Cette enquête porte sur une durée très longue, et aborde, de ce fait, des contextes socio-culturels et géographiques très différents : l'Antiquité grecque et latine, le Moyen Âge, la Renaissance, et ce qui a pu se passer en Italie et en France, mais aussi sur l'île de Madura en Indonésie... Ce qui en ressort, c'est une grande variété de situations. Il est donc très difficile de tenir un discours général sur la position des spectatrices parce que celle-ci est extrêmement variable suivant les époques, les contextes socio-culturels, mais aussi selon la catégorie sociale auquel appartenaient ces femmes. C'est à la Renaissance italienne, par exemple, qu'elles ont été le plus mises en valeur. A la cour, elles étaient placées sur des tribunes, sur des estrades, pour que leurs vêtements, les bijoux qu'elles portaient et qui reflétaient les flammes des chandelles, puissent contribuer à la pompe et au faste du spectacle. Et puis, inversement, à d'autres périodes, elles ont été déplacées dans des zones éloignées de la scène. Il y avait la volonté de les mettre dans des endroits qui reflétaient un statut social inférieur à celui des hommes. Par exemple, dans les théâtres romains de l'Antiquité, elles étaient assises tout en haut des gradins, loin de l'action. J’imagine que l’on voit une concordance entre le statut social de ces femmes et leur placement dans la salle… C'est ce que montre l'étude de l'architecture des théâtres ; la disposition des spectateurs dans la salle est toujours pensée comme un reflet de la société, et traduit ainsi la hiérarchisation des catégories qui la compose. Et à ce titre en effet, le statut social des spectatrices compte souvent davantage que leur appartenance genrée. Ainsi, une princesse ou une reine vont systématiquement occuper la même place que le Roi de France, en étant positionnées au premier rang, alors qu'une femme du peuple se trouvera reléguée au fond de la salle, de facto marginalisée au même titre que les autres personnes de condition identique. Pareillement, le degré de liberté de la spectatrice a connu des variations en fonction de ce même statut social. Les reines avaient le droit de commander des spectacles qui leur étaient spécialement destinés, et de jouer ainsi un rôle de mécènes. Progressivement, au sein de la société de cour, il y eut une mise en valeur de plus en plus importante des femmes, qui se retrouvaient assises aux meilleures places, tandis que l'essor de la bourgeoisie aux XVIIIe et XIXe siècles a coïncidé avec un recul marqué, caractérisé par un contrôle moral plus pesant sur les spectatrices, dont les sorties ont été de plus en plus surveillées. « [La mixité au théâtre] est ce qui a fait le plus peur aux moralistes, dont certains étaient devenus des adversaires acharnés, mettant en garde la société contre la fréquentation de ces lieux. » Justement, dans quelle mesure se rendre au spectacle était-il un facteur d'affranchissement pour ces femmes ? Était-ce un moyen de faire « comme les hommes » ? C'était le cas, effectivement. Le fait même d'aller au théâtre constituait une forme d'émancipation. C'était une libération qui permettait de desserrer l'étau d'une condition genrée particulièrement contraignante, surtout à des époques où les allées et venues des femmes honnêtes avaient commencé à faire l'objet d'une grande attention et d'un contrôle de plus en plus strict de la part des hommes. Au XVIIe siècle, une femme de bien, pour qui être considérée comme moralement irréprochable était quelque chose d'essentiel, ne pouvait pas aller au théâtre si elle n'était pas accompagnée par son mari ou un membre de sa famille. C'était impossible. De ce fait, la sortie au spectacle était particulièrement importante pour elles, dans la mesure où cela leur permettait de s'échapper de l'espace domestique. Ces sorties leur donnaient accès à un espace public où elles avaient la possibilité de faire des rencontres. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait le plus peur aux moralistes, dont certains étaient devenus des adversaires acharnés du théâtre, mettant en garde la société contre la fréquentation de ces lieux. Pour autant, est-ce que les raisons qui poussaient ces femmes à devenir des spectatrices ont connu des variations au fil des siècles ? Oui, bien sûr. Les motivations pour aller au spectacle ont toujours été multiples. Au XVIIe, c'était d'abord et avant tout une occasion sociale. Pour les femmes importantes, de même que celles qui étaient de condition aisée, c'était le moyen d'être vue, de rencontrer ses amies, de frayer avec la bonne société, de faire remarquer sa toilette. Dans la plupart des cas, cet aspect social était le déclencheur de la sortie au théâtre. Au contraire, pour d'autres femmes, c'était davantage ce qui se passait sur scène, cette expérience de fiction qui se déroulait sous leurs yeux, qui allait principalement les intéresser. A partir des XVIIIe et XIXe siècles, des correspondances, puis des critiques écrites par des femmes montrent le net développement d'une importante activité de réception et de jugement des pièces par les spectatrices. En fait, en tant qu'objet esthétique, le théâtre était – et est encore – au centre d'une multiplicité de motivations qui passent par le divertissement social, la sortie entre amis, mais aussi tout simplement le plaisir de voir les comédiennes et les comédiens en train de jouer. A ce titre, les actrices de théâtre ont pu être considérées comme les modèles ou les contre-modèles féminins de leur temps. Par ailleurs, les spectatrices pouvaient aussi prendre plaisir à contempler les acteurs et à les désirer. « En France, au XVIIe siècle, quand une polémique a fait son apparition autour du théâtre par les moralistes et les religieux, c'était la question des rencontres possibles entre hommes et femmes qui était montrée du doigt. » Précisément, de la part des hommes, dans quelle mesure les spectatrices sont-elles également envisagées comme des objets de désir, les lieux du spectacle étant, depuis toujours, des endroits propices aux rencontres amoureuses ? C'est, en effet, un invariant que l'on retrouve de tout temps à travers l'histoire du théâtre. Déjà dans l'Antiquité, Ovide dispensait des conseils avisés aux jeunes gens pour aller faire la cour aux femmes présentes dans le public. En France, au XVIIe siècle, quand une polémique a fait son apparition autour du théâtre par les moralistes et les religieux, c'était la question des rencontres possibles entre hommes et femmes qui était essentiellement montrée du doigt. De ce fait, s'intéresser aux spectatrices permet aussi de mettre en valeur cette dimension sensuelle et érotique de la fréquentation des théâtres car ces lieux permettaient aux hommes et aux femmes de faire connaissance en dehors de leurs demeures, bénéficiant ainsi d'une plus grande liberté. Il faut aussi rappeler que dans les théâtres, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la salle était plus éclairée que la scène. Les spectateurs et spectatrices pouvaient ainsi s'observer à loisir. Il y avait tout un jeu de regards, avec des petits signes qui étaient échangés, des hochements de tête, des clins d'œil. Les femmes ont-elles influencé les auteurs dans l'écriture de leurs pièces comme dans la façon de mettre en scène ? A partir du moment où le public était devenu en bonne partie féminin, et que le théâtre était un divertissement commercial, il est évident que les dramaturges ont été amenés à chercher à plaire également aux femmes. Il faut se rappeler qu'ils recherchaient, tout comme aujourd'hui, la reconnaissance et le succès. A un moment donné, il fallait donc convaincre les deux sexes, et pas seulement les hommes, de venir au spectacle et de payer une place. De ce fait, la question du goût des dames est progressivement devenue saillante. Ce qui est certain, c'est que du XVIe au XVIIIe siècle, de plus en plus de personnages féminins et d'héroïnes ayant un rôle important à leur actif ont été mises en scène. Il y a clairement une montée en puissance qui est observable, et qui traduit, en creux, le souhait de mieux considérer le public féminin. Par ailleurs, dans le discours critique, chez les théoriciens, un débat a pris forme sur la nécessité de prendre en compte la sensibilité des femmes dans la création des œuvres. Néanmoins, ce principe a souvent été dénigré, ou associé à des genres méprisés. Le théâtre noble, celui qui méritait un réel intérêt, était celui pensé pour les hommes. En quoi le traitement réservé aux spectatrices est-il le révélateur des relations qui ont pu exister entre hommes et femmes au fil du temps ? Ce qui nous a paru intéressant lorsque nous nous sommes emparés de ce sujet, c'était de mettre en avant les échanges qui ont pu exister entre les spectatrices et le spectacle vivant. Cette étude permet d'ouvrir toute une série de questionnements qui décentrent et enrichissent notre regard sur les représentations théâtrales. Inversement, le spectacle vivant apparaît aussi comme un outil pour réfléchir à la façon dont les relations entre hommes et femmes ont pu se transformer au fil du temps, en prenant en compte la manière dont la société assigne des stéréotypes aux individus en fonction de leurs sexes. Tout au long de son histoire, le théâtre a indéniablement contribué à forger ces rôles, et même à les attribuer en participant notamment au contrôle social du public féminin, mais en même temps, il les a également en partie déconstruit à travers les scénarios fictifs qui étaient représentés sur scène, invitant ainsi les spectateurs et les spectatrices à mieux réfléchir sur eux-mêmes et sur leurs relations avec l'autre sexe. – Véronique Lochert est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université de Haute-Alsace. Spectatrices ! vient de paraître aux éditions du CNRS. Légende de l'illustration : Spectatrices d'une scène de théâtre, dessin de Maurice Lourdey, circa 1900 - source : Gallica-BnF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 24, 2022 9:09 AM
|
Propos recueillis par Thierry Cheze dans Première - 20 nov. 2022 Avec Les Amandiers, la cinéaste replonge dans cette école dirigée par Patrice Chéreau qui l’a formée au métier d’actrice. L’occasion idéale d’échanger sur son processus de création, devant comme derrière la caméra, et la manière dont on se libère ou non d’un tel mentor. Cet entretien est paru à l'origine dans le numéro 534 de Première, toujours disponible en kiosque et sur notre boutique en ligne. PREMIÈRE : À la fin de l’été, une courte séquence extraite du documentaire Il était une fois 19 acteurs, que François Manceaux a consacré à l’école des Amandiers, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vous êtes jeune et quand on vous demande ce que vous attendez d’un metteur en scène, vous répondez « qu’il m’aime et qu’il me casse ». Vous diriez la même chose aujourd’hui ?
VALERIA BRUNI TEDESCHI : « Qu’il me casse », je ne le dirais plus. La vie est passée depuis et je n’ai vraiment pas besoin de ça ! Quant à « qu’il m’aime », je dirais plus « qu’il m’accueille ». C’est en tout cas ce que j’essaie de faire avec mes acteurs. Et c’est un grand bonheur pour moi. Car je le fais peu dans la « vraie » vie. Je suis trop peu attentive aux autres, trop autocentrée. Mais lorsque je mets en scène, je me transforme en grand sage. J’ai la sensation d’être dans une position d’adulte alors qu’en tant qu’actrice, je me sens plus enfant ou adolescente ; quelqu’un qui a envie de se faire aimer alors que l’adulte aime. Je préfère cette place de protectrice. Au fond, pour moi, c’est plus gai d’être adulte que d’être enfant.
Quand vous jouez dans vos propres films, vous devenez schizophrène ?
Cette question, je me la suis posée avant mon premier film, Il est plus facile pour un chameau. Et je suis allée demander conseil à Patrice Chéreau pour savoir comment combiner les deux. Il m’a dit une chose qui m’accompagne depuis : « Surtout, ne te dé- double pas. C’est la même personne qui joue et qui réalise. Unis-toi. » Exactement le contraire de ce que j’aurais fait spontanément! Depuis, il n’y a jamais de frontière entre le personnage que je joue et la réalisatrice qui dirige les autres. Cette possibilité d’effacement des frontières entre la vie et le travail est sans doute la chose la plus précieuse que nous a enseignée l’école des Amandiers. Pour rendre le travail très vrai et pas uniquement technique. Pour mêler ses propres émotions et celles de son personnage. LES AMANDIERS : VALERIA BRUNI-TEDESCHI REVISITE BRILLAMMENT SES ANNÉES CHÉREAU [CRITIQUE] On sait que ce mélange peut se révéler dangereux. Vous n’avez jamais eu peur de vous y perdre ?
Bien sûr qu’on peut s’y perdre. Et j’ai conscience que l’école des Amandiers ne nous a pas vraiment donné les armes pour gérer tout ça, pour nous aider à nous retrouver une fois la pièce ou le tournage terminés. Mais on nous a offert autre chose : l’envie et les instruments pour nous perdre, afin de faire cadeau de ce déséquilibre, de cette fragilité, à nos personnages. Comment se débrouille-t-on pour retomber sur ses pieds ?
Pour ma part – et c’est pour cela que j’ai tenu dans Les Amandiers à évoquer Lee Strasberg à travers un voyage à New York – c’est en travaillant, après l’école des Amandiers, avec des grands coachs américains de la Méthode comme Susan Batson. C’est auprès d’eux que j’ai trouvé des instruments pour ne plus me mettre en danger, sauf sur scène. J’y ai appris – et compris – qu’il ne faut jamais abîmer l’instrument qu’est son corps. La Méthode m’a ouvert des horizons, mais uniquement comme complément à cette expérience de vie et de travail que j’avais connue avec Chéreau. Vous n’avez jamais eu le sentiment d’être écrasée par la figure de Chéreau ? Une fois que vous étiez sortie de l’école, n’a-t-il pas pris à certains moments plus de place que vous ne le souhaitiez ? Pendant l’école, j’étais vraiment l’élève qui essayait de faire au mieux. Et c’est vrai que, par la suite, j’ai eu du mal à me défaire de ce rapport-là. Le fait que je n’ai jamais encore osé mettre en scène du théâtre vient sans doute du fait que je suis, sur ce terrain-là, encore écrasée par lui. Mais un tournant a eu lieu sur le tournage de Ceux qui m’aiment prendront le train où je le vouvoyais encore. Un jour, il m’a prise à part pour me dire : « Tu n’es plus mon élève. » Cette phrase m’a autorisée à changer mon rapport à Chéreau. Il m’a fait là un cadeau énorme car il au- rait pu rester dans la position confortable du mentor qui vous guide, certes, mais vous écrase aussi de sa puissance. On a pu entendre récemment un autre son de cloche chez Agnès Jaoui, élève des Amandiers elle aussi, qui expliquait avoir eu affaire à un gourou, à quelqu’un qui avait besoin de diviser pour mieux régner. C’est quelque chose que vous pouvez entendre ? Évidemment. Chacun a sa perception de ces années où tout était sans cesse en mouvement. Où, selon les jours, on était plus ou moins aimé et du coup on aimait plus ou moins Patrice comme Pierre [Romans, metteur en scène qui enseignait aussi aux Amandiers], qui était tout aussi important que lui. Tout cela créait de la tension, du malaise, de l’inconfort... Mais toujours dans certaines limites. Lesquelles ? Chéreau ne nous malmenait pas. Il pouvait rentrer dans de grandes colères quand on ne se mettait pas assez en danger à ses yeux. Mais ce n’était ni un sadique ni un pervers. Y compris dans sa façon de draguer : il n’y a jamais eu de chantage au rôle par exemple. Il pouvait tomber très amoureux d’un homme hétérosexuel en sachant qu’il ne se passerait jamais rien, sans que cela ne change rien aux rôles qu’il lui proposait. Et j’espère vraiment qu’on le ressent dans mon film. Quand on plonge dans ses souvenirs, comment faire pour éviter justement d’enjoliver les choses, de taire les moments moins glorieux ? C’est très simple pour moi, car quand je fais des films, j’ai envie de parler des douleurs. Je galère bien plus à trouver les moments de bonheur ! (Rires.) Y compris dans votre manière de raconter un homme qui a tant compté pour vous. Ça n’affecte pas votre création en vous censurant, consciemment ou non ?
Je vais être honnête. Oui, ça a été difficile pour moi de critiquer le personnage de Chéreau. Dans la première version du scénario, il était très bien élevé, très sérieux. Sauf que Chéreau lui-même aurait dé- testé qu’on accole son nom à un personnage lisse car il les haïssait. Ce qu’il aimait dans l’être humain, c’était son côté obscur. Je me suis donc sentie obligée pour lui rendre hommage... de ne pas lui rendre hommage! C’est étrange car je le sens très présent depuis sa disparition. Récemment, Marthe Keller m’a dit une phrase que je trouve extrêmement juste : « Patrice est le plus vivant de tous nos morts. » Pour- tant, j’ai perdu énormément d’êtres chers. Mon frère est mort, mon père est mort... Mais Patrice, c’est autre chose. Il fait partie des fantômes qui peuplent le film, avec ceux de Pierre Romans, de Luc Bondy, de Bernard-Marie Koltès, de Michel Piccoli et de tous les élèves qui ne sont plus là. La drogue et le sida ont fait des ravages durant ces années. On avait conscience de côtoyer la mort au quotidien. J’ai tenu à le raconter dans Les Amandiers. Montrer qu’on avait à la fois l’inconscience de la jeunesse et la conscience de cette tragédie qui fauchait nos proches. Créer pour vous passe par l’évocation ou la reconstitution de moments que vous avez traversés, y compris tragiques. Je pense à la scène de l’enterrement du personnage inspiré par le comédien Thierry Ravel, qui était votre compagnon à l’époque. Comment vivez-vous ce type de moment ? Comme une souffrance ? Une catharsis ?
Écrire crée chez moi un filtre, un antidote à la nostalgie, alors que je suis très mélancolique et nostalgique dans la vie. L’autre antidote, dans le cas des Amandiers, ce sont les jeunes comédiens que j’ai réunis. Soudain, il ne s’agit plus des gens d’il y a trente ans mais d’eux. Donc quand je suis au cimetière, les images du passé ne me reviennent pas, je suis totalement dans le présent des scènes. Je me vis vraiment comme un artisan qui essaie de faire le plus beau des meubles. Et je fais volontiers miens les mots de Woody Allen : « Le travail est un subterfuge à l’angoisse. » Et un endroit où vous semblez aussi beaucoup vous amuser. Dans Des Amandiers aux Amandiers, le documentaire que Karine Silla Perez et Stéphane Milon ont consacré à l’aventure de votre film, on vous voit ainsi jouer toutes les scènes devant vos comédiens. Cela fait toujours partie de votre processus de création ? Non, ce n’est pas systématique. Si je l’ai fait autant sur le plateau des Amandiers, c’est sans doute parce que je ne joue pas moi-même et que je dirige de jeunes comédiens. C’est ma façon de les prendre par la main. En leur parlant pendant les scènes, c’est comme si je me glissais à l’intérieur d’eux. Mais je ne fonctionne pas de la même manière avec tous. Je chuchotais beaucoup plus dans les oreilles de Nadia [Tereszkiewicz] que dans celles de Sofiane [Bennacer] avec qui j’ai vite senti que je ne devais pas être trop intrusive. Que ça n’allait ni l’aider ni lui faire du bien. Certains sur le plateau m’ont d’ailleurs demandé pourquoi j’avais l’air de moins le diriger que les autres. Mais je ne le dirigeais pas moins, je le dirigeais autre- ment. En l’accueillant les bras grands ou- verts. Alors que Nadia, il fallait l’accueillir mais aussi la bousculer. Vous exprimez d’ailleurs dans le même documentaire le besoin et le plaisir de malmener vos comédiens... Malmener mais pas maltraiter ! Et là encore, pas tout le monde et pas de la même manière pour tous. Parfois, c’est même l’inverse d’ailleurs. Louis [Garrel, qui interprète Patrice Chéreau] par exemple, j’ai compris que je devais le laisser me malmener. Que c’était son plaisir et ma façon de le diriger. Je l’ai laissé se moquer de moi devant tout le monde. Car ainsi, il me donnait des choses plus précieuses que ce qu’on avait écrit. Vous avez déjà été malmenée en tant qu’actrice ?
Non, jamais. Une fois, j’ai pu me sentir mal aimée. J’en ai d’ailleurs tiré un film en 2007, Actrices. Comment pensez-vous que vous réagiriez si c’était le cas ?
Je pense que je n’aimerais pas... (Silence.) Quoique je sois sans doute assez maso pour en avoir envie et finir par aimer ça ! (Rires.) Mais alors, il faut que ce soit avec un génie. J’aurais bien voulu être dirigée par Pialat. Et je veux bien tourner avec Kechiche qui a la réputation d’être dur. Une chose est sûre : je ne pourrais me mettre en souffrance que dans un imaginaire qui m’inspire. Les Amandiers. De Valeria Bruni-Tedeschi. Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel... Durée 2h06. Sortie le 16 novembre 2022

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 23, 2022 7:02 PM
|
Par Sébastien Broquet et Nadja Pobel
Publié dans Le Petit Bulletin - Lyon Mercredi 23 novembre 2022 Mercato / Six candidatures, dont deux duos, ont été retenues pour succéder à Dominique Delorme, l'emblématique directeur des Nuits de Fourvière, qui prend sa retraite après vingt années à la tête du festival. Les dossiers des six finalistes (dont deux duos) ont été déposés ce lundi et le choix final de celle ou celui qui succédera à Dominique Delorme à la tête du festival Nuits de Fourvière devrait être connu fin décembre ou début janvier. à lire aussi : Nuits de Fourvière : Dominique Delorme sur le départ Deux des noms (Paul Rondin et Marc Cardonnel) étaient déjà connus, car dévoilés fin septembre par Lyon People. Voici les six candidates et candidats retenus. - Paul Rondin, l'ancien numéro 2 du Festival d'Avignon — derrière Olivier Py —, jusqu'à cette année (il en était directeur délégué depuis 2013), qui a par ailleurs travaillé avec les artistes Balazs Gera et François Lazaro et a été secrétaire général de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
-
- Marc Cardonnel, patron de Rain Dog Production (qui produit les spectacles d'Alexandre Astier) et actuel conseiller artistique aux musiques actuelles de l'Auditorium et conseiller musical à la Philharmonie de Paris. Il a par ailleurs été secrétaire général et conseiller artistique des Nuits de Fourvière de 2003 à 2012.
-
- Jérôme Laupies, co-directeur du producteur de concerts de musiques actuelles Mediatone et co-gérant du bar Le Melville à Lyon.
-
- Géraldine Mercier, actuellement directrice des études et de la production à l’ENSATT, ancienne secrétaire générale au festival des Nuits de Fourvière de 2009 à 2019, et toujours conseillère artistique "théâtre et cirque" de ce même festival à l'heure actuelle, depuis 2009.
-
- Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, lui est actuellement responsable des musiques actuelles et de projets pluridisciplinaires à la Philharmonie de Paris et ancien programmateur du Festival Days Off (toujours à Paris), elle est actuellement secrétaire générale de l'Auditorium de Lyon et ancienne déléguée de production de la salle Pleyel à Paris.
-
- Le couple libanais Mia Habis (danseuse professionnelle) et Omar Rajeh (chorégraphe), déjà finalistes malheureux pour la direction de la Maison de la Danse.
Le jury auditionnera les candidates et candidats les 19 et 20 décembre prochain avant de révéler le nom du futur directeur ou directrice. Par Sébastien Broquet & Nadja Pobel

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 23, 2022 10:13 AM
|
Le Théâtre National de Nice porte un projet fort et si de récentes polémiques cherchent à le déstabiliser, elles semblent ne connaître ni son fonctionnement, ni sa programmation.
Aujourd’hui nous possédons - en place de la salle Michel Simon - la sublime salle des Franciscains, située au centre du Vieux Nice, avec une capacité d’accueil supérieure.
En remplacement de la salle Pierre Brasseur, nous aurons dans quelques années une grande salle plus moderne, au Palais des expositions, salle modulable et adaptée au théâtre contemporain, sur un modèle inspiré de la Schaubühne.
En attendant la construction de ce projet, nous avons depuis la saison dernière déjà La Cuisine - équipement qui n’a rien à voir avec un chapiteau en toile – qui nous accueille certes provisoirement, mais que la ville gardera car ce beau plateau équipé de 600 places remplit parfaitement son rôle.
Située juste en face de l’arrêt du tramway, La Cuisine nous permet, à l’ouest de Nice, grâce à une programmation toujours aussi ambitieuse, de convaincre un nouveau public et d’asseoir notre mission de service public.
À terme, nous aurons donc une “grande salle” au PEX et une “grande petite salle” aux Franciscains.
Aujourd’hui la ville nous offre en plus le plateau des Arènes de Cimiez, afin de poursuivre en période estivale notre aventure hors les murs, qui depuis 3 saisons remporte un grand succès. Ce plateau historique nous permettra de proposer au public le grand répertoire classique de juin à septembre. Le TNN disposera alors de trois plateaux - contre deux précédemment - et de styles très différents.
Nous avions envisagé le projet Iconic pour garder dans ce temps d’attente du PEX une visibilité la plus large possible ; il se révèle aujourd’hui qu’il est à la fois plus coûteux, et moins complémentaire aux deux salles existantes, et les Arènes de Cimiez rempliront mieux ce rôle de troisième scène.
La programmation initiale sera respectée, les spectacles prévus à Iconic étant reprogrammés dans les salles du TNN.
Le TNN et l’ensemble de son équipe ont toujours eu à cœur de s’assurer que ses missions de service public soient pleinement remplies, au travers d’une programmation riche en offre de spectacles accueillis tout comme en créations. Nous l’avons fait sur 2 scènes en 20/21, sur 7 scènes en 21/22, sur 3 scènes en 22/23 et nous continuerons à le faire.
Défendre aujourd’hui une entreprise théâtrale est si complexe que je regrette infiniment des polémiques destructrices, sans argumentaire précis, sans curiosité et sans dialogue.
Muriel Mayette-Holtz
Directrice
L'article paru dans actu Nice le 22 novembre : Nice. "Fiasco", pétitions, gouvernement alerté : le Théâtre national ira-t-il à Cimiez ? Légende photo : Après l’annonce surprise de l’installation du Théâtre National de Nice aux arènes de Cimiez en 2023, au lieu d’Iconic, faite ce lundi par Christian Estrosi, les voix s’élèvent dans l’opposition et parmi les habitants du quartier. (©CBL / Actu Nice)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2022 10:16 AM
|
Par Camille Curnier dans Toutelaculture.com - 21 nov. 2022 Le rideau se lève pour le Théâtre National de Nice ainsi que l’Acropolis. Malgré les vives oppositions suscitées suite aux annonces des projets d’urbanisation de la ville, la destruction des deux géants de la coulée verte sera programmée début 2023. Quel avenir peut-on alors voir pour la place de la culture à Nice ? Un dossier malaisant pour la politique culturelle de Nice 21 novembre 2022 : le Théâtre National de Nice est gardé par un mur de barrières et d’échafaudages grisâtres laissant apercevoir le squelette du bâtiment et les premiers gravats sur le sol. Signé en ce début d’année, le permis de démolition du TNN rentre dans le cadre du grand projet d’extension de la promenade du Paillon présenté lors de la campagne municipale de Christian Estrosi. Un projet qui dévoilait un aménagement paysager d’envergure de plus d’un kilomètre et qui devrait être composé d’une véritable « forêt urbaine ». À l’heure où la ville de Nice se porte candidate au titre de capitale européenne de la culture pour 2028, Estrosi indique que ce projet doit être vu comme un processus de reconquête et de « redécouverte des racines architecturales urbaines et paysagères qui font que Nice est digne de rentrer au patrimoine de l’Unesco ». Nice est une métropole dynamique et représente une des villes les plus attractives de France. Le projet d’Estrosi est présenté à partir de ce même constat. Il vise à rendre Nice plus attractive et durable notamment d’un point de vue économique. Le relais sera pris par le palais des arts et de la culture qui verra le jour en 2025 avec un auditorium de plus de 1000 places. En attendant, une petite dizaine de lieux recevront le public sur les spectacles initialement prévus au Théâtre National de Nice. Parmi eux, on retrouve notamment les Francis-Gag et Lino-Ventura ou encore le Forum Nice-Nord. L’occasion de se réinventer pour certain·e·s et la destruction d’une stratégie et politique pour d’autres. Les avis divergent autour de ce projet, mais il arrive tout de même à concentrer de vives oppositions depuis son annonce en 2020. Les structures culturelles importantes comme le TNN remplissent une mission d’intérêt général considérable en facilitant l’accessibilité à tous et toutes à la culture. L’éclatement du Théâtre en divers sites ne facilite pas l’accès à cette culture et vient au contraire la rendre moins abordable et plus opaque. Pour la ministre de la Culture « le bâtiment ne répond plus aux attentes du public » et il est préférable de rechercher une pérennité et non pas la facilité en gardant ces structures. Pour Patrick Allemand, président de la pétition « Nice au cœur » lancée en 2021 contre le projet, « le TNN tel qu’il est conçu aujourd’hui répond parfaitement à la demande des Niçois ». Construits en 1989, le Théâtre National de Nice et l’Acropolis ne sont pas obsolètes pour autant. Le projet « écoresponsable » d’une droite à contre-courant La destruction du TNN est également justifiée par des arguments écologiques en vantant un gain de carbone de 1740 tonnes de CO2 annuel possible grâce à la plantation de plus de 1500 arbres qui capteraient jusqu’à 50 tonnes de CO2 par an. Avec la destruction, 13000 tonnes de déchets seront également revalorisées. Selon les objectifs fixés par la mairie, 90 % des matériaux seront réemployés dans les bâtiments publics. Pour Estrosi, ce nouvel espace permet de remplacer ce qu’il considère comme « deux usines à béton » en lieu d’oxygénation. On peut alors se demander si la destruction totale de ces deux bâtiments à l’heure où la configuration des lieux culturels suit la tendance des tiers-lieux. Par nature, les tiers-lieux incarnent une volonté de dynamismes nouveaux à travers la réhabilitation de lieux et la cohabitation d’espaces où le travail se mélange à d’autres aspects de la vie. Un projet de réhabilitation et de rénovation avait été proposé par le groupe Nice écologique permettant au Théâtre National de Nice et à l’Acropolis d’être remis au centre de la Coulée Verte sans pour autant tout avoir à reconstruire. Le projet proposait notamment une végétalisation des lieux, une requalification de l’Acropolis et la mise en place d’une ferme solaire. Pour Fabrice Decoupigny, maître de conférences à l’Université de Nice, la reconstruction n’est pas moins chère qu’une réhabilitation, hormis dans le cadre d’un bâtiment historique comme la Cathédrale de Notre-Dame. Les destructions et les reconstructions engagées auraient un coût total de 45000 tonnes de CO2. Il faudrait 200 ans pour que la « simili forêt urbaine » ait un bilan carbone positif selon lui. Martine Bayard, fille de l’architecte du TNN, a récemment déposé un recours pour violation au droit moral à l’égard de l’œuvre de son père, mais celui-ci a été refusé par le tribunal judiciaire de Marseille, jugeant la destruction du bâtiment proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne répondant pas « à un motif légitime d’intérêt général ». Le maire de Nice félicite cette décision du tribunal, qui a ses yeux, donne une fois de plus « raison à la ville de Nice face à ceux qui veulent tout faire pour [l]’empêcher de créer cette forêt urbaine en centre-ville ». Visuel : © Fred Romero

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 2:05 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 17 nov. 2022 Dirigée par un metteur en scène de Glasgow, Andy Arnold, patron du Tron Theatre, la merveilleuse comédienne et âme de l’IVT, International Visual Theatre, met ses pas dans ceux d’Arletty face à un Baptiste incarné par Ramesh Meyyappan. On pense aux Enfants du Paradis, mais c’est plus compliqué, La Performance ! C’est tout le cinéma du réalisme poétique français des années 30-45 qui a inspiré Andy Arnold, artiste d’Ecosse qui dirige à Glasgow le Tron Theatre, lieu très connu, souvent du côté de l’avant-garde. C’est là qu’a été créé le spectacle que l’on peut découvrir actuellement à l’IVT, aujourd’hui devenu un centre de ressources sur la langue des signes française (LSF) et dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David. Dans un décor de coulisses de théâtre, avec, en fond, une toile peinte d’évocation urbaine en noir et blanc, et, devant les deux tables de maquillage des personnages, on suit, en une heure vite envolée, les faits et gestes des deux interprètes, Emmanuelle Laborit et Ramesh Meyyapan, comédien sourd, originaire de Singapour, et très connu partout à travers le monde, en particulier avec un solo qu’il a composé, Off Kilter. Ils sont accompagnés d’un pianiste spirituel, Ross Whyte, qui participe à l’action et apporte son esprit souriant, son énergie à la représentation. Pas ou quasiment pas de langue des signes dans la représentation. On est du côté des mimodrames. Cela fait d’autant plus penser aux Enfants du Paradis. On les voit s’échauffer, revêtir leurs costumes de scène, jouer. Se chamailler. Se réconcilier. On ne s’étendra pas plus sur les trouvailles joyeuses de ce moment délicat et heureux. Ramesh Meyyappan est très expressif, il impose sa présence virile et sa délicatesse. Elle, Emmanuelle Laborit, on l’admire depuis tant d’années, que l’on sait que l’on va être ravi par sa force, son engagement, son esprit insolent, espiègle. Et sa gravité. Elle est toujours aussi belle et dans son costume rouge, cette robe signée Victoria Brown (qui a imaginé tous les costumes), elle est encore plus séduisante. Les lumières de Benny Goodman, la scénographie de Jenny Booth, la composition du pianiste Ross Whyte, tout enchante. C’est doux, tendre, mélancolique, souvent très drôle, parfois heurté car le personnage d’Emmanuelle Laborit adore se mettre en colère, et cela lui va bien, c’est à découvrir pour le plaisir ! Et les enfants, dès l’âge de dix ans, sont les bienvenus. Armelle Héliot « La Performance » .Jusqu’au 20 novembre. International Visual Theatre, 7, Cité Chaptal, 75009 Paris. www.itv.fr Contact : contact@ivt.fr Tél : 01 53 16 18 18. Légende photo : Le charme, la grâce. PHOTO DE Mihaela Bodlovic

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 11:38 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 20 nov. 2022 En une heure dense et dansante, le comédien Fitzgerald Berthon nous plonge dans une évocation profonde du destin de celui qui fut condamné à mort pour avoir tué un gardien de la paix et découvrit Dieu, le Christ et la Vierge Marie en prison. Il y a quelque chose d’impardonnable dans le comportement de Jacques Fesch, fils de famille indolent qui préféra fréquenter Saint-Germain-des-Prés plutôt que d’aller jusqu’au bac. Il y a quelque chose d’impardonnable et d’ailleurs la société de son temps ne lui pardonna rien puisqu’il fut condamné à mort, au temps de la guillotine, pour avoir, après une tentative de vol à main armée, abattu un policier, le 25 février 1954, dans le quartier de la Bourse, à Paris. Jacques Fesch trouva la foi en prison. Il eut des guides. A commencer par son avocat, homme qui avait dû renoncer à sa vérité de conscience et de désir, et qui savait ce qu’était la souffrance. Jacques Fesch affronta la vérité de son caractère et de sa fatale sortie de route, dans l’enfermement particulièrement cruel des prisons de son temps. Ce blouson doré solitaire, qui trouva tout de même un ami pour l’accompagner dans sa tentative de braquage -ce dernier tenta au dernier moment de trouver des aides pour convaincre la tête brûlée de renoncer à son projet- est devenu, au fil du temps, un modèle, un homme de foi qui éclaire l’Eglise à tel point que son procès en béatification a été ouvert. Ne racontons pas ici toute la vie de Jacques Fesch : le spectacle a ceci de puissant qu’il est assez clair pour que les personnes qui ne connaîtraient rien de cette vie, en saisissent assez. Pour ce moment intitulé Dans 5 heures, plus simple serait difficile : une table, une chaise, au sol un rectangle délimité par un trait blanc, des lumières, des voix off, du son, de la musique. On est à fleur de plateau dans le petit espace du Théâtre La Flèche, rue de Charonne, au fond d’une cour très séduisante. Le public, nombreux, semble acquis à la cause et du « héros » et du spectacle. Mais l’on n’est ni au catéchisme, ni dans une entreprise d’animation culturelle. Il s’agit bien de théâtre et de théâtre puissant. Lumières et son, signés Vincent Hoppe, voix off d’Eric Devillers et de Maxime d’Aboville, regard pour la danse, Jann Gallois, regard pour le théâtre, collaboration artistique, Vincent Joncquez. Toute une équipe pour que Fitzgerald Berthon puisse incarner, de toutes ses fibres et avec audace, rigueur, sincérité, ce parcours bouleversant. Il y a donc de la danse dans cette évocation. Une danse très expressive, une danse de combat en même temps. Et puis le récit, les pensées. C’est en puisant dans les écrits de prison de Jacques Fesch que Fitzgerald Berthon a mis au point le texte. Voix bien placée, regard proche puisque la salle est petite, se déplaçant, d’abord dans les limites du rectangle tracé au sol, puis suivant l’extérieur, comme s’il retrouvait la liberté avec la foi, il impose, par-delà sa personnalité athlétique, l’homme Fesch, mais d’abord ses questions, ses errements, sa découverte d’un sens à la vie, au destin. Un moment bref, d’une heure à peine, mais fort et d’une haute qualité d’intelligence et de sensibilité. Jacques Fesch était né le 6 avril 1930, à Saint-Germain-en-Laye. Il mourut le 25 février 1954. « Dans 5 heures », « Conversion d’un condamné », d’après les écrits de prison de Jacques Fesch, par Fitzgerald Berthon. Jusqu’en février. Les samedis à 19h00. Durée : 1h00. A La Flêche Théâtre, 77 rue de Charonne, 75011 Paris. Tél : 01 40 09 70 40. Les écrits de Jacques Fesch sont disponibles à l’issue des représentations. Armelle Héliot Légende photo : Dans la solitude de la cellule, un homme va être transfiguré. La Flèche. Photographie de Christophe Raynaud de Lage. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 4:57 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 20 nov. 2022 « Une autre histoire du théâtre », joli titre, joliment ambitieux proposé par Fanny de Chaillé à quatre jeunes acteurs de son précédent « Chœur ». Trop ambitieux peut-être pour ne pas accoucher d’un spectacle plaisant sans plus. Telle Pénélope, Fanny de Chaillé détricote son travail précédent pour en entamer un autre, tout autrement. Elle ne thésaurise pas. C e qui demeure, de spectacle en spectacle, c’est le questionnement premier : qu’est qu’un spectacle ? Qu’est-ce que jouer ? Qu’est ce que lire ? Tout texte n’en cache-t-il pas un autre ? Etc. Elle aime prendre les choses par l’autre bout de la lorgnette et, qui plus est, sans lorgnette. Bref, elle décape le paysage attendu, les idées toutes faites, le prêt-à-porter des valeurs en cours. Elle démonte les modes. Dans un manteau elle aime la doublure, les points de couture. Or donc, avec deux jeunes actrices et deux jeunes acteurs de son précédent spectacle Chœur (lire ici), soit Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz, elle dit avoir eu envie de les interroger sur leur expérience : « Pourquoi faire ce choix de devenir acteur aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela met en jeu chez vous ? En quoi cela vous relie au monde dans lequel vous vivez? « Passionnantes questions que le spectacle repousse souvent en coulisses, pour essayer vaille que vaille de répondre au titre ambitieux: Une autre histoire du théâtre. Ça veut dire quoi « autre « ? Autre, les cours de Louis Jouvet au Conservatoire illustrés par un extrait dit par les quatre de Elvire-Jouvet, spectacle de Brigitte Jacques avec l’immense acteur qu’était Philippe Clévenot et Maria de Medeiros alors presque débutante, spectacle merveilleusement filmé par Benoît Jacquot ? Autre la fameuse scène d’Elvire dans le Dom Juan de Molière , avec les commentaires si souvent cités ? Heureusement, le spectacle ouvre d’autres tiroirs ; ici un acteur tente d’imiter la voix de Tadeusz Kantor, là Jerzy Grotowski fait un tour de piste, ailleurs la redoutée Stella Adler fait du Stella Adler, Ça défile, ça accumule, cela manque d’articulations, de contradictions. Cette histoire du théâtre qui se veut autre s’en tient pour l’essentiel au XXe siècle qui a vu l’avènement de la mise en scène. Des grands noms sont évoqués (de Langhoff à Castellucci) sans qu’ils soient de nommés. Plus intéressant, Fanny de Chaillé insiste sur les paroles d’acteurs comme Martin Wuttke (mais curieusement laisse de côté le formidable livre de Nicolas Bouchaud sur sa pratique) et sur les paroles d’actrices (de Jeanne Moreau à Catherine Hiégel) , sans que jamais ces noms ne soient nommés sur scène (ils figurent dans le programme de salle). Ce n’est pas un casting et peu importe si les spectateurs ne mettent pas un nom derrière telle phrase. Ce qui compte c’est ce qui se passe sur le plateau devant nous. Or si ce que l’on voit est plaisant, cela s’apparente le plus souvent à des exercices, fruits ou pas «d’ impro ». Cela manque de surprises, cela patine vite. On aurait aimé que Fanny de Chaillé développe plus avant ce qu’elle présente comme une « ambition » du spectacle, celle de raconter (et, là, ce serait effectivement « une autre histoire ») « la pluridisciplinarité qui existe depuis les avant-gardes historiques et qui est indissociable des formes qui se fabriquent aujourd’hui et dont ne parle quasiment jamais ». Espérons que son prochain spectacle en parlera abondamment. Le spectacle Une autre histoire du théâtre a été créé à Chambéry, il est passé au Phénix de Valenciennes, le voici jusqu’au 27 nov au Théâtre public de Montreuil dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Puis du 29 nov au 3 déc au Théâtre de Chaillot, Bonlieu (Annecy) les 6&7 déc, Sète les 13&14 déc, Théâtre Garonne (Toulouse) les 7, 11 et 13 janv, Lieu Unique (Nantes) du 7 au 9 fév, Théâtre Nouvelle Génération (Lyon) du 23 au 27 mai. Légende photo : Scène de "Une autre histoire du théâtre"; © Marc Domage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2022 5:36 PM
|
En 2022, Maria Casarès aurait eu 100 ans. Retour sur le parcours de cette actrice qui a marqué le théâtre du 20eme siècle avec Johanna Silberstein, directrice de la maison Maria Casarès à Alloue en Charentes. Ecouter l'entretien en ligne (6 mn)
Avec
Johanna Silberstein Comédienne et responsable artistique de "La Maison Maria Casarès" depuis septembre 2016. Exilée espagnole, maîtresse ardente d’Albert Camus, Maria Casarès est avant tout une grande actrice de théâtre, une tragédienne qui a marqué de son empreinte si particulière les œuvres qu’elle a incarnées et les spectateurs qu’elle a rencontrés. La comédienne Maria Casarès Après la mort d’Albert Camus, Maria Casarès achète une maison dans les Charentes qui pour elle, selon Johanna Silberstein, directrice de la maison Maria Casarès dans les Charentes, est un refuge, le « chez elle » dont elle avait besoin après avoir fuit l’Espagne. « Dans son autobiographie "Résidente privilégiée", Maria Carasès dit que c’est un lieu pour se réfugier hors du bûcher théâtral. Maria Casarès a brûlé toute sa vie entière sur les planches et a dédié sa vie à défendre un théâtre public, des poètes et des grandes histoires aussi bien classiques dans "Marie Tudor" de Victor Hugo ou dans le rôle de Lady Macbeth chez Shakespeare. Elle a également défendu des auteurs contemporains comme Albert Camus, qui a été sa grande histoire d’amour ; et a inspiré d’autres jeunes auteurs tels que Sartre, Genet, Claudel, Copi ou encore Bernard-Marie Koltès, qui raconte que parce qu’il avait vu Maria Casarès jouer le rôle de Médée, il avait commencé à écrire pour le théâtre. Ce sont des rencontres qui ont changé la face du théâtre du XXème siècle. » Selon Johanna Silberstein, Maria Casarès a participé à de nombreuses aventures qui ont fondé les bases du théâtre d’aujourd’hui, notamment celle de la décentralisation. La comédienne a travaillé avec Jean Vilar, fondateur du Festival d’Avignon et du Théâtre National Populaire à Chaillot ; et a été l’une des premières grandes actrices interdisciplinaires en dansant pour Maurice Béjart dans la Cour d’honneur du Palais des papes. Maria Casarès continue le théâtre auprès de Patrice Chéreau au Théâtre des Amandiers ou encore avec Bernard Sobel à Gennevilliers. « Elle avait un rapport à son corps d’actrice très particulier. On se souvient d’elle au cinéma comme une très belle jeune comédienne brune et mystérieuse, qui, au fur et à mesure de sa vie, devient de plus en plus androgyne. A la fin de sa carrière, elle joue des rôles comme le Roi Lear chez Shakespeare, et Genet lui écrit des monologues où elle incarne le pape. Maria Casarès est aussi dans cette question transgenre. » « La maison Maria Casarès est un centre culturel de rencontre dédié au théâtre où l'on défend la jeune création théâtrale » Fille du Premier ministre de la République espagnole, Maria Casarès a fui la dictature de Franco quand elle avait quatorze ans. Elle a alors appris le français et est devenue comédienne. En 1961, à la mort d’Albert Camus, Maria Casarès achète le domaine de Lavergne, comptant cinq hectares en Charente. Quand Maria Casarès décède en 1996, elle décide de léguer le domaine et tout ce qu’il contient à la commune d’Alloue pour remercier la France d’avoir été une terre d’asile. Ce domaine est devenu aujourd’hui la maison Maria Casarès, un centre culturel de rencontre dédié au théâtre où l'on défend la jeune création théâtrale avec le dispositif "Jeunes Pousses" qui accueille de jeunes metteurs en scène sortis d’école mais aussi de jeunes auteurs de théâtre. De plus, un Festival d’été se déroule pendant cinq semaines célébrant le patrimoine, le matrimoine, la gastronomie locale et le théâtre. Une année de commémoration 2022 est le centenaire de la naissance de Maria Casarès. Il s’agit, selon Johanna Silberstein, de trouver le bon équilibre entre commémoration et jeune création. « Les différentes directions se sont emparées du legs de Maria Casarès afin qu’elle inspire les jeunes générations et qu'elles assurent la continuité du geste théâtral. Ce centenaire va se déplacer dans plusieurs endroits en commençant à la Corogne, sa ville natale, en Espagne où on redécouvre sa mémoire. Il y aura donc des commémorations mais aussi des colloques universitaires notamment à Barcelone et à Avignon. Cet été aura lieu une lecture au Festival d’Avignon sur Maria Casarès et Gérard Philipe car on célèbre également le centenaire de ce dernier. Cette lecture est programmée par le Festival d’Avignon mais également par la maison Jean Vilar qui va consacrer un grande exposition aux deux comédiens stars des années Vilar du TNP. » « Pendant le Festival de la Maison Casarès, on monte également le parcours sonore de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès pour découvrir les jardins du domaine accompagné de différentes lectures. De plus, on va créer une exposition autour des années du TNP de Maria Casarès et chaque année on s'arrêtera sur une année particulière de sa carrière. Actuellement, on est en train d’organiser un week-end de commémoration qui aura lieu en novembre à Alloue avec de jeunes auteurs car ce qui nous intéresse c’est la création d‘aujourd’hui. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 19, 2022 7:24 PM
|
Propos recueillis par Brigitte Salino dans Le Monde - 19 nov. 2022 Dans un entretien au « Monde », le directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques 2024 répond à Gérald Darmanin évoquant un report ou une annulation des festivals à l’été 2024. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/19/jo-paris-2024-pour-thomas-jolly-on-ne-peut-pas-opposer-sport-et-culture_6150694_3246.html
Thomas Jolly, nommé à la direction artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de l’été 2024 et metteur en scène de l’opéra rock Starmania, revient sur les déclarations du ministre de l’intérieur, le 25 octobre, annonçant un possible « report ou annulation des grands événements sportifs ou culturels mobilisant de nombreuses forces de police et de gendarmes ». Il dit son inquiétude pour les professionnels et les territoires. Comment avez-vous réagi aux propos de Gérald Darmanin ? J’ai été surpris, puis stupéfait, puis inquiet. Je comprends les impératifs de sécurité, d’autant que, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d’ouverture n’aura pas lieu dans un stade, mais le long de la Seine, et que des milliers d’athlètes, des centaines de milliers de spectateurs et des chefs d’Etat seront présents. Ce qui m’a surpris, c’est que l’annonce du manque de gendarmes et de policiers ne sorte que maintenant, alors que les Jeux sont annoncés depuis longtemps. « N’oublions pas que tous les Français ne seront pas à Paris en juillet 2024. Chacun a droit à un accès à la culture, où qu’il soit » Ensuite, j’ai été stupéfait que le ministre de l’intérieur oppose la culture et le sport, car c’est contraire aux valeurs de l’olympisme. Et enfin, j’ai été très inquiet pour les festivals que je connais bien pour y avoir travaillé, et pas seulement à Avignon. Pour les professionnels et les territoires, ils sont très importants d’un point de vue économique. Au-delà, ils sont un outil merveilleux. N’oublions pas que tous les Français ne seront pas à Paris en juillet 2024. Chacun a droit à un accès à la culture, où qu’il soit. Iriez-vous jusqu’à mettre votre poste en jeu pour défendre cette cause ? Ce serait triste d’en arriver là. On verra le moment venu. Je comprends qu’il y ait des crispations. Mon mandat a démarré en janvier 2020, avec le Covid-19, il a fallu réinventer de nouvelles façons de travailler. Par ailleurs, l’équipe a dû s’adapter à mon projet, alors qu’elle avait l’habitude de travailler avec mon prédécesseur, Frédéric Bélier-Garcia, qui est resté treize ans en poste. Après ma nomination pour les JO, j’ai démissionné purement et simplement, de manière très « réglo ». Je trouve étonnant que l’on pose une lumière suspicieuse sur cette démission. On pourrait se réjouir que les Jeux olympiques aient choisi un jeune metteur en scène du théâtre public. Quand vous a-t-on proposé d’être le directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques ? En octobre 2021, le journal L’Equipe avait demandé à quelques artistes, dont moi, ce qu’ils imagineraient pour ces cérémonies. L’article a dû faire son petit chemin. En juin, j’ai été approché par Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des JO, et son conseiller Thierry Reboul, puis par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Mi-août, ils ont proposé mon nom au CIO [Comité international olympique]. Fin août, j’ai été choisi à l’unanimité. Mi-septembre, j’ai rencontré Emmanuel Macron. Le 27 septembre, j’ai été nommé. Comment le rendez-vous avec le président de la République s’est-il passé ? J’ai présenté les grands axes de mon projet, il les a écoutés. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que la France, pour vous ? » Et il m’a répondu que la France est un récit avant d’être une identité. Un récit qui ne cesse d’être en mouvement, de se construire, de se réinterroger, de se réinventer. Je trouve cette idée d’autant plus inspirante que je n’ai pas l’intention de faire une cérémonie muséale à la gloire de l’histoire de France. Cette histoire est présente dans le trajet de la cérémonie d’ouverture, 6 kilomètres d’Austerlitz au Trocadéro, qui passent par le Louvre, la Conciergerie, la tour Eiffel, Notre-Dame, évidemment… Je suis en train de me familiariser avec ce dispositif, pour trouver un espace de création à l’intérieur. La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques se tiendra sur la place de la Concorde, et les cérémonies de clôture auront lieu au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Thomas Jolly sur les JO de Paris 2024 : « On peut être sobre et spectaculaire » Comment organisez-vous le travail ? J’ai formé un comité dramaturgique, constitué d’auteurs et d’autrices qui travaillent sur les grandes lignes des récits. Je veux insister sur les emblèmes de la France, ceux que l’on connaît à travers notre histoire et ceux que notre histoire, présente et future, pourrait inventer. A partir du printemps, je commencerai à développer le projet scénique, en m’entourant d’un référent ou d’une référente pour chaque discipline, la danse, la musique, l’image filmique, les costumes… Puis je verrai si je mets tout en scène ou si je délègue des parties à des artistes Il y a aura des spectateurs le long des 6 kilomètres. Comment les satisfaire tous ? Même si l’égalité est un frontispice de notre république, elle ne sera pas possible. Sur 6 kilomètres, on ne peut pas tous voir la même chose. En revanche, il y aura une équité : où que l’on soit, un spectacle aura lieu. Propos recueillis par Brigitte Salino Lire aussi JO Paris 2024 : la Seine sera le théâtre de la cérémonie d’ouverture des Jeux, devant 600 000 personnes Légende photo : Thomas Jolly, à Paris, le 13 septembre 2022. ANTHONY DORFMANN
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 6:11 PM
|
Par Marie-Aude Roux (Rennes, envoyée spéciale) dans Le Monde, publié le 26/11/2022 La première mise en scène d’art lyrique de la performeuse et jongleuse confère une revigorante radicalité au troisième des opéras de Philip Glass d’après Jean Cocteau.
Lire l'article sur le site du Monde
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/26/opera-phia-menard-a-place-les-enfants-terribles-en-ehpad_6151794_3246.html Un train de trois pianos lancé sur une tournette extérieure, à l’intérieur ; un manège en sens inverse ; au centre, la valse centrifuge d’une chambre d’hôpital aux persiennes blanches : imaginé par Phia Ménard, ce triple dispositif met en scène et en mouvement la scénographie des Enfants terribles (1996), de Philip Glass, troisième des ouvrages consacrés par le compositeur américain à Jean Cocteau, après Orphée (1993) et La Belle et la Bête (1994). Vertige, vitesse, hypnose, les boucles répétitives de la musique propulsent un synopsis qui emprunte également au film éponyme de Jean-Pierre Melville (1950), relatant la violence d’un huis clos qui voit s’aimer et se détruire Elisabeth et son frère Paul. Un jeu dangereux dès lors que Paul tombera amoureux d’Agathe, double féminin du fascinant Dargelos qui l’a blessé alors qu’il était enfant, déclenchant le tragique passage à l’acte d’Elisabeth. Les lumières d’Eric Soyer habillent le drame d’un étrange réseau d’ombres La performeuse, jongleuse, chorégraphe et metteuse en scène, dont c’est la première incursion à l’opéra, a eu l’idée transgressive de replacer le quotidien fantastique et onirique des adolescents dans un Ehpad. Dans leurs vêtements d’intérieur surannés, ces enfants terribles sont de vieux enfants – Paul est en fauteuil roulant, livré aux maltraitances de sa sœur –, dont le jeu consiste à chausser des casques de réalité virtuelle, histoire de convoquer le temps de leur jeunesse. Ils sont veillés et surveillés par des pianos infirmiers, tandis qu’un comédien se fait tour à tour narrateur, médecin ou animateur (séance de pliage d’origamis), voire clone de Cocteau. Les lumières d’Eric Soyer habillent le drame d’un étrange réseau d’ombres. Particulièrement frappant, le tournis affolé des dernières scènes, avec ses personnages costumés par Marie La Rocca en éléments de décors rappelant les pièces d’un jeu d’échecs. Paul et sa tour mauve de Moyen Age, Elisabeth en méchante reine des neiges, Gérard harnaché en cheval de parade rouge, Agathe en dame de cour déjantée aux couleurs de la folie. Le chaos accueillera la fin de Paul et Elisabeth. Relation toxique Sur leurs claviers numériques, les trois pianistes Flore Merlin, Nicolas Royez et Emmanuel Olivier (également directeur musical de la production) déroulent le continuum consonant de Glass dans une uniformisation de couleurs et de nuances propre à soutenir de manière presque oraculaire l’implacable progression du drame. Générale, la sonorisation expose particulièrement les voix, déjà très sollicitées par une écriture atonale, à rebours de la prosodie, comme si le compositeur francophile avait voulu illustrer dans la chair des mots la relation toxique entre les protagonistes. Elisabeth très engagée scéniquement, Mélanie Boisvert compense un timbre acidulé par une incarnation vocale énergique et soutenue, cependant qu’Olivier Naveau dessine un Paul doloriste et résigné. Si le Gérard de François Piolino reste un peu falot, Ingrid Perruche campe une Agathe solide à la voix charnue. Le comédien Jonathan Drillet observe une remarquable variété de tons Quant au comédien Jonathan Drillet, il observe une remarquable variété de tons, même si le long passage où il présente l’extrait d’une interview réalisée par le poète français en 1962, Jean Cocteau s’adresse à l’an 2000, nous a semblé un peu déconnecté. Peut-être parce qu’en évoquant, entre peur de la robotisation et vœu pour l’humanité, un monde bien réel, il brisait en quelque sorte le pacte onirique de la musique. D’ores et déjà programmés dans une dizaine de lieux, ces Enfants terribles, nouvelle production de la Co[opéra]tive, consortium de six scènes nationales et opéras fédérés depuis 2014 afin d’assurer un plus grand rayonnement à l’art lyrique, continueront de tourner. Après Quimper et Rennes, ils rayonneront d’abord à Tourcoing (Nord), Dunkerque (Nord) et Compiègne (Oise) puis, en 2023, à Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bruxelles et Bobigny (Seine-Saint-Denis). Les Enfants terribles, de Philip Glass. Avec Mélanie Boisvert, Olivier Naveau, Ingrid Perruche, François Piolino, Emmanuel Olivier, Flore Merlin, Nicolas Royez (pianos numériques), Phia Ménard (mise en scène et scénographie), Eric Soyer (création lumières), Marie La Rocca (costumes), Jonathan Drillet (dramaturgie). Opéra de Rennes, le 16 novembre. Prochaines représentations : les 26 et 27 novembre à Tourcoing (Nord) ; les 1er et 2 décembre à Dunkerque (Nord) ; le 7 décembre à Compiègne (Oise) ; les 10 et 11 janvier 2023 à Besançon (Doubs) ; les 17, 19 et 20 janvier 2023 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; les 1er et 2 février 2023 à Grenoble (Isère) ; les 10 et 11 février 2023 à Bruxelles (Belgique) ; les 23, 24 et 26 février 2023 à Bobigny (Seine Saint-Denis). Marie-Aude Roux (Rennes, envoyée spéciale) / Le Monde Légende photo « Les Enfants terribles », de Philip Glass, dans une mise en scène de Phia Ménard, lors de la répétition générale au Théâtre de Cornouaille à Quimper, le 7 novembre 2022. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:33 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 26 nov. 2022 Ultime mise en scène de Sylvain Maurice comme directeur du CDN de Sartrouville, « La Campagne » de Martin Crimp, est aussi intelligemment dirigée que magistralement interprétée. Au côté de celle qui est aussi devenue une auteure, Manon Clavel, magnifique et Yannick Choirat, dans le rôle ingrat de celui qui ment. Allons droit au fait ! On connaît bien la pièce de Martin Crimp. Elle a été très tôt montée en France. Mais c’est comme si elle était neuve. On ne s’en étonne pas car on sait depuis très longtemps la puissance et l’art très sensible de Sylvain Maurice. C’est un très grand artiste et, avec La Campagne, son dernier travail de metteur en scène au Théâtre de Sartrouville (et des Yvelines, un centre dramatique national), il nous offre un moment d’une force profonde. Il a conduit les trois interprètes au plus près des humeurs évanescentes et angoissantes distillées par Martin Crimp. Ici, plus que jamais, l’écrivain britannique, né en 1956, apparaît comme un héritier d’Harold Pinter. Mais il possède une personnalité profonde, et Crimp est Crimp ! La traduction de Philippe Djian, déjà entendue, résonne ici de son ambivalence vénéneuse. Là aussi, Sylvain Maurice est un maître : il éclaire toutes les moirures de l’angoissante situation et les comédiens jouent toutes les notes. Tout paraît simple, paisible. Une femme, jeune, découpe des motifs de fleurs avec de grand ciseaux et s’adresse à son mari. On comprend qu’il est rentré la veille, tard, avec une toute jeune fille, qui dort à côté, dans une pièce de la maison. Elle se repose. Il l’a trouvée, inconsciente ou presque, dans un fossé, le long de la route qui le ramenait à la maison, lui qui est médecin. De campagne. Dans les intonations, musicales, légères mais interrogatives de l’épouse, Corinne, se love immédiatement le noeud dramatique de ces scènes de la vie d’un couple. Ils sont beaux, ils s’aiment, certainement, en tout cas elle le pensait. Mais le venin de la trahison, du mensonge, corrode toutes les belles apparences de calme, d’harmonie. Disons-le : on connaît, on admire, on suit, Isabelle Carré depuis ses tout débuts. Elle avait 18 ans et sans doute moins. Elle a toujours été séduisante, bouleversante. Mais ici, elle a encore monté d’un cran. Elle est éblouissante, libre, fascinante. Elle est portée par le rôle, l’écriture, le metteur en scène. Le dispositif scénique, de Sylvain Maurice lui-même, est l’idéal lieu qui éclaire le propos de Crimp. Lumière, son, Rodolphe Martin et Jean De Almeida, illuminent encore le jeu. Dans la partition ambivalente du mari, Richard, Yannick Choirat est parfait. Il est séduisant, comme il se doit, sincère dans son engagement de médecin, mais faible, mais fuyant, mais menteur. Une interprétation très maîtrisée et fine. Et puis il y a celle qui introduit le doute, celle qui sépare mais que tout le monde -le mari et la femme, en fait- aime. Rebecca, portée par une jeune comédienne déjà repérée mais qui, ici, s’épanouit. Libre comme Isabelle Carré, audacieuse, insolente comme l’est son personnage, comme l’est le personnage de Corinne, menteuse, fuyante, odieuse avec Corinne car elle se sent forte et qu’elle adore l’ambiguité destructrice de la situation. Cette mise en scène de La Campagne est remarquable. La meilleure mise en scène en France de Martin Crimp. Un trio d’interprètes incandescents. Pour des personnages si proches… La dernière représentation a lieu ce samedi, en présence de l’auteur. Une tournée suit :
du 1er au 3 décembre au Théâtre Montansier, Versailles
du 7 au 9 décembre 2022 à la Comédie de Picardie, Amiens
du 5 au 22 janvier 2023 au Théâtre du Rond-Point, Paris
du 26 au 28 janvier 2023 au Théâtre national de Nice Photo © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 4:35 PM
|
Par Zineb Dryef, Clarisse Fabre, Gilles Rof(Marseille, correspondant) et Nathalie Stey (Strasbourg, correspondance) dans Le Monde , publié le 26 novembre 2022 A l’affiche du film « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi, l’acteur de 25 ans fait l’objet de trois mises en examen, deux pour viol sur des anciennes compagnes et une pour violence sur conjoint.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/26/l-affaire-sofiane-bennacer-embarrasse-le-cinema-francais_6151736_3246.html
C’est une affaire qui plonge la profession dans l’embarras. A l’affiche du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni Tedeschi, l’acteur Sofiane Bennacer, 25 ans, fait l’objet de trois mises en examen, deux pour viol sur des anciennes compagnes et une pour violence sur conjoint, comme l’ont révélé Le Parisien et Libération. Dans un long message posté sur Instagram, il clame son innocence : « La présomption d’innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un Etat de non-droit, un Etat où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ? » Lire aussi : Affaire Sofiane Bennacer : ce que l’on sait des accusations de viols contre l’acteur des « Amandiers » « Un pur lynchage médiatique », a dénoncé Valeria Bruni Tedeschi, sa compagne, dans un communiqué, vendredi 25 novembre, qui assume avoir choisi ce jeune acteur tout en ayant eu vent de rumeurs à son sujet. « Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui. » Elle poursuit : « Pour ma part, j’avais depuis quelques mois appris à connaître Sofiane Bennacer dans le travail, notamment pendant la longue période de répétitions, et à être tout à fait confiante sur ses qualités humaines : lorsque l’on filme quelqu’un, on “voit” qui l’on a en face de soi. » Sélectionné dans la liste des trente-deux comédiens présélectionnés pour les Césars des révélations féminines et masculines, Sofiane Bennacer en a finalement été exclu. L’Académie des César a fini par prendre acte des « informations publiées par la presse concernant la mise en examen de l’acteur et le contrôle judiciaire qui lui est imposé ». Alertes répétées C’est précisément cette absence de réactions, malgré des alertes répétées, depuis le casting jusqu’à la réception du film, qui est aujourd’hui dénoncée. Deux cinémas – L’Ecran de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Le Concorde à La Roche-sur-Yon (Vendée) – ont d’ores et déjà annoncé avoir retiré Les Amandiers de leur programmation, alors que des appels au boycott commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le collectif #metoothéâtre, très actif, a dénoncé l’« omerta » de la profession : « La structuration de nos métiers et de la société est construite sur la protection des agresseurs et la “silenciation” des victimes. Une fois encore, ce système se vérifie dans cette affaire avec une production qui se défausse de ses responsabilités afférentes au droit du travail. » Sur Instagram, le collectif #metoothéâtre, très actif, a dénoncé l’« omerta » de la profession C’est sur les planches que tout a commencé. En janvier 2021, au Théâtre national de Strasbourg (TNS), Sofiane Bennacer est accusé de viol par l’une de ses camarades. Les faits qu’elle dénonce remontent à 2018, lorsqu’ils étaient tous deux étudiants à La Filature à Mulhouse (Haut-Rhin). Ils étaient alors en couple. La direction de l’établissement affirme n’avoir recueilli à l’époque « aucun témoignage, aucune information qui aurait pu nous mettre la puce à l’oreille ». A Strasbourg, Stanislas Nordey, le directeur du TNS, explique au Monde qu’il a été mis au courant par Sofiane Bennacer lui-même : « Un jour, Sofiane débarque dans mon bureau, en larmes, m’expliquant qu’il est accusé de viol. Je ne suis pas un violeur, dit-il. Je convoque la jeune fille et lui pose la question. Elle me répond qu’elle n’avait pas l’intention de venir me parler, mais elle confirme l’accusation. Les élèves du TNS ont commencé à s’en mêler, et les réactions se sont déchaînées sur les réseaux sociaux. Au vu du climat, je propose alors à Sofiane de prendre trois semaines de congé. Quand il revient, il m’annonce qu’il démissionne. Sofiane est parti, a quitté Strasbourg, et je pensais que l’affaire était close. » « Rumeurs » Il entend de nouveau parler de lui lorsque la production des Amandiers, Alexandra Henochsberg (Ad Vitam) et Patrick Sobelman (Agat Films), le contacte pour vérifier des « rumeurs ». Stanislas Nordey évoque des soupçons d’agressions sexuelles : « Je n’ai pas dit qu’il était accusé de viol comme l’écrit Libé. En tout cas, cela m’étonnerait beaucoup que j’aie utilisé ce mot. J’ai essayé d’être le plus factuel possible. Je n’ai pas non plus précisé aux producteurs que j’avais effectué un signalement au procureur de la République, car je suis tenu au devoir de réserve. » Enfin, lorsque les producteurs lui demandent s’il a connaissance d’une plainte déposée par la comédienne, Stanislas Nordey répond qu’il ne sait pas. « Je savais qu’une plainte avait été déposée, mais la jeune actrice m’avait demandé de ne pas le dire. J’ai donc respecté son choix. Par ailleurs, Agat Films aurait pu interroger directement la jeune actrice… car celle-ci avait été auditionnée pour Les Amandiers », ajoute le directeur du TNS. En effet, avant que l’affaire éclate, Stanislas Nordey et l’équipe du TNS avaient été sollicités en vue du casting des Amandiers : « La direction du casting souhaitait avoir quelques noms d’élèves du TNS susceptibles de passer les auditions. Nous avons alors transmis plusieurs contacts, parmi lesquels ceux de Sofiane Bennacer et de la jeune fille. » En juin, des remous agitent le TNS lorsque Stanislas Nordey accepte d’accueillir l’ancien élève dans le cadre de représentations du spectacle Superstructure produit par la compagnie Diphtong. A l’époque, face à la réaction très vive des étudiants, il s’était retranché derrière le principe de présomption d’innocence pour maintenir le spectacle. Des mesures conservatrices avaient été adoptées : une grande partie des élèves de l’école avait été déplacée à Eymoutiers (Haute-Vienne) et à Montreuil (Seine-Saint-Denis), durant la période des représentations, pour éviter tout risque de rencontre entre le comédien et ses victimes présumées. Le planning de travail d’une salariée avait également été adapté pour que les deux ne se croisent pas. « Nous étions obligés, pour des raisons juridiques, de le programmer et nous l’avons fait après consultation du ministère de la culture », explique Stanislas Nordey. « Pas de scandale “Les Amandiers” » A Aix-en-Provence, où Sofiane Bennacer a suivi sa formation de théâtre après avoir grandi dans un milieu populaire à Marseille, l’annonce des accusations laisse sous le choc les équipes du Deust théâtre d’Aix-Marseille Université et leur responsable, Louis Dieuzayde, également président du Théâtre Antoine-Vitez. « C’est extrêmement douloureux, car cela concerne un de nos anciens étudiants et un acteur dont on suit la carrière, témoigne l’enseignant. Sofiane était une intelligence et un acteur que l’on appréciait beaucoup lorsqu’il était étudiant. D’autant plus méritant qu’il est rare de voir un jeune de sa classe sociale choisir cette voie dans notre région. » Le théâtre avait prévu d’organiser un événement autour de lectures de ses propres textes, encore inédits, par Valeria Bruni Tedeschi, au début de février 2023. Une programmation qui laisse désormais l’équipe aixoise dans l’embarras. « Je ne vous cache pas que cette soirée est fortement compromise, mais nous souhaitons prendre un peu de temps avant d’acter une décision définitive », poursuit Louis Dieuzayde. Les producteurs du film, Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman, disent avoir averti, deux jours après le début du tournage, Valeria Bruni Tedeschi, qui a refusé de se séparer de son acteur Pour sauver leur film, Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman plaident, dans un communiqué, que « s’il y a une affaire Sofiane Bennacer, il n’y a pas de scandale Les Amandiers ». Ils reconnaissent avoir appris, deux jours après le début du tournage, qu’une plainte pour viol avait été déposée contre le comédien. Ils disent avoir averti Valeria Bruni Tedeschi, qui a refusé de se séparer de son acteur : « A ce stade, rien dans le droit du travail ne nous permet de justifier son licenciement, il pourrait se retourner contre nous (…). Nous organisons alors une réunion sur le plateau avec toute l’équipe, Valeria prend la parole pour expliquer la situation. Nous proposons à ceux que la situation rend mal à l’aise de quitter le tournage sans aucune pression ni conséquence. » Ils interrogent : « Aujourd’hui, comment notre expérience pourrait-elle servir à améliorer la position des producteurs face à ce type de situation ? Comment répondre légalement au nécessaire devoir d’exemplarité ? » Pour ne pas risquer une affaire Polanski bis – la remise du prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski en 2020 avait secoué le cinéma français – les César prévoient aussi de plancher sur la question : que faire d’un film dont un participant est poursuivi pour viol et violences sexuelles ? Lire aussi Article réservé à nos abonnés L’Académie des Césars critiquée pour ses pratiques opaques et ses choix contestés Zineb Dryef, Clarisse Fabre, Gilles Rof(Marseille, correspondant) et Nathalie Stey(Strasbourg, correspondance) ------------------------------------------------------- Affaire Sofiane Bennacer : ce que l’on sait des accusations de viols contre l’acteur des « Amandiers » Article publié par Le Monde avec AFP, le 25 nov. 2022 Le comédien, mis en examen en octobre, a été placé sous contrôle judiciaire. Alors qu’il dément les faits qui lui sont reprochés, la réalisatrice du film, Valeria Bruni-Tedeschi, lui a apporté son soutien vendredi, dénonçant un « lynchage médiatique Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2022/11/25/affaire-sofiane-bennacer-ce-que-l-on-sait-des-accusations-de-viols-contre-l-acteur-des-amandiers_6151662_3476.html
Il partage la tête d’affiche du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni-Tedeschi, sorti en salles le 16 novembre et encensé par la critique. L’acteur Sofiane Bennacer, âgé de 25 ans, se retrouve toutefois dans la lumière pour tout autre chose depuis le 22 novembre : ses mises en examen pour viols et violences sur ex-conjointes. Alors que ce dernier conteste les faits et a reçu le soutien de la réalisatrice du film vendredi, Le Monde revient sur ce que l’on sait de cette affaire. Accusé par quatre anciennes compagnes, l’acteur est triplement mis en examen Sofiane Bennacer a été mis en examen en octobre par le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) pour viols présumés sur deux anciennes compagnes et pour « violences sur conjoint » concernant une troisième, a fait savoir la procureure de la République Edwige Roux-Morizot mardi, confirmant des informations du Parisien. Le comédien a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre d’une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne, qui l’accuse de viol. Les faits allégués se seraient produits « entre 2018 et 2019 » à Mulhouse, à Strasbourg et à Paris, et les victimes présumées évoluent « dans le monde du théâtre », a détaillé Edwige Roux-Morizot. Selon Le Parisien, l’acteur a connu l’une de ses accusatrices à l’école de théâtre La Filature, à Mulhouse, où « le couple se serait formé ». Les victimes présumées « décrivent une liaison sous emprise, au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu », écrit le quotidien. Lire aussi : L’acteur Sofiane Bennacer mis en examen pour viols et violences sur d’anciennes compagnes Le Théâtre national de Strasbourg (TNS), l’école où Sofiane Bennacer avait été admis en 2019, avait saisi le ministère de la culture pour des faits « de violences sexistes, sexuelles et de harcèlement dont [il] avait été informé », selon le journal. Le ministère avait ensuite fait un signalement à la justice, a déclaré Edwige Roux-Morizot, sans préciser la date. Benjamin Morel, administrateur du TNS, a dit mercredi à l’Agence France-Presse que c’est ensuite le jeune comédien lui-même « qui a pris la décision de démissionner le 19 février 2021 ». La procureure de Mulhouse a fait savoir mardi que l’acteur a été placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen, sur demande du parquet. Il lui est interdit de se rendre en région parisienne, à Strasbourg ainsi qu’à Mulhouse. Il est également interdit à M. Bennacer de rencontrer les plaignantes tout comme les témoins du dossier, parmi lesquels figure Valeria Bruni-Tedeschi, qui serait, selon la procureure, citée par Libération, l’actuelle « compagne » du comédien. L’Académie des Césars a retiré son nom des « révélations » Dans la soirée de mercredi, l’Académie des Césars a annoncé le retrait du nom de l’acteur de la liste des révélations masculines 2023, estimant que « les informations publiées par la presse (…) commandaient, sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées, de le retirer de la liste ». Lire aussi : Article réservé à nos abonnés 5 ans après #metoo, les avancées et les limites de la prévention dans le cinéma, le théâtre ou la danse L’institution du cinéma français a par ailleurs précisé qu’elle entamait « une réflexion afin d’envisager une modification du règlement qui régit l’organisation de la cérémonie des Césars, qui ne prévoit pas, à ce jour, l’hypothèse d’une mise en cause judiciaire d’un·e participant·e à un film éligible ». Le comédien clame son innocence Sofiane Bennacer a réagi mercredi, dans un long message posté sur Instagram, en clamant son innocence : « La présomption d’innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un Etat de non-droit, un Etat où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ? ». Dénonçant « de faux témoignages », il a ajouté : « Je vais peut-être me faire boycotter par le cinéma. De toute façon, je me suis fait humilier au plus profond de mon âme. (…) Je vais être libre dans quelques mois, car je n’ai rien fait. (…) S’il y avait la moindre preuve contre moi, pas de simples témoignages bidon, des vraies preuves, je serais déjà en prison. » Face à ces dénégations, Grégoire Mehl et Anne Lassalle, avocats de l’une des plaignantes, ont annoncé que leur cliente « maintient intégralement les propos et les positions déjà exprimés devant les services enquêteurs ». Une « omerta » durant le tournage des « Amandiers » ? Mais que s’est-il passé sur le tournage du film ? Est-ce que tout le monde savait ? Selon une enquête publiée par Libération jeudi, dans laquelle le journal explique avoir interrogé une trentaine de personnes, dont une quinzaine de professionnels présents lors du tournage, celui-ci se serait déroulé dans un climat d’« omerta », tant la réalisatrice tenait à travailler avec Sofiane Bennacer, décrit comme son « coup de cœur » artistique. Réalisé à l’été 2021, le film voit très vite naître des rumeurs au sujet de violences sexuelles qu’aurait commises M. Bennacer, qui occupe le premier rôle masculin du film. Des alternants et stagiaires ayant pris connaissance d’un premier dépôt de plainte disent avoir alerté la réalisatrice trois jours après le début du tournage. Valeria Bruni-Tedeschi aurait alors réuni l’équipe pour défendre le comédien en son absence, « comme à chaque fois que son cas sera abordé sur le tournage ». L’une des témoins de Libération avance : « Elle nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements. » Après la démission de deux personnes, une chappe de plomb s’installe, selon Libération, autour d’un « secret dont il ne fa[ut] pas parler » : la production et la réalisatrice maintiennent coûte que coûte l’acteur, et les rumeurs, bien que confortées par le dépôt de plaintes, sont reléguées à leur simple rang. Patrick Sobelman, l’un des deux producteurs du film, a réagi vendredi matin à la publication de cette enquête. « A aucun moment la production ne savait avant de l’engager, et à aucun moment la production n’a orchestré la moindre omerta pour faire en sorte que rien ne sorte de cette histoire », a-t-il déclaré sur France Inter, précisant qu’« il était absolument impossible d’arrêter le tournage et de virer Sofiane pour une raison très simple : nous n’avions aucune base juridique pour faire ça ». « Il ne s’est rien passé de répréhensible pendant tout le tournage du film », a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant qu’il y a pu « y avoir une ambiance compliquée pour certains parce qu’ils se retrouvaient dans une situation qu’ils n’avaient pas voulue et ça jetait comme ça un doute, une ombre ». « Nous avons appris sa mise en examen il y a un mois [et] qu’il y a eu quatre plaintes différentes. Ce n’est pas la même chose : nous ne savions pas et nous l’avons appris en même temps que tout le monde », a-t-il répété. Valeria Bruni-Tedeschi dénonce un « lynchage » médiatique La réalisatrice du film Les Amandiers est sortie du silence vendredi pour dénoncer un « lynchage médiatique », après la parution de l’enquête de Libération. « A ce jour, tout le monde sait qu’il n’a pas été jugé, et un tel procédé relève, selon moi, d’un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d’une volonté d’informer de façon objective et impartiale », écrit Valéria Bruni-Tedeschi dans un communiqué. Elle s’y dit « indignée qu’un journal comme Libération puisse piétiner à ce point la présomption d’innocence ». Cette dernière confirme toutefois avoir eu « connaissance » des « rumeurs » dont faisait l’objet le jeune comédien pendant le tournage. « Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui », avance-t-elle en soulignant avoir été « impressionnée artistiquement par Sofiane Bennacer dès la première seconde du casting » de son film. « Plus tard, nous avons eu connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée », explique-t-elle encore. A propos des victimes présumées, l’actrice assure avoir « un immense respect pour la libération de la parole des femmes », mais elle insiste sur la « présomption d’innocence » en confiant avoir été elle-même « abusée dans [son] enfance » et en affirmant connaître « la douleur de ne pas avoir été prise au sérieux ». Valeria Bruni-Tedeschi a ensuite reçu le soutien de sa sœur, Carla Bruni. Dans un long post sur Instagram, l’épouse de Nicolas Sarkozy a réagi vendredi pour défendre la « présomption d’innocence » et apporter son « soutien total et absolu à [sa] sœur », s’en prenant directement à Libération. L’actrice et danseuse Andréa Bescond, réalisatrice du film Les Chatouilles – où elle revient sur les violences sexuelles dont elle a été victime enfant – a répondu à Carla Burni au micro de LCI. Elle a apporté directement son soutien aux victimes présumées et lancé : « C’est une féministe en carton. (…) J’ai répondu [en commentaire à sa publication] en disant qu’il fallait un peu de respect pour les victimes, elles sont quand même quatre, il y a des mises en examen. » Le Monde avec AFP -------------------------------------------------------- Affaire Sofiane Bennacer : pour la productrice des “Amandiers”, “il n’y a pas eu d’omerta sur le tournage” Par Hélène Marzolf dans Télérama - 27 nov. 2022 Alexandra Henochsberg, coproductrice et distributrice du film “Les Amandiers”, réagit pour “Télérama” aux révélations concernant Sofiane Bennacer, l’acteur principal du film de Valeria Bruni Tedeschi, mis en examen pour viols et violence sur conjoint. Une onde de choc secoue le cinéma français, après les mises en examen de Sofiane Bennacer, l’acteur principal des Amandiers, de Valeria Bruni-Tedeschi, dans des affaires de viols et de violence sur conjoint. Mise en cause dans une enquête du quotidien Libération, la production du film a publié, le 25 novembre, un communiqué, et se défend d’avoir fait régner l’omerta sur le plateau. Co-productrice et distributrice du film à travers sa société Ad Vitam, Alexandra Henochsberg s’explique. Avec ce communiqué, votre coproducteur, Patrick Sobelman (Agat Films), et vous-même, avez cherché à répondre à Libération…
L’article de Libé nous ayant paru très à charge, nous avons voulu donner notre point de vue, rétablir notre vérité. Nous traversons une période très dure, et il nous paraissait important, dans ce texte, de retracer le plus clairement possible la manière dont les choses s’étaient passées. Lire aussi : Affaire Sofiane Bennacer : Valeria Bruni Tedeschi répond, des cinémas déprogramment “Les Amandiers”3 minutes à lire Vous y précisez n’avoir pas été mise au courant d’une plainte pour viol au moment d’engager Sofiane Bennacer. En revanche, des bruits circulaient déjà concernant une possible agression sexuelle.
Au moment du casting, nous avons eu en effet connaissance d’une rumeur concernant le comportement violent qu’aurait eu Sofiane envers une jeune comédienne deux ans avant d’avoir intégré le Théâtre national de Strasbourg (TNS). Patrick Sobelman a alors contacté le directeur de l’école, Stanislas Nordey, qui a confirmé avoir convoqué Sofiane suite à ces accusations, et lui avoir conseillé de quitter l’établissement. Mais - et je tiens à insister là-dessus - à aucun moment Stanislas ne nous a parlé de plainte pour viol - alors qu’elle existait déjà - ni d’un signalement auprès du procureur de la république. Dans un article du Monde, il reconnaît d‘ailleurs avoir omis volontairement de mentionner ces éléments, et en explique les raisons [Stanislas Nordey argue d’« un devoir de réserve », et dit aussi avoir respecté la volonté de la plaignante qui ne voulait pas que l’affaire s’ébruite, ndlr]. Quant à cette histoire de signalement, nous l’avons découverte il y a seulement quelques jours, dans Le Parisien. Que Stanislas ne nous ait rien dit, c’est son droit, je ne vais pas l’attaquer là-dessus. Mais la conséquence, c’est qu’on s’en prend plein la figure aujourd’hui. “Depuis ma place de productrice, cela me paraissait impossible de dire : ok, arrêtons le tournage.” Après avoir été avertie, comme toute l’équipe, de l’existence de cette plainte, par une jeune alternante présente sur le plateau des Amandiers, vous avez été accusés, ainsi que la réalisatrice, d’avoir fait régner l’omerta..
Je ne peux que contester ce terme d’omerta ! Dès que nous avons découvert cette plainte – au bout de deux jours de tournage –, nous avons fait une réunion avec les jeunes alternants, nous avons énormément discuté avec l’équipe et les comédiens. Franchement, j’estime que nous n’avons pas minimisé l’onde de choc que cette affaire suscitait, ni fait régner la terreur. Émotionnellement, je comprends que cela ait été compliqué pour tout le monde. Parmi les jeunes, certains auraient voulu qu’on licencie Sofiane dans l’heure. Je comprends cette position, elle est tout à fait défendable. Mais depuis ma place de productrice, cela me paraissait impossible de dire : ok, arrêtons le tournage, immédiatement, mettons 90 personnes au chômage. Patrick et moi avons une responsabilité vis-à-vis des dizaines de personnes que nous avons engagées. Nous nous sommes retrouvés dans une situation impossible, d’autant que notre réalisatrice n’envisageait pas de continuer le tournage sans Sofiane. Avez-vous néanmoins senti un malaise au sein de l’équipe ?
La jeune fille qui nous avait avertis de la plainte a préféré partir dès le début du tournage, ainsi qu’une autre étudiante en alternance de la Cinéfabrique qui travaillait comme assistante-monteuse. En dehors de cela, l’ambiance était bonne et il arrivait que les jeunes fassent la fête entre eux. Après le papier de Libé, j’ai parlé avec les chefs de poste qui, eux aussi, sont tombés des nues en découvrant la teneur de l’article. Alors bien sûr, la présence de Sofiane n’était pas anodine, et a pu mettre des gens mal à l’aise. Mais lors de la fête de fin du tournage, tout le monde était présent. Et depuis, nous sommes tous restés en contacts, nous échangeons sur des fils WhatsApp, nous avons assuré une projection pour l’équipe avec 200 personnes dans la salle parisienne du Silencio des Prés, nous avons organisé une avant-première… Lire aussi : Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé Entre le tournage à partir de juin 2021 et le premier article du Parisien, le 23 octobre 2022, vous n’avez entendu parler de rien ?
Nous savions depuis mai que Libé enquêtait, car la journaliste nous avait contactés, Patrick Sobelman, moi-même, la réalisatrice, et une partie de l’équipe pendant le festival de Cannes. Elle nous a expliqué par mail qu’elle était en train de recueillir un certain nombre de « témoignages à charge », mais nous n’avions à cette époque-là aucune idée de la nature de ces charges, ni des témoignages… Elle nous a posé des questions précises sur les conditions de tournage, questions auxquelles nous avons répondu. Je ne savais absolument pas à cette époque qu’il y avait plusieurs plaignantes, et je ne l’ai découvert que ces derniers jours dans la presse. Et à ce moment-là, Sofiane n’avait pas encore été convoqué par la police. Comment s’est passée la promotion du film dans ce contexte ?
Sofiane, en octobre, nous a signalé qu’il n’y participerait plus, car l’enquête avait démarré [il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ndlr], ce qui m’a soulagée. Et avant cela, il a été tenu, le plus possible, à l’écart de la promotion. Il est venu à Cannes, mais brièvement, il n’était pas présent au Festival de la Rochelle où le film a été présenté, ni à un certain nombre d’autres événements. “Ce qui s’est passé avec l’affaire Polanski, sous l’ancienne direction, semble ne plus pouvoir se reproduire aujourd’hui.” Pouvez-vous comprendre que dans ce contexte, le fait que Sofiane ait été placé sur la liste des comédiens retenus pour les Révélations des César ait été problématique, d’autant que la directrice de casting des Amandiers, Marion Touitou, fait partie du comité de sélection ?
Oui, mais je ne veux pas commenter ça, ce n’est pas mon rôle. Ce que je peux dire, c’est que je suis heureuse que l’académie des César ait réagi dès qu’elle a su que Sofiane était poursuivi, dès les révélations du Parisien. Son nom a été immédiatement retiré de la liste, et l’Académie réfléchit à un changement de son règlement.. Je trouve positif qu’au moins, ce type d’affaires puisse permettre de faire changer les choses. Ce qui s’est passé avec l’affaire Polanski, sous l’ancienne direction, semble ne plus pouvoir se reproduire aujourd’hui, et je trouve ça très bien que l’institution évolue. Plusieurs cinémas ont déprogrammé Les Amandiers. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Cela me chagrine, mais je peux le comprendre. Si des cinémas se sentent mal à l’aise à l’idée de programmer Les Amandiers, je respecte ce choix, et j’ai d’ailleurs envoyé un communiqué aux exploitants dans ce sens. Ils sont confrontés au public tous les jours, ils ont vis-à-vis de lui une responsabilité, doivent lui rendre des comptes, et je conçois que ce soit compliqué pour eux de mettre à l’affiche un film dont l’acteur principal est accusé de viol. Je n’ai aucun souci avec ça. De la même manière que je n’ai aucun souci avec le fait que des gens, pendant le tournage, aient voulu quitter le plateau. Je trouve tout cela malheureux pour le film mais je le comprends. Comment envisagez-vous la suite ?
Patrick (Sobelman) et moi-même avons reçu énormément de messages de collègues producteurs qui, comme nous, se demandent comment gérer ce type de situations à l’avenir. Pour l’instant nous n’avons pas de pistes, nous sommes sous le choc, mais je pense en effet qu’il faut entamer, tous ensemble, une réflexion collective. ------------------------------------------------ Affaire Sofiane Bennacer : Sandra Nkaké, au casting des “Amandiers”, “sous le choc et en colère” Par Valérie Lehoux dans Télérama - 27 nov. 2022 Sandra Nkaké, chanteuse et comédienne, figure au générique des “Amandiers”, le film de Valeria Bruni Tedeschi dont l’acteur principal, Sofiane Bennacer, est mis en examen pour viol. Pour elle, cette affaire illustre une fois de plus le peu de cas que l’on fait de la parole des femmes. Chanteuse et comédienne, Sandra Nkaké a participé au tournage des Amandiers, film de Valeria Bruni Tedeschi au centre d’un scandale – l’un de ses acteurs principaux, Sofiane Bennacer, étant accusé de viols et de violences, visé par une plainte et mis en examen. La réalisatrice y a répondu dans un communiqué, brandissant la présomption d’innocence. Elle assume pleinement le fait d’avoir confié un rôle central au comédien de 25 ans, même si, dit-elle, elle avait eu vent de « rumeurs » à son sujet ; quant au dépôt d’une plainte à son encontre, elle l’avait appris juste après le début du tournage. Valeria Bruni Tedeschi qui dénonce par ailleurs un « lynchage médiatique », l’affaire ayant fait, ce vendredi 25 novembre, la une du quotidien Libération. Le même jour (en l’occurrence, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes), Sandra Nkaké publiait sur Instagram une vidéo et un texte, dans lesquels elle explique avoir été victime d’inceste durant l’enfance : « Personne ne m’a protégée, personne ne m’a écoutée… » Réagissant au scandale des Amandiers, elle nous dit sa stupeur et sa colère. Lire aussi : “Les Amandiers” déprogrammé d’un cinéma : “On ne peut plus montrer le film de manière anodine”3 minutes à lire « Je suis sous le choc.
Sous le choc, parce qu’encore une fois des victimes sont niées dans leurs souffrances.
Sous le choc, parce que tourner avec Valeria Bruni Tedeschi a été un travail intense, incarné et profond. Je lui suis reconnaissante de la confiance qu’elle m’a portée. Mais cette reconnaissance a aujourd’hui un goût amer. Je n’étais pas au courant de ces accusations, je n’en ai pris connaissance qu’en écoutant la radio avant-hier. Si je l’avais été, je n’aurais pas pu accepter le rôle. Et je suis en colère. La violence subie fait partie de ma vie. Découvrir ces accusations ainsi, soudainement, après le tournage, est une chose très violente. Tout le monde me pose la question : “Est-ce que tu savais ?” J’ai tourné quatre jours et devant moi, cela n’a jamais été évoqué, ni en rendez-vous, ni en répétitions, ni pendant le tournage. À aucun moment. J’apprends que des personnes, qui étaient au courant, ont quitté le projet et l’ont fait en silence, parce qu’elles n’ont pas été accompagnées. Nous portons une responsabilité collective sur la manière dont nous nous engageons dans la vie et dans le travail. Quand je constitue une équipe pour une tournée, cela fait partie de nos toutes premières discussions : avant même de parler de musique, de planning, de cachets, nous nous demandons dans quel environnement nous voulons travailler, avec quel genre de partenaires, quelles règles de comportement… C’est un préalable important. Et cela me fait mal au ventre de penser qu’on peut jouer ensemble, faire une fête de fin de tournage, se retrouver sur les marches de Cannes… Alors que beaucoup savent, et ne parlent pas. C’est insupportable. Cette histoire pose une fois de plus la question de la prise en compte de la parole des victimes présumées. Elles ne sont jamais mises au rang de sujets, ou très peu. Cinq ans après #MeToo, il est important de continuer de nous fédérer, et de lutter. Les choses avancent-elles trop lentement ? Au regard de nos exigences, peut-être. Mais si l’on remet tout cela dans la perspective de l’Histoire, si on les regarde à travers le prisme de siècles et de siècles où la parole des victimes a été niée, alors oui, on avance. Lentement. Mais on avance. » Lire aussi : Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé3 minutes à lire Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé L’acteur de 25 ans à l’affiche du film “Les Amandiers” est mis en examen pour viols sur des ex-compagnes, dont au moins une comédienne. Y a-t-il eu une faille dans le système ? Stanislas Nordey, qui a encadré Sofiane Bennacer au TNS, assure avoir activé tous les leviers à sa disposition. Mis en examen en octobre pour viols et violences sur d’anciennes compagnes, l’acteur Sofiane Bennacer (25 ans), découverte du film de Valéria Bruni Tedeschi Les Amandiers, vient de voir son nom retiré de la liste des révélations concourant aux César 2023. Ainsi en a décidé une académie des César soucieuse de ne pas revivre l’onde de choc qui avait suivi, en février 2020, le sacre de Roman Polanski. « Sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées », l’académie a donc fait le choix de la prudence. Désormais placée sous les feux des projecteurs, « l’affaire » Sofiane Bennacer aurait débuté dans l’intimité d’un couple. En septembre 2018, le jeune Marseillais intègre la classe préparatoire qui vient d’être créée au sein du théâtre La Filature, à Mulhouse. Il y rencontre Juliette, étudiante originaire de la ville. « Il semblait clair qu’entre eux se nouait une relation amoureuse », témoigne Monica Guillouet-Gélys, ex-directrice de la Filature qui se dit aujourd’hui « très triste de ce qui se passe ». Ni elle ni son équipe n’ont « été témoins de quoi que ce soit ». Dès la fin des cours, rappelle-t-elle, les élèves étaient priés de quitter les locaux. « Si quoi que ce soit avait eu lieu chez nous, nous l’aurions vu. » Le viol présumé aurait eu lieu à cette époque sans que Juliette en fasse alors état auprès de l’établissement. Deux plaintes supplémentaires À l’automne 2019, le jeune couple est séparé. Sofiane rejoint l’École du Théâtre national de Strasbourg où il vient d’être admis. Juliette, recalée, redouble avant de finalement réussir, un an plus tard, ce même concours du TNS. « Réaliser qu’on n’est pas consentant à un acte sexuel, cela peut prendre du temps. Est-ce de retrouver Sofiane deux ans après les faits qui a réactivé chez Juliette certaines choses ? » s’interroge Stanislas Nordey. Disant hériter d’une « situation privée entre deux adultes », le directeur du TNS assure avoir activé tous les leviers à sa disposition. « Dès que Juliette m’a dit vouloir porter plainte, j’ai immédiatement fait, comme nous y oblige la loi, un signalement au procureur de la République. J’ai alerté les associations et le ministère de la Culture. J’ai conseillé à Sofiane de s’éloigner pour apaiser les esprits. Il a pris des congés. Lorsqu’il est revenu, il a donné sa démission. Pour nous qui nous étions assurés que Juliette n’était plus en danger, l’histoire s’arrêtait là. » L’institution n’aurait donc pas failli dans sa prise en charge. Mais aujourd’hui, deux femmes de plus ont, elles aussi, porté plainte, a-t-on appris dans Le Parisien. Lire aussi : Étincelante dans “Les Amandiers”, Nadia Tereszkiewicz, l’étoile polaire2 minutes à lire Le TNS aurait-il dû aller plus loin et en avait-il les moyens ? « Certains élèves me demandaient de virer Sofiane mais je n’en ai pas le droit. Nous ne sommes pas force de justice ou de police », explique Stanislas Nordey, qui n’avait jamais eu à gérer ce genre de situations. Il a donc suivi à la lettre les préconisations du ministère de la Culture. Mis en place par Roselyne Bachelot-Narquin en novembre 2021, un « Plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant » conditionne désormais le versement des subventions au respect de certaines obligations. Parmi celles-ci, la mise en place de cellules d’écoute et la présence de référents dans les établissements nationaux du spectacle vivant. “C’est lorsqu’on se croit en sécurité que le danger peut revenir” Est-ce suffisant pour rassurer les élèves et éviter le dérapage qui voit un mot déplacé se transformer en geste inacceptable ? « Non. Il faut aller bien au-delà », répond Claire Lasne Darcueil. La directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) dispose d’une cellule d’écoute interne et d’une seconde, externe, au sein de l’université Paris Sciences et Lettres. À l’en croire, c’est une chance : « Notre maison est petite. Les choses se savent vite. Il faut une adresse au-dehors pour que les élèves s’expriment en toute liberté. » La patronne du CNSAD est par ailleurs de celles qui tranchent dans le vif : « C’est lorsqu’on se croit en sécurité que le danger peut revenir. La meilleure façon de sécuriser réellement les jeunes acteurs qui viennent parler, c’est parfois d’avoir le courage de demander aux incriminés de partir. Même si ça m’a coûté, je l’ai fait à quatre reprises au sein du Conservatoire. » La mesure est radicale mais, précise Claire Lasne Darcueil, « elle est autorisée par le Code l’éducation dont disposent les directeurs, et qui permet, après commission de discipline, la suspension temporaire ou définitive en cas de mise en danger des étudiants ». Si cette mesure a le mérite de désamorcer les problèmes en leur coupant d’emblée l’herbe sous le pied, elle peut aussi passer pour très expéditive. Pour éviter d’en arriver là, c’est à la racine du problème qu’il faudrait pouvoir s’attaquer : « Éduquer nos garçons et faire en sorte que les filles parlent plus vite », souffle Monica Guillouet-Gélys. Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" ------------------------------------------ Légende photo : L’acteur Sofiane Bennacer au Festival de Cannes, le 23 mai 2022, pour la présentation du film de Valeria Bruni Tedeschi, « Les Amandiers ». STÉPHANE MAHE/REUTERS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2022 6:45 AM
|
Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 18/11/2022 Avec Prénom Nom, l’auteur et metteur en scène Guillaume Mika poursuit son passionnant et très ludique entremêlement du théâtre et des sciences. « Fiction génétique », cette nouvelle création qui a vu le jour au Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap nous offre d’assister à une expérience unique : la tentative de scolarisation d’un tardigrade – animal en principe microscopique – à taille humaine. Avec Prénom Nom, l’auteur et metteur en scène Guillaume Mika poursuit son passionnant et très ludique entremêlement du théâtre et des sciences. « Fiction génétique », cette nouvelle création qui a vu le jour au Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap nous offre d’assister à une expérience unique : la tentative de scolarisation d’un tardigrade – animal en principe microscopique – à taille humaine. Vêtu d’une blouse blanche, rendu presque méconnaissable par une perruque sans équivoque quant à l’indifférence de son personnage à son apparence, Guillaume Mika donne d’emblée sur la scène de Prénom Nom une présence concrète à la science. L’objet de la grande passion du chercheur qu’il incarne est minuscule : le tardigrade, animal d’environ 0,5 mm. Un bref exposé, dont certains signes nous font anticiper les dérives, nous permet de commencer à comprendre la monomanie et les cheveux longs du protagoniste. Largement agrandie grâce à la caméra branchée à un microscope, la créature translucide que l’on voit s’agiter sur le mur du théâtre est, apprend-on, la plus indestructible de la planète. Le zéro absolu ne menace en effet pas plus la vie du tardigrade que les rayons X. Il peut se reproduire seul au cas où il ne trouverait pas de partenaire sexuel à la hauteur de ses ambitions. Il résiste au vide spatial et, dans des conditions insuffisantes à ses besoins, il peut s’auto-déshydrater pour entrer en « cryptobiose », activité métabolique très ralentie dont il peut sortir dès que les choses prennent pour lui un tour meilleur. C’est cette particularité qui retient particulièrement l’attention de la communauté scientifique depuis une dizaine d’années, tout comme celle de Guillaume Mika. Ce qui n’est pas un hasard : avec sa compagnie Des Trous dans la Tête, dont Prénom Nom est la quatrième création, l’auteur et metteur en scène entend défendre le dialogue entre arts et sciences et en faire le cœur de son théâtre accueillant à bien d’autres langages encore. À la musique et à la vidéo que l’artiste très polyvalent pratique lui-même, mais aussi à la danse ou au cirque. Ce goût du grand mélange ou, selon les termes de Guillaume Mika, de l’« Informe, de l’incohérence », préserve Prénom Nom de tout excès de pédagogie. Ce qui était déjà le cas dans la précédente création de Des Trous dans la Tête, La Flèche, où pour nous faire entrer dans le cerveau de Frederic Winslow Taylor, le théoricien de l’Organisation Scientifique du Travail, l’artiste et les comédiens Heidi-Eva Clavier et Maxime Mikolajczak construisaient à vue, tout au long de la pièce, une machine étrange. Une sorte de cinématographe à pédales qui prouvait le talent de Guillaume Mika à dire le scientifique, le complexe avec une drôlerie attenante à l’absurde. Avec aussi une théâtralité à la fois concrète, physique parce que bricoleuse, et savante. Dans Prénom Nom, l’artiste touche-à-tout, anti-spécialiste convaincu, réussit de nouveau son subtil mélange d’ingrédients très divers. À la fin de son introduction à la vie incroyable des tardigrades, Guillaume Mika nous présente le personnage central de sa pièce, qui place d’emblée celle-ci à distance de La Flèche, beaucoup plus proche de l’absurde. Car le héros du spectacle n’est pas le scientifique, mais la créature qu’il a pour mission d’étudier, si extraordinaire que son existence semble beaucoup plus adaptée au cinéma ou à la littérature qu’au théâtre. C’est justement ce qui intéresse Guillaume Mika : avec son tardigrade géant prénommé Lucas, il met le théâtre au défi de l’irreprésentable. Il s’en sort avec une fiction à l’image de son animal : complètement invraisemblable. Le scientifique y est déguisé en employé de Centre d’Information et d’Orientation (CIO), sous la direction d’une conseillère-psychologue incarnée par Heidi-Eva Clavier. Dans un décor de CIO quelque peu adapté aux particularités de la grosse bestiole, le biologiste tente de provoquer la cryptobiose de l’objet de toutes leurs curiosités. Leur stratégie : faire subir à ce dernier un processus d’orientation. Dans le cadre hybride où se déroule la pièce – les apparences CIO masquent mal le laboratoire qu’elles sont sensées cacher –, Guillaume Mika a l’art d’insérer bien des formes et des histoires, qui toutes sont des tentatives d’angoisser l’animal fantastique pour l’amener à ralentir son métabolisme. La théorie de la « récapitulation embryonnaire » de Ernst Von Haeckel, selon laquelle un embryon d’une espèce récapitule pendant son développement tous les caractères des espèces avant lui, côtoie ainsi différentes méthodes appliquées à l’orientation scolaire ou encore un mythe grec. On le devine à la précision avec laquelle ils sont abordés, tous ces domaines ont fait l’objet de recherches approfondies, de rencontres entre l’équipe artistique et des spécialistes. S’il a des Trous dans la Tête, Guillaume Mika sait très bien les remplir. Construit autour de la créature, incarnée par le contorsionniste Adalberto Fernandez Torres qui habite à merveille son costume plus réaliste que le CIO où il évolue, l’ensemble est d’un ludique et d’une cohérence des plus réjouissantes. Le grotesque de la bestiole, à la gestuelle très précise, riche en effets comiques, agit dans la pièce tel un véhicule très accueillant, très grand, à l’intérieur duquel peuvent se penser ensemble des sujets aussi apparemment éloignés que notre rapport au vivant et les évolutions du système scolaire en France. Avec Guillaume Mika et ses complices, on pense de tant rire, et inversement. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr Prénom Nom Écriture et mise en scène Guillaume Mika Cie Des Trous dans la Tête Collaboration artistique et à la dramaturgie Samuel Roger
Avec Adalberto Fernandez Torres, Heidi-Eva Clavier, Guillaume Mika
Création tardigrade et costumes Aliénor Figueiredo assistée de Julie Cuadros
Scénographie et accessoires Mathilde Cordier
Lumières et régie générale Léo Grosperrin
Vidéo Valery Faidherbe
Musique Vincent Hours
Collaboration au mouvement Violeta Todo-Gonzalez
Construction Alexis Boullay
Collaboration tardigrades Laurence Héchard
Assistanat technique Rose Bienvenu
Administration Shanga Morali / Mozaïc
Diffusion Claire Novelli Coproduction : Théâtre Joliette, Scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines, Marseille ; Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; Le Carré Sainte-Maxime ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le théâtre des Halles, Avignon ; Théâtre de Vanves, Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts ; Le Cube – Studio Théâtre d’Hérisson
Soutien et accueil en résidence : La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle ; Le Lieu Multiple, pôle de création numérique de l’Espace Mendès France, Poitiers ; Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt national art et création, Château-Arnoux-Saint-Auban ; La Nef – Manufacture des Utopies ; Le Lieu – fabrique de création à Gambais
Soutien : la Ville de Toulon ; la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ; le Département du Var ; la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur ; la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur Durée : 1h20 Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap
Les 17 et 18 novembre 2022 Carré Sainte-Maxime
Les 5 et 6 décembre 2022 Le Liberté – Scène nationale de Toulon
Les 14 et 15 décembre 2022 Théâtre Joliette – Marseille
Du 1er au 4 février 2023 Théâtre de Vanves
Du 7 au 10 février 2023 Théâtre des Halles – Avignon
Les 12 et 13 avril 2023 18 NOVEMBRE 2022/PAR ANAÏS HELUIN Crédit photo : Jean-Pierre Estournet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 24, 2022 5:23 AM
|
Par Jacques Morice dans Télérama - Publié le 23/11/22
Ado, il se rêvait garde forestier et rien ne le destinait au métier de comédien. Mais en trente ans de cinéma, Sami Bouajila a su incarner tous les rôles avec une sensibilité et une maîtrise rares. Émouvant. Avec beaucoup de pudeur et de dignité, pour éloigner le pathos. C’est ainsi que ce grand comédien consciencieux nous touche, depuis près d’une trentaine d’années. Sans doute parce qu’on parvient à lire, en deçà de ses prestations solides, une part intime. Une fêlure. Sami Bouajila est un écorché vif. On l’a senti en interview. À sa manière exigeante de chercher le mot juste, de ne pas se satisfaire des raccourcis, de s’échauffer un peu. Mais il y a du mieux. « Je me soigne dorénavant, devance-t-il, lucidement. J’étais torturé, sans vraiment m’en rendre compte, en me disant que tout le monde l’était pareillement. Je faisais du coup souffrir quelqu’un, qui m’a poussé à faire un diagnostic. Il se trouve que je suis bipolaire. Bon, je sais, c’est en vogue, mais voilà, c’est un fait. » Passage sur le divan, prise de thymorégulateurs, recours à la méditation : il balance tout cela sans ambages. Sacrée franchise. Cet hypersensible a longtemps tenu une place à part dans le paysage du cinéma français. On se disait qu’il ne jouissait peut-être pas de la reconnaissance qu’il méritait. De fait, elle est arrivée, à travers plusieurs récompenses : un César du meilleur second rôle masculin pour Les Témoins en 2008, un autre l’an dernier comme meilleur acteur pour Un fils, un Prix d’interprétation masculine collectif à Cannes pour Indigènes en 2006… Lui-même admet que sa place excentrée était à la fois subie (« Je me sentais invisible ») et voulue. « Je suis quelqu’un de discret. J’ai longtemps vécu à la montagne, dans un village d’Isère. Loin de Paris. » Cette semaine, il est de nouveau formidable et surprenant, dans Les Miens. Il y joue Moussa, un homme gentil et doux, victime d’un traumatisme crânien qui le transforme en une sorte de robot à la parole sans filtre. Un révélateur féroce et drôle disant à ses proches leurs quatre vérités, les obligeant à un examen de conscience. C’est le deuxième film, après Omar m’a tuer, qu’il tourne sous la direction de Roschdy Zem, qu’il appelle « Rosch ». Plus qu’un ami, son « grand frère » dans la vie et le film, sur lequel il ne tarit pas d’éloges. « Il a un détachement que j’ai mis un temps fou à acquérir, moi qui suis plus besogneux. Je l’ai vu s’épanouir en tant que personne, j’ai vu sa parole s’affûter. Sur le plateau, le peu qu’il me dit suffit. Je marche dans ses pas. On a une complicité, comme une cordée. On s’épaule pour franchir les voies. On a appris ensemble à faire fleurir notre métier. » On se dit que ce parcours en commun est presque trop beau. Pas de rivalité ? « Il y en a eu à notre insu, au début. Le système était tel que c’était lui ou moi, on se piquait les rôles », sourit-il. C’était à l’aube des années 1990, cette époque qui semble lointaine, où Roschdy et lui ont joué un rôle pionnier, en étant les premiers « Beurs », comme on disait alors, à galvaniser le cinéma français d’un sang neuf. Chacun avec son style : plus acteur félin, impénétrable et masculin, du côté de Roschdy. Plus comédien de composition, à l’anglaise, du côté de Sami. Car ce qui frappe chez ce dernier, c’est qu’il a tout joué, avec une grande subtilité, déjouant bien des stéréotypes. Jardinier chétif et taiseux accusé d’un crime (Omar m’a tuer), gynécologue marqué par la guerre civile à Alger (Les Bienheureux), policier hétéro qui tombe amoureux d’un jeune garçon (Les Témoins), sans-papiers vivant de petits boulots (La Faute à Voltaire), gay séropositif et pourtant plein d’allant traversant la France en auto-stop (Drôle de Félix), caporal révolté (Indigènes), assassin en puissance d’un père haï (Léo en jouant « Dans la compagnie des hommes »). Il a pu être un clown inoubliable – son rôle de coiffeur, amoureux transi, piquant une colère en pur mandarin, dans De vrais mensonges, de Pierre Salvadori. Comme le leader sombre, puissant et impassible d’un gang (Braqueurs). Ce talent, il l’a acquis sur les planches, où il a joué Shakespeare et Koltès. C’est au conservatoire régional puis à l’école de La Comédie de Saint-Étienne, auprès de François Cervantes, que s’est formé l’ancien gamin d’une cité d’Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Le théâtre n’était pas une vocation, mais ce fut une révélation. Complexé, avec juste un CAP de tourneur en poche, il découvre sur le plateau qu’il a enfin droit à la parole et qu’au-delà des mots c’est tout son corps qui devient « expressif ». “J’étais très cinéphile, assoiffé de culture. Il y avait alors à Paris tout le jeune cinéma français, autour d’Éric Rochant et Arnaud Desplechin.” Il monte ensuite à Paris, écumant les salles de cinéma. « J’étais très cinéphile, assoiffé de culture. Il y avait alors un vivier de création formidable, tout le jeune cinéma français, autour d’Éric Rochant et Arnaud Desplechin. » Il découvre aussi Elia Kazan et Frank Capra, deux réalisateurs « issus tous deux d’un milieu populaire » qui incarnent magnifiquement à ses yeux le cinéma « bigger than life » (« plus grand que la vie »). Il tourne quelques films dans la capitale mais peine à y trouver sa place. C’est à Marseille que les portes s’ouvrent, grâce à Bye-Bye (1995) et sa rencontre décisive avec Karim Dridi. Avec lui, il a un point commun : la Tunisie. C’est le pays d’où sont originaires ses parents. Un ancien protectorat français « sans les tensions qu’il y avait en Algérie ». Il y allait enfant chaque été, jusqu’à ses 16 ans. L’acteur, franco-tunisien, perçoit sa double culture comme un enrichissement formidable. « Ça débordait de vie dans ma famille, comme dans la comédie italienne. Mes aïeuls avaient eux aussi une culture composite, à la fois arabe et francophone. Ils savaient parfois plus de choses que moi sur la France. » S’il ne considère pas forcément que la France a raté l’intégration puisque lui-même se vit comme un cas de réussite, il constate qu’aujourd’hui la jeunesse ne bénéficie pas du même soutien. « L’Éducation nationale devrait faire plus d’efforts pour parvenir à créer une citoyenneté commune, pour apaiser les traumas et faire en sorte que nos différences soient une force. » De la force, il en a pour traquer la part d’humanité de ses personnages. Les extirper des rets de l’Histoire, les élever. Sa beauté élancée et sèche lui donne le profil d’un champion. Pas seulement parce qu’il a joué le premier concurrent algérien d’une épreuve de ski de fond aux JO d’hiver, dans l’attachante comédie sociale Good Luck Algeria (2015). Celui qui aime la nature et songeait, ado, à devenir garde forestier a longtemps pratiqué de manière intensive la natation, le jogging, la randonnée. « Être comédien, c’est avoir une hygiène de vie », dit-il. On hasarde que les contre-exemples ne manquent pas, à commencer par Gérard Depardieu. Il rétorque aussitôt : « Détrompez-vous : c’est un athlète de l’affectif. Qui encaisse très bien les coups et les émotions. » « Athlète de l’affectif » : à lui aussi, la formule va à ravir. À voir
Les Miens, de Roschdy Zem. En salles. Légende photo : Sami Bouajila : « J’ai longtemps vécu à la montagne, dans un village d’Isère. Loin de Paris. » Photo : Roberto Frankenberg

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 23, 2022 11:37 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 23 nov. 2022
Une partie des spectacles, prévus initialement dans le futur complexe Iconic, se dérouleront dans les arènes romaines de Cimiez.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/23/changement-de-decor-pour-la-programmation-du-theatre-national-de-nice_6151290_3246.html
Et maintenant, un théâtre en plein air. Le redéploiement du Théâtre national de Nice (TNN), dont la démolition du bâtiment historique est programmée pour décembre, change subitement de nature. Ainsi en a décidé, lundi 21 novembre, Christian Estrosi en accord avec Murielle Mayette-Holtz. Le maire de la ville et la directrice du Centre dramatique national (CDN) Nice-Côte d’Azur abandonnent l’idée de programmer une partie des spectacles du TNN dans la future salle de 500 places du complexe immobilier Iconic, à deux pas de la gare. Ils lui préfèrent désormais les arènes romaines de Cimiez, au nord de la ville. Après des travaux d’aménagement, des premières représentations devraient s’y tenir cet été afin d’« expérimenter » l’amphithéâtre à ciel ouvert. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Drôle de drame autour du Théâtre national de Nice Cette « idée nouvelle, permettant la valorisation du TNN, a émergé suite à des échanges avec la direction du théâtre, explique Christian Estrosi dans une longue lettre adressée, jeudi 17 novembre, à la ministre de la culture Rima Abdul-Malak, dont Le Monde a eu connaissance. Ce projet est d’ores et déjà en phase d’études (…) Je vous saurais gré de m’accorder votre aval afin de lancer rapidement ces travaux », poursuit l’élu. Une rencontre entre la ministre et le maire est prévue la semaine prochaine rue de Valois pour aborder, notamment, cette nouvelle et soudaine évolution du projet. C’en est donc fini d’Iconic retenue initialement pour être l’une des trois salles dévolues à l’accueil de la programmation du TNN. Après l’ouverture, fin avril, de la salle des Franciscains (300 places) dans le Vieux Nice, puis, le 20 mai, de celle du théâtre éphémère La Cuisine (600 places), à l’ouest de la ville, l’espace Iconic (un programme immobilier privé financé par la Compagnie de Phalsbourg) devait, dès janvier 2023, proposer des spectacles du CDN. Mais à quelques semaines de son ouverture, la mairie renonce à signer le bail. « Plafond trop bas, scène trop petite », cette salle « ne paraît pas être la meilleure option », justifie Christian Estrosi. Revirement critiqué Ce revirement est vivement critiqué par l’opposition locale. « Impréparation, improvisation, gâchis », dénonce Juliette Chesnel-Leroux, présidente du groupe écologiste au conseil municipal. Tandis qu’Eric Ciotti, député LR et vice-président du département des Alpes-Maritimes, évoque « une faute culturelle et économique ». Lors des questions au gouvernement, mardi 22 novembre à l’Assemblée nationale, l’éternel rival du maire niçois a « demandé solennellement à la ministre de la culture de revenir sur la décision d’autorisation de la destruction du TNN ». Quel que soit leur bord politique, les opposants estiment que la mairie ne tient plus ses engagements vis-à-vis du ministère. Dans un courrier en date du 2 décembre 2021 adressé à Christian Estrosi, l’ancienne ministre Roselyne Bachelot avait conditionné l’autorisation de destruction du bâtiment du TNN à la réalisation de trois nouvelles salles. Son feu vert était délivré, écrivait-elle, « sous réserve des assurances que vous pourrez donner à mon administration concernant la livraison en 2022 des trois équipements nécessaires à la poursuite de l’activité du CDN. Je tiens à ce que la continuité soit assurée, notamment dans la programmation et dans le travail des équipes artistiques. » Or, les arènes de Cimiez ne pourront être utilisées qu’aux beaux jours et non toute l’année. Quant à la grande salle « de prestige » de 800 places promise dans le futur Palais des arts et de la culture, elle ne devrait pas ouvrir avant 2026. Pour 2022, le budget de fonctionnement d’un théâtre désormais multisites a été augmenté, à titre prévisionnel, de 300 000 euros pris en charge à moitié par la municipalité niçoise et par l’Etat En 2021, les subventions allouées au CDN étaient de 3,924 millions d’euros (1,57 million financé par l’Etat, 1,52 par la ville, 600 000 euros du département et 234 000 de la région). Pour 2022, le budget de fonctionnement d’un théâtre désormais multisites a été augmenté, à titre prévisionnel, de 300 000 euros pris en charge à moitié par la municipalité niçoise et par l’Etat. Mais le nouveau projet des arènes de Cimiez (nécessitant tribunes démontables, équipements scéniques, régie couverte, etc.) change la donne. « La ville de Nice est pleinement consciente de l’impact financier de cette stratégie résolue de développement territorial de son CDN. En conséquence, elle s’est d’ores et déjà engagée auprès de la SA TNN par un accroissement significatif de son soutien financier, désormais majoritaire parmi les subventions publiques de cette institution », écrit Christian Estrosi dans sa lettre à Rima Abdul-Malak sans préciser le montant. Muriel Mayette-Holtz – qui dirigera également, à compter du 1er janvier 2023, la Villa Ephrussi de Rothschild de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) – se dit « ravie » d’occuper prochainement les arènes de Cimiez. Elle qui avait mis en scène, en 2019, Les Troyennes dans le grand théâtre grec à ciel ouvert de Syracuse (Sicile), envisage de créer en 2024 dans l’amphithéâtre niçois un festival international dédié à la tragédie antique. Quant à Christian Estrosi, il considère que la réorganisation de l’offre théâtrale locale viendra « appuyer la candidature de Nice au label de capitale européenne de la culture en 2028 ». De son côté, le ministère, comme pris de court, refuse de communiquer sur ce dossier avant la rencontre avec le maire. Sandrine Blanchard Légende photo : Le Théâtre National de Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur) par l’architecte Yves Bayard, le 9 février 2022. PROCIP/ROBERTHARDING/PHOTONONSTOP/YVES BAYARD/ADAGP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2022 5:42 PM
|
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog - 22 nov. 2022 Dans un dispositif scénique bi-frontal, un radeau aux voiles salies et pendantes.
On reconnaît aussitôt le fameux Radeau de La Méduse (1818-1819) de Théodore Géricault, avec ses plus de trente-quatre m2 d’effroi, aux corps et flots tourmentés.
Une peinture exemplaire, d’une puissance et d’une exactitude qui force l’admiration depuis qu’il a été exposé pour la première fois sous la Restauration.
Cécile Feuillet et sa compagnie Marée Basse se sont emparées de ce qui pourrait être l’emblème de notre époque : en deux mots, l’humanité va à la catastrophe. Voyez seulement les déceptions engendrées par les COP successives sur le climat, sans parler du pire. Avec ce Et puisque départir nous fault, l’angoisse des temps donne ceci : puisque le navire est à moitié naufragé et qu’on ne sait pas où on va, allons-y, sous la poigne ferme d’une capitaine à la ville comme à la mer. Cécile Feuillet, qui se rêve un peu en Tadeusz Kantor mort en 1990 (voir l’histoire du théâtre au XXème siècle). Presque toujours sur le plateau de ses spectacles, peut-être pour son goût de personnages-marionnettes dont on ne sait trop où est l’âme ? Dans le manipulateur ou dans l’objet ? Revenons au radeau : d’abord considérer ceux qui restent : hommes ou pantins, morts ou vifs ? Puis recruter un équipage : incompétent, trouillard, renâclant, rêveur, maladroit,. Mais tout le monde est embarqué et il faudra bien faire groupe, : c’est cela qui compte. Avec même celui qui surgira dans un éblouissement de lumière, sans pour autant être une révélation.
L’histoire ? Celle de ce rafiot qui finit par recevoir un nom, à défaut de cap. Et plein de magies diverses. Au fond d’une malle, d’abord . C’est par là que commencent les jeux d’enfants et le théâtre. Et aussi sur le bureau de la capitaine qui trouve de l’énergie pour la radio du bord… en branchant la prise sur sa tête! Nous ne vous raconterons pas tout et il n’y a d’autre chronologie ici, que celle d’une dérive dans la «pétole» ou la «bonasse». La mise en scène très précise par ailleurs se soucie peu des durées, variables et pas toujours maîtrisées : la capitaine tenant à laisser une petite place à l’improvisation. Là-dessus, faire confiance au jeu de clown, à chacune le sien, risqué et forcément inégal, tantôt attendu, tantôt surprenant. Mais toujours puissant, entre la répétition de l’échec -mais pourquoi cela fait-il toujours rire ?- et des trouvailles minuscules et triomphantes. Le décor, en rien improvisé, est plutôt le septième personnage de la pièce. Héritier d’un radeau construit avec des laisses de mer sur une île grecque (Ô Ulysse !), il en a gardé le bois poli et blanchi, les voiles à moitié déchirées, les amarres embrouillées en spaghettis. Nous en sentons la matière, le toucher et cela évoque d’emblée un théâtre bricolé, aussi ancien que cet art lui-même, cousin du chariot de Thespis et de la scène roulante envolée dans Molière, le film d’Ariane Mnouchkine. L’équipage, nous nous en apercevons peu à peu, est constitué uniquement de filles : Cécile Feuillet, la capitaine, mais aussi Anaïs Castéran, Jade Labeste, Pauline Marey-Semper, Alice Rahimi, Mathilde Weil. Avec, en renfort pour la scénographie: Diane Mottis, Frank Échantillon et Julien Puginier. Et pour les costumes : Valy Montagu, la lumière : Simon Fritschi) et le son, le musicien Nikola Takov et Marion Cros.
Palme d’or pour la régie-plateau. Ces acteurs sont sortis récemment du Conservatoire National d’Art Dramatique qui mérite bien ses majuscules. Son enseignement confère des responsabilités et c’est ici la première rencontre de ses ex-élèves avec un vrai public, celui souvent jeune du Théâtre de la Cité Internationale et donc à moitié acquis.
Pour le reste, à elles de faire le travail, avec de petites blagues dans le décor comme ce : Merci au public, écrit sur une planchette descendant des cintres, avec la poésie de leurs objets et ce que le public doit inventer à partir de leurs grommelots. Nous entendons quand même quelques paroles, mais ce n’est pas le plus important. Voilà un spectacle à l’écart des modes… à moins que ce ne soit la prochaine. Archaïque, sans complexes comme l’indique le titre choisi mais très rigoureux dans le parti pris… Son équipage peut envisager quelques voyages au long cours. Christine Friedel Jusqu’au 26 novembre, Théâtre de la Cité Internationale, 17 boulevard Jourdan, Paris (XIVème). T. : 01 85 53 53 85. Photographie © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2022 7:29 AM
|
par Anne Diatkine, Envoyée spéciale à Rennes pour Libération - 21 nov. 2022 Machine joyeuse qui rassemble des publics variés, le festival du Théâtre national de Bretagne offre un condensé de pièces ayant fait leurs preuves et de fraîches découvertes qui s’entrechoquent autant qu’elles se font signe. C’est tout de même une chance que de pouvoir hésiter entre Howl 2122 de Laure Catherin, un spectacle d’étudiants en art conçu juste après le confinement qu’on a très envie de voir en raison même de sa matière – l’alliance entre le poème d’Allen Ginsberg écrit en 1955 sur les désirs et les désarrois de la jeunesse américaine, et ceux des étudiants soumis à l’épidémie de Covid aujourd’hui sur le campus de Rennes – et Sur la voie royale d’Elfriede Jelinek monté par Ludovic Lagarde, et incarné par l’exceptionnelle Christèle Tual dont c’est la dernière représentation en 2022 – impossible à rater, donc. Puis de pouvoir se faufiler à la mi-temps de Stadium, ce blockbuster de Mohamed El Khatib avec des comédiens supporteurs de Lens, tous présents cinq ans après la première à la Colline et c’est l’entièreté du théâtre qui est mis sens dessus dessous, fanfare et odeurs de frites comprises. Et encore, d’assister à la (re)création de la Chanson [reboot], le premier spectacle de Tiphaine Raffier qui raconte comment le désir de créer vient à l’esprit d’une toute jeune fille en rupture de ban. Curiosité attisée du public A quoi reconnaît-on qu’un festival est une machine vivante et joyeuse qui s’engouffre dans les rues, prend son élan et suscite un désir partagé qui déborde bien largement le cercle des seuls passionnés de théâtre et des professionnels venant faire leur marché ? Pas seulement au nombre de créations – il y en a beaucoup au festival rennais du Théâtre national de Bretagne (TNB) imaginées par son directeur, le metteur en scène Arthur Nauzyciel, et à l’heure où les spectacles ont des durées de vie de plus en plus courtes, ce type de rassemblement sur un temps concentré sert aussi, et peut-être encore plus, à offrir aux Rennais un condensé de plusieurs saisons. Pas seulement au ratio artistes anciens et fraîches découvertes, même si on a hâte de voir Par autan de François Tanguy, notamment. C’est à des petits signes plus impalpables et moins mesurables, qu’on saisit qu’un festival prend : la curiosité attisée du public qui remplit la jauge effroyable et absurde de 930 places, y compris lorsque c’est un monologue particulièrement ardu signé d’Elfriede Jelinek qui est à l’affiche. Ou la manière dont les œuvres s’entrechoquent et se font signe : comment résonne par exemple la tessiture de la prix Nobel Jelinek grâce à la performance ultra-ouvragée de Christèle Tual, qui ne cesse de se métamorphoser à vue et glisse d’une figure à l’autre, en duo avec la maquilleuse habilleuse Pauline Legros, et la simplicité bouleversante de Marie-Sophie Ferdane, lorsqu’elle lit Notre Solitude de Yannick Haenel, sans chercher le moins du monde à s’interposer entre les images que suscitent la lecture et l’écoute. La scène est donc transformée en boîte blanche et éblouissante, avec un fauteuil tulipe, pour Sur la voie royale de Jelinek. Deux lycéens anxieux, derrière nous : «1h40 ! Je prie pour que mon téléphone ne sonne pas.» Ils seront saisis, les mouches absentes, ne volent pas, mais on les entendrait s’il y en avait. Christèle Tual arrive telle qu’en elle-même, haut de survêtement, et c’est immédiatement qu’elle nous entraîne dans l’écriture sphérique de Jelinek, ce monologue entamé la nuit de l’élection de Donald Trump, se métamorphosant tantôt en voyante aveugle, en Jelinek elle-même, puis en Donald Trump ou sa femme Melania, poupée Barbie de synthèse. Défier la mort Incroyable est la manière dont Christèle Tual se laisse maquiller, démaquiller, coudre les yeux, perruquer, habiller sans jamais interrompre une logorrhée parfaitement intelligible et insaisissable, sans point d’appui dans le glissement d’une identité à l’autre. Le spectacle est promis à tourner en 2023-2024. La comédienne dira ensuite qu’évidemment, l’apprentissage du monologue qui se présente comme l’escalade d’une muraille lisse a été le plus dur, ligne à ligne pendant le confinement, mais aujourd’hui, la langue de Jelinek lui semble limpide, plus aucun silence ou menues variations ne lui échappent. Aux antipodes, autre type de cadeau, avec la lecture de Notre Solitude de Yannick Haenel qui de septembre à décembre 2020 a suivi le procès de la tuerie du 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo. Jean noir, tee-shirt blanc, cheveux relevés mise de l’effacement, dans une toute petite salle : magnifique est la manière dont Marie-Sophie Ferdane s’efface pour laisser vivre un texte, qui parle tout autant de l’écriture, de la paralysie ou de son impossibilité d’autant plus gigantesque que l’auteur se donne pour tâche de défier la mort tant qu’il écrira. Marie-Sophie Ferdane porte le livre qu’elle lit, passeuse dégagée de l’incarnation et du par cœur, qui avance au rythme des phrases, dont la voix rend sensible toutes sortes d’images pas seulement horrifiques. «Je ne veux pas passer par la force, je veux croire en la fragilité comme une façon de s’intéresser au monde», dit Yannick Haenel. C’est chose faite avec cette lecture. Anne Diatkine / Libération Festival du Théâtre national de Bretagne à Rennes, du 15 au 27 novembre. Légende photo : «La Chanson» [reboot]», premier spectacle de Tiphaine Raffier, raconte comment le désir de créer vient à l’esprit d’une toute jeune fille en rupture de ban. (Photo :Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 12:28 PM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 21 nov. 2022 En compagnie de quatre jeunes et talentueux comédiens, Fanny de Chaillé plonge, avec une gourmandise non feinte et une ironie mordante, dans la pratique et la fabrique de l’art dramatique, et dessine un panorama drôle, enlevé et d’une infinie richesse. « […] C’est impossible de raconter l’histoire du théâtre, ça dure depuis des siècles, c’est dans tous les pays du monde. Déjà on a du mal à maîtriser l’histoire du théâtre et là en plus on veut en faire une autre… » D’emblée, Fanny de Chaillé mesure la difficulté du pari qu’à travers un simple titre elle s’est imposé : tricoter Une autre histoire du théâtre. Avant elle, le metteur en scène Milo Rau a lui aussi tenté cette expérience au long de son cycle Histoire(s) du théâtre. Pour éviter de tomber dans le piège de la leçon rébarbative, de l’exposé réservé aux spécialistes, de la recension chronologique, et forcément lacunaire, le directeur du NTGent a choisi de procéder par étapes, de demander à des artistes – Faustin Linyekula, Angélica Liddell, Miet Warlop, et bientôt Rabih Mroué – de plonger à sa suite dans l’histoire de leur théâtre et d’y réfléchir comme forme d’art. Afin d’enjamber les mêmes chausse-trapes, Fanny de Chaillé a également pris la tangente. Sur la scène du Théâtre Public de Montreuil, elle a confié à quatre jeunes comédiens le soin d’interroger leurs pratiques du théâtre, sa fabrique et ses évolutions, et transforme ce qui aurait pu être scolaire, élitiste et ennuyeux en expédition intime et universelle, drôle et brillante. Ce quatuor bourré de talent, la metteuse en scène l’a rencontré lors de sa dernière création, Le Chœur, proposé dans le cadre du dispositif Talents Adami Théâtre. À chacune et chacun de ses membres, âgés de 25 à 30 ans, elle a réclamé des pierres pour bâtir un édifice commun fait d’archives mémorables et de retours d’expérience, de grands moments de théâtre et de petits instants de vécu, de textes du répertoire et de débats du temps présent. Entre deux discussions collectives, souvent enflammées, s’invitent alors, le plus souvent sans s’annoncer, Louis Jouvet et Jeanne Moreau, Richard III et Hedda Gabler, Pina Bausch et Stella Adler, Phèdre et Elvire, Jerzy Grotowski et Giorgio Strehler, Martin Wuttke qui interprète Arturo Ui et Dario Fo qui décortique L’Illusion comique de Corneille. Loin d’être un vulgaire empilement de références, d’arguments d’autorité et d’anecdotes, cet enchevêtrement s’impose comme un formidable tremplin pour explorer les différentes facettes de l’art dramatique, révéler les mutations et les doutes qui le façonnent, remettre en perspective sa construction, sa fragilité et son humanité. Sur un plateau nu, tout juste équipé de deux micros et éclairé par trois rampes lumineuses, les comédiens s’interpellent, se confient et se réapproprient les monuments et les personnages qu’ils convoquent pour leur redonner vie. Sans avoir l’air d’y toucher, dans un enchaînement d’une remarquable fluidité, ils abordent directement ou par la bande une variété de questions éternelles et contemporaines. Du rôle du spectateur à l’importance plus ou moins relative de la scénographie, des techniques d’interprétation au métier d’acteur, de la toute-puissance discutée et discutable du metteur en scène à la place des femmes, de l’évolution des modes de jeu au rapport au corps, de l’envie de devenir comédien à l’impact de la technique, ils dessinent, au gré des scènes, un panorama d’une infinie richesse. La démarche a quelque chose de jouissif dans sa façon de ne prendre personne de haut, mais plutôt à revers, de porter un regard à la fois touchant, ironique et sarcastique sur le théâtre tel qu’il s’est pratiqué et se pratique encore. À intervalles réguliers, elle parvient même à mettre le doigt sur la magie de l’art dramatique et ses paradoxes : il ne faut rien, et en même temps beaucoup, pour faire théâtre, plus que d’aucuns peuvent en tous cas l’imaginer quand ils sont sagement assis dans leurs fauteuils rouges. Cette réussite qui s’affranchit des codes habituels de toute « histoire », Fanny de Chaillé la doit avant tout à ses jeunes comédiens qui insufflent à sa pièce cette fraîcheur et cette envie de croquer le plateau à pleines dents sur lesquelles les bons spectacles reposent souvent tout entier. Dans un mouvement de va-et-vient constant entre constitution d’un collectif et affirmation de leur individualité, Margot Viala, Valentine Vittoz, Malo Martin et Tom Verschueren passent de la moquerie au plus grand sérieux, d’un personnage du répertoire à leur propre rôle avec une étonnante agilité, et offrent à leur autre histoire cette petite étincelle qui nous rappelle pourquoi nous aimons tant le théâtre et pourquoi chaque soir, ou presque, nous y retournons. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Une autre histoire du théâtre
Conception et mise en scène Fanny de Chaillé
Avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz
Assistant Christophe Ives
Lumières Willy Cessa
Son Manuel Coursin
Musiques Malo Martin
Régie lumière Jérémie Sananes
Régie son Clément Bernardeau Production Association Display
Coproduction Malraux scène nationale Chambéry Savoie ; Festival d’Automne à Paris ; Chaillot – Théâtre national de la Danse ; Théâtre Public de Montreuil – Centre dramatique national ; Le Quartz, scène nationale de Brest ; Points communs – Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise ; Théâtre nouvelle génération – CDN de Lyon ; Le Lieu unique – Centre de culture contemporaine de Nantes ; Théâtre Garonne, scène européenne de Toulouse ; Théâtre Molière, Sète, scène nationale archipel de Thau ; La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
Coréalisation Théâtre Public de Montreuil – CDN ; Festival d’Automne à Paris Display est conventionnée par le ministère de la Culture, DRAC Auvergne Rhône-Alpes et labellisée « compagnie Auvergne Rhône-Alpes » par la Région. Durée : 1h Théâtre Public de Montreuil, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
du 18 au 27 novembre 2022
Chaillot – Théâtre National de la danse
du 29 novembre au 3 décembre Bonlieu, Scène nationale d’Annecy
les 6 et 7 décembre Théâtre Molière Sète, Scène nationale archipel de Thau
les 13 et 14 décembre Théâtre Garonne, scène européenne de Toulouse
du 5 au 7, puis du 11 au 13 janvier 2023 Le Lieu Unique, Nantes
du 7 au 9 février Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon
du 23 au 27 mai 21 NOVEMBRE 2022/PAR VINCENT BOUQUET

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 5:17 AM
|
Par Brigitte Salino (Prague - envoyée spéciale) du Monde. Publié le 21 novembre 2022 Créée à Prague, la mise en scène par Arthur Nauzyciel de la pièce d’Arthur Schnitzler, qui fit scandale en son temps, est présentée à Rennes.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/21/theatre-la-ronde-un-manege-social-a-la-derive_6150858_3246.html
Il suffit parfois d’une image pour que vive un spectacle. Dans La Ronde, d’Arthur Schnitzler, créée par Arthur Nauzyciel au Théâtre national de Prague, avant de venir à Rennes, cette image, c’est celle d’un tram dans la nuit. Il s’avance, du fond du plateau, dans un brouillard froid troué par une grosse lampe ronde à l’avant de la machine. A l’intérieur, il n’y a pas de passagers sur des sièges, mais des passants dans une cage d’escalier. Des hommes et des femmes, pressés par on ne sait quel désir, hâtés par on ne sait quelle peur. Des contrebandiers, en somme, en chemin vers ce qui mobilise leur corps et leur esprit : faire l’amour. Ces personnages sont scandaleux. Ils ont d’ailleurs causé un scandale de tous les diables au début du XIXe siècle. Parue pour la première fois en 1900, La Ronde n’a été créée qu’en 1921 à Berlin, où elle a été attaquée en justice pour trouble à l’ordre public, tant les réactions dans la salle étaient violentes. Mais derrière se glissait le poison de l’antisémitisme. Arthur Schnitzler était juif. Il a répondu aux attaques en interdisant que sa pièce soit jouée jusqu’à sa mort, en 1931, à 69 ans. Viennois, médecin, grand bourgeois, Arthur Schnitzler n’a jamais aussi bien, dans son œuvre, dressé le tableau mortifère de la fin de siècle de l’Autriche que dans La Ronde. La pièce s’ouvre avec la rencontre d’une fille et d’un soldat, qui font l’amour dans les taillis des faubourgs. Elle se poursuit avec la rencontre du soldat avec une femme de chambre, que l’on retrouve avec un jeune monsieur, que l’on retrouve avec une jeune femme mariée, que l’on retrouve… Oui, il s’agit bien d’une ronde, entre dix personnages qui se rencontrent ou se retrouvent, font l’amour et se quittent. Mélancolie insidieuse La pièce commence avec un « bonjour, mon ange », et se clôt avec un « bonjour ». L’ange pourrait être celui de l’amour. Rêvé peut-être, mais disparu, envolé dans la poursuite de la jouissance qui aspire les corps les uns contre les autres, les uns dans les autres, toujours pressés, inquiets d’arriver à leur fin, chavirés d’avoir osé, dégrisés aussitôt après. « Une fois passé, eh bien, c’est passé », dit un des personnages. Restent la gueule de bois, le retour à l’ordre social le temps d’une saillie transgressé, et une mélancolie insidieuse comme une mort qui rôde. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La voix des femmes se fait entendre au Festival du Théâtre national de Bretagne C’est ce dernier point que la mise en scène d’Arthur Nauzyciel met en avant. Quand le Théâtre national de Prague lui a proposé de signer une mise en scène, le directeur du Théâtre national de Bretagne, à Rennes, a pensé à La Ronde, qui le renvoie à ce que nous avons traversé avec la pandémie. Rassurez-vous, rien n’est explicatif dans son spectacle. Mais sa Ronde sait capter l’air du temps. Elle nous met sur la voie de l’inconscient – Schnitzler était contemporain de Freud, qui l’a évité longtemps, « de crainte de rencontrer [son] double ». L’ambiance expressionniste, la gestuelle syncopée de l’acte sexuel orchestrée par Phia Ménard, le jeu impeccablement distancé des comédiens tchèques, tout concorde à nous montrer un manège social à la dérive, malade de sa propre vacuité. Il y a une forme de monotonie dans La Ronde ; mais c’est cette monotonie même qui lui donne quelque chose de frénétique et d’angoissant, comme peuvent l’être les automates – on pense à celui de la femme poupée dans le Casanova de Fellini. Le comte qui clôt la pièce retrouve la fille du début, prostituée. Il est vieux, elle est jeune. Pour lui, plus rien n’a de sens. Pour elle, rien n’a de sens. C’est dans ce « rien » que niche le scandale de La Ronde. Il troue la nuit du théâtre comme la grosse lampe du tram, et vous transperce. La Ronde, d’Arthur Schnitzler, mise en scène Arthur Nauzyciel. Avec la troupe du Théâtre national de Prague. Théâtre national de Bretagne, à Rennes. 17 € et 14 €. Durée : 2 heures. En tchèque surtitré en anglais et en français. Du 23 au 26 novembre. Le texte est édité en « Folio théâtre », dans la traduction d’Anne Longuet-Marx, 266 p., 7,80 €. Brigitte Salino (Prague - envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 4:49 AM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore pour Transfuge 21 nov. 2022 Dans le cadre du Festival du TNB, Arthur Nauzyciel explore les faux-semblants en montant avec la troupe permanente du théâtre national de Prague, La Ronde de Schnitzler. La scène est nue. Une femme en robe noire moulante, hypersexy, fait face à un homme en uniforme. Son visage est à moitié masqué par d’énormes lèvres pailletées. Elle est prostituée, il est militaire. La suite du récit est déjà toute tracée, pourtant entre les deux, les mots de l’amour vont un temps maintenir leurs corps à distance. Un peu de décorum, tout de même, avant de conclure le marché. Elle le veut, il hésite. Elle s’offre à lui gratis, mais sa chambre est trop loin. C’est dans la rue que l’acte aura lieu. L’affaire conclue, juste le temps de se dire un adieu plein de promesses, un petit tour, la fille cède la place à la femme de chambre. Ainsi va La Ronde de Schnitzler. Tour à tour, dix couples de conditions et d’âges différents, se succèdent au plateau, chaque saynète étant liée l’une à la suivante par l’un des deux protagonistes qui entre et guide le pas des deux suivant. Sulfureuse autant que satirique, l’œuvre phare du dramaturge autrichien invite dans les alcôves d’une société corsetée par l’étiquette imposée aux Viennois par un François-Joseph rigide et vieillissant, en proie dans l’ombre aux vices et à la licence, impuissante à empêcher le drame sourd qui la gangrène. Écrite en 1897, publiée en 1903, censurée l’année suivante, la pièce ne sera finalement créée qu’en 1920, dans un Berlin où vient d’être fondé par Hitler, le national-socialisme. Le scandale est immense. Des persécutions antisémites s’en suivent, obligeant l’auteur à interdire les représentations. Loin du vaudeville auquel La Ronde est souvent associée, Arthur Nauzyciel préfère s’attacher à ce que cachent les non-dits, les sous-entendus, ce que révèle l’intimité de ces couples légitimes ou non, des rapports de classe sous-jacents qu’elle met en lumière. S’appuyant sur le travail ciselé de clair-obscur de Scott Zielenski, sur la très allusive scénographie de Ricardo Hernandez, le metteur en scène, directeur du TNB, invite à plonger dans un monde d’illusions, de faux serments d’amour que personne ne croit. Ici, la passion n’est que de façade, la carte de Tendre est biaisée. Le sexe, la possession charnelle de l’autre justifie toutes les parades. Le très imagé et burlesque travail chorégraphique de Phia Ménard va dans ce sens. Personne n’est dupe, cette ronde d’amour n’est finalement qu’une danse macabre, un ballet étourdissant empêchant de voir le drame à venir. Pour cette entrée de l’œuvre au répertoire du Théâtre national de Prague, Arthur Nauzyciel fait le choix symbolique de l’ancrer dans les années 1930, sur fond de fascisme galopant. D’un tramway nommé désir au train de la mort menant au camp de concentration, il déploie avec délicatesse et virtuosité, un imaginaire allusif autant qu’allégorique. Dirigeant au cordeau la troupe permanente, l’artiste signe une tragicomédie noire, où les larmes amères succèdent aux rires insouciants. Faisant écho à la montée dangereuse du nationalisme dans de nombreuses démocraties occidentales, il entraîne le spectateur vers le point de rupture. Le passé s’invite dans le présent, réveille de vieilles blessures, présageant des lendemains ignorés, inquiétants ! La Ronde d’Arthur Schnitzler, mise en scène d’Arthur Nauzyciel. Du 23 au 26 novembre 2022, au TNB dans le cadre de son festival.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2022 4:21 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 21 nov. 2022
Le spectacle « Forêt », des chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret, propose une performance immersive inédite, où la danse prend son envol dans l’aile Denon du musée parisien.
Lire l'article sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/11/20/festival-d-automne-danseurs-et-toiles-en-osmose-au-louvre_6150725_4500055.html
Danser le Louvre. Incarner Véronèse, Vinci, Titien ou Géricault. Tramer les récits peints il y a des siècles des fils nerveux d’une chorégraphie d’aujourd’hui. Présenté par le Festival d’automne, Forêt, conçu par Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret, déroule une performance déambulatoire dont le titre contient en germes une frondaison touffue de gestes. Et pour cause. Le parcours investit 5 000 mètres carrés de la fameuse aile Denon, celle notamment des chefs-d’œuvre italiens de la Renaissance, dont La Joconde en tête de gondole et point de départ de la horde de onze danseurs. « Il s’agit de ralentir le regard en faisant dialoguer les gestes et les peintures », résume Anne Teresa De Keersmaeker. « Même si nous sommes à plusieurs dizaines de centimètres des peintures, nous tentons d’en créer des prolongations en dansant. » Némo Flouret. Se jeter à l’assaut d’un espace aussi majestueux, symbolique et chargé que le monument parisien visité au quotidien par 30 000 personnes n’est pas une mince affaire. Les représentations se déroulant le soir, après la fermeture, seulement 500 spectateurs sont attendus à chaque représentation de Forêt, dont la durée est de deux heures trente. « Mais les entrées sont échelonnées en trois temps entre 19 heures et 21 h 30, précise Luc Bouniol-Laffont, directeur de l’auditorium et des spectacles du Musée du Louvre. Il s’agit de conserver une fluidité et un confort pour les visiteurs. » Dans le contexte des actions répétées des militants écologistes prenant pour cible des tableaux de maîtres, les mesures de sécurité sont-elles renforcées ? Si la vigilance est plus que jamais le maître mot, aucun dispositif spécial n’est annoncé par l’établissement. Le nombre d’agents d’accueil et de surveillance n’est pas non plus divulgué. Les barrières de mise à distance devant les cimaises restent identiques – à environ 70 centimètres des toiles – pour les performeurs comme pour les spectateurs. Un parcours autour d’une trentaine d’œuvres En revanche, des contraintes particulières liées aux œuvres ont été listées pour les artistes. « Il faut se rappeler que le Louvre n’est pas un théâtre, indique Sébastien Allard, conservateur général du patrimoine et directeur du département des peintures du Musée du Louvre. Il est par exemple impossible d’être dans le noir complet, car les issues de secours sont toujours éclairées. Aucun câble électrique ne peut être tiré et il ne peut y avoir aucune lumière violente supplémentaire pour la danse. Pas de musique trop forte non plus, car les vibrations peuvent fragiliser certaines peintures. » Ces précautions deviennent des paramètres importants pour le duo de chorégraphes qui a dessiné le parcours autour d’une trentaine d’œuvres devant lesquelles les interprètes s’arrêteront. « Même si nous sommes à plusieurs dizaines de centimètres des peintures, nous tentons d’en créer des prolongations en dansant, raconte Némo Flouret. Plus que de s’opposer aux contraintes, on tente de les absorber. » Aucun éclairage en plus, donc. Quant à la musique de Forêt, elle sera celle des corps en cavale, souffles et halètements entrelacés avec les sons du lieu : craquements des planchers, échos des courses sous les hauts plafonds et bruissements des visiteurs. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Avec « Dream » au Centquatre, « Forêt » au Musée du Louvre... La danse s’affranchit de la scène « Tout est visible dans cette promenade et en particulier les mouvements du public dont nous devons tenir compte », commente Anne Teresa De Keersmaeker. Et la foule, qui pourra aussi aller se restaurer au Café Mollien, spécialement ouvert pour l’occasion, reste sans doute la plus grande inconnue de cette déambulation tant on sait combien elle peut être volatile, voire dissipée. « En fait, jusqu’à la dernière minute, on ne saura pas comment ça va se passer », conclut Némo Flouret. Et c’est sans doute le plus excitant de cette Forêt où l’on rêve déjà de se perdre. « Forêt », d’Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret, Festival d’automne, Musée du Louvre. Neuf soirées entre le 23 novembre et le 10 décembre. Légende photo : Lors du spectacle « Forêt », les danseurs évolueront au milieu des peintures de maîtres présentes dans l’aile Denon du Louvre. ANNE VAN AERSCHOT
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...