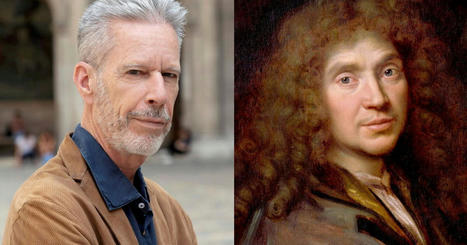Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 10, 2022 7:46 AM
|
Par Marie Sauvion dans Télérama Comme chaque année, l’Aafa dresse le bilan de la présence à l’écran d’actrices de plus de 50 ans. Et comme chaque année, le résultat est sans appel : seuls 7 % des rôles leur sont attribués, contre 16 % côté hommes. Les feuilles tombent, les études aussi, bref c’est l’automne, saison des mornes bilans. Comme chaque année depuis sept ans, l’Aafa (Actrices et acteurs de France associés) s’est livrée au relevé minutieux et un tantinet déprimant des actrices coincées dans le fameux « tunnel » des plus de 50 ans. Verdict ? Rien ne change. « Sur l’ensemble des films français sortis en 2021, pointe l’association, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. En 2020 c’était 9 % ; en 2019, 8 % ; en 2016, 6 % ; et en 2015, 8 %. » La part des emplois attribués aux acteurs de plus de 50 ans, en revanche, atteint 16 % en 2021, soit plus du double. Ils ont le droit de vieillir, quand elles ont le devoir de disparaître. La nouveauté, c’est que, cette fois, l’Aafa s’est demandé si les réalisatrices étaient plus engagées que les réalisateurs. Mauvaise surprise : avec 8,5 % des rôles donnés par des femmes à des actrices de plus de 50 ans, contre 7 % par des hommes, la réponse est non. Sachant que ces chiffres sont, cependant, à mettre en relation avec une autre étude, émanant de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui rappelle que les femmes ne représentent toujours qu’un quart des cinéastes européens… Rien ne change (bis). “J’ai joué la mère de Guillaume Canet alors que nous n’avons que onze ans d’écart !” L’Aafa, en tout cas, pointe systématiquement le déséquilibre entre la population française, où une personne majeure sur quatre est une femme ayant atteint la cinquantaine, et sa représentation à l’écran. Une approche comptable qui a ses limites – en quoi le cinéma serait-il tenu de « représenter » la société ? –, mais qui fait bien d’interroger nos imaginaires. Et embraye sur une question non moins essentielle : filmer les femmes à tout âge, d’accord, mais comment ? L’exemple de Dominique Blanc, extraordinaire en panthère névrotico-vénéneuse dans L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, donne à la fois matière à penser… et à espérer. “Il faudrait plus de films permettant aux actrices de jouer avec leur vieillissement”6 minutes à lire Marie Sauvion Légende photo : La formidable Dominique Blanc, 66 ans, entourée de Céleste Brunnquell et Laure Calamy, dans « L’Origine du mal ». Avenue B Productions - Laurent Champoussin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2022 6:57 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 8 nov. 2022 Sous le titre Un jour en été, Patrick Sommier réunit les deux auteurs en scènes brèves et irrésistibles, illuminées par le talent de Christiane Millet, Hervé Briaux, Laurent Manzoni.
Anton Tchekhov, d’accord ! Mais Ivan Bounine ? Avouez que vous le connaissez moins bien…Et pourtant, il fut le premier Russe à recevoir le prix Nobel de Littérature, en 1933. Et il est indissociable de l’auteur des Trois sœurs. Lui-même écrivain, poète et romancier, nouvelliste, il rencontra Tchekhov en 1885. Une amitié profonde les lia jusqu’à la mort du dramaturge le 2 juillet 1904, à Badenweiler. Bounine avait entrepris une biographie de son ami, la laissant inachevée. Il s’était exilé après dix-sept et vécut à Paris jusqu’à sa mort, en 1953. Leur alliance littéraire ne fait pas de doute et il est à la fois intelligent et légitime de les lier. Dans les textes qu’a choisis Patrick Sommier, excellent connaisseur de la Russie d’autrefois et d’aujourd’hui, c’est un même esprit qui circule, des personnages qui se ressemblent. Le metteur en scène, qui fut directeur de la MC93, a traduit les textes avec Michel Parfenov. Il a retenu cinq nouvelles de Tchekhov et une nouvelle de Bounine. Le titre, Un jour en été, renvoie à certains thèmes des nouvelles, mais reprend celui d’un tableau d’Isaac Levitan, l’un des artistes du groupe Sreda, un cercle que fréquentaient également Bounine et Maxime Gorki. Dans la salle du Poche, tout débute de manière très cocasse, dans une nuit profonde…Ce sont les Egarés. Hervé Briaux et Laurent Manzoni commencent fort ! Vient une dispute intellectuelle oiseuse dans En terre étrangère, puis avec La Sirène, une célébration de la gastronomie russe qui vous donnera faim. Des textes brefs, des croquis, mais d’une grande force car Tchekhov a le sens de l’humain. Les personnages ont immédiatement de l’épaisseur. On passe à un registre plus romanesque avec La Maison à mezzanine, et à une panique incontrôlable avec Le Fruit du péché. On ne vous dit rien des arguments, car la découverte est à chaque fois délicieuse. Un décor tout simple, table, sièges, déplacés à vue par les interprètes eux-mêmes. Des costumes seyants de Malaury Flamand, un travail précis de son, beaucoup de musique, par Lazare Boghossian et des lumières de Juan Cristobal Castillo-Mora. C’est très bien dirigé et magistralement joué. Belle, très belle et ultra-sensible, nuancée, Christiane Millet est excellentissime dans des registres différents. On aimerait la voir plus. Qu’elle ait plus à jouer ! Hervé Briaux, sociétaire du Poche qui enchaîne avec son fertile Montaigne, compose avec précision les hommes un peu rigides, toujours sur leurs gardes. Sa voix sonore fait merveille. Laurent Manzoni, servi par des partitions avantageuses, impose sa merveilleuse personnalité. C’est un très grand comédien, peu vu dans les théâtres privés, mais que l’on applaudit depuis l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg. Il endosse avec subtilité les personnages ridicules, les pathétiques, les cocasses, toujours humain, profond, magnifique. Une pépite. On s’amuse de bon cœur et l’on sort de là léger, ravi. Admiratif d’un travail aigu et spirituel. Théâtre de Poche-Montparnasse, du mardi au samedi à 19h00, dimanche à 17h00. Durée : 1h15. Tél : 01 45 44 50 21. www.theatredepoche-montparnasse.com Armelle Héliot Photo : Hervé Briaux et Laurent Manzoni. Photo d’Alejandro Guerrero. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2022 11:58 AM
|
Aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux, du 9 au 10 novembre 2022, Matthieu Cruciani, co-directeur de la Comédie de Colmar, présente sa très belle adaptation de La nuit avant les forêts. Dans un décor de parking abandonné, il dirige avec justesse Jean-Christophe Folly et donne à entendre puissamment les maux de Koltès. Rencontre.
Quel est votre premier souvenir d’art vivant ?
Je n’ai pas une très bonne mémoire… Un Dom Juan à l’opéra de Nancy m’a-t-on dit. Mais je me souviens plus de la salle, du moment que de la scène et de ce qui s’y passait. Et de ce que mon père m’avait proposé de faire mon devoir de maths à ma place pour que je puisse m’y rendre avec ma mère. En tout cas, j’ai d’abord été fasciné par les théâtres comme objets, comme constructions, puis par ce qui pouvait s’y passer.
Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur de l’art vivant ?
Il n’y a pas eu de déclencheur unique. La première inquiétude, comme pour beaucoup, a déjà été d’y survivre. C’est là que j’ai d’abord mis l’énergie, en autodidacte, étape après étape. Les écoles, les premiers spectacles, les premières mises en scène… Encore aujourd’hui, je vis ce métier comme une chose très fragile. Du provisoire qui dure. Et c’est sans doute ce qui m’y plaît. Donc, pour vous répondre : sans doute le moment où j’ai compris que je pourrais difficilement m’y ennuyer. Ou que je n’aurais plus qu’à ne m’en prendre qu’à moi-même si c’était le cas. Qu’est ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédien et metteur en scène ? Plein de mauvaises raisons, j’imagine. À 17 ans… Du désœuvrement sans doute. C’est la manière que j’ai trouvée de participer au monde. C’est le biais que j’ai trouvé à l’époque. De ne pas me laisser bercer et en devenir un pur spectateur, ce qui est peut-être plus mon penchant. Cela peut être très intimidant le monde. Alors participer oui, mais discrètement, en jouant. Pour la mise en scène, ce fut l’amour fou des textes d’abord, maintenant, c’est l’admiration que j’ai pour les actrices et les acteurs. Clairement. A tel point qu’aujourd’hui ma mécanique de désir s’est comme inversée. J’ai d’abord envie de travailler avec telle actrice ou tel acteur, et ensuite, seulement, je cherche le juste projet ou le juste texte. Voilà. Ce sont les gens d’abord. Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ? Quand j’étais à l’école de Chaillot, Gilles Cohen nous avait mis en scène dans un spectacle sur Pierre Cami que nous avions donné au théâtre de la Tempête. Je n’y avais jamais vraiment repensé avant que vous ne me posiez cette question. Mais un bon souvenir à coup sûr. Celui d’une précarité très noble. D’un banditisme joyeux et plein d’innocence. On ne connaissait rien à rien. On faisait sans doute un peu n’importe quoi, mais avec un sérieux… C’était parfait. Votre plus grand coup de cœur scénique ?
La chambre d’Isabella de Jan Lauwers. Avec Louise Peterhoff. La merveille. Quelles sont vos plus belles rencontres ?
Celles qui ont duré et durent encore. Émilie Capliez, avec qui je dirige maintenant la Comédie de Colmar. Là, on tient une petite rencontre fondatrice, n’est-ce pas. Ensuite, il y a les meilleurs copains, avec qui tout a commencé. Sharif Andoura. Pierre Maillet. Marc Lainé. Ce sont les frères d’art en quelque sorte. Ensuite, on rencontre tant de monde, et on ne peut suivre de vraies relations qu’avec si peu qu’il serait forcément injuste et incomplet de dresser une liste. J’ai eu de vraies rencontres avec des équipes de théâtres. J’adore ça les équipes. Celle de la Comédie de Colmar qui est formidable (best team), celle de la Comédie de Saint Etienne. Des gens m’ont aidé très fort. Daniel Benoin. Arnaud Meunier. Les Lucioles. Sophie Chesnes. Benoit Lambert. Les gens avec qui on travaillait en compagnie : Stéphane Triolet, Florence Verney. Des autrices et auteurs comme Francois Bégaudeau, Pauline Peyrade. Et puis les équipes de création, évidemment. Toutes. Il se passe forcément quelque chose de spécial. Sur ma dernière, La nuit juste avant les forêts, c’était totalement parfait. Nicolas Marie, Marie la Rocca, Carla Pallone, Maelle Dequiedt, Kelig le Bars, Thierry Gontier, Manuel Bertrand, Eve-Anne Joalland. Toute le monde était génial, tout le temps, sur tout, calme, simplement à son affaire. Et puis, bon : Jean Christophe Folly. Jean Christophe Folly, quoi ! En tous les cas, j’aime les amours et les amitiés qui se réalisent dans le travail théâtral. En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?
Franchement, je cherche. Pas certain d’être vraiment à l’équilibre, d’ailleurs, ni que ce métier m’y aide en quoi que ce soit. C’est simplement dévorant. Le théâtre est essentiel à mon déséquilibre, donc, déséquilibre qui me va très bien visiblement. Qu’est-ce qui vous inspire ?
Qu’est-ce qui m’inquiète, surtout… Beaucoup de choses. Comme tout le monde, je crois, les livres, la colère, la musique, les beautés, les laideurs, la solitude, la nature, celles et ceux que j’aime. Celles et ceux que j’aime un peu moins. La vie, la mort. Globalement, tout ce que je comprends mal et qui m’attire. De quel ordre est votre rapport à la scène ?
Fluctuant, comme la lune et les marées. En ce moment, elle me manque beaucoup comme comédien. C’est une vraie surprise. Mais j’ai très envie de jouer. Parfois aussi, tout ce noir m’oppresse, et je voudrais juste aller courir dans la forêt. Sinon et en un mot : sacré. C’est bébête, mais c’est vrai. Et je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle ou pas. À quel endroit de votre chair, de votre corps, situez-vous votre désir de faire votre métier ?
Dans mon petit doigt qui m’a dit d’y insister. Je ne suis pas déçu. Plus classiquement, je le situe à l’épiderme. Nettement. Pour le meilleur et le pire. Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ?
La liste est trop longue à établir Et puis on ne dévoile jamais le nom de ceux qui nous plaisent : ça fait toujours tout capoter. À quel projet fou aimeriez-vous participer ?
J’aimerais tant de choses. Je ne sais pas si elles sont folles. Jouer en Italie par exemple. Et en Italien. Mettre en scène aussi en Italie. Travailler sur Musil, Walser, Claude Simon, Ernst Junger. Travailler sur Jaccottet tient. Je vais répondre aussi en tant que directeur : j’aimerais beaucoup agrandir la Comédie de Colmar. Bâtir une seconde salle, plus grande, avec un meilleur accueil pour le public, pour les artistes. C’est un projet un peu fou que nous portons avec nos partenaires, et j’aime y participer. Nous ne sommes pas loin d’y parvenir. Fingers crossed. Si votre vie était une œuvre, quelle serait-elle ?
Christina’s world. Andrew Whyeth. Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Création en octobre 2021 à la Comédie de Colmar
Reprise
les 9 et 10 novembre 2022 aux Gémeaux, Scène nationale de Sceaux Crédit Portrait © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 7, 2022 5:18 PM
|
Par Véronique Hotte dans son son blog Hottello - 7 nov. 2022 Les Petites Epouses des Blancs / Histoires de mariages noirs, spectacle documentaire, de et par Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry. Regard extérieur, Corine Miret, scénographie et costumes Bertrand Renard assisté de Marine Rieunier, lumière Luc Jenny.
Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry conversent sur la scène : des concubinages ont uni des femmes africaines et des colons durant la période coloniale. Tous deux sont les héritiers de cette histoire, de manière radicalement distincte. L’arrière-grand-mère de Marisa était une Africaine du Dahomey, tandis que l’arrière-grand-père de Stéphane était un colon français au Gabon. Histoire, conte doux-amer entre résonance coloniale et patriarcale : une situation délicate pour Stéphane Olry, du côté des colons malgré lui face à la vindicative Marisa Gnondaho dit Simon. Ils ont mené une enquête sur la mémoire de ces « petites épouses » des blancs et la postérité de ces « mariages noirs » dans leurs familles respectives, d’où ici Les Petites Epouses des Blancs. Dans la réalité coloniale, les « mariages mixtes » désignent les unions entre une « indigène » et un « citoyen français » – « mariages noirs » de la littérature coloniale. Ces unions se passaient du consentement de la femme, nommée « petite épouse ». Nulle reconnaissance officielle ou administrative ne validait ces unions demeurées souvent illégitimes, de même les enfants conçus. Marisa Gnondaho dit Simon a donné à lire à Stéphane Olry Souvenirs de brousse, écrit par son arrière-grand-père, fonctionnaire colonial en poste en Afrique de l’Ouest au début du 20 ème siècle. Son union avec une femme africaine, l’arrière-grand-mère de Marisa, n’y est jamais évoquée… – mensonge par omission. Dans la famille africaine de celle-ci, était évoquée la liaison de filiation avec un Européen. Quant à l’arrière-grand-père de Stéphane, Henri Jeanselme, il acquit l’Ile aux Perroquets sur l’embouchure du fleuve Gabon en 1892. Quand l’île fût vendue en 1947, le notaire apprit à la famille française du planteur qu’il s’y trouvait une maison avec une famille gabonaise : la décence et la justice commandaient qu’ils pussent demeurer là. Les descendants de France surent ainsi que leur arrière-grand-père avait une seconde famille africaine. Le nom de la femme noire allongée nue sur une natte, sur les clichés photographiques de l’arrière grand-père, n’était pas indiqué. Une lettre signée « votre sœur » parvint aux héritiers, qui les remerciait d’avoir abandonné gracieusement la maison de l’Ile aux Perroquets. La Revue Eclair partage ici avec les spectateurs certaines des questions soulevées par le destin de ces femmes aux noms oubliés. Réalité ou symbole, chacun est héritier de cette histoire. Dans la fiction présentée sur scène, Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry prétendent être cousins – ce qu’ils ne sont pas – et descendre de l’ancêtre Marc Simon, fonctionnaire colonial au Dahomey. Stéphane Olry présente le livre écrit par son aïeul Marc Simon : Souvenirs de brousse. L’acteur expose des plaques photographiques prises par ce même arrière-grand-père. Marisa Gnondaho dit Simon l’interrompt au moment où il s’apprête à montrer quatre photos – une jeune femme nue allongée sur une natte, dans quatre positions différentes : « Accepteriez-vous de montrer ces photos si la jeune femme en question était votre arrière-grand-mère ? » et blanche… Le dissensus possible entre les deux protagonistes est posé dès le début. Ils sont cousins, tous deux descendants du même ancêtre : un fonctionnaire colonial qui a deux descendances. Une officielle, blanche, reconnue, en métropole. L’autre cachée, métisse, bâtarde, laissée en Afrique. Le récit narre de la découverte du lien familial qui les unit, les discussions qui les divisent, l’enquête qui les réunit, jusqu’au deuil des parents, témoins ultimes de ces « mariages noirs ». L’arrière-grand-mère de Marisa Gnondaho dit Simon, « la petite épouse » de Marc Simon, prend la parole, révèle son nom et raconte son histoire à elle, celle qui a été tue durant quatre générations. Certains spectateurs sont invités à lire à voix haute des documents de l’époque coloniale – le Guide pratique de l’Européen dans l’Afrique Occidentale, à l’usage des militaires, fonctionnaires, commerçants, colons et touristes, du Dr Barot, médecin des Troupes Coloniales. L’ enquête a conduit les narrateurs vers des témoins, avatars contemporains du colonialisme : notaire, chocolatière, griot, ethno-psychiatre, syndicaliste, tirailleurs sénégalais, etc. Ils relient le « Questionnaire sur les métis » émis par la société d’anthropologie de Paris en 1907 aux tests osseux pratiqués sur les jeunes mineurs isolés à la rue actuellement – ou comment les politiques successives des gouvernements ont toujours été étayées par des théories scientifiques. À l’issue du spectacle, les spectateurs sont invités à dialoguer avec les aimables protagonistes. Un spectacle fidèle à la Revue Eclair – regard délicat de Corine Miret et inventivité facétieuse de Stéphane Olry -, avec la belle présence sourde de Marisa Gnondaho dit Simon, un jeu subtil entre un passé significatif et revisité de témoignages et son ré-ajustement à un présent à re-considérer. Véronique Hotte Spectacle vu au Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie – Route du Champ de Manoeuvre 75012 – Paris. Les 17 et 18 novembre à 20h au Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 – Paris palais-portedoree.fr Le 22 novembre à 20h au Centre Culturel Jean Cocteau 1, pl. Gérard Philipe – 91090 Lisses. Gratuit sur réservation : 01 69 11 40 10

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 6, 2022 10:55 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 6 nov. 2022 Dans ce marché dérégulé du spectacle vivant, aucune tutelle ne chapeaute les directeurs de lieux.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/05/le-off-d-avignon-confronte-a-une-delicate-equation-ecologique_6148614_3246.html
Près de 1 600 spectacles et 33 000 levers de rideau, 138 salles qui turbinent du matin au soir pendant trois semaines, 300 000 personnes (au moins) qui passent par les rues d’Avignon, des centaines de milliers d’affiches accrochées de manière sauvage et des centaines de milliers de tracts distribués, des centaines de compagnies qui viennent de partout avec leurs décors, et des températures caniculaires… L’équation de la transition écologique n’est pas simple, pour le Festival « off » d’Avignon. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le spectacle vivant au défi de la transition écologique Harold David et Laurent Domingos, les coprésidents de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF & C), en ont conscience. D’autant plus que leur rôle est limité : le « off » d’Avignon est un marché dérégulé du spectacle vivant, et aucune tutelle ne chapeaute les directeurs de lieux. Aucun bilan carbone n’a été, à ce jour, établi pour le festival. Mais les deux hommes se disent prêts à faire avancer les choses. « Les théâtres du “off” sont dans une logique individuelle, donc on a fait le choix de travailler, en lien avec la mairie d’Avignon, sur les questions qui sont à notre portée : la mobilité, la gestion des déchets, la numérisation des outils de communication et l’affichage, qui est la plus symbolique, même si ce n’est pas forcément la plus problématique en termes d’émission », expliquent-ils. Sur la mobilité, des discussions sont en cours avec la SNCF pour tenter de la convaincre d’un allongement des horaires de train en soirée pour la région Sud, comme la région Occitanie a réussi à l’imposer. « On a des études qui montrent qu’il y a une vraie demande, et que ce ne serait pas absurde », plaide Laurent Domingos. Le bureau du « off » travaille aussi, conseillé par Samuel Valensi, du Shift Project, sur l’organisation d’un système de fret ferroviaire mutualisé pour les décors des compagnies. « L’axe Lille-Paris-Lyon-Avignon regroupe près des deux tiers des compagnies, cela aurait du sens. » 60 tonnes de papier Sur l’affichage, sujet qui cristallise les critiques, les deux hommes réfléchissent aussi à des alternatives. « Il ne s’agit pas de le supprimer complètement, mais de lutter contre l’affichage sauvage, et de le repenser. Le folklore, c’est une chose qui se renouvelle. L’affichage pourrait être pensé comme un décor, à l’image de ce qu’ils ont fait au Festival d’Edimbourg (Ecosse), et qui est très réussi. » Il semblerait que la ville d’Avignon soit hautement favorable à une telle solution, et pour cause : à l’issue du festival, ce sont 60 tonnes de papier qui doivent être traitées. Cette tâche occupe la centaine d’agents d’entretien de la mairie pendant l’intégralité du mois d’août. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés En 2022, le « off » d’Avignon renoue avec le public Le « off » va aussi baisser le nombre de catalogues papier distribués (100 000 en 2022), pour privilégier le numérique, et encourager les salles à s’équiper en éclairages LED. Mais le sujet qui fâche, plus encore que l’affichage, c’est celui de la climatisation. Avec des températures comprises entre 35 degrés et 40 degrés dans la journée, comme ce fut le cas en 2022, impossible de jouer sans rafraîchir les salles. Selon des études, l’utilisation de la climatisation ferait augmenter de deux degrés la température de la ville pendant le festival Or, selon des études, l’utilisation de la climatisation ferait augmenter de deux degrés la température de la ville pendant le festival. Le bureau du « off » préconise le passage à des systèmes de refroidissement plus écologiques, mais ne se fait aucune illusion sur le sujet. « Le passage à ces systèmes plus vertueux ne sera pas éligible à des aides publiques, et dans ces conditions les salles ne changeront pas d’équipement. » L’idée d’observer une « pause méridienne » de midi à 17 heures, lancée fin octobre par la militante écologiste Anne Laroutis sous forme de pétition, a reçu une fin de non-recevoir de la part de l’ensemble des théâtres du « off », qui, disent-ils, ont besoin de multiplier les créneaux horaires de représentations pour rentrer dans leurs frais. « Nous ne voyons pas du tout comment avancer sur ce sujet », résument les deux coprésidents du « off », néanmoins déterminés à agir là où ils le peuvent. Fabienne Darge Légende photo : Des affiches recouvrent les murs de la ville d’Avignon, le 16 juillet 2021, lors de la 55e édition du Festival « off ». VIRGINIE HAFFNER/HANS LUCAS VIA AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2022 10:59 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 1er nov. 2022 En 1868, à Paris, rue de l’Ecole-de-Médecine, un homme se donne la mort en laissant à la postérité un manuscrit autobiographique : l’« Histoire d’Alexina B. »… Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, d’après Herculine Barbin dite Alexina B. , publié et préfacé par Michel Foucault, adaptation Catherine Marnas et Procuste Oblomov, mise en scène de Catherine Marnas. En 1868, à Paris, rue de l’Ecole-de-Médecine, un homme se donne la mort en laissant à la postérité un manuscrit autobiographique : l’« Histoire d’Alexina B. » que publiera en 1874 un grand notable de la médecine légale, Ambroise Tardieu. Pour celui-ci, il s’agit des « souvenirs et impressions d’un individu dont le sexe avait été méconnu », bref d’un « pseudo-hermaphrodite ». En 1860, à plus de vingt et un ans, Herculine Adélaïde Barbin, surnommée Alexina, devient Abel, changeant de sexe à l’état civil. Son histoire raconte les tourments et les émois de la jeune fille, et s’achève sur l’amer désespoir de l’homme. En 1978, Michel Foucault publie ce document assorti d’un dossier historique. A l’assignation médicale d’un « vrai sexe », le philosophe de l’Histoire de la sexualité invoque les délices d’une vie sans sexe certain. A cette édition, s’ajoute une nouvelle, « Un scandale au couvent », du médecin allemand Oscar Panizza, une version romancée au tournant du XX è siècle de la vie d’Alexina. La postface d’Eric Fassin (2014) montre enfin dans quelle mesure les gender studies et l’essor du mouvement inter-sexe engagent à relire ce récit où Herculine/Abel s’invente un « vrai genre ». (Herculine Barbin dite Alexina B. de Michel Foucault, suivi de Un scandale au couvent d’Oscar Panizza, préface de l’auteur, postface d’Eric Fassin, Gallimard, collection Tel, 2021). Née le 8 novembre 1838, Adélaïde Herculine Barbin, dite Alexina, est élevée en jeune fille modeste et méritante dans un milieu presque exclusivement féminin et fortement religieux, à l’hospice civil de Saint-Jean-d’Angély – tenu par les bonnes soeurs – puis au couvent des Ursulines. A 15 ans, Herculine rejoint sa mère, gouvernante chez les Bonnamy de Bellefontaine à La Rochelle, et devient femme de chambre de leur fille. Au mariage de celle-ci, deux ans plus tard, elle obtient une bourse pour suivre une formation d’institutrice au couvent des Filles de la Sagesse à Château d’Oléron. Nommée institutrice, elle prend son premier poste à Archiac dans un pensionnat de filles dirigé par Madame Bastiat et ses deux filles. Peu à peu, Herculine s’éprend de Sara, la fille de Madame Bastiat, institutrice à ses côtés, et une relation amoureuse durable s’installe – passion et embrasement des corps. Au cours de leurs ébats, le doute s’instille sur le véritable sexe d’Herculine, doute confirmé par des douleurs à l’aine qui l’obligent à consulter un médecin, puis un deuxième qui ne peut passer sous silence l’obligation qui doit lui être faite d’un changement d’état civil : elle a été reconnue fille à sa naissance par erreur. Désormais elle va être homme et s’appeler Abel. Pour fuir le scandale né de sa fréquentation de milieux féminins et de sa relation avec Sara, il/elle part s’établir à Paris, travaille au Chemin de fer d’Orléans, puis dans une administration financière avant de connaître le non-emploi et la misère. Il/elle se suicide dans la nuit du 12 au13 mars 1868. Au début de Mes souvenirs, rédigé alors que sa vie à Paris est de plus en plus « mauvaise », Herculine/Abel écrit : « J’ai beaucoup souffert, et j’ai souffert seul ! Abandonné de tous ! ». Elevé comme une fille, changeant de genre, obligé de s’habiller en homme (le travestissement était alors sévèrement puni et son éducation semble lui avoir interdit tout comportement de ce genre) et de « vivre » en homme, Abel ne s’intégrera jamais, ni professionnellement, ni affectivement, ni socialement et écrira encore « J’ai vingt-cinq ans, et, quoique jeune encore, j’approche, à n’en pas douter, du terme fatal de mon existence ». (Procuste Oblomov). Catherine Marnas, directrice du TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – qui met en scène Herculine Barbin a été touchée au vif par la lecture sensible des Souvenirs qui fait écho aux questions de notre temps, enfin largement entendues et ouvertes à la reconnaissance de l’Autre: « Elle qui craignait tant d’être un monstre – une fois reconnue comme homme – disant qu’elle n’avait plus aucune place dans ce monde, s’était donné comme tâche de raconter son histoire comme on lance une bouteille à la mer. Les récits d’hermaphrodites – comme on les appelait à l’époque, les personnes inter-sexes aujourd’hui – sont très rares, et ce témoignage rédigé à la première personne l’était avec l’idée manifeste que cet écrit allait lui survivre. « Obligé de changer de sexe, héros malheureux de la chasse à l’identité », selon les paroles de Michel Foucault dans sa préface, il/elle – iel – a « réalisé » dans sa chair, et ce jusqu’au suicide, un « problème » qui n’était pas nommément le sien mais celui d’une société figée dans ses certitudes. Le texte fort porte à lui seul les problématiques du temps, d’autant que le personnage d’Herculine est incarné par Yuming Hey, acteur qui revendique genderfluid, accompagné sur le plateau par le chanteur et acteur Nicolas Martel qui est à la fois le récitant des rapports médicaux, d’autopsie, d’état civil modifié, mais aussi des extraits des Métamorphoses d’Ovide, et le passeur entre l’époque d’Herculine, celle de Michel Foucault et la nôtre. (Entretien C. Marnas et Yves Kafka.) La scénographie ouvragée de Carlos Calvo, sous les lumières de Michel Teuil, la vidéo de Valéry Faidherbe, et les sons de Madame Miniature, est soignée, entre rêve esthétisant et récit d’une réalité brute, écrit dans la langue classique du XIX è siècle, à la manière épistolaire du XVIII è. Le songe est alimenté par la contemplation d’un décor inaugural somptueux – sorte d’installation plastique contemporaine glacée -, entre le minéral – pierres et glaces enneigées – et le végétal, si l’on regarde les images d’architecture d’églises, de bâtiments religieux, d’art roman et gothique, soit les représentations artistiques d’une Histoire bien vivante du sacré, qui défilent à l’écran. Et s’impose l’eau – éléments liquides, source qui coule, pluie qui tombe et orages qui grondent. Une image du temps, irréversible, comme vivent et meurent les hommes – apparitions et disparitions. Une rangée de petits lits blancs d’internat est évocatrice de la « fiction » d’Herculine, dont le monde connu jusqu’à ses vingt ans, est un gynécée religieux protégé. Tels les gisants de marbre blanc des chapelles italiennes dont un voile fin sculpté recouvre, comme en un frémissement de vie, les dépouilles minérales. On pourrait croire que celles-ci respirent encore au-delà de la mort. Prédominent les murmures, à côté de la légèreté et l’évanescence des voiles, et les sensations physiques d’un univers féminin confidentiel, un écho à La Religieuse de Diderot. Or, cette réalité est « hors-Histoire », une fiction mise en abyme, d’autant que la voix de basse de Nicolas Martel nourrit l’impression d’un voyage musical – classicisme sacré et Troisième sexe d’Indochine. Le jeu de duo entre les deux interprètes, Yuming Hey et Nicolas Martel, chorégraphié sous le regard d’Annabelle Chambon, entre silences, non-dits et intuitions d’une belle attention à l’autre, est admirablement déployé sur l’espace du plateau. Le second se fait le servant du premier, l’assistant au sens fort, l’accompagnant de son « être-là » dans la prévenance et la douceur. Il leur arrive même de s’échanger les rôles, le plus mâle s’étendant les bras en croix sur le lit de couvent. Autant l’un serait l’icône d’un inter-sexe, entre féminin et masculin, aérien, autant l’autre serait paisiblement viril et terrien – impressions furtives où les appréciations se rejoignent et s’échangent. Les vêtements glissent sur les peaux, différents et variés, selon la condition de genre imposée, à travers la pertinence des costumes choisis de Kam Derbali. Le spectacle est un délicat ballet silencieux, un pas de deux qui exprime au plus profond la difficile existence de celui qui « diffère ». Véronique Hotte Du 15 novembre au 3 décembre 2022, mardi, mercredi, vendredi à 20h, jeudi à 19h, samedi à 16h, au Théâtre 14 – 20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris Réservation : theatre14.fr / 01.45.45.49.77 / billetterie@theatre14.fr Lire aussi : l'article de Véronique Hotte sur la publication "Herculine Barbin par Michel Foucault Crédit photo : Pierre Planchenault - Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, mise en scène de Catherine Marnas.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 1, 2022 6:31 AM
|
Publié sur le site de Sceneweb - 1er nov. 2022 Alors qu’il répète en ce moment Othello sur le plateau du CDN Le Quai, sous la direction de Jean-François Sivadier, Adama Diop va mettre en scène La Troupazimut en décembre à Anthony. Une troupe de comédiens amateurs de 16 à 25 ans. Le spectacle SKREENS résulte de la rencontre entre Adama Diop (qui interprètera Othello dans la prochaine mise en scène de Jean-François Sivardier), et les jeunes comédiens amateurs de La Troupazimut qu’il suit depuis un an.
A travers ce projet, ces jeunes âgés de 16 à 25 ans mettent en lumière leurs questionnements, leurs peurs et leurs revendications. « Quand Marc Jeancourt (co-directeur de L’Azimut) m’appelle, je suis en train de travailler sur deux projets : ma prochaine création en tant qu’auteur et metteur en scène, et l’école d’acteurs que je suis en train d’ouvrir au Sénégal » explique Adama Diop. « Ce qui guide ces deux projets, c’est la question de la non-rencontre, ce dont je suis sans cesse témoin depuis que je suis arrivé en France. Mes mondes ne se rencontrent jamais : j’habite à Montreuil où il y a des gens de beaucoup d’origines, beaucoup de communautés… et pourtant ces communautés ne se rencontrent pas – ou très peu. Ça m’a toujours questionné. En parlant avec Marc, j’ai compris que la Troup’Azimut répondait au même questionnement. J’ai dit oui tout de suite ! »
Adama Diop a mené les auditions et son chois c’est porté sur huit filles et deux garçons. Et le groupe a travaillé un an avec le comédien. Le processus de création s’est fait à partir de nombreux échanges et jeux d’improvisations qui ont donné lieu à des lectures de textes d’auteurs classiques et contemporains tels que William Shakespeare, Enzo Cormann et Alexandra Badea. « Nous partons de Shakespeare, mais j’ai adapté le texte pour aller vite dans l’intrigue, et les autres textes, ceux de Cormann et celui de Badea, s’insèrent dedans. L’idée, c’est que la troupe prenne le pouvoir, impose son aventure. Je n’ai pas forcément envie de faire un geste fort de mise en scène avec ce projet. Ce que je veux, c’est créer un dispositif pour elles et pour eux, pour cette génération qui veut que l’on comprenne que ce n’est plus possible. C’est un cri fort, puissant, ça va passer par des textes difficiles et un univers assez violent. Mais il faut aussi que ce soit enveloppant pour le public, et je suis là pour les accompagner là-dedans. D’ailleurs c’est très beau de voir comment les garçons du projet accompagnent ces questionnements. C’est une génération qui dit qu’ensemble on peut changer les choses, et qui se demande comment on réfléchit à ce qui vient après. » Extrait des propos du dossier de presse recueillis par Emmanuelle Jacquemard SKREENS
Textes de William Shakespeare, Enzo Cormann, Alexandra Badea
Projet accompagné par Adama Diop
Avec Tatiana André, Romane Bouguerouche, Rémi Giordan, Dounia Kouyate, Ana Lorvo, Patrice Mendes, Alicia Mouyal, Alicia Popov, Jeanne Rouilleault-Delsaut, Manon Spanoudis
Collaboration artistique, musique Anne-Lise Binar
Scénographie, lumière Camille Duchemin L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony
Du 16 au 18 décembre 2022 1 NOVEMBRE 2022/PAR DOSSIER DE PRESSE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2022 10:24 AM
|
Propos recueillis par Vanessa Schneider dans Le Monde - 29 oct. 2022 ENTRETIEN« Je ne serais pas arrivée là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. A 77 ans, l’actrice revient sur les deuils qui ont marqué son entrée dans l’âge adulte.
Lire cet article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2022/10/30/la-comedienne-aurore-clement-il-fallait-que-je-vive_6147899_3476.html
Aurore Clément, fille d’agriculteurs modestes, a débuté comme mannequin après avoir travaillé à l’usine. Elle est devenue célèbre en 1974 en incarnant une jeune fille juive dans le film de Louis Malle Lacombe Lucien. Je ne serais pas arrivée là si… Si, quand j’avais 17 ans, mon père n’était pas mort dans mes bras à 23 heures, un soir. Si je n’avais pas eu la responsabilité d’élever ma petite sœur, morte trois ans après, et de prendre soin de ma mère, qui était infirme, dans ce petit village de Buzancy dans le nord-est de la France. Si la vie ne m’avait pas donné la responsabilité de m’occuper de mes deux amours, ma sœur et ma mère, je n’aurais sans doute pas eu le courage d’aller plus loin. Je le dis sans pathos, mais il m’est resté de toutes ces épreuves une tristesse profonde qui m’accompagne encore aujourd’hui. C’était tellement à hurler de douleur que si je ne me relevais pas, ça aurait été la fin. Il fallait que je vive. Quelle était votre vie avant le décès de votre père ? J’ai grandi partagée entre deux mondes. Celui de mes parents, la paysannerie, la ferme, les terres, et celui de ma tante qui m’a plus ou moins élevée, et qui était couturière à Soissons. Elle m’a appris le beau. Elle retaillait des manteaux de fourrure pour des personnes qui étaient revenues des camps et étaient dans le besoin. Elle m’emmenait dîner les vendredis soir chez ces gens merveilleux, rares, affectueux. Cela me changeait du monde de la campagne, si dur. Ces deux milieux m’ont aidée à grandir. D’où venaient vos parents ? Mon père était issu d’une famille de petits paysans dignes et travailleurs dans cette région du Nord-Est qui était sur la route des Allemands. Nous étions à une centaine de kilomètres de Paris qui nous en paraissaient mille. Je suis une enfant de l’après-guerre. Quand j’étais petite, il y avait encore les traces des combats, tout était en ruine, rien n’était reconstruit. On ne s’en rendait pas compte, pourtant. Nous savions que quelque chose de terrible s’était passé, il y avait beaucoup de misère, mais ça allait, nous avions de quoi manger. Et votre mère ? On n’a jamais vraiment su d’où elle venait. De nombreuses légendes couraient dans la famille. On racontait que son père avait été trouvé sur une plage, à Barcelone, je ne sais pas ce qu’il en est exactement. Elle s’appelait Olga Judas et était infirme à la suite d’une blessure mal soignée à la jambe. Elle a toujours souffert et a consacré sa vie à la religion. Elle avait failli entrer dans les ordres. J’ai été élevée dans un univers très croyant. Je me souviens de ma mère travaillant dans les champs malgré son handicap. Elle chantait, elle priait beaucoup et fumait une cigarette par jour. Comment s’est déroulée votre enfance ? Triste et solitaire. J’ai eu très froid. Les vitres de la maison avaient été soufflées par les bombes et n’avaient pas été remplacées. Moi aussi, je travaillais aux champs car mes parents avaient besoin d’aide. Dès que je quittais l’école, à partir de l’âge de cinq ou sept ans, je devais les rejoindre pour arracher les pommes de terre, les betteraves, couper le blé à la faux. Je n’avais pas de copines avec lesquelles échanger, jouer, mais nous avions un cochon qui dormait à côté de ma chambre dans notre ferme dénuée de tout confort. Les jours de repos, ma mère m’obligeait à coudre et à tricoter, de deux heures à six heures, mais je ne me plaignais pas, tout cela me semblait normal. Une enfance à la dure… Oui et avec des gens qui n’exprimaient pas beaucoup d’affection. Mon père ne m’a jamais dit qu’il m’aimait, il n’y avait aucun geste de tendresse, c’était comme ça à la campagne. Le soir était particulièrement triste. Nous n’avions aucun loisir, pas de télévision évidemment, pas de musique, pas de livres à part ceux de prière, rien. Je ne savais pas que les cinémas existaient, ni les restaurants. A l’âge de 14 ans, mon père a décidé de me mettre dans une école catholique, à Soissons, qu’il payait en nature avec des produits de la ferme. C’était un cadre très rigide. Heureusement que ma tante a été là pour me laisser entrevoir un autre monde. J’y rencontrais des gens que je trouvais bien habillés, des femmes avec du rouge à lèvres et des ongles vernis. Ça m’emportait. A la mort de votre père, vous entrez à l’usine… Il ne gagnait pas assez bien sa vie à la ferme. Alors il avait été embauché à la Société des sucreries et distilleries du Soissonnais. Le patron de cette usine était un grand monsieur, riche et très élégant, qui m’a dit quand mon père est mort d’un cancer : « Vous allez quitter l’école maintenant et vous allez apprendre un métier. » Je ne me suis pas posé de questions, là encore, je n’avais pas le choix : il fallait gagner de l’argent pour ma sœur et ma mère. Je me suis retrouvée dans un bureau sous les toits, au service chargé d’imprimer les documents administratifs. La vue de la fenêtre donnait sur le cinéma Le Vox, mais il me semblait inaccessible. Le matin, j’emmenais ma sœur à l’école. J’ai appris à conduire, je prenais la voiture de mon père pour me rendre à l’usine. « Ces 100 kilomètres qui vous arrachent à vos racines est le plus long au monde » Comment en êtes-vous sortie ? Un jour, le grand patron de l’usine, qui aimait beaucoup mon père, m’a proposé de l’accompagner avec sa femme pour assister à un défilé de Christian Dior à Paris. C’était pour moi la plus belle chose au monde. De temps en temps, j’allais acheter Paris-Match, je regardais les mannequins, de très belles filles, de grandes blondes qui faisaient partie de l’agence Catherine Harlé, à Paris. J’étais naïve et je me suis dit en regardant ces beautés : « Et pourquoi pas moi ? » J’ai pris ma voiture, dont le siège avant était cassé. J’y ai installé une chaise à l’aide de cordes et j’ai demandé à ma mère la permission d’aller à Paris voir cette madame Harlé. Je me souviens avoir remonté les Champs-Elysées. J’ai fait le tour de l’Arc de triomphe, j’ai aperçu les stores rouges du Fouquet’s. Je n’étais jamais entrée dans un restaurant ou un café, mais je me suis dit que c’était si beau, je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis garée devant, j’ai commandé des huîtres comme mes voisins de table, je n’en avais jamais mangé. J’ai bu l’eau du rince-doigts jusqu’à ce qu’un monsieur très chic me dise très gentiment qu’elle ne servait pas à ça. Je me suis ensuite rendue passage Choiseul pour me présenter à l’agence de Catherine Harlé. Comment avez-vous été reçue ? Je m’en souviens comme si c’était hier. Elle m’a dit : « Vous voulez quoi mon petit ? ». « Je voudrais faire des photos dans des magazines » Elle : « Vous n’y pensez pas ! » Elle s’est saisie d’un stylo pour soulever ma jupe et me montrer mes jambes qu’elle devait trouver trop grosses. « Vous n’avez aucune chance, repartez dans votre usine. » Elle m’a recontactée trois mois plus tard pour me proposer de faire des photos pour des catalogues, ce qui était nettement moins bien considéré, mais j’ai accepté tout de suite. Et vous quittez Soissons… J’ai beaucoup voyagé, mais ce voyage-là, ces 100 kilomètres qui vous arrachent à vos racines est le plus long au monde. Parce que c’était toute la vie qui se jouait là. Je quittais un lieu de naissance et de mort. Je savais que ce départ serait sans retour, j’avais la peur au ventre d’être seule, définitivement seule. A Paris, j’habitais dans une petite chambre rue Saint-Joseph et je gagnais suffisamment pour subvenir aux besoins de ma mère et de ma sœur. J’ai acheté des livres sur Greta Garbo, Marlène Dietrich et Ingrid Bergman, trois stars dont je me suis inspirée. Très vite, j’ai obtenu des couvertures de Vogue. « Je dormais dans le salon de maquillage de Mistinguett. Le soir, on faisait des collages avec Prévert » Quels souvenirs avez-vous de ces débuts à Paris ? Je suis tombée amoureuse d’un étudiant en psychiatrie, Abraham, un homme meurtri de dix-huit ans mon aîné, qui était juif et orphelin d’une famille de déportés. Il m’a emmené rue des Rosiers, m’a raconté l’histoire de ses parents, raflés par les Allemands. Cette première prise de conscience politique a été à la fois terrible et déterminante, elle ne m’a plus quittée. C’est cet homme qui m’a éduquée, m’a appris à lire. Avant, je ne savais rien. Il me forçait à lire Céline et Primo Levi, nous allions au cinéma. Ses amis étaient médecins, avocats, galeristes, ils étaient comme des pères avec moi. Comme il me trompait, je l’ai quitté. J’ai ensuite rencontré Peter Wyss, un photographe suisse allemand de talent, qui a fait les magnifiques photos du livre édité grâce à l’écrivain Mathieu Terence. Nous habitions sur la terrasse du Moulin-Rouge, avec pour voisins Jacques Prévert et la femme de Boris Vian. Je dormais dans le salon de maquillage de Mistinguett. Le soir, on faisait des collages avec Prévert. C’était très joyeux. Grâce aux photos de Peter, j’étais prise partout, ma carrière de cover-girl décollait. Ce furent des années intenses. Et Louis Malle vous repère en couverture du magazine « Elle »… Il m’a contactée. Moi, je n’avais jamais pensé à faire du cinéma ou du théâtre. Peter a dû quasiment m’amener de force chez lui car je ne voulais pas y aller, j’étais terrifiée à l’idée d’essuyer un refus. Louis Malle a commencé à me poser des questions. Il était issu de la famille Béghin et m’a interrogée sur la sucrerie dans laquelle j’avais travaillé. On a répété pendant deux mois chez lui. Un jour, je lui ai dit : « C’est mon dernier jour, je sais que vous voyez d’autres filles pour le rôle. J’arrête. » Il m’a rappelée une semaine plus tard : « Est-ce que vous êtes prête à changer de métier ? » J’étais choisie. J’ai couru dans tout Paris tellement j’étais heureuse. Le succès de Lacombe Lucien a été mondial. Après, on m’a proposé d’autres grands rôles, mais je voulais apprendre le métier et j’ai recommencé au début. Lacombe Lucien m’a conduite aux Etats-Unis où j’ai rencontré au festival de New York Liza Minnelli, et surtout Milos Forman. J’ai appelé Peter à Paris et je lui ai dit : « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Milos Forman, viens me chercher. » Il m’a répondu : « Non, tu es une grande fille » et il est reparti vivre à Zurich. Ça a duré quatre ans avec Milos, il ne voulait pas que je le quitte une seconde. J’ai passé tout le tournage de Vol au-dessus d’un nid de coucou à ses côtés. Vous êtes une grande amoureuse… Un jour, Francis Ford Coppola me demande de rejoindre le tournage d’Apocalypse Now aux Philippines. J’ai d’abord refusé car il y avait des scènes de nu. J’avais fait des photos de nu pour gagner ma vie dans les magazines, Louis Malle m’avait également mise nue, je l’avais mal vécu, mais j’ai décidé de faire confiance à Coppola. Je suis partie les rejoindre aux Philippines. Le tournage devait durer quinze jours, il a duré deux mois. Quand je suis arrivée là-bas, la folie régnait partout. Il y avait eu un typhon, Coppola était perdu, il ne savait pas comment terminer son film, Dennis Hopper était devenu fou, Martin Sheen faisait une crise cardiaque, Marlon Brando ne savait plus s’il voulait continuer le film ou pas, j’étais la seule femme là-dedans. Mon rôle a été coupé au montage, mais je n’en ai pas souffert. J’ai ensuite tourné beaucoup en Italie et grâce à Coppola, j’ai rencontré l’homme de ma vie : Dean Tavoularis, son chef décorateur et son frère de cœur. A partir de là vous avez partagé votre vie entre Paris et Los Angeles… J’ai été adoptée par la famille Coppola. Je faisais des allers-retours tout le temps. J’ai eu parfois des regrets. Peut-être aurais-je davantage tourné si j’étais restée en France, mais je ne pourrai jamais le savoir. Jouer a toujours été un plaisir immense. Je suis une personne inquiète et c’est pour cela que je joue : quand je joue, j’ai peur de tout et cela me plaît ; c’est à cet endroit que je suis un peu heureuse. Vous avez également eu de grandes rencontres féminines… Avec Delphine Seyrig notamment, et surtout Chantal Akerman avec laquelle j’ai tourné huit films, une personne fondamentale dans ma vie. Avec elle, c’était instinctif. Nous avions une relation de travail, amicale, familiale, totale. Un jour, j’avais rendez-vous avec Chantal dans notre restaurant habituel, en face de la gare du Nord. J’ai attendu une heure, deux heures, et je suis rentrée chez moi. J’ai appris qu’elle s’était suicidée. J’ai interdit qu’on me dise comment tant ça a été terrible. Aujourd’hui vous vivez à Paris avec votre mari… Nous n’en pouvions plus de tous ces voyages. Je me sens calme, presque heureuse. Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé, comment cette petite fille de la campagne a pu avoir cette vie. J’ai rompu la solitude sans m’en rendre compte. Je suis très entourée, mais au fond, je reste une femme seule qui regarde par la fenêtre l’obscénité du monde. Livre : « Une femme sans fin s’enfuit, Aurore Clément ». Texte de Mathieu Terence, photographies de Peter Wyss, the (M) éditions, octobre 2022, 84 pages, 450 €. Edition limitée à dix exemplaires numérotés et signés accompagnés d’un tirage unique. Crédit photo : CAROLE BELLAÏCHE POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2022 1:36 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération - 28 octobre 2022 Début 2022, la Comédie-Française présentait «Tartuffe ou l’Hypocrite» de Molière, version en trois actes censurée en 1664, perdue et reconstituée par Georges Forestier. Ce dernier, qui considère cette pièce comme son adaptation, assigne l’institution culturelle pour «violation de ses droits d’auteur» Souvenez-vous, c’était en janvier dernier, la Comédie-Française ouvrait les célébrations du 400e anniversaire de Molière par un événement extraordinaire : la création mondiale d’une version de Tartuffe en trois actes telle que l’avait écrite et voulue Molière, et jouée seulement trois fois, en privé, devant le roi, lors d’une grande fête de printemps dans les jardins de Versailles en 1664. Le souverain applaudit la pièce, avant de la faire interdire deux jours après la première pour des raisons politiques et religieuses, sous la pression des dévots. Durant des siècles, cette première version de Tartuffe, mentionnée dans des lettres, Tartuffe, et parfois l’Hypocrite, pour laquelle Molière s’était battue, avait disparu. Ou plutôt, comme l’a montré Georges Forestier, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste incontesté du Grand Siècle, auteur d’une biographie de Molière qui fait autorité, elle était restée dissimulée sous la pièce en cinq actes passée à la postérité sous le titre Tartuffe ou l’Imposteur, parmi les plus célèbres de Molière, et la plus jouée au Français, loin devant l’Avare. Pour restituer la version cachée, en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier, par ailleurs responsable de l’édition dans la Pléiade de l’œuvre complète de Molière. Début janvier, quinze jours avant la première, Libération rencontrait l’universitaire dans la bibliothèque-musée de la Comédie-Française, en compagnie de la conservatrice-archiviste de la Maison de Molière Agathe Sanjuan. Laquelle ne cachait pas son enthousiasme et témoignait que c’est grâce «à une connaissance inégalée» de Molière et sa troupe que Georges Forestier avait pu faire resurgir ce Tartuffe dévot hypocrite scandaleux, en dépit des documents manquants et notamment en l’absence de tout manuscrit puisqu’à l’époque, ils n’étaient pas conservés. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. La Comédie-Française comme Georges Forestier se réjouissaient de voir enfin cette pièce jamais présentée dans un cadre institutionnel monté par Ivo van Hove, metteur en scène on ne peut plus prestigieux. Deux mois plus tard, rien ne va plus ! En mars, Georges Forestier demande à la Comédie-Française de lui verser des droits d’auteur. En septembre, comme l’a révélé mardi la cellule investigation de Radio France, le spécialiste a assigné la Comédie-Française et les cinémas Pathé qui ont diffusé en live des représentations, devant les tribunaux pour «violation de ses droits d’auteurs». «Il a modifié la fin de la pièce» Joint par Libération, le conseil de la Comédie-Française, maître Julien Guinot-Deléry, estime que «la reconstitution en art n’est pas un phénomène nouveau» et n’engage pas obligatoirement des droits. «Tout dépend de la nature du travail de monsieur Forestier.» Il rappelle dans un communiqué que Georges Forestier a préalablement autorisé le théâtre à s’appuyer sur ses travaux d’historien du théâtre pour la production de la pièce le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière. L’avocat regrette que la partie adverse ait choisi de médiatiser le litige et souligne que Georges Forestier a attendu le mois de mars, bien après les premières représentations en janvier, pour revendiquer des droits d’auteur. Pour l’heure, la Comédie-Française ne souhaite pas s’exprimer davantage. Selon l’avocat du plaignant, maître Jean-Paul Carminati, il est à l’inverse évident que Georges Forestier a fait œuvre d’adaptation, et qu’il s’agit d’un texte original comme l’atteste le contrat d’édition qui commercialise la «nouvelle» pièce de Molière aux éditions Portaparole sur laquelle il touche des droits. En matière juridique, explique l’avocat, «l’adaptation ne se mesure pas en terme de quantité mais d’effet et d’originalité». On est en droit de revendiquer sa qualité d’auteur quand on y place son «empreinte». Maître Carminati précise : «Ici, Georges Forestier a opéré une adaptation par soustraction de textes et réagencement de séquences, et il a modifié la fin de la pièce.» Denis Podalydès, qui joue le rôle-titre dans cette version de Tartuffe reprise du 31 janvier au 19 mars 2023, s’étonne : «Dans ce cas-là, la majorité des interprètes et les metteurs en scène sont des auteurs qui s’ignorent ! Il nous arrive souvent de cheviller des alexandrins, d’en réinventer, de soustraire des passages. Y compris dans ce Tartuffe, j’ai ajouté avec l’autorisation d’Ivo Van Hove deux alexandrins pris dans le second acte supprimé qui me semblaient nécessaires ! Quand j’ai monté Cyrano de Bergerac, j’y ai introduit une série d’alexandrins consacrés aux anciens sociétaires de la maison, et j’ai réagencé des vers, et coupé dans la pièce !» «Sans moi, [la pièce] n’existerait toujours plus» Dans les Fourberies de Scapin, que l’acteur a également mise en scène, un passage lui apparaissait «comme une ivresse du texte». Il a demandé à Benjamin Lavernhe qui interprétait le rôle-titre, «de s’emparer du grand plateau en improvisant» comme le faisait probablement la troupe de Molière – qui présentait les spectacles sans partition fixée. Podalydès explique : «On joue avec les canons d’une pièce de la manière qui nous semble la plus proche de l’auteur selon notre lecture subjective.» Le sociétaire de la Comédie-Française regorge d’exemples : «Quand j’ai monté Fantasio, de Musset, j’y ai adjoint un dialogue entre deux poètes ratés Dupont et Durand. Ai-je revendiqué des droits ? Bien sûr que non.» Pour autant, on ignore quelle serait sa réaction si un metteur en scène s’arrogeait la paternité de ce dialogue ou le reprenait à son compte. Pour le comédien, la revendication de Georges Forestier est autant une question «morale, éthique, et esthétique» qu’un problème juridique. Ce à quoi Forestier nous envoie une réponse tranchante : «Les acteurs et les metteurs en scène coupent dans une pièce qui reste la même. Moi, j’ai coupé, (et j’ai ajouté) pour créer une autre pièce très différente sur le plan émotionnel, thématique, et politique, qui avait existé mais qui n’existait plus, et qui sans moi n’existerait toujours plus.» «Revoir mes prétentions à la hausse» Aucun contrat n’a prévalu à l’exploitation du Tartuffe en trois actes que Georges Forestier a transmis en plein confinement en avril 2020 à Denis Podalydès et l’administrateur général de la Comédie-Française, Eric Ruf. Silence de quelques mois. La bonne surprise arrive le 26 janvier 2021, lors d’une première conversation téléphonique où Georges Forestier apprend que le metteur en scène Ivo Van Hove a choisi la version restituée en trois actes de Tartuffe, plutôt que la pièce qu’on connaît. Forestier reçoit ensuite immédiatement un mail du directeur de la production de la Comédie-Française : «Un grand merci de nous autoriser à présenter la version en 3 actes du Tartuffe de Molière que vous avez reconstituée. Un grand merci également de nous avoir proposé de présenter gracieusement cette version. Comme je vous l’ai dit, nous allons nous rapprocher de la SACD [Société des auteurs et compositeurs dramatiques, ndlr] pour étudier les différentes possibilités et je reviendrai vers vous afin que nous puissions en parler ensemble.» Tous les mots pèsent. De son côté, Georges Forestier lui confirme qu’il autorise la maison «à présenter gracieusement» cette version, tout en ajoutant dans une parenthèse : «Il sera bien temps si vous entamez une tournée mondiale dans les plus grandes capitales de revoir mes prétentions à la hausse.» Selon l’avocat de Georges Forestier, cet échange ne vaut pas contrat et la Comédie-Française était dans l’obligation de préciser les conditions de l’exploitation de la pièce, le nombre de représentations et ainsi que les lieux. Pourquoi donner «gracieusement» les fruits de sa recherche si c’est pour ensuite, faire «un revirement» selon le mot de l’avocat de la Comédie-Française, et exiger des droits d’auteur ? Georges Forestier nous l’explique : «Dans mon esprit, j’ai donné gracieusement à la Comédie-Française le droit de cession ou d’autorisation de représenter mon adaptation de Tartuffe ou l’Hypocrite. En revanche, un membre de la SACD n’a pas le droit de renoncer à ses droits d’auteur. Naïvement, je pensais que la Comédie-Française déclarerait à la SACD ce Tartuffe en trois actes comme une adaptation. Or, la pièce a été qualifiée comme n’importe quelle autre pièce de Molière tombée dans le domaine public.» Ce qui prive de facto George Forestier de tout droit d’auteur sur chaque place vendue. «Travaux d’archéologie littéraire» Est-ce parce qu’il a constamment mis l’accent sur le caractère «scientifique» de sa méthode, ce qui laisse supposer que tout historien ayant la même connaissance encyclopédique et fréquentation du Grand Siècle que lui aurait peu ou prou abouti à la même version de la pièce «d’origine» de Molière ? Ou est-ce parce que l’administration de la Comédie-Française est bien avertie de ce qu’impliquerait l’utilisation du mot «adaptation» ? Georges Forestier n’est, à notre connaissance, jamais présenté comme un adaptateur dans les différents documents qui accompagnent l’exploitation de la pièce. Ainsi, dans le programme de salle distribué en janvier dernier, il est mentionné comme ayant «restitué» avec la complicité d’Isabelle Grellet la pièce interdite. A la fin du programme, un texte d’Agathe Sanjuan met l’accent sur les «travaux d’archéologie littéraire» de Georges Forestier qui a permis l’émergence du texte initial. C’est toute l’ambiguïté de cette version dont la valeur est d’autant plus grande qu’on lui accorde le crédit d’être la plus proche possible de ce qu’aurait écrit Molière. En d’autres termes, ce qui paraît fonder l’originalité de ce Tartuffe ou l’Hypocrite – le titre est de Georges Forestier – est de révéler une pièce originale signée de Molière, incontestable et incontestée par ses pairs, et qui n’a nécessité «l’ajout que d’une quinzaine de vers pour souder» l’ensemble nous confiait-il en janvier, «bien moins que ce qu’exige de peinture un tableau lorsqu’on le restaure». Proposition de dédommagement de 15 000 euros Selon nos informations, l’homme de lettres a reçu une première proposition de l’avocat de la Comédie-Française, qu’on a pu consulter et qui l’engage à renoncer à toute réclamation financière à l’encontre de la Comédie-Française et de la société Pathé et à avertir la SACD qu’il ne revendique la perception d’aucun droit. Et une seconde, cet automne, qui l’invite à accepter un dédommagement de 15 000 euros en solde de tout compte en tant que «collaborateur occasionnel», à condition qu’il renonce à sa qualité d’auteur d’une adaptation originale. De son côté, le conseil de monsieur Forestier a écrit au ministère de la Culture afin qu’une solution soit trouvée et le procès évité. Selon Georges Forestier, la Comédie-Française est bien la seule à nier son statut d’auteur. «Quand mon Tartuffe a été monté cet été par la Compagnie Veilleur dans la maison Maria-Casarès à Poitiers, la SACD m’a prévenue qu’elle allait collecter mes droits d’auteur que j’ai par ailleurs accordés gracieusement à la compagnie.» Les tentatives de conciliations entre la Comédie-Française et Georges Forestier n’ont pour l’instant pas abouti. Une première audience de procédure aura lieu le 24 novembre. Les suivantes suivront si aucun accord n’est trouvé d’ici là, en juin ou septembre prochain. Anne Diatkine / LIbération Légende photos : Pour restituer la version cachée de «Tartuffe» de Molière (à droite), en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier. (Mantovani/Opale, Alamy/Abaca)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2022 8:30 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 28 oct. 2022
Seulement un quart des entrepreneurs des arts de la scène remplissent l’obligation légale de transmettre leurs données de billetterie.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/10/28/spectacle-vivant-la-frequentation-difficile-a-mesurer-quatre-ans-apres-la-creation-du-systeme-de-billeterie-sibil_6147666_3246.html
Quelle est la fréquentation du spectacle vivant en France ? A cette question en apparence simple le ministère de la culture n’est toujours pas en capacité d’apporter une réponse précise. Pourtant, il a lancé depuis quatre ans un nouveau système d’information billetterie (Sibil) dans lequel toutes les structures accueillant des spectacles, qu’elles relèvent du secteur public ou privé, doivent ouvrir un compte et transmettre leurs données. Mais encore faut-il que cet outil d’observation soit alimenté. Or, à l’heure actuelle, seulement un quart des entrepreneurs de spectacles remplissent cette obligation inscrite dans la loi relative à « la liberté de la création, l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016. « Sur 12 000 inscriptions attendues, nous en avons 3 200 », détaille-t-on Rue de Valois, où Sibil est copiloté par la direction générale de la création artistique et le secrétariat général. En mai, un rapport de la Cour des comptes consacré au « soutien du ministère de la culture au spectacle vivant » relevait le manque criant de données « fiables » et exhaustives sur le nombre annuel de spectacles et d’entrées. « Les importantes difficultés de déploiement de Sibil doivent impérativement être surmontées à brève échéance », insistaient les magistrats de la Rue Cambon. Développé par le cabinet de conseil Capgemini pour un budget de 400 000 euros, le logiciel Sibil est censé centraliser les données de billetterie pour obtenir une photographie du secteur économique du spectacle vivant, un état des lieux de la création et de la diffusion afin de mieux évaluer l’impact des politiques publiques. Les entrepreneurs de spectacles doivent transmettre, par voie dématérialisée, le nombre d’entrées (payantes ou gratuites), le prix, le type de spectacle, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le lieu de représentation et la durée de la programmation. « Tradition d’opacité » Si tous les éditeurs de billetterie proposent désormais une remontée automatisée vers Sibil – ce qui évite le déclaratif sur papier –, moins de 30 % des salles l’utilisent. Bien sûr la crise sanitaire a en partie retardé le processus. Mais elle n’explique pas tout. « Il y a une grande tradition d’opacité dans le spectacle vivant. Chacun a envie de savoir ce qui se passe chez l’autre mais personne n’a envie de dire ce qui se passe chez lui. Cela fait près de vingt ans que le sujet des données de fréquentation est sur la table et que plus de transparence est demandée », souligne un connaisseur du dossier. « Le ministère de la culture a créé un seul outil pour un secteur trop large » - un responsable du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles Contrairement au cinéma, dont on peut suivre, grâce au Centre national du cinéma (CNC), les détails de la fréquentation des salles et de la répartition des entrées par film, le spectacle vivant demeure le parent pauvre de la statistique. Or, en cette période post-Covid, il serait plus que jamais intéressant de savoir si le public a retrouvé le chemin des lieux de spectacle. A titre d’exemple, les chiffres du premier semestre 2022 fournis par le Syndicat national du théâtre privé (SNTP) affichent une baisse de 25 % à Paris et de 16 % en province, comparativement au premier semestre 2019. « Les discussions sur la conception de Sibil ne se sont pas très bien passées, se souvient l’un des responsables du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac, qui regroupe quelque 300 structures subventionnées). Le ministre a demandé par exemple les données des places gratuites sans faire la différence entre les places de servitude [ministère, médecin de garde, accompagnateurs de personnes handicapées, etc.] et les invitations. » A ses yeux, « la Rue de Valois a créé un seul outil pour un secteur trop large, aux typologies trop diverses ». « Aucun retour » Des cafés-théâtres aux centres dramatiques nationaux, en passant par les théâtres municipaux ou privés, les opéras, les salles de concert, etc., il est vrai que le paysage du spectacle vivant est vaste. « Même si l’idée est louable, c’est une usine à gaz peu opérationnelle », estime-t-on au SNTP. « Je suis incapable de dire si on transmet à Sibil », lâche un directeur de salle parisienne. Et il n’est pas le seul. Si, de leur côté, toutes les structures subventionnées ont embarqué sur Sibil, « nous n’avons aucun retour quant à l’exploitation des données fournies. C’est comme si ça tombait dans un trou », regrette le Syndeac. Au vu du nombre actuel d’inscrits, le ministère de la culture admet son incapacité à publier des premiers résultats : « Nous avons besoin de données robustes et homogènes, ce qui n’est pas encore le cas. D’autant que les lieux doivent aussi nous transmettre, de manière rétrospective, tous les chiffres de 2019, qui sera l’année référence. » Sibil, précise la Rue de Valois, « ne sera pas un outil de flicage mais d’observation. Les données ne seront pas individualisées mais agrégées par domaine artistique, par région, on ne citera pas les structures ». Bref, ce nouvel outil n’est pas près de livrer ses premières statistiques. « Nous avons encore beaucoup de travail de communication et de conviction à poursuivre auprès des lieux », reconnaît-on au ministère. Il faudra attendre au mieux 2023 pour obtenir « des données qui font sens ». Sandrine Blanchard Légende photo : Lors du concert de Bigflo & Oli, à Audincourt (Doubs), le 1er octobre 2022. LIONEL VADAM/« L'EST RÉPUBLICAIN »/MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2022 4:55 AM
|
Publié par Sceneweb le 28 octobre 2022 Alexander Neef, Directeur général de l’Opéra national de Paris, a nommé José Martinez Directeur de la Danse, succédant ainsi à Aurélie Dupont. L’ancien directeur de la Compagnie nationale de danse d’Espagne et danseur Étoile du Ballet de l’Opéra de Paris prendra ses fonctions le 5 décembre 2022. Né en 1969 à Carthagène, en Espagne, José Martinez commence la danse dans sa ville natale puis entre au Centre de Rosella Hightower, à Cannes, dans la classe de José Ferran.
En 1987, il remporte une bourse au Prix de Lausanne qui lui ouvre les portes de l’École de Danse de l’Opéra de Paris. Il est engagé l’année suivante dans le Corps de Ballet et devient «Sujet» en 1990. « Prix du public » 1991, il remporte en 1992 la médaille d’or du Concours International de Danse de Varna et reçoit le Prix du Cercle Carpeaux. Il est, cette même année, promu « Premier danseur ». Mats Ek le choisit pour être l’Hilarion de sa Giselle. À l’issue de la représentation de La Sylphide, le 31 mai 1997, il est nommé « Danseur Étoile ».
Il sera à la fois l’interprète des princes lumineux et des monarques plus sombres, tels le Nosferatu de Jean-Claude Gallotta ou encore le terrible Ivan de Iouri Grigorovitch.
Remarqué par les chorégraphes invités – et plus particulièrement ceux d’expression contemporaine – il crée également à l’Opéra national de Paris, Pas./parts de William Forsythe (1999), Appartement de Mats Ek (2000). Pina Bausch le choisit pour être Orphée dans son opéra dansé Orphée et Eurydice (2008).
Il a également à son répertoire : Giselle (d’après Jean Coralli et Jules Perrot), La Sylphide et Paquita (versions de Pierre Lacotte), Les Sylphides (Mikhail Fokine), Till Eulenspiegel (d’après Vaslav Nijinski), La Symphonie fantastique, Parade et Le Tricorne (Léonide Massine), les productions de Rudolf Noureev (Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette, Raymonda, Don Quichotte, Cendrillon, Roméo et Juliette, La Bayadère), Suite en blanc (Serge Lifar), Études (Harald Lander), Grand Pas classique (Victor Gsovsky), Soir de fête (Léo Staats), les œuvres de George Balanchine (Le Palais de cristal, Sylvia – pas de deux, Thème et variations, Les Quatre Tempéraments, Agon, Joyaux, Tchaïkovski – pas de deux), celles de Maurice Béjart (IXe Symphonie, Webern op. V, Le Concours, Boléro), celles de John Neumeier (Le Songe d’une nuit d’été, Vaslaw, Magnificat, Sylvia, La Dame aux camélias), Le Messager du Chant de la terre et Lescaut dans L’Histoire de Manon (Kenneth MacMillan), Frollo dans Notre-Dame de Paris, Don José dans Carmen et Passacaille (Roland Petit), Rhapsody (Frederick Ashton), Temptations of the Moon (Martha Graham), Auréole (Paul Taylor), In The Middle, Somewhat Elevated, Pas./parts et Woundwork 1 (William Forsythe), Stepping Stones (Jiří Kylián), Giselle, A sort of… et Appartement (Mats Ek), Les Variations d’Ulysse (Jean-Claude Gallotta), Le Rire de la lyre (Montalvo-Hervieu), Coppélia (Patrice Bart), Shéhérazade (Blanca Li), Onéguine (John Cranko).
Pour sa carrière de danseur, José Martinez a reçu le prix Danza & Danza (1998), le Prix Léonide Massine-Positano pour son interprétation du Tricorne de L. Massine, le Grand Prix National de la Danse (Espagne, 1999), le Prix France/Chine (2004) et le Prix des Arts scéniques (Espagne, 2005). Il est Commandeur des Arts et des Lettres.
En dehors de ses activités à l’Opéra national de Paris, José Martinez a dansé dans les plus grandes compagnies du
monde, et a formé le groupe « José Martinez en Compagnie » qui s’est produit régulièrement, plusieurs années, en Europe (particulièrement en Espagne) et aux États-Unis. Chorégraphe, il signe sa première création en 2002, Mi Favorita, dont il présente une nouvelle adaptation sur la scène du Palais Garnier pour les spectacles « Jeunes danseurs » en 2003. Une première œuvre créée sur des musiques de Gaetano Donizetti, pour laquelle il puise dans son acquis de danseur la matière d’un ballet « classique », s’amusant à prendre quelques distances avec le répertoire qu’il cite ou détourne avec humour et fantaisie. Il chorégraphie la même année un pas de deux, Delibes Suite, qui est également repris pour le spectacle des Jeunes danseurs de l’Opéra en 2006 et entre au répertoire du San Francisco Ballet en 2007. En 2005, il livre une pièce pour les élèves de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris, Scaramouche, au travers de laquelle il renoue avec la tradition de pantomime de la commedia dell’arte. La même année, il crée au Japon, Parenthèse 1, un solo pour Laëtitia Pujol et, en 2006, Soli-ter, dans le cadre des spectacles d’« Incidence Chorégraphique» puis Favoritita pour les danseurs du Junior Ballet du CNSMDP. Il présente en 2007, au Musée Picasso de Malaga en Espagne, El Olor de la Ausencia (L’Odeur de l’absence) un duo sur fond de guerre d’Espagne. En octobre 2008, pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, il chorégraphie Les Enfants du paradis d’après le chef-d’œuvre du cinéma français de Marcel Carné et Jacques Prévert.
En 2009, il reçoit le « Prix Benois de la Danse » pour cette chorégraphie. Il poursuit sa collaboration avec le CNSMDP en créant Ouverture en deux mouvements (2009). En 2010, il crée pour le Ballet de Shanghaï Marco Polo, the last mission. Il a aussi créé Résonance en 2014 pour le Boston Ballet.
José Martinez est directeur artistique de la Compagnie Nationale de Danse d’Espagne de 2011 à 2019. Pendant deux mandats, il donne une nouvelle identité à la Compagnie, avec un équilibre entre un nouveau répertoire classique et la création contemporaine travaillant avec des chorégraphes comme Mats Ek, Ohad Naharin, Angelin Preljocaj, Jiří Kylián, Johan Inger, William Forsythe, Itzik Galili, Sharon Fridman, Annabelle Lopez Ochoa, Andonis Foniadakis et Nacho Duato. Le ballet néoclassique et classique est présent dans la Compagnie pendant cette période avec des œuvres de George Balanchine, Jérome Robbins, Uwe Scholz, Ben Stevenson, Roland Petit, Marius Petipa ou August Bournonville et une vraie identité est créée avec des créations de jeunes chorégraphes de la scène espagnole comme Ivan Perez, Alejandro Cerrudo, Iraxte Ansa, Cayetano Soto, Marcos Morau & La Veronal, Mario Bermudez, Goyo Montero, Juanjo Arques, Altea Nuñez, Arantxa Sagardoy, entre autres… L’éclectisme de la programmation inclut des œuvres historiques comme Le Tricorne de Léonide Massine, repris lors du centenaire de la création du ballet, tout autant que le Show Must Go On de Jérôme Bel (œuvre incluant des non-danseurs qui ont rejoint la Compagnie pour ce projet). Il crée lui-même pour la Compagnie Nationale de Danse, durant cette période, Sonatas (2012), Raymonda Divertimento (2013), Don Quichotte (2015) et Casse-Noisette (2018).
Programmant des résidences de création au sein de la Compagnie pour de jeunes chorégraphes, favorisant les rencontres et les collaborations, il épaule et accompagne les talents créatifs de ses propres danseurs leur permettant de s’épanouir comme chorégraphes. Certains d’entre eux, comme Antonio de Rosa et Mattia Russo ont même créé leur propre compagnie, Korsia, par la suite.
Depuis 2019, il est professeur et chorégraphe indépendant. En mars 2020, il crée sa version du ballet Le Corsaire pour le Ballet de l’Opéra de Rome puis met en scène une nouvelle version en Slovénie avec le Ballet de l’Opéra de Ljubljana (2021). En parallèle, ses deux chorégraphies du Concert du Nouvel An de Vienne en 2020 et 2021, remportent un grand succès. Ses derniers projets le conduisent au Croatian National Theatre à Zagreb, où il propose en 2022 sa version de Giselle.
28 OCTOBRE 2022/PAR DOSSIER DE PRESSE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2022 9:37 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 21 octobre 2022 Frêle et pudique, il incarne le père imaginé par Antonio Tarantino dans Vêpres de la Vierge bienheureuse, dans une mise en scène sobre et sensible de Jean-Yves Ruf. C’est Olivier Cruveiller et Paul Minthe qui avaient fait connaître à Jean-Yves Ruf La Passion selon Jean d’Antonio Tarantino, texte traduit par Jean-Paul Manganaro et publié aux Solitaires Intempestifs. Ils créèrent le spectacle vers 2010. L’écrivain, d’abord connu comme plasticien, peintre, sculpteur, s’était mis tardivement à l’écriture dramatique. A plus de cinquante ans. Sa manière de transcrire, en d’étranges textes irrigués d’une culture chrétienne, mais puisant ses racines dans les vieux fonds mythologiques méditerranéens, sa passion pour les humbles, sa manière ferme d’affronter les réalités de la société, lui valurent une reconnaissance immédiate et de nombreux prix prestigieux. Les artistes et le public l’aimeront toujours. Né le 10 avril 1938, à Bolzano, dans le nord-est de l’Italie, Antonio Tarantino s’est éteint le 21 avril 2020. Partout célébré, traduit, il avait pourtant été rattrapé par la pauvreté, comme s’il avait rejoint ses « personnages » -mais il avait reçu une aide de l’Etat… Un être à part, une âme forte. Aujourd’hui, on peut donc découvrir Vêpres de la Vierge bienheureuse. Dans la petite salle du Rond-Point, salle Roland-Topor, dans une proximité émouvante avec l’unique interprète, l’interprète unique qu’est Paul Minthe. Un banc et une urne funéraire. On comprend que l’homme, avec son pantalon qui plisse sur ses talons, son chapeau vissé sur la tête, attend le bus qui le ramènera vers la gare. L’urne est celle des cendres de son fils. Il avait fui sa famille. A Milan, il a basculé : travesti, prostitué, malheureux. Il a fini par se suicider. Tardivement, son père se reprend. Il le comprend, il le célèbre. Dans le monologue de cet homme frêle comme un enfant, les voix de la mère, les voix des voisins, pointent parfois. Le texte est difficile parfois, à cause de ces ruptures peu marquées. Jean-Yves Ruf dirige avec tact, intelligence, tendresse, le comédien et donne à entendre ces étranges « vêpres ». Le père ne se justifie de rien. Il lui a fallu le temps de la séparation pour comprendre son enfant. A la fin, il lui donne des conseils. Surtout ne pas se séparer de sa belle robe rouge, ni de ses cothurnes : ainsi sera-t-il accepté dans l’au-delà. Celui des Grecs. Car c’est là qu’il a sa place, une fois traversé le Styx redoutable… La ferveur contenue, la voix tendre, la douceur et la grâce de Paul Minthe, sont magnifiques. Tout, ici, bouleverse. Mais sans démonstration aucune. Un art très fin préside à la représentation. Armelle Héliot Théâtre du Rond-Point, à 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h30. Durée : 1h15. Jusqu’au 30 octobre. Tél : 01 44 95 98 21. Texte aux Solitaires Intempestifs. www.theatredurondpoint.fr Légende photo : Paul Minthe dans la mise en scène de Jean-Yves Ruf - Crédit Photo © Alban van Hassenhove Autre critique de Christine Friedel publiée dans Théâtre du blog : Un petit homme frêle porte sur son bras, très simplement, comme un bouquet de fleurs embarrassant ou un enfant tenu avec une certaine maladresse, l’urne contenant les cendres de son fils. C’est l’histoire d’un éloignement, d’une séparation, entre un pas-grand-chose de père et un fils inquiet, différent et qui se fera travesti à Milan. Il faudra son suicide par noyade pour que le père remonte le courant et, faute de le ramener à la maison, l’accompagne enfin. Il parle de sa propre vie, pas reluisante, faite de bagarres et traîneries de bistrot, avec des copains qui ne valent pas mieux que lui. Traversant son récit, la voix de la femme, de la mère, en colère contre ce propre à rien incapable d’apporter une lire à la maison, sinon fauchée en douce.
Et puis on entend celle du fils, douloureuse. Et c’est comme si ces voix transformaient l’homme. Elles font de lui le « psychopompe », le tendre accompagnateur de l’âme de son fils jusqu’au cœur de la mort. Ta robe de fille, tes talons hauts ? Oui, garde-les, glorieux, cela t’ouvrira une priorité chez les morts. Tu pourra te payer le passage du Styx. Et les anges battent des ailes, apaisants….
Antonio Tarantino, récemment disparu comme on dit, mais très présent par son théâtre, était aussi peintre et sculpteur. On est tenté de déchiffrer dans son écriture cette pratique d’artiste : il écrit comme on peint au couteau, avec de la matière, posée en gestes larges ou par petites touches. Cela donne une langue heurtée, bizarre, dérobée, avec des trous– rendons un hommage particulier au traducteur, Jean-Paul Manganaro- et pas commode à lire.
En compensation, cette langue donne beaucoup au théâtre, au personnage comme au comédien. Double effet : ce collage, ces accidents permettent aux différentes voix qui traversent ces Vêpres de se faire entendre, et au spectateur de suivre de mieux en mieux le chemin que fait dans sa tête ce père pas intéressant, à l’en croire.
On dira que c’est le principe même de l’écriture théâtrale, mais Tarantino en joue, dans ce flux interrompu, avec une force particulière.
Cette langue de théâtre unique permet de passer à l’état brut du social, au très intime, et du très intime, au spirituel. Tout en permettant au public de faire la synthèse des émotions ressenties. Grandissant son fils dans la mort, le père accède lui-même à une dignité et devient la « mater dolorosa » consolatrice « bienheureuse » de cette mort réconciliée. Passion selon Jean est le premier texte d’Antonio Tarantino que Paul Minthe a apporté à Jean-Yves Ruf, en 2008. Avec Olivier Cruveiller, il lui en avait fait entendre une lecture. Car il faut l’entendre, il faut l’effort des comédiens, leur présence physique pour que cette écriture prenne sens, avec sa force et sa musicalité. Jean-Yves Ruf est musicien, et, avec Paul Minthe, a réussi l’interprétation parfaite.
Une mise en scène très discrète : le père est debout devant un banc, finit par s’asseoir, avec ce poids lourd sur les bras, épuisé par le chemin parcouru dans sa conscience et ses émotions, mais l’air de rien, comme on attend l’autobus. En réalité, il se passe beaucoup de choses. Acteur et metteur en scène, ensemble creusent de plus en plus profond, sans relâche, dans la vérité du personnage.
Et la vaillance du comédien suit, sans faille, sans lâcher la simplicité de l’ «homme de rien». C’est tout et c’est essentiel. Et sans doute, ce qui produit certains soirs, un si beau silence avant les applaudissements. Le public, lui aussi, est entré dans une émotion et une pensée partagées.
Christine Friedel / Théâtre du blog Jusqu’au 30 octobre, Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, Paris (VIII ème). T. : 01 44 95 98 00. Le texte de la pièce est publié aux Solitaires intempestifs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2022 5:03 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 26 oct. 2022 Second Cabaret de l’exil au Théâtre équestre Zingaro. Des chevaux bien sûr et des musiques et des poésies colportées par le Irish travellers, un peuple nomade qui, pour la première fois, se montre en dehors de son pays, accueilli à bras ouverts par Bartabas et les siens. Au tout début du nouveau spectacle de ce diable de Bartabas, en voyant débouler sur la piste une théorie (une nuée ? Une horde ? Un régiment?) de dindons, je me suis souvenu d’autres dindons (leurs arrière-grands parents ?) moins nombreux mais au aussi dodelinants, c’était, il y a bien longtemps (4O ans? Plus ? ) un soir d’été sur l’île de la Barthelasse, au temps du cirque Aligre. Personne ne connaissait alors cette bande d’hurluberlus formés à la rue autant qu’au cirque. Ces joyeux rois du frappadingue. se prétendaient fils d’un baron , tous parlaient le skovatch, un sabir compréhensible par eux seuls. Le soir, avant le spectacle de la Cour d’honneur, je revois Martex (futur Bartabas) déboulant sur son cheval place du Palais des papes, il se dresse, avale un rat et repart. De cette aventure naîtra Zingaro. Sur la photo qui ouvre le vieil et bel album fêtant les vingt cinq ans de Zingaro, tout le monde est là : Igor et Mirage (cheval), Branlo (frère d’Igor) et Bib-bip le dindon, Nigloo et Pépé le chien, Brigitte seule à gauche de l’image, Bartabas avec l’aigle botté, Marcus et Champagne (cheval). Leurs vies vont bientôt bifurquer. Igor avec sa compagne Lilly allaient fonder l’aventure sans pareille des Dromesko, Nigloo et Branlo allaient suivre d’autres routes merveilleuses (comme celle, ces dernières années, du cirque Trottola) , Bartabas restera à la tête de Zingaro. Plus tard l’architecte Patrick Bouchain, amis de tous, construira au fort d’Aubervilliers, ce bel édifice en bois du théâtre équestre Zingaro où Bartabas et ses chevaux vivent à demeure. Quand le maître des lieux ne crapahute pas à travers le monde c’est le monde qui vient à lui, sur scène et dans la salle. De succès en succès, Bartabas parfait sa légende que le mot cirque ne résume pas et que le mot poésie scénique ne récuse pas. Dans ce livre des vingt cinq ans de Zingaro (à quand celui des cinquante ans ? ), je retrouve un entretien avec Bartabas datant d’ octobre 1991, au moment de la reprise parisienne de Zingaro opéra équestre, donné dans l’antre d Aubervilliers après la création au Festival d’Avignon. « On se sent proches de Kantor, de Novarina, de Pina Bausch. Ou du Bread and puppet, de l’Odin théâtre, de Jérôme Deschamps » me disait-il. Résumé d’une époque qu’une bonne partie des spectateurs d’Aubervilliers n’ont pas vécu. Donc, après la traversée porte-bonheur et mémorielle des dindons, place aux chevaux, place au chants et à la musique, place aux Irish travellers, second volet des cabarets de l’exil après celui de la culture Yiddish (un troisième viendra ultérieurement clore le cycle). Bartabas est allé en Irlande chercher ces frères de lait abreuvés aux chevaux, à la musique et à l’errance, en marge dans leur propre pays. Ils n’en étaient jamais sortis. Les voici avec leurs chants souvent déchirants chantées par l’immense Thomas Mc Carthy et les musiciens enjoués que sont Gerry O’Connor (violon et un peu plus que ça), Loïc Blejean (pipe, la cornemuse irlandaise)), Ronan Blejean (accordéon) et Jean-Bernard Mondoloni (bodhrán - sorte de tambour irlandais - et piano). Une vingtaine de chevaux ayant pour noms Angelo, Conquête, Corto, Dan, Dicky, Dragon, Famine, Guerre, Guizmo, Homer, Misère, Posada, Raoul, Ted, Totor, Tsar, Ultra, Oberon, Olimpo, Quijo, Schlimak, Zurbarán, sans compter la mule et l’âne. Et autant d’artistes autour de Bartabas : Henri Carballido, Sébastien Chanteloup, Michaël Gilbert, Mickaël G. Jouffray (danseur), Manolo Marty (artiste force), Perrine Mechekour, Théo Miler, Bérenger Mirc, Leonardo Montresor (corde volante), Fanny Nevoret, Paco Portero, Bernard Quental, Emmanuelle Santini, Alice Seghier, Cheyenne Vargas, Dakota Vargas, et David Weiser . Du beau monde. Une heure quarante cinq durant tout s’enchaîne sans temps mort, de cavaliers et cavalières virtuoses en gags bon enfants ou en suspension poétique tel ce poulain seul en scène dans une nuage de fumée, le spectacle lui aussi galope, entrecoupé par les chants a capella dont les premiers mots dit en français par une cavalière donnent une vague idée mais qu’importe, Thomas Mc Carthy nous emporte. Les Irish travellers voyagent en Irlande en famille avec leurs chevaux , leurs caravanes. Bien que reconnus comme une minorité ethnique depuis 2017, des associations présentent à Aubervilliers racontent comme les Irish travellers sont victimes dans leur pays de discrimination (santé, école, etc.). En Irlande comme dans la plupart des pays, ce peuple nomade est peu à peu contraint à une certaine sédentarisation. Leurs chants, leurs épopées, leur poésie, leur musique et leurs chevaux font leur force et préserve leur culture, leur identité . Ils traversent ce cabaret de l’exil comme dans un rêve, celui d’une reconnaissance au-delà des frontières de leur pays. Cabaret de l’exil, Irish travellers au Théâtre équestre Zingaro, les mar, mer, vend et sam 20h30, dim 17h30 (sf le 25 déc) ,jusqu’au 31 décembre. Légende photo : Scène de "Cabaret de l'exil, irish travellers"; © Hugo Marty
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 10, 2022 7:33 AM
|
Publié le 9 nov. 2022 dans Ouest-France Choisi pour créer les cérémonies d’ouverture et de clôture des JO de Paris 2024, en plus de la comédie Starmania qu’il met en scène, le directeur du Quai a annoncé ce mercredi soir 9 novembre aux salariés qu’il ne pouvait plus assurer ses fonctions à Angers.
La nouvelle est tombée tardivement ce mercredi 9 novembre sur la messagerie des salariés du Quai. Le metteur en scène Thomas Jolly, qui dirige le centre dramatique national angevin depuis janvier 2020, a averti tous ses collaborateurs qu’il était contraint de démissionner de ses fonctions. C’est la rançon d’un trop grand succès pour l’artiste âgé de 40 ans qui a été choisi en septembre dernier pour mettre en scène les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 et qui inaugurait ce mardi à La Seine musicale, à Paris, la nouvelle version de la comédie musicale Starmania qu’il a été chargé de dépoussiérer.... (suite de l'article réservée aux abonnés) Autre article publié le 10/11 Appelé à occuper la fonction de directeur artistique pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Thomas Jolly a annoncé mercredi soir son départ du Quai d’Angers, le Centre Dramatique National (CDN) où il avait été nommé directeur en janvier 2020 : Au lendemain matin de cette annonce, la Ville d’Angers salue l’artiste dans un communiqué intitulé : « Merci pour l’émotion, merci pour l’ambition… et bonne chance pour la suite Thomas Jolly ». Voici l’intégralité du texte : « Contrarié par la crise sanitaire, qui a durement touché les structures culturelles, le projet de Thomas Jolly pour le Quai-CDN a su demeurer ambitieux et s’est adapté continuellement. Dès l’été 2020, une programmation inédite, intitulée « Quai l’été », a permis au public et aux professionnels du spectacle de se retrouver après des mois sans culture vivante. Au cours de ces trois années, le public aura pu vibrer et rêver dans un lieu mis en mouvement. » LIRE AUSSI | Thomas Jolly contraint de démissionner de la direction du théâtre Le Quai « Thomas Jolly a dirigé l’équipe du CDN dans un lieu souvent fermé, accueillant les artistes quand il l’a pu, mais jamais cet enfant du théâtre public n’a renoncé à son ambition d’une « Maison commune », d’un théâtre ouvert aux spectacles et aux rencontres, bouillonnant de création et d’audace pour permettre à chacun de s’émouvoir et de se questionner grâce au théâtre. » Un théâtre populaire, exigeant et festif « À Angers, avec l’équipe du Quai, il a accompagné, par une étroite collaboration avec les partenaires locaux, la mise en place du Cycle d’orientation professionnelle et de la Classe préparatoire aux études supérieures visant à la professionnalisation des élèves en théâtre du Conservatoire à rayonnement régional ; dans le domaine de l’écriture et avec la participation du public, il a créé le DESC (Département des Écritures pour la Scène Contemporaine) ; il a favorisé le lien avec le public par l’aménagement chaleureux d’un forum mis « en scène » à qui il a donné toute sa place de lieu de rencontre convivial et d’échange ; il a permis au public et aux professionnels de se retrouver avec le Go Festival. » « Avec son projet d’un théâtre populaire, exigeant et festif, il a tenu à relever le défi de donner l’envie à tous de « vouloir aller au théâtre ». Pari réussi avec ses dernières créations : « La nuit de Madame Lucienne », « Le Dragon » et surtout cet incroyable marathon théâtral proposé en juin 2022 : la tétralogie « H6R3 » de Shakespeare (Henry VI & Richard III), trésor du théâtre universel en lien avec l’histoire d’Angers, qui a été jouée en une seule fois et durant 24 heures. « Si le monde est un théâtre, comme le dit Shakespeare, la ville d’Angers est fière d’avoir été la scène des créations et actions de Thomas Jolly, notamment de cette épopée shakespearienne pionnière et inédite, liant patrimoine et création. Les spectateurs chanceux qui l’ont vécu resteront marqués par cette expérience théâtrale intense », évoque Nicolas Dufetel, Président de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Le Quai-CDN et Adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d’Angers. « Aujourd’hui, la ville d’Angers est partagée entre l’émotion ressentie au départ de l’une de ses étoiles et la fierté que celle-ci ait brillé en Anjou et brille bien au-delà désormais », souligne Jean-Marc Verchère, maire d’Angers.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2022 12:54 PM
|
Par Fabienne Darge (Reims (Marne), envoyée spéciale) dans Le Monde - 8 novembre 2022 Chloé Dabert met brillamment en scène la pièce de Lucy Kirkwood sur la confrontation entre un jury de mères de famille et une jeune fille accusée de crime. A voir au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis dès le 9 novembre.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/08/theatre-le-firmament-le-huis-clos-haletant-de-douze-femmes-en-colere_6149048_3246.html Quoi de neuf sous le ciel étoilé du théâtre ? Lucy Kirkwood, une autrice britannique de 38 ans, que l’on découvre en cet automne avec deux pièces : Les Enfants, mis en scène par Eric Vigner, au Théâtre de l’Atelier, à Paris, et Le Firmament, mis en scène par Chloé Dabert, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), spectacle qui a déjà fait un tabac quand il a été joué au Centquatre, à Paris, et à la Comédie de Reims (Marne). Et il y a de quoi. Sous ce firmament brille une impressionnante constellation de talents féminins, qui offrent l’une des soirées les plus intenses et captivantes qui puissent se vivre au théâtre, ces temps-ci. La scène se passe dans l’est de l’Angleterre, en 1759. Alors que l’on annonce le passage imminent de la comète de Halley, une petite fille est sauvagement assassinée, coupée en morceaux. Elle appartenait à la famille la plus riche de la ville, les Wax. Les deux coupables sont vite retrouvés, jugés en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Le premier, un homme qui semble être tombé du ciel pour semer le chaos dans la petite ville, est pendu de manière tout aussi expéditive. Sa complice, la jeune Sally Poppy, est une fille du coin. Elle aurait été lynchée et pendue avec la même ardeur, si elle n’avait « plaidé le ventre », comme on disait alors. Autrement dit, elle prétend être enceinte – et, si elle l’est, elle échappe à la peine de mort, pour être déportée dans une lointaine colonie. Mais, à ce stade, son état ne se voit pas. Le juge local décide alors de réunir un « jury de mères de famille », au nombre de onze, qui vont devoir examiner si Sally attend ou non un enfant. Non-dits d’une société L’action de la pièce tient tout entier dans la confrontation de ces femmes, en un huis clos haletant, qui fait ressortir l’organisation sociale du temps, ses inégalités de classe et la manière dont la condition féminine est au cœur du système patriarcal. Les onze héroïnes – douze, avec l’accusée – sont d’âge et de conditions sociales diverses, ont eu vingt enfants ou ont accumulé les fausses couches et n’auraient jamais eu l’occasion de se rencontrer hors ce cadre si particulier. Le cas de la jeune Sally va servir de révélateur à toutes les frustrations, faire sortir les non-dits d’une société où les filles, surtout si elles sont en position de domestiques, se font violer plus souvent qu’à leur tour. Lucy Kirkwood écrit avec un sens de la fable et une efficacité qui montrent qu’elle a aussi bien retenu les leçons de Brecht que celles des scénaristes de séries d’aujourd’hui Lucy Kirkwood fait de ces femmes des personnages inoubliables, chacune dans sa singularité, à commencer par celle qui est à la tête du groupe : Elizabeth, la sage-femme de la ville, jeune veuve vivant une vie relativement libre pour l’époque et dont l’avis est évidemment décisif. L’autrice britannique écrit avec un sens de la fable et une efficacité qui montrent qu’elle a aussi bien retenu les leçons de Brecht que celles des scénaristes de séries d’aujourd’hui : les dialogues claquent, sans aucun temps mort. Sa pièce n’est jamais didactique, toujours extraordinairement vivante et incarnée, et ménage une série de rebondissements jusqu’au dénouement, que l’on ne révélera évidemment pas, en forme de coup de poing à l’estomac. Cette superbe partition a inspiré à Chloé Dabert une mise en scène tout en maestria, qui superpose différents plans avec une aisance confondante : le passé et le présent, l’ici et maintenant du théâtre et le hors-champ offert par le cinéma, le trivial et le sacré – l’un et l’autre n’étant pas toujours où on les attend. Le décor que signe Pierre Nouvel est ainsi une épure moderniste, mais les femmes qui viennent s’y inscrire comme en un tableau issu de la peinture flamande, sont en costumes d’époque. Des costumes signés par Marie La Rocca, et qui sont parmi les plus beaux et inventifs que l’on ait vus au théâtre ces dernières années. Sacrée pléiade d’actrices Le dialogue entre théâtre et cinéma est particulièrement fécond. Les images tournées par Pierre Nouvel, qui ont un grain particulier, un flou et une douceur, prennent en charge à la fois le plus concret de l’infini labeur des femmes et la dimension la plus mystérieuse de la pièce : l’opacité du meurtre et du rapport au monde de Sally Poppy, l’insondable d’instincts ou de pulsions qui semblent guidés par des forces supérieures. C’est comme si le réalisateur floutait le réel pour lui redonner une forme de noblesse et pour rendre compte de l’irréalité dans laquelle a baigné Sally au moment du meurtre. Une irréalité à laquelle, peut-être, aspirent toutes ces femmes, face à leur quotidien de bêtes de somme. Elles sont, ces douze femmes – plus ou moins – en colère, incarnées par une sacrée pléiade d’actrices, où l’on est heureux de retrouver, notamment, Océane Mozas et Marie-Armelle Deguy. Bénédicte Cerutti, dans le rôle d’Elizabeth, fait vibrer le désir de justice de cette femme avec une noblesse et un lyrisme magnifiques. Quant à Sally Poppy, elle a la chance d’avoir croisé la route de la jeune comédienne et chanteuse franco-libanaise Andréa El Azan, qui lui insuffle une rage et un esprit de rébellion proprement révolutionnaires. C’est l’un des aspects les plus intéressants de la pièce de Kirkwood que de n’avoir fait de son héroïne principale, meurtrière ou supposée telle, ni un monstre ni une simple victime. Affreuse, sale et méchante, Sally Poppy l’est, indubitablement. Reste à savoir pourquoi, au fil du suspense qu’entretient le spectacle. Dans ce choix réside une bonne part de la réflexion de fond de cette grande pièce politique et cosmique, placée sous le sceau d’une comète invisible, en révolution permanente au sein de l’Univers. Le Firmament, de Lucy Kirkwood (traduit de l’anglais par Louise Bartlett, L’Arche Editeur). Mise en scène de Chloé Dabert. Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jusqu’au 19 novembre. Du lundi au vendredi à 19 h 30, le samedi à 17 heures, le dimanche à 15 heures. De 6 € à 23 €. Tgp.theatregerardphilipe.com Fabienne Darge (Reims (Marne), envoyée spéciale) Légende photo : « Le Firmament », de Lucy Kirkwood, mis en scène par Chloé Dabert, au Centquatre, à Paris, le 27 septembre 2022. VICTOR TONELLI

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2022 8:53 AM
|
Par Yann Bouchez dans Le Monde - 8 nov. 2022 L’opéra rock composé par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon revient à La Seine musicale à partir du 8 novembre jusque fin janvier 2023. Le quotidien l’évoque pour la première fois dès le 6 novembre 1978
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/11/08/starmania-dans-le-monde-du-double-album-au-monument-de-la-musique-francaise_6149028_4500055.html
Les années passent mais le loubard Johnny Rockfort, chef de la bande des Etoiles noires, Zéro Janvier, richissime homme d’affaires devenu président, Ziggy, disquaire homosexuel, ou Stella Spotlight, sex-symbol sur le déclin, ne prennent pas une ride. Nés en 1978, les personnages de la comédie musicale Starmania, dont les tubes sont devenus autant d’incontournables de la culture populaire, renaissent une fois encore. L’opéra-rock est recréé, jusqu’à fin janvier, à La Seine musicale de Boulogne-Billancourt, avant une tournée en France, en Belgique et en Suisse. Le Monde mentionne pour la première fois Starmania le 6 novembre 1978, « un double album imaginé en forme de comédie musicale » composé par Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Les airs et paroles de Quand on arrive en ville, Le Blues du businessman, Le monde est stone, ou SOS d’un terrien en détresse sont alors encore inconnus des Français, mais le journaliste Claude Fléouter semble déjà sous le charme de « la musique sophistiquée, pleine de vibrations et de nonchalance de Michel Berger [qui] donne à Starmania comme une sorte de magie ». L’album, à ses oreilles, « démontre que, même en France aujourd’hui, la musique de variétés peut être tout autre chose qu’un produit aseptisé et banalement traditionnel ». Séduit par le spectacle La comédie musicale est jouée à Paris au printemps 1979, pour quatre semaines de représentations. Parmi la quarantaine d’interprètes, peu d’artistes renommés, hormis Diane Dufresne, France Gall ou Daniel Balavoine. Le Monde, dans un compte rendu du 13 avril 1979 toujours signé Claude Fléouter, semble d’abord prendre ses distances avec un spectacle qui « n’est ni une comédie musicale ni un opéra-rock, mais une vague histoire chantée, une fragile bande dessinée sur la ville de demain qui est déjà celle d’aujourd’hui, sur l’argent, la violence, la déshumanisation des métropoles, le besoin d’espace et de soleil ». Quelques lignes plus loin, le journaliste apparaît pourtant séduit par le spectacle : « Starmania bouge et swingue dans un décor qui utilise habilement – et totalement – l’immense plateau du Palais des congrès (…). La mise en images épouse la sensibilité et la spontanéité, la simplicité et la subtilité, la rigueur et le lyrisme des chansons et le monde fragile qu’elles expriment. » Starmania est « rentrée dans la tête du public » avant même d’apparaître sur scène ; voilà plusieurs semaines que les radios, surtout Europe 1, qui coproduit la comédie musicale, passent en boucle les morceaux du double album. Une vaste campagne d’affichage est menée. L’opéra-rock franco-québécois s’invite même, à son insu, dans des lieux inattendus. Ainsi apprend-on dans Le Monde du 14 mai 1979 qu’il fut question de Starmania au… 23e congrès du Parti communiste français, auquel assiste le journaliste Patrick Jarreau. Entre divers sujets, allant de l’union de la gauche à l’alliance entre classe ouvrière et intellectuels, l’un des orateurs, Jean-Michel Catala, figure du PCF, « évoque la “désespérance” d’une partie des jeunes », plombés selon lui par la petite délinquance, la prostitution juvénile dans certains quartiers et la violence. « Cette attitude de repli sur soi et de résignation à une vie médiocre, il l’illustre par l’opéra Starmania, relève Patrick Jarreau. Cette œuvre, selon lui, fait chanter qu’il n’y a plus d’espoir sur la terre et assure la confusion entre fascisme et forces de progrès. » « La force des chansons l’a emporté sur la faiblesse du scénario. » La journaliste Véronique Mortaigne en 2009 Loin de ces joutes politiques, les tubes de Berger et Plamondon continuent de s’installer sur les ondes, pourtant enclines à diffuser crescendo des tubes anglo-saxons. Pour un nouveau spectacle sur scène, en revanche, il faut attendre près de dix ans. En 1988, Starmania est devenu un monument de la musique populaire française. Même Bernard Tapie, lors d’une émission de TF1, a interprété Le Blues du businessman. Une décennie après sa naissance, l’opéra-rock permet à une nouvelle troupe, où figurent Maurane, Richard Groulx ou Wenta, d’éclore. Et Claude Fléouter (par ailleurs créateur des Victoires de la musique, en 1985) apprécie encore ce spectacle qui « n’accuse aucune ride : mélodies nerveuses, texte simple, aux résonances actuelles ». La comédie musicale s’exporte en étant adaptée en anglais sous le nom de Tycoon. En 1992, la chanteuse américaine Cyndi Lauper sort The World is Stone. Succès mondial. Plus les années passent, plus Starmania semble intemporel, malgré la mort de certaines figures emblématiques – Daniel Balavoine (1986), Michel Berger (1992). Trente ans après sa naissance, l’album original a été vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires. Le 24 avril 2009, alors que France 2 consacre une nouvelle émission à l’opéra-rock, animée par France Gall, la journaliste Véronique Mortaigne signe dans Le Monde une pleine page mi-sérieuse, mi-amusée sur les qualités visionnaires du show. Si « Starmania a longtemps eu mauvaise réputation » – « “mièvre”, “ridicule”, jugeaient ses détracteurs » –, la journaliste estime que « la force des chansons l’a emporté sur la faiblesse du scénario ». « Aujourd’hui, poursuit-elle, des exégètes se penchent sur Starmania en en soulignant les aspects prémonitoires. France Gall ne manque pas d’arguments : les black blocs qui ont manifesté lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg, les 3 et 4 avril ? Des jumeaux des étoiles noires de Starmania, qui sèment la peur sur Monopolis, capitale de l’Occident, bien sûr. La tour où habite Zéro Janvier, symbole du capitalisme arrogant ? Les tours jumelles du 11-Septembre, évidemment. Et que dire de l’idée qu’un président de la République puisse épouser un sex-symbol ? » Véronique Mortaigne n’a pas besoin de préciser que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se sont mariés quelques mois auparavant, le clin d’œil est évident. Starmania, Nostradamus des comédies musicales ? France Gall résume : « Ce qu’il y a de formidable, c’est que tout le monde s’identifie. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés L’étoile noire de « Starmania » scintille toujours, quarante-trois ans après sa création La chanteuse, compagne de Michel Berger, meurt le 7 janvier 2018, juste avant la diffusion d’un documentaire de Thomas Snégaroff et Olivier Amiot, intitulé Starmania, l’opéra-rock qui défie le temps. Christine Rousseau, qui chronique le film, rappelle à cette occasion que lancer une comédie musicale en France il y a quarante ans n’avait rien d’une évidence. L’aventure « semble à l’époque un peu folle ». On l’a un peu oublié, mais le succès s’est d’ailleurs construit dans la difficulté. « En décembre 1978, écrit la journaliste, alors que l’album est en passe de devenir le bide de l’année, les deux compères [Michel Berger et Luc Plamandon] se voient confier une émission spéciale où, dans un ultime baroud d’honneur, ils présentent avec les futurs interprètes de la comédie tout ou partie des chansons. Le déclic s’opère avec Les Uns contre les autres, qui devient le premier tube de Starmania. » Un texte que Luc Plamondon avait jeté au fond d’une corbeille à papier, raconte le documentaire, avant que Michel Berger ne mette la main dessus. Archive vidéo de la version de 1978 Archive vidéo de la reprise en 1988 Yann Bouchez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 6, 2022 11:19 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 6 novembre 2022 Pour sa première venue à Paris, la jeune artiste japonaise Yuri Yamada nous offre une plongée acide dans l’univers des femmes et des hommes, aujourd’hui.
Le Japon nous séduit. L’Empire des signes que célébrait Roland Barthes, nous tient sous son emprise intellectuelle et affective, par sa culture ancienne, ses paysages, ses finesses rituelles, ses mystères. On dirait, un peu naïvement, que le Japon éternel nous séduit. Nous sommes réceptifs à ses expressions, du Kabuki aux robots anthropomorphes que l’on a d’ailleurs applaudi sur les scènes… On aime ses réalisateurs, ses romanciers, ses poètes, ses comédiens, ses metteurs en scène. On a la chance, en tout cas en France, d’avoir accès à un Japon créateur, vivant. Un Japon d’aujourd’hui. A la Maison de la Culture du Japon à Paris, merveilleux bâtiment situé non loin de la Tour Eiffel, on se rend toujours avec un profond plaisir, certain d’être complètement dépaysé et de découvrir des artistes qui nous touchent. De la danse, beaucoup, de la musique et du théâtre. En ce moment, dans le cadre du Festival d’Automne, on peut savourer un spectacle dont le titre, ironique et tendre à la fois, est tout un programme : Et pourtant, j’aimerais bien te comprendre… Dans la merveilleuse salle de spectacle, aussi harmonieuse que confortable –et transformable évidemment- on est dans une relation de proximité. On découvre un décor un peu triste à nos yeux : des voilages entourent l’espace d’une salle à manger d’aujourd’hui. Très simple et sans originalité. Une grande table rectangulaire juponnée d’une nappe à plis, un éclairage à dessein sans subtilité, voilà pour l’essentiel. Un lampadaire, une petite lampe sur pieds, des chaises évidemment, un coin avec un coussin par terre, pour s’y lover. On ne vous racontera pas ici le détail de l’intrigue car le bonheur de cette représentation vive, enjouée, mais sérieuse sinon grave, en même temps, est de découvrir ce qui se passe dans la vie de ce jeune couple sympathique. Lui, un peu indolent, elle, hyper active. Deux bonnes, fausses jumelles aux comportements réglés au cordeau, coiffures avec une sorte de tresse qui monte verticalement, intrusives et inquiétantes, plus une amie qui elle aussi arbore une étrange coiffure, à cornes de cheveux… Il est question de la responsabilité des hommes et des femmes dans une société d’une férocité sans état d’âme. Les femmes sont des êtres inférieurs pour de nombreux Japonais. Leur destin est de se marier, d’avoir des enfants. Triste réalité qui conduisent de plus en plus de jeunes filles à fuir mariage et enfantement. C’est très bien joué par cinq jeunes interprètes charmants et très précis dans leur interprétation. Un homme, quatre femmes. Elégants, légers et aigus, ils donnent au propos de la jeune auteure/metteure en scène qui les dirige avec une fermeté et une précision lumineuses, une force spirituelle qui nimbe un propos critique, politique. De quoi se divertir, réfléchir. Un délicieux moment d’intelligence et de talent. Maison de la Culture du Japon, jusqu’au 9 novembre. Durée : 1h15. En japonais avec d’excellents et très lisibles surtitres. Mardi 8, rencontre avec l’auteur/metteuse en scène Yuri Yamada, à l’issue de la représentation. Dans le cadre du Festival d’Automne. Photo : © Kengo Kawatsura

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2022 7:45 PM
|
Par Alice Raybaud dans Le Monde - 4 novembre 2022
« La Relève ». Chaque mois, « Le Monde Campus » rencontre un jeune qui bouscule les normes. A 30 ans, la comédienne Séphora Pondi vient d’intégrer la Comédie-Française, où elle est à l’affiche du « Roi Lear » et jouera en fin de saison le rôle-titre de « Médée ».
Lire l'article dans Le Monde : https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/11/04/sephora-pondi-puissante-et-jeune-tempete-a-la-comedie-francaise_6148446_4401467.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
Qui l’a déjà vue jouer la reconnaîtra en une seconde. Séphora Pondi nous accueille avec l’allégresse et la vitalité qui la caractérisent sur scène. Il faut dire que la comédienne – et elle ne s’en cache pas – n’est pas totalement redescendue de son émerveillement. A 30 ans, elle vient d’entrer à la Comédie-Française comme nouvelle pensionnaire. Elle y reçoit dans sa loge à l’allure de studette. Près de 13 mètres carrés rien que pour elle, où de grandes fenêtres donnent sur l’effervescence du quartier. « Si on m’avait dit que, dans ma vie d’intermittente du spectacle, je travaillerai dans de telles conditions et serai un jour choyée comme ça… ! », s’étonne encore Séphora Pondi.
Au sein de l’institution, intégrée fin 2021, la jeune femme goûte quotidiennement le répertoire classique par lequel elle est venue au théâtre. Elle qui est pourtant issue, comme elle le dit, d’un milieu « éloigné de la culture majoritaire », celui d’une classe moyenne paupérisée. D’une énergie saisissante sur scène, Séphora Pondi s’est d’abord révélée dans des rôles de femmes insoumises. Remarquable – et remarquée – dans Désobéir, qu’elle joue à peine sortie d’école, en 2017, sous la direction de Julie Berès, puis dans Au Bois, un chaperon rouge moderne au Théâtre national de la Colline, à Paris. Rien d’étonnant, alors, à ce qu’elle endosse aujourd’hui le rôle de Kent dans le Roi Lear, de Shakespeare, pièce-phare de la rentrée à la Comédie-Française, mise en scène par Thomas Ostermeier. Plus proche fidèle du souverain – joué par Denis Podalydès –, le personnage est chassé du royaume « pour avoir osé dire la vérité devant le pouvoir », commente Séphora Pondi, assise sur le canapé de sa loge. Tout près d’elle, le texte de Médée, dont elle commence les séances de lectures avec l’équipe. La comédienne tiendra, en fin de saison, le rôle-titre de l’impitoyable magicienne dans cette tragédie d’Euripide. « Soif d’expression » Longtemps, la jeune femme a cherché à conquérir un espace pour déployer sa voix. Séphora Pondi grandit dans « toutes les banlieues populaires de Paris, ou presque », raconte-t-elle, avec ses parents, immigrés camerounais, professeurs de gestion et comptabilité en lycée professionnel. Dans sa famille, on ne va pas au théâtre. « Mais mon père était quelqu’un qui avait le goût du spectacle. Il était très charismatique, extraverti. Ma mère, elle, se montrait très coquette, toujours avec une certaine mélancolie. Toute mon enfance, j’ai eu l’impression de vivre des tragédies de châtelains, alors que j’habitais en HLM », s’amuse-t-elle. Volontiers théâtrale, la figure paternelle est, à la maison, plutôt autoritaire, parfois menaçante.
En elle, une « rage » enfle. « J’ai grandi dans un environnement social et une culture patriarcale qui ne m’a pas autorisée à prendre la parole, à dire ce que j’avais envie de raconter. Je me sentais retranchée dans le silence, que ce soit à l’école ou chez moi. Et pendant des années, j’ai eu soif d’expression », confie la comédienne. Enfant, faute de mieux, elle écoute, observe, décrypte. Et sent « confusément » que beaucoup se joue dans la maîtrise de la langue, que détiennent certains adultes référents : « J’avais l’intuition que mon origine pourrait venir me limiter plus tard, et qu’il me fallait cette maîtrise-là. » Séphora Pondi écume alors les bibliothèques municipales. Dans son lycée, elle décide aussi de s’inscrire à l’atelier théâtre que vient de monter une surveillante de l’établissement, proposant de travailler des textes classiques. C’est là qu’elle se rend compte qu’elle ne se voit pas faire autre chose. D’abord, avec « beaucoup d’effroi ». « C’était prendre un grand risque : me lancer dans une profession incertaine, sans bagage, et en n’ayant pas tellement de modèles qui me ressemblaient dans cet univers », souligne la jeune femme noire. Rencontrer des pairs A cette période, quelques portes s’entrouvrent pour accueillir des profils comme le sien – encore faut-il savoir s’y engouffrer. Le programme « 1er Acte » en fait partie. Porté en 2014 par Stanislas Nordey à La Colline, il forme de jeunes talents issus de la diversité pour favoriser l’émergence de nouveaux visages sur les plateaux ; en sont sortis Lyna Khoudri ou Dali Benssalah. Alors dans une petite école départementale publique de théâtre, c’est grâce à son ancienne surveillante de lycée que Séphora Pondi en entend parler.
Convaincante lors de l’audition – où elle interprète un poème de Maïakovski, conçu comme un « cri » de colère par son auteur –, elle intègre ce programme d’ateliers de travail avec des artistes installés : « J’avais eu jusque-là un chemin assez solitaire. Me retrouver avec un tout nouvel entourage, ces profils de jeunes comédiens que je ne voyais nulle part auparavant, m’a beaucoup soulagée. Je découvrais aussi une forme d’ambition de travail, avec des professionnels qui, constamment, questionnent leur pratique : je trouvais cela très beau. » Parmi eux, Denis Podalydès, son parrain dans le programme, qu’elle retrouve aujourd’hui sur scène, comme un clin d’œil dans ce parcours express. Durant cette phase de formation, elle fraude dans les TGV pour pouvoir faire les allers-retours entre Paris et Cannes, où elle a été admise en parallèle à l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes. Là-bas, elle comprend que son corps, éloigné des standards de beauté, lui permet de dégager une certaine puissance. C’est ce théâtre très corporel que Séphora Pondi continue à explorer, après l’école, avec la metteuse en scène Julie Berès dans Désobéir. Cette dernière cherchait un quatuor de comédiennes de seconde ou troisième génération de l’immigration, pour monter une pièce d’actualité au théâtre de la Commune, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), autour de jeunes femmes dressées contre des assignations sociales ou familiales.
Entre la comédienne et la metteuse en scène se joue un coup de foudre mutuel. « Dans la lettre qu’elle m’a écrite pour candidater et sa manière de me parler de son histoire familiale, de sa découverte de la littérature ou du fait d’être noire, j’ai tout de suite vu non seulement une plume intelligente, sensible et lucide, mais une personnalité intense », explique Julie Berès, qui parle d’une « rencontre fondamentale » dans sa carrière – la pièce s’est d’ailleurs jouée plus de cinq ans, avec des programmations dans toute la France. Séphora Pondi y expérimente un « rapport nerveux et volubile à la langue ». Sur scène, elle se métamorphose, tantôt jeune fille de banlieue stigmatisée, tantôt incarnation d’une figure paternelle violente. « Au cinéma, une logique des canons très forte » Lors d’une des représentations, elle est repérée par l’administrateur général de la Comédie-Française, Eric Ruf. Et deux ans plus tard, il lui propose une place dans la prestigieuse institution. Quand elle reçoit son appel, à l’été 2021, Séphora Pondi arrive au bout d’un cycle : « Au cinéma, où je tentais ma chance, j’étais fatiguée de me voir toujours proposer les mêmes rôles, d’infirmières notamment. Comme si, avec mon corps rond et noir, donc maternant ou forcément projeté dans des professions considérées comme subalternes, c’était les seuls personnages que je pouvais faire. Au cinéma, la logique des canons reste très forte. » Elle raconte ne pas s’être heurtée à de si vives résistances au théâtre, reconnaissante envers les femmes noires qui l’ont précédée : « Elles ont essuyé les plâtres pour que notre génération puisse se faire une place. » Constatant même que des visages différents peuvent générer désormais une certaine « attraction ». Fondée en 1680, la Comédie-Française commence timidement à s’ouvrir à des profils comme le sien. Mais face au répertoire classique, Séphora Pondi sent qu’on lui donne « pleinement [s]a chance ». « Ce n’est peut-être pas le visage qu’on imaginait de moi, pourtant c’est ma culture aussi : les classiques sont mes premières amours, alors pour moi, là, la boucle est bouclée », s’enthousiasme-t-elle. Médée, en particulier, est une des premières pièces qui l’ait marquée. « C’était déroutant de voir Lisaboa Houbrechts [la metteuse en scène] me proposer de jouer Médée : un rôle qui me travaille depuis l’adolescence. Dans la démesure du texte tragique, il y a quelque chose qui, avec mon environnement parental, m’est familier. » A travers la figure de la magicienne, elle retrouve aussi sa fascination pour l’univers des sorcières. Ces « femmes rebelles en prise avec des forces troubles », que Séphora Pondi a suivies en séries. Définitivement plus Buffy contre les vampires que cheerleader. Alice Raybaud Légende photo : Sephora Pondi, le 19 avril 2022. STÉPHANE LAVOUÉ, COMÉDIE-FRANÇAISE.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2022 9:02 AM
|
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog 1er nov. 2022 The Silence, texte et mise en scène de Falk Richter, traduction d’Anne Monfort
«Dans notre famille, on n’a jamais parlé de…» C’est l’histoire répétée de la famille petite-bourgeoise européenne, peut-être aujourd’hui encore, dans une société où les mœurs et la parole se seraient libérés. Si ce n’était le coup de fouet en retour qu’on observe un peu partout pour maintenir bien solides les non-dits des pouvoirs.
«Se taire, dit Falk Richter, profite souvent au maintien des structures de pouvoir injustes et corrompues». Les violences intrafamiliales, comme on dit pudiquement, des coups, de l’enfant terrorisé enfermé dans le noir absolu ou jeté contre un mur, se passent dans le silence. Le père frappe, la mère, la sœur, témoins muets (témoins n’a pas de forme au féminin?) voient tout et ne disent rien. Et ça continue à l’extérieur, plus tard.
Des voyous pas très au clair avec leur propre sexualité tabassent un “pédé“ devant un restaurant : silence. Personnel et clients attendent que la “bagarre“ se termine et négligent d’appeler la police. L’auteur le rappelle : dans le monde du patriarcat, le « droit à l’intégrité physique n’est pas garanti » ni aux femmes, ni aux homosexuels, ou à ceux qui ne sont pas “hétéro-normés“. Les deux premiers tiers de The Silence sont une magnifique spirale qui revient à chaque tour sur les différents silences qui ont construit la jeunesse du narrateur, du châtiment violent, à l’émerveillement de The Silence, celui de la rencontre amoureuse entre deux garçons. Cette « spirale de la violence » continue de générations en génération, le père détruit par la guerre, parce qu’il a tué lui-même, parce qu’il a vu les corps de ses camarades voler en éclats ; la mère détruite, parce qu’on ne lui a jamais appris à être femme, à faire l’amour, à aimer autrement que soumise à un homme et dans l’oubli d’elle-même. Et la violence sociale, étroitement imbriquée dans la violence familiale : Falk Richter se réfère à des auteurs comme Didier Éribon, Edouard Louis, Virginie Despentes qui travaillent sur cette plaie. Ni plainte ni colère, en apparence, le dramaturge donne une ample respiration à ce qui n’est plus le souvenir brut et pas encore une fiction. Il a voulu «écrire sur un mode autobiographique sans rien poétiser, avec le plus de précision et d’honnêteté possible » et « préfère au vrai Falk Richter le personnage fictionnel de Falk que va jouer Stanislas Nordey ». Comédien parfait pour ce texte, il s’en empare avec l’appétit et l’humour qu’il faut, par exemple pour les scènes au téléphone -justement plutôt “téléphonées“- et qui marchent d’autant mieux. L’acteur a une longue amitié avec Falk Richter et a partagé le travail avec lui pour Je suis Fassbinder, (2016). Cela lui donne ici toute liberté d’apporter sa part, généreuse, à l’invention en direct de la fiction. À lui, sur scène, de faire craquer les silences. Y compris cette arme familiale et sociale qui consiste à faire un fantôme, d’une personne comme si elle n’existait pas. Il faut mettre au silence ce fils dangereux qui ose écrire et peut donc trahir, révéler des secrets, dont celui de sa propre homosexualité, et briser le silence de l’ordre établi. À la veille de créer son spectacle, Falk Richter a enregistré sa mère, l’a questionnée sur sa vie à elle, sur son enfance à lui. Nous entendons le poids des non-dits, en un dialogue affectueux frisant parfois le déni : non, ce n’était pas ça du tout, non, je ne me souviens plus. Ce ne sont pas des mensonges mais une couverture: elle et son mari sont persuadés d’avoir exercé cette violence sur l’enfant «pour son bien ». L’auteur a recadré avec intelligence le document vécu dans la fiction pour en faire une source, et non un témoignage dans l’impossible procès de la famille. Dans la dernière partie,, l’écriture perd de sa fermeté. Les personnages introduits, comme l’agent artistique, le compagnon du Richter-Nordey de fiction apportent un cadre social un peu satirique ; cela a son intérêt mais affaiblit la structure de la pièce. Mais le spectacle lui-même ne perd rien d’un aspect essentiel : sa qualité d’enfance. Le décor lui-même a quelque chose d’enfantin. La maison des parents est comme un jeu de cubes, avec un mur qui parle – où la vidéo de l’entretien avec la mère sont projetées -, un jardin en laine défrisée où le héros (ni l’auteur ni le comédien, ou les deux) vient planter sa tente d’enfant. Dans un coin, le bureau de l’auteur, tel qu’on le représente dans les bandes dessinées classiques : piles de papier, corbeille débordant de brouillons froissés, piles de livres écroulées… Nous entendons aussi après la mort d’un père qui jusqu’à bout n’a pas parlé, n’a jamais fait craquer la carapace, la libération des fantasmes meurtriers de l’enfant.
« L’écriture théâtrale est un espace qui me permet de comprendre ma famille mais aussi d’échapper… ». Elle donne la possibilité de «désapprendre» et défaire la maison où on a été formaté. C.Q.F.D; : la maison est un jeu de cubes et l’enfance sauve l’enfance.
C’est sans doute ce qui importe à Falk Richter : l’inquiétude pour l’avenir, pour une nature fragile et sensible, dont les humains font partie, dite avec la vitalité, la fraternité de Stanislas Nordey. Et on sort dans un état de bonheur paradoxal, si l’on pense à la dureté du sujet. ..
Christine Friedel Jusqu’au 6 novembre, MC93 à Bobigny (Seine-Saint-Denis) . T.01 41 60 72 72 Spectacle créé au Théâtre National de Strasbourg le premier octobre. Le numéro 5 de la revue Parages, éditée par le T.N.S., est consacré à Falk Richter. Légende photo : Stanislas Nordey dans « The silence » de et par Falk Richter au TNS, à Strasbourg, le 30 septembre 2022. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2022 12:13 PM
|
Par Flore Caron sur le site de France Musique - 31 octobre 2022 Un activiste du collectif écologiste « Dernière rénovation » est monté sur scène à l’Opéra Bastille vendredi 28 octobre aux alentours de 21h30 pour « faire pression sur le gouvernement » face à la crise écologique. Mise en scène impromptue à Bastille. Un militant écologiste du collectif « Dernière rénovation » a interrompu le deuxième acte de La Flûte enchantée vendredi 28 octobre pendant une dizaine de minutes. Paré d’un t-shirt blanc arborant la phrase « We have 879 days left » (il nous reste 879 jours), Victor est monté sur scène aux alentours de 21h30 et s’est attaché par le cou à une échelle du décor avec un antivol de vélo. Le militant a seulement eu le temps de crier « Je ne suis pas là par plaisir » avant que le rideau ne tombe. Une action visant à alerter le public sur l’urgence climatique, qui a déclenché des huées dans la salle. « Derrière les rideaux, j’ai essayé de continuer à parler. Je n’étais pas venu là pour perturber, j’avais envie d’expliquer pourquoi j‘étais là, parler avec mon cœur », nous a expliqué Victor, tout juste sorti de 20 heures de garde à vue. « Évidemment, ça me brise le cœur d’en arriver là. Personne n’entre en résistance civile par plaisir. J’aurais préféré continuer à regarder La Flute enchantée comme le reste des spectateurs, mais il faut faire comprendre au public que cette beauté n’existera pas dans un monde où les gens se battent pour leur survie », a poursuivi le militant, qui se dit personnellement « très sensible » à la musique. « Notre but premier était d’interpeller, au-delà du public présent ce soir-là. Sur ce point, nous sommes satisfaits car nous avons eu beaucoup de sollicitations médiatiques et nous allons pouvoir parler de cette action. » Contacté, l’Opéra n’a pas donné suite à nos requêtes. « Un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments » Le même jour, d’autres membres du mouvement écologiste « Dernière rénovation » avaient bloqué l'autoroute A6 près d'Arcueil, au sud de Paris, provoquant de gros embouteillages. Le but de ces actions est de « faire voter une loi ambitieuse de rénovation énergétique des bâtiments à horizon 2040 avec une prise en charge pour les foyers les plus modestes. À ce jour, les propositions de loi qui vont dans ce sens sont consensuelles. Il y a un vrai manque de volonté politique », a martelé Victor. Cette action fait écho à d’autres actes similaires commis depuis quelques semaines en Europe. Aux Pays-Bas, des militants écologistes s’étaient collés jeudi 27 octobre avec de la colle forte sur la vitre protégeant la toile de La jeune fille à la perle de Vermeer au musée Mauritshuis de la Haye. Un peu plus tôt, le 24 octobre, des activistes de « Last Generation » avaient lancé de la purée sur Les Meules de Claude Monet après que des militants du mouvement Just Stop Oil avaient aspergé de soupe Les Tournesols de van Gogh à la National Gallery de Londres. Légende photo : Un militant écologiste du collectif Dernière Rénovation s'est invité sur la scène de l'Opéra Bastille vendredi 28 octobre - Collectif "Dernière rénovation"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2022 6:40 AM
|
Critique de Corinne Denailles dans Webthéâtre - 24 oct. 2022 - Assise nonchalamment sur son tabouret de bar, après une entrée toujours « lente et désinvolte », le visage maquillé de lourds traits noirs et de paillettes, moulée dans une robe fourreau noir dont la haute fente laisse voir une longue jambe gainée de noir, Catherine Hiégel interprète une vieille artiste de music-hall sur le retour, une gloire déchue. Elle raconte les tristes conditions qui lui sont maintenant réservées en tournée, avec ses deux acolytes, ses « boys », dans des théâtres parfois si petits qu’elle se voit coincée entre le fond de scène et le public. Bienheureuse de jouer dans un théâtre et non dans une pauvre salle des fêtes comme cela pouvait arriver. Son récit, qui transpire la mélancolie et la solitude, est celui du naufrage d’une artiste dont on ne saura jamais si elle a vécu ou rêvé une carrière brillante. Un vieux magnétophone Revox diffuse de temps à autre une chanson d’amour interprétée par Joséphine Baker. Un escalier de star, de hauts rideaux bleu nuit pailletés évoquent de belles heures passées. Les boys forment un duo burlesque et pathétique, un couple de vieux clowns gominés en frac, tristes et surannés, interprétés par Raoul Fernandez, le petit râblé, vif et espiègle, et Pascal Ternisien, grand échalas aux airs de serviteur aristocratique désabusé. La bonhomie de l’un et le pseudo dédain de l’autre ne masquent pas la précarité de leur existence.
Le texte de Lagarce est un hommage à cet art éphémère, à ces artistes obscurs, la passion chevillée au cœur, qui sillonnent la France des théâtres les plus miteux où les questions de sécurité incendie prévalent sur la représentation, où il faut encaisser toutes les humiliations. « Jouons quand même, faisons semblant d’exister » dit-elle à ses boys dans une salle vide de public. Faire semblant d’exister pour ne pas mourir, voilà le défi.
L’écriture de Lagarce, singulière et musicale, semble pourtant avancer par hoquets, avec ses retours en arrière, ses repentirs, ses répétitions à une variable près, la recherche de la précision parfaite dans les plus infimes détails, jusqu’aux silences. Ici, tous ces atermoiements ne parlent que de fragilité, de lutte pour vivre encore un peu.
Qu’elle interprète une conférencière sérieusement absurde dans Les règles du savoir-vivre ou une artiste de music-hall, Catherine Hiégel se glisse dans les mots de l’auteur qu’elle sert avec un grand art dans la remarquable mise en scène de Marcia Di Fonzo Bo.
Corinne Denailles / WebThéâtre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2022 11:03 AM
|
Par Clément Ghys et Sibylle Grandchamp pour M le magazine du Monde -28 octobre 2022 Le succès des spectacles de (La)Horde à la tête du Ballet national de Marseille raconte l’engouement actuel pour la danse, sortie des théâtres pour infiltrer le quotidien. Un nouveau public émerge et les pratiques s’épanouissent dans les rues comme sur TikTok.
Lire l'article (et voir le portfolio d'images) sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/portfolio/2022/10/28/sur-scene-en-plein-air-dans-les-bals-sur-tiktok-tous-happes-par-la-danse_6147749_4500055.html
« Cherche place ». Devant le Théâtre du Châtelet à Paris, ce mois de septembre, ils étaient très nombreux, chaque soir, pancartes à la main, à rêver d’assister au spectacle à l’affiche. Leur graal : Room With a View, la pièce du trio de chorégraphes (La)Horde mise en musique par le compositeur électronique Rone. En seulement onze dates, du 14 au 25 septembre, le spectacle créé en 2020 a attiré plus de 20 000 personnes. Un chiffre imposant – auquel il faut ajouter les entrées de la tournée –, mais qui ne dit pas la singularité de ce succès. « La chorégraphie rencontre la musique pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles, qui cherchent à se fédérer pour se donner un sens, dans des communautés de fête et de combat. »
(La)Horde Car ceux qui se pressaient à l’entrée du théâtre étaient de tous les âges, de toutes les allures, de tous les genres. Tous venus voir, dans un décor de bunker détruit, une quinzaine de jeunes gens, eux aussi de tous les styles (cagoulés, décolorés en blond, portant des dreadlocks, nus, en survêtement…), virevolter sur scène, sauter dans les airs, tomber au sol et sans cesse se relever, avec l’énergie des danseurs de raves. « La chorégraphie rencontre la musique, expliquent Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, les chorégraphes, pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles, qui cherchent à se fédérer pour se donner un sens, dans des communautés de fête et de combat. » Ils sont plus de 12 000 à avoir pris des places pour We Should Have Never Walked on the Moon, le nouveau spectacle de (La)Horde au Théâtre de Chaillot, en scène depuis le 27 octobre et jusqu’au 4 novembre. Au lieu d’être assis, les spectateurs déambulent entre des sculptures vivantes, des performances de cascadeurs, un DJ, et autres œuvres installées dans l’espace monumental où régnait autrefois en maître Jean Vilar. Mais c’est à la place de Roland Petit, figure tutélaire de la danse hexagonale à Marseille, que les trois chorégraphes sont aujourd’hui installés. Depuis septembre 2019, (La)Horde est à la tête du Ballet national de Marseille, troupe célèbre dans toute l’Europe, créée en 1972 par celui qui fut l’époux de Zizi Jeanmaire. Des trentenaires bien dans leur époque, qui citent la culture rave, la science-fiction et l’art contemporain, aiment la mode la plus louche, les matériaux comme le cuir ou le vinyle, ou les ensembles déstructurés… Et qui attirent un nouveau public dans les salles avec de la danse. Il y a quelques années encore, les spectateurs étaient encore très homogènes, constitués de connaisseurs et d’abonnés du théâtre public. La donne a changé. La danse n’a jamais connu un tel engouement. Voguing, waacking, danse extatique ou Gaga Dance Sorti en mars, le film En corps, de Cédric Klapisch – avec, dans le rôle principal, l’une des danseuses les plus en vue du Ballet de l’Opéra de Paris, Marion Barbeau, a attiré plus de 1,3 million de spectateurs. Les vidéos de chorégraphies font le succès de TikTok, le réseau social né en 2016, qui a atteint le milliard d’utilisateurs cette année. Autant de signes d’un emballement de l’époque pour la danse. Les marques de luxe ne s’y sont pas trompées : à la rentrée, à l’Opéra de Paris, quelques jeunes femmes, journalistes, influenceuses ou actrices, ont été invitées par Chanel à un cours de ballet où elles apprenaient les cinq positions du classique. En septembre, au défilé de prêt-à-porter de la maison Dior, des danseurs défilaient autour des mannequins. Quelques jours plus tôt, le chausseur Weston organisait un bal au siège de la Garde républicaine, au cours duquel des chorégraphes contemporains enseignaient des pas aux invités. Et le grand magasin La Samaritaine a choisi le thème de la danse pour ses vitrines de Noël. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Avec « Dream » au Centquatre, « Forêt » au Musée du Louvre... La danse s’affranchit de la scène Ce succès s’observe partout. Dans les cours, c’est l’affluence. Il y a ceux qui se remettent aux pointes, quelques décennies après l’enfance. Les professeurs de flamenco, de zumba, de tango, de salsa ou de comédie musicale voient arriver toujours plus d’élèves. Et le panel s’étoffe : le voguing, mouvement né dans les clubs gay noirs new-yorkais, en partie popularisé par Madonna, où il s’agit d’imiter les poses affectées des mannequins du magazine Vogue, est de plus en plus pratiqué en France. On voit aussi se répandre le waacking, très similaire, né à Los Angeles, où on bouge les bras pour imiter les stars hollywoodiennes ; la danse extatique, sans chorégraphie, afin que les mouvements ne soient pas entravés ; la danse des 5 rythmes, qui se vit comme une méditation en mouvement ; la Gaga Dance, une méthode d’improvisation guidée… Bien sûr, le yoga reste une pratique courante, voire banale, pratiquée depuis les années 2010 dans toutes les villes et par toutes les générations, mais la danse s’impose de plus en plus. À partir de début 2020, les confinements ont donné envie de pousser les murs, de laisser libre cours aux mouvements du corps. Les adeptes du yoga, ou du combo pompes-abdos-gainage, n’ont pas arrêté leurs activités. Mais d’autres se sont mis à danser. Avec comme un besoin de se défouler, de trouver un exutoire, mais aussi de s’exprimer librement, appliquant à la lettre les mots d’Isadora Duncan, figure de la danse moderne, qui affirmait : « Si j’avais les mots pour le dire, je n’aurai pas besoin de le danser. » Nouvelles pratiques liées à la création vidéo Après le vivre-ensemble, le « bouger-ensemble ». Depuis des années, à Paris, les bords de Seine, notamment dans le 5e arrondissement, se remplissent certains soirs de couples qui dansent en plein air. Plus récemment, plusieurs associations se sont mises à organiser des bals dans d’autres quartiers de la capitale, notamment sur la place de la République. On y danse la bachata, originaire de la République dominicaine, ou la salsa. Et puis il y a les danses de salon, qu’on pensait oubliées. Et qu’on n’aurait jamais imaginé pratiquées hors de studios poussiéreux. Exactement comme les premiers danseurs de hip-hop, qui agaçaient les passants autrefois et qui font désormais partie du paysage. Il ne se passe pas une semaine sans que le chorégraphe Rachid Ouramdane, à la direction du Théâtre de Chaillot, ne guette, depuis sa fenêtre, l’effervescence du parvis du Trocadéro. Il observe des chorégraphies de K-pop et d’autres danses urbaines. Le succès de ces nouvelles pratiques et expériences, souvent liées à la création vidéo, le fascine. « Ce rapport au numérique n’est pas toujours dans l’oubli du corps. Certaines personnes sont collées au réseau, mais elles dansent énormément et mettent leur corps à l’épreuve, souvent de manière très physique », reconnaît-il. Rachid Ouramdane, 51 ans, est d’une génération qui a fait ses premiers pas quand le hip-hop vibrait déjà dans l’espace public. Il était devenu possible, enfin, de danser partout. Une fois arrivés à la tête d’institutions, lui et ses camarades ne pouvaient que persévérer dans cette quête de liberté. « La danse est un médium formidable dans l’espace public. Sur une place, on n’a pas besoin de scène ni de gradins pour danser. Ce rapport très horizontal permet de voir des gens danser de loin et se retrouver facilement happés par la danse… » Boris Charmatz, chorégraphe Les voilà donc nombreux à faire bouger les choses. Au Palais de Tokyo à Paris, Vittoria Matarrese dirige la programmation consacrée aux arts performatifs. « Les arts vivants sont parfaits pour venir interpréter des formes qui sortent du cadre figé d’une salle. Ils permettent de traverser l’espace avec un autre regard, plus grand et plus transversal, où le public n’est peut-être pas forcément devant, mais derrière, ou encore de côté, et surtout, qu’il puisse se balader. » Pour célébrer les 20 ans de l’institution en septembre, elle a donné carte blanche à l’artiste Marinella Senatore. Deux cent quarante performances par jour pendant quatre jours, et de toutes sortes : percussions corporelles, krump, parkour, voguing… Le mot d’ordre, répété sur des enseignes lumineuses colorées : « Dance First, Think Later ! » (« Danse d’abord, pense après ! »). Le chorégraphe français Boris Charmatz, habitué à organiser des spectacles en plein air hors de la scène, ajoute : « La danse est un médium formidable dans l’espace public. Sur une place, on n’a pas besoin de scène ni de gradins pour danser. Ce rapport très horizontal permet de voir des gens danser de loin et se retrouver facilement happés par la danse… » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Mon père qui enflamme le dancefloor sur Lady Gaga, je n’étais pas prête » : la danse, arme fatale des parents Le grand public est parfois invité à venir sur scène. Le 23 avril, 2 000 personnes sont venues danser au Palais de Chaillot. Tout au long de la journée, l’événement gratuit, baptisé « On danse chez vous », mêlait performances, cours, extraits de spectacle et conférences… Aux manettes, Mehdi Kerkouche. Au même titre que (La)Horde, le chorégraphe de 36 ans incarne sans doute les mille formes que prend la danse aujourd’hui. Il organise des ateliers pour le grand public, a orchestré un spectacle joué, sous la tour Eiffel, par trente femmes atteintes du cancer du sein dans le cadre du mois de sensibilisation « Octobre rose », collabore avec des danseurs contemporains parmi les plus pointus, travaille avec Hermès, conçoit les shows de la chanteuse Angèle… Le 14 septembre, il était nommé à la direction du respecté Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. Une entrée dans l’institution publique qui ne devrait pas altérer sa passion pour les chanteuses pop dont les clips ont déclenché sa vocation. Bientôt un spectacle de danse contemporaine autour des déhanchés de Britney Spears ? Pourquoi pas ? La danse n’a pas fini de décloisonner les genres. Clément Ghys et Sibylle Grandchamp We Should Have Never Walked on the Moon, de (La) Horde/Ballet national de Marseille, jusqu’au 4 novembre au Théâtre national de la danse de Chaillot, Paris 16e. theatre-chaillot.fr Légende photo : le collectif (La) Horde. Photo : Vincent Desailly pour M le magazine du Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2022 7:26 AM
|
Portrait par Julie Brafman dans Libération - 27 octobre 2022 Rencontre à Nancy, sa ville, avec l’acteur reconnu tardivement, agréablement surpris que le sort lui ait été favorable. Tous les convives ont déserté le restaurant chic, avec sa moquette moelleuse et sa vue sur la place Stanislas à Nancy. Le déjeuner est terminé, il tombe des trombes d’eau et ne reste plus que cet homme aux yeux couleur ciel sans nuage, assis avec sa «putain de bonne étoile». Celui qui a été amoureux de Sabrina en CM2, qui a passé ses vacances d’enfance dans un camping-car «tout pourri» baptisé «Totor», qui s’est électrocuté le doigt quand il était gamin en voulant changer toutes les ampoules de sa chambre – «le médecin a expliqué que si la décharge était tombée pendant un battement de cœur j’aurais pu mourir mais c’était un silence» –, qui dit «patins» pour «chaussons» et qui emporte toujours sa machine à café en tournage. Celui qui joue à la canasta en ligne dès le réveil (il est classé 460e sur 10 000, tout de même), qui adore le film de la fin des années 80 Papa est parti, maman aussi – son fils s’est approprié la réplique «je n’en veux plus, ça sent la souris» –, qui penche pour les manteaux à capuches plutôt que les parapluies et qui a un yorkshire nommé «Chantal» (on dit «Chanchan»). Au troc des petits bouts de soi, Pierre Deladonchamps préfère le récit de son «métier bizarre» pour lequel «il faut être un peu fou». Si aujourd’hui le cinéma le chérit et les films s’enchaînent (il est actuellement à l’affiche de Vous n’aurez pas ma haine et Reprise en main de Gilles Perret, où il interprète un ouvrier qui veut racheter son usine), ce serait grâce à cette «putain de bonne étoile». Elle a frappé une première fois ici même, enfin plutôt là derrière, à l’angle de la petite rue pavée, vous voyez ? Anne, l’amoureuse de ses 17 ans – qui est aujourd’hui sa meilleure amie – lui avait lancé comme un défi «viens, on fait du théâtre !» et c’est comme ça qu’ils s’étaient inscrits dans le club du centre-ville. «Quelques années plus tard, un de mes potes m’a demandé de lui donner réplique pour le Cours Florent. On a été pris tous les deux», poursuit-il. A l’époque, Pierre Deladonchamps a 23 ans, il est un peu paumé dans «son école de commerce semi-publique» et part pour Paris. La vie se mue en boulots temporaires et castings décevants, rêves de grand écran et petits salaires. En 2010, il bat en retraite. Retour à Nancy. C’était sans compter sur la «putain de bonne étoile» : deux ans plus tard, il décroche le rôle qui va tout changer, celui de Franck dans l’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie. A croire que «les cendres n’étaient pas complètement éteintes», dit-il en souriant. Viendra le césar du meilleur espoir masculin et le début d’une nouvelle ère où le téléphone n’en finit plus de sonner. Pierre Deladonchamps a joué le pédophile dans les Chatouilles, le tueur en série de Vaurien, et puis aussi Jacques, écrivain atteint du sida – merveilleux Jacques avec sa délicatesse qui ne tient qu’à un fil – dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. «Ça a scellé quelque chose. J’aime faire des films utiles, ajoute l’électeur de gauche. Pour moi, l’art est politique et il fait plus avancer les choses que la politique politicienne. Quand je vois l’Italie où triomphe l’extrême droite, je ne peux m’empêcher de faire le lien entre la décrépitude du secteur culturel et des idées.» Quand le cinéaste Kilian Riedhof lui a proposé d’incarner Antoine Leiris, ce journaliste qui a perdu sa femme au Bataclan et a écrit le message devenu viral : «Vous n’aurez pas ma haine», il n’a pas hésité. «Je savais que je le voulais, ce rôle. J’avais été frappé, à l’époque, par l’intelligence et la résilience d’Antoine Leiris.» Dans les interstices de l’interview, ceux où l’on oublie parfois d’être sérieux, Pierre Deladonchamps laisse entrevoir le gamin qu’il nous a décrit, le genre à faire le pitre «et créer des situations comiques». D’ailleurs, son prochain film, Hawaï, sera une comédie, «l’histoire d’une bande de copains réfugiés dans un abri car ils pensent qu’ils vont mourir. Ils se disent leurs quatre vérités. Sauf qu’ils ne meurent pas». Quelle serait sa tirade de fin du monde ? Terrassé par la peur, il ferait plutôt l’amour, répond-il. Classique. Aujourd’hui, il vit seul, entre Nancy et Paris, avec ses deux enfants de 4 et 12 ans en garde alternée (et Chanchan qu’il trimballe en scooter, train et avion). L’aînée vient de tourner dans son premier film, elle veut devenir actrice. Pendant longtemps, Pierre Deladonchamps a pensé que le cinéma le «sauverait de la folie ou du mal-être», que ça «allait le remplir d’amour». Mais «ça n’a pas comblé le vide». A 44 ans, il se «sent finalement davantage soigné par le fait d’être parent qu’acteur». Peut-être parce qu’il en avait assez de tourner autour de lui-même, admet-il. Quand on lui cite Pialat : «Tu crois aimer mais tu attends seulement qu’on t’aime», il réplique avec Jean-Jacques Goldman : «Il y a une question dans “je t’aime” qui demande “et m’aimes-tu, toi ?” Alors sache que je. Sache que je.» Dans sa playlist qui résonne dans le restaurant vide, il y a des dizaines de tubes du chanteur dont Veiller tard. Son passage préféré est celui-ci : «Ces étreintes qu’en rêve on peut vivre cent fois», «parce que finalement, c’est ça être acteur». Et puis aussi Jacques Higelin : «Vois comme les étoiles sont indifférentes au chagrin, au bien au mal» – ou encore A regarder la mer d’Alain Barrière qui accompagnera la scène inaugurale du premier long métrage qu’il est en train d’écrire. Il s’est inspiré de l’histoire de sa famille, «très dé-zoomée», notamment de sa relation avec son frère, Guillaume, qui s’est suicidé à 26 ans. En guise de totem, il n’y aura pas Totor mais le tandem qui les unissait durant l’enfance. Guillaume était «génial, très drôle». Compositeur et musicien, il a laissé à sa famille une quarantaine de textes dont certains chantés par Pierre Deladonchamps en 2005 en première partie de Jacques Higelin. Guillaume était aveugle aussi. «Mais pour moi, c’était comme une couleur de cheveux, un détail mais pas un problème», poursuit-il. Dans la maison de Jarville-la-Malgrange, à côté de Nancy, où il vivait avec son père qui travaillait dans le social, sa mère, institutrice, et trois autres enfants recueillis après le décès de leurs parents dans un accident de voiture, «le regard a eu une importance particulière, il a été conscientisé et chéri». Pierre Deladonchamps est devenu le petit frère qui joue au grand, celui qui passe son temps à décrire le monde, à chuchoter les films dans le fond des salles obscures, à déclamer le catalogue de la Redoute – notamment la section chaînes hi-fi avec tous les détails techniques – et à être fier qu’on ait «besoin de lui». La première fois qu’il a abordé Pedro Almodóvar, l’une de ses idoles – Chanchan a failli s’appeler Kika – c’était pour lui dire à quel point la Mauvaise Education lui rappelait Guillaume. Depuis, ils s’écrivent régulièrement. Finalement, Pierre Deladonchamps trouve que le cinéma, c’est comme le reste, «ça peut arriver à tout le monde». Parfois, on a une «putain de bonne étoile». Ou alors ça s’appelle juste de la patience. 1978 Naissance à Nancy. 2013 L’Inconnu du Lac. 2014 César du meilleur espoir masculin. Octobre et novembre 2022 Reprise en main et Vous n’aurez pas ma haine. Légende photo : Pierre Deladonchamps, à Nancy, le 27 septembre 2022. (Mathieu Cugnot/Divergence pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2022 9:47 AM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks - 26 octobre 2022 Nouvellement promu directeur de La Ménagerie de Verre à Paris, Philippe Quesne hérite du lieu créé voici quarante ans par Marie-Thérèse Allier. En guise de premier acte, il organise une exposition immersive dans la filmographie de Jean-Luc Godard. Présent sur tous les fronts, le Festival d’automne lui consacre un mini portrait en trois spectacles où il démontre son éclectisme artistique, avec un drôle de space opera, une installation hantée et la mise en scène d’un lied de Gustav Malher. Rencontre. Vous venez de prendre la direction de la Ménagerie de Verre à Paris. Que représente cette salle pour vous ? Philippe Quesne – D’abord, c’est un lieu que j’adore, une salle créée dans le parking d’une ancienne imprimerie dont les ateliers sous verrière ont été transformés en studios de danse. J’y suis longtemps venu comme spectateur pour voir les travaux de Xavier Leroy, Jérôme Bel ou Claude Régy. La Ménagerie de Verre représente aussi beaucoup dans mon parcours créatif. Marie-Thérèse Allier, la directrice et fondatrice du lieu, m’a invité a présenter chez elle ma première pièce, La Démangeaison des ailes. En 2004, j’avais créé le spectacle à Dijon avec une bande d’amis dont certains m’accompagnent encore aujourd’hui. C’était un coup d’essai. J’étais le prototype de l’artiste émergent et Marie-Thérèse avait fait le déplacement pour découvrir mon travail avant de me convier à le présenter dans le cadre de son festival, Étrange Cargo. L’étape a été déterminante pour l’avenir de la compagnie en ouvrant la porte sur une première tournée. On ne pouvait rêver mieux. Plus tard, j’ai eu l’occasion d’être invité en résidence pour créer d’autres spectacles comme L’Effet de Serge. Comment en êtes vous arrivé à prendre cette direction ? Au fil du temps, des liens très forts m’ont rapproché de Marie-Thérèse Allier, même si, à partir d’un certain moment, mes spectacles ne rentraient plus dans la salle de la Ménagerie. À 91 ans, elle envisageait depuis deux ou trois ans de passer les clefs de la maison à quelqu’un dont elle appréciait l’état d’esprit. Elle avait imaginé que je pourrais prendre sa suite. Sa mort en mars dernier a précipité les choses. Sensible à l’émergence et ultra réactif, le modèle inventé avec la Ménagerie de Verre reste d’avant-garde dans le domaine des formes hybrides et irrévérencieuses qu’elle a toujours défendues. Votre premier geste est de reprendre un parcours consacré à la filmographie de Jean-Luc Godard, la suite d’une exposition initiée en 2019, alors que vous étiez le directeur du théâtre Nanterre- Amandiers. À l’aube des quarante ans de la Ménagerie de Verre, on cherchait une idée pour habiter le lieu. Marie-Thérèse a tout de suite été enthousiaste quand je lui ai parlé de reprendre ce parcours dédié à Jean-Luc Godard. Je l’ai mise en relation avec l’équipe qui entourait le réalisateur et avec laquelle j’avais travaillé à Nanterre. Elle trouvait très beau que l’on puisse visiter l’exposition le soir en parcourant les studios de danse où se donnent des cours le jour. Cette fois, on va se concentrer sur les cinq derniers films de Godard : Éloge de l’amour (2001), Notre musique (2004), Film Socialisme (2010), Adieu au langage (2014), Le Livre d’image (2018). Je me réjouis que le projet rebondisse aujourd’hui. C’est très émouvant de commencer par mettre en œuvre cette nouvelle page qu’on avait rêvée ensemble, et de le faire l’année de leur double disparition. Au départ du projet, comment êtes-vous entré en contact avec Jean-Luc Godard ? De manière très spontanée. Je cherchais un événement pour clore mon mandat à Nanterre. Je suis tombé sur son intervention mémorable au smartphone où il annonçait, à propos du Livre d’image, que le film était à Cannes mais qu’il n’envisageait pas de le sortir en salle, car ce n’était plus forcément l’endroit où voir ses films. Comme il excluait aussi les grandes institutions et les musées, je me suis permis de lui écrire. Je lui ai fait passer ma demande de consacrer une exposition à ses films en entrant en contact avec son entourage. Je me présentais en fan de son travail en lui expliquant que j’avais un théâtre qui était dans la liste des lieux restant possibles pour montrer ses films. J’ai été jusqu’à lui préciser que si le théâtre ne lui convenait pas, il y avait en face une piscine qui pourrait aussi faire l’affaire. L’accord a été immédiat et on s’est vite mis au travail avec deux de ses proches collaborateurs, Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaggia. J’avais libéré tous les espaces du théâtre, du plateau aux loges et au dessous de scène, on a tout investi. Je n’ai jamais rencontré directement Jean-Luc Godard, mais je sais qu’il était tenu au courant de tout ce qu’on faisait. Après coup, il m’a envoyé un gentil mot pour me remercier. Quel est votre projet pour la Ménagerie de Verre ? L’espace est atypique et c’est sa force. Travailler à la Ménagerie de Verre a été important pour une nouvelle génération d’artistes mais aussi pour d’autres, plus connus, qui ont trouvé là une occasion de repenser leur esthétique. Il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Il faut juste perpétuer la méthode de Marie-Thérèse Allier, faire confiance à l’intuition et miser sur le talent de se réinventer au quotidien. L’important étant de préserver le fait qu’il s’agit d’une ruche de travail et d’échanges qui ne reçoit du public que lors d’événements ponctuels, comme le festival Inaccoutumés à venir fin octobre. C’est cette pulsation mesurée entre ouverture et fermeture qu’il faut conserver. Vous avez longtemps été scénographe avant de devenir metteur en scène. Qu’est-ce que cela change dans votre approche de la scène ? J’ai été formé dans les écoles d’art. Dès quinze ans, je suis entré à l’école Estienne avant de passer par les Arts Déco où j’ai étudié la muséographie, la scénographie et la performance. Cet environnement est propice à l’envie de donner vie à ses propres fables et cet enseignement rend possible le fait de rêver à d’autres mondes, en prétendant que la fiction est l’endroit de solutions qui peuvent résoudre des questions qui se posent dans la réalité. J’ai ensuite passé dix ans à gagner ma vie comme scénographe ; c’était une expérience très riche d’assister à des répétitions menées par d’autres. Dans les années 2000, tout ce que je voyais au théâtre me lassait vite. Ce déclic m’a amené à m’intéresser à faire spectacle de ce que les autres laissaient de côté et à imaginer le théâtre à partir de la poésie et de la littérature, de collages d’images ou de l’idée qu’un espace pourrait engendrer une histoire. Au début, j’y consacrais mes week-ends. J’inventais mon théâtre comme on répète dans un groupe de rock, sans pression et dans l’intimité d’un petit cercle d’amis. Ma croyance dans les aventures collectives se double dans mes fables du désir d’assumer la fragilité et le bricolage de leur fabrication. Prendre le temps de me trouver a été une étape déterminante dans la construction de mon imaginaire. Avec trois spectacles à l’affiche du Festival d’Automne à Paris, on va découvrir la grande diversité de vos approches créatives. Au-delà du plaisir de les voir réunies par le festival, ces trois pièces m’ont été commandées juste avant la pandémie et les aléas liés à la fermeture des salles. Ceci explique ce calendrier où l’on peut les découvrir ensemble sans que ce soit prémédité. Avec Cosmic Drama, vous nous entraînez dans un space opera. J’ai rêvé d’une pièce de science-fiction mettant en scène une petite communauté d’astronautes se penchant sur le sort d’un astéroïde dépressif, orphelin parmi les siens. Il s’agit d’humains qui tentent d’établir un dialogue avec des pierres errantes de l’espace. Dans Fantasmagoria, vous rendez hommage à l’art forain. Ca fait longtemps que j’avais envie de travailler sur un théâtre se passant des acteurs. Le déclencheur a été le désir de redonner sa chance au squelette qui volait dans La Démangeaison des ailes. Je me suis souvenu d’Étienne-Gaspard Robertson, qui mettait en scène des spectres dans des baraques de foire à l’époque de la Révolution française. J’ai réuni une quinzaine de pianos mécaniques et je fais entendre des textes de bonimenteurs en voix off. C’est le prétexte à des apparitions fantomatiques dignes des lanternes magiques d’antan et des attractions des Grands Boulevards. Avec Le Chant de la terre, vous montez un Lied de Gustav Mahler. J’accepte très rarement les formes opératiques. Mais je ne pouvais refuser Le Chant de la terre, pièce géniale sur la réconciliation de l’homme et de la nature. C’est une réflexion sur la beauté et la lente disparition du monde tel qu’il était… Une manière de prendre date en 1907 de la fin du romantisme. Je m’empare de l’œuvre avec une grande humilité. J’ai imaginé une vaste lande de terre qui réagit aux intempéries et un accrochage de toiles d’Albert Bierstadt qui bougent simplement dans le vent. On va fêter en 2023 les quarante ans de la Ménagerie de Verre. Qu’envisagez-vous pour cet anniversaire ? Pour rendre hommage à Marie-Thérèse Allier, je souhaite me rapprocher au plus près de ce qu’elle avait imaginé, une réunion de créateur·ices ayant participé de l’histoire de la Ménagerie de Verre et des nouvelles têtes à découvrir. Je veux éviter tout cérémonial et donner la place aux artistes. L’étrangeté de cet anniversaire, c’est qu’il correspond aux vingt ans de ma compagnie. À cette occasion, j’ai le désir de créer une grande fresque en m’emparant du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Ce tableau peint en 1500 fait lien avec le surréalisme et ouvre une foule d’histoires à raconter. J’adore démarrer l’écriture d’un spectacle comme une enquête, et celle-ci s’avère des plus excitantes. Propos recueillis par Patrick Sourd Dans le cadre du Festival Inaccoutumés : Éloge de l’image, parcours dans la filmographie de Jean-Luc Godard, conception Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaggia, du 23 novembre au 18 décembre, La Ménagerie de Verre, Paris. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris : Cosmic Drama, conception, mise en scène et scénographie, Philippe Quesne, du 20 au 22 octobre, MC93, Bobigny. Fantasmagoria, conception, mise en scène et scénographie, Philippe Quesne, du 3 au 6 novembre, Centre Pompidou, Paris. Le Chant de la terre (Das Lied von der Erde) de Gustav Mahler, direction musicale Emilio Pomarico, mise en scène et scénographie, Philippe Quesne, les 9 et 10 novembre, Théâtre du Châtelet, Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2022 8:00 AM
|
Critique de Christine Friedel dans Théâtre du blog - 26 octobre 2022 Extraire la racine carrée d’un nombre, une opération étrange rappelant le collège est ici associée à la conjugaison d’un des deux verbes auxiliaires. Calcul et grammaire : on ne les pratique plus guère en grandissant mais on n’oubliera jamais à quel point l’école compte pour former un être, dit Wajdi Mouawad. Commençons par le verbe : être, mot clé du théâtre depuis Shakespeare. « Être ou ne pas être ? » Question étrange : nous sommes, nous pensons donc nous sommes. Mais qui, nous ? Moi ? Et si les hasards du destin en avaient décidé autrement ? La pièce arborescente de Wajdi Mouawad part d’une hypothèse: si le premier avion emmenant ses parents (lui avait neuf ans) loin du Liban en guerre, avait été celui de Paris au lieu de celui de Rome ? Et si nous étions non seulement chacun soi-même, mais cinq ou six nous-mêmes possibles et différents, vivant en même temps, avec la même parentèle, dans d’autres villes et d’autres histoires ?Hypothèse culottée, que l’auteur, metteur en scène et acteur met en place posément, puis de façon de plus en plus vertigineuse.
Nous retrouvons Talyani Waqar Malik en chirurgien génial et odieux à Rome. Ensuite en peintre peut-être génial et un peu moins odieux (encore que…) aux Etats-Unis. Puis en commerçant cyclothymique, peintre lui aussi à ses heures, récupérant des pantalons dans sa boutique écrasée par l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Ses parents, eux, n’ont pas quitté le pays.
Puis en chauffeur de taxi parisien bien intégré et joueur de trompette entre deux prises en charge ; en condamné à mort dont le propre père quitte ce monde, chacun attendant à la même seconde, l’injection finale…
Talyani Waqar Malik, le même et un autre, garde son nom et ses origines, et chacun pousse comme un rameau d’arbre, à sa façon, différente de celles de ses avatars, puisque pour lui l’histoire commence avec ce premier avion. Parfois, il aura deux enfants adolescents ou non, en conflit avec lui, comme dans n’importe quelle famille « normale », ou jusqu’à la guerre totale, parfois.
Nous ne perdrons jamais le fil et les suivrons tous jusqu’au bout. Ce sera drôle pour certains, et pour d’autres, ira jusqu’au tragique. Apparaîtront un bébé miraculé et curieux de l’assassin de ses parents, un roi Lear vendant à ses enfants un héritage imaginaire contre des certificats d’amour, une Antigone, une Tamar… Nous entendrons résonner les grands mythes antiques et bibliques. La famille n’est-elle pas le nid la tragédie ?
Dans la première partie du spectacle, Wajdi Mouawad prend le temps de poser les règles du jeu, dont le sens se précise ensuite. Ce qu’il faut pour laisser pousser les ramifications de cette identité au pluriel, à partir d’un premier point de départ : l’avion, et autour d’une catastrophe : l’explosion du port de Beyrouth. Ensuite, tout s’accélère et s’approfondit à la fois : l’arbre métaphorique pousse ses racines et entrecroise ses branches. Et il n’est pas que métaphore : parmi les problèmes de société et d’une urgence actuelle, rencontrés dans la pièce, Wajdi Mouawad donne une grande place au sauvetage des arbres. Avec un hommage au grand jardinier Gilles Clément qui célèbre la capacité des arbres à se régénérer et à revivre sous d’autres formes, quand les créations humaines, vite obsolètes, encombrent la terre de débris toxiques. Comment jouer une pièce feuilletée de tant de récits, grandes questions, affaires de famille, vies et morts ? Vite et les interprètes ne perdent pas de temps, se renvoient la balle du texte, évoluent dans le décor sans cesse changeant d’Emmanuel Clolus, tenant le fil de chaque histoire.
Wajdi Mouawad joue le rôle multiple de Talyani Waqar Malik, qu’il a médité durant le confinement en silence dans la salle de répétitions. Il le partage avec Jérôme Kircher, son double de théâtre : même densité physique, même évidence dramatique.
Les différents Talyani Waqar Malik peuvent se croiser à la charnière d’une scène à l’autre, jusqu’à se trouver ensemble sur scène, quand toutes les destinées finissent pas se tresser. Un, plusieurs, cent mille, dirait Pirandello.
Nora Krief la sœur de tous, comme le personnage du film de Saeed Roustaee Leila et ses frères, répond avec une grande justesse sur un ton égal et aussi forte, aussi présente, à quatre ou cinq histoires simultanées.
Parmi les prouesses de ce spectacle : une vertigineuses démonstration sur la racine carrée de 2 et les abîmes philosophiques et poétiques qu’elle ouvre. Entre autres, l’existence des nombres irrationnels (démontrée par le calcul de la raison), et le fait que cette suite infinie de chiffres contient –en représentant chaque lettre de l’alphabet par un chiffre- le mot : Hamlet en entier (mais on ne nous dit pas en quelle langue). Le public applaudit le spectacle avec un grand soupir de joie, rapportant chez lui quelques vérités solides comme : l’école est la seule chose qui peut faire de vous un homo sapiens. Et il faut arrêter de plaindre les exilés de luxe et les sommer de rentrer au pays, non pour la nostalgie, mais pour le reconstruire, en famille. Qu’il ne s’agit pas d’être pour ou contre l’homosexualité, mais tout simplement d’aimer les gens, que c‘est une nécessité, comme la vie et la mort. Que ça vaut la peine d’écouter de longues et belles histoires tourmentées, à l’orientale. Que l’art est indispensable pour voir le monde et que le calcul mathématique contient des surprises gigantesques et d’une beauté renversante.
Professeur Mouawad, n’arrêtez pas de nous faire la leçon. La vôtre est parfois drôle, parfois tragique, parfois confuse sur le moment mais s’éclaire ensuite. Grave, elle ose des transgressions : c’est la vie même.
Le mieux : voir l’intégrale. Mais sinon les première et deuxième parties, et la troisième le lendemain. Mais de toute façon, vous aurez envie de voir la suite… Christine Friedel Jusqu’au 30 décembre, Théâtre National de la Colline, 17 rue Malte-Brun, Paris (XX ème). T. : 01 44 62 52 52.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...