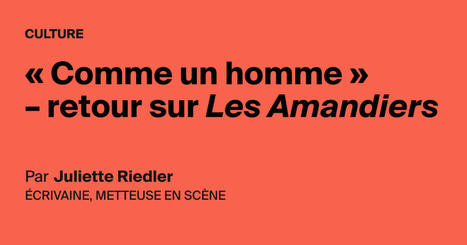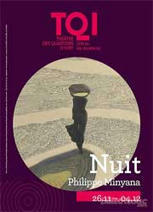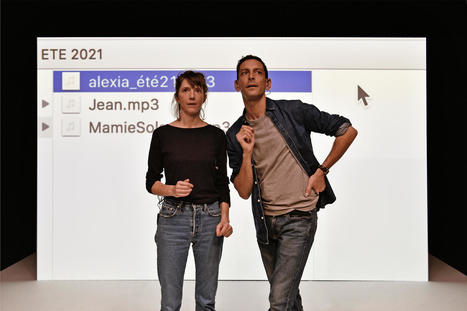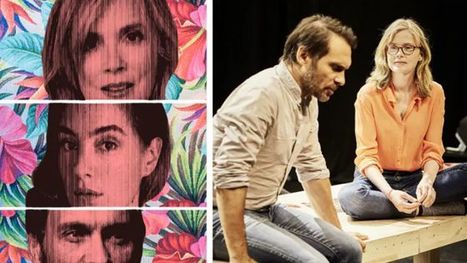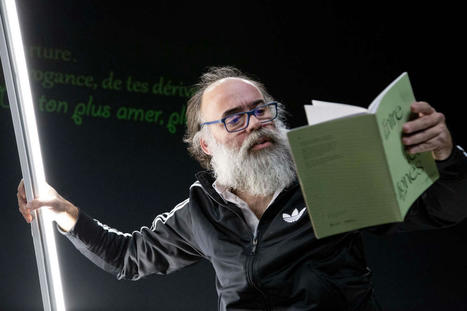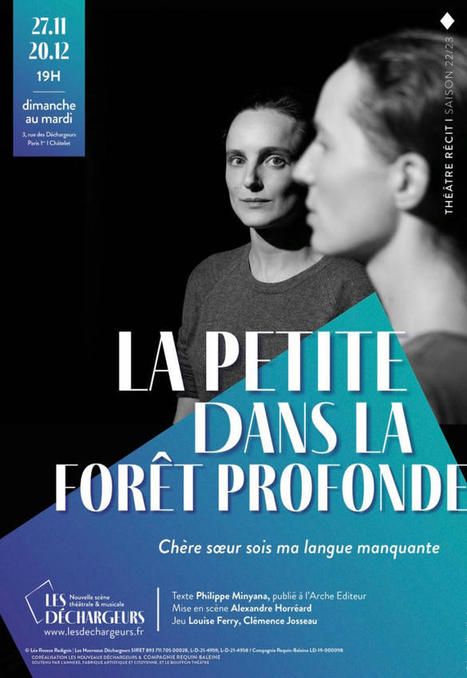Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 7, 2022 3:44 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - 7/12/2022 Sous la pression d’associations, le Théâtre 13, à Paris, a déprogrammé la pièce mise en scène par Lena Paugam, adaptée d’un récit de Laurène Marx. Triste affaire dont personne ne sort gagnant : ni le lieu ni les personnes trans, dont la mobilisation s’achève par une censure. Peut-on incarner une personne trans lorsqu’on n’est pas trans soi-même ? La réponse vient de tomber : c’est non. Déprogrammées par Lucas Bonnifait, directeur du Théâtre 13 à Paris, les représentations de Pour un temps sois peu, un récit autobiographique de l’autrice trans Laurène Marx mis en scène par Lena Paugam, n’auront pas lieu comme prévu du 4 au 19 janvier. La raison ? L’actrice n’est pas trans. Joué près de vingt fois en France depuis 2021, ce spectacle incarné par Hélène Rencurel n’avait jusque-là jamais posé problème. Mais sa venue à Toulouse, en novembre 2022, s’est heurtée aux contestations d’associations locales très remontées qui menaçaient de venir manifester chaque soir à Paris. Face à cette levée de boucliers, la comédienne et l’équipe du Théâtre 13 ont préféré, elles aussi, jeter l’éponge. « Je ne suis pas là pour lutter contre les trans. Je comprends et j’accompagne leur combat. L’invisibilisation de leurs corps est un problème de société. Si jouer signifie les invisibiliser encore plus, alors cela ne m’est plus possible », avoue Hélène Rencurel. Triste affaire dont personne ne sort gagnant : ni le lieu, contraint de renoncer à un projet de qualité, ni les personnes trans, dont la mobilisation s’achève par une censure. Ni l’art, à qui sont déniés son droit et sa capacité à représenter l’altérité. Un dialogue tendu Comment en est-on arrivé là ? En 2019, le collectif rennais Lyncéus passe commande à Laurène Marx. Sa pièce sera interprétée par Hélène Rencurel et mise en scène par Lena Paugam. Cette dernière se souvient des mots de l’écrivaine : « Elle m’a dit : je veux que tu montes ce spectacle mais, attention, je ne veux pas que ce soit un spectacle trans pour les trans. » Une consigne qui semble avoir évolué avec le temps. À l’hiver 2020, Laurène Marx manifeste le désir de jouer elle-même son propre rôle. Ce qu’elle fait, dans une mise en scène de Fanny Sintès, en novembre 2022, au Théâtre de Belleville, à Paris. Proche du stand-up, sa performance n’a rien à voir avec le travail, plus théâtral, déployé par Hélène Rencurel. Pourquoi ces deux spectacles, qui ne se faisaient pourtant pas d’ombre, ne pouvaient-ils coexister ? Loin de calmer la colère des associations trans, Laurène Marx se méfie à leurs côtés d’un projet perçu comme le bras armé de l’oppression : « La première fois que j’ai vu le travail de Lena et Hélène, j’ai été émue. Mais ça n’a pas duré. Je ne veux pas qu’on fantasme mon vécu. Je n’en peux plus d’entendre les gens de théâtre dire qu’on peut tout performer. C’est une façon de coloniser les arts. » Des paroles radicales qui évacuent l’ADN esthétique au profit d’une bataille politique dont l’enjeu est si crucial que l’autrice en accepte le coût : avec l’annulation, elle perdra environ 3 000 euros de droits d’auteur. “Dans le fond, je suis en accord avec les demandes légitimes des personnes trans concernées par le texte de Laurène Marx.” Pour Lena Paugam, à qui deux semaines d’exposition dans la capitale sont donc interdites, le constat est amer : « Je peux comprendre la crainte du théâtre face à la menace de manifestations. Mais il est terrible d’en arriver là alors que notre démarche a justement pour sens de dénoncer l’exclusion, la discrimination, la transphobie. Ceux dont nous défendons les idées sont ceux qui nous rejettent. Nous subissons des positionnements de principe qui remettent en question l’acte même du théâtre. » Entre l’autrice et la metteuse en scène, le dialogue est tendu. Victimes collatérales du conflit : les spectateurs. À Toulouse, au Théâtre Sorano, un échange public a été organisé. Une discussion contre-productive, pour le directeur Sébastien Bournac : « Une cinquantaine de personnes trans nous ont reproché de ne pas être assez représentées sur les plateaux. Chacun est resté campé sur ses positions. » Le lieu a beau être respecté pour ses saisons inclusives, cela n’a pas suffi à apaiser les esprits : « Le débat identitaire recouvre les questionnements artistiques que nous défendons. On nous a demandé si nous n’avions pas honte de programmer le spectacle de Lena. Bien sûr que non ! S’il devait être annulé, ce serait le théâtre tout entier qui y perdrait. » Procès en appropriation culturelle À quoi ressemblerait un théâtre amputé de sa part imaginaire et métaphorique ? Le propre des acteurs est de pouvoir tout jouer : ce qu’ils sont comme ce qu’ils ne sont pas. Mais ce n’est pas la première fois que la scène fait les frais de l’activisme militant. Depuis quelques années, les créateurs s’attirent les foudres de communautés qui défendent leur droit à se représenter elles-mêmes. En 2018, le Canadien Robert Lepage, concepteur de Kanata, avait ainsi affronté des Amérindiens furieux de voir leurs rôles pris en charge par des acteurs non autochtones. La multiplication des procès en appropriation culturelle empoisonne le monde du spectacle vivant pris en otage entre ses principes humanistes et ses aspirations artistiques. Lire aussi : Pourquoi nous ne verrons pas “Kanata”, le nouveau spectacle de Robert Lepage « On est à peu près d’accord sur le fait qu’une Blanche ne peut pas jouer une Noire mais pas au point qu’une femme cis ne puisse pas jouer une femme trans », soutient Laurène Marx, qui pointe la difficulté d’accès aux écoles pour sa communauté. Le chemin qui mène à la professionnalisation de comédiens issus de minorités est ardu. Leur précarité les expédie dans les recoins de la société. L’institution tente de lever peu à peu les obstacles. Dans les écoles de jeu, les élèves LGBTQ + ne sont plus l’exception. Leur intégration est en cours. Fallait-il réellement sacrifier un spectacle pour accélérer ce processus de cooptation ? La déprogrammation de Pour un temps sois peu en dit long sur le malaise de professionnels soumis à des revendications qu’ils cautionnent mais qui les placent en porte-à-faux. Lucas Bonnifait, directeur du Théâtre 13, affirme ne pas avoir agi « sous la contrainte de pressions ». Et ajoute : « Dans le fond, je suis en accord avec les demandes légitimes des personnes trans concernées par le texte de Laurène Marx. Maintenir le spectacle de Lena Paugam, ce serait m’inscrire aux antipodes de ce que je pense intimement.» L’argument se défend. Mais il n’est pas de bon augure. Entre la prise de conscience salutaire et une culpabilité de mauvais aloi, il n’y a qu’un pas. Un autre pas, et la censure devient autocensure. Ces pas viennent d’être franchis. Il y a de quoi s’inquiéter pour l’indépendance future du théâtre. Joëlle Gayot ----------------------- Autre article publié dans Libération : Article réservé aux abonnés Récit intime d’une femme trans, la pièce de Laurène Marx «Pour un temps sois peu», mise en scène par Léna Paugam et jouée par une actrice cisgenre, a suscité de vifs débats sur la visibilité des personnes trans. Prévue à Paris début janvier, elle a été déprogrammée. par Anne Diatkine / Libération publié le 13 décembre 2022 à 7h52 Finalement, ils ne sont pas si nombreux, les metteurs en scène, directeurs de lieu, artistes, qui acceptent de s’exprimer sur la décision pourtant exceptionnelle de déprogrammer les deux semaines de représentations parisiennes de Pour un temps sois peu, au Théâtre 13 après que des personnes trans ont exprimé en novembre, lors de deux représentations à Toulouse, leur souffrance de voir ce texte porté par une actrice cis. Peur de prendre des balles sur les réseaux sociaux ? De rajouter un peu d’huile bouillante dans une marmite déjà en surchauffe ? Il faut reconnaître que les données sont complexes et explosives. Ou peut-être trop simples. Complexe, cette histoire qui voit une autrice trans prendre au fil des mois conscience de sa force en tant que porte-parole, et de la portée de son texte autobiographique. Complexe également car l’histoire suppose qu’on étudie les non-dits, les micromouvements de chacun des protagonistes. Mais également trop simple, car c’est «un fait divers» comme nous a dit l’une de nos interlocutrices trans, peu suspecte de transphobie, dont le chien écrasé se nommerait théâtre. «Un fait divers» constitué aussi de rivalités mal placées et de réseaux sociaux stimulés. Mise en distance Pour un temps sois peu est un monologue écrit par Laurène Marx, elle-même trans, qui relate son trajet. Récit intime tissé d’injonctions à la deuxième personne, il est une commande du dynamique collectif Lyncéus qui offre aux écrivains dont ils retiennent les projets une résidence et une bourse, une publication, et la possibilité d’être mis en scène par l’un des membres du collectif. Qui dit mieux ? Au début, en effet, tout se passe bien. En 2019, Laurène Marx choisit de confier son texte à Léna Paugam, qui fait partie du collectif. Preuve de sa confiance, elle suggère à cette dernière d’en être également l’interprète. Que Léna Paugam soit cisgenre n’est alors pas un obstacle. Mais Léna juge qu’elle n’est pas assez intime avec les problématiques du texte pour endosser la double casquette d’actrice et de metteuse en scène. Surtout, elle perçoit que son apport sur le monologue, la révélation de sa théâtralité, passent par une mise en distance. Avec l’accord de Laurène Marx, le rôle est alors proposé à Hélène Rencurel, comédienne engagée, et également membre de Lyncéus. L’autrice et l’interprète se rencontrent à plusieurs reprises avant les répétitions pour explorer le texte ensemble. Un an après que son projet a été sélectionné, Laurène Marx fait part de son désir de jouer son texte. En février 2021, elle est conviée à rejoindre Léna Paugam et Hélène Rencurel pour réfléchir à une version du monologue avec deux comédiennes, dont elle-même. Un drame survient qui empêche Laurène de se déplacer et évacue l’option de travailler à trois. «Je ne me pose alors absolument pas la question» La pièce est créée au Lyncéus festival, en juin 2021, à Binic (Côtes-d’Armor). Pendant un an, elle circule sous forme de maquette dans de nombreux festivals afin de trouver les financements. L’accueil est excellent, comme en témoigne Laurence de Magalhaes, codirectrice du Rond-Point et du festival Paris l’Eté. Elle se souvient de son «choc» et de sa décision immédiate de programmer : «Je ne me pose alors absolument pas la question de savoir si c’est un problème qu’Hélène ne soit pas trans puisqu’elle ne fait en rien semblant de l’être.» En avril 2022, Laurène annonce qu’elle présentera sa propre version scénique de son écrit-manifeste au théâtre de Belleville. Léna Paugam : «J’ai dit à Laurène combien j’étais contente. Le collectif a bien sûr envie que les textes issus du festival soient repris sous de multiples formes et circulent.» En juillet, la mise en scène de Léna Paugam est présentée avec succès, d’abord au festival Paris l’Eté, puis au festival du Théâtre national de Bretagne (TNB) tout récemment en novembre. Comme Laurence de Magalhaes, Arthur Nauzyciel, à la tête du festival du TNB, reçoit de très bons retours. Pas la moindre anicroche à signaler. Quant à Laurène Marx, elle a joué sa pièce sous forme de stand-up percutant tout le mois de novembre au théâtre de Belleville – sa version, mise en scène par Fanny Sintès, promet d’être l’un des événements dans le off d’Avignon en 2023. «Prise de conscience soudaine» Pourquoi aujourd’hui la direction du Théâtre 13 a-t-elle décidé d’annuler toutes les représentations de la mise en scène de Léna Paugam ? A part quand la mort survient, ou que la sécurité n’est pas assurée, il n’y a pas d’autres exemples de suppression d’un projet porté et désiré par ceux-là mêmes qui optent pour la déprogrammation. Joint au téléphone, le directeur du Théâtre 13, Lucas Bonnifait, affirme qu’il n’a ni agi sous la pression, ni n’a été saisi d’une impulsion solitaire. Selon lui, il s’agit au contraire d’une décision mûrement réfléchie, prise avec l’équipe artistique et les diffuseurs du projet. Léna Paugam apporte une nuance de taille sur l’aspect collectif de la décision : «Si le directeur ne peut plus défendre ce projet parce qu’il doute de la légitimité politique de notre travail, alors nous ne pouvons pas jouer. Je respecte sa décision même si je trouve dommage de ne pas pouvoir présenter notre travail au public.» Lors des deux représentations à Toulouse, Lucas Bonnifait explique qu’il a été saisi d’«une prise de conscience soudaine» de la douleur des trans qui reprochent à la performance portée par une actrice cis de s’accaparer leur «vécu» pour en faire du théâtre, alors que les plateaux leur sont rarement ouverts. Durant les débats, une jeune femme trans va jusqu’à promettre : «Si j’étais comédienne, je refuserais les rôles de femmes cis.» L’accusation d’appropriation culturelle apparaît à Lucas Bonnifait suffisamment fondée pour remettre en question une proposition théâtrale qu’il a pourtant déjà vue deux fois auparavant et qui n’existerait pas sans son soutien – il codirige en effet La Loge, organisme dédié aux projets émergents. «La nature même du texte de Laurène qui parle du corps trans rend problématique qu’une actrice cis le représente», explique-t-il aujourd’hui à Libération. Un choix déchirant partagé par l’actrice Hélène Rencurel, qui estime elle aussi qu’il ne lui est plus possible de monter sur le plateau : «A Toulouse, on s’est cogné au réel. On ne peut pas s’emparer du texte de Laurène Marx comme si c’était Tartuffe ou n’importe quel texte du répertoire. Sa contemporanéité est aussi la mienne. Je ne peux pas supporter que par ma seule présence sur le plateau, j’engendre de la souffrance.» La comédienne reconnaît que cette cristallisation a été suscitée par un tout petit nombre de femmes, pas forcément représentatives de toutes les trans : «Lorsqu’on jouait à Rennes, l’actrice Alice Needle nous a écrit pour exprimer son désaccord qu’une femme cis s’empare du vécu d’une trans. A Toulouse, le premier jour, elles étaient cinq, et durant la deuxième, elles lisaient le texte de Laurène à l’extérieur devant une cinquantaine de personnes.» «Offrir aux spectateurs un espace imaginaire» Le directeur du TNB Arthur Nauzyciel, qui a programmé le spectacle de Léna Paugam à Rennes, s’inquiète que les protestations d’un si petit nombre puissent suffire aujourd’hui à faire annuler un spectacle : «A Rennes, il y avait aussi des trans parmi les spectateurs que le travail de Léna et Hélène rendent heureux.» Il poursuit : «Et il y a des trans qui n’ont pas du tout envie d’être assigné(e)s à cette place. Ou des trans et des cis qui ont besoin de voir la mise en scène de Léna Paugam avant de savoir quoi en penser. Si on se mettait à annuler des spectacles à chaque fois que des spectateurs les considèrent illégitimes, on ne pourrait plus rien programmer.» Pour lui, la décision de supprimer ces quinze représentations parisiennes, plutôt que de les accompagner de débats et d’assumer les risques de débordements et de polémiques, est «gravissime» : «C’est nier au théâtre toute capacité à offrir aux spectateurs un espace imaginaire dans lequel ils peuvent penser ce qui leur est raconté.» Il remarque : «Aujourd’hui, de plus en plus souvent, le plateau devient l’endroit où des personnes racontent leurs histoires véridiques et ne sont légitimes à prendre la parole qu’en raison de leur appartenance à un groupe. Le peu de visibilité sur le plateau de certaines minorités peut-il être résolu en interdisant à des acteurs et des metteurs en scène qui n’en font pas partie de s’y intéresser ?» Léna Paugam met en tout cas en garde contre les condamnations de principe sans avoir vu son travail. «Car précisément, Hélène ne “joue” pas le “rôle” d’une personne trans mais “porte les mots” d’une femme trans dont on raconte l’histoire… Dans cette forme de théâtre-récit, le travail de l’interprète n’est pas d’incarner un rôle ou un personnage, mais de permettre par le biais du texte de suivre une histoire racontée.» «Nous n’avons ni souhaité ni œuvré à cette annulation» Laurène Marx souhaitait-elle cette annulation, alors qu’en juillet, soit il n’y a même pas six mois, elle avait cédé les droits de son texte à Léna Paugam, en lui accordant l’autorisation des représentations partout en France à l’exception d’Avignon – où la mise en scène de Léna Paugam aurait été présentée au théâtre du Train bleu en juillet 2023 – et dans les pays de la Loire – car la compagnie Je t’accapare que Laurène Marx et Fanny Sintès viennent de fonder est basée à Nantes ? L’autrice n’a pas donné suite à nos demandes. Pour comprendre son point de vue, il est utile de regarder sa prise de parole après sa première lecture de son texte, à la Mousson d’été, fin août 2021. Avec une force incontestable, l’autrice y explique combien ce premier texte publié lui est consubstantiel, indissociable de sa voix, ses intonations, ses saccades. L’entendre, c’est «entrer dans mon crâne», dit-elle. Le statut du texte – fiction, document, témoignage, manifeste – n’est pas questionné. Dans cet entretien, Laurène Marx indique avoir proposé «timidement» de porter elle-même son récit d’emblée. Un an et demi plus tard, ses posts sur son compte Facebook sont sans ambiguïté : la semaine où le spectacle de Léna Paugam joue à Rennes, elle écrit : «Réfléchis à ça : si je ne pourrais jamais jouer une meuf cis, pourquoi toi tu pourrais jouer une meuf trans ? Si tu as des droits que d’autres n’ont pas, il faut soit que tu te battes pour qu’on ait les mêmes droits, soit que tu renonces à tes droits.» Outre que des trans jouent parfois des «meufs cis» – Marie France chez André Téchiné par exemple – on peut s’étonner que Laurène Marx et son agent n’aient pas songé à intimer, comme l’ont fait en leur temps Beckett ou Koltès, par quel type d’interprètes Pour un temps sois peu devait être joué. Peut-on jouer un texte contre le désir de son auteur, lorsque celui-ci se manifeste de manière impérieuse, avec des arguments politiques et non esthétiques ? Et réciproquement, un auteur peut-il clamer haut et fort qu’il se désolidarise des représentations alors qu’il vient d’accorder les droits de son texte ? Jeudi 8 décembre, Fanny Sintès nous envoie un texto : «Nous n’avons ni souhaité ni œuvré à cette annulation. De la même façon, aucun droit n’a été retiré pour Avignon puisque rien n’avait été acté ni signé.» Hélène Rencurel, interloquée, demande à ce qu’on lui relise l’énoncé. «Qu’on joue ou non, on aurait eu tort quoi qu’on fasse.»

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 5, 2022 6:25 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 1er déc. 2022: A quelques semaines de la fin de son mandat de directeur du Rond-Point, il fait un tour de piste avec ses propres textes. Ce « Carnet de la dernière pluie » est partagé avec les excellentes Manon Chircen ou Marie-Christine Orry. Pour qui connaît les écrits de Jean-Michel Ribes, ce florilège cocasse, féroce, sombre et libre jusqu’au délire, ne surprendra pas. Pour ceux qui aiment le théâtre, les textes de Jean-Michel Ribes sont aussi connus que les sketches de Fernand Raynaud, Raymond Devos ou Guy Bedos. On les sait par coeur. Mais c’est un genre qui n’est pas abîmé par les redites. Au contraire. Il y a là quelque chose de la soumission des enfants à la répétition. A peine en avez-vous terminé avec une histoire, que vous entendez : « Encore ! » Et bien, dans la petite salle du Rond-Point, voici l’histoire de l’huissier qui rend visite à Roland Topor alors qu’il travaille avec Jean-Michel Ribes à leurs désopilantes « Batailles ». Et le voici qui s’incruste ce Monsieur Bellamy…La suite ? Vous la connaissez et vous riez d’avance, ou bien… Assis derrière une petite table sur laquelle il a posé son célèbre feutre, le directeur du Rond-Point demeure impassible -presque, le soir où nous y étions, hier, il n’a pu réprimer un sourire sur une étourderie de sa merveilleuse partenaire. Ils sont deux, en effet. Ces jours-ci, c’est la grande et précise Manon Chircen qui accompagne l’auteur ! Elle-même écrit. Elle est d’autant plus sensible aux folies de ces textes, ces bonbons déguisés, ces brèves de comptoir développées -quelquefois, en effet, on parle de choses vues et l’on a un tel sentiment de vérité que l’on peut tout croire, même à un narrateur nu sur un toit, à Maubert-Mutualité… Jean-Michel Ribes n’a pas choisi la plus petite salle du théâtre qu’il dirige depuis vingt ans, par goût du retrait : tout le hall de ce cirque, qui fut une patinoire, est empli de reproductions de déclarations, de Jack Lang à Valérie-Anne Expert, de la SACD, tout le monde y va de ses lignes d’admiration. « C’est quoi le Rond-Point de Jean-Michel Ribes, pour vous ? « , a-t-on sans doute demandé aux personnes sollicitées. Certaines sont assez âgées pour avoir vu la compagnie Renaud-Barrault expulsée de la gare d’Orsay, certains ont vu l’inlassable Jean-Louis Barrault repartir comme un jeune homme dans ce lieu pas vraiment fait pour le théâtre. « De Marigny au Rond-Point, on aura mis 40 ans à traverser l’avenue », disait-il, malicieux. Revenons au présent. Les textes de l’écrivain Ribes tiennent bien le coup. Il n’a jamais été un homme insouciant. Il a été léger. Insolent. La cascade des textes, souvent des échanges à deux voix, plus un narrateur « off », l’excellentissime Luc-Antoine Diquéro, sont épatants. Féroces, terribles. Irrésistibles. Manon Chicen est excellente, car, restons des enfants, elle met le ton, elle joue toutes les notes. Elle est convaincue, convaincante. Formidable. Et Jean-Michel Ribes, c’est Jean-Michel Ribes : un jongleur mélancolique. On pourrait revenir : « Encore !« . Mais aussi pour Marie-Christine Orry, interprète de haut vol ! Théâtre du Rond-Point, salle Roland-Topor, Manon Chircen jusqu’au 3 et les 13, 14, 15 décembre. Marie-Christine Orry, du 6 au 11 décembre, et les 16, 17, 18 décembre. Jusqu’au 18 décembre. A 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h30. Durée 1h15. Tél : 01 44 95 98 21. A l’issue de la représentation, vous pouvez retrouver Jean-Michel Ribes et ses textes à la Librairie du Rond-Point, nouvellement reprise par une équipe d’excellence d’éditeurs et libraires.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 4, 2023 6:00 AM
|
Texte de Juliette Riedler pour AOC - 3 janvier 2023 En s’accrochant à son acteur comme à une part morbide en elle-même qu’elle ne parviendrait pas tout à fait à lâcher, Valeria Bruni Tedeschi a agi « comme un homme ». Cette affaire des Amandiers pose des questions très profondes, qui ont trait à la confiance que l’on a en son propre travail, en la logique marchande du cinéma. Se reconnaître ou s’identifier homme ou femme dans l’art comme dans la vie en société aujourd’hui a des conséquences quant à la diversité des rôles proposés, aux dangers auxquels on est exposé·e, à l’histoire à laquelle on peut se rapporter. Peu de gestes de femmes en effet dans les arts du théâtre et du cinéma, et leur quasi absence dans notre histoire et notre vie imaginaire communes se manifeste, peut-être en apparence de manière paradoxale, avec la polémique autour du récent film de Valeria Bruni Tedeschi (VBT), Les Amandiers. Ce film, qui revient sur la période de formation de la réalisatrice en tant qu’actrice, sa découverte de l’amour et de la mort, veut aussi ressaisir le souffle particulier d’une promotion, l’aura d’un maître sur elle. L’endroit d’implication de la réalisatrice est complexe, et il m’interroge aux niveaux de la fable, du rapport de la réalisatrice à ses interprètes, et du panthéon imaginaire auquel au fond elle se rapporte. En effet, tout en déconstruisant la figure du maître tout puissant en en révélant les faiblesses, VBT construit un personnage féminin principal (son alter ego) consumé de passion pour un garçon autodestructeur[1]. En outre, la réalisatrice fait le choix de garder son acteur principal après qu’elle ait appris, trois jours après le début du tournage, qu’il était accusé de viols par plusieurs jeunes femmes dont certaines sont actrices. La douleur et la joie suscitées par le travail de mise en scène de son propre passé et les zones de troubles dans lesquelles toute créatrice, tout créateur navigue sont infiniment respectables ; cela ne doit toutefois pas nous interdire de porter attention aux implicites et aux chevauchements de ces différents niveaux, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective. Apprendre qu’un acteur dans une troupe est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles : cette nouvelle dut faire l’effet d’une bombe. La réalisatrice a réuni son équipe et proposé à qui le souhaitait de quitter le tournage. Elle s’adressait alors plutôt aux jeunes femmes, qui étaient déjà, en tant que groupe social, éprouvées par ces révélations. Double peine donc pour elles : avoir peur et possiblement quitter une aventure (un long-métrage, le graal pour les jeunes interprètes !) qui promettait de s’avérer réjouissante et lucrative. Le choix de VBT est « artistique » : elle croyait avoir trouvé en la personne de son acteur principal l’interprète de son défunt amoureux. En négatif, cela impliquait que les jeunes actrices recrutées pour les autres rôles étaient dispensables, remplaçables. L’élection d’un seul a lieu aux dépends des autres, ici des femmes. Or VBT est une femme, elle est une actrice, pour l’occasion réalisatrice. Elle s’est formée dans et par le regard de Patrice Chéreau, lui-même réalisateur. Si le sujet du film avait été sa promotion, nul interprète aurait été « remplaçable », ou bien chacun·e. S’il avait été son histoire d’amour, nous retombions tristement dans le cliché de la jeune femme éperdue pour un homme tourmenté. Si le sujet du film est le théâtre lui-même, Les Amandiers, alors c’est aussi l’histoire d’un fantôme – puisque le théâtre a été détruit – ou du fantasme d’une nouvelle virginité, nouvelle jeunesse de la réalisatrice dans l’œil de son film et de son acteur principal en particulier (l’amandier étant l’arbre symbole de la virginité car il offre précocement des fleurs à nos yeux ébahis, entre janvier et mars ; il est fécondé par un arbre d’une autre espèce qui ne se trouve pas loin de lui). À présent, on dirait que le sujet du film s’est resserré sur ce choix inaugural, celui d’avoir gardé Bennacer pour interpréter le rôle de Thierry Ravel malgré les plaintes dont il était l’objet. En choisissant de poursuivre le tournage, la réalisatrice prend le risque que ces plaintes soient avérées et que le tournage tourne mal, elle expose aussi son acteur à la vindicte publique qu’elle conspue aujourd’hui. VBT agit comme une femme de pouvoir, elle impose son désir, vertical et transcendant, faisant fi des paroles des victimes à laquelle il est une nouvelle fois accordé bien peu de poids. Ce faisant, elle agit « comme un homme », sourde à la plainte de ces jeunes actrices à qui elle aurait toutefois pu s’identifier et prendre en empathie, puisque leur histoire aurait pu être la sienne, étant donné ce qu’elle sait, ce qui est connu désormais, de la réalité des rapports de pouvoir dans le milieu du théâtre et du cinéma. VBT reproduit la violence de Chéreau qu’elle dénonce à l’écran, plutôt qu’elle ne s’interroge sur ce qui, dans cet événement de la parole de ces jeunes femmes, touche très exactement au sujet de son film. VBT a fait de son film une bombe ; peut-être avait-elle besoin en effet que quelque chose éclate. La proposition de quitter la production adressée aux actrices est une fin de non recevoir et une défense absolue de l’élection de Bennacer envers et contre tout. La question morale ne porte pas sur le contenu ni sur le sujet de l’œuvre mais bel et bien sûr le choix de ses interprètes, sur la possibilité de prendre le temps de la réflexion après de telles révélations, et sur la capacité d’un·e réalisateur·rice d’offrir à son équipe un espace de création sécurisé à tous points de vue[2], pour des personnes dont le métier est de jouer avec émotions et sentiments puissants. Qu’est-ce qui autorise une personne, une femme, à faire fi du réel, à ne pas accueillir ces paroles, à ne pas considérer la difficulté de parler (pour une actrice, cela ressemble à un comble) – qui plus est de cet endroit si intime qu’est la sexualité ? À cet endroit très précis s’articulent à mon sens l’art et le féminisme, c’est-à-dire la capacité d’accueillir le présent, de se rendre sensible aux courants de fond d’une époque – le propre du geste artistique – et celle de faire place aux paroles des femmes – d’où part le féminisme. Refuser de faire place à ces voix, pour VBT, c’est se rendre sourde à son « être femme » victime d’une situation d’assujettissement structurelle[3], et dans le même mouvement s’identifier à la figure masculine de qui fait taire pour ne pas déroger au plan de travail (ainsi ce simili d’arrêt de la production pour proposer à qui le souhaite de partir). En prenant parti pour l’un contre les autres, se remettant à une production plutôt qu’à l’irruption du présent, la réalisatrice met en danger ses interprètes dorénavant au courant de ces accusations et crée entre eux·lles de l’inégalité, reproduisant l’ancienne hiérarchie de troupe calquée sur l’importance des rôles dans la fable. Je crois qu’il se joue dans cette affaire des questions très profondes, qui ont trait à la confiance que l’on a en son propre travail, en la logique marchande du cinéma – et certaines salles aujourd’hui ont déprogrammé le film. VBT a remis sa foi et presque son film en cet acteur. Elle en a fait une bombe ; peut-être avait-elle besoin en effet que quelque chose éclate. Peut-être que ce film, qui parle d’un très grand amour et d’une immense et indicible douleur, ne pouvait que faire éclater la polémique autour du respect de la parole des femmes victimes de violences. Peut-être que ce film, dans lequel VBT remet en scène cette période de sa vie dans une forme glorieuse (la beauté de l’actrice qui joue son rôle, lequel comporte une dimension sacrificielle comme l’a bien vu Mona Chollet dans son article) ne pouvait lui revenir que dans une forme de violence, laquelle est aussi celle du cinéma tel qu’il se pratique de manière majoritaire. Mettre en scène sa vie, travailler (avec) son histoire sont des gestes souvent féminins dans notre culture où les femmes, tenues aux marges des vies politiques et culturelles, ont été dévolues aux « intérieurs ». De là non seulement ont-elles pu porter un regard d’« étrangères » sur ces scènes, observer leurs fonctionnements particuliers, les contradictions entre les dits et les actes, mais elles ont sans doute aussi développé un « tropisme », pour le dire avec le mot d’une autre grande artiste de la langue, vers ce qui touche en effet à l’intériorité, donc à soi, et à la circulation particulière du pouvoir dans les corps. Désormais que nous avons, en tant que femmes, accès à la parole politique et aux écoles d’art, que faisons-nous ? Comment pouvons-nous agir en vertu de nos observations et de nos désirs pour ne pas répéter la douleur de la mise au ban ? Est-ce que VBT, en faisant la critique de la personne de Patrice Chéreau sans voir le schéma d’identification global dans lequel il s’insère, se libère, et libère la mémoire de ce « monstre sacré », pour reprendre à son compte l’expression de Jean Cocteau à l’endroit de Sarah Bernhardt ? Les arts du théâtre et du cinéma jouent de nos besoins de grandeur et d’aspiration à une autre vie que la nôtre. Ils nous proposent des visions du passé et du présent qui tantôt nous offrent des perspectives d’émancipation via la croyance en d’autres formes de vie et de relation possibles, tantôt nous condamnent en nous expliquant par le menu pourquoi le monde va comme il est. De grandes actrices comme Sarah Bernhardt en effet mais aussi Isadora Duncan, Yvette Guilbert, Colette à sa manière, Zouc ou encore Angélica Liddell nous offrent des perspectives émancipatrices dans la mesure où elles sont en colère précisément contre ce monde-là et qu’elles le font – plus ou moins et selon certaines périodes de leurs vies – depuis leur position de femme. Non nécessairement en tant que féministes affirmées comme le fut Isadora Duncan, mais en forgeant des alliances avec d’autres positions de minorité – les personnes frappées de maladie physique ou mentale, sans ressources, les animaux, etc. Ici l’affaire est d’autant plus complexe que Bennacer est issu d’un quartier pauvre de Marseille, et que son extraction sociale a sans doute servi d’alibi à Tedeschi pour le garder sur le tournage. Elle a échoué à articuler cette prise en compte avec celle qui la détermine en tant que femme dans une/son histoire. VBT a refusé d’écarter Bennacer en qui elle voyait sans doute un mort. Elle s’est accrochée à lui comme à une part morbide en elle-même qu’elle ne parvient pas tout à fait à lâcher… et qu’elle fait éprouver à ses interprètes au moment des répétitions en les blessant. Car au fond on dirait qu’en refusant de considérer la parole d’anciennes compagnes de celui qui est actuellement son compagnon, la réalisatrice non seulement met en œuvre ce qu’elle demande à vingt ans à un metteur en scène (« qu’il me casse[4] ») mais encore semble refuser de considérer la blessure que provoque un tel vœu. Blessure insue qui dès lors ne cesse de s’appliquer à d’autres, blessure narcissique qui s’incarne dans le motif de la honte, souvent soulevé, un vrai moteur de jeu chez elle, conscient et parfois complaisant. « Honte d’être riche », dit-elle dans le documentaire qui lui est consacré sur Arte, alors qu’elle cherche à dynamiser une scène entre deux jeunes acteurs en « fouillant » le sentiment de la honte chez celui qui n’est pas son amant. Et j’entends dans la bouche de celle qui ne cite comme références illustres que des hommes (jusqu’à Coluche, après la mort duquel le monde aurait « changé » et à qui il « manque ») la honte d’être du sexe deuxième, absent de son panthéon, qui sur la scène imaginaire de la capacité d’agir et d’être soi en toute intégrité, est en coulisses. Honte de sa puissance en tant que femme, honte de la peur qu’elle produit dans le regard des hommes, honte de sa richesse au sens de sa grande générosité d’être, transparente dans ses films ? De ces coulisses de l’histoire d’où les femmes historiquement voient le monde se trouve toutefois une jolie place pour qui souhaite tenir une caméra. De l’ombre portée des « grands hommes » sur les « petites femmes », des hontes sur elles projetées (avoir un corps ; n’en pas savoir jouir – VBT dit bien qu’on lui reprochait son rire), brûlent d’être incarnés des fantômes d’êtres et de pensées qui en leur temps n’ont pas su éclore. Floraison précoce que celle des amandiers qui voit le jour en plein hiver, à l’image de ces voix de femmes qui refusent de se laisser congeler par le froid, persévèrent et finalement fleurissent à travers le film auquel elles finissent par imposer leur clarté. Dans ses précédents films, VBT parlait plutôt de son présent. Elle le faisait avec talent, et j’ai toujours été émue par la manière dont elle se met en scène résistant aux autres, cherchant par tous les moyens, presque, à faire reconnaître sa sensibilité, sa particularité. Certes, la plupart du temps VBT n’est pas dans le déni, c’est ce qui fait sa beauté, et ce pourquoi en parlant d’elle aujourd’hui me viennent en mémoire le geste d’autres grandes actrices, réalisatrices, d’autres créatrices qui peuplent mon imaginaire de la scène. Porter le regard sur son passé n’est pas facile, surtout quand il s’agit pour une femme à l’aube de la cinquantaine d’affirmer sa puissance, à un moment où l’on est habitué à voir disparaître les créatrices. De ce film, de son histoire, je retiens l’importance d’entretenir une forme d’humilité et d’attention à son époque, le désir de se renouveler, de se laisser informer par le présent. Car si VBT fait confiance, dans une certaine mesure, comme le montre le documentaire, à de jeunes interprètes, elle ne semble pas être sensible au bruit du temps qui demande urgemment de changer les manières de représenter ce qui nous meut comme de faire place à d’autres liens, qu’un certain œil de l’histoire ne veut pas voir. Elle préfère juger l’époque et parfois pontifier sur un « retour de la morale », c’est-à-dire entretenir une confusion largement répandue entre notre besoin d’entendre d’autres voix, autant de points de vue et de manières de voir et vivre le monde, et les réactions à la violence de l’invisibilisation qui, démunies, ne parviennent qu’à souhaiter interdire toute manifestation qui reproduisent cette violence (et donc proroger le mécanisme d’invisibilisation par la censure). Il faut je crois se réjouir du progrès de la conscience de soi des jeunes interprètes qui ne veulent plus se laisser faire ni se laisser taire, et ouvrir, dé-couvrir les champs et les pans entiers de nos imaginaires tus et laissés dans la nuit parce qu’ils sont des gestes et des histoires de femmes. NDLR : Juliette Riedler a récemment publié 7 Femmes en scène, émancipations d’actrices aux éditions L’extrême contemporain.
ÉCRIVAINE, METTEUSE EN SCÈNE, DOCTORESSE EN ÉTUDES THÉÂTRALES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2022 5:49 PM
|
Propos recueillis par Eric Nunès dans Le Monde 3/12/22 « Le Monde » interroge une personnalité sur ses années d’études et son passage à l’âge adulte. Ce mois-ci, le metteur en scène Thomas Jolly, choisi pour orchestrer les cérémonies des Jeux olympiques de Paris en 2024, et dont l’adaptation de « Starmania » rencontre un grand succès, revient sur ses années de formation.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/03/thomas-jolly-metteur-en-scene-le-harcelement-au-college-n-a-fait-que-renforcer-celui-que-j-avais-envie-d-etre_6152775_4401467.html
« Généralement je m’ennuie après une minute trente », avertit Thomas Jolly lorsqu’on le rencontre dans le café qui borde La Seine musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), quelques heures avant une nouvelle représentation de la comédie musicale Starmania qu’il a montée. Le metteur en scène hyperactif, âgé de 40 ans, prend néanmoins de son temps pour raconter son cheminement, depuis son enfance normande jusqu’à ses succès en cascade. Un parcours mené avec une énergie qu’il n’économise pas : après l’adaptation de Starmania, il prépare un Roméo et Juliette pour le Palais Garnier et sera le maître des cérémonies des Jeux olympique (JO) de Paris en 2024. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés JO Paris 2024 : pour Thomas Jolly, « on ne peut pas opposer sport et culture » Quel a été votre premier rendez-vous avec la scène ? D’aussi loin que je m’en souvienne, la première rencontre a lieu alors que je n’ai que 4 ou 5 ans. Cela se passe dans ma chambre d’enfant : j’ai pris dans la discothèque de mes parents une cassette audio, La Force du destin de Verdi. Ce n’est pas un ballet, mais je m’improvise chorégraphe, je fais des grands gestes avec les bras, je donne des indications à des danseurs imaginaires. C’est mon premier souvenir de scène, lié sans doute à ma pratique de la danse classique, qui n’a duré qu’un temps. Le théâtre est apparu un peu plus tard. Votre passion est-elle née dans l’enfance ? J’ai grandi à La Rue-Saint-Pierre, un tout petit village de Seine-Maritime situé entre Rouen et Dieppe : il y avait une école, une église, mais pas de magasin. Mes parents n’allaient pas à l’opéra, nous n’allions pas au théâtre, juste au cinéma une ou deux fois par an. Mais je me rappelle avoir vu un documentaire sur le Palais Garnier : j’ai 6 ans, cela fait deux ans que je fais de la danse dans la salle des fêtes du village. Je lève la tête et je dis à ma prof que je pars. Je lui explique que ce que nous faisons n’est pas assez beau, que l’endroit est moche. Moi, je voulais des tutus chatoyants, des dorures, un décorum fastueux, je voulais déjà monter Le Lac des cygnes, même si, à cette époque, je ne le connaissais pas ! Vos parents vous ont-ils encouragé ? Mes parents ont été géniaux car ils m’ont toujours laissé faire ce que je voulais : danse classique, piano, puis théâtre. Cela coûtait pourtant 700 francs (110 euros) par trimestre, une somme pour eux. La seule chose qu’ils me demandaient, c’était la réussite scolaire. Y a-t-il une influence familiale dans votre goût pour la scène ? Peut-être, mais je l’ai découverte plus tard. En 2005, alors que je suis élève à l’école du Théâtre national de Bretagne à Rennes, le directeur, Stanislas Nordey, m’accorde une carte blanche, c’est-à-dire la possibilité de monter mon propre spectacle. Je propose un projet autour du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Pour le long monologue d’un personnage féminin, à la fin de la pièce, Nordey me suggère de choisir quelqu’un qui a du sens pour moi et je pense à ma grand-mère. Je lui propose, elle accepte et j’apprends qu’elle a toujours rêvé d’être actrice et qu’elle ne l’a jamais fait. Lire aussi Thomas Jolly, metteur en scène : « Quand ma grand-mère est entrée pour la première fois sur le plateau, j’ai pleuré à torrents » Est-ce qu’il y a quelque chose qui a sauté une génération ? Je ne sais pas ! Mais il y a un truc quand même, car depuis que c’est mon métier, ma mère s’est mise au théâtre, mon oncle également. Il y a une filiation… à l’envers. Comment êtes-vous passé de la danse classique au théâtre ? Enfant, ma mère m’a offert un livre de Pierre Gripari, Sept farces pour écoliers, que j’ai monté dans ma chambre, où je préparais des spectacles pour mes parents. Je jouais et surtout je mettais en scène. Dès le début de ma vie, j’ai voulu organiser le monde autour de moi, je voulais diriger. A l’école, étiez-vous un bon élève ? Le primaire passe vite et bien dans ma petite école municipale. Je saute même la classe de CE1. Ensuite arrive le collège. L’établissement, la période… tout est atroce, sordide. Entre nous, les ados, on est des chiens. Je me prends de plein fouet les regards sur moi, sur ma féminité, sur mes goûts et je ne comprends pas. Ma mère m’a raconté cette anecdote que je trouve mignonne et en même temps d’une tristesse folle : un soir de l’année de 6e, je rentre et raconte que je me suis fait traiter de « pédale » dans la cour. Je ne comprends pas : quelle est cette blague en lien avec un vélo ? Je demande à ma mère. Et discrètement, elle part pleurer. Vous avez été un élève harcelé ? Clairement. Mais j’ai nourri, durant ces années, non pas une rancœur, mais une force. Je me suis dit : je suis comme ça et c’est tout. Je ne vais pas changer, au contraire. Je me souviens aussi avoir été fan des chaussures Dr Martens, et j’en voulais des jaunes ! J’ai eu une paire pour mon anniversaire et les porte en classe. Dans un collège de campagne au début des années 1990, c’est une déflagration. Tout le monde ne parle que de ça. J’ai été harcelé, poussé dans les couloirs, enfermé dans les chiottes par les grands, désapé par ces types qui veulent savoir si je suis un garçon ou une fille. Je suis brutalisé mais cela ne fait que renforcer celui que j’ai envie d’être. Je développe de nouvelles compétences, par le théâtre notamment, qui est un espace de liberté et d’expression, mais aussi un exutoire. Où jouez-vous alors ? J’intègre à 11 ans, en 1993, la compagnie Théâtre d’Enfants dans la banlieue rouennaise. Je suis le seul rural du groupe, je joue avec les gosses de riches de l’agglomération, et je me sens plus proche d’eux que de ceux de mon collège. En fin de 3e, j’intègre le lycée Jeanne-d’Arc de Rouen qui change ma vie : je suis avec une autre jeunesse, plus ouverte, en lien avec des activités culturelles. Enfin, en classe de 1re, je suis admis au sein de la classe théâtre du lycée : je suis alors dans mon monde. Je vais au théâtre chaque semaine voir des spectacles, dont ceux de Stanislas Nordey, qui aura un rôle plus tard dans ma carrière. Je bosse avec des acteurs professionnels, je fais chaque semaine plus de dix heures de théâtre. J’obtiens mon baccalauréat de justesse grâce à une moyenne de 19 sur 20 en théâtre, en théorie et en pratique. Ensuite, je choisis logiquement de faire une licence arts du spectacle à l’université de Caen. La faculté me laisse beaucoup de temps, je rencontre plein de gens, on monte des compagnies, des spectacles. Nous avons même les clefs de la Maison de l’étudiant qui dispose d’un petit théâtre, et après la licence, je suis admis au sein de l’école du Théâtre national de Bretagne [TNB], à Rennes, dirigé par Nordey. Vous gardez de bons souvenirs de votre passage à l’école du TNB de Rennes ? La première année, en 2003, c’est le bonheur absolu, je navigue de stage en stage, je suis certain d’être à ma place. Puis, au début de la deuxième année, je traverse une forme de crise, je pense alors qu’être acteur ce n’est pas simplement être un bon technicien, mais qu’il faut vivre, ressentir. A la fin de la troisième et dernière année, l’école prépare un spectacle de sortie. Il y a dans la pièce un personnage nommé Minus. Comme son nom l’indique, il est minuscule, il a trois lignes de texte. C’est moi qui en hérite. Je ne le vis pas bien du tout. A la dernière heure du dernier jour de la dernière année, Nordey dresse le bilan de ce que nous avons accompli. Il me lance : « Thomas, cela fait trois ans que tu es là, je ne sais toujours pas qui tu es. » Quelle a été votre réaction ? Je décide de faire mon théâtre et d’écrire mon histoire. Mais je me retrouve sans boulot. Puisque mon téléphone ne sonne pas, je décide de monter ma compagnie. Je réunis des gens que j’estime amicalement et artistiquement, des anciens de l’université de Caen ou du TNB, avec lesquels je monte, en 2006, Arlequin poli par l’amour, de Marivaux. Lire le portrait : Article réservé à nos abonnés Avignon : Thomas Jolly, une certaine idée du théâtre populaire Nous nous installons dans des locaux désaffectés à Gaillon [Eure] et le théâtre de Cherbourg [Manche] nous programme : la compagnie La Piccola Familia est née. C’est mon premier spectacle. Seize ans après, il se joue toujours – il est actuellement à Mulhouse [Haut-Rhin], jusqu’au 30 décembre. C’est une aventure unique que j’ai lancée à 24 ans. Ce spectacle lance votre carrière. Suivront « Henry VI », « Thyeste »… Des créations où vous mélangez les genres et les références. Comment s’est construit votre paysage culturel ? J’ai grandi avec la discothèque de mes parents. J’y ai trouvé Verdi, mais aussi Boney M, Les Innocents et Francis Cabrel. Adolescent, je regarde M6, des clips, des émissions musicales. Cela forge une culture musicale éclectique. Et puis il y a le jeu vidéo, la télévision… J’utilise cette culture pop parce que c’est la mienne. Vous présentez aujourd’hui un nouveau « Starmania », qui met en scène des jeunes gens en rébellion. Y a-t-il, dans cet opéra-rock, des résonances avec vos 20 ans ? J’ai retiré tout l’aspect futuriste un peu cheap de l’œuvre pour me concentrer sur la matière noire et l’énergie du désespoir. Tous les personnages ont le mal de vivre, sont dans une quête de sens de leur existence. Ils ne savent pas comment se réaliser dans un monde qui ne leur ressemble pas. Cela passe par la violence, l’image qu’on veut avoir de soi, la volonté d’accéder à la notoriété par le mensonge, la brutalité, le sexe. Starmania est une œuvre sur la dépression. C’est cette force sombre qui fait le succès de Starmania depuis quarante ans. 20 ans a-t-il été pour vous le plus bel âge ? Le plus bel âge est celui qui arrive. Je ne l’ai pas encore. Eric Nunès Légende photo : Le metteur en scène Thomas Jolly, à Paris, le 3 novembre 2022. JOEL SAGET / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 2, 2022 10:20 AM
|
Chronique de Michel Guerrin parue dans Le Monde - 2 décembre 2022 Dans sa chronique, Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde », souligne les mises en abyme saisissantes entre le film de Valeria Bruni Tedeschi, qui montre une bande de jeunes apprenant le métier de comédien dans les années 1980, et la réalité, entre les époques, entre les acteurs et leur double à l’écran.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/02/les-amandiers-et-l-affaire-sofiane-bennacer-une-incroyable-mise-en-abyme-entre-le-film-et-la-realite_6152690_3232.html
Il est difficile d’aller voir Les Amandiers sans penser à l’affaire qui, depuis quelques jours, met le film dans la tourmente. A son acteur principal, Sofiane Bennacer, accusé de viols et de violences par d’anciennes compagnes. A la cinéaste Valeria Bruni Tedeschi, qui le soutient. Aux autres comédiens, plutôt discrets en ce moment. Aux producteurs niant avoir couvert ce que certains nomment un « scandale ». A toutes celles qui dénoncent le jeune comédien. Chacun sa vérité. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés L’affaire Sofiane Bennacer embarrasse le cinéma français Les Amandiers montre une bande de jeunes, dans les années 1980, apprenant le métier de comédien – la vie aussi – dans une école adossée au mythique Théâtre des Amandiers, à Nanterre, dirigé par le non moins mythique Patrice Chéreau. Constatons l’incroyable mise en abyme qui se joue dans ce drame. Entre le film et la réalité. Entre les époques, entre les acteurs et leur double à l’écran. Dans la vraie vie, Sofiane Bennacer, 25 ans, est accusé d’avoir commis des viols en 2018 et 2019, alors qu’il étudiait le théâtre à Mulhouse (Haut-Rhin) et à Strasbourg. Dans le film, il joue un des jeunes des Amandiers, mais au profil d’outsider : il parle avec un fort accent de banlieue, vit un peu en marge, se drogue, est violent et jaloux, s’emporte vite. Son amoureuse, également aux Amandiers, est alertée par ses copines – il est dangereux. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Les Amandiers », de Bruni Tedeschi : à l’école de Patrice Chéreau, un espace de rêve avant-gardiste Après la révélation de sa mise en examen pour viol, par Le Parisien, le 23 novembre, Sofiane Bennacer, originaire d’une famille ouvrière de Marseille, a publié un communiqué sur Instagram dans lequel, tout en clamant son innocence, il pousse la carte de l’exclu qui n’a pas les clés de la notabilité. « On m’a bien fait comprendre que ma place n’était pas dans ce milieu. » Il aurait même reçu des messages racistes, écrit-il. Un symbole d’échec Dans un monde culturel qui éprouve les pires difficultés à impliquer les classes populaires – sur scène et dans le public –, où les écoles d’art cherchent la diversité, cette affaire sonne comme un symbole d’échec. Quelles que soient les suites judiciaires, Sofiane Bennacer est déjà condamné socialement et il est probable qu’on ne le verra pas de sitôt à l’écran. Alors que son nom a été retiré des Césars 2023, Libération a clos le débat, le 26 novembre, en illustrant sa « une » accompagnant une enquête décisive, fouillée et contradictoire, sur le « cas Bennacer » d’une photo de l’acteur arborant des yeux exorbités et des doigts ensanglantés de prédateur. Autre mise en abyme, Les Amandiers est un film qui célèbre le théâtre, mais c’est dans le théâtre qu’on s’en est pris au film. Des voix dans la mouvance du collectif #metoothéâtre ont dénoncé un tournage où « l’on savait ». Le paradoxe est que les producteurs des Amandiers, sans doute meurtris mais sûrs de leur bonne foi, incarnent le cinéma d’auteur français, avec en prime une réputation d’humanisme et d’éthique. Et sans doute, dans un cinéma français déjà peu en forme, la plaie mettra du temps à se refermer. Le cas le plus stupéfiant est celui de Valeria Bruni Tedeschi. Pourquoi n’a-t-elle pas voulu changer d’acteur quand elle a su qu’il y avait des plaintes pour viol ? Sofiane Bennacer est son compagnon, sauf que leur relation a commencé quand le film était fini. Et si elle le défend mordicus, le fait qu’elle invoque la présomption d’innocence n’explique pas tout. Il faut voir Les Amandiers pour comprendre : Sofiane Bennacer y est excellent. Différent. Il a un côté James Dean avec la tête baissée et les yeux relevés. La cinéaste jure qu’elle ne pouvait pas faire le film avec un autre, et on la comprend. Jusqu’où le choix esthétique de l’artiste doit primer, à chacun de trancher. Une position « vertigineuse » Revenons à la mise en abyme. Et cette fois il faut regarder le documentaire Des Amandiers aux Amandiers, sur Arte.tv, chronique du tournage, à la fois hagiographique et passionnante. Valeria Bruni Tedeschi y reconnaît que sa position est « vertigineuse ». Etudiante aux Amandiers en 1986, elle renaît dans le film à travers les traits de l’actrice Nadia Tereszkiewicz. Et revit sur pellicule l’histoire d’amour qu’elle a eue avec un autre étudiant, Thierry Ravel, mort d’une overdose en 1991 à l’âge de 28 ans. Qui est incarné par Sofiane Bennacer. Valeria Bruni Tedeschi a donc vu mourir son amour de jeunesse et voit aujourd’hui la mort sociale de son compagnon. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Cannes 2022 : Valeria Bruni Tedeschi et les années Amandiers, époque bénie du théâtre Ce n’est pas pour la plaindre, c’est juste un constat. Qui va plus loin. Dans son film, la cinéaste dessine un Patrice Chéreau (joué par Louis Garrel, son ancien compagnon) en gourou qui embrasse de force un étudiant et humilie une étudiante. Valeria Bruni Tedeschi ne dénonce pas Chéreau, elle fait la même chose durant le tournage de son film, tient les acteurs sous emprise, les martyrise gentiment, les fait parler de choses intimes. « Cette génération est beaucoup plus précautionneuse que la mienne, et vraiment ça m’a fait plaisir de les malmener », remarque-t-elle. Suivant un mécanisme bien repéré, elle fait subir ce qu’elle a subi. « Je voulais être cassée », confie à un moment l’actrice-cinéaste. Entendez : être poussée dans mes retranchements. Elle est persuadée que c’est la seule façon de faire un bon film et de dégager une parole juste. Voilà pourquoi elle écrit que le travail devant la caméra avec Sofiane Bennacer la rend « tout à fait confiante sur ses qualités humaines : lorsque l’on filme quelqu’un, on “voit” qui l’on a en face de soi. » On n’est pas obligé de la suivre. En fait, Valeria Bruni Tedeschi, 58 ans, rend hommage avec ses Amandiers aux années 1980, qu’elle voudrait ininterrompues, revivre, tant elle a adoré la liberté phénoménale et les conventions malmenées. C’est une époque où la notion d’emprise, on n’en parle même pas, où il semblait inconcevable qu’un viol soit commis au sein du couple. « Par rapport à un personnage violent avec une femme, je voudrais ne pas être politiquement correcte », dit-elle dans le film. Elle est sincère. Michel Guerrin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 2, 2022 8:17 AM
|
Par Philippe Person dans Froggy's Delight - 27 nov. 2022 Comédie dramatique écrite et mise en scène par Philippe Minyana, avec Luce Mouchel, Sarah Biasini, Nicolas Ducloux, Florent Baffi, Jérôme Billy, Balthazar Gouzou et Emma Santini. Au milieu de la scène, un large rond vert sur le sol. Quelques secondes après son apparition, un joggeur commence à en faire le tour. Il accélère et, au deuxième tour, se vautre : le public ne retient plus ses rires. Et ne va plus jamais les retenir, car, tout va s'enchaîner dans un climat serein avec un quatuor d'adultes dont on va suivre la vie jusqu'à leur vieillesse et aux portes de leur mort. Fort d'une œuvre commencée dans les années 1990, Philippe Minyana est au sommet de son art. Il n'aura jamais besoin de se forcer pour raconter plus de cinquante années de vie de ses personnages. Comme jadis le faisait au cinéma la comédie italienne, il va multiplier les saynètes drôles et émouvantes, les alterner, leur donner sens ou les saisir dans leur absurdité. On va apprendre à connaître Gino (Florent Baffi), le garde-chasse, et son épouse Edith (Sarah Biasini), Carlos (Jérôme Billy) et sa sœur (Luce Mouchel), à les suivre dans leurs conversations. On les écoutera se confesser, avouer leurs inhibitions. Dans de courtes scènes, toujours réussies, et pouvant frôler le réalisme ou, au contraire, flirter avec l'absurde, ils dévoilent ce qu'ont été leurs vies. Des vies qui, à l'égale de toute les existences humaines, contiennent autant de banalité que de fantaisie. Tout dans cette merveilleuse construction renvoie au théâtre. Le savoir-faire de Philippe Minyana, à la fois metteur en scène et auteur, ne souffre aucune exception : on défiera quiconque de trouver une scène inutile, voire une scène faible. A ses débuts, en 1990, Minyana travaillait avec le compositeur Georges Aperghis. Cela donnait "Jojo". Aujourd'hui, il travaille avec Nicolas Ducloux et, sans être officiellement une comédie musicale, "Nuit" appartient à un genre hybride où chaque personnage peut, à tout moment, élever la voix. Face à Sarah Biasini et Luce Mouchel, comédiennes accomplies qui peuvent chanter, ou plutôt chantonner comme dans les films de Jacques Demy, leurs partenaires, eux, sont de vrais chanteurs d'opéra, aux voix qui portent et qui accentuent, par moments, l'étrangeté de ces deux couples singuliers. "Nuit" pourrait être l'aboutissement d'une brillante carrière artistique. On suppose que Philippe Minyana n'en restera pourtant pas là. Tant mieux. Il a mis la barre très haut et pour l'heure, on se permettra d'écrire que "Nuit" est son chef d'œuvre. Philippe Person

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 30, 2022 7:29 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - 27 nov. 2022 C’est en fond de cale d’une péniche amarrée sur le canal de l’Ourcq à Paris qu’Yves-Noël Genod enterre sa vie artistique débutée avec Claude Régy et achevée à la Pop. Prononçant lui-même une oraison funèbre qui emprunte autant à Marguerite Duras qu’à Sylvie Vartan, il fait de « TITANIC, hélas » un vibrant hommage à la scène, beau et triste à la fois, drôle et mélancolique, à son image. Drôle d’endroit pour un adieu. Une fois passé la porte de la péniche la Pop[1] amarrée sur le bassin de la Villette, le spectateur entre de plain-pied dans la salle de spectacle. À l’intérieur, Yves-Noël Genod joue les hôtes de maison, embrasse les amis, salut les inconnus, offre çà et là une coupe de champagne. Le spectacle va bientôt commencer, ou plutôt la mise en bière. Quoi de mieux qu’un fond de cale pour un enterrement ? En l’occurrence celui de la carrière artistique de l’une des figures les plus singulières de la scène française. La sonnerie d’un téléphone portable retentit, laissant entendre une mélodie dont seuls les plus de cinquante ans se souviennent, la chanson d’un amour qui s’achève interprétée en 1976 par une Américaine à Paris. Le jeune homme au téléphone murmure tout d’abord puis se lève pour mieux entonner la rupture, en ressentir la douleur, espérer la dernière étreinte : « Faisons l’amour avant de nous dire adieu ». Derrière lui, une femme âgée, déjà au seuil de sa vie, enfile une robe rouge sang qu’elle assortit de talons aiguilles de même couleur. Une apparition, un fantôme, l’incarnation de la vie dans ce qu’elle a de plus précaire : la brièveté des corps, et de plus beau : la fragilité. La beauté contemporaine est immuablement éphémère. Le prologue s’achève alors que ce couple improbable, sorte d’Harold et Maud du bassin de la Villette incarnant deux temps fondamentaux de la vie, la promesse et le souvenir, deux âges de l’être humain, quitte une scène accidentée par de petites saillies formant tranchées, des trappes qui, si elles ne sont pas laissées béantes sont néanmoins entrouvertes de façon à créer un parcours en relief, comme semé d’embuches, à la surface de ce fond de cale, telle une ligne de vie scarifiée par les affres qu’elle a traversée. « Avant de nous dire adieu » Assis parmi les spectateurs, Yves-Noël Genod esquisse un signe de croix, geste assurément culturel qui n’en est pas moins religieux pour autant, avant d’entamer la longue litanie des raisons qui le conduisent à mettre un terme à sa carrière. S’il se dit en pleine forme, il n’a « depuis quelque temps, plus assez de commandes et surtout pas assez de public pour continuer[2] ». Le temps est venu de la reconversion. « Après tout, j’avais formé des gens, j’avais eu — moi aussi — mon petit conservatoire de Mireille — où pas mal de monde était passé… » rappelle-t-il en introduction. Genod joue sur la figure archétypale du dépassement de l’artiste par de plus jeunes, avouant : « Je suis une grande actrice. Mais un peu d’une autre époque ». Comme toujours chez l’artiste, l’humour se mélange à la poésie et aux sanglots longs. Chacune de ses performances théâtrales est un manifeste. « TITANIC, hélas » n’échappe pas à la règle, interrogeant ici la signification de la création artistique dans un monde au bord du naufrage, un monde où les salles de spectacles ne font plus recette. Faire ses adieux à la scène sur la Seine (ou presque), il fallait oser. À la fois metteur en scène, chorégraphe, comédien, performeur et auteur sans doute le plus prolifique des arts vivants en France – il a plus d’une centaine de spectacles à son actif –, Yves-Noël Genod se forme à l’école d’Antoine Vitez à Chaillot et fut d’abord interprète de Claude Régy pour qui écrire était à la fois « parler et se taire[3] » – le maître aimait à travailler sur les contrastes –, et demandait « aux interprètes d’être au niveau, d’à la fois parler et s’taire, à la fois vivants et morts », et de François Tanguy au Théâtre du Radeau. La pratique du Contact improvisation[4](CI) le fait doucement dévier vers la danse. En juin 2003 lors du festival Let’s Dance au Lieu Unique à Nantes, répondant à l’invitation du chorégraphe Loïc Touzé, il signe son premier spectacle. Simplement intitulé « En attendant Genod », il prend pour modèle le Stand-Up anglo-saxon. Le succès de ce premier spectacle en appelle d’autres. Depuis cette date, il met en scène tous ses spectacles dont les formes hybrides dénotent une certaine résistance aux catégories. Yves-Noël Genod déborde des cases. « J’ai abusé du temps, et à présent le temps abuse de moi » La performance repose sur le texte, lui-même construit par collage de citations plus ou moins célèbres, plus ou moins déformées, évoquant le théâtre, la scène. « Ce spectacle est un jeu de ‘samples’ souvent non référencés » écrit Yves-Noël Genod dans la feuille de salle. Il cite ainsi pêlemêle Vladimir Jankélévitch et Barbara, Emmanuele Coccia et Stéphane Mallarmé, Marcel Proust et Florence Foresti, reprend la fascinante prédiction de fin du monde que Marguerite Duras nous adresse depuis 1986 : « Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur[5] ». Duras avait raison : « Le capitalisme a fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne[6] ». Il prend soin cependant de rappeler que dans la fin du monde il y a aussi la fin de soi, et que si ce thème a été et est si populaire, c’est parce qu’il représente un pas supplémentaire vers notre propre mort. « Dieu merci, notre art ne dure pas » se rassure-t-il, empruntant la formule à Peter Brook. Il est plus proche cependant de la pensée de Madeleine Renaud pour qui le théâtre est du côté de la vie, pas de la mort. Il assume sa mélancolie, affirmant que « la mélancolie, c’est le bonheur d’être triste », mais peine à raconter des blagues belges, avouant lui-même son incapacité à en imiter l’accent. Côté avenir, il annonce, sans même y croire, sa reconversion dans le commerce de bouche, formulant le souhait d’ouvrir une boucherie dans les Cévennes, hésitant encore à la spécialiser : bio ou chevaline. « Sylvie Guillem, il paraît qu’elle élève des ânes. Ça, ça me plairait… » dit-il rêveur. Il s’adresse au public venu ce soir-là en nombre : « Pendant des années, vous m’avez permis de vivre ». Si le désir est intact, les commanditaires sont de moins en moins présents. Peut-être redeviendra-t-il interprète comme avant. Lui qui a été « conçu pour enchanter les foules trois cent soixante-cinq jours par an » préfère se retirer. « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ! » Qu’on se rassure, chaque spectacle d’Yves-Noël Genod est unique et, par conséquent, le dernier, et les prochains n’échapperont pas à ce protocole sans protocole. Soyons sûrs que l’artiste fera ses adieux pendant bien des années encore. C’est bien là tout le mal qu’on lui souhaite. « Le passé ne m’intéresse pas, ne m’intéresse que le présent et un tout petit peu l’avenir ». dit-il, faisant siennes, à nouveau, des paroles de Madeleine Renaud. C’est bien à cet endroit que se situe la grâce, dans l’instant T, le moment présent, ce qui est en train de se faire et qui n’est déjà plus. Telle une épiphanie, « être déplacé par l’autre ». Yves-Noël Genod avait promis du rire et des larmes. La réapparition des fantômes qui avaient ouverts le bal des adieux annonce déjà la fin du spectacle. Que la fête commence. [1] Incubateur artistique et citoyen installé sur une péniche du bassin de la Villette, la Pop ouvre au public en 2016. Structure de production, lieu de résidence, de recherche et d’expérimentation, espace de création multidisciplinaires, elle interroge les rôles et fonctions que jouent la musique et les sons pour l’individu, les communautés, la société ou les écosystèmes. [2] Le texte TITANIC, hélas est disponible à la lecture dans son intégralité sur blog de l’artiste Le Dispariteur, http://ledispariteur.blogspot.com/2022/11/t-exte-de-titanic-helas.html?m=1 Consulté le 27 novembre 2022. [3] « Le maître soumet son auditoire à l'écoute, à la patience. Ponctuant de ses commentaires chaque fragment du poème de Vessas lu par les stagiaires, il instille, entre autres principes, que « le sens apparent n'est pas intéressant », que « seul compte le non-exprimé, le poétique », qu’« il faut faire entendre la multiplicité, les sens contraires ». Bref, qu’il ne faut pas lire, mais rêver en lisant et remplacer la passivité par l'activité » ou, en d'autres termes, « qu'il faut lire et écouter en même temps ». Dans ce contexte, se taire ou parler constitue un travail identique pour l'acteur : c'est ici la première leçon », Virginie Lachaise, « Claude Régy : une leçon de maître », Jeu, n°129, 2008, pp. 72–76. [4] Champ de recherche par le mouvement initié par le chorégraphe et danseur américain Steve Paxon à partir de 1972 qui en donne la définition suivante : « Ce n’était pas de la lutte, une forme d’étreinte, du sexe, de la danse sociale, pourtant c’était en partie un peu de tout cela. Il fallait trouver un nom (…). Contact Improvisation… ? », Steve Paxton, Nouvelles de danse N°38-39, 1999, p.113. [5] Marguerite Duras. « Tchernobyl, une mort géniale. Entretien avec Gilles Costaz », Le Matin, 4 juin 1986. [6] Ibid. TITANIC, hélas - Conception Yves-Noël Genod. Interprétation Aymen Bouchou, Mariella Mounnie et Yves-Noël Genod. Son Benoît Pelé. Scénographie et lumière Philippe Gladieu. Production Le Dispariteur. Coproduction La Pop Du 25 au 27 novembre 2022. La Pop
Face au 61, quai de la Seine, Bassin de la Villette
75 019 Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2022 9:45 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 29 nov. 2022 Crédit photo : Ph. Lebruman
Playlist Politique d’Emilie Rousset, conception, écriture et mise en scène Emilie Rousset. En co-réalisation avec le Festival d’Automne à Paris. Interprétation Anne Steffens, Manuel Vallade, création vidéo Gabrielle Stemmer, dramaturgie Simon Hatab, collaboration à l’écriture Sarah Maeght, lumières Manon Lauriol, régie générale Jérémie Sananes. Metteuse en scène de la compagnie John Corporation, Emilie Rousset explore divers modes d’écriture théâtrale et performative. Utilisant l’archive et l’enquête documentaire, elle crée pièces, installations, films. Collectant des mondes, des idées, déplaçant les mouvements de pensée observés, elle ré-invente des dispositifs où les acteurs ré-incarnent ces paroles déjà dites. L’exploration scénique pourrait sembler abstraite, conceptuelle et peu vivante. N’empêche, à côté de l’écran et devant cet accessoire léger, mais tellement lourd de ses possibilités infinies d’archivage, de recherche, de classement, de connaissances éclairées et aiguës – technicité banale d’un paysage quotidien investissant à son tour le plateau -, les acteurs Anne Steffens et Manuel Vallade assurent le show, s’employant au reenactment dont sont friands les spectateurs, soit les coulisses de la création via le bureau d’ordinateur projeté, construisant le spectacle à vue. Et l’inspiration est ici musicale qui s’attache aux hymnes accompagnant l’Histoire, entre le plaisir de l’oubli de soi à travers l’enthousiasme collectif et le pouvoir de faire consentir l’auditeur à l’autorité. Mémoire collective et imaginaire, la part belle est donnée à l’Ode à la joie extraite de la Neuvième Symphonie de Beethoven – hymne européen dont sont révélés les paradoxes divers. Non seulement Beethoven se rêvait révolutionnaire, mais il se voulait compositeur d’Etat. Et l’arrangement final confié à Karajan, malgré sa compromission avec les nazis, un Hymne à la joie raccourci, sans les mots retirés de Schiller, en dit long sur l’incohérence politique et artistique, en n’oubliant pas le goût de l’argent de l’adaptateur et de ses héritiers. La Neuvième symphonie contiendrait selon l’historien et musicologue Esteban Buch un « désir d’Etat », la partition est habitée par une esthétique du héros militaire. Il n’en fallait pas plus pour voir le Président Macron traverser la cour du Louvre – enfin, son double, l’acteur Manuel Vallade, jouant l’Histoire, oreillette ou pas, bras levés au tempo -, reprise de cette longue marche chorégraphiée sur l’Ode à la joie, le soir de son élection en 2017 dans la cour du Palais du Louvre. Le chant collectif envolé : l’orchestre et le chœur font place à un DJ, l’image se veut festive et pop. Le spectacle reviendra à l’Ode à la joie pour l’intronisation de Mitterrand au Panthéon, le 10 mai 1981, une histoire de roses rouges à distribuer, l’Homme d’Etat, une éternelle rose à la main, bien qu’il en ait distribué une sur la tombe de Jean Moulin, une sur celle de Jean Jaurès, une autre… Des ombres furtives, cachées derrière les piliers de l’intérieur sombre du Panthéon, lui sont venues en aide. L’architecte et scénographe Christian Dupavillon raconte le « dérèglement » minuté de la cérémonie, l’hymne joué par les Chœurs et l’Orchestre de Paris, sous la baguette de Daniel Barenboïm qui la laissa tomber, agacé par le vrombissement des voitures présidentielles. L’hymne est analysé comme un outil de propagande, pour aider à l’adhésion et au sentiment d’appartenance. Mais foin de l’Hymne à la joie et de la Neuvième Symphonie, les commentateurs et interprètes évoquent dans cette Playlist Politique, la cérémonie d’adieux d’Angela Merkel au son du morceau Du hast den Farbfilm vergessen ( Tu as oublié la pellicule couleur ) de la chanteuse punk Nina Hagen, une référence à la jeunesse de l’ex-chancelière en Allemagne de l’Est, morceau étrangement accompagné par l’orchestre militaire des armées, et maudit pour d’autres raisons. Le spectacle s’achève par ce que l’auteure nomme une « ré-appropriation de plaisir collectif du chant ». Aussi une chorale amateur est-elle invitée, la Queerale : les choristes chantent alors Pastime Paradise (1976) de Stevie Wonder, arrangement de la cheffe de choeur, Sylvère Santin. Humour, légèreté, décalage, moquerie, mime et satire des commentateurs – radio, télé, presse écrite -, qui se sentent investis de cet honneur de se confronter aux dits « spécialistes », de les interroger ou d’être questionnés à leur tour – aura intellectuelle et morale de ce qui est « sérieux ». Avec de facétieux interprètes, Manuel Vallade et ses postures loufoques de méditation circonstanciée et silencieuse, et Anne Steffens, décidée, convaincante, enjouée et solaire. Véronique Hotte Du 25 novembre au 7 décembre 2023, 19h, relâches dimanche et lundi 5 décembre, au Théâtre de la Bastille en co-réalisation avec Le Festival d’Automne à Paris, 76 rue de la Roquette 75011 – Paris. Tél : 01 43 57 42 14 www.theatre-bastille.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 5:12 PM
|
Propos recueillis par Eve Beauvallet dans Libération 28/11/2022 A l’affiche du solaire «Annie Colère», où une femme se redécouvre au sein d’un groupe engagé pour la légalisation de l’IVG, l’actrice férue de rôles troubles insiste sur l’importance du collectif et de la transmission des savoirs. C’est un film sur l’avortement mais c’est surtout l’histoire d’une naissance. En 1974, alors que des centaines de femmes meurent chaque année des suites d’un avortement clandestin, Annie (Laure Calamy), ouvrière, mariée, deux enfants, à distance de tout engagement politique, tombe enceinte accidentellement. Terrifiée, elle se rend dans l’antenne locale du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (Mlac), une association regroupant médecins, paramédicaux, bénévoles, tous engagés pour la légalisation de l’IVG, où on la rassure : Annie ne connaît-elle pas la méthode de Karman, un avortement par aspiration ? C’est indolore, gratuit, très simple à appliquer et à enseigner. Quelques jours plus tard, sur un lit de fortune installé chez une bénévole, et pendant qu’un gynécologue aspire l’œuf, Annie accouche symboliquement d’un autre soi. C’est grâce à cette voix féminine qui chante pour elle pendant la durée de l’opération, comme pour endormir un enfant, aux yeux attentionnés de cette bénévole qui pénètrent dans les siens pour la calmer, à la pédagogie dont font preuve les militantes et militants du Mlac pour expliquer à une femme comment fonctionne son corps. «C’est tout ? C’est déjà fini ?» Ce qu’Annie découvre là-bas d’écoute, de solidarité et d’engagement la lance dans un processus de métamorphose, déployé sur les deux heures du beau film solaire de Blandine Lenoir, sorti quelques jours à peine après le vote, à l’Assemblée nationale, sur l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution. Voici donc un roman d’apprentissage qui s’illumine des multiples contre-pieds pris d’avec les attendus du film militant traditionnel : les trajectoires ne sont pas nécessairement traumatiques, le mari d’Annie n’est pas un macho, les scènes d’avortement ne sont pas filmées comme un arrachement glauque mais comme une simple libération. Elles sont même nimbées d’une lumière. Celle de découvrir, pour Annie, la puissance mobilisatrice du groupe, d’acquérir une somme de savoir-faire à transmettre aux générations futures, celle de «s’autoriser à penser», résume devant nous Laure Calamy, flamboyante en ingénue émerveillée par la connaissance. Et la surprise permanente que traque la cinéaste sur le visage de l’actrice est aussi celle du spectateur, à qui fut très rarement contée l’aventure collective du Mlac, pan méconnu de l’histoire du combat pour la légalisation de l’avortement habituellement laissé dans l’ombre de la figure de Simone Veil. Avant de s’engager dans le film de son «amie» Blandine Lenoir, qui a écrit le rôle pour elle, Laure Calamy n’avait entendu parler de cette mobilisation citoyenne qu’une seule fois. Bien plus jeune, par sa mère. Une baby-boomeuse qui aiguisa chez sa fille le goût du théâtre et lui transmit, comme Annie le transmet à ses enfants, les rudiments nécessaires pour entretenir un feu : jeter joyeusement son corps dans la bataille. Rencontre. A quelle occasion votre mère vous avait-elle parlé du Mlac ? Je me souviens vaguement que, plus jeune, au moment où j’apprenais ce qu’était la loi Veil, elle avait été assez outrée qu’on ne retienne de ce combat que la seule figure de Simone Veil. C’est pourtant grâce à la pression que les militantes et militants du Mlac mirent sur le gouvernement Giscard que la loi fut votée. Ça n’enlève rien, bien sûr, au brio avec lequel la ministre a défendu la loi, mais c’est fou à quel point ce mouvement incroyable de désobéissance civile est tombé dans l’oubli ! Même les jeunes militantes féministes d’aujourd’hui, je ne suis pas sûre qu’elles connaissent toutes cette histoire. Grâce à la découverte du Mlac, votre personnage choisira de plier bagage pour devenir infirmière. C’est le métier de votre mère… Oui, et ça me touche beaucoup ! Comme Annie en effet, ma mère, qui avait peut-être 27 ans à cette époque, a quitté son milieu de petits paysans pour arriver à Paris et découvrir un nouveau monde. Pendant le tournage, je lui ai envoyé une photo, elle a eu l’impression de se voir plus jeune, avec les vêtements de son époque. Découvrir un nouveau monde, l’émerveillement de l’apprentissage, c’est aussi le sujet du film ? Oui, complètement, et c’est le parti pris génial de Blandine Lenoir : le savoir et sa transmission. Elle montre qu’à partir du moment où l’on explique, il n’y a plus de traumatisme. En tout cas, plus le même. La veille du tournage, toute l’équipe s’était réunie pour un moment d’apprentissage du geste de la méthode de Karman. La première assistante s’était dévouée pour faire le cobaye. Donc il y a eu à la fois des moments de grande concentration mais aussi des instants plus légers parce que les actrices qui jouaient les avortées devaient porter des culottes avec de faux poils pubiens dessus… Ces moments collectifs ont été super importants, on s’est soudés, tout le monde s’est mis à raconter des histoires intimes autour de ce thème : le corps des femmes, l’orgasme féminin, la connaissance anatomique, etc. «Tous ces sujets qui deviennent nobles», comme avait dit Delphine Seyrig... Le film montre en effet une archive télévisée de l’actrice, qui a incarné ce combat au péril de sa carrière. La première démonstration de l’avortement par la méthode de Karman a été pratiquée chez elle, dans son appartement. Plus elle s’est engagée dans le combat féministe, moins elle a pu travailler au cinéma. Ça paraît fou, hein, aujourd’hui où le féminisme est même devenu un argument de vente pour les assurances ! Quand même, quel courage. Ce qui est frappant dans ce film féministe, c’est aussi le soin réservé aux personnages masculins… De toute façon, rien n’est manichéen dans ce film. Le personnage du médecin qui raconte à Annie son électrochoc pour entrer en désobéissance civile est superbe – joué par Eric Caravaca, magnifique acteur. Le film prend le soin de montrer à quel point le combat concerne l’ensemble de la société, sans évacuer les débats en interne entre hommes et femmes du Mlac : qui conserve le pouvoir, qui prend la parole, qui pratique les interventions ? Comment avez-vous rencontré Blandine Lenoir ? Sur le tournage de Bancs publics (2009), de Bruno Podalydès, c’est la première fois que je jouais au cinéma. Puis, je l’ai invitée à venir voir Modèles, une création collective que j’ai faite au théâtre avec Pauline Bureau dans laquelle on parlait de sujets féministes qui semblent peut-être aujourd’hui tartes à la crème – les organes sexuels, l’inégalité de genre dans la grammaire française… C’était la première fois que je touchais à de «l’écriture de plateau», c’est-à-dire où c’est toi qui écris ta propre partition à partir d’impros. A la suite de ça, elle m’a proposé un rôle dans Zouzou (son premier long) et nous sommes devenues amies. Modèles, c’est la seule fois où vous avez écrit votre propre personnage ? Non, je l’ai beaucoup fait dans les pièces de Vincent [Macaigne, ndlr] sur certaines scènes. Par exemple, dans celles avec mon fils dans Au moins j’aurais laissé un beau cadavre [où elle jouait la mère de Hamlet], il y a un canevas mais beaucoup d’impros. Même si mon monologue de fin, c’est Vincent qui me l’a dicté la veille de la générale au Festival d’Avignon (2011). Ça doit être ultra effrayant ! Ah moi, ça m’excite à mort. Le déséquilibre, c’est ce que je recherche. Jusqu’à un certain point, j’aime me malmener dans le travail. Sur les plateaux de Vincent, c’était dangereux, on pouvait vraiment se blesser. Avec mon partenaire, on devait baiser à poil dans une flotte qu’on ne pouvait pas changer et qui croupissait au soleil. Ils mettaient des pastilles de Javel pour la désinfecter, je me suis chopé des champignons humains… une mycose, quoi ! Dans une autre pièce de Vincent, Requiem 3, comme il n’y avait pas assez d’argent pour acheter du faux sang, ils avaient préparé une sorte de potion artisanale mais qui avait pourri. Mon partenaire devait s’en asperger. L’odeur était devenue si ignoble qu’il s’est vomi dessus en pleine représentation. Il devait venir sur moi me violer longuement, il a juste eu le temps de me glisser «J’ai dégueulé !», j’ai juste fait «OK». J’ai failli vomir moi-même. Les pièces de Vincent, c’était de la performance, on se mettait onze heures par jour dans des états pas possibles, les mecs avaient perdu 10 kilos. Bon, moi, seulement 5… Quand c’est au service d’une aventure folle, c’est passionnant. La mère de Hamlet est un personnage de femme très trouble. On n’est pas dans le même registre que l’héroïne lumineuse d’«Annie Colère» ! Ah c’est sûr, mais j’ai joué aussi des rôles troubles au cinéma, dans l’Origine du mal, de Sébastien Marnier, dernièrement. Et j’aime évidemment les endroits de «monstruosité» – enfin plutôt d’humanité parce qu’on a tous des monstres en nous. Je ne suis pas là pour être morale avec mes personnages. Quel genre de rôle vous attirait au Conservatoire supérieur d’art dramatique ? Disons que, dans le théâtre classique, on est quand même dépendant de ce qu’on véhicule physiquement : j’étais petite, avec un nez retroussé, pour peu que vous soyez un peu drôle, un peu pétillante, et on vous donne les servantes de Molière, par exemple. Mais j’ai adoré jouer ça aussi ! Après, ce que je préférais, c’était les rôles de mères ou de belles-mères atroces. Dans les Feydeau, il y en a plein. Passé 30, 35 ans, on admet la folie chez les femmes, on a le droit d’envoyer chier, le droit d’être méchante, c’est génial. Comme je n’avais pas le physique de la jeune première, j’avais déjà la chance inouïe de pouvoir jouer cette palette super excitante. Ça vous manque parfois, la scène ? Oui, mais on me propose des choses tellement passionnantes en ce moment au cinéma que j’en profite tant que ça se passe bien : je sais que ça peut s’arrêter vite. Mais ce que je préfère au théâtre, ce sont les tournées dans les petits lieux de la décentralisation. Rencontrer le public en «bord plateau» à la fin des spectacles. Parce que ça me ramène à mes premières découvertes artistiques, plus jeune, à Orléans. C’était le sujet de votre discours lors des césars en 2021. Des directeurs de théâtre ou de cinémas d’art et essai vous ont-ils remerciée d’avoir aussi bien défendu l’importance de leur travail de fourmi ? Eh bien justement, j’ai entendu dire par une directrice qu’un théâtre n’avait pas eu la baisse de subvention qu’il redoutait grâce à ce discours ! On en est là, quand même… C’est fragile, la volonté politique en matière de culture, hein. Et c’est fou, la vitesse avec laquelle, si on ne défend pas les acquis, ils peuvent disparaître. Ça vaut pour le droit à l’avortement comme pour la décentralisation culturelle. Annie Colère, de Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, India Hair, Zita Hanrot… 1h58. Légende photo : Laure Calamy à Paris, en 2018. (Martin COLOMBET/Photo Martin Colombet. Hans Luca)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 9:51 AM
|
Par Mona Chollet dans son blog La Méridienne - 28/11/2022 Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont Les Amandiers, le film de Valeria Bruni-Tedeschi (sorti le 16 novembre), et les polémiques qui l’entourent semblent être en train de cristalliser un conflit de générations au cinéma et au théâtre. La réalisatrice a reconstitué dans ce long-métrage son expérience d’élève comédienne à l’école fondée dans les années 1980 au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, par les metteurs en scène Patrice Chéreau et Pierre Romans. Nadia Tereszkiewicz y joue le rôle de Stella, le double de la cinéaste, tandis que Sofiane Bennacer interprète Étienne, inspiré de Thierry Ravel, l’ancien compagnon de Bruni-Tedeschi, également élève de l’école, mort d’une overdose en 1991. Autour d’eux, une joyeuse bande de jeunes acteurs campent des personnages librement inspirés d’autres camarades de promotion de la réalisatrice, dont beaucoup sont devenus célèbres : Eva Ionesco, Marianne Denicourt, Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Vincent Perez… Le 22 novembre, Le Parisien a révélé que Sofiane Bennacer avait été mis en examen en octobre pour « viols et violences sur conjoints » à la suite des plaintes de quatre femmes. L’Académie des Césars a alors annoncé le retrait du nom de l’acteur de la liste des révélations masculines 2023. En 2021, moins d’une semaine après le début du tournage, peut-on lire dans Libération (25 novembre), la production des Amandiers avait déjà appris qu’une plainte pour viol avait été déposée contre son acteur principal, mais la réalisatrice avait insisté pour travailler avec lui malgré tout. Bruni-Tedeschi continue aujourd’hui à défendre celui qui est entre-temps devenu son compagnon, invoquant la « présomption d’innocence » et parlant d’un « lynchage médiatique ». Libération a illustré son enquête d’une photo saisissante, prise lors de la présentation du film à Cannes, sur laquelle Bennacer se tient entre Valeria Bruni-Tedeschi et Nadia Tereszkiewicz ; il met sa main devant les yeux de la réalisatrice, comme pour l’aveugler. Au-delà de l’affaire elle-même, il est frappant de voir comment les accusations portées contre le comédien, et la façon dont Bruni-Tedeschi y réagit, amplifient certaines questions soulevées par le film. Doté d’un charme et d’une vitalité indéniables, Les Amandiers montre l’utopie théâtrale que fut cette école, l’euphorie des élèves d’avoir été choisis, les amitiés et les amours qui naissaient entre eux, leur enthousiasme, leur fantaisie, leur exubérance – leurs poses et leur narcissisme, aussi, parfois –, leur admiration pour leurs mentors, le côté touchant et parfois enfantin de ces derniers. On sourit, on rit beaucoup. Mais, de temps en temps, une scène fait sursauter. On voit Chéreau (interprété par Louis Garrel) forcer un élève à l’embrasser, un soir, alors qu’ils sont les derniers dans les locaux. On voit aussi sa brutalité envers Anaïs (Léna Garrel), qu’il humilie publiquement en lui assénant qu’il n’a jamais voulu d’elle dans l’école, que c’est Pierre Romans qui a insisté pour la prendre et que lui, il n’est « pas ému par elle ». « Le machisme règne
et les apprenties actrices
se prennent des savons monumentaux
en cas de retard
ou d’oubli de répliques » Le personnage d’Anaïs est vraisemblablement inspiré d’Agnès Jaoui. En 2018, retraçant l’épopée des Amandiers dans Le Monde, Clément Ghys écrivait : « Pour les apprenties actrices, la donne est différente. Le machisme règne et elles sont moins complices de Chéreau et Romans, se prennent des savons monumentaux en cas de retard ou d’oubli de répliques. Quand il ne s’agit pas de réflexions sur le physique. Assez vite, Agnès Jaoui n’en peut plus, et, ulcérée par l’emprise de Chéreau sur tout le monde, songe à quitter l’école. Marianne Denicourt résume : “Il fallait être un bon petit soldat quand on était une fille.” Et de tempérer : “Au moins, ça changeait du traitement que les hommes du métier réservent aux jeunes comédiennes” [1]. » (Traduction : au moins, Chéreau, étant homosexuel, n’agressait pas sexuellement les jeunes femmes.) Beaucoup de critiques ont salué le fait que Valeria Bruni-Tedeschi ne dresse pas un portrait idéalisé de Chéreau, qu’elle a pourtant vénéré. Sauf que le statut de ces scènes démystifiantes n’est pas du tout clair. Certaines choquent une partie du public, mais… pas la réalisatrice. Interrogée par Télérama sur celle du baiser forcé, elle commentait en mai dernier : « À l’époque, on trouvait ça normal, on rigolait de Chéreau qui essayait d’embrasser des jeunes gens dans un couloir – Chéreau avait des élans mais ne faisait pas de harcèlement, de chantage. Je ne raconte pas cette scène de façon scandaleuse, c’est un moment de gêne pour Baptiste et de solitude un peu ridicule pour Chéreau [2]. » La seule chose qu’elle trouve grave dans le comportement de Chéreau et de Romans, c’est qu’ils se droguaient (cocaïne, héroïne) et donnaient ainsi un mauvais exemple à des élèves qui les idolâtraient. On peut voir dans la désinvolture de la réalisatrice, et de ses camarades à l’époque, une illustration de plus du fait qu’un baiser forcé (« volé », selon un euphémisme révélateur) n’est souvent pas perçu comme une agression sexuelle, alors qu’il répond juridiquement à cette définition. Quand c’est une femme qui le subit, on le minimise parce qu’on estime plus ou moins consciemment que le corps des femmes est une chose publique, appropriable par n’importe qui ; et quand c’est un homme, on le traite effectivement sur le mode de la plaisanterie, comme si un homme adulte n’était pas censé se formaliser pour si peu, ni avoir une intégrité physique et sexuelle qu’il prétendrait faire respecter. Une autre chose laisse très perplexe : le traitement de l’histoire d’amour entre Stella et Étienne. Au-delà des accusations qui pèsent sur Sofiane Bennacer, son personnage dans Les Amandiers apparaît comme extraordinairement malsain et toxique. Dans une scène, Adèle (Clara Bretheau) met d’ailleurs en garde Stella contre la violence d’Étienne, ainsi que contre sa propre tendance sacrificielle à vouloir le « sauver » de sa toxicomanie. Mais le film reste en quelque sorte au milieu du gué : il continue à traiter Étienne comme un jeune premier romantique et torturé avec qui l’héroïne vit une histoire d’amour certes un peu mouvementée et éprouvante, mais si intense. En plus de se montrer violent et jaloux, Étienne est lourdingue et antipathique ; on a vraiment du mal à voir ce qui séduit Stella chez lui. Le cliché est si énorme qu’il en naît presque un effet de comique involontaire et pathétique. La « souffrance »
de l’homme violent L’attirance de la jeune femme semble se résumer entièrement à un syndrome du Saint-Bernard : Étienne l’attendrit parce qu’il a eu une enfance difficile et parce qu’il « souffre » – souffrance qu’il étale complaisamment à chaque réplique, ou presque. La référence à Marlon Brando, c’est-à-dire à un acteur notoirement maltraitant, tant dans ses rôles que dans sa vie, est éloquente sur les origines de ce modèle de séduction virile, que le film n’interroge pas. « Ce qui me touche dans un personnage violent, c’est sa douleur, c’est d’où vient la violence ; c’est cette tragédie enfantine, c’est son impuissance à s’exprimer autrement que par la violence, dit la réalisatrice dans le making-of du film, Des Amandiers aux « Amandiers ». Je vois l’enfant, en fait. Moi, par rapport à un personnage violent avec une femme, je voudrais ne pas être politiquement correcte. » On ne peut s’empêcher de penser que Valeria Bruni-Tedeschi n’a pas tiré toutes les conclusions de l’expérience qu’elle a vécue aux Amandiers, ni analysé les rapports de pouvoir qui s’y jouaient, que ce soit entre élèves ou entre élèves et professeurs. Tout le monde ne peut pas avoir la lucidité précoce d’une Agnès Jaoui. Il y a de quoi être glacée par ces images d’archives (reprises dans le making-of) d’une interview dans laquelle, quand on lui demande ce qu’elle attend d’un metteur en scène, la jeune Valeria répond : « Qu’il m’aime, avant tout – même si je trouve que je n’ai pas tellement de raisons d’être aimée. Et puis qu’il me casse, aussi. Qu’il me casse. Qu’il me casse bien. Qu’il me casse tout. Qu’il me casse ! Qu’il me casse en deux, qu’il me casse, mes défenses et tout ça. » Ces lieux communs masochistes, elle ne les a pas inventés : ils sont omniprésents au théâtre et au cinéma, où ils justifient toutes sortes de maltraitances. On pourrait comprendre et même respecter cette difficulté de la cinéaste à remettre en question la formation qu’elle a reçue, difficulté dans laquelle il pourrait bien entrer un syndrome de Stockholm (son positionnement en rappelle un autre dans le cinéma français : celui de Maïwenn). On le pourrait d’autant plus que, dans le communiqué qu’elle a publié en réaction à l’enquête de Libération, elle dit avoir été « abusée dans [son] enfance » et connaître « la douleur de ne pas avoir été prise au sérieux ». Sauf qu’ici, d’autres personnes sont impliquées. Lorsqu’elle décide de faire jouer sa jeunesse à ses acteurs, en se mettant elle-même dans le rôle que tenait Chéreau à l’époque, elle s’expose à reproduire les travers qui ont marqué sa propre formation. « On essaie de creuser les choses
qui nous détruisent le plus » Des Amandiers aux « Amandiers » montre une réalisatrice enfermée dans son rêve, dans sa nostalgie ; le fait qu’elle soit apparemment tombée amoureuse de l’acteur qui jouait son amour de jeunesse ne fait que le confirmer. Rien de cela ne serait problématique – mettre les autres au service de son rêve, c’est la définition même de la mise en scène – s’il n’y avait pas chez elle un tel aveuglement aux abus de pouvoir, les siens comme ceux des autres. Ces abus de pouvoir sont bien sûr très courants ; ils sont admis et même considérés comme admirables lorsqu’ils sont le fait de metteurs en scène masculins et blancs, et ne sont en général dénoncés que lorsqu’ils sont pratiqués par une femme ou par une personne non blanche (se souvenir de l’affaire Kechiche après La Vie d’Adèle), dont la tyrannie est considérée comme moins légitime. Mais cela ne les rend pas moins problématiques dans tous les cas. Sur le tournage, tel que le montre Des Amandiers aux « Amandiers », Bruni-Tedeschi soumet ses acteurs à un bombardement de directives psychologisantes et intrusives, qui pourrait n’être qu’agaçant, mais qui dérape franchement quand elle les pousse à révéler devant toute l’équipe – et, par la même occasion, devant la caméra des réalisateurs du making-of – certains de leurs secrets les plus intimes. On a très mal pour Vassili Schneider, en particulier. « Le film a été un petit peu comme une thérapie parfois, et parfois comme une anti-thérapie : on essaie de creuser les choses qui nous détruisent le plus », commente le jeune homme (23 ans) avec une placidité résignée, sans qu’on voie en quoi ce jeu de massacre consternant serait indispensable à la réussite d’un film. Des Amandiers aux « Amandiers » met d’autant plus mal à l’aise qu’il est à l’évidence conçu comme une hagiographie de la cinéaste – il est coréalisé par Karine Silla Perez, épouse de Vincent Perez, qui fut le camarade de Bruni-Tedeschi aux Amandiers et le compagnon de sa sœur Carla Bruni. Souvent débutants, les jeunes acteurs qui y sont interrogés ne sont pas en position de formuler autre chose que des louanges au sujet d’une réalisatrice confirmée qui est aussi, rappelons-le, une femme immensément riche (c’était le sujet de son premier film, Il est plus difficile pour un chameau…) et la belle-sœur d’un ancien président de la République. L’une dit tout de même à mots couverts, en termes très diplomatiques, que le tournage a été difficile : « Mon caractère n’est pas vraiment compatible avec (…) cette manière de me bousculer. » Ce n’est peut-être pas un hasard si le seul qu’on voit se rebeller ouvertement contre le flot de directives incessant de la réalisatrice est Louis Garrel, qui, en plus d’être son ancien compagnon, de faire partie des acteurs plus âgés et d’avoir déjà une prestigieuse carrière derrière lui, appartient à l’un des clans les plus puissants du cinéma français. Ni si la seule à qualifier frontalement la méthode de la réalisatrice de « violente » est une autre Garrel : Léna, demi-sœur de Louis. Ainsi, l’interdiction faite à l’équipe d’évoquer les accusations pesant sur Sofiane Bennacer – une omerta seulement brisée, une nuit, par l’intervention de colleuses féministes au courant de l’affaire – semble n’avoir fait que prolonger et amplifier un partage inéquitable du droit à la parole sur le tournage, recoupant des hiérarchies professionnelles, sociales, générationnelles. C’est seulement aujourd’hui que des actrices du film peuvent dire dans Libération, sous couvert d’anonymat, combien il leur a pesé de devoir travailler avec un homme accusé de viol [3], ou qu’une autre, Sandra Nkaké (Susan), peut clamer sa colère [4]. « Je trouve cette génération
beaucoup plus précautionneuse
que la nôtre » Des Amandiers aux « Amandiers » montre une réalisatrice qui semble engagée non seulement dans une reconstitution de sa jeunesse, mais aussi dans un combat pour réhabiliter les valeurs de sa génération. Ce serait anodin si elle se contentait d’expliquer à ses jeunes acteurs ce que représentait Coluche dans les années 1980 ou de leur enjoindre de visionner La Maman et la Putain. Mais cela s’accompagne de fréquentes imprécations contre l’époque actuelle, qui serait trop « morale ». À l’appui de ce reproche, elle cite les interrogations dont lui a fait part une collaboratrice quant au traitement de l’avortement de Stella dans une conversation entre Stella et Adèle – une scène à laquelle il n’y a effectivement rien à redire. Mais elle ne pouvait pas ne pas avoir en tête, à ce moment, une contestation beaucoup plus sérieuse à laquelle elle avait été confrontée : les accusations contre Sofiane Bennacer, qu’elle choisit de passer sous silence. « Je trouve cette génération beaucoup plus précautionneuse que la nôtre, et vraiment ça m’a fait plaisir de les malmener », fanfaronne-t-elle. Avec le tollé que suscite aujourd’hui la façon dont elle protège son acteur, il se produit un spectaculaire retour de boomerang : cette génération à laquelle elle prétendait faire la leçon lui tient tête, et affirme avec force son refus de tolérer les violences physiques et sexuelles. Au lieu de s’attendrir sur la « douleur » de l’homme violent, d’en faire une excuse, cette génération clame sa volonté de prendre plutôt en compte la douleur des femmes qui l’accusent. Faute d’examen critique, la bulle de rêve et de nostalgie a volé en éclats. « Aujourd’hui, une telle école ne pourrait plus exister. Tant mieux. Mais alors, cette liberté et cette folie-là ne peuvent plus exister non plus. Cette absence totale de limites nous emmenait dans des endroits… intéressants. Des endroits où les élèves du Conservatoire n’allaient pas », disait encore Bruni-Tedeschi à Télérama en mai [5]. Ici, on retrouve ce raisonnement pour le moins déconcertant selon lequel, si on refusait les abus de pouvoir, la vie deviendrait sinistre. (Cela rappelle un peu ces gens qui redoutent que le rire disparaisse de la surface de la Terre si on arrête de faire des blagues racistes ou sexistes.) C’est aussi le réflexe qu’ont parfois des femmes qui vivent une relation d’emprise : elles semblent persuadées que la violence est le prix à payer pour les qualités qu’elles trouvent par ailleurs à leur compagnon. Naïvement, on a envie de demander : pourquoi ? Pourquoi ne pourrait-on pas garder la liberté, l’exubérance, la fantaisie, tout en s’assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le monde, tout en étant attentifs aux rapports de pouvoir et en refusant d’infliger ou de tolérer des violences sexuelles, physiques, psychologiques ? Le tri n’est pas si difficile à faire. Et, même s’il l’était, cela vaudrait la peine de s’y atteler. Sous peine de continuer à passer des bataillons de comédien-ne-s par pertes et profits. Il faut que je l’avoue : le travail d’inventaire auquel Valeria Bruni-Tedeschi se refuse avec tant de force, j’ai moi-même besoin d’y procéder. Patrice Chéreau a été une grande figure de mon adolescence, et même de mon enfance. Quand elle était comédienne, ma mère a joué dans plusieurs spectacles de son ami Claude Stratz, metteur en scène genevois devenu par la suite, de 1981 à 1988, l’assistant de Chéreau aux Amandiers. Elle-même avait pour Chéreau une immense admiration, qu’elle m’a transmise. Gamine, j’ai vu à la télévision une rediffusion du Ring, l’opéra de Wagner monté en 1976 au Festival de Bayreuth par Chéreau et Pierre Boulez, qui m’a énormément marquée [6]. J’ai vu son Hamlet, avec Gérard Desarthe, au Festival d’Avignon, en 1987. J’ai vu sa magistrale interprétation, en duo avec Pascal Greggory, de la pièce de Bernard-Marie Koltès Dans la solitude des champs de coton, en 1995. J’ai vu le fascinant documentaire qui le montrait répétant Shakespeare avec des élèves du Conservatoire national d’art dramatique de Paris, en 1999. Au cinéma, j’en ai pris plein les yeux avec La Reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train, Intimité… Mais, par ce qu’il montre de lui, et par les exhumations dont il est l’occasion, le film de Valeria Bruni-Tedeschi me fait prendre conscience des limites et des travers du personnage. Il me sort de l’idéalisation – et tant mieux, puisque ce n’est jamais une bonne idée d’idéaliser un être humain ; c’est toujours un abandon de souveraineté. Voilà peut-être la tâche qui s’impose à ma génération et aux précédentes : revisiter – sans forcément les renier entièrement – les admirations qui nous ont construites, en ouvrant les yeux sur les abus de pouvoir que nos « grands hommes » pratiquaient au nom de l’Art. Et en s’efforçant de ne pas les perpétuer ni les cautionner.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 6:11 PM
|
Par Marie-Aude Roux (Rennes, envoyée spéciale) dans Le Monde, publié le 26/11/2022 La première mise en scène d’art lyrique de la performeuse et jongleuse confère une revigorante radicalité au troisième des opéras de Philip Glass d’après Jean Cocteau.
Lire l'article sur le site du Monde
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/26/opera-phia-menard-a-place-les-enfants-terribles-en-ehpad_6151794_3246.html Un train de trois pianos lancé sur une tournette extérieure, à l’intérieur ; un manège en sens inverse ; au centre, la valse centrifuge d’une chambre d’hôpital aux persiennes blanches : imaginé par Phia Ménard, ce triple dispositif met en scène et en mouvement la scénographie des Enfants terribles (1996), de Philip Glass, troisième des ouvrages consacrés par le compositeur américain à Jean Cocteau, après Orphée (1993) et La Belle et la Bête (1994). Vertige, vitesse, hypnose, les boucles répétitives de la musique propulsent un synopsis qui emprunte également au film éponyme de Jean-Pierre Melville (1950), relatant la violence d’un huis clos qui voit s’aimer et se détruire Elisabeth et son frère Paul. Un jeu dangereux dès lors que Paul tombera amoureux d’Agathe, double féminin du fascinant Dargelos qui l’a blessé alors qu’il était enfant, déclenchant le tragique passage à l’acte d’Elisabeth. Les lumières d’Eric Soyer habillent le drame d’un étrange réseau d’ombres La performeuse, jongleuse, chorégraphe et metteuse en scène, dont c’est la première incursion à l’opéra, a eu l’idée transgressive de replacer le quotidien fantastique et onirique des adolescents dans un Ehpad. Dans leurs vêtements d’intérieur surannés, ces enfants terribles sont de vieux enfants – Paul est en fauteuil roulant, livré aux maltraitances de sa sœur –, dont le jeu consiste à chausser des casques de réalité virtuelle, histoire de convoquer le temps de leur jeunesse. Ils sont veillés et surveillés par des pianos infirmiers, tandis qu’un comédien se fait tour à tour narrateur, médecin ou animateur (séance de pliage d’origamis), voire clone de Cocteau. Les lumières d’Eric Soyer habillent le drame d’un étrange réseau d’ombres. Particulièrement frappant, le tournis affolé des dernières scènes, avec ses personnages costumés par Marie La Rocca en éléments de décors rappelant les pièces d’un jeu d’échecs. Paul et sa tour mauve de Moyen Age, Elisabeth en méchante reine des neiges, Gérard harnaché en cheval de parade rouge, Agathe en dame de cour déjantée aux couleurs de la folie. Le chaos accueillera la fin de Paul et Elisabeth. Relation toxique Sur leurs claviers numériques, les trois pianistes Flore Merlin, Nicolas Royez et Emmanuel Olivier (également directeur musical de la production) déroulent le continuum consonant de Glass dans une uniformisation de couleurs et de nuances propre à soutenir de manière presque oraculaire l’implacable progression du drame. Générale, la sonorisation expose particulièrement les voix, déjà très sollicitées par une écriture atonale, à rebours de la prosodie, comme si le compositeur francophile avait voulu illustrer dans la chair des mots la relation toxique entre les protagonistes. Elisabeth très engagée scéniquement, Mélanie Boisvert compense un timbre acidulé par une incarnation vocale énergique et soutenue, cependant qu’Olivier Naveau dessine un Paul doloriste et résigné. Si le Gérard de François Piolino reste un peu falot, Ingrid Perruche campe une Agathe solide à la voix charnue. Le comédien Jonathan Drillet observe une remarquable variété de tons Quant au comédien Jonathan Drillet, il observe une remarquable variété de tons, même si le long passage où il présente l’extrait d’une interview réalisée par le poète français en 1962, Jean Cocteau s’adresse à l’an 2000, nous a semblé un peu déconnecté. Peut-être parce qu’en évoquant, entre peur de la robotisation et vœu pour l’humanité, un monde bien réel, il brisait en quelque sorte le pacte onirique de la musique. D’ores et déjà programmés dans une dizaine de lieux, ces Enfants terribles, nouvelle production de la Co[opéra]tive, consortium de six scènes nationales et opéras fédérés depuis 2014 afin d’assurer un plus grand rayonnement à l’art lyrique, continueront de tourner. Après Quimper et Rennes, ils rayonneront d’abord à Tourcoing (Nord), Dunkerque (Nord) et Compiègne (Oise) puis, en 2023, à Besançon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bruxelles et Bobigny (Seine-Saint-Denis). Les Enfants terribles, de Philip Glass. Avec Mélanie Boisvert, Olivier Naveau, Ingrid Perruche, François Piolino, Emmanuel Olivier, Flore Merlin, Nicolas Royez (pianos numériques), Phia Ménard (mise en scène et scénographie), Eric Soyer (création lumières), Marie La Rocca (costumes), Jonathan Drillet (dramaturgie). Opéra de Rennes, le 16 novembre. Prochaines représentations : les 26 et 27 novembre à Tourcoing (Nord) ; les 1er et 2 décembre à Dunkerque (Nord) ; le 7 décembre à Compiègne (Oise) ; les 10 et 11 janvier 2023 à Besançon (Doubs) ; les 17, 19 et 20 janvier 2023 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; les 1er et 2 février 2023 à Grenoble (Isère) ; les 10 et 11 février 2023 à Bruxelles (Belgique) ; les 23, 24 et 26 février 2023 à Bobigny (Seine Saint-Denis). Marie-Aude Roux (Rennes, envoyée spéciale) / Le Monde Légende photo « Les Enfants terribles », de Philip Glass, dans une mise en scène de Phia Ménard, lors de la répétition générale au Théâtre de Cornouaille à Quimper, le 7 novembre 2022. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:33 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 26 nov. 2022 Ultime mise en scène de Sylvain Maurice comme directeur du CDN de Sartrouville, « La Campagne » de Martin Crimp, est aussi intelligemment dirigée que magistralement interprétée. Au côté de celle qui est aussi devenue une auteure, Manon Clavel, magnifique et Yannick Choirat, dans le rôle ingrat de celui qui ment. Allons droit au fait ! On connaît bien la pièce de Martin Crimp. Elle a été très tôt montée en France. Mais c’est comme si elle était neuve. On ne s’en étonne pas car on sait depuis très longtemps la puissance et l’art très sensible de Sylvain Maurice. C’est un très grand artiste et, avec La Campagne, son dernier travail de metteur en scène au Théâtre de Sartrouville (et des Yvelines, un centre dramatique national), il nous offre un moment d’une force profonde. Il a conduit les trois interprètes au plus près des humeurs évanescentes et angoissantes distillées par Martin Crimp. Ici, plus que jamais, l’écrivain britannique, né en 1956, apparaît comme un héritier d’Harold Pinter. Mais il possède une personnalité profonde, et Crimp est Crimp ! La traduction de Philippe Djian, déjà entendue, résonne ici de son ambivalence vénéneuse. Là aussi, Sylvain Maurice est un maître : il éclaire toutes les moirures de l’angoissante situation et les comédiens jouent toutes les notes. Tout paraît simple, paisible. Une femme, jeune, découpe des motifs de fleurs avec de grand ciseaux et s’adresse à son mari. On comprend qu’il est rentré la veille, tard, avec une toute jeune fille, qui dort à côté, dans une pièce de la maison. Elle se repose. Il l’a trouvée, inconsciente ou presque, dans un fossé, le long de la route qui le ramenait à la maison, lui qui est médecin. De campagne. Dans les intonations, musicales, légères mais interrogatives de l’épouse, Corinne, se love immédiatement le noeud dramatique de ces scènes de la vie d’un couple. Ils sont beaux, ils s’aiment, certainement, en tout cas elle le pensait. Mais le venin de la trahison, du mensonge, corrode toutes les belles apparences de calme, d’harmonie. Disons-le : on connaît, on admire, on suit, Isabelle Carré depuis ses tout débuts. Elle avait 18 ans et sans doute moins. Elle a toujours été séduisante, bouleversante. Mais ici, elle a encore monté d’un cran. Elle est éblouissante, libre, fascinante. Elle est portée par le rôle, l’écriture, le metteur en scène. Le dispositif scénique, de Sylvain Maurice lui-même, est l’idéal lieu qui éclaire le propos de Crimp. Lumière, son, Rodolphe Martin et Jean De Almeida, illuminent encore le jeu. Dans la partition ambivalente du mari, Richard, Yannick Choirat est parfait. Il est séduisant, comme il se doit, sincère dans son engagement de médecin, mais faible, mais fuyant, mais menteur. Une interprétation très maîtrisée et fine. Et puis il y a celle qui introduit le doute, celle qui sépare mais que tout le monde -le mari et la femme, en fait- aime. Rebecca, portée par une jeune comédienne déjà repérée mais qui, ici, s’épanouit. Libre comme Isabelle Carré, audacieuse, insolente comme l’est son personnage, comme l’est le personnage de Corinne, menteuse, fuyante, odieuse avec Corinne car elle se sent forte et qu’elle adore l’ambiguité destructrice de la situation. Cette mise en scène de La Campagne est remarquable. La meilleure mise en scène en France de Martin Crimp. Un trio d’interprètes incandescents. Pour des personnages si proches… La dernière représentation a lieu ce samedi, en présence de l’auteur. Une tournée suit :
du 1er au 3 décembre au Théâtre Montansier, Versailles
du 7 au 9 décembre 2022 à la Comédie de Picardie, Amiens
du 5 au 22 janvier 2023 au Théâtre du Rond-Point, Paris
du 26 au 28 janvier 2023 au Théâtre national de Nice Photo © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 4:35 PM
|
Par Zineb Dryef, Clarisse Fabre, Gilles Rof(Marseille, correspondant) et Nathalie Stey (Strasbourg, correspondance) dans Le Monde , publié le 26 novembre 2022 A l’affiche du film « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi, l’acteur de 25 ans fait l’objet de trois mises en examen, deux pour viol sur des anciennes compagnes et une pour violence sur conjoint.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/26/l-affaire-sofiane-bennacer-embarrasse-le-cinema-francais_6151736_3246.html
C’est une affaire qui plonge la profession dans l’embarras. A l’affiche du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni Tedeschi, l’acteur Sofiane Bennacer, 25 ans, fait l’objet de trois mises en examen, deux pour viol sur des anciennes compagnes et une pour violence sur conjoint, comme l’ont révélé Le Parisien et Libération. Dans un long message posté sur Instagram, il clame son innocence : « La présomption d’innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un Etat de non-droit, un Etat où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ? » Lire aussi : Affaire Sofiane Bennacer : ce que l’on sait des accusations de viols contre l’acteur des « Amandiers » « Un pur lynchage médiatique », a dénoncé Valeria Bruni Tedeschi, sa compagne, dans un communiqué, vendredi 25 novembre, qui assume avoir choisi ce jeune acteur tout en ayant eu vent de rumeurs à son sujet. « Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui. » Elle poursuit : « Pour ma part, j’avais depuis quelques mois appris à connaître Sofiane Bennacer dans le travail, notamment pendant la longue période de répétitions, et à être tout à fait confiante sur ses qualités humaines : lorsque l’on filme quelqu’un, on “voit” qui l’on a en face de soi. » Sélectionné dans la liste des trente-deux comédiens présélectionnés pour les Césars des révélations féminines et masculines, Sofiane Bennacer en a finalement été exclu. L’Académie des César a fini par prendre acte des « informations publiées par la presse concernant la mise en examen de l’acteur et le contrôle judiciaire qui lui est imposé ». Alertes répétées C’est précisément cette absence de réactions, malgré des alertes répétées, depuis le casting jusqu’à la réception du film, qui est aujourd’hui dénoncée. Deux cinémas – L’Ecran de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Le Concorde à La Roche-sur-Yon (Vendée) – ont d’ores et déjà annoncé avoir retiré Les Amandiers de leur programmation, alors que des appels au boycott commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le collectif #metoothéâtre, très actif, a dénoncé l’« omerta » de la profession : « La structuration de nos métiers et de la société est construite sur la protection des agresseurs et la “silenciation” des victimes. Une fois encore, ce système se vérifie dans cette affaire avec une production qui se défausse de ses responsabilités afférentes au droit du travail. » Sur Instagram, le collectif #metoothéâtre, très actif, a dénoncé l’« omerta » de la profession C’est sur les planches que tout a commencé. En janvier 2021, au Théâtre national de Strasbourg (TNS), Sofiane Bennacer est accusé de viol par l’une de ses camarades. Les faits qu’elle dénonce remontent à 2018, lorsqu’ils étaient tous deux étudiants à La Filature à Mulhouse (Haut-Rhin). Ils étaient alors en couple. La direction de l’établissement affirme n’avoir recueilli à l’époque « aucun témoignage, aucune information qui aurait pu nous mettre la puce à l’oreille ». A Strasbourg, Stanislas Nordey, le directeur du TNS, explique au Monde qu’il a été mis au courant par Sofiane Bennacer lui-même : « Un jour, Sofiane débarque dans mon bureau, en larmes, m’expliquant qu’il est accusé de viol. Je ne suis pas un violeur, dit-il. Je convoque la jeune fille et lui pose la question. Elle me répond qu’elle n’avait pas l’intention de venir me parler, mais elle confirme l’accusation. Les élèves du TNS ont commencé à s’en mêler, et les réactions se sont déchaînées sur les réseaux sociaux. Au vu du climat, je propose alors à Sofiane de prendre trois semaines de congé. Quand il revient, il m’annonce qu’il démissionne. Sofiane est parti, a quitté Strasbourg, et je pensais que l’affaire était close. » « Rumeurs » Il entend de nouveau parler de lui lorsque la production des Amandiers, Alexandra Henochsberg (Ad Vitam) et Patrick Sobelman (Agat Films), le contacte pour vérifier des « rumeurs ». Stanislas Nordey évoque des soupçons d’agressions sexuelles : « Je n’ai pas dit qu’il était accusé de viol comme l’écrit Libé. En tout cas, cela m’étonnerait beaucoup que j’aie utilisé ce mot. J’ai essayé d’être le plus factuel possible. Je n’ai pas non plus précisé aux producteurs que j’avais effectué un signalement au procureur de la République, car je suis tenu au devoir de réserve. » Enfin, lorsque les producteurs lui demandent s’il a connaissance d’une plainte déposée par la comédienne, Stanislas Nordey répond qu’il ne sait pas. « Je savais qu’une plainte avait été déposée, mais la jeune actrice m’avait demandé de ne pas le dire. J’ai donc respecté son choix. Par ailleurs, Agat Films aurait pu interroger directement la jeune actrice… car celle-ci avait été auditionnée pour Les Amandiers », ajoute le directeur du TNS. En effet, avant que l’affaire éclate, Stanislas Nordey et l’équipe du TNS avaient été sollicités en vue du casting des Amandiers : « La direction du casting souhaitait avoir quelques noms d’élèves du TNS susceptibles de passer les auditions. Nous avons alors transmis plusieurs contacts, parmi lesquels ceux de Sofiane Bennacer et de la jeune fille. » En juin, des remous agitent le TNS lorsque Stanislas Nordey accepte d’accueillir l’ancien élève dans le cadre de représentations du spectacle Superstructure produit par la compagnie Diphtong. A l’époque, face à la réaction très vive des étudiants, il s’était retranché derrière le principe de présomption d’innocence pour maintenir le spectacle. Des mesures conservatrices avaient été adoptées : une grande partie des élèves de l’école avait été déplacée à Eymoutiers (Haute-Vienne) et à Montreuil (Seine-Saint-Denis), durant la période des représentations, pour éviter tout risque de rencontre entre le comédien et ses victimes présumées. Le planning de travail d’une salariée avait également été adapté pour que les deux ne se croisent pas. « Nous étions obligés, pour des raisons juridiques, de le programmer et nous l’avons fait après consultation du ministère de la culture », explique Stanislas Nordey. « Pas de scandale “Les Amandiers” » A Aix-en-Provence, où Sofiane Bennacer a suivi sa formation de théâtre après avoir grandi dans un milieu populaire à Marseille, l’annonce des accusations laisse sous le choc les équipes du Deust théâtre d’Aix-Marseille Université et leur responsable, Louis Dieuzayde, également président du Théâtre Antoine-Vitez. « C’est extrêmement douloureux, car cela concerne un de nos anciens étudiants et un acteur dont on suit la carrière, témoigne l’enseignant. Sofiane était une intelligence et un acteur que l’on appréciait beaucoup lorsqu’il était étudiant. D’autant plus méritant qu’il est rare de voir un jeune de sa classe sociale choisir cette voie dans notre région. » Le théâtre avait prévu d’organiser un événement autour de lectures de ses propres textes, encore inédits, par Valeria Bruni Tedeschi, au début de février 2023. Une programmation qui laisse désormais l’équipe aixoise dans l’embarras. « Je ne vous cache pas que cette soirée est fortement compromise, mais nous souhaitons prendre un peu de temps avant d’acter une décision définitive », poursuit Louis Dieuzayde. Les producteurs du film, Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman, disent avoir averti, deux jours après le début du tournage, Valeria Bruni Tedeschi, qui a refusé de se séparer de son acteur Pour sauver leur film, Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman plaident, dans un communiqué, que « s’il y a une affaire Sofiane Bennacer, il n’y a pas de scandale Les Amandiers ». Ils reconnaissent avoir appris, deux jours après le début du tournage, qu’une plainte pour viol avait été déposée contre le comédien. Ils disent avoir averti Valeria Bruni Tedeschi, qui a refusé de se séparer de son acteur : « A ce stade, rien dans le droit du travail ne nous permet de justifier son licenciement, il pourrait se retourner contre nous (…). Nous organisons alors une réunion sur le plateau avec toute l’équipe, Valeria prend la parole pour expliquer la situation. Nous proposons à ceux que la situation rend mal à l’aise de quitter le tournage sans aucune pression ni conséquence. » Ils interrogent : « Aujourd’hui, comment notre expérience pourrait-elle servir à améliorer la position des producteurs face à ce type de situation ? Comment répondre légalement au nécessaire devoir d’exemplarité ? » Pour ne pas risquer une affaire Polanski bis – la remise du prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski en 2020 avait secoué le cinéma français – les César prévoient aussi de plancher sur la question : que faire d’un film dont un participant est poursuivi pour viol et violences sexuelles ? Lire aussi Article réservé à nos abonnés L’Académie des Césars critiquée pour ses pratiques opaques et ses choix contestés Zineb Dryef, Clarisse Fabre, Gilles Rof(Marseille, correspondant) et Nathalie Stey(Strasbourg, correspondance) ------------------------------------------------------- Affaire Sofiane Bennacer : ce que l’on sait des accusations de viols contre l’acteur des « Amandiers » Article publié par Le Monde avec AFP, le 25 nov. 2022 Le comédien, mis en examen en octobre, a été placé sous contrôle judiciaire. Alors qu’il dément les faits qui lui sont reprochés, la réalisatrice du film, Valeria Bruni-Tedeschi, lui a apporté son soutien vendredi, dénonçant un « lynchage médiatique Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/cinema/article/2022/11/25/affaire-sofiane-bennacer-ce-que-l-on-sait-des-accusations-de-viols-contre-l-acteur-des-amandiers_6151662_3476.html
Il partage la tête d’affiche du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni-Tedeschi, sorti en salles le 16 novembre et encensé par la critique. L’acteur Sofiane Bennacer, âgé de 25 ans, se retrouve toutefois dans la lumière pour tout autre chose depuis le 22 novembre : ses mises en examen pour viols et violences sur ex-conjointes. Alors que ce dernier conteste les faits et a reçu le soutien de la réalisatrice du film vendredi, Le Monde revient sur ce que l’on sait de cette affaire. Accusé par quatre anciennes compagnes, l’acteur est triplement mis en examen Sofiane Bennacer a été mis en examen en octobre par le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) pour viols présumés sur deux anciennes compagnes et pour « violences sur conjoint » concernant une troisième, a fait savoir la procureure de la République Edwige Roux-Morizot mardi, confirmant des informations du Parisien. Le comédien a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre d’une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne, qui l’accuse de viol. Les faits allégués se seraient produits « entre 2018 et 2019 » à Mulhouse, à Strasbourg et à Paris, et les victimes présumées évoluent « dans le monde du théâtre », a détaillé Edwige Roux-Morizot. Selon Le Parisien, l’acteur a connu l’une de ses accusatrices à l’école de théâtre La Filature, à Mulhouse, où « le couple se serait formé ». Les victimes présumées « décrivent une liaison sous emprise, au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu », écrit le quotidien. Lire aussi : L’acteur Sofiane Bennacer mis en examen pour viols et violences sur d’anciennes compagnes Le Théâtre national de Strasbourg (TNS), l’école où Sofiane Bennacer avait été admis en 2019, avait saisi le ministère de la culture pour des faits « de violences sexistes, sexuelles et de harcèlement dont [il] avait été informé », selon le journal. Le ministère avait ensuite fait un signalement à la justice, a déclaré Edwige Roux-Morizot, sans préciser la date. Benjamin Morel, administrateur du TNS, a dit mercredi à l’Agence France-Presse que c’est ensuite le jeune comédien lui-même « qui a pris la décision de démissionner le 19 février 2021 ». La procureure de Mulhouse a fait savoir mardi que l’acteur a été placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen, sur demande du parquet. Il lui est interdit de se rendre en région parisienne, à Strasbourg ainsi qu’à Mulhouse. Il est également interdit à M. Bennacer de rencontrer les plaignantes tout comme les témoins du dossier, parmi lesquels figure Valeria Bruni-Tedeschi, qui serait, selon la procureure, citée par Libération, l’actuelle « compagne » du comédien. L’Académie des Césars a retiré son nom des « révélations » Dans la soirée de mercredi, l’Académie des Césars a annoncé le retrait du nom de l’acteur de la liste des révélations masculines 2023, estimant que « les informations publiées par la presse (…) commandaient, sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées, de le retirer de la liste ». Lire aussi : Article réservé à nos abonnés 5 ans après #metoo, les avancées et les limites de la prévention dans le cinéma, le théâtre ou la danse L’institution du cinéma français a par ailleurs précisé qu’elle entamait « une réflexion afin d’envisager une modification du règlement qui régit l’organisation de la cérémonie des Césars, qui ne prévoit pas, à ce jour, l’hypothèse d’une mise en cause judiciaire d’un·e participant·e à un film éligible ». Le comédien clame son innocence Sofiane Bennacer a réagi mercredi, dans un long message posté sur Instagram, en clamant son innocence : « La présomption d’innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un Etat de non-droit, un Etat où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ? ». Dénonçant « de faux témoignages », il a ajouté : « Je vais peut-être me faire boycotter par le cinéma. De toute façon, je me suis fait humilier au plus profond de mon âme. (…) Je vais être libre dans quelques mois, car je n’ai rien fait. (…) S’il y avait la moindre preuve contre moi, pas de simples témoignages bidon, des vraies preuves, je serais déjà en prison. » Face à ces dénégations, Grégoire Mehl et Anne Lassalle, avocats de l’une des plaignantes, ont annoncé que leur cliente « maintient intégralement les propos et les positions déjà exprimés devant les services enquêteurs ». Une « omerta » durant le tournage des « Amandiers » ? Mais que s’est-il passé sur le tournage du film ? Est-ce que tout le monde savait ? Selon une enquête publiée par Libération jeudi, dans laquelle le journal explique avoir interrogé une trentaine de personnes, dont une quinzaine de professionnels présents lors du tournage, celui-ci se serait déroulé dans un climat d’« omerta », tant la réalisatrice tenait à travailler avec Sofiane Bennacer, décrit comme son « coup de cœur » artistique. Réalisé à l’été 2021, le film voit très vite naître des rumeurs au sujet de violences sexuelles qu’aurait commises M. Bennacer, qui occupe le premier rôle masculin du film. Des alternants et stagiaires ayant pris connaissance d’un premier dépôt de plainte disent avoir alerté la réalisatrice trois jours après le début du tournage. Valeria Bruni-Tedeschi aurait alors réuni l’équipe pour défendre le comédien en son absence, « comme à chaque fois que son cas sera abordé sur le tournage ». L’une des témoins de Libération avance : « Elle nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements. » Après la démission de deux personnes, une chappe de plomb s’installe, selon Libération, autour d’un « secret dont il ne fa[ut] pas parler » : la production et la réalisatrice maintiennent coûte que coûte l’acteur, et les rumeurs, bien que confortées par le dépôt de plaintes, sont reléguées à leur simple rang. Patrick Sobelman, l’un des deux producteurs du film, a réagi vendredi matin à la publication de cette enquête. « A aucun moment la production ne savait avant de l’engager, et à aucun moment la production n’a orchestré la moindre omerta pour faire en sorte que rien ne sorte de cette histoire », a-t-il déclaré sur France Inter, précisant qu’« il était absolument impossible d’arrêter le tournage et de virer Sofiane pour une raison très simple : nous n’avions aucune base juridique pour faire ça ». « Il ne s’est rien passé de répréhensible pendant tout le tournage du film », a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant qu’il y a pu « y avoir une ambiance compliquée pour certains parce qu’ils se retrouvaient dans une situation qu’ils n’avaient pas voulue et ça jetait comme ça un doute, une ombre ». « Nous avons appris sa mise en examen il y a un mois [et] qu’il y a eu quatre plaintes différentes. Ce n’est pas la même chose : nous ne savions pas et nous l’avons appris en même temps que tout le monde », a-t-il répété. Valeria Bruni-Tedeschi dénonce un « lynchage » médiatique La réalisatrice du film Les Amandiers est sortie du silence vendredi pour dénoncer un « lynchage médiatique », après la parution de l’enquête de Libération. « A ce jour, tout le monde sait qu’il n’a pas été jugé, et un tel procédé relève, selon moi, d’un pur lynchage médiatique, procédé très éloigné d’une volonté d’informer de façon objective et impartiale », écrit Valéria Bruni-Tedeschi dans un communiqué. Elle s’y dit « indignée qu’un journal comme Libération puisse piétiner à ce point la présomption d’innocence ». Cette dernière confirme toutefois avoir eu « connaissance » des « rumeurs » dont faisait l’objet le jeune comédien pendant le tournage. « Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui », avance-t-elle en soulignant avoir été « impressionnée artistiquement par Sofiane Bennacer dès la première seconde du casting » de son film. « Plus tard, nous avons eu connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée », explique-t-elle encore. A propos des victimes présumées, l’actrice assure avoir « un immense respect pour la libération de la parole des femmes », mais elle insiste sur la « présomption d’innocence » en confiant avoir été elle-même « abusée dans [son] enfance » et en affirmant connaître « la douleur de ne pas avoir été prise au sérieux ». Valeria Bruni-Tedeschi a ensuite reçu le soutien de sa sœur, Carla Bruni. Dans un long post sur Instagram, l’épouse de Nicolas Sarkozy a réagi vendredi pour défendre la « présomption d’innocence » et apporter son « soutien total et absolu à [sa] sœur », s’en prenant directement à Libération. L’actrice et danseuse Andréa Bescond, réalisatrice du film Les Chatouilles – où elle revient sur les violences sexuelles dont elle a été victime enfant – a répondu à Carla Burni au micro de LCI. Elle a apporté directement son soutien aux victimes présumées et lancé : « C’est une féministe en carton. (…) J’ai répondu [en commentaire à sa publication] en disant qu’il fallait un peu de respect pour les victimes, elles sont quand même quatre, il y a des mises en examen. » Le Monde avec AFP -------------------------------------------------------- Affaire Sofiane Bennacer : pour la productrice des “Amandiers”, “il n’y a pas eu d’omerta sur le tournage” Par Hélène Marzolf dans Télérama - 27 nov. 2022 Alexandra Henochsberg, coproductrice et distributrice du film “Les Amandiers”, réagit pour “Télérama” aux révélations concernant Sofiane Bennacer, l’acteur principal du film de Valeria Bruni Tedeschi, mis en examen pour viols et violence sur conjoint. Une onde de choc secoue le cinéma français, après les mises en examen de Sofiane Bennacer, l’acteur principal des Amandiers, de Valeria Bruni-Tedeschi, dans des affaires de viols et de violence sur conjoint. Mise en cause dans une enquête du quotidien Libération, la production du film a publié, le 25 novembre, un communiqué, et se défend d’avoir fait régner l’omerta sur le plateau. Co-productrice et distributrice du film à travers sa société Ad Vitam, Alexandra Henochsberg s’explique. Avec ce communiqué, votre coproducteur, Patrick Sobelman (Agat Films), et vous-même, avez cherché à répondre à Libération…
L’article de Libé nous ayant paru très à charge, nous avons voulu donner notre point de vue, rétablir notre vérité. Nous traversons une période très dure, et il nous paraissait important, dans ce texte, de retracer le plus clairement possible la manière dont les choses s’étaient passées. Lire aussi : Affaire Sofiane Bennacer : Valeria Bruni Tedeschi répond, des cinémas déprogramment “Les Amandiers”3 minutes à lire Vous y précisez n’avoir pas été mise au courant d’une plainte pour viol au moment d’engager Sofiane Bennacer. En revanche, des bruits circulaient déjà concernant une possible agression sexuelle.
Au moment du casting, nous avons eu en effet connaissance d’une rumeur concernant le comportement violent qu’aurait eu Sofiane envers une jeune comédienne deux ans avant d’avoir intégré le Théâtre national de Strasbourg (TNS). Patrick Sobelman a alors contacté le directeur de l’école, Stanislas Nordey, qui a confirmé avoir convoqué Sofiane suite à ces accusations, et lui avoir conseillé de quitter l’établissement. Mais - et je tiens à insister là-dessus - à aucun moment Stanislas ne nous a parlé de plainte pour viol - alors qu’elle existait déjà - ni d’un signalement auprès du procureur de la république. Dans un article du Monde, il reconnaît d‘ailleurs avoir omis volontairement de mentionner ces éléments, et en explique les raisons [Stanislas Nordey argue d’« un devoir de réserve », et dit aussi avoir respecté la volonté de la plaignante qui ne voulait pas que l’affaire s’ébruite, ndlr]. Quant à cette histoire de signalement, nous l’avons découverte il y a seulement quelques jours, dans Le Parisien. Que Stanislas ne nous ait rien dit, c’est son droit, je ne vais pas l’attaquer là-dessus. Mais la conséquence, c’est qu’on s’en prend plein la figure aujourd’hui. “Depuis ma place de productrice, cela me paraissait impossible de dire : ok, arrêtons le tournage.” Après avoir été avertie, comme toute l’équipe, de l’existence de cette plainte, par une jeune alternante présente sur le plateau des Amandiers, vous avez été accusés, ainsi que la réalisatrice, d’avoir fait régner l’omerta..
Je ne peux que contester ce terme d’omerta ! Dès que nous avons découvert cette plainte – au bout de deux jours de tournage –, nous avons fait une réunion avec les jeunes alternants, nous avons énormément discuté avec l’équipe et les comédiens. Franchement, j’estime que nous n’avons pas minimisé l’onde de choc que cette affaire suscitait, ni fait régner la terreur. Émotionnellement, je comprends que cela ait été compliqué pour tout le monde. Parmi les jeunes, certains auraient voulu qu’on licencie Sofiane dans l’heure. Je comprends cette position, elle est tout à fait défendable. Mais depuis ma place de productrice, cela me paraissait impossible de dire : ok, arrêtons le tournage, immédiatement, mettons 90 personnes au chômage. Patrick et moi avons une responsabilité vis-à-vis des dizaines de personnes que nous avons engagées. Nous nous sommes retrouvés dans une situation impossible, d’autant que notre réalisatrice n’envisageait pas de continuer le tournage sans Sofiane. Avez-vous néanmoins senti un malaise au sein de l’équipe ?
La jeune fille qui nous avait avertis de la plainte a préféré partir dès le début du tournage, ainsi qu’une autre étudiante en alternance de la Cinéfabrique qui travaillait comme assistante-monteuse. En dehors de cela, l’ambiance était bonne et il arrivait que les jeunes fassent la fête entre eux. Après le papier de Libé, j’ai parlé avec les chefs de poste qui, eux aussi, sont tombés des nues en découvrant la teneur de l’article. Alors bien sûr, la présence de Sofiane n’était pas anodine, et a pu mettre des gens mal à l’aise. Mais lors de la fête de fin du tournage, tout le monde était présent. Et depuis, nous sommes tous restés en contacts, nous échangeons sur des fils WhatsApp, nous avons assuré une projection pour l’équipe avec 200 personnes dans la salle parisienne du Silencio des Prés, nous avons organisé une avant-première… Lire aussi : Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé Entre le tournage à partir de juin 2021 et le premier article du Parisien, le 23 octobre 2022, vous n’avez entendu parler de rien ?
Nous savions depuis mai que Libé enquêtait, car la journaliste nous avait contactés, Patrick Sobelman, moi-même, la réalisatrice, et une partie de l’équipe pendant le festival de Cannes. Elle nous a expliqué par mail qu’elle était en train de recueillir un certain nombre de « témoignages à charge », mais nous n’avions à cette époque-là aucune idée de la nature de ces charges, ni des témoignages… Elle nous a posé des questions précises sur les conditions de tournage, questions auxquelles nous avons répondu. Je ne savais absolument pas à cette époque qu’il y avait plusieurs plaignantes, et je ne l’ai découvert que ces derniers jours dans la presse. Et à ce moment-là, Sofiane n’avait pas encore été convoqué par la police. Comment s’est passée la promotion du film dans ce contexte ?
Sofiane, en octobre, nous a signalé qu’il n’y participerait plus, car l’enquête avait démarré [il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ndlr], ce qui m’a soulagée. Et avant cela, il a été tenu, le plus possible, à l’écart de la promotion. Il est venu à Cannes, mais brièvement, il n’était pas présent au Festival de la Rochelle où le film a été présenté, ni à un certain nombre d’autres événements. “Ce qui s’est passé avec l’affaire Polanski, sous l’ancienne direction, semble ne plus pouvoir se reproduire aujourd’hui.” Pouvez-vous comprendre que dans ce contexte, le fait que Sofiane ait été placé sur la liste des comédiens retenus pour les Révélations des César ait été problématique, d’autant que la directrice de casting des Amandiers, Marion Touitou, fait partie du comité de sélection ?
Oui, mais je ne veux pas commenter ça, ce n’est pas mon rôle. Ce que je peux dire, c’est que je suis heureuse que l’académie des César ait réagi dès qu’elle a su que Sofiane était poursuivi, dès les révélations du Parisien. Son nom a été immédiatement retiré de la liste, et l’Académie réfléchit à un changement de son règlement.. Je trouve positif qu’au moins, ce type d’affaires puisse permettre de faire changer les choses. Ce qui s’est passé avec l’affaire Polanski, sous l’ancienne direction, semble ne plus pouvoir se reproduire aujourd’hui, et je trouve ça très bien que l’institution évolue. Plusieurs cinémas ont déprogrammé Les Amandiers. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Cela me chagrine, mais je peux le comprendre. Si des cinémas se sentent mal à l’aise à l’idée de programmer Les Amandiers, je respecte ce choix, et j’ai d’ailleurs envoyé un communiqué aux exploitants dans ce sens. Ils sont confrontés au public tous les jours, ils ont vis-à-vis de lui une responsabilité, doivent lui rendre des comptes, et je conçois que ce soit compliqué pour eux de mettre à l’affiche un film dont l’acteur principal est accusé de viol. Je n’ai aucun souci avec ça. De la même manière que je n’ai aucun souci avec le fait que des gens, pendant le tournage, aient voulu quitter le plateau. Je trouve tout cela malheureux pour le film mais je le comprends. Comment envisagez-vous la suite ?
Patrick (Sobelman) et moi-même avons reçu énormément de messages de collègues producteurs qui, comme nous, se demandent comment gérer ce type de situations à l’avenir. Pour l’instant nous n’avons pas de pistes, nous sommes sous le choc, mais je pense en effet qu’il faut entamer, tous ensemble, une réflexion collective. ------------------------------------------------ Affaire Sofiane Bennacer : Sandra Nkaké, au casting des “Amandiers”, “sous le choc et en colère” Par Valérie Lehoux dans Télérama - 27 nov. 2022 Sandra Nkaké, chanteuse et comédienne, figure au générique des “Amandiers”, le film de Valeria Bruni Tedeschi dont l’acteur principal, Sofiane Bennacer, est mis en examen pour viol. Pour elle, cette affaire illustre une fois de plus le peu de cas que l’on fait de la parole des femmes. Chanteuse et comédienne, Sandra Nkaké a participé au tournage des Amandiers, film de Valeria Bruni Tedeschi au centre d’un scandale – l’un de ses acteurs principaux, Sofiane Bennacer, étant accusé de viols et de violences, visé par une plainte et mis en examen. La réalisatrice y a répondu dans un communiqué, brandissant la présomption d’innocence. Elle assume pleinement le fait d’avoir confié un rôle central au comédien de 25 ans, même si, dit-elle, elle avait eu vent de « rumeurs » à son sujet ; quant au dépôt d’une plainte à son encontre, elle l’avait appris juste après le début du tournage. Valeria Bruni Tedeschi qui dénonce par ailleurs un « lynchage médiatique », l’affaire ayant fait, ce vendredi 25 novembre, la une du quotidien Libération. Le même jour (en l’occurrence, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes), Sandra Nkaké publiait sur Instagram une vidéo et un texte, dans lesquels elle explique avoir été victime d’inceste durant l’enfance : « Personne ne m’a protégée, personne ne m’a écoutée… » Réagissant au scandale des Amandiers, elle nous dit sa stupeur et sa colère. Lire aussi : “Les Amandiers” déprogrammé d’un cinéma : “On ne peut plus montrer le film de manière anodine”3 minutes à lire « Je suis sous le choc.
Sous le choc, parce qu’encore une fois des victimes sont niées dans leurs souffrances.
Sous le choc, parce que tourner avec Valeria Bruni Tedeschi a été un travail intense, incarné et profond. Je lui suis reconnaissante de la confiance qu’elle m’a portée. Mais cette reconnaissance a aujourd’hui un goût amer. Je n’étais pas au courant de ces accusations, je n’en ai pris connaissance qu’en écoutant la radio avant-hier. Si je l’avais été, je n’aurais pas pu accepter le rôle. Et je suis en colère. La violence subie fait partie de ma vie. Découvrir ces accusations ainsi, soudainement, après le tournage, est une chose très violente. Tout le monde me pose la question : “Est-ce que tu savais ?” J’ai tourné quatre jours et devant moi, cela n’a jamais été évoqué, ni en rendez-vous, ni en répétitions, ni pendant le tournage. À aucun moment. J’apprends que des personnes, qui étaient au courant, ont quitté le projet et l’ont fait en silence, parce qu’elles n’ont pas été accompagnées. Nous portons une responsabilité collective sur la manière dont nous nous engageons dans la vie et dans le travail. Quand je constitue une équipe pour une tournée, cela fait partie de nos toutes premières discussions : avant même de parler de musique, de planning, de cachets, nous nous demandons dans quel environnement nous voulons travailler, avec quel genre de partenaires, quelles règles de comportement… C’est un préalable important. Et cela me fait mal au ventre de penser qu’on peut jouer ensemble, faire une fête de fin de tournage, se retrouver sur les marches de Cannes… Alors que beaucoup savent, et ne parlent pas. C’est insupportable. Cette histoire pose une fois de plus la question de la prise en compte de la parole des victimes présumées. Elles ne sont jamais mises au rang de sujets, ou très peu. Cinq ans après #MeToo, il est important de continuer de nous fédérer, et de lutter. Les choses avancent-elles trop lentement ? Au regard de nos exigences, peut-être. Mais si l’on remet tout cela dans la perspective de l’Histoire, si on les regarde à travers le prisme de siècles et de siècles où la parole des victimes a été niée, alors oui, on avance. Lentement. Mais on avance. » Lire aussi : Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé3 minutes à lire Sofiane Bennacer accusé de viols : ce que disent les théâtres qui l’ont formé L’acteur de 25 ans à l’affiche du film “Les Amandiers” est mis en examen pour viols sur des ex-compagnes, dont au moins une comédienne. Y a-t-il eu une faille dans le système ? Stanislas Nordey, qui a encadré Sofiane Bennacer au TNS, assure avoir activé tous les leviers à sa disposition. Mis en examen en octobre pour viols et violences sur d’anciennes compagnes, l’acteur Sofiane Bennacer (25 ans), découverte du film de Valéria Bruni Tedeschi Les Amandiers, vient de voir son nom retiré de la liste des révélations concourant aux César 2023. Ainsi en a décidé une académie des César soucieuse de ne pas revivre l’onde de choc qui avait suivi, en février 2020, le sacre de Roman Polanski. « Sans préjudice de la présomption d’innocence et par respect pour les victimes présumées », l’académie a donc fait le choix de la prudence. Désormais placée sous les feux des projecteurs, « l’affaire » Sofiane Bennacer aurait débuté dans l’intimité d’un couple. En septembre 2018, le jeune Marseillais intègre la classe préparatoire qui vient d’être créée au sein du théâtre La Filature, à Mulhouse. Il y rencontre Juliette, étudiante originaire de la ville. « Il semblait clair qu’entre eux se nouait une relation amoureuse », témoigne Monica Guillouet-Gélys, ex-directrice de la Filature qui se dit aujourd’hui « très triste de ce qui se passe ». Ni elle ni son équipe n’ont « été témoins de quoi que ce soit ». Dès la fin des cours, rappelle-t-elle, les élèves étaient priés de quitter les locaux. « Si quoi que ce soit avait eu lieu chez nous, nous l’aurions vu. » Le viol présumé aurait eu lieu à cette époque sans que Juliette en fasse alors état auprès de l’établissement. Deux plaintes supplémentaires À l’automne 2019, le jeune couple est séparé. Sofiane rejoint l’École du Théâtre national de Strasbourg où il vient d’être admis. Juliette, recalée, redouble avant de finalement réussir, un an plus tard, ce même concours du TNS. « Réaliser qu’on n’est pas consentant à un acte sexuel, cela peut prendre du temps. Est-ce de retrouver Sofiane deux ans après les faits qui a réactivé chez Juliette certaines choses ? » s’interroge Stanislas Nordey. Disant hériter d’une « situation privée entre deux adultes », le directeur du TNS assure avoir activé tous les leviers à sa disposition. « Dès que Juliette m’a dit vouloir porter plainte, j’ai immédiatement fait, comme nous y oblige la loi, un signalement au procureur de la République. J’ai alerté les associations et le ministère de la Culture. J’ai conseillé à Sofiane de s’éloigner pour apaiser les esprits. Il a pris des congés. Lorsqu’il est revenu, il a donné sa démission. Pour nous qui nous étions assurés que Juliette n’était plus en danger, l’histoire s’arrêtait là. » L’institution n’aurait donc pas failli dans sa prise en charge. Mais aujourd’hui, deux femmes de plus ont, elles aussi, porté plainte, a-t-on appris dans Le Parisien. Lire aussi : Étincelante dans “Les Amandiers”, Nadia Tereszkiewicz, l’étoile polaire2 minutes à lire Le TNS aurait-il dû aller plus loin et en avait-il les moyens ? « Certains élèves me demandaient de virer Sofiane mais je n’en ai pas le droit. Nous ne sommes pas force de justice ou de police », explique Stanislas Nordey, qui n’avait jamais eu à gérer ce genre de situations. Il a donc suivi à la lettre les préconisations du ministère de la Culture. Mis en place par Roselyne Bachelot-Narquin en novembre 2021, un « Plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant » conditionne désormais le versement des subventions au respect de certaines obligations. Parmi celles-ci, la mise en place de cellules d’écoute et la présence de référents dans les établissements nationaux du spectacle vivant. “C’est lorsqu’on se croit en sécurité que le danger peut revenir” Est-ce suffisant pour rassurer les élèves et éviter le dérapage qui voit un mot déplacé se transformer en geste inacceptable ? « Non. Il faut aller bien au-delà », répond Claire Lasne Darcueil. La directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) dispose d’une cellule d’écoute interne et d’une seconde, externe, au sein de l’université Paris Sciences et Lettres. À l’en croire, c’est une chance : « Notre maison est petite. Les choses se savent vite. Il faut une adresse au-dehors pour que les élèves s’expriment en toute liberté. » La patronne du CNSAD est par ailleurs de celles qui tranchent dans le vif : « C’est lorsqu’on se croit en sécurité que le danger peut revenir. La meilleure façon de sécuriser réellement les jeunes acteurs qui viennent parler, c’est parfois d’avoir le courage de demander aux incriminés de partir. Même si ça m’a coûté, je l’ai fait à quatre reprises au sein du Conservatoire. » La mesure est radicale mais, précise Claire Lasne Darcueil, « elle est autorisée par le Code l’éducation dont disposent les directeurs, et qui permet, après commission de discipline, la suspension temporaire ou définitive en cas de mise en danger des étudiants ». Si cette mesure a le mérite de désamorcer les problèmes en leur coupant d’emblée l’herbe sous le pied, elle peut aussi passer pour très expéditive. Pour éviter d’en arriver là, c’est à la racine du problème qu’il faudrait pouvoir s’attaquer : « Éduquer nos garçons et faire en sorte que les filles parlent plus vite », souffle Monica Guillouet-Gélys. Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" ------------------------------------------ Légende photo : L’acteur Sofiane Bennacer au Festival de Cannes, le 23 mai 2022, pour la présentation du film de Valeria Bruni Tedeschi, « Les Amandiers ». STÉPHANE MAHE/REUTERS
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 6, 2022 6:12 PM
|
Par Louis Juzot dans le blog Hottello - le 3 décembre 2022 1983, conception Alice Carré et Margaux Eskenazi, assistant à la mise en scène Chloé Bonifay, scénographie Julie Boillot Savarin, lumières Mariam Rency, costumes Sarah Lazaro, son Antoine Prost, vidéo Quentin Vigier – Compagnie Nova. Alice Carré pour l’écriture et Margaux Eskenazi, pour la mise en scène, toutes deux de la Compagnie Nova, poursuivent « leur réflexion sur les identités françaises et les transmissions mémorielles », à travers le dernier volet du triptyque Ecrire en Pays Dominé. Les deux premiers, Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre et Et le cœur fume encore étaient consacrés à la négritude et la créolité, d’une part, et à la Guerre d’Algérie d’autre part, alimentés par des matériaux littéraires ou des témoignages, mettant à jour le non dit du discours hexagonal dominant pour la reconnaissance d’une parole longtemps étouffée. 1983 nous conduit au cœur de l’hexagone justement, et entremêle les récits de combats politiques et sociaux de ces années-là, quand la gauche vient d’arriver au pouvoir, et où tous les espoirs sont permis. Le combat des radios libres, celui contre la fermeture des usines automobiles Talbot à Poissy, la Marche pour l’Egalité, partie des Minguettes à Vénissieux, sont l‘occasion de croiser l’histoire collective et ses soubresauts avec l’intimité des familles ou des amis. L’enthousiasme des luttes sociales ou des initiatives que l’on qualifierait aujourd’hui de citoyennes, comme la création des radios libres, sont retraduits avec une candeur non feinte, une ingénuité un peu brute, comme la montée du racisme et des tensions sociales. Les comédiens, Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cisse, Anissa Kaki, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle , Raphaël Naasz, Eva Rami, endossent plusieurs rôles et changent joyeusement de look à vue car les scènes vives s’enchaînent rapidement. Le décor fixe joue sur plusieurs espaces permettant aux scènes de se succéder avec fluidité et au public de suivre et de relier ces différents récits comme dans un film ou une série. Quelques imitations décalées viennent s’introduire dans les histoires privées, comme celle de Jean-Marie Le Pen face à Jean-Louis Servan- Schreiber à « L ‘Heure de Vérité » ou d’Yves Montant présentant « Vive la Crise ». Indéniablement, les émissions de télévision de l’époque ont produit une source documentaire importante du spectacle, leur relecture est réjouissante ! Dans un autre registre, belle imitation de Rachid Taha et de Carte de séjour pour rappeler que les banlieues exprimaient hautement leurs revendications. Quant au fond, la thèse est assez simple : 1983 est la date de tous les reniements, François MItterrand choisissant le maintien dans le SME – Système monétaire européen -, prônant une politique de rigueur excluant toute relance économique. Pire, il va instrumentaliser l’extrême-droite pour tenter de se maintenir au pouvoir alors que le PS via SOS Racisme prend la main sur le mouvement issu de la Marche pour l’Egalité. Le cynisme l’emporte, ne reste plus que la sphère privée pour se réaliser comme ce représentant syndical qui abandonne le combat pour vivre en famille apaisée dans son petit pavillon de banlieue. C’est un peu simpliste et unilatéral, voire très discutable, mais la vitalité du spectacle et l’engagement des comédiens font passer l’exégèse politique au second plan, heureusement. Un spectacle efficace et divertissant sur un sujet qui ne l’est pas – une belle gageure en fin de compte. Louis Juzot Du 1er au 9 décembre à 20h, samedi 10 décembre à 15h au Théâtre de la Ville, Les Abbesses, 31 rue des Abbesses 75018 Paris. Tél : 01 42 74 22 77. Le 15 décembre, au Théâtre d’Angoulême. Les 5 et 6 janvier 2023 à l’Etoile, Mouvaux. Du 11 au 22 janvier 2023 au Théâtre Gérard Philipe Saint-Denis. Du 24 au 31 janvier, au Théâtre de la Cité internationale, Paris. Le 9 février, Le Forum, Carros. Le 14 février, au Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin. Le 16 février au Théâtre du Vésinet. Du 21 au 24 février à La Comédie de Saint-Etienne. Les 7 et 8 mars au Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence. Le 11 mars, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France. Les 18 et 19 mars à La Ferme du Buisson, Noisiel. Le 29 mars la Merise, Trappes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 5, 2022 3:54 PM
|
Par Lucile Commeaux pour Libération - 4 décembre 2022 L’adaptation à la Comédie-Française de l’œuvre d’Andersen s’avère rythmée et diverse mais prend le risque de transformer la fable en une inoffensive suite de belles scènes. Avec la Reine des neiges, voici la grande Comédie-Française occupée à jouer sur le terrain du grand divertissement, celui de Disney. Les studios ont, depuis 2013, littéralement annexé l’œuvre originale d’Hans Christian Andersen en noyant un conte hypermodifié sous les flocons, les paillettes et les chansons sucrées. Cette production tout public, signée Johanna Boyé, parvient à s’en extirper de manière plutôt convaincante, mais sans en être tout à fait libérée ou délivrée. Il faut dire que cette «histoire oubliée» est moins séduisante et plus complexe qu’attendue. Au seuil du texte original, le diable s’amuse à construire un miroir magique qui renvoie à celui qui s’y regarde le mal et le laid en toutes choses – le plus beau paysage par exemple, ressemblait à «des épinards cuits». Un jour, ce miroir est brisé, ses éclats s’éparpillent dans le vaste monde et l’un d’entre eux tombe dans l’œil d’un jeune garçon nommé Kay, occupé à jouer avec sa voisine Gerda. Devenu cruel et indifférent, il disparaît, et son amie décide d’aller le chercher jusqu’au château de la reine des neiges où il est retenu, rencontrant sur sa route obstacles et personnages fantastiques. Le conte, qu’écrit Andersen en 1844 alors qu’il est déjà célèbre dans l’Europe entière, est noir et inquiétant, qui campe ce petit garçon devenu triste et intéressé seulement par des «jeux raisonnables», et cette petite fille lancée seule sur des routes dangereuses et glacées. Sa forme surtout est irrégulière, avec ce prologue en forme de parabole, et puis cette rencontre étrange une nuit d’hiver de Kay avec la reine, qui lui donne des baisers à la fois réconfortants et dangereux. Le spectacle s’en empare dans une forme plutôt joyeuse pourtant, dans un décor mouvant et souvent coloré – fleurs vives, robes foisonnantes, chevelures fluo, danses et chansons. Dans son récit cadre, interprété par une gentille grand-mère au coin du feu (Danièle Lebrun), les péripéties du conte original trouvent un moule facile et les jeunes interprètes du couple principal, Léa Lopez et Adrien Simion, au demeurant très bons, ont tendance à surjouer la vivacité enfantine. Le diable est devenu troll, dont les cheveux rappellent ces petites figurines populaires dans les années 90. Le désir très ambigu de la reine des neiges de faire de Kay un homme accompli est adouci par la grâce juvénile de son interprète (Suliane Brahim) et la beauté lumineuse de son château, figuré en hauteur par une niche encadrée d’éclats de glace brillants. Fort bien rythmée, diverse et spectaculaire parfois – ce miroir par exemple qui s’étire en savon et éclate en une multitude de bulles –, la performance plaît sans nul doute aux plus jeunes, et attrape par-ci par-là l’attention particulière d’un public adulte sans risquer d’ennuyer les petits, dans ce passage par exemple où, dans le noir, une corneille spirituelle met Gerda sur un divan. Mais à vouloir plaire à tout le monde, le spectacle édulcore le conte, et prend le risque de transformer la fable en une inoffensive suite de belles scènes, dont certaines sont opportunément chantées et dansées, comme dans une comédie musicale. Ou comme dans un bon Disney de Noël. La Reine des neiges, l’histoire oubliée, d’après Hans Christian Andersen. Mise en scène Johanna Boyé. Avec Jérôme Pouly, Suliane Brahim, Adrien Simion, Léa Lopez, etc. A la Comédie-Française jusqu’au 8 janvier. Légende photo : L'ombres des studios Disney plane sur la pièce. (Agathe POUPENEY/Agathe Poupeney )

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2022 6:35 PM
|
Par Brigitte Salino dans le Monde - 30 nov. 2022 Dans cette adaptation de la pièce créée en 2013, le nouveau directeur du Festival d’Avignon met en scène son acteur fétiche, Tonan Quito, dans un monologue entre création et réalité.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/30/theatre-entre-les-lignes-ou-les-poupees-russes-de-tiago-rodrigues-entre-present-et-passe_6152388_3246.html?im=259188
La plupart des théâtres à l’italienne de Paris sont dotés de deux salles, une grande, et une petite qui n’existait pas à l’origine. La plus belle est celle de l’Athénée-Louis Jouvet. Voulue par Pierre Bergé, directeur du théâtre de 1977 à 1981, elle a été édifiée avec un raffinement que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une forme carrée douce, des murs peints en trompe-l’œil, 91 fauteuils : c’est un théâtre intime de rêve, où l’on se rappelle avoir découvert un très bel Aglavaine et Sélysette, de Maeterlinck, mis en scène par Françoise Merle, dans les années 1980. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Tiago Rodrigues : « Quand un artiste dirige le festival d’Avignon, il doit repenser sa façon de travailler » Depuis, on a peu à peu perdu l’habitude d’aller dans la salle Christian-Bérard, en partie parce que l’on n’y accède seulement par un escalier et qu’elle niche haut, sous les combles du théâtre. La nouvelle direction qui a succédé à Patrice Martinet en 2021 – le duo Olivier Poubelle et Olivier Mantei – offre l’occasion de remonter au septième ciel, avec une pièce de Tiago Rodrigues, Entre les lignes, jouée par Tonan Quito. Il est sur scène quand le public prend place. En jogging et baskets, avec une barbe grise bien fournie : l’allure d’un comédien dans une salle de répétition. Sur une table, il y a une machine à café dont il fait usage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les spectateurs qu’il vient servir dans la salle. Ce n’est pas rien, le café, dans l’histoire de Tonan Quito, et on comprendra vite pourquoi. L’acteur de 46 ans est un compagnon de travail de longue date de Tiago Rodrigues, l’auteur, metteur en scène et nouveau directeur du Festival d’Avignon. Tous deux ont créé Entre les lignes en 2013, à Lisbonne, et l’ont adaptée pour sa présentation à l’Athénée. Plaisir du partage d’histoires La pièce s’articule comme des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Au départ, il y a le projet de l’auteur d’écrire un monologue pour son acteur, à partir d’Œdipe roi, de Sophocle. Mais, comme toujours, nous dit Tonan Quito, Tiago Rodrigues est en retard. Il annonce une date qu’il ne tient pas et ne livre le texte qu’au dernier moment. En attendant, tous deux discutent dans une salle de répétition, en buvant du café. Et voilà que, cette fois, Tiago Rodrigues disparaît. Il ne répond pas au téléphone ou donne des rendez-vous dans un café où il ne vient pas. Jusqu’au jour où il vient, les yeux rougis. Il a un problème de vision, les ophtalmologues essaient de le soigner mais il ne peut pas écrire. Il propose à Tonan Quito que chacun travaille de son côté. Le père de l’acteur possède une bibliothèque qu’il a achetée à un major, au Mozambique. Il n’était pas cultivé, il s’est mis à lire, avec passion. Quand son fils lui parle de ses déboires, son père lui conseille de prendre une version d’Œdipe roi dans sa bibliothèque. Le livre provient du centre pénitentiaire de Lisbonne. Entre les lignes, un détenu a écrit, à la main bien sûr, une lettre à sa mère. Il lui explique pourquoi il a tué son père, sous les mots mêmes d’Œdipe apprenant qu’il a tué son père. L’écriture de Tiago Rodrigues est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir Ainsi se noue un dialogue entre hier et aujourd’hui, le geste et le jeu, la création et la réalité. Tiago Rodrigues est un as en la matière. Il sait enchâsser différents niveaux les uns dans les autres, au risque parfois d’en faire un procédé. Mais son écriture est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir. Plaisir d’un esprit vif qui jamais ne traite de haut le spectateur et souvent se moque de soi. Plaisir du partage d’histoires sensibles, comme celle d’Entre les lignes, où l’auteur, d’une main alerte, nous guide entre le théâtre et la prison, la santé et la maladie, le meurtre et la vie. Tonan Quito est à son aise dans ce monologue. Joueur, séducteur, il met la salle dans sa poche. Son art d’acteur repose sur une virtuosité discrète, dont il semble lui-même se méfier. Il est là, seul sur scène, et il sert la pièce de Tiago Rodrigues comme il offre le café : naturellement, tel un cadeau à partager. A la fin, il distribue le texte d’Entre les lignes à tous les spectateurs. Entre les lignes, de et mis en scène par Tiago Rodrigues. Avec Tonan Quito. Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, 2-4, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris 9e. Tél. : 01-53-05-19-19. De 22 € à 30 €. Du mardi au samedi, à 20 h 30. Durée : 1 h 20. Jusqu’au 17 décembre. www.athenee-theatre.com/ Brigitte Salino Légende photo : Tonan Quito dans « Entre les lignes », de Tiago Rodrigues, à l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet, à Paris, le 22 novembre 2022. MARIANO BARRIENTOS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2022 5:16 PM
|
TRIBUNE par Mona Chollet publiée dans Le Monde - 3/12/2022 La journaliste et essayiste revient sur la polémique résultant du choix de la réalisatrice du film de maintenir l’acteur Sofiane Bennacer, désormais son compagnon, dans le rôle principal, alors que des accusations de viol pesaient sur lui.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/03/mona-chollet-valeria-bruni-tedeschi-n-a-pas-analyse-les-rapports-de-pouvoir-qui-se-jouaient-aux-amandiers_6152780_3232.html
Les Amandiers, le film de Valeria Bruni-Tedeschi, et les polémiques qui l’entourent semblent être en train de cristalliser un conflit de générations au cinéma et au théâtre. La réalisatrice y reconstitue son expérience d’élève à l’école fondée, dans les années 1980, au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, par les metteurs en scène Patrice Chéreau et Pierre Romans. Nadia Tereszkiewicz y joue le rôle de Stella, le double de la cinéaste, tandis que Sofiane Bennacer interprète Etienne, inspiré de Thierry Ravel, l’ancien compagnon de Bruni-Tedeschi, également élève de l’école, mort d’une overdose, en 1991. Le 22 novembre, Le Parisien a révélé que Sofiane Bennacer avait été mis en examen en octobre pour « viols et violences sur conjoints » à la suite des plaintes de quatre femmes. Peu après le début du tournage, peut-on lire dans Libération du 25 novembre, la production des Amandiers avait déjà appris qu’une plainte pour viol avait été déposée contre son acteur principal, mais la réalisatrice avait insisté pour travailler avec lui malgré tout. Bruni-Tedeschi continue à défendre celui qui est entre-temps devenu son compagnon, invoquant la « présomption d’innocence » et parlant d’un « lynchage médiatique ». Lire aussi : Article réservé à nos abonnés L’affaire Sofiane Bennacer embarrasse le cinéma français Au-delà de l’affaire elle-même, les accusations portées contre le comédien et la façon dont Bruni-Tedeschi y réagit amplifient certaines questions soulevées par le film. Doté d’un charme et d’une vitalité indéniables, Les Amandiers montre l’utopie théâtrale que fut cette école, l’euphorie des élèves d’avoir été choisis, les amitiés et les amours qui naissaient entre eux, leur enthousiasme, leur fantaisie, leur exubérance, leur admiration pour leurs mentors, le côté touchant et parfois enfantin de ces derniers. On sourit, on rit beaucoup. Mais, de temps en temps, une scène fait sursauter. On voit Chéreau (Louis Garrel) forcer un élève à l’embrasser, un soir, alors qu’ils sont les derniers dans les locaux. On voit aussi sa brutalité envers Anaïs (Léna Garrel), qu’il humilie publiquement en lui assénant qu’il n’a jamais voulu d’elle dans l’école. Un baiser forcé Le personnage d’Anaïs est vraisemblablement inspiré d’Agnès Jaoui. En 2018, retraçant l’épopée des Amandiers, dans Le Monde du 3 août, Clément Ghys écrivait : « Le machisme règne et elles [les apprenties actrices] se prennent des savons monumentaux en cas de retard ou d’oubli de répliques. Quand il ne s’agit pas de réflexions sur le physique. Assez vite, Agnès Jaoui n’en peut plus, et, ulcérée par l’emprise de Chéreau sur tout le monde, songe à quitter l’école. » Beaucoup de critiques ont salué le fait que Valeria Bruni-Tedeschi ne dresse pas un portrait idéalisé de Chéreau, qu’elle a pourtant vénéré. Sauf que le statut de ces scènes démystifiantes n’est pas du tout clair. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Les Amandiers » et l’affaire Sofiane Bennacer, « une incroyable mise en abyme entre le film et la réalité » Interrogée par Télérama (daté du 22 mai) sur celle du baiser forcé, la réalisatrice commentait : « A l’époque, on trouvait ça normal, on rigolait de Chéreau qui essayait d’embrasser des jeunes gens dans un couloir – Chéreau avait des élans mais ne faisait pas de harcèlement, de chantage. Je ne raconte pas cette scène de façon scandaleuse, c’est un moment de gêne pour Baptiste et de solitude un peu ridicule pour Chéreau. » Sa désinvolture, et celle de ses camarades à l’époque, témoigne du fait qu’un baiser forcé n’est souvent pas perçu comme une agression sexuelle, alors qu’il répond juridiquement à cette définition. Quand c’est une femme qui le subit, on le minimise parce qu’on estime plus ou moins consciemment que le corps des femmes est une chose publique, appropriable par n’importe qui ; et quand c’est un homme, on le traite effectivement sur le mode de la plaisanterie, comme si un homme adulte n’était pas censé se formaliser pour si peu, ni avoir une intégrité physique et sexuelle qu’il prétendrait faire respecter. Modèle de séduction virile Une autre chose laisse perplexe : le traitement de l’histoire d’amour entre Stella et Etienne. Au-delà des accusations qui pèsent sur Sofiane Bennacer, son personnage apparaît comme extraordinairement malsain et toxique. Dans une scène, Adèle (Clara Bretheau) met d’ailleurs en garde Stella. Mais le film reste en quelque sorte au milieu du gué : il continue à traiter Etienne comme un jeune premier romantique et torturé avec qui l’héroïne vit une histoire d’amour certes un peu mouvementée et éprouvante, mais si intense. En plus de se montrer violent et jaloux, Etienne est lourdingue et antipathique ; on a vraiment du mal à voir ce qui séduit Stella chez lui. Le cliché est si énorme qu’il en naît presque un effet de comique involontaire. La référence à Marlon Brando, c’est-à-dire à un acteur notoirement maltraitant, tant dans ses rôles que dans sa vie, est éloquente sur les origines de ce modèle de séduction virile, que le film n’interroge pas. Le film documentaire « Des Amandiers aux Amandiers » montre une réalisatrice enfermée dans son rêve, dans sa nostalgie L’attirance de la jeune femme semble se résumer à un syndrome du saint-bernard : Etienne l’attendrit parce qu’il a eu une enfance difficile et parce qu’il « souffre » – souffrance qu’il étale à chaque réplique, ou presque. « Ce qui me touche dans un personnage violent, c’est sa douleur, c’est d’où vient la violence ; c’est cette tragédie enfantine, c’est son impuissance à s’exprimer autrement que par la violence, dit la réalisatrice dans le making of du film documentaire Des Amandiers aux Amandiers. Je vois l’enfant, en fait. Moi, par rapport à un personnage violent avec une femme, je voudrais ne pas être politiquement correcte. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La fréquentation des « Amandiers » freinée par l’affaire Sofiane Bennacer On ne peut s’empêcher de penser que Valeria Bruni-Tedeschi n’a pas analysé les rapports de pouvoir qui se jouaient aux Amandiers, que ce soit entre élèves ou entre élèves et professeurs. Dans une interview exhumée par le making of, quand on lui demande ce qu’elle attend d’un metteur en scène, la jeune Valeria répond : « Qu’il m’aime, avant tout – même si je trouve que je n’ai pas tellement de raisons d’être aimée. Et puis qu’il me casse, aussi. Qu’il me casse. Qu’il me casse bien. Qu’il me casse tout. Qu’il me casse ! Qu’il me casse en deux, qu’il me casse, mes défenses et tout ça. » Abus de pouvoir Ces lieux communs masochistes, elle ne les a pas inventés : ils sont omniprésents au théâtre et au cinéma, où ils justifient toutes sortes de maltraitances. On pourrait comprendre et même respecter cette difficulté de la cinéaste à remettre en question la formation qu’elle a reçue. On le pourrait d’autant plus que, dans le communiqué qu’elle a publié en réaction à l’enquête de Libération, elle dit avoir été « abusée dans [son] enfance » et connaître « la douleur de ne pas avoir été prise au sérieux ». Sauf qu’ici d’autres personnes sont impliquées. Lorsqu’elle décide de faire jouer sa jeunesse à ses acteurs, en se mettant elle-même dans le rôle que tenait Chéreau à l’époque, elle s’expose à reproduire les travers qui ont marqué sa formation. On retrouve ce raisonnement déconcertant selon lequel, si on refusait les abus de pouvoir, la vie deviendrait sinistre. Naïvement, on a envie de demander : pourquoi ? Des Amandiers aux Amandiers montre une réalisatrice enfermée dans son rêve, dans sa nostalgie. On n’y trouverait rien à redire – mettre les autres au service de son rêve, c’est la définition de la mise en scène – s’il n’y avait pas chez elle un tel aveuglement aux abus de pouvoir, les siens comme ceux des autres. Ces abus de pouvoir sont admis et même jugés admirables lorsqu’ils sont le fait de metteurs en scène masculins et blancs, et ne sont en général dénoncés que lorsqu’ils sont pratiqués par une femme ou par une personne non blanche (se souvenir de l’affaire Kechiche après La Vie d’Adèle), dont la tyrannie est considérée comme moins légitime. Mais cela ne les rend pas moins problématiques dans tous les cas. Sur le tournage, tel que le montre Des Amandiers aux Amandiers, Bruni-Tedeschi soumet ses acteurs à un bombardement de directives psychologisantes et intrusives, qui pourrait n’être qu’agaçant, mais qui dérape quand elle les pousse à révéler devant toute l’équipe leurs secrets les plus intimes. On a très mal pour Vassili Schneider, en particulier. « Le film a été un petit peu comme une thérapie parfois, et parfois comme une antithérapie : on essaie de creuser les choses qui nous détruisent le plus », commente le jeune homme (23 ans), sans qu’on voie en quoi ce jeu de massacre serait indispensable à la réussite d’un film. Un partage inégal du droit à la parole Des Amandiers aux Amandiers est, à l’évidence, conçu comme une hagiographie de la cinéaste – il est coréalisé par Karine Silla Perez, épouse de Vincent Perez, qui fut le camarade de Bruni-Tedeschi aux Amandiers et le compagnon de sa sœur, Carla Bruni. Souvent débutants, les jeunes acteurs qui y sont interrogés ne sont pas en position de formuler autre chose que des louanges au sujet d’une réalisatrice confirmée qui est aussi, rappelons-le, une femme immensément riche et la belle-sœur d’un ancien président de la République. L’une dit tout de même, en termes très diplomatiques, que le tournage a été difficile : « Mon caractère n’est pas vraiment compatible avec (…) cette manière de me bousculer. » Ainsi l’interdiction faite à l’équipe (selon Libération du 25 novembre) d’évoquer les accusations pesant sur Sofiane Bennacer – une omerta seulement brisée, une nuit, par l’intervention de colleuses féministes au courant de l’affaire – semble n’avoir fait que prolonger un partage inégal du droit à la parole sur le tournage, recoupant des hiérarchies professionnelles, sociales, générationnelles. Des Amandiers aux Amandiers montre une réalisatrice engagée dans un combat pour réhabiliter les valeurs de sa génération. Ce serait anodin si elle se contentait d’expliquer à ses jeunes acteurs ce que représentait Coluche dans les années 1980. Mais cela s’accompagne d’imprécations contre l’époque actuelle, qui serait trop morale. « Je trouve cette génération beaucoup plus précautionneuse que la nôtre, et vraiment ça m’a fait plaisir de les malmener », fanfaronne-t-elle. Avec le tollé que suscite aujourd’hui la façon dont elle protège son acteur, il se produit un retour de boomerang : cette génération à laquelle elle prétendait faire la leçon lui tient tête et affirme avec force son refus de tolérer les violences sexuelles. Au lieu de s’attendrir sur la « douleur » de l’homme violent, d’en faire une excuse, elle clame sa volonté de prendre plutôt en compte la douleur des femmes qui l’accusent. Faute d’examen critique, la bulle de rêve et de nostalgie a volé en éclats. « Aujourd’hui, une telle école ne pourrait plus exister. Tant mieux. Mais alors, cette liberté et cette folie-là ne peuvent plus exister non plus. Cette absence totale de limites nous emmenait dans des endroits… intéressants », disait encore Bruni-Tedeschi à Télérama en mai. Ici, on retrouve ce raisonnement déconcertant selon lequel, si on refusait les abus de pouvoir, la vie deviendrait sinistre. Naïvement, on a envie de demander : pourquoi ? Pourquoi ne pourrait-on pas garder la liberté, l’exubérance, la fantaisie, tout en s’assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le monde, tout en refusant d’infliger ou de tolérer des violences sexuelles, physiques, psychologiques ? Le tri n’est pas si difficile à faire. Et, même s’il l’était, cela vaudrait la peine de s’y atteler. Sous peine de continuer à passer des bataillons de comédiennes et comédiens par pertes et profits. Mona Chollet est journaliste et essayiste, autrice du livre « D’images et d’eau fraîche » (Flammarion, 192 pages, 19,90 euros, 2022). Ce texte est la version raccourcie d’un billet paru sur son blog. Après la publication en ligne de ce texte, Vassili Schneider a répondu sur Instagram (30 novembre) : « En ce qui me concerne, il n’y a eu que du positif. Valeria nous a aidés à nous dépasser, à sortir de nos zones de confort, mais toujours avec énormément de bienveillance. Oui, j’ai dit qu’“on essaie de creuser les choses qui nous détruisent le plus”, mais ça fait partie du travail d’acteur. Tout acteur essaie de se mettre émotionnellement le plus à nu. C’est notre travail et je trouve injuste d’accuser Valeria sur sa manière de nous avoir guidés dans ce processus. Si j’ai eu envie de me livrer ce jour-là devant Valeria et la caméra de Karine Silla, c’était de manière lucide et consentante. » Mona Chollet Journaliste et essayiste En complément de ce texte, il est utile d'écouter l'émission "Signe des temps" diffusée le 4 décembre sur France Culture Lien pour l'écoute de l'émission -
Sa sortie en salle le 16 novembre dernier s’est vu parasitée une semaine plus tard par les révélations du Parisien selon lesquelles l’un de ses acteurs principaux, Sofiane Bennacer, 25 ans, originaire d’une famille ouvrière de Marseille, se trouve sous le coup de quatre procédures judiciaires pour viols et violences sur des ex-compagnes qui auraient été commis entre 2018 et 2019, alors qu’il étudiait le théâtre au Théâtre Nationale de Strasbourg. Libération a fait sa Une de l’affaire en publiant des témoignages de techniciens et alternants accusant la production et la réalisatrice d’avoir embauché Sofiane Bennacer en connaissance de cause, et organisé sur le tournage ce que Libération appelle une Omerta sur ces accusations. Sofiane Bennacer, aujourd’hui compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi qui soutient son choix de l’avoir fait travailler a nié dans un communiqué la véracité de ces accusations. Le débat qui fait rage depuis rebondit ce week-end avec la publication dans Le Monde d’un texte de Mona Chollet d’abord publié sur son blog et dans lequel la journaliste fait le lien entre ces accusations de viol, qu’elle prend pour argent comptant, et la direction d’acteurs de Valeria Bruni-Tedeschi qui reposerait selon elle sur des méthodes devenues intolérables depuis MeToo. Les invités du jour Marc Weitzmann reçoit : - Marc Citti, comédien et auteur de Les enfants de Chéreau : une école de comédiens paru aux éditions Actes Sud en 2015
- Michel Guerrin, rédacteur en chef au journal Le Monde
- Coraly Zahonero, comédienne, et notamment dans Les Trois Sœurs, téléfilm de Valeria Bruni Tedeschi, d’après l’œuvre de Tchekhov
metteuse en scène, sociétaire de la Comédie française

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 2, 2022 8:33 AM
|
Par Corinne Denailles dans Webthéâtre - 27 nov. 2022 Entre les lignes d’un dialogue entre Œdipe et le devin Tirésias, la lettre d’un homme en prison à sa mère. Tónan Quito, en survêtement et baskets, lit le texte qui défile en arrière-plan, sur deux lignes, lecture interminable dès la première minute jusqu’à ce qu’il pose son livret pour s’adresser au public, qui, soulagé, peut respirer à nouveau normalement. Le spectacle bascule provisoirement vers la comédie. Puis, le comédien portugais reprend la lecture. Au double récit s’ajoute l’histoire de la pièce en train de ne pas se faire, le dialogue entre Tónan et Tiago, la genèse rocambolesque de cette lettre écrite au centre pénitencier de Lisbonne qu’on a retrouvée dans une bibliothèque au Mozambique entre les pages d’Œdipe roi de Sophocle. Les connexions se font entre les récits comme autant de nouvelles synapses et déploient des mises en abyme en cascade. Tiago devient aveugle, Tónan confie à la fin ses problèmes de vue, le vieil aveugle à la bibliothèque de la prison commente un passage de Don Quichotte et dicte à son compagnon la lettre d’un prisonnier à sa dulcinée. Ces deux vieillards, ce sont Tiago et Tónan en train d’inventer l’histoire qu’on nous raconte.
Tiago Rodrigues interroge les liens entre dramaturge et comédien, mais aussi entre fiction et réalité ; il métabolise le réel au profit de l’imaginaire, l’auteur et le comédien devenus personnages rejoignent Œdipe, Tirésias, Jocaste, Don Quichotte sans quitter la réalité puisque ce sont les manipulateurs qui se prennent eux-mêmes pour des marionnettes entre les mains de leur créateur.
On admire la virtuosité et la complexité de l’écriture funambulesque, caractéristique de l’auteur, sans pourtant adhérer vraiment au spectacle. Par choix, le comédien tient le texte à distance. Quand vient s’ajouter une dimension supplémentaire avec les didascalies soi-disant écrites par la fille de Tiago, il les exécute à dessein de manière caricaturale, mais cela tourne à vide. Et il n’est plus personne quand, à la fin du spectacle, il explique au public que la pièce n’a pas eu lieu, qu’elle restera peut-être coincée dans le futur pour ne pas avoir pu s’inscrire dans un passé. Il reste extérieur au récit et nous aussi. On pouvait espérer qu’un grain de folie l’entraîne au contraire à prendre tous les partis, un peu comme Cyrano dans la tirade du nez, à s’engager également dans toutes les instances de lecture. Les options de jeu ne servent pas le récit pourtant riche de fortes potentialités.
Entre les lignes, une création de Tiago Rodrigues et Tónan Quito. Texte, Tiago Rodrigues. Traduction, Thomas Resendes. Avec Tónan Quito. Décor, lumières, costumes : Magda Bizarro, Tiago Rodrigues, Tónan Quito. A Paris, A l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet jusqu’au 17 décembre 2022. Durée : 1h20.
Crédit photo© Mariano Barrientos

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 1, 2022 6:08 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 30/11/2022
Dans « Une autre histoire du théâtre », Fanny de Chaillé met en scène quatre jeunes comédiens qui racontent leur passion pour cet art.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/30/a-chaillot-une-mise-en-abyme-de-l-amour-du-theatre-vivante-et-ludique_6152406_3246.html
La question est simple. Les réponses, vertigineuses. Cette question, on peut la formuler ainsi : en quoi l’histoire du théâtre concerne-t-elle chacun d’entre nous ? La metteuse en scène Fanny de Chaillé y répond avec un spectacle aussi drôle et accessible que brillant et profond, travaillant son sujet dans sa forme même, Une autre histoire du théâtre, qui a fait un tabac tout au long des représentations au Théâtre public de Montreuil (Seine-Saint-Denis), où la pièce a été jouée avant de partir au Théâtre de Chaillot, à Paris, puis en tournée. La grande force du spectacle, c’est la transparence avec laquelle il emboîte différents niveaux de lecture sans jamais prendre le spectateur de haut. Fanny de Chaillé en a eu l’idée lors de sa création précédente, Le Chœur, menée avec quatre jeunes comédiens. Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala et Valentine Vittoz avaient entre 25 et 30 ans, et la metteuse en scène leur a posé les questions suivantes : « Pourquoi faire ce choix de devenir acteur aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela met en jeu chez vous ? En quoi cela vous relie au monde dans lequel vous vivez ? » La grande force du spectacle est la transparence avec laquelle il emboîte différents niveaux de lecture sans jamais prendre le spectateur de haut Ces interrogations les ont menés vers l’envie de raconter « une autre histoire du théâtre », issue d’une subjectivité collective, où seraient convoqués sur le plateau et incarnés par eux-mêmes les artistes, textes, spectacles ou pédagogues qui ont compté pour eux dans l’amour qu’ils portent à cet art. Autrement dit, faire théâtre avec le fait de raconter le théâtre, en une mise en abyme qui prend un tour on ne peut plus vivant et ludique. Les voilà donc, sur le plateau entièrement nu, ces quatre jeunes gens d’aujourd’hui habillés comme dans la rue, à la fois banals et pas banals, chacun dessinant discrètement sa singularité. Et la mise en abyme est d’emblée démultipliée avec la séquence qui ouvre la représentation : elle rejoue un passage d’un spectacle, Elvire Jouvet 40, qui a fait date quand il a été créé, en 1986. La metteuse en scène Brigitte Jaques-Wajeman avait choisi de créer une pièce à partir des cours donnés par Louis Jouvet, en 1940, à une jeune élève du Conservatoire, à qui il faisait travailler la deuxième scène d’Elvire dans Dom Juan, de Molière. Fascinante leçon de théâtre, dans laquelle le maître pousse son élève dans les retranchements du « moi encombrant qui la possède » et dans la recherche d’un jeu sans artifices. Présent partagé Est-ce que jouer, c’est faire semblant ou devenir le personnage ? Faut-il mettre ses tripes sur la table ? Toutes ces questions, et bien d’autres, le spectacle va les redétricoter à travers moult autres références : qu’il s’agisse d’un passage d’une pièce de Pina Bausch, de Marcial Di Fonzo Bo jouant Richard III sous la direction de Matthias Langhoff ou de Martin Wuttke incarnant Arturo Ui sous celle de Heiner Müller, ou encore de Dario Fo se livrant à une explication drôlissime et féministe du théâtre de Corneille. Point n’est besoin, pourtant, de connaître ou de repérer ces références pour apprécier le spectacle, comme on a pu le constater à Montreuil. Les scènes fonctionnent en elles-mêmes, par la force de ce qui fait le théâtre depuis toujours : l’interprétation par des êtres humains, dans leur singularité, d’une partition qui revit dans le présent partagé entre acteurs et spectateurs. Ces quatre acteurs de talent passent et repassent de manière imperceptible la frontière entre jeu et non-jeu Une des scènes réjouissantes du spectacle le montre bien, qui voit le grand monologue de Phèdre monté manière comédie musicale, avec un kitsch assumé et où, pourtant, les boucles sonores des merveilleux vers de Racine reprennent toute leur fraîcheur : « Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée./Je l’aime, non point tel que l’ont vu les enfers,/(…) Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche,/Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi. » Tout le spectacle se joue sur la manière dont ces comédiens de talent passent et repassent de manière imperceptible la frontière entre jeu et non-jeu. Face à tant d’objets scéniques préfabriqués, que l’on nous vend comme des spectacles « sur » – la violence à l’égard des femmes, le harcèlement, la transidentité, etc. –, Fanny de Chaillé revient à un geste de théâtre aussi simple qu’essentiel. Et montre ainsi tout ce que le théâtre a à nous dire, à travers plus de deux mille ans d’histoire, sur la violence, l’amour, le pouvoir, les relations entre les hommes et les femmes, les rôles dévolus aux genres féminin et masculin, et l’accomplissement de soi. Une autre histoire du théâtre, par Fanny de Chaillé. Festival d’automne, Chaillot-Théâtre national de la danse, Paris 16e. Jusqu’au 3 décembre. Puis tournée jusqu’en mai 2023, à Annecy, Sète, Toulouse, Nantes et Lyon. Tout public à partir de 10 ans. Fabienne Darge Légende photo : De gauche à droite : Tom Verschueren, Valentine Vittoz, Malo Martin et Margot Viala dans « Une autre histoire du théâtre », de Fanny de Chaillé, à Chaillot-Théâtre national de la danse, à Paris, le 1er novembre 2022. MARC DOMAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 30, 2022 12:21 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 30 nov. 2022 A 41 ans, le comédien et metteur en scène navigue entre théâtre et musique avec ses spectacles inventifs et déjantés, à l’image de « Sans tambour », succès lors du Festival d’Avignon.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/30/festival-d-automne-samuel-achache-les-fugues-d-un-indisciplinaire_6152397_3246.html
Ne cherchez pas à l’enfermer dans une case, Samuel Achache, ou il partira en courant à coup sûr. Avec son air d’enfant espiègle et mélancolique, sa carrure poids plume de Charlot dansant, il semble toujours en train de se ménager des fugues, des échappées. Même la case « théâtre musical », avec lui, prend l’air de toutes parts, laisse entrer des vents contraires. Pourtant, sans tambour ni trompette, il est devenu, à 41 ans, avec ses spectacles aériens et réjouissants, l’incarnation du renouveau de ce théâtre musical qui n’en finit plus de retisser de nouveaux rapports, toujours plus fins, plus intimes, entre les deux disciplines. Sa dernière création, Sans tambour, a cassé la baraque au dernier Festival d’Avignon, avant son arrivée au Festival d’automne, avec son esprit doucement déjanté et son inventivité tous azimuts. Théâtre ou musique ? Il a toujours dansé d’un pied sur l’autre depuis son adolescence de « cancre », du côté de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Sa mère était éditrice, son père prof de philo, auteur et éditeur. « J’ai grandi avec des murs de livres autour de moi, mais ce n’est pas pour autant que je les lisais, raconte-t-il avec un petit sourire en coin. J’étais totalement ascolaire, l’école a été pour moi un synonyme de l’enfer. » « Musicien raté » Il s’est sauvé en poussant la porte du cours de théâtre qui était en face de chez lui et en jouant du piano, de la batterie et de la trompette. Puis il a choisi le théâtre, « par facilité, parce que c’est moins exigeant que la musique », dit-il avec une pointe de regret. « Je me vis un peu comme un musicien raté. » Peut-être, mais il a eu la chance de tomber, pendant ses années de formation au conservatoire du 5e arrondissement de Paris, puis au Conservatoire national d’art dramatique, dans des années enchantées, les 2000, où la scène explose de tous ses feux interdisciplinaires, et où Paris accueille les meilleurs créateurs du monde entier. « Arpad Schilling, le tg STAN, Frank Castorf, Christoph Marthaler, Alain Platel… Tous ces artistes nous ont formé le goût et le regard », constate-t-il. Samuel Achache dit « nous », parce que, pendant ses années d’école de théâtre, il a surtout rencontré sa bande, ses proches, avec lesquels, pour la plupart, il travaille encore aujourd’hui : Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutinier, Lionel Dray ou Jeanne Candel, qui va devenir sa compagne. C’est la grande époque des collectifs de théâtre – Sylvain Creuzevault avec D’ores et déjà, Julie Deliquet avec In Vitro… –, et Samuel Achache et Jeanne Candel créent le leur en 2009, La Vie brève. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Francesca Corona : « Le Festival d’automne est un mégaphone incroyable » C’est avec ce collectif qu’ils signent, en 2013, un beau coup d’éclat : Le Crocodile trompeur, variation libre et jazzy sur Didon et Enée, de Purcell. Le spectacle offre une fusion inédite entre théâtre et musique, où la seconde devient un acteur du drame à part entière, et où le théâtre acquiert une liberté et une subtilité expressives toutes musicales, sans être tenu par les codes d’une narration trop linéaire. L’ensemble dégage une fantaisie, une grâce et une énergie qui emballent un public très éloigné de l’opéra traditionnel : le spectacle remporte le Molière du spectacle musical et tourne pendant des mois, avec le même succès partout où il passe. Capacité à improviser « Et pourtant, tout est parti presque par hasard, se souvient Samuel Achache. Nous étions au Conservatoire, Jeanne Candel et moi, en même temps que Judith Chemla, et nous l’entendions souvent chanter, merveilleusement, des airs de Didon et Enée. On s’est dit qu’il fallait absolument en faire profiter d’autres que nous, et nous les avons réunis, elle et d’autres amis, pour beaucoup venus du jazz, et donc dotés de cette capacité à improviser. » Le Crocodile a posé les bases de l’art de Samuel Achache, et notamment de sa façon, si singulière, de « raconter une histoire sans la raconter ». Des bases à partir desquelles il a poursuivi sa recherche, avec ou sans Jeanne Candel, dont il est aujourd’hui séparé, d’une forme à l’autre : Fugue (2015), Orfeo/Je suis mort en Arcadie (2017), La Chute de la maison (2017) ou Songs (2019). Aujourd’hui, Sans tambour apparaît comme l’aboutissement virtuose de toutes ces explorations, que Samuel Achache mène encore quelques pas plus loin avec ses fidèles complices, Florent Hubert en tête, qui assure la direction musicale de l’ensemble. Le metteur en scène avait envie avec cette nouvelle création de parler de l’effondrement, celui du monde et celui d’un couple, le second étant vu comme l’illustration du premier. « Tous les spectacles que j’ai faits se profilent sur un fond tragique, mais que l’on n’aborde pas comme tel : ce que j’aime, c’est cet écart » Pour ce faire, il est allé chercher des lieder de Schumann, principalement issus du cycle des Liederkreis, Op. 39, supposés être une incarnation absolue du romantisme. « Ce qui est intéressant avec cette musique, c’est son caractère éminemment intime : c’est une musique faite pour être jouée chez soi, en petit comité, peau contre peau. Une musique qui porte en elle une tragédie profonde, mais aussi une ironie. On l’oublie souvent, mais le romantisme allemand est très différent du nôtre, en France : il est bien plus drôle, cruel, rugueux, pour ne pas dire truculent. Tous les spectacles que j’ai faits se profilent sur un fond tragique, mais que l’on n’aborde pas comme tel : ce que j’aime, c’est cet écart, cette conscience que, dans toute tragédie, il y a quelque chose qui se révèle de la farce qu’est la vie, de son absurdité. » Ironie douce Ainsi va l’art du frottement de Samuel Achache, un art qui donne la parole à la musique et décrasse le théâtre de son bavardage pour lui offrir une légèreté toute musicale, en un tressage des plus intimes et des plus impalpables. L’homme, lui, avance dans la vie avec sa sensibilité à fleur de peau et son humour en bandoulière, une ironie douce comme seul rempart face à une époque qui assigne l’art, de plus en plus, à des formes réalistes massives et manichéennes, à des récits simples, à un message. Les messages, Samuel Achache semble les déjouer plus souvent qu’à son tour, lui qui a intitulé sa nouvelle compagnie, doublée d’un orchestre, La Sourde. Quant au titre de son spectacle, il n’a en apparence rien à voir avec la choucroute. Mais là aussi, l’ironie est à l’œuvre, si l’on songe à l’origine de l’expression « sans tambour ni trompette ». Dans les siècles passés, siècles de guerres, les troupes partaient au combat accompagnées de musiciens, tambours et trompettes essentiellement, supposés galvaniser les combattants. Mais, en cas de défaite, il n’était plus question de claironner, les soldats devaient se retirer le plus discrètement possible, sans tambour ni trompette, donc. Comment mieux dire que l’effondrement actuel, s’il a lieu sans tambour ni trompette, sans crier gare, n’en est pas moins réel ? Ce qui n’empêche pas le spectacle de Samuel Achache d’être tout à fait galvanisant. Sans tambour, mis en scène par Samuel Achache. Du 1er au 11 décembre au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Les 3 et 4 février 2023 à Points communs-Théâtre des Louvrais. Hors Festival d’automne, du 22 février au 5 mars 2023 au Théâtre des Bouffes du Nord. Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Festival d’automne à Paris. Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 5:26 PM
|
Par Frédéric Bonfils dans le blog Foudart -28/11/2022 Après quelques minutes d'adaptation, on se laisse complètement porter par ce conte morbide. Cet étrange et merveilleux objet théâtral La petite dans la forêt profonde Le désir peut évoquer l’envie… de plaire, d’aimer ou de savoir mais aussi de dominer, d’avilir ou de violenter. Les perversions du désir Dans notre culture, la notion de désir incontrôlable est une idée romanesque bien ancrée et même parfois acceptée ou excusée. Un désir si fort qu’il rendrait l’homme incontrôlable au point qu’il se transforme en bête. Mais de plus en plus souvent, on commence à reconnaitre que les débordements du désir ne sont pas de l’amour mais bien de la violence. On commence à clamer haut et fort qu’un désir qui menace et blesse n’est qu’un désir de possession égoïste et destructeur et non une preuve de passion romantique. Cette affirmation est assez récente bien que présente dans les textes anciens comme dans Les Métamorphoses d’Ovide. Philippe Minyana, ce poète du sensible, cet auteur qui a toujours su manier comme personne l’art du grotesque et du tragique, s'est emparé des personnages de Procné et Philomèle pour en faire une adaptation contemporaine et il le fait « à hauteur d’humain», en s’éloignant du grandiose et de la poésie lyrique du texte d’Ovide. Un jeune roi et sa petite belle-soeur arrivent dans son pays. Avant d’aller rejoindre son épouse au palais, ils feront une halte dans une bergerie. C’est un stratagème. Le jeune Roi veut la petite, mais elle l’ignore. Un désir brûlant qui finira de la plus abjecte des façons. « Tu dis que c’est un havre de paix ? Demande la petite Oh oui Dit le jeune roi C’est un beau bâtiment ? Demande-t-elle encore ? Oh oui Dit-il et il ajoute Viens » EXTRAIT Aujourd’hui, c’est au tour d’un jeune metteur en scène Alexandre Horréard, accompagné de deux jeunes comédiennes Louise Ferry et Clémence Josseau bruiteuses, chanteuses de nous conter cette folle histoire. « Le but de la mise en scène n’était pas de noyer le formalisme de Minyana sous d’autres couches de formalisme, mais de faire entendre la poésie, les mots, et bien sûr le fond. Restituer la violence par le récit. Nous voulions nous servir de la douceur du conte, sans grands cris ni déchaînements pour explorer l’insoutenable » Les deux comédiennes sont les conteuses, à la fois à l'intérieur et en dehors du récit mais également Philomèle et Procné. La parole du roi, la parole de la violence, est donc toujours rapportée par ces deux femmes, ses victimes, la petite et la reine. Elles content avec leur voix timide, mutine ou effrayante et, à l’aide d’un micro, de bruitages et de chants, dans un chuchotement qui peut faire pensée à la méthode ASMR, créent l’ambiance sonore au plateau. Après quelques minutes d'adaptation indispensable à ce type de spectacle très différent, très inhabituel et très créatif, on se laisse complètement porter par ce conte morbide et... presque malicieux. Cet étrange et merveilleux objet théâtral. Avis de Foudart 🅵🅵🅵 La petite dans la forêt profonde Texte Philippe Minyana, publié à l’Arche Editeur Mise en scène Alexandre Horéard Avec Louise Ferry et Clémence Josseau Lumières Alexandre Horréard Crédit / photos Marie Hamel Théâtre les Déchargeurs Du 27 novembre au 20 décembre 2022 Du dimanche au mardi à 19H • Durée 1 heure • À partir de 14 ans

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 4:57 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 28/11/2022 Icône des marges, génie de l’incongru, l’ancien acteur de Claude Régy et ami de Marguerite Duras tirait, ce week-end, sa révérence dans «Titanic, hélas», sublime stand-up donné sur une péniche dans l’adoration de son public et l’indifférence des «pros». Touché, vraiment coulé ? Il cite Françoise Sagan et les Grosses Têtes avec la même grâce. Pour un peu, il ferait passer du Patrick Timsit pour du Marguerite Duras. Il aime à la fois le chic et le toc. Quand il «reçoit» au théâtre comme d’autres tiennent salon, il sert toujours aux spectateurs du champagne dans des verres en plastoc. N’est-ce pas la moindre des choses quand on est la plus grande actrice de son époque ? Ce week-end, à contrecœur et presque en douce, Yves-Noël Genod faisait ses adieux à la scène, sur la Seine. Dans la cale d’une péniche parisienne, ses fans s’entassaient sous des manteaux, des plaids, et quelques gilets de sauvetage pour entendre son Titanic, hélas (c’est le titre), révérence tirée à une carrière qui prenait l’eau. Tandis que l’artiste disparaissait dans le noir, main dans la main avec une vieille dame au dos voûté, maquillée de fards colorés et gantée jusqu’aux coudes comme les chanteuses de music-hall, le froid et l’émotion faisaient naître de la buée sur les hublots. Que s’est-il donc passé, dans la société, pour qu’on doive se passer des dingueries d’Yves-Noël Genod ? A poil dans les vestiaires Inoubliable pour son petit public d’addicts, tout à fait inconnu pour les autres, l’acteur, metteur en scène, grand accoucheur d’acteurs (mémorables Marlène Saldana ou Jonathan Capdevielle), avance lui-même des hypothèses en ouverture de ce sublime stand-up de fin du monde. Fin d’un monde, en tout cas. Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. Les temps, constate-t-il, ne sont plus «aux p’tits gars» comme lui. Sans amertume, il en prend son parti. Quand Yves-Noël Genod est monté sur Paris pour jouer dans les spectacles de Claude Régy – un metteur en scène mort aujourd’hui, et dit-il, déjà tombé dans l’oubli –, «tous les garçons étaient homos […] La tendance s’est renversée et c’est normal […] mais, moi, je ne suis pas une petite chanteuse lesbienne de vingt ans, bien entendu ; hélas». Nécessairement, aujourd’hui, face à tous ces jeunes «homos déconstruits», comment ne pas apparaître, poursuit-il avec son élégance de grande dame, comme un «vieux naturiste» quand il prend sa douche à poil dans les vestiaires du théâtre, sous les yeux gênés de ses comédiens qui, tous, bien sûr, ont gardé leur slip ? Dans sa bouche, les mots «vieux phoque» ou «grosse gouinasse» brillent du même raffinement qu’un vers de Charles Baudelaire. On ne peut pas dire ça ? Alors on ne peut plus rien dire ? Mais Yves-Noël Genod peut tout dire. D’abord parce qu’on n’est jamais sûr que ses mots soient bien les siens. Titanic est un grand jeu de sample, et n’avance que par citations, une polyphonie de voix où s’enlacent, sans que l’on sache vraiment à qui attribuer quoi, les mots de Florence Foresti et de Michel Houellebecq, de Paul Verlaine et d’Elie Semoun, de Vivienne Westwood et de Luc Plamondon. Jeanne Balibar flanquée d’un dindon Surtout, rôdent ici en fantômes les voix des plus mégalo des divas d’antan, grotesques dans leur besoin de briller, pathétiques dans leur peur panique d’être oubliées. Et Titanic devient alors une déclaration d’amour à leur verve, leur mauvaise foi, leur art de l’enfumage et du bobard, théâtrales névroses qui n’ont jamais été aussi bien servies qu’ici, avec cette silhouette oblongue qui n’appartient qu’à lui : la tronche d’Iggy Pop avec des yeux de Bambi, un charisme d’Aigle noir de Barbara surmonté du petit carré frangé jaune poussin de Mireille Darc, et cette façon de sembler, perpétuellement, étonné de sa propre incongruité. Une autre star des marges, un ami, le décrivait ainsi : «Un mélange de standing Yves Saint Laurent et de Royco minute soupe». Yves-Noël Genod, donc, n’arrive plus à se produire et ne remplit pas les salles. Il s’adapte, il ouvrira une «petite boucherie bio dans les Cévennes». Comprenons aussi les programmateurs, toujours face à un sacré merdier avec lui : l’acteur et metteur en scène n’a jamais voulu créer de structure stable, ne travaille que sur commande et livre des projets jamais normés, sans «action théâtrale» répertoriée, jamais «finis». Les spectacles d’Yves-Noël Genod ont parfois ressemblé à ça : un paysage contemplatif nimbé d’ennui, et soudain, surgissant de l’outrenoir du plateau, Jeanne Balibar dans la brume flanquée d’un dindon. C’était sans doute «invendable» et c’était inouï. Fut un temps pourtant, dans le monde du spectacle vivant, des producteurs irresponsables s’acharnaient à faire place pour pareille bizarrerie. Cette fois, pour la «der des der», Yves-Noël Genod leur facilite la tâche : Titanic dure 1h30 et se pose au parfait carrefour du Jamel Comedy Club et de Claude Régy. Un format parfait pour que ces adieux deviennent un come-back ! Il eut fallu peut-être que l’auteur contacte un peu plus de programmateurs. Au téléphone, Yves-Noël Genod admet qu’il manque peut-être de stratégie mais le pouvoir, dit-il, le «terrifie» : «Je ne sympathise avec les programmateurs qu’une fois qu’ils prennent leur retraite.» Est-il vraiment trop tard pour que les plus jeunes redressent la barre ? Eve Beauvallet / Libération Titanic, hélas d’Yves-Noël était donné à la Péniche POP du 25 au 27 novembre. Légende photo : Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. (Sébastien Dolidon/photo © Sébastien Dolidon)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 5:44 AM
|
Critique d'Anne Diatkine publiée dans Libération - 25/11/2022 La pièce minimaliste de Fanny de Chaillé multiplie les niveaux de lecture, et réussit le tour de force de satisfaire les attentes des spectateurs les plus néophytes comme des plus aguerris. Est-il possible de s’adresser à des enfants dont un certain nombre ne sont sans doute jamais allés au théâtre et à des adultes avertis sans privilégier ni les uns ni les autres ? Peut-on construire un spectacle qui invente une (autre) histoire du théâtre, qui emporte tout autant des enfants de dix ans et des adolescents que des adultes avisés, mais pas toujours aux mêmes endroits et pour les mêmes motifs, et ne nécessite aucun savoir préalable pour l’apprécier ? Qu’est-ce qui différencie fondamentalement un public d’enfants et un public d’adultes ? Et qu’appelle-t-on «histoire du théâtre» ? Le hasard nous conduit à voir la merveille modeste – les accessoires de décor tiennent en une petite valise, costumes compris – de Fanny de Chaillé un mercredi à 15 heures au CDN de Montreuil avec la nouvelle directrice du festival d’automne Francesca Corona – spécimen s’il en est de public avisé – dans une salle remplie de scolaires – une classe de CM1 de huit et neuf ans, une autre de première et de terminale. Les plus petits réagissent un peu comme à un spectacle de marionnettes, ils retiennent leur souffle, bougent telle une vague, crient lorsque les quatre acteurs se battent «pour de vrai», sur un plateau totalement dénué de décors. Les plus grands sont très attentifs – sauf une jeune femme à nattes qui ne cesse de s’affairer sur son portable lumineux, mais on s’apercevra à la sortie qu’elle n’est pas élève mais accompagnatrice. Références et indices Les acteurs éprouvent-ils les passions qui habitent leurs personnages ? Qu’est-ce qui nous permet de croire à une situation que l’on sait pourtant illusoire ? Et à quoi pense-t-on lorsqu’on est spectateur ? Le grand plaisir du spectacle est de donner corps à ces questions immémoriales sans qu’elles apparaissent naïves ou théoriques grâce aux quatre formidables (jeunes) acteurs Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala et Valentine Vittoz, déjà repérés dans Chœur. Oui, il y a bien une part didactique, mais les informations s’insinuent dans la trame sans forcing, au détour d’une phrase ou d’une situation. A chaque fois, c’est par le jeu que les acteurs escaladent un sujet-obstacle et grimpent de rocher en rocher sans achoppement ni effet de catalogue. Probablement, le spectateur adulte ne pourra s’empêcher de chercher les références qui se nichent dans cette histoire du théâtre qui se construit sous nos yeux : cette actrice volontaire qui semble parler dans le poste et qui considère que son heure de gloire n’a que trop tardé, n’est-ce pas Jeanne… Moreau ? Et l’intervieweur condescendant, obséquieux dans son ironie, c’est bien sûr… François Chalais. Ce même spectateur s’attache à tous les indices, se cramponne aux accents, à la gestuelle, au vocabulaire suranné ou aux modes de domination, car l’histoire du théâtre est aussi celle des manières d’exercer le pouvoir. Il attend Vilar, Vitez, Brook, Chéreau, tandis que l’enfant aura tendance à s’identifier frontalement aux acteurs, car comme eux, il passe son temps à jouer et à croire à son jeu. On souhaite bonne chance à l’adulte : Fanny de Chaillé est bien trop maline pour ne pas déjouer l’écueil du best of et de la panoplie. L’un des atouts de ce spectacle tient à sa simplicité : éliminer tout le superflu, comme diraient Grotowski ou Peter Brook, afin que ne restent que les acteurs et leurs questionnements intimes. Leur âge a une certaine importance, car on n’imagine pas la même histoire du théâtre selon que les spectacles et les noms devenus mythiques ont un jour accompagné notre présent, ou qu’ils ont toujours appartenu à une époque révolue et aujourd’hui rêvée. Fanny de Chaillé dit avoir élagué les trois quarts du matériel amené et improvisé par les acteurs, comme on coupe des costumes à même les modèles afin de mieux se concentrer sur l’ordonnance du récit. Il lui serait possible de faire surgir une dizaine d’autres histoires du théâtre avec les mêmes acteurs, ce qu’elle n’exclut pas d’entreprendre. Mais ce pourrait être avec d’autres acteurs réunis eux aussi dans Chœur actuellement en tournée, qui à leur tour apporteraient leur propre matériel, mémoires, histoires. Ou comment, sans le prévoir, sans s’en douter, la plus minuscule des pelotes mène à une fresque sans fin. Anne Diatkine / Libération «Une autre histoire du théâtre», de Fanny de Chaillé. Jusqu’au 27 novembre au CDN de Montreuil, du 29 novembre au 3 décembre à Chaillot, puis grande tournée. Légende photo : «Une autre histoire du théâtre», de Fanny de Chaillé. (Marc Domage )

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:40 PM
|
Enquête de Cassandre Leray dans Libération - 27 nov. 2022 Au surlendemain de la publication de l’enquête sur les accusations visant Sofiane Bennacer et leurs conséquences sur le tournage du film, «Libération» apporte de nouveaux éléments. Des «rumeurs». C’est en ces termes que les producteurs des Amandiers et sa réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi évoquent ce que d’autres autour du film qualifient d’alertes. Suite à la parution de notre enquête, le 24 novembre, les réactions s’enchaînent. Patrick Sobelman d’Agat Films et Alexandra Henochsberg d’Ad Vitam production – les deux sociétés qui produisent les Amandiers – le répètent : «A aucun moment la production ne savait avant de l’engager», a martelé le premier sur France Inter vendredi. Avant d’ajouter que, une fois découverte l’existence d’une plainte, «il était absolument impossible d’arrêter le tournage et de virer Sofiane, pour une raison très simple : nous n’avions aucune base juridique pour faire ça». Dans un long communiqué publié samedi, les deux producteurs du film le certifient : «Il n’y a pas de scandale les Amandiers», en référence à la une de Libé de vendredi. Climat d’omerta Dans nos pages, une partie de l’équipe du film affirme que la production et la réalisatrice ont «protégé» l’acteur Sofiane Bennacer, alors qu’ils auraient été alertés d’accusations de violences sexuelles à son sujet. Ils racontent les coulisses du tournage des Amandiers à l’été 2021, dans un climat d’omerta, que la production réfute, alors que plusieurs témoignages décrivent ce sentiment d’être «enfermés dans ce secret dont il ne fallait pas parler», selon une technicienne. Une alternante raconte même que «[Valeria Bruni-Tedeschi] nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements». Une plainte pour viol contre Sofiane Bennacer a été déposée le 5 février 2021 par Romane (1), une de ses ex-petites amies, soit plusieurs mois avant le début du tournage. Trois autres anciennes compagnes de Sofiane Bennacer ont depuis été entendues par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg chargée de l’enquête, et deux d’entre elles décrivent des faits de viol. Outre sa mise en examen pour «viols» et «violences», le comédien a été placé sous statut de témoin assisté pour des faits de «viol sur conjoint», précise la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. La magistrate ajoute que «d’autres [plaintes] ont été recueillies au cours de l’enquête préliminaire puis sur commission rogatoire». Lui conteste systématiquement les faits, aussi bien auprès de Libération que sur son compte Instagram. Au cœur du débat, plusieurs questions : qui était en possession de quelles informations, et à quel moment ? Plusieurs jours après la parution de notre enquête, nous faisons le point et révélons de nouveaux éléments. Une comédienne «forcée» à auditionner Selon nos informations, une première alerte à l’égard de l’acteur Sofiane Bennacer aurait été formulée fin mars 2021. A l’époque, les auditions pour le film les Amandiers sont en cours. Anna (1), étudiante à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS) – où Sofiane Bennacer a aussi étudié avant de démissionner en février 2021 – tente elle aussi sa chance pour le long métrage. Dans la même promotion que Romane, elle connaît les accusations portées à l’égard de Sofiane Bennacer. Lorsqu’elle apprend qu’elle devra donner la réplique au comédien pour la suite des essais, elle refuse, et dit à l’assistante de casting qu’il est «accusé de violences sexuelles». Elle ne donne pas plus de précisions, et nous indique qu’elle a été «forcée» à auditionner avec le comédien malgré tout. La production, tout comme Valeria Bruni-Tedeschi elle-même, le reconnait : des «rumeurs» circulaient bien concernant le comédien, et ce avant le début du tournage. Le duo de producteurs explique avoir entendu parler d’une «rumeur concernant une soirée avec son ancienne petite amie du TNS, qui aurait mal tourné avec un comportement violent de Sofiane». Ces échos leur viennent dès le mois de «février ou mars», alors que le casting «commençait à se resserrer sur Sofiane». «Fin mai», d’après la production, décision est alors prise de joindre Stanislas Nordey, directeur de l’école du TNS. Contacté, Stanislas Nordey confirme cet appel : «J’ai dit que c’était deux jeunes gens qui étaient en couple, avant le début de l’école. J’ai dit que Sofiane était venu me dire qu’il était accusé à tort de viol, qu’on a convoqué la jeune fille qui nous a dit qu’elle confirmait les accusations.» Le directeur du TNS décide toutefois de ne pas mentionner la plainte de Romane, dont il avait connaissance, arguant qu’il se devait de respecter «le secret de l’enquête». La production, de son côté, dément fermement avoir entendu Nordey parler de «viol», et déplore que celui-ci ne leur ait pas parlé de la plainte. Il aurait seulement évoqué une «histoire» et aurait traité le sujet «à la légère». Selon Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, il est pourtant possible de faire état de l’existence d’une plainte sans contrevenir au secret de l’enquête «en respectant l’anonymat des plaignantes et sans donner des informations sur les faits». «Agressée physiquement, moralement, verbalement» Pour la production, «sur le seul fondement d’une rumeur», rien n’empêchait d’engager Sofiane Bennacer. Une position fermement défendue par Valeria Bruni-Tedeschi dans un communiqué diffusé vendredi : «J’ai été impressionnée artistiquement par Sofiane Bennacer dès la première seconde du casting de mon film et j’ai voulu qu’il en soit l’acteur principal malgré des rumeurs dont j’avais connaissance», écrit la réalisatrice. «Mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences, mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m’arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui», souligne-t-elle encore. Sur la même ligne, Valeria Bruni-Tedeschi et les producteurs assurent n’avoir découvert l’existence d’une plainte pour viol que deux jours après le début du tournage, le 5 juin 2021. Un témoignage contredit cette version. Mathilde (1), l’une des jeunes femmes mettant en cause Sofiane Bennacer pour des faits de violences sexuelles et physiques dans notre enquête, a elle aussi tenté d’alerter l’équipe du film. Le 16 mai 2021, elle contacte une des actrices du film via Facebook. Dans un échange, elle écrit que «Sofiane est accusé de viol» et que «le procès est en cours et n’a pas encore été classé». Elle ajoute qu’elle aurait, elle aussi, «été agressée par Sofiane. Physiquement, moralement, verbalement» et qu’elle aurait «reçu un appel d’une autre fille qui souhaitait [lui] raconter son histoire, si proche de la [sienne]». Une semaine plus tard, la comédienne lui répond : «Oui, la production est au courant et la réalisatrice a quand même décidé de l’embaucher.» Et ajoute : «J’ai parlé à la réalisatrice et j’ai exigé que le procès de Sofiane et son accusation de viol soient connus par toutes les filles du tournage […] et elle nous a donc réunies pour nous en parler […] Vu ma position, je ne sais pas quoi faire de plus.» Nous sommes le 24 mai 2021, les répétitions sont en cours mais le tournage n’a pas encore commencé. Dans un communiqué paru à la suite de notre enquête, le duo de producteurs répète malgré tout avoir découvert l’existence d’une plainte pour viol alors que le tournage était déjà entamé. Et explique avoir échangé avec Valeria Bruni-Tedeschi à ce sujet : «Mettant en avant la présomption d’innocence, celle-ci n’envisage pas de continuer le film sans ce comédien. Nous n’avons alors que peu de solutions : à ce stade, rien dans le droit du travail ne nous permet de justifier son licenciement, il pourrait se retourner contre nous.» «Rien à redire» Un dilemme dont les producteurs avaient déjà fait part. Que faire pour l’employeur face à un salarié qui est accusé et fait l’objet d’une plainte mais qui n’est pas jugé et donc présumé innocent ? La juriste Catherine Le Magueresse – sans commenter le cas précis des Amandiers – estime qu’il n’est pas impossible pour un employeur de mettre fin au contrat d’un salarié suite à la découverte d’une plainte contre celui-ci. «Un licenciement pour cause réelle et sérieuse est envisageable», argumente-t-elle. «La dissimulation de l’existence d’une plainte pour viol par un candidat constitue un manquement au devoir de loyauté et de bonne foi. Dans un contexte de moindre acceptation sociale des violences sexuelles, elle est en outre susceptible de nuire à l’employeur qui pourrait être suspecté d’indifférence sur ce sujet.» Faire marche arrière et changer l’un des principaux rôles d’un film n’est pas sans conséquence pour un projet d’une telle ampleur. Alexandra Henochsberg et Patrick Sobelman expliquent ainsi que, s’ils avaient mis un terme au contrat de Sofiane Bennacer, ils auraient aussi dû «arrêter le tournage et licencier les 89 salariés sur le plateau sans justifications légales valables». Pour Catherine Le Magueresse, «il est certain qu’une telle situation est compliquée. Mais dans une ère post MeToo, il est difficilement envisageable de ne pas agir. Ce n’est pas seulement une question de droit, mais une question de morale». Les producteurs auraient alors fait avec les «armes» dont ils disposaient, expliquent-ils: convocation de Sofiane Bennacer afin de lui demander de prendre un avocat, présence quotidienne sur le plateau de tournage… Ils affirment également avoir échangé avec l’une des coprésidentes du collectif 50/50 – sans se souvenir de son nom –, qui leur aurait indiqué qu’elle ne voyait «rien à redire» quant aux décisions prises. Contacté, le nouveau conseil d’administration du collectif explique que si les producteurs ont contacté l’une des anciennes présidentes, «c’est à titre privé et non au nom du collectif». Et tient à préciser : «Il est extrêmement choquant que de pareils agissements continuent de prendre place au sein des domaines du cinéma et de l’audiovisuel, qu’un régime de silence soit encore en faveur dans certaines productions, que des tournages se déroulent en présence de personnes qui représentent un danger pour leurs collègues.» (1) les prénoms ont été modifiés. Légende photo : Louis Garrel, Valéria Bruni-Tedeschi, Sofiane Bennacer et une partie de l'équipe des «Amandiers» lors de la montée des marches du Festival de Cannes, le 22 mai. (David Boyer/ABACA)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2022 5:10 PM
|
Enquête de Cassandre Leray publiée dans Libération le 24/11/22 «Libération» a recueilli les témoignages de jeunes femmes qui mettent en cause le comédien à l’affiche des «Amandiers» de Valeria Bruni-Tedeschi. Elles décrivent des violences sexuelles et physiques, et l’accusent d’avoir fait pression sur elles, les menaçant de nuire à leur carrière. Il a été mis en examen pour «viols et violences sur conjoint». Les Amandiers sont partout. Sur les panneaux d’affichage, dans les kiosques à journaux et sur les devantures des cinémas. Le film, qui figurait en compétition officielle au Festival de Cannes au printemps, est sorti en salles le 16 novembre sur près de 250 écrans, solidement soutenu par une importante campagne de promotion et un relais critique enthousiaste (y compris dans nos colonnes) sur cette peinture du climat délétère qui régnait dans la légendaire école de théâtre dirigée par Patrice Chéreau dans les années 80. A l’affiche du nouveau long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi, le visage de Sofiane Bennacer. Malgré son rôle central, il est resté absent des plateaux radio et télé. Et pour cause. En octobre, l’acteur a été mis en examen pour «viols et violences sur conjoint» par un juge d’instruction de Mulhouse, comme l’a révélé le Parisien mardi 22 novembre, une information confirmée à Libération par la procureure Edwige Roux-Morizot. En réaction à ces informations, l’Académie des césars a décidé de retirer Sofiane Bennacer de la liste des 32 révélations pour la cérémonie de 2023. Plusieurs anciennes ex-compagnes entendues par les gendarmes Le parquet avait initialement requis un mandat de dépôt, pour «éviter toute pression au regard de témoins ou potentielles victimes non encore entendues». L’acteur a finalement été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Il lui est ainsi interdit de se rendre dans les villes de Strasbourg, Mulhouse et Paris ainsi qu’en région parisienne, zones géographiques correspondant aux lieux de domiciliation de témoins et plaignantes. Sofiane Bennacer a également l’interdiction de rencontrer sa «compagne» − selon le terme de la procureure − Valeria Bruni-Tedeschi, entendue dans le cadre de l’enquête, ainsi que l’ensemble des plaignantes et témoins du dossier. Romane (1) a déposé plainte pour «viol» contre Sofiane Bennacer le 5 février 2021 au commissariat de Strasbourg. Dans sa plainte, que Libération a pu consulter, l’étudiante alors âgée de 23 ans raconte avoir été violée à plusieurs reprises par le comédien entre 2018 et 2019, pendant qu’elle était en couple avec lui. Trois autres anciennes compagnes de Sofiane Bennacer ont été entendues par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg chargée de l’enquête, et deux d’entre elles décrivent des faits de viol. Outre sa mise en examen pour «viols» et «violences», le comédien a été placé sous statut de témoin assisté pour des faits de «viol sur conjoint», précise Edwige Roux-Morizot. Elle ajoute que le comédien a été mis en examen à la suite d’une première plainte, puis que «d’autres ont été recueillies au cours de l’enquête préliminaire puis sur commission rogatoire». Pendant huit mois, Libération a enquêté, après de nombreuses alertes de plusieurs militantes féministes concernant Sofiane Bennacer. Nous avons pu rencontrer Romane et recueillir les témoignages de deux autres femmes. Elles l’accusent de violences sexuelles et physiques. Sofiane Bennacer dément fermement les accusations portées par Romane et affirme qu’elle aurait «quémandé des témoignages» auprès d’ex-compagnes. Libération a recueilli la parole de deux femmes qui mettent en cause le comédien, par ailleurs visé par d’autres plaintes. «Il la dévalorisait constamment» Lorsque l’on rencontre Romane dans un café strasbourgeois en février 2022, un peu plus d’une année s’est écoulée depuis le dépôt de sa plainte, mais l’instruction n’est pas encore ouverte. Une tasse de café dans les mains, la comédienne en formation à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS) pèse chacun de ses mots. Elle l’affirme à plusieurs reprises : «Je n’ai pas du tout envie de le détruire.» La comédienne craint aussi des représailles du comédien, qui l’aurait déjà menacée au cours de leur relation : «Il connaît du monde dans le milieu, il disait toujours “si je veux détruire quelqu’un je le fais direct” ou ”quand je serai une star, je te le rendrai, mais si t’es pas avec moi t’es contre moi”.» Si elle ne souhaite pas s’exprimer médiatiquement à ce jour, nous avons pu consulter la plainte déposée par la comédienne. Celle-ci fait état de plusieurs viols au cours de sa relation avec Sofiane Bennacer, entre 2018 et 2019. Une relation d’emprise au cours de laquelle des violences psychologiques auraient eu lieu est également dépeinte. Romane rencontre Sofiane Bennacer à l’été 2018, alors que tous deux entament une formation au théâtre de la Filature, une classe préparatoire aux concours des écoles de d’art dramatique à Mulhouse. S’en est suivie une relation amoureuse. Leïla (1), comédienne de 25 ans et camarade de promotion à Mulhouse, se souvient de «crises de violence» dont elle a été témoin. Notamment une, en pleine répétition : «J’entendais hurler, j’ai vu [Sofiane] choper [Romane] par le bras pour la forcer à faire ci ou ça. Il lui donnait des ordres.» Avec du recul, elle estime que Romane était «très fortement sous l’emprise de Sofiane. Il la dévalorisait constamment, j’ai remarqué qu’elle avait perdu beaucoup de poids…» Au fil du temps, elle devient peu à peu l’une des confidentes de Romane. A l’été 2020, plus de six mois avant que la plainte ne soit déposée, cette dernière racontait déjà à Leïla «que leurs rapports sexuels étaient méga violents, […] qu’il la forçait». «Petit à petit, Romane a pris conscience de plus en plus de choses» Au printemps 2019, Sofiane Bennacer met fin à la relation. Il entre à l’école du Théâtre national de Strasbourg, tandis que Romane reste étudier à Mulhouse. Un an plus tard, Romane est à son tour admise au TNS. En juin 2020, peu avant la rentrée, elle parle pour la première fois de ce qui s’est passé avec Sofiane Bennacer à sa meilleure amie Claudia (1). Contactée par Libération, cette dernière, proche de Romane depuis le lycée, se souvient de l’échange. Elle confirme avoir recueilli les confidences de son amie, bien avant qu’une plainte ne soit déposée ou que le comédien ne soit casté pour le premier rôle des Amandiers. «Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir peur d’une autre personne comme ça. Petit à petit, Romane a pris conscience de plus en plus de choses, dont les violences sexuelles.» En janvier 2021, Romane confronte Sofiane Bennacer à sa sortie des cours et lui décrit les violences qu’elle aurait subies au cours de leur relation. Dans la foulée, Sofiane Bennacer se rend auprès de la directrice des études du TNS pour dénoncer les «accusations diffamatoires» de Romane, selon l’administrateur de l’établissement, Benjamin Morel, contacté par Libération. Romane, qui n’envisageait pourtant pas de faire remonter les faits au sein de l’école, est convoquée. Face à la direction, elle maintient ses propos. Le 5 février 2021, Romane dépose plainte, fait dont la direction de l’école confirme avoir été informée. Sofiane Bennacer, de son côté, démissionne du TNS le 19 février 2021. L’établissement précise à Libération avoir procédé à un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code pénal – qui oblige tout fonctionnaire ou toute autorité à dénoncer à la justice un crime ou délit dont il aurait connaissance – le 31 mars 2021. Une information confirmée par le parquet de Mulhouse. Si Romane a porté plainte contre Sofiane Bennacer, alors qu’elle n’en avait pas l’intention initialement, c’est parce qu’elle a découvert qu’elle n’était «pas seule». En janvier 2021, après avoir confronté Sofiane Bennacer, elle contacte plusieurs ex-compagnes de l’acteur. En quelques jours, elle reçoit des témoignages dépeignant un vécu similaire au sien : ces femmes lui décrivent des violences psychologiques, parfois physiques, mais aussi des violences sexuelles. Auprès de Libération, deux d’entre elles affirment avoir été violées par le comédien en 2019. Débordée par ces récits, Romane porte plainte. Encore aujourd’hui, la jeune femme martèle sa volonté de «laisser la justice mener son travail», refusant ainsi que des détails de son témoignage soient relayés dans la presse – raison pour laquelle l’enquête de Libération n’avait pas encore été publiée. Ses avocats, Anne Lassalle et Grégoire Mehl, déplorent la parution d’articles dans la presse «révélant des informations sur le contenu de sa plainte ainsi que son identité sans son consentement», qui contraignent la plaignante à «supporter la médiatisation» : «Romane a été très choquée et ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet qui fait l’objet d’une instruction.» «C’est la première fois que je raconte tout à quelqu’un» Pour Anaïs (1), 24 ans, une autre femme mettant en cause l’acteur, parler serait une manière de s’assurer que Sofiane Bennacer «ne puisse pas recommencer». Elle est étudiante en art à Mulhouse lorsqu’elle rencontre le comédien, début 2019. A l’époque, Anaïs traverse de graves problèmes familiaux et pense que boire un verre lui changera les idées. Par peur de rentrer seule à pied en pleine nuit, elle accepte d’aller chez Bennacer, qui «insiste». Une fois chez lui, le jeune homme commence «à la toucher et l’embrasser» et la «pénètre avec sa main». «Je disais non, j’enlevais sa main, il souriait et la remettait, décrit Anaïs. C’est du viol. A partir du moment où j’ai clairement exprimé le non et qu’il le faisait quand même, c’était comme si je ne pouvais rien faire.» Ce soir-là Sofiane Bennacer aurait également pénétré la jeune femme avec son sexe sans préservatif, sans son consentement. Elle ne le revoit jamais et plonge dans une «profonde dépression». Contactée par un gendarme dans le cadre de l’enquête ouverte après la plainte de Romane, elle décide de ne pas porter plainte, de peur que sa famille apprenne ce qui lui est arrivé. Aujourd’hui encore, elle confie n’avoir presque jamais parlé de cette histoire à ses proches, tant elle avait «honte». «C’est la première fois que je raconte tout à quelqu’un», dit-elle, se refusant à témoigner dans le cadre de la procédure judiciaire pour l’instant. Mathilde (1), elle non plus, n’a pas souhaité porter plainte. Elle a toutefois témoigné dans le cadre de l’enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Si elle accepte de parler à Libération, c’est pour dénoncer un «système» qui dépasse son histoire personnelle et la «protection» dont Sofiane Bennacer a bénéficié en travaillant sur le tournage du film les Amandiers. Au cours de l’été 2019, l’étudiante en art voit Sofiane Bennacer épisodiquement à Paris. Elle décrit des violences sexuelles répétées : «Sur le fait de vouloir ou pas vouloir, sur le fait de se protéger ou non, sur comment ça doit être fait, on n’a pas le choix. Si je disais non, soit il l’ordonnait physiquement soit il jouait sur la culpabilisation.» Preuve de son trouble et de ses craintes, elle prend même l’habitude «d’envoyer sa géolocalisation à ses amis» avant de rejoindre Sofiane Bennacer. «Plusieurs fois, il m’a étranglée ou a été violent avec moi.» «C’est un des moyens de pression les plus forts qu’il ait utilisés» Quand la jeune femme décide de mettre un terme à sa relation avec Sofiane Bennacer, quelques mois après leur rencontre, elle craint immédiatement qu’il ne s’en prenne à sa carrière : «C’est un des moyens de pression les plus forts qu’il ait utilisés», souligne Mathilde, âgée de 24 ans au moment des faits. A l’époque, elle travaille sur un projet artistique important pour lequel Sofiane Bennacer la soutient. Quand elle lui annonce vouloir cesser de le fréquenter, l’acteur l’aurait alors menacée : «Il m’a dit que si mon projet fonctionnait, c’était grâce à son réseau, qu’il allait tout faire péter.» Un récit qui fait écho à celui de Romane. Alors que les deux jeunes femmes évoluent dans le milieu culturel, l’acteur aurait joué de ses contacts pour faire pression sur elles, dans un milieu où la peur d’être blacklisté est omniprésente. Libération a retrouvé la trace de trois autres femmes qui accusent Sofiane Bennacer de violences sexuelles, psychologiques ou physiques. Elles n’ont pas souhaité s’exprimer dans cette enquête. Nous avons également recueilli les témoignages de plusieurs anciens camarades de promotion de Sofiane Bennacer, qui retracent le parcours du comédien. Plusieurs comédiens et comédiennes ayant croisé son chemin le décrivent en des termes similaires : l’une parle d’un homme «charismatique» et ayant régulièrement recours à «l’intimidation», tandis qu’un ancien camarade de Mulhouse dépeint Sofiane Bennacer comme une personne «agressive», avec un côté «manipulateur» et qui aurait tendance à «prendre les femmes pour des objets». Contacté par Libération dès le mois de mai, Sofiane Bennacer s’est exprimé dans un long mail dans lequel il dément formellement les accusations de Romane. Il affirme qu’elle serait allée «quémander de témoigner» contre lui auprès de plusieurs ex-compagnes, «en leur disant qu’il y avait déjà six filles qui avaient porté plainte contre moi, chose qui est complètement fausse». Des accusations qu’il a réitérées sur son compte Instagram mercredi. Libération a pourtant pu consulter des messages envoyés par Romane aux jeunes femmes ayant fréquenté Sofiane Bennacer. Aucun ne fait état de ces éléments. Concernant les deux autres témoignages le mettant en cause pour des faits de violences sexuelles et physiques, à propos desquels Libération lui a transmis plusieurs questions, le comédien est resté vague mais affirme qu’il n’a «jamais violé ni frappé personne». Contactée par Libération, son avocate, Jacqueline Laffont, n’a pas souhaité répondre à nos questions à ce stade. Dans un SMS envoyé mercredi à Libération, Sofiane Bennacer se dit «innocent» avant d’ajouter : «Je défendrai toujours les femmes de ces actes horribles.» (1) Les prénoms ont été modifiés. ----------------------------------------------------- Enquête Libé Sur le tournage des «Amandiers», «on avait l’impression d’être enfermés dans ce secret» Au sein de l’équipe, certains avaient eu vent dès les auditions d’accusations de violences sexuelles visant l’acteur Sofiane Bennacer. Des techniciens et alternants racontent l’omerta sur le plateau. par Cassandre Leray dans Libération publié le 24 novembre 2022 Le temps de quelques minutes, l’omerta vole en éclats. Lundi 5 juillet 2021 au petit matin, Margot (1) découvre des lettres tapissées sur la Maison des arts de Créteil. Pendant la nuit, des militantes féministes ont collé des messages sur les abords du théâtre, occupé par le tournage du film les Amandiers. «Production complice» sur un camion ou «un loup dans la bergerie» dans les escaliers… Sur les façades du bâtiment, d’autres phrases en lettres noires sur papier blanc : «Une plainte en cours ils n’en ont cure.» Puis un message nominatif : «Sofiane Bennacer acteur-violeur.» Les mots ciblent le jeune acteur qui incarne le premier rôle masculin du nouveau long métrage de Valeria Bruni-Tedeschi, les colleuses ayant appris qu’il est visé par une plainte pour viol déposée en février 2021 par une ex-petite-amie, Romane (1). Margot sait immédiatement à quoi ils font allusion. La technicienne de 26 ans a découvert les accusations à l’égard du comédien quand elle a commencé à travailler sur le tournage, en juin 2021. Discrètement, elle prend une photo des collages avec son smartphone. Très vite, la régie décolle les lettres des décors, mais Margot se sent soulagée : «Le monde extérieur nous voyait d’un coup, alors qu’on avait l’impression d’être enfermés dans ce secret dont il ne fallait pas parler.» Valeria Bruni-Tedeschi réunit l’équipe du film et se lance dans un discours pour défendre son acteur, absent, parlant de «présomption d’innocence». Margot ne l’écoute que d’une oreille. Pour elle, trois mots résument cette scène : «Une honte absolue.» Pendant huit mois, Libération a plongé dans les coulisses du long métrage, interrogeant une trentaine de personnes dont une quinzaine de professionnels sur le tournage. Nombre d’entre eux accusent la production et Valeria Bruni-Tedeschi d’avoir «protégé» Sofiane Bennacer en connaissance de cause. «Une rumeur» Que savaient vraiment les producteurs et la réalisatrice des accusations visant Sofiane Bennacer, avant et pendant le tournage ? Dès les auditions, une comédienne crache le morceau, fin mars 2021. Anna (1) passe le casting des Amandiers. Elle est au courant pour Sofiane Bennacer : elle connaît la plaignante, Romane, dont elle est camarade de promotion à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS). Le jeune comédien était aussi étudiant au TNS avant d’en démissionner en février. Quelques semaines après que Romane a confirmé à la direction du théâtre avoir été violée par Sofiane Bennacer lorsqu’ils étaient en couple, avant leur entrée au TNS. L’établissement précisera d’ailleurs à Libération avoir fait un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code pénal fin mars 2021. Lorsqu’Anna apprend qu’elle devra donner la réplique à Sofiane Bennacer lors de son audition, elle appelle l’assistante de casting pour expliquer pourquoi elle refuse : «J’ai dit qu’il était accusé de violences sexuelles.» Contactés par Libération en mai, Alexandra Henochsberg, d’Ad Vitam Production, et Patrick Sobelman d’Agat Films – les deux sociétés qui produisent les Amandiers –, confirment avoir entendu parler d’une «rumeur concernant une soirée avec son ancienne petite amie du TNS qui aurait mal tourné avec un comportement violent de Sofiane». «Fin mai 2021», décision est prise d’appeler Stanislas Nordey, qui dirige le TNS. Un appel confirmé par le directeur du théâtre qui aurait alors expliqué que le comédien était accusé de «viol». La production dément l’avoir entendu parler de viol. En plus d’avoir omis l’existence de la plainte, le directeur n’aurait pas non plus mentionné le signalement au procureur, assurent les producteurs à Libération : «A ce moment-là, on n’a aucun autre moyen de savoir s’il y a plainte ou pas. C’était lui notre interlocuteur.» Sofiane Bennacer est embauché car, «sur le seul fondement d’une rumeur, rien ne nous empêchait» de l’engager. Le tournage débute le 3 juin 2021. Le long métrage raconte l’histoire de comédiens de 20 ans fraîchement acceptés au sein de l’école des Amandiers, à Nanterre (Hauts-de-Seine), fondée à la fin des années 80 par deux figures du théâtre français : Patrice Chéreau et Pierre Romans. En haut de l’affiche, les acteurs Nadia Tereszkiewicz et Sofiane Bennacer. Le film raconte leur histoire d’amour, inspirée de la relation entre la réalisatrice et le comédien Thierry Ravel, mort d’overdose. «Confiance totale envers son casting» Ce 3 juin, Coline (1), 21 ans, débarque pour son premier jour de travail. Peu de temps avant, elle a appris par des amies que Sofiane Bennacer était accusé d’agression sexuelle. Dès son deuxième jour, l’étudiante à la CinéFabrique – une école de cinéma lyonnaise – décide de s’en ouvrir auprès de ses collègues, dont plusieurs camarades de promotion, eux aussi présents sur le projet. Une première rencontre a lieu entre les cinq alternants de son école et les producteurs. «Ils disaient qu’ils avaient eu vent de rumeurs et qu’ils ne se sentaient pas légitimes à refuser à quelqu’un de travailler à cause de rumeurs», résume Nina (1), en alternance à la technique. Sauf que Coline n’en démord pas. Elle mène sa propre enquête, contacte une amie, étudiante au TNS, retrouve la trace de Romane et découvre qu’elle a déposé plainte pour viol. Deux jours plus tard, Coline déballe tout ce qu’elle sait : il ne s’agit pas d’une simple «rumeur d’agression sexuelle» mais d’une «plainte pour viol». Impensable de maintenir Sofiane Bennacer dans son rôle : les alternants le disent très clairement à la réalisatrice. «On lui a expliqué que ce n’était pas un taf anodin, qu’il y allait avoir une répercussion médiatique et que c’était valider le fait d’engager des mecs accusés de violences sexuelles, relate Elise (1), alternante. Valeria a été très claire : elle nous a dit qu’elle était en accord avec son choix, que, pour elle, il n’y avait aucun problème.» Devant l’ensemble de l’équipe technique et en l’absence de Sofiane Bennacer, comme chaque fois que son cas sera abordé sur le tournage, la réalisatrice assure avoir une «confiance totale envers son casting». «Elle nous a dit qu’il ne fallait pas que Sofiane sente que l’équipe était au courant ou que ça change nos comportements, ajoute Elise. C’était une bonne claque dans la gueule de voir comment les choses se passent dans ce milieu-là.» Coline tente le tout pour le tout. Ne supportant pas l’omerta, elle pense organiser une grève sur le tournage mais se rabat sur une réunion avec les actrices. Une seule osera se présenter. La coupe est pleine. Coline finit par quitter le plateau. Elle lâchera même complètement le cinéma : «Je préfère être au chômage que bosser pour des personnes comme ça.» Louise (1), stagiaire de 22 ans au montage, va suivre la même trajectoire : elle démissionne après un mois, même si elle sait que sa décision signe probablement la fin de sa carrière dans le cinéma. Peur d’être blacklisté Deux démissions puis le silence. Sur le plateau, le sujet Bennacer passe en sourdine. Le tournage se poursuit sans encombre jusqu’au jour des collages féministes. Mais, malgré les accusations qu’il nie en bloc, le «coup de cœur» de Valeria Bruni-Tedeschi, comme on dit autour d’elle, reste en place. La réalisatrice «souhaitait absolument travailler avec lui», raconte Matthieu (1), technicien quadragénaire. Sur le plateau, ne subsistent que des chuchotements entre collègues. Certains «outrés», «mal à l’aise», d’autres détachés, car «on est là pour faire notre travail avant tout», estime Matthieu. Plusieurs jeunes femmes se font la promesse d’éviter l’acteur autant que possible. «Il ne pouvait que le sentir, une bonne partie des jeunes de son âge ne lui parlait jamais», souligne Margot, technicienne. Du début à la fin du tournage, la ligne de Valeria Bruni-Tedeschi ne va jamais varier : la «présomption d’innocence». «Je comprends qu’on ne puisse pas condamner quelqu’un sans décision de justice, commente Hugo (1), régisseur. Mais on n’avait pas à subir le fait de travailler avec lui sans savoir.» D’autant que l’enquête judiciaire est alors en cours, rappelle Nina, alternante à la technique : «S’il avait purgé sa peine, ce serait différent. Mais là, la justice n’a pas été rendue.» «Valeria disait que c’était aussi le sauver lui, lui donner une chance et le propulser dans ce milieu, et qu’elle croyait en son talent», se souvient Noémie (1), de l’équipe caméras. Cette quadragénaire perçoit comme une fracture dans l’équipe : les anciens d’un côté, de l’autre la «nouvelle génération» qui a vu la naissance de #MeToo et est allée demander des comptes. «Avec les techniciens de mon âge, on se disait : “On n’est pas d’accord, mais on est là pour travailler, alors on ferme un peu les yeux.”» La décision de maintenir ou non Sofiane Bennacer sur le film était entre les mains de trois personnes : les producteurs et la réalisatrice. Contacté par Libération, le duo Henochsberg-Sobelman admet s’être retrouvé dans une situation «extrêmement compliquée à gérer», découvrant la plainte pour viol deux jours après le début du tournage, comme tout le monde. La production l’aurait alors convoqué afin de lui demander de prendre un avocat et d’aller «de lui-même se confronter à la justice». Même s’ils l’avaient voulu, argumentent les producteurs, il aurait été impossible de se séparer de l’acteur : «Le droit ne nous permet pas de licencier un employé sur ces allégations, il pourrait légitimement nous attaquer en justice.» «Valeria a embarqué tout le monde dans cette histoire» Valeria Bruni-Tedeschi, que Libération a relancée plusieurs fois afin de fixer une rencontre, n’a pas donné suite à nos demandes à ce jour. Plus d’un an après le tournage, elle a été entendue en octobre comme témoin dans l’enquête judiciaire visant Sofiane Bennacer. Dans un mail adressé au journal en mai dernier, juste avant la projection des Amandiers à Cannes, elle racontait avoir été elle-même «victime de violences dans [s]on enfance». «Je connais la souffrance de ne pas être entendue. Mais je ne crois pas que le combat pour les droits des femmes et des plus démunis doive s’accommoder de la violation de la présomption d’innocence», écrivait-elle. Quid de l’équipe ? Aurait-elle dû quitter le plateau ? Le dilemme est grand entre l’évidente nécessité de «gagner des sous», le «tremplin professionnel» que ce tournage représentait et la peur d’être blacklisté. Claquer la porte, c’était risquer «d’enterrer sa carrière», selon la formule de Romain (1), apprenti technicien qui, à moins de 30 ans, en tire une triste leçon professionnelle : «Si on fait passer l’éthique en premier, je crois que ce n’est pas possible de travailler dans ce milieu.» Aucun doute : s’il part, il sera remplacé en un claquement de doigts. Toutes et tous le savent. Certains ont «honte», regrettent de n’avoir rien dit. «Valeria a embarqué tout le monde dans cette histoire sans mettre les gens au courant, lâche Alicia (1), la trentaine et technicienne. Quand on a découvert les faits, on était déjà engagés.» D’autres racontent aussi l’attachement au film et à sa réalisatrice. L’une des actrices, Lucie (1), la vingtaine, revoit les centaines de candidats évincés au fil des semaines d’auditions. «On a réussi à arracher une place dans ce film qui nous faisait rêver. Partir ou rester, c’est une question de l’ordre du sacrifice, déclare la jeune femme. Je ne vois pas pourquoi des actrices devraient sacrifier leur carrière pour des acteurs accusés de viol.» Pour Agathe (1), qui joue aussi dans les Amandiers, «c’est Sofiane qui n’aurait pas dû faire ce film». Aujourd’hui, Lucie et Agathe, les deux seules actrices à avoir répondu à Libération, ont une peur : que «ce qu’a fait Sofiane nous éclabousse tous». «Pour moi, ce n’est pas du tout normal de l’avoir recruté, s’énerve Agathe. Mais ce n’est pas parce qu’on est restés que nous sommes des complices.» Cassandre Leray, Libération (1) Les prénoms ont été changés.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...