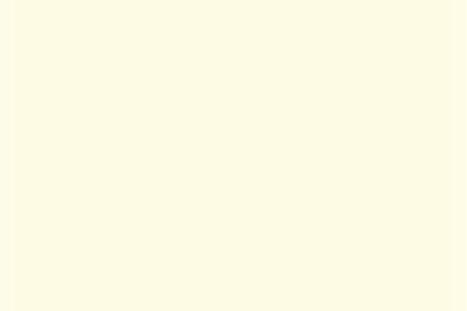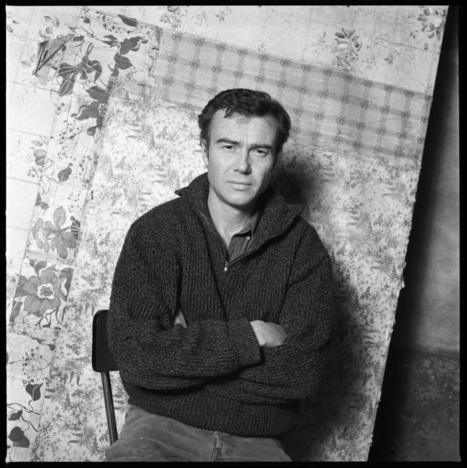Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 12:26 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 19/12/2022 La metteuse en scène devient la seule femme à diriger un des cinq établissements nationaux.
Lire l'article sur le site du Monde :https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/19/caroline-guiela-nguyen-nommee-a-la-tete-du-theatre-national-de-strasbourg_6155080_3246.html
C’était une des nominations les plus attendues dans le théâtre français : la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, 41 ans, a été nommée lundi 19 décembre, à la direction du Théâtre national de Strasbourg (TNS), seul établissement national implanté en région et vaisseau amiral d’une importance capitale pour la création théâtrale, en raison des moyens de production dont il dispose. Elle y remplacera Stanislas Nordey, en poste depuis 2014, qui n’était pas candidat à sa succession mais avait accepté, en octobre, un intérim jusqu’au 31 août 2023 dans l’attente de sa succession. Caroline Guiela Nguyen devient ainsi la seule femme à diriger, à l’heure actuelle, un des cinq théâtres nationaux de France, qui plus est doublé d’une école prestigieuse. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2023. « Caroline Guiela Nguyen a l’ambition de s’adresser à tous ceux qui se sentent éloignés du théâtre, pour qu’ils trouvent leur place à la fois dans le public, sur scène, ou au sein de l’école du TNS » se réjouit la ministre de la culture Rima Abdul Malak dans un communiqué qui précise que la nouvelle directrice entend faire de ce théâtre, un lieu « où les pratiques du théâtre, du cinéma et de l’audiovisuel se construisent et se pensent dans un même mouvement ». Le TNS s’associera d’ailleurs dans cet objectif à la chaîne Franco-allemande Arte annonce le ministère. Un style et des récits nouveaux Cette nomination couronne un superbe parcours, qui a vu la jeune femme imposer en quelques années un ton, un style et des récits nouveaux qui manquaient dans le théâtre français. De par ses origines familiales, Caroline Guiela Nguyen a des liens avec le Vietnam, l’Algérie et l’Inde et avec l’histoire coloniale et postcoloniale de la France. Et c’est lestée de ce bagage qu’elle a amené quelque chose de tout à fait neuf et investi des territoires oubliés ou occultés, au fil de ses spectacles : Se souvenir de Violetta (2011), Le Bal d’Emma (2012), Elle brûle (2013), Le Chagrin (2015) et, surtout, Saïgon qui, depuis sa création au Festival d’Avignon en juillet 2017, a connu un succès fracassant et n’a cessé de tourner dans le monde entier, de la Chine à l’Australie en passant par l’ensemble de l’Europe. Entretemps, Caroline Guiela Nguyen a signé Fraternité, conte fantastique (2021), premier volet d’un cycle qui s’est poursuivi avec la création, le 7 octobre, à la Schaubühne de Berlin, de Kindheitsarchive [Enfance - Archive]. Casser le moule masculin A Strasbourg, elle revient sur des terres déjà connues, puisqu’elle a fait ses études à l’école du TNS (en section mise en scène), dont elle est sortie en 2008. Elle a été marquée dans ce parcours par deux grands artistes, Krystian Lupa et Joël Pommerat. Et c’est avec des camarades de sa promotion qu’elle a créé sa compagnie, Les Hommes approximatifs – un nom tiré d’un poème de Tristan Tzara. Son originalité est d’avoir remis le réel, intimement traversé par l’histoire, au cœur du théâtre, tout en croyant dur comme fer aux pouvoirs de la fiction et de l’émotion. Tous ses spectacles cassent le moule encore largement ethnocentré et masculin du théâtre français, mêlent comédiens amateurs et professionnels et sont marqués du sceau d’une écriture cinématographique – Caroline Guiela Nguyen est également cinéaste et a tourné, en 2020, un court-métrage, Les Engloutis, avec des détenus de la maison centrale d’Arles. « Contrairement à ce que l’on croit souvent, l’imaginaire est le lieu même du politique, déclarait-elle dans un entretien au Monde en 2019. L’endroit qui peut être profondément politique, c’est de refaire apparaître des gens, de créer de l’imaginaire : remettre des êtres, des visages, des corps derrière des mots abstraits. C’est quand on n’arrive plus à imaginer l’humain que l’on tombe dans les pires dérives. » Fabienne Darge Légende photo : Caroline Guiela Nguyen, le 4 juin 2019, à Paris. FRÉDÉRIC STUCIN/PASCO POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 9:18 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 19/12/2022 L’autrice du spectacle « Les Chatouilles ou la Danse de la colère », a annoncé l’annulation de la pièce qui devait être reprise en janvier au Théâtre libre, à Paris, en raison de différends relatifs aux combats que mène la comédienne.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/19/andrea-bescond-rompt-avec-son-producteur-jean-marc-dumontet_6155045_3246.html
La rupture est consommée entre Andréa Bescond et Jean-Marc Dumontet. La comédienne a annoncé, jeudi 15 décembre, dans une vidéo postée sur Instagram, qu’elle ne jouerait pas son spectacle Les Chatouilles ou la Danse de la colère – dont la reprise était programmée du 18 janvier au 2 février 2023 au Théâtre libre, à Paris – et a renvoyé la responsabilité de cette annulation sur son producteur. « Le dialogue est trop difficile avec JMD Production (…). Clairement, on me fait payer mon engagement contre les violences sexuelles », déclare Andréa Bescond, autrice de ce seule-en-scène racontant l’histoire d’une petite fille victime de pédophilie et qui tente de se reconstruire grâce à la danse. Lire la critique des « Chatouilles » : « Les Chatouilles » : une vie brisée par le viol Cette histoire, c’est la sienne. Enfant, Andréa Bescond a été violée par un ami de ses parents. Depuis le succès de ce spectacle bouleversant (Molière 2016 du seul-en-scène) et sa déclinaison cinématographique (César 2019 de la meilleure adaptation), la comédienne a fait de la lutte contre la pédophilie et les violences sexuelles un combat citoyen. Jean-Marc Dumontet (propriétaire de six théâtres parisiens, dont le Théâtre libre) soutient ce spectacle depuis sa création en 2014 et le produit depuis 2017. Que s’est-il donc passé pour qu’Andréa Bescond dise aujourd’hui ne plus vouloir travailler avec lui, allant même jusqu’à « bloquer » le numéro de portable de celui-ci pour ne plus recevoir ses appels ou ses SMS ? Tout semble être parti d’un désaccord sur les conditions de la promotion du spectacle. Mais, derrière ses différends d’ordre logistique se cachent des divergences bien plus profondes, qui sortent du cadre artistique. « Beaucoup d’éléments ont pesé », explique au Monde la comédienne, au premier rang desquels l’affaire Richard Berry. En février 2021, le comédien – qui triomphe alors au Théâtre libre avec son spectacle Plaidoiries, produit par Jean-Marc Dumontet – est accusé d’inceste par sa fille Coline Berry-Rojtman. « A l’époque, Andréa m’a tout de suite appelé pour connaître ma position, se souvient le producteur. Je ne voulais pas piétiner un homme avec qui je travaillais depuis quatre ans et m’ériger en juge. » Depuis, l’enquête a été classée sans suite pour prescription. La comédienne vit mal ce qu’elle considère comme un soutien à l’acteur. « Il n’y a aucune raison que Coline ait inventé une histoire pareille. Depuis des mois, reconnaît-elle, c’était très compliqué pour moi d’avoir le même producteur que Richard Berry. » Le sentiment d’être « punie » Néanmoins, en mai 2022, Andréa Bescond fait savoir à Jean-Marc Dumontet qu’elle souhaite rejouer Les Chatouilles, notamment pour montrer le spectacle à ses enfants. Des dates sont alors fixées pour janvier 2023 au Théâtre libre. Mais dès les répétitions, à la fin de novembre, un premier différend survient à propos des lumières du spectacle, puis concernant sa commercialisation. « Je voulais pour Les Chatouilles le même plan média que celui qu’avait eu Richard Berry pour Plaidoiries. Rappelez-vous, à l’époque il avait des affiches partout, sur les bus, dans le métro, etc., et une grande bâche sur la façade du théâtre », explique Andréa Bescond. La production lui fait savoir que l’affichage sur des colonnes Morris débutera le 20 décembre et que la bâche ne sera posée que lors de la première représentation. Andréa Bescond a alors le sentiment d’être « punie ». Pas seulement pour avoir « critiqué le soutien de Jean-Marc Dumontet à Richard Berry », mais aussi « pour avoir dénoncé l’inaction du gouvernement dans la lutte contre la pédophilie et la protection de l’enfance » alors que son producteur est un proche du président de la République. « Mi-décembre, elle nous a envoyé des mails très agressifs », explique Jean-Marc Dumontet. « Je ne suis pas soumise, et ça, ça énerve, observe Andréa Bescond. Dumontet m’a appelée pour me dire que je ne donnais plus envie et pour me reprocher mon militantisme. Selon lui, la lutte contre les violences m’avait complètement bouffée et je devenais trop radicale, poursuit, dépitée, la comédienne. A partir de là ce n’était plus possible de jouer. » Le producteur assure « ne pas vouloir polémiquer » et reconnaît qu’Andréa Bescond et son spectacle « exceptionnel et nécessaire » ont contribué à « sensibiliser le public au fléau des violences sexuelles ». Mais désormais il considère que « même si sa cause est noble », la comédienne « est dans un chemin où elle s’enferme en n’étant que dans la dénonciation ». Et d’ajouter : « J’étais son allié depuis huit ans. On a pleuré ensemble lorsque j’ai découvert son spectacle en 2014 au festival “off” d’Avignon. Je suis triste qu’elle jette à la poubelle cette aventure. Aujourd’hui, je représente à ses yeux le patriarcat et soi-disant les puissants. Sur son compte Instagram, Andréa Bescond dénonce régulièrement, dans des posts en lettrage blanc sur fond noir, les violences faites aux femmes et aux enfants et les carences de la justice et de l’Etat en matière de lutte contre ce fléau. « Je ne veux plus de ce monde-là, de ces hypocrites, de cette complicité passive autour de la pédocriminalité et de l’inceste. Et je ne veux plus travailler avec un homme “colonisé” par Macron, qui rêve de devenir un de ses ministres », argue la comédienne. Elle souhaite toujours rejouer Les Chatouilles. Mais « plus tard, quand les droits seront tombés et que je pourrai moi-même produire le spectacle. Je ne suis pas pressée ». Le 4 janvier 2023, elle publiera aux éditions Albin Michel son premier roman, Une simple histoire de famille, qu’elle prévoit d’adapter au cinéma. Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 8:49 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 15/12/2022 C’est dans la salle la plus haut perchée du Théâtre Lucernaire appelée le Paradis, que Roland Dubillard , bien servi par Denis Lavant et Samuel Mercer, nous livre, post mortem, quelques affres et joyeuseté de sa composition extraits de « Ses carnets en marge » ,sous le titre »Je ne suis pas de moi ». Merci Roland. Près de mille pages, réunissant une cinquantaine de carnets écrits sur des tas de supports, ses Carnets en marge sont parus en 1998. Roland Dubillard était vivant, mais atteint d’une hémiplégie depuis 1987, et donc fortement diminué. Quand on allait lui rendre visite du côté de Bondoufle, la parole, parfois, lui revenait, caustique. Sa compagne Maria Machado veillait sur lui, et aujourd’hui c’est elle qui, inlassablement, veille sur son œuvre. C’est aussi elle, avec Charlotte Escamez, qui a mis en scène Je ne suis pas de moi (phrase on ne peut plus dubillardienne) où le jeune Samuel Mercer côtoie ce vieux briscard doué en tout qu’est Denis Lavant. Les Carnets en marge sont tout sauf un journal, d’ailleurs les rares noms qui apparaissent, hormis ceux des célébrités, sont souvent tronqués. Derrière un certain Stern, auteur dramatique, on peut penser que...Ces carnets, c’est de l’écriture en acte, au présent, cinquante durant, de 1947 à 1997. C’est un livre que l’on a plaisir à ouvrir au hasard : la pêche est toujours bonne .Par exemple, ces deux lignes écrites le 26 mai 1949 : « On cite le cas d’un cheval si épris d’une rose, que c’était pour elle qu’il n’arrêtait pas de manger de l’herbe ». Ou ceci écrit le 6 juin 1953 : « Le dormeur pâle, nu sous le ciel étoilé, dans une barque qui dérive, mêle dans son souffle le large mouvement de la mer au mouvement insensible des constellations. Ses yeux plombés d’une clarté, pourtant venue de loin ; son sourire dévoilant à peine ses dents : on dirait sa respiration prêt à chanter sans qu’il ne veuille. L’approcher comme on approcherait quelque chose de lointain, mais qui deviendrait de tout près plus lointaine. » Ou cette saillie du 30 août 1955 : « Depuis quand Jésus-Christ porte-il une barbe ? » Ou ceci qui annonce ses futurs Confessions d’un fumeur de tabac français qui paraîtra chez Gallimard en 1974, l’année où sa pièce Olga ma vache recevra le Grand pris de l’humour noir : « Pour pisser on dispose d’endroits solitaires. Pour respirer rien n’est prévu,il faut respirer en public. Tout le bonhomme se précipite dans cette question. Est-il rien de plus humble que la respiration ? L’orgueil ne s’en accommode pas ». Terminons par ce dialogue noté le 28 mars 1975, intitulé « Sur Scène » : « A : Etre là tous les soirs à dire la même chose, qu’on a apprise par cœur une fois pour toutes, sur la même scène du même théâtre B ; Pas devant le même public. A ; Heureusement ! Le public, il es raisonnable, lui ! Il change tous les soirs, mais nous si nous changions de texte tous les soirs (comme nous faisons ce soir), à votre avis, ce serait supportable ? B : Pour vous ? Je ne crois pas. Il faudrait aussi changer le reste. A : Changer de théâtre ? B;Ou changer de métier. A : Si chaque soir nous changions de tout : de texte, de théâtre, de décors, de costumes, de sexe même -le public, lui, pourrait rester le même ». Que ces phrases soient dites ou pas par les deux acteurs importe peu. L’étonnement et le ravissement chez Roland Dubillard font toujours la paire. Jean-Pierre Thibaudat Théâtre du Lucernaire, du mar au sam 19h, dim15h30, jusqu’au 31 déc. Lundi prochain à 19h les acteurs du spectacle liront la pièce de Dubillard Les crabes, entrée gratuite. « Les Carnets en marge » sont édités chez Gallimard, 982p. Légende photo : Scène de "Je ne suis pas de moi"; © Giovanni Cittadini

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 7:36 AM
|
Par Marie-José Sirach dans L'Huma 18 déc. 2022 14e édition d’Impatience s’est tenue en Île-de-France, du 6 au 15 décembre. Consacrée au théâtre émergent, cette manifestation a réservé de belles surprises qui témoignent de la vitalité d’une nouvelle génération d’artistes. Dix spectacles figuraient à l’affiche de cette édition du festival Impatience. Créé il y a quatorze ans sous l’impulsion de notre consœur de Télérama Fabienne Pascaud et avec la complicité active dans un premier temps de l’Odéon, puis, désormais, du 104, Impatience porte bien son nom : celui de jeunes gens qui se lancent dans l’aventure artistique du théâtre (pas plus de deux créations à leur actif). Sur 250 propositions parvenues aux organisateurs (le 104, le Jeune Théâtre national , les Plateaux sauvages, le Théâtre de Chelles, le CDN de Sartrouville, le Théâtre Louis-Aragon de Tremblay, le Théâtre 13), dix projets ont été retenus. Un marathon théâtral qui s’est déroulé du 6 au 15 décembre, parsemé de spectacles pour certains audacieux, d’autres plus fragiles dans la forme comme dans le fond, serait-on tenté d’écrire. Quatre prix ont été décernés : le prix du public, le prix des lycéens, le prix SACD et le prix du jury, présidé cette année par le metteur en scène Julien Gosselin. Le prix du public est revenu au spectacle écrit et mis en scène par Yacine Sif El Islam Sola Gratia. Un récit autobiographique qui évoque avec pudeur et sensibilité une agression homophobe dont les traces, une balafre sur la joue pour Yacine, une autre dans le dos pour Benjamin, son compagnon, se lisent sur leurs corps. Si le spectacle est encore fragile, l’engagement de l’acteur, sa façon de nous raconter l’horreur sans hausser le ton, son geste d’une violence contenue pour ouvrir les pages du livre où il a consigné son récit (publié aux éditions Komos) avec le couteau dont se sont servis ses agresseurs questionnent la violence, la haine, sans faux-semblants. La « Koulounisation » et la guerre d’Algérie Le prix des lycéens (et celui de la SACD) a récompensé le très beau travail de Salim Djaferi Koulounisation. Pour évoquer la colonisation et la guerre d’Algérie, il s’est détourné du récit estampillé « historique ». Il a juste posé une question, à sa mère, à sa tante, ici, en France, à des amis, en Algérie : « Comment dit-on “colonisation” en arabe ? » Dès lors, il remonte le fil de l’Histoire à partir de récits intimes, la quête d’un mot qui, dans la langue arabe, existe sous plusieurs formes. Ce travail autour de la langue, cette recherche sémantique pour un mot fantôme, la découverte, dans une librairie francophone d’Alger, que les livres sur cette période sont rangés non pas dans la catégorie « guerre d’Algérie » mais « révolution » lui permettent de dérouler les fils emmêlés des souvenirs qui jaillissent au fil des rencontres. Des témoignages patiemment recueillis qui ne s’inscrivent pas dans le roman national officiel à l’œuvre des deux côtés de la Méditerranée mais dans la mémoire collective des deux peuples. Avec, pour accessoires, des fils tendus sur lesquels il va accrocher des objets comme autant de traces de cette histoire douloureuse et des panneaux de polystyrène qu’il va manipuler à vue, Koulounisation est un spectacle d’une rare intelligence qui sait mettre des mots sur des points aveugles d’une histoire commune, loin des versions officielles qui alimentent le terreau de l’extrême droite en France et celui des intégristes en Algérie. Les Dévorantes, un spectacle punk Le prix du jury a distingué le Beau Monde, une création collective d’Arthur Amard, Rémi Fortin et Blanche Ripoche. Une dystopie joyeuse, un inventaire à la Prévert avec son côté aléatoire qui nous projette dans cent ans, à une époque où le théâtre n’existe plus. Charge à une poignée d’hommes et de femmes de raconter aux générations futures, tous les soixante ans, le souvenir de ce rituel avec un, deux ou plusieurs acteurs qui, face public, racontaient des histoires, mettaient le monde en scène. De ces textes consignés, il ne reste que des fragments. Des fragments comme des haïkus, joués, chantés, mimés ou dansés pour raconter le théâtre. C’est drôle, intelligent, poétique, porté par trois jeunes acteurs au diapason de cette partition loufoque et débridée. Avec quelques cailloux à même le sol, des costumes enfilés à l’envers d’où sortent les étiquettes, les trois acteurs se métamorphosent en Petit Poucet. Et comme le héros du conte de notre enfance, ils ne s’en laissent pas conter et portent sur notre monde actuel un regard vif et percutant. Les repères spatio-temporels volent en éclats. Ils parlent au futur proche et nous tendent un miroir sur notre monde contemporain. Le rire se fait alors plus grave. Le théâtre étant concomitant de l’avènement de la démocratie, si l’un était amené à disparaître, l’autre aurait du mal à lui survivre… Un dernier aperçu de la variété des propositions d’Impatience : les Dévorantes, un spectacle punk écrit, joué et chanté par Sarah Espour sur les femmes criminelles. La découverte d’une sacrée artiste, une performeuse hors pair. Le Beau Monde sera programmé au Festival d’Avignon en juillet. Légende photo : Le prix du jury a distingué le Beau Monde. Une dystopie joyeuse, un inventaire à la Prévert porté par trois jeunes acteurs au diapason d’une partition loufoque et débridée. Photo Mohamed Charara

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2022 10:02 AM
|
Par Lucile Commeaux dans Libération - 15 décembre 2022 Dans une interprétation foisonnante du dernier opéra de Mozart, Johanny Bert subvertit les rapports de genre avec délicatesse. Il arrive souvent qu’on découvre l’opéra avec la Flûte enchantée, régulièrement programmée dans les périodes de fête car souvent considérée comme «tout public». Pourtant, la partition de Mozart, dont c’est le dernier opéra, est redoutable, et le livret signé Emanuel Schikaneder, sous ses airs de conte enfantin, est ardu et opaque, parfois répétitif, en tout cas très difficile à appréhender sur scène. Soit un jeune prince, Tamino, lancé par une Reine de la nuit furieuse sur les traces de sa fille Pamina, qui a été enlevée par Sarastro, le grand ordonnateur d’une secte révérant Isis et Osiris. Parvenu au temple, Tamino est soumis à des épreuves afin d’être initié et d’obtenir ainsi la main de Pamina. Cette mystérieuse quête chevaleresque est doublée de son envers burlesque, celle de l’oiseleur Papageno qui cherche son âme sœur. Sur la scène de l’Opéra du Rhin, alors que sur les places strasbourgeoises les marchés de Noël promettent un divertissement facile, le metteur en scène et marionnettiste Johanny Bert tente pour cette première expérience lyrique une interprétation foisonnante dont on interroge d’abord la cohérence. Sur la scène les idées fusent : la mise en abyme avec coulisses apparentes, le cirque avec des trucs un peu magiques (un serpent de papier s’élève dans les airs, une robe à paniers devient pour la jeune fille séquestrée une cage lumineuse), le burlesque assumé (Tamino déshabillé par les fées), le décalage contextuel (la Reine de la nuit apparaît dans un module figurant une chambre miteuse, clope et whisky à la main). Il faut attendre l’apparition de Sarastro, personnage hiératique souvent maltraité par les metteurs en scène, pour que véritablement le sens de cette proposition fasse son chemin, et éclaire ensuite le celui de l’opéra : le grand prêtre mozartien est interprété par une marionnette monumentale représentant un vieillard assis dans un fauteuil roulant, manipulé par trois marionnettistes, et doublé par un chanteur qui lui sert en quelque sorte d’interprète. La marionnette est belle, et humanise paradoxalement les relations étranges qui lient ces deux couples contrariés ; on comprend dès lors comment, dans une subversion sensible et intelligente du conte qui exalte originellement les valeurs masculines et éreinte l’inconstance féminine, le spectacle de Johanny Bert travaille à adoucir les rapports de genre et de générations avec délicatesse, dans les décors, les costumes, les accessoires, les marionnettes, bref en homme d’un théâtre d’objets et d’artisanat. A la fosse, l’orchestre symphonique de Mulhouse soutient avec la même générosité le chœur de l’Opéra du Rhin et un plateau vocal parfois fragile mais qu’on sent soudé et enthousiaste, et la Flûte enchantée peut conquérir ce vaste public qu’elle intimide ou ennuie trop souvent. La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart à l’Opéra du Rhin et à la Sinne à Mulhouse, jusqu’au 8 janvier, direction musicale Andreas Spering, mise en scène Johanny Bert. Légende photo : Sarastro est interprété par une marionnette. (Klara Beck)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2022 7:47 AM
|
Par Luc Hernandez dans ExitMag, le 16/12/2022 Vous pouvez le voir en avant-première au TNP à Villeurbanne. Le Suicidé, « vaudeville soviétique » de Nicolaï Erdman est une satire tragi-comique russe dont Jean Bellorini livre un grand spectacle, comédie musicale rythmée et drôlissime d’hier qui claque comme une radiographie politique d’aujourd’hui. Magnifique ! Le drôle de “suicidé” de ce “vaudeville soviétique”, c’est un jeune homme que tout le monde croit mort ou sur le point de mourir, alors qu’en précaire de son temps, il n’est attaché qu’à une seule chose : vivre, et aimer sa belle dulcinée… Son temps, c’est celui de 1928 et de l’interdiction de cette grande oeuvre contestataire de la culture russe (elle n’a pas pu être jouée avant 1978 en URSS et Nicolaï Erdman est mort en 1970). Mais c’est aussi le temps de la vitalité des jeunes russes d’aujourd’hui écrasée par la “guerre”, cette “guerre” dont Nicolaï Erdman livre un réquisitoire sans pareil dans un monologue final d’il y a bientôt cent ans alors qu’on pourrait croire qu’il vient de l’écrire hier. Jean Bellorini met en scène sa tragique actualité dans une dernière vidéo estomaquante qu’on vous laissera découvrir. Une BD du régime stalinien en forme de comédie musicale Mais cette vraie tragédie et aussi et surtout dans sa forme une pure comédie désespérée en forme de course à l’abîme. Le public rit sans cesse des échappées surréalistes de cet anti-héros naïf en slip blanc harcelé par la “conscience sociale” de l’intelligentsia (extraordinaire Damien Zanoly en commissaire absurde du régime). Dans la vision joyeuse et lucide de Jean Bellorini, la farce est même une comédie musicale dans laquelle les comédiens sont aussi chanteurs et musiciens (on retrouve l’essentiel de la troupe fidèle du Jeu des ombres, la précédente création de Bellorini pour le TNP). On chante au banquet, danse le pas de deux avec un hélicon ou livre une version live sublime du Creep de Radiohead comme un appel désespéré vers la liberté occidentale dans ce qui restera pour nous un des grands moments de théâtre de la saison. Les costumes de Macha Makeïeff (qui rappellent Moscou quartier des Cerises, la comédie musicale de Chostakovitch qu’elle avait montée à l’Opéra de Lyon) apportent une merveille graphique à cette espèce de BD du régime stalinien et la traduction de Markowicz toute la théâtralité de cette langue typique aux dialogues impayables : “ce qu’un vivant pense, seul un mort peut le dire !”. François Deblock, acteur-poète de haut vol Dans une scénographie splendide, Jean Bellorini parvient surtout à faire de ce chef-d’oeuvre aux ruptures de ton permanentes typique de la culture russe, un récit fluide et parfaitement rythmé à travers différents niveaux de réalité. Jusqu’au complot qui s’orchestre en coulisses dans les images vidéos, ou les vraies-fausses funérailles d’un défunt fictif qui n’avait rien demandé, que de trouver sa place dans la société. A ce jeu tragi-comique, François Deblock est un acteur-poète de haut vol, physique d’allumette à l’étonnement naïf qui ne se départit jamais de la gravité du régime qui l’oppresse, et le condamne à la solitude au milieu des autres. Un grand spectacle, aussi drôle que politique, chef-d’œuvre d’hier et radiographie d’aujourd’hui. La plus belle raison d’être du théâtre.
Le Suicidé, vaudeville soviétique, de Nicolaï Erdman. Mise en scène Jean Bellorini. Vendredi 16 et samedi 17 décembre, puis du vendredi 6 au vendredi 20 janvier à 20h (dim 15h30) au TNP à Villeurbanne, grande salle Roger Planchon (2h15). tnp-villeurbanne.com
THEATRE - LE SUICIDÉ, VAUDEVILLE SOVIÉTIQUE de Nicolaï Erdman, mise en scene par Jean Bellorini, au Theatre National Populaire, décembre 2022. Avec François Deblock, Mathieu Delmonté, Clément Durand, Anke Engelsmann, Gérôme Ferchaud, Julien Gaspar-Oliveri, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, Damien Zanoly et Tatiana Frolova.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 13, 2022 9:57 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 6/12/22 L’actrice dit vouloir jouer encore et encore ce spectacle, « jusqu’ au bout ». Elle a raison. Ce qu’elle fait, seule en scène, est indescriptible. Thierry Thieû Niang l’accompagne dans ce texte extrême de Marguerite Duras créé sous le direction de Patrice Chéreau il y a bientôt quatorze ans. La douleur de Marguerite Duras est un texte que ni relève d’aucune catégorie. « Le mot « écrit » ne conviendrait pas » précisait -elle après avoir écrit « La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie » .Le mot, journal, auquel on peut vaguement penser, serait, lui, réducteur. Alors quoi ? Alors La douleur. Dans son appartement de la rue Saint Benoît, alors que les armées alliées libèrent les camps un à un, avec D (Dionys Mascolo) , elle attend Robert L (Robert Antelme) dont elle est sans nouvelles depuis son départ en Allemagne où il croupit dans un camp de concentration. D et Robert étaient des amis très proches. Duras a épousé Robert, elle est est tombée amoureuse de D, elle divorcera du premier pour épouser le second, mais nous n’en sommes pas là aux premières pages de La douleur. Marguerite, « la petite Marguerite » comme l’appelle affectueusement D, attend le retour de Robert. Mais reviendra-t-il ? Est-il vivant ? Va-t -il lui téléphoner, sonner à la porte ? A -t-il été fusillé ? Elle voit la scène, son corps s’affaissant dans le fossé. Elle attend. Elle va à la gare d’Orsay travailler avec ses amies dans une association créée pour ceux qui reviennent en marge des autorités, mais, tôt ou tard, elle revient chez elle, près du téléphone. « On ne me demande plus comment ça va, on ne me dit plus bonjour. On dit : « aucune nouvelle ? » Je dis aucune. » Elle le voit revenir et elle se voir mourir. « peut-être est-il mort depuis quinze jours déjà, paisible, allongé dans ce fossé noir », une balle dans la nuque. Toujours sur le divan, près du téléphone, elle attend. « Et tout à coup la certitude en rafale : il est mort ». Enfin une once de tangible, des camarades de Robert viennent d’arriver à Paris : « On l’a quitté il y a deux jours » Et puis : « je ne sais plus quel jour c’était , si c’était encore un jour d’avril, non c’était un jour de mai, un matin à onze heures le téléphone a sonné. Ça venait d’Allemagne, c’est François Morland (nom de résistance de François Mitterrrand) : « Ecoutez-moi bien, Robert est vivant ». S’en suit le récit hallucinant de son retour de Dachau, presque mourant. Ramené par D et un ami médecin avec des ordres de mission et des uniformes fournis par Morland. Duras raconte. Robert croit qu’il n’arrivera pas vivant en France. Mais il arrive rue Saint Benoit. La petite Marguerite écrit : « Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s’éteignent et je le vois. Immense. Devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde. Il sourit. Il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d’être arrivé à vivre jusqu’à ce moment ci. C’est à ce sourire que tout à coup, je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d’un tunnel ». Tout le texte est comme extirpé de ce tunnel. La vie reviendra lentement. La petite Marguerite n’omet aucun détail : la merde verte qui deviendra moins verte, la nourriture par cuillerèes, sa faim grandissante. Le texte s’achève sur une plage en Italie. « Lui s’est levé et il a avancé vers la mer. Je suis venue près du bord. Je l’ai regardé.il a vu que je le regardais.il clignais des yeux derrière ses lunettes et il me souriait, il remuait la tête par petits coups comme on fait pour se moquer ». Bientôt Robert Anselme écrira L’espèce humaine. Le chorégraphe Thierry Thieû Niang avait lu La douleur et c‘est lui qui, en 2010, fait connaître ce texte à Patrice Chéreau (dont il était un proche et un collaborateur régulier) et à Dominique Blanc. Ils en ont fait une lecture publique ensemble avant que l’actrice ne demande à Chéreau d’en faire un spectacle où elle serait seule en scène « parce que c’est vraiment l’histoire d’une solitude » disait-elle, avec raison. Le spectacle a fait le tour du monde. Et dans chaque ville, chaque pays on trouvait sur place un bureau, quelques chaises, se souvient Thierry Thieû Niang. Qui précise dans le programme : « Jamais nous n’avions pu imaginer reprendre ce spectacle—et pour ma part aucun spectacle créé et partagé avec Patrice. Il y a plus d’un an, Dominique m’a dit que là, le temps passant, au présent de nos vies, de nos métiers, qu’elle avait envie qu’ensemble on tente de traverser à nouveau ce texte, ce projet dont il n’y a aucune captation ». Et le miracle s’est accompli, avec une extrême délicatesse. Sous le regard de Thierry Thieû Niang, Dominique Blanc a retrouvé, doucement modulé, et même acéré (« le temps passant ») ce qu’elle faisait il y a dix ans. Pas le moindre théâtre oserai-je dire, dans ce cheminement tendrement frontal, dans sa façon d’ôter de remettre une laine, un manteau, de se lever, de s’asseoir à la table sous le regard d’une pomme. Comme une conduite médiumnique dans laquelle le spectateur se glisse comme un somnambule. Théâtre de l’Athénée, 20h, jusqu’au 11 déc. Puis au Théâtre des Bernardines de Marseille du 13 au 18 déc. Et l’année prochaine : le 23 mai à Thonon les bains, le 25 mai à Soissons, du 30 au 31 mai à La Rochelle, les 2 et 3 juin à Nice, le 8 juin à Grenoble et le 13 juin au festival d’Anjou à Angers Légende photo : Moment de "La douleur"; © Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2022 4:26 PM
|
05 DÉCEMBRE 2022 | PAR GAUTIER HIGELIN dans Toutelaculture.com
Du 6 au 16 décembre, Guillaume Béguin présente sa nouvelle création Les nuits enceintes à Théâtre Ouvert. Il a accepté de répondre à nos questions.
Parlez moi des racines de cette création et particulièrement du lien avec Vidy-Lausanne
Depuis 2015, presque toutes mes pièces ont été créées et accompagnées par Vidy. Vincent Baudriller et ses équipes sont des coproducteurs aussi fidèles qu’exigeants.
Mon travail tourne autour des frontières de l’humain, et de ses frottements avec d’autres formes d’existence. Je me suis beaucoup intéressé à l’évolution humaine, à la façon dont nous nous représentons à nous-mêmes, en tant qu’individu ou en tant que groupe, et comment le déploiement de notre imagination influence nos sociétés. Le baiser et la morsure (2013), par exemple, avait pour sujet l’émergence du langage articulé dans un groupe d’hommes-singes, et toutes les répercutions que cela engendre sur leur sensualité, leurs liens, leurs comportements. J’ai écrit au plateau plusieurs « pièces-poèmes » de ce genre, et à un moment, j’ai ressenti le besoin d’écrire à table, et de faire une « vraie pièce », avec un décor unique, un temps unique, des personnages humains clairement définis et identifiés, et qui s’exprimeraient dans une langue humaine réaliste.
Je construis chacun de mes projets avec une méthode de travail opposée à celle j’ai adoptée pour créer le précédent. Au final, Les nuits enceintes n’est pas si classique que je l’avais imaginé au départ. C’est une pièce où « ça parle beaucoup ». Mais il ne faut peut-être pas tout écouter rationnellement. Il y a des thèmes ou des motifs qui doivent aussi agir musicalement. Votre pièce évoque différents rapports que l’on peut entretenir avec la terre, quel est le vôtre ? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. J’ai de la peine à concevoir la Terre comme un organisme ou une entité à laquelle je pourrais me confronter et entretenir un rapport. Disons que je fais partie d’elle (et qu’elle loge parfois dans mon imagination). Je suis dépendant d’elle. Je suis un peu elle. Vous présentez la nuit comme l’espace-temps de la gestation, de l’émergence éphémère de nouveaux imaginaires, mais n’est-elle pas aussi celui de la réappropriation ? (Je pense ici au travail de Jacques Rancière et son livre La nuit des prolétaires qui retrace la vie d’ouvriers qui décident, à la tombée de la nuit, de privilégier le travail de la pensée plutôt que le sommeil réparateur. « Le rêve éveillé de l’émancipation ouvrière est d’abord la rupture de cet ordre du temps qui structure l’ordre social, l’affirmation d’un droit dénié à la qualité d’être pensant. ») Pour moi, les événements, les rêves et les actes nocturnes ne semblent pas porter à conséquence, tant que le jour n’a pas révélé la violence ou la beauté de ce qui s’est produit dans l’obscurité. Il m’arrive d’être puissamment heureux, puissant, angoissé ou amoureux durant la nuit, mais une fois que le jour se lève, je recommence à vivre une existence un peu morne et sans aspérité. La nuit trouble. Je ne me reconnais plus. Parfois le jour efface ce qui s’est produit durant la nuit, qui n’était, dans ce cas, qu’une parenthèse. Parfois pourtant, l’aube révèle une profonde métamorphose déjà achevée, irrémédiable, et que l’on n’a pas senti opérer. Certaines nuits sont puissamment transformatrices, parce qu’on est moins conscients de ce qui se trame et l’on se donne à elles sans résister. L’ambition de votre pièce se trouve dans la nécessité d’atterrir et de redevenir des terriens en réapprenant à s’inscrire dans le monde. Ce sont des termes qui font écho à la pensée de Bruno Latour et aux personnes qui gravitent autour de lui (Vinciane Despret, Baptiste Morizot, Isabelle Stengers, etc.) tous partisans de ZAD similaire à celle de votre pièce. Quels rapports entretenez-vous avec cette « philosophie de l’Anthropocène » lors de l’écriture et la mise en scène ? L’écriture des Nuits enceintes a en effet été jalonnée par la lecture de leurs textes, ainsi que ceux des philosophes australiens Val Plumhood et Glenn Albrecht, ou encore de l’écoféministe Starhawk.
Comme beaucoup de monde, je suis extrêmement inquiet par la crise climatique que nous traversons et l’indifférence des politiques. Je suis en colère. Ce n’est pas en supprimant les sacs en plastique dans les supermarchés et en achetant un vélo électrique pour faire certains trajets que l’on va résoudre cet immense défi qui s’impose à nous : maintenir le réchauffement climatique dans des limites pas trop catastrophiques. Le discours dominant est complétement irresponsable et culpabilisant. On privilégie les petits gestes individuels, les petits renoncements symboliques et anodins, on essaye de culpabiliser les gens qui mangent de la viande ou qui prennent l’avion. La question n’est pas là. Il faut opérer un ralentissement puissant de notre production de biens de consommation. Il faut ralentir et atterrir.
La crise climatique met aussi en évidence une crise de l’identité humaine. Nous nous sommes extraits artificiellement de la nature. Nous l’avons opposée à nous. Alors qu’en fait, comme le disent les zadistes aux flics qui les assaillent : « toi aussi, tu es la nature ». Oui, nous sommes la nature. Trouver des personnages et inventer des situations qui expriment ces idées et ces préoccupations était extrêmement amusant pour moi. Je me suis inspiré de tous ces écrits, ces constats, ces livres, mais aussi des personnalités des actrices et des acteurs qui allaient devoir les jouer. J’ai tout mélangé dans ma tête et il en est ressorti cette pièce, à mon grand étonnement, sans que je comprenne très bien comment cela s’est produit. Le processus a cependant été très long, aussi long qu’une gestation d’éléphante (presque deux ans). Finalement, pour transformer la société, vaut-il mieux rêver activement ou bien décrire le réel d’un regard lucide mais languissant ? Il faudrait sans doute trouver une dialectique entre les deux. Mais ma pièce exprime une opposition irréconciliable entre celles et ceux qui veulent rêver et s’extraire du monde réel, et celles et ceux qui prétendent être puissamment ancré dans le réel, et qui ne veulent embrasser que des solutions ultra-pragmatiques pour sauver la Terre. La catastrophe climatique produit beaucoup d’angoisse, et on sait que l’angoisse ne pousse pas à l’action et génère souvent des rêveries stériles. Il faut sans doute trouver d’autres moyens de s’inscrire dans le monde et de se rêver soi-même. Pour le moment, nous sommes dans une impasse.
Pourtant, il existe des motifs de se réjouir. Les héros des Nuits enceintes éprouvent des désirs puissamment sincères (même s’ils sont parfois dérisoires) de s’aimer, aimer la Terre et renouveler leur présence au monde. Il y a dans cet élan une force et une promesse immenses. Visuel: © Mathilda Olmi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 10, 2022 5:34 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 10/12/22 A l’affiche de la salle parisienne, la comédie musicale culte est revisitée avec bonheur par la mise en scène de Robert Carsen.
Lire l'article sur le site du Monde https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/10/au-lido-2-paris-un-cabaret-intense-et-grave_6153855_3246.html Relever le nez sur les Champs-Elysées illuminés donne envie de fredonner. Pas le tube de Joe Dassin mais l’intro inoubliable de Cabaret, à l’affiche jusqu’au 3 février 2023 du Lido 2 Paris : « Willkommen, bienvenue, welcome ». On en repart trois heures plus tard avec un entrain redoublé et la même mélodie aux lèvres. La nouvelle production du musical rendu célèbre et quasi intouchable après le film réalisé en 1972 par Bob Fosse avec Liza Minnelli inaugure le nouveau Lido et se révèle une excellente pioche. Elle fait d’une pierre au moins deux coups. Elle annonce la seconde vie de la superbe salle parisienne, créée en 1946, désormais sous la houlette de Jean-Luc Choplin ; elle ravive, dans la mise en scène de Robert Carsen, ce spectacle-culte, autour des années 1930 à Berlin et de la montée du nazisme, aussi frondeur et culotté qu’il est grave et terrifiant. A peine le temps de profiter des boules à facettes que nous voilà à Berlin. L’orchestre et ses neuf musiciens, situés de chaque côté du plateau, vrombissent. L’ambiance trépidante et instable de Cabaret, joué en anglais surtitré, gagne la salle. Il fallait oser choisir cette histoire, plurirécompensée et multiremontée depuis sa création à Broadway, en 1966. Entre le roman de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, publié en 1939 (réédité en français par Grasset en 2014), les adaptations au théâtre, au cinéma et autres reprises musicales, cette œuvre phénomène (dont la musique et les paroles ont été signées par John Kander et Fred Ebb) a résisté à tout. Non seulement la plupart de ses chansons appartiennent à la mémoire collective, et c’est merveilleux, mais ses thèmes (la liberté sexuelle, le féminisme, l’avortement, le fascisme et l’antisémitisme) restent terriblement vivaces. Mais parlons de l’affiche d’abord. Elle explose avec le visage plein cadre d’une créature chauve, aux yeux maquillés de noir comme sa bouche grande ouverte prête à vous manger tout cru. Il s’agit de l’artiste non binaire Sam Buttery, qui chante et joue Emcee, maître de cérémonie de Cabaret. L’image est à la hauteur de la performance scénique, et au-delà. Buttery, en robe noire à paillettes, tient la baraque, et ça ne rigole pas. Qu’il interprète la chanson mythique Money, assis sur une montagne de lingots au sommet de laquelle se dresse un « trône » en or, ou Two Ladies sur l’amour à trois, son envergure vocale et théâtrale, son mordant de bateleur fouettent le show sans coup de mou pendant deux heures quarante. Sam Buttery en maître de cérémonie Avec Buttery en tête, le peloton a intérêt à bien se tenir. Le casting de vingt-quatre artistes est solide. La vision de Robert Carsen relance le propos avec fluidité et efficacité. Les changements de décor opèrent à vue, profitant d’une machinerie minimale mais suffisante qui fait monter et descendre rapidement les différents espaces du récit. Vite, les loges du Kit Kat Club lâchent leurs bêtes de scène dont la chanteuse Sally Bowles. Interprétée par Lizzy Connolly, aussi blonde que Minnelli était brune, elle emporte l’adhésion aux côtés de son épatant amoureux Clifford Bradshaw, joué par Oliver Dench. Les deux autres couples en vedette : Herr Schultz (Gary Milner), le vieux marchand de fruits juif, et la logeuse Fräulein Schneider (Sally Ann Triplett) émeuvent tandis qu’Ernst Ludwig (Ciaran Owens), le nazi, et sa chérie (Poppy Tierney) font dresser le poil. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Ce sera Broadway à Paris » : le nouveau Lido se voit déjà en haut de l’affiche Robert Carsen, en complicité avec Jean-Luc Choplin, a adapté la version de Cabaret datant de 1966, remettant sur un pied d’égalité les protagonistes que le film de Fosse avait déséquilibrés en sortant du lot Liza Minnelli. Certaines de ses chansons, très attendues par les fans, dont Mein Herr et Maybe This Time, ne sont pas données, mais d’autres, moins connues, nous régalent. It Couldn’t Please Me More, autour d’un cadeau d’amour qui se révèle être un… ananas ou encore Married, sur la beauté de la bague au doigt, libèrent une tendresse pleine de cocasserie. Mais ce qui réjouit est l’intensité paradoxale des sensations que procure Cabaret et que l’on avait oubliée. Des images d’archives de Hitler, des camps de la mort ainsi que des despotes d’aujourd’hui concluent la pièce. Le plaisir du show et du chant nervuré de fils d’angoisse autour de la question du fascisme serre le cœur et le ventre. Cabaret est là. Cabaret, de Robert Carsen. Lido 2 Paris, 116, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e. Jusqu’au 3 février 2023. De 29 à 120 euros. lido2paris.com Rosita Boisseau Légende photo : « Cabaret », de Robert Carsen, au Lido 2 Paris. JULIEN BENHAMOU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 8, 2022 11:30 AM
|
par Anne Diatkine dans Libération - 7/12/2022 Porté par le talent de ses acteurs, la pièce de Margaux Eskenazi et Alice Carré scrute avec brio, la gauche du tournant de la rigueur dans des milieux populaires. Il y a des moments formidables dans ce 1983 par Margaux Eskenazi et Alice Carré, qui restitue les années Mitterrand, des espoirs les plus fous placés sur cette gauche qui arrive enfin au au pouvoir aux sévères déceptions liées au tournant de la rigueur, jusqu’à la fameuse Marche contre le racisme et pour l’égalité, récupérée par le PS. Moments formidables, comme quand la comédienne Loup Balthazar s’incarne en Rachid Taha du groupe Carte de séjour et se met à chanter Douce France, devant une foule imaginaire dont on fait bien sûr partie. Le concert a réellement eu lieu place de la Concorde en 1985, provoquant un tollé parmi une partie des participants, et devenant l’emblème de la riposte au FN sur le point de remporter des voix à l’Assemblée nationale. L’actrice tangue sur le toit et reprend des propos que le chanteur lancera quelques années plus tard : «Y aurait-il deux sortes d’Arabes ? Les gentils migrants qui contribuent à l’expression culturelle française – c’est-à-dire nous –, qui mangent des petits fours dans les salons lambrissés des administrations, et les méchants immigrés qui se font tabasser parce qu’ils ne font qu’apporter leur force de travail à leur pays d’adoption ?» Echapper au temps et à sa restitution figée Qu’est-ce qui plaît tant ? La consécration par le théâtre d’un moment fondateur ? Ou le sentiment à l’inverse de s’extraire de l’aspect documentaire, d’échapper au temps et à sa restitution figée, par la force de l’actrice, ici et maintenant ? Autre moment lui aussi, politique et chanté, porté par une actrice d’exception, Armelle Abibou, Yves Montand dans l’émission Vive la crise, étape clé de l’adoption du credo ultralibéral par ceux qui étaient censés personnifier une certaine gauche. Là encore, qu’est-ce qui emporte l’adhésion ? Que l’actrice imite à la perfection les jeux de mains et les tics du vieux comédien roublard, resté si souple de l’échine, et si prompt à retourner sa veste ? Ou que la comédienne donne tout à voir en même temps : sa distance critique et le moment télévisuel successful et désastreux – Libération, qui orchestra avec Antenne 2 l’affaire et sortit un numéro spécial, n’est pas cité. Autre moment télévisuel reproduit sur scène et autre séquence réussie : la première interview de Le Pen (Yannick Morzelle) à la télé à l’Heure de vérité, le 13 février 1984, qui signe le début de la normalisation du FN… Conversations type café du commerce La pièce emporte par l’énergie des acteurs. Même l’aspect pédagogique – panneaux où se déverse du texte (bien écrit) dit par une voix off – n’invalide pas la démarche qui consiste à redonner forme, sens et vie, aux événements qui précédèrent la naissance de la plupart des acteurs. Le geste suffit à faire oublier de nombreux passages affreusement ratés, lourdement didactiques, où le collectif n’a visiblement pas réussi à s’affranchir des conversations type café du commerce, censées illustrer la virulente montée du racisme dans les cités. On ne sait comment ni pourquoi, soudainement des bribes de théâtre poussiéreux surgissent. Ça n’en finit pas, régulièrement on écrit «à couper» dans son cahier, dans l’espoir vain d’avoir un pouvoir sur ce qu’on voit, dès lors qu’il perd ce qui constitue son point névralgique. La précédente création de la compagnie Nova, Et le cœur fume encore, forait autour de la guerre d’Algérie. Alice Carré et Margaux Eskenazi et tous les protagonistes étaient partis recueillir les paroles inédites de leurs proches parents, voisins ou autres. Pour 1983, le collectif a procédé de même auprès de personnes dites ressources, sociologues, anciens de la Marche pour l’égalité, musicien de Carte de séjour. Si la montée du chômage teinte la plupart des situations, on s’étonne que l’épidémie de sida et la peur qu’elle engendrait n’apparaissent jamais, même au détour d’une phrase. 1983 conçu par Alice Carré et Margaux Eskenazi et mis en scène par Margaux Eskenazi jusqu’au 10 décembre au Théâtre de la ville de Paris – les Abbesses, puis en tournée à Angoulême, Pantin, Saint-Etienne, Aix-en-Provence… Légende photo : La pièce emporte par l’énergie des acteurs. ((c) Loïc Nys)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 8, 2022 8:52 AM
|
Rébecca Chaillon garde de ses années de collège un souvenir amer, lié à la stigmatisation de son corps, de sa sexualité et de ses origines. De cette rage, elle fait un poème performatif collectif, destiné à réparer les émotions violentes que les adolescentes et adolescents traversent souvent à l’aveugle. Dans la lignée de ses performances autour du corps, du désir et des discriminations, l’artiste s’adresse pour la première fois aux jeunes pour décrire l’intime en construction et en tempête. Premières fois, hormones en ébullition, tabous familiaux, conduites à risque, rejet de tout… Elle transmet à de jeunes performeuses et performeurs ses outils scéniques, du body painting à la nourriture, pour inventer des métamorphoses susceptibles d’ouvrir un chemin vers la réconciliation avec soi-même et la fabrication d’une famille choisie.
Entretien avec Rébecca Chaillon autour de Plutôt vomir que faillir
Comment ce projet s’inscrit-il dans votre parcours ?
Il est né de l’envie de réunir mon expérience de performeuse, travaillant sur des questionnements autour du désir, du corps, des discriminations de genre, de sexualité, de race et celle acquise pendant des années dans la compagnie de théâtre-forum Entrées de jeu, avec un projet pédagogique très cadré, dans des classes de collège. Le collège est dans mon souvenir une période atroce. Le fait de pouvoir nommer les émotions, la découverte du corps et de la sexualité, la compréhension même du fait d’être noire, de l’origine et de l’histoire de ma famille, du rapport de la Martinique avec la France… Tout ça est arrivé très tard. Je me dis qu’il n’est pas possible aujourd’hui de laisser les jeunes gens dans le doute, dans l’absence de dialogue. Il y a dans mes spectacles un rapport à la consolation, à la réparation de l’adolescente que j’ai été et qu’il s’agit cette fois d’adresser aux plus jeunes. On va donc disséquer et mettre en performance tous ces événements hyper violents traversés par les ados, sans regarder ailleurs, sans faire semblant.
Comment qualifier votre adolescence ?
J’ai grandi à Beauvais en Picardie dans une famille à la fois nombreuse et assez explosée. Je baignais dans la culture martiniquaise. La question de l'intégration se posait selon une dynamique un peu différente de celle de parents d’origine africaine : avec une potentielle légitimité parce que la Martinique, c’est la France. Néanmoins la culture présente à la maison n’était pas forcément la culture dominante. Je ne me retrouvais pas non plus dans les livres éducatifs que je lisais sur la crise d’adolescence, qui était un luxe à mes yeux : j’avais la sensation qu’il fallait tenir un cadre et obéir. J’ai donc eu l’impression de vivre une adolescence sinon calme, du moins en retenue, malgré du harcèlement, que je ne pouvais pas identifier à l’époque. Et puis je voyais tout le monde avoir des relations amoureuses alors que je ne me sentais pas attirante. C’est le théâtre qui m’a ouvert une voie de libération. Cela me semble juste aujourd’hui de lui rendre la monnaie de la pièce.
Dans cette adolescence difficile, qu’est-ce qui a construit l’artiste que vous êtes devenue ?
Au collège à Beauvais, il y avait peu de personnes noires ou arabes. On était stigmatisées et cette sensation de marginalité et d’étrangeté, avec son lot d’insultes mais aussi de fétichisme, a beaucoup nourri mon écriture. D’ailleurs c’est drôle, je n’avais pas de bonnes notes à mes dissertations, qui étaient jugées peu claires. Vingt ans plus tard, je me rends compte que j’avais déjà une manière d’écrire un peu poétique, qui est valorisée aujourd’hui. C’est tellement dommage que l’Éducation nationale n’encourage pas la différence. Il m’a fallu vingt ans pour me consoler. Le collège, ce fut aussi la découverte du théâtre en 5e. La vie quotidienne n’était pas forcément facile mais dans cette troupe très exigeante qui demandait beaucoup d’heures de présence, je me sentais bien : j’étais acceptée et j’avais des beaux rôles. Enfin, bizarrement, tout en me sentant décalée, j’ai toujours été déléguée de classe ! C’était sans doute une façon de me faire accepter. Finalement, j’ai été leader de cette manière.
« Il s’agit de trouver un pont entre nos générations car les traumas sont communs, même si le contexte diffère. »
Comment avez-vous découvert la performance ?
J’ai fait partie dès mes 18-19 ans des CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), un mouvement d’éducation populaire partenaire depuis très longtemps du Festival d’Avignon. Je découvre au festival en 2004 des formes qui m’ont retournée : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Romeo Castellucci ou Rodrigo Garcia. J’accède à ces spectacles qui mélangent danse et théâtre, écriture poétique et corps en action, où la lumière et le son deviennent des personnages. Par ailleurs, à la fac, en arts du spectacle, j’ai des cours sur le body art et la body performance : Orlan, Chris Burden, Michel Journiac qui fait du boudin avec son sang, Marina Abramovic… Je n’y comprends rien mais cela me secoue profondément et cela m’intéresse. Vient ensuite un stage en 2010 avec Rodrigo Garcia, dont les spectacles me font rire et comprendre des enjeux politiques. Je me retrouve avec des gens qui travaillent sur l’inceste, les prostituées, les règles, etc. Rodrigo Garcia accompagne et parraine nos essais. Ainsi après avoir été spectatrice, j’ai pu éprouver concrètement ce que j’avais à faire et à dire.
Quels sont les défis de ce spectacle qui s’adresse à des jeunes gens ?
La nudité ne pose pas de problème car le body painting, le maquillage, la transformation ou des effets spéciaux fascinants comme les prothèses sont des outils très plastiques qui permettent de contourner cette question. L’enjeu est plus de ne pas trop fantasmer les collégiens d’aujourd’hui, car j’ai quitté le collège il y a vingt ans et arrêté le théâtre forum depuis cinq ans. Heureusement je peux observer dans mon entourage proche des collégiens et je recrute des performeurs et performeuses entre 18 et 25 ans, qui sont moins éloignés que moi de l’adolescence et ont un rapport fort au numérique. Or c’est important aujourd’hui pour parler de harcèlement ou de sexualité. En définitive, il s’agit quand même de trouver un pont entre nos générations car les traumas sont communs, même si le contexte diffère.
Quel est votre processus de travail ?
Je vais transmettre quelques outils performatifs comme le maquillage et la nourriture mais il faut que je les aide à trouver leur propre esthétique. Je vais aussi écrire des textes en amont sur ces sensations obscures que l’on éprouve quand on est un ado en construction et que l’on n’est pas accompagné. À mon époque, on était gothique, hip hop, ou métal, et trois ans plus tard on avait changé de look. C’était quelque chose d’assez extérieur. Aujourd’hui on se définit par ce qu’on ingère (est-ce que tu es vegan, végé ?), par des questions de genre (est-ce que tu es cis, trans, non binaire, queer ?) et de race. Tout cela m’interroge. Cela m’intéresse de travailler sur ces nouvelles étiquettes et ces nouvelles communautés, sur les chemins empruntés pour se trouver des familles choisies.
« La « faille » est un mot qui me parle beaucoup. Il s’agit de laisser voir ses failles sur scène, de montrer sa vulnérabilité et d’en faire une force. »
De quels univers viennent les performeurs ?
Je n’ai pas forcément une discipline en tête, mais je priorise les personnes non blanches et queer qui ont moins de visibilité sur les plateaux et moins d’espaces pour raconter leurs récits. Enfin pour la rencontre avec les collégiens, j’ai besoin d’une équipe qui réfléchisse les choses politiquement et humainement avec moi et qui soit dans la transmission.
Un mot sur le titre ?
Il peut effrayer or je pense qu’il est important de ne pas éviter la violence de ce que les ados vivent.
« Vomir » traduit un organisme qui se protège, de l’alcool, d’un trop-plein de nourriture ou d’une angoisse : la protection plutôt que la mort ou la chute. La « faille » est un mot qui me parle beaucoup. Il s’agit de laisser voir ses failles sur scène, de montrer sa vulnérabilité et d’en faire une force.
Propos recueillis par Olivia Burton en avril 2022.
Présenté à la MC93 du 7 au 10 décembre 2022
https://www.mc93.com/saison/plutot-vomir-que-faillir

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 7, 2022 7:13 PM
|
Par Julie Carriat et Mariama Darame Publié le 7 déc. 2022 dans Le Monde L’élu Nupes du Val-d’Oise, manifestement ivre dans la soirée du mardi 6 décembre, s’est attiré les foudres de ses collègues à l’Assemblée, après avoir été interpellé sur Twitter par le metteur en scène de la pièce interrompue.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/12/07/le-depute-aurelien-tache-perturbe-une-representation-au-theatre-lepic-et-cree-la-polemique_6153428_823448.html
Ce devait être une représentation comme une autre au théâtre Lepic, dans le 18e arrondissement de Paris, mardi 6 décembre. Lettres à Anne, mis en scène par Benjamin Guillard, avec Patrick Mille seul en scène dans le rôle de l’ancien président socialiste François Mitterrand écrivant à Anne Pingeot, sa maîtresse. Dès le lever de rideau pourtant, un spectateur s’agite sur son siège, répond tout haut à l’acteur. Les lettres s’enchaînent, les spectateurs multiplient les « chut » à l’intention de leur voisin. Puis Mitterrand, rejouant un colloque socialiste un peu houleux des années 1960, descend dans le public. Il fusille du regard le spectateur, manifestement éméché, qui étale tout haut sa culture de l’histoire du Parti socialiste. Ça ne suffit pas. Alors il s’interrompt et lui demande de sortir. L’autre s’exécute, se lève. Un peu éloigné du président de théâtre, il multiplie les invectives, et se dévoile sur l’air de « je suis député, vous aurez affaire à moi, ça ne va pas en rester là ». Le spectacle reprend, se finit. Et l’on discute dans la salle de cette rarissime interruption. Un spectateur a reconnu Aurélien Taché : consternation, le spectateur ivre était bien député. Le metteur en scène, dans un tweet, l’interpelle : « Pour qui vous prenez-vous Aurélien Taché ? Dans quel monde vivez-vous ? » Les réseaux sociaux font leur œuvre, et les adversaires politiques de droite et d’extrême droite ou d’anciens collègues macronistes du député, Marlène Schiappa en tête, relaient le message de Benjamin Guillard. Une manière facile d’alimenter l’image d’une Nouvelle Union populaire écologique et sociale à l’attitude délétère, loin de l’exemplarité exigée par la fonction. « Récupération politique » Ancien socialiste, ex-macroniste, le député du Val-d’Oise est désormais membre du groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Lui reconnaît avoir « un peu naïvement perturbé la séance » après la consommation « d’un verre ou deux » lors du dîner. Chez les écologistes, certains citent un problème d’alcoolisme. « On ne sanctionne pas les gens qui sont malades », élude-t-on pour mieux refuser d’en faire une histoire politique. D’autres, Cyrielle Chatelain – la présidente du groupe écologiste – la première, assument la nécessité de possibles sanctions en vertu du règlement interne au groupe. Cette dernière l’a aussi appelé, mercredi, pour s’enquérir de son état. Au théâtre, l’emballement médiatique a surpris, et tous aimeraient qu’il redescende. « Il s’est mis tout seul dans cette situation, mais personne au théâtre ne souhaite que ça prenne des proportions désastreuses pour lui », résume Salomé Lelouch, directrice du théâtre Lepic. Le metteur en scène, quant à lui, tout en maintenant son indignation quant au comportement de M. Taché, a condamné, mercredi, « les insultes et les réflexions plus que douteuses dont il peut faire l’objet suite à ce tweet » et s’est dit « absolument effrayé et tétanisé par la récupération politique qui est faite de [s]es propos ». Julie Carriat et Mariama Darame / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 7, 2022 11:44 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama, 7/12/2022 Il était le metteur en scène du Théâtre du Radeau, basé au Mans. “Choral”, “Item”, “Cantates”, “Soubresaut”… Avec poésie et audace, ses pièces se démarquaient d’un paysage théâtral formaté. François Tanguy est mort le 7 décembre. Il avait 64 ans. François Tanguy, immense metteur en scène, qui déployait d’énigmatiques et sublimes féeries visuelles et musicales dans de subtils enchevêtrements de châssis de bois ou d’étoffes soyeuses, est mort cette nuit. Il aurait dû être présent, demain 8 décembre, au Théâtre de Gennevilliers où devait se jouer sa dernière création, Par autan. Un spectacle accueilli par le Festival d’automne, soutien de la première heure qui a, dès 1987 et la représentation de Mystère Bouffe, accompagné le travail de ce créateur atypique né en 1958. En 1982, François Tanguy rejoint le Théâtre du Radeau, une troupe rassemblée près du Mans autour de la comédienne Laurence Chable. Il devient leur metteur en scène attitré et s’installe, avec eux, en 1985, dans un ancien garage automobile du centre-ville. En 1992, il le transforme en espace de travail collectif : la Fonderie est née. L’artiste ne quittera plus cet antre. Ce pas de côté qui l’éloigne des bruits et de la fureur du théâtre ne le rend pourtant pas insensible aux fracas de ce monde. En 1985, à l’instar d’Olivier Py ou d’Ariane Mnouchkine, il entame une grève de la faim pour la Bosnie. Ballets fascinants, désordre orchestré La Fonderie, lieu de pèlerinage (et de résidence) pour bien des créateurs, est un territoire préservé où Tanguy prend le temps nécessaire pour que se déploient ses projets. Ce qui sort de ses salles ne se plie à aucune mode et les transcende toutes. Lui qui, en 1982, mettait en scène Dom Juan de Molière délaisse très vite les pièces structurées. Il puise des fragments de textes chez les poètes ou les philosophes, il les dissémine dans des ballets fascinants, aussi vaporeux qu’organiques, au sein desquels les acteurs déambulent en proférant des bribes de mots. Passent et repassent à nos oreilles, entrelacées à des musiques de Bach, Beethoven, Brahms, Pascal Dusapin ou John Cage, des paroles de Dante, Virgile, Brecht, Plutarque ou bien Nietzsche. On ne comprend pas tout et ça n’a aucune importance. De Choral (1994) à Item (2019), des Cantates (2001) à Soubresaut (2016), les représentations déposent leurs strates mystérieuses en s’arrimant à la musique. Les titres sont éloquents : Coda, Ricercar ou Onzième. Ce qui se trame sur le plateau s’inscrit dans le corps du spectateur. Les propositions de François Tanguy relèvent de la sensation plus que de l’intellect. Elles parlent aux inconscients et pas à la raison. Elles réconcilient le spectre et le vivant, l’antique et l’aujourd’hui, elles associent les contraires dans un paradoxe que rien ne permet de résoudre : guerre et sérénité, silence et cacophonie, opacité et transparence, douceur et brutalité, sophistication et sauvagerie, tout s’agence et se réagence dans un continuum hypnotique. Les comédiens traversent et habitent ce désordre savamment orchestré. En frac, en robes longues, leurs têtes coiffées d’invraisemblables chapeaux, ils forgent seconde après seconde la trame mouvante d’une toile de maître. Du chaos jaillissent des lumières. Inoubliables moments de grâce François Tanguy distillait, dans un paysage théâtral souvent formaté et parfois peu imaginatif, des moments suspendus et en état de grâce. De ces moments qui déréalisent le quotidien et marquent à jamais le public. Il aimait le beau auquel il dédiait, en hommage, des cérémonials tremblés et précaires. Lové dans ses spectacles, on apprenait à lâcher prise. À laisser parler en soi une langue hybride, inconnue et pourtant familière. À accueillir avec volupté le poème écrit par la scène. Alors on notait, en toute hâte, sur un coin de papier en sortant de la salle, des phrases attrapées au vol. Dont celle-ci, de Dante, qui se faisait entendre au cours de Soubresaut : « Comme je m’angoissais pour ma vue éteinte, de la flamme fulgurante qui l’éteignit sortit un souffle qui me fit attentif, et qui disait : en attendant que tu recouvres la vue que tu as consumée en moi, il est bon qu’en parlant tu la compenses. » Il y a là de quoi s’arrêter une seconde. Faire silence. Méditer. C’est cette méditation offerte en partage qu’emporte avec lui François Tanguy dans la mort. Joëlle Gayot / Télérama Extraits vidéo de Soubresaut (2016) Présentation par François Tanguy de son ultime création "Le Vent d'autan" (2022) Légende photo : Le metteur en scène François Tanguy, en 2014. Photo Claudine Doury/Agence VU
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 10:28 AM
|
Tribune collective (signataires en fin de texte) publiée dans Le Monde - 19/12/2022 Alors que près de 90 % des établissements culturels s’apprêtent à réduire, voire à suspendre, leur activité, un collectif de professionnels de la culture et d’élus demande, dans une tribune au « Monde », à Rima Abdul Malak, ministre de la culture, d’organiser de toute urgence des conférences budgétaires territoriales.
Lire la tribune sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/19/madame-la-ministre-de-la-culture-la-fermeture-de-nos-etablissements-n-est-plus-une-chimere_6155066_3232.html
Qui l’aurait cru ? Qui aurait imaginé que, dès ces prochains mois, nos concitoyens pourraient une nouvelle fois trouver porte close et rideaux fermés dans des lieux de culture à peine remis d’une pandémie mondiale ? Et pourtant, de semaine en semaine, les alertes se multiplient, venues de tout l’Hexagone. Et pourtant, dans l’écrasante majorité de nos maisons, les prochains jours imposeront de choisir parmi des missions toutes essentielles. Et pourtant, dans d’innombrables territoires, à l’heure du vote de leur budget, les collectivités territoriales regrettent leur impuissance, orphelines des marges de manœuvre qui étaient les leurs hier. Elus et professionnels de la culture, associations et syndicats, nous sommes tous animés par la même envie : celle d’un égal accès à la culture pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de vie. Toutes et tous doivent pouvoir éprouver cette intensité culturelle et artistique, si nécessaire à l’émancipation de chacune et chacun, au dynamisme économique de nos territoires et au rayonnement de notre pays. C’est cette ambition, inscrite dans les fondements de notre Nation, nichée au cœur de l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, que nous défendons ensemble aujourd’hui : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » Une singularité menacée Au quotidien, nous portons un objectif commun : faire vivre les droits culturels, nourrir ce dialogue permanent, vivant, entre les artistes et le public. Les opéras et orchestres sont parmi les lieux les plus aboutis dans l’animation de cette conversation, un archétype dans l’histoire de la politique culturelle de décentralisation artistique. Aujourd’hui, c’est cette expérience collective de la culture qui est mise en péril. Une singularité menacée, celle d’un pays pénétré en profondeur par une énergie culturelle omniprésente. Si les efforts déployés par nos équipes, leur agilité et leur engagement sans faille ont permis de survivre au Covid, c’est maintenant, paradoxalement, que la situation est le plus grave. Crise de l’énergie, inflation galopante, c’est une véritable lame de fond qui vient frapper nos maisons et nos territoires. Concrètement, 89 % de nos maisons s’apprêtent à suspendre leur activité, à couper une partie de leur programmation dès 2023. Certaines pour quelques jours, d’autres pour plusieurs semaines, les plus touchées pour des mois. Et nous savons que l’ensemble de nos partenaires du monde de la musique ainsi que les professionnels du théâtre et de la danse, les compagnies, le secteur des arts de la rue et du cirque, du secteur public comme les indépendants, font face aux mêmes impasses. Un risque de réduction ou de diminution de l’activité Car les aides exceptionnelles annoncées ces dernières semaines semblent bien frêles et inadaptées face aux pourcentages à trois chiffres de l’augmentation des factures énergétiques que subissent nombre d’entre nous. Il en va de même pour les collectivités locales : d’année en année, elles perdent leur capacité à agir. Préserver et porter une ambition pour la culture devient donc de plus en plus difficile, même si de nombreux élus locaux font ce choix courageux. Lire aussi : Le budget du ministère de la culture augmentera de 7 % en 2023 Et l’exercice du réel n’est pas le même pour l’Etat d’une part, et pour nos collectivités et nos établissements d’autre part. Pour ceux-ci s’applique la règle d’or de l’équilibre obligatoire des dépenses et des recettes cependant que l’Etat, en accord avec la Commission de Bruxelles, peut supporter les déficits imprévus qu’occasionne une situation aussi grave qu’inédite. Sans un réveil immédiat du ministère, nos maisons ne pourront que réduire leur activité ou fermer leurs portes ponctuellement. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le bilan culturel d’Emmanuel Macron marqué par la crise sanitaire Aux dépens des Français, en demande d’émotions et qui ont retrouvé avec joie le chemin de nos salles. Aux dépens des entreprises, chaque euro dépensé par nos établissements culturels générant 1,33 euro au sein du tissu économique local. Aux dépens du secteur culturel, avec une chute déjà entamée de l’emploi artistique. Aux dépens des territoires, privés d’un service public de la culture capable de s’adresser à tous, et de nouer ce contact si essentiel avec les habitants de nos communes. Une urgence de concertation avec l’Etat Face à ce péril imminent, il est urgent que l’Etat sorte d’une simple lecture court-termiste et comptable qui ne permet pas de donner vie à un projet de société, dans lequel les collectivités comme le secteur culturel pourraient prendre toute leur part. Parce qu’il n’est plus possible d’imaginer qu’on puisse faire fonctionner nos maisons et les projeter vers l’avenir uniquement les yeux rivés sur le budget de chaque semaine, chaque mois à venir. Nous demandons à la ministre de la culture d’organiser de toute urgence des conférences budgétaires territoriales partout où nos établissements s’apprêtent à fermer en 2023. Pour sortir des concertations sans fin et trouver ensemble des solutions à la hauteur des réalités du terrain. Parce que, si le caractère essentiel de la culture ne peut plus être discuté, si la culture « définit ce que nous sommes », comme l’affirmait le président candidat dans son programme, nous ne pouvons imaginer que vous restiez spectatrice devant ce gâchis annoncé. Les signataires de la tribune, Dimitri Boutleux, adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la création et des expressions culturelles et président de l’Opéra national de Bordeaux ; Aline Chassagne, adjointe au maire de Besançon, en charge de la culture, présidente de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté ; Anne-Catherine Goetz, adjointe au maire de Mulhouse chargée de la culture ; Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne ; Loïc Lachenal, vice-président des Forces musicales et directeur de l’Opéra de Rouen Normandie ; Bertand Masson, adjoint au maire de Nancy en charge de la culture, président de l’Opéra de Lorraine ; Anne Mistler, adjointe à la maire de Strasbourg chargée des arts et cultures ; Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon en charge de la culture ; Aline Sam-Giao, présidente des Forces musicales et directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon. Collectif

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 9:06 AM
|
Le nouveau spectacle des indociles “Chiens de Navarre”, la reprise de “Cabaret” au Lido réinventé, Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie... Découvrez les pièces de théâtre qui jouent ce mois-ci à Paris, et ce que “Télérama” en a pensé. “Girls and Boys” Bénédicte Cerutti fait face. Rarement l’expression aura eu autant de sens que dans cette représentation où il faut à l’actrice un aplomb héroïque pour remonter, mot après mot, jusqu’au néant, c’est-à-dire jusqu’au récit clinique d’une tragédie sanglante qui nous coupe le souffle. Elle est cette mère qui se tient devant nous et parle à ses enfants absents. Elle se raconte : adolescente paumée puis amoureuse passionnée puis épouse comblée, doublée d’une femme d’affaires accomplie. Elle ne voit pas qu’à côté d’elle son mari perd de sa superbe et peu à peu la jalouse. Elle le quitte. Il reviendra, quatre mois plus tard, armé d’un couteau tranchant. La comédienne ne vacille pas. Le regard planté dans les yeux du public, elle prend la parole comme si elle tendait la main à cette mère endeuillée pour lui insuffler son courage. Pour que le drame se sache. Elle le fait chaque soir sur la scène du théâtre. Exceptionnel.
TTTT De Dennis Kelly, mise en scène de Chloé Dabert. Durée : 1h40. Jusqu’au 23 déc., 20h (mer., ven., mar.), 19h (jeu.), 16h (sam.), Théâtre 14 – Jean-Marie-Serreau, 20, av. Marc-Sangnier, 14e, 01 45 45 49 77. (10-25 €). “La Ménagerie de verre” Une grotte qui ouvre sur la mémoire primitive du monde... Sur les murs peints, le visage du père, qui a abandonné sa femme (Isabelle Huppert) et leurs deux enfants dans la débâcle économique des années 30. Tennessee Williams désirait que cette œuvre pionnière soit montée avec liberté. Sans doute parce qu’il osait y avouer son homosexualité à une mère trop aimante, à une sœur trop fragile. Moins lourdement tourmentée que les grands mélodrames à venir, La Ménagerie de verre (1944) est une bulle pleine de grâces enfantines, suspendue dans le temps et l’espace. S’y devine plus que ne s’y pleure la souffrance d’être différent dans un monde qui ne vous accepte pas. Accompagnée de trois acteurs magnifiques, Isabelle Huppert est simultanément odieuse et pathétique, dans ce huis clos de souffrance et de solitude qu’Ivo van Hove a magiquement transformé en écrin de larmes. — F.P.
TTTT De Tennessee Williams, mise en scène d’Ivo van Hove. Durée : 2h. Jusqu’au 22 déc., 20h (du jeu. au sam., mar.), 15h (dim. et sam. 10 et 17), Odéon – Théâtre de l’Europe, 1, place de l’Odéon, 6e, 01 44 85 40 40. (6-41 €).
“Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne” C’est fou comme en une heure de représentation une vie entière peut être mise en boîte, de la naissance à la mort, en n’omettant aucun des rendez-vous prisés par la bienséance : le baptême, le mariage et, enfin, l’enterrement religieux en grande pompe. Adaptant le manuel de civilité de la baronne Staffe, best-seller de la fin du xixe siècle qui entérinait le code de bonne conduite de la bourgeoisie, Jean-Luc Lagarce a glissé dans sa pièce ce qui fait le sel de son écriture : précision, ironie et humour pince-sans-rire. Le résultat sur scène est étincelant. D’autant plus qu’une légende théâtrale s’empare du texte : Catherine Hiegel, dont la maturité, la finesse, la souplesse de jeu transforment en brûlot féministe et contemporain ce bréviaire d’un autre âge. L’actrice est au sommet de son art. À ce niveau-là d’excellence, elle peut tout, et nous, on se régale.
TTTT De Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo. Durée : 1h20. Jusqu’au 18 jan. 2023, 21h (du mer. au sam.), 16h (dim.), 19h (mar.), Théâtre du Petit Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, 10e, 01 42 08 00 32. (15-27 €). “Doreen” Une femme subit une injection. Dans sa nuque pénètre un produit qui, loin de la soigner, l’empoisonne... Peu à peu, l’ennemi a pris ses quartiers dans le corps de Doreen sous le regard, impuissant, du mari dévasté. L’agonie s’annonce longue, douloureuse, dégradante. Le couple choisit le suicide. Ils vont mourir au même moment. Cette histoire n’est pas une fiction. C’est l’histoire d’André Gorz, philosophe, et de sa femme, Dorine. David Geselson en a fait l’argument d’un spectacle bouleversant, qu’il interprète avec Laure Mathis. Dans une salle aménagée comme un appartement où l’on s’inviterait à l’heure de l’apéritif s’engage un pas de deux entre les époux. Tout n’a pas à être dit. Dans les silences et les regards échangés se faufilent la pensée, l’émotion, la passion. Procédant par ellipses, la représentation va et vient entre calme de la parole et colère des sentiments. Tact, pudeur, intelligence, sensibilité, tout est là.
TTT De et par David Geselson. Durée : 1h20. À partir du 14 déc., 19h30 (mar.), 14h30 (ven.), 18h30 (sam.), 16h30 (dim.), MC 93, 1, bd Lénine, 93 Bobigny, 01 41 60 72 72. (9-27 €). “Dorothy” On en apprend, des choses, sur Dorothy Parker dans ce spectacle écrit par Zabou Breitman, qui incarne aussi l’écrivaine, seule entre un paravent, un canapé et une table de mixage, d’où elle règle elle-même la lumière et le son. On découvre par exemple que les cendres de la poétesse américaine, plume du journal TheNew Yorker, ont été oubliées dans le tiroir d’un bureau pendant de longues années. Entrée en matière surprenante. Mais, si l’entame de la représentation est un rappel biographique, la suite ne s’apparente pas à un « biopic ». L’actrice a conçu un spectacle ambitieux qui entre dans le vif des fictions de la romancière. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, elle donne corps aux personnages. Se transforme en convive terrassée par l’ennui lors d’un dîner mondain ou en amoureuse éplorée attendant l’appel de son amant. De ces saynètes qui surgissent puis s’évaporent avec l’élégance des songes, nous parvient l’essence d’une femme aimant le vin, l’intelligence et l’ironie.
TTT D’après Dorothy Parker, adaptation et mise en scène de Zabou Breitman. Durée : 1h15. 20h30 (sam.), Théâtre des Deux-Rives, 107, rue de Paris, 94 Charenton-le-Pont, 01 46 76 47 32. (19-29 €).
“Féminines” Voici l’exemple même d’un spectacle fédérateur, qui sait battre le rappel des troupes en déroulant l’histoire édifiante d’une équipe de foot féminine. Reims, 1968 : des femmes originaires de milieux populaires se retrouvent chaque week-end pour taper dans le ballon sous la houlette de deux entraîneurs. Une aventure qui les propulse jusqu’à la Coupe du monde de 1978, qu’elles gagnent. Happy end célébré par l’autrice-metteuse en scène Pauline Bureau, qui glisse habilement dans sa pièce quelques critiques bien senties contre un patriarcat repu de clichés. La fable a beau être en partie imaginaire, donc un peu utopique, elle nous fait du bien, en dépit de quelques bons sentiments disséminés ici et là. Mise en scène énergique cumulant théâtre et vidéos, jeu convaincant des comédiennes, dont les personnages, en devenant footballeuses, s’émancipent. Cette représentation bagarreuse est une métaphore des enjambées qui mènent à la liberté.
TTT De et par Pauline Bureau. Durée : 2h05. Les 14 et 15 déc., 20h30 (mer.), 19h30 (jeu.), Théâtre de Sartrouville (CDN), place Jacques-Brel, 78 Sartrouville, 01 30 86 77 79. (8-22 €). “La vie est une fête” Ça commence dans l’hystérie d’un débat à l’Assemblée nationale. Au milieu des spectateurs, les acteurs-députés invectivent les ministres et parlementaires qui tentent vainement de s’exprimer sur le plateau. Dans le théâtre devenu forum politique, nos représentants sont au bord de la crise de nerfs. Et c’est justement aux urgences psychiatriques que se poursuit l’irrésistible dernière création des barbares Chiens de Navarre. Partir de la dinguerie du pouvoir incarné par un parlement survolté pour aboutir à la déliquescence d’un hôpital où se multiplient les névroses, raconter combien nos maux privés sont liés à nos folies publiques, tel est le canevas ordinaire de cette troupe désormais essentielle. Ses excès mêmes, entre farce potache et cinéma gore, appartiennent à la joyeuse tradition du spectacle bordélique à sensations et se concentrent en une seule passionnante question : dans quelle démocratie vivons-nous donc ? — F.P.
TTT nMise en scène de Jean-Christophe Meurisse. Durée : 1h45. Du 14 au 18 déc., 20h (du mer. au ven.), 18h (sam.), 16h (dim.), MC 93, 1, bd Lénine, 93 Bobigny, 01 41 60 72 72. (9-27 €). “Mes chers enfants” Dans une série de lettres à ses « chers enfants », une veuve débordant encore du désir d’expérimenter la vie décortique le lien maternel. Il a fallu à Jean Marbœuf, cinéaste aux cinquante ans de carrière mais encore jeune auteur de théâtre, un grand sens de l’observation pour se glisser si bien dans la voix d’une femme. Sans doute s’est-il inspiré de sa magnifique interprète, Anny Duperey, à l’évidence vraiment chez elle dans ce rôle de mère « aimante et rebelle », comme elle l’exprime au fil d’une correspondance parfois impudique. Son personnage fait partie d’une génération — plus ou moins 20 ans en 68 — qui a vécu l’amour fou, défendu les utopies politiques et qui se retrouve face à une progéniture moins concernée par la marche du monde ; ou différemment. Devenue si populaire en incarnant pendant vingt-six ans un autre personnage de femme forte dans la série télé Une famille formidable, Duperey distille ici des émotions plus tranchantes, avec une sensibilité toujours pleine de grâce. — E.B.
TTT De et par Jean Marbœuf. Durée : 1h20. Jusqu’au 25 déc., 21h (du jeu. au sam.), 16h (dim.), Théâtre de Passy, 95, rue de Passy, 16e, 01 82 28 56 40. (10-35 €).
“La Petite dans la forêt profonde” Le calme troublant de l’écriture rend d’autant plus infernales les atrocités de l’histoire racontée avec une feinte désinvolture dans ce texte percutant inspiré des Métamorphoses d’Ovide. Un jeune roi entraîne une enfant (sa belle-sœur) dans les bois. Il la viole sauvagement avant d’être tué par son épouse. Avec un sens virtuose de la cruauté, la reine venge en effet le crime subi par sa petite sœur. Ce spectacle s’offre comme une promenade champêtre sur fond de bruitage subtil : craquement des feuilles, souffle du vent, piaillement d’oiseaux. Deux actrices se partagent les rôles et passent de l’insouciance au drame. Elles jouent pointu sur du velours, car cette pièce de Philippe Minyana est une vraie merveille. Ironique mais incisive, poétique mais concrète, elle va, mine de rien, loin dans l’analyse de la violence et ce, sans jamais oppresser le public. Elle n’en est que plus appréciable.
TTT De Philippe Minyana, mise en scène d’Alexandre Horréard. Durée : 1h. Jusqu’au 20 déc., 19h (dim., lun., mar.), Théâtre des Déchargeurs, salle Vicky-Messica, 3, rue des Déchargeurs, 1er, 01 42 36 00 50. (10-24 €).
“Adieu Monsieur Haffmann” Paris, 1942. Un bijoutier juif propose à son employé de tenir sa boutique pendant qu’il se cachera dans la cave ; et surveillera de loin les affaires. Joseph est père de famille ; le jeune Pierre se désespère de sa stérilité. Il accepte la proposition à condition que Joseph fasse un enfant à sa femme... Curieuse et troublante négociation sur fond de guerre, de nazisme, d’antisémitisme, de marché noir, d’objets d’art volés, de peur et de menaces... Dans un espace minimaliste et via des dialogues directs et sans graisse, le metteur en scène-auteur Jean-Philippe Daguerre a l’art des situations romanesques et politiques à la fois, des coups de théâtre et du suspense. Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur et délicatesse. Habile, efficace, mais sans effets faciles. Avec charme et émotion, Jean-Philippe Daguerre recrée sous nos yeux médusés les tourments cachés du Paris de 1942...
TTT De et par Jean-Philippe Daguerre. Durée : 1h30. Jusqu’au 31 déc., 21h (mer.), 18h30 (sam.), 16h30 (dim.), Théâtre de la Tour Eiffel, 4, square Rapp, 7e, 01 40 67 77 77. (12-54 €).
“Cabaret” Alors que pointe partout le retour des extrêmes, reprendre Cabaret, qui fustige l’émergence du nazisme, est culotté. Tirée d’une nouvelle de Christopher Isherwood (1904-1986), l’œuvre sulfureuse traverse la grande histoire via la petite : les coulisses glauques d’un cabaret fauché... Clifford Bradshaw, jeune écrivain anglais, débarque à Berlin pour vivre sa bisexualité et se toque de Sally Bowles, l’entraîneuse du Kit Kat. La patronne de leur hôtel miteux s’entiche aussi d’un marchand de fruits juif. Hélas, le national-socialisme met un terme à ces idylles. Sally refuse de fuir, préfère les abîmes du Kit Kat, où officie le très provocant et troublant Emcee (Sam Buttery). À la fin du spectacle défileront les visages des dictateurs à venir... Dommage que derrière le rythme canaille impulsé par Robert Carsen les interprètes restent sages. On se régale quand même de si insidieusement plonger au cœur de nos gouffres politiques et intimes. — F.P. TTT D’après John Van Druten, mise en scène de Robert Carsen, chorégraphie de Fabian Aloise, musique de John Kander. Durée : 2h30. Jusqu’au 3 fév. 2023, 20h (du mar. au sam.), 15h (sam., dim.), Lido, 116, av. des Champs-Élysées, 8e, 01 53 33 45 50. (29-120 €). “Comédiens !” Magie du « théâtre dans le théâtre » ! Comédiens ! l’illustre avec facétie. Un couple de comédiens de province s’échine à monter son triomphe lyonnais : un vaudeville en chansons de 1880. Les rejoint un copain de conservatoire. Et le scandale : la comédienne avoue vouloir jouer Othelloavec un autre metteur en scène ; son mari crève de jalousie. Comme Othello... Inspiré d’un fait divers et du Paillasse de Leoncavallo, Comédiens ! se joue avec ironie des styles et les sublime jusqu’à la tragédie... On rit, on s’émeut. La musique est drôle, les comédiens-chanteurs, savoureux. Un genre musical tout ensemble bricolé et virtuose, désuet et original. Délicieux. — F.P.
TTT De Samuel Sené et Éric Chantelauze, mise en scène de S. Sené, musique de Raphaël Bancou. Durée : 1h30. Jusqu’au 25 déc., 19h (ven.), 20h45 (mer., jeu.), 20h30 (sam.), 15h (dim.), Artistic Théâtre, 45 bis, rue Richard-Lenoir, 11e, 01 43 56 38 32. (16-36 €).
“La Fontaine et le confinement” Trente-cinq ans qu’on aime à le retrouver, psalmodiant de spectacle en spectacle les phrases miracle de grands auteurs. Son secret ? Fabrice Luchini aborde poètes et philosophes pour la beauté sensuelle de leur langue et l’élégance de leur pensée, avec l’émerveillement du garçon-coiffeur qu’il fut. Pour le public, il déguste et savoure ces écrivains tel un ogre, les mâche et les articule entre violence et ravissement. Et ses mille digressions personnelles, politiques, sociétales, toujours drôles et partageuses, font mieux pénétrer encore dans les sophistications de n’importe quel langage. Luchini veut rendre ici hommage à ceux qui lui ont permis de résister à l’enfermement et à la solitude du confinement. Tel Blaise Pascal, La Fontaine, Baudelaire, qui lui ont donné la force de transcender les grands vides. Le confinement l’a ainsi bonifié. Il n’éructe plus quand tempête dans la salle un bruyant portable, il pardonne. Il avoue même désormais avoir le cœur plus à gauche. Le diabolique acteur n’a pas fini de nous époustoufler. — F.P.
TTT Mise en scène d’Emmanuelle Garassino. Durée : 1h50. Jusqu’au 21 fév. 2023, 18h30 (mar.), Théâtre Montparnasse, 31, rue de la Gaîté, 14e, 01 43 22 77 74. (24-71 €).
“L’Île d’or” Il y a de tout et de trop dans cette représentation, dont la somptueuse vitalité est communicative. Le spectacle d’Ariane Mnouchkine est une invitation à entrer d’un pas ailé dans la chambre de l’imagination de l’artiste, laquelle dépose, sur le plateau, le monde qui l’habite. Ce monde est un flux d’images, de souvenirs, de désirs. Sur scène, une metteuse en scène alitée appelle le théâtre, le Japon, l’amour, l’humour, et la vie telle qu’elle pourrait être. Cette femme, double fictif de la patronne du Soleil, est un arc tendu de délires, de fantasmes, de cauchemars, de joies et de combats. Elle imagine une île où il serait possible d’être heureux parce que l’art y aurait eu le dernier mot. Elle le fait avec une ardeur contagieuse. Qui, à part Ariane Mnouchkine, est capable de célébrer l’imaginaire avec ce sens fulgurant de l’image, ce faste du mouvement, cette beauté de la métaphore qui prend corps ? Parce que l’artiste rêve en grand, elle nous intime de faire de même. TTT D’Hélène Cixous, mise en scène d’Ariane Mnouchkine, musique de Jean-Jacques Lemêtre. Durée : 3h15. À partir du 9 déc., 19h30 (ven.), 15h (sam.), Théâtre du Soleil, Cartoucherie, route du Champ-de-Manœuvre, 12e, 01 43 74 24 08. (16,50-39 €). “Simone Veil. Les combats d’une effrontée” Adapté du récit autobiographique de Simone Veil, Une vie, ce spectacle évite l’écueil de l’hagiographie. Pauline Susini, metteuse en scène, y joue le rôle d’une thésarde, invitée aux micros à évoquer celle qui fut l’objet de sa recherche universitaire. Incarnée avec une précision scrupuleuse par Cristiana Reali (la ressemblance est saisissante), Simone Veil se tient à quelques mètres d’elle sur la scène. Chignon sage, jupe stricte et blouse colorée, la comédienne convoque une femme qu’elle inscrit résolument dans le présent. Présent de sa parole, des souvenirs et des actes. La représentation n’est pas chronologique. La Shoah ne cesse de venir frapper à la porte du propos. Comme une toile de fond dans laquelle se seraient ancrés tous les combats de cette figure politique majeure. Cette volonté de « présentifier » fait de la représentation un moment totalement partagé avec le public. Une réussite. TTT D’après Simone Veil, mise en scène de Pauline Susini. Durée : 1h15. Jusqu’au 31 déc., 19h (du mer., au ven., dim.), 16h (sam.), Théâtre Antoine, 14, bd de Strasbourg, 10e, 01 42 08 77 71. (16-51 €). “Songe à la douceur” Des pétales, une pelouse, des jeunes filles en fleur, des garçons fougueux, des chansons, une moisson de sentiments : cette aventure printanière est emmenée par des acteurs vifs et attachants, qui font de ce spectacle théâtral et musical, où se déploient les passions amoureuses, un moment en tout point charmant. Justine Heynemann tisse avec brio un récit parlé et chanté, où une ironique narratrice ouvre et ferme les guillemets pour nous présenter les scènes vécues par les héros. L’histoire est celle d’une adolescente qui tombe amoureuse d’un jeune homme taciturne et cynique. Elle se heurte à son rejet avant de reprendre avec lui, bien des années plus tard, le fil d’une histoire appelée à se consumer. Adaptée d’un roman contemporain, lui-même inspiré d’Eugène Onéguine, de Pouchkine, cette représentation est un régal pour qui cherche au théâtre un peu plus que le théâtre : un souffle, une âme et du vivant. Une réussite. TTT Mise en scène de Justine Heynemann. Durée : 1h30. À partir du 13 déc., 20h (mar.), Théâtre Paris-Villette, 211, av. Jean-Jaurès, 19e, 01 40 03 72 23. (8-20 €). “Tout ça pour l’amour !” Entrer dans une salle sans rien attendre de précis, en ressortir le cœur en joie, c’est l’expérience vécue face à cet étonnant spectacle que porte, avec une ardeur, une cohérence et un talent remarquables, Edwige Baily. L’actrice excelle, quel que soit le registre adopté : comique, dramatique, réaliste, fantastique. On la croit dévolue au stand-up quand la voici soudain qui bascule dans un plaidoyer enflammé pour la littérature. Jamais figée et toujours en mouvement, elle est deux héroïnes en une. La première rejoue le destin de Gabrielle Russier. Condamnée pour avoir aimé un de ses élèves, cette professeure de français se suicide en 1969. La seconde venge la première en nous rappelant au pas de charge l’histoire d’Antigone, figure universelle de la résistance féminine. La représentation est une déferlante d’humour, d’intelligence, de verbe porté haut, de vie. Le cœur exulte. C’est épatant. TTT D’Edwige Baily et Julien Poncet, mise en scène de J. Poncet. Durée : 1h20. Jusqu’au 31 déc., 19h (jeu., ven., sam.), 15h (dim.), Théâtre de l’Œuvre, 55, rue de Clichy, 9e, 01 44 53 88 88. (29 €). “Dabadie ou les Choses de nos vies” On a tous en nous quelque chose de Jean-Loup Dabadie. César et Rosalie, Un éléphant, ça trompe énormément ; Romy Schneider et Yves Montand ; des histoires d’amour, de rupture, d’amitié, de rires et d’engueulades. Des chansons popularisées par Julien Clerc. Il y a beaucoup de vie et d’émotion dans ce retour musical et théâtral sur le parolier prolifique qui articulait avec tact les mots et les sentiments. Qu’il ait écrit pour des chanteurs ou pour des réalisateurs, Dabadie captait l’intime tout en racontant son époque. Il n’est pas démodé mais intemporel. Épaulés sur scène par un musicien (Mathieu Geghre), deux chanteuses (Clarika, Maissiat) et un comédien également metteur en scène (Emmanuel Noblet) circulent souplement dans ce passé dont on ne saurait se passer, tout en jouant avec un paravent de toile comme avec un écran, où leurs ombres chinoises accouchent de leurs corps en présence. Chaleureux, drôle et doux : ce spectacle, c’est un peu de printemps qui vient défier l’hiver. TT De Jean-Loup Dabadie, mise en scène d’Emmanuel Noblet. Durée : 1h15. Jusqu’au 31 déc., 19h (du mar. au sam.), 15h (dim.), Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, 18e, 01 46 06 49 24. (19-35 €). “Exécuteur 14” C’est un acteur à la fois très intérieur et totalement physique, qui se déplace avec une souplesse féline et varie les intensités de jeu à la façon d’un musicien. Antoine Basler ne marchande pas le don de sa personne au théâtre. Il entre de plain-pied dans la peau d’Exécuteur 14, héros, victime et/ou coupable d’une guerre sanglante qui le dépossède de sa raison. Il n’y a pas d’explication aux crimes commis. Le processus de déshumanisation ne s’autorise que de lui-même. L’intérêt de ce spectacle tient à la performance du comédien. Habité par le texte, il fait corps avec lui au point qu’on a parfois le sentiment de ne plus exister. Son regard ne nous voit pas. Ses paroles ne nous semblent pas adressées. Il dit les mots pour lui-même plus que pour le public. Ce qui fait qu’on l’observe comme on scruterait, incrédule, une impressionnante œuvre d’art. Avec la sensation que, même sans notre présence dans la salle, il saurait poursuivre seul son hypnotique traversée du mal. TT Mise en scène d’Antoine Basler. Durée : 1h20. Jusqu’au 23 déc., 19h (du mer. au sam.), Théâtre des Déchargeurs, salle Vicky-Messica, 3, rue des Déchargeurs, 1er, 01 42 36 00 50. (10-24 €). “1983” Recluse chez elle depuis 1983 en compagnie de son homme à tout faire, une créatrice de mode en panne d’inspiration ouvre sa porte au xxie siècle : 2022 fait irruption chez cette ex-star des robes à paillettes sous les traits de deux jeunes femmes dont l’une est influenceuse sur les réseaux sociaux. Autant dire que le choc risque d’être brutal entre la maîtresse de maison, pour qui le Minitel est le summum de la modernité, et ce monde contemporain livré aux « selfies », aux « followers » et à la frénésie des « like ». L’auteur de ce boulevard désopilant et énergique fait rire tout en invitant à réfléchir sur nos compulsions moutonnières dans le monde virtuel. Cette pièce malicieuse trouve, avec Chantal Ladesou dans le rôle de la créatrice passée de mode, une actrice qui, si elle a du chien, articule à peine ses phrases. Ce qui, au théâtre, pose problème. TT De et par Jean Robert-Charrier. Durée : 1h30. Jusqu’au 26 mars, 20h (jeu., ven.), 16h, 20h30 (sam.), 16h (dim.), Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18, bd Saint-Martin, 10e, 01 42 08 00 32. (12-55 €). “Comme il vous plaira” Auréolée de ses quatre Molières 2022, voilà donc la comédie shakespearienne la plus virevoltante de la saison. C’est que Pierre-Alain Leleu a su alertement adapter une œuvre particulièrement compliquée, sise dans la forêt, et faite, comme toujours chez l’élisabéthain, de travestissements, de doubles, d’amours complexes et de genres ambigus. Rien de plus contemporain. Mis en scène par la comédienne Léna Bréban elle-même, le spectacle, encore une fois en mode tréteaux avec décors modulables — influence Michalik oblige... −, déborde joliment d’humour et de doutes, d’ironie et de désillusion sur les jeux du désir. Il est mené, emporté par Barbara Schulz, impériale. — F.P. TT D’après William Shakespeare, adaptation Pierre-Alain Leleu, mise en scène de Léna Bréban. Durée : 1h50. Jusqu’au 31 déc., 21h (du mar. au sam.), 16h (sam.), la Pépinière Théâtre, 7, rue Louis-le-Grand, 2e, 01 42 61 44 16. (22-56 €). “La Machine de Turing” C’est fou ce que le théâtre nous apprend de pans méconnus de l’histoire. Tel le destin de l’Anglais Alan Turing. Ce mathématicien bègue a contribué à inventer une machine capable de décoder les messages cryptés des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Les forces britanniques et alliées en firent bon usage. Mais, parce qu’il était homosexuel, Turing fut livré à la vindicte tandis que son apport était passé sous silence. En 2013, son nom fut enfin réhabilité. L’histoire est ainsi faite qu’elle se nourrit d’oublis et d’injustices. C’est pour réparer ses manquements que Benoît Solès a écrit ce spectacle percutant, qu’il interprète avec son partenaire de jeu sur une scène où un écran vidéo s’orne de milliers de chiffres, comme autant de rhizomes qui gagnent du terrain tout en n’allant nulle part. C’est plutôt réussi ! TT De Benoît Solès, mise en scène de Tristan Petitgirard. Durée : 1h25. Jusqu’au 2 avr. 2023, 20h30 (mer.), 19h (ven., sam.), 15h (dim.), Théâtre du Palais-Royal, 38, rue Montpensier, 1er, 01 42 97 40 00. (17-48 €). “Lettre d’une inconnue” La fragilité d’Ophélia Kolb est surexposée lors de cette représentation qui l’épingle seule sur scène face au public. L’actrice arrive du fond de la salle. Pieds nus et en nuisette, elle remonte l’allée centrale qui sépare les rangées de sièges des spectateurs. Elle gagne un plateau enserré dans de hauts voilages blancs, un espace plus glacial qu’un cercueil ouvert qu’on aurait posé à la verticale. Ses premiers mots sont pour son enfant mort. Les suivants déclinent sa passion jamais démentie pour un homme, croisé une première fois alors qu’elle n’avait que 13 ans et avec qui elle passera quelques nuits, cinq ans plus tard, sans que jamais il ne la reconnaisse. Elle l’a aimé au premier regard, elle l’aimera jusqu’à son dernier souffle. La comédienne fait corps avec ce récit exalté, d’une tristesse insondable. Elle est l’âme vivante d’un spectacle où tout, des sentiments de l’héroïne à la salle de théâtre sinistre, est d’une réfrigérante morbidité. TT De Stefan Zweig, mise en scène de Bertrand Marcos. Durée : 1h20. Jusqu’au 30 déc., 20h (du jeu. au sam.), 16h (dim.), Studio des Champs-Élysées, 15, av. Montaigne, 8e, 01 53 23 99 19. (10-32 €). “Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres...” Julie Deliquet aime se réapproprier les textes via une écriture dite « de plateau », qui fait la part belle aux instincts des comédiens. Pour célébrer le 400e anniversaire de Molière, elle s’est arrêtée sur le triomphe de son École des femmes en 1662 — année où il épouse aussi Armande Béjart, fille de sa compagne — et les polémiques qui l’ont suivi, retranscrites dans La Critique de l’École des femmes et L’Impromptu de Versailles, où Molière ose se mettre en scène lui-même. Las, si l’intention est passionnante et l’immersion dans le quotidien des comédiens du XVIIe émouvante, étonnante et riche, le texte, aux allures de film à la Sautet, a bien des trous, des longueurs, des facilités comme des obscurités. Même les talentueux comédiens du Français n’apparaissent pas au mieux de leur forme dans ce besogneux bla-bla, déroutés par une pièce qui raconte si maladroitement leur propre histoire. — F.P. TT D’après Molière, adaptation et mise en scène de Julie Deliquet. Durée : 2h25. Jusqu’au 15 jan. 2023, 20h30 (sam., lun.), Comédie-Française, salle Richelieu, 2, rue de Richelieu, 1er, 01 44 58 15 15. (6-49 €). “Lady Agatha” À la mode du joyeux et trépidant théâtre de tréteaux, vite joué, bien joué, avec des décors simples et faciles que les acteurs manipulent à vue, voilà une biographie allègrement troussée de la reine du polar anglo-saxon, lady Agatha Christie en personne (1890-1976), et ici décidée à nous conter son destin, plus mouvementé qu’on ne saurait imaginer... Effets de théâtre dans le théâtre, jeux de miroirs et mise en abyme vont bon train dans cette comédie efficace et drôle, rondement dirigée par Cristos Mitropoulos. Un gai moment sans prétention de divertissement... — F.P.
TT De Cristos Mitropoulos et Ali Bougheraba, mise en scène de C. Mitropoulos. Durée : 1h40. Jusqu’au 31 déc., 20h (du mer. au ven.), 17h30, 21h (sam.), 15h (dim.), Théâtre Saint-Georges, 51, rue Saint-Georges, 9e, 01 48 78 63 47. (14-40,50 €). “Smoke Rings” Smoke Rings est une pièce de Léonore Confino, autrice contemporaine qui a écrit un texte à sketchs sur des couples qui s’aiment, se détestent, se désirent, se trompent, se fiancent, divorcent, s’ennuient, s’engueulent ou se disent des mots doux. Tous les cas de figure sont ici recensés par une plume acérée, qui va à l’essentiel. Cette mosaïque de duos conjugaux trouve sa résolution dans un spectacle éclaté dans tous les espaces du théâtre. Scène, coulisses, balcon, escalier, bar, accueil. Selon que la rose qu’on vous donne à l’entrée est rouge ou blanche, suivez votre guide : il vous amène vers un couple, puis un autre, puis un autre. À observer de près les actions, on entre dans l’intimité des personnages. Et on se prend au jeu vif des acteurs, qui jouent les scènes comme si leur vie en dépendait. On appelle ça du théâtre immersif, et c’est tout bonnement formidable. TT Mise en scène de Sébastien Bonnabel. Durée : 1h30. Jusqu’au 19 fév. 2023, 20h30 (dim.), Théâtre Michel, 38, rue des Mathurins, 8e, 01 42 65 35 02. (39 €). “Un jour en été” Patrick Sommier est un fin connaisseur de la Russie, de ses artistes et de son théâtre. Il est aussi un lecteur avisé de Tchekhov chez qui il a prélevé cinq textes courts mis en scène par ses soins avec un esprit facétieux qui fait mine d’hésiter entre délicatesse et rudesse, à l’image des musiques qui enveloppent de mélancolie ou de franche gaîté le jeu des comédiens. Un peu hésitants au soir des premières représentations, les trois acteurs arpentent des récits sans scorie, dont on retient l’humour et le sens de l’autodérision. En se moquant de ses personnages, c’est de la Russie dont rit le dramaturge. Une Russie fêtarde, jouisseuse, gaffeuse, prétentieuse et qui marche de travers avec une sorte de bonne humeur contagieuse. Pas de samovar et pas de nostalgie : tout se vit au présent. Comme ce spectacle dont la dernière séquence (un texte du biographe de Tchekhov, Ivan Bounine) ne s’imposait sans doute pas.
TT Mise en scène de Patrick Sommier. Durée : 1h15. Jusqu’au 15 jan. 2023, 19h (du mar. au sam.), 17h30 (dim.), Théâtre de Poche-Montparnasse, 75, bd du Montparnasse, 6e, 01 45 44 50 21. (10-35 €).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 8:40 AM
|
Par Amandine Vachez dans Lille Actu - Publié le 18 Déc 22 Pendant 15 jours, les élèves de la promo du Studio 7 du Théâtre du Nord de Lille sont restés au Congo. Ils y ont travaillé sur des projets de théâtre. Une expérience marquante. « Pleins de gens, pleins de couleurs », et « un accueil très chaleureux ». Voilà quelques exemples piochés dans ce qui a marqué les élèves de l’École du Nord, partis à Pointe-Noire, en République du Congo, pendant 15 jours cette fin d’année 2022. Récit. Les locaux racontent leur pays C’était l’une des envies de David Bobée, arrivé à la direction du Théâtre du Nord : emmener les élèves de son école à la découverte de la richesse du spectacle vivant, notamment par celle d’autres cultures. Lui qui, en 2014, a mis en scène Hamlet avec des artistes congolais grâce à un atelier théâtral de l’Institut français du Congo, a souhaité emmener les jeunes dans ce pays. Ils se sont donc rendus à Pointe-Noire, où les attendaient Pierre Claver Mabiala, le directeur de l’espace culturel Yaro, centre de création situé au cœur d’un quartier populaire de Pointe-Noire. Le directeur et metteur en scène de métier a accompagné les comédiens dans leur découverte de la culture locale, au travers d’un travail sur une pièce inspirée des traditions des congolais. Pièce écrite par Romuald Djimbi, le fondateur aujourd’hui disparu de l’espace culturel Yaro (il s’agit de son pseudonyme). Toute la durée du séjour, les jeunes étudiants sont allés à la rencontre des habitants, fiers de leur montrer quelles étaient leurs traditions et spécialités. « Performer » les contes Pour les quatre auteurs de la promotion, un travail a été mené avec un « conteur des forêts ». « Il nous a expliqué ce que c’était d’être conteur, là-bas. Les contes sont racontés avec des chants, des cris, même ! Savoir conter des histoires est un rite de passage, au Congo. C’est une vraie étape dans l’éducation », explique Jean-Serge Sallh, élève de la promo Studio 7. Il s’amuse à imaginer qu’il poursuivra cette expérience : « C’était très joyeux ! C’était une expérience singulière. Je vais peut-être mettre dans ma valise "l'outil conte" ». La deuxième semaine, lui et les autres auteurs ont travaillé sur un projet autour du slam. « Nous devions intégrer à notre histoire des thermes congolais, des ‘congolismes’ , que l’intervenant nous a appris. » Les élèves ont imaginé une histoire autour du suivi d’un match du mondial de football dans un bar. « Là-bas l’auteur n’écrit pas juste sur un bout de papier. Il est un ‘performer’, il présente son histoire directement au public. » « Ce ne sont pas des bavardages, ce sont des réactions » Les comédiens eux, ont travaillé sur une pièce de Romuald Djimbi, Le fruit défendu. Marie Moly, élève en parcours comédien, nous résume le propos : « C’est l’histoire d’un jeune qui part en France, pour passer son bac. Dans le village, les ‘tontons’, figures très importantes pour les enfants, elles sont ‘le sang’, doivent apporter des ‘fruits’, à la communauté ». Les fruits sont des gens, offerts en sacrifice, dont la « valeur » est ajoutée en fonction de leur expérience. « Ça parle de sorcellerie, un sujet avec lequel on ne rit pas, là-bas », complète Sam Chemoul, qui a participé aux ateliers des acteurs avec Marie. Lui et les autres élèves du parcours comédien ont partagé la scène avec quatre artistes congolais. « Nous portions des masques, confectionnés à la main sur place, pour la représentation. Avec Marie, nous jouions les sorciers », personnages qui n’ont pas le même visage, de jour et de nuit. Comme les auteurs pour les contes, ce qui a surpris les comédiens est le comportement du public, très réceptif. « Ça réagit dans le public. Mais ce ne sont pas des bavardages, ce sont des réactions ! », témoigne Sam. « Il y a une dame, à un moment qui a lancé : ‘Vous allez payer, les sorciers !’, c’était fou ! », se souvient-il. "On portait une histoire, qui n'était pas la nôtre. Au début, nous avions peur que ce soit mal pris, mais les gens étaient très contents qu'on soit là, le fait qu'on s'empare de cette histoire a été bien reçu." Sam Élève comédien du Studio7 (2021-2024) Le contraste du rêve avec la réalité « Pour nous, ça a été une très belle expérience. On a été très bien accueillis. On a fait de belles rencontres… On a aussi appris des chants », relève Marie, « autour de divers thèmes, comme le deuil. » Et Sam de contraster : « Mais par moments on a aussi été été frappés par une autre réalité ». Il évoque un « choc terrible », ressenti aux abords d’une vaste zone industrielle. Car les géants de l’industrie pétrolière sont partout, jusque dans les « prétendus musées » et monuments. Pour Jean-Serge, se trouver confronté à ça a été un vrai choc personnel. « Nous avons été sur le lieu duquel partaient des navires d’esclaves. On réalise que ça s’est passé là. » Avec d’autres élèves de la promotion, il partent avec leurs bons souvenirs, mais n’oublient pas cette partie du voyage. Jean-Serge a relevé la proposition de Pierre Claver Mabiala, précisant qu’ils étaient bienvenus pour une autre escale. « La proposition a été entendue, elle sera saisie ! », sourit-il, avec déjà quelques idées en tête. Quoi qu’il advienne, un cheminement s’est fait, dans le parcours de nos artistes, à la fois émerveillés, interloqués et saisis, par cette expérience hors du commun.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2022 6:21 PM
|
Par Jane Roussel dans Jeune Afrique - 17/12/22 À tout juste 30 ans, Séphora Pondi est déjà intégrée au sein de la prestigieuse troupe de la Comédie-Française où elle est à l’affiche du « Roi Lear » mis en scène par Thomas Ostermeier. La comédienne française d’origine camerounaise interprète Kent, aux côtés de Denis Podalydès, jusqu’au 26 février. Séphora Pondi n’a pas eu une enfance biberonnée à la prose de Molière. Comme pour les arts en général, le théâtre était aux abonnés absents de son quotidien. Et la voilà pourtant, âgée de 30 ans, foulant les planches de la plus prestigieuse des institutions en la matière : la Comédie-Française. Depuis l’été 2021, la comédienne a élu domicile Place Colette. « J’ai commencé le théâtre relativement tard, en tant que lycéenne, à 16 ans », indique la jeune femme en guise de présentation. L’adolescente – férue de littérature – grandit dans une famille d’immigrés camerounais qui se concentre sur « les impératifs et les enfants, où la légèreté n’est pas de mise ». Mais la banlieue modeste où elle vit a un établissement qui propose des options artistiques. Au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge, Séphora entame une filière L « arts-plastiques ». C’est là qu’elle fait la rencontre d’une surveillante, comédienne en devenir, qui ouvre un cours de théâtre. De Corneille à Wajdi Mouawad On est en pleine époque « High School Musical », nourrissant « tout un fantasme autour de la classe de théâtre, que j’imagine peuplée de gens chelous auxquels je m’identifie », sourit-elle. Au fil de la discussion, la comédienne varie les niveaux de langage, piochant dans des répertoires soutenus ou plus décontractés qui ne sont pas sans rappeler la diversité des rôles dans lesquels on l’a vue jouer. Elle se dévoile spontanément, avec un plaisir facile à deviner, même par combinés interposés. Ces cours de théâtre lui font découvrir des textes jusqu’alors inconnus : l’habituée des vers de Corneille (qu’elle dévore) se met à scander du Wajdi Mouawad. Celle qui se retrouvait dans les personnages féminins mythiques du répertoire classique se plaît aussi à habiter les figures « flamboyantes » de la création contemporaine. Les deux dialoguent bien, comme dans sa prose actuelle. « Je me sens alors complètement à ma place, comme si quelque chose qui attendait depuis longtemps s’était enfin déclaré », se souvient-elle. Au point de changer d’option pour passer un bac L « théâtre ». À la maison, il n’y a « pas spécialement d’encouragements », mais personne ne la freine. Peut-être y a-t-il tout de même l’espoir qu’une fois dans la vie active, elle ne se lance pas dans une carrière d’actrice, vue comme « un métier à risque, c’est tout ». Mais bientôt, les études de lettres à la Sorbonne ne lui suffisent plus, et à 18 ans elle annonce qu’elle arrête pour intégrer une école de théâtre publique départementale, l’EDT91. La réception familiale se corse, mais pas de quoi la décourager : la jeune femme décroche une place dans une école nationale, l’Erac, sur la Côte d’Azur. De la banlieue parisienne, avec un « niveau de vie relativement bas », Séphora passe à Cannes, cette ville « où tout est très cher ». Avec euphémisme, elle glisse le mot « compliqué ». D’autant que simultanément, elle reçoit un mail qui va la ramener très souvent à Paris. C’est la pionne du lycée, devenue une amie, qui lui écrit pour l’inciter à postuler au Programme 1er Acte, que lance le metteur en scène Stanislas Nordey. « Arrête de faire ta grosse méchante black ! » Pour lutter contre le manque de diversité sur les plateaux de théâtre, il s’adresse aux jeunes d’origines sociales, culturelles ou ethniques diverses qui voudraient y monter à leur tour. Rapidement, elle intègre la première promo de 15 acteurs. Du lundi au vendredi, elle étudie dans le sud, le week-end, c’est Paris. « Je fraudais dans le TGV pour y aller, ça coûtait une fortune », avoue-t-elle. Séphora Pondi saisit toutes les opportunités : elle se raconte en « stakhanoviste » du théâtre. Et pour cause, « je me disais, tu n’es attendue nulle part, tu n’as pas d’héritage symbolique culturel ou financier qui te permette de te dire : “à tout moment dans une rue du 6e arrondissement, tu peux être repérée !”, il fallait que j’aille au-devant de mon désir. » À cette époque, elle n’a pas une seule figure de référence qui soit une femme noire comédienne. Par une « chance insolente », insiste-t-elle, provoquer ce destin de comédienne ne passe pas par des rôles stigmatisants. “LES INSTITUTIONS ONT BEAUCOUP DE SENS : MES PARENTS ONT TOUT SACRIFIÉ POUR EN ARRIVER LÀ” Mais il y a bien un souvenir qui l’a marquée, avec un metteur en scène « problématique », à la réputation de « tyran des plateaux ». Après une scène qu’elle joue à l’école, il éructe : « Arrête de faire ta grosse méchante black ! » L’atmosphère anxiogène est telle que personne ne réagit, pas même elle, malgré l’humiliation. « Ça ne me freine pas dans mes élans. Je fais partie de ces gens qu’on fait sortir par la porte et qui reviennent par la fenêtre. » Elle obtient son diplôme et continue sur cette lancée : une pièce au Liban, un rôle dans Désobéir mis en scène par Julie Berès qui tourne pendant quatre ans, des cours dans des lycées de Paris et alentours, des rôles au cinéma… Tandis qu’elle cultive un secret fantasme, celui d’être un jour pensionnaire de la Comédie-Française. En 2019, alors qu’elle joue au théâtre Paris-Villette, l’acteur Eric Ruf la repère et l’interroge : aimerait-elle rejoindre la compagnie ? Elle répond oui. Il note, mais pour plus tard. « À l’été 2021, il me propose d’en être », rebondit-elle. Après des années à valser entre une multitude de projets, Séphora Pondi se pose dans cette « maison » et entre dans la peau de son premier personnage, Kent, du Roi Lear de Shakespeare. Elle y découvre la magie du « Français », son énergie, ses moyens : « Les costumes sont sublimes et faits à la main, je suis maquillée par une professionnelle tous les jours : c’est lunaire pour une intermittente du spectacle ! » dit-elle en riant. L’autre récompense se trouve dans le regard de sa famille, où l’émerveillement a pris la place du doute. « Ils sont encore plus enthousiastes et impressionnés que moi. Pour des personnes avec le passé de mes parents, les institutions ont beaucoup de sens. Ils ont tout sacrifié pour en arriver là. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2022 9:01 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 15 décembre 2022
La metteuse en scène et marionnettiste, qui présente « L’Etang » au Centre Pompidou, explore, dans une belle esthétique glacée, les tréfonds de l’espace mental.
Lire sur le site du "Monde":
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/15/la-choregraphe-gisele-vienne-reveille-les-angoisses-intimes_6154618_3246.html
Une boîte blanche. A l’intérieur, un petit lit défait. Une silhouette d’ado allongé. Des bonbons multicolores jetés au sol. Une tache rouge sang. Soudain, des voix venues d’on ne sait où zèbrent l’espace. Des mots se heurtent et explosent : « Amour, mort, mère, père, noyade… » Le ton monte. Des cris stridents éclatent. Au bout d’une heure et vingt-cinq minutes de ce traitement de choc, on vous libère, taux d’anxiété au plafond, ventre serré. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Gisèle Vienne : « Mon art dit le combat que je mène » Cette expérience éprouvante mais redoutablement intense est celle provoquée par L’Etang, de Gisèle Vienne. Créée en 2020, à l’affiche du Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 18 décembre, la pièce, inspirée par le texte éponyme de l’écrivain suisse Robert Walser (1878-1956), signe l’esthétique de la metteuse en scène, chorégraphe et marionnettiste désormais repérée à l’international : glacialement belle, brutalement sophistiquée émotionnellement dévastée. Parallèlement, deux autres spectacles, This Is How You Will Disappear et Crowd, sont également en tournée à l’enseigne du programme Répertoire du Festival d’automne, offrant un observatoire de sa trajectoire. Libérer un taux d’angoisse aussi fort est rare au théâtre. Gisèle Vienne est une experte en la matière depuis ses premières créations, comme I Apologize (2004) ou Une belle enfant blonde (2005), dans lesquelles elle explorait des fantasmes extrêmes liant le sexe et la pulsion de mort. Si L’Etang n’a pas le même impact plastique, ni la même virulence psychique, il installe néanmoins un climat ravagé. Il faut dire que l’histoire, adaptée de façon très elliptique, y est pour beaucoup. Un jeune garçon, Fritz, s’interroge sur l’amour de ses parents, et en particulier celui de sa mère, jusqu’à mettre en scène et simuler sa noyade. Les dix personnages de l’œuvre originale sont ici interprétés – et c’est un exploit – par les deux comédiennes Adèle Haenel et Julie Shanahan, dont les voix sont trafiquées en direct par des effets de réverbération et de larsens hallucinants. Monologues intérieurs La narration stricte s’y perd un peu, mais le spectacle donne l’impression sidérante de pénétrer dans un espace mental irradié. Y cohabitent en temps réel les monologues intérieurs de Fritz et de sa mère, mais aussi les conversations avec la famille et les amis dans une chambre d’échos de folie. Eclatent, en mille éclats tranchants, la violence, l’inceste, le délire, l’infinie complexité de l’esprit, les gouffres d’une personnalité prise d’assaut par des pulsions, des fantômes, et qui se débat pour trouver une issue. Pas étonnant que Gisèle Vienne se passionne pour la ventriloquie, en particulier dans Jerk (2008) – un solo éberluant autour d’un tueur en série et de ses victimes, interprété par Jonathan Capdevielle entouré de cinq marionnettes, aujourd’hui disponible en film. Lire aussi : Gisèle Vienne et ses poupées cruelles Gisèle Vienne, passée par des études de philosophie ainsi que par l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, s’est fait connaître par son utilisation magistrale de mannequins grandeur nature que l’on retrouve au début de L’Etang. Elle convoque l’inanimé des pantins pour mieux semer la confusion entre le vrai et le faux, la réalité et l’artifice, soulignant le trouble identitaire des personnages qui manipulent les poupées aux visages souvent tuméfiés comme des êtres vivants. Elle les photographie régulièrement et les expose dans des cercueils en verre transparent. La fascination pour la catastrophe, pour l’horreur, ourle la plupart de ses œuvres centrées autour de situations traumatiques liées à l’adolescence. L’un de ses proches collaborateurs est d’ailleurs l’écrivain américain Dennis Cooper, tout en style meurtri. Les disparitions douces, brutales ou simplement suggérées font glisser les spectacles vers l’enquête policière semée de flaques de sang. Egalement en tournée, This Is How You Will Disappear (2010) raconte la virée assassine d’une ado gymnaste, de son entraîneur et d’un jeune homme rockstar. Gisèle Vienne y affûte une écriture de la commotion, sauvage comme un passage à l’acte. Lire aussi : Les perturbantes histoires sanglantes de « Jerk » Le plateau, chez cette artiste, est un champ magnétique dont on s’approche avec précaution tant on flaire le danger. Quelque chose est arrivé ou va surgir, ou les deux à la fois, et la tension est maximale. Une forêt profonde dissimule et perd le trio de This Is How You Will Disappear tandis qu’un no man’s land semé de déchets et de sacs de chips écrasées accueille la rave de Crowd (2017). Sur les accents électro de Peter Rehberg (1968-2021), ce désormais best-seller de la compagnie maintient quinze danseurs en slow motion dans un temps englué, soudain déchiré par un hurlement muet. L’indicible s’appelle Gisèle Vienne. L’Etang, de Gisèle Vienne, au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 18 décembre. Puis en tournée : du 22 au 24 février 2023, à La Chaux-de-Fonds (Suisse) et du 28 février au 2 mars 2023 à Besançon. This Is How You Will Disappear, de Gisèle Vienne, au Théâtre de la Colline, à Paris, du 6 au 15 janvier 2023. A Grenoble, les 2 et 3 mars 2023. Crowd, de Gisèle Vienne. En tournée à partir de mars 2023. Rosita Boisseau Légende photo : Adèle Haenel dans « L’Etang », de Gisèle Vienne à la Comédie de Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2022. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2022 7:41 AM
|
Par Gilles Renault dans Libération le 15/12/2022 Subtile mise en scène de la reine d’Autriche causant Facebook et coworking, la nouvelle pièce de Nicole Genovese pulvérise les limites de l’absurde avec tendresse et cruauté. A qui ne connaîtrait pas l’univers de Nicole Genovese – ce qui, y compris parmi les habitués du spectacle vivant, doit encore représenter un paquet de gens – faisons la suggestion suivante : accorder un blanc-seing à l’auteur de ces lignes en zappant ce qui suit, afin d’en savoir le moins possible, et courir ventre à terre au théâtre des Bouffes du Nord, où se joue un des moments les plus jubilatoires de la fin d’année théâtrale, sinon de l’année tout court. Pour les autres, suivez le guide : planté au beau milieu du grandiose repaire de feu Peter Brook, le dispositif paraît riquiqui et obsolète, puisque constitué, à l’ère de la vidéo et des effets numériques, de simples tréteaux du temps jadis, surmontés d’un cadre en bois, avec, en fond d’écran, une série non moins désuète de toiles peintes que l’on effeuillera tout du long de la représentation, à mesure que l’action évoluera entre scènes d’intérieur et d’extérieur. «Brève de boudoirs» Or, raccord avec le cadre, s’assied d’abord, sur le côté, un musicien (et compositeur) en livrée, bas et souliers, qui, avec sa viole de gambe, donne le la, «proto-baroque». Avant que deux dames de haut rang – les perruques, robes à paniers et autres corsets faisant foi – ne se mettent à jacasser à l’heure du thé. Tout à leur désœuvrement, Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe ont en effet des choses à se dire. Mais, accent du Sud compris, leur échange s’engouffre sans le moindre préavis dans une gigantesque faille spatiotemporelle, où il est question d’espace de coworking, de profil Facebook, de cuisine Mobalpa. Ou de «brèves de boudoir», style : «Les gens aiment trop l’argent.» «Mais non, les gens sont comme tout le monde.» Pulvérisant les limites d’une absurdité truffée d’anachronismes – comme de purs silences quasi métaphysiques – suffisamment bien dosés pour prévenir l’essoufflement du procédé, nous voici donc, roture prosaïque, à épier dans la pénombre la condescendance veule d’une coterie que compléteront Louis XVI et le comte d’Artois. Ainsi que, histoire de finir de brouiller les pistes, Fred et Deborah, un couple méridional sans filtre, dont la beauferie ingénue renverra dos à dos monarchie agonisante et Ve République matérialiste et inculte. Poilante entreprise Précieux moment de mystification ridicule, le Rêve et la Plainte se tient donc là, corrosif et pourtant bizarrement empathique, dans ce dynamitage des codes qui, depuis ce Ciel ! Mon placard démontant en 2014 les rouages du vaudeville, singularise l’écriture de Nicole Genovese. Une poilante entreprise de démolition qui, pour imposer le nonsense, s’appuie autant sur la subtilité de la mise en scène de Claude Vanessa, complice de longue date, que sur l’interprétation de sept comédiens hors pair, dans le sillage d’un indétrônable couple royal où l’hébétude abrutie de Maxence Tual le dispute à la faconde paradoxalement «fille du peuple» de Nabila Mekkid. Le Rêve et la Plainte, de Nicole Genovese, m.s. Claude Vanessa, Théâtre des Bouffes du Nord, 75010, jusqu’au 30 décembre, puis en tournée (Cherbourg, Lorient…) Légende photo : Marie-Antoinette devise avec la princesse de Lamballe. (Charlotte Fabre)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2022 6:20 PM
|
Publié le 8 déc. 2022 dans Sceneweb - Abdelwaheb Sefsaf nommé à la direction du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines. Il prendra ses fonctions au 1er janvier 2023, succédant ainsi à Sylvain Maurice. Artiste au parcours singulier, Abdelwaheb Sefsaf a été formé à l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de Saint-Etienne avant de fonder le groupe de musique Dezoriental dont les concerts ont rassemblé de nombreux publics dans les plus prestigieux festivals et les plus grandes scènes de France. Depuis 2011 et la création de la compagnie Nomade In France, il défend un théâtre musical qui traverse les âges, les cultures, les traditions et les genres, un théâtre d’ouverture et de décloisonnement. Abdelwaheb Sefsaf entend faire du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines une fabrique pluridisciplinaire, accessible à tous, étendue sur tout le territoire et ouverte sur le monde. Odile Grosset-Grange, Margaux Eskenazi, Mathurin Bolze et Maurin Ollès l’accompagneront pour faire du centre dramatique une maison partagée et vivante de créations intergénérationnelles. Abdelwaheb Sefsaf souhaite que leurs actions rayonnent au-delà des murs du théâtre, en particulier dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines, pour que cette biennale demeure un moment d’effervescence créative unique au service des enfants et des familles. Abdelwaheb Sefsaf prendra ses fonctions au 1er janvier 2023, succédant ainsi à Sylvain Maurice, qui poursuivra en compagnie son parcours artistique d’excellence. Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture salue l’action de ce dernier à la tête du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, dont il a fait un établissement remarqué pour sa programmation ouverte à des esthétiques plurielles, son soutien à la création jeunesse et sa politique d’élargissement et de diversification des publics. Après une formation à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Saint-Etienne, Abdelwaheb Sefsaf participe à plusieurs mises en scène de Daniel Benoin et Jacques Nichet. En 1999, il fonde Dezoriental, un groupe de musique world à l’ascension fulgurante qui donne plus de 400 concerts dans les plus prestigieux festivals nationaux et internationaux et signe plusieurs albums chez Sony Music auprès du prestigieux Label Dreyfus. En 2006, le groupe reçoit le Prix Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros. Puis, en tant que comédien-chanteur, il travaille avec Claudia Stavisky, Claude Brozzoni autour du spectacle Quand m’embrasseras-tu ? adaptation théâtrale et musicale des textes de Mahmoud Darwich et Jacques Nichet avec lequel il reçoit avec Georges Baux le Grand Prix du Syndicat de la Critique « meilleure musique de scène » pour le spectacle Casimir et Caroline d’Ödön von Horváth . En 2011, avec la scénographe et plasticienne Souad Sefsaf, il fonde la Compagnie Nomade In France avec l’ambition de développer un théâtre-musical de formes nouvelles qui traverse les âges, les cultures, les traditions et les genres, un théâtre d’ouverture et de décloisonnement. De 2012 à 2014, il est directeur du Théâtre de Roanne – Scène régionale (Loire). En 2014, il crée son premier texte de théâtre Medina Mérika qui partira en tournée pour plus de cent représentations et reçoit en 2018, le Prix du Jury MOMIX, festival international de la création pour la jeunesse de Kingersheim. Depuis, ce sont sept spectacles, dont les deux derniers Si loin si proche et Ulysse de Taourirt forment un diptyque intime sur le récit de son enfance et l’histoire de son père immigré algérien arrivé en France en 1948. Il crée en complicité avec Georges Baux, Marion Guerrero, Marion Aubert, Rémi Devos, Jérôme Richer, Souad Sefsaf, Nestor Kéa, Daniel Kawka, André Minvielle et une large équipe de technicien.ne.s, comédien.ne.s, chanteu.r.se.s, plasticien.ne.s, réalisat.rice.eur.s, dans une exploration permanente de la relation entre musique, théâtre et vidéo. En collaboration avec l’ensemble Canticim Novum, sa prochaine création Kaldûn, autour de la déportation des Algériens et Communards en Nouvelle-Calédonie est prévue à l’automne 2023. Parallèlement à ses projets de création, il mène auprès des publics des projets d’actions culturelles d’envergure mêlant écriture, théâtre, musique et vidéo. 8 DÉCEMBRE 2022/PAR DOSSIER DE PRESSE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2022 3:24 PM
|
Par Sylvain Siclier dans Le Monde -10/12/22 Au Hall de la chanson, à Paris, un spectacle présente la passion de l’écrivain pour les cafés-concerts autour d’une vingtaine de chansons et, en parallèle, sa relation amoureuse avec le compositeur Reynaldo Hahn. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/10/theatre-le-bonheur-de-proust-au-cafe-concert_6153835_3246.html
Ils avaient pour nom Les Ambassadeurs, L’Alcazar, L’Eldorado, La Scala, le Concert parisien… Nés à partir du milieu du XIXe siècle, ce sont les cafés-concerts de la capitale, des salles où l’on consomme en assistant à des spectacles avec un orchestre, des chanteuses et des chanteurs, des danseuses, des numéros d’acrobatie, de magie… Capacité d’accueil, plusieurs centaines de places, mille, voire un peu plus. Dans le public, mêlés, des employés, des prolétaires, l’aristocratie, la bourgeoisie. Parmi celles et ceux qui y viennent régulièrement, l’écrivain Marcel Proust, dont est actuellement célébré le centenaire de la mort, le 18 novembre 1922, à l’âge de 51 ans, avec des expositions, des publications, des émissions radiophoniques, des documentaires. Et un spectacle très réussi, savoureux, au Hall de la chanson, au parc de La Villette, à Paris, durant lequel est rappelée la passion de l’auteur d’A la recherche du temps perdu pour le café-concert, ses lieux, ses interprètes. Classiques de la polissonnerie Le décor est double. A gauche, le salon, avec paravent de bois aux motifs floraux, où vit Proust, où il retrouve son amour, le compositeur Reynaldo Hahn (1874-1947), relation tout aussi passionnelle évoquée en parallèle. A droite, le rideau rouge des cafés-concerts, celui qui s’ouvre pour qu’apparaissent Yvette Guilbert (1865-1944), que le bon goût trouve trop tragique, sombre, que Toulouse-Lautrec peint et dessine, Emma Valladon dite Thérésa (1837-1913), Félix Mayol (1872-1941), qu’adore Proust – il aurait voulu le faire venir chanter chez lui, cela ne se fera pas –, Paulus (1845-1908), Harry Fragson (1869-1913), Polin (1863-1927)… Proust raconte ses émotions dans les lieux enfumés, bruyants, où le populaire et le grand monde se mêlent, prend le parti des chanteuses et chanteurs contre des articles de presse Olivier Hussenet est Marcel, Quentin Vernede est Reynaldo, ils deviennent Mayol, Paulus, Fragson, Polin, Dranem. Catherine Pavet, la bonne, aux percussions à partir d’ustensiles ménagers, de clochettes, d’un tambour militaire, chante aussi. Lucie Sansen, pianiste et chanteuse, incarne Thérésa. Au programme, une vingtaine de chansons. Des classiques de la polissonnerie, dont Les Amis de monsieur, où le soupirant apprend que nombre de ses compagnons sont déjà passés dans les bras de la soubrette, Amour de trottin. Des romances, Quand je ne t’aimerai plus et Pourquoi ne pas m’aimer ?, qui résument les amours de Marcel et Reynaldo. Des fantaisies, Les Héritiers et son cortège de mesquineries, Viens Poupoule, le succès de Mayol, Le Parfait Homme du monde, portrait d’un parfait goujat, L’Anatomie du conscrit, qui détourne le registre patriotique illustré par Le Père la Victoire. Les quatre interprètes leur donnent allégresse et tendresse, en accord avec les deux directions fortes vers lesquelles mène le spectacle. Entre les morceaux, des extraits de la correspondance de Proust. Il y défend ces chansons, cette musique « immense dans l’histoire sentimentale des sociétés », raconte ses émotions dans les lieux enfumés, bruyants, où le populaire et le grand monde se mêlent, prend le parti des chanteuses et chanteurs contre des articles de presse. Et dit à Reynaldo son attachement, le tourment de ses sens, mouille de larmes ses écrits lorsque le couple n’est plus. De ce spectacle, où l’on découvre l’homme de lettres sous cet angle musical, l’on ressort en fredonnant ces airs qui ont amusé, choqué à l’époque et appartiennent aujourd’hui au patrimoine. Proust au café-concert, au Hall de la chanson, parc de La Villette, pavillon du Charolais, Paris 19e. Samedi 10 décembre, à 17 h 30 et dimanche 11, à 16 h 30. De 10 € à 13 €. Reprise du 6 au 28 janvier 2023. Sylvain Siclier Légende photo : Le chanteur et comédien Olivier Hussenet, qui interprète notamment Marcel Proust, et la percussionniste, chanteuse et comédienne Catherine Pavet, dans « Proust au café-concert », au Hall de la chanson, à Paris, lors d’un filage du spectacle le 18 novembre 2022. NABIL BOUTROS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 9, 2022 9:44 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 8 décembre 2022 Le chorégraphe arrête sa carrière en nous donnant à lire tout ce qui aura fait son style sur scène. Réflexions et rêveries se mêlent dans un subtil pas de deux, délicieusement imprévisible.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/08/post-scriptum-georges-appaix-entre-litterature-et-incarnation-dansee_6153464_3232.html
Livre. Il a décidé d’arrêter après trente-six ans de danse et l’annonce dans sa pièce ultime, encore en tournée, intitulée XYZ. Heureusement, le chorégraphe Georges Appaix, l’auteur le plus subtilement littéraire du spectacle vivant depuis le début des années 1980, ne la ferme pas complètement. Pour ne pas nous abandonner sans un mot ou presque, celui dont la compagnie ne s’appelait pas La Liseuse pour rien, nous offre tout bonnement un livre, un vrai. Il a beau se dissimuler derrière son titre et vouloir n’être qu’un post-scriptum, il souligne évidemment un message urgent et important comme c’était souvent le cas lorsqu’on ajoutait ce terme aujourd’hui un peu désuet en fin de course d’une lettre. Georges Appaix est l’homme d’une œuvre étrange, fascinante et simplement complexe que cet ouvrage recouvre d’un filet de phrases comme attrapées au fil de la pensée. Librement construit, sans aucun chapitre, il articule des paragraphes de longueur inégale, louvoyant entre souvenirs, commentaires du moment, points de vue sur le travail, confidences sur la méthode et l’amour de la boîte noire. Il ressemble à son écriture chorégraphique, sautant d’un sujet à l’autre, bifurquant net, chavirant soudainement pour installer un moment d’accalmie. Sportif, joueur de saxo et amateur de jazz – il a imaginé des pièces sur Ornette Coleman, John Coltrane, Wayne Shorter et beaucoup d’autres –, le Marseillais Appaix a la révélation de la danse après des études à l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers d’Aix-en-Provence. Le hasard le fait rencontrer la pédagogue et chorégraphe Odile Duboc. Le voilà en studio en train de découvrir un espace autre que celui qu’il arpentait en dialoguant avec le ballon de foot. Rien que la façon dont il décrit le plancher du studio de Duboc donne illico la sensation de son corps glissant sur le bois, du toucher des pieds et de leur propulsion. Dès 1983, il commence à créer. Un an après, il démarre son abécédaire spectaculaire. Léger et bondissant De A comme Affabulations, Agathe et Antiquités, à XYZ, qui finit un peu vite, en passant par H pour Hypothèses fragiles, O façon Once upon a time ou U comme Univers Light, il dessine sa route entre littérature référencée (Homère, Ponge, Diderot, Musil, Duras…) et incarnation dansée. Toujours d’un pied sur l’autre, toujours léger et bondissant, elliptique par nature, paradoxal parce que c’est comme ça, Appaix invente son texte et sa langue en trouvant aussi sa voix dans le mouvement. Il a sorti le poisson rouge qu’est le danseur de son bocal pour le faire causer, bavarder avec ses collègues, bref l’ouvrir, même si c’est pour bégayer ou ne pas finir ses phrases. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Georges Appaix danse la fin de son abécédaire Le verbe, selon le chorégraphe, apporte à la danse « une sorte de complication, renvoie à une humanité plus complexe, vulnérable aussi ». Cette petite musique, inoubliable, se faufile entre les pages de ce livre précieux qui vous porte avec douceur. La réflexion et la rêverie s’y interpénètrent pour livrer une philosophie de la vie et de l’art dont la saveur reste longtemps en bouche. La conclusion de l’ouvrage signe l’élégance d’Appaix : « Ne pas s’étendre trop, épargner le lecteur comme le spectateur. Tout le plaisir était pour moi ! » Pour nous aussi ! « Post-scriptum », de Georges Appaix. Carnets, Centre national de la danse, 120 pages, 14 euros.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 8, 2022 10:36 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 8/12/22 Du « Jeu de Faust » (1987) au « Chant du Bouc » (1991), de « Choral » (1994) à « Coda » (2004), de « Ricercar »(2007) à «Soubresaut » (2016), d’«Item ») (2019) à « Par autan » (2022), François Tanguy, capitaine de l’équipage du Théâtre du Radeau aura durablement marqué le théâtre français et, avec La Fonderie du Mans, inventé une autre façon d’habiter le théâtre. Il laisse bien des orphelins. La première fois (pour moi) c’était, il y a quarante ans, L’Eden et les cendres (1983) , François Tanguy en avait 24.Le spectacle se donnait dans de qui était déjà, je crois, un garage. Etait-ce déjà celui où le Radeau s’installerait un peu plus tard ? Il y avait là, venue assister au spectacle, Mady Tanguy, la tante de François, comédienne amateure au Studio théâtre de Vitry de Jacques Lassalle. Première approche filiale, affective. Accueilli par Laurence Chable, François Tanguy avait rejoint le Théâtre du Radeau en 1982. Il allait en devenir l’âme et Laurence la cheville ouvrière, lui le poète, le scénographe, le maître d’œuvre, elle l’actrice, la cheffe de groupe, l’aubergiste. Dix ans et quelques spectacles plus tard (Mystère bouffe, Jeu de Faust, Woyzeck-Büchner-Fragments forains, Chant du bouc), avec la bienveillance de bras amis comme ceux de Claude Régy , commencerait (1992) dans l’ancien garage aux locaux aménagés un à un, l’aventure de la Fonderie, meilleure auberge du théâtre de France, hier comme aujourd’hui. Bientôt, dans un champ en dehors de Mans, François et le Radeau devaient installer une grande tente blanche où se fomenteront les spectacles. A l’heure de l’élaboration, du défrichage, cela commençait par des journées de lectures ( Walter Benjamin, le Cardinal de Retz, Robert Walser, Hölderlin ,Shakespeare, Leopardi et tant d’autres) autour d’une table où prenaient place fidèles et nouveaux venus, une table en bois dressée dans la clairière Grüber (ainsi nommée parce que Klaus Michael Grüber aimait l’endroit). Et puis cela germait, se ramifiait et le passage sous la tente faisait que tout avançait de front : corps, mots, mouvements, musique, décor, costume, accessoires, lumière). Un jeu d’étonnements et de connivences . Des spectacles aussi insensés qu’irracontables, que les deux mots accolés théâtre-poème ne résument pas. La Tente étant vouée au Radeau, Fonderie est alors vouée au séjour de multiples compagnies venus en résidence mais aussi à d’autres aventures artistiques (entre autres musicales au salon de musique) , sociales et politiques. Ou encore à des week-ends informels où on se rassemble autour d’une table. On y croise Jacques Rancière, Lacoue-Labarthe, Les Straub et tant d’autres. La Fonderie sera au cœur des années Bosnie, François avec Ariane Mnouchkine, Olivier Py et quelques autres mènent une grève de la faim. Le spectacle Choral (1994) se donnera à Sarajevo. Dans la distribution de ce spectacle, on retrouve des historiques du Radeau comme Fròde Bjornstad, Laurence Chable et Jean Rochereau, mais aussi, le temps de plusieurs spectacles, Nadia Vonderheyden, Branlo et Nigloo, Yves-Noël Genod, Jean-Louis Coulloc’h et Pierre Meunier qui tous, traceront leur route. Comme une constellation Radeau autour de l’astre François. Les spectacles se succèdent, Bataille de Tagliamento ( 1996), Orphéon (1998). Bruno Tackels (François Tanguy et le Théâtre du Radeau, Éditions les solitaires intempestifs ) et surtout Jean-Paul Manganaro ( François Tanguy et le Radeau, POL) en seront les attentifs mémorialistes. Manganaro parle de « l’intranquillité vigilante du théâtre de Tanguy »,on ne saurait mieux dire. Et à propos de Cantates(2001), il écrit ceci « Comment le corps de l’acteur va-t-il traverser les mots de Hölderlin tout en laissant au texte sa puissance désinvolte et légère, sans le prendre à parties, sans en faire son affaire, sans l’intérioriser ? Comment les corps, traçant d’impossibles affrontements, vont-ils traverser la barbarie sauvage de Chostakovitch en quelques notes aussi puissantes qu’une intégrale, sans en faire simplement une valse mimée, mais recadrant chaque geste et les ensembles de gestes hors de l’emphase d’une ruine des corps qui l’un l’autre se détruisent et se sauvent, hors de l’emphase d’une joie mêlant cruauté et masque, charnel et costume, les noyant dans l’amour jou de la folie de l’amour qui exclut et rejette, et reprend, inlassablement? Et comment les châssis se mettent à chanter et glissent leurs mouvements et leurs couleurs dans une solitude hiératique et pensive du théâtre et du cinéma, une solitude joyeusement peuplée de leur présence qui se dresse en scène ? » Oui, les châssis du Radeau chantent et d’ailleurs à chacun, François donnait un nom. Suivront Coda (2004), Ricercar (2007), Onzième (2011), Passim (2013) , tous accueillis au Festival d’automne, comme les précédents depuis Mystère bouffe , comme le suivant, Soubresaut, au titre beckettien, qui précède Item et celui qui sera désormais le dernier spectacle de François Par autan. Au hasard ou presque, retour sur l’un d’entre eux, Soubresaut : « Comme toujours au Théâtre du Radeau, l’espace du jeu nous accueille à l’orée du nouveau spectacle, Soubresaut. A vue. Que voit-on dans la pénombre ? Un entrelacs de lignes, de plans où domine l’oblique. Comme toujours, c’est un assemblage de cadres, de châssis, de planches, de toiles plus ou moins transparentes, peu de papier peint cette fois (un peu, au loin), une petite table. Une scénographie signée, comme toujours, François Tanguy. Elle occupe la pénombre, en attente de mouvement, de lumières (co-signées François Fauvel, Julienne Havlicek Rochereau et François Tanguy), de sons et de musiques (Eric Goudard et François Tanguy), d’acteurs-machinos (Didier Bardoux, Frode Bjornstad, Laurence Chable, Jean-Pierre Dupuy, Muriel Hélary, Ida Hertu, Vincent Joly, Karine Pierre). Une femme s’assoit de profil dans la pénombre, elle se lève, suit un dédale étroit, disparaît au fond. Prélude. Écho (involontaire ?) au début de Soubresauts, le texte de Beckett que convoque, malgré lui, le titre du spectacle. Début : « Assis une nuit à sa table la tête sur les mains, il se vit se lever et partir ». Sur le côté droit, un plan incliné monte vers un trou noir. Comme on en voit dans les échafaudages de chantier. Un homme revenu d’un voyage dans des contes de la vieille Europe ou en congé, d’un tableau de maître flamand ou de je ne sais quoi, glisse sur le plan incliné jusqu’en bas comme sur un toboggan de l’enfance. La femme assisse de profil est revenue, on la revêt d’atours, de manchons de fortune. Une fois, deux fois, la brassée de fleurs devient bouquet boursouflé. Délice de la répétition qui n’en est jamais une. Musiques et lumières en bourrasque, cadres que l’on déplace, l’espace danse. De façon amicale et par bouffées de tendresse, Soubresaut s’ébat, fouine dans l’enfance du théâtre et le théâtre que l’on fabrique avec trois fois rien quand on est enfant. Comme les autres, ce spectacle du Radeau est fait main. Le pied d’un porte-manteau y devient l’amorce d’un fusil, un bout de tuyau de poêle coudé suffit à dire l’armure, une lampe de chantier retournée sur une tête et hop, un chapeau de mandarin. Rien de fixe, de définitif. Beauté du suggéré. Tout bouge, les corps, les lumières, les musiques, les planches, les cadres. On cadre, on recadre, on décadre, on fait, on défait, on refait, on sort, on entre, on s’habille, on se déshabille, on remonte la pente, on re-glisse en bas. On ne s’attarde pas. Les sons, les lumières, les paroles, les mouvements, les objets, les costumes se répondent, comme dit le poète. Le Radeau met les sens aux aguets. On rit, à Soubresaut comme à Charlot, des petits malheurs du tout-venant. Ainsi ce bonhomme avec les lunettes et la moustache de Groucho Marx, machiniste empêtré dans le tas de toiles qu’il porte enroulées entre ses bras comme des ailes malhabiles d’albatros. On est du côté des empêchés. » L’onde de François et du Radeau s’est propagée, loin du Mans, à travers bien des aventures plus récentes voire nouvelles . Créant des ponts, des liens, des signes de reconnaissance ou des réseaux secrets. L’une des plus belles connivences reste celle qui, depuis une dizaines d’années, liait Sylvain Creuzevault à François Tanguy. Une connivence de frères. Un été, Creuzevault et son équipe sont venus répéter à la Fonderie Angelus Novus. Au final le décor de François pour Passim (2013), réinvesti, est entrée dans le spectacle de Sylvain. Plus qu’un geste magnifique d’amitié, faut-il y voir ou entrevoir aujourd’hui, un passage de témoin ? Les premières représentations de Par autan (lire ici),au Théâtre de Gennevilliers ont été supprimées. Les obsèques de François Tanguy auront lieu lundi. On saura prochainement les suites données à la tournée de Par autan à Gennevilliers et ailleurs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 8, 2022 6:32 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 8/12/2022 La réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi a fait jouer à son compagnon, Sofiane Bennacer, un ancien amour – mort – de la cinéaste. La frontière entre le réel et la fiction, ainsi mise en jeu, est troublante. D’autant que l’acteur, parallèlement accusé de viols et violences, est ardemment défendu par la cinéaste.
Lire l'article dans le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/08/les-amandiers-au-risque-de-la-confusion-entre-mise-en-scene-et-vraie-vie_6153469_3232.html
Analyse. Le théâtre, dit-on, est l’art des fantômes. Celui de convoquer les morts, de faire passer leur souffle, leurs mots, leur âme, à travers la chair vive et l’esprit d’êtres bien vivants, présents dans l’espace et le temps partagés de la représentation. La métaphore parfaite de cet art des fantômes, c’est Hamlet, où Shakespeare fait vivre sur scène le spectre du père du héros – et sans doute celui de son propre père, mort peu de temps avant qu’il n’écrive la pièce maîtresse de tout le théâtre occidental. Le théâtre est aussi, comme le cinéma, qui en est directement issu, un jeu de désirs, de fantasmes, de projections, qui circulent entre un metteur en scène et des acteurs. Un jeu qui, jusqu’à une période récente, a principalement eu lieu entre un metteur en scène homme et des actrices, souvent bien plus jeunes que leur pygmalion. Tout cela, Valeria Bruni-Tedeschi ne l’ignore pas. C’est même un des sujets de son film Les Amandiers, sorti en salle le 9 novembre, et qui se trouve aujourd’hui au cœur d’une tempête médiatique, à la suite des accusations de viols et de violences dont fait l’objet l’acteur qui joue le principal rôle masculin de son film, Sofiane Bennacer. Les Amandiers est un film de fantômes, qui convoque un certain nombre de figures disparues, comme Patrice Chéreau ou Pierre Romans, qui dirigeaient l’éphémère école d’acteurs du Théâtre des Amandiers, à Nanterre. Lire aussi : Affaire Sofiane Bennacer : ce que l’on sait des accusations de viols contre l’acteur des « Amandiers » Sofiane Bennacer y incarne un jeune comédien, Thierry Ravel, mort d’une overdose en 1991, à 28 ans, et qui était alors l’amoureux de Valeria Bruni-Tedeschi, quand tous deux faisaient partie de cette troupe d’élèves acteurs. Jusque-là, rien d’extraordinaire : nombre d’artistes invitent dans leurs œuvres les figures de leurs morts. Valeria Bruni-Tedeschi l’avait déjà fait elle-même avec un personnage directement inspiré de son frère, dans son film Un château en Italie ; on peut penser aussi à Patrice Chéreau, évoquant son père dans Ceux qui m’aiment prendront le train. Interrogations vertigineuses Ce qui a troublé dans l’affaire Sofiane Bennacer, c’est l’information selon laquelle le jeune acteur – âgé de 25 ans – est le compagnon actuel de la cinéaste. Là encore, en apparence, rien d’extraordinaire : l’histoire du théâtre et du cinéma regorge d’exemples de metteurs en scène qui ont des histoires d’amour avec leurs actrices ou leurs acteurs. Valeria Bruni-Tedeschi, qui, à 58 ans, est une femme puissante et séduisante, n’aurait fait que retourner le vieux schéma patriarcal, ce qui peut d’ailleurs être vu comme une avancée. Et pourtant, cette information amène à des interrogations vertigineuses. Ce qui se joue ici est, à notre connaissance, tout à fait inédit. Sofiane Bennacer ne se contente pas d’incarner Thierry Ravel ou un personnage qui lui ressemble, ce qui est son travail d’acteur. Il vit, dans la vie réelle, une histoire d’amour avec la cinéaste. Il est, dans son film, le fantôme de Thierry Ravel. A l’image de ce qu’il est lui se superpose inévitablement l’image de celui qu’il incarne. A l’image de ce qu’elle est se superpose son incarnation, jeune, dans le film (par l’actrice Nadia Tereszkiewicz). Que rejoue Valeria Bruni-Tedeschi avec cette histoire, avec ces vases communicants entre la fiction et le réel, entre la vie et la mort ? Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Les Amandiers » et l’affaire Sofiane Bennacer, « une incroyable mise en abyme entre le film et la réalité » Les frontières entre les deux, fiction et réel, se brouillent de manière dérangeante et explosive, dans cette réincarnation, par être vivant interposé, d’une histoire d’amour tragiquement avortée. Et cette transgression de frontières interroge : le théâtre – ou le cinéma – est certes un art des fantômes, mais, dans la plupart des cas, la frontière entre le réel et le symbolique est tout à fait claire ou, si elle est poreuse, elle le reste dans des limites vivables pour les artistes. Opération un peu vaudoue On connaît des acteurs qui se sont abîmés dans l’identification à leurs personnages, ou abîmés dans les complexités existentielles que peut mettre à nu le théâtre. Mais ils sont finalement peu nombreux, et un gros travail a été fait depuis trente ans dans la formation des jeunes comédiens pour rendre claire dans leur esprit la frontière entre fiction et réel, pour leur apprendre à poser la distance entre eux-mêmes et les personnages qu’ils jouent. Valeria Bruni-Tedeschi, elle, dans la lignée de Chéreau, est d’une autre école, qui prône un art profondément poreux avec la vie – et inversement –, ce qui donne souvent des résultats
formidables en matière d’intensité de jeu. Ce dont témoigne d’ailleurs Les Amandiers. Mais, à partir de là, on s’interroge sur le rôle de Sofiane Bennacer, dans cette opération un peu vaudoue, consistant pour Valeria Bruni-Tedeschi à redonner vie à l’histoire d’amour de ses années Nanterre, non seulement dans son film, mais dans sa propre vie. Dans quelle étrange circulation du désir et de la mort le jeune acteur a-t-il été pris ? Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Mona Chollet : « Valeria Bruni-Tedeschi n’a pas analysé les rapports de pouvoir qui se jouaient aux Amandiers » Toutes ces interrogations, sans doute, seraient restées dans un tiroir, si Sofiane Bennacer n’était pas apparu sur le devant de la scène pour de tout autres raisons que son talent, qui éclate avec évidence dans le film. Mais, au-delà de ce dont il s’est rendu coupable ou non auprès des jeunes femmes qui l’accusent, et qui est du ressort de la justice, cette interrogation en amène une autre. Si Valeria Bruni-Tedeschi défend bec et ongles « son » acteur face aux accusations qui le visent, est-ce parce qu’elle sait qu’elle lui a fait jouer un rôle bien plus complexe que celui de simple acteur, et qu’elle en ressentirait une forme de culpabilité ? L’affaire Sofiane Bennacer n’a sans doute pas fini de propager ses ondes de choc : pas seulement concernant l’avancée du mouvement #metoo, mais aussi sur la manière dont un artiste peut manipuler cette matière hautement inflammable et fragile qu’est la vie des autres. Fabienne Darge / LE MONDE Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 7, 2022 6:59 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération, 7 déc. 2022 Figure du théâtre du Radeau et auteur d’œuvres uniques en leur genre, le Manceau est mort dans la nuit de mardi à mercredi. Il s’apprêtait à présenter «Par Autan», sa dernière pièce, au T2G de Gennevilliers. François Tanguy est mort dans la nuit du 6 au 7 décembre attrapé par une septicémie, au Mans, à l’hôpital où il avait été admis lundi dernier. Mort par surprise, alors même que son dernier spectacle, Par Autan, est en tournée et s’apprête à vivre dès jeudi sur la scène du T2G à Gennevilliers. François Tanguy était évidemment beaucoup trop jeune pour s’éclipser, metteur en scène unique de 64 ans, qui depuis quatre décennies imaginait des œuvres limpides, à condition de se laisser happer dans un état second, lumineux si l’on accepte que la lumière ne soit pas antagoniste à la brume, et qui paraissaient se faire écho les unes aux autres – du moins, c’est toujours avec les mêmes mots que les critiques successifs tentent d’en faire état, de les attraper, toujours en vain. La vie de François Tanguy elle-même ressemblait à ce rêve éveillé et pourtant vécu, utopie concrète qui s’incarnait à la Fonderie, cet ancien bâtiment industriel du Mans de 4 200 m², puis garage, devenu théâtre. Avec le théâtre du Radeau, compagnie fondée en 1977, il y vivait et travaillait, y concevait longuement tous ses spectacles, y accueillait nombre de compagnies en résidence, mais aussi des associations ou des artisans depuis 1985. Car si François Tanguy ne pouvait respirer que dans un théâtre, celui-ci s’ouvrait au monde. Les espaces dédiés à la vie quotidienne, aux rencontres, aux autres, n’étaient pas dissociés de ceux investis par l’expérimentation et la recherche, les frontières n’avaient pas à être abattues puisqu’elles n’existaient pas. François Tanguy était indissociable de ses comédiens et réciproquement. Dans Par Autan, qu’on a découvert lors de la dernière édition du festival du TNB à Rennes, il est magnifique de les voir qui paraissent avoir vieilli ensemble comme des prunes à l’eau-de-vie dans un même bocal, unis par la même fidélité obstinée – tels Laurence Chable, Erik Gerken, Frode Bjornstad – avec Anaïs Muller, la plus jeune de tous, splendide de tenue, qui fait entendre la texture de chacun de ses mots. Allure testamentaire Forcément, cette dernière création prend une allure testamentaire. Nous voici donc face à toute une famille marchant malgré l’ouragan qui courbe leur corps et interdit leurs mouvements. Vraie famille ou famille de théâtre, petite troupe, qui soudainement semble en déséquilibre sur une crête alors même qu’on est dans ce qui semble être un genre de mansarde avec des parois à colmater sans fin, des vitres rafistolées, des murs palimpsestes sur lesquels s’écrit, songeait-on, une histoire du théâtre. Famille de théâtre que le mauvais vent de la mort vient de terrasser. La scénographie semble signer et rassembler tout l’univers de Tanguy : un intérieur, mais sans cesse transpercé, une multitude de cadres et décadrages, qui modifient et bousculent le regard, l’attire sur des arrière-cours jusque-là invisibles. Comme souvent chez lui, textes, musiques, acteurs, ustensiles, rideaux écrus, tout est à égalité sur le plateau, sur le même plan. Cela suscite une rêverie partagée et sensorielle. Et comme toujours, rien ne fait décor, ou trompe-l’œil, au point qu’on s’était surprise à la sortie à scruter le bois du plancher du plateau comme pour en évaluer la solidité ou l’ancienneté. Personne pour nous reprocher de ne pas suivre l’intrigue ou l’histoire si jamais elle existe. Il nous avait paru entendre les récits fragmentaires de Robert Walser, l’écrivain suisse retrouvé congelé dans la neige en 1956 après une longue promenade entamée un jour de Noël à la clinique psychiatrique de Berne – oui, c’est bien lui, mais peu importe que la reconnaissance ait lieu, que l’on distingue ou non ses mots ou ceux de Shakespeare ou de Tchekhov. Sur le plateau, on avait noté, comme dans nombre de ses spectacles, la grande table rectangulaire en bois, celle des banquets, meuble récurrent et élément solide, pour une mise en scène aussi mobile qu’un rêve qui s’échappe. Et il y a le vent‚ un grand vent, l’autan du titre, le vent des fous qui ravive chez le spectateur le souvenir ancien de dessins d’albums pour enfants – de Claude Ponti et d’Ungerer. Mariée en blanc On ne se serait pas risquée à évaluer précisément la temporalité durant laquelle se déroulent ces tableaux – une nuit, une saison, trente ans, une éternité ? Quant à l’époque, disons, comme les enfants, qu’il s’agit de «l’ancien temps», la fin du XIXe, le début du XXe, et que ça n’a aucune importance tant cette maisonnée, malgré ses chevaliers, sa mariée en blanc, et autres figures. Les murs qui tiennent malgré l’autan et le jeu des acteurs paraissaient condenser l’énergie qu’il fallait à François Tanguy pour persister dans son art au fil des décennies. Après le spectacle, on avait questionné Anaïs Muller, 37 ans, qui vit avec Par Autan sa première expérience avec le théâtre du Radeau. Participer à l’élaboration du spectacle - six mois de répétitions sur place quand la plupart des spectacles se bouclent en trois semaines - fut comme «d’entrer dans un poème», «l’esprit de Tanguy». Vivre sur place, s’imprégner des lieux, faire même l’expérience de l’ennui collectif et en tout cas d’une certaine lenteur, furent pour elle l’une des voies d’accès au metteur en scène. Le maître mot, nous avait-elle confié était «en douceur». Douceur des déplacements, de la cavité de la voix, de cette plongée sensorielle. Un ami de François Tanguy nous avait expliqué que le metteur en scène préférait répondre aux questions en proposant des livres. Mais pas forcément immédiatement, il prenait son temps avant d’apporter un volume, qui lui semblait plus adéquat que tout ce qu’il pourrait dire. On avait cherché ensuite dans les archives du journal des entretiens avec le metteur en scène, et l’on avait fait chou blanc. Ce même ami nous disait qu’en tournée, François Tanguy avait coutume d’habiter et dormir dans les théâtres qui accueillaient sa pièce, décors ou loge. Il y reste. Par Autan, du 8 au 17 décembre au T2G à Gennevilliers, et du 6 au 14 janvier au TNS à Strasbourg.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...