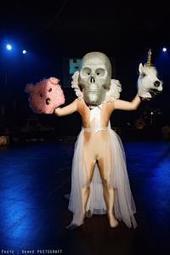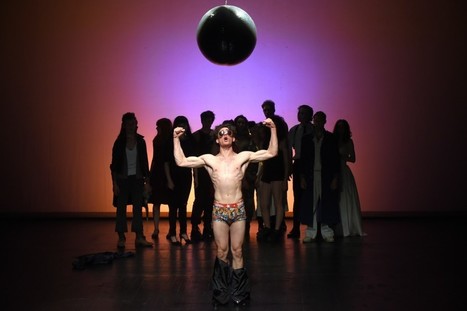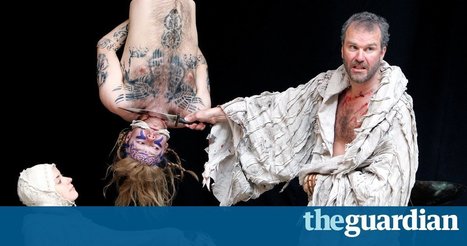Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2016 4:00 PM
|
Par Par Cyriel TARDIVEL pour Théâtrothèque
Quand le monde du cirque rencontre celui de la cybernétique, il se crée un troisième univers, celui de ''Hentaï Circus''.
Le Japon, à l’autre bout du monde. Des traditions ancestrales et une culture riche. Les Japonais, inventeurs et précurseurs, ont également créé un autre monde, parallèle au nôtre, celui de la cybernétique. Le développement informatique et des nouvelles technologies ont transformé leur pays, leur vision du monde, leurs habitudes, les relations entre eux. Depuis plusieurs années, se déroule la "Japan Expo" à Paris et, avec le temps, son succès va grandissant ; mais que connaissons-nous vraiment des nouvelles mœurs japonaises ?
Karelle Prugnaud nous offre un petit aperçu de cette culture extrême avec sa nouvelle création Hentaï Circus. Elle s’entoure de circassiens, de musiciens, de performeurs et d’une tatoueuse également, un melting-pot d’artistes pour nous offrir ce voyage à travers le Japon modern hyper connecté. Une découverte par les cinq sens.
C’est au travers des recherches sur la toile et des fantasmes d’un Otaku (geek no-life), que la découverte commence. A la manière d’Alice tombée dans le terrier, le public est aspiré dans une spirale de folie et de délire mêlant mangas, sexualité, enfance, cyber, transformation, poulpe (animal très apprécié et incontournable de la culture japonaise moderne), punk/rock, zentaï (combinaison de latex ou lycra)... Ici, les motos s’envolent, les hommes mûrs se transforment en "dollers" et exécutent des danses kawaïs, la piste s’enflamme, des poupées apparaissent...
Les artistes féminines sont étonnantes. Elles enchaînent les costumes et les prouesses, repoussant de nombreuses limites. Sylvaine Charrier offre un numéro de contorsion marquant accompagné d’un poulpe. Myriam Laurencin, affublée d’une énorme tête de poupée et de chaussures compensées, se lance dans un numéro aérien de corde époustouflant. Daphné Millefoa incarne "Princesse Caniche", toute de rose vêtue, elle est en quelque sorte la maîtresse de cérémonie de ce cabaret si particulier. Sa fraîcheur et sa joie de vivre sont communicatifs.
Les hommes ne sont pas en reste. Stéphane Depot vole littéralement sur ses motos. Chacun apporte son engagement profond au spectacle, donnant de soi et brisant les barrières de la bienséance française. C’est fou et rafraîchissant à la fois. Certains passages sont particulièrement étonnants et marquants. Les dollers sont à la fois touchants et dérangeants ; les vidéos hentaï projetées sur l’écran en fond de scène sont inhabituelles sur les scènes de cirque ou de théâtre...
Oui, c’est un mélange d’étonnant, mais une belle alchimie entre les textes d’Eugène Durif, la mise en scène de Karelle Prugnaud, les musiques de Bob X et Géraud Bastar, et les vidéo de Bob X, Karelle Prugnaud et Marie Chatte. Ça bouge, ça secoue, on ne peut rester de marbre. Et puis, bien loin d’être dans un fantasme salace ou malsain, l’approche de cette culture japonaise par la création du spectacle Hentaï Circus est une proposition de découvertes et de réflexions sur cet univers. Pourquoi certaines personnes aiment-elles se transformer en poupée rose ? Pourquoi une telle fascination du poulpe ? Pourquoi certaines personnes se coupent-elles complètement du monde extérieur et passent-elles le reste de leur vie derrière leur écran sur des jeux en réseau ?
Pure folie ?! A y regarder de près, pas tant que ça. Un besoin urgent d’amour et une profonde, une très profonde solitude. Les otakus s’enferment dans leur monde virtuel car ils souffrent de notre monde difficile et très égoïste ; se créant ainsi leur zone de confort. On ne peut pas être blessé dans un rêve, tout y est possible et personne ne peut vous juger.
Un spectacle réussi à bien des égards. Une troupe soudée et motivée. Beaucoup de poésie. Un partage, un échange entre les artistes et le public. Ne jugeons pas, découvrons, observons et essayons de comprendre.
Hentaï Circus Cirque Electrique (PARIS)
Textes d'Eugène Durif Mise en scène de Karelle Prugnaud Avec Sylvain Charrier, Antonin Boyot Gellibert, Alain Claudinon, Stéphane Depont, Géraud Bastar, Frank Desmaroux, Myriam Laurencin, Daphné Millefoa, Karelle Prugnaud, Pascal Sandoz, Oriane Aka Tannuki (tatouage), Mayumi Shimizu (à l'écran)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2016 8:41 AM
|
Entretien par Sandrine Blanchard dans Le Monde
Je ne serais pas arrivé là si…
… Si je n’avais pas chanté « moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier » à la communion de ma sœur. Je devais avoir quatre ans, j’étais un enfant timide, je suis monté sur la table avec le trac et j’ai eu beaucoup de succès, on m’a applaudi. Après, je suis allé faire la sieste, épuisé et heureux. Puis j’ai essayé de renouveler ce moment-là, de me préparer avec la peur au ventre, et de la faire disparaître dans le plaisir sensuel de la scène.
Dans votre village normand de Saint-Georges-des-Groseillers, vous étiez dans un tout autre environnement. Une mère garde-barrière, un père sous-chef de gare, personne ne faisait ce métier…
Non, mais on pouvait voir Fernand Raynaud à la télé. J’avais plein d’incapacités : pour le sport, le bricolage, etc. Je ne m’exprimais pas très bien, mais je sentais que le langage m’intéressait. J’aimais beaucoup, môme, écrire des rédactions. Je me rêvais parlant mieux que je ne parlais.
Votre père vous a mis à l’école « chez les curés ». Pourquoi ?
Un jour, il a surpris mon frère à 14 h 30 dans les rues de Flers, sortant d’un bistrot ou de je ne sais où. Alors il s’est dit : « maintenant, ils vont aller chez les curés parce que c’est plus sérieux ». Mon père voulait qu’on ait une meilleure situation que lui ; il avait arrêté l’école à 13 ans, souhaitait qu’on fasse des études. Il croyait beaucoup à l’ascenseur social.
A quel moment avez-vous dit à vos parents : j’ai envie d’être comédien ?
Je l’ai gardé pour moi très longtemps. Mais je faisais des spectacles en amateur. A priori, ma mère aurait préféré que je travaille au Crédit agricole et que je fasse du théâtre le soir, juste pour m’amuser avec des copains. J’ai fait une maîtrise de lettres à Caen, et Robert Abirached, directeur de l’institut d’études théâtrales, était mon directeur de thèse. Je me rapprochais du théâtre.
De quelle manière le milieu populaire, dont vous êtes issu, vous a-t-il nourri ?
C’est constitutionnel. Je me sens légitime quand je suis sur scène, parce que c’est le résultat d’un travail, d’une recherche, mais j’ai toujours l’impression de venir du public. Je ne suis pas un enfant de la balle. Ce n’était pas si naturel que cela que je sois là, et en même temps, c’est une volonté farouche. La logique aurait voulu que, ayant monté dans l’ascenseur social, je devienne prof de français. Lors de mes spectacles en amateur, je ressentais une vraie passion. Mais souvent, je comprends mieux les pièces avec mes pieds qu’avec mon cerveau.
C’est-à-dire ?
Je dois me battre avec la langue, avec les mots. C’est lorsque je mets un pied sur un plateau que je comprends le texte.
De quoi parlait le premier sketch que vous avez écrit ?
C’était « dubillardesque », absurde. J’étais un prof de théâtre autoritaire et un peu fou qui n’arrêtait pas d’interrompre l’élève comédien en lui répétant sans cesse : « Quand je dis rien, c’est que c’est bien », « quand je dis rien, c’est que c’est bien. »
D’où vient ce goût pour l’absurde ?
Quand j’étais petit, j’écoutais les contes de Gérard Sire, qui flirtait parfois avec le surréalisme, ou les sketchs de Bernard Haller. Dans l’un d’eux, un personnage montait un escalier. Plus il montait, plus il se rendait compte que les marches étaient hautes. En réalité, les marches n’étaient pas plus hautes mais étaient des lames de rasoir. Plus il montait, plus il rapetissait. J’adorais ce truc-là. J’aime aussi Dubillard, un grand auteur parce qu’il y a un mystère dans sa langue. Quand on le lit, on est paumé. Quand on le joue, tout d’un coup ça remplit l’espace et l’imaginaire. On est sur un nuage, dans un univers hyperpoétique, parce qu’il y a un mystère sur ce qui déclenche le rire.
Vous avez souvent dit avoir eu « l’audace », après votre maîtrise de lettres à Caen, de concourir à la rue Blanche. Pourquoi « l’audace » ?
L’audace, c’était d’avoir envie de faire partie d’un autre monde ; dans lequel je n’avais aucune relation. Il y avait trois écoles nationales gratuites, ce dernier aspect avait son importance parce que mes parents n’étaient pas très fortunés : la rue Blanche, Strasbourg et le Conservatoire. Strasbourg me paraissait trop loin géographiquement et le Conservatoire trop loin socialement. La rue Blanche me semblait plus accessible, et des gens que j’aimais y étaient passés : Guy Bedos, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Serrault. J’ai eu la chance que Brigitte Jaques me repère parmi les élèves comédiens qui cherchaient à entrer dans cette école, et qu’elle ait envie de s’entourer de gens plus âgés que d’habitude, avec des personnalités peut-être déjà un peu plus accomplies. Quand j’ai été reçu à la rue Blanche, ma mère était en larmes. Inquiète, elle disait : « il va rater sa vie ». Pour elle, c’était beaucoup moins sûr que des écoles commerciales.
A Paris, avez-vous ressenti un décalage social, avez-vous eu un temps d’adaptation ?
Je n’ai jamais joué au Parisien. J’avais une lenteur dans le phrasé, lié à ma province. Etre associé à une image provinciale ne me gênait pas ; la force de chacun, c’est son histoire. Lorsque je retourne du côté de Saint-Georges-des-Groseillers voir ma mère, je retrouve une grande pudeur chez les gens. Cette manière de parler, de dire les choses, elle est en moi. Lors d’un de mes premiers spectacles professionnels, on m’avait demandé de prendre un accent rural. J’ai pris mon accent normand – celui que j’utiliserai plus tard dans les Deschiens – et j’ai été retenu parce que cet accent avait une vérité.
Qu’est-ce qui a le plus joué dans votre itinéraire ?
L’entêtement personnel, l’envie de se dire on va y arriver quoi qu’il arrive.
Vous avez douté par moments ?
Pas tant que ça. Lors d’un stage à la Sacem, un fonctionnaire m’avait dit que j’étais bon auteur, mais que je ne serais jamais comédien. J’étais persuadé du contraire. J’ai cru en moi dans la longueur en me disant qu’un jour ça le ferait. A 25 ans, je n’avais pas un physique qui me permettait de dire « il faut que je travaille dans les cinq ans qui viennent, parce qu’après je serai vieux ! » Je voulais vraiment faire l’artiste, écrire et jouer. Ce n’était pas tant être connu que d’occuper mes journées à cela.
En 1989, vous intégrez la troupe de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps. Que retenez-vous de cette période ?
Je ne serais pas arrivé là où j’en suis si je n’étais pas allé voir un spectacle de Jérôme Deschamps, Les petits pas, qui m’avait bouleversé, enthousiasmé et donné envie d’entrer dans sa troupe. J’y ai appris une exigence sur le rire et le besoin d’imagination du public. J’ai toujours en tête une phrase que j’adore, que Michel Bouquet disait à ses élèves du conservatoire : « N’oubliez pas que le public ne vient pas vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. »
Quels sont vos souvenirs les plus forts de cette troupe, dans laquelle vous êtes resté dix ans ?
Une grande liberté d’invention et une forme d’inconscience liée au groupe. On avait un certain culot. Par exemple, nous jouions dans la cour du Palais des papes à Avignon, enfermés dans des petits placards. Dans une scène, Olivier Saladin venait frapper à la porte et je lui ouvrais. Un soir, je n’ai pas ouvert. Il refrappe, je n’ouvre pas, il frappe une troisième fois et je lui dis : « J’étais au fond, je ne vous avais pas entendu. » Cela a déclenché un fou rire. Avec Yolande Moreau, Bruno Lochet, etc., on venait tous d’un milieu populaire, et nous étions regardés par quelqu’un qui, lui, ne venait pas de ce milieu. Et puis Jean-Michel Ribes a eu aussi un rôle essentiel. Je l’ai rencontré en 1988, pour la série « Palace ». Il m’a donné confiance comme auteur.
Vous êtes devenu connu du grand public à la quarantaine, grâce aux Deschiens sur Canal+. Il y a un avant et un après…
La notoriété est arrivée collectivement, on se protégeait les uns les autres. Si l’un était devenu prétentieux, il se serait fait vanner par les autres. En tant que Monsieur Morel, personnage que j’avais créé pour Les Deschiens, j’étais le meilleur. Alors qu’en tant qu’acteur je ne le suis pas. J’avais été très fier de tourner un film avec Lucas Belvaux. Je faisais la couverture de la revue Positif ! Il y avait six pages sur la trilogie de Lucas Belvaux. Je vois mon nom et juste un mot : François Morel, entre parenthèses, « décevant » ! Cela m’a remis à ma place immédiatement. Quoi faire après Monsieur Morel ? C’était un peu compliqué. J’ai eu envie d’arrêter. Je ne voulais pas gérer un seul personnage jusqu’à la fin de ma vie et m’ennuyer. Maintenant, on me parle davantage de mes chroniques sur France Inter que des Deschiens. Cela me plaît bien, parce que c’est plus récent. Cela veut dire que je suis toujours un peu dans la vie !
L’envie de faire rire, elle vient d’où ?
A mon rapport au monde, à ma façon d’être en classe, où j’avais tendance à faire rire. A une volonté d’exister, de séduire. Mais en restant soi-même. Je suis assez laconique. Les chroniques, les chansons, ça me va bien !
Votre absence de cynisme, de méchanceté, votre volonté de donner du courage aux gens, c’est parce que l’époque est dure ?
Oui, quand même, l’époque n’est pas facile. Individuellement, les gens ne vont pas si mal que cela, mais il y a une forme de désespoir collectif. On entend : « Moi ça va, mais le monde est difficile. » Je n’ai pas envie de rajouter du cynisme. J’aime que les gens repartent d’un spectacle un peu plus légers. Le prochain s’appellera : La vie, titre provisoire. Je ne suis pas un Guy Bedos. Parler de Sarkozy ou Hollande ne me passionne pas suffisamment, alors que les petites choses de la vie, la manière de s’en sortir, d’être des gens bien malgré tout, tout cela me passionne. Le courage des gens me touche, j’ai envie de le valoriser, de le partager, même si le positif n’est pas très à la mode.
Vous évoquez aussi souvent le temps qui passe…
C’est quelque chose qui m’émeut. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu’on va au théâtre aussi pour se consoler face à notre angoisse de l’inéluctable. Les spectacles qui m’ont le plus bouleversés dans ma vie parlaient de cela : La Cerisaie de Tchekhov, montée par Peter Brook, et Les petits pas de Jérôme Deschamps.
Votre père était cheminot et cégétiste. Quel regard portez-vous sur le mouvement social actuel ?
Cette colère diffuse ne vient pas de nulle part. On mène les gens en bateau, c’est cela qui est insupportable et qui fait complètement partir la confiance. Lorsqu’on se fait élire, il faut un programme. Si on n’arrive pas à le respecter, il faut démissionner. Sinon on déçoit trop. La loi travail, je ne l’ai pas lue, mais il me semble que ceux qui écrivent les lois sont loin de la réalité des gens.
Vous êtes souvent en défense du peuple de gauche ? C’est familial ?
Oui, sûrement. C’est ma culture, et je n’ai pas envie de faire le malin. La critique du politiquement correct m’agace un peu : effectivement, je suis contre le racisme, l’homophobie ; effectivement, je considère importantes les notions de solidarité et de justice. Et je trouve cela bien d’être comme cela.
Votre maman, qui pleurait quand vous êtes entré à l’école de la rue Blanche, maintenant que dit-elle ?
Elle est fière. Mais parfois elle est gênée. Dans un spectacle, je disais régulièrement : « J’encule le chat ». Le poème se terminait par : « Mon affaire accomplie, je reviens au jardin, l’air serein, retrouver ma maman qui tricote. Que faisais-tu mon fils ? Que faisais-tu dis-moi ? Rien maman, je rêvais et j’enculais le chat. » Elle n’avait pas tellement aimé ! Une autre fois, j’avais fait une chanson qui disait : « Papa, comment qui va rentrer papa ? Sera-t-il saoul, ou ne sera-t-il pas ? » Elle n’avait pas spécialement aimé non plus…
Cette chanson rappelait de mauvais souvenirs ?
Oui. Pour tout le monde.
On se dit quoi, quand on voit revenir son père titubant à la maison ?
Que le monde des adultes n’est pas sûr. J’ai écrit cette chanson parce que ma sœur me racontait qu’elle avait encore, à 60 ans, des angoisses la nuit, en se souvenant des parents qui s’engueulaient. C’est quelque chose qui peut accompagner toute une vie.
Vous avez eu besoin d’en parler en chanson…
Oui. Je me débarrasse de tout sur scène.
Propos recueillis par Sandrine Blanchard
« Le billet de François Morel », tous les vendredis à 8 h 55 sur France Inter
La vie, titre provisoire, du 4 octobre au 6 novembre au théâtre du Rond-Point à Paris, spectacle musical. Sortie de l’album de chansons le 30 septembre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2016 8:03 AM
|
Par Benjamin Locoge dans Paris Match | Publié le 18/06/2016 à 02h00
Considéré comme l’un des plus grands metteurs en scène européens, le directeur de la Schaubühne de Berlin présente à l’Odéon une version très dépouillée de « La mouette ».
Paris Match. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps avant de vous attaquer à Tchekhov ?
Thomas Ostermeier. Je n’en voyais pas l’intérêt par rapport à notre société contemporaine. Mais je suis tombé sur une citation de Tchekhov lui-même, à la suite de son voyage sur l’île de Sakhaline, l’île des prisonniers où il a vu la misère de la Russie. C’était une entrée en matière parfaite pour son œuvre. Car de manière générale il ne parle pas de la situation sociale ou politique dans ses pièces. Dans “La mouette”, il évoque avant tout l’ennui d’une petite colonie de vacances composée d’intellectuels et de bourgeois réunis au bord d’un lac. Il montre combien c’est ridicule de se comporter de cette façon face à la misère du monde. Cela avait une vraie résonance avec l’actualité.
Etiez-vous satisfait du résultat ?
Plutôt, oui. Mais la peur – qui n’est pas une bonne chose pour être créatif – joue un rôle majeur dans ce processus. Les comédiens ont peur d’aller sur scène, peur de ne pas réussir, peur de n’être pas complètement ouverts, de se cacher derrière l’idée d’un personnage. Cette peur existe moins lors des répétitions. Le véritable enjeu est de reconstruire ce que l’on a réussi en répétitions sans tomber dans la routine. Cela veut dire rester vivant, être à la recherche.
Pourquoi refusez-vous l’étiquette d’un théâtre engagé ?
Parce que ce n’est pas forcément ma vision du théâtre. Je me suis rendu compte que ce qui m’intéresse est de rester proche de mes propres passions. Je ne peux pas parler pour les autres, parce que je ne les connais pas. Je préfère m’interroger sur moi-même et sur mes propres défauts ; aussi bien au niveau politique que dans l’intimité. Et je questionne aussi la mort.
Quand je vois la beauté, je pense au moment où elle va disparaître
“La mort, c’est la véritable humiliation”, avez-vous coutume de dire…
Oui, je dois porter une mélancolie en moi... La mort rôde, elle peut arriver tous les jours, à n’importe quel moment. C’est tout sauf une question d’âge. C’est quelque chose que l’on retrouve tout le temps quand on regarde la nature ou la beauté. Quand je vois la beauté, je pense au moment où elle va disparaître.
Dans cette perspective, n’est-ce pas vain d’aller sur scène ?
Face à la vanité de la vie, le théâtre est la seule forme d’art qui soit plutôt sincère, parce qu’elle meurt tous les soirs. Le cinéma reste, tout comme la peinture, la musique ou la littérature. Pas le théâtre : il est vivant pendant deux heures et après, c’est fini. On ne peut pas le retrouver. Surtout pas dans les captations de télévision.
Vous parlez de Berlin comme d’une ville “embourgeoisée et où l’on s’ennuie”.
C’est ce que je ressens. Mais Paris est encore pire ! [Il rit.] Sur le plan culturel, nommer l’ancien patron de la Tate Modern de Londres à la Volksbühne est une décision que j’ai du mal à comprendre. C’est un mauvais signal pour l’avenir. L’idée que le théâtre est interdisciplinaire ou performatif est ridicule. Depuis plus de soixante ans déjà, on la pratique à la Schaubühne, avec Sasha Waltz, et aujourd’hui encore, en travaillant avec Romeo Castellucci, Katie Mitchell, Milo Rau, Falk Richter…
Quels endroits vous intéressent ?
Istanbul, avant les attentats, était une ville assez forte. Aujourd’hui, Belgrade m’intéresse. A Bogota, j’ai vu la compagnie colombienne Mapa Teatro, et c’était magnifique. Du coup, j’essaie de les faire venir à Berlin. Mais ce qui m’interpelle le plus ce sont les villes asiatiques où l’on joue beaucoup, à commencer par la Chine. Si je parlais la langue, c’est l’endroit où je m’installerais pour travailler. On y est bien loin de la mélancolie européenne.
Y a-t-il des auteurs qui vous font encore peur ?
Tchekhov ! J’ai l’impression que mon spectacle actuel n’est qu’un premier essai. Il reste un auteur difficile. C’est à la fois le rien, l’absence d’actions, de mouvements et en même temps chaque personnage vit des drames intimes. Alors comment représenter cela ? Ça reste une question passionnante… Mais celui qui me fait le plus peur et qui m’intéresse le plus reste Shakespeare.
« La mouette », théâtre de l’Odéon, jusqu’au 25 juin. A lire : « Le théâtre et la peur », de Thomas Ostermeier, éd. Actes Sud, 160 pages, 15 euros.
Photos : Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin. Julien Weber

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 6:11 PM
|
Communiqué SACD du 13/06/2016.
Processus Cirque 2016 : les nouveaux lauréats.
Dans le cadre de son action culturelle, la SACD a créé en 2014 en partenariat avec l’Académie Fratellini, un nouveau dispositif de soutien à la recherche et la création dans le domaine des Arts du cirque intitulé « Processus Cirque ». Ce dispositif a pour objet d’aider à la création d’œuvres originales de cirque initiées par des auteurs de cirque qui vont à la rencontre d’autres disciplines telles que la danse, les arts de la rue, la musique ou le théâtre.
Réuni le 1er juin, le jury de la commission Processus Cirque présidé par Jérôme Thomas, auteur jongleur administrateur cirque SACD, était composé de Marc Fouilland (CIRCA-Auch), Stéphane Simonin et Valérie Fratellini (Académie Fratellini), Martin Palisse (Le Sirque/Pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin), Yveline Rapeau (La Brèche Pôle national des arts du cirque de Cherbourg/Cirque théâtre d’Elbeuf), Stéphane Ricordel (Le Monfort à Paris), Julien Rosemberg (HorsLesMurs).
Le jury a sélectionné 9 projets :
Vincent Berhault pour Entre, Cie Les Singuliers
Clément Dazin pour Humanoptère, La Main de l’Homme
Raphaël Navarro et Clément Debailleul pour Wade in the water, Association 14:20
Célia Casagrande-Pouchet et Sarah Devaux pour A nos fantômes, Cie Menteuses
Jonathan Fenez, Anthony Moreau, Jérôme Hoffmann et Sébastien Le Guen pour Masse critique, Lonely Circus
Jonathan Guichard pour 3D, CIRCa Auch Gers Pôle national des arts du cirque
Chloé Moglia pour Ose, Cie Rhizome
Anna Rodriguez pour Comme ça et tel quel, Idem Collectif
Luna Rousseau et Nathan Israël pour Laboratoires – Le jardin des délices, Le jardin des délices (Production La Scabreuse)
Les compagnies lauréates du dispositif reçoivent une bourse de 5000 euros dont l’objectif est le financement d’un temps de recherche et de création pour une durée d’un an.
À l’issue de cette période, en juin 2017, les auteurs pourront proposer en coproduction avec la SACD, dans le cadre du festival « Les Impromptus » de l’Académie Fratellini, une maquette, un extrait de l’œuvre créée ou l’œuvre complète, si celle-ci est achevée.
Les Lauréats de l’édition 2015 présentés à l’Académie Fratellini du 2 au 10 juin 2016
Les 8 lauréats Processus Cirque 2015 étaient présents dans le cadre des « Impromptus » du 2 au 10 juin à l’Académie Fratellini :
¨ Marine Mane pour A mon corps défendant, Cie In Vitro/Association la Tramédie
¨ Antoine Rigot et Patrick Vindimian pour Etoile-Mat, Cie Les Colporteurs
¨ Boris Gibé pour L’absolu Cie Les Choses de Rien
¨ Rafael de Paula pour Nebula, Cie du Chaos
¨ Rémi Darbois, Julien Clément et Nicolas Matis pour Nuit, Collectif le Petit Travers
¨ Kitsou Dubois pour Recherche cirque capteurs et spatialisation du son, Cie Ki Productions
¨ Laurent Chanel pour To fall is to understand the universe, Cie A.R.N
¨ Laurent Barboux, Michèle d’Angelo, Jeanne Ragu et Pauline Barboux pour Trait d’Union, Association L’Envolée

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 2:39 PM
|
Nous nous sommes rendus cette semaine au cirque Romanès (Square Parodi, Paris XVI). L’accueil incroyable que nous ont réservé Delia et Alexandre nous pousse aujourd’hui à publier cet appel à l’aide. Le cirque est aujourd’hui mis en difficulté par un voisinage clairement hostile et un climat général délétère.
Chers amis,
Entre les attaques racistes, dont nous sommes victimes depuis septembre 2015 et les terribles conséquences des attentats de Paris du 13 novembre sur la fréquentation des salles de spectacle, le Cirque Tzigane Romanès est menacé de disparition !
Aujourd’hui c’est un cri de détresse que je lance, car dans cette période de sinistrose aiguë, il est vital pour nous tous que le partage, la joie de vivre et la liberté soient préservés. Le cirque Romanès, qui en est l’un des fleurons, est menacé.
Aujourd’hui, notre petit cirque est en danger à cause de certains riverains du XVIème arrondissement de Paris. Nous sommes dans un endroit clairement hostile aux Tziganes !
Nous continuons le combat pour faire connaitre notre culture, encore méconnue aujourd’hui.
Vous nous avez toujours soutenus, j’espère avoir encore votre soutien pour nous aider à sortir de cette impasse, car vous êtes notre principale défense !
C’est la première fois que nous lançons une campagne d’appel aux dons, en espérant attirer l’attention d’un grand nombre d’hommes et de femmes.
Pour remettre en état le cirque et pouvoir continuer à faire nos spectacles, nous avons besoin de 60.000 €. Plus vite nous atteindrons notre objectif, plus vite nous pourrons repartir du bon pied !
En France, il y a plusieurs façons de faire du cirque, et c’est très bien comme ça, mais il y a seulement quelques cirques qui sont uniques ! Le Cirque Romanès en fait partie ! Et c’est le seul Cirque tzigane qui existe en Europe…
Si nous devons disparaître – car le risque existe – , personne ne pourra prendre notre place, car nous venons de loin et ce que nous sommes ne s’apprend pas dans une école. Malgré toutes les tempêtes que nous les Tziganes avons traversées, notre force est notre joie de vivre.
Nos chants portent le témoignage douloureux d’un peuple toujours méprisé, nous luttons contre vents et marées pour garder notre culture et notre âme. La richesse de la culture française, c’est sa diversité. Le Cirque Romanès fait partie du patrimoine culturel français.
Merci d’avance pour l’attention que vous nous portez,
Merci de partager, diffuser l’information à vos réseaux.
Merci d’avance pour votre générosité, pour votre solidarité et surtout pour votre bienveillance.
Que Dieu soit avec nous tous !
Je vous embrasse avec le cœur,
Délia Romanès
La campagne d’appel aux dons est ouverte sur HelloAsso. SAUVONS LE CIRQUE ROMANES – L’Unique Cirque Tzigane au Monde !
Lieu du spectacle :
Chapiteau du Cirque Tzigane Romanès
Au Square Parodi, en face du 31 Bd de l’Amiral-Bruix
A Porte Maillot (Paris 16) Métro : Porte Maillot (Ligne 1 – sortie 5)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 8:43 AM
|
Par Gilles Renault dans Libération
Au Théâtre du Rond-Point, Guillaume Vincent et l’actrice Emilie Incerti Formentini explorent sans pathos la vie intérieure d’une femme bipolaire.
Un monologue lucide.
«En commençant le travail, nous n’avons jamais cherché à imiter ou à incarner, nous avons cherché la place, la distance juste. Nous étions très loin de l’incarnation quasi simiesque des acteurs de biopics… Ce fut un travail de direction d’acteurs très particulier et qui s’est vraiment fait à deux. Moi, connaissant, si je puis dire, la vérité, et elle [la comédienne Emilie Incerti Formentini, ndlr], l’inventant, la recréant.» Ainsi, dans sa note d’intention, le metteur en scène Guillaume Vincent résume-t-il la manière dont il a abordé Rendez-vous gare de l’Est, créé fin 2012 à la Comédie de Reims et actuellement à l’affiche du Théâtre du Rond-Point : en établissant le lien artistique entre deux femmes, l’une comédienne dans l’exercice de ses fonctions, l’autre pas, physiquement absente, parlant d’une seule et même voix sans s’être jamais rencontrées.
Complicité
Passé, entre autres, par l’école du Théâtre National de Strasbourg, Guillaume Vincent connaît dans son entourage proche une femme bipolaire avec qui il va mener toute une série d’entretiens durant lesquels elle évoque son quotidien, sans dramatisation, ni faux semblants (à l’instar de la réalisatrice italienne Caterina Profili, dont le superbe docu Etoile bipolaire, tiré de son expérience personnelle, vient d’être diffusé sur Arte - et reste accessible en rediffusion). En compilant ces témoignages étalés dans le temps, l’homme de théâtre se retrouve non pas avec un bilan clinique (tel n’est pas son dessein) mais avec un aussi simple qu’extraordinairement complexe portrait de femme, dont il va «réécrire fidèlement la parole, en réorganisant parfois l’ordre, sans rien changer». D’où l’idée de comparer son travail à «celui d’un monteur».
Le thème de l’enfermement, au propre comme au figuré, n’est pas étranger à Guillaume Vincent, lui qui a jadis joué (sous la direction d’Hubert Colas) dans 4.48 psychose de Sarah Kane, et qui cite en référence Paroles prisonnières de Raymond Depardon, un ouvrage publié en 2004 mêlant en textes et en images le dialogue entre prévenus et magistrats, dans un contexte de «misère ordinaire».
Renvoyant à une vie intérieure passablement tourmentée, sinon dévastée, Rendez-vous gare de l’Est possède le mérite inverse d’une infinie clarté. Assise sur une banale chaise, au beau milieu d’un plateau délesté de tout accessoire qui risquerait de parasiter l’attention, il y a donc là la comédienne Emilie Incerti Formentini, dont dix années de compagnonnage avec l’auteur et metteur en scène ont dû forger une solide complicité. Les lumières ne sont pas éteintes dans la salle qu’elle commence à se raconter à la première personne. Or, si l’évocation d’une «petite nièce», de sa «vie de couple très très forte» ou de ses problèmes de poids paraissent renvoyer au quotidien de tout un chacun, la prose s’éloigne assez vite des berges de la normalité, sans jamais en faire tout un fromage. Ainsi, quand elle précise avoir «90% de chances d’aller à l’hôpital, si j’arrête les médicaments». Pourtant, sa langue n’est pas pâteuse, elle qui sait également manier l’humour au détour de telle ou telle remarque douloureuse, du style: «Je ne sais pas si je retournerai dans un hôpital psychiatrique, maintenant qu’on n’a plus le droit de fumer.»
Folle réalité
Monologue lucide, qui ne confond pas pesanteur (une heure à peine) et densité (mise en scène parcimonieuse), Rendez-vous gare de l’Est questionne, réfutant toute attitude péremptoire, quand la malade fait observer que «le monde n’est pas rationnel». Ou soumet à la réflexion collective : «Qu’est ce que c’est vraiment, la folie ?»
Pas de doute, la capsule appartient bien à la sphère théâtrale. Mais la réalité n’en reste pas moins connexe. La nuit tombe tard à cette époque de l’année et, côté cour, sur la scène de la petite salle Roland-Topor, on devine à travers une fenêtre qui n’a pas été obturée la vie qui défile en contrebas de l’avenue des Champs-Elysées.
Gilles Renault
Rendez-vous gare de l’Est Texte et m.s. Guillaume Vincent. Théâtre du Rond-Point, 75008. A 20 h 30. Jusqu’au 26 juin. Rens. : www.theatredurondpoint.fr
Photo G. Cittadini. Cesi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 8:00 AM
|
Par Aurélien Bouron dans toutelaculture.com
Du 14 au 18 juin, le théâtre de l’Union de Limoge organise pour la 1ère édition le festival « L’union des Ecoles », sous la direction de Jean Lambert-Wild, et regroupe six écoles internationales, de France, de Suisse, de Géorgie et de Côte d’Ivoire. Ce sont donc des étudiants comédiens aux cultures qui diffèrent mais se complètent qui se retrouvent sur les planches limousines pour six pièces sur trois jours. Must Go On de Nathalie Fillion a fait l’ouverture du festival et donne le ton.
Ils sont 14 à devoir se partager les mots, les chants et les mouvements. Must Go On a été écrite il y a des années mais a été adaptée pour correspondre aux traits de caractères de chaque étudiant comédien. De Limoges ou de Québec, ils sont sur une scène revisitée en discothèque. Une boule à facette, un podium pour accueillir le DJ, et de l’espace pour mettre en scène une folle nuit du samedi soir. Décor minimaliste pour une pièce du mouvement et de la performance.
Ils chantent, ils dansent, ils jouent, ils crient, ils meurent, ils bougent. Les apprentis comédiens délivrent au public une véritable démonstration de leurs multiples talents. Même le personnage du DJ se prête au jeu et remplace les platines par un beat box très réussi. La scène du théâtre de l’Union est suffisamment grande pour ces jeunes acteurs. Leurs mouvements, chorégraphiés par Jean-Marc Hoolbecq, occupent l’espace autant que notre esprit. La première partie est illustrée par le narcissisme et le « m’as-tu-vu » des personnages. « Dis-moi à quoi je ressemble », phrase répétée, tournée et détournée, résume bien tout cela. Le public rit, sourit, balaye la scène du regard espérant ne rien rater. Du mouvement à l’immobile, Nathalie Fillon, la metteure en scène va jusqu’à installer une symétrie à l’aide des deux jeunes québécoises. Dans une robe noire à pois rouges, elles se ressemblent et font le jeu du miroir à la perfection. Face à face, elles s’imitent et parlent en même temps jouant de leur accent d’outre atlantique.
Quand une jeune fille armée fait irruption dans cette discothèque, ce lieu de fête et de jeunesse, la pièce raisonne dans nos mémoires et dans l’actualité. L’ambiance change, la boule à facette descend et les réflexions sur la jeunesse, sur le théâtre, sur l’image de soi donnent une autre dimension à Must Go On. Les comédiens occupent la scène tour à tour contrastant avec la première partie, nous laissant explorer leurs personnages. Le rythme, alors élevé en première partie, a baissé, trop peut-être. Il y a des courts instants qui en deviendraient long, mais une fois la concentration portée sur les mots, on devient spectateur de la profondeur de la jeunesse. Sa recherche de la beauté, son refus de vieillir et sa peur, surtout, de se chercher et de se trouver. Le mythe de narcisse, élément sous-jacent de la pièce, cache tout cela.
Difficile de s’imaginer que la pièce a été écrite en 2005 lorsque l’on voit la portée très actuelle des propos. Le mouvement devient personnage à part entière pour illustrer cette jeunesse, la mort, cette frontière floue et sombre entre fiction et réalité. Nathalie Fillon arrive avec ses comédiens à apporter légèreté et rires à des réflexions troublées et troublantes.
Visuels: Tristan Jeanne-Valès ©

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 7:50 AM
|
« Télérama », le Centquatre-Paris et la Colline – théâtre national se sont à nouveau associés pour présenter la 8e édition d’Impatience, festival de jeunes compagnies de théâtre contemporain.
Pour cette édition 2016, un nouveau grand partenaire nous a rejoints : le Festival d’Avignon. Cette collaboration doit permettre de faire découvrir plus largement encore au public et aux professionnels des talents émergents. Ainsi, dès cet été, le Festival d’Avignon accueillera la compagnie qui a reçu le prix Impatience 2016. Initié en 2009 par Télérama et le Théâtre de l’Odéon, le festival Impatience 2016 s’est déroulé du 2 au 11 juin 2016 au Centquatre-Paris et à la Colline – théâtre national. Avec le soutien de la région Île‑de‑France, de la S.A.C.D., de l’Odia Normandie, de Spectacle vivant en Bretagne, de Réseau en scène Languedoc-Roussillon et l’O.A.R.A., Office artistique de la région Aquitaine.
Les lauréats 2016
Le prix Impatience est attribué à la Cie Man Haast pour Lotissement (Île‑de‑France). Le prix Impatience est décerné par un jury de professionnels et assure au spectacle primé une série de représentations au Centquatre-Paris, à la Colline – théâtre national, au Festival d’Avignon, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, à l’Apostrophe, scène nationale de Cergy‑Pontoise et du Val‑d’Oise, à l’espace 1789 de Saint‑Ouen, à la Loge à Paris, au Studio‑Théâtre de Vitry‑sur‑Seine, au Théâtre Louis‑Aragon à Tremblay‑en‑France, au Théâtre Populaire romand à La Chaux‑de‑Fonds en Suisse, au Canal-Théâtre du Pays‑de‑Redon.
Le prix du Public revient au collectif Le Grand Cerf bleu pour Non c’est pas ça ! (Treplev variation) (Languedoc-Roussillon – le spectacle est soutenu par l’agence régionale Réseau en scène Languedoc-Roussillon). Le prix du Public est décerné par vote du public.
Le prix des Lycéens est décerné à la Cie À tire-d’aile pour Iliade (Île‑de‑France). Pour la troisième année consécutive, afin de donner la parole aux jeunes d’Île‑de‑France, le Centquatre-Paris et la Colline – théâtre national, avec Télérama, ont renouvelé le prix des Lycéens décerné par 14 lycéens qui ont suivi l’aventure Impatience en ayant vu l’intégralité de la programmation. L’enjeu de ce prix est de favoriser l’émergence de la pensée lycéenne, au-delà des accompagnements menés par les enseignants ; un pont vers la nécessaire prise d’autonomie, dès le lycée dans la construction de leur parcours culturel personnel.
Impatience 2016 en quelques chiffres
8 spectacles et 20 représentations
146 artistes et collaborateurs présents sur le festival
100 % de fréquentation
2 883 places vendues
Le festival a accueilli 211 professionnels (programmateurs et journalistes)
Rappel des 8 compagnies sélectionnées à l’issue de l’appel à projet 2016
Cie Man Haast, Lotissement, texte Frédéric Vossier, mise en scène, scénographie, lumière Tommy Milliot
Cie Lyncéus, Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit, d’après les Yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Duras, mise en scène Lena Paugam
Cie À tire‑d’aile, Iliade, d’après Homère, mise en scène Pauline Bayle
Interpréludes, Théâtre, conception, mise en scène, direction musicale et travail vocal Marcus Borja
Collectif Le Grand Cerf bleu, Non c’est pas ça ! (Treplev variation) inspiré très librement de la Mouette de Tchekhov, mise en scène Laureline Le Bris‑Cep, Gabriel Tur, Jean‑Baptiste Tur
Collectif Mariedl, Homme sans but, d’après le texte d’Arne Lygre (traduction Terje Sinding), mise en scène Coline Struyf
La Camara oscura, Big Shoot, texte Koffi Kwahulé, mise en scène Alexandre Zeff
Cie L’An 01, ADN Acide désoxyribonucléique, de Dennis Kelly (traduction Philippe Le Moine), mise en scène Yohan Bret
Les lauréats 2015 étaient :
Prix du Jury et prix du Public : le collectif OS’O avec Timon/Titus, une écriture collective d’après William Shakespeare, mis en scène par David Czesienski. Timon/Titus sera programmé avec la Colline – théâtre national au Centquatre-Paris du 10 au 26 novembre 2016.
Prix des Lycéens : la Cie Coup de poker avec Nuit, écrit et mis en scène par Guillaume Barbot.
Les Trois Coups

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 7:17 PM
|
Rencontre féerique et poétique avec des mythes
Après avoir inauguré le Théâtre Claude Levi – Strauss en 2006, avec la mise en œuvre d’un épisode du Mahabharata, présenté par la suite au Festival d’Avignon 2014 avec le succès que l’on sait, le talentueux metteur en scène japonais Satoschi Miyagi, retrouve en résidence le Musée du Quai Branly à l’occasion de son dixième anniversaire. Avec une création spécifique, amorcée depuis plusieurs mois au Shizuoka Performing Arts Center qu’il dirige, qui se fonde sur les écrits posthumes de Claude Levi – Strauss publiés sous le titre L’Autre Face de la lune (Editions du Seuil ) dans lequel l’anthropologue et ethnologue ( 1908 – 2009) considère que la mythologie japonaise forme une variante d’une source mythologique issue d’Asie centrale qui se serait étendue en Amérique et en Europe. A partir de cette hypothèse, refusant une hiérarchisation des cultures, la troupe du Shizuoka a effectué un long travail de recherche aboutissant à une écriture collective à partir des légendes japonaises contenues dans les trois volumes du Kojiki ( Chronique des faits anciens par le conteur Hedia no Are, datée du VIIIème siècle) dont Le Lièvre blanc, épopée mouvementée, en plusieurs épisodes, entreprise par le kami (divinité) Okuninushi et ses quatre – vingt demi – frères en route pour Inaba avec pour objectif majeur des épousailles avec la belle princesse Yagami hime, qui ouvre sur de multiples rencontres avec les figures mythiques japonaises, associées à celles des Navajos, peuple amérindien d’Amérique du Nord, comme deux ponctuations de la civilisation.
Un spectacle total
Si pour la majorité des spectateurs parisiens non spécialistes, la rencontre avec ces mythes semble parfois sibylline - malgré un sur-titrage en français de la langue japonaise – il est facile de se laisser emporter par ce récit épique ponctué de poésie, de musiques et chansons, tant sa réalisation scénique est superbe. Elle utilise avec bonheur le jeu et les expressions sensibles et révélatrices des vingt six excellents comédiens – musiciens – danseurs, dont les corps, la gestuelle, la vitalité et les chorégraphies contribuent à créer un univers onirique. En prenant différentes identités et apparences avec des beaux masques de différentes dimensions, inspirés de ceux du IXème au XIIème siècle au Japon, des costumes et accessoires signifiants, associés aux ponctuations de percussions venues de divers horizons. L’ensemble constitue un magnifique livre d’images sonorisé, dont les pages se succèdent dans une fluidité, avec une précision et une cohérence adaptées. Pour son retour aux sources, Satoshi Miyagi fait preuve une nouvelle fois de sa maîtrise et de son originalité théâtrale ouverte sans frontières depuis ses débuts, dans une filiation d’esprit avec son maître Suzuki Tadashi, philosophe et metteur en scène.
Autour de ce spectacle, une journée d’étude et un atelier sont prévus avec la présence du metteur en scène et de chercheurs.
Photo Musée Quai Branly
Le Lièvre blanc d’ Inaba et des Navajos, conception et mise en scène Satoschi Miyagi avec le Shizuoka Performing Art Center, écriture collective Kubota Azumi avec la troupe, avec 26 comédiens et musiciens,. Musique Hiroko Tanakawa. Scénographie Junpei Kiz. Création costumes et masques Hayo Takahashi. Son Hisanao Kato. Accessoires Eri Fukasawa. Durée : 1 heure 45.
Théâtre Claude Lévi – Strauss / Musée du Quai Branly à Paris, jusqu’au 19 juin 2016. Réservation tel 01 56 61 71 72

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 2:55 PM
|
Le programme lancé par la Fondation d’entreprise Hermès en 2011, New Settings, connait sa 6ème édition. Un tournant se dessine vers un engagement plus large dans le soutien de la création artistique contemporaine.
L’aventure a débutée il y a six ans par le soutien de quatre projets. Aujourd’hui, la Fondation d’entreprise Hermès en accompagne treize: une avancée significative dans le mécénat, un engagement toujours plus avant pour le spectacle vivant et des arts plastiques. La maison n’est pas seulement en collaboration avec ces deux domaines, elle se met à la croisée des chemins et aide les artistes à la création. Il s’agit également de faire la promotion des artistes, d’aider à la diffusion. Ainsi, le programme s’inscrit dans la tradition lancée par la Fondation d’entreprise Hermès qui s’est donné deux missions: faire valoir le savoir-faire, la transmission, et la création.
Cette année encore partenaire, et ce, depuis cinq ans, le Théâtre de la Cité Internationale présentera cinq spectacles, dont Monumental de Jocelyn Cottencin, qui travaille sur le jeu de l’image et s’interroge sur sa composition dans une interaction avec le public. Man anam ke Rostam bovad pahlavan d’Ali Moni est un spectacle fondé sur une interaction avec une marionnette, dont le titre, un proverbe persan, est employé pour dénoncer l’usurpation qui peut être faite d’un succès. On découvre également le spectacle d’Ola Maciejewska, Bombyx Mori, qui instaure un regard critique sur la danse: là où le corps, comme sujet, est souvent séparé de l’objet, la pièce propose de penser ou simplement de voir, la robe dansante. Le 4ème spectacle présenté, Cutting the edge de WHS/Kalle Nio, crée un mariage entre magie et changement visuel, invitant le spectateur sur le chemin du rêve et de la poésie. Enfin, I wish I could speak in technicolor de Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Fanny Futterknecht s’interroge sur les états altérés de la conscience, aux moments où la perception rejoint la sensation.
Nouveau partenaire, le Festival d’Automne propose des représentations créées par des artistes innovants, qui cherchent à repousser les frontières entre les arts, où esthétique et éthique se rejoignent. Ainsi, Boris Charmatz y présentera son spectacle Danse de nuit. Il s’agit pour ce spectacle de sortir de son cadre, de se décloisonner, pour investir les espaces publics, tels que les cours. Dans la continuité de cette idée, on pense alors à Christian Rizzo qui animera la cour de l’Hôtel-Dieu le temps d’une nuit autour d’un travail de son et lumière.
Le Théâtre Nanterre-Amandiers présentera pour sa part deux spectacles, à savoir Welcome to Caveland!- La nuit des taupes et DGMFS (Dents, gencives, machines, futur et société) par Lili Reynaud Dewar où est présentée Memphis, ville américaine, symbole des conflits raciaux et sociaux. Le Théâtre de la Ville présentera Mettre en pièce(s) de Vincent Dupont au Théâtre des Abbesses. Enfin, la Fondation se fait partenaire avec la FIAF (French Institute Alliance Française) à New York, ce qui permet à des artistes labellisés New Settings de présenter leurs œuvres au public new-yorkais.
New Settings franchit une nouvelle étape par d’autres engagements: la Fondation soutient autre autres « Egalité des chances », qui permet à une vingtaine de jeunes une formation de théâtre, et deux projets de formation de danse et de théâtre dans les banlieues de Sydney et à Berlin. Par cette ouverture à un plus grand nombre de projets, la Fondation d’entreprise Hermès montre son attachement au milieu artistique, autant dans la création que dans la diffusion de ses œuvres.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 2:30 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog "Hottello"
Crédit photo : Brigitte Enguerand
Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully, mise en scène de Clément Hervieu-Léger, direction musicale et conception musicale du spectacle de William Christie
Créée par la troupe de Molière « pour le divertissement du Roi » le 6 octobre 1669 à Chambord, la pièce en trois actes de Monsieur de Pourceaugnac reprend quelques-uns des grands thèmes moliéresques : le mariage forcé, la cupidité et la médecine.
Venu de Limoges pour épouser la jeune Julie, le Limousin est la proie de Scribagni et Nérine, homme et femme d’intrigue payés par l’amant de la belle pour empêcher le mariage arrangé. Livré à une série de figures populaires – médecins, apothicaire, Picarde, Languedocienne, avocats, le provincial, perdu dans les rues de la ville, est victime d’un tournis diabolique, acculé à fuir Paris, travesti en femme :
« un hallali impitoyable contre la candide et monumentale bêtise » (Robert Jouanny)
Mais comme toujours chez Molière, la fable amuse et instruit son public en même temps : la caricature esquisse un portrait, une satire contre les mœurs du temps.
La province ou la région est exposée sur la scène – diversité des patois, des caractères, des attitudes et des manies ridicules : de qui est-on l’étranger ?
Sous un ton bouffon, Molière s’attaque aux institutions sociales – vénalité et friponnerie des gens de justice, précipitation des instructions criminelles…
La résonance actuelle de cette réalité n’en finit pas, en passant, de se déployer.
Et l’attaque contre les médecins bat son plein – ignorance, cupidité, esprit de routine.
Sous la forme d’une comédie qui fraie du côté de la farce, inspirée de canevas italiens et agrémentée de musique et de danse, Monsieur de Pourceaugnac est une pièce sombre et cruelle qui décrit un personnage si moqué qu’il ne sait plus qui il est. L’impression d’inéluctabilité à la fois tragique et grotesque de ce drôle de héros, que contrebalance l’heureux mariage d’Eraste et de Julie est accentuée par la place singulière de la musique de Lully : sarabandes, carnaval et danse grisent jusqu’à la folie. Autour du personnage de Sbrigani, évolue une bande de ragazzi italiens, rompus aux manœuvres et aux stratagèmes, inventant à vue et dans l’amusement tous ces personnages extravagants auxquels se trouve confronté Pourceaugnac – Gilles Privat, inénarrable dans l’étonnement et la surprise hébétée. Travestissements, menaces, accents feints, couplets chantés, danses, la mascarade est bien sombre, et le rire est souvent d’abord amer avant qu’il ne fuse plus joyeux.
La consultation des médecins aliénistes qui vont interner un homme sain d’esprit avec les apparences d’une méthode scrupuleusement scientifique est cocasse.
La mise en scène de Clément Hervieu-Léger sous la direction musicale de William Christie est un véritable plaisir pour le public, un écho au refrain final du chœur :
« Ne songeons qu’à nous réjouir ; La grande affaire est le plaisir. »
Les scènes semblent tirées du cinéma italien des années 1960 – dessin souple des robes colorées pour les dames et pantalons et polos ajustés pour les hommes. L’appel de la rue est puissant, et les travailleurs circulent sur le plateau, les uns à vélo, certains en voiture d’époque, les autres à pied : tout bouge et bruit, l’activité quotidienne et les bruits de la ville développent la belle qualité d’instants vivants.
Tous les interprètes – comédiens, musiciens et danseurs – s’amusent et jouent avec brio et sourire, glissant comme des ombres sur la scène ou bien s’arrêtant. Les rondes dansées participent de ce même esprit festif et convivial précieux.
Un joli rendez-vous de printemps et d’été qui fait du bien à nos temps troublés.
Véronique Hotte
Théâtre des Bouffes du Nord, du 14 juin au 9 juillet. Tél : 01 46 07 34 50

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2016 7:31 PM
|
À compter du 8 juillet, Julien Gosselin et sa joyeuse troupe (Si vous pouviez lécher mon cœur) se jetteront dans la fosse aux lions du Festival d’Avignon, pour cinq représentations de « 2666 ». La première sortie publique de cette pièce hors norme (douze heures !), le metteur en scène nordiste la réserve au Phénix de Valenciennes, ce samedi.
Accrochez vos ceintures de spectateur : avec « 2666 » ces deux prochains samedis, les volontaires embarqueront pour douze heures de représentation.
En quoi est-ce un événement ?
Vu son amplitude (neuf heures et demie de représentation, douze heures trente avec les entractes), c’est de loin « la production théâtrale la plus imposante de l’année », tranche le directeur du Phénix, Romaric Daurier. Julien Gosselin a fait du « roman-monde » du Chilien Roberto Bolaño une pièce hors norme, qui échappe à tous les codes.
Personne ou presque ne le connaissait quand il a mis les pieds dans le plat avignonnais, en 2013. Avec le culot de ses 26 ans, il s’était attaqué à l’adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Ce que personne n’avait osé faire avant lui, en France. Énorme succès critique, cinq nominations aux Molière. C’est peu dire que sa nouvelle création suscite énormément d’attente. Des professionnels mais pas seulement : le Phénix a enregistré plus de 400 réservations pour la représentation de ce samedi 18.
Pourquoi « 2666 » ?
Par goût du défi, assurément. Après Les Particules élémentaires, Julien Gosselin s’est mis en quête d’un texte « au moins aussi insurmontable » à adapter. « Un jour, je me suis souvenu que 2666 était considéré comme le premier grand roman du XXIe siècle », racontait-il, en janvier, entre deux répétitions. Un patchwork de 1 400 pages explorant les thèmes et les genres, que l’auteur, de son vivant, prévoyait de publier en cinq livres. Impossible à transposer sur la scène d’un théâtre : « C’était donc très excitant. » Le carton des Particules « m’offre la possibilité de monter ce spectacle, tant mieux. Ce texte, je le trouve magistral, je ne vais pas m’en priver. »
Comment Julien Gosselin a-t-il travaillé ?
Pendant la (longue) tournée des Particules élémentaires, il s’enfermait dans une loge avec son ordinateur pour retravailler le texte. « Quand vous entendez quatre répliques, il faut vous dire que ça représente quinze pages du livre », expliquait-il un soir où il avait ouvert les portes d’une répétition à quelques privilégiés. Venue une première fois en résidence à Valenciennes en janvier, l’imposante troupe de trente personnes y est de retour depuis la mi-mai. Le temps se resserre. Le premier filage dans les conditions réelles de la représentation s’est fait mercredi ; sinon, c’était du 14 h – minuit, tous les jours sauf le dimanche.
Quel a été le rôle du Phénix ?
Quand il a choisi de porter l’aventure 2666, dont il est le plus gros producteur, le Phénix n’avait pas la garantie d’être retenu comme pôle européen de création, projet derrière lequel l’État, la Région et Valenciennes Métropole s’engagent financièrement. « C’est notre boulot de producteurs de prendre des risques et de faire en sorte que les artistes ne les assument pas seuls, argumente Romaric Daurier, le directeur de la scène nationale. Toute création est un pari. » 2666 marque la suite logique de ce qui avait été initié, en 2013, avec Les Particules élémentaires. Julien Gosselin est devenu, entre-temps, artiste associé du Phénix (il le restera jusqu’en 2019). « On accompagne le projet sur les plans technique, financier, sur les temps de répétition. Il n’y a pas trente-six lieux dans lesquels on peut faire ça, poursuit le directeur. C’est dans cet esprit que le Phénix avait été créé en 1998. » Pour renouer avec la vocation créatrice de l’Athènes du Nord.
« 2666 » : d’après le livre de Roberto Bolaño, adaptation et mise en scène de Julien Gosselin (Si vous pouviez lécher mon cœur) : création les samedis 18 et 25 juin, à 13 h, grande scène du Phénix.
Tarifs : 22,17, 13 et 9 €.
Renseignements et réservations : www.lephenix.fr ou 03 27 32 32 32.
Le programme de la journée : 13 h – 15 h : partie 1, « Les critiques » ; 15 h – 16 h : entracte ; 16 h – 17 h 15 : partie 2, « Amalfitano » ; 17 h 15 – 17 h 45 : entracte ; 17 h 45 – 19 h 45 : partie 3, « Fate » ; 19 h 45 – 20 h 45 : entracte ; 20 h 45 – 23 h : partie 4, « Les crimes » ; 23 h – 23 h 30 : entracte ; 23 h 30 – 1 h 30 : partie 5, « Archimboldi ».
Sur place, pendant les entractes, possibilité de se restaurer et de se détendre (terrains de mini-foot et de badminton, table de ping-pong, yoga, exposition photos de la création, etc.).
PHOTO © SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2016 12:25 PM
|
Un message de Samuel Churin - 16 juin 2016
A PARTAGER 26 JUIN 2003 – 16 JUIN 2016
C’est fait.
L’accord sur l’assurance chômage des intermittents contre lequel nous nous battons depuis 13 ans va être remplacé par l’accord du 28 avril. Cette longue parenthèse pendant laquelle beaucoup d’intermittents ont été précarisés d’avantage est refermée.
A partir de mi-juillet c’est 507 h 12 mois avec ouverture de droits sur une période de 12 mois pour tout le monde. Finis la période glissante et les 243 jours !
Les négociations sur l’assurance chômage ont échoué, autrement dit le Medef et la CFDT ne se sont pas mis d’accord pour ouvrir les discussions sur le régime général. L’état reprend donc la main et n’a pas besoin de leur avis. Il procède par décret. La convention générale est prorogée et l’accord du 28 avril sur les intermittents est intégré et sera applicable mi-juillet.
Nous nous battons toujours contre la loi El Khomri et son monde mais nous pouvons crier, hurler VICTOIRE avant de continuer. Notre parenthèse sera plus courte et plus joyeuse que la leur !
Cette victoire est emblématique de la lutte. Elle prouve évidemment que la lutte paye, qu’il ne faut pas baisser les bras, et que OUI c’est possible. Mais cette victoire n’est pas éternelle, à chaque discussion de convention d’assurance chômage le régime spécifique des intermittents sera remis en cause.
Cette victoire est due à l’action de toutes celles et tous ceux qui ont au moins une fois participé à la mobilisation. Je pense notamment aux grévistes qui ont dû se demander depuis ces treize longues années si leur grève servirait un jour à quelque chose. Cette victoire nous engage à étendre l’intermittence du spectacle à toute l’intermittence de l’emploi. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que d’autres précaires voient leurs droits diminuer.
Nous savons intimement ce que représente l’assurance chômage dans nos vies, nous pouvons d’autant plus facilement imaginer ce que nous deviendrions sans. Cette victoire nous engage à continuer de lutter pour des droits attachés à la personne, pour que tous les chômeurs soient indemnisés.
Et aujourd’hui cette victoire est dédiée aux 4 camarades toulousains arrêtés cet après-midi pour avoir déménagé pacifiquement les meubles de la CFDT et plus généralement à toutes celles et ceux victimes de la répression des luttes.
Continuons sans relâche à lutter pour une société plus juste et rendons illégal ce qui est illégitime.
Publié sur la page Facebook de Samuel Churin - 16 juin 2016 - 17h00
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2016 2:59 PM
|
Par Joëlle Gayot pour le site de son émission sur France Culture.
Ecouter l'émission (30 mn) : http://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/la-souplesse-d-un-acteur
Il a en lui quelque chose d’une enfance qui n’abdiquerait pas, un sourire, une lueur claire dans l’œil, le cheveu légèrement en pagaille. Pourtant rien n’est flou chez lui, ni le regard, tranchant, précis, ni la prise de parole, effilée comme une lame d’acier, toujours nette.
Laurent Stocker, 511ème sociétaire de la Comédie Française, est un acteur aussi vif qu’un écureuil. Sa palette de jeu va du nord au sud et de l’est en ouest : il est comique comme Louis de Funès, plus inquiétant qu’un serial-killer. Il est pile électrique et calme olympien. Il est l’une des pièces maîtresse de la maison de Molière où on va voir les spectacles, parce qu’il en est. Le dernier en date, c’est Britannicus, de Racine, mis en scène par Stéphane Braunschweig salle Richelieu. L’occasion pour nous d’approcher de plus près ce blond comédien qui endosse le costume de Néron.
Photo : Laurent Stocker• Crédits : Stéphane Lavoué, coll. Comédie-Française

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2016 8:07 AM
|
Par Jean-Perre Thibaudat pour Balagan, son blog de Mediapart
La vie des festivals est fragile. Cela tient à peu de choses : un changement politique, un nouveau directeur ou de nouvelles lois. A la tête du « Printemps des comédiens » le capitaine Jean Varéla sait mener sa barque, maintenant un cap où l’excellence et l‘ambiance font la paire.
Aux portes de Montpellier, le domaine d’O est un vaste et rare ensemble composé de pinèdes, d’un grand cyprès orgueilleux et solitaire, de bosquets chatoyants, de chemins caillouteux gardés par des haies de buis ou d’épineux, d’une belle demeure ancestrale (le château d’O), de carrés verdoyants, d’allées cavalières. S’y sont adjoints, au fil des dernières décennies, des chapiteaux, des théâtres, les uns au sud du domaine, les autres au nord, dont le plus récent, tout de rouge vêtu, l’imposant théâtre Jean-Claude Carrière, lequel semble le président à vie du Printemps des comédiens, un festival qui fête ses trente ans.
Le triomphe de l'amour
Le domaine avait été récupéré par le département dans les années 1920. Longtemps il n’en fit pas grand chose, laissant y prospérer quelques fantasmes. Certains appelaient le château qui en occupe le centre, « la maison des fadas ». En 1986, les lois de décentralisation libèrent les collectivités de l’état,en particulier les départements. Un espace s’ouvre. Un festival va naître. Comment? Comme souvent, de l’alliance de l’artistique et du politique, d’une volonté partagée. Daniel Bedos qui organisait un petit festival à Pézenas propose à GérardSaumade, président (PS) du conseil général de l’Hérault, de créer un grand festival dans le domaine d’O. Ainsi nait le Printempsdes comédiens en 1986, « contre l’avis du vice-président chargé de la culture et avec des budgets du tourisme la première année » se souvient, en souriant, Jean Varéla, l’actuel directeur.
Très vite c’est un succès. Le festival comble un vide. Le maire de droit divin de Montpellier, Georges Frêche, ne porte pas vraiment le théâtre en son cœur : le CDN n’est pas au centre-ville mais à sa périphérie. Le bouillonnant maire préfère la musique (le défunt Festival de Radio France, un édifice édifiant, etc) et la danse (un festival de première bourre, toujours en forme). Au pays des socialistes, les divisions sont reines. Le département de l’Hérault qui; comme beaucoup d’autres, souffre d’un manque de visibilité urbaine, voit dans le Domaine d’O une façon d’être visible à Montpellier. Calcul politique ? Pas seulement. Saumade est un homme qui « a des humanités, il connaît le théâtre » se souvient Varela. « On m’a raconté qu’il avait demandé à Jacques Nichet (qui dirigeait alors le CDN appelé alors le Théâtre des Treize vents)) de venir au domaine et devant le château il lui avait dit : ce n’est pas Molière qu’il faut monter ici, c’est Marivaux. Et il avait raison le château du domaine, c’est l’élégance du XVIIIème siècle. » Et Nichet monta avec brioun « Triomphe de l’amour ».
Jean Varéla entre en scène
Jean Varéla, qui fut acteur et en a gardé le goût de convaincre son auditoire, a fait ses preuves dans la région en dirigeant avec succès plusieurs lieux. Le département fait appel à lui en 2006 pour diriger le domaine de Bayssan aux portes de Béziers fort d’un beau projet. Pour diverses raisons les choses se précipitent, le département achète dans l’urgence un chapiteau, c’est le début de l’aventure de Sortie Ouest dont Varélaest l’activiste et inventif directeur au grand dam du maire de Béziers, Robert Ménard, qui n’en peut mais.
En 2010, après 24 ans de service, Daniel Bedos, s’en va. Jean Varéla est appelé à la direction du Printemps des comédiens. « Je monte une première édition de transition et je suis confirmé ». Que faire de l’héritage ? Le poursuivre ? L’infléchir ? Rompre ? « Daniel Bedos avait quasiment abandonné les rives du théâtre public, il est allé vers les nouveaux cirques puis vers les cultures du monde avec chaque année, comme socle, une déambulation à 18h qui mettait à l’honneur l’une de ces cultures. Cela avait du succès. Très vite je me dis qu’il fallait revenir au théâtre pour lui donner une placequ’il n’a jamais eu à Montpellier. Amener au domaine d’O l’excellence et présenter un état des lieux du théâtre. Faire en sorte que le festival soit lié à la ville, qu’il soit un outil que personne ne pourra attaquer. Cela passe par l’exigence artistique et le souci de la faire partager au plus grand nombre. »
Et c’est ce qui s’est passé. Astucieusement, Varéla reprend l’idée de la déambulation qui ouvre les festivités. C’était le cas lors de sa première édition avec « Les règles du savoir-vivre »deJean Luc Lagarce quand le regretté Richard Mitou nous promenait dans tout le domaine entouré d’une troupe composée des élèves de l’école de Montpellier mise en place par Ariel Garcia Valdès. C’est le cas cette année avec Yoann Bourgeois qui, en plusieurs stations, avec la complicité de Marie Fonte, présente des « Tentatives d’approches d’un point de suspension ».
La composition d'un tableau
Astucieusement encore, Varéla n’a pas biffé la ligne des nouveaux cirques, pour preuve cette année, le cirque Poussière et « BoO » l’‘étonnante installation des 386 bambous du cirk Vist tutoyant le ciel. Comme un peintre, Jean Varéla procède par touches, équilibre et mouvement des lignes. « Battlefield » par Peter Brook d’un côté, de l’autre « Timon/Titus » du collectif O’sO (Varéla n’avait pas vu leur spectacle mais il en avait entendu causer et une conservation avec le collectif l’a convaincu). Georges Lavaudant mais avec un texte du trop méconnu Stanislas Rodanski. «Le « Don Juan » de Molière par la bande à Sivadier mais aussi « Myrhhra » première étape prometteuse d’une pièce et d’un spectacle de Guillaume Vincent à partir des « Métamorphoses » d’Ovide qui sera créé l’an prochain au Printemps des comédiens.
Varéla déroule également le fil quelques fidélités comme Michèle Anne de Mey, Joco Van Dormael e le collectif Kiss & Cry avec « Cold Blood »ou le Théâtre de la complicité de Simon Mc Burney qui vient deprésenté (première en France) son nouveau spectacle « The encounter » (« la rencontre ») qui prend à retrousse poil son public habitué à voir les merveilles de ce faiseur d’images. Cette fois, l'anglais se vautre dans une histoire qui fleure bon le peace and love des années 70 mais il le fait sans autre décorum que sa parole assortie d’un intense travail sonore, un régal pour les techniciens. A l’opposé on peut assister à de simples lectures comme celle de la nouvelle pièce de David Léon. Et ainsi de suite.
Pas de thématiques, par de cases à remplir, mais des intuitions, des pas de côté, des coups de cœurs et des prises de risque. C’est en considérant l’ensemble a postériori que Varélay y lit des filiations, y décèle des histoires sous-jacentes. Et ce sont ces histoires qu’il raconte aux spectateurs potentiels en allant, chaque année, dès le mois de février, chez les gens (des « relais » rassembleurs). Des dizaines de rencontres, des milliers de personnes sensibilisées et charmées. Le conteur né qu’il est, l’acteur qu’il est demeuré, sont à la manœuvre. Varéla ne vend pas un programme, il caresse l’esprit d'une composition florale, en fait partager les parfums secrets.
Deux prises de risque
Des risques, Jean Varéla en a pris deux cette année, majeurs. Le premier c’est d’avoir reprogrammé « Arlequin serviteur de deux maîtres » dans la mise en scène de Giorgio Strehler qui avait ouvert le premier Printemps il y a trente ans. Le spectacle mémorable se joue encore avec le créateur du rôle-titre, Ferruccio Soleri, 84 ans (en alternance avec un plus jeune). Et si le spectacle avait mal vieilli ? Non il est miraculeusement intact. C’est une des histoires que raconte Varéla quand il va à la rencontre des futurs spectateurs, la filiation qui va d’Arlequin à Sganarelle et pousse le bouchon jusqu’à la Révolution française (« Ça ira (1) La fin de Louis » l’impressionnant spectacle de Joël Pommerat est aussi au programme).
L’autre prise de risque, c’est d’avoir programmé au Printemps et sur une longue période (jusqu’au 10 juillet) le Théâtre Zingaro avec le nouveau spectacle de Bartabas,« On achève bien les anges », et d’avoir osé le faire, non pas à Montpellier mais à Béziers, à Sortie Ouest sur le domaine de Bayssan. A la barbe de l’imberbe Ménard lequel ne décolère pas contre « le bourgeois cultureux», « le pauvre petit snob méprisant » qu’est, à ses yeux aveuglés de fiel et de ressentiment, Jean Varéla. Pruriy qui n'est pas pour déplaire à Barbatas, l'homme qui préfère dilaiguer avec les chevaux. « Il est plus important aujourd’hui d’être à Béziers qu’au festival d’Avignon, dans le contexte de l’entre soi où il n’y a plus rien à prêcher. Le vrai combats est ici, dans cette aventure vers l’autre » a déclaré le roi Zingaroà « Objectif Languedoc ». Pari gagné, le public vient de partout, d’abord de Béziers et alentour mais aussi de Montpellier, de Perpignan...
« Je sens aujourd’hui que je pourrai aller vers plus de créations, de coproductions, plus de novations. On a cette année trois spectacles surtitrés et le public a suivi » affirme Jean Varéla. « J’ai peu de temps en amont avant de prendre possession du domaine car il y a d’autres festivals. Aujourd’hui, avec le théâtre Jean-Claude Carrière je peux élargir, travailler en hiver. Accompagner les artistes et entraîner les spectateurs dans cette démarche. »
La loi française entre en scène
Sauf que… La loi française, jamais à court d’idées à complications, a consacré la naissance des métropoles. Un transfert de compétences doit s’opérer entre le département et la métropole. Au moins trois compétences. Si, au Ier janvier 2017, l’accord n’est pas scellé, la loi donne raison à la métropole. « Ici à Montpellier la pierre d’achoppement c’est la culture, explique Jean Varéla. La métropole veut la récupérer et donc récupérer le domaine d’O et le département ne veut pas. Pour l’instant les discussions sont au point mort. » S’il n’y a pas d’accord il y aura encore quatre mois de négociations sous l'égide du préfet, et s’il n’y a toujours pas d’accord, la culture devrait revenir à la métropole ce qui interdirait au département toute action culturelle et le festival deviendrait métropolitain. Va-t-on vers cette issue ? Et si oui, que deviendra le Printemps des comédiens ?
S’exprimant dans le journal du festival, Kléber Mesquida, le patron du conseil départemental de l’Hérault, principal bailleur de fonds du festival (et de loin), ne l’entend pas de cette oreille, tandis que le maire de Montpellier, qui a la main sur la Métropole, n’en pense pas moins. « Nous avons proposé à la Métropole une structure de gouvernance commune pour le Domaine d’O dans laquelle elle aurait évidemment sa place. Pour l’instant le président de la Métropole refuse, voulant prendre seul les rênes » rage Mesquida. Entre socialistes, du parti ou ex parti, ce n’est pas exactement l’entente cordiale. « Nous maintiendrons le cap » insiste, frondeur, Mesquida qui met en avant les autres domaines du conseil départemental comme celui de Bayssan à Béziers ou celui de Bessilles à Montagnac. Certains envisagent même une partition du domaine d’O ! Avec un mur des lamentations au milieu? Des barbelés ?
Pendant ces combats de coqs et d’égos, le trentième Printemps des comédiens continue jusqu’au 10 juillet.
Photo : Scène de "On achève bien les anges" © Hugo Marty

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 7:16 PM
|
Par Laurence Albert dans Les Echos
Le mythique centre dramatique national de Nanterre, symbole de la démocratisation culturelle, va être rénové de fond en comble. Un dénouement heureux après douze ans de valse-hésitation.
En 2015, le théâtre des Amandiers de Nanterre a eu cinquante ans, mais le coeur n'était pas à la fête. Trop d'incertitudes assombrissaient alors l'horizon de ce mythique centre dramatique national (CDN), l'un des plus importants de France, connu pour sa force symbolique - la présence d'un haut lieu de culture en banlieue - autant que pour les têtes d'affiches qui s'y sont succédé - Patrice Chéreau l'a dirigé pendant presqu'une décennie.
Un an plus tard, son directeur, Philippe Quesne, arbore enfin le sourire. En ce printemps, des décisions stratégiques ont enfin été prises après douze ans de valse-hésitation. Le théâtre des Amandiers ne déménagera pas sur une autre parcelle de Nanterre, qu'importe si les esprits chagrins le trouvent trop éloigné des transports en commun.
« Un héritage artistique à préserver »
Il ne sera pas davantage détruit, puis reconstruit à neuf. « L'option qui a été retenue, et pour laquelle un budget d'environ 40 millions d'euros va être débloqué, est celle d'une rénovation lourde du lieu », explique Philippe Quesne, pas mécontent d'avoir emporté le morceau après avoir mené bataille plusieurs mois durant pour emporter l'adhésion des financeurs, Etat, Ville, Conseil départemental et Conseil régional. « Intuitivement, nous souhaitions rester sur place, il y a un aspect éthique dans le théâtre de banlieue, un héritage artistique à préserver ici », assure-t-il.
Une proposition élaborée conjointement avec Nathalie Vimeux - alors codirectrice-, qui a d'autant su trouver l'oreille des décideurs qu'elle est moins onéreuse qu'une reconstruction, dans un contexte financier délicat pour la culture et les collectivités. « Le lieu a des atouts, des raretés : un parc, sur lequel nous pourrions davantage nous ouvrir en repensant l'architecture, une salle de 850 spectateurs, un atelier de décors... A nous de rendre ces espaces de travail plus fonctionnels, plus modulables, afin d'y développer des transversalités », explique Philippe Quesne.
Comme ce « Planetarium », devenu, par défaut au fil des ans, une petite salle de représentation de 200 places, dont la fonction sera désormais gravée dans le marbre. Ou cette grande salle, qu'il faudra rendre accessible aux handicapés, et moins gourmande en énergie. Sans doute le plus gros des chantiers, celui pour lequel la saison 2017-2018 devra être repensée. Car pas question pour son directeur de fermer les portes du théâtre pendant les deux années que dureront les travaux.
Spectacles hors-les-murs dans la ville ou dans le parc voisin - déjà exploité pour certaines pièces -, salles provisoires, comme l'atelier de décors... Philippe Quesne n'exclut aucune piste pour faire exister les Amandiers pendant les travaux. « C'est même plutôt une idée excitante », assure le directeur, qui, après une « très bonne saison » ( 75 % de remplissage) n'entend pas laisser repartir le nouveau public, rajeuni, que les Amandiers sont en train de conquérir en sus de ses fidèles historiques.
« De nouveaux habitants arrivent. L'Ouest évolue entre l'Ile Seguin, la Défense, et les centres dramatiques voisins changent aussi. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique, sans publier dans celle du Grand Paris, car il faut imaginer le théâtre des cinquante prochaines années », assure Philippe Quesne. Reste à donner le coup d'envoi. Ce devrait être rapidement chose faite, d'autant que la Région vient de confirmer qu'elle participera bien à la rénovation du site. Reste encore à confirmer son niveau d'investissement.
À NOTER
Né en 1965, le théâtre a été hébergé sous un chapiteau à ses débuts. Le bâtiment définitif n'a été inauguré qu'en 1976.
Laurence Albert
Photo Edward Lindao Marazita-CC BY-SA 3.0

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 3:32 PM
|
Eric Elmosnino reprend aux Nuits de Fourvière « Monsieur Armand dit Garrincha », une pièce de Serge Valletti créée en 2001 à l’Odéon dans une mise en scène de Patrick Pineau. Quand la vie d’un petit joueur de foot croise celle d’une star. Un spectacle nostalgique où le comédien excelle, même si parfois on se perd un peu dans le texte.
Un décor tout en vert et jaune, aux couleurs du Brésil, avec en son centre un énorme écran vidéo fait apparaître Monsieur Armand dans sa chambre. Un vieux France Football traine sur son bureau, il boit du Fanta et se rappelle ses souvenirs de jeunesse dans les années 50 lorsque tout jeune footballeur il croise la star brésilienne Garrincha lors d’une tournée du Botafogo en France.
Serge Valletti est parti d’un article paru dans l’Equipe Magazine et découpé en 1998 par Eric Elmosnino pour bâtir cette histoire rêvée. Ce Monsieur Armand a vraiment existé. C’est l’oncle de l’auteur, premier joueur à avoir marqué un but au Stade Vélodrome à Marseille. Dans ce spectacle aux images sépia, la petite histoire croise la grande histoire. Monsieur Armand, stoppeur (défenseur – le numéro 4) va sauver la vie du plus grand ailier de l’histoire du football en lui évitant d’assister aux 24 heures du Mans automobile en 1955. Lors de cette édition, la voiture de Pierre Levegh percute une tribune et provoque la mort de 84 spectateurs. La narration est cocasse même si le texte n’est pas toujours d’une grande fluidité. On s’est beaucoup perdu dans les limbes de l’écriture de Serge Valletti.
Mais Eric Elmosnino possède l’art de renverser les situations. Il incarne avec beaucoup de fragilité ce Monsieur Armand. Il fait des pauses. Il s’adresse au public. Il prend son temps. Il disparaît de temps en temps de la scène pour réapparaitre filmé derrière le décor dans sa cuisine ou dans sa chambre. On passe finalement un bon moment, avec le plaisir de retrouver ce grand comédien, happé désormais par le cinéma et le théâtre de boulevard.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
Monsieur Armand dit Garrincha
Serge Valletti – Patrick Pineau – Eric Elmosnino
Mise en scène Patrick Pineau
Avec Éric Elmosnino
Scénographie Sylvie Orcier
Lumières Christian Pinaud
Son Jean-Philippe François
Durée 1h20
Nuits de Fourvière 2016
Jusqu'au 30 juin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 12:32 PM
|
Spectacles, concerts, expositions... découvrez la saison en cours au Centquatre-Paris !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 8:38 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde
L’époque n’est pas, c’est le moins que l’on puisse dire, d’une gaieté folle. Autant ne pas laisser passer les occasions de rire et de s’émerveiller. En voici une, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, qui se présente sous le beau titre de Nous, rêveurs définitifs, un cabaret magique auquel il est fortement conseillé de se rendre avec des individus de moins de 10 ans, rêveurs par nature, que ce spectacle met en joie, mais que l’on peut tout autant apprécier quand on a gardé son esprit d’enfance.
On doit ce cabaret poétique et (très) drôle à toute la bande des artistes de la « magie nouvelle », un mouvement en plein essor depuis quinze ans, sous la houlette de Clément Debailleul et de Raphaël Navarro, qui signent la conception de ce spectacle. La magie nouvelle s’inscrit dans tout le mouvement du nouveau cirque et a suscité l’apparition ces dernières années de véritables auteurs, d’artistes aussi singuliers qu’Etienne Saglio et Yann Frisch qui, cela tombe bien, participent à ce spectacle.
LE RÉEL N’EST-IL PAS LUI-MÊME UNE ILLUSION ? TOUT LE SPECTACLE DÉCLINE CE THÈME, EN MÊLANT JONGLERIE, MAGIE ET CLOWNERIE
Les Rêveurs ont conçu leur soirée sur le modèle des galas de magie à l’ancienne, mais en le décalant, bien sûr. Il y aura donc bien des sortilèges, des tours de passe-passe, des apparitions, des disparitions, des lévitations et des métamorphoses au fil de cette soirée. Laquelle commence avec l’incroyable Eric Antoine, magicien-humoriste au parcours plus traditionnel que ses camarades, mais qui s’agrège sans problème à la bande. Il fait office de Monsieur Loyal très doué pour jouer avec les spectateurs et leur faire perdre leurs repères.
Réel ou illusion ? Le réel n’est-il pas lui-même une illusion ? Tout le spectacle décline de multiples variations sur le thème, en mêlant la jonglerie, la magie et la clownerie. Etienne Saglio, avec son personnage de jeune Hamlet de la magie nouvelle, apporte les moments les plus poétiques du spectacle, notamment quand il fait voler dans la salle plongée dans le noir un petit fantôme lumineux et dansant, insaisissable, qui vient vous frôler avant de filer à nouveau dans la nuit. Magie pure.
« La vie est une ombre qui passe », dit Shakespeare dans Macbeth, et Etienne Saglio n’a pas son pareil pour donner corps à cette idée, pour faire apparaître et disparaître des formes volatiles et spectrales, qui se multiplient au fur et à mesure qu’il se bat avec elles.
Jongleur épileptique
Avec Yann Frisch, c’est un autre style qui entre en scène, avec son personnage de Boudu sauvé des eaux, de jongleur-illusionniste épileptique, dérangé et… virtuose.
Car le garçon, outre le fait d’avoir un univers on ne peut plus personnel et légèrement dérangeant, a quand même été champion de France, d’Europe et du monde de magie. Qu’est-ce qui fascine autant dans sa manière de faire apparaître et disparaître comme par enchantement de petites balles rouges comme des nez de clown ? Sans doute le jeu sur une forme d’anarchie très contrôlée.
IL Y A UNE PETITE SCÈNE DÉLICIEUSE DE CINÉMA MUET REVISITÉE AVEC DES HOLOGRAMMES
Mais il y a aussi dans le spectacle des tours de cartes dont ne sait plus s’ils sont vrais ou faux, la danse en lévitation d’Ingrid Estarque et une petite scène délicieuse de cinéma muet revisitée avec des hologrammes.
« L’homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage », écrivait André Breton dans le premier Manifeste du surréalisme. C’est cette réalité travaillée par le rêve, cette surréalité infinie d’un corps, humain ou non, dans l’espace, que ces rêveurs explorent pour le plus grand bonheur de tous.
Nous, rêveurs définitifs, cabaret magique, conçu par Clément Debailleul et Raphaël Navarro. Théâtre du Rond-Point, 2 bis, av. Franklin-Roosevelt, Paris 8e. Mo Champs-Elysées-Clemenceau. Tél. : 01-44-95-98-21. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 15 heures, jusqu’au 3 juillet. De 16 à 38 €. Durée : 1 h 30. www.theatredurondpoint.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2016 7:52 AM
|
Par Stéphane Capron pour Sceneweb
Simon McBurney est de retour en France. Un évènement. Quatre ans après « Maître et Marguerite » au Festival d’Avignon (il était artiste associé de la 66ème édition), il présente « The Encounter » – « La Rencontre » d’après le livre du roumain Petru Popescu qui raconte le périple d’un photographe américain Loren McIntyre parti à la rencontre des peuples d’Amazonie à la fin des années 60.
La première française s’est déroulée à Montpellier au Printemps des Comédiens avant de prendre la route la semaine prochaine des Nuits de Fourvière et à partir de septembre, le spectacle sera présenté à Broadway. C’est du théâtre féérique et sonore. Simon McBurney raconte avec frénésie pendant deux la vie des indiens d’Amazonie à travers le regard d’un européen. Il est seul en scène et les spectateurs l’écoutent dans un casque avec un environnement sonore époustouflant.
On a le sentiment d’être immergé dans la forêt amazonienne grâce à un dispositif sonore binaural de très haute qualité. On sent le souffle du comédien, le vent, le feu, les insectes. Ce spectacle est aussi un grand cri du cœur pour la préservation de la planète. C’est une performance d’acteur. Simon McBurney est un monstre de scène. Rencontre avec ce magicien du théâtre à l’issue de la représentation.
Après « Maitre et Margueritte » en 2012 dans la Cour d’honneur à Avignon, et un opéra à Lyon, vous revenez en France avec un projet qui vous touche particulièrement.
Il y a beaucoup de sujets qui me concernent dans ce spectacle. Il est question de notre culture. Où est-on ? Où va-t-on ? Est-ce que le temps existe vraiment ? Et il y a bien sur la question du devenir de notre planète.
Et tout cela dans un voyage au cœur de l’Amazonie, le poumon de la planète.
Et j’y étais il y a deux ans avec deux communautés très éloignées. L’une totalement acculturée et l’autre qui vit comme l’on vivait au début de l’humanité. Il n’y a rien d’exotique chez eux. Ils vivent de façon saine par rapport à nous. Eux voient les conséquences de notre société de consommation. Leurs fleuves sont pollués, les poissons meurent. Et nous n’avons pas conscience de cela car nous en sommes tellement éloignés. Et ce voyage c’est l’exposé d’un des nôtres, un blanc qui découvre ces gens.
Vous êtes seuls sur scène et grâce à ce dispositif sonore binaural, votre voix entre à l’intérieur de notre cerveau !
La forme de ce spectacle et son contenu sont indivisibles. On oublie par moment que l’on a des casques. Et je vois des gens qui se retournent par moment parce qu’ils pensent qu’il y a des choses bizarres dans leur dos. C’était important que le spectacle se place dans la même position que le photographe Loren McIntyre lors de son voyage en 1969.
Par moment on a même l’impression que les insectes nous effleurent !
C’est cela qui est important, on entend des choses et pourtant il n’y a rien sur scène. On sortant les gens racontent des images qu’ils ont imaginé et qui ne figurent pas dans le spectacle. C’est magique ! Au cœur de cette pièce il y a aussi la question de la narration et de la fiction. C’est quoi la fonction d’une histoire dans notre culture ? Nous nous appelons « Homo Historius », l’homme qui se raconte des histoires. C’est cela qui constitue l’homo sapiens.
Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
photo Robbie Jack

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 7:34 PM
|
From The Guardian
Sarah Kane’s ultra-violent Cleansed left them reeling in the stalls at the National Theatre last week. Was that a rare exception on an otherwise tame British stage?
Matt Trueman, theatre critic and journalist
Has British theatre shied away from violence and atrocity, as the director Katie Mitchell claimed last week? I’m not so sure. There’s a long tradition of it – from Jacobean tragedians to the in-yer-face playwrights of the 1990s – but violence alone doesn’t make for challenging theatre.
Mitchell’s revival of Sarah Kane’s 1998 play Cleansed at the National Theatre caused five audience members to faint last week. It features gruesome imagery – limbs are mangled, tongues are cut out – all played with an eye for excruciating detail. But Cleansed isn’t challenging simply because it contains extreme violence. Shakespeare and Tarantino show us much the same. In fact, the hardest thing to watch was an actor force-fed an entire box of chocolates – hardly the stuff of an 18 rating.
It’s challenging because it doesn’t give us easy explanations. We’re never told why these people are being tortured – or why they submit. Kane asks us to make sense of what we’re watching and, crucially, what we’re feeling. We have to reconcile the play’s contradictions, its beauty as well as its horror. Too often British theatre gives us all the answers. A lot of plays tell us exactly what they’re talking about, what we should think, when to laugh, cry and clap. We need more uncertainty: theatre that challenges us to find our own route through.
Mark Shenton, joint chief critic and associate editor of The Stage
This isn’t the first time a play has caused fainting in the stalls — Titus Andronicus at Shakespeare’s Globe in 2006 and revived in 2014, had audiences falling like flies; there were 43 reported at one performance alone. Its director Lucy Bailey was proud to have provoked this reaction, saying in one report, “I find it all rather wonderful. That people can connect so much to the characters and emotion that they have such a visceral effect. I used to get disappointed if only three people passed out.” She amplified the realism of the violence, which includes one character having her tongue cut out, telling me at the time, “We were canny in using dark blood – usually in the theatre it is too bright, so people don’t believe it.”
As with Cleansed, Titus Andronicus — written 400 years earlier — is meant to shock. As are shows like Jerry Springer – the Opera, also produced at the National, or The Book of Mormon in the West End, that both deal in taboo-breaking representations of religion. (In Jerry Springer, we had Jesus in a nappy admitting to being “a little bit gay”, and God declaring in an aria “It ain’t easy being me”.) Audiences go with some expectation that they’re going to be challenged; theatres don’t necessarily need to push the boat out any further. But they could perhaps have better prepared audiences as to what to expect in the case of Cleansed. A small warning in the publicity that the play “contains graphic scenes of physical and sexual violence” is little more than a theatrical equivalent of an X-rating.
MT It depends what you mean by challenging. If an audience arrives braced for shock, even eager to be shocked, are they really being challenged? Jerry Springer and The Book of Mormon are good examples actually. Is the blasphemy really shocking audiences, who not only choose to attend but pay for the privilege, or is our reaction a kind of mock shock? We might perform offence but we’re actually displaying our own unshockability. Besides, these shows don’t challenge anything – not really. In 2007 two British judges ruled that Jerry Springer “could not reasonably be regarded as aimed at, or an attack on, Christianity or what Christians held sacred.” The Mormon church itself advertised in The Book of Mormon programme.
That extends across theatre. It tends to leave the status quo intact. Because we go to it, rather than vice versa, theatre can end up preaching to the converted – not challenging audiences but confirming everything they already believe. When we talk about challenging audiences, we need to ask who those audiences are. Different things will challenge different audiences – so the question comes back to access and diversity.
MS Yes, the theatre necessarily gets a self-selecting audience; one that tends to either be open for the challenges it might provoke, or knows what it wants, and that is to have a good time. The audiences flocking to The Lion King are very different to the ones that might go to see a Sarah Kane play at the National.
But theatre is very good, too, at using Trojan horses to challenge each of those audiences: Disney entrusted The Lion King to an experimental theatre maker and puppeteer Julie Taymor, who gave it a truly theatrical treatment, not a pantomime; and Katie Mitchell, who directed Cleansed, is a director known for her bold, confrontational experiments with theatrical form.
Right now, the biggest hit on Broadway is Hamilton, a dazzling musical history of one of America’s founding fathers refracted through a hip-hop score and an intentionally mixed-race cast, to claim a very white story as one that is owned by all Americans. It’s a challenge to the status quo, and has turned the modern Broadway musical on its head. Likewise, the West End stage musical version of Bend It Like Beckham (closing on March 5) is the most diverse show in London, a portrait of contemporary multicultural London that is thrillingly of the moment and fuses western and Asian musical influences to make something new. Theatrical form, in other words, is being tested and shifted, even in the supposedly risk-averse world of the commercial musical.
MT So why not argue for more of that? Why wouldn’t you want theatre to push itself further – and, in the process, push its audiences further? Imagine if every audience member, even those just hoping for a good night out, left the theatre challenged by whatever they’ve just seen.
That’s how art changes the world, isn’t it? It doesn’t trigger social change overnight. It shifts attitudes and assumptions, bit by bit, one person at a time. To do so, it has to challenge its audiences – and challenging theatre doesn’t have to be off-putting.
Even crowd-pleasing musicals can challenge their audiences, so why settle for those that don’t?
As you say, even crowd-pleasing musicals can challenge their audiences, so why settle for those that don’t? By the same token, there’s no reason that challenging shows can’t also prove popular. Cleansed is regularly selling out the Dorfman theatre, despite (or perhaps because of) some one-star reviews. If there’s a better argument for British theatres challenging their audience, I can’t think of one. It sells.
MS Agreed! Change is incremental. But it doesn’t need to be wholesale. Hamilton didn’t arrive on Broadway without, first, its composer Lin-Manuel Miranda penning a far more conventional, but nevertheless Tony-winning, musical, In the Heights (now at London’s King’s Cross theatre), and second, by means of an off-Broadway run at the Public Theater (arguably the closest New York has to the National Theatre). Seeking to be confrontational with audiences, therefore, and challenging them shouldn’t be done for its own sake – or even just to annoy Daily Mail theatre critics — but in a staged approach.
But there also has to be room for work that is simply audience-pleasing. Not everyone wants to be challenged every time they go to the theatre.
As for selling out the Dorfman, that’s impressive – but it only has 400 seats. To fill the average West End house, you need audiences two or three times that size. And that’s what the original production of Shopping and Fucking achieved, too, when it improbably transferred from the 80-seater Royal Court Theatre Upstairs (then temporarily based at the Ambassadors) to Shaftesbury Avenue in the mid-90s.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 7:13 PM
|
Petits contes d’amour et d’obscurité, texte et mise en scène de Lazare
Auteur, mais aussi metteur en scène d’une œuvre (voir Le Théâtre du Blog) que l’on a dit inclassable, à la fois pleine de fantaisie et qui flirte avec les arts plastiques, Lazare aime créer un théâtre avec des matériaux très divers, d’inspiration surréaliste, parfois proches de Tadeusz Kantor. Ces Petits contes tiennent d’une épopée du sentiment amoureux. Avec une mise en abyme du corps des acteurs, ici très sollicité.
De formation diverse, Anne Baudoux, Laurie Bellanca, Axel Bogousslavsky, (le remarquable acteur de Marguerite Duras et Claude Régy) Laurent Cazanave, Julien Lacroix, Claire Nouteau, Philippe Smith, accompagnés par Florent Vintrigner musicien, disent avec une grande virtuosité, ce texte parfois difficile qui tient plus d’un long poème, et qui devient prétexte à images, dont certaines de toute beauté, comme cette acrobate suspendue par les pieds à une poutrelle, ou cette jeune femme derrière une fenêtre, ou encore ces scènes d‘amour dans un gros cube tout éclairé de bleu.
Avec des éléments de décor sans doute récupérés: grandes cordes suspendues, miroirs sans tain, vieille armoire à glace des années cinquante en plaqué chêne, fenêtre sur un châssis à roulettes, ce qui introduit une fragmentation intéressante de l’espace scénique.
« Pour les Petits contes d’amour et d’obscurité, dit Lazare, j’ai voulu pouvoir donner place à cet ailleurs de la pensée, à des reflets déformants de notre réel, à notre subjectivité et notre imaginaire. Puis d’un seul coup, toutes choses disparaissent derrière des voiles noirs, et la présence de l’être-là au monde, en face de nous, dans un récit et une adresse directe au spectateur ».
C’est un spectacle intéressant mais souvent bavard et qui reste un peu confidentiel… Tout se passe comme si Lazare s’écoutait un peu trop écrire. Et ces Petits contes d’amour et d’obscurité, que l’on pourrait qualifier de « travail en cours », par ailleurs bien réalisé, et sans doute bâti à partir d’improvisations, reste malgré de vraies qualités, encore assez brut de décoffrage et concerne plutôt les amateurs de Lazare…
Philippe du Vignal
Studio-Théâtre de Vitry (en collaboration avec le Cent-Quatre), 18, avenue de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine. T : 01 46 81 75 50, jusqu’au 16 juin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 2:48 PM
|
Par Frédérique Roussel , Luc Peillon et Amandine Cailhol pour Libération
Après l’échec des négociations, jeudi, entre les partenaires sociaux, le gouvernement s’est empressé de reprendre la main. Et de protéger le fragile accord sur le régime des intermittents.
Petit tremblement de terre au sein de l’assurance chômage. Après quatre mois d’échanges, les organisations patronales et syndicales, gestionnaires de l’Unédic, ont acté jeudi l’échec des négociations sur la nouvelle convention qui régit les règles d’indemnisation des chômeurs. Un nouveau foyer d’embrasement pour un gouvernement déjà empêtré dans de nombreux dossiers sociaux, dont la loi travail. D’où l’extrême réactivité de l’exécutif, qui a décidé, dès l’annonce de cet échec, de prolonger l’actuelle convention, tout en réglant par décret la question - connexe - des intermittents du spectacle. Explications.
Pourquoi les négociations ont-elles échoué ?
Sans surprise, les syndicats accusent le Medef et inversement. «Les organisations patronales n’ont pas été à la hauteur de leur responsabilité. Il n’y a pas eu de négociations, seulement des travaux techniques», pointe Véronique Descacq, de la CFDT. «Le Medef mène un drôle de jeu, très dangereux. Il joue avec les demandeurs d’emploi, c’est inacceptable», abonde Eric Courpotin, de la CFTC, qui regrette que le négociateur du Medef n’ait jamais eu de mandat de la part de son conseil exécutif pour négocier. La faute à des «conflits internes au Medef», estiment les deux centrales réformistes dans un communiqué commun. Prévue pour 2018, la succession de Pierre Gattaz, le patron du Medef, a, selon eux, pesé dans la balance. «Ce n’est pas un problème de méthode de négociation, mais d’état de santé du Medef», poursuit Descacq. Même constat d’Eric Aubin, de la CGT : «Au Medef, la guerre de succession de Gattaz est engagée, et ceux qui sont contre le paritarisme ont gagné la bataille !»
Mais l’élection du président du Medef, dans deux ans, n’est pas la seule explication mise en avant. Certains, comme Michel Beaugas, de FO, soulignent que l’élection présidentielle approchant, le patronat a pu «faire le pari d’un changement de majorité». D’autres, comme Jean-François Foucard, de la CGC, pointent la méthode de négociation, où seul le Medef tient les rênes des discussions. «Celui qui tient la plume aujourd’hui est complètement autiste aux autres», explique Jean-François Foucard.
Pour le négociateur de l’organisation patronale, Jean Cerutti, ce sont les «déclarations» ayant précédé les négociations, notamment du gouvernement, qui ont compliqué les échanges. Mais aussi le comportement des syndicats, qui sont dans «l’incapacité de dépasser des postures dogmatiques visant à "punir" les entreprises - donc les salariés et indirectement les chômeurs - en procédant à des hausses de cotisations sur le travail».
Quels sont les points de désaccord ?
Dès le début, le patronat a refusé net une mesure qui faisait pourtant consensus du côté des syndicats de salariés : la modulation plus importante des cotisations chômage en fonction de la durée des contrats de travail. Autrement dit, taxer davantage les contrats courts tout en baissant les cotisations pour les CDI, le tout dans le cadre d’une enveloppe financière constante. L’idée n’est pas neuve : un temps, le gouvernement avait envisagé de l’inscrire au cœur de la loi travail, avant d’abandonner face à la levée de bouclier du patronat. Pour Jean-Michel Pottier, de la CGPME, il s’agit d’un «diktat» que les organisations syndicales ont porté tout au long de la négociation. Et d’ajouter : «Nous avons toujours dit que nous étions d’accord pour négocier, mais il y a un point que nous ne voulions pas franchir : taxer de manière supplémentaire les CDD. Taxer l’accès à l’emploi aujourd’hui est une mesure contre-productive. Nous laissons la responsabilité à ceux qui voudront prendre cette décision, mais ils seront comptables devant les Français.» Pour le président du Medef, «il faut en finir avec les positions "symboliques" qui veulent que pour faire passer une réforme, il faille taxer les entreprises d’une manière ou d’une autre».
Autre demande syndicale repoussée par le patronat : une taxation des ruptures de contrat des plus de 50 ans, afin de favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, «tout en dissuadant les entreprises d’utiliser l’assurance chômage comme un système de pré-retraite». Un sujet sur lequel «le Medef s’était engagé en octobre, il ne respecte donc pas sa signature», pestent la CFDT et la CFTC.
Et maintenant ?
L’exécutif, qui fait également porter la responsabilité de cet échec au patronat, souhaite désormais «qu’à la rentrée, les partenaires sociaux puissent reprendre des négociations en vue d’aboutir à un accord». Un optimisme pas vraiment partagé pas la CFDT, qui considère qu’il y a très peu de probabilité que les discussions reprennent avant la présidentielle. «Se remettre autour de la table ? Pour quoi faire ? interroge Aubin, de la CGT. Si le Medef nous dit qu’il a un nouveau mandat pour apporter des recettes nouvelles, pourquoi pas. Sinon, non. La balle est dans le camp du Medef.» Même prudence de la CFTC, qui préfère laisser passer la présidentielle de 2017 et «les pressions liées à la loi travail».
D’ici là, les règles en vigueur continuent de s’appliquer. Dans les minutes même qui ont suivi la fin des négociations, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a en effet annoncé une prolongation de l’actuelle convention au-delà de sa date limite du 30 juin. «Le gouvernement tient à rassurer l’ensemble des demandeurs d’emploi indemnisés et ceux qui le deviendraient : ils continueront de percevoir leurs allocations sans subir le moindre désagrément», explique le cabinet de la ministre dans un communiqué. Reste à savoir si la ministre du Travail fera le choix de modifier, par la suite, les règles de l’assurance chômage, par décret.
Les difficultés des partenaires sociaux à se mettre d’accord et les économies promises, soit 800 millions d’euros (alors que le régime est en déficit de 4,5 milliards et porte une dette de 35 milliards), pourraient l’inciter à le faire. «On attend de l’Etat qu’il prenne ses responsabilités», explique FO. La centrale invite notamment le gouvernement à «remettre en place la surtaxation des contrats courts et voir sous quelle forme il pourrait augmenter les contributions des entreprises». Mais l’idée ne fait pas consensus. Voire inquiète, notamment la CFTC. «Dès l’instant où l’Etat reprend la main, il y a une multitude de risques qui vont émerger», note Eric Courpotin.
Et pour les intermittents ?
Autre dossier lié à la convention d’assurance chômage, celui des intermittents du spectacle. Ceux-ci bénéficient en effet d’un régime spécifique d’indemnisation, abrité dans les annexes 8 et 10 de la convention générale. Or depuis des mois, il y a le feu autour de leur régime. Le Medef et la CFDT exigent depuis mars qu’ils fassent 185 millions d’euros d’économies, dont éventuellement 80 millions apportés par l’Etat. Réunis autour d’une table, syndicats et employeurs du spectacle sont donc tombés d’accord, fin avril, sur une série de mesures générant quelque 90 millions d’euros d’économies, tout en rétablissant certains droits aux intermittents, supprimés en 2003. Insuffisant pour le Medef et la CFDT, d’autant que l’Etat n’apportait pas les 80 millions manquants. Donc même si la convention générale avait abouti à un accord, les annexes sur les intermittents avaient de fortes chances d’être repoussées. Un échec qui menaçait de mettre en péril les festivals d’été. Le gouvernement a donc annoncé jeudi un décret, applicable dès la mi-juillet, qui reprend les mesures décidées par les professionnels du spectacle fin avril.
Quid des festivals et du mouvement social ?
La transposition de l’accord de branche des intermittents devrait enrayer la mobilisation qui s’annonçait chez les intermittents. Et qui risquait de paralyser les festivals, Avignon en tête. «Mais c’est une victoire dont on mesure les limites», relativise Denis Gravouil, le secrétaire général de la CGT-Spectacle. On est en sursis une fois de plus et pour une période courte.» Cette situation inédite pose en effet beaucoup de questions : Quelle sera la durée du décret ? Quid de la participation financière de l’Etat à laquelle s’opposent les intermittents qui refusent une caisse autonome ? «Nous serons vigilants sur la transposition de l’accord», poursuit Denis Gravouil. S’il se félicite de cette victoire après treize ans de bataille depuis la réforme de 2003, Samuel Churin, de la Coordination des intermittents et des précaires (CIP), avance aussi sur Facebook que «cette victoire nous engage à étendre l’intermittence du spectacle à toute l’intermittence de l’emploi».
A Lyon, où des actions étaient organisées tout au long de cette journée, comme à Caen, Montpellier, Toulouse, Avignon et Paris, une porte-parole du Collectif unitaire 69 parle de «statu quo» et se demande «combien de temps cela durera». Le groupe qui occupe le Théâtre de l’Union à Limoges depuis mardi a décidé de rester mobilisé dans les lieux jusqu’à vendredi. Et des sujets, dont la loi travail, restent en piste. Les intermittents vont prendre le temps de soupeser la portée de cette victoire.
Frédérique Roussel , Luc Peillon , Amandine Cailhol

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2016 8:02 AM
|
Par Frédérique Roussel pour Libération / Next — 16 juin 2016
Cette année, six écoles du théâtre public présentent les spectacles de sortie de leurs étudiants. Rencontres.
Un réveil avec une aiguille qui dit «Maintenant» figure sur l’affiche du festival des écoles du théâtre public, qui se déroule jusqu’au 3 juillet entre la Cartoucherie et la Colline. Oui, dès maintenant, les promotions de ces écoles nationales vont s’égailler dans la nature, pour rejoindre une compagnie, tenter une audition, adapter un texte préféré, ou peut-être galérer dans un secteur où le statut de l’intermittence, raboté en 2003, se trouve depuis en permanence sur le billot.
Initié par François Rancillac, directeur du Théâtre de l’Aquarium, en 2010, ce festival permet de présenter leurs spectacles de sortie. «Il leur permet d’être vus par un maximum de monde, par la profession et le public, explique-t-il. Les spectacles de sortie sont de drôles d’objets : des espaces de liberté et de création aussi pour des metteurs en scène, avec l’occasion de monter des pièces à quinze et de faire des commandes d’écriture.»
Ce festival, qui accueille cette année six écoles, dont la Manufacture de Lausanne, est conforté par un autre à Limoges, l’Union des écoles, qui se tient jusqu’au 18 juin. Ainsi, le Must Go On, mis en scène par Nathalie Fillion, avec les élèves de l’Académie à Limoges, vient ensuite à la Cartoucherie. Beaucoup de textes contemporains et de l’énergie à revendre. Echantillons de sortants.
------------------------------------------------------------------
Johanna Bonnet, 25 ans, Ecole régionale d’acteurs de Cannes (ERAC)
«Apporter la culture dans les villages reculés sans se prendre pour des bien-pensants ?»
«On vient de faire une italienne [répétition d’une voix neutre, ndlr], et j’ai le temps de parler de moi avant la mise, la préparation du plateau, quoi, pour la représentation de ce soir. Moi, je joue la sœur de Suzy, Claudia Storck. C’est quelqu’un de terre à terre, je dirais, qui prend les choses comme elles sont. Notre promotion a été coupée en trois spectacles. Notre metteur en scène à nous cinq, Jean-Pierre Baro, je le connaissais avant l’Erac, il m’avait aidée au conservatoire à préparer le concours.
«Je viens d’un tout petit village d’Auvergne, Tence. Le premier théâtre le plus proche, c’était la Comédie de Saint-Etienne, à une heure de route… Je n’ai eu aucun accès à la culture, et faire du théâtre a été instinctif. C’est une question qui me taraude : comment apporter la culture dans les villages reculés sans se prendre pour des bien-pensants ou des missionnaires ?
«C’est une pression pour un Erac monte à Paris de jouer dans une institution comme le Théâtre de la Colline ! On sort de la «maison», Marseille. Il y a un mois et demi, on jouait des farces médiévales dans les calanques, et là on est à la Colline. Et finalement, pour nous, ce n’est pas différent. Je ne le vois pas comme un spectacle de sortie : je suis hyper fière de cette pièce et de mes camarades. Mais qu’est-ce que j’ai le trac !
«J’ai depuis cinq ans une compagnie professionnelle, L’Eternel été, qui a déjà fait trois festivals d’Avignon. Je vais travailler sur une création avec le Théâtre Joliette- Minoterie pour le mois de décembre. Mais j’espère continuer avec les élèves de ma promotion. A partir du 20 juin, je mets en scène les Récits d’Odessa d’Isaac Babel, avec les treize de ma promo et les vingt-et-un du CFA Métiers du spectacle avec qui ont partagé des locaux à Marseille. J’aime vraiment les spectacles où il y a énormément de gens, et j’ai imaginé un grand repas de mariage ! Nous aurons dix jours de répétition pour une représentation les 1er et 2 juillet, l’Erac nous permet de monter des projets comme ça. Elle nous a aussi emmenés à Palerme travailler avec Emma Dante et à la MC2, à Grenoble. La sortie de l’Erac, c’est le 17 juillet et on va au festival d’Avignon faire des lectures pour France Culture.
«J’ai l’impression que je me remets en question à chaque fois que je joue. Quand je joue, je suis animée par une puissance de vie. Cette pièce, Suzy Storck, pourrait être jouée dans les villages. Elle ne veut pas d’enfants : ce n’est pas subversif dans le milieu artistique, peut-être plus dans les campagnes…»
-------------------------------------------------------
Julien Breda, 25 ans, Erac
«Je fais du théâtre pour défendre les mots qui me touchent auprès du public»
«J’ai pratiqué le théâtre dès le collège comme d’autres font du sport ou de la musique. Cela n’ a pas été un déclic. Cela devient un métier au fur et à mesure de l’expérience. L’école de cinéma était trop chère, j’ai préféré aller à Paris-III études théâtrales. J’ai tenté ensuite plusieurs écoles, Paris, Strasbourg, Limoges, Cannes. Après le conservatoire, je sentais que j’avais encore besoin d’apprendre des choses sur le corps et les différentes langues.
«On rentre dans une école et on en sort changé. On déconstruit parfois ce qu’on a appris à faire avant. L’entente entre nous, les quatorze élèves, a tout de suite été très forte. Ce n’est pas sentimental et mou, ce que je dis. Nous avons eu rapidement conscience qu’il fallait travailler ensemble pour s’aider et progresser. L’énergie sur le plateau passe par là aussi.
«On n’a pas la sensation d’un spectacle de sortie, de cette pensée un peu économique. Je travaille pour une langue, pour un metteur en scène. Je suis Hans Vassili Kareuz, compagnon de Suzy Storck. Ils se rencontrent à l’usine de poulets. Lui a une vision de sa propre vie liée étrangement à des prêts-à-penser que peut imposer la société : il faut trouver un travail et fonder une famille. Un système économique qui envahit de plus en plus le personnage. Politiquement, je trouve ce texte de Magali Mougel très fort par rapport à ce qui se passe maintenant, le monde du travail, le 49.3, etc. Comment faire pour que notre vie coïncide avec les logiques économiques du système…
«Je n’ai pas de modèle précis de comédien ou de metteur en scène. C’est lié à une certaine génération, d’avoir des modèles. C’est une vision classique de figer dans un rôle. Je vois ce qui me touche chez différents acteurs ou dans des fragments de spectacles. Pour l’avenir, je n’ai pas envie de m’enfermer dans un choix. D’autant que toutes les formes peuvent être insérées dans le théâtre, du cinéma, des images, la vidéo.
«Le théâtre est un endroit où l’on peut encore défendre des corps et des origines différents. A quoi sert-il ? J’évite de me dire qu’il y a un totem. Si je fais du théâtre, c’est pour défendre les mots qui me touchent auprès du public. La pensée et le langage sont assez maltraités dans la société dans laquelle on vit. En allant au théâtre, on fait des expériences avec le langage et le corps. Donc, on s ’affranchit de choses qu’on veut nous imposer. On se fait peut-être mal au début, comme en sport, mais à force, on a de moins en moins mal.»
----------------------------------------------------------------
Teddy Bogaert, 23 ans, Ecole supérieure d’Art dramatique (ESAD)
«Je m’intéresse à la manière de faire du théâtre sans les mots»
Paris, le 14 juin 2016. Des élèves d'écoles de Théâtre Public. Sur la photo : Teddy Bogaert, élève de l'ESAD, juste avant la répétition de la pièce Gratte Ciel au théâtre de l'aquarium à la Cartoucherie (XIIem arr.).
«A Valence (Drôme), j’ai eu la chance de rencontrer le théâtre grâce au Centre dramatique national. J’allais à l’atelier du lundi soir avec Annie Perrier, une prof de français. J’ai pris l’option théâtre au lycée et j’ai rejoint l’école de la Comédie. J’ai eu la chance de partir en tournée à 16 ans dans Roberto Zucco, mis en scène par Christophe Perton. Mes parents, électricien et auxiliaire de vie, me soutiennent. Il y a de la place aussi pour des gens comme moi, apparemment pas prédisposés à ça.
«En début de deuxième année de l’Esad, nous avons travaillé avec Gildas Milin, qui nous a écrit un texte sans nous connaître. Il a réussi à nous faire sentir que tout le groupe sur scène pendant le processus de création, c’est essentiel. La dernière année était beaucoup moins scolaire. Avec Catherine Rétoré, on a beaucoup appris sur l’autonomie de l’acteur, l’entretien du corps, la santé, le travail des réseaux, la fréquentation de spectacles. Je n’ai pas eu une éducation politisée, mais l’Esad nous incite toujours à nous positionner sur ce que l’on veut dire, nos rages intérieures, nos luttes et nos rêves.
«Dans Gratte-Ciel, je joue deux figures : celle d’Ali La Pointe, l’un des leaders du FLN pendant la guerre d’Algérie, et celle d’Ali Bendaj, un personnage de la décennie noire. Après, je vais travailler avec de jeunes metteurs en scène. C’est tellement fort, aussi, de travailler avec notre génération. Je vais interpréter Hippolyte dans le Phèdre de Marina Tsvétaeva, avec la Compagnie Terre-Neuve. Ce rôle de fougueux, entêté par son rejet de l’amour, et souvent différemment décliné, me tient à cœur depuis longtemps. J’adapte aussi Vie animale, de Julien Torres, avec six comédiens pour le festival Rabotage !, en septembre. C’est un roman que j’avais envie de rendre public par le théâtre. Je m’intéresse aussi à comment faire du théâtre sans les mots.»
--------------------------------------------------
Lucie Dordoigne, 22 ans, Esad
«Ce spectacle est la consécration de tout un apprentissage»
«Née dans une famille de comédiens, je n’ai jamais envisagé de faire un autre métier. Aucune journée ne se ressemblait, avec des challenges tous les jours ! Notre spectacle de sortie, Gratte-Ciel, un texte de Sonia Chiambretto mis en scène par Pascal Kirsch, est la consécration de tout un apprentissage. Mais c’est aussi un spectacle d’entrée… dans le monde professionnel. Je joue Darin, une Algérienne de 20 ans, dans cette pièce sur la guerre d’Algérie et son après, qui a des échos avec l’actualité comme les attentats. Quoi de mieux pour des jeunes comédiens que de s’engager sur un sujet qui parle aux gens ? C’est une chance de pouvoir créer in situ pendant trois semaines dans la salle du Théâtre de l’Aquarium.
«Après, je me vois à la fois mener mes propres projets et créer dans le cadre du groupe de la promotion. Les expériences de chacun peuvent ensuite profiter aux autres. On parle beaucoup entre nous de la façon de ne pas être en compétition, créer une solidarité. Mais ces rencontres inter-écoles sont aussi l’occasion de découvrir d’autres métiers, qu’il n’y a pas à l’Esad.
«Cet été, je vais interpréter Marianne dans les Caprices de Marianne de Musset avec une compagnie basée à Loudun. J’aimerais aussi travailler sur des textes qui n’existent pas, qui partent d’un thème et qui s’écrivent sur le plateau. A l’Esad, le corporel est primordial et j’aime l’expression théâtrale sans texte. Comment raconter sans avoir à dire.
«Le théâtre, c’est l’art du live. On jouit d’une autonomie qui permet de faire partie d’un processus de A à Z. Ma première grosse scène, c’était avec les ateliers de danse du conservatoire de Nadia Vadori-Gauthier, sur la scène du Monfort.Je me suis vraiment sentie à ma place. Mais personne ne choisit cette voie par facilité. L’intermittence a permis à mes parents de nous élever mes sœurs et moi. Il est important de défendre ce régime, voire de l’élargir à tous les métiers intermittents.»
Frédérique Roussel
Festival des écoles du théâtre public Cartoucherie de Vincennes, 75012 et Théâtre de la Colline, 75020. Jusqu’au 3 juillet. Gratuit. Rens. : theatredelaquarium.com
Paris, le 14 juin 2016. Des élèves d'écoles de Théâtre Public. Sur la photo : Julien Breda, élève de l'ERAC, en répétition au théâtre de la Colline.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2016 12:56 PM
|
Communiqué de la CGT- Spectacle
Mise à jour le 16 juin 2016
NEGOCIATION ASSURANCE CHOMAGE : LE MEDEF MIS EN ECHEC PAR NOS LUTTES … ELLES CONTINUENT !
Le jeudi 16 juin, la huitième et dernière séance de négociations sur l'assurance chômage s'est conclue par un échec du Medef à imposer des baisses de droits aux allocataires. Le patronat, amené par le Medef, a refusé depuis le début d'augmenter les recettes.
La Cgt a refusé de porter toute co-responsabilité et n'a pas signé le procès-verbal de désaccord.
Le Medef a continué de torpiller l'accord du 28 avril ouvrant des droits nouveaux aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle, y compris en continuant d'exiger la participation de l'Etat au financement des annexes 8 et 10, ce que nous refusons catégoriquement !
Le patronat a y compris refusé de proroger la convention actuelle, prenant le risque de suspendre le versement des allocations au 1er juillet. Son intransigeance oblige l'État à reprendre la main à travers plusieurs décrets : la ministre du Travail a annoncé un décret prorogeant les droits à partir du 1er juillet pour l'ensemble des allocataires, et un décret à la mi-juillet transposant l'accord pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle.
La Cgt sera très vigilante sur le contenu des décrets, n'acceptera aucun recul des droits pour les allocataires et exige que le gouvernement intègre des augmentations de recettes au régime général en rappelant ses propositions :
-surcotisations sur les contrats courts
-contributions sur les ruptures conventionnelles des seniors
-déplafonnement des cotisations sur les salaires supérieurs à 12 000 €/mois
-égalité salariale entre femmes et hommes
Ces mesures résorberaient le déficit de l'Unedic et permettraient d'améliorer les droits des demandeurs d'emploi.
Augmenter simplement les cotisations patronales de 1 %, comme nous l'avons fait dans l'accord du 28 avril, rapporterait au régime général 5 milliards d'euros, alors que le déficit annuel est de 4 milliards !
Bien évidemment nous allons être extrêmement vigilants sur la transposition de l'accord du 28 avril dans le deuxième décret. Le gouvernement serait bien inspiré de sortir ce décret le plus tôt possible, en plein Avignon en particulier, plutôt que d'insulter les manifestants et la Cgt en particulier.
La lutte unitaire paye : elle continue plus que jamais, autant sur l'assurance chômage que contre le travail gratuit des artistes et contre la loi Travail.
Allons enfin vers la construction de nouveaux droits et une véritable sécurité sociale professionnelle !
Pour l'IDF : AG Lundi 20 juin à partir de 19H à la Bourse du Travail – 3 rue du Château d’Eau - salle Grande Croizat – M° République
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...