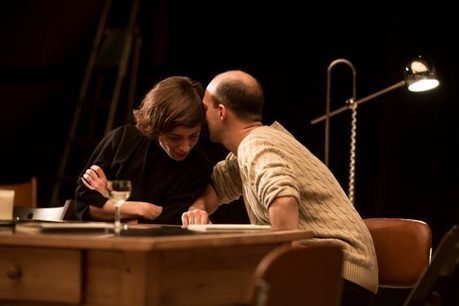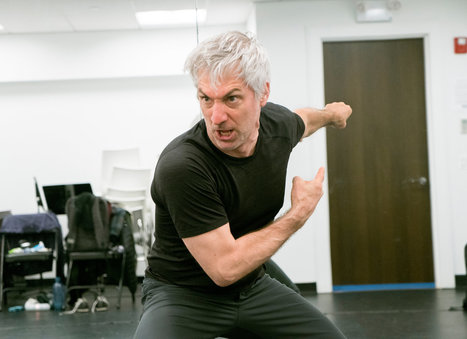Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 12, 2017 2:15 PM
|
Par Vincent Bouquet pour le blog "Du théatre par gros temps"
A certains égards, Soudain l’été dernier a la saveur des premières fois pour Stéphane Braunschweig : première pièce montée sous les ors du Théâtre de l’Odéon en tant que directeur, mais aussi premier texte de Tennessee Williams auquel le metteur en scène, plutôt coutumier de Pirandello et d’Ibsen, ose s’attaquer. Une nouvelle étape de sa carrière que l’homme de théâtre franchit aisément en délivrant une version de la pièce de l’auteur américain bien différente de celle du film de Mankiewicz. Volontairement allégorique, moins psychanalysante et, surtout, plus aiguisée.
Au cœur du jardin de son défunt fils Sébastien, peuplé de plantes en tout genre, Mrs Venable (Luce Mouchel) dresse le portrait de celui qu’il fut au Dr Cukrowicz (Jean-Baptiste Anoumon). Jeune neuro-chirurgien à l’hôpital public de Lyons View, il est en quête de subsides financiers pour poursuivre ses expérimentations – sérum de vérité, lobotomie, etc. – sur ses patients aliénés. Mais la riche veuve pose une condition à son soutien : l’internement dans sa structure de sa nièce par alliance, Catherine Holly (Marie Rémond). Seul témoin de la mort de Sébastien à Cabeza de Lobo l’été dernier, elle est soupçonnée par Violet Venable d’être la meurtrière de son fils. En cause : un récit du drame qui a paru si incohérent aux yeux de ses proches qu’ils ont décidé de l’enfermer dans un asile. Pris en étau, le Dr Cukrowicz va chercher à confronter leurs versions pour, enfin, faire éclater la vérité.
Une lutte à triple entrée
Au-delà des deux faces d’un même homme, ce sont bien deux mondes qui s’affrontent à travers ces deux femmes. Psychologiquement, d’abord, la frontière entre la folie et le réel s’estompe à mesure que la pièce avance : Catherine est-elle vraiment la plus psychotique des deux ou Mrs Venable est-elle, au contraire, enfermée dans un déni de réalité qui l’empêche de voir son fils tel qu’il était réellement ? Sociologiquement, ensuite, la richesse de Violet s’entrechoque avec la pauvreté des proches de Catherine qui sont prêts à tout pour faire exécuter rapidement le testament de Sébastien qui leur a légué 2 millions de dollars. Le tout sur fond de lutte sociale larvée dont la « plage municipale gratuite » de Cabeza de Lobo et l’hôpital public désargenté de Lyons View, méprisés par Mrs Venable qui revendique le snobisme de son fils, sont autant de symboles. Physiologiquement, enfin, la veuve – qui n’accepte pas de vieillir et d’être diminuée par une attaque cérébrale qu’elle nie – veut faire payer à Catherine son jeune âge qui lui a donné les moyens de la remplacer auprès de Sébastien.
En révélant cette complexité, Stéphane Braunschweig dévoile le côté incisif de Tennessee Williams. Volontiers logorrhéique, le propos de l’écrivain américain apparait cette fois, grâce au travail d’adaptation du metteur en scène, bien plus riche, polymorphe et tranchant que le pitch initial ne pouvait le laisser à penser. Dans ce très bel – quoi qu’effrayant – écrin organique, qui cède progressivement la place aux murs capitonnés d’une chambre d’isolement, la lutte entre les deux femmes, remarquablement interprétées par Marie Rémond et Luce Mouchel, devient particulièrement anxiogène et saisissante. Jusqu’à faire perdre la tête au spectateur qui, en récoltant quelques indices disséminés ça et là, pourra se forger son propre avis sur la vie et la mort de Sébastien. Stéphane Braunschweig laissant, à dessein, toutes les portes ouvertes pour que chacun détermine, en son âme et conscience, qui de ces deux femmes est la prédatrice et l’autre la proie.
Soudain l’été dernier de Tennessee Williams, mis en scène par Stéphane Braunschweig au Théâtre de l’Odéon (Paris) jusqu’au 14 avril, puis du 25 au 29 avril au Théâtre du Gymnase (Marseille) et du 11 au 14 mai au Piccolo Teatro (Milan). Durée : 1h35. ****
« Soudain l’été dernier » / Crédit photo : Élizabeth Carecchio.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 12, 2017 1:53 PM
|
Par Marjolaine Henry pour TéléObs
Remarquée pour son élégance visuelle, "les Témoins", la série d'Hervé Hadmar et Marc Herpoux, revient avec une saison 2 étoffée et salutairement torturée.
Les psychopathes qui croisent la route de Sandra Winckler, l'héroïne des "Témoins", sont des metteurs en scène qui s'ignorent : dans la première saison, l'inspectrice découvrait des cadavres gentiment installés dans des maisons témoins. Cette fois, quinze hommes sont retrouvés morts, congelés, dans un bus. Leur point commun : avoir aimé la même femme, incarnée par Audrey Fleurot. Avec son esthétique affirmée et son inclination travaillée pour le merveilleux, le duo de créateurs Hervé Hadmar et Marc Herpoux (le premier est scénariste, le second, également réalisateur) imprime sa patte, depuis dix ans, dans le paysage des séries françaises avec "les Oubliées", "Pigalle, la nuit", "Signature" ou "Au-delà des murs". Sur l'air plus classique du thriller, la saison 1 des "Témoins" a été un succès d'audience sur France 2. Plus longue, cette suite s'affranchit de la mécanique pour faire la part belle aux obsessions de ses auteurs.
La mère oublieuse
Marc Herpoux : "Après avoir exploré le caractère mortifère de la famille nucléaire, en saison 1, avec nos maisons témoins peuplées de macchabées, on s'est attaqué au tabou de la maternité… Le principe, c'est de confronter notre héroïne, Sandra Winckler (Marie Dompnier), inspectrice de son état, à enquêter - éventuellement à l'insu d'elle-même ! - sur ses propres parts d'ombre. On a su qu'on tenait cette saison 2 quand on a imaginé sa relation avec Catherine Keemer (Audrey Fleurot) et conçu leur duo comme une occasion d'explorer la complexité du lien maternel : Sandra est une mère dans le contrôle absolu avec ses enfants alors que Catherine, frappée d'amnésie, a littéralement oublié qu'elle en avait ! Cela en fait une figure assez inédite de la maternité sur nos écrans : libérée de ses responsabilités, elle trouble profondément Sandra.
La ramification d'intrigues se construit, jusqu'au dernier épisode, autour de la question de la parentalité, de l'éducation, du cadre, de la liberté. Comme toujours, cela devient intéressant quand on dépasse le manichéisme. D'ailleurs, dans cette saison, le seul qui croit dur comme fer au mariage est un authentique psychopathe !"
Saison 2 , là où tout commence
Hervé Hadmar : "Une série ne démarre vraiment qu'à la saison 2 ! Le vrai plaisir du genre est là, dans ce “Que sont-ils devenus ?”. On retrouve notre duo de flics, Sandra et Justin (Jan Hammenecker), dont on connaît la complicité et avec lesquels on a désormais un petit bout de passé commun. C'est un plaisir de jouer avec ces acquis, de mobiliser les codes qu'on a créés."
Marc Herpoux : "J'aime les effets d'ellipse, d'une saison à l'autre.
Prendre le train en marche, c'est toujours grisant en fiction ! On est obligés de carburer et cela génère de l'empathie pour ces personnages sur lesquels on projette nos propres esquisses de scénario.
Faire une suite offre aussi la chance de décliner un dispositif : à chaque saison, Sandra est amenée à se découvrir elle-même, via ses interactions avec un allié-adversaire, interprété par un “guest”. Après s'être émancipée de la figure paternaliste de Paul Maisonneuve (Thierry Lhermitte) dans la première saison, elle fusionne avec l'intrigante Catherine Keemer. Si on fait une saison 3, on déploiera à nouveau cette forme. Mais pour l'instant, on cherche encore un thème aussi fort. C'est la condition sine qua non pour qu'on continue."
"Thelma et Louise"
Marc Herpoux : "Je n'ai jamais oublié le choc ressenti devant “Thelma et Louise”, d'où l'envie d'un road-movie pour cette saison 2. Evidemment, on voulait des personnages féminins complexes et qui ont des combats à mener. Pour citer le test de Bechdel [inventé par l'auteure de BD Alison Bechdel pour juger du sexisme d'un film, NDLR], quand elles sont ensemble, ce n'est pas pour parler d'un mec mais pour traquer un tueur !"
Casting : des terriens et des lutins
Hervé Hadmar : "Sa pâleur, sa chevelure flamboyante, son visage de lutin… Audrey Fleurot semble tout droit sortie d'un conte. J'avais déjà pensé à elle pour la saison 2 de “Pigalle, la nuit” [finalement annulée avant le tournage, NDLR] , je savais qu'elle appartenait à notre monde. L'enchevêtrement du merveilleux et du réalisme doit aussi se ressentir dans la construction du casting. On a des personnages plus terriens comme celui de Justin, incarné par Jan Hammenecker - même s'il insuffle aussi sa dose de surréalisme ! Avec Marie Dompnier, qui m'a encore plus bluffé que la première fois, on a insufflé une ambiance de troupe : elle connaissait déjà Yannick Choirat, je suis allé le voir sur scène, chez Joël Pommerat, et il campe, dans cette saison, un méchant fascinant de magnétisme et de précision. Quant à Anne Benoît, qui avait déjà joué avec Marie au théâtre, elle a fait de son personnage d'adulte réfugié dans l'enfance une création poétique."
Huit épisodes ou la victoire des personnages
Marc Herpoux : "La première saison ne comptait que six épisodes et on s'est fait bouffer par l'intrigue. On était vraiment frustrés pour le personnage de Paul Maisonneuve : on avait écrit tant de choses sur lui que l'on n'a pas eu la place de mettre. Cette fois, on a stipulé dès le début qu'il nous fallait huit épisodes et France 2 a tout de suite accepté."
Hervé Hadmar : "Huit épisodes au lieu de six, cela change tout. Ce n'est plus l'intrigue qui mène la série mais les personnages. Ce sont eux les grands gagnants ! En même temps, la structure narrative gagne en complexité : on introduit, à la fin du quatrième épisode, un autre point de vue, celui du tueur lui-même ! Alors qu'en six épisodes, celui-ci ne serait apparu qu'à la fin, il aurait été l'objet de la quête et non l'un des pivots du récit. Cela change aussi les attentes du spectateur en matière de rythme : en six épisodes, on attend sans cesse un nouveau rebondissement qui viendra toujours trop tard…
Là, on a une chance de se laisser embarquer dans ce qui fait l'essence même d'une série : ces digressions, ces détails qui font l'épaisseur d'un personnage, ces saynètes humoristiques dont on se prive à coup sûr si l'on manque de temps.
Minotaure, éoliennes et autres mythologies
Marc Herpoux : "Ce glissement vers le conte est devenu notre marque de fabrique. Cette fois, on a travaillé sur le Minotaure, qui attend, dans son Labyrinthe, qu'on lui livre des enfants en pâture. Une figure patriarcale en contrepoint des figures maternelles…
Mais on tient aussi à territorialiser nos histoires, on cherche à s'ancrer dans notre réalité pour mieux révéler son potentiel fantasmagorique, l'extraordinaire à l'œuvre dans l'ordinaire, le merveilleux qui commence à l'orée d'un bois, le cauchemar qui surgit au détour d'un site de rencontres.
Hervé Hadmar : "J'avais en tête depuis longtemps l'image de corps retrouvés au pied de pylônes électriques ou d'éoliennes. Finalement, j'ai choisi les éoliennes pour leur côté organique et j'ai travaillé leurs sons comme des bruits d'animaux... Une façon de faire entendre le réel autrement pour faire exister nos monstres contemporains."
La religion du thriller
Hervé Hadmar : "Apparemment, on n'a rien trouvé de mieux pour exorciser nos peurs que de regarder des gentils combattre des méchants ! Pour ma part, j'ai un authentique plaisir à lire, à regarder et à écrire des polars, donc je m'amuse beaucoup à jouer avec ces codes, à citer “Seven” le temps d'une scène, à faire monter l'angoisse ou à imaginer des retrouvailles avec un grand méchant… dans un Flunch ! Mais c'est vrai qu'on manque de diversité dans les genres en France et qu'il est infiniment plus facile de vendre un thriller qu'une série de science-fiction."
Marc Herpoux : "Difficile de faire autre chose que du polar à la télé française ! On ne refera probablement pas de sitôt “Au-delà des murs” [mini-série fantastique diffusée à la rentrée 2016 sur Arte].
Le polar rassure tout le monde : c'est la certitude d'avoir une histoire avec une amorce, un développement, une résolution. Pour accéder à plus de diversité dans les sujets et les formes, il faudrait probablement accepter, comme en Angleterre, de segmenter l'audience.
Mais pour l'instant, en France, on cherche toujours à réunir le plus grand nombre devant le même programme."
Le showrunner est dans les détails
Hervé Hadmar : "Quand j'ai commencé à faire de la télé avec “les Oubliées” [en 2007, sur France 3], moi qui venais de la pub, j'ai tout de suite repéré qu'il manquait un corps de métier : le directeur artistique ! Dix ans plus tard, je vois encore trop de séries françaises dont les épisodes sont tournés par des réalisateurs différents, chacun avec leur style, sans unité visuelle. Il faut que tout soit cohérent de la première à la dernière image, du générique jusqu'au travail du son. Du coup, pour l'instant, je réalise la totalité des épisodes. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'identifier quelqu'un qui se porte garant de cette exigence, qu'on l'appelle showrunner ou autrement. On en a encore eu la preuve en écoutant les acheteurs des 71 pays qui ont acquis “les Témoins” : il faut une identité esthétique affirmée pour s'exporter."
Mercredi 15 mars à 20h55 sur France 2. "Les Témoins" (1 et 2/8), réalisé par Hervé Hadmar. (2017) Avec Marie Dompnier, Audrey Fleurot, Jan Hammenecker, Judith Henry. (Disponible en replay sur Pluzz)
Marjolaine Jarry
Journaliste

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 2:01 PM
|
par Judith Sibony pour son blog "Coup de théâtre" :
Doreen par David Geselson, métaphysique du couple
Le spectacle qu’a créé David Geselson autour de Doreen Keir, femme de l’écrivain André Gorz, est un exploit poétique mais surtout galant. J’emploie ici ce mot au sens des héros chevaleresques pour qui la galanterie était une véritable éthique : placer la femme au-dessus de tout, n’en déplaise à tous les critères de la société ou de la notoriété, simplement au nom de l’amour.
André Gorz avait montré le chemin, avec sa lettre fameuse publiée en 2006 chez Galilée, un an avant le suicide du couple. Ce court texte intime du journaliste et pionnier de l’écologie politique fut son plus grand succès de librairie. Lettre à D., sous-titre : Historie d’un amour. Une lettre à couper le souffle, qui dit l’émerveillement toujours renouvelé, la sensation de « re » tomber amoureux sans cesse, même si on est marié depuis plus d’un demi siècle. Un texte qui laisse aussi entrevoir les conflits, les débats d’idées, le dévouement absolu d’une épouse à la fois flamboyante et dans l’ombre. Et puis la souffrance permanente de cette femme, pendant quarante ans, suite à un empoisonnement médical sordide.
Avec sa création « autour » de la lettre, David Geselson fait mieux qu’être fidèle au texte : il va encore plus loin. En dépit de la discrétion volontariste de l’héroïne, il rend son prénom à celle qui voulait être simplement « D. ». Et puis il imagine ses cris et les donne à entendre. Il lui fait dire directement ce que l’écrivain citait d’elle. Enfin par un miracle dont seul le théâtre a le secret, il lui prête grâce et vie dans les traits d’une actrice époustouflante : Laure Mathis, dont le visage et la voix sont tellement expressifs qu’ils constituent un spectacle à eux tout seuls.
Ici, d’ailleurs, l’homme s’efface presque : certes, André est bien là, sous son vrai nom, Gérard (incarné par Geselson lui-même), mais c’est Doreen qui prend toute la lumière, et c’est d’elle que viennent les idées les plus fortes : l’initiative de la demande en mariage, l’analyse critique d’une société qui s’apprête à devenir l’esclave du pétrole, et une façon de poser sur le monde un regard à la fois joyeux et inquiet. Parce qu’elle le voit de l’intérieur ce monde : elle qui a connu des épisodes de cécité dans son enfance, elle trouve absolument insupportable l’idée de ne pas voir les choses en face.
À la fin de la pièce, au moment où les deux amants octogénaires s’en vont mourir ensemble, tout le monde s’est tu le soir de la première au Théâtre de la Bastille. Chacun a ressenti le besoin d’attendre de longues secondes avant d’applaudir à tout rompre. C’est extrêmement rare, ce genre de silence. Et c’est sans doute la preuve qu’au-delà du spectacle, il se joue ici une expérience profondément sérieuse de pensée du couple et de l’amour.
Doreen, Autour de LETTRE À D. d’André Gorz. Texte et mise en scène : David Geselson. Avec David Geselson et Laure Mathis. Au théâtre de la Bastille jusqu’au 24 mars.
Laure Mathis et David Geselson dans DOREEN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 1:04 PM
|
Sur le site de Poésie et ainsi de suite sur France Culture
Trois invités et de la lecture. Mot à mot, avec l’écrivain et critique Laurent Nunez qui dissèque l’énigme des premières phrases pour un éloge de la relecture. A haute voix, avec Vincent Laisney, qui fait des lectures en petit comité un contre-manuel de l’histoire littéraire du XIXème siècle. Et sur scène avec Yves Noël Genod qui met sa lecture de Proust sur un plateau.
Ecouter l'émission https://www.franceculture.fr/emissions/poesie-et-ainsi-de-suite/poesie-et-lecture
Invités :
Vincent Laisney, maître de conférences à l'Université de Paris Ouest, spécialiste du romantisme français et des sociabilités littéraires au XIXe siècle. Il vient de publier En lisant, en écoutant (Les Impressions nouvelles, Bruxelles, charlotte Heymans) Cet ouvrage s'intéresse à un phénomène capital, quoique méconnu, de l'histoire littéraire du XIXe siècle : la lecture à haute voix en petit comité. De Lamartine à Gide en passant par Stendhal, Hugo, Flaubert, Rimbaud et Mallarmé, tous les écrivains ont essayé leurs œuvres devant un petit parterre d'amis et de confrères. Maillon oublié de la chaîne du livre, cette phase test est une étape importante, voire déterminante, dans le processus de création littéraire.
Laurent Nunez pour L’énigme des premières phrases (Grasset) Selon l’auteur, l’analyse d'une quinzaine de premières phrases d'ouvrages littéraires célèbres. Selon l'écrivain, elles révèlent l'oeuvre et la pensée de l'auteur, par l'arrangement et l'harmonie des mots. Une manière de relire Racine, Duras, Camus, Baudelaire, Gide, Molière, Mallarmé, Barthes, Zola, Aragon et bien d'autres encore.
Yves Noël Genod, metteur en scène, danseur, acteur et performeur français, pour sa version ardente et poétique, au plus près du langage proustien, d’A la recherche du temps perdu. La Beauté contemporaine, deuxième volet de La Spirale du temps perdu (d'après Marcel Proust) est une rêverie sur la beauté et sur la jeunesse imaginée pour la Ménagerie de Verre, 12 rue Léchevin, à 20h30, les 14, 15 et 16 mars pour l'ouverture du festival Etrange Cargo. (Jauge limitée, réservation hautement conseillée.) Avant-premières les 11, 12 et 13, 20h30 (entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles).
Intervenants
Laurent Nunez : journaliste
Yves-Noël Genod : metteur en scène
Vincent Laisney
Photo : Yves-Noël Genod aux Bouffes du Nord • Crédits : MF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 6:09 AM
|
Par Clarisse Fabre et Fabienne Darge dans Le Monde
La culture en campagne 2/8. Alors que le secteur reste traversé par de profondes inégalités entre les sexes, tous les candidats à la présidentielle ne font pas preuve du même volontarisme pour corriger le tir.
« Où sont les feeeemmes, avec leurs textes plein de chaaaaaaarmes ? » La troupe de Thomas Jolly est déchaînée, en ce jour de juillet 2016. Dans le cadre du feuilleton théâtral quotidien qu’elle crée sur l’histoire du Festival d’Avignon, l’épisode de ce jour-là est consacré à la présence des auteures dans la programmation du festival d’art dramatique le plus prestigieux au monde, et singulièrement en son lieu sacro-saint : la Cour d’honneur du Palais des papes.
Et le constat s’avère accablant : depuis la création du festival, en 1947, aucune dramaturge n’a été jouée dans la Cour d’honneur. Les femmes apparaissent sur les programmes en 1995, avec deux spectacles, l’un cosigné par Macha Makeïeff avec son mari Jérôme Deschamps, l’autre par la chorégraphe Pina Bausch. Depuis, d’autres femmes sont entrées dans la Cour, exclusivement des chorégraphes : Mathilde Monnier, Anne Teresa De Keersmaeker. Que se passe-t-il avec la parole des femmes, dans ce temple de la parole qu’est la Cour ?
En cette fin de quinquennat de François Hollande, les jeunes comédien(ne)s de Thomas Jolly ne sont pas les seul(e)s à être en colère, dans un milieu culturel qui reste profondément inégalitaire entre les hommes et les femmes. A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, le 23 avril, les attentes sont fortes.
La danse plus équilibrée
Le constat est connu depuis – au moins – dix ans. En 2006, le rapport de Reine Prat, commandé par le ministère de la culture, avait sidéré la profession en dévoilant l’ampleur des discriminations : les théâtres étaient alors dirigés à 92 % par des hommes, et seules trois metteuses en scène dirigeaient des centres dramatiques nationaux (CDN) ; on comptait 86 % d’hommes à la tête des établissements musicaux subventionnés, et « 97 % des compositeurs dont on entend la musique sont des hommes », lisait-on encore dans le rapport.
Le secteur de la danse apparaissait plus équilibré, avec neuf directrices de centres chorégraphiques nationaux (CCN) sur un total de dix-neuf. Dans son rapport, Reine Prat établissait le seuil de 33 % à partir duquel une certaine mixité devient effective, et proposait quelques pistes pour atteindre l’égalité : la mise en place de jurys paritaires pour les nominations, un égal accès aux moyens de production pour les metteuses en scènes, les réalisatrices, etc.
L’intitulé du second rapport de Reine Prat publié en 2009, « De l’interdit à l’empêchement », résume la situation. Ces études ont réveillé la profession. En 2008, le mouvement HF voyait le jour en Rhône-Alpes, en vue de réclamer une égalité réelle dans les programmations des scènes de spectacle vivant, des lieux d’art contemporain, ainsi que dans les nominations à la tête des institutions. La première saison égalitaire fut mise en place au Théâtre des Célestins, à Lyon, en 2011, et le mouvement HF compte désormais onze collectifs régionaux.
Lire aussi l’entretien avec Eric Ruf : « Le mouvement pour l’égalité des sexes dans le théâtre est irréversible » http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/03/11/eric-ruf-le-mouvement-pour-l-egalite-des-sexes-dans-le-theatre-est-irreversible_5093076_1654999.html
Circulaire retardée
Quand François Hollande est élu à l’Elysée, en 2012, sa ministre de la culture et de la communication était déjà sensibilisée à la question. En 2013, Aurélie Filippetti a créé un Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture, réuni un comité ministériel chargé d’agir en faveur de la parité dans la culture… Quitte à essuyer critiques et moqueries. Des nominations de femmes ont suivi à la tête de théâtres, de centres d’art, etc.
Fleur Pellerin, sa successeure (2014-2016), a poursuivi cette politique. En juin 2015, le comité ministériel de la Rue de Valois approuvait une proposition de Sophie Deschamps, alors présidente de la Société d’auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), visant à augmenter de 5 % par an la présence des femmes dans les directions et les programmations des établissements culturels.
Mais la circulaire qui devait mettre en œuvre ces quotas a tardé à voir le jour : elle n’a été signée que le 8 mars 2017 par la troisième ministre de la culture du quinquennat, Audrey Azoulay, et encore dans une forme édulcorée. Pour continuer à lever les barrières, le cabinet de la ministre a annoncé un colloque, le 30 mars, à la Philharmonie de Paris, intitulé « Pour que les femmes accèdent à tous les métiers de la culture ».
AUCUNE FEMME NE DIRIGEAIT UN GRAND THÉÂTRE NATIONAL OU UN DES GRANDS THÉÂTRES PRIVÉS EN 2016
« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! », dénonce la SACD dans une brochure distribuée aux candidats. De fait, malgré les récentes nominations – Laurence Engel à la tête de la Bibliothèque nationale de France, Laurence des Cars au Musée d’Orsay –, le bilan que l’on peut faire, en cette semaine du 8 mars qui célèbre les luttes féministes, n’est pas brillant.
La place des femmes n’a guère progressé, voire reculé dans certains secteurs, tel le spectacle vivant, au cours des deux dernières années. Aucune femme à la tête d’un théâtre national, ou d’un des grands théâtres privés.
Dans les programmations, les artistes femmes sont toujours très minoritaires, malgré l’effort notable effectué par le Festival d’Avignon en 2016, qui a présenté un tiers de spectacles signés par des metteuses en scène, et, surtout, celui mené par la Comédie-Française où, en cette saison 2016-2017, la programmation est paritaire.
Majorité de diplômées en art
Dans la nouvelle génération, les artistes femmes sont nombreuses – elles sortent majoritaires des écoles d’art depuis plusieurs années. Dans le cinéma, 21 % des films français sont signés par des réalisatrices, mais une infime minorité monte les marches du Festival de Cannes.
A l’image de tous les hauts fonctionnaires qui ont travaillé sur le dossier, Sophie Deschamps, à la SACD, est déçue : « La circulaire ministérielle du 8 mars intervient bien tard, alors que l’équipe actuelle est en train de faire ses cartons », constate-t-elle.
« Si elle n’est pas suivie par un deuxième texte avec obligation de résultat, elle n’aura aucun effet. Le volontarisme pratiqué depuis dix ans ne suffit plus. Les subventions versées aux établissements culturels sont déjà conditionnées à différents critères. Pourquoi ne pas les soumettre également au respect de la progression de la part des femmes ? »
Peu de candidats osent aller jusque-là. Où sont les femmes, d’ailleurs, dans cette campagne ? Au QG de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, on affiche clairement l’objectif d’atteindre « la parité parfaite dans la culture à l’issue du quinquennat », explique Danièle Atala, plasticienne, ancienne travailleuse sociale et coresponsable du volet culturel de la campagne. « Je fais confiance aux acteurs de la révolution que nous voulons mener. Notre mouvement est déjà paritaire dans toutes les commissions. La recette, on ne l’a pas, ce ne peut être qu’un processus. »
SOPHIE DESCHAMPS, EX PRÉSIDENTE DE LA SACD : « POUR L’INSTANT, IL N’Y A PAS DE RÉELLE PRISE DE CONSCIENCE DE LA VALEUR D’EXEMPLARITÉ DE LA CULTURE »
« Pour faire évoluer les mentalités, on ne le fait pas que par la contrainte », souligne-t-on dans l’équipe d’Emmanuel Macron. « La proposition de la SACD est pertinente car elle repose sur des études chiffrées. Il s’agit d’une moyenne à adapter en fonction des situations réelles », précise Frédérique Dumas, productrice de films et membre du comité politique d’En marche !
« Une soirée sur les femmes et la culture, avec une prise de parole d’hommes, sera organisée le 5 avril à La Bellevillloise, à Paris, ajoute-t-elle. C’est une mutation culturelle. Beaucoup d’hommes s’engagent dans un collectif dénommé MEUF(s), les Mecs extrêmement utiles aux femmes. »
« Passer à la vitesse supérieure »
Etre utile, au Parti socialiste, cela passe par une « politique plus coercitive et en même temps participative, revendique le responsable du projet culture de Benoît Hamon, Frédéric Hocquard, conseiller PS de Paris. Dans la culture, l’Etat est régulateur et interventionniste. On doit passer à la vitesse supérieure. La question de la féminisation doit faire partie des critères d’attribution de l’aide publique. Quitte à prendre des sanctions financières si ce critère n’est pas respecté. »
Pour Sébastien Chenu, responsable du projet culturel du Front national (FN), et conseiller régional des Hauts-de-France, « la sous-représentation des femmes n’est pas un problème spécifique à la culture, mais un phénomène général. Peut-être parce que je suis administrateur dans deux structures, le Louvre-Lens et l’Opéra de Lille, qui sont toutes deux dirigées par des femmes, je n’ai pas le sentiment que la culture oppresse les femmes. »
Le FN ne propose donc pas de mesures particulières : « C’est en ouvrant les conseils d’administration aux représentants du public, aux Françaises et aux Français, que ces derniers pourront faire pression sur les nominations. »
L’ENJEU DE LA FÉMINISATION, C’EST AUSSI LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES ŒUVRES, ET DONC DANS LA SOCIÉTÉ
Du côté des Républicains, impossible de savoir si François Fillon développe une pensée et des propositions sur le sujet : sollicitée par Le Monde, l’équipe de campagne n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.
L’enjeu de la féminisation, c’est aussi la représentation des femmes dans les œuvres, et donc dans la société. « Avec l’arrivée d’une nouvelle vague de réalisatrices dans le cinéma, une frontière est en train de se déplacer. Des jeunes femmes investissent des terrains nouveaux, le cinéma de genre, à l’image de Grave(2016) de Julia Ducournau », note Nathalie Coste-Cerdan, directrice de la Fémis, la prestigieuse école de cinéma parisienne. Mais il reste de gros progrès à accomplir au niveau des moyens de production, dit-elle : « Les femmes sont les plus représentées dans les films à petit budget, et beaucoup moins dans les grosses productions. » « Pour l’instant, il n’y a pas de réelle prise de conscience de la valeur d’exemplarité de la culture, déplore Sophie Deschamps. Comment l’Etat peut-il concevoir de dépenser l’argent public à 80 % pour les hommes ? »
Clarisse Fabre
Reporter culture et cinéma
Fabienne Darge
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 5:58 PM
|
By Lauryn Collin Hugues in New York Times
Stephan Wolfert was drunk when he hopped off an Amtrak train somewhere in Montana, toting a rucksack of clothes and a cooler stocked with ice, peanut butter, bread and Miller High Life — bottles, not cans. It was 1991, he was 24, and he had recently seen his best friend fatally wounded in a military training exercise.
His mind in need of a salve, he went to a play: “Richard III,” the story of a king who was also a soldier. In Shakespeare’s words, he heard an echo of his own experience, and though he had been raised to believe that being a tough guy was the only way to be a man, something cracked open inside him.
“I was sobbing,” Mr. Wolfert, now 50 and an actor, said recently over coffee in Chelsea. “I didn’t know you could have emotions out loud.”
That road-to-Damascus moment — not coming to Jesus, but coming to Shakespeare — is part of the story that Mr. Wolfert tells in his solo show, “Cry Havoc!,” which starts performances Wednesday, March 15, at the New Ohio Theater. Taking its title from Mark Antony’s speech over the slain Caesar in “Julius Caesar,” it intercuts Mr. Wolfert’s own memories with text borrowed from Shakespeare. Decoupling those lines from their plays, Mr. Wolfert uses them to explore strength and duty, bravery and trauma, examining what it is to be in the military and what it is to carry that experience back into civilian life.
“Cry Havoc!” is being produced by the Off Broadway company Bedlam, praised for its spare and nimble stagings of plays like “Saint Joan” and “Sense & Sensibility.” The company also has an outreach program for veterans led by Mr. Wolfert. But both Mr. Wolfert and Eric Tucker, Bedlam’s artistic director, agree that this show must succeed as theater for the audience, not just as therapy for the actor.
“One-person shows, come on, those are like hit or miss — and mostly miss,” said Mr. Tucker, the director of “Cry Havoc!” who’s known Mr. Wolfert since their days in graduate school at Trinity Rep Conservatory. “We’re not just doing this as a vet outreach thing. I’m not doing it to put my friend onstage. If it wasn’t good, I wouldn’t put it up.”
A master of self-deprecation, Mr. Wolfert recalled the time several years ago, when he was still living in Los Angeles, that he performed an early version of the show for Mr. Tucker. When Mr. Wolfert finished, the director was distinctly unimpressed.
“He goes, ‘Well, you certainly had a lot of emotions, but I didn’t,’” Mr. Wolfert said, laughing.
Mr. Tucker told him he needed to be honest with the audience — to show that he was a mess of a human being, not hide behind humor and pretend he was doing fine. So Mr. Wolfert gathered his courage, and they set to work to fix it.
Joining Up, Getting Out
You can’t hear his accent anymore — that’s how diligently he has labored to erase it — but Mr. Wolfert grew up in La Crosse, Wis., on the Mississippi River, where the locals sound like cousins to Frances McDormand in “Fargo.” A sensitive little boy in a working-class family, he yearned to perform, especially to dance. Fearing ridicule, he took up martial arts instead.
After high school, he joined the Minnesota National Guard. Recruited for officer training, he stayed in the service for seven years, until 1993. When the first Persian Gulf war began, he was activated but not sent. He did spend time, though, with the School of the Americas, a military training institute at Fort Benning, Ga.
Along the way, even before his best friend was killed, accidentally shot in a nighttime exercise at the Army’s National Training Center in California, he began to question what he was doing, and to recoil at the notion that there is always glory in sacrificing one’s life for one’s country. “Honor,” he scoffed, and noted Falstaff’s speech on the topic from “Henry IV, Part I” — a highlight of “Cry Havoc!” for him.
“Can honor set to a leg?” Falstaff asks. “No. Or an arm? No. Or take away the grief of a wound? No. Honor hath no skill in surgery, then? No.”
As he and Mr. Tucker, a veteran of the Navy Reserve, have reshaped “Cry Havoc!” for New York, Mr. Wolfert has been thinking of adding Wilfred Owen’s World War I poem “Dulce et Decorum Est,” which describes in ghastly detail a man dying in action. “I struggle to read the thing and not sob,” Mr. Wolfert said.
He knows how it feels to be repelled by a war, even adamantly opposed to it, and to be simultaneously tempted to join the fight.
“I disagreed with both the Iraq and Afghanistan invasions, and yet when they extended the age to 40, I examined re-enlisting,” he said. “I felt like, I don’t agree, but if we’re going to be there, I should be there. Maybe I can save more lives — somehow? Look at the hubris in that. But that’s what went through my head.”
His back rebelled, though, when he strapped on a 65-pound rucksack and went for a run. “The cold, hard reality is I was a nondeployable asset,” he said. “I wasn’t going to do anyone any good.”
Mr. Wolfert worked with veterans in his own theater company during his decade in Los Angeles and has had supporting roles in Bedlam productions since moving to Brooklyn in 2013 with his wife, Dawn Stern, a former actress.
“Cry Havoc!,” which he has performed in various incarnations since 2012, puts him in the spotlight alone — laying bare his fragility, just as Mr. Tucker urged. Fixing the show meant rebalancing it, making the narration strong enough — and candid enough — to stand alongside the Shakespeare.
This time, though, Mr. Wolfert seeks something new. Sober for four years, and happy, he is determined not to let other people’s opinions dictate his behavior anymore. Yet a part of him hungers to know how he measures up, doing Shakespeare in New York.
“Do I deserve to be in the big leagues as an actor?” he asked.
It’s a vulnerable question. But he is more eager than afraid to find out.
Healing and Dealing
On a Monday night in early February, in an upstairs room at the Sheen Center on Bleecker Street, nearly 20 people gathered in a circle of chairs. This was Bedlam’s free, weekly veterans-only acting class, a place where healing and dealing are at least as important as the art.
The students are a multigenerational range of ranks and service branches, mostly men with a sprinkling of women. (A weekly Tuesday night class exclusively for female veterans, a more recent and as yet unfunded addition to the program, will go on hiatus during “Cry Havoc!”)
Mr. Wolfert tries to keep the stress low: There is no apologizing for anything, no raising of hands to speak, no scene-study-style critique of anyone’s performance.
Not all of these veterans are pursuing acting careers, but Chris Walker is. A strapping former Marine captain who served in Afghanistan, he stepped to the center of the circle when Mr. Wolfert asked for a volunteer to do a monologue.
Mr. Walker, 30, delivered a speech from “Macbeth” that he had been practicing for a month — the “If it were done when ’tis done” soliloquy, Macbeth’s debate with himself about whether to kill Duncan, the king. The class isn’t about performing Shakespeare’s plays; as in “Cry Havoc!,” Mr. Wolfert is interested in how a given monologue might resonate with a veteran, not what it means in its original context.
So as he led Mr. Walker through line reading after line reading, Mr. Wolfert gently but persistently asked him to think about what Macbeth, who’s experienced in war, is considering: killing someone in civilian life.
“We don’t kill people off the battlefield,” Mr. Wolfert said, and the conversation tripped from the text to real life. Speaking softly and with palpable anguish, Mr. Walker recounted a physical fight this winter that he didn’t start and didn’t want, in which he tried hard not to hurt his attacker even as someone goaded him from the sidelines to do what he was trained to do.
“Suddenly I was in adrenaline mode, and I hadn’t felt like that since the last time I had killed somebody,” Mr. Walker said. “It felt invasive and wrong. It’s not supposed to be like that at home.”
“Right. Right!” Mr. Wolfert said, and downshifted his excitement into soothing assurances of safety. “We’ve got you. You can leave this exercise at any time. All right?”
“Yeah,” Mr. Walker said.
“But just to explore it, can you do whatever it takes to get into that moment, that conflict that you just described?”
Mr. Walker paused for several beats, and when he dived once more into the monologue, the difference was extraordinary. His breathing was slower and more intense, his voice more powerful yet edged with a quaver. Afterward, he explained that he was thinking as he spoke about making a different choice in that fight: hurting the other guy.
To Mr. Wolfert, who teaches controlled methods of accessing charged memories, the need to retool a lethal skill set for civilian life is a vital task that the military leaves people to figure out on their own.
“That’s something that we hold uniquely, I think, as veterans,” he told the class. “We know what we’re capable of — even for the so-called peacetime or Cold War vets. The training’s still there. And I don’t care if you’re a clerk typist. You still fired a weapon at a human silhouette.”
This, he believes, is where Shakespeare can prove an ally: as a means to understand trauma, and to start coming back from it.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 4:17 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama
Comme d’habitude, quinze jours avant le Festival d’Avignon, le Festival Montpellier Danse annonce son programme. Et c’est à peine si l’on s’aperçoit qu’il réduit, cette année, sa voilure de deux jours et de quelques levers de rideaux. Stagnation de budget oblige malgré le soutien, toute la saison durant, de la métropole (1,5 millions d’euros de subventions), de la région (550 000) et de l’État (300 000 euros) dont le directeur du festival, Jean-Paul Montanari, a cependant souligné avec insistance la modestie persistante de l’engagement… Tout en rappelant l’importance du public local « formé et éclairé à 100 km à la ronde » autour de Montpellier.
A peine si l’on remarque ces économies (avec qui beaucoup de programmateurs composent désormais), tant l’affiche, où figurent quatorze chorégraphes venus de dix pays, est… dansante. Sans doute plus grand public que d’habitude, avec quatre grandes pièces partant à l’assaut du Corum, cette trop grande salle des années 80 de 2000 places : « Comme pour la Cour d’Honneur à Avignon, si on “rate” le Corum, on rate le festival », répète à l'envi Jean-Paul Montanari. On y reverra Dance, la fameuse pièce signée en 1979 par Lucinda Childs, recréée si puissamment par Le Ballet de Lyon à l’automne dernier ; les deux pièces qu’Angelin Preljocaj avait conçues en 1997 et 2013 pour le New York City Ballet : La Stravaganza (sur Vivaldi) et Spectral Evidence (partition de John Cage) enfin rassemblés en une soirée, interprétée par sa troupe ; la pièce créée par Marie Chouinard à Avignon l’année dernière (Soft vituosity, Still humid, On the edge) ; et enfin, deux programmes du Dutch National Ballet conçus par le chorégraphe Hans van Manen « moins connu que Jiri Kylian et son travail au Nederland Dans Theater à l’époque, selon Montanari, mais tout aussi fin »…
Parmi les projets alléchants, on note le sacré pari d’Emanuel Gat avec le Ballet de Lyon (encore) conçu comme un événement pour Montpellier Danse : mêler les deux compagnies (l’une indépendante et contemporaine, l’autre ballet de répertoire) pour un programme à la fois différencié et mixé (trois pièces sur ces Ten works ne seront visibles qu’au festival).
Avec une expédition-exploration de l’histoire argentine sur le principe du Bal de Jean-Claude Penchenat et de sa troupe du Campagnol (qui revisitait l’histoire de la danse en société et de la société tout court dans les années 70), la chorégraphe Mathilde Monnier tient le flambeau des spectacles les plus ambitieux. Sans la rencontre avec l’écrivain argentin Alan Pauls, auteur du synopsis, elle ne se serait pas sentie « autorisée », avoue-t-elle, à partir à Buenos Aires et à y choisir douze danseurs. Autre voyage sud-américain : celui que nous promet la chorégraphe du Cap Vert Marlene Monteiro Freitas avec Bacchantes, prélude pour une purge, pièce a priori expressionniste et jubilante. Tout comme la Danse Malade du Brésilien Marcelo Evelin qui ne devrait pas laisser indifférent et que l’on retrouvera ensuite au Festival d’Automne. L’été des festivals, sur le papier en tous cas, commence bien à Montpellier.
Du 23 juin au 7 juillet : Programme complet et tous les détails sur montpellierdanse.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 3:57 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart
Au Petit 38 à Grenoble, Chantal Morel accompagne deux actrices dans la vie d’Hölderlin, entourée d’amis qui lui sont chers. Eblouissant. Une belle façon de dire adieu à ce lieu qu’elle occupe depuis plus de vingt ans et qu’elle quitte en en confiant les clefs à une jeune équipe.
Sur la caisse (une modeste table en bois) à l’entrée du Petit 38, rue Saint-Laurent à Grenoble, un tas de petites feuilles de couleur, des modestes feuilles A4 fraîchement pliées en deux. C’est le programme. Sur la première page, un dessin : dans un grand miroir posé contre un mur, un homme de dos, assis sur un fauteuil en bois, siège en paille tressée et accoudoirs légèrement galbés, regarde devant lui, au-delà de la fenêtre, un paysage de montagnes.
Se consacrer à la poésie
Au-dessus du dessin, le titre du spectacle, Le Chagrin d’Hölderlin, sans qu’y figure le nom de celle qui signe la mise en scène : Chantal Morel. En dessous du dessin, une citation du poète allemand : « Hélas : le dieu en nous est toujours solitaire et misérable. Où trouverait-il tous ceux qui lui sont apparentés ? Ceux qui furent là, autrefois, et qui seront là ? Quand viendra le grand revoir des esprits ? Car, ainsi que je le crois, nous fûmes une fois tous ensemble. »
On ouvre la page pliée. Au verso du dessin, un texte dit pour l’essentiel ce que fut la vie de Friedrich Hölderlin en s’attardant sur son enfance (son père meurt quand il a deux ans, le second mari de sa mère quand il a neuf ans), le petit séminaire où il a pour condisciples Hegel et Schelling, sa volonté grandissante jusqu’à devenir absolue de ne pas devenir pasteur mais de se consacrer à la poésie, sa première publication, son emploi de précepteur et l’amour violent pour la mère de son élève (Suzette qui lui inspirera la Diotima de son Hypérion), son départ forcé, plus tard son arrivée à Bordeaux pour un autre poste de précepteur, les poèmes qui se multiplient, les lettres, les traductions de Sophocle et sa fascination pour la Grèce, La Mort d’Empédocle.
Une constellation d’amis
Et puis, « de plus en plus inquiet et solitaire », l’internement en 1806 puis les 37 années passées à Tübingen auprès du menuisier Zimmer et de sa fille Lotte. Le spectacle suit ce fil et s’arrête là, à l’orée de ce silence, dans le retournement d’une bouleversante berceuse empruntée à Georg Büchner et mise en musique par Patrick Najean qui accompagne Chantal Morel depuis des lustres, tout comme le scénographe Sylvain Lubac. C’est ce dernier qui signe le dessin de la couverture du programme et celui qui figure en dernière page sous la distribution du spectacle : le même fauteuil en bois, mais vide. Le poète est parti. A moins que cela ne soit Chantal Morel. Partis. Dans la montagne, sans doute. Le spectacle, en parlant d’Hölderlin et de sa constellation d’amis, en ne parlant que de ça, ne cesse de nous parler de Chantal Morel, déployant la poésie irradiante de son théâtre intime.
En regard de la page consacrée à la vie d’Hölderlin, c’est la page des « Merci ». Aux compagnons d’aujourd’hui du poète allemand que sont Nathalie Schleif et Laurent Henrich, à ceux qui ont prêté leur voix pour les sous-bois du spectacle, à « Adrienne, pour les fenêtres », à « Amélie, pour le bois », à d’autres encore, à tous ceux qui, le temps du Chagrin d’Hölderlin et au-delà donnent un sens au mot « ensemble ».
Il n’y a guère aujourd’hui qu’au Théâtre du Radeau qu’on trouve de semblables programmes qui ne s’encombrent pas de fioritures et de chiures de mouches. Et corollairement, les deux aventures habitent des lieux où il faut bon entrer. Le Petit 38, lieu de l’Ensemble de Création Théâtrale de Chantal Morel, est en tout petit ce que la Fonderie du Mans, lieu du Théâtre du Radeau, est en très grand. Comme au Mans, rien n’indique sur la devanture le trésor qui est à l’intérieur.
"Le chagrin d'Hölderlin", autre scène © Sylvain Lubac
Rien ne semble avoir changé au Petit 38. Sur le côté droit de la vitrine, on lit toujours ces mots attribués à Orson Welles : « En ces temps de supermarché, je reste votre sympathique épicerie de quartier. » A l’intérieur, le vin servi en carafe est toujours à prix libre, et pour voir Le Chagrin d’Hölderlin il vous en coûtera 7, 10 ou 15€ ; c’est vous qui choisissez en conscience.
Des étagères sans livres
Cependant le long d’un mur, des étagères sont vides. Chantal Morel a emporté ses livres. Depuis le 1er mars, ce lieu (de par la volonté de celle qui l’occupe depuis plus de vingt ans) n’est plus le sien (lire ce blog demain) : il est désormais géré par une équipe dont l’un des membres est l’une des deux actrices du spectacle Le Chagrin d’Hölderlin. On ne saurait rêver plus doux, plus juste, plus déchirant et plus pudique adieu.
Le public – la salle peut accueillir 24 spectateurs – se presse dans ce petit lieu chaleureux qui ressemble à un modeste gîte (la cuisine est au fond à droite) et nullement à un hall de théâtre. Un mur de photos garde la porte d’entrée en bois qui donne accès, juste derrière, à l’aire du spectacle. Hölderlin au centre ; autour, tous ceux qui ont gravité autour de lui durant de longs mois de gestation du spectacle. Les amis du poète, mais aussi Novalis, Spinoza, et encore Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Walter Benjamin, Arthur Rimbaud, Didier-Georges Gabily, Samuel Beckett, Gilles Aillaud, Jacques Tati, Paul Celan…
Simplement intensives
On prend place sur l’un des deux bancs en bois de la salle posés devant un mur et construits pour l’occasion. Que voit-on ? Sur le côté gauche, quatre vieilles planches au bois raviné par la pluie et la neige semblent avoir dévalé la montagne pour finir leur vie ici, devenant tour à tour une couche, un promontoire, un parapet, un refuge. Au-dessus, un dessin en cache un autre par un habile jeu de rideaux. Juste à côté, une fenêtre et puis, plus au fond, une autre fenêtre et encore une devant et encore une plus loin, tout cela pris dans la nasse d’un jeu de palissades, de couloirs, de recoins. Et puis aussi une échelle, un pichet d’eau, des bougies, des lampes-tempête, une robe que l’on enfile à demi.
Les deux actrices, Elisa Bernard et Eloïse Guérineaudelamérie, sont passées par le conservatoire de Grenoble et se sont retrouvées là où il fallait qu’elles soient et Chantal Morel les a reconnues. A elles deux, simplement intensives, elles se glissent dans Hölderlin, sa mère, son amante, ses amis. Le rôle du poète passe de l’une à l’autre, éclairant ici sa volonté obstinée, là sa sensibilité maladive, ensemble elles partent à l’assaut du Rhin, « le plus noble des fleuves » : un trou noir que forme maintenant la pièce du Petit 38 où nous étions tout à l’heure, la bande-son gronde sans déchirer les oreilles : « C’est l’éclair / Qui sillonne et déchire la terre, suivi / D’un fuyant cortège de forêts enchantées, / Parmi l’écroulement des monts ». Le théâtre se grandit toujours lorsqu’il creuse sa nudité et sa précarité premières.
Friedrich Hölderlin (qui signe Fritz la plupart de ses lettres) à la poésie si haute, si intraduisible bien que magnifiquement traduite par Philippe Jaccottet et quelques autres comme Gustave Roud, Chantal Morel l’approche comme un animal sauvage, lui parle doucement, l’apprivoise dans les passages des parois en bois ouvrant sur l’inconnu. Elle se tient au plus près de l’être humain que fut le poète, l’éclairant par ses proches, en lisière de sa poésie, qu’elle distille à petit feu comme on le fait pour les alcools forts, chaque goutte inondant l’air d’effluves insensées. Ainsi nous vient Le Chagrin d’Hölderlin dans la merveilleuse incertitude interprétative de ce titre que chacun entendra comme il voudra. Tous les spectacles de Chantal Morel sont des offrandes. Celui-ci est son cadeau d’adieu au Petit 38 (lire demain).
Petit 38 à Grenoble les 11 et 12 mars puis du 28 mars au 2 avril.
Photo : Scène du spectacle "Le chagrin d'Hölderlin" © Sylvain Lubac

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 8:26 AM
|
Par Hélène Rochette dans Télérama
Isabelle Huppert et Louis Garrel dans Les Fausses Confidences, l’adaptation de Marivaux, réalisée par Luc Bondy
Virevoltante adaptation de la pièce de Marivaux, c'est dans les coulisses du Théâtre de l'Odéon que Luc Bondy a filmé “Les Fausses confidences”. Les deux acteurs reviennent sans concession sur la dernière réalisation de Luc Bondy, disparu en novembre 2015.
Réunis au théâtre de L’Odéon, à Paris, le 1er février dernier, Isabelle Huppert et Louis Garrel présentaient Les Fausses Confidences, l’adaptation de Marivaux, réalisée par Luc Bondy peu avant son décès. Une fiction tournée au printemps 2015, en même temps que la reprise sur scène de la pièce, qui est diffusée ce soir sur Arte. A cette occasion, les deux comédiens reviennent très librement sur cette adaptation de la pièce de Marivaux, le travail de Luc Bondy et les différences entre théâtre et cinéma. Morceaux choisis.
Coup de maîtreSur Arte, des “Fausses Confidences” étincelantes par Luc Bondy
Isabelle Huppert : Quand Luc nous a parlé de ce projet de fiction des Fausses Confidences pour Arte, je me suis souvenue du film extraordinaire [réalisé en 1988, ndlr] qu’il avait tiré de sa pièce Terre étrangère, d’après Arthur Schnitzler. Sur scène comme sur l’écran, les acteurs étaient magnifiques : il y avait Bulle Ogier, Kristin Scott-Thomas, Michel Piccoli, Didier Sandre… J’ai tout de suite su qu’avec Les Fausses Confidences, ce serait la même chose. Qu’il ne ferait pas une captation classique, que son film serait inhabituel.
Louis Garrel : Le côté fou de cette pièce des Fausses Confidences c’est qu’il n’y a quasiment pas d’intrigue ! Dans une comédie romantique, on distingue ceux qui sont amoureux de ceux qui ne le sont pas, et la grande question est de savoir quand les premiers vont enfin déclarer leur flamme aux seconds. Avec Marivaux, c’est autre chose ! Les Fausses Confidences, ce serait un peu comme si on avait la matrice d’une comédie romantique, mais avec la profondeur d’une histoire qui s’écrit en temps réel : les personnages se demandent eux-mêmes s’ils sont amoureux ! Toute la pièce repose sur cette ambiguïté… Au début, j’ai eu peur qu’on se casse la figure avec cette version filmée d’une pièce classique si énigmatique, mais quand j’ai vu Luc corriger à mesure le scénario, dépasser les obstacles en multipliant les lieux de tournage dans L’Odéon : sur la terrasse, dans le parc du Luxembourg, je me suis dit qu’il allait faire un objet baroque, très étrange ! Et pour moi, c’est une qualité que de faire un film étrange !
Dans le parc du Luxembourg
Isabelle Huppert : La transition entre théâtre et cinéma a été d’autant plus simple que l’interprétation de la pièce par Luc était déjà très contemporaine. Avec le film, on a franchi une étape supplémentaire en amenant un aspect plus urbain… Mais le passage entre la scène et le film a surtout été facilité par le fait que la langue de Marivaux peut se dire de manière très naturelle, très moderne. C’est une langue sinueuse, délicate. Et même si ce n’était pas tout à fait le même texte que sur scène, il n’y a pas eu de saut fondamental entre le jeu au théâtre et le jeu pour la caméra ; il a juste fallu adapter la force sonore de la voix… Evidemment c’était un peu spécial de jouer en continu Marivaux, toute la journée devant la caméra, et tous les soirs à l’Odéon ! Bizarrement, je n’ai pas du tout le souvenir que c’était un tour de force !
Louis Garrel : Oui, toi tu n’as pas eu cette impression ! Pour toi, ce n’était pas dur…
Isabelle Huppert : Ce que je veux dire, c’est que même si c’était une sacrée gymnastique, ce n’était pas désagréable ! La concentration que demande le théâtre est très différente de celle du cinéma. Quand on tourne un film, on peut aller se balader entre les jours de tournage, parfois entre les séquences. Sur scène, au contraire, on a cette tension qui monte au cours de la journée et on a du mal à se détacher de la représentation du soir. A part le matin, où l’on peut se libérer l’esprit, on est constamment happé par cette force. Souvent, on tente de faire mille choses dans la journée qui n’ont rien à voir avec la pièce !
“Le grand paradoxe de Luc, c’est que lorsqu’il faisait du cinéma, il détestait le cinéma et voulait faire du théâtre”
Louis Garrel : La grande différence vient aussi du fait que quand on joue la pièce sur scène, les cinq cents spectateurs de la salle forment une sorte de contrepoint : c’est comme un commentaire sur ce que l’on est en train de faire. Et parfois, cela va nous révéler des choses, à nous-mêmes acteurs, plongés dans l’énigme de Marivaux ! Par exemple, avec Luc, on s’est rendus compte que cela riait très fort dans des situations qu’on jouait tragiquement. Moi, cela m’a déstabilisé, au début, de ne plus avoir la réaction du public quand on jouait devant la caméra, surtout pour les passages sur la souffrance amoureuse, le narcissisme ou la cruauté. Ne plus avoir ce repère, c’était vertigineux !
Isabelle Huppert : C’est vrai que dans la version filmée, on avait perdu ce partenaire. Car le public est un partenaire. Et dans la fiction de Luc, avec ces monologues face caméra, on a une version plus intériorisée, plus feutrée…
Louis Garrel : Le grand paradoxe de Luc, c’est que lorsqu’il faisait du cinéma, il détestait le cinéma et voulait faire du théâtre, et quand il faisait du théâtre, il détestait le théâtre et préférait le cinéma ! Je me souviens d’une intervention télévisée de lui, où il était sur le plateau d’une émission avec Claude Régy. Ils étaient tous les deux invités pour parler de théâtre à la télé ; et c’était très drôle car Claude Régy était venu dans l’idée de défendre la pratique théâtrale comme un art qui surpassait tous les autres types de récit… Et je vois encore Luc, assis juste à côté de lui, et qui ne parlait que d’une chose : Breaking Bad ! Luc adorait les séries télé.
Isabelle Huppert : Je trouve en tout cas qu’il a merveilleusement réussi à transformer cet objet de théâtre des Fausses Confidences en objet cinématographique. C’est d’autant plus remarquable que souvent, les spectacles captés ou adaptés de pièces, ne sont pas la meilleure manière de promouvoir le théâtre !
Louis Garrel : Pour moi qui ai une vraie fascination pour Marivaux et pour sa langue, l’idée même qu’il y ait une version filmée de cette pièce, qu’on a adoré jouer pendant deux saisons à Paris, et ensuite en tournée, c’est inespéré…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 6:24 PM
|
Par Philippe Lançon Envoyé spécial à Bruxelles, pour Libération
En confiant tous les rôles de «Five Easy Pieces» à des enfants, le metteur en scène suisse allemand Milo Rau interroge la notion même de théâtre, entre imitation et voyeurisme, dans une création inspirée du drame de 1996 mettant en cause le pédophile belge.
Le crime, le jeu, l’enfance, l’humanité et l’histoire d’un pays se retrouvent là, sur scène, élevant chacun au cœur des ténèbres et de la compassion.
Milo Rau met en scène et en abyme le monde et le théâtre tels qu’il vont. Il est né à Berne en 1977. Il a pas mal voyagé, lu, interrogé. Il fait aussi du cinéma et, il y a vingt ans, il était influencé par Quentin Tarantino, qu’il définit plaisamment : «Un intellectuel qui fait semblant d’être un idiot accompli.» Milo Rau est un artiste qui fait semblant d’être un naturaliste accompli. Il a lu Bourdieu. Il a commencé par être journaliste et il l’est toujours, quand il ne fait ni théâtre ni film, comme critique littéraire dans une émission de télévision suisse allemande. Quand il a ouvert la Route des Flandres, de Claude Simon, huit heures ont passé avant qu’il referme le livre, et c’est un mal au ventre qui l’a réveillé : il en avait oublié d’aller pisser. Au théâtre, il présente des destins. Il y a quelque chose de grec dans son travail, un soin hiératique apporté aux individus mordus au sang par l’histoire, dans un monde sans dieux mais pas sans horizon, ni sans poids léger. Pour le dire d’un paradoxe, il restitue la violente complexité des existences contemporaines en les concentrant. Il se sert du théâtre pour comprendre la vie, et de la vie pour comprendre le théâtre. C’est un métier, et c’est du sacré métier.
Cette dynamique créative à double sens anime Five Easy Pieces, directement inspiré par la vie et les crimes du Belge Marc Dutroux. Sur scène, après s’être présentés sous leurs vrais noms et nous avoir fait part de leurs hobbies, parfois en chantant, sept enfants flamands jouent les rôles de différents protagonistes : du père de Dutroux à l’une de ses victimes, d’un policier chargé de l’enquête aux parents d’une autre victime, en passant même par le roi des Belges. Le spectacle commence par une cérémonie coloniale et s’achève par un enterrement. Tandis qu’ils jouent, les enfants sont filmés par un coach qui les interroge, les corrige, s’amuse avec eux, les manipule sans les manipuler. Ce coach pourrait aussi bien être Dutroux, que nul n’interprète.
Des scènes sont projetées en direct sur un écran situé au-dessus de la scène, mais, si elles présentent les mêmes personnages, c’est pour leur faire jouer une autre cérémonie que celle qu’on voit, au même moment, sur les planches. Ce n’est donc ni la réalité ni une reconstitution : un espace net et flottant où l’une se révèle par les apparences de l’autre ; une surréalité. Les enfants sont les enfants, mais aussi les adultes qu’ils jouent, et encore autre chose. Ce qui offrait à Bruxelles, au Kunstenfestivaldesarts où nous avions vu le spectacle en juin dernier, un accès simple, direct et digne à la plus violente émotion. Selon le psychiatre Donald Winnicott, l’enfant qui joue est un être essentiellement concentré : il «habite une aire qu’il ne quitte qu’avec difficulté, où il n’admet pas facilement les intrusions». C’est dans cette aire que le spectateur est attiré par les enfants de Milo Rau. Il n’est pas déplacé, à propos d’un sujet aussi dur que l’affaire Dutroux, de parler ici d’état de grâce. Le crime, le jeu, l’enfance, l’humanité et l’histoire d’un pays se retrouvent là, sur scène, élevant chacun au cœur des ténèbres et de la compassion, par la magie austère de la distanciation. Entretien avec le metteur en scène, à l’occasion de la reprise de Five Easy Pieces au Théâtre Nanterre-Amandiers.
Pourquoi s’intéresser à cette affaire ?
Comme je travaillais en Belgique sur un spectacle précédent, j’avais demandé aux gens : «C’est quoi, pour vous, être Belge ?» On me répondait : «C’est l’équipe nationale de foot et la marche blanche de 1996, après l’affaire Dutroux.» Dutroux est donc devenu un alibi pour parler de la Belgique : quelque chose qui lie la décolonisation [il est né au Congo belge], la désindustrialisation [ses crimes ont eu lieu dans le bassin minier de Charleroi] et la paranoïa postmoderne qui a débouché sur la haine contemporaine des élites. Entre cette marche et la création de la pièce, vingt ans ont passé et la décomposition de la Belgique a continué. Tout ce qu’annonçait l’affaire Dutroux s’est renforcé. Au moment où nous travaillions, il y avait les jihadistes de Molenbeek, des gens qui étaient comme des voisins avec qui on aurait pu boire un verre au café. Tout cela m’a conduit à m’éloigner un peu du théâtre documentaire pour aller vers quelque chose de plus existentiel.
Quelle idée vous faites-vous de Marc Dutroux ?
Il n’apparaît pas dans la pièce et, comme je l’ai dit, n’est qu’un alibi pour parler d’une histoire et d’un état du pays. J’ai interrogé des psychiatres, des policiers, des gens qui l’ont connu. Pour moi, c’est quelqu’un qui est incapable de sentir, mais qui est très intelligent, et qui sait comment manipuler les autres en imitant des sentiments qu’il n’a pas. Avec juste, de temps en temps, une petite minute d’auto-sentimentalisme, mais pas plus. Il est comme un metteur en scène qui copie les mises en scène des autres : il suffit d’analyser et de ne pas sentir. C’est aussi pourquoi je ne me suis pas intéressé, dans mon travail, à son histoire psychologique. Le fait qu’il soit père, moi qui le suis aussi, m’a par ailleurs énormément choqué.
Comment avez-vous choisi les enfants ?
On a passé une annonce. Deux cents enfants ont envoyé leur photo et un petit texte chacun. On en a gardé quatre-vingt. Là, on a fait des groupes de huit personnes. On en a gardé trente. Puis on a fait un casting un par un et j’en ai finalement gardé sept. Il y avait au départ de vrais «petits acteurs », mais ils ne m’intéressaient pas. Je cherchais autre chose. Et puis il y a les lois du casting : si tu as un petit qui rigole, tu choisiras de mettre à côté un grand mélancolique. Avec les sept, et avec leurs parents, très associés au projet, on a commencé à raconter l’histoire de Dutroux, un personnage qu’ils connaissaient tous, tout en apprenant à tout faire : comment un vieillard tousse, comment on pleure, comment on se place sur scène, ce qu’on fait quand on se tait, comment être face au public.
Vous n’aviez jamais travaillé avec des enfants. Comment c’est ?
Avec les enfants, c’est simple : il n’y a que moi, l’entraîneur, et eux. L’entraîneur qu’on voit sur scène est joué par un autre, mais c’est moi. Première différence avec les acteurs : les enfants n’ont rien appris. En leur apprenant à jouer, c’est comme si je devenais metteur en scène avec eux. Ils comprennent très bien qu’il faut se donner à 100 %. Ce sont des professionnels nés. Simplement, il faut leur expliquer les choses, et les expliquer doit donner un sens à tout ce qu’on fait. L’enfant sur scène, c’est très joli, très drôle, c’est comme un animal (c’est-à-dire, comme ce que tout acteur rêverait d’être), le fétiche du théâtre postmoderne. Mais utiliser ce fétiche doit conduire à se poser des questions : pourquoi je l’utilise ? Qu’est-ce qu’on fait ici ensemble ? Ne suis-je pas coupable de l’utiliser ? Souvent, je les laissais vérifier eux-mêmes si ce qu’ils faisaient fonctionnait.
Avez-vous improvisé ? Par exemple, dans la terrible scène de la cave, où la petite fille, Rachel, hésite à se déshabiller, comme le lui demande le coach qui la filme, pour refaire les gestes d’une victime de Dutroux ?
L’improvisation avec les enfants, c’est difficile. Une fois, avec Rachel, on a essayé : ça n’a pas marché du tout, elle s’est mise à pleurer. Tandis que, si tout est écrit sur le script, y compris les hésitations, ça marche. On savait que le rôle de la victime devait arriver et on a choisi Rachel pour son physique. Au casting, cependant, elle avait joué un rôle de music-hall, elle est plutôt douée dans le style opérette. Il a donc fallu travailler avec elle la résistance, l’understatement, le style «flamand».
Que vous apporte ce travail avec les enfants ?
Je crois qu’il me permet de synthétiser l’histoire du théâtre et l’histoire de la performance. En Allemagne, où j’ai longtemps travaillé, il y a une tradition très forte de la performance, venue de Bertold Brecht et de la haine du naturalisme petit-bourgeois. A un moment, j’ai voulu combiner un nouveau réalisme avec la performance. Les enfants le permettent : sur scène, ils sont entièrement présents comme enfants et, en même temps, ils sont entièrement théâtraux. On leur dit : «Joue un prince», et ils jouent un prince, en l’étant totalement tout en sachant qu’ils ne le sont pas. Malheureusement, ils grandissent, et après, c’est perdu.
Sur scène, les enfants sont filmés. Ils jouent tous les rôles, mais ils ont l’âge des victimes de Dutroux. Et nous, on les regarde. Quels rapports y a-t-il entre le théâtre et le voyeurisme ?
Le voyeurisme est la source du théâtre. Il y a ceux qui sont dans la lumière - les personnages - et ceux qui sont dans l’ombre - le public -, et il n’y a pas vraiment d’échange entre les deux. Mais regarder, c’est aussi un travail. Le spectateur doit être dans une sorte d’hypnose, presque dans un rêve, à l’intérieur de quoi il doit se concentrer. Déconcentrer les gens, c’est ce qu’on fait tout le temps. Moi, j’essaie toujours de faire des choses simples pour éviter la dispersion, même si ça doit être lent, un peu ennuyeux. C’est comme la littérature. Il faut traverser l’ennui pour aller vers autre chose. L’idée de libérer le spectateur en le déstabilisant, en perturbant les limites entre la scène et la salle, en faisant au théâtre de la démocratie participative, cette idée n’a pour moi aucun sens. Je n’ai jamais trouvé ça drôle et je trouve même que c’est un peu humiliant. Mettre de la musique, des batteurs sur scène, comme dans les années 90, ça me paraît ringard et déplacé. Le spectateur doit être au calme, dans le noir et un certain confort. La fantaisie se développe quand il oublie son propre personnage et qu’aucun artifice ne vient le lui rappeler. Chaque soir, à Berlin, pour écrire mes pièces, j’allais dans une salle de cinéma voir des films muets. Pendant deux heures, face à ces images, je réfléchissais. Ensuite, j’écrivais. D’autres font du sport, je crois.
Philippe Lançon Envoyé spécial à Bruxelles
Five Easy Pieces
Texte et m.s. Milo Rau
Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, av. Pablo-Picasso (92). Du 10 au 19 mars. Rens. : www.nanterre-amandiers.com
Photo Phile Deprez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 5:30 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde
Reportage dans la cabane praguoise des jumeaux de Milos Forman, où ils répétaient « Deadtown », un drôle de western à l’affiche du Théâtre-Sénart, à Lieusaint.
Une bonne odeur de soupe remplit la voiture. Elle sera servie à la troupe d’acteurs et de marionnettistes des frères Forman, qui répète jusqu’au soir dans un hangar posé au bord d’un champ gelé, près de Prague. Là, pas de chauffage sauf un énorme tuyau jaillissant du mur entre les jambes d’un cow-boy – en réalité, un pantin grandeur nature – et débouchant dans la salle avec un vrombissement de turbo. Se poser juste devant garantit une température agréable. Sinon, café à volonté et brioches au pavot tiennent l’estomac au chaud. Sinon, à cheval pour courser la bande des Forman occupés à faire pétarader leurs flingues entre trois cactus montés sur roulettes.
Chaud devant ! Deadtown, nouveau spectacle western des jumeaux praguois, fils du cinéaste Milos Forman, sort les gros calibres. Le désert américain déroule son tapis volant sur fond de saloons paumés, avec poupées French cancan et lascars en goguette qui règlent l’addition en trouant le barman, évidemment. Mercredi 25 janvier, six semaines avant la création, mardi 7 mars, au Théâtre-Sénart, à Lieusaint (Seine-et-Marne), Petr Forman commente l’action, entre deux changements de plateaux, en laissant tomber des phrases énigmatiques comme des sous-titres en français. « Je suis un magicien tchèque dans un cabaret paumé », précise-t-il en courant de la scène à la régie, et inversement. Il réussira à faire brûler en direct son portefeuille. « On attend le gros projecteur pour finaliser les images », glisse-t-il un peu plus tard. La tempête de sable sera pour demain. Un skateboard fuse. « En 1976, nous sommes allés aux Etats-Unis fêter l’Oscar de notre père pour Vol au-dessus d’un nid de coucou et nous avons rapporté un skate, s’amuse Petr Forman. Nous étions les premiers à en avoir un ici. »
Fantasme amoureux et moqueur
Un western en République tchèque ? Une grande illusion entre cinéma muet, Tex Avery, Sergio Leone, Quentin Tarentino. Un fantasme amoureux et moqueur avec erreurs volontaires de casting et de boussole que les bisons projetés sur écran payent cash. Pour les Forman, un hommage au cinéma qui passe par l’animation du début du XXe siècle, celle de Karel Zeman (1910-1989) en particulier, pionnier tchèque du genre. Ou encore, au personnage de Jo Limonade, d’après le western tchécoslovaque foutraque réalisé par Oldrich Lipsky en 1964.
« Pour nous qui avons passé notre enfance à Prague, l’Amérique, les cow-boys auxquels on jouait enfants, mais aussi le cabaret et dans un autre registre la mer tout simplement, ont fait partie de nos rêves, poursuit Petr Forman. Et puis on a toujours envie de s’amuser et de créer un monde qu’on a imaginé gamin. » D’où cette cavalcade fanfaronne et faussement naïve accompagnée en direct par un band (français) de country tchèque.
Chez les Forman, chacun assume sa partie. Ici, Petr est à l’écriture, la mise en scène et fait l’acteur ; Matej, à la scénographie et à la construction. Les deux s’articulent comme les doigts de la main avec les tensions logiques d’une fraternité serrée collée. « Ils habitent l’un au-dessus de l’autre et leurs chiens n’arrêtaient pas de vouloir se battre », raconte un de leurs proches.
LEURS DÉBUTS SOUS LE RÉGIME COMMUNISTE DÉGAGENT ILLICO LEUR VOIE SINGULIÈRE.
Enfants, les jumeaux, nés en 1964, ont vécu avec leur mère, comédienne, leur père Milos s’installant à Paris quatre ans plus tard. Petr a étudié à l’Académie de théâtre et de marionnettes ; Matej a choisi les Beaux-Arts. Leurs débuts sous le régime communiste dégagent illico leur voie singulière. En 1984, ils déboulent dans la foire qui se tient l’été sur l’île des Archets (Strelecky Ostrov) à Prague. Pour déjouer la censure qui s’abat net sur les artistes trop téméraires, ils décident de monter des spectacles de marionnettes.
« C’était une île de liberté incroyable, se souvient Matej. Nous avons vite compris que les choses légères passent plus facilement et avons pu développer notre travail. » Souvenir de cette bulle de création, la barge de 70 mètres transformée en théâtre flottant où chaque été des petits concerts et spectacles sont proposés. Sinon ? Le hangar en bois et tôle susceptible d’accueillir 350 spectateurs qu’ils baladent au gré des tournées.
Statut d’anomalie
Envers et contre tout, depuis 1992, les Forman brandissent l’étendard d’un théâtre forain qu’on transporte sur son dos. Dans un contexte porté aux textes de répertoire – ils ont aussi mis en scène des opéras pour le Théâtre national –, avec une quinzaine de productions à leur actif dont le fameux Obludarium (2007), ils s’accrochent à leur statut d’anomalie. « La tradition des marionnettes se perd ici », précisent-ils.
Economiquement, le budget de Deadtown – 450 000 euros dont 150 000 de leur poche – a couvert un an de répétitions avec dix-huit interprètes qui, pour la plupart, vont et viennent entre différents spectacles pour gagner leur vie. « Il s’agit de les fidéliser pour travailler tous ensemble », précise Petr Forman, qui propose environ 1 500 euros par mois – le salaire moyen en République tchèque étant de 900 euros.
Artistiquement, ces héros modestes et acharnés d’un geste artisanal, proche d’Igor et Lily du Théâtre Dromesko avec lesquels ils ont créé La Baraque, cantine musicale – vin, soupe, musique (1996), enfoncent le clou d’un théâtre de proximité au sens noble, avec cirque, chansons, danses, marionnettes. A la fin de chaque représentation de Deadtown, le public est invité dans le saloon à fêter la soirée.
Deadtown, des frères Forman. Théâtre-Sénart, Lieusaint (Seine-et-Marne). Jusqu’au 18 mars. Tél. : 01-60-34-53-60. De 12 à 20 euros. Sur le web : www.theatre-senart.com
Rosita Boisseau
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 5:05 PM
|
Par Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale) dans Le Monde
À Rennes, le metteur en scène offre une version incandescente de la pièce de Maxime Gorki.
Ici, il ne reste que l’homme, dans toute sa nudité. » Ici ? Dans Les Bas-Fonds, de Maxime Gorki, dans lesquels on plonge grâce au spectacle intense et incandescent que signe Eric Lacascade. Le metteur en scène revient à son cher répertoire russe, qui lui a toujours réussi, et singulièrement à Gorki, dont il a déjà monté Les Barbares et Les Estivants. Le spectacle est présenté au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, jusqu’au 11 mars, avant d’arriver au théâtre Les Gémeaux, de Sceaux, du 17 mars au 2 avril, où il est programmé en lien avec le Théâtre de la Ville.
Ici, c’est « une cave qui ressemble à une grotte », écrit Gorki au tout début de sa pièce. En fait, un hospice pour les déclassés, les exclus, les marginaux, les malheureux, les bons à rien qu’une société rejette sur ses rivages. Un non-lieu qui pourrait devenir un de ces « hyper-lieux » qu’explore le géographe Michel Lussault dans un livre passionnant, où l’on découvre que l’avenir de notre monde se joue peut-être plus là, paradoxalement, qu’en ses centres.
La cave-grotte est ici un vaste espace où se déclinent toutes les nuances de noir, avant que n’apparaissent peu à peu les gris de la vie, et même quelques éclats de blanc pur. Ici vivent Mikhaïl Ivanovitch Kostylev et sa femme, qui sont les tenanciers de l’hospice et n’ont rien à envier à nos bons vieux Thénardier. Autour d’eux, l’humanité blessée qui peuple leur bouge. Il y a là Kletch, le serrurier, avec sa femme, Anna, sur laquelle il crie et il tape, et qui se meurt de tuberculose.
DANS CET UNIVERS OÙ TOUTES LES COULEURS VIVES ONT DISPARU, CE SONT BIEN DES ÊTRES HUMAINS QUE NOUS AVONS DEVANT NOUS
Kletch est le seul qui travaille encore. Les autres, qui ont été baron, acteur ou cordonnier, ont dérivé de leurs amarres. Ils ont échoué ici, où il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que boire, pour s’oublier. Que fait l’homme, quand il est confronté à sa dépossession, plus crûment encore que quand son insertion sociale lui permet de masquer cette nudité consubstantielle à la condition humaine ? Il choisit, plus crûment encore, entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres.
Tel est le parcours dans lequel nous emmène Gorki quand, dans ses bas-fonds, débarque un nouveau pensionnaire, Louka. Il n’est pas comme les autres. Il pourrait être le pèlerin d’une nouvelle religion qui serait celle de l’homme, et, s’il prêche, c’est par l’exemple – celui de la simple bonté, de la pitié pour la souffrance et de l’empathie pour l’autre.
Résolument contemporaine
Son arrivée va dérégler l’équilibre de bric et de broc qui régnait dans l’asile de Kostylev, emmenant certains de ses pensionnaires vers une forme de rédemption reposant sur la fraternité, en conduisant d’autres à se noyer dans l’abîme le plus noir. Gorki a écrit la pièce dans la Russie prérévolutionnaire de 1902. Et force est de constater que les résonances sont aiguës avec ce que nous vivons aujourd’hui, surtout dans la mise en scène d’Eric Lacascade qui, comme à son habitude, monte la pièce de manière résolument contemporaine, ancrée dans notre monde.
Crue, gorgée d’énergie, portée par des acteurs au jeu superbement physique et concret, la mise en scène de Lacascade, en retrouvant l’électricité, l’humanité profonde qui ont fait le prix de ses grands spectacles, gomme ce que Gorki peut avoir parfois d’un peu simpliste. Dans cet univers où toutes les couleurs vives ont disparu, où les petits lits recouverts de couvertures en feutre se transforment en un clin d’œil en cercueils, ce sont bien des êtres humains que nous avons devant nous, dans le présent du théâtre, qui est celui de leurs vies.
S’ils sont là, tellement là, et ne nous lâchent plus, c’est bien grâce à une troupe d’acteurs comme Eric Lacascade sait les réunir et les diriger. Plusieurs de ses vieux compagnons de route portent cette aventure, rejoints par des acteurs plus jeunes, excellents eux aussi. Et c’est un bonheur en soi que ce théâtre de troupe, qui se fait de plus en plus rare sur nos scènes pour des raisons de coûts de production.
Densité rare
Jérôme Bidaux, lutin tragi-comique, pantin démantibulé, comédien virtuose, joue L’Acteur, celui pour qui la tragédie devient réalité, celui que ses mots perdus, noyés dans l’alcool, ne sauveront pas. Christophe Grégoire est d’une densité rare dans le rôle de Satine, l’assassin qui retrouve son cœur pur, comme décapé à l’acide de la crasse qui l’avait recouvert. Alain D’Haeyer est magnifique en Louka, celui qui révèle aux autres si leur âme est morte ou encore vivante. Murielle Colvez, que l’on avait un peu perdue de vue et que l’on retrouve avec plaisir, déploie toute la folie de jeu dont elle est capable dans le rôle de Vassilissa Karpovna, l’exploiteuse sans scrupules. Après les représentations de Rennes, c’est Eric Lacascade lui-même, qui est aussi un acteur de forte présence, qui endossera le rôle de Medvedev, le commissaire de police, et le spectacle devrait encore y gagner.
Gorki n’est pas Tchekhov, et son image d’auteur officiel du régime soviétique ternit son œuvre, aujourd’hui encore. Mais Les Bas-Fondsont été écrits bien avant que l’espoir de l’avènement d’un homme meilleur ne se fracasse sur les folies du stalinisme. Et ce qui peut apparaître comme une forme de naïveté s’enracine chez l’auteur russe dans une expérience personnelle et viscérale.
Déchéance partagée
Gorki (un pseudonyme qui veut dire « amer », en russe) sait de quoi il parle, quand il parle des bas-fonds de la société, lui qui, orphelin à 8 ans, fut chassé par son grand-père et exerça moult métiers pour survivre, de cordonnier à plongeur sur un bateau, de docker à gardien de nuit.
Qu’est-ce que ce moment extrême de déchéance dans lequel se retrouvent les êtres des Bas-Fonds, comme tant d’êtres aujourd’hui ? Qu’est-ce que rester humain dans un monde ainsi fait ? La déchéance, évidemment, est au moins autant du côté des exploiteurs que des exploités.
Commencée dans la clownerie tragique, la traversée des Bas-Fonds avance peu à peu, grâce à son énergie vitale, vers une forme de transcendance qui n’a rien de céleste. Tout se termine dans une orgie de bière que ne désavouerait pas la metteuse en scène Angélica Liddell, avant la dernière image, saisissante, que l’on ne révélera pas. Les héros des Bas-Fonds ne sont pas des anges. Juste des hommes, aux prises avec cette question sans fin : comment vivre dignement dans un monde indigne ?
Les Bas-Fonds, de Maxime Gorki. Adaptation : Eric Lacascade, d’après la traduction d’André Markowicz.
Théâtre national de Bretagne, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. : 02-99-31-12-31. A 20 heures, jusqu’au 11 mars. www.t-n-b.fr
Puis au Théâtre Les Gémeaux, à Sceaux, du 17 mars au 2 avril. www.lesgemeaux.com
Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale)
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 3:38 PM
|
Par Véronique Hotte pour Théâtre du blog :
Anton Tchekhov critique le théâtre commercial de son temps qui, traditionnellement, loin de rendre hommage aux auteurs, acteurs et public, se moque un peu d’eux. Aussi est-il souvent question de l’art de la scène dans les œuvres du dramaturge russe, un fil infini et radieux du théâtre dans le théâtre, solide à l’extrême. Anton Tchekhov n’aimait pas non plus les « décadents »; La Mouette (1896) se lit comme une satire contre le langage grandiloquent et abstrait de la nouvelle école, et évoque les disputes sur les tendances d’un petit monde fermé, cruel et suffisant.
Dans la mise en scène de Thibault Perrenoud, le poète Constant Treplev (Mathieu Boisliveau) s’associe à cet esprit novateur en s’insurgeant contre les académismes à la mode ; à un moment savoureux, on voit Nina, apprentie comédienne, incarner l’idéal artistique rêvé. De la terre déversée sur le plateau, des sacs de jardinage jetés et vidés en vrac, et l’actrice en herbe, vêtue d’une peau d’ours, se roule dans la terre fraîche en proférant. Chloé Chevalier joue de sa belle énergie, d’une volonté et d’une joie d’être.
D’une façon générale, Anton Tchekhov recherche les «formes nouvelles » et, voulant «décrire la vie telle qu’elle est », rend compte à petit feu de sa banalité, selon une esthétique nouvelle. L’homme de théâtre reprend à son compte les paroles de l’écrivain Trigorine (Marc Arnaud), amant d’Arkadina (Aurore Paris), la mère de Constant-et amant prochain de Nina qu’aime d’un amour sans retour le jeune homme : «Jour et nuit, je suis poursuivi par la même idée obsédante, je dois écrire, je dois écrire, je le dois…»
Mais Anton Tchekhov fait résonner en même temps la parole de Constant, le fils d’Arkadina, actrice capricieuse et choyée qui ne rêve que de théâtre en vogue. Dans la pièce, le jeune poète amoureux de Nina ne s’intéresse pas tant à la forme mais plutôt à l’existence de l’âme.
Le dramaturge Anton Tchekhov/Constant s’insurge contre l’idée d’un héroïsme, producteur d’effets scéniques : «Pourtant, dans la vie, ce n’est pas à tout bout de champ qu’on se tire une balle, qu’on se pend, qu’on déclare sa flamme, et ce n’est pas à jet continu qu’on énonce des pensées profondes. Non ! Le plus souvent, on mange, on boit, on flirte, on dit des sottises. C’est ça qu’on doit voir sur la scène… »
Il faut laisser la vie telle qu’elle est, et les gens tels qu’ils sont, vrais et non exagérés, des êtres éclairés qui éprouvent plus ou moins toutes les sensations et émotions. Thibault Perrenoud prend au pied de la lettre la banalité quotidienne de la vie, une dimension privilégiée qu’il déploie à l’excès, faisant de cette Mouette, un spectacle flirtant avec le café-théâtre et les clins d’œil au public. Sur une scène quadri-frontale et de plain-pied, comme pour être dans le vif du sujet, et les comédiens agiles de Kobal’t surgissent des quatre coins.
Scènes d’été en maillot de bain et lunettes de soleil ; plancha pour l’instituteur qui fait griller poivrons et autres petits légumes ; bouteille de rosé pour Macha (Caroline Gonin), l’amoureuse éconduite du poète ; bottes de pêche pour l’écrivain (Marc Arnaud), tandis que le médecin Dorn (Eric Jakobiak) joue les sages et le vieux Sorine (Pierre-Stefan Montagnier), les fieffés impénitents. Tout ce petit monde se laisse un peu vivre, à fleur de peau, toujours sur le qui-vive, et au présent : l’une retient dans les cris d’une scène pathétique son amant volage, l’autre regrette bruyamment sa jeunesse perdue qu’il aurait voulu vivre à plein régime, et le troisième pleure à chaudes larmes, avant de se donner la mort…
Que de nervosité, comme il est dit dans La Mouette, mais ici l’électricité devrait laisser passer un peu plus ce courant poétique qui fait entendre «ce qui coule de l’âme».
Véronique Hotte
Théâtre de la Bastille, rue de la Roquette, Paris XIème, jusqu’au 11 mars, et du 13 au 25 mars puis du 27 mars au 1er avril. T : 01 43 57 42 14.
photo : Clément Camar-Mercier
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 12, 2017 1:58 PM
|
Par Stéphane Capron sur Sceneweb
Ce sera l’un des évènements de la 71ème édition du Festival d’Avignon, Olivier Py va présenter une adaptation de son roman Les Parisiens paru en septembre 2016 aux Éditions Actes Sud. L’histoire d’Aurélien, un jeune provincial qui se lance à l’assaut de la Capitale et du monde du théâtre. On le croise dans les fêtes, dans les salons, dans les lieux gay. On peut s’attendre à un spectacle fleuve, le roman compte plus de 500 pages. Olivier Py a montré une première version en janvier 2017 à la FabricA. Brigitte Masson a pu assister à cette étape de travail qu’elle relate sur son blog. « C’est drôle. C’est violent, dense, intense, provocateur, audacieux. « C’est joué ‘tambour battant’. Les jeunes acteurs ‘mettent la gomme’, sont ‘tout feu tout flamme’ et défendent la cause, les causes plutôt, de la pièce » écrit-elle.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 4:13 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
C’est au Petit 38, à Grenoble, de l’autre côté de l’Isère que Chantal Morel a créé son dernier spectacle, « Le Chagrin d’Hölderlin ». Elle habite ce petit lieu depuis plus de vingt ans, après avoir dirigé le Centre dramatique national des Alpes et en avoir démissionné, écrivant un "retour de mission" qui n’a rien perdu de son acuité. Elle vient de confier le Petit 38 à une jeune équipe.
Retour en arrière. En 1986, nommé auprès de Roger Planchon à la direction du TNP de Villeurbanne en remplacement de Patrice Chéreau, Georges Lavaudant mettait fin à ses années grenobloises. Un beau parcours depuis le Théâtre Partisan jusqu’à son entrée au CDNA (Centre dramatique national des Alpes) parrainé par le grand aîné Gabriel Monnet (l’un des papes de la décentralisation dramatique) et les belles années qui s’ensuivirent. La logique voulait qu’il fût remplacé par l’autre belle figure du théâtre à Grenoble, Chantal Morel et son groupe Alertes.
Une usine de boutons-culottes
A l’époque, on ne parlait pas d’appel d’offre, de short lists et autres agaceries ; on affirmait des choix. Nommer la jeune Chantal Morel à la tête du CDNA en était un. Fort (elle avait une réputation de « rebelle »). L’acteur Ariel Garcia Valdes (l’un des acteurs phares de la troupe de Lavaudant) l’accompagna, sans doute pour rassurer les élus et le ministère et tout autant pour rassurer Chantal Morel qui hésitait à franchir le gué.
Très vite, Chantal Morel se retrouva seule avec son administrateur de l’époque, Jean-Paul Angot, à la tête du Centre dramatique. Loin d’aller au bout de son mandat et d’en demander le renouvellement deux ou trois fois, elle démissionna de son poste au cours du premier. Une première dans l’histoire de la décentralisation dramatique et un cas unique. Pas un coup de tête, un geste réfléchi assorti d’un long texte, cosigné par Jean-Paul Angot, et rendu public en avril 1989.
Sous le titre « Retour de Mission », avec en exergue une belle phrase d’Adorno (« mettre du chaos dans l’ordre »), Chantal Morel dresse un portrait sévère de la situation du CDNA et, au-delà, de tous les centres dramatiques à l’orée des années 90.
Que constate-t-elle ? Que sur un budget (chiffres arrondis) de 7 millions de francs, 5 vont aux frais fixes de fonctionnement et 2 à la création. Aujourd’hui, près de trente ans plus tard, le rapport ne s’est pas inversé, il s’est aggravé. Et dans cette masse salariale fixe, que dénonce-t-elle ? « Le maintien de gens incompétents, une organisation administrative relevant plus d’une usine de boutons-culottes que du théâtre, le manque de réflexion, disons-le carrément, le manque d’intérêt entraînant les solutions les plus coûteuses par incompétence intellectuelle, (…) une ignorance complète de la situation actuelle du théâtre et de l’existence de réseaux de diffusion moins prestigieux » que celui des grands théâtres parisiens. Elle critique par ailleurs le nombre abusif d’invitations, la pratique des cocktails, le train de vie du théâtre : « Pourquoi offrir à boire et à manger à des gens qui vont glousser toute la soirée des inepties de privilégiés ? Dans ces moments-là, j’ai des visions d’apocalypse. Imaginez une horde furieuse débarquant, composée de gens qui ont faim, de chômeurs, de malades, de rejetés... » Le ton est cinglant, elle parle sans fard, sans gants.
« C’est dans l’endormissement, le manque d’idée et la conviction qu’un centre dramatique doit avoir une "image de marque" que réside l’aberration de cette masse fixe », ajoute-elle. Elle aborde bien d’autres questions et insiste sur le fait que rien de ce qu’elle avance n’est strictement lié au CDNA mais que c’est là « le symbole de la crise traversée par les CDN ». Et va plus loin : « si le constat que nous faisons est juste et qu’il s’avère impossible de bouger quoi que ce soit, ces centres dans leur forme actuelle doivent mourir ! Il ne faut plus avoir peur ! »
Le "retour de mission" et l’omerta
Mais ils ont tous eu peur. Les directeurs de CDN en place et ceux qui espéraient bien l’être un jour, les instances régionales, le ministère de la Culture, les syndicats. Partout, ce fut l’omerta. Attention : danger. Oublions cette empêcheuse de tourner en rond ! Loin d’être lu, considéré, interrogé, ce « retour de mission » fut aussitôt enterré, oublié. Ce texte qui aurait dû ouvrir un champ de réflexions fut considéré par beaucoup comme un affront. Des années durant, et en fait jusqu’aujourd’hui, Chantal Morel paya très cher son geste et ses mots. Elle allait devenir auprès de beaucoup une pestiférée, une has been précoce, quelqu’un dont il fallait et dont il faut toujours se méfier. Et, bien entendu, on ne lui proposa plus jamais rien. Rares sont eux qui ne l’oublièrent pas, suivirent son parcours aussi radical que talentueux, respectèrent sa personnalité peu apte aux compromis.
Partie du CDNA, Chantal Morel ne quitte pas sa ville, Grenoble. Elle fonde une nouvelle compagnie, l’Equipe de Création Théâtrale. Au CDNA, durant son année d’exercice, elle avait créé une pièce de Serge Valletti, Le jour se lève, Léopold. Elle poursuit dans cette veine en créant plusieurs autres de ses pièces : Mary’s à Minuit, Balle Perdue, Conférence de Brooklyn sur les galaxies. Suivront Un jour, au début d’octobre d’après Roman avec Cocaïne d’Aguéev (1990), Groom de Jean Vautrin (1991), Le Roi Lear de Shakespeare (1993) et, en 1995, Pourvu que le monde ait encore besoin de nous (dans l’usine Bouvier Darling à Grenoble), spectacle qui précède l’ouverture du Petit 38, au 38 de la rue Saint-Laurent à Grenoble.
La ville a fait l’acquisition de plusieurs locaux dans le quartier Saint-Laurent, de l’autre côté de l’Isère, au pied de la montagne. Elle loue le 38, un ancien café-restaurant de 89 m², à Chantal Morel et son équipe modeste mais fidèle. Ils vont en faire certes un théâtre, mais d’abord un lieu de vie.
Tout respire le bois
Passée la porte de verre du Petit 38, tout respire le bois. La salle où l’on entre, les murs, le sol, l’arrière-petite salle du lieu de répétition et de spectacle. Le vieux bois, celui des anciens décors de la compagnie, recyclés. C’est un lieu fait pour un petit nombre de personnes, une trentaine au plus. Les soirs de spectacles, on s’attarde autour d’une grande table. Un lieu « où poser nos utopies », écrit Chantal Morel, pour « rendre à la vie sa grandeur de partage et de songe », une « maison de théâtre », pour « retourner au murmure, au frissonnement à plusieurs », un lieu sans « programmation ».
Chantal Morel y entame ou plutôt y poursuit son long compagnonnage avec Dostoïevski en mettant en scène La Douce. Elle place une phrase du Russe en exergue de cette nouvelle aventure : « Sortir de l’isolement des esprits pour se rapprocher de ses frères même au risque de passer pour un fou. » Et l’associe à ces mots de Didier-Georges Gabily : « Il s’agit d’une déclaration de Je ensemble. » C’est un lieu à hauteur d’homme, fait pour l’écoute, la parole, fait aussi pour prendre le temps de faire sans le couperet du calendrier. Laisser les mots, les voix, les corps advenir sur la scène, là au fond, où l’espace scénique et l’espace public ne font qu’un mais aussi autour de la table, avant, après le spectacle. Et pas seulement le spectacle. Au fil de ces années, les rencontres vont se multiplier avec des scientifiques, des artistes, des anonymes, des gens du quartier, de Grenoble et d’ailleurs, des étrangers.
C’est ainsi que s’ouvre au Petit 38 une « Ecole des gens » dont s’occupe Gérard de Bernis, économiste et historien de l’économie. Chantal Morel : « A un moment, nous avons fait le constat : plusieurs membres de l’équipe se sentaient dépassés par les transformations du monde, la mondialisation, l’économie, la bourse. Dépassés et démunis… Nous nous sommes dit qu’en tant qu’adultes, pris dans les filets du quotidien, nous ne devions pas être les seuls à ressentir cette perte de repères pour comprendre ce monde nouveau. Alors, pour se forger une réflexion personnelle, pour acquérir des outils, comme nous manquions de compétences personnelles, nous avons demandé à un professionnel, un professeur. C’était la possibilité de dire "je ne comprends pas" et de faire en sorte que les gens qui viendraient puissent dire la même chose. » Plus tard, tout un cycle sera consacré à la politique par Jean-Pierre Arthur Bernard, professeur à l’IEP de Grenoble. Et plus tard encore un troisième sur le travail.
La grande table
L’équipe est restreinte. Aussi, quand l’Equipe de Création Théâtrale est embarquée dans une lourde création comme Crime et Châtiment qui sera créé à Strasbourg au Maillon en octobre 1997, le Petit 38 ferme quelque peu. Pour mieux rouvrir. Rencontres (Jack Ralite, Armand Gatti, Hélène Châtelain, Jean-Marie Boeglin, Gabriel Monnet et bien d’autres) et spectacles se succèdent ; La Révolte de Villiers de l’Isle Adam (1999), L’Invention de Morel d’Adolfo Bioy Casarès (2000), Frankenstein d’après Mary Shelley (2001). Ces créations sont souvent précédées de « lectures-feuilletons » publiques autour de la grande table accompagnant la préparation du futur spectacle. D’autres compagnies viennent travailler dans le lieu et présenter leurs spectacles. Grenobloises ou pas, comme La Belle Meunière de Pierre Meunier qui, avec Jean-Louis Coulloc’h, y façonne Le Tas. Il y a des choses que seul un tel lieu pouvait inventer, comme Le Droit de rêver ou Les Musiques orphelines que propose Patrick Najean à partir des musiques des spectacles qu’il a composées pour les spectacles de Chantal Morel.
Claude Régy viendra deux fois parler avec les gens du Petit 38 : « Les deux fois, j’ai senti que par la personnalité de Chantal Morel, les murs, si contraignants qu’ils soient, ne limitaient en rien la vie de l’esprit, sa circulation infinie. Le resserrement, par la simplicité du rapport, crée comme un approfondissement de ce qui s’échange. »
En 2004, Chantal Motel renoue avec Tchekhov dont elle avait monté Platonov au temps du groupe Alertes (le spectacle durait 8 heures) avec Macha s’est absentée, des variations autour des Trois sœurs (y mêlant bien des écritures, d’Adamov à Gabily en passant par Büchner et Hölderlin).
De midi à minuit
Et l’histoire a ainsi continué. En 2008-2009, ce fut le grand chantier des Possédés de Fédor Dostoïevski avec Marie Lamachère, Isabelle Lafon et bien d’autres (lire ici et ici), spectacle créé en janvier 2009 à la MC2 (l’ex-Cargo qui abritait le CDNA) dirigée par Jean-Paul Angot, l’ancien complice. Puis la longue tournée de la nouvelle version de Home de David Storey (lire ici). Durant ces périodes, le Petit 38 reste ouvert aux petites compagnies. Elles viennent y travailler et y présenter des spectacles : 2-3... grammes par Bernard Falconnet, avec Line Wiblé ; Ma Solange de Noëlle Renaude, par Denis Bernet-Rollande et Jérémie Mignotte ; Léo 38 de et par Monique Brun (sur Léo Ferré) ; Premier amour de Samuel Beckett, pour n’en citer que quelques-unes. Des venues parfois impromptues ou des prolongations de spectacles imprévus. C’est au Petit 38 que Chantal Morel a répété et créé en 2014 Ce quelque chose qui est là d’après La Nuit tombée d'Antoine Choplin (lire ici). Avant un retour en pointillés à Tchekhov avec Ils ne sont pas tous là..., des pages arrachées de La Cerisaie (lire ici).
Florent Barret-Boisbertrand, metteur en scène, est l’un de ceux qui ont poussé la porte de verre du Petit 38. Comme il s’y est senti bien, il s’est attardé. Elisa Bernard, que Florent Barret avait connue au conservatoire de Grenoble, a fait de même. Et quand Chantal Morel a envisagé de quitter le lieu où elle aura passé plus de vingt ans en confiant à d’autres les clefs du Petit 38, elle a pensé à Florent Barret-Boisbertrand et à Elisa Bernard (l’une des deux actrices du Chagrin d’Hölderlin) qui ont créé pour l’occasion le collectif Midi/Minuit, rejoints par un administrateur, Alejandro Alonso. Midi/Minuit car le but est d’ouvrir le Petit 38 tous les jours de midi à minuit. Le passage s’est fait en douceur au fil des derniers mois de l’année 2016, pendant le travail préparatoire et les répétitions du spectacle Le Chagrin d’Hölderlin. Il est effectif depuis le 1er mars 2017.
Au début de l’année, le collectif Midi/Minuit a lancé une opération « Bon d’armement culturel », chacun s’engageant à payer 4 euros par mois pour soutenir le petit lieu. Des ateliers ont été ouverts, des concerts sont annoncés, des expositions suivies de repas ainsi qu’une école du spectateur. Et, bien sûr, l’accueil des compagnies, la création de spectacles. Le Petit 38 continue.
Au Petit 38 :
Le Chagrin d’Hölderlin, 20h30, dim 17h, les 11 et 12 mars puis du 28 mars au 2 avril.
La Vie matérielle d’après Marguerite Duras par Cécile Coustillac et Marieke Bouche, 20h30, dim 16h, du 19 au 23 mars.
Photo Le petit 38 © Sylvain Lubac

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 1:09 PM
|
Propos recueillis par Clarisse Fabre et Fabienne Darge dans Le Monde
L’administrateur de la Comédie-Française estime qu’il y a « plus de talent chez les femmes que chez les hommes » dans la nouvelle génération.
« Tiens, c’est drôle, il y a une sorte de parité qui s’est faite… » Comme l’on dirait en descendant dans son jardin, « tiens, les fleurs se sont ouvertes », l’administrateur de la Comédie-Française Eric Ruf, âgé de 47 ans, observe l’air de rien la révolution douce qui s’est accomplie dans l’institution théâtrale qu’il dirige depuis 2014 : il y a autant, et même plus de femmes que d’hommes à l’affiche de la saison 2016-2017. Question de talent, explique le comédien et metteur en scène qui refuse de « brandir le drapeau de la parité », citant « l’éternelle phrase de Molière » : « Il faut faire et non pas dire. » Il n’empêche, Eric Ruf assume sa volonté de mener une politique égalitaire dans un univers, le théâtre, qui ne l’est pas.
Comment fabrique-t-on une saison paritaire, à la Comédie-Française ?
Je ne l’ai pas fait exprès, ce qui est plutôt rassurant. Cela veut dire que je suis plutôt le témoin d’une évolution, notamment dans la nouvelle génération. Quand je prépare une saison, je cherche des projets singuliers. Le premier réflexe que j’ai, c’est de choisir des artistes dont je sens qu’ils ont un rapport fertile aux comédiens, et ça, c’est un critère unisexe ! Ces dernières saisons, ce sont plutôt les jeunes femmes qui ont marqué le coup en faisant des choses retentissantes. Dans cette génération, il y a plus de talent chez les femmes que chez les hommes.
J’ai rencontré et programmé Marie Rémond, Julie Deliquet, Chloé Dabert, etc. Quand je les reçois dans mon bureau, je ne sens aucunement des jeunes femmes qui taperaient sur la table pour exiger leur dû… Je les trouve surtout assez impressionnantes. Quand Julie Deliquet a présenté la maquette de son spectacle Vania (d’après Oncle Vania) devant l’équipe du Français, elle a déroulé son projet avec une maîtrise étonnante. D’ailleurs Julie va revenir, je pense qu’elle est prête pour la salle Richelieu [la salle historique, où ont été présentés plus de 3000 textes du répertoire depuis 1680]. Il faut juste qu’elle abandonne son éternelle table de collectif, parce que dans un théâtre à l’italienne, cela bloque la vue [rires].
Qu’apportent selon vous ces artistes femmes ?
Prenons un exemple : je cherchais quelqu’un pour monter du Feydeau. Je connaissais Isabelle Nanty, elle a ce rapport à la vie, à l’humour qui me plaisait. En même temps, elle a ce côté norvégien qui la plombe, et elle n’a pas la carrière qu’elle mérite. Elle va donc mettre en scène L’Hôtel du libre-échange. Marie Rémond, elle, a fait le bonheur de cette maison avec son spectacle sur Bob Dylan - Comme une pierre qui… –, coécrit avec Sébastien Pouderoux. Je suis aussi en compagnonnage avec Chloé Dabert – elle sera au Français la saison prochaine –, que j’ai rencontrée au festival Impatience. Quant à Christiane Jatahy, qui présente actuellement La Règle du jeu, d’après le film de Jean Renoir, j’étais simplement amoureux de ses spectacles, c’est aussi simple que ça. Elle est tellement libre par rapport aux œuvres, alors qu’il existe souvent un respect à la lettre chez les metteurs en scène français. En ce sens, elle est exotique, et tellement pertinente ! Mais elle se serait appelée Markus Jatahy, cela aurait été la même chose…
Tout de même, on sent chez vous une attention à la question de la place des femmes…
Il faut dire aussi que j’ai eu plus de professeures femmes que d’hommes : Madeleine Marion, Catherine Hiegel, Joséphine Derenne… Au lycée, je faisais partie des deux ou trois garçons qui voulaient bien faire du théâtre au milieu d’un aréopage de filles – et avec un professeur de lettres qui était une femme. J’ai donc été nourri à l’autorité féminine, à un âge où je ne me posais pas la question de remettre ça en cause. Et les filles sont tellement plus douées, pour ce métier-là ! Mais il y a une injustice : au Conservatoire, les filles sont plus nombreuses, et l’on se retrouve à être un peu moins exigeant avec les garçons parce qu’il faut faire des promotions paritaires. Ensuite, dans la vie professionnelle, il y a plus de rôles pour les garçons dans le répertoire, ce qui dessert les filles…
Les femmes peuvent-elles jouer des rôles d’hommes ? En 1993, Maria Casarès avait interprété Le Roi Lear, dans la mise en scène de Bernard Sobel… Glenda Jackson vient de faire de même, à Londres, sous la direction de Deborah Warner…
Cela se fait parfois. Une comédienne de la troupe, Françoise Gillard, va remplacer un comédien parti en tournée dans 20 000 lieux sous les mers, parce que ça l’intéresse, et aussi parce qu’elle est très douée physiquement et va pouvoir manipuler des marionnettes.
Dans le Lucrèce Borgia de Denis Podalydès, la comédienne Suliane Brahim jouait Gennaro à la création [elle a depuis été remplacée par Gaël Kamilindi]. Et je dis bravo Denis ! J’avais moi-même interprété ce rôle dans le passé et elle s’en est mieux sortie que moi. Pour jouer l’adolescence chez Victor Hugo, qui est toujours tétanisée, stupéfaite, on a tendance à y mettre du muscle quand on est un homme – d’ailleurs j’étais un jeune premier un peu musculeux. Suliane, elle, n’est pas encombrée par sa masculinité. Je lui ai entendu des accents de stupéfaction qu’un bonhomme ne pourrait pas avoir…
Par ailleurs, je rappellerai juste qu’à l’époque de Shakespeare, un homme pouvait jouer le rôle d’une femme tout simplement parce que les femmes ne pouvaient pas jouer. Ce n’était pas un point de vue libertaire…
Comment trouver davantage de rôles pour les comédiennes ?
Il existe quelques « tubes » de pièces avec de beaux rôles de femmes : La maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, que l’on a présenté en 2015, et le Dialogue des Carmélites, de Georges Bernanos, que l’on montera sans doute un jour. Je suis aussi attentif, quand je lis des pièces du répertoire – c’est un travail que je fais en ce moment avec la metteuse en scène Lilo Baur, par exemple, qui va sans doute revenir travailler dans cette maison, et nous réfléchissons sur Gorki, Hanokh Levin… – à cette question de trouver des rôles pour les comédiennes. Quand je suis allé outre-Rhin voir Katharina Thalbach [actrice et metteuse en scène allemande qui, à partir du 1er avril, met en scène La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht, salle Richelieu], je lui ai demandé quels étaient les grands rôles pour des femmes de son âge. Elle m’a fait une liste de rôles que je ne connaissais pas, extraordinaires, issus de pièces russes ou allemandes.
La troupe de la Comédie-Française n’est pas paritaire…
Nous avons un gros tiers de femmes dans la troupe. C’est déjà très généreux, si je puis dire, au regard du répertoire qui comprend une grande majorité de rôles masculins. Arriver à la parité serait absurde. Ce serait joli sur le papier, mais s’il n’y a pas de rôles à
donner aux femmes, elles me demanderaient très vite pourquoi elles ont été engagées, à quoi elles servent, etc. Mais la Comédie-Française reste une maison assez protégeante, où l’on peut traverser quelques creux de hamac moins difficilement qu’à l’extérieur. Les comédiennes peuvent faire des enfants, elles sont attendues à leur retour. La coopérative d’acteurs est très généreuse.
Concernant les femmes auteurs, les autrices : y a-t-il une possibilité de redécouvrir des œuvres qui auraient été gommées dans le passé ?
Au comité de lecture, qui lui est paritaire, nous travaillons sur le sujet, et nous allons essayer d’exhumer des pièces. Mais j’ai une responsabilité, notamment avec la salle Richelieu : si l’auteur (trice) est méconnu(e), il m’est difficile de remplir la salle. Dans ce cas-là, je dois être très vigilant à trouver un(e) metteur(e) en scène emblématique, pour attirer le public.
Est-ce que l’égalité d’accès aux moyens de production, entre les hommes et les femmes, est inscrite dans le cahier des charges de la maison ?
C’est inscrit dans les mœurs… L’égalité de salaires est la règle, et les doyennes ont été ces dernières années plus nombreuses que les doyens. Certes, le système des « feux » [le cachet que touchent les acteurs du Français à chaque représentation] favorise les hommes, puisqu’ils jouent plus que les femmes… Mais la différence n’est pas énorme. Encore une fois, je pense que le mouvement pour l’égalité est vraiment en marche, et irréversible, dans le milieu du théâtre. Les derniers des Mohicans à qui cette question donne encore des boutons sont de plus en plus regardés comme des momies.
Clarisse Fabre
Reporter culture et cinéma
Fabienne Darge
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2017 12:42 PM
|
Règlement Prix RFI Théâtre 2017
Société organisatrice : France Médias Monde, Société Anonyme au capital de 3 487 560 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 501 524 029 ayant son siège social 80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les Moulineaux, représentée par Victor ROCARIES (Directeur général chargé du pôle ressources).
France Médias Monde est éditrice du service de communication radiophonique et multimédia dénommé Radio France Internationale (RFI), ci-après dénommée « RFI ».
Le « Prix RFI Théâtre 2017 », ci-après dénommé « le Prix », est organisé en partenariat, notamment avec :
- La SACD, société des auteurs et compositeurs dramatiques, 9, rue Ballu 75009 Paris ;
- L’Institut Français, 8-14 rue du Capitaine Scott, 75015 Paris;
- Le Festival des Francophonies en Limousin/ Maison des Auteurs, 11 avenue du General De Gaulle 87 000 Limoges ;
- Le Théâtre de l’Aquarium, route du Champ de Manœuvre, Cartoucherie 75012 Paris.
- Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, Théâtre des 2 Rives – 48 rue Louis Ricard – 76176 Rouen Cedex 1 ;
Ci-après « les Partenaires ».
1. Description du « Prix RFI Théâtre 2017 »
RFI, profondément engagée dans la défense des cultures du monde a décidé de renouveler son Prix Théâtre pour promouvoir les écritures dramatiques contemporaines de langue française.
France Médias Monde organise un Prix international à destination d’auteurs de théâtre dénommé « Prix RFI Théâtre 2017 ». Ce Prix a pour but de favoriser le développement de la carrière d’auteurs de théâtre d’Afrique, des îles de l’Océan Indien, des Caraïbes et du Proche et Moyen-Orient.
Le but du Prix est de promouvoir de nouveaux talents par le biais de textes propres, originaux et dotés d’une bonne qualité dramaturgique.
RFI, par le biais d’un Jury indépendant composé par ses soins (5. Composition du Jury), désignera le Lauréat.
Le Lauréat bénéficiera d’une lecture de son texte diffusée sur les antennes de RFI, d’une dotation financière et de l’organisation en France d’une résidence temporaire de création ainsi que d’une résidence temporaire de travail. Les termes exacts seront précisés au Lauréat lors de la remise du Prix et feront l’objet de contrats distincts conclus entre le Lauréat et les Partenaires dans la mesure où ces dotations sont fournies au Lauréat par ces derniers.
2. Calendrier du Prix
A titre indicatif, le calendrier de déroulement du Prix est le suivant :
- Le Prix se déroulera entre le 13 Mars 2017 et le 24 Septembre 2017.
- Les Candidats devront transmettre leur dossier de candidature à RFI entre le 13 mars 2017 et le 16 avril 2017. (Voir 4. Candidature).
- Les Candidats présélectionnés seront prévenus par téléphone ou mail de leur sélection le 15 juillet 2017 au plus tard.
- Date de la sélection du Jury : à compter du 1er septembre 2017.
- Date de communication du Lauréat au public: le 24 Septembre 2017 lors du Festival des francophonies en Limousin.
3. Conditions d’admission au Prix
- Seuls les textes reçus en langue française seront jugés recevables.
- La participation au Prix est individuelle.
- Les auteurs devront avoir entre 18 et 46 ans à la date où ils se portent Candidats, soit avant le 16 avril 2017.
- Ne seront pas admises les candidatures à titre posthume.
Le Prix est ouvert à tous les auteurs originaires et résidents dans l’un des pays situés dans l’une des zones suivantes (hors départements et territoires d’outre-mer français) :
- en Afrique ;
- dans l’Océan Indien ;
- aux Caraïbes ;
- au Proche et Moyen Orient.
Les pays des zones géographiques mentionnées ci-dessus seront dénommés ci-après « le Territoire ».
- Le but du « Prix RFI Théâtre 2017 » est de promouvoir de nouveaux talents par le biais de textes propres, originaux et à des fins d’exploitation scénique. Ces textes devront être écrits en français et ne devront pas être des adaptations d’une œuvre d’un autre auteur. Ces textes devront être inédits et ne devront pas avoir donné lieu à une mise en scène en France.
- En conséquent, il est rappelé aux Candidats que dans le cadre du « Prix RFI Théâtre 2017 »:
- Chaque Candidat doit envoyer un texte de théâtre d’un minimum de quinze (15) pages rédigées en police 11 et en caractère Arial.
- Chaque Candidat ne peut envoyer qu’un seul texte.
- Les textes présentés lors des éditions précédentes du Prix ne peuvent pas être représentés par les Candidats pour l’édition 2017 du Prix RFI Théâtre.
- La participation au « Prix RFI Théâtre 2017 » est interdite aux collaborateurs de France Médias Monde et de ses Partenaires, aux membres du Jury et à leurs familles ou du Comité de lecture et à leurs familles.
L’ensemble des auteurs réunissant les conditions précitées seront ci-après dénommés “les Candidats”.
- Les Candidats souhaitant concourir devront confirmer par écrit et retourner le Formulaire d’information joint en Annexe 1 avant le 16 avril 2017 selon les modalités indiquées à l’article 4.1.
-Le règlement du « Prix RFI Théâtre 2017 » est disponible sur le site internet de RFI à l’adresse suivante : http://www.rfi.fr/culture/20170309-prix-theatre-rfi-2017-auteurs-ecriture-francophonie
4. Candidature
4.1. Les textes devront intégralement être déposés par messagerie électronique à l’adresse suivante : prix.theatre@rfi.fr, entre le 13 mars 2017 et le 16 avril 2017 à minuit (La candidature et les pièces jointes ne devront pas dépasser une taille maximale de 5 Mo).
Chaque candidature devra être obligatoirement accompagnée du Formulaire d’information en Annexe dûment complété.
Les textes pourront être adressés :
- directement par les auteurs eux-mêmes.
- par le réseau d’institutions participantes.
- par nos partenaires (voir ci-dessus).
Les textes devront ensuite intégralement être adressés à RFI (Voir 3.Conditions de participation).
Toute candidature reçue sans le Formulaire d’information ou toute candidature accompagnée d’un Formulaire contenant des informations fausses ou inexactes sera rejetée.
Uniquement en cas d’impossibilité pour un candidat d’envoyer sa candidature par voie numérique, les candidatures pourront être envoyées par voie postale à l’adresse suivante :
France Médias Monde, « Prix Théâtre RFI 2017 », A l’attention de Pascal PARADOU, 80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux – France.
4.2 Parmi les candidatures déclarées recevables au regard des conditions d’admission et des modalités de candidature, un maximum de douze textes seront présélectionnés par RFI et ses partenaires selon les critères suivants :
-Originalité
-Qualité littéraire
-Qualité dramaturgique
Conformément au Calendrier du Prix (2.), les Candidats présélectionnés par le Jury seront tous prévenus par téléphone ou mail le 15 juillet 2017 au plus tard par RFI.
En cas de question, les candidats présélectionnés pourront s’adresser à : prix.theatre@rfi.fr
4.3 Les dispositions relatives à la cession des droits des Candidats sont limitées au strict cadre du Prix et de sa promotion et sont prévues à l’article 7 du présent règlement.
5. Sélection du Lauréat
Composition du Jury
Le Jury du Prix sera composé d’un nombre pair de quatre membres minimum, réunissant des collaborateurs de RFI, les représentants des partenaires du Prix RFI Théâtre, et des professionnels du monde de la création théâtrale et des médias.
La liste des membres du Jury sera communiquée sur le site internet de RFI au plus tard le 31 juillet 2017.
Le Jury sera présidé par une personnalité qualifiée extérieure choisie par RFI. Celle-ci disposera d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
La liste des membres du Jury pourra être communiquée sur demande écrite adressée à France Médias Monde.
Désignation du Lauréat
Le Jury se réunira à partir du 1er septembre 2017 pour désigner parmi les textes présélectionnés celui qui aura été le plus apprécié pour son originalité et ses qualités littéraires et dramatiques. L’auteur du texte en question sera désigné « Lauréat ».
Il ne peut y avoir d’ex-æquo. Dans l'hypothèse où deux ou plusieurs Candidats parviendraient à égalité pour l’attribution du Prix, il appartiendrait au Président du Jury de départager les Candidats présélectionnés.
Les décisions du Jury sont sans appel. Le Jury se réserve la possibilité de ne pas désigner de Lauréat si les critères de sélection ne sont pas remplis.
Le prix sera remis au Lauréat le 24 septembre 2017 lors du Festival des Francophonies en Limousin.
6. Prix
Récompenses
Le Lauréat se verra attribuer, par les Partenaires et selon les modalités d’application définies au sein de contrats distincts, les récompenses suivantes :
- Une dotation financière d’un montant de 1500 € (mille cinq cent euros) attribuée par la SACD ;
- Le financement par l’Institut français d’une résidence de création d’une durée d’un à trois mois dans l’une et/ou l’autre des structures partenaires d’une valeur de 2500 €.
- La promotion du Lauréat par des lectures du texte primé sur les antennes de RFI.
- Le financement par le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen d’une résidence de travail sur scène de l’œuvre primée ainsi que deux représentations théâtrales de celle-ci, le budget étant géré par le service production du CDN.
- Une lecture du texte primé lors de la manifestation littéraire Nouvelles Zébrures organisée par le Festival des Francophonies en Limousin 2017.
Il est entendu par le Lauréat qu’aucune réclamation ne pourra être faite à l’encontre de FMM qui n’est pas responsable de la remise desdites récompenses. Comme indiqué, les conditions et modalités de remise des récompenses sont définies dans des contrats distincts à intervenir entre le Lauréat et chaque Partenaire.
Le Lauréat s’engage à participer à des activités liées à la promotion de l’œuvre primée, à l’initiative de France Médias Monde uniquement, conformément à l’article 8 du présent règlement. Aucune rémunération ne sera versée au Lauréat pour lesdites activités et participations, quelle qu’en soit la nature, qu’il serait amené à réaliser, sur proposition de France Médias Monde, à des fins de promotion du Prix.
France Médias Monde se réserve le droit de capter et de diffuser lesdites activités promotionnelles (radiodiffusion et/ou télédiffusion sans limitation de vecteur de diffusion, y compris Internet) en intégralité et/ou sous forme d’extraits conformément aux dispositions de l’article 8 du présent règlement.
Acceptation du Prix
Le Lauréat sera contacté par courrier électronique et/ou par voie postale, au choix exclusif de France Médias Monde afin d’être informé que le Prix lui est décerné.
Si le Lauréat ne se manifeste pas avant le 24 septembre 2017, il sera considéré comme ayant renoncé au Prix.
Les récompenses ne peuvent donner lieu, de la part du Lauréat, à aucune contestation, d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. Le Prix n’est pas cessible.
7. Cession des droits sur le texte du Lauréat et sur la Captation du texte du Lauréat
7.1 En participant au Prix, le Lauréat confère à France Médias Monde, à titre gratuit et non exclusif, pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle, le droit de reproduire (voir article 7.2 ci-dessous) et de représenter (voir article 7.3 ci-dessous) son œuvre primée, et les éventuelles captations audiovisuelles de la dite œuvre, sans limitation de zone géographique, de supports et de nombre, à titre promotionnel uniquement et à l’exception de toute exploitation commerciale, sur tous supports conformément à la réglementation française et communautaire applicable et notamment les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
7.2 Le droit de reproduction comprend notamment :
- Le droit d'établir ou de faire établir en tel nombre qu'il plaira à France Médias Monde ou à ses ayants-droit, un original et/ou des copies en tous formats et par tous procédés, connus et à connaître de l’œuvre primée;
- Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles et/ou copies, pour représentation publique ou privée et pour radiodiffusion sonore et visuelle ou par tout autre moyen audiovisuel ;
- Le droit d'établir ou de faire établir toutes versions sous-titrée et/ou doublée en toutes langues ;
- Le droit de télédistribuer et télécharger partiellement ou en intégralité l’œuvre primée;
7.3 Le droit de représentation comprend notamment :
- Les droits de distribuer ou de faire distribuer, de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier tout ou partie de l’œuvre primée, sur tous les services de communications électroniques linéaires ou non (télévision ou radio de rattrapage, télévision ou radio à la demande, enregistrement sur un support propre de l’auditeur ou du téléspectateur, enregistrement via un support technique mise à disposition par un distributeur etc.), services interactifs (réseaux sociaux à usage personnel, professionnel…), sites internet des services édités par France Médias Monde et les sites dits partenaires (comptes des marques éditées par France Médias Monde sur des plateformes de partage de contenus, sites internet tiers à des fins de syndications de contenus, réseaux sociaux…) édités et diffusés par tous moyens et selon toutes méthodes et technologies existantes ou à venir (par voie numérique, analogique ou autres), via tous les supports techniques et technologiques connus, en cours de développement ou à venir (par voie hertzienne, câblé et/ou par satellite, par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication) privatif ou ouvert, en vue de leur réception, directe ou indirecte, sur tous supports fixes ou mobiles (télévisions, ordinateurs, tablettes, smart-phones et autres terminaux mobiles…), à destination du public de manière individuelle ou collective dans des lieux publics ou privés ;
Toute diffusion et publication fera mention du prénom et du nom du Lauréat ou, à défaut, de son pseudonyme.
Ces dispositions sont mentionnées à titre indicatif afin d’assurer la promotion du Lauréat et de son texte en l’absence de discussions préalables avec France Médias Monde.
Le Lauréat pourra se manifester dans un délai de 15 jours après sa désignation afin de solliciter la formalisation d’un nouvel accord de cession des droits.
7.4 France Médias Monde se réserve la possibilité de ne pas faire usage des droits mentionnés ci-dessus.
8. Promotion
Du fait de la participation au Prix et l’acceptation du Prix, le Lauréat autorise France Médias Monde à utiliser son nom, prénom, et ses contributions dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au Prix, sans restriction ni réserve autre que le cas prévu à l’article 7 ci-dessus, et sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque.
Conformément à l’article 7 du présent règlement le Lauréat autorise France Médias Monde à mettre en scène et réaliser un enregistrement sonore et/ou audiovisuel de l’œuvre, et ce aux fins de :
- Diffusion sur les antennes de RFI, en intégralité ou par extraits, ainsi que sur les antennes de France 24 et/ou MCD en intégralité ou par extrait;
- Diffusion de l’enregistrement précité de l’œuvre primée sur le site internet de RFI, de France 24, de MCD ou de leurs partenaires pour le « Prix RFI Théâtre 2017» ;
- Reproduction de l’enregistrement précité de l’œuvre sur tous supports (recueil, dvd, etc), à des fins promotionnelles du Prix, du théâtre, et/ou de l’activité de France Médias Monde et des services qu’elle édite, ainsi que de ses Partenaires dans le cadre du Prix.
Les Candidats présélectionnés et le Lauréat autorisent France Médias Monde à réaliser un CD ou un DVD à partir des prestations précitées, et/ou un recueil des textes en compétition. En cas de commercialisation des supports précités, un accord séparé sera conclu avec les Candidats et les Lauréats concernés aux conditions usuellement constatées dans la profession. Il est entendu que les Candidats et les Lauréats font leur affaire de l’accord et de la rémunération éventuelle de chacun des ayants droits sur les œuvres et/ou enregistrements des œuvres, le cas échéant. Les Candidats et les Lauréats garantissent France Médias Monde contre tout recours à cet égard.
Il est précisé que toute exploitation commerciale de tout ou partie de l’œuvre ou de son enregistrement devra faire l’objet de l’accord préalable écrit du Lauréat.
Dans l’hypothèse où France Médias Monde renoncerait à réaliser l’enregistrement précité de l’œuvre et/ou tout ou partie des actions promotionnelles, aucun dédommagement ne sera versé.
Le Lauréat bénéficiera d’une mise en avant sur divers supports (presse, radio, télévision, web), et notamment sur le site web à l’occasion du Prix.
Sous réserve de défraiement et de validation préalable écrite de la prise en charge dans les conditions prévues par France Médias Monde, le Lauréat s’engage à participer à titre gracieux à toutes les actions promotionnelles (représentation, interviews, émissions de radio, télévision, etc.) nécessaires à la promotion du Prix et à l’initiative de France Médias Monde uniquement.
Pour permettre d’assurer ces actions de promotion, le Lauréat autorise expressément France Médias Monde à utiliser son image dans le cadre des actions susmentionnées ainsi que pour permettre la réalisation de supports promotionnels (affiches, flyers, campagne de presse, etc.).
Le nom de France Médias Monde (et/ou de ses marques RFI et/ou France 24 et/ou MCD) sera associé à celui du Lauréat pour ces actions de promotion. Le Lauréat ainsi que, le cas échéant, tout ayant droit sur les œuvres et/ou enregistrements visés à l’article 7, permet à France Médias Monde de capter, diffuser et copier des enregistrements sonores et/ou visuels qui pourront être reproduits et envoyés, pour diffusion, à toutes les radios et télévisions associées à France Médias Monde (filiales et radios partenaires), notamment Canal France International, TV5 Monde et tout média souhaitant promouvoir le « Prix RFI Théâtre 2017 ». Cette autorisation est concédée à France Médias Monde pour le monde entier, gratuitement et sans limitation de support ou de durée.
France Médias Monde se réserve la possibilité de ne pas organiser de manifestation publi-promotionnelle et de ne pas faire usage des droits mentionnés ci-dessus.
9. Acceptation du règlement
La participation au Prix vaut acceptation par les Candidats de toutes les clauses du présent règlement. Toutes difficultés quant à l’application du règlement feront l’objet d’une interprétation souveraine des organisateurs. Les contestations ne seront recevables que dans un délai de 15 jours après l’attribution du Prix au Lauréat.
France Médias Monde se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler le Prix si elle estime que les circonstances l’exigent. Elle ne pourra être l’objet d’une quelconque réclamation visant à engager sa responsabilité. Il en est de même en cas de problèmes techniques avant et pendant la durée du Prix.
France Médias Monde ne sera pas tenue responsable pour tous cas de force majeure la contraignant à annuler, reporter ou modifier le Prix.
10. Protection des données à caractère personnel – Respect de la loi Informatique et libertés
Les Candidats autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, France Médias Monde s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Les données collectées ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.
Les organisateurs du Prix déclarent se conformer à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 aout 2004, et que les mesures techniques de collecte et d’organisation appropriées ont été mises en œuvre pour assurer un niveau de sécurité adéquat pour la protection des données à caractère personnel.
Conformément à la règlementation en vigueur, les informations collectées dans le cadre du Prix sont destinées exclusivement à la société organisatrice et à ses Partenaires et ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre à France Médias Monde de traiter toute demande de participation au Prix. Les destinataires de ces données sont les organisateurs du Prix et les membres du Jury. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6 aout 2004, les Candidats disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant à France Médias Monde – Service Juridique – 80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux – France. Les Candidats peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant
11. Remboursement des frais de participation
En l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès aux sites de France Médias Monde s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion, par câble, ADSL ou liaison spécialisée), ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que la connexion aux sites de France Médias Monde par le Candidat pour participer au Prix ne lui occasionne aucun frais supplémentaire.
- Pour les Candidats justifiant ne bénéficier d’aucune de ces offres, le remboursement des frais de connexion et d’affranchissement se fera sur simple demande auprès de France Médias Monde accompagnée des pièces suivantes :
- Photocopie d’une pièce d’identité.
- Indication du nom, prénom et adresse postale du Candidat,
- Indication de date, heure et durée de la connexion au site et adresse IP de l’ordinateur,
- Copie de la facture détaillée de l’opérateur.
- Relevé d’identité bancaire du Candidat.
- Pour les Candidats justifiant n’avoir aucun accès à Internet, le remboursement des frais de participation se limitera aux seuls frais de timbre postal à l’exception de tout autre mode d’envoi
Les demandes de remboursement devront être adressées à l’attention de France Médias Monde au plus tard le 24 avril 2017, soit 8 jours après l’expiration de la période de candidature.
12. Attribution de compétence
Le Prix est soumis à la réglementation française. La loi française est seule applicable.
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable relève du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
13. Dépôt
Le règlement du Prix est déposé à l’étude :
SCP PROUST & A.FRERE
Huissiers de Justice Associés,
28 Ter rue Guersant
75017 Paris
Il est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite à l’adresse suivante :
France Médias Monde – Service Juridique
80 rue Camille Desmoulins
92 130 Issy les Moulineaux
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par France Médias Monde, dans le respect des conditions énoncées. L’avenant sera déposé à l’étude ci-dessus mentionnée.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 6:20 PM
|
Par Emmanuel Serafini dans Inferno-magazine
Ni chagrin, ni pitié…
La dernière fois qu’on a croisé Éric Lacascade avec une pièce de Gorki sous le bras, c’était « les Estivants », après « Les barbares » créés dans la cour d’honneur du Palais des Papes, lors du Festival d’Avignon 2006 ; cour qu’il occupait pour la troisième fois, ce qui fait de ce metteur en scène l’un des rares artistes qui peut s’enorgueillir d’un tel fait. Témoignage aussi qu’Eric Lacascade sait faire des spectacles qui plaisent à un large public sans que, pour autant, il ne lésigne sur la qualité et l’exigence, comme quoi, quand on veut, ça se trouve…
En se rendant à la Salle Didier Georges Gabily, aménagée à la lisière de la zone industrielle de Rennes depuis quelques années pour des répétitions par le Théâtre National de Bretagne, on se demande néanmoins pourquoi Eric Lacascade s’est emparé des Bas fonds…
Il suffit pour cela d’assister au spectacle et de voir que tous les thèmes en débat dans nôtre société – sans parler de ceux de la campagne pour la présidentielle ! – y figurent en bonne place… tout y est. Rien ne manque. Les Bas-fonds étant eux mêmes une sorte de métaphore de la société mais celle d’en bas, celle des « sans dents » déjà abondamment décrite par Gorki dès 1902, date de la création de la pièce…
Eric Lacascade ne cherche pourtant pas à faire du théâtre réaliste à la façon de l’Actor-studio ou les comédiens auraient dû aller passer quarante jours avec des SDF pour apporter sur scène le suc de leur expérience… Non, il s’agit de convoquer des images, d’agiter en nous des réflexes et l’imaginaire, de part et d’autre de la scène, fait le reste…
Dès les premières minutes, par une scénographie simple et des lumières sombres sans être glauques, on sent la vodka frelatée qui coule à flot dans ce bouge, la crasse et la poussière qui emplit l’espace fait de promiscuité et de centimètres grappillés par les uns sur les autres… Un endroit fait de cabanes, symbolisées par des tables en bois blanc, branlantes et semblant à peine tenir debout. On s’y pose, on s’y jette comme sur le dernier bastion d’une vie qui ne tient qu’à un fil…
Dans Les Bas fonds, c’est comme partout, il y a des règles, des riches, des moins riches et des très pauvres… Les sentiments existent. L’amour plane avec son lot d’évolution sociale possible…
Si on parle argent, amour, on y parle aussi de la mort… Et elle rôde… Elle est présente. Tout au long de la pièce. On pense, on repense aux sujets d’actualité des JT et c’est ce qui intéresse Eric Lacascade. Cette emprise du réel dans son théâtre, c’est à la fois sa marque de fabrique et son obsession…
À quoi sert le théâtre dans notre société ? Est-il un outil qui entretient une caste dans son quant-à-soi ou un moyen – puissant – d’expérimentation des nouvelles utopies ? Un espace qui montrerait la voie d’un modèle de vivre ensemble, un espace vierge où toutes les propositions alternatives seraient bonnes à être expérimentés ?
Tel est le sujet sous-jacent de ce spectacle imaginé par Eric Lacascade et sa troupe, au sens littéral du terme, c’est à dire sa bande, ceux qui vont travailler avec lui et qui proposent une vision du personnage, de la scène, du texte même… Tous passent par les rôles des uns et des autres avant de s’en voir confier un… Même Eric Lacascade s’y colle. Il a une admiration pour les acteurs-metteurs en scène comme Vitez dans Faust à son arrivée à Chaillot, ou Chéreau dans La Solitude dans les Champs de coton… C’est sa façon de se mettre en danger, de traverser l’expérience dans le feu de l’action.
Un moyen aussi pour le rhétoricien Lacascade d’essayer » de dire autre chose » avec le théâtre, de trouver sur cette scène » à quoi sert le théâtre de nos jours ». D’ailleurs c’est tellement une obsession qu’il vient d’en faire un livre « Au cœur du réel » à paraitre chez Acte Sud. Un livre important pour l’artiste, aussi important qu’une mise en scène. Un effort de pensé pour poser dans le temps les fondamentaux d’une expérience qui a commencé dans le Nord avec sa compagnie le Ballatum théâtre en 1981, on s’en souvient…
Ce qui plaît aussi à Lacascade dans le fait de monter pour la troisième fois un Gorki, c’est cette idée de trouver dans cet auteur Russe la continuité de Tchekhov dont il avait monté Ivanov en 2000 et qui fut pour le metteur en scène une vraie révélation… Celle de l’âme Russe, mais surtout celle d’une époque complexe entre la fin d’une monarchie cruelle, le Tzarisme et d’un communisme qui ne va pas se révéler aussi pertinent que l’idée des pères fondateurs…
Il est drôle d’ailleurs de trouver dans la correspondance entre les deux auteurs qui s’admiraient, des commentaires tel que celui extrait d’une lettre de Tchekhov à l’auteur des Bas-Fonds datée de septembre 1899 :
(…) » Encore un conseil : en relisant les épreuves, supprimez, là où c’est possible, les adjectifs et les adverbes. Il y en a tant chez vous que l’attention s’y perd et que le lecteur se lasse. On comprend lorsque j’écris : « L’homme s’assit sur l’herbe » ; on comprend parce que c’est clair et que cela ne retient pas l’attention. Au contraire je deviens obscur et fatigant si j’écris : « Grand, la poitrine étroite, un homme de taille moyenne, à la barbe rousse, s’assit sur l’herbe déjà foulée par les passants, il s’assit sans bruit, jetant autour de lui des regards timides et craintifs… » Cela ne s’inscrit pas d’un coup dans le cerveau, et la littérature doit s’y inscrire d’un seul coup, à la seconde. Une chose encore : vous êtes par nature un lyrique, le timbre de votre âme est tendre. Si vous étiez compositeur, vous éviteriez d’écrire des marches. Jurons, vacarme, injures, cela n’est pas dans le caractère de votre talent. Aussi vous comprendrez que je vous conseille de ne pas épargner dans vos corrections les « fils de putain », « salope » et autres qui émaillent de-ci de-là les pages de la Vie. On comprend mieux alors le besoin de ce va-et-vient entre le maître de la psychologie russe, du drame et du désenchantement vers un Gorki plus cru, moins policé… Témoignage d’une époque qui change et que Gorki saisit pour en faire un théâtre prolétaire bien en vogue à l’époque.
Chaque instant du quotidien fait dire à Eric Lacascade qu’on se rapproche des Bas fonds. A la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les rues, au bas de chez soi, la réalité cogne à notre porte et on doit trouver les moyens de l’appréhender sans être en contradiction avec ses convictions. Le moyen de le faire passer sans doute par un théâtre plus engagé mais plus audacieux, qui ne renonce pas à évoquer les sans papiers ; la question des papiers, véritable sésame de notre société contemporaine, on vient de le voir avec le décret Trump aux USA…
Ne pas évacuer de traiter sur scène la misère, la pauvreté, sans entrer dans un théâtre documentaire où l’imitation serait le fondement… Non, pas de trucs ni de trucages, des comédiens rivés au texte, qui s’emplissent des mots et les font résonner justement avec ce triste spectacle que leur offre un quai de Seine, une gare de province ou un bidonville d’un camp de réfugiés aux portes, si ce n’est au coeur même, de l’Europe.
Alors, Les Bas-fonds… Histoire des gens comme des milliers de par le Monde, fauchés par l’âpreté de la vie qui se débattent pour rester à fleur d’eau. Des répliques cinglantes sur les bourgeois, les assistés… Cette réflexion sur les classes sociales qu’on espérait voir évoluer entre 1902 et notre XXI ème siècle débutant… Et puis, tant de progrès, de technologies, de moyens de communiquer pour encore tant et plus de misère qui valide cette réplique des Bas-Fonds : je ne comprends pas, c’est qui les bons et c’est qui les méchants ?
Emmanuel Serafini
Les Bas-fonds de Maxime Gorki – Mise en scène : Éric Lacascade – Théâtre National de Bretagne, Rennes -Création TNB – Salle Vilar -jeudi 2 au samedi 11 mars 2017
Reprise à : Les Gémeaux, scène nationale de Sceaux — vendredi 17 mars au dimanche 2 avril 2017
photos Julia Riggs

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 4:39 PM
|
Par Les frères James dans leur blog des Inrocks
Salut les frérots,
Du côté de Londres, les gens n’ont en ce moment que le mot « Brexit » à la bouche. Alors que les Britanniques sont relativement peu politisés, qu’ils expriment rarement en public leurs opinions, surtout politiques, le résultat du référendum du 23 juin dernier a bouleversé la donne. Les décisions prises par la Premier ministre Theresa May quant à l’avenir du pays intéresse les Londoniens, qui n’hésitent plus à se lancer dans des débats enragés. Une grande première dans un pays où les discussions lors des apéros et des dîners tournaient plutôt autour des précédentes soirées alcoolisées et des résultats de la Premier League de football.
Une pièce de théâtre profite de cette ambiance très particulière et connaît un succès populaire remarquable : « This House », qui se joue jusqu’à fin février au Garrick Theater, en plein centre de la capitale. Cette pièce, créée et montée pour la première fois en 2012 au National Theater, traite de l’opposition à la Chambre des Communes (The House of Commons en question) entre les partis conservateurs et travaillistes de 1974 à 1979 à travers les relations entre leurs « Whips ». Ces groupuscules sont chargés dans chaque parti de veiller à ce que les élus votent en suivant les consignes de leur direction et d’organiser des alliances avec les indépendants ou les autres partis de la Chambre des Communes.
Avec le Brexit, « This House » trouve aujourd’hui un écho démultiplié par le mimétisme des événements entre les deux époques : un référendum sur l’Union Européenne et sur l’Ecosse ont lieu, tous les responsables de partis voient leur leadership disputé, une femme devient Premier Ministre, comme Margaret Thatcher en 1979, les grèves se multiplient, le pays est divisé.
Si les événements semblent similaires, le comportement et les mentalités des acteurs du monde politique sont radicalement différents. Les politiciens de profession étaient encore rares, les députés travaillistes étaient par exemple quasiment tous issus du monde syndicaliste et ouvrier. Les idées étaient donc bien plus tranchées. Derrière son côté parfois grinçant et souvent drôle et cocasse, la pièce met en évidence la foi de la plupart des protagonistes dans leurs idéaux de société, même s’ils sont parfois pervertis par le besoin et la volonté de se maintenir ou d’acquérir le pouvoir. Un sérieux rappel à la réalité actuelle, où les candidats ne comptent souvent pas appliquer leurs promesses de campagne.
Tiens, quelques liens sur la pièce, elle-même donc un long reportage réalisé par the National Theater à son lancement.
http://thishouseplay.com/
Bande annonce / Trailer : https://youtu.be/rxviKJmgtxc

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 4:10 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog Hottello :
La Beauté intérieure, texte (extrait du Trésor des humbles) Maurice Maeterlinck, conception et mise en scène Thomas Bouvet
La Beauté intérieure de Thomas Bouvet, est un spectacle extrait du recueil Le Trésor des humbles de Maurice Maeterlinck, qui se donne pour objet de traquer la beauté.
Beauté de l’âme, beauté intérieure, beauté existentielle, la perception du monde est affaire de sensation tremblante et d’impression frémissante en soi – beau mystère.
A l’artiste, via Maeterlinck, de saisir, en l’arrêtant, la beauté belle recelée en l’être.
Vaste aventure et prospection aléatoire qui pourrait faire sourire si elle n’était juste.
La beauté n’est pas rationnelle pour qui se pique de contemplation ou de lyrisme : Est-ce un idéal mystique ou une transcendance qui mobilise implicitement chacun ?
Selon Proust, dans sa Préface à la Bible d’Amiens de John Ruskin, la beauté – tel le bonheur – doit être aimée pour elle-même, comme quelque chose de réel qui soit senti hors de soi et qui se révèle bien plus important que la joie qu’elle donne.
L’art – musique, littérature, spectacle -, qui produit plaisir esthétique et bonheur, n’est pas le seul sanctuaire de la beauté, mais la nature aussi, lieu d’articulation entre création humaine et création divine, et l’être humain encore – corps, et âme d’abord : l’aventure intérieure consiste à sentir, comprendre et aimer, les voies du Beau créé.
« Le beau est plus dans l’âme qu’il ne s’établit dans les règles », selon George Sand (Histoire de ma vie), et pour Zola, une chose est belle « parce qu’elle est vivante, parce qu’elle est humaine », hors de toute dimension physique ou métaphysique.
Le « Beau intérieur » procède d’une nécessité profonde ressentie comme absolue.
La nature, la vie, la vérité, l’amour suscitent le sentiment intime de la beauté, la satisfaction de l’âme qui contemple un bel objet – réalité, idée, sentiment – dans la sensation aigue d’une présence au monde infiniment consciente et intensifiée.
Sur la scène, depuis l’ombre brumeuse d’un brouillard enveloppant l’alentour, et après que le noir total ait été fait, surgissent lentement et comme furtivement cinq figures – quatre chanteurs lyriques dont Sophie Arama (soprano), Claude Brun (mezzo-soprano), Renaud Boutin (baryton) et Cyrille Laïk (basse) qui n’émettent d’abord aucun son, entourant le récitant au centre, Thomas Bouvet lui-même.
Apparition et fantôme, le chœur lyrique se met en place, jouant une partition musicale créée collectivement. Et les voix chantées se conjuguent à la parole, au silence des intervalles, à la brume projetée sur la scène et aux lumières diffractées.
Résonnent les anaphores et les répétitions chères à Maeterlinck : « Rien au monde, rien au monde… », la parole assénée est claire, économe, limpide et entêtante.
Aux métamorphoses de l’espace – nappes de smog anglais ou vapeur blanche qui surgissent des hauteurs et des ténèbres du ciel pour diffuser en même temps une lumière gracile et pâle sur une musique sourde qui gronde et résonne fort en soi. Des rappels métaphoriques lointains des installations plastiques de Castellucci.
L’expérience est passionnante en ce qu’elle diffuse le verbe de grande beauté de Maeterlinck, entre voix lyriques célestes ou abyssales et lumières énigmatiques.
Le public installé dans l’ombre fascinante ne pipe pas mot, subjugué par son être-là.
Véronique Hotte
T2G Théâtre de Gennevilliers, CDN de Création contemporaine, du 8 au 17 mars. Et L’Humanité, du 10 au 12 mars Tél : 01 41 32 26 26

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2017 9:21 AM
|
Par Thomas Ostermeier (metteur en scène allemand, codirecteur de la Schaubühne de Berlin) pour Le Monde
Vu de l’extérieur 2/9. Le metteur en scène berlinois répond à la question : « Que représente pour vous la France de 2017 ? »
« A côté des banlieues marginalisées, il semble qu’il existe aussi nombre d’enseignants, de travailleurs sociaux et d’éducateurs qui n’ont pas encore renoncé à faire des Français, même des plus modestes, des citoyens républicains, grâce à l’éducation et à la culture.
A l’approche des élections, Le Monde invite des artistes internationaux de renom, qui connaissent bien notre pays pour y travailler régulièrement, à répondre à la question : « Que représente pour vous la France de 2017 ? » Car s’il est un enjeu qui engage mutuellement artistes et politiciens, c’est bien celui de la représentation. Après le cinéaste néerlandais Paul Verhoeven, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier se prête, à son tour, à notre jeu. Agé de 48 ans, il codirige la Schaubühne à Berlin depuis 1999, l’une des institutions théâtrales phares d’Allemagne et d’Europe.
Les Français me demandent souvent pourquoi Berlin exerce une telle attraction sur les jeunes artistes et comment il pourrait en être de même avec Paris. La plupart du temps, je réponds par une boutade : érigez un mur au milieu de la ville, laissez-le quarante ans puis détruisez-le.
Les énergies alors libérées sont sans comparaison possible. C’est de l’humour bien sûr, j’espère évidemment qu’il n’y aura jamais un tel mur dans Paris. Cependant, plus je viens en France et plus je prends conscience que ce mur existe bel et bien. Comme dans toutes les autres métropoles européennes, il sépare ceux d’en haut et ceux d’en bas.
« De l’argent sur la table »
1 - Invité à Sceaux pour quelques représentations d’Hamlet, je prends un taxi de l’aéroport à Paris. Le chauffeur est un immigré algérien de deuxième génération, sensiblement de mon âge. Alors que nous sommes coincés dans les embouteillages, ce fils de harki me raconte qu’il a grandi à Créteil dans une famille de cinq enfants.
A 14 ans, comme ses autres frères, il a dû mettre, dit-il, « de l’argent sur la table ». Il quitte prématurément l’école pour suivre une formation de mécanicien automobile. Jusqu’à 25 ans environ, il vit avec ses trois frères et sœurs et ses parents dans un trois-pièces, dans l’une de ces barres grises que l’on rencontre partout à la périphérie de Paris. Il doit remettre l’intégralité de son salaire d’apprenti à ses parents pour les aider.
Il a commencé à travailler comme chauffeur de taxi il y a vingt ans. A cette époque, on pouvait encore gagner beaucoup d’argent dans la profession. D’après lui, ce n’est plus le cas aujourd’hui en raison de la concurrence d’Uber et des VTC, du prix élevé du carburant et des licences trop nombreuses. Malgré tout, il a réalisé un de ses rêves en achetant il y a quelques années un petit pavillon en banlieue parisienne, dans un de ces villages au-delà des cités HLM. Il a pris un crédit de 300 000 euros qu’il tente à présent de rembourser en conduisant jusqu’à quatorze heures par jour.
Curieusement, nous ne parlons à aucun moment de religion, de voile, des réfugiés ou de la peur du terrorisme. Le chauffeur de taxi tient de bout en bout un raisonnement laïc et éclairé, il s’intéresse à la politique, il est attaché à la démocratie. Il a néanmoins d’importants soucis matériels.
Une porte fermée
2 - J’arrive à l’hôtel où la Schaubühne a ses quartiers depuis plus de dix ans lorsqu’elle est en tournée à Paris. L’établissement se trouve juste à côté du Pont-Neuf, au cœur de Paris. La porte, par laquelle avant les terribles attentats de novembre 2015 on pouvait entrer et sortir nuit et jour, est à présent fermée à clef.
Pour l’ouvrir, il faut utiliser la carte qui permet d’accéder à la chambre mais que je n’ai pas encore. Après avoir sonné désespérément à plusieurs reprises, on m’ouvre enfin. Antoine, le veilleur de nuit,enfant d’immigrés, m’accueille comme toujours chaleureusement. Il n’apprécie visiblement pas cette façon qu’a l’établissement, appartenant à une grande chaîne hôtelière, de se retrancher.
Dans le hall, un téléviseur diffuse la chaîne d’information en continu BFM-TV. Impossible d’y échapper ! Nous sommes avant le second tour de la primaire à gauche. Les deux candidats s’affrontent au cours d’un débat. On voit qu’ils n’ont plus aucune chance de faire passer ce qui différencie leurs programmes. Il ne s’agit plus que d’apparaître crédibles et de présenter un masque souriant aux téléspectateurs.
Mais qu’est-ce que la crédibilité dans un tel contexte ? S’agit-il d’être crédible en défendant ses propres convictions et son programme ? Ou de l’être en montrant que l’on est davantage intéressé par le bien-être de la France que par l’exercice du pouvoir ? L’hystérie propre à ce type de médias montera encore d’un cran quelques jours plus tard avec le « Penelopegate ».
« A la Comédie-Française, il y a des jeunes spectateurs, des classes entières. En Allemagne, les élèves issus de milieux défavorisés n’ont plus accès à une culture exigeante. »
Antoine me remet une carte qui ne donne pas seulement accès à la chambre, mais également au hall, espace autrefois ouvert à tous et qui fait désormais partie des nombreux lieux auxquels on n’accède plus sans carte ou contrôle de sécurité : halls d’hôtels ou de théâtres, stations de radio, sans parler naturellement des abords des ministères. Je repense aux difficultés dont m’a parlé le directeur du Théâtre de la Ville.
L’Espace Pierre-Cardin, qui lui a été alloué provisoirement, se trouve juste en face des ambassades américaine et britannique. Récemment, le célèbre danseur russe Mikhaïl Baryshnikov y a interprété, seul, un texte mis en scène par Robert Wilson. A la sortie du théâtre et alors qu’il se dirige vers sa voiture, des fans lui demandent un autographe. Comme, en dépit des rappels à l’ordre, Baryshnikov continue à distribuer des signatures, deux policiers le saisissent par le bras et le font monter sans ménagement dans sa voiture. L’espace public s’amenuise, les zones de sécurité prospèrent.
Contradictions françaises
3 - Je profite de mon séjour pour aller à la Comédie-Française. Je suis toujours profondément impressionné de voir combien les amateurs de théâtre sont nombreux et enthousiastes dans toute la France. Sans parler du nombre de gens prêts chaque année à assister à des représentations en allemand surtitrées. Cela ne concerne d’ailleurs pas uniquement des mises en scène allemandes car, en réalité, le théâtre du monde entier est chez lui sur les scènes parisiennes. Il l’est aussi dans la mesure où les artistes sont souvent plus appréciés à Paris que dans leurs pays d’origine. C’est tout à fait singulier, et cela n’existe nulle part ailleurs en Europe à ce point. A cet égard, Paris est une ville véritablement ouverte sur le monde.
Une chose me frappe ce soir-là à la Comédie-Française comme à chacune de mes rencontres avec le public français. D’un côté, il y a dans la salle une bourgeoisie très cultivée, ouverte y compris aux expériences théâtrales les plus complexes. Mais il y a aussi à toutes les représentations des jeunes spectateurs, des élèves, des étudiants, et bien souvent des classes entières.
En Allemagne, il y a bien longtemps que les élèves issus de milieux sociaux défavorisés n’ont plus cet accès à une culture exigeante. Cela fait partie des contradictions françaises. A côté des banlieues marginalisées, sans espoir et violentes, il semble qu’il existe aussi nombre d’enseignants, de travailleurs sociaux et d’éducateurs qui n’ont pas encore renoncé à faire des Français, même des plus modestes, des citoyens républicains, grâce à l’éducation et à la culture.
Après la représentation, je dîne dans une brasserie avec mes acteurs et deux écrivains français très connus en Allemagne. Le garçon n’a visiblement aucune envie de nous servir et n’a de cesse de marmonner des jurons. A la fin de la soirée, le plus jeune de mes deux amis français l’interpelle. Le serveur se justifie en disant qu’il n’a pas eu un seul repos depuis dix jours. Pour notre jeune collègue, ce n’est pas une excuse. Le plus âgé de mes amis me dit alors : « Voilà la gauche radicale française ! Elle demande aux prolétaires pauvres, exploités et en situation précaire de s’expliquer mais est incapable de comprendre leur colère refoulée. »
Contrôle de sécurité
4 - Je suis sur le chemin du retour. Au contrôle de sécurité de l’aéroport, on me demande d’enregistrer mon bagage à main alors que je le prends toujours en cabine lorsque je voyage à l’étranger. On me remet un badge pour pouvoir l’enregistrer rapidement et ne pas avoir à refaire la queue. Lorsque je me présente au comptoir d’enregistrement, on m’invite pourtant soit à utiliser une machine soit à faire la queue. J’invoque le privilège que m’accorde le badge mais suis débouté par l’employé pour qui celui-ci n’a aucune valeur car il m’a été remis par la société de sécurité et non par Air France.
« En dépit de la peur des attentats, malgré les inquiétudes quant à l’avenir politique et économique de leur pays, les Français demeurent courtois. »
Espérant gagner du temps avec la machine, je tente ma chance. En vain. Je finis par m’énerver bien que je me sois promis, moi, Allemand en France, de rester au moins aussi poli que les autres. Je me rends ensuite au contrôle de sécurité et me dirige vers les appareils à rayons X et les portiques où officie une importante équipe d’employés d’une société de sécurité, au statut probablement précaire et tous issus de l’immigration.
Après être passé devant plusieurs soldats en uniforme portant leur arme en bandoulière – eux aussi pour la plupart issus de l’immigration –, je me retrouve dans un fast-food qui, comme les portiques de sécurité, est totalement submergé par les nombreux passagers.
Derrière le comptoir, seuls quelques employés issus de l’immigration font face à une armada de voyageurs. Une fois de plus, je suis dans la mauvaise queue si bien que lorsque j’arrive à la caisse, l’aimable serveuse me demande de me mettre dans l’autre file. Là où je suis, on n’accepte que les cartes de crédit. Or, je souhaite régler en espèces.
Dans ce genre de situations, je suis toujours étonné par un comportement qui me paraît très improbable en Allemagne, a fortiori à Berlin,où les gens exprimeraient haut et fort leur mécontentement. En dépit de la peur des attentats, malgré les inquiétudes quant à l’avenir politique et économique de leur pays, les Français demeurent courtois. C’est un acquis de civilisation dont on n’estime pas suffisamment la valeur. En même temps, on a le sentiment que cette forme de savoir-vivre est importante pour maintenir la cohésion de la société française. Cette première contradiction en cache d’autres, nombreuses.
Les contrastes entre les pauvres et les riches, entre ceux d’en haut et ceux d’en bas, et le paradoxe d’un pays qui, face au terrorisme international, s’efforce de réagir de manière plus réfléchie et civilisée que les Etats-Unis, par exemple, mais prétend malgré tout être en guerre. Les contradictions d’un pays qui, à chacune de mes visites, me paraît plus multiculturel et varié que l’Allemagne, mais qui, bien que socialiste, n’a accueilli que peu de réfugiés syriens par rapport à une Allemagne pourtant dirigée par des conservateurs. Une liste de contradictions qui est sans doute loin d’être exhaustive.
« Notre seul espoir »
5 - « Les contradictions sont notre seul espoir » (Bertolt Brecht).
(Traduit de l’allemand par Valérie Bonfils)
Thomas Ostermeier (metteur en scène allemand, codirecteur de la Schaubühne de Berlin)
(Photo: Thomas Ostermeier, à Venise, en 2011).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 6:51 PM
|
Publié dans Télérama - Sortir
Musique classique - Spectacle lyrique
Quand la metteure en scène Louise Moaty s'empare du chef-d'œuvre des années 20 de Leos Janácek, La Petite Renarde rusée, c'est une forme un peu surréaliste de poésie qui s'invite sous nos yeux. Hommage vibrant au monde de la nature, cet opéra est ici réduit pour une quinzaine d'instruments par Laurent Cuniot, à la tête de l'Ensemble TM+. Masques, marionnettes, dessins, images du spectacle filmées en direct, instrumentistes : tous les intervenants sont sur scène pour cette version aussi artisanale que pointue technologiquement (projection vidéo très audacieuse). Une reprise à ne pas manquer, avec notamment les voix de Noriko Urata et Caroline Meng.
La Petite Renarde rusée
Du 15 mars 2017 au 26 mars 2017 au Théâtre de l'Athénée - Louis Jouvet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 6:03 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération / Next
Dans ses ateliers nomades, la récente édition du Cabaret de curiosités a réuni quatre jours durant des spectacles autour de la notion de partage.
C’est un Cabaret de curiosités, comme les cabinets du même nom où, aux XVIe et XVIIe siècles, les gens fortunés collectionnaient des bizarreries en provenance de nouveaux mondes. Y trônaient l’hétéroclite et l’inédit. Ce festival de création contemporaine, aussi bref que riche, a été imaginé par Romaric Daurier, directeur du Phénix, Scène nationale de Valenciennes. Du 28 février au 3 mars, on aura donc réfléchi à ce qu’est un «bien commun» à une époque où tout se privatise (bientôt l’air qu’on respire ?) et assisté à des spectacles parfois balbutiants, comme celui de la coopérative artistique l’Amicale de production, attendu bientôt au CentQuatre, à Paris (XIXe).
La fortune n’est pas vraiment ce qui caractérise ce territoire de 350 000 habitants dont 40 000 vivent en-dessous du seuil de pauvreté, où le FN bat à chaque nouvelle élection ses propres scores. Vieux refrain : le théâtre a-t-il une valeur d’usage pour tous ? Quels sont ses effets politiques dans une région où la crise est une constante ? Parler de théâtre expérimental et populaire est-il un oxymore ? Pour que l’expérience de la scène passe par la pratique et embarque ceux qui acceptent d’être recrutés, le Phénix a créé des «ateliers nomades», lors desquels des artistes - chorégraphes, metteurs en scène, plasticiens - travaillent avec des habitants qui cumulent toutes les difficultés, et d’autres moins, «sinon, ce serait stigmatisant», intervient Romaric Daurier. S’y fomentent des pièces qui, parfois, voyagent en France et au-delà des frontières, comme dernièrement Corbeaux, la puissante performance chorégraphique participative de Bouchra Ouizguen, remarquée au dernier Festival d’automne à Paris.
On souhaite le même destin à Gâchette du bonheur, l’atelier nomade mené par les Portugais Ana Borralho et João Galante. Ils sont douze sur la scène du Boulon (friche industrielle de 4 000 m2 de la périphérie de Valenciennes) comme les douze apôtres de la Cène de Léonard de Vinci. Douze très jeunes adultes qui se tiennent derrière une longue table rectangulaire et jouent à une roulette russe qui ne les tue pas mais les invite à parler. C’est l’aisance qui frappe, chez ces jeunes gens qui ne se connaissaient pas il y a dix jours, et n’avaient aucune pratique de la scène. Ils délivreront pendant deux heures une parole intime, l’articulant parfois difficilement, mais la relançant à travers des questions et des blagues sur des sujets aussi explosifs que la religion ou la sexualité. Ils s’épaulent quand les mots manquent et se passent le pistolet qui, lorsqu’il se déclenche, éclabousse leurs visages et leurs vêtements de peinture tandis qu’un petit bout de papier plié s’en échappe. Dessus, une question. Des histoires de plus en plus invraisemblables émergent : un garçon raconte une rencontre à un meeting où Brigitte Macron, prenant la pose entre lui et son copain, en aurait «profité» pour leur passer la main «très bas dans le dos». Ou tels autres livrent en des termes très crus et précis des expériences sexuelles - «j’espère que ma famille n’est pas là», répète l’un d’eux.
Si ce jeu de la vérité dérange, lasse, étonne simultanément, il ne manque pas d’interroger sur notre capacité à donner du crédit à toute histoire présentée comme véridique. Pourquoi repousse-t-on l’hypothèse que ce pourrait être des acteurs qui interprètent ? Pourquoi balaie-t-on la supposition que le texte a été appris préalablement et que les hésitations sont un jeu ? Dans cet atelier nomade, qu’on pourra voir la saison prochaine au Nouveau Théâtre de Montreuil (Seine-Saint-Denis) avec des Montreuillois, le processus intrigue autant que le résultat.
Anne Diatkine

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 5:23 PM
|
Une Saison en Enfer est l’ultime combat d’un homme, d’une vie et d’une œuvre touchant sans cesse à l’absolu.
Le texte nous plonge dans les entrailles d’un homme damné par «la liqueur non taxée, de la fabrique de Satan». Il y a une expérience cathartique à être confronté à ce destin exceptionnel et tragique. De cette fusion d’une vie et d’une œuvre, dont la conquête du sens est le combustible, tout lecteur de Rimbaud garde à jamais dans son esprit la brûlure. C’est cette expérience intime du texte que j’ai voulu rendre sur scène. J’ai souhaité par le prisme du théâtre rendre la flamme mystique et celle du charnel associées. Comme espace de création j ai choisi le Purgatoire, en référence à la Divine Comédie de Dante qui concentre ce florilège fantasmagorique et mystique – que nous évoque à plus d’un titre Une Saison en Enfer – sur l’ascension et le renouveau de l’âme. La question du déchirement mental et du reniement des valeurs chrétiennes est brûlante.
Dans ce cortège sans cesse en mouvement, j’ai choisi la rupture par un rythme où les silences et les respirations coexisteraient avec le poème. Dans cette préfiguration d’un langage réinventé, les lumières tamisées, proches de l’aube, obscures et chaudes à la fois font surgir des reflets évocateurs qui trompent le personnage, exposé sur une scène au miroitement indistinct.
Ce personnage inconnu, ce Rimbaud dont le ‘’Je est un autre’’, incarné par Jean-Quentin Châtelain est ici entouré de trois masques sculptés légèrement en relief, symbole des trois Parques.
La rencontre de Jean-Quentin Châtelain, alors qu’il prêtait sa voix au poète Blaise Cendrars – frère de Rimbaud pour ce qui est de l’aventure et du voyage –, m’a révélé l’instrument pouvant donner corps à cette expérience, capable de transmettre le mouvement, le rythme et les aspirations de cette œuvre exemplaire. Note d’intention d’Ulysse Gregorio.
UNE SAISON EN ENFER
D’ARTHUR RIMBAUD
MISE EN SCÈNE ULYSSE DI GREGORIO
AVEC
JEAN-QUENTIN CHÂTELAIN
COSTUMES : SALVADOR MATEU
SCÉNOGRAPHIE : BENJAMIN GABRIÉ
PRODUCTION : LE K SAMKA
COPRODUCTION : LE THÉÂTRE MONTANSIER DE VERSAILLES ET LA COMPAGNIE DES ORFÈVRES
CORÉALISATION : THÉÂTRE LUCERNAIRE, LIEU PARTENAIRE DE LA SAISON ÉGALITÉ 3 INITIÉE PAR HF ÎLE-DE-FRANCE
Durée: 1h15
Lucernaire
DU 8 MARS AU 6 MAI 2017
DU MARDI AU SAMEDI À 19H

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2017 5:01 PM
|
Publié par Yves POEY dans son blog De la Cour au jardin
(c) Photo Y. P. -
William. Timon. Cyril.
William Shakespeare, Timon d'Athènes, Cyril Le Grix.
Une claque.
Une véritable claque théâtrale, voici ce que m'ont asséné les trois personnes sus-nommées.
Une baffe salutaire en pleine figure.
Cyril Le Grix nous propose sa version, je devrais écrire sa vision hallucinée de la tragédie réputée comme la plus difficile et peut-être la plus violente de Shakespeare.
Une tragédie ? Oui mais...
Timon est un riche et puissant seigneur athénien.
Il a énormément d'amis. Et pour cause.
Timon dépense sans compter, dilapide sa fortune, ses drachmes en festins, cadeaux somptueux et autres largesses à ces « amis » pique-assiettes et autres profiteurs éhontés.
C'est un homme bon, ce Timon... Et vous savez ce qu'on dit des hommes bons...
Pourtant, ce ne sont pas les mises en garde de son intendant qui manquent : Flavius sait bien que les caisses sont vides.
Et ce qui devait arriver arrive : plus d'argent, adieu les potes, même pas moyen de solliciter ces soi-disant copains. Tous refusent de prêter de l'argent pour des motifs plus fallacieux les uns que les autres.
Timon est ruiné et devient misanthrope comme seuls les misanthropes peuvent être misanthropes lorsqu'ils ont vraiment décidé d'être misanthropes.
Rien n'y fera, il mourra ermite sur une plage, sur le sable et dans la carcasse d'une barque.
Deux grandes parties dans cette pièce, donc, on l'aura compris.
Cyril Le Grix s'est emparé à bras le corps de cette tragédie qui regorge pourtant d'humour noir et de bons mots.
On rit souvent, dans Timon d'Athènes. La traduction de J.C. Carrière y est pour beaucoup.
Le parti-pris principal du metteur en scène a été de matérialiser le plus finement possible le passage de la verticalité de la première partie, dans le palais du personnage principal (de hauts panneaux noirs à jardin et à cour réfléchissent le reste de la scène) à l'horizontalité de la plage.
D'un homme bien debout, Timon devient un pauvre hère souvent allongé ou assis.
(Quelle métaphore pour nos sociétés qui acceptent pratiquement sans broncher de voir de plus en plus de gens vivre et dormir dans la rue !)
Au lointain, un gigantesque tableau pompier, même que plus pompier, ça ferait vraiment trop.
Le passage de la première à la deuxième partie, sans entracte, sera matérialisé par une formidable et magnifique trouvaille scénographique. Je n'avais jamais ressenti cela : l'image, le son, et bien sûr un souffle plus qu'épique ! (Je ne vous en dis pas plus.)
C'est Patrick Catalifo qui incarne Timon.
Il est é-pous-tou-flant !
Purement et simplement époustouflant.
De bonhomme jovial, joyeux, insouciant, voire libertin, il se transforme en ermite misanthrope, même que plus misanthrope, ça ferait également trop.
Un ermite aux yeux exorbités, à la chevelure hirsute, à la voix grave, rauque, hurlante.
Catalifo est phénoménal !
Dans la carcasse de la barque, il incarne ce type désabusé, désespéré, bouleversant de colère, de rage, ce type qui a désormais les yeux ouverts.
Le reste de la troupe est à l'avenant, avec notamment l'excellent Xavier Bazin, qui interprète l'intendant Flavius, seul personnage constructif de la pièce.
On l'aura compris, Cyril Le Grix nous plonge au cœur d'une entreprise politique et citoyenne.
Le metteur en scène fait sien le propos shakespearien concernant les méfaits de l'argent, de la politique politicienne et la corruption qui gangrènent la Cité, pervertissent les âmes et avilissent l'Homme.
Il fait sien le message du grand William qui postule que le genre humain ne peut s'affranchir de ces fléaux. Shakespeare est d'un désespérant mais ô combien lucide pessimisme.
J'ai assisté à du très grand théâtre.
Une pièce de plus de quatre cents ans mais d'une troublante et confondante modernité, (pléonasme shakespearien, me direz-vous...).
La violence exprimée chez ces Athéniens, cette violence extrême est ici admirablement mise en exergue et en abîme pour mieux la dénoncer, pour mieux nous faire nous interroger sur ceux de tous bords qui actuellement la prônent et la font déferler.
Sans oublier évidemment un metteur en scène militant, enflammé et très inspiré, une troupe de comédiens en état de grâce, une équipe technique très pointue, avec en prime trois talentueux musiciens de jazz en live.
Que demander de plus ?
Qu'est-ce que ça fait du bien, par les temps qui courent, d'assister à ce Timon d'Athènes !
----------
Je ne saurais trop vous conseiller d'écouter demain la passionnante interview webradio que m'a accordée Cyril Le Grix, juste après la représentation.
Un metteur en scène érudit, enflammé, militant, engagé !
Ce fut pour moi un grand moment que j'ai hâte de vous faire partager !
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...