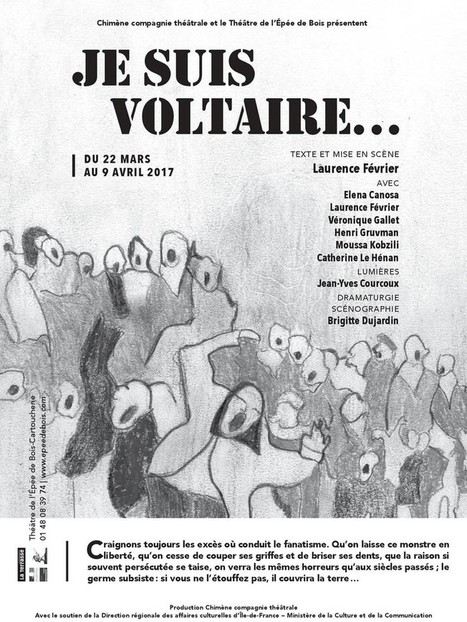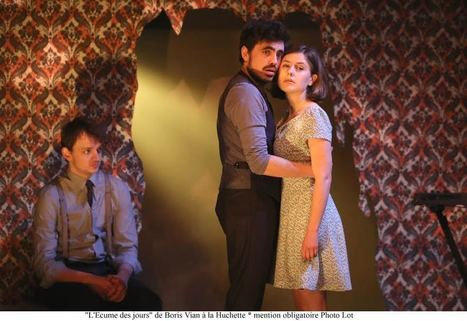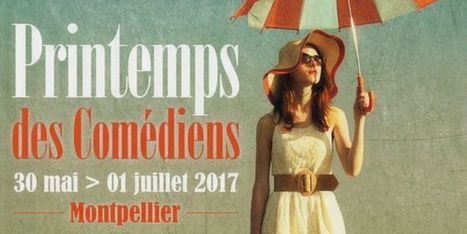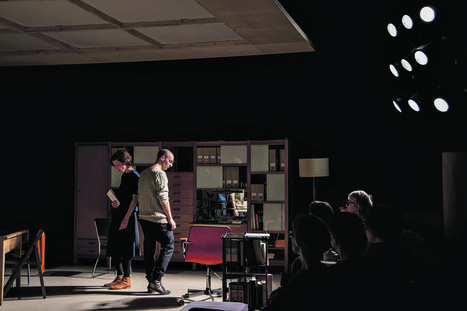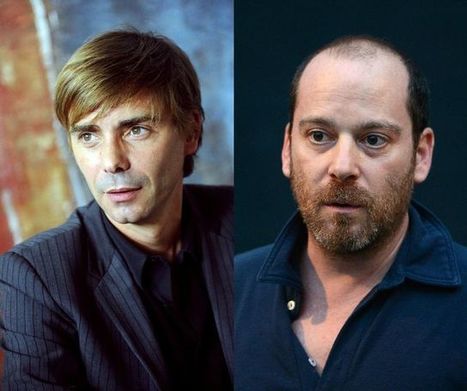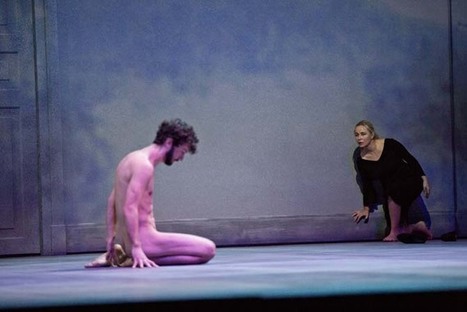Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2017 8:42 AM
|
Par Frédéric Perez sur son blog Spectatif
Ce spectacle revêt une audace incroyable. Il convoque la philosophie de Voltaire pour interroger le fanatisme aujourd’hui et en faire une pièce de théâtre, ô combien réussie.
Chapeau bas, madame Laurence Février ! Vous écrivez là et mettez en scène du théâtre politique digne de celui défendu par vos prédécesseurs Gémier, Vilar, Brecht ou autre Dario Fo…
Le public s’installe. Almona est au fond, papier et crayon à la main, elle attend. Il y a cette femme aussi, assise au bord du plateau, qui attend aussi. Nous apprendrons plus tard qu’elle est Ézéchièle, une ange-femme. Les deux femmes attendent Voltaire.
Une agitation anime le plateau, le début d’une conférence avec Émilie du Châtelet et Voltaire est prévue. Almona et François qui vient d’entrer et d'installer une caméra, se préparent à interroger les invités.
La porte s’ouvre et Ninon entre, aussitôt admonestée d’invectives et de reproches par Ézéchièle, rudement, aux limites de l'agression. Elle ne mérite pas d’être là, qu’elle se taise et écoute. De force, Ézéchièle l’installe au premier rang du public.
Voltaire ne vient toujours pas. Émilie du Châtelet entre à son tour. Une virago en fusion, hurlant des ordres, réclamant son matériel. Cette femme de sciences et de lettres du début du siècle des lumières nous fait découvrir son regard aiguisé et sa quête militante de progrès.
Commence alors la conférence. Nous comprenons que Voltaire ne viendra pas. Émilie du Châtelet est interrogée et parle volontiers, brillante et intraitable. Elle situe sa relation avec Voltaire.
La compagne, la muse et la complice du philosophe, explique le travail de l'illustre penseur, sa lutte acharnée et incessante contre l’injustice et le fanatisme religieux qu’il appelait « l’infâme ». Elle démontre avec maestria combien le combat contre l’intolérance et pour l’émancipation des peuples fut le leur.
Situation forte, charge lourde contre le cléricalisme castrateur et liberticide.
La conférence est terminée. Émilie du Châtelet sort.
Entre alors Frédéric, ancien camionneur, devenu auditeur des cours de l’université de Vincennes en 1968, puis professeur d’histoire et aussi tuteur de détenus pour crime de terrorisme, chargé d’œuvrer à leur réinsertion sociale. À ce titre, il s’occupe de Ninon dont nous devinons qu’elle est une jeune française fanatisée. Il vient la chercher et la conduit avec lui au centre du plateau. Une discussion s’engage.
Les travaux sur l’intolérance et le fanatisme de Voltaire, les « plis de la compréhension » et la nécessité que « les gens pensent » défendus par Deleuze sont développés pour expliquer à Ninon son fourvoiement frénétique et l'emprise de son embrigadement. Le débat nous éclaire et apporte des clés de réflexion sur l’actualité.
Entre la vacuité et la vanité vaine du combat terroriste, les réminiscences d’une nouvelle guerre de religions et d’une nouvelle inquisition, quelle place laissée à la liberté de penser par soi-même, au-delà des croyances imposées par l’éducation et la culture ?
La mise en scène et la scénographie utilisent des procédés indirects de mise en vie, attractifs et surprenants. Elles réservent la relation frontale au public pour mieux l’interpeller, le surprendre et l’inviter à la réflexion qui ne peut que naitre ou renaitre devant lui. Audace, adresse et efficacité.
La distribution crédible et enthousiaste comme sa volonté manifeste de partage nous touchent. C'est très bien joué.
JE SUIS VOLTAIRE est un spectacle qui nous rappelle que nous sommes Voltaire, comme nous sommes Paris ou Londres. Indispensable moment de « théâtre de la cité ».
Texte et mise en scène de Laurence Février. Dramaturgie, Scénographie et environnement sonore de Brigitte Dujardin. Lumières de Jean-Yves Courcoux. Avec Éléna Canosa, Laurence février, Véronique Gallet, Henri Gruvman, Moussa Kobzili et Catherine Le Hénan.
Du mardi au samedi à 20h30, matinées samedi et dimanche à 16h00 – Cartoucherie, route du Champ de Manœuvre, Paris 11ème - 01.48.08.39.74 - www.epeedebois.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 4:30 PM
|
Par Thomas NgoHong-Roche pour son blog Hier au Théâtre :
Après avoir rendu Mme Bovary si proche de nous, le duo Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps poursuit son exploration musicale du patrimoine littéraire avec L’Éume des jours. Dans le petit cocon de la Huchette, l’écriture si touchante de Vian, déploie ses fleurs poétiques avec grâce et légèreté. Le trio de jeunes comédiens sur scène possède cette naïveté si touchante d’adultes-enfants en proie à la beauté et à la douleur du monde. Brillant.
Un joli papier peint géométrique très 60’s en toile de fond ; une guitare électrique, un synthétiseur et un sampleur en guise de musique : un mariage décalé et étrange qui résume à lui seul la loufoquerie poétique de Boris Vian. Dans son roman-phare, l’auteur déroule la trajectoire amoureuse de Chloé et Colin, accompagnés de leur ami Chick, un ingénieur fanatique. De la découverte de l’autre et du désir, de la sensualité au mariage puis de la maladie à la mort, aucune étape ne nous est épargnée. Ce crescendo émotionnel, de la lumière riante des débuts à la métaphore cancéreuse du nénuphar, est respecté avec tact et finesse.
Les deux metteurs en scène, aidés par l’adaptation efficace (qui aurait tout de même pu être resserrée d’un bon quart d’heure) de Paul Emond, respectent l’esprit de l’écrivain : on retrouve avec délice cette langue si gourmande d’inventivité, cette étrangeté si proche de nous, cet onirisme du quotidien. La production est modeste mais pas chiche en trouvailles ; le travail remarquablé opéré sur les bruitages par exemple, suffit à évoquer tout un imaginaire. Le dire se combine au chanté et au joué en une harmonie salutaire et naturelle.
La fureur de vivre
Trois comédiens seulement se partagent tous les rôles et pas que : Roxane Bret, Antoine Paulin et Maxime Bouteraon sont des bulles de fraîcheur absolument prometteuses. Ces graines de talent se lancent à corps perdu dans leur rôle pour un résultat plein de peps, de joie solaire et de complexité. Ils jouent non seulement la comédie mais se font en plus récitants, musiciens et chanteurs. Multi-casquettes ces jeunes ? Oui et plutôt deux fois qu’une. Retenez bien leurs noms, ils ont de beaux jours devant eux.
L’ÉCUME DES JOURS de Boris Vian. M.E.S de Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps. Théâtre de la Huchette. 01 43 26 38 99. 1h30 ♥ ♥ ♥ ♥
© Lot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 10:38 AM
|
JORF n°0076 du 30 mars 2017
texte n° 50
Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
NOR: MCCB1628608D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/MCCB1628608D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-432/jo/texte
Publics concernés : toutes structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, exerçant leurs activités dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Objet : dispositif de labellisation et de conventionnement à destination des structures dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le décret définit les principes communs à l'ensemble des labels relevant du régime fixé par l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : les structures éligibles au label, la liste des labels dont le cahier des missions et des charges sera défini par arrêté, les conditions permettant l'attribution d'un label, la procédure d'attribution, les obligations liées à l'attribution, la procédure de sélection du dirigeant de la structure labellisée qui fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, la procédure d'évaluation, de renouvellement, de suspension et de retrait du label. Il prévoit également, en application de l'article 57 de la loi susmentionnée, des dispositions spécifiques pour l'attribution et le retrait du label « fonds régional d'art contemporain » (FRAC) ainsi que pour l'enrichissement la gestion et la protection des collections des structures labellisées FRAC. Il prévoit enfin des dispositions particulières pour le conventionnement de projet pour les structures qui développent un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce décret et le code du patrimoine qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 116-1 et L. 116-2, dans leur rédaction résultant de l'article 57 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment ses articles 5, 111 et 117 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques
.
I. - Les labels institués par l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et précisés, en ce qui concerne les fonds régionaux d'art contemporain, par l'article L. 116-1 du code du patrimoine sont :
1° « Centre chorégraphique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de danse ;
2° « Centre d'art contemporain d'intérêt national », au titre d'une activité d'exposition et production d'œuvres et de diffusion des arts visuels contemporains ;
3° « Centre de développement chorégraphique national », au titre d'une activité de diffusion et de mise en valeur de la diversité de la création chorégraphique ;
4° « Centre dramatique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de théâtre ;
5° « Centre national de création musicale », au titre d'une activité de création, production et diffusion de musique contemporaine ;
6° « Centre national des arts de la rue et de l'espace public », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles et œuvres conçus pour l'espace public ;
7° « Fonds régional d'art contemporain », au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 116-1 du code du patrimoine ;
8° « Opéra national en région », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles lyriques, musicaux et chorégraphiques ;
9° « Orchestre national en région », au titre d'une activité de valorisation des répertoires de musique symphonique et de leur renouvellement par la création contemporaine ;
10° « Pôle national du cirque », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles des arts du cirque ;
11° « Scène de musiques actuelles », au titre d'une activité de création, diffusion et accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ;
12° « Scène nationale », au titre d'une activité pluridisciplinaire de diffusion et de soutien à la création.
Au titre du présent décret, le terme « structures » désigne les personnes morales de droit public ou de droit privé et les services en régie d'une collectivité territoriale auxquels le ministre chargé de la culture peut attribuer un label dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 7 juillet susvisée.
II. - Le cahier des missions et des charges attaché à chaque label est établi par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées.
Il précise les missions et les charges, qui incombent aux structures bénéficiaires du label, de développement et de renouvellement artistiques, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, de participation à l'éducation artistique et culturelle, d'action et de médiation culturelle dans le champ social pour l'élargissement et le renouvellement du public, de professionnalisation des artistes interprètes et, le cas échéant, des artistes auteurs dans les disciplines spécifiques au label. Il mentionne leurs principales actions de coopération avec les organismes artistiques, culturels et éducatifs, aux niveaux régional, national et international, notamment avec les autres structures bénéficiaires du label. Il prévoit des modalités d'évaluation de l'accomplissement des missions et charges.
III. - Le label « fonds régional du patrimoine » est régi par les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret et par les articles R. 116-1 à R. 116-7 du code du patrimoine.
L'attribution d'un label est subordonnée au respect par la structure qui le demande des conditions suivantes :
1° Présenter un projet artistique et culturel d'intérêt général, de création, de production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, conforme au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 1er ;
2° Garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la direction responsable de celle-ci la gestion autonome d'un budget identifié ;
3° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès du public le plus large et le plus diversifié aux productions et aux œuvres, en portant une attention particulière à ceux qui, pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou physiques, sont éloignés de l'offre artistique ;
4° Mettre en œuvre un programme d'actions et de médiation culturelles notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l'action sociale ;
5° Disposer d'une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en œuvre du projet artistique et culturel et de locaux et d'équipements adaptés à ses missions ;
6° Bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu'elle met en œuvre, du soutien financier d'au moins une collectivité territoriale, hors mise à disposition de locaux ou de moyens humains. Cette condition n'est pas applicable aux structures qui demandent le label « centre dramatique national » et dont les statuts prévoient que la mission principale s'exerce à travers une itinérance sur le territoire national ;
7° S'engager à ce que le poste de dirigeant de la structure, dès lors que le label lui serait attribué, soit pourvu selon la procédure de sélection prévue à l'article 5.
I. - La demande d'attribution d'un label est adressée par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités territoriales qui la financent.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est réputé complet.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture.
III. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture.
Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
I. - L'attribution d'un label donne lieu dans les six mois à la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre la structure bénéficiaire du label et l'Etat, et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires.
Cette convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du projet artistique et culturel d'intérêt général à travers des objectifs concrets et mesurables, y compris financiers, pour l'application du cahier des missions et des charges attaché au label.
II. - La convention pluriannuelle d'objectifs est conclue pour une période de trois à cinq ans.
III. - Pour son fonctionnement général et la mise en œuvre du projet, la structure bénéficiaire du label reçoit un soutien financier de l'Etat.
IV. - Six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle d'objectifs, la structure bénéficiaire du label transmet au préfet de région, aux collectivités territoriales et à leurs groupements partenaires un bilan détaillé de la mise en œuvre du projet artistique et culturel, précisant notamment les résultats obtenus pour chacun des objectifs fixés par la convention.
I. - Pour la nomination de son dirigeant, la structure bénéficiaire du label met en œuvre une procédure de sélection assurant l'égalité de traitement des candidats et comportant :
1° Un appel public à candidatures, préparé en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat et validé par son instance de gouvernance compétente ;
2° Sur la base des lettres de candidatures, une présélection d'un nombre restreint de candidats, prenant en compte le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction, opérée par un comité de sélection comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;
3° L'élaboration par chaque candidat présélectionné d'une note présentant les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;
4° La soutenance de ce projet devant un jury, composé dans la mesure du possible d'un nombre égal d'hommes et de femmes, comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;
5° La validation de la proposition du jury par l'instance de gouvernance de la structure.
II. - L'autorité compétente pour la nomination transmet au ministre chargé de la culture la proposition du jury validée par l'instance de gouvernance.
La nomination du dirigeant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition validée. Passé ce délai, l'agrément est réputé délivré.
En cas de refus, le ministre notifie sa décision motivée aux membres du jury et à l'instance de gouvernance.
Article 6
Lorsqu'elle est relative à une entreprise de spectacles bénéficiaire du label « centre dramatique national », la convention pluriannuelle d'objectifs est complétée par un « contrat de décentralisation dramatique » conclu entre l'Etat et le dirigeant de ladite structure.
Le contrat de décentralisation dramatique comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'arrêté du ministre chargé de la culture fixant le cahier des missions et des charges attaché au label.
Article 7
I. - Dans le cas où la structure ne respecte pas les conditions et obligations prévues aux articles 2, 4 et 5, et plus généralement dans celui où elle manque à ses obligations légales au regard, notamment, du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s'y conformer dans un délai maximum de six mois.
La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la structure bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.
II. - Si la mise en demeure prévue au I reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label.
La décision de suspension ou de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.
III. - La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an. Si au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le label est retiré.
Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.
Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.
La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.
Chapitre II : Dispositions relatives au conventionnement
Article 8
En application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, une convention pluriannuelle d'une durée maximale de cinq ans peut être conclue entre l'Etat et une structure pour la mise en œuvre d'un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Pour chaque type de conventionnement, le cahier des missions et des charges mentionné au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, est ajouté le tableau suivant :
« Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
«
1
1° Arrêté d'attribution du label « Centre chorégraphique national »,
2° Arrêté d'attribution du label « Centre d'art contemporain d'intérêt national »,
3° Arrêté d'attribution du label « Centre de développement chorégraphique national »,
4° Arrêté d'attribution du label « Centre dramatique national »,
5° Arrêté d'attribution du label « Centre national de création musicale »,
6° Arrêté d'attribution du label « Centre national des arts de la rue et de l'espace public »,
7° Arrêté d'attribution du label « fonds régional d'art contemporain »
8° Arrêté d'attribution du label « Opéra national en région »,
9° Arrêté d'attribution du label « Orchestre national en région »,
10° Arrêté d'attribution du label « Pôle national du cirque »,
11° Arrêté d'attribution du label « Scène de musiques actuelles »,
12° Arrêté d'attribution du label « Scène nationale ».
Article 3
2
Agrément du dirigeant d'une structure bénéficiant du label mentionné à l'article 3
Article 5
».
Article 13
I. - Les structures bénéficiant à la date de publication du présent décret de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er reçoivent le label au sens du présent décret, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance de leur convention pluriannuelle et, au plus tard, dans un délai de deux ans.
La procédure de désignation des dirigeants prévue à l'article 5 s'applique pour ces structures à compter de la cessation du mandat de leur dirigeant en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Lire le texte complet du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DFFECDB29AC8D6A0862A32A81072FC57.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000034307944&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034307228

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 5:35 AM
|
Sur le site de l'émission d'Alain Kruger : "On ne parle pas la bouche pleine" sur France Culture.
A écouter le dimanche 2 avril à 12h00 sur France Culture, réécoute ensuite en ligne en suivant ce lien :https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/imagine-la-france-azimutee-le-guide-le-cuisinier-et-la
Dieppe Scène Nationale accueille le festival «Tous Azimuts» du 7 au 8 avril à Dieppe, au programme Cuisine et décadence et cuisine des enfers avec Karelle Prugnaud, Bernard Menez et Bruno Verjus
Tous Azimuts ! Performances artistiques & dîners fantastiques•
Karelle Prugnaud met en scène une joyeuse fantaisie gourmande.
Au programme Cuisine et décadence et Cuisine des enfers. http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/telechargement/tout_azimuts.pdf
Dîners déambulatoires dans le petit train de la ville guidés par Bernard Menez. La partition culinaire est composée par Bruno Verjus, les textes azimutés d'Eugène Durif et Ingrid Astier.
Au menu : tartare de sirène, coquilles Saint-Jacques encore vivantes, pêche miraculeuse...De l'acteur Denis Lavant en Roi Cannibale à la chanteuse Béatrice Demi Mondaine, contorsionnistes, plasticiens, musiciens stimuleront pupilles et papilles.
Tous Azimuts ! Performances artistiques & dîners fantastiques• Crédits : Nigentz
Liens
La compagnie l'envers du décor : http://www.cie-enversdudecor.com/
Le programme des réjouissances
http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/accueil.php#facebook
Dieppe Scène Nationale - Festival Tous Azimuts les 7 et 8 avril 2017http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/accueil.php
La page facebook de l'évènement
https://www.facebook.com/dsn.dieppescenenationale/
Food Intelligence, le blog de Bruno Verjus http://foodintelligence.blogspot.fr/
Crédits : Nigentz

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2017 7:48 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello
Palestro, un projet de Bruno Boulzaguet co-écrit avec Aziz Chouaki, mise en scène de Bruno Boulzaguet
Palestro, commentaire-fiction théâtral, fait le récit des épreuves d’un ancien combattant qui, initié à l’effroi en tant que témoin de l’embuscade de Palestro en Kabylie durant la Guerre d’Algérie (1954-1962), chemine jusqu’au naufrage existentiel d’un présent maudit, insérant çà et là ses trois enfants adultes.
Le titre du spectacle évoque l’embuscade de Palestro, épisode militaire du 18 mai 1956, qui met aux prises l’armée française à l’armée de libération nationale algérienne. L’affrontement conduit au quasi-anéantissement de l’unité française.
Les représailles « liquident » seize moudjahidines et quarante-quatre algériens.
Aziz Chouaki, auteur algérois d’expression française, et le metteur en scène Bruno Boulzaguet sont, en tant que fils de soldats de la Guerre d’Algérie, imprégnés de l’héritage générationnel de cette histoire : « Nous en avons hérité sans avoir touché une seule arme, sans rien connaître de l’histoire de ces guerres, ni de ces hommes.»
Une aventure non transmise du fait du mutisme paternel, un « legs pesant, tissé de silence et d’opacité » pour le fils Boulzaguet, que pourtant les témoignages d’anciens combattants et les récits d’historiens ont révélée à travers un spectacle de qualité.
Cinq cent mille hommes tués côté Algériens, vingt-huit mille côté français … Des paysans et des ouvriers sont devenus combattants, puis anciens combattants pour ceux qui ont survécu, d’une guerre perdue, sans que le mot ne soit jamais prononcé.
Avec initiation française à la boisson – la bière Kronenbourg –, puis la vie à la dérive.
Les enfants adultes, lors l’enterrement du « héros », décident de s’engager dans la quête de ce père alcoolique et silencieux, à partir d’une carte postale inachevée.
Les comédiens illuminent la scène, Luc-Antoine Diquéro, Cécile Garcia-Fogel et Stanislas Stanic qui jouent des êtres plus ou moins blessés, eux aussi, malgré la distance temporelle et comme par réfraction en victimes de bombe à retardement.
Unis par une relation fraternelle profonde, ils expriment une sensibilité à fleur de peau, jouant du non-dit et de l’implicite, entre colère rentrée puis éclat libératoires.
L’aîné (Luc-Antoine Diquéro) porte un fardeau psychologique symbolique – dévalorisation et mépris de soi, haine portée à ses proches et au monde entier : le comédien joue la vérité et l’authenticité d’une dérive paradoxale, vivace et énergique.
Fragilisé par la boisson, reflet du père, il n’en dégage pas moins force et convictions.
Le frère qui a fui ses origines pour s’installer à la ville est un intellectuel, situé confortablement du « bon côté », en messager des causes humanitaires et en défenseur obstiné et sentencieux de tous les exclus et « étrangers » de la terre.
Le jeu de Stanislac Stanic est persuasif dans sa manière de ne pas trop s’engager, accordant à la parole la puissance significative du partage et de l’équité raisonnée. Et quand il revêt le rôle du bourreau algérien, il sait interpréter un personnage apparemment aux antipodes du premier, avec la même fermeté et la même rigueur. Or, la dialectique des deux figures opposées aboutit à un enfermement similaire.
Quant à la sœur, incarnée avec la présence radieuse et la voix feutrée de Cécile Garcia-Fogel, plus naïve que ses frères au départ, elle clôt l’expérience loin au-delà d’eux, en les « dépassant » grâce à sa propre conscience féminine éclairée qui se lasse de ces jeux de guerre de soldats dits virils mais plutôt vindicatifs et vengeurs.
Voiture de tourisme ou camion militaire, le conducteur tourne son volant sous un jeu bruyant de batterie de cuisine en ferraille, métaphore des cantines rustres d’époque.
Des canapés et fauteuils changent d’horizon sur le plateau, une grande table de bois porte un grand plat de couscous avec le parfum de ses feuilles odorantes plantées : soit l’embuscade miniaturisée de Palestro qui se revit dans un décalage expressif.
Tom Boyaval, Etienne Bianco et Guillaume Jacquemont, les apprentis acteurs issus de l’ESCA d’Asnières, incarnent la jeune génération – celle qui officiait dans les années de guerre, appelés du contingent, armée régulière et parachutistes.
Innocence d’un jeune âge, foi dans les gradés, ils racontent leur désenchantement, en jouant au ballon avec un jerrican, chantant et révélant élan, énergie et vivacité.
Au-delà de ces temps et lieux tragiques, la bonne humeur et la sensibilité des personnages-acteurs diffusent sur la scène la vitalité inexorable d’un beau spectacle vivant, qui sait mêler les tensions du passé à un présent incertain qui doute encore.
Ce spectacle mérite longue vie sur les scènes de France, d’Algérie et de tous pays.
Véronique Hotte
L’Atalante 10 place Charles-Dullin 75018 Paris, du 24 mars au 1er avril 2017, lundi, mercredi et vendredi 20h30, jeudi et samedi 19h, dimanche 17h. Tél : 01 46 06 11 90
Crédit photo : Alain Richard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2017 8:28 AM
|
Publié dans Profession Spectacle
Le théâtre du Hangar, à Toulouse, propose des résidences d’artistes, le temps de quelques jours de travail, pour la saison 2017-2018. Les candidatures sont à envoyer uniquement par courriel avant le 15 mai prochain ; les projets sélectionnés seront annoncés à la mi-juin.
.
Modalités d’accueil
Prise en charge
-mise à disposition de la salle de travail équipée (lumière et son)
- mise à disposition des espaces de vie (coin cuisine, loges, costumerie, douche, toilettes)
- prise en charge des fluides (chauffage, électricité, eau)
Accompagnements proposés
- régisseur de la salle à disposition 4 heures à votre arrivée et 2 heures en fin de résidence
- mise à disposition de notre fichier de diffusion (base de travail)
- accompagnement artistique : mise en lien avec des artistes pour des regards extérieurs
- possibilité de présentation informelle du travail en cours après accord du comité de direction du lieu
Périodes et horaires
entre juillet et décembre, les accueils en résidences pourront s’organiser sur des périodes continues allant d’1 à 6 semaines ;
entre janvier et mai, les résidences seront d’une ou plusieurs semaines mais seulement entre le mercredi 18h et le dimanche 17h. Il faudra donc sur les 3 jours de “relâche” laisser le plateau nu, à la disposition des stagiaires de la formation du Hangar.
Pièces à fournir
le dossier de présentation du projet
parcours des participants liés au projet et parcours de la compagnie
un ou plusieurs visuels s’il y a lieu
la fiche complétée : la télécharger en pdf. http://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/03/Le-Hangar-de-Toulouse-Appelk-%C3%A0-projet-pour-r%C3%A9sidence.pdf
Candidatures
La demande (cf. fiche) est à envoyer avant le 15 mai 2017.
Courriel : residences@lehangar.org
Téléphone : +33 5 61 48 38 29
Le dossier sera ensuite étudié et une réponse sera communiquée avant le lundi 12 juin.
PDF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 6:14 PM
|
Par Anaïs Heluin pour Le Point Afrique
Au-delà de la mise en scène de la pièce de Koffi Kwahulé sur le peintre Jean-Michel Basquiat, Laëtitia Guédon veut partager son regard original.
Laëtitia Guédon aurait pu attendre la fin des travaux en automne 2017 pour ouvrir Les Plateaux sauvages*, nouvel établissement culturel de la Ville de Paris à la tête duquel elle a été nommée. Elle a préféré se lancer dans l'aventure au plus vite. Mettre en place un temps de préfiguration permettant aux artistes et au public de commencer à s'apprivoiser. C'est donc dans un espace encore en chantier qu'elle nous accueille, tandis que la compagnie La Louve de Lou Wenzel répète dans la salle de l'ancien Vingtième Théâtre. Résultat d'une fusion entre cette structure et le centre d'animation des Amandiers situé à quelques mètres, Les Plateaux sauvages se veulent lieu de métissage. D'abord entre création professionnelle et transmission artistique, mais aussi entre cultures différentes. Deux types de mélanges que Laëtitia Guédon pratique également en tant que metteuse en scène à la tête de sa compagnie 0,10.
Cela notamment dans sa dernière création intitulée SAMO**, a Tribute to Basquiat, consacrée au peintre noir américain Jean-Michel Basquiat (1960-1988), créée début mars à la Comédie de Caen. Dans ce spectacle comme dans le lieu qu'elle dirige, Laëtitia Guédon questionne son identité et celle des personnes de sa génération. En particulier de celles qui sont issues de l'immigration. Elle a pour cela passé commande d'un texte à l'auteur d'origine ivoirienne Koffi Kwahulé, et s'est entourée d'un comédien – Yohann Pisiou – au physique étonnamment proche de celui de Jean-Michel Basquiat, du danseur Willy Pierre-Joseph, du musicien-performeur Blade MC Alimbaye, du jazzman Nicolas Baudino ainsi que du vidéaste Benoît Lahoz.
Résultat : une forme hybride qui rappelle non seulement l'esthétique des œuvres les plus connues du peintre, réalisées de 1986 à sa mort deux ans plus tard, mais aussi l'énergie de ses balbutiements. Ses déambulations dans le quartier de Soho avec ses acolytes Al Diaz et Shannon Dawson, à la recherche du mur idéal pour réaliser des graffitis signés « SAMO © » - anagramme de « Same Old Shit ». Ses expériences musicales au sein du groupe Gray dont aucun des membres n'avait de formation musicale. Incarné par trois interprètes, le Basquiat de Laëtitia Guédon est tel que le décrit Glenn O'Brienn dans le catalogue de l'exposition du musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 2010. « Un peu comme Mohammed Ali sur le ring, bondissant rythmiquement en avant et en arrière, secouant la tête en zigzaguant comme pour éviter d'invisibles coups de poing. »
Le Point Afrique : Avec Samo, a Tribute to Basquiat, vous revenez à l'écriture de Koffi Kwahulé, que vous avez découverte avec Bintou (Lansman, 1997), objet en 2009 de votre première mise en scène à la tête de votre compagnie 0,10. En quoi son théâtre vous intéresse-t-il particulièrement ?
Laëtitia Guédon : Une des choses qui me touchent le plus dans son écriture, c'est la manière dont elle questionne l'identité. Histoire d'une jeune fille française issue de l'immigration africaine, Bintou a fait écho pour moi aux émeutes des banlieues en 2005. Lorsque j'ai découvert ce texte, je sortais à peine de l'école d'Asnières où j'ai fait ma formation de comédienne. Je n'avais alors jamais rien lu de semblable : très influencée par le jazz, l'écriture de Koffi Kwahulé s'attache à des personnages de l'entre-deux très peu présents dans les récits portés sur les scènes nationales. Née en France d'un père martiniquais et d'une mère marocaine, je me reconnais dans le malaise qu'ils expriment. Dans l'étrangeté qu'il y a à se sentir pleinement française, tout en étant sans cesse ramenée aux origines que suggère ma couleur de peau.
Parmi les artistes que vous avez déjà accueillis en résidence aux Plateaux sauvages, plusieurs travaillent sur la notion d'identité. Blandine Savetier dans son adaptation du roman Neige de Orhan Pamuk par exemple, ou encore Sidney Ali Mehelleb pour Babacar ou l'Antilope. Est-ce un axe de votre projet ?
Les compagnies accueillies aux Plateaux sauvages sont avant tout sélectionnées pour leur disponibilité à entrer en contact avec un territoire. En l'occurrence avec celui du quartier des Amandiers, remarquable par la mixité sociale de ses habitants. Je suis persuadée qu'en culture, le métissage des publics et des récits passe par la réinvention de l'action culturelle. Plus que vendre des billets, je veux remettre le théâtre à l'endroit du partage et de la simplicité. Permettre à tous de profiter des plaisirs de la scène, à la fois à travers les ateliers et autres activités proposées par les compagnies et grâce à des ateliers de pratique artistique amateur dirigés par des professeurs de qualité à des tarifs raisonnables, indexés sur le quotient familial. Le thème de l'identité, abordé en effet par plusieurs des compagnies en résidence et par moi-même avec ma compagnie, n'a donc pas été fixé. Les sensibilités convergent naturellement vers ce sujet.
Vous avez tout de même initié une collaboration avec le label Jeunes Textes en liberté, qui porte de manière explicite cette question de l'identité.
Je ne peux pas rester indifférente au débat sur la diversité, qui agite en ce moment le milieu culturel. Créé par Penda Diouf et Anthony Thibault, le label Jeunes Textes en liberté se saisit du problème de la manière qui me semble la plus intelligente : en favorisant l'émergence d'auteurs dramatiques contemporains qui prennent en compte la représentativité de la diversité française, qu'ils en soient eux-mêmes issus ou non. Car cette question n'est pas la propriété des artistes issus de l'immigration. Les Plateaux sauvages vont offrir un ancrage au label, notamment à travers un festival annuel. Nous ouvrirons aussi une librairie tournée vers les écritures francophones émergentes.
Dans vos mises en scène, cette diversité est en partie liée à votre démarche d'action culturelle, dont des traces sont visibles dans les spectacles. Création et travail avec les habitants devront-ils être ainsi associés aux Plateaux sauvages ?
Dans Samo, a Tribute to Basquiat en effet, le travail que j'ai mené avec ma compagnie auprès de la population – adolescente en particulier – de Caen et d'Ivry-sur-Seine a beaucoup servi la pièce. Dans les vidéos réalisées par Benoît Lahoz, on retrouve des visages de jeunes gens rencontrés lors de ce travail de territoire. Et les ateliers d'écriture que Koffi Kwahulé a faits avec eux ont nourri son écriture. J'ai toujours fonctionné ainsi, notamment à Aubervilliers où j'ai grandi puis travaillé au théâtre de la Commune, mais chaque compagnie accueillie aux Plateaux sauvages procède comme elle veut. L'important étant qu'il y ait rencontre avec la population. Lou Wenzel fait en ce moment une initiation au théâtre avec les élèves de l'école des Amandiers. Sidney Ali Mehelleb, qui cherche à mêler sport et théâtre, a organisé un stage d'une semaine sur le thème du coup porté avec une association locale de karaté...
Votre projet aux Plateaux sauvages comme votre pratique de la mise en scène sont largement inspirés de votre connaissance de la ville d'Aubervilliers. Je garde en effet un souvenir enchanté de mon enfance dans la petite cité de la Maladrerie à Aubervilliers, à un moment où Jack Ralite faisait beaucoup pour les artistes, convaincu que leur présence dans la cité était nécessaire. Peintre, mon père recevait dans son atelier tous types de personnes. Et il peignait aussi bien sur de grandes toiles que sur les murs de la cité. Cette circulation de l'art, son ancrage dans le quotidien, sont restés mon idéal. L'utopie de la Maladrerie a pourtant pris fin... En effet. Pourtant, lorsque je suis retournée sur les lieux vingt ans après les avoir quittés, j'ai retrouvé sur les murs les fresques de mon père. Tout avait été tagué, sauf elles, comme si on avait voulu garder une trace du passé. De ce moment où tout semblait possible pour la culture, du moins dans mes souvenirs d'enfant. Je ne peux pas dire quel sera l'avenir des Plateaux sauvages : c'est un laboratoire qui connaîtra sans doute ses échecs, mais que mon équipe et moi allons développer au mieux afin que nos successeurs puissent s'appuyer sur une base solide tout en imaginant leur propre projet.
On retrouve votre intérêt pour la trace dans votre dernière création, à travers les graffitis du jeune Basquiat. La révolte de celui-ci est-elle, selon vous, semblable à celle qui anime la jeunesse avec laquelle vous travaillez ?
Je crois que, contrairement à Basquiat et à une bonne partie de la jeunesse de Soho à New York dans les années 70, les jeunes Français des cités n'ont pas les moyens de transcender leur révolte. Leur lucidité sur l'avenir les empêche souvent d'essayer de s'en sortir. Ce que je trouve formidable chez Basquiat, c'est qu'à un moment donné l'art aspire tout. J'aimerais que les Plateaux sauvages puissent offrir la possibilité de ce dépassement. C'est pourquoi le premier endroit que j'ai voulu investir dans l'ancien centre d'animation, c'est le sous-sol où j'ai ouvert un petit studio d'enregistrement. Les jeunes pourront venir y travailler en toute discrétion.
Est-ce pour cela que vous avez choisi de vous intéresser à la jeunesse du peintre, et non aux années 1986-1988 où il produit ses œuvres les plus célèbres ?
La manière dont l'artiste se crée à ce moment-là une identité sous le pseudonyme de « Samo » m'a passionnée. Sa détermination à devenir une star lui donne une énergie incroyable, qui se déploie sous des formes diverses, parmi lesquelles des inscriptions murales. Le terme de « graffitis » ne rend pas tout à fait compte de ces productions. Comme de nombreux artistes de l'époque, Jean-Michel Basquiat refusait d'ailleurs de l'utiliser : ils lui préféraient le substantif « Écritures ». Ce foisonnement m'a permis de sortir des codes théâtraux classiques. De créer un frottement entre danse, théâtre, jazz, naissance du hip-hop, arts plastiques et vidéo. Un projet indiscipliné plus que pluridisciplinaire.
Quelle place réservez-vous à la revendication d'une identité noire américaine par Basquiat ?
Basquiat n'a jamais versé dans une revendication de type Black Panthers. C'est aussi cela qui m'intéresse chez lui. Il a beau avoir peint les plus grandes figures noires américaines de l'époque et avoir été passionné par la musique de Charlie Parker, il a toujours sur faire preuve d'humour sur ces sujets. Le spectacle rend compte de cette distance qui donne une grande force politique à son œuvre. Mon père disait souvent « l'art doit être oblique ». Je suis d'accord avec lui.
* Les Plateaux sauvages, 5, rue des Plâtrières, 75020 Paris. Tél. : 01 40 31 26 35. www.lesplateauxsauvages.fr. Inauguration et lancement de la saison 2017-2018 en automne 2017.
** SAMO, a Tribute to Basquiat, du 22 mars au 1er avril au théâtre des Quartiers d'Ivry-CDN du Val-de-Marne, Manufacture des Œillets / Le Lanterneau, 1 place Pierre-Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine. www.theatre-quartiers-ivry.com, également du 5 au 14 avril à La Loge à Paris, le 21 avril théâtre Victor Hugo à Bagneux et le 27 avril au Quai des arts à Argentan.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 12:30 PM
|
Par Agathe Charnet dans son blog du Monde L'Ecole du spectateur :
Le festival A contre sens, événement majeur de la vie étudiante de l’université Paris-III ©Sorbonne nouvelle Photothèque / E. Prieto Gabriel
Quarante-six représentations, 24 spectacles programmés et une centaine d’artistes étudiants à l’affiche. Le festival A contre sens de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III bat son plein en ce début de printemps 2017. Créé en 1996, ce festival embrasse tous les aspects du spectacle vivant, de la marionnette au théâtre, de la danse contemporaine au masque. « Le festival est organisé de bout en bout par les étudiants, explique Tristan Héraud, 24 ans, qui supervise A contre sens pour la troisième année consécutive. Aux manettes, 25 étudiants bénévoles de l’ATEP 3, l’association théâtrale des étudiants de Paris-III, mobilisés durant toute une année universitaire pour cette fête artistique.
« Nous élaborons la programmation en faisant des auditions, nous assurons la communication, les aspects techniques, l’accueil des compagnies et du public… On est dans de vraies conditions, c’est extrêmement formateur, détaille Tristan Héraud. Au total, près de 2 000 spectateurs sont attendus sur le campus de la Sorbonne nouvelle, du 22 mars au 5 avril. Un travail de titan qui fait honneur à l’Institut d’études théâtrales de Paris-III dont sont issus la plupart des jeunes organisateurs.
Un millier d’étudiants en études théâtrales
Il faut dire que le théâtre fait partie de « l’identité de la Sorbonne nouvelle », raconte le directeur de l’Institut d’études théâtrales, Pierre Letessier. L’Institut d’études théâtrales était parmi les membres fondateurs de l’université Paris-III, sur le campus de Censier, en 1968. » Dans le 5e arrondissement de Paris, un millier d’étudiants sont intégrés à l’Institut, de la licence au master. Ils disposent de plusieurs salles de pratique artistique équipées de projecteurs et de matériel de son. La théâtrothèque Gaston-Basty leur offre un vaste choix de ressources et de documentation sur les arts du spectacle.
L’objectif des formations dispensées au sein de l’institut d’études théâtrales ? « Articuler une approche historique et théorique tout en gardant un lien constant avec la pratique et la création », décrit Pierre Letessier. La licence d’études théâtrales permet ainsi de s’initier à l’histoire du théâtre, à la dramaturgie ou au droit du spectacle vivant. Des ateliers pratiques sont aussi proposés à ces jeunes artistes. Car beaucoup d’étudiants suivent en parallèle des cours de théâtre dans des conservatoires d’arrondissement ou des écoles privées.
Une réalité pleinement prise en compte par Pierre Letessier et son équipe : « nos élèves ont des profils très variés et nous aménageons leur scolarité en fonction. Certains sont dispensés de contrôle continu ou de pratique artistique à l’université. Pendant la période des concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art dramatique, les bancs des amphis se vident ! » Le cursus d’études théâtrales « n’est pas un conservatoire », précise Pierre Letessier. « Les étudiants reçoivent à l’université une formation pointue qui peut accompagner et nourrir leur pratique de comédien ou de metteur en scène et vice-versa. Ils sont aussi sensibilisés aux questions de l’intermittence et aux réalités du monde professionnel. »
Formations spécialisées
Pour œuvrer à l’insertion professionnelle des étudiants, des formations spécialisées et sélectives sont proposées par l’Institut d’études théâtrales. Trois licences professionnelles permettent ainsi de se former à la scénographie, au costume et à l’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale.
Au niveau master, la Sorbonne nouvelle propose un master recherche en études théâtrales mais aussi un master en art thérapie et un master 2 des métiers de la production théâtrale. Les étudiants sont formés en apprentissage à l’administration, à la production et à la diffusion. Laura Cohen suit actuellement cette formation, en alternance avec la salle de concert parisienne Le Point éphémère. Cette jeune femme de 24 ans a réalisé tout son cursus à Paris-III en études théâtrales. « Je fais du théâtre en parallèle et j’ai eu besoin de m’assurer un diplôme universitaire et d’approfondir mes connaissances, explique Laura Cohen. Le master de production théâtrale m’aide à gérer ma compagnie et me permet d’apprendre un métier passionnant. »
Pour ces futurs professionnels du spectacle vivant, le festival A contre sens permet de faire ses premières armes. Et de refléter le dynamisme et les grands enjeux de la création étudiante. « Cette année, beaucoup des spectacles abordent la question du vivre ensemble, la citoyenneté et de l’engagement », remarque Tristan Héraud. Des thématiques qui ne sont sûrement pas étrangères à l’approche de l’élection présidentielle.
–
Festival A contre sens, du 22 mars au 5 avril 2017. Campus de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III, 13, rue de Santeuil, Paris 75005.
Programmation ici, http://www.atep3.fr/WordPress/festival/festival-2017/programme2017 ; entrée libre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 5:24 AM
|
Sur le site de l'émission d'Olivia Gesbert "La Grande table" sur France Culture
Ecouter l'émission en ligne sur le site de France Culture (34min) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/jean-marie-horde-le-theatre-refuge-democratique
Quel peuple pour quel théâtre ? Jean-Marie Hordé, directeur du Théâtre de la Bastille à Paris, publie son nouvel ouvrage "L’Artiste et le Populiste" aux Solitaires intempestifs. En discussion avec le metteur en scène Eric Lacascade, invité de la première partie.
Dans une tribune au Monde, il appelait à ne pas enfermer l'art dans une soi-disant culture populaire, estimant que "l'Art n'est pas pour tous, mais pour chacun"... Après "Un directeur de théâtre", plaidoyer pour un théâtre singulier en 2008, où il revenait sur son rôle de programmateur, certes, mais aussi sur la mission qu'il s'est assignée de créer les conditions d'une expérience sensible partagée, après "Le démocratiseur" aussi en 2011 où il regrettait l'appauvrissement de la culture sous prétexte d'égalité et déplorait l'abandon de toute ambition artistique, Jean-Marie Hordé poursuit aujourd'hui sa réflexion avec L'Artiste et le Populiste, réponse à cette tentation croissante d'opposer les élites aux peuples. En dialogue avec le metteur en scène Eric Lacascade.
"Je trouve l'espace de création, de rencontre, de désir, permis par le théâtre, un peu absent dans d'autres sphères de la société actuelle".
"Le théâtre permet un espace de création, de désir entre acteur et spectateur qu'on ne trouve pas ailleurs".
"Le perpétuel questionnement c'est l'ouverture de possibles, un travail sur l'augmentation de la puissance d'un individu".
Eric Lacascade
"Le populiste, porteur d'une "raison" déformée, prétend parler à la place du peuple, et évite de se demander ce que c'est".
"Le théâtre, face-à-face vivant, offre la possibilité d'une variation, d'un écart : là est l'expérience démocratique".
"J'attends d'une bonne politique culturelle qu'elle développe du potentiel, voie loin, ait de l'ambition irréalisable".
Jean-Marie Hordé
Sons diffusés :
- Jérôme Clément, directeur de l'Alliance Française, "Un autre jour est possible" (France culture), 1er juin 2016
- Jacques Rancière, extrait d'une vidéo du Festival d'Avignon
Pour réécouter le metteur en scène et comédien Eric Lacascade, invité de la première partie, c'est ici : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/eric-lacascade-mise-en-lumiere-des-bas-fonds
Intervenants
Jean-Marie Hordé : directeur du théâtre de la Bastille
Bibliographie
L'Artiste et le Populiste (Quel peuple pour quel théâtre ?) Solitaires Intempestifs, Jean-Marie Hordé
Photo : public au théâtre d'Epidaure, en Grèce (2015) Crédits : Reuters staff - Reuters

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 4:36 AM
|
Par Audrey Jean pour theatres.com :
Lætitia Guédon, directrice du tout nouveau lieu parisien Les plateaux sauvages, signe actuellement la mise en scène d’un spectacle hommage au peintre Basquiat. Un poème hybride porté par trois artistes de talent et sublimé par le musicien Nicolas Baudino, une forme plurielle et dense à l’image de la complexité de l’emblématique Basquiat.
À la manière d’une enquête, d’un puzzle à reconstituer, Lætitia Guédon s’attarde ici à retrouver le sens de SAMO « Same old Shit » prémices de tout un pan de l’art urbain initié par Basquiat et ses acolytes, elle entreprend de dessiner en quelque sorte une esquisse de Basquiat, les contours mouvants de l’homme qu’il fût avant de devenir le grand artiste torturé et prolifique que tout le monde connaît. C’est la plume vibrante de Koffi Kwahulé qui mettra des mots sur cette enquête. À travers une langue saccadée, nerveuse, à l’énergie brûlante le spectateur est transporté au cœur même d’une époque arty, débordante, politisée, un New York grouillant d’innovations, une époque où la rue est le théâtre d’une créativité sans limites. Au plateau il y aura donc trois facettes de Basquiat, trois moyens d’expressions de son inventivité et de ses fulgurances, de ses émotions, de son histoire personnelle. Yohann Pisiou est l’interprète de sa parole brute, violente, spontanée et jaillissante de Basquiat, une parole qui dit tout de lui, de sa rage de survivre, de sa combativité sans faille face aux difficultés, de ses errances aussi. Une parole dont la puissance est renforcée par la ressemblance frappante du comédien avec le jeune Basquiat, ainsi que par sa présence scénique incandescente. Willy Pierre-Joseph lui ne parle qu’avec son corps mais quel langage explosif, le danseur se livre en effet à des performances absolument saisissantes de beauté. L’artiste Blade Mc Alimbaye enfin incarne la figure du père ainsi que la musicalité de Basquiat au moyen notamment d’une boite à rythmes complétant à la perfection avec le musicien Nicolas Baudino ce spectacle conceptuel. Il en résulte une ode troublante et envoûtante au talent de Basquiat, à sa personnalité hors-normes, écorchée vive, mais aussi un cri d’amour en direction de tous ceux qui se battent pour faire émerger la création sous ses formes les plus diverses.
Audrey Jean
« SAMO, a tribute to Basquiat » de Koffi Kwahulé
Mise en scène de Lætitia Guédon
Avec Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, Blade Mc Alimbaye et Nicolas Baudino
Jusqu’au 1er Avril à la Manufacture des Oeillets
Du mardi au vendredi à 20H
Samedi à 18H30
Du 4 au 14 Avril à La Loge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 8:00 PM
|
Par Brigitte Salino (Berlin, envoyée spéciale) dans Le Monde
Frank Castorf quitte la direction du grand théâtre allemand avec une mise en scène phénoménale de « Faust ».
Quand on arrive devant la Volksbühne, il faut toujours lever les yeux et regarder le calicot au frontispice du théâtre, qui change selon l’actualité et les spectacles. Il y a quelques mois, y était écrit « Verkauft » (« vendu »). C’était un message envoyé par Frank Castorf, le directeur et fantastique metteur en scène, à qui le Sénat de Berlin a fait savoir, au printemps 2015, qu’il devrait quitter son poste en août 2017 pour laisser la place à Chris Dercon, le patron de la Tate Modern de Londres. Une révolution : pour la première fois, un curateur, et non un homme de théâtre, était nommé à la tête d’une scène emblématique de Berlin, située dans l’ex-Est et édifiée par Oskar Kaufmann en 1914.
Lire le portrait : Frank Castorf, le génial kamikaze, quittera la Volksbühne en 2017 : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/27/frank-castorf-le-genial-kamikaze-quittera-la-volksbuhne-en-2017_4623382_3246.html
Cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de la culture berlinois, où elle a provoqué une violente controverse. Pour ses soutiens, Chris Dercon augure d’une nouvelle ère de la Volksbühne : le Flamand polyglotte, né en 1958, qui a mené une carrière de haut vol en Europe, met en avant une ouverture sur toutes les disciplines artistiques – arts numériques compris –, un renforcement de la dimension internationale de la programmation et une extension géographique de la Volksbühne, qui devrait s’approprier le Hangar 5 de l’aéroport désaffecté de Tempelhof, au sud de Berlin.
Lire le compte-rendu : Violente controverse autour de l’avenir des théâtres berlinois : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/04/06/violente-controverse-autour-de-l-avenir-des-theatres-berlinois_4610472_1654999.html
Chris Dercon a mené une opération de charme – et il est doué en la matière – quand il est venu présenter son projet à Berlin, en avril 2015. Mais il n’a pas calmé ses détracteurs. Pour eux, le projet du curateur détruit l’héritage de la Volksbühne, livrée à la marchandisation du théâtre et à l’événementiel. Claus Peymann, le directeur du Berliner Ensemble, qui, lui aussi, quittera son poste en août, juge que Chris Dercon est « une chemise vide ». Frank Castorf pense que l’on veut « vendre le théâtre, en Allemagne » – d’où le « Verkauft ». Il est suivi par son équipe, qui a écrit une lettre ouverte contre l’arrivée de Chris Dercon, à l’automne 2016.
Lire le récit : De Londres à Berlin, l’envol de Chris Dercon : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/27/de-londres-a-berlin-l-envol-de-chris-dercon_4623166_3246.html
Car la lutte continue, même si elle n’est plus aussi virulente. Klaus Lederer, le sénateur (Die Linke, gauche) à la culture de Berlin depuis décembre 2016, a fait savoir dans un premier temps qu’il voulait rompre le contrat de Chris Dercon. Le prix du dédommagement – plus d’un million d’euros, dit-on – l’en a dissuadé, et les relations avec le nouveau directeur semblent s’apaiser. Tout le monde attend maintenant la conférence de presse de Chris Dercon, qui annoncera la programmation de sa première saison le 16 mai. D’ici là, la Volksbühne de Frank Castorf livre sa cérémonie des adieux.
Lire le reportage : Berlin divisée par une polémique théâtrale : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/04/24/berlin-divisee-par-une-polemique-theatrale_4621885_1654999.html
« Erotisme de la trahison »
« Don’t look back », lit-on sur les murs d’une petite maison posée dans le hall du théâtre, et recouverte de photographies de comédiens. A côté, on peut trouver, comme toujours à la Volksbühne, des boîtes d’allumettes gratuites. Il y a un an, il était écrit sur ces boîtes, au choix, « Still Alive » ou « Fuck Off ». Aujourd’hui, il n’y a plus que le fameux logo de la Volksbühne, une roue qui court, avec des jambes : Bert Neumann, le décorateur de génie de Frank Castorf, l’avait dessinée en 1990,pour la création des Brigands, de Schiller, en reprenant un très vieux signal des truands berlinois.
Lire l’enquête : Le nouveau paysage du théâtre allemand http://www.lemonde.fr/scenes/article/2016/02/29/le-nouveau-paysage-du-theatre-allemand_4873528_1654999.html
C’était deux ans avant que Castorf, aujourd’hui âgé de 65 ans, soit nommé à la direction de la Volksbühne. Vingt-quatre ans plus tard, le Faust de Goethe annonce la fin de son règne. Ou plutôt son Faust, qui vole à des années-lumière du texte original, et emprunte à plusieurs sources, du Nana, d’Emile Zola, à des discours de Frantz Fanon. Frank Castorf a toujours pratiqué ainsi : c’est un fou d’associations, un bâtisseur iconoclaste, un maître de « l’érotisme de la trahison », pour reprendre le titre d’un livre (non traduit) qui lui est consacré.
FRANK CASTORF NE FAIT PAS DU THÉÂTRE POLITIQUE, IL FAIT POLITIQUEMENT DU THÉÂTRE, ICI ET MAINTENANT
« Comment on devient un trou du cul », titre le programme du spectacle. Ça, c’est pour la provocation, qui serait une simple marque de fabrique du metteur en scène si elle n’accordait aussi bien le fond et la forme : Frank Castorf ne fait pas du théâtre politique, il fait politiquement du théâtre, ici et maintenant. « Je mets en scène Faust parce qu’on peut faire ce qu’on veut avec Faust », déclare-t-il. Soit : parler du capitalisme et de la colonisation, à travers la guerre d’Algérie.
Lire l’entretien avec Frank Castorf : « L’artiste doit se sentir étranger » http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/09/10/theatre-pour-frank-castorf-l-artiste-doit-se-sentir-etranger_4995520_3246.html
Sur ce dernier point, le metteur en scène justifie le choix de Faust en citant deux vers liés à l’épisode de Philémon et Baucis, dans le Faust II. Il aurait tout aussi bien pu s’en passer. Quand on voit son spectacle, on voit ce que lui inspire un homme, un intellectuel usé, qui a raté sa vie et fait avec le diable un pacte qui lui permet de tout se permettre. Et permet donc à Castorf de mettre en scène ce qu’il a envie de mettre en scène aujourd’hui, en laissant entendre, au passage, que la société peut elle aussi faire des pactes politico-culturels douteux.
Là encore, on en trouve des traces dans le hall de la Volksbühne : des éléments de décor dans lesquels les comédiens sont filmés. L’un d’eux est une reproduction de la station de métro Stalingrad, à Paris. Dans son jus des années 1960, mais détournée : les sorties indiquent « Stalingrad » et « Maxime Gorki ». Des scènes de toute beauté se jouent dans une voiture de métro, fidèlement reproduite, avec ses bancs en bois. L’une d’elles fait entendre La Fugue de la mort, de Paul Celan, dite par Abdoul Kader Traoré, un comédien burkinabé.
Damnés du capitalisme
L’alchimie des fragments est un ressort essentiel de la mise en scène, qui convoque au même plan Lord Byron (le comédien imite l’accent flamand de Chris Dercon lorsqu’il parle allemand), Méphisto, Marguerite, une sorcière, Wagner et Bordenave, embarqués dans une folie théâtrale, à l’aune du décor multifonctions : une gueule ouverte qui marque l’entrée de l’enfer – un château de foire – s’imbrique dans la perspective d’une ville nocturne, où l’on verra apparaître une prison et un poste-frontière, et où trône une affiche d’exposition coloniale. Dans cette jungle mentale du XXe siècle, les comédiens se battent comme des lions en cage, des damnés du capitalisme et de la colonisation, des traîtres à la cause, des forçats de la chair hurlant l’hallali du désir.
Dire que l’on comprend tout serait d’une certaine présomption. Mais, à travers les fragments, l’imbrication des styles de jeu, le mélange entre théâtre et cinéma, et la croyance frénétique en la force de la représentation, on perçoit et on ressent les pertes et fracas d’un pan de notre histoire française, la désillusion acharnée d’un système, la quête sans fin d’un espoir politique. Il y a, comme souvent avec Frank Castorf, quelque chose de phénoménal qui se joue, avec une liberté immense et une implication sans faille des acteurs, une élite de la troupe de la Volksbühne.
IL Y AVAIT BEAUCOUP DE JEUNES DANS LA SALLE, ET DES AMATEURS AGUERRIS DE FRANK CASTORF, VENUS LUI DIRE AU REVOIR
C’était particulièrement frappant un soir où le spectacle ne s’est pas donné à 18 heures, comme d’habitude. Samedi 18 mars, la représentation a commencé à 23 heures, et s’est achevée sous les hourras à 6 heures le lendemain matin. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, et des amateurs aguerris de Frank Castorf, venus lui dire au revoir. A l’aube, certains ramassaient des bouteilles, puis tout le monde a été invité à prendre un petit déjeuner. C’est peut-être la lumière, celle du fameux « mehr Licht » (« plus de lumière ») qu’aurait dit Goethe avant de mourir, qui restera dans les mémoires, quand chacun sortit dans Berlin où le soleil brillait, comme par miracle.
On pouvait voir alors, au frontispice de la Volksbühne, le calicot du moment : « Bekannte Gefühle, Gemischte Gesichter » (« sentiments connus, visages mêlés »). Une nouvelle plaisanterie de Frank Castorf ? Non, c’est un clin d’œil de Christoph Marthaler, qui a choisi ce titre, emprunté à une pièce de Botho Strauss, pour le dernier spectacle qu’il fait là où tout a commencé pour lui. En 1993, il signait la création inaugurale du mandat de Castorf à la Volksbühne : Murx den Europäer ! Murx Ihn ! Murx Ihn ab ! (« Etrangle l’Européen ! Etrangle-le ! Etrangle-le ! »), et ce fut un événement : les Allemands et, très vite, toute l’Europe du théâtre, accouraient pour découvrir un Suisse venu de la musique, qui offrait du jamais-vu.
Vingt-cinq ans d’histoire
Il n’y avait aucune intention anti-européenne dans Murx !… Mais une douzaine d’hommes et de femmes affalés dans une cantine où, parfois, ils se relevaient de leurs chaises et chantaient de vieilles chansons populaires. Ce sont eux que l’on retrouve aujourd’hui. Ils ne sont pas dans une cantine, mais dans la salle vide d’un musée où un homme en blouse grise (le Français Marc Bodnar, qui est de tous les spectacles de Marthaler) apporte des boîtes de déménagement, desquelles sortent des hommes et des femmes. Comme dans Murx !…, le temps les a figés. Ils ne disent pratiquement pas un mot, ils chantent parfois, à voix basse.
Quand Christoph Marthaler est arrivé à la Volksbühne en 1993, il a découvert un théâtre qui portait les strates de la RDA (République démocratique allemande). Aujourd’hui, il revient sur vingt-cinq ans d’histoire. A sa façon. Sans délivrer de message, mais en faisant savoir, à travers une mélancolie qui jamais ne pèse, mais se pose comme un voile dans nos consciences, que les années passent, la roue tourne, avec ses jambes véloces, et que le plateau du théâtre reste l’endroit irremplaçable d’une consolation. Tout berlinois qu’ils soient, ses Sentiments connus, visages mêlés parlent à tous, partout en Europe. Ils seront au Printemps des comédiens, à Montpellier (les 30 juin et 1er juillet). A la Volksbühne, un nouvel été aura commencé.
Lire l’éclairage : Un beau Printemps des comédiens s’annonce à Montpellier : http://sco.lt/66pK77
Brigitte Salino (Berlin, envoyée spéciale)
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 7:19 PM
|
Par Brigitte Salino
La 31e édition, du 30 mai au 1er juillet, offre une affiche internationale de haut niveau.
Ariane Mnouchkine, Romeo Castellucci, Christoph Marthaler, Isabelle Huppert : il y aura du beau monde au Printemps des comédiens, qui se tiendra du 30 mai au 1er juillet, à Montpellier (Hérault). Pour sa 31e édition, le festival dirigé par Jean Varela conforte la position majeure qu’il a acquise au cours de la dernière décennie, et rassemble, dans le magnifique domaine d’O, du théâtre et de la danse, de la performance, du cirque et de la musique.
Les spectateurs auront la primeur en France de Sentiments connus, visages mêlés, la création que Christoph Marthaler vient de faire à la Volksbühne de Berlin, et du nouvel opus de Romeo Castellucci, De la démocratie en Amérique, inspiré par Alexis de Tocqueville, qui sera ensuite l’invité du Festival d’automne à Paris.
Ils seront aussi les premiers, en province, à entrer dans La Chambre en Inde du Théâtre du Soleil, qui ouvre Le Printemps des comédiens, où il n’était pas venu depuis 1992. Isabelle Huppert, elle, lira Sade, qui côtoie Gorki, avec Les Bas-fonds mis en scène par Eric Lacascade, et Ovide et Shakespeare, réunis par Guillaume Vincent dans Songes et métamorphoses.
Un Faust d’aujourd’hui
Faust aussi rôdera dans le domaine, un Faust d’aujourd’hui, magistralement réinventé par Sylvain Creuzevault dans Angelus Novus. Dans un autre registre, le tendre et rêveur Théâtre Dromesko présentera deux spectacles sous chapiteau, Le Jour du grand jour, et Le Dur désir de durer, et Stéphane Ricordel offrira un moment de cabaret fou, avec les Dark Daughters, six chanteuses ukrainiennes insoumises.
Parmi les autres rendez-vous, il faut noter Les Restes, une création de Charly Breton avec les élèves du Conservatoire de Montpellier, dont une promotion précédente avait offert un des spectacles les plus remarquables de ces dernières années, Nobody, mis en scène par Cyril Teste.
Lire le compte-rendu de l’édition 2016 : Pour le Printemps, direction Montpellier
Printemps des comédiens, Domaine d’O, 178, rue de la Carriérasse, Montpellier (Hérault). Tél. : 04-67-63-66-66. printempsdescomediens.com.
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:45 PM
|
Par Sonia Bos-Jucquin dans Théâtoile
Très peu montée en France, Vera est la dernière pièce du dramaturge et cinéaste tchèque Petr Zelenka. Drôle et tragique, Karin Viard se voit confier la vie d’une femme féroce, qui lui va parfaitement, au point de penser que le rôle a été écrit pour elle, sur mesure. C’est la troisième fois qu’elle collabore avec Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo. L’alchimie est indéniable et fait éclore une comédie sociale grinçante et acide qui doit beaucoup à sa distribution éclatante.
Vera est une directrice d’agence de casting pour acteurs de cinéma et de télévision à Prague. C’est ce qu’on appelle une femme active, toujours en train de courir après le temps, pendue au téléphone et gérant toutes les sphères de sa vie d’une main de fer. Elle est au sommet de sa carrière mais n’a pas totalement assouvi son désir de puissance et de pouvoir. Lorsqu’elle amorce la fusion avec une autre agence basée en Grande-Bretagne, elle signe un pacte avec le diable en personne. Dépourvue de son âme, s’ensuit pour elle ce qui s’apparente à une lente et longue descente aux enfers où elle va tout perdre, victime d’un système néo-libéral qui la dépasse et la dévore. Ce zoom sur son existence, dont chaque pan s’effondre tel un château de cartes, est l’expression d’une société individualiste au cœur d’un capitalisme que Petr Zelenka dépeint avec talent, comme s’il déroulait la pellicule d’un film de vie. L’ouverture de la pièce se fait d’ailleurs sous la forme d’un générique cinématographique, clin d’œil appuyé à l’auteur et au propos sous-jacent.
Vera ouvre un questionnement sur le métier d’acteur et la fabrication de l’image renvoyée aux spectateurs. Le texte du tchèque Petr Zelenka est proche du pamphlet politique mais avec une forte présence de l’humour comme arme ultime, rempart infaillible à toute attaque. La forme plaisante et rythmée s’apparente à celle d’un scénario avec une succession de courts tableaux entrecoupés par des ellipses temporelles. Sur le plateau, si Karin Viard, époustouflante comme à son habitude, s’attache à montrer la déchéance de Vera, ses camarades de jeu endossent à eux cinq près d’une trentaine de personnages. Karin Viard est impitoyable et ne se ménage pas dans l’incarnation de cette femme que l’on peut qualifier sans trop exagérer de « sans foi ni loi ». Ses valeurs sont celles de la jungle où il faut se battre pour s’en sortir, tout en mettant de côté ses états d’âme. Mais à vouloir agir sur tous les fronts, le risque est bien entendu de perdre pied. C’est ce qui arrive au personnage mais pas à l’actrice qui maîtrise parfaitement la vaste palette déployée. Elle parvient à redonner une forme d’humanité qui, malgré les aspérités, enclenche une forme d’empathie chez le spectateur. On la juge mais au final, on la plaint. Karin Viard est irrésistible et monstrueusement humaine.
La scénographie de Marc Lainé inclut une grande présence de la vidéo et à travers elle toute la réflexion sociale sur l’image. On y voit des clichés de Karin Viard enfant entrecoupés de phrases assassines telles que « ton physique n’est plus à la mode ». Autant avoir le moral au beau fixe pour monter dans le wagon de ce train d’enfer. Heureusement, on peut respirer grâce aux notes d’humour et à la chanson écrite par Pierre Notte qui revient tel un refrain à chaque nouvelle étape franchie vers la perte d’influence et la noyade psychologique de Vera qui voit son existence échapper à toute emprise, à tout contrôle. A l’aide d’une succession de plans séquences, la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier font de Vera un film scénique sur une drôle de vie, celle d’une femme qui joue avec le système libéral et capitaliste jusqu’à s’en brûler les doigts et les ailes. Une satire sociale qui pose les questions basiques de toute déchéance : comment peut-on en arriver là ?
Photo © Tristan Jeanne Valès
————————————————————————————————————————————–
Vera
Texte : Petr Zelenka
Traduit du tchèque par : Alena Sluneckova
Version scénique : Pierre Notte
Mise en scène : Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
Avec : Karin Viard, Helena Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza
Durée : 1h50
Du 23 mars au 8 avril
Représentations à 20h30
Dimanche 26 mars à 15h
Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 paris
Réservations : 01 42 74 22 77 ou www.theatredelaville-paris.com
Advertisements
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 6:14 PM
|
Publié sur le blog "Mordue de théâtre" :
Critique de La résistible ascension d’Arturo Ui, vue le 31 mars 2017 à la Comédie-Française
Avec Thierry Hancisse, Éric Génovèse, Bruno Raffaelli, Florence Viala, Jérôme Pouly, Laurent Stocker, Michel Vuillermoz, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez, Nâzim Boudjenah, Elliot Jenicot, et Julien Frison, dans une mise en scène de Katharina Talbach
Alors qu’on célèbre les 80 ans du Guernica de Picasso, et devant la découverte de l’immense texte qu’est Arturo Ui, une constatation s’impose : les périodes de très grandes crises produisent toujours de grands génies. Je connais mal Brecht, et ne l’ai vu monté qu’ici, à la Comédie-Française, il y a près de 6 ans maintenant. J’était plus jeune, trop jeune peut-être pour percevoir l’intensité de la dénonciation, la puissance des mots, et le pouvoir du théâtre qui s’incarnent à travers ses textes.
Évidemment. Monter Arturo Ui aujourd’hui, à un mois du premier tour des élections présidentielles, est une nécessité. Mettre en scène l’effrayante montée au pouvoir d’un homme (il faut comprendre ici l’être humain, et si Arturo s’était appelé Artura cela n’aurait rien changé à l’affaire, mais bien entendu je ne vise personne) au moyen des pires bassesses qui existent ne peut qu’entraîner une résonance amère avec la situation actuelle. J’aurais voulu que Brecht ne soit pas un classique, car sa capacité de parler au présent est absolument déroutante. Comment a-t-on pu oublier si vite des mécanismes qu’on connaît si bien et qu’on a tant haï ? S’il vous plaît, n’oubliez pas d’aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Mais je m’égare.
J’avais peur des codes brechtiens. Je sais par ma courte expérience de la Commedia dell’arte que le théâtre de code n’est pas forcément ma tasse de thé. Je sais aussi que je peux me tromper et le reconnaître assez vite pour entrer dans une pièce qui me laissait perplexe en premier lieu. A travers La résistible ascension d’Arturo Ui, j’ai compris à quel point les codes étaient essentiels au théâtre de Brecht, à quel point la distanciation permettait la réflexion du spectateur, par son absence totale d’identification tout au long du spectacle. J’ai compris que le rire, nécessaire tout au long de la pièce pour pouvoir reprendre son souffle face à tant d’horreurs, était l’une des dernières échappatoires face à notre monde troublé.
Mais on ne rit pas toujours, dans ce spectacle. La mise en scène permet de mettre en valeur ce texte d’une force incroyable, en reprenant les codes du Volkstheater. Les personnages, grotesques, ridicules, se retrouvent dessinés si grossièrement qu’ils en deviennent des pantins. Ils ont si peu d’intériorité qu’il ne s’agit plus alors pour les acteurs de rechercher en eux pour construire les personnages, mais bien plus de baser la plupart du spectacle sur un millimétrage précis, des effets musicaux imparables, et une technique époustouflante. Si je recherche souvent l’âme au théâtre, il n’en est ici jamais question : il ne s’agit alors plus que de faire ressortir l’horreur, inhumaine et incompréhensible, des ces êtres qui sont pourtant présentés comme des êtres petits, bas, et sans grande importance à première vue.
Pour compléter son tableau sans faute, Katharina Talbach réunit une distribution impeccable, proposant des comédiens en très grande forme. On retrouve avec plaisir un Thierry Hancisse aux allures de Mackie de l’Opéra de Quat’sous, dont la voix, le port, l’habileté et l’intonation siéent si bien à Brecht. Il y a ces comédiens pour lesquels je manque de superlatifs, comme Serge Bagdassarian qui ne cesse de m’étonner et dont je sens une montée en puissance sur les derniers spectacles, où il semble s’épanouir de plus en plus dans de nouveaux types de rôles. Et comment ne pas trembler en le voyant chanter Ein Freund, ein guter Freund, lui qui nous proposait il y a quelques mois sa propre version d’Avoir un bon copain. Je pense aussi à Michel Vuillermoz, pour cette grande scène où il apparaît dans cet habit de comédien qui ne va pas sans me rappeler cet homme au long nez qui est un jour tombé de la Lune. Mais je devrais citer également Éric Génovèse aux allures repoussantes de Donald Trump, Bakary Sangaré qui ouvre et conclut le spectacle de manière remarquable, Bruno Raffaelli dont la puissance s’abaisse face à la cruauté. Seule Florence Viala semble encore se chercher dans cette distribution. Il faut dire qu’il est délicat de se faire une place de gentil parmi ces pourritures.
Il y a un duo que j’attendais tout particulièrement dans ce spectacle. Un duo composé de deux comédiens dont je ne parviens pas à percevoir les limites. Rien ne semble les arrêter, et l’un marche dans les traces de l’autre. Ceci dit, comme je suis persuadée qu’ils peuvent tout jouer, leurs traces sont aussi difficiles à cerner que leurs limites. Vous l’aurez compris, je parle ici de Jérémy Lopez et Laurent Stocker. Je ne m’étalerai pas ici avec des superlatifs qui ne suffiraient pas à décrire l’énergie, l’enivrement, et l’espoir qu’ils transmettent. Car malgré l’horreur qui se dégage de ce spectacle, les personnages sont résistibles, et c’est là tout l’intérêt de la pièce. Du plus jeune, je pense que le rire glacial, glaçant, et inquiétant résonnera longtemps en moi. Du plus ancien, c’est l’hystérie, la nervosité, et la peur, qui laisseront une trace indélébile dans mon esprit, et continuent de me donner la force de me battre. De résister. Ironiquement. Grâce à cet immense Arturo Ui.
Voilà une véritable claque théâtrale. Après La Règle du Jeu, je ne peux que m’incliner profondément devant la Comédie-Française qui me permet de découvrir des univers théâtraux extravagants, exceptionnels, et jusqu’alors inconnus.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 11:06 AM
|
par Hadrien Volle dans Sceneweb
Robert Cantarella / Notre Faust, saison 2 – Nanterre-Amandiers
Après une saison 1 présentée au Théâtre Ouvert en 2015, Robert Cantarella poursuit sa série théâtrale sur le thème de Faust au Théâtre de Nanterre-Amandiers. Le mois de mars a vu se succéder un épisode par semaine sur ses planches de la salle transformable et s’achève avec l’intégrale jouée jusqu’au 1er avril. L’idée attrayante d’utiliser les codes de la série télévisée au théâtre est malheureusement trop imparfaitement traitée pour créer un véritable engouement.
Un prospectus distribué à l’entrée de la salle nous apprend que dans la saison 1, la femme du héros était morte et que ce dernier avait couché avec sa sœur grâce à la complicité de Mephisto. Dans la foulée, il lui avait fait un enfant. Au départ, la saison 2 n’en est pas moins prometteuse : elle commence très fort : Henri Faust (Nicolas Maury) est debout au pied d’un lit d’hôpital, une flaque de sang à ses pieds. Il se réveille émasculé après trois ans de coma. A peine debout, il est pris dans l’aventure familiale « Felicity », du nom de l’entreprise dirigée par une belle-mère aux faux airs de Cruella. Son but ? Trouver un moyen de vendre le bonheur aux gens, remplaçant ainsi Dieu, cela pour enrichir sa famille et donc elle, indirectement. Dans cette saison, Mephisto est transparent, presque dépressif, en tous les cas bien moins puissant que Faust qui le contrôle désormais.
Cette histoire et les rebondissements, nombreux, qui l’accompagnent ne sont pas suffisamment bien traités pour provoquer l’effet d’une série sur le spectateur. Il y a souvent des passages qui donnent l’impression d’un théâtre à la durée étendue, sans rythme. Ce qui serait impensable venant d’une série télévisée actuelle sous peine de se priver d’audience. Face à une telle lenteur, parfois, on se dit que le but n’est donc pas de singer l’objet de la série, mais son système.
Alors justement, que reste-t-il de ce système qui, selon les arguments de Cantarella, a inspiré la construction du spectacle ? Quelques codes montrés puis immédiatement brisés : de multiples auteurs sont convoqués pour converger autour d’une histoire commune mais leur plume se fait peu narrative ; on entend la musique pop fredonnée pendant les scènes tragiques, mais celle-ci agace les personnages. L’aspect factice d’un bonheur projeté sur l’écran est sans cesse souligné, à commencer par la scénographie qui a tout des studios télévisés et donc son esthétique de chantier. Cette simulation ironique du bonheur des personnages apparaît dans les scènes mêmes, lorsqu’ils posent pour une photo de mariage (épisode 1) ou bien qu’ils sont à la plage (épisode 2) : deux rares réussites de l’intégrale. On relève au passage que dans le domaine du bonheur à créer, la création du Teater No 99, « Ma femme m’a fait une scène et a effacé toutes nos photos de vacances » allait bien plus loin. En bref, du système des séries, Cantarella complique tout et semble sans cesse vouloir s’excuser de s’inspirer d’un art que certains considèrent encore comme vulgaire.
Robert Cantarella / Notre Faust, saison 2 – Nanterre-Amandiers
A vouloir trop en prendre distance, certaines situations sont absurdes et perdent de leur intérêt car le metteur en scène veut les rendre à tout prix « théâtrale » (dans le sens vide que peut renfermer ce terme). On voit des personnages qui sont tous fous, mais du coup qui étouffent la folie les uns des autres. Aucun ne se démarque comme le feraient les héros d’un « House of Cards » ou « How to get away with murder ». On est plutôt dans un cabaret moderne – à l’image de celui de Jeanne Candel avec « Le Goût du faux » mais qui ici n’est pas assumé. Chaque personnage est livré à lui-même et compte sur sa seule individualité. Les répliques sont souvent inattendues, aucune n’en appelle une autre, parfois on se demande : où est le dialogue ? La simplicité est bien trop intellectualisée, rien ne fait sens dans la globalité, rien ne fait « série ». L’histoire de Faust est coupée de son origine et donc de sa lisibilité essentielle. Le personnage voulu par Goethe ne ressort pas enrichi de cette expérience, pas même modernisé d’une quelconque manière.
On remarque néanmoins quelques fulgurances, notamment à partir de l’épisode 3 où les acteurs semblent prendre toute leur dimension, livrés à leur seul talent – immense pour la plupart d’entre eux. La distribution très jeune est marquée par Nicolas Maury qui semble avoir un potentiel sans limites, on remarque aussi Aurélien Feng qui compose un duo trash et délirant avec Maud Wyler a qui on laisse ici tout l’espace pour libérer sa folie poétique et dangereuse. Mais ces quelques coups de génie nous laissent sur notre faim, la tension redescend et pendant de longs moments on est en suspens à cause d’inévitables longueurs qui sans cesse reviennent. Même la fin est gâchée par ce cercle infernal : Henri Faust fait un monologue splendide, où il capte toute notre attention et achève de s’épanouir. Cantarella pourrit son « season finale » que tout amateur de série, depuis « Les Sopranos » sait si important en donnant la fin à deux nouveaux personnages venus de nulle part qui viennent débattre philosophie et mathématique pascalienne. Un événement totalement superflu.
Alors que retenir de cette soirée « série » au théâtre ? Une bonne idée de départ qui n’est pas assumée. Robert Cantarella semble avoir voulu sans cesse montrer qu’il prenait distance – pour ne pas dire de la hauteur – par rapport aux séries télévisées. Cela donne donc une sorte de variante des « Feux de l’Amour » assaisonnée de tabous. D’autres metteurs en scène, avec des textes existants, ont pourtant su bien intégrer la construction des séries : Thomas Jolly avec « Henry VI » ou encore Julien Gosselin avec « 2666 » en sont les exemples les plus réussis.
Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr
« Notre Faust, saison 2 »
Mise en Scène : Robert Cantarella
Ecriture : Stéphane Bouquet, Robert Cantarella, Nicolas Doutey, Liliane Giraudon, Noëlle Renaude, Anais Vaugelade
Avec
Faust : Nicolas Maury
Méphisto : Rodolphe Congé
Rachel : Cécile Fisera
Wurtz : Gaétan Vourc’h
Anne : Charlotte Clamens
Emilien : Emilien Tessier
Inès, la mère : Florence Giorgetti
Claude, le compagnon de la mère : Roger Itier
Euphoryon : Aurélien Feng
Hélène de Troie : Maud Wyler
L’infirmière Audrey, Le chien : Margot Van Hove
Gaétan : Orphée de Corbière
Beyonce : Rebecca Meyer
Scénographie : Élodie Dauguet
Lumières : Philippe Gladieux
Musique : Alexandre Meyer
Chant : Rébecca Meyer
Costumes : Constance de Corbière
Nanterre Amandiers
Épisode 1 : du 2 au 5 mars
Épisode 2 : du 9 au 12 mars
Épisode 3 : du 16 au 19 mars
Épisode 4 : du 23 au 26 mars
Jeu., ven. à 20h
Sam. à 18h
Dim. à 15h30
Durée de chaque épisode
1h
Dates et horaires des intégrales
du 29 mars au 1er avril à 19h30
Durée de l’intégrale
4h10, pauses comprises

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 9:27 AM
|
Un poème plein de frénésie et de fureur
Par Jean‑François Picaut pour le blog Les Trois Coups
Pour sa nouvelle mise en scène au Théâtre national de Bretagne, où elle est artiste associée, Christine Letailleur a opté pour le jeune Brecht. Dans une atmosphère souvent crépusculaire, c’est un long poème barbare qu’elle nous offre.
Baal est la première pièce de Brecht, écrite en 1918, remaniée dès 1919. C’est la version élue par Christine Letailleur, et à maintes reprises réécrite jusqu’au milieu des années 1950. La metteuse en scène a choisi la traduction d’Éloi Recoing, spécialiste de théâtre et traducteur de Brecht, Kleist, Wedekind, de préférence à celle, plus ancienne, d’Eugène Guillevic.
La langue de Brecht, revue par Recoing, est âpre, rugueuse, sensuelle et violente. Elle souligne bien ce que doit à Rimbaud (et peut-être à la vie de Brecht lui-même) ce texte d’un jeune poète sorti meurtri de la guerre et qui exècre la bourgeoisie et ses petitesses.
Cette révolte tient de l’anarchie la plus radicale et d’un culte païen de la nature cosmique et sexuelle. Ainsi, le passage des saisons est‑il soigneusement marqué, l’attention portée aux vents, aux ciels est permanente, et la référence au grand mythe de la forêt, espace de la liberté originelle, est récurrente. Pour autant, la question sociale, nœud de l’œuvre ultérieure de Brecht, est loin d’être absente.
Une mise en scène somptueuse
Baal est un long poème tragique (deux heures trente, tout de même, et quelques longueurs, il faut l’avouer) dont la noirceur ne se dément pas d’un bout à l’autre de la pièce. Christine Letailleur, fidèle à ses choix constants, a pris le parti de le présenter le plus souvent dans la pénombre. Elle joue avec une adresse diabolique des lumières et des ombres, de la vidéo, d’un décor stylisé dans lequel les corps nus ou habillés se meuvent comme dans une chorégraphie. L’ensemble est somptueux et relève du grand art.
On commence, ou presque, par de la satire féroce. On est quasiment chez Guignol dans ce salon bourgeois où les protagonistes ont une gestuelle artificielle, stéréotypée et où se joue une scène renouvelée de celle du sonnet dans les Femmes savantes. Pour louer un poème que vient de lire Baal, on le compare à Rilke, à Wedekind, à Verlaine et, curieusement, au symboliste Verhaeren ! L’idole ne va pas tarder à tomber de son piédestal quand Baal renvoie à son néant le poème d’une des invitées. Baal éclate alors : « Vous êtes des porcs et ça me plaît. Croyez-moi, c’est encore la meilleure partie de vous-même ».
Cette révolte à la fois adolescente et existentielle de Baal, c’est Stanislas Nordey qui la porte avec panache tout au long de la pièce. Belle performance : il semble ne jamais quitter le plateau. Baal, ce « grand seigneur méchant homme », comme dit Sganarelle de Don Juan, est un séducteur sans foi ni loi qui n’est jamais aussi dangereux que quand il fait le doux. Suborneur de l’innocence juvénile (Joanna), mauvais fils, mauvais père (Sophie) et mauvais ami (il finit par tuer son ami et amant Eckart parce qu’il vient de faire l’amour avec une serveuse prostituée qu’il n’entend pas partager !), voleur, Baal devrait inspirer l’horreur. Et malgré tout il séduit : « Tu es laid mais je t’aime », lui dit un personnage.
Un tel antihéros, omniprésent de surcroît, écrase évidemment une distribution. La modestie de Stanislas Nordey et la subtile direction de Christine Letailleur font pourtant que les autres interprètes sont loin d’être réduits à de simples utilités. Chacun(e), touche par touche, compose le tableau final et contribue à sa réussite.
On peut récuser le nihilisme iconoclaste et irrévérencieux de la pièce. On peut sourire de la figure au romantisme un peu morbide de l’écrivain maudit. On ne peut être insensible au souffle poétique de la langue de Brecht dans ce Baal (1919). On sera séduit par la mise en scène puissante et sobre, à sa façon, de Christine Letailleur, et par la performance de Stanislas Nordey. ¶
Jean‑François Picaut
Pour découvrir tous nos articles concernant Stanislas Nordey, c’est ici.
Baal (1919), de Bertolt Brecht
Traduction : Éloi Recoing
Mise en scène : Christine Letailleur
Avec : Youssouf Abi‑Ayad, Clément Barthelet, Fanny Blondeau, Philippe Cherdel, Vincent Dissez, Valentine Gérard, Manuel Garcie‑Kilian, Emma Liégeois, Stanislas Nordey, Karine Piveteau, Richard Sammut
Assistante à la mise en scène : Stéphanie Cosserat
Scénographie : Emmanuel Clolus et Christine Letailleur
Lumière : Stéphane Colin
Son et musiques originales : Manu Léonard
Vidéo : Stéphane Pougnand
Assistanat à la dramaturgie : Ophélia Pishkar
Production déléguée : Théâtre national de Bretagne à Rennes
Coproduction : Fabrik Théâtre, Cie Christine Letailleur, Théâtre national de Strasbourg, la Colline, Théâtre de la Ville (Paris)
Photo : © Brigitte Enguérand
Théâtre national de Bretagne • salle Vilar • 1, rue Saint‑Hélier • 35000 Rennes
Réservations : 02 99 31 12 31
www.t-n-b.fr
Au TNB, Rennes du mercredi 21 au vendredi 31 mars
Au Théâtre national de la Colline du 20 avril au 20 mai 2017 http://www.colline.fr/fr/spectacle/baal

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2017 5:15 AM
|
Publié par Culturebox
Découvrez la nouvelle création de Bartabas mêlant théâtre, danse, musique et art équestre
Le fondateur du théâtre équestre Zingaro est de retour avec “On achève bien les anges” et fait écho à l’actualité dans un spectacle sombre où le spectateur passe des larmes aux rires.
Malgré quelques apparitions en solitaire, comme dans son spectacle Golgotha, Bartabas s’était éloigné de la scène pour se consacrer à l’Académie Équestre Nationale du Domaine de Versailles fondée en 2003. En 2016, il revient aux côtés de son théâtre équestre Zingaro, avec le spectacle “On achève bien les anges”. Une nouvelle création actuelle et sombre décrit comme une “allusion aux massacres quotidiens des animaux ? Ou plus tragique, plus politique, à celui d'autres anges achevés récemment : ceux de Charlie Hebdo…”, explique Télérama.
Date ; 30 septembre 2016 Durée1h 19min
ProductionLa Compagnie des Indes
Metteur en scène Bartabas
Assistante mise en scène Anne Perron
Perruques, maquillages Cécile Kretschmar
Costumes Laurence Bruley
Musiques Tom Waits, Jean-Sébastian Bach, Jerry Bock, Thierry Escaich, Marcel Dupré, Jean-Louis Florentz, Dave Franklin, Jean Guillou, Alain Jehan, Ewan MacColl, Olivier Messiaen, Serge Prokofiev, Mary Schindler, Jean Schwarz, Kurt Weill…
Cavaliers Bartabas, Nathalie Dongmo, Michael Gilbert, Noureddine Khalid, Mathias Lyon, Gaëlle Pollantru, Etienne Regnier, Alice Seghier, Arthur Sidoroff, Messaoud Zeggane
Musiciens François Marillier (direction musicale) Janyves Coïc, Cyrille Lacombe Yuka Okazaki, William Panza Paulus
Boucheur confiseur Riton Carballido
Chevaux Angelo, Antonete, Arruza, Barock, Belmonte, Bombita, Cagancho, Calacas, Le Caravage, Chamaco, Chicuelo, Conchita-Citron, Conquête, Dominguin, El Cordobes, El Gallo, El Soro, El Viti, Famine, Guerre, Joselito, Le Gréco, Majestic, Manolete, Manzanerès, Misère, Nimeño, Paquiri, Posada, Soutine, Tarzan, Tintoret, Zurbaran, l’âne et la mule

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2017 7:29 PM
|
Par Clarisse Fabre dans Le Monde
Le metteur en scène congolais Dieudonné Niangouna dénonce l’absence du théâtre africain dans la programmation d’Olivier Py.
Voilà le monde du théâtre plongé dans l’embarras, depuis le coup de colère de l’auteur et metteur en scène Dieudonné Niangouna. L’artiste congolais a ouvert une polémique sur la programmation du Festival d’Avignon, qui prévoit un focus sur la scène de l’Afrique subsaharienne, entre autres axes forts – la 71e édition aura lieu du 6 au 26 juillet. Le directeur du « in » d’Avignon, Olivier Py, dévoilait ainsi, le 22 mars, les artistes sélectionnés. Citons, entre autres, la chorégraphe Dorothée Munyaneza, originaire du Rwanda, qui présentera Unwanted, une création – avec des prises de parole – sur les femmes violées pendant le génocide rwandais, et les enfants nés de ces viols. Dans le champ musical, les Basongye de Kinshasa, Manu Dibango, Angélique Kidjo, Rokia Traoré monteront sur scène. Mais les festivaliers ne verront nulle pièce de théâtre issue du continent africain ou de sa diaspora.
Cette absence du théâtre est « bien pire qu’une injure », a dénoncé Dieudonné Niangouna dès le 23 mars, sur sa page Facebook. Cette charge venant d’un artiste très identifié en France, programmé dans les grands théâtres (dernièrement à La Colline, à Paris), n’en a été que plus retentissante. En voici un extrait : « Inviter un continent sans sa parole est inviter un mort. C’est une façon comme une autre de déclarer que l’Afrique ne parle pas, n’accouche pas d’une pensée théâtrale dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir », écrit-il.
Reflet d’un imaginaire colonial
Le texte a été publié intégralement sur le site Sceneweb.fr. Sans prononcer le mot, le metteur en scène suggère que ce « focus » est le reflet d’un imaginaire colonial, cantonnant les artistes africains à la danse et à la musique. Agé de 40 ans, Dieudonné Niangouna dirige le Festival Mantsina, à Brazzaville, et fait découvrir chaque année, au mois de décembre, des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens. Il était par ailleurs, lors de l’édition 2013 d’Avignon, « artiste associé » du « in » avec Stanislas Nordey, à l’époque où Hortense Archambault et Vincent Baudriller dirigeaient le festival.
Olivier Py n’a pas souhaité réagir, pour ne pas ajouter de l’huile sur le feu, dixit son entourage. Rokia Traoré, elle, a choisi un ton conciliant pour marquer son désaccord. Sur sa page Facebook, la chanteuse et compositrice malienne souligne que les artistes africains représentent des « petites parcelles d’un ensemble » où chacun a sa place. Par ailleurs, dit-elle, l’Afrique a ses propres codes théâtraux. Qui ne sont pas forcément les mêmes qu’en Europe. « En Afrique, l’art dramatique peut être dans la parole qui se raconte, s’interprète ou se chante, il peut être dans les mouvements et les formes », écrit-elle.
PERSONNE N’ACCABLE OLIVIER PY : SA PROGRAMMATION RELÈVERAIT DAVANTAGE D’UNE MALADRESSE
En off, beaucoup de metteurs en scène comprennent le coup de gueule de « Dieudo », mais personne n’accable Olivier Py : sa programmation relèverait davantage d’une maladresse. Et chacun regrette cette absence du texte à l’heure où une brillante génération d’auteurs africains, primés, reconnus par la critique, arrive sur la scène théâtrale (Leonora Miano, Hakim Bah, etc.).
C’est ce qu’explique, en choisissant ses mots, la metteuse en scène franco-ivoirienne-malienne, Eva Doumbia, 47 ans, l’une des initiatrices de l’appel à « décoloniser les arts » dans le spectacle vivant. « Dieudonné est en colère, je le comprends, mais le défaut de son texte est qu’il ne décortique pas le système historico-politique qui a conduit à cette situation. Le problème de cette programmation africaine, c’est que les spectacles ont été choisis sur des sentiers balisés de la francophonie, héritage du colonialisme. Cela dénote une méconnaissance du terrain. Et il n’y a donc pas la possibilité de pluralité dont parle Rokia Traoré, qui permettrait de faire aussi entendre du théâtre textuel d’Afrique. »
Clarisse Fabre
Reporter culture et cinéma

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 6:57 PM
|
La Truite
CRÉATION
21 > 31 MARS
TEXTE BAPTISTE AMANN
MISE EN SCENE RÉMY BARCHÉ
Une histoire de famille où tout paraît extraordinairement banal, et merveilleux à la fois.
info : http://bit.ly/2jkacSe
résa : http://bit.ly/2j92ACA
-------------------------------------------------------------------
Toute la programmation : lacomediedereims.fr
-------------------------------------------------------------------
Vidéo réalisée par La Production rémoise / laproductionremoise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 6:02 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération / Next
Briser le «quatrième mur», cette frontière fictive entre comédiens et spectateurs, est une pratique courante et délicate. Plusieurs acteurs s’expriment sur ce jeu d’équilibristes.
C’était au début de l’année, lors de la reprise de Hamlet, mis en scène par Thomas Ostermeier aux Gémeaux, à Sceaux. Le prince du Danemark s’approche d’un couple au premier rang, dont l’un traduisait à l’autre les dialogues en langue des signes. «C’est drôle», dit Hamlet-Lars Eidinger, comédien star de la Schaubühne, qui entame une conversation avec eux, apprenant au passage quelques répliques dans ce langage. L’attention des spectateurs se focalise alors sur la sourde muette, son accompagnatrice et Lars Eidinger à l’extrême bord de la scène. L’acteur est-il sorti de son personnage ? Ou est-il Hamlet, se saisissant de l’imprévu ? Ou est-il plus vraisemblablement dans une zone incertaine où la frontière entre lui et son rôle est ébranlée ? Le jeu avec les spectateurs et les adresses à leur égard se manifestent-elles de la même manière si Lars Eidinger incarne Hamlet ou Richard III, qu’il a interprété notamment à Avignon en 2015 ? L’acteur, champion de la digression, ne casse jamais l’illusion théâtrale. Mais a-t-il tendance à être plus autoritaire avec le public lorsqu’il incarne un tyran psychopathe ? Rappelons qu’il a été jusqu’à poursuivre dans le hall des spectateurs qui s’enfuyaient.
C’était il y a deux ans au Théâtre national de Bretagne à Rennes, lors d’une représentation de Don Juan. Nicolas Bouchaud, grand seigneur méchant homme, offrait des fleurs à une spectatrice, pour lui reprendre une minute après et les donner à une autre, fidèle à son personnage. Mais voici que la première jeune femme, ravie d’être l’élue, s’était jetée à son cou pour l’embrasser. Et qu’elle avait affiché, larmes aux yeux, sa déconvenue, lors de la confiscation du bouquet. L’aurait-il voulu que l’acteur n’aurait pas pu s’excuser de sa goujaterie, mais Nicolas Bouchaud dit avoir été troublé. La déconfiture de la spectatrice avait teinté la scène suivante d’une meurtrissure qui serait restée, sans elle, pure fiction. La jeune femme avait finalement joué une partition et influé de manière imprévue sur la représentation.
Justesse du jeu
L’adresse au public est évidemment aussi vieille que le théâtre. «A Londres, au XVIIe siècle, lors des créations des pièces de Shakespeare, les spectateurs étaient debout, tout près de la scène, autour des acteurs, et leur touchaient les pieds, explique Béatrice Picon-Vallin, professeur d’histoire du théâtre au Conservatoire national et longtemps directrice de recherches sur les arts du spectacle au CNRS. C’est le quatrième mur, c’est-à-dire l’idée qu’il pourrait ne pas y avoir d’interaction entre les acteurs et les spectateurs, qui est récente.» Théorisé au début du XXe siècle par Constantin Stanislavski qui cherchait à bannir l’emphase, la grandiloquence, au profit de la justesse du jeu, ce fameux mur invisible, imaginaire et transparent qui sépare la scène de la jauge, a été discrètement érigé par Diderot dans son Discours sur la poésie dramatique. Mais c’est au début du XXe siècle que le comédien et metteur en scène André Antoine lui offre un nom : le quatrième mur.
Assiste-t-on aujourd’hui à l’alliance, autrefois jugée impossible car antagoniste, du plus grand réalisme et de la suppression de ce mur imaginaire, miroir sans tain ? Le spectacle le plus mémorable de cette saison, en tournée depuis la rentrée 2016 et visible à Rennes début avril, est Doreen, écrit et mis en scène par David Geselson, autour de la Lettre à D. d’André Gorz (lire aussi Libération du 17 novembre 2016). Plus de salle, plus de scène, mais un salon - qui est évidemment une illusion de salon - où les spectateurs sont réellement reçus, accueillis, encouragés à prendre un verre de vin s’ils le souhaitent, et des apéritifs, avant de s’asseoir, pour certains, à des tables et même aux côtés des deux acteurs, Laure Mathis et David Geselson. On est donc chez eux, le pronom renvoyant autant aux rôles, qu’aux acteurs et qu’à l’équipe du théâtre. Laure Mathis, dans le rôle de Dorine Keir, qui s’est suicidée à 82 ans : «Le premier quart d’heure nous fragilise énormément. On est sans carapace, complètement poreux. Il suffit que les spectateurs ne soient pas bons, un peu difficiles, pour complètement nous plomber, comme dans la vie quand l’alchimie entre deux personnes n’a pas lieu. C’est très animal. On sent des présences qui ne nous aident pas. On est si proche d’eux. On les voit.» L’actrice donne un exemple. Un spectateur arrive dans la salle et répond à son bonjour en lui lançant : «Mais vous n’avez pas l’accent anglais !»
Laure Mathis prend la réflexion pour une agression. «Je n’ai eu aucune répartie, j’aurais pu lui répondre : "Je n’ai pas 82 ans non plus, je ne vais pas me tuer dans une heure !" Si bien que je commence hyper mal le début, je me mets en retrait, le public ne m’entend pas, je tremble, j’ai tous les symptômes de celle qui veut quitter le plateau, or, il n’y a pas de plateau. Je finis par m’asseoir à une table, entre deux spectateurs. L’un me sert un verre de vin. On a eu un fou rire. Ils m’ont vraiment détendue. Ça m’a remise sur de bons rails. A la fin de la pièce, je les ai cherchés pour les remercier, je les aurais serrés dans mes bras, mais ils avaient disparu. C’était comme si on avait écrit une scène à trois. Je ne sais pas s’ils ont eu conscience d’avoir sauvé la représentation.» L’actrice ajoute : «Au théâtre, les accidents sont des cadeaux, mais il est parfois difficile de s’en servir quand il y a un quatrième mur.» Dans Doreen, cependant, les acteurs n’improvisent jamais. «Mais plus je joue, plus j’ai l’impression de ne rien faire. De m’abandonner sans présager de ce qui va arriver.»
Nicolas Bouchaud le dit autrement : «Lorsqu’une pièce tourne très longtemps, on cherche les accidents, la zone de vie où tout peut arriver, la souplesse avec le public. On peut faire une très bonne représentation en se laissant traverser par pleins d’autres pensées que la pièce elle-même : le monde entier, la journée qui vient de passer, un visage oublié qui resurgit… On n’est plus crispé sur le personnage ou les situations car on les a complètement intégrés.» Lorsqu’il jouait la Loi du marcheur d’après un entretien avec Serge Daney, il arrivait que des spectateurs continuent de se disputer sur des films ou de s’adresser à lui, alors même que l’acteur reprenait les rennes de son personnage. «L’adresse était modifiée car je faisais en sorte d’intégrer les propos des spectateurs sans pour autant modifier le texte. C’était très amusant.»
Comment répète-t-on lorsque le public fait partie intégrante de l’espace scénique ? Eh bien, on ouvre largement les répétitions. «Sauf que ça n’a rien d’évident, de montrer un spectacle qui n’existe pas encore. On est alors complètement envahi par ce que nous renvoient les spectateurs, qui peuvent nous trouver extrêmement mauvais, se souvient David Geselson, sur l’élaboration de Doreen. En particulier, on a mis beaucoup de temps à trouver comment se manifestait l’amour entre deux personnes qui vivent ensemble depuis cinquante-huit ans. Des spectateurs nous disaient : "Vous ressemblez à des coloc ! Quel intérêt, votre truc ?" Mais l’amour entre deux êtres - ou son absence - renvoie chacun à sa propre vie. Si bien que le spectacle n’a pas été conçu à deux ou à trois, mais avec le conscient et l’inconscient de toute l’équipe.» La réussite périlleuse de Doreen tient beaucoup à ce que l’abolition de la frontière scène-salle n’a jamais été un préalable ou une décision théorique, mais un aboutissement. David Geselson : «On ne s’est pas dit, chouette, super, on va tenter un truc exceptionnel. La scénographie est apparue logiquement. On ne peut pas mettre les spectateurs à l’extérieur de l’espace où on les a invités. Ce sont des spectateurs de l’intérieur.»
Crainte du cabotinage
Certains metteurs en scène donnent aux acteurs l’ordre de ne pas se laisser perturber par les spectateurs. C’est le cas notamment d’Anatoli Vassiliev, pour qui la recherche pendant les répétitions compte au moins autant que le résultat, et qui a pu dire que la présence du public était accessoire. Mais aussi, entre autres, de Romeo Castellucci ou d’Ivo Van Hove, qui a conseillé aux acteurs de la Comédie-Française de ne pas tenir compte des réactions du public, pendant les représentations des Damnés. «Or, il n’y a pas de représentations sans interactions. Une quinte de toux peut désorganiser toute la concentration d’une salle. Un rire particulier qui se détache, glacer la salle et les acteurs qui vont diminuer leurs effets comiques», explique Denis Podalydès. L’acteur aime préserver autant que possible le quatrième mur, par crainte du cabotinage, parce qu’il n’aime pas improviser, et parce que lorsque «vous sortez du rôle, ça fragilise la mémoire de tout le monde». Néanmoins, dit-il, «un visage dans le public qui devient bleu à cause d’un portable allumé me donne des envies de meurtres immédiats !» Refrénées jusqu’à présent. Mais qui ouvrent une nouvelle perspective sur l’utilité de ce quatrième mur.
Anne Diatkine
Doreen écrit et mis en scène par David Geselson. Les 5 et 6 avril au Théâtre national de Bretagne dans le cadre du festival Mythos. Et en tournée sur la saison 2017-2018.
Photo : Dans «Doreen», Laure Mathis et David Geselson installent le public sur scène et s’adressent frontalement à lui. Photo Charlotte Corman

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 12:26 PM
|
Par Agathe Charnet dans son blog du Monde "L'Ecole du spectacle"
Quarante-six représentations, 24 spectacles programmés et une centaine d’artistes étudiants à l’affiche. Le festival A contre sens de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III bat son plein en ce début de printemps 2017. Créé en 1996, ce festival embrasse tous les aspects du spectacle vivant, de la marionnette au théâtre, de la danse contemporaine au masque. « Le festival est organisé de bout en bout par les étudiants, explique Tristan Héraud, 24 ans, qui supervise A contre sens pour la troisième année consécutive. Aux manettes, 25 étudiants bénévoles de l’ATEP 3, l’association théâtrale des étudiants de Paris-III, mobilisés durant toute une année universitaire pour cette fête artistique.
« Nous élaborons la programmation en faisant des auditions, nous assurons la communication, les aspects techniques, l’accueil des compagnies et du public… On est dans de vraies conditions, c’est extrêmement formateur, détaille Tristan Héraud. Au total, près de 2 000 spectateurs sont attendus sur le campus de la Sorbonne nouvelle, du 22 mars au 5 avril. Un travail de titan qui fait honneur à l’Institut d’études théâtrales de Paris-III dont sont issus la plupart des jeunes organisateurs.
Un millier d’étudiants en études théâtrales
Il faut dire que le théâtre fait partie de « l’identité de la Sorbonne nouvelle », raconte le directeur de l’Institut d’études théâtrales, Pierre Letessier. L’Institut d’études théâtrales était parmi les membres fondateurs de l’université Paris-III, sur le campus de Censier, en 1968. » Dans le 5e arrondissement de Paris, un millier d’étudiants sont intégrés à l’Institut, de la licence au master. Ils disposent de plusieurs salles de pratique artistique équipées de projecteurs et de matériel de son. La théâtrothèque Gaston-Basty leur offre un vaste choix de ressources et de documentation sur les arts du spectacle.
L’objectif des formations dispensées au sein de l’institut d’études théâtrales ? « Articuler une approche historique et théorique tout en gardant un lien constant avec la pratique et la création », décrit Pierre Letessier. La licence d’études théâtrales permet ainsi de s’initier à l’histoire du théâtre, à la dramaturgie ou au droit du spectacle vivant. Des ateliers pratiques sont aussi proposés à ces jeunes artistes. Car beaucoup d’étudiants suivent en parallèle des cours de théâtre dans des conservatoires d’arrondissement ou des écoles privées.
Une réalité pleinement prise en compte par Pierre Letessier et son équipe : « nos élèves ont des profils très variés et nous aménageons leur scolarité en fonction. Certains sont dispensés de contrôle continu ou de pratique artistique à l’université. Pendant la période des concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art dramatique, les bancs des amphis se vident ! » Le cursus d’études théâtrales « n’est pas un conservatoire », précise Pierre Letessier. « Les étudiants reçoivent à l’université une formation pointue qui peut accompagner et nourrir leur pratique de comédien ou de metteur en scène et vice-versa. Ils sont aussi sensibilisés aux questions de l’intermittence et aux réalités du monde professionnel. »
Formations spécialisées
Pour œuvrer à l’insertion professionnelle des étudiants, des formations spécialisées et sélectives sont proposées par l’Institut d’études théâtrales. Trois licences professionnelles permettent ainsi de se former à la scénographie, au costume et à l’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale.
Au niveau master, la Sorbonne nouvelle propose un master recherche en études théâtrales mais aussi un master en art thérapie et un master 2 des métiers de la production théâtrale. Les étudiants sont formés en apprentissage à l’administration, à la production et à la diffusion. Laura Cohen suit actuellement cette formation, en alternance avec la salle de concert parisienne Le Point éphémère. Cette jeune femme de 24 ans a réalisé tout son cursus à Paris-III en études théâtrales. « Je fais du théâtre en parallèle et j’ai eu besoin de m’assurer un diplôme universitaire et d’approfondir mes connaissances, explique Laura Cohen. Le master de production théâtrale m’aide à gérer ma compagnie et me permet d’apprendre un métier passionnant. »
Pour ces futurs professionnels du spectacle vivant, le festival A contre sens permet de faire ses premières armes. Et de refléter le dynamisme et les grands enjeux de la création étudiante. « Cette année, beaucoup des spectacles abordent la question du vivre ensemble, la citoyenneté et de l’engagement », remarque Tristan Héraud. Des thématiques qui ne sont sûrement pas étrangères à l’approche de l’élection présidentielle.
–
Festival A contre sens, du 22 mars au 5 avril 2017. Campus de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III, 13, rue de Santeuil, Paris 75005.
Programmation ici, http://www.atep3.fr/WordPress/festival/festival-2017/programme2017 entrée libre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 5:09 AM
|
Par Marie Richeux sur le site de son émission Les Nouvelles vagues sur France Culture
Aujourd'hui, le couple est autant celui du théâtre et de la littérature, que celui reliant deux êtres par un amour qui aura duré 58 ans avant leur décision de mourir ensemble. Nous parlons de "Doreen", une pièce de David Geselson, qui raconte les dernières heures d'un couple singulier.
Ecouter l'émission (59mn) : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/le-couple-45-derniere-lettre-lautre
Avec David Geselson, comédien et metteur en scène. Son spectacle Doreen d’après Lettre à D, histoire d’un amour d’André Gorz (éd. Galilée, 2006), qu'il interprète lui-même avec Laure Mathis, est actuellement en tournée en France : jusqu'à ce soir au Théâtre de Lorient (56) ; du 28 février au 04 mars au Lieu Unique à Nantes (44) ; du 08 au 24 mars au Théâtre de la Bastille à Paris. Son texte est écrit à partir du chant d'amour fou adressé par André Gorz, pseudonyme de Gérard Horst, à Doreen Keir.
Programmation musicale :
Selma Mutal, Intimité
Renaud, Manu
Intervenants
David Geselson : Acteur, metteur en scène et écrivain
Bibliographie
Lettre à D. Histoire d’un amour
Lettre à D. Histoire d’un amour Galilée, 2006 André Gorz
Photo : "Doreen" de David Geselson• Crédits : © Charlotte Corman

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 8:01 PM
|
Par Laure Adler sur le site de son émission de France Inter
Effacer, oublier les frontières quelles qu’elles soient, ne se sentir ni d’ici, ni d’ailleurs.
Emmanuel Demarcy-Mota et Arthur Nauzyciel appartiennent avec James Thiérrée, à la même génération théâtrale. La scène les a fait connaître, chacun de son côté, chacun à sa manière. Leurs spectacles ne se ressemblent en rien. Ils ne sont jamais précisément là où on les attend, toujours un peu à côté, en train de bouger. Dans leur travail, leurs recherches comme dans leur vie et dans leur tête, ils explorent même si la réalité vient à eux en "dirigeant" des Théâtres.
Emmanuel Demarcy-Mota ne pense pas arrêter le théâtre, c’est ancré en lui, cela dit, il a aussi besoin de penser qu’il peut encore s’enrichir et ne pas être seulement dans le "faire", continuer à travailler à la démocratisation de la culture, au développement d’un théâtre politique. Il a choisi donc de mettre en scène "L'Etat de siège" d’Albert Camus pour faire entendre une parole de résistance, celle face à la peur.
Quant à Arthur Nauzyciel, il est arrivé depuis janvier à Rennes, et prend ses marques dans son nouveau costume de directeur du Théâtre national de Bretagne. Plus que jamais, toujours acteur, toujours metteur en scène, il souhaite "ouvrir le théâtre à d’autres publics" avec une programmation qui fera la part belle à d’autres disciplines comme la danse, la musique ou les arts plastiques.
Choix musical d’ Emmanuel Demarcy-Mota : Joan Baez avec "Diamonds and rust"
Choix musical d'Arthur Nauzyciel : Albin de la Simone avec "Le grand amour"
Archive 14 juillet 1976 : Antoine Vitez à propos de la direction d’acteur
Archive Ina du 13 mai 2002 (au micro de Daniel Mermet) : Dario Fo à propos de la prise de conscience politique du peuple italien après Berlusconi et de la tradition du bouffon au théâtre
Archive Ina du 19 septembre 1955 (au micro de Jean Mogin) : Albert Camus à propos de la notion de révolte
Archive Ina du 9 septembre 2013 : Patrice Chéreau explique sa prise de position sur le théâtre français et la nomination des directeurs de théâtre
Générique : Veridis Quo des Daft Punk
Photo : Emmanuel Demarcy-Mota, acteur, dramaturge et metteur en scène et Arthur Nauzyciel, comédien et metteur en scène © AFP / BERTRAND GUAY / BORIS HORVAT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 7:32 PM
|
Par Jean-Louis Sagot-Duvauroux dans son blog :
Depuis que, le 22 mars 2017, Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, a dévoilé la programmation du « focus Afrique » dont il a doté la 71e édition de la grande manifestation des arts de la scène, un vif débat s’est engagé. Le choix retenu exclut en effet les spectacles mettant en scène des textes de théâtre au point qu’une des principales personnalités littéraires et théâtrales du continent, Dieudonné Niangouna, a pu écrire : « Inviter un continent sans sa parole est inviter un mort ». Très engagé depuis une vingtaine d’années dans la vie théâtrale du Mali, j’ai moi aussi déploré ce choix. Des arguments et des coups de gueules se sont échangés, qui m’ont amené à infléchir et approfondir mon point de vue. Voici un point d’étape sur les principales thèses énoncées à l’occasion de cette polémique que je crois utile.
1 – Les spectacles chorégraphiques et musicaux qui font l’essentiel de ce focus parlent aussi
La danse africaine parle. C’est indubitable. Le 18 mars 2017, le festival des Rencontres Essonne Danse organisait à Morsang-sur-Orge, où je dirige le petit théâtre de l’Arlequin au nom de la compagnie malienne BlonBa, un « colloque dansé » intitulé « Danse contemporaine, questions d’Afrique ». Cette passionnante rencontre réunissait des grands noms de l’art chorégraphique africain – le Nigérian Qudus Onikeku, le Burkinabè Salia Sanou, le Sud-Africain Vincent Mantsoé – et d’impressionnants danseurs hip hop : le Malien Salah Keïta, de la compagnie bamakoise Dogmen G, le franco-congolais Michel Onomo. « Colloque dansé ». Colloque où les choses seraient dites à la fois dans les mots et par la danse. Pari gagné à la satisfaction émerveillée des participants. Quelques semaines plus tôt, à Bamako, était organisé dans le nouveau lieu de la compagnie BlonBa, qu’avec mon ami Alioune Ifra Ndiaye nous avons fondée dans la capitale malienne il y a bientôt 20 ans, un festival original et novateur, le Fari foni waati (temps des corps en mouvement). Y participait notamment le chorégraphe burkinabè Serge-Aimé Coulibaly, esprit particulièrement aiguisé dont les créations « parlent » assurément, et fort, et de façon tranchante. Salia Sanou, Serge Aimé Coulibaly sont inclus dans le « focus Afrique » d’Avignon et leurs œuvres y parleront.
Dans les civilisations d’Afrique de l’Ouest, la danse fait partie de la culture générale. Elle joue un rôle important de liberté d’expression : dire ce que les corps, habituellement contenus par les règles de la civilité, ne peuvent exprimer dans la vie courante ; le dire par des mises en forme qui affirment la dignité humaine jusque dans l’expression de la violence ou de l’érotisme. Ce qui se construit au sud du Sahara sous le label occidental de danse contemporaine est de moins en moins coupé de cette inspiration et vit aujourd’hui, en Afrique, un tournant qui mérite l’attention. Beaucoup de pièces ont une trame narrative explicite et usent du texte. Quand les conditions d’accès, financières notamment, le permettent, on peut désormais voir un public populaire, jeune, nombreux suivre avec passion ces « récits » et ne plus s’en écarter au motif longtemps invoqué qu’il s’agirait d’une « affaire de Blancs ». Les suivre avec une culture du corps et du geste globalement plus sophistiquée qu’en Europe. Comme dans les formes anciennes de la danse en Afrique, la sublimation des situations par la chorégraphie, leur métamorphose en symboles d’humanité habitent bien des propositions. C’est par exemple le cas du splendide et récent We almost forgot de Qudus Onikeku, dont BlonBa s’honore d’être co-producteur, où la barbarie sauvage des crimes évoqués jamais ne laisse douter de la dignité humaine, représentée par la qualité des images et des mouvements, un peu comme la peinture classique occidentale affirme dans ses mises en forme la grandeur de l’humanité, même lorsqu’elle use d’une iconographie de l’horreur et de la cruauté. Oui, assurément, les spectacles retenus par la direction du Festival ne laisseront pas l’Afrique sans voix.
2 – L’exclusion des arts du texte n’a rien d’anodin
Parmi les arguments de ceux qui défendent la programmation retenue dans ce « focus », « les attaques violentes formulées à l’égard de ces choix de programmations » témoigneraient « d’une conception pour le moins rance de la hiérarchie entre les disciplines basées sur une dichotomie corps-esprit » (Eve Beauvallet, Libération, 27 mars). En clair, la distinction entre pièce de théâtre et pièce de chorégraphie, entre mise en scène d’un texte et chorégraphie des corps serait une vieillerie fleurant la moisissure. L’argument est spécieux. En Afrique comme ailleurs et pour longtemps, il existe des arts du texte dit, des savoir-faire spécifiques pour les dire, une culture partagée pour les entendre. Même si des croisements peuvent survenir, le métier d’un comédien n’est pas celui d’un danseur, l’art d’un kotèden ne fait pas de lui un tamanfola, un auteur de théâtre produit du sens par d’autres voie qu’un chorégraphe, il y a des funè et il y a des jeli. Quand le festival de Jean Vilar propose un « focus Afrique » en excluant les arts du texte, comment ne pas y lire un déni ? Comment s’empêcher d’entendre en sourdine d’étranges résonnances entre ce déni et les clichés qui vouent le corps noir à la danse et au chant. Les sélectionneurs d’Avignon l’ont-ils vu ?
3 – Les arts du texte dit ne sont pas un monopole de l’Occident
Intervenant dans le débat, Jan Goossens, directeur du Festival de Marseille, justifie ses collègues avignonnais en tentant un autre argument contre le point de vue exprimé par Dieudonné Niangouna : « Sa vision de l’art dramatique comme lieu exclusif du texte littéraire (une tradition plutôt française) n’est pas du tout centrale en Afrique où les traditions font plus de place au mouvement, au chant, aux traditions orales bien sûr. Le texte littéraire sur les plateaux n’est venu qu’avec les projets coloniaux ». Contrairement à ce qu’affirme cette curieuse opinion, les arts du texte dit, dont le théâtre est une des formes, sont tout à fait centraux dans l’Afrique que je connais. Que ces textes soient inscrits dans les mémoires ou écrit sur les pages d’un livre est d’une certaine manière secondaire. Les deux coexistent très bien et s’alimentent mutuellement. Le texte écrit est très présent au Mali jusqu’au XVIe siècle (on retrouve aujourd’hui des dizaines de milliers de manuscrits dans les villes anciennes de la boucle du Niger). Il est maintenu vivant par la pratique de la religion musulmane (la religion chrétienne en Ethiopie), mais marginalisé lorsque la pression conjuguée des esclavagismes arabes et européens font voler en éclat les grands ensembles politiques de l’Afrique soudano-sahélienne. L’usage de l’écriture se répand à nouveau avec la mondialisation colonialiste et l’alphabétisation qui, même quand elle est marginale (7% d’enfants scolarisés quand le Mali prend son indépendance), fait germer chez certains de ceux qui la maîtrisent le goût et le talent d’écrire. Jan Goossens assigne les « vrais » Africains au « mouvement » et au « chant ». Les Africains seraient-ils donc, par le fait même d’écrire, des traitres à l’authenticité africaine, Mandela aurait-il dû transmettre son message au tam tam, Sony Labou Tamsi ne serait-il qu’un bounty et faut-il remercier Olivier Py de les rappeler à leur vraie nature ? Bigre !
Quant à suggérer que « le texte littéraire sur les plateaux n’est venu qu’avec les projets coloniaux », c’est également un raccourci spécieux. Un exemple : dans les années 80, des auteurs, metteurs en scène et comédiens bamakois font monter la longue histoire du kotèba (farces burlesques de satire sociale) sur la scène du Palais de la Culture de Bamako. Ce kotèba en salle se distingue clairement du cercle qui se forme dans les villages autour du feu lors des nuits où se joue cet art. Mais le public malien n’a aucun doute sur l’ascendance endogène de cette innovation, sur la vérité de « l’esprit kotèba » qui en est l’âme. Ce renouveau théâtral est jusqu’à présent explicitement associé par l’opinion au mouvement de révolte qui abattra en 1991 la dictature de Moussa Traoré. Projet colonial sous prétexte que cet « esprit » se joue sur une scène et dans une grande ville ? L’opinion saugrenue de Jan Goossens est intenable. Si on la suivait, il faudrait aussi condamner le cinéma africain, l’internet africain, la télévision africaine, la mode africaine quand elle imagine des vestons ou des jupes, condamner aussi pour trahison de l’identité nationale les Français qui joue du jazz, mangent des bananes ou portent des vêtements de coton.
4 – Que les professionnels africains du théâtre se sentent blessés par ce choix est normal
Un des arguments qui alimente la polémique consiste à soupçonner ceux qui critiquent ce choix d’être des aigris, des jaloux, dépités de ne pas avoir été retenus. La totale exclusion du théâtre de texte relativise cette opinion, car du coup les protestations ne sont pas faite ad hominem, mais contre un choix qui concerne tous ceux qui font vivre en Afrique cette forme là des arts de la scène, celle-là même qui a valu à Olivier Py d’être nommé par la puissance publique au poste qu’il occupe aujourd’hui. Et puis il suffit de se mettre un instant à la place d’un homme ou d’une femme de théâtre reconnus, engagés dans des conditions souvent extrêmement précaires, convaincus de l’importance cruciale de la reconstruction culturelle de l’Afrique, du rôle qu’y tient le théâtre et placés devant ce dédain. Mes expériences les plus intenses de théâtre, je ne les ai pas connues dans les théâtres à 30€ la place, aux lumières impeccables, aux finesses à répétition, aux programmations débordantes d’intelligence et à l’importance indécise, séances où d’ailleurs je prends souvent beaucoup de plaisir. Je les ai vécues en plein soleil dans Bangui déchirée par la guerre, dans les quartiers populaires de Bamako, devant des spectacles qui prenaient pour leur public majoritairement composé de moins de 30 ans une importance cruciale. Oui, je suis blessé par le fait que de telles expériences qui ont tant à dire au théâtre français aient été à ce point dédaignées. Blessé pour le théâtre africain. Blessé pour le théâtre français. Et je rends hommage à Dieudonné Niangouna, un auteur et un artiste indiscutable, ultra reconnu par l’Institution et à juste titre, d’avoir eu le courage de dire sa vérité blessée, au risque d’être pris pour un jaloux et un aigri, au risque d’être blacklisté, quand les baisses générales de budgets culturels rendent les exclusions si tentantes.
5 – Réunir les spectacles africains retenus sous la dénomination de « focus Afrique » est une supercherie
En bref, ce qui pèche dans la programmation africaine du festival n’est pas la qualité des spectacles retenus, c’est l’annonce d’un « focus Afrique » dont tous ceux qui connaissent un peu ce qui se passe sur ce continent du côté des arts de la scène verront le déséquilibre criant. Il n’y aurait rien eu à dire si les artistes programmés, que pour la plupart j’apprécie beaucoup, l’avaient été dans le droit commun du festival, témoins des goûts et des choix de sa direction. Ils le méritent et apporteront j’en suis sûr beaucoup de satisfaction et d’intelligence à ceux qui auront les moyens d’aller les voir. Mais les enrôler au nom de l’amour de l’Afrique dans une aventure aussi douteuse, boiteuse, disons, pour rester sobre, que ce n’est pas sain. Ces grands de la scène africaine ne méritent pas d’être instrumentalisés par une situation qui sussurre à l’oreille des affidés du festival : « Nous n’avons rien trouvé d’intéressant dans le genre que vous et moi nommons théâtre ».
6 – L’argent justement
Beaucoup d’Avignonnais, beaucoup de Français ont désormais une ascendance en Afrique, Afrique du Nord et Afrique sub-saharienne. On les verra très peu dans les salles du in. Pour des raisons symboliques : difficile pour la France populaire de se sentir « chez elle » dans des lieux si socialement typés. Des raisons financières aussi, du fait d’une tarification que beaucoup d’amateurs d’art impécunieux ressentent comme une gifle et dont la ligne la plus caricaturale est le « tarif spécifique » de 19 € destiné aux allocataires du RSA (535,17 €/mois). En proportion du revenu, c’est comme si ceux qui gagnent 3000 €/mois devaient payer 85 € la place, mais on a pris soin de ne pas leur appliquer ce ratio et 38 € suffisent pour filtrer grosso-modo ceux qui savent respecter les rites. Le Festival d’Avignon est majoritairement financé par l’argent public. Les Français qui ont un lien familial avec l’Afrique sont bien souvent les enfants des soutiers qui ont construit nos maisons, nos routes, nos grands équipements, théâtres compris, lavé la vaisselle dans les restaurants où l’on sort après le spectacle. Ils habitent plutôt le quartier avignonnais de Saint-Chamand que la vieille ville, Sevran que Neuilly-sur-Seine. Dommage pour eux. Dommage aussi pour les artistes et les compagnies théâtrales africaines qui pouvaient, en direct ou représentés par des collègues, rendre visible l’importance de leur travail et y trouver des moyens supplémentaires dans une situation de vertigineux déséquilibre entre la France et l’Afrique. Dommage pour une France qui menace de s’enfermer dans l’aigreur identitaire et qui a un besoin crucial d’imaginaires partagés, largement partagés, par delà les frontières géographiques, religieuses, civilisationnelles ou de comptes en banque.
En réponse à ce déni, beaucoup des réactions venues d’Africains disent mot pour mot : « Avignon, on s’en fout ». Dommage pour nous tous.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 7:03 PM
|
Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse
Un homme, une femme, un jeune homme : de multiples possibilités d’unions, de partages et d’assujettissements. Après La Conférence, en 2011, Stanislas Nordey revient à l’écriture de Christophe Pellet avec Erich von Stroheim. Un spectacle à la puissance énigmatique, qui questionne l’isolement, la marginalité et le rapport à l’autre.
Comme souvent dans le théâtre de Stanislas Nordey, il y a les mots. Le texte qui nous parvient de manière quasi directe, sans artifice psychologique, dans une mise en relation instantanée des spectateur-rice-s et des comédien-ne-s. Il y a la densité de l’écriture, chargée de sa nature incandescente, de son pouvoir d’inspiration. Pourtant, dans Erich von Stroheim, c’est autre chose qui, immédiatement, marque de son empreinte les enjeux de la représentation. C’est un corps. Le corps nu du jeune acteur Thomas Gonzalez. De bout en bout du spectacle, il impose sa présence physique au sein d’une scénographie alliant dépouillement et monumentalité (signée Emmanuel Clolus). On est loin, dans cette mise en scène d’une grande intelligence, des recettes éculées qui dévêtissent certains interprètes pour provoquer les rires ou mettre à mal les pudeurs. La nudité que convoque ici Stanislas Nordey est ample, exigeante, agissante. Elle permet d’établir un contrepoint organique au mélange de sécheresse et de formalisme qui caractérisent le texte de Christophe Pellet.
Entre stylisation et corporalité
Face à ce corps dont la nudité finit par sembler d’autant plus naturelle qu’elle ne fait jamais l’objet d’un regard différencié de la part des autres personnages, Emmanuelle Béart, elle, porte une robe noire à manches longues. Quant à Laurent Sauvage (qui joue en alternance avec Victor de Oliveira), il apparaît en jean et le torse nu. C’est donc à travers cette palette de présences plus ou moins charnelles, mais aussi de tonalités de jeu allant de l’expressivité à la distanciation, que se déclinent les multiples relations amoureuses reliant Elle (une femme d’affaires ambitieuse et autoritaire), L’Un (un acteur porno quadragénaire qui profite des derniers feux de sa beauté) et L’Autre (un jeune homme anticonformiste qui essaie de s’inventer une vie en dehors des normes de la société). Les questions de la relation à l’autre, de la solitude, des rapports de soumission et de domination, résonnent ici de façon à la fois belle et énigmatique. Stanislas Nordey trouve le point d’équilibre entre stylisation et corporalité. Son Erich von Stroheim regorge d’une puissance insolite. Il éclaire d’une lumière crue les troubles et les revers de l’existence.
Manuel Piolat Soleymat
Crédit Photo: Jean-Louis Fernandez Légende : Thomas Gonzalez et Emmanuelle Béart dans Erich von Stroheim, mis en scène par Stanislas Nordey.
A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
ERICH VON STROHEIM
du 25 avril 2017 au 21 mai 2017
Salle Renaud-Barrault.
2 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, France
Du 25 avril au 21 mai 2017 à 21h, le dimanche à 15h. Relâches les lundis ainsi que le 30 avril et le 2 mai. Spectacle vu au Théâtre National de Strasbourg le 14 février 2017. Durée de la représentation : 1h30. Tél. : 01 44 95 98 21. www.theatredurondpoint.fr.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...