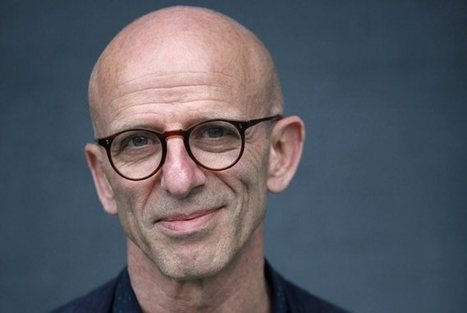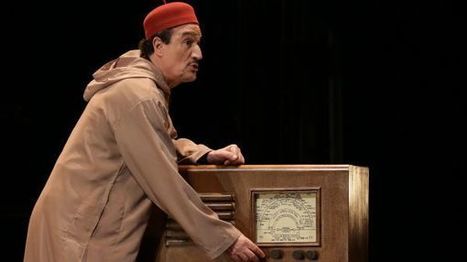Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:45 PM
|
Par Sonia Bos-Jucquin dans Théâtoile
Très peu montée en France, Vera est la dernière pièce du dramaturge et cinéaste tchèque Petr Zelenka. Drôle et tragique, Karin Viard se voit confier la vie d’une femme féroce, qui lui va parfaitement, au point de penser que le rôle a été écrit pour elle, sur mesure. C’est la troisième fois qu’elle collabore avec Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo. L’alchimie est indéniable et fait éclore une comédie sociale grinçante et acide qui doit beaucoup à sa distribution éclatante.
Vera est une directrice d’agence de casting pour acteurs de cinéma et de télévision à Prague. C’est ce qu’on appelle une femme active, toujours en train de courir après le temps, pendue au téléphone et gérant toutes les sphères de sa vie d’une main de fer. Elle est au sommet de sa carrière mais n’a pas totalement assouvi son désir de puissance et de pouvoir. Lorsqu’elle amorce la fusion avec une autre agence basée en Grande-Bretagne, elle signe un pacte avec le diable en personne. Dépourvue de son âme, s’ensuit pour elle ce qui s’apparente à une lente et longue descente aux enfers où elle va tout perdre, victime d’un système néo-libéral qui la dépasse et la dévore. Ce zoom sur son existence, dont chaque pan s’effondre tel un château de cartes, est l’expression d’une société individualiste au cœur d’un capitalisme que Petr Zelenka dépeint avec talent, comme s’il déroulait la pellicule d’un film de vie. L’ouverture de la pièce se fait d’ailleurs sous la forme d’un générique cinématographique, clin d’œil appuyé à l’auteur et au propos sous-jacent.
Vera ouvre un questionnement sur le métier d’acteur et la fabrication de l’image renvoyée aux spectateurs. Le texte du tchèque Petr Zelenka est proche du pamphlet politique mais avec une forte présence de l’humour comme arme ultime, rempart infaillible à toute attaque. La forme plaisante et rythmée s’apparente à celle d’un scénario avec une succession de courts tableaux entrecoupés par des ellipses temporelles. Sur le plateau, si Karin Viard, époustouflante comme à son habitude, s’attache à montrer la déchéance de Vera, ses camarades de jeu endossent à eux cinq près d’une trentaine de personnages. Karin Viard est impitoyable et ne se ménage pas dans l’incarnation de cette femme que l’on peut qualifier sans trop exagérer de « sans foi ni loi ». Ses valeurs sont celles de la jungle où il faut se battre pour s’en sortir, tout en mettant de côté ses états d’âme. Mais à vouloir agir sur tous les fronts, le risque est bien entendu de perdre pied. C’est ce qui arrive au personnage mais pas à l’actrice qui maîtrise parfaitement la vaste palette déployée. Elle parvient à redonner une forme d’humanité qui, malgré les aspérités, enclenche une forme d’empathie chez le spectateur. On la juge mais au final, on la plaint. Karin Viard est irrésistible et monstrueusement humaine.
La scénographie de Marc Lainé inclut une grande présence de la vidéo et à travers elle toute la réflexion sociale sur l’image. On y voit des clichés de Karin Viard enfant entrecoupés de phrases assassines telles que « ton physique n’est plus à la mode ». Autant avoir le moral au beau fixe pour monter dans le wagon de ce train d’enfer. Heureusement, on peut respirer grâce aux notes d’humour et à la chanson écrite par Pierre Notte qui revient tel un refrain à chaque nouvelle étape franchie vers la perte d’influence et la noyade psychologique de Vera qui voit son existence échapper à toute emprise, à tout contrôle. A l’aide d’une succession de plans séquences, la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier font de Vera un film scénique sur une drôle de vie, celle d’une femme qui joue avec le système libéral et capitaliste jusqu’à s’en brûler les doigts et les ailes. Une satire sociale qui pose les questions basiques de toute déchéance : comment peut-on en arriver là ?
Photo © Tristan Jeanne Valès
————————————————————————————————————————————–
Vera
Texte : Petr Zelenka
Traduit du tchèque par : Alena Sluneckova
Version scénique : Pierre Notte
Mise en scène : Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
Avec : Karin Viard, Helena Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza
Durée : 1h50
Du 23 mars au 8 avril
Représentations à 20h30
Dimanche 26 mars à 15h
Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 paris
Réservations : 01 42 74 22 77 ou www.theatredelaville-paris.com
Advertisements

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:30 PM
|
Par Benoît Lagarrigue dans le Journal de Saint-Denis
Ça commence par un seul en scène alerte, vif, au sens de la formule aiguisé, où le rire, petit à petit, devient plus acerbe et grinçant. Ça continue par un duo, tout aussi brillant, tout aussi efficace, drôle et percutant. Et ça se termine par une fresque aux multiples personnages, un feu d'artifice de mots et de cris, d'élans d'émotions, de craintes et d'espoirs. Trois précédé de Un et Deux, triptyque écrit et interprété par Mani Soleymanlou (avec l'irrésistible Emmanuel Schwartz dans Deux et une quarantaine de comédiens dans Trois) est un formidable moment de théâtre dont le point de départ, pourtant, s'annonçait en ces temps obscurs comme un défi : parler de l'identité et des origines. C'est là tout le talent de l'auteur, québécois né en Iran et ayant vécu à Paris, et l'intérêt de son propos. Du qui suis-je ? et du où est chez-moi ? individuels de Un, il questionne ce que veut dire « être de souche » dans Deux en se faisant la réflexion : « Je suis chez moi et on me demande d'où je viens... » Avec Trois, une autre étape est franchie : dans la France d'aujourd'hui, comment faire pour que le brouhaha devienne voix commune ? Ce spectacle, en plus d'être drôle et intelligent, est un formidable pied de nez aux identitaires de tous poils. C'est dire s'il est salutaire.
Trois précédé de Un et Deux, jusqu'au 31 mars au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), à 19 h 30, le dimanche à 15 h. Relâche le mardi. Durée : 4 h 15, entractes compris. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:04 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :
Dans le cadre du festival « Programme commun » initiant une livre circulation entre différents théâtres de Lausanne, Vincent Macaigne reprenait au Théâtre de Vidy « En manque », créé en décembre dernier. Reprenait ? C’est un mot qu’il ne connaît pas. Chacune des ses représentations est une aventure unique, ultime. Du théâtre à la vie à la mort.
Vincent Macaigne est mort samedi dernier à Lausanne au Théâtre de Vidy où se donnait son nouveau spectacle, En manque. On l’avait vu avant la représentation avec son t-shirt blanc et puis on ne l’a plus vu. Mick Jagger était mort pendant le spectacle, un panneau clignotant nous avait annoncé la nouvelle. Tous les spectacles de Macaigne sont peuplés de cadavres, de morts-vivants.
La fable de la fondation
Tous les soirs, il meurt pour ainsi dire en scène, joue son va-tout, comme si c’était la dernière fois. C’est toujours la dernière fois. Chaque représentation est unique, chaque représentation est la dernière. Celle d’En manque que j’ai vue le samedi 25 mars au théâtre de Vidy-Lausanne n’a pas grand-chose à voir avec celles du même spectacle créé en décembre au même endroit, ni avec celles qu’il donnera ailleurs. Macaigne brûle ses vaisseaux tous les soirs. Rien n’est plus vivant que ce mort-là qui renaît tous les soirs où il embrasse le théâtre tellement fort qu’il va jusqu’à lui serrer le kiki.
Un temps, Macaigne s’est réfugié derrière Shakespeare, Dostoïevski et compagnie, aujourd’hui il s’abrite derrière une fable qui lui sert vaguement de trame. Son théâtre a besoin de paravents pour se déshabiller. Alors voici la fable de la fondation qui aurait acheté toute la culture européenne. Les proprios et leurs pairs vivent en haut dans la montagne. Et en bas, dans la vallée, il y a les autres, les pauvres. Là-haut, ils ont tout (pris) : le fric, le pouvoir, la culture. Magnanime, la fondation va exposer en bas une série de Caravage. Tout est sous contrôle, tout est sous clef. Manque l’essentiel : l’envie, le désir, l’amour, la joie.
Alors tout cela revient comme un boomerang, les certitudes vacillent, les apparences se déchirent. On pète les plombs, on détruit tout. La famille, la communauté première, explose. La jeune Liza (extraordinaire Liza Lapert) veut tuer sa mère Sofia (Sofia Teillet) et partir avec celle qu’elle aime, Clara (Clara Lama-Schmit) tandis que le mari ou l’ex (Thibaut Evrard) venu d’on ne sait où déboule du haut des gradins (là où se tient la régie, là où Macaigne orchestre la soirée) et pousse sa gueulante. C’est lui, naguère, qui a pris sa petite fille dans ses bras pour la séparer de sa mère droguée à l’acide.
Un film de famille
Le spectacle avait commencé par une expo de Caravage dans la vallée, et c’est Michel Ange qui s’invite quand, dans le brouillard, la petite fille tenue par son père tend une main vers celle tendue de sa mère pétrifiée. On ne sait plus trop où on est et on s’en fout. Vers la fin de cette séquence, sur un moniteur perdu dans la fumée, on voit une scène de vacances sur une plage. Un film de famille. Ils sont jeunes, le bébé pleure, ils sont heureux, ils ne savent pas encore qu’ils vont vieillir, faire ces concessions, pactiser, baisser trop souvent les bras, ne plus trop oser se regarder dans une glace pour ne pas voir apparaître les premières rides. Macaigne est en manque de jeunesse, d’hier, de morts. Les disparitions de Bowie, Prince (il nous fait chanter « Purple rain ») et d’autres ont foutu le bourdon au sablier. Alors quoi ? Alors détruire, c’est recommencer à vivre.
Ne vous fiez pas à ce que je viens d’écrire : une histoire construite. Elle ne l’est pas. Par pudeur peut-être, Macaigne s’en sert pour parler de lui, de ses (nos) doutes, de ses (nos) échecs. De sa génération, pas seulement. « Se regarder soi-même. Se regarder et affronter ça, son propre échec et ses propres faiblesses », écrit-il en préambule de ce que doit être En manque. Ou encore : « Pas faire un spectacle sur l’actualité. Mais sur notre profondeur noire et lumineuse. Notre amour et notre intimité dans le Monde. Notre colère et notre crainte de l’avenir. Notre culpabilité et notre chemin accompli. Ne pas résoudre les paradoxes et les contradictions. Essayer d’être plus grand que le cadre. » Si le théâtre n’excède pas le théâtre, il est bon pour n’être qu’un produit culturel.
« Il n’y a que l’amour de vrai »
« Il est désespérant d’être nous », peint l’homme en lettres rouges sur un mur blanc. C’est un autre « nous » que cherche Macaigne, celui d’une communauté, d’une bande. Fût-elle celle d’un soir : à un moment du spectacle, le premier rang se lève (des complices) et invite tout le monde à danser, à faire la fête, il y a un distributeur de cannettes au fond du plateau. On tend des guirlandes de néons, la musique pousse ses décibels, Macaigne au micro depuis la régie joue les DJ et incite les gens à s’embrasser. On pressent chez lui une envie de fondre en un le DJ, le metteur en scène et l’acteur. La communauté, la bande, c’est d’abord celle que forment ceux qui l’entourent le temps d’un spectacle. Acteurs, collaborateurs et techniciens. Etre bien ensemble un bout de chemin. C’est le rêve de Macaigne : que tout spectacle soit comme une étreinte. C’est pourquoi il ne peut pas se passer de théâtre. « Il n’y a que l’amour de vrai. » Ce sont les derniers mots d’En manque.
C’est du théâtre qui rage, rugit, rêve à haute voix. Un théâtre à vif contre la torpeur, la défaite, le no future. Inquiet mais vivant. Violent mais touchant. On retrouve dans En manque son vocabulaire scénique : fumées blanches, musique et micros tonitruants, néons, sols et murs maculés, etc. A un moment, la fumée blanche envahit tout, on aperçoit sur le côté droit un brasero. Une flamme tremble en cherchant à s’évader du bidon qui l’a vue naître. Chacun fait ce qu’il veut avec ça. Moi, j’ai eu les larmes au yeux. A cause de la fumée ?
Le spectacle En manque doit poursuivre ses aventures la saison prochaine.
Photo :scène de "En manque" © Mathilda Olmi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 5:28 PM
|
C’EST UNE MOUETTE
« Elle se rappelait que la veille, après le thé, Grouzdev avait joué avec le caniche Maxime et ensuite avait raconté l’Histoire d’un caniche très intelligent qui avait poursuivi un corbeau dans la cour. Le corbeau s’était retourné vers lui en disant :
– Coquin, va !
Sur quoi le caniche, qui ne savait pas qu’il avait affaire à un corbeau instruit, s’était senti très gêné et avait battu en retraite complètement consterné avant de se mettre à aboyer. »
Anton Tchékhov, « Après le théâtre ».*
Le hasard a voulu que je tombe sur cette anecdote lorsque j’eus pris connaissance de l’esquintage en règle qu’un critique vient de produire sur La Mouette du même Tchékhov traduit par mon ami Clément Mercier et mis en scène par mon ami Thibault Perrenoud. (Ah ! ce sont vos amis et vous les défendez, vous devriez être mis en examen !) Le lecteur appliquera cette fable du caniche et du corbeau comme il l’entendra.
J’ai quelquefois traduit. Toujours avec une fidélité exemplaire, à toute épreuve. Sauf que je ne sais pas en quoi consiste cette fidélité exemplaire qui passerait toutes les épreuves. Et aussi parce que, si les poètes vérifient le Genus inritabile vatum d’Horace (« la race irritable des poètes »), la race des traducteurs l’est mille fois davantage, et plus encore ceux qui donnent des leçons de traduction. Le narcissisme de la petite différence, cher à Freud, les gratte et les démange à tout instant. Ils deviennent venimeux.
Aussi vais-je commencer par deux exemples, l’un chez Plaute, l’autre chez Tchékhov.
Dans le Pseudolus (« L’Imposteur »), il y a un leno (en latin : marchand d’esclaves, ou de femmes, entremetteur, pourvoyeur). Pierre Grimal traduit (Pléiade) : « Le marchand de femmes », un autre, (Alfred Ernout, aux Belles-Lettres) traduit, si on peut dire : le « léno » ! Florence Dupont, dans ses merveilleuses traductions (qui ne sont pas sans faire penser à celle de Mercier), traduit « le proxo », qui passe pour être l’argot des banlieues. La question est que vous, vous dites : le maquereau, le proxénète, ou le proxo, vous ne dites jamais « le marchand de femmes » (quelle pudeur !), et encore moins le leno, sauf dans la salle des profs à un collègue latiniste. Bon.
Le dernier mot de La Cerisaie (je ne sais pas le russe, mais je pourrais pour briller vous trouver le mot en russe dans Google) que le vieux Fierce, resté seul dans ladite Cerisaie, se dit à lui-même, c’est, traduit par Elena Pavis- Zahradnikova et Patrice Pavis : « espèce de bon à rien ! » (Le Livre de poche); par Génia Cannac et Georges Perros : « espèce d’empoté » (Folio classique) ; et moi j’adorais celle d’Elsa Triolet : « Vieux nicdouille (écrit aussi niquedouille), va ! ». Alors ?
J’admets que le Critique déteste la traduction Mercier, mais l’exercice qui consiste à vous montrer que chaque réplique est horrible est assez vain. C’est toujours mieux ailleurs, chez Vitez, et surtout en russe, n’est-ce pas, pour qui sait goûter cette belle langue !
Le Critique relève donc les premières répliques de la traduction et les compare avec celle de Vitez, et il croit qu’il suffit de les citer pour mettre immédiatement le lecteur de son côté. Je vous le fais moi-même. Tenez :
Le vieux Sorine qui entre dit à Constantin : « Moi, mon ami, à la campagne, il y a quelque chose qui ne me convient pas et, de toute évidence, je ne m’habituerai jamais ici. » C’est la traduction d’Antoine Vitez. Selon Mercier, « cette réplique devient » : « Fait chier ! La campagne, mec, je sais pas : c’est pas ça. ». Ouf ! vous êtes aussitôt d’accord que c’est moche. Vous n’irez pas voir la pièce. Moi, je m’étonne seulement et je me demande où le traducteur veut en venir lorsqu’il procède ainsi. Rien n’est évident, et il ne suffit pas de le citer pour obtenir une réprobation supposée unanime. D’autant que vous ne savez pas s’il y a des niveaux de langue en russe. Après tout, il y a un traducteur émérite de Dostoïevski qui vous explique que cet auteur écrit mal en russe !
De même, entre Constant : « Mais oui ! On aime le théâtre. Bravo le théâtre ! Bien sûr. Mais il faut des formes nouvelles. Des formes nouvelles. Et sinon : rien. »
« Comme cela sonne mal ! » dit le Critique, qui ajoute ; « De retour à la maison, j’ouvre la traduction de Vitez » :
« SORINE : On ne peut pas se passer de théâtre.
CONSTANTIN TREPLEV : Il faut des formes nouvelles. De nouvelles formes, oui, et s’il n’y en a pas, mieux vaut rien du tout. »
J’avoue ne pas entendre en quoi la traduction, littérale sans doute de Vitez, est tellement plus relevée que la traduction de Mercier. Ni que « bravo le théâtre » se condamne de soi-même. Je m’interroge et m’angoisse sur mes goûts.
Dans sa mise en scène récente, Thomas Ostermeier avait bien davantage détourné, modernisé, actualisé tout le début de la pièce concernant le théâtre. Il s’était d’ailleurs attiré cette critique du Critique : « maladroite voire douteuse actualisation ». Mais bon, à la fin, il ajoutait, en fin connaisseur des Russes : « c’est toujours Tchékhov qui gagne ». Merci pour lui. Comme cela est aisé à dire ! d’autant que le culte de Tchékhov est un tel tabou dans les milieux français de théâtre qu’il suscite la plupart du temps des réflexes conditionnés (vive les auteurs qui ne déclenchent pas cette unanimité automatique digne de ce « style à la Vaucanson » relevé par Baudelaire) !
L’un de ces réflexes est d’ailleurs celui qui consiste à se gargariser de la nomination russe des personnages (Irina Nikolaïevna, Konstantin Gavrilovitch, Boris Alexeïevitch, etc.), qui réjouit les habitués et fait que bien des spectateurs ne s’y retrouvent pas. Aussi sais-je gré à Mercier d’avoir transposé les noms propres. Ce n’est nullement obligatoire, mais cela évite au spectateur ignorant de se croire l’invité d’un club d’initiés, les Tchékoviens. C’est un choix.
Choix aussi, la mise en scène de Thibault Perrenoud en quatre côtés qui permet une diffraction intelligente et intéressante de l’espace. Le Critique le reconnaît d’ailleurs lui-même, mais il ne juge pas utile de développer ce point, ce n’est après tout qu’une petite compagnie qu’il ne faut surtout pas encourager. On est là pour aboyer n’est-ce pas !** Alors qu’il m’a semblé que ces espaces, dont les dimensions et dont les distances entre les lieux sont toujours énigmatiques et originaux chez Tchékhov, trouvaient là une topologie adéquate et révélatrice (de quoi ? : des rapports entre les êtres aussi bien). J’avais relevé cet aspect dans Sur la grand-route, mis en scène naguère par Grüber, et je m’étais demandé si tout, chez Tchékhov, ne se trouvait pas constamment en mouvement : sur la grand-route. Une dramaturgie en mouvement qui subvertit radicalement l’espace scénique depuis peut-être même les origines du théâtre : un centre, la maison, qui est partout, et la circonférence, la propriété, le parc, la forêt, qui ne sont nulle part. Les Nouvelles de Tchékhov, où l’on parcourt tant de verstes, le confirmerait (le Critique, toujours petit malin, se réjouit que parfois les comédiens soient off : enfin il ne les voit plus, il les entend à peine ! Voilà bien après tout une réflexion digne de la critique théâtrale aujourd’hui, non-dupe, moutonnière et patibulaire. Heureusement, le théâtre se porte mieux qu’eux !).
Il me souvient de la protestation qu’un certain nombre de traducteurs professionnels avaient opposée à Heiner Müller traduisant Quai ouest, de Bernard-Marie Koltès. Je me réfère à Wikipédia citant la revue ‘Theater heute’ en 1986. D’un côté, le traducteur s’est vu reprocher ses incorrections : « les critiques se jettent alors sur le texte en disant : “Il ne sait même pas l’allemand ” [Heiner Müller !] ; de l’autre, Bernard-Marie Koltès intervient dans Der Spiegel pour défendre l’entreprise : “ Je ne peux absolument pas juger cette traduction. Je ne parle pas l’allemand, mais je suis entièrement sûr de mon fait : cette fois, j’ai donné ma pièce non à un traducteur, mais à un écrivain. Je trouve une très bonne chose que Heiner Müller ait inséré sa propre langue dans ma pièce.”»
On va me dire, oui, mais Tchékhov n’approuve pas la traduction de Clément Mercier. Certes, mais il ne la désapprouve pas non plus ! Et encore, oui, mais Heiner Müller était un écrivain, alors que Mercier n’en est pas un. Qui le dit ? Eh bien ! justement le Critique ! Ah ! bon, alors tout va bien.
C’est fou ce que l’exercice de la traduction pratiqué en classe, notamment dans la version latine, demeure ancré dans les âmes : le contresens est une faute, c’est un péché. Si universitaire sois-je moi-même, si rigoureux veux-je être, je sais parfaitement, comme me le disait un jour Lacan, que traduire une langue dans une autre est impossible, et que pourtant, ajoutait-il, on y arrive !
J’ai enfin envie de renvoyer à un beau texte de Pierre Boulez, « Court post-scriptum sur la fidélité ». À propos de Lulu, d’Alban Berg, pour défendre Chéreau accusé d’avoir trahi l’œuvre en transposant vers 1930 un action située vers 1880 (voir Lulu, II, Opéra, M&M, 1979). « L’œuvre, écrit Boulez, est une proposition, n’est qu’une proposition – spécialement l’œuvre théâtrale liée au transitoire dans ce qu’il a de plus irratrapable. […] L’important – non, l’essentiel ! au théâtre comme avec tout autre moyen d’expression, c’est la greffe, la création à partir de la proposition fournie par l’œuvre. Inestimable s’avère l’enrichissement qui se produit par la greffe d’une pensée sur une autre, d’une attitude sur une autre. »
Qu’on me permette cependant de terminer par l’adage célèbre invoqué plus haut par notre Critique, et digne de Monsieur Fenouillard : à la fin, c’est toujours Tchékhov qui gagne !
François Regnault / 22 mars 2017
_______________________________________________________
*Tchékhov, Nouvelles, la Pochothèque, Le livre de poche, trad. Vladimir Volkof]
Le spectacle est La Mouette de Tchékhov, traduction de Clément Camar-Mercier, mise en scène de Thibault Perrenoud, au Théâtre de la Bastille qui se joue du 6 mars au 1er avril 2017
La critique du Critique ici critiquée est celle de Monsieur Jean-Pierre Thibaudat, sur son blog Balagan.
**Je note aussi d’ailleurs que le Critique se réjouit de ne pas avoir vu le Misanthrope par les mêmes. Il sait, de science infuse, que ce devait être mauvais. Je cite le texte qui comporte son pesant de mépris dans les termes que je me permets de mettre en italiques :
« Le même tandem avait monté dans le même Théâtre de la Bastille un Misanthrope. Je suppose que c’était une traduction de ce français cacochyme du XVIIe en langage branché putain fais chier. Ce Misanthrope a connu deux ans de tournée. On prend les mêmes et on recommence : « monter La Mouette d’Anton Tchekhov avec la même équipe m’est apparu comme une évidence », note le metteur en scène. Je n’ai pas vu ce Misanthrope et j’avoue ne pas le regretter. » Eh bien oui, tu l’avoues ! On te pardonne !
François Regnault, sur le site de la Compagnie Pandora

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 5:55 PM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks
Guidé par Alexis de Tocqueville, Romeo Castellucci tire le portrait des Etats-Unis, dans la folle accumulation des tableaux d’un théâtre d’images irrigué par la grâce de la danse.
Pour sa dernière création, De la démocratie en Amérique, Romeo Castellucci trouve l’inspiration dans l’essai qu’Alexis de Tocqueville consacra, en 1835, à la fondation du système politique des Etats-Unis. Tous les chemins mènent à Rome, affirme l’antienne, et Romeo Castellucci ne déroge pas à son obsession de commencer par s’interroger sur les voies qu’empruntent les prières pour parvenir jusqu’aux oreilles de leur divin destinataire.
Ainsi, le spectacle s’ouvre sur un dialogue réunissant le couple des fermiers puritains du fameux tableau American Gothic, peint en 1930 par Grant Wood. Le duo se désespère de vivre un jour du travail de la terre. Toute à sa colère, la femme alterne prières et blasphèmes.
Le melting-pot chorégraphique d’une population de migrants
Mais elle est comptable de son pêché devant sa communauté, et son procès est l’occasion pour Romeo Castellucci d’abandonner la litanie des mots pour basculer dans le théâtre d’images. Un enchaînement de tableaux décline le melting-pot chorégraphique d’une population de migrants en s’inspirant de danses traditionnelles puisées au folklore de l’Albanie, de la Grèce, de la Sardaigne, de l’Angleterre, de la Hongrie et du Botswana.
Comme on feuillette un grand livre illustré dont les pages se tournent avec bonheur, le metteur en scène perturbe avec malice son déroulé par des inserts arty, à l’instar de cette sculpture animée qui descend des cintres et figure les membres découpés d’un cheval galopant dans le vide.
Après les noirs et les blancs propres à la rigueur morale du puritanisme, on passe à l’exubérance des ors et des rouges avec la tenue d’un cérémonial païen. La transition nous conduit avec humour sur les terres des comédies musicales de Broadway.
Une Amérique qui ne serait qu’un énigmatique tigre de papier
L’ironie succède à la fascination, quand le regard de l’artiste se porte sur une Amérique perturbée se conjuguant au présent. Une parade de drapeaux propose le jeu typographique d’un Scrabble géant, permettant de décliner toutes les possibilités de sens offertes par les lettres qui composent le titre du spectacle.
Ultime dédicace oscillant entre l’ethnologie et le stand up, deux Indiens beckettiens arpentent une plaine herbeuse où l’on s’attend à voir débouler un bison. Quelques répliques suffisent pour comprendre qu’ils s’initient à la langue anglaise.
Concluant sur une pirouette destinée à nous faire rire, Romeo Castellucci évacue la caricature dénonciatrice. Au grand Satan des uns et au Big Brother des autres, il préfère l’iconographie d’une Amérique qui ne serait, au final, qu’un énigmatique tigre de papier.
De la démocratie en Amérique librement inspiré de l’essai d’Alexis de Tocqueville, mise en scène Romeo Castellucci, en italien surtitré en français, du 30 mars au 2 avril au Théâtre de Vidy, Lausanne, Suisse, dans le cadre de Programme commun, puis du 13 au 15 juin à Montpellier (Printemps des comédiens) et du 12 au 22 octobre à la MC93 Bobigny (dans le cadre du Festival d’Automne à Paris)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 5:09 PM
|
Par Rosita Boisseau pour M le magazine du Monde
Dans « Réversible », les membres de la troupe canadienne revisitent leurs souvenirs familiaux. Un récit collectif, comme un miroir tendu au public, qui s’admire jusqu’au 1er avril.
Devant la façade d’une maison ordinaire, les huit jeunes acrobates de Réversible, spectacle de la troupe de cirque canadienne Les 7 doigts de la main, passent au micro pour évoquer, qui son grand-père, qui sa grand-mère. Leurs souvenirs ont nourri ce spectacle. « L’idée de cette production m’est venue lors d’un séjour dans la ferme familiale du Massachusetts, raconte Gypsy Snider, l’un des 7 doigts. Cette propriété est dans ma famille depuis quatre générations. J’étendais du linge à l’extérieur. J’ai ressenti la grande solitude de n’avoir personne autour, sur des kilomètres. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où j’avais eu ce sentiment. J’ai alors pensé à toutes les femmes de ma famille qui ont fait les mêmes gestes au même endroit et je me suis sentie moins seule. Regarder vers le passé semblait me donner des forces pour le futur. »
Cette expérience intime sera le moteur de Réversible. Comme souvent dans cette compagnie parmi les plus reconnues dans le monde, les rênes sont tenues par un ou deux metteurs en scène sur les sept qui constituent la troupe. Gypsy Snider, également auteure de Loft (2002) et Traces (2006), aime appuyer son geste théâtral sur des espaces précis. « Je voulais un décor architectural de trois murs mobiles, qui pourraient créer à la fois des espaces de vie fermés et des façades extérieures, explique-t-elle. C’est ce qui a donné son titre au spectacle. Les murs représentent les barrières personnelles, la séparation et la protection. Les portes évoquent l’ouverture tout comme la fermeture. Les fenêtres sont une incitation à un certain voyeurisme. Mais ce sont d’abord d’excellents moyens de placer les éléments circassiens dans un contexte humain et de tendre un miroir au public. »
Intentions et improvisations
Un an avant les premières répétitions, en 2015, Gypsy Snider a proposé une liste de questions à chacun des acrobates, à charge pour eux de plonger dans leur mémoire familiale. « Il leur fallait trouver des histoires sur leurs grands-parents, poursuit-elle. Des événements qui ont marqué leurs vies. » À partir des confidences de chacun, des scènes et des personnages se sont imposés, soufflés par la virtuosité des jeunes artistes, des personnalités exubérantes, qu’ils soient experts en jonglage, hula-hoop, acrobaties aériennes ou mât chinois.
« Au cœur de chacun de nos spectacles, il y a toujours une intention première, puis des improvisations théâtrales, précise Gypsy Snider. Cela permet à notre travail d’être authentique, brut et évolutif. » Dans le contexte de nos vies bousculées, les courses vives et autres pics acrobatiques, entre la chambre et le bureau des interprètes de Réversible, claquent avec force. « Réversible nous aide à définir un chemin pour le futur, et m’a permis aussi de me rapprocher du public, poursuit Gypsy Snider. Nous avons tous des grands-parents. Des souvenirs qui nous ont construits et nous lient. »
« Réversible », Les 7 doigts de la main. Le Bataclan, 50, bd Voltaire, Paris 11e. Jusqu’au 1er avril. www.bataclan.fr
La vidéo de présentation de « Réversible »
Rosita Boisseau
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 3:35 PM
|
Une femme de ménage sur une scène, mais pas pour y passer la serpillère : Moi, Corinne Dadat est un spectacle de Mohamed El Khatib, actuellement au théâtre de la Colline à Paris. Avec beaucoup d'humour, le metteur en scène-chorégraphe dirige cette femme de ménage rencontrée à Bourges. Depuis trois ans, ils ne se quittent plus.
Ecouter l'entretien sur le site de France Info : http://www.francetvinfo.fr/culture/corinne-dadat-une-femme-de-menage-sur-les-planches-du-theatre-de-la-colline_2118543.html
"Tu ne disais jamais bonjour !"
L'histoire commence mal, Mohamed El Khatib anime un atelier de théâtre dans un lycée de Bourges, là où travaille Corinne Dadat, femme de ménage, 53 ans. "Tu ne disais jamais bonjour, dit le premier, quand je suis venu te voir..." "Ben oui, lui répond la seconde. Les gens ne disent jamais bonjour. Alors ça m'a fait du bien, quand tu m'as posé cette question là..."
"Il a fallu le temps de s'apprivoiser mutuellement. Le temps que s'installe une confiance... Ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à apprendre l'espace, une forme de virtuosité dans le ménage, une extrême précision", explique Mohamed El Khatib. "J'ai dit oui tout de suite, se souvient Corinne Dadat. Et pourtant il n'avait rien écrit. Je me suis méfiée au début... Le plus dur, c'est d'attendre que les gens entrent et s'asseoient. C'est horrible ça..."
Une femme de l'ombre dans la lumière, sans pathos
Sur scène, Corinne Dadat improvise chaque soir, épaulée par la danseuse Elodie Guézou, elle tente des chorégraphies. Cash, drôle, elle parle de sa vie : "On est des femmes de l'ombre", dit-elle. Mohamed El Khatib, la met en lumière, sans pathos, ni parole moralisatrice. "Je suis issu d'une famille de culture ouvrière. Quand je vois Corinne, je vois ma mère, d'une certaine manière. Ce sont des gens qui ont une vie extrêmement laborieuse et beaucoup de dignité... Puisque les gens auxquels on souhaite s'adresser ne viennent pas dans les salles de théâtre, on les fait venir sur les plateaux !" En peuplant les plateaux, le metteur en scène espère peupler les salles, un peu plus à l'image de la France d'aujourd'hui, dans sa diversité.
"Dans mon lycée, se souvient Corinne Dadat, il y avait des profs qui ne me disaient jamais bonjour. Et après ma représentation à Bourges, en reprenant le travail, les profs sont passés à côté de moi, et m'ont, là, dit bonjour. Il y en a qui me disaient même "Bonjour Coco ! Faux-culs, va..."
Entre deux spectacles, le retour au travail
Depuis trois ans Moi, Corinne Dadat tourne en France et à l'étranger, entre deux spectacles, Corinne retourne travailler. "Cela me change, s'amuse-t-elle. Parce que je n'étais jamais sortie de Bourges. Maintenant, je prends le train toute seule, je vais dans les hôtels, je mange dans les restaurants." Il y a bien une chose qui lui manque : son fils de 35 ans, qui vit à La Réunion. Elle espère que lui aussi viendra la voir, malgré les billets d'avion.
>> Moi, Corinne Dadat au théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 1er avril et en tournée en France.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 3:30 PM
|
Propos recueillis par Eric Demey dans La Terrasse Deuxième édition du festival Wet qui cherche à repenser le concept de festival dédié à l’émergence. Explications avec son initiateur, Jacques Vincey, directeur du CDR de Tours.
La première spécificité de ce festival réside-t-elle dans l’identité de ses programmateurs ?
Jacques Vincey : En effet, nous avons une chance unique en France, celle d’héberger un collectif de jeunes acteurs et techniciens, qui sortent tous d’écoles nationales, et travaillent ici pendant une année entière. Nous leur avons remis les clés de cette programmation. Ils sont partis à la recherche de spectacles souvent élaborés par des gens de leur génération. Le but, c’est de les sensibiliser à la manière dont fonctionnent les institutions, vu de l’intérieur. Et cela permet en retour à l’institution de s’ouvrir à la sensibilité de ces jeunes gens.
Quels sont les grands traits de cette programmation ?
J.V. : Ils sont partis à la recherche de formes originales et nous avons simplement veillé à ce que ces formes soient diverses, à ce qu’elle ne se répètent pas. On trouvera ainsi des textes théâtraux comme La Maison de poupée librement adaptée d’ibsen et mise en scène par Lorraine de Sagazan. Mais aussi du théâtre à la lisière de la performance avec le travail de Marion Siefert autour des réseaux sociaux. Une création maison issue d’une carte blanche que le collectif avait produit ici avec Truelle côtoiera, pour la création régionale, Play war de la compagnie Discrète, avec deux comédiens tourangeaux qui renouvellent l’art du mime. Ce dernier est un spectacle tout public comme celui des belges du collectif Wow ! qui proposent une pièce radiophonique et visuelle à la fois, Piletta Remix, et, en version plus rock, Carter est un porc de la compagnie du 7ème étage raconte l’histoire d’un garçon obèse et rouquin de six ans.
« L’audace peut aussi être une marque de la jeunesse. »
La programmation est orientée vers l’émergence…
J.V. : On se méfie de cette notion car on pense que l’audace ne s’en va pas avec les années, comme en témoigne par exemple la présence de Claude Degliame dans Genèse n°2 du collectif AOI conçu à partir des textes d’Ivan Viripaev. L’audace peut aussi être une marque de la jeunesse : le texte d’Hugues Duchêne, Le roi sur sa couleur, politique-fiction autour de l’éviction d’Olivier Py du Théâtre de l’Odéon en 2011, en témoigne. Tout comme le Collectif la Catastrophe, qui a fait grand bruit avec une tribune parue dans Libération (le 22 septembre 2016), affirmant qu’étant donné le désespoir de notre société, il ne restait qu’à être absolument libre et joyeux. Nous avons donné carte blanche à ce collectif pour imaginer notre soirée de clôture.
Propos recueillis par Eric Demey
A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
FESTIVAL WET, COMMENT PENSER L’ÉMERGENCE
du 28 avril 2017 au 30 avril 2017
CDR de Tours – Théâtre Olympia
7 Rue de Luce, 37000 Tours, France
7 rue de Luce, 37000 Tours. Egalement dans des structures associées. Du 28 au 30 avril. Tel. : 02 47 64 50 50.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2017 11:42 AM
|
Par David Rofé Sarfati dans Toutelaculture.com
Le Théâtre Montansier de Versailles vient de décider de façon unilatérale d’annuler les représentations prévues des Métamorphoses dans la version d’Aurélie Van Den Daele pour programmer une autre version des Métamorphoses dans une mise en scène de Gerold Schumann.
Au delà de la malice qui consiste à présenter au public une pièce portant le même nom que celle annoncée dans l’espoir sans doute de ne pas voir annuler réservations et encaissements, cette décision constitue pour Aurélie Van de Daele interrogée par TLC, « un non-respect flagrant des engagements pris et un douloureux désaveu de son travail », d’autant que le Montansier est coproducteur de la pièce et que son administratrice ne découvre aujourd’hui ni le texte d’Ovide ni le travail de Aurélie Van Den Daele.
La décision de l’administratrice est surprenante, car Les Métamorphoses de Aurélie Van Den Daele, actuellement au Théâtre de l’Aquarium rencontre, comme ce fut le cas en 2015 de son Angels In America le succès de la critique et du public. Mme Geneviève Dichamp justifie sa reculade au motif que le spectacle ne peut pas être vu par de jeunes scolaires de 14 ans. Mme Geneviève Dichamp argue en outre que dans le spectacle, on parle serbe. De nombreuses classes d’élèves de 14 ans sont venues à l’Aquarium découvrir la pièce sans qu’il ne soit constaté de problème, et l’argument du serbe semble disproportionné au vu de la déprogrammation. Jointe au téléphone Geneviève Dichamp s’explique : « Le spectacle était destiné à un jeune public, il est visible par des jeunes de 14 ans mais ne peut être proposé à des plus jeunes; or les Métamorphoses sont cette année au programme des 6eme, soit 11/12 ans, ce sont ces scolaires qui ont réservé. »
Des échanges de courrier avaient lieu encore le 22 Mars entre l’administratrice et la metteuse en scène.
Visuel :DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2017 5:57 PM
|
Par Anaïs Héluin dans La Terrasse
Il y a d’abord Un, monologue autofictif. Puis il y a Deux, duo avec le Québécois Emmanuel Schwartz. Il y a enfin Trois, qui réunit trente-cinq interprètes issus d’horizons divers. Dans sa géniale trilogie, le Québécois d’origine iranienne Mani Soleymanlou s’empare avec humour et audace du guêpier identitaire.
Parfois, Mani Soleymanlou se dit qu’il ferait mieux de monter des pièces de Michel Tremblay. Ou pourquoi pas de faire de l’impro ? Ça ferait très québécois et qui sait, ça finirait peut-être par lui faire oublier un moment le « souvenir profondément ancré dans un vide » qui lui tient lieu d’identité. Mais depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 2008, la question identitaire le poursuit – et réciproquement – pour la plus grande joie du public canadien. Pour le nôtre aussi, depuis que Un fut présenté à Chaillot en 2013. Soit deux ans après sa création à Montréal, sous l’impulsion du Théâtre de Quat’Sous qui organisait alors des « lundis découverte » proposant de « découvrir un artiste québécois issu d’un milieu culturel ». Un concept dont Mani Soleymanlou ne se prive pas de rire dans le seul en scène qui en est pourtant issu, ainsi que dans son spectacle suivant. Un duo avec le comédien québécois « de souche » Emmanuel Schwartz tout simplement intitulé Deux. Quitte à appuyer là où ça fait mal, et parce qu’au Québec aussi on dit qu’il n’y a jamais de deux sans un trois, l’acteur et metteur en scène né en Iran et installé au Canada depuis l’enfance remet sur le plateau son malaise identitaire dans Trois. Il invite cette fois trente-cinq interprètes professionnels, en formation ou amateurs à s’emparer de sa quête pour bâtir un spectacle choral sur la notion d’identité nationale. Le tout forme une trilogie d’une intelligence et d’un humour d’autant plus précieux qu’ils se déploient en terrain sensible. Menacé à la fois par les stéréotypes et par un contexte politique tendu.
L’Iran pour les Nuls
Mani Soleymanlou n’a guère besoin de compagnie pour être très nombreux. La preuve par Un. Seul au milieu d’un carré de chaises noires alignées comme pour une conférence, il ouvre sa trilogie par ce monologue autofictif dans lequel il décline les différentes strates de son identité. Sa culture mosaïque et les incompréhensions qu’elle suscite là où son nomadisme le conduit. Entre anecdotes intimes, parodie d’exposés sur la culture persane qu’il avoue ne connaître que grâce à Google et réflexions sur les révoltes de 2009 à Téhéran ainsi que sur le multiculturalisme canadien, Un présente des contours joyeusement accidentés. Fidèle à son goût du coq-à-l’âne, mais peu enclin à la répétition, Mani Soleymanlou reprend ce drôle de cadre dans les deux volets suivants de sa trilogie et s’amuse à le mettre à l’épreuve de l’Autre. Si l’histoire de Deux commence toujours « un dimanche du siècle dernier. Un dimanche du mois de janvier 1982 en Iran », elle est en effet donnée à entendre autrement grâce à la présence d’Emmanuel Schwartz. Un fin garçon blond sans problème identitaire particulier malgré ses racines juives, qui forme avec le brun et imposant Mani Soleymanlou une paire irrésistible, aux débats contradictoires poussés à l’extrême dans la troisième partie de la fresque, où toutes les chaises sont enfin remplies. Avec un Gustave Akakpo en Africain proverbial à souhait, chacun des nombreux comédiens de Trois apporte sa pierre ou plutôt la jette avec énergie sur l’édifice de Mani Soleymanlou. Lequel finit magnifiquement brinquebalant. Mais toujours rieur.
Anaïs Heluin
Photo : Trois de Mani Soleymanlou. © Anne Sendik
A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
TROIS, PRÉCÉDÉ DE UN ET DEUX
du 23 mars 2017 au 29 avril 2017
CDN Théâtre Gérard Philipe
59 Boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis, France
Jusqu'au 31 mars, du lundi au samedi à 19h30, relâche le mardi. Tel : 01 48 13 70 00. www.theatregerardphilipe.com. Également à Chaillot – Théâtre national de la Danse du 18 au 22 avril. Tél : 01 53 65 30 00. Et au Tarmac – La scène internationale francophone du 25 au 29 avril. Tél : 01 43 64 80 80. Durée (avec entractes) : 4h15.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2017 7:46 AM
|
Des aveux modelés dans la glaise
Le Studio-Théâtre se prête merveilleusement aux formes courtes et enlevées. Preuve en est encore avec Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Le proverbe de Musset mis en scène par Laurent Delvert est expédié en quarante-cinq minutes chrono. Le temps d’un épisode d’une série T.V. Cette sitcom badine à la langue pétillante tranche dans le vif avec des saillies d’esprit étonnamment modernes. Jennifer Decker irradie en chipie piquante qui mène à la baguette un Christian Gonon hypnotisé et transi d’amour.
La Marquise invite le spectateur à pénétrer dans son loft-atelier au design épuré sans son élégante géométrie. Telle Demi Moore dans Ghost, elle sculpte patiemment la glaise en T-shirt décontracté-chic (Cristina Cordula approuverait, surtout quand les costumes sont signés Christian Lacroix). Le geste est lent et obstiné, éminemment sensuel. L’ombre du désir plane. Un homme de dos semble hésiter à franchir la porte de l’appartement. Il se décide et se déclenche alors une conversation qui mènera à une issue pour le moins heureuse. Mais avant d’en arriver là, notre Marquise aura fait tourner en bourrique le Comte. Elle lui aura aussi tout de même appris à s’affirmer et à tirer au clair ses sentiments.
Les piques fusent : les hommes et leurs techniques de séduction d’une affligeante banalité subissent les moqueries exaspérées de la gent féminine tandis qu’on reproche aux dames de se montrer trop froides et cruelles.
Une partition rêvée pour Jennifer Decker
Jennifer Decker trouve ici un rôle à sa mesure : espiègle comme une gamine qui ferait tourner en bourrique ses prétendants, elle déploie un jeu naturel et convaincant qui insuffle un sentiment d’actualité à la verve mussienne. Face à elle, Christophe Gonon ne démérite pas en homme gentiment malmené et un brin torturé par le feu qui le ronge. Laurent Delvert anime cet échange du chat et de la souris avec une simplicité bienvenue. Claire et fraîche, cette proposition évoque une matinée ensoleillée de novembre : là où le feu et le gel se convoitent, se cherchent et terminent par s’accoupler dans une charmante reddition. Et si finalement, la créature informe puis sculptée avec soin dans la matière malléable n’était autre que ce cher Comte transformé par les paroles malicieuses de la marquise ?
IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE d’Alfred de Musset. M.E.S de Laurent Delvert. Comédie-Française. 01 44 58 15 15. 50 min. ♥ ♥ ♥
© Brigitte Enguérand

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2017 6:36 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello
Tesseract, conception et interprétation Nacho Flores
(tout public à partir de 6 ans)
« Matériau noble » et résistant, le bois conserve symboliquement les caractères de la vie végétale et des qualités de pouvoir poétique intense. De plus, frayer avec le bois – en caresser la matière, être sensible à son dessin, à la géométrie et à la solidité des volumes -, c’est aussi se laisser aller, pour l’équilibriste Nacho Flores, madrilène d’origine, à jouer avec des cubes… en bois – discipline constructive, volonté d’ordre et de mesure.
Sans parler de la dimension de l’équilibre sollicitée par l’interprète un peu fou qui s’embarrasse à plaisir de morceaux et fragments de bois, billots, rondins, mais non, de « cubes » dont Nacho Flores fait ainsi tout son miel, tel un ours de conte enfantin qui se serait égaré dans un bois d’arbres fabriqués dont les cimes montent au ciel, et aurait choisi par la force des choses de faire l’équilibriste en herbe sur cubes de bois.
Tesseract – titre éponyme du spectacle – est un terme mathématique qui désigne un hyper-cube, un cube à quatre dimensions. Avec des techniques diverses qui vont de la vielle magie à la 4D ou au mapping tendance – placage d’une image sur un objet 3D -, l’artiste mathématicien ou géomètre utilise un certain nombre de figures géométriques primaires qu’il s’emploie à déconstruire avec méthode : les cubes appréhendés comme des pixels traduisent notre monde numérique.
Barbe et cheveux lâchés ou bien retenus, l’interprète est au plus proche de la nature.
Non seulement il lui faut se tenir en exacte mesure physique – harmonie corporelle – sur quelques piles minces plus ou moins déconstruites de cubes accumulés, dont il enlève lui-même dangereusement tel cube ou tel autre, histoire de goûter au risque et de voir les construction ordonnées avec soin dévier tout à coup et s’effondrer sec.
Déviation, décalage, déraillement, les figures désaxées se fragilisent sur de délicats équilibres, selon la poursuite imaginaire et bientôt concrète du point de rupture. L’artiste – comme le public – respire d’un même souffle dans l’attente haletante de la catastrophe à venir qui vient ou pas, s’accomplit brutalement ou pas. Mystère.
En dépit des chutes à venir, l’équilibriste reconnaît aimer le bois, sa texture, sa lumière, sa flexibilité qu’il fait vivre au son de la musique live et des notes de guitare d’Alessandro Angius, entre ombres et luminosité, apparitions et disparitions.
L’artiste de cirque est un enfant ou bien un génie des bois, se plaisant à assembler, à combiner entre eux des cubes, à les modifier, les transformer pour créer de nouvelles formes. Jeux d’illusion et de manipulation grâce au manipulateur d’objets placé dans l’ombre non loin du circassien et grâce aux images projetées sur les tours de cubes, qui les font apparaître, spectaculairement, comme disparaître par magie.
Amusement, divertissement et récréation ludiques, Nacho Flores se montre ravi quand il se confronte avec les lois de la gravité, quand il construit des « architectures de l’instant », des « paysages éphémères » et des « monuments à forme humaine ».
Un spectacle-performance revivifiant, frais et entêtant, à la poésie boisée.
Véronique Hotte
Théâtre de la Cité Internationale, du 20 au 31 mars, lundi, mardi et vendredi 20, jeudi et samedi 19h, dimanche 16h, relâche mercredi. Tél : 01 43 13 50 50

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2017 5:44 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Hier Olivier Py, debout, au centre de la scène du si beau théâtre du Conservatoire de Paris (cette école nationale dont il avait été naguère l'élève), présentait le programme très international du prochain Festival d’Avignon qui, chaque année, trois semaines durant, en juillet, entend être le centre du monde (théâtral).
430 rendez-vous, 257 « levers de rideau », 50 lieux. C’est du lourd. On aurait aimé un peu moins de spectacles avec une durée de vie plus conséquente. Donner un peu de temps au temps. Et non, il faut nourrir la bête, le marché, lequel est insatiable, en veut toujours plus. Conséquence : des spectacles à la durée de vie de plus en plus courte, ce qui est dommageable, surtout pour les compagnies les plus fragiles. La quasi-totalité des spectacles du Festival ne se donneront au mieux que six ou sept fois, que les metteurs en scène soient très connus et très attendus ou non, ce qui promet des batailles homériques pour obtenir l’un des 120 000 billets proposés à la vente. Précisons toutefois qu’une partie des spectacles du Festival sera à l’affiche de divers théâtres en France la saison prochaine.
Du Japon à l’Australie
Ainsi verrons-nous à Avignon les dernières productions de Frank Castorf (d’après Le Roman de monsieur de Molière de Boulgakov), Guy Cassiers (Le Sec et l’Humide d’après le livre de Jonathan Littell écrit en marge des Bienveillantes, et un autre spectacle en tandem avec Maud Le Pladec à partir du récent texte de Elfriede Jelinek, Les Suppliants), Katie Mitchell (Les Bonnes de Genet). Le Japonais Satoshi Myagi (venu il y a quelques étés avec une étonnante version du Mahabharata) ouvrira le Cour d’honneur du Palais des papes avec Antigone de Sophocle (« on a toujours besoin des Grecs », a lancé le professoral Py). Israel Galvan lui succèdera, ce qui ne déplaira pas à Georges Didi-Huberman qui a consacré un ouvrage à cet homme phénomène du Flamenco.
Si le Portugais Tiago Rodrigues va créer une nouvelle pièce (Souffle, les confessions de la souffleuse du théâtre national de Lisbonne), si une autre de ses pièces se retrouve dans la catégorie « théâtre jeune public » aux côtés d’une pièce de Pierre-Yves Chapalain et d’une autre d’Olivier Balazuc, la création de pièces nouvelles est un des points faibles de cette édition, même si l’auteur-metteur en scène-directeur Olivier Py créera une version scénique de son épais roman Les Parisiens à la Fabrica. Magnifique lieu, où lui succèdera un spectacle, inclassable et donc classé dans la catégorie « indiscipline », dont on ne sait rien, pas même le titre, no comment revendiqué par son auteur le Grec Dimitris Papioannou.
De l’Afrique à Taubira
C’est dans cette catégorie « indiscipline » que se nichent des formes nouvelles d’écritures hybrides, ceci expliquant en partie le déficit de nouveaux auteurs. On note dans cette catégorie un spectacle signé Lemi Ponifasio, qui nous vient d’Auckland, à partir d’un texte d’une poétesse syrienne, et une création de Dorothée Munyaneza qui ouvrira l’un des points forts : une présence affirmée de l’Afrique, et pas seulement de l’Afrique francophone. Huit pays seront à l’honneur, dont le Rwanda. Musique, danse, théâtre et une soirée dans la Cour d’honneur du Palais des papes sera consacrée au texte célèbre de Léopold Sédar Senghor, Femme noire .
Une soirée qui ne devrait pas déplaire à Christiane Taubira à qui Olivier Py a eu la bonne idée de confier le feuilleton quotidien qui, chaque jour à midi, fait les délices du jardin Ceccano. Sous le titre prêtant à confusion On aura tout, elle choisira dans sa riche mémoire, dans sa bibliothèque fournie et dans des archives d’assemblée et autres des textes parlant de l’homme, de la femme et de leurs droits. Les textes seront mis en scène par Anne-Laure Liégeois et portés en bouche par de jeunes acteurs, en particulier par des élèves du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris.
De Saïgon à la prison d’Avignon
C’est dans cette école qu’Olivier Py a été formé, et c’est l’école nationale invitée cette année. On y verra les élèves dans des mises en scène signées Yann-Joël Collin, François Cervantès et Clément Hervieu-Léger. Mais on n’y verra pas, hélas, un extraordinaire spectacle de clowns, présenté il y a quelques semaines (en parallèle du passionnant Roberto Zucco de Collin) par une partie de la promotion sortante ; une absence incompréhensible.
Autre centre d’intérêt habituel du Festival, les créations de la nouvelle génération de metteurs en scène hexagonaux. Caroline Guiela Nguyen explore son passé familial (et pas seulement) dans Saïgon ; Pascal Kirsch dont le dernier spectacle était une merveille et devient enfin reconnu, vient à la rencontre de La Princesse Maleine de Maeterlinck ; la toujours surprenante Fanny de Chaillé propose Les Grands à partir des textes du trop rare Pierre Alferi ; le Birgit ensemble poursuit son tour d’Europe avec Mémoires de Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes.
D’Italie viendront Emma Dante (une habituée) et Antonio Latella (un projet à partir des Atrides), d’Australie via Amsterdam on découvrira Simon Stone (autour d’Ibsen), de Géorgie les marionnettes admirables de Rézo Gabriadze nous enchanteront à coup sûr (une histoire d’amour entre deux locomotives soviétiques), du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet un Hamlet aura une permission spéciale pour être joué par des détenus à la Maison Jean Vilar. Un spectacle, fruit d’un long atelier, mis en scène par Enzo Verdet et Olivier Py, lequel ne vit pas seulement à Avignon les mois d’été.
Etc. J’en oublie. Et je n’ai rien dit des rencontres, des débats, des films à Utopia, de la soirée Barbara avec Juliette Binoche et Alexandre Tharau. Je n’ai surtout rien dit des indispensables « Sujets à vifs » qui chaque année provoquent des duos surprenants et qui, pour fêter leurs 20 ans, s’offrent le bonus des facéties proposées par Frédéric Ferrer.
L’affiche, très intrigante (bon signe), est signée Ronan Barrot qui exposera ses œuvres à l’église des Célestins. On y voix deux corps. Le premier de dos, regarde vers la gauche tout en écartant les bras comme pour protéger l’autre corps, celui, s’accrochant peut-être à ce dos et lui aussi de dos, regarde vers la droite. Cette seconde personne, plus frêle, semble porter quelque chose dans son dos. Un sac à dos ? Un enfant ? Qui sont-ils ? Des voyageurs ? Des marcheurs ? Des festivaliers ? Des sans logis ? Des réfugiés fuyant un danger ?
Festival d’Avignon du 6 au 26 juillet. Programme complet début mai. Ouverture de la billetterie le 12 juin.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:36 PM
|
Par Hélène Kuttner dans Artistik Rézo
Du 23 mars au 8 avril 2017, puis tournée en France jusqu'en 2018
Dans le rôle de Vera, wonder wooman surpuissante qui gère son agence de casting comme elle le fait du turnover d’aide-soignantes autour de son vieux père, Karin Viard est formidable d’énergie et d’effronterie réunies. Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo ont monté la pièce de Petr Zelenka dans une scénographie très imagée, à l’image du zapping à la télévision. Un spectacle efficace, puissant, drôle, dans l’adaptation de Pierre Notte, qui est un témoignage en direct de notre monde individualiste et carnivore.
Wonder woman
Petr Zelenka est un dramaturge et scénariste tchèque. Le monde qu’il décrit, autour du personnage de Véra, une directrice d’agence de casting survoltée, moulée dans sa robe en zigzag rouge, des nattes platine collées autour de la tête, ressemble à une foire d’empoigne ou un ring de boxe, où il faut beaucoup respirer avant d’être envoyé KO. C’est la loi du « marche ou crève », un miroir éclatant du « business » adopté par la nouvelle République Tchèque qui joue à fond la loi de l’offre et de la demande pour embaucher des gens et débaucher le personnel en un quart d’heure. Véra, Karin Viard, n’a pas le temps de souffler car elle a fait fusionner son agence avec un gros groupe londonien. Pour exister au top, elle ment, vire, injurie, manipule, dissimule, jusqu’à accepter de faire passer une jeune actrice pour une call-girl, pour les besoins d’une star de cinéma.
Multiplication des décors et des personnages
A part Karin Viard qui joue Vera de son apogée à sa décadence, deux heures durant, tous les acteurs interprètent plusieurs personnages. Les les costumes et les perruques sont changées rapidement, la vidéo, très présente, multiplie les plans, en noir et blanc ou en couleur, pour diffracter l’image ou l’accélérer, donnant ainsi au spectateur l’impression d’un vertige scénique qui fait se parasiter le virtuel et le réel. Hélène Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza composent une galerie de personnages plus vrais que nature, burlesques et touchants, qui gravitent pour le meilleur et pour le pire autour de Vera. Acteurs cabots, figurants crève la faim, paternel socialiste et amant impuissant, assistante survoltée et docile comme un chien, tous sont broyés et méprisés par l’héroïne dont le désir de puissance et de réussite n’a d’égal que sa déchéance.
Une fable cruelle
La pièce, qui multiplie les points de vue et les séquences à la manière d’un Fassbinder, dessine une société en forme de cirque cruel, farcesque, délirant, qui s’achève dans une décharge publique où vient échouer Véra. On ne révèlera d’ailleurs pas toutes ses aventures, car le rire ici, rabelaisien et caustique, côtoie souvent la mort. Bien sûr, la mise en scène a tendance à rallonger inutilement certaines scènes en forçant le trait, mais le jeu des comédiens, l’engagement total de Karin Viard, généreuse, monstrueuse mais tellement vivante, sont totalement réjouissants. On rit, on est effrayé, on s’interroge : quel est ce miroir tendu par Vera ? Est-ce le nôtre ?
Hélène Kuttner
[Crédits Photos : © Tristan Jeanne-Valès]

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:24 PM
|
Par Julien Avril
Le théâtre peut-il encore être politique ? Je veux dire au sens étymologique : prendre la responsabilité de l’organisation de la vie des hommes dans la cité. Et si oui, est-ce de l’art ?
La réponse de Marie-José Malis à ces questions brille par sa force, sa radicalité, son engagement et son audace. En effet ce qu’elle ose montrer sur le plateau de la Commune d’Aubervilliers avec sa « Pièce d’actualité n°8 – Institution », c’est un geste hautement politique et artistique. Les acteurs du drame qui va se jouer s’avancent. Ils sont ouvriers, comédiens, employés du théâtre, bénévoles… Tous participent à l’École des Actes créée à la Commune en 2016 et qui accueille ceux qui veulent avancer, comme Ntji Coulibaly. Il parle de son foyer de travailleurs immigrés, des groupes de réflexion qui y sont nés sous les menaces d’expulsions et dont l’École des Actes s’inspire. Une volonté de la part des personnes en situation illégale ou de pauvreté, et considérées comme un « problème » par la société, de ne pas attendre de solution de la part des institutions, mais d’unir leurs forces pour améliorer eux-mêmes l’organisation de leur vie collective.
Puis le plateau se vide et les comédiens jouent alors un extrait de Catherine de Sienne de Jakob Lenz. Ntji Coulibaly reste là, comme la marque indélébile du réel dans l’espace. Dans cette scène, deux femmes appellent de leurs vœux le retour du gentilhomme qui seul sait manier la pompe à incendie et saura sauver leur village. La poésie de Lenz issue du mouvement Sturm und Drang allemand, qui place en son centre l’individu, sa liberté et sa sensibilité, apparaît comme archaïque, voire déplacée, dans le contexte créé par l’ouverture du spectacle.
Nous assistons ensuite à la prise de l’espace par l’École des Actes elle-même. Une cinquantaine de personnes déploie tables et chaises, sort papiers et crayons et se met à étudier. La scène de Lenz est reprise, jouée exactement de la même façon, au milieu des élèves imperturbables. Et tout devient limpide. C’est un chant funèbre. Un triste adieu de la metteur en scène au théâtre tel que nous le connaissons. Celui qui fait encore et toujours l’éloge de la liberté individuelle et des sentiments. Nous en avons fini avec ce théâtre, malgré tout l’amour qu’on peut lui porter. Il faut autre chose. Il n’y a pas a espérer l’arrivée de l’homme providentiel, car Ntji Coulibaly le dit lui-même avec humour, il peut très bien actionner aussi la pompe à incendie. Tout le monde le peut.
Puis le groupe d’élèves interrompt son étude et commence une Assemblée Générale. Nous sommes invités à rester, mais pas à participer. Il nous faudrait nous engager dans l’École pour cela. Ceux qui le souhaitent prennent la parole tour à tour, parfois dans leur langue maternelle avec l’aide d’un interprète et partagent leurs réflexions sur la question du travail. C’est magnifique, c’est émouvant et c’est complètement du théâtre : s’identifier à ceux qui sont réellement invisibles et inaudibles et qui pourtant partagent notre quotidien ; prendre en pleine face l’universalité de la condition humaine quand tout les discours tendent à nous diviser les uns les autres ; assister à une forme nouvelle en train de s’inventer.
Marie José Malis appelle à abandonner le théâtre dans ce qu’il peut déployer de puissant car le spectacle de cette puissance est analgésique, voire aliénant. Il empêche d’agir. C’est la crise de la représentation qui est problématisée sur le plateau. Représentation démocratique ou théâtrale, aucune différence. On ne peut représenter ce qui n’a pas encore été réalisé. Alors, puisque le théâtre est le lieu d’où l’on voit, la metteur en scène donne à voir ce qui est en train de s’accomplir. Un groupe qui se réunit, qui étudie et prend la parole pour produire une pensée politique et des écrits, des manifestes. Et par ce geste, elle nous encourage à ne plus être passif, à ne plus déléguer notre pouvoir à ceux qui nous représentent, mais à enfin, plutôt qu’en résistance, entrer vraiment en réalisation. Et j’ai hâte de voir maintenant quel imaginaire, quelle poésie nouvelle naîtra de cette institution.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Julien Avril
Julien Avril est auteur, metteur en scène et dramaturge. Diplômé du Master Professionnel de mise en scène et dramaturgie de l'Université de Nanterre, il a fondé en 2005 la Cie Enascor avec laquelle il a déjà créé trois pièces pour la jeunesse. Il travaille actuellement à la mise en scène de – L'Atome –, forme de théâtre documentaire sur les paradoxes liés à l'énergie nucléaire, pièce lauréate de l'aide à la création du Centre National du Théâtre qui sera créée en novembre 2017 au Liberté - Scène Nationale de Toulon. Il travaille également à l'écriture de – A la Mélancolie – dans laquelle il explore les méandres de la paternité à l'ombre du Titan Cronos, avec le soutien de La Chartreuse-CNES à Villeneuve-lès-Avignon.
http://www.enascor.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 6:00 PM
|
Par Elena Scapatticci dans Le Figaro
Les organisateurs de la 29e édition de la fête annuelle du théâtre français ont annoncé ce mercredi 29 mars la première liste des prétendants.
La liste des nommés aux Molières 2017 a été dévoilée ce mercredi 29 mars. Les grands succès de l'année 2016 sont au rendez-vous, à l'exception notable d'Une Chambre en Inde, d'Ariane Mnouchkine, évincée de la cérémonie suite à une erreur de procédure grossière.
L'énorme succès de la saison, Edmond, d'Alexis Michalik, avec sept nominations, fait d'ores et déjà figure de grand favori pour le théâtre privé. Belle reconnaissance également pour Les Damnés. L'adaptation du film de Luchino Visconti par le metteur en scène belge Ivo van Hove récolte six nominations.
Le Molière du meilleur acteur d'un spectacle de théâtre privé se disputera entre Pierre Arditi (Le cas Sneijder), Jean-Pierre Bacri (Les Femmes savantes), Jean-Pierre Bouvier (La Version Browning) et Guillaume de Tonquédec (La Garçonnière). Chez les femmes s'affronteront Béatrice Agenin (La Louve), Catherine Arditi (Ensemble), Clémentine Célarié (Darius) et Cristiana Reali (M'man).
Côté théâtre public, le choix se fera entre Patrick Catalifo (Timon d'Athènes), Philippe Caubère (Le Bac 68), Laurent Natrella (Les Enfants du silence) et Denis Podalydès (Les Damnés). Romane Bohringer (La Cantatrice chauve), Isabelle Carré (Honneur à notre élue), Françoise Gillard (Les Enfants du silence) et Elsa Lepoivre (Les Damnés) seront en compétition pour le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de Théâtre public.
Nicolas Bedos présentera la cérémonie
Jean-Marc Dumontet, producteur des Molières depuis 2014, s'est réjoui que l'humoriste, comédien et réalisateur Nicolas Bedos ait souhaité présenter pour la troisième fois la cérémonie. Le rendez-vous annuel des professionnels du théâtre se déroulera le 29 mai prochain au Théâtre Les Folies Bergères. On ignore encore quelle pièce précédera la diffusion de la cérémonie, sur France 2.
Liste complète des nominations
Molière du Théâtre privé :
Bigre de Pierre Guillois, Agathe L'Huillier, Olivier Martin-Salvan - Théâtre Tristan Bernard
Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal
La Garçonnière de Billy Wilder et IAL Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris
Les Femmes Savantes de Molière, mise en scène Catherine Hiegel - Théâtre de la Porte Saint-Martin
Molière du Théâtre public :
Karamazov d'après Dostoïevski mise en scène Jean Bellorini - TGP de Saint-Denis
Les Damnés de Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove - Comédie Française
La Grenouille avait raison de James Thierrée Cie du Hanneton
Les enfants du Silence de Mark Medoff mise en scène Anne-Marie Etienne / Théâtre du Vieux Colombier - Comédie-Française
Molière de la Comédie :
Bigre de Pierre Guillois, Agathe L'Huillier, Olivier Martin-Salvan - Théâtre Tristan Bernard
Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal
La Garçonnière de Billy Wilder et Al Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris
Silence, on tourne! de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras mise en scène Patrick Haudecoeur - théâtre Fontaine
Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé :
Pierre Arditi pour Le Cas Sneijder
Jean-Pierre Bacri pour Les Femmes savantes
Jean-Pierre Bouvier pour La Version Browning
Guillaume de Tonquédec pour La Garçonnière
Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé :
Béatrice Agenin pour La Louve
Catherine Arditi pour Ensemble
Clémentine Célarié pour Darius
Cristiana Reali pour M'man
Molière du comédien dans un spectacle du Théâtre public :
Patrick Catalifo pour Timon d'Athènes
Philippe Caubère pour Le Bac 68
Laurent Natrella pour Les enfants du Silence
Denis Podalydès pour Les Damnés
Molière de la comédienne dans un spectacle de Théâtre public :
Romane Bohringer pour La Cantatrice Chauve
Isabelle Carré pour Honneur à notre élue
Françoise Gillard pour Les Enfants du silence
Elsa Lepoivre pour Les Damnés
Molière du Comédien dans un second rôle :
Jean-Paul Bordes dans Vient de paraître
Jacques Fontanel dans La Garçonnière
Pierre Forest dans Edmond
Gilles Privat dans le Temps et la Chambre
Didier Sandre dans Les Damnés
Molière de la Comédienne dans un second rôle :
Evelyne Buyle dans Les Femmes Savantes
Ludivine de Chastenet dans Politiquement Correct
Anne Loiret dans Avant de s'envoler
Dominique Valadié dans Le Temps et la Chambre
Florence Viala dans le Petit-Maître Corrigé
Molière de la Révélation féminine :
Anna Cervinka dans Les Enfants du Silence de Mark Medoff mise en scène Anne-Marie Étienne / Théâtre du Vieux Colombier -
Comédie-Française
Hélène Degy dans La Peur de Zweig, mise en scène Elodie Menant
Delphine Depardieu dans Le Dernier Baiser de Mozart d'Alain Teulié mise en scène Raphaëlle Cambray
Mélodie Richard dans La Mouette de Tchkhov, mise en scène Thomas Ostermeier
Molière de la Révélation masculine :
Fabio Marra dans Ensemble
Christophe Montenez dans Les Damnés de Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove
Matthieu Sampeur dans La Mouette de Tchekhov, mise en scène Thomas Ostermeier
Guillaume Sentou dans Edmond d'Alexis Michalik
Molière de l'auteur francophone vivant :
Nasser Djemaï pour Vertiges
Salomé Lelouch pour Politiquement Correct
Alexis Michalik pour Edmond
Marie Ndiaye pour Honneur à notre élue
Pierre Notte pour C'est Noël tant pis
Gérard Watkins pour Scènes de violences conjugales
Molière du Metteur en scène d'un spectacle de Théâtre public :
Jean Bellorini pour Karamazov
Julien Gosselin pour 2666
James Thierrée pour La Grenouille avait raison
Ivo van Hove pour Les Damnés
Molière du Metteur en scène d'un spectacle de Théâtre privé :
Pierre Guillois pour Bigre
Catherine Hiegel pour Les Femmes Savantes
Alexis Michalik pour Edmond
José Paul pour La Garçonnière
Molière de la Création visuelle :
Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal - décor: Juliette Azzoprdi, costumes: Marion Rebmann, lumière: Arnaud Jung
La Garçonnière de Billy Wilder et IAL Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris - décor: Edouard Laug, costumes: Brigitte Faur-Perdigou, lumière: Laurent Béal
La grenouille avait raison - scénographie: James Thierrée, costumes: Pscaline Chavanne, lumières: Alex Hardellet et James Thierrée
Les Damnés de Visconti - mise en scène Ivo van Hove - scénographie: Jan Versweyveld et Roal Van Berckelaer, costumes: An D'Huys, lumière: Jan Versweyveld et François Thouret
Molière du spectacle musical :
Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand
Les Sea Girls
Oliver Twist, le musical
Traviata
Molière de l'humour :
Dany Boon
François-Xavier Demaison
Gaspard Proust
Vincent Dedienne
Molière du jeune public :
Dormir 100 ans de Pauline Bureau
L'après-midi d'un foehn de Phia Ménard
Le Bossu de Notre Dame mise en scène Olivier Soliveres
Les Fourberies de Scapin mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Molière seul/e en scène :
L'Asticot de Shakespeare avec Clémence Massart
Réparer les vivants avec Emmanuel Noblet
Venise n'est pas en Italie avec Thomas Solivérès
L'Esprit de contradiction avec Camille Chamoux

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2017 5:16 PM
|
Par Aurélie Charon sur le site de son émission "Une vie d'artiste" sur France Culture :
Fellag est né en 1950 en Kabylie. Enfant il est fasciné par Charlie Chaplin, commence le théâtre, devient acteur d'Etat. Il part d'Algérie pendant la décennie noire, menacé. Depuis plus de vingt-ans il raconte sur scène la France et l'Algérie et à travers le rire, soulage les mémoires.
Ecouter l'émission en ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-31-fellag-le-bled-runner
Il est 23h et il faut se méfier des enfants silencieux. A un moment ils vont se mettre à parler. Mohand est un petit garçon discret devenu bavard plus tard. Dans ses montagnes en Kabylie, il prend la parole mais souvent on lui enlève, ca se dérobe, on change sa langue. A la maison on parle berbère, à l’école français, plus tard l’arabe classique. Au début il paraît que ses ancêtres sont les gaulois. Il attend les français au village, il a 5 ans – mais ils sont noirs et musulmans, ce sont des tirailleurs sénégalais. Pas évident de s’y retrouver. Il se met à lire – sa mère se plaint du poids du sac à porter, Victor Hugo c’est lourd. Mohand Fellag grandit, fête l’Indépendance de l’Algérie, observe les noms dans la ville changer, on se donne rendez vous pas rue Michelet mais sur Didouche Mourad, nous sommes à El Djazaïr. Fellag suivra l’école d’acteur, avec des cours sur Stanislavski et Meyerhold, ce sont les bénéfices des choix du gouvernement. Il commence à travailler et apprend à faire du théâtre d’allusions, à ruser, à contourner. Mais dans les années 90 les spectacles mettent sa vie en danger : il part en France. Vingt ans plus tard, dans la salle où il joue en ce moment à Paris ces histoires entre la France et l’Algérie, un soir de printemps en 2017, on entend des hommes et des femmes rire et chuchoter « c’est exactement ça », et puis « c’est tellement ça ». Et le dire de plus en plus fort. C’est le moment où on ne peut pas s’empêcher d’acquiescer, Fellag est sur scène et quelque chose d’important se joue là. Il fait entrevoir ce qu’on aurait pu réussir – il fait apercevoir le possible, les erreurs, les échecs et un espoir. Il nous fait rire, de ce dont une heure après dans la vie on ne rira plus du tout. C’est comme un rire de décompression qui ne dit pas son nom : on rit comme on rougit, d’une incompréhension préalable et même pas prononcée. On rit de cette situation qui a tardé parfois : ne s’être finalement pas rencontrés les uns les autres. On rit de tendresse, de désespoir aussi. Fellag dit qu’il cherche à « soulager la mémoire ». Il fait du bien. Il répète : Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance, on est quitte. Chacun dans le noir se surprend à avoir envie de dire oui, lui taper dans la main et repartir à zéro. Chacun se surprend à se sentir si proche des deux côtés de la Méditerranée. Plus tard on retourne à nos téléphones, nos alertes infos, nos nouvelles pas drôles, mais on a, seul et tous ensemble acquiescé le temps d’une soirée et on sait que : c’est ça, c’est exactement ça, c’est tellement ça.
Fellag, écrivain, conteur. Son spectacle Bled Runner au Théâtre du Rond Point jusqu'au 9 avril.
Son ami l'humoriste, ancien joueur de basket de haut niveau Sami Ameziane alias Le Comte de Bouderbala. Au Théâtre du Gymnase en avril.
LIVE : MELISSA LAVEAUX
Intervenants
Fellag : humoriste et écrivain
Fellag• Crédits photo : Charlotte Spillemaecker

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 5:44 PM
|
Par Nadja Pobel dans Le petit bulletin
Arrivée de Victor Bosch, déprogrammation de certains spectacles de fin de saison... la ville de Décines n'en finit pas de secouer le Toboggan après avoir déjà fait le vide dans la masse salariale et s'être séparée de sa directrice, Sandrine Mini. Le point sur la situation.
Ce pourrait être un épilogue apaisant. Mais il n'en est rien pour l'instant. Victor Bosch arrive au Toboggan comme directeur artistique, réclamé par la municipalité de Décines via l'adjoint à la culture Denis Djorkaeff afin, selon ce dernier, de « faire une programmation en un temps record. »
Son type de contrat n'est pas encore connu, mais il devrait être là dans la durée et a été présenté à l'équipe la semaine dernière. Depuis un an, tout converge pour que Sandrine Mini, directrice depuis 2014 (en poste jusqu'au 30 avril) parte : réduction du budget de 27% par la ville (- 220 000€, voté le 2 février 2016), plan de restructuration drastique, débarquement de deux cadres (sur six) et une ambiance pour le moins intenable, selon les personnes concernées.
En découle une inquiétude quant au devenir de cette salle âgée de vingt ans, qu'un collectif des amis du Toboggan a décidé de soutenir par une pétition ayant recueilli plus de 2500 signatures au printemps dernier. Le procès en incompétence fait à Sandrine Mini, limogée en décembre (sur une question de contrat supposé illégal) dernier a fait flop : elle vient d'être nommée à la tête d'une structure hiérarchiquement supérieure dans les échelons du ministère de la Culture, la Scène nationale de Sète.
L'HOMME PROVIDENTIEL ?
Pendant ce temps-là, au Toboggan, des spectacles sont annulés en cours de saison. Les artistes ont été prévenus en mars, par lettre recommandée signée Denis Djorkaeff, qui nous confirme s'adapter à une réalité économique : « il n'y avait que 38 réservations pour certains spectacles. » Mais la communication n'avait pas encore été enclenchée pour tous, et certaines jauges étaient de seulement cent places.
Exit donc la journée consacrée à l'émergence (Décines-moi la nuit) le 18 mars dernier, avec l'excellent Pas de Bême, remarqué à Avignon et annoncé par nos soins : il n'y a pas eu communication autour de ces annulations. À la benne aussi Never mind the future, hommage aux Sex Pistols prévu le 28 mars et Subliminal de Arcosm le 27 avril.
Thomas Guerry, le chorégraphe de la précieuse compagnie Arcosm, n'a « jamais vu ça. On nous invoque le faible remplissage. Or on a une grande histoire avec le Toboggan, à l'époque de Jean-Paul Bouvet déjà (NdlR, directeur de la salle de son ouverture jusqu'à 2014), on a fait des interventions pédagogiques, on a été présent sur le terrain, ce n'est pas comme si on venait de nulle part. On a joué huit pièces là-bas, dont une série de cinq. On n'a jamais eu de problème de jauge jusque-là. »
Sidéré, il poursuit : « comment peut-on d'un coup se permettre de dire à toute une équipe que c'est fini et les rayer ? C'est incompréhensible. On ne va pas se laisser faire, même si on sait très bien qu'on aura rien en retour. » Car comme dans beaucoup de théâtres, le contrat ne devait être signé qu'un mois avant la représentation.
Alex Potocki, membre du conseil d'administration, représentant des habitants, rappelle que de toute façon, même avec des stars qui remplissent la salle comme François Morel récemment, « nous sommes déficitaires car cette salle ne pratique pas des tarifs prohibitifs qui pourraient exclure des Décinois ou les habitants de l'est lyonnais. »
Comment Victor Bosch va-t-il pouvoir réussir la quadrature du cercle avec un budget dont Denis Djorkaeff nous dit qu'il ne sera pas augmenté ? Certes, l'ancien directeur du Transbordeur va faire bénéficier le Toboggan du réseau qu'il déploie déjà au Radiant-Bellevue, qu'il gère depuis sa rénovation en 2013. La danse contemporaine sera-t-elle encore de la partie, comme le prévoit le label du Toboggan qui, comme une trentaine d'autres salles en France est une "scène conventionnée danse" et reçoit à ce titre une subvention de la DRAC (85 000€ annuels) ? Les missions d'éducation artistique, censées être maintenues, pourront-elles être menées par un homme par ailleurs très occupé ?
Éléments de réponses mi-juin, quand Victor Bosch présentera cette saison que M. Djorkaeff qualifie déjà « de transition ». Les Décinois et les métropolitains sauront alors si cette salle compte garder son niveau d'exigence et d'accessibilité.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 4:33 PM
|
Par Ève Beauvallet dans Libération/Next
Depuis le dévoilement de la 71e édition du Festival d’Avignon, des voix s’élèvent pour dénoncer la présumée «domination post-coloniale» dont aurait fait preuve la direction en n’invitant aucun artiste africain étiqueté «théâtre». Vrai débat idéologique ou vieille querelle esthétique ?
Conférence de presse de Olivier Py pour présenter la 71ème édition du festival d' Avignon, le 22 mars. Photo Boris Horvat.AFP
L’équipe du Festival d’Avignon méprise-t-elle l’Afrique et ses récits ? Ou du moins, la programmation de son «focus Afrique», dans le cadre de la 71e édition du festival témoigne-t-elle d’une forme de paresse intellectuelle et de condescendance postcoloniale ? Les réponses sont plus ou moins tranchées mais les questions fleurissent depuis le dévoilement, mercredi et après plusieurs mois de suspense, du contenu de ce temps fort consacré aux artistes de l’Afrique subsaharienne.
Le directeur du festival, Olivier Py, a eu beau graisser les gonds des portes ouvertes dans son édito, à base de «théâtre-émancipateur-partageur-de-sensible-et-d’altérité», (on résume), une polémique a tout de même émergé. En cause : parmi les neuf spectacles annoncés dans le focus, quatre sont classés dans la catégorie «danse», deux dans celle de l’«indiscipline», trois dans celle de la «musique» (avec les précautions suivantes pour deux d’entre eux : «récit-musique» et «littérature-musique»). Mais aucun dans la catégorie «théâtre». Pas de metteur en scène africain certifié «théâtre de texte», quand le reste de la programmation compte une tripotée de grands écrits classiques ou contemporains (dont ceux de Jonathan Littell et d’Elfriede Jelinek).
«Inviter un continent sans sa parole est inviter un mort»
Une absence que condamnait, sur son blog, le philosophe et dramaturge français Jean-Louis Sagot Duvauroux, qui salue les chorégraphes et musiciens invités au Festival d’Avignon, tout en estimant que «ces quelques pépites ne rendent pas compte du bouillonnement qu’on voit en Afrique aujourd’hui», écrit-il, avant de déplorer le registre dans lequel l’Occident cantonnerait les programmations «Afrique» : «Le théâtre est inexplicablement absent de cette programmation, le théâtre d’autodérision notamment, si important dans le relèvement de ce continent humilié […]. Comme s’il était admis de pleurer sur les malheurs de l’Afrique, qui méritent la compassion autant que tout autres, mais déplacé de se moquer avec elle des vices qu’elle exorcise ainsi.»
Au vu de l’attachement d’Olivier Py pour la parole incarnée, pour les grands récits, certains ont cru le prendre en flagrant délit d’«invisibilisation». En première ligne, le toujours très courroucé Dieudonné Niangouna, auteur et metteur en scène, qui s’enflammait en fin de semaine sur sa page Facebook dans un brûlot à l’encontre de ce Festival d’Avignon dans lequel il n’a pas eu la grâce d’être invité cette année, mais dont il fut l’artiste associé en 2013 (sous la direction d’Hortense Archambault et de Vincent Baudriller). Extrait : «Inviter un continent sans sa parole est inviter un mort. C’est une façon comme une autre de déclarer que l’Afrique ne parle pas, n’accouche pas d’une pensée théâtrale dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Et insister en invitant cette Afrique sous cette forme muselée c’est bien pire qu’une injure. C’est inviter un mort à sa table, lui envoyer toutes les abominations à la gueule, sans se reprocher quoi que ce soit, parce que de toute évidence on sait que le mort ne parlera pas, et c’est bien la raison de cette invitation.» Ce «J’accuse», signé d’un metteur en scène qui taxe parfois de racisme quiconque aurait l’audace de s’ennuyer devant ses pièces, pose-t-il de bonnes questions ? Celle, par exemple, d’une domination culturelle du Nord sur le Sud tellement sédimentée qu’on peinerait à en reconnaître les signaux ?
«Une vision réductrice de la création contemporaine africaine»
Peut-être aurait-ce été le cas si les chorégraphes et musiciens invités cette année par le Festival d’Avignon avaient été des figures mineures de la danse folklorique, des petits chansonniers ou des stars de comédies musicales type le Roi lion, programmés aux côtés des grands pontes de la mise en scène occidentale. Mais on imagine d’ici la réaction d’un chorégraphe de la trempe du très engagé Burkinabè Serge Aimé Coulibaly ou de la Malienne Rokia Traoré (programmée avec un récit de l’épopée mandingue) à la lecture de ces phrases. «On n’invite pas les gens pour se taire. On n’invite pas les gens sans leur parole, écrit Dieudonné Niangouna. On n’invite pas un morceau de terre sans ses poètes.» Plus loin : «Mais enfin, sommes-nous revenus à l’époque d’Hérodote où l’on disait que le noir n’est que bruit, son et tam-tam ? […] On ne peut pas saboter le sens pour continuer à droguer le plaisir et agiter des oriflammes sous des couleurs africaines c’est bêtement honteux.»
Les attaques violentes formulées à l’égard de ces choix de programmations témoignent au mieux d’un manque d’informations flagrant sur les projets programmés, au pire d’une conception pour le moins rance de la hiérarchie entre les disciplines basées sur une dichotomie corps-esprit qu’on aurait cru enterrée. Joint par téléphone, Jan Goossens, reconnu pour sa connaissance de la scène artistique africaine, une scène avec laquelle il travaille depuis des années (hier au KVS de Bruxelles, aujourd’hui au festival de Marseille qu’il dirige), se dit de son côté «à la fois respectueux du travail de Dieudonné Niangouna, à la fois très perturbé par cette vision extrêmement réductrice de la création contemporaine africaine. Sa vision de l’art dramatique comme lieu exclusif du texte littéraire (une tradition plutôt française) n’est pas du tout centrale en Afrique où les traditions font plus de place au mouvement, au chant, aux traditions orales bien sûr. Le texte littéraire sur les plateaux n’est venu qu’avec les projets coloniaux», rappelle-t-il à quelques jours d’annoncer publiquement le contenu du prochain festival de Marseille (du 15 juin au 9 juillet), adossé au focus Afrique d’Avignon. Au vu de cette réalité, le focus me semble légitime. Est-ce qu’il est complet ? Je ne pense pas que ce soit l’idée. Il est complémentaire avec ce qui a déjà pu être présenté au Festival d’Avignon en 2013, par exemple, lorsque Dieudonné Niangouna était artiste associé. Mais dire que des artistes comme Serge Aimé Coulibaly ou Dorothée Munyaneza ne sont pas des représentants légitimes du théâtre africain contemporain, c’est comme dire qu’Alain Platel ou Jan Lauwers ne sont pas des représentants légitimes du théâtre contemporain flamand».
Ève Beauvallet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 3:33 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart
Artiste associée au Théâtre national de Strasbourg auprès de Stanislas Nordey, Christine Letailleur le met en scène dans « Baal », une pièce du jeune Brecht dans sa version de 1919, la plus folle, traduite par Eloi Recoing. Une belle équipe d’acteurs au service d’une pièce ivre de poésie.
Baal ! Le double a n’est pas de trop. Il s’étire et se prolonge tout au long du spectacle. Il déchire la gorge de ceux qui aiment Baal sans retour : Emmi, la femme de son ex-employeur, la jeune Sophie Dechant, bien baisées, engrossées et mal aimées, d’autres encore, et son ami le musicien Ekart... Tous lancent son sombre nom dans la nuit obscure où ils vont, errants, souvent éperdus. Un long râle qui s’amplifiant vire au brame, âcre cri d’amour animal, Baaaaaaaaaal. Ces cris qui pleurent comme des larmes, Baal ne les entend pas, ou ne veut pas les entendre ; la gorge et le ventre lourds d’alcool, il va de l’avant à l’aveugle, les yeux fascinés par les couleurs du ciel, déjà ailleurs sans autre but que la nuit de l’ivresse pour mieux s’enfoncer dans l’ombre de la forêt aux odeurs faisandées, antre de la mort.
La poésie avant toute chose
Baaaaaaal… Cette plainte est aussi un chant, une complainte, une sale légende brodée d’or qu’il entretient de routes en estaminets. Un sale type, un misogyne, un bousilleur de femmes assurément, mais un être entier, sans compromis, sans faux-semblant. Un authentique poète. Ses visions sont celles d’un poète. Alors on lui pardonne tout. On l’appelle, on veut entendre sa poésie.
Ce que retient Christine Letailleur qui met en scène Baal de Bertolt Brecht, c’est d’abord cela : sa langue, sa poésie. Chantant l’amour : « Et l’amour est comme quand on laisse flotter son bras dans l’eau glacée d’un étang, avec des algues entre les doigts, comme le doux supplice devant qui l’arbre entonne son chant grinçant chevauché par le vent fou. » Chantant son désir de poésie : « Je veux faire naître quelque chose ! Je dois faire naître quelque chose ! Mon cœur bat à tout rompre. Mais parfois, assourdi comme les pas d’un cheval, tu sais ! La senteur des folles nuits de mai est en moi. » Chantant l’amour, l’ivresse et le ciel : « Je suis ivre et tu chancelles. Le ciel est violacé, à nous la balançoire, Malaga et Madère dans le ventre et le ciel est violacé. Je t’aime. »
C’est une pièce de jeunesse du très jeune Brecht en blouson de cuir, fasciné par l’écriture et la vie de Frank Wedekind dont Letailleur avait monté il y a quelques années avec maestria une pièce méconnue, Le Château de Wetterstein (lire ici). Brecht écrit Baal d’un jet à 20 ans, en 1918, peaufine la pièce l’année suivante puis la reprendra, la rabotera jusqu’en 1955 ; il mourra l’année suivante. Christine Letailleur choisit la version de 1919 superbement traduite par Eloi Recoing il y a dix ans pour la mise en scène qu’en donna alors Sylvain Creuzevault avec la troupe de sa compagnie D’ores et déjà aujourd’hui en partie dispersée. Le désir qu’a Christine Letailleur de monter cette pièce dans cette version-là est inséparable du choix de l’acteur qui en joue le rôle-titre : Stanislas Nordey, un acteur qu’elle a plusieurs fois dirigé.
La loi du marcheur
Le physique de Baal tel que le décrit Brecht dès la dédicace à son ami Orge est celui d’un type qui a passé la trentaine et est physiquement « plutôt gâté par la nature ». Et pas mal atteint, nous dira le timide Johannes : « Tes dents sont celles d’une bête : gris jaune, énormes, inquiétantes. » Ce n’est pas du tout le cas du maigrelet Nordey, jeune quinquagénaire racé, qui semble même avoir perdu quelques kilos depuis qu’il dirige le Théâtre national de Strasbourg, menant plusieurs vies en une. Ce qui les rassemble, c’est leur façon de muscler la langue. L’un dans l’écriture, l’autre dans la profération.
Nordey, ce grand amoureux des textes, aime détacher les phrases pour mieux les savourer, il en ralentit le débit pour mieux nous les faire entendre, et il accompagne cela d’une gestuelle des bras et des mains qui orchestre l’émission des mots. Le texte, le poème y retrouve son état naissant. Et comme Baal passe son temps à marcher sans trop savoir où il va, le poème s’invente en marchant et la pièce lui emboîte le pas, si je puis dire. L’ivresse et les femmes brouillent le jeu, non la poésie. Nordey, Letailleur et Baal ne font qu’un lorsque ce dernier proclame : « Je déteste l’exaltation romantique. »
Il y a du Alceste (Le Misanthrope), du Octave (Les Caprices de Marianne) et du Peer Gynt dans Baal, il y a surtout du Rimbaud dans ce Baal-là: Brecht avait dévoré sa poésie. C’est une époque où il écrivait des vers en pagaille, certains admirables. Lui aussi aurait pu écrire « Ô mes petites amoureuses, / Que je vous hais ! / Plaquez de fouffes douloureuses / Vos tétons laids ! ». Lui aussi s’est « baigné dans le Poème ». Baal rêve du Bateau ivre.
Le fantôme de la mère
Alors Letailleur pousse l’errance dans une nuit de plus en plus envahissante, peuplée d’ombres portées de plus en plus gigantesques (comme si la mise en scène devenait, elle aussi, sujette aux troubles de l’ivresse). Pas de décor où l’œil pourrait s’arrêter sur des détails, des objets, hormis la divine bouteille, mais des murs que l’on longe, des escaliers conduisant à une passerelle, une circulation incessante ponctuée par des arrêts aux auberges (un cadre sur le côté) ou au cabaret (un cadre de scène au fond) avec des ombres chinoises.
Le tenancier du cabaret, sentant la bonne affaire face au type désargenté, essaie d’acheter Baal en monnayant son originalité. Baal enverra tout balader, comme il l’avait déjà fait lors de la scène d’ouverture de la pièce dans un salon bourgeois où on le courtisait. La seule femme qui l’ébranle sans pour autant avoir prise sur lui, c’est sa mère. Dans la mise en scène de Letailleur, elle apparaît tel un fantôme, tenant une bougie à la main, de dos, sans visage, sans regarder son fils qui, lui, la regarde de biais, comme l’image d’une obsession, peut-être d’un remords, le seul.
Toute la distribution est au petit poil. L’ami Ekart, c’est Vincent Dissez (artiste associé au TNS) qui sait faire affleurer l’amour, y compris sexuel, qu’il porte à son ami, un amour réciproque ; un coup de couteau tend à le prouver. Johannes, c’est Youssouf Abi-Ayad, sorti de l’école du TNS tout comme Emma Liégois jouant sa fragile fiancée qui tombe sous le charme de Baal et n’y survivra pas, laissant son compagnon se noyer dans l’ivresse, doublure ruinée de son mentor. Sophie Dechant, c’est Karine Piveteau, sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne, actrice fétiche de Simon Gauchet (lire ici). Emmi, la femme éperdue du chef de Bureau, c’est Valentine Gérard, venue de Belgique tout comme Fanny Blondeau, à la fois Louise la serveuse de l’auberge et Anna la dernière fiancée de Baal. Familiers des spectacles de Christine Letailleur, Manuel Garcie-Kilian, Philippe Cherdel et Richard Sammut se partagent les autres rôles avec Clément Barthelet.
Dernière salve de Baal traduite par Eloi Recoing : « Nous sommes libres, plus rien ne nous oblige. Nous pouvons par exemple dormir dans le foin ou bien à ciel ouvert... ou pas du tout. Nous pouvons nous promener. Nous pouvons chanter. Nous avons des rêves devant nous. Nous pouvons aussi ne pas y regarder de trop près. Ou pour mieux dire crever. »
Théâtre national de Bretagne, 20h, jusqu’au 31 mars ;
Théâtre national de Strasbourg, du 4 au 12 avril ;
Théâtre national de la Colline en collaboration avec le Théâtre de la Ville, du 20 avril au 20 mai ;
Maison de la Culture d’Amiens, les 23 et 24 mai.
La traduction d’Eloi Recoing vient de paraître à L’Arche Editeur, 96 p., 11€.
Photo : Scène de "Baal" © Brigitte Enguerand

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2017 3:24 PM
|
Emission de la Dispute d'Arnaud Laporte en réécoute sur le site de France Culture
Au menu de cette dispute: "Vera" au théâtre des Abbesses, "L'état de siège" à l'espace Pierre Cardin, et le DVD 1789 d'Ariane Mnouchkine. Avec la participation de Marie-José Sirach, Anna Sigalevitch, Lucile Commeaux et Arnaud Laporte.
Ecouter l'émission : https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/spectacle-vivant-vera-letat-de-siege-1789
"Vera" de Petr Zelenka,
Mis en scène par Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo au Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses jusqu’au 8 avril.
Karin Viard joue Vera, une directrice de casting flamboyante grisée par le succès… Une comédie d’une féroce actualité qui mêle méchanceté et burlesque.
Petr Zelenka, talentueux auteur venu du pays de Kafka, manie brillamment le comique et le tragique, l’humour noir et le burlesque, pour raconter la descente aux enfers d’une femme que rien ne semblait pouvoir arrêter sur la route du succès. Argent, pouvoir, médiatisation, statut social, tout peut s’acquérir si l’on joue le jeu. Mais Vera, la redoutée directrice de casting jouée par Karin Viard, aveuglée par sa réussite, devient une marionnette dans les mains de ceux à qui elle s’est vendue et perd tout ce qu’elle croyait avoir gagné. Une danse macabre, impitoyable et drôle, qui raconte l’air du temps, la violence de l’ultralibéralisme, la perte des repères, la folie de l’aveuglement. Une satire efficace et bienvenue, racontée par six acteurs jouant plus de vingt rôles. Un auteur peu connu en France à découvrir d’urgence.
[Jean-François Perrier]
"L’état de siège" d’Albert Camus,
Mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota, au Théâtre de la Ville - Espace Pierre Cardin (jusqu’au 1er avril puis en tournée).
La ville au bord de la mer est étrangement paisible. Il ne s’y passe rien et le Gouverneur s’en réjouit. Le marché bat son plein, des comédiens répètent… Tout à coup, l’un d’eux s’effondre. Deux médecins diagnostiquent la peste. Un homme arrive, accompagné de sa secrétaire, il exige la place du Gouverneur : « Je suis la Peste », déclare-t-il.
L’état de siège est proclamé… La Terreur s’installe.
Aux « songeries du “vieux monde” », la Peste apporte l’ordre, la logique fonctionnelle de l’organisation, de l’administration, des listes, des fiches, des statistiques, de l’inquisition, de la persécution. Tout ce dont la Peste est le symptôme ou le nom !
Jusqu’à ce que la révolte s’organise, menée par un jeune homme : Diego.
Jusqu’à ce que le vent de la mer se lève…
Cette pièce rare, créée en 1948 par Jean-Louis Barrault, développe une allégorie multiple, teintée de fantastique, sur les régimes corrompus, autoritaires, fascisants. Albert Camus, dont les références furent souvent le théâtre espagnol de l’Âge d’or (Calderón, dont il a adapté certaines pièces) déclarait à son propos : « Mon but avoué était d’arracher le théâtre aux spéculations psychologiques et de faire retentir sur nos scènes murmurantes les grands cris qui courbent ou libèrent aujourd’hui des foules d’hommes. »
[François Regnault, théâtre de la ville]
Tournée : du 25 avril au 6 mai 2017 au TNB de Rennes ; Oct.-nov. 2017 : BAM, New-York ; Cal Performances, Berkeley ; UCLA, Los Angeles ; Centre national des art, Ottawa-Canada; Février 2018 : Luxembourg
"1789" d’Ariane Mnouchkine et la troupe du Théâtre du Soleil (dvd et bluray disponibles chez BelAir Classiques - filmé en 1973 à la Cartoucherie de Vincennes)
DVD "1789" Ariane Mnouchkine Théâtre du Soleil (Bel Air classiques)•
Au lendemain de la fusillade du Champ-de-Mars du 17 juillet 1791, des bateleurs entreprennent de jouer les principaux évènements des deux années qui viennent de s’écouler : de la réunion des Etats généraux à la proclamation de la loi martiale, en passant par la prise de la Bastille, la Grande Peur, et la nuit du 4 août. Dans une grande liesse populaire, ils tentent de montrer le détournement des espoirs, l’explosion de la joie puis l’effondrement du rêve d’égalité des droits. Pour ce faire, les bateleurs utilisent toutes les formes théâtrales, de la pantomime à la tragédie, des marionnettes à l’opéra-bouffe. Ils représentent ainsi les personnages importants ou humbles de cette année décisive et prennent à leur compte la phrase de Saint-Just : «La Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur.» [BelAir classiques]
Coup de fil à une scène nationale:
- Laurent Cogez, metteur en scène du collectif Colette, pour le spectacle Pauline à la plage d’après Eric Rohmer à la Scène nationale 61 à Alençon, les 5 et 6 avril prochains
Le Petit salon de Lucile Commeaux
Tous les jours aux alentours de 21h20 les critiques de la Dispute passent au Petit Salon pour discuter d’un sujet de l’actualité culturelle – nouvelles têtes, polémiques, querelles esthétiques. À retrouver ici.
Chroniques
21h20
12min
Le Petit Salon
Des Mouettes partout
Podcast
Intervenants
Anna Sigalevitch
Marie-José Sirach : Journaliste au journal L'humanité

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2017 10:35 AM
|
L’auteur du message pour 2017 est Isabelle Huppert, l'actrice française de théâtre et de cinéma.
Voici donc 55 ans que chaque année au printemps une Journée Mondiale du Théâtre à lieu. Une journée, c’est à dire 24 heures qui commencent du côté du théâtre NO et du Bunraku, qui passent par l’Opéra de Pékin et le Kathakali, s'attardent entre la Grèce et la Scandinavie, d'Eschyle à Ibsen, de Sophocle à Strinberg, entre l'Angleterre et l'Italie, de Sarah Kane à Pirandello, et aussi la France entre autres, où nous sommes et où Paris est tout de même la ville du monde qui reçoit le plus de troupes étrangères. Ensuite nos 24 heures nous mènent de la France en Russie, de Racine et Molière à Tchékhov, puis traversent l’Atlantique pour finir dans un campus californien où des jeunes gens réinventent peut-être le théâtre. Car le théâtre renait toujours de ses cendres. Il n'est que convention qu'il faut inlassablement abolir. C'est ainsi qu'il reste vivant. Le théâtre a une vie foisonnante qui défie l’espace et le temps, les pièces les plus contemporaines sont nourries par les siècles passés, les répertoires les plus classiques deviennent modernes chaque fois qu’on les monte à nouveau.
Une Journée Mondiale du Théâtre, ce n’est évidemment pas une journée au sens banal de nos vies quotidiennes. Elle fait revivre un immense espace-temps et pour évoquer l’espace-temps, je voudrais faire appel à un dramaturge français, aussi génial que discret, Jean Tardieu. Je le cite : « Pour l’espace, il demande quel est le plus long chemin d’un point à un autre... Pour le temps il suggère de mesurer en dixième de secondes le temps qu'il faut pour prononcer le mot «éternité». Pour l'espace-temps il dit aussi : «Fixez dans votre esprit avant de vous endormir deux points quelconques de l'espace et calculez le temps qu'il faut, en rêve, pour aller de l'un à l'autre.» C'est le mot «en rêve» que je retiens. On dirait que Jean Tardieu et Bob Wilson se sont rencontrés. On peut aussi résumer notre jour mondial du théâtre en se souvenant de Samuel Beckett qui fait dire à Winnie dans son style expéditif : «Oh le beau jour que ça aura été.» En songeant à ce message qu'on m'a fait l'honneur de me demander, je me suis souvenue de tous ces rêves de toutes ces scènes. Ainsi je n’arrive pas toute seule dans cette salle de l’UNESCO, tous les personnages que j’ai interprétés sur scène m’accompagnent, des rôles qu’on a l’air de quitter quand c’est fini, mais qui mènent en vous une vie souterraine, prêt à aider ou à détruire les rôles qui leur succéderont : Phèdre, Araminte, Orlando, Hedda Gabbler, Médée, Merteuil, Blanche Dubois... M’accompagnent aussi tous les personnages que j'ai aimés et applaudis en spectatrice. Et là j’appartiens au monde entier. Je suis grecque, africaine, syrienne, vénitienne, russe, brésilienne, perse, romaine, japonaise, marseillaise, new yorkaise, philippine, argentine, norvégienne, coréenne, allemande, autrichienne, anglaise, vraiment le monde entier. La vraie mondialisation elle est là.
En 1964 à l'occasion de cette journée du théâtre, Laurence Olivier annonçait qu'après plus d'un siècle de combat, on venait enfin de créer en Angleterre un théâtre national, dont il avait aussitôt voulu que ce soit un théâtre international, au moins par son répertoire. Il savait bien que Shakespeare appartenait à tout le monde dans le monde.
J’ai aimé apprendre que le premier message de ces Journées Mondiales du Théâtre en 1962 a été confié à Jean Cocteau, tout désigné puisqu’il est, n’est-ce pas, l’auteur d’«un tour du monde en 80 jours». J’ai fait le tour du monde différemment, je l’ai fait en 80 spectacles ou 80 films. Je dis films aussi car je ne fais aucune différence entre jouer au théâtre et jouer au cinéma, ce qui surprend à chaque fois que je le dis, mais c’est vrai, c’est comme ça. Aucune différence.
En parlant ici je ne suis pas moi-même, je ne suis pas une actrice, je suis juste l'une des si nombreuses personnes grâce à qui le théâtre continue d’exister. C'est un peu notre devoir. Et notre nécessité: Comment dire: Nous ne faisons pas exister le théâtre, c'est plutôt grâce à lui que nous existons. Le théâtre est très fort, il résiste, il survit à tout, aux guerres, aux censures, au manque d’argent. Il suffit de dire «le décor est une scène nue d’une époque indéterminée» et de faire rentrer un acteur. Ou une actrice. Que va-t-il faire ? Que va-t-elle dire ? Vont-ils parler ? Le public attend, il va le savoir, le public sans lequel il n'y a pas de théâtre, ne l'oublions jamais. Une personne dans le public c'est un public. Pas trop de chaises vides quand même ! Sauf chez Ionesco... À la fin la Vieille dit : « Oui oui mourons en pleine gloire ...Mourons pour entrer dans la légende... Au moins nous aurons notre rue... »
La Journée Mondiale du Théâtre existe depuis maintenant 55 ans. En 55 ans je suis la huitième femme à qui on demande de prononcer un message, enfin je ne sais pas si le mot "message" convient. Mes prédécesseurs (le masculin s'impose!) parlent à propos du théâtre d’imagination, de liberté, de l'origine, ont évoqué le multiculturel, la beauté, les questions sans réponses... En 2013 il n'y a donc que quatre ans Dario Fo dit : «la seule solution à la crise, réside dans l’espoir d’une grande chasse aux sorcières contre nous, surtout contre les jeunes qui veulent apprendre l’art du théâtre : ainsi naîtra une nouvelle diaspora de comédiens, qui tirera sans doute de cette contrainte des bénéfices inimaginables par une nouvelle représentation.» Les bénéfices inimaginables c'est une belle formule digne de figurer dans un programme politique non ?... Puisque je suis à Paris peu avant une élection présidentielle je suggère à ceux qui ont l'air d'avoir envie de nous gouverner d'être attentifs aux bénéfices inimaginables apportés par le théâtre. Mais pas de chasse aux sorcières !
Le théâtre pour moi c’est l’autre, c'est le dialogue, c'est l'absence de haine. L'amitié entre les peuples, je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais je crois dans la communauté, dans l'amitié des spectateurs et des acteurs, dans l’union de tous ceux que le théâtre réunit, ceux qui l'écrivent, ceux qui le traduisent, ceux qui l'éclairent, l'habillent, le décorent, ceux qui l'interprètent, ceux qui en font, ceux qui y vont. Le théâtre nous protège, nous abrite... Je crois bien qu'il nous aime... autant que nous l'aimons... Je me souviens d'un vieux régisseur à l’ancienne, qui avant le lever du rideau, en coulisses, disait chaque soir d'une voix ferme : « Place au théâtre ! » Ce sera le mot de la fin. Merci.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2017 7:59 AM
|
Par Lisa Burek dans Le Monde
Le théâtre, laboratoire urbain de participation citoyenne ? Depuis 2013, la compagnie stéphanoise « Collectif X » monte des spectacles avec les habitants afin de réfléchir à l’avenir de leur quartier.
« Quand on arrive dans un quartier, on essaye de le comprendre. » Arthur Fourcade n’est pas urbaniste mais comédien et metteur en scène au sein de la compagnie de théâtre stéphanoise Collectif X, ce qui ne l’empêche pas de mener une « réflexion sur le devenir de sa ville ».
A chaque quartier sa problématique urbaine, à chaque citadin sa vision de la ville. Depuis 2013, dans le cadre de son projet « Villes », la troupe arpente les quartiers, rencontre ceux qui y résident, joue cette vie locale sur les planches sous forme de spectacles dont les répliques et le scénario sont directement inspirés des propos des habitants.
Dans la compagnie d’une vingtaine de personnes, on trouve des comédiens mais aussi un maître de conférences à l’Ecole d’urbanisme de Paris et un diplômé de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, département « génie civil et urbanisme ». Car la démarche se veut aussi scientifique. Yoan Miot, co-metteur en scène du projet et urbaniste, a établi « un outil d’enquête sociale » en quatre temps : une balade urbaine pour connaître le quartier, des entretiens avec les habitants sur leur vie quotidienne, puis un « chœur public » où chacun peut inscrire sa définition de la ville sur des panneaux. Enfin des débats sont organisés sur un sujet qui suscite la polémique dans le quartier.
Pendant un mois, les comédiens mènent scrupuleusement cette « enquête ». Ils recueillent les histoires des résidents puis les mettent en scène. A la fin, ils présentent le portrait du quartier dans le cadre de deux ou trois représentations. Que ce soit au contact des acteurs locaux, dans les centres sociaux ou les écoles, au hasard de rencontres dans la rue ou grâce au bouche-à-oreille, la bande « tente de recueillir les paroles les plus diverses possible pour construire une superposition de discours du quartier, parfois contradictoires, parfois convergents, explique Arthur Fourcade. Et faire entendre ceux qui n’ont pas forcément l’occasion de s’exprimer dans l’espace public ».
Participer ? Réfléchir sur la ville, aussi. « Le théâtre est un bon moyen pour aborder des sujets sérieux comme la politique urbaine », raconte Hervé Ménard, habitant du quartier Tarentaize-Beaubrun-Severine, à l’ouest de Saint-Etienne, qui a participé aux débats. « La transposition de leur vie en jeu théâtral aide les gens à s’impliquer et à dialoguer », constate Arthur Fourcade.
L’initiative culturelle se veut un outil de participation citoyenne dans l’élaboration des politiques urbaines. En janvier 2017, la ville de Billom, à une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, a fait appel aux comédiens dans le cadre d’une étude sur le logement en centre-ville. Sur une durée plus courte, la troupe y a expérimenté les mêmes méthodes qu’à Saint-Etienne. Le mercredi 22 mars, une représentation finale était ouverte aux Billomois. « J’étais un peu inquiet au début, raconte Jacques Fournier, adjoint au maire à l’urbanisme, l’environnement et les patrimoines. Mais au final, le projet a permis de connaître ce que pensent les habitants de manière plus diversifiée que lors de réunions “sérieuses” qui n’intéressent pas beaucoup les gens et où ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. »
Arthur Fourcade, prudent, voit la troupe comme « un organe de médiation » qui n’est pas là pour « conclure ou influencer la décision des élus ». Pour le Stéphanois Hervé Ménard, ce sont les récits joués sur scène qui l’ont marqué : « Un peu comme des interviews de grands personnages à la radio. Sauf que là, c’était les tranches de vie de nos voisins. »
Smart Cities : « Le Monde » décrypte les mutations urbaines
Le Monde organisera vendredi 7 avril à Lyon une journée de débats sur le thème « Gouverner la ville autrement : les villes peuvent-elles réenchanter la démocratie ? ». Entrée gratuite sur inscription ici.
A cette occasion, Le Monde récompensera avec ses partenaires les lauréats de la deuxième édition des Prix européens de l’innovation Le Monde-Smart Cities pour leurs projets innovants améliorant la vie urbaine. Les candidatures aux prix internationaux (hors Europe) sont encore ouvertes.
Retrouvez l’actualité des villes décryptée par les journalistes du Monde dans la rubrique « Smart cities » sur Lemonde.fr. : http://www.lemonde.fr/smart-cities/
Lisa Burek
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2017 7:41 AM
|
Entretien mené par Nedjma Bouakra pour A voix nue. Cinq épisodes d'une demie heure en réécoute sur le site de France Culture.
Depuis plus de 35 ans, l’oeuvre chorégraphique de Maguy Marin s’est imposée comme majeure et incontournable sur la scène mondiale. Refusant les étiquettes, la chorégraphe est une tête chercheuse, elle ouvre la danse à toutes les grammaires de l’art, vocale, musicale, verbale et plastique.
Par Nedjma Bouakra. Réalisation : Laurent Paulré. Prise de son : Jord Robert. Attachée de production : Claire Poinsignon.
Il y eut La jeune fille et la mort en 1979. Une pièce chrysalide, pour une apprentie chorégraphe. Un concours à Nyon puis celui de Bagnolet. Tous deux gagnés. Maguy Marin sort de la tutelle de Maurice Béjart, pour devenir chorégraphe, le maître l’a émancipée de la danse corsetée avec l’École Mudra.
Elle fonde alors le Ballet-théâtre de l’arche avec Daniel Ambash. May Be, pièce inspirée de Fin de partie de Samuel Beckett, d’abord mal reçue fera le tour du monde. May Be et son chœur anachronique, vacillant, pris dans des pulsions grégaires, qui parfois opine du chef, se mord, se ravise, se disloque, un chœur rassemblé ou divisé, affecté par une musique carnavalesque.....
Et puis cette commande, juste trois ans plus tard, de l’Opéra de Paris, Cendrillon de Prokofiev, et la consécration en 1985 car ce fut un immense succès. Avec cette œuvre, véritable pavé dans la mare, la "nouvelle danse" prend son envol.
Époque étonnante, l’expérimentation se pratique non à la marge mais au cœur d’une dynamique impulsée tant par les jeunes chorégraphes que par le ministère de la culture et les toutes nouvelles infrastructures dans les régions que sont les Centres chorégraphiques nationaux : Maguy Marin vit l’âge d’or de la Danse.
Intervenants
Maguy MARIN,

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2017 6:13 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog Hottello
Paul de Musset qui lit ce proverbe à Venise en 1845 écrit dans Biographie :
« Je reconnaissais, d’ailleurs, les personnages. Celui du Comte était si ressemblant que de loin, je voyais mon frère prenant son chapeau à chaque coup de sonnette, laissant la porte entr’ouverte, et ne pouvant se décider à rester ni à sortir… »
Dans la réalité, la marquise resta veuve et le poète s’en alla en fermant la porte. Mais la porte close finale de la comédie signe l’aboutissement initiatique amoureux.
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, proverbe d’Alfred de Musset – prétexte littéraire d’un genre mondain scénique – est publié dans La Revue des Deux-Mondes en 1845, représenté à la Comédie-Française et édité dans Comédies et Proverbes.
Dans la fiction, le Comte se rend chez la Marquise qui reçoit dans son salon, comme à son habitude, tel jour de la semaine, un après-midi d’hiver. Or, hasard heureux ou préparé habilement, au lieu d’être un parmi d’autres habitués, le galant est le seul visiteur à se présenter chez la dame, ce jour-là, avec mauvais temps à l’extérieur.
Conversation badine, joute verbale à la fois ludique et tendue à l’extrême, confrontation du désir implicite de chacun des locuteurs, volatilité des acquiescements et refus, la pièce s’achève effectivement sur une porte qui se ferme, mais avec les fiançailles des deux amants en perspective pour un mariage prochain.
Pour le metteur en scène Laurent Delvert, la pièce porte un éclairage facétieux sur une reconversion à l’amour dans l’abandon fragile de soi pour se livrer en entier.
Ce petit drame, qui oscille entre légèreté et gravité, tend à saisir ce « moment amoureux du temps suspendu » à travers les mouvements libres des répliques.
La teneur malicieuse et grave du drame intérieur des partenaires évolue, les minutes passant, selon un mélange instinctif de cœur et d’esprit, entre humour et fantaisie, selon la sourdine d’un parler spontané aux mots délicats et aux élans furtifs.
La Marquise taquine conduit le Comte à sa propre reconnaissance pour qu’il amorce d’un pas lucide et sincère le chemin libératoire d’une existence nouvelle.
Un joli traitement du motif amoureux : à la lassitude du Comte qui reproche à la Marquise de traquer le neuf contre la banalité de ce qu’elle nomme des « refrains », répond la présence de la Vénus éternelle de Milo installée dans le salon : « …c’est aussi toujours la même chose ; en est-elle moins belle, s’il vous plaît ? Si vous ressemblez à votre grand-mère, est-ce que vous en êtes moins jolie ? »
La scénographie de Philippine Ordinaire est d’autant plus amusante que la Marquise, dame bien née et bobo d’aujourd’hui, est observée en tant qu’artiste, malaxant de l’argile avec de l’eau déversée d’un seau pour donner forme à sa sculpture aboutie :
« Cette Vénus est faite pour être belle, pour être aimée et admirée, cela ne l’ennuie pas du tout… », dit le Comte, se moquant de celle qui prétend ne pas vouloir entendre parler d’amour alors qu’elle porte en même temps de la dentelle.
Le jeu atemporel des discours amoureux jamais ne passe de mode ni ne vieillit.
Christian Gonon pour le Comte et Jennifer Decker pour la Marquise se plient fidèlement à l’exercice, en connaisseurs avertis de l’âme et de sa petite musique.
Véronique Hotte
Studio-Théâtre de la Comédie-Française, du 23 mars au 7 mai. Tél : 01 44 58 98 58
Photo : Crédit photo : Brigitte Enguérand Coll. Comédie-Française
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...