 Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 10:31 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog Le Grand Théâtre du monde :
Dans la salle Jean-Bouise du TNP, la compagnie Théâtre en pierres dorées présente la délicieuse comédie dans une mise en scène de Julien Gauthier, interprète du rôle-titre. Il est très bien entouré.
On les connaît ! On les connaît presque tous. La plupart sont issus de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), l'ancienne rue Blanche désormais sise à Lyon. La plupart ont travaillé dans la troupe créée par Christian Schiaretti. La plupart ont par ailleurs frayé leur propre chemin. Mais ils ne sont jamais loin les uns des autres.
C'est dans doute l'un des secrets de cette très séduisante production du Menteur de Pierre Corneille. Ils se connaissent, ils sont une troupe de fait. Laurence Besson, Amandine Blanquart, Clément Carabédian, Julien Gauthier, Damien Gouy, Rafaèle Huou, Clément Morinière, Juliette Rizoud, Julien Tiphaine.
Ils ont la trentaine. Ils sont brillants. Ils ont été à très bonne école, à l'ENSATT ou au Studio 34, ils ont travaillé avec des metteurs en scène exigeants, amoureux de la haute littérature, de la langue, du bien dire. De Christian Schiaretti à Bernard Sobel, mais également avec des gens de leur génération.
Ce Menteur est l'une des productions inscrites dans le cycle des "résidences de création" voulu par la direction du TNP. Après, entre autres un Roméo et Juliette par Juliette Rizoud, ou un spectacle signé Olivier Balazuc, voici une production de la jeune compagnie "Théâtre en pierres dorées" qui tire son nom d'un bel endroit du Beaujolais où Damien Gouy et ses amis ont créé un festival il y a quelques années. Le festival de Theizé.
C'est avec leurs propres deniers de compagnie, le soutien d'Agnès B. (pour les costumes) et la mise à disposition des équipements du TNP que les neuf ont monté ce délicieux spectacle.
Le Menteur a de quoi séduire. On le connaît. La pièce n'est pas très souvent jouée. Elle a été crée en 1643 au Théâtre du Marais, avec beaucoup de succès. Mais elle provoqua une polémique qui conduisit Corneille à écrire La suite du Menteur. Le jeune héros y est jugé plus sévèrement.
On avait vue cette pièce il y a longtemps et on n'oublie pas Richard Fontana, qui était Dorante, dans la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie-Française. 1986 ? Il y a quelques années, à Hébertot, théâtre privé, Dorante était joué par Nicolas Vaude dans une mise en scène de Nicolas Briançon et dans des costumes modernes.
Avec Julien Gauthier, on est encore plus près de notre temps. Les costumes des garçons, les robes des filles, ou la jupe et le petit chemisier de Clarice, sont signés Agnès B. Et cela nous va très bien car les atermoiements du menteur sont éternels...Et parce que Le Menteur est aussi une pièce sur la jeunesse, la vitalité, les hésitations...
Le décor est très malin. Jessica Chauffert. l'a dessiné d'un trait sûr, avec les indications du metteur en scène. Un tréteau sur lequel est posée une construction de bois très simple : une arche de porte cochère flanquée de deux esquisses de façades avec leurs portes et leurs indispensables dessus, puisqu'il y a une scène du balcon dans Le Menteur...
Parfois un encadrement d'ampoules donne un air de music-hall enjoué aux joutes et complète les plafonniers tout simples, étoffés de lumières changeantes signées Rémi El Mahmoud.
Dorante, qu'incarne Julien Gauthier, vif et enfiévré, a quitté Poitiers pour Paris. Aux Tuileries, accompagné de son fidèle Cliton, l'excellent Clément Morinière, il tombe raide amoureux d'une belle. Elle se nomme Clarice. Elle est assez insolente. C'est la blonde Amandine Blanquart. Dorante pense qu'elle se prénomme Lucrèce. Mais Lucrèce, c'est sa copine, la fine Rafaèle Huou -la nouvelle venue de la troupe !
L'imbroglio commence par cette méprise et s'enjolive des cascades de mensonges du cher Dorante. Quand son père lui propose une charmante qui se nomme Clarice, il va jusqu'à prétendre qu'il s'est marié à Poitiers...
Pendant ce temps là, Corneille s'amuse, Clarice demande justement à Lucrèce de tester les sentiments du jeune homme en organisant un glissement de prénoms...
Et ce n'est pas fini.
Clarice a un amoureux assez caractériel, un personnage épatant comme Corneille s'amuse parfois à en créer dans ses comédies.
Il se nomme Alcippe c'est le malicieux Clément Carabédian qui lui donne une alacrité digne des comédies de Shakespeare...
Ah ! La vie est bien compliquée quand on ment et quand on n'est pas sûr de son désir ou que l'on voudrait tout à la fois...
En père sérieux, Damien Gouy impose sa maturité sans pesanteur. Juliette Rizoud est une Sabine très ciselée, comme l'Isabelle de Laurence Besson et Julien Thiphane offre à Philiste sa belle présence.
Ils sont très bien dirigés par leur camarade Julien Gauthier. Il a choisi du jazz pour donner du nerf et de la mélancolie à la fois à cette belle représentation. Pierre-Alain Vernette est chargé du son.
Ce qui frappe le plus, dans ce travail, et réjouit le coeur et l'oreille, c'est la virtuosité et le naturel avec lequel tous ces jeunes gens -car on l'a dit, ils ont la trentaine- manient le vers, se jouent de l'Alexandrin et en font une langue d'aujourd'hui.
Alors que ce Corneille de la pleine maturité est aussi très baroque et que sa langue n'est pas toujours facile et que les retournements perpétuels des situations sont difficiles. Et bien eux, nos jeunes gens "en pierres dorées" rendent tout accessible, clair, délicieusement musicale et proche.
Il y a dans ce travail une franchise fraternelle, une intelligence des enjeux, une générosité formidable.
Théâtre national populaire de Villeurbanne, à 20h30 tous les soirs jusqu'à samedi 8 avril, et également à 14h30 les 4, 6, 8 avril. Durée : 1h45 sans entracte. Réservations au 04 78 03 30 00;
A noter : Les Cinquièmes rencontres de Theizé sont organisées par la compagnie Théâtre en pierres dorées du 23 juin 2017 au 25 juin 2017 au Château de Rochebonne (69620) à Theizé-en-Beaujolais. Le Festival est organisé sous la direction artistique de Damien Gouy assisté de Benjamin Kerautret.
Accessible À Tous. Des Déambulations, Des Lectures, Des Spectacles…
Photographie (c) Michel Cavalca.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 4:46 AM
|
Sommaire :
- Frédéric Vossier : Éditorial-Responsabilités, Variations
Ensemble éditorial
- Christophe Fiat : Miss Monde suivi de Cléopâtre. Give me some music !
- Mohamed El Khatib : Faut pas pleurer
- Joëlle Gayot : La phrase, la partouze
- David Léon : À corps perdu
- Claudine Galea : Faire l’expérience
- Jean-René Lemoine : Rite de passage
- Alexandra Badea et Anne Théron : Amour. Politique des larmes
- Éric Noël et Christophe Pellet : Amour. Membres fantômes
- Bérénice Hamidi-Kim : Pauline Peyrade, portrait(s) de femme(s). Politiques du désir
- Céline Champinot : La Bible. Vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable
- Bérénice Hamidi-Kim : Écrire ne s’apprend pas, mais écrire s’accompagne
Entretien avec Enzo Cormann et Samuel Gallet
- L’Arche éditeur – Focus : L’Éditeur absolu
- Marie-Amélie Robilliard : Incarner la mélancolie. Le Théâtre de Fabrice Melquiot
- Fabrice Melquiot : Portrait de Rudolf Rach en treize pièces détachées
- Rudolf Rach : Visite à Thomas Bernhard
- Jean-Louis Fernandez : Amor Mundi (Portfolio)
- Lancelot Hamelin : Rond-Point / Tabloïd. Un art français du théâtre. Chroniques
La revue est composée d'un Ensemble éditorial dont les membres sont :
Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Joëlle Gayot, Lancelot Hamelin, Bérénice Hamidi-Kim et David Lescot.
Parages, revue de création et de réflexion, s’est construit comme espace d’appartenance où l’on peut regarder, penser et écrire en toute liberté, et croiser autrui, à tout hasard, sans volonté idéologique.
Parages se veut être le surgissement de la pluralité, le règne improbable et titubant, mais tenace et solidaire, du «singulier pluriel». C’est donc un espace de singularités et de rôdeurs que le Théâtre National de Strasbourg, sous l’égide du locataire de la parole, Stanislas Nordey, accueille, le temps d’un numéro.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2017 3:20 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Armand Gatti ne parlera plus, place à son œuvre colossale
A 93 ans, Armand Gatti dit Dante quitte un monde où il aura mené bien des combats. Ecrivain de grandes traversées, il aura écrit des tas de pièces, après avoir été un journaliste remarqué. Ses mots sont des paroles en acte. En attendant de le (re)lire, saluons l’homme. Salut Dante !
C’était il y a quelques semaines, dans l’antre de sa tribu à Montreuil, La Parole errante. Au pied des gradins garnis de vieux et jeunes amis, il était venu s’asseoir derrière la petite table de bois placée devant les spectateurs. Il aimait ces moments de lecture partagée. Comme toujours, il portait sa veste de cuir noir qui lui donnait l’allure d’un vieux marlou. Les pas étaient plus lents, à 93 ans (le 26 janvier dernier), il n’avait plus la prestance de ses années de maquis dans la forêt de Berbeyrolle, de journaliste dans la cage aux lions ou en Sibérie, de cinéaste de terrain, de bourlingueur de mots, d’homme de théâtre volontiers hors les murs œuvrant à Saint-Nazaire, en Irlande, en Allemagne, en Avignon, partout.
Devant lui, une liasse de feuilles peuplées de mots vadrouillant entre les lignes, jamais tranquillement alignés sur la page. Il se pencha sur le premier feuillet et ce fut comme si les mots jaillissaient de la page pour aller le rejoindre, comme dans une nouvelle du Russe Krzyzanowski, un auteur que nous a fait découvrir Hélène Châtelain, sa compagne. Les mots rentraient d’où il venaient, le poulailler, la forge, l’arbre Gatti où ils avaient été mis en corrélation avec des tas de compagnons d’armes. Une fois encore, Gatti s’est engouffré dans la parole avec ses poings à jamais serrés, sa voix toujours rageuse, une saine et vieille colère. Des mots qui, entre deux virgules, ont eu tôt fait de convoquer les fantômes de sa vie et de son œuvre prolifique : Rosa Luxembourg, Mao Tsé Toung, Jean Cavaillès, l’anarchiste ukrainien Makhno, Evariste Gallois et tant d’autres. Il ne reviendra plus s’asseoir à la petite table. C’est fini.
Le corps d’Armand Gatti s’est arrêté de battre et de se battre au matin du 6 avril 2017. Surprise dans son sommeil, la carcasse s’en est allée au bout de sa fatigue.
Ecouter sa voix s'emporter était toujours un grand bonheur. Un jour, Gatti vient parler au Capitole. Sans doute en s’asseyant au bord de la scène, les pieds ballants comme je l’avais vu faire, enfant, au Théâtre de Villejuif au moment de V comme Vietnam. A la fin, des jeunes l’entourent. Le voici au café Tortoni entouré d’une bande de jeunes dont Daniel Bensaïd alors étudiant. Une rencontre marquante : « Hirsute, débraillé, assis sur un dossier de chaise, il s’exprimait avec flamme, par tous les moyens que pouvait lui fournir son corps : avec le geste sec et précis, le regard mobile, le sourire bon enfant, les grimaces et une parole heurtée et violente. »
C’est en Belgique à l’Institut des arts de Louvain-La-Neuve où ils sont élèves que les frères Dardenne croisent la parole et la carcasse de Gatti. Lorsqu’ils arrivent à l’école, Gatti est déjà là, il balaie, trouvant le plancher trop dégueulasse. Les deux frères avaient des parcours différents, c’est Gatti qui les a réunis, racontent-ils. Ils parlent de lui comme d’un « père spirituel ». Ils le suivront à Saint-Nazaire, en Irlande, deux étapes marquantes du parcours de Gatti. Ils ne seront pas les seuls ; l’acteur André Wilms ou le journaliste Marc Kravetz par exemple seront de l’aventure. C’est cet activiste, ce poète oral, ce militant d’aucun parti (mais qui abritait à Montreuil le salon du livre anarchiste) qui vient de disparaître.
Quel chemin depuis le berceau italien où il puisa son surnom de Dante, lui le fils du balayeur Auguste Gatti et de Letizia Luzona, femme de ménage, jusqu’à la maison de l’arbre de Montreuil, les 1730 pages de La Parole errante, les 1296 pages de La Traversée des langues et avant ses années de journaliste très prisé, ses films et les trois épais volumes de son théâtre incomplet dont une pièce interdite par le pouvoir gaulliste au TNP de Jean Vilar à Chaillot pour ne pas offenser le dictateur Franco. Après cette censure, Gatti quitte les théâtres pour la rue, les foyers, les prisons, les usines. Il quitte aussi la France pour mieux y revenir.
« Ma première idée de théâtre est née devant une porte de prison », écrit-il. Mais l’aventure théâtrale, selon ses dires, commença le jour où dans un camp, trois juifs baltes ont fait une pièce de théâtre qui tenait en trois phrases : « ich bin, ich war, ich werde sein » (je suis, j’étais, je serai). « C’était la première pièce de théâtre que j’ai vue dans ma vie, et la révélation que le théâtre pouvait ressembler à quelque chose. » Des dizaines de pièces allaient répondre à cette injonction première. Beaucoup furent mises en scène dans les années 50, 60 et 70.
L’écriture de La Parole errante à partir de 1981 ouvre de nouveaux horizons. L’écriture se fait rhizome. L’œuvre impressionne par sa puissance, son poids, ses échappées vers la Kabbale ou la physique quantique. Elle a été longtemps lue et commentée par des compagnons de lutte et de route. C'est plus ouvert aujourd’hui avec le travail remarquable qu’effectuent de jeunes metteurs en scène et des chercheurs comme Catherine Brun et Olivier Neveux qui dirigent les Cahiers Armand Gatti. Chaque numéro (annuel) éclaire une facette de cette homme qui n’en manque pas : le journaliste, le cinéma, les arts, la traversée des langages. C’est passionnant.
Reste à (re)lire, aborder l’œuvre désormais sans l’ombre portée du colosse. Sa légende entamée de son vivant va pouvoir se déployer : celle d’un poète-univers, l’un des plus féconds, l’un des plus vertigineux du XXe siècle. Alors aujourd’hui, on a préféré se souvenir de l’homme.
Jean-Pierre Thibaudat
Photo: Le poète et dramaturge Armand Gatti, en 2006. SERGE COHEN/COSMOS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 6:46 PM
|
Par Frédérique Roussel dans Libération
Le poète, dramaturge et metteur en scène qui a marqué le théâtre par ses expériences collectives et son souffle révolutionnaire est mort jeudi à 93 ans.
Al’été 2010, à 86 ans, Armand Gatti était venu créer une pièce à Neuvic, en Corrèze. Le fronton du gymnase du lycée agricole Henri-Queuille de la commune arborait des portraits en noir et blanc d’hommes et de femmes de la Résistance et un long titre mystérieux : Science et Résistance battant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d’oiseau des altitudes. A l’intérieur, une trentaine de stagiaires français et étrangers virevoltait, déclamait et chantait, bâton de kung-fu en main. A un bureau, assis, se tenait Gatti, massif, silencieux, les yeux rivés sur son texte. Une phrase mal dite, un chœur en sous régime, et il se levait d’un coup, bras tendu, braillant d’une voix puissante. Du théâtre ? «Jamais !» aurait-il tonné de rage.
L’aventure de la création de Neuvic n’avait rien d’anodin. La forme, monter des textes fleuve qu’il réécrivait au fur et à mesure avec un collectif impressionné par son aura, il la pratiquait depuis la toute fin des années 60. Que ce soit avec ses «loulous» ou sa «tribu». Mais en Corrèze, Armand Gatti revenait géographiquement à un carrefour de son existence, l’époque de la Résistance. Celle-ci, avec de grandes figures qu’il avait totémisées comme le mathématicien Jean Cavaillès, revenait dans ses propos, imprégnait son texte. Et à Neuvic plus qu’ailleurs, résonnait. A l’hiver 1942, le jeune Gatti avait été maquisard à La Berbeyrolle, à 60 km de là, avec trois autres camarades. Dans cette emphase physique qui le caractérisait, Armand Gatti racontait qu’il avait trompé la peur en lisant des poèmes de Gramsci aux arbres. Quand on est venu l’arrêter en lui demandant d’un coup dans le genou pourquoi il résistait, la vision d’un rouge-gorge lui inspira un : «Je suis venu faire tomber Dieu dans le temps.» Il fut pris pour un fou et épargné. Les mots lui ont donc sauvé la vie ; et toute sa vie, il aura forgé des mots. Journaliste, poète, scénariste, metteur en scène, l’immense Armand Gatti est mort jeudi à 93 ans.
Matricule 17173
Il faudrait un roman en plusieurs tomes pour relater ses multiples vies, justement, ses centaines de rencontres, ses milliers de pages noircies encore durant les dernières semaines (1). Dante Sauveur Gatti a d’abord grandi dans pas grand-chose, un bidonville, à Monaco où il est né le 26 janvier 1924 d’un père anarchiste italien et balayeur, Augusto Reiner Gatti et de Letizia Luzona, femme de ménage. Il commence bien mal, pourrait-on dire : exclu du petit séminaire, exclu du lycée, puis petits boulots. En 1942, son père meurt après un tabassage lors d’une grève d’éboueurs. La même année, Dante rejoint la Résistance dans sa forêt de Corrèze, arrêté, emprisonné, condamné à mort, gracié, déporté (matricule 17173), évadé, engagé dans les parachutistes britanniques avec lesquels il participe à la bataille de Hollande. Entre-temps, sans doute, Gatti a rencontré Gramsci et la poésie. Le combat, le sens et le verbe. Après la guerre, pendant une quinzaine d’années, il est journaliste et collabore à beaucoup de titres, le Parisien, Paris Match, l’Express. Au Parisien libéré, à partir de 1946, il court les tribunaux ; le soir, le poète commence l’écriture de Bas-relief pour un décapité. En 1954, Il apprend le métier de dompteur pour son enquête Envoyé spécial dans la cage aux fauves (prix Albert-Londres). Devenu grand reporter, Armand Gatti voyage en Amérique latine. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il part pour trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. Puis en voyage avec Joseph Kessel à Helsinki. L’année suivante, il devient rédacteur en chef du Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie et part en Sibérie avec Chris Marker.
Pièce massacrée
Pendant ces années de terrain, il écrivait également de la poésie et du théâtre. Difficile de citer une bibliographie aussi impressionnante (2). Sa première pièce publiée sera le Poisson noir (Seuil, 1958). Sa première pièce jouée sera le Crapaud-buffle par Jean Vilar, au théâtre Récamier, le petit TNP, en 1959. «La pièce a été massacrée par la critique, raconte Marc Kravetz, son ami depuis cinquante ans. Il dit alors à Jean Vilar : "Je n’écrirai plus jamais de pièce", Jean Vilar l’a au contraire encouragé. C’était le début d’une amitié pour la vie.»
De fait, en 1962, la Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., inspirée de son père, créée à Villeurbanne par Jacques Rosner, sera son premier grand succès. Le dramaturge se lance aussi dans le cinéma. En 1960, il réalise l’Enclos, dont il a écrit le scénario et les dialogues avec Pierre Joffroy. Le film obtient le prix de la critique à Cannes. En 1962, il tourne son second film à Cuba, El Otro Cristobal.
Son histoire avec le théâtre ressemble à une relation passionnelle, avec un désir viscéral de dépassement. Sa «théâtrographie» est longue aussi (2). C’est en janvier 1966, qu’il met en scène une pièce culte : Chant public devant deux chaises électriques, sur Sacco et Vanzetti, au TNP-Palais de Chaillot. En 1967, c’est V comme Vietnam, au théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. En 1968, Armand Gatti recueille les témoignages d’habitants du XXe arrondissement de Paris sur les transformations de leur quartier. Ainsi naîtra les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mis en scène par Guy Rétoré.
Physique quantique
C’est le soir de la première en mars 1968 que Marc Kravetz rencontre Gatti. «On ne se le rappelle pas mais la phrase "Sous les pavés la plage" vient d’une réplique de cette pièce», précise Kravetz. La Passion du général Franco est retirée de l’affiche le 19 décembre 1968, sur ordre du gouvernement français. Gatti quitte la France pour Berlin-Ouest où cet anarchiste libertaire dans l’âme va monter une série de pièces dont une sur Rosa Luxembourg (Rosa Collective). Il en fera une lecture au Festival d’Avignon. Encore récemment, ce fantastique conteur a donné une lecture à Montreuil.
Quand Armand Gatti revient d’Outre-Rhin, il décide de travailler hors de l’institution théâtrale. Dans des expériences collectives comme Neuvic. Ses textes évoquent des figures révolutionnaires et des résistants, et sont empreints de physique quantique. Morceau de bravoure, en 1976 : le Canard sauvage qui vole contre le vent. Armand Gatti crée une expérience de création collective, localement controversée, sur les dissidents soviétiques à l’invitation du directeur de la Maison des jeunes et de l’éducation permanente de Saint-Nazaire (MJEP), Gilles Durupt.
La tribu s’installera ensuite à L’Isle-d’Abeau. De 1983 à 1985, Armand Gatti se pose à Toulouse pour y créer l’Atelier de création populaire, l’Archéoptéryx. Puis il y aura Marseille, le théâtre universitaire de Besançon (2003), l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (2006), etc. Ses dernières années, Gatti continuait à façonner le deuxième tome de son récit personnel la Parole errante. Jusqu’au bout, habité et mu par le lyrisme du langage.
(1) Ses monuments personnels publiés la Parole errante et la Traversée des langages, Verdier. (2) Consulter le site de la Parole errante : www.armand-gatti.org
Frédérique Roussel
Photo : Armand Gatti dirigeant son film, «El Otro Christobal» sur la révolution cubaine, 1962. Photo René Burri. Magnum

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 6:21 PM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 5:22 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération/Next
Lazare, erreur système ?
Volubile, poétique, méfiant : l’auteur de «Sombre Rivière», actuellement en tournée, confie son obsession des cases et de l’enfermement.
Et très vite le ton monte : les journalistes ne font pas leur travail, non seulement ils ne vont pas voir les pièces, mais ils réduisent l’autre à un stéréotype, les autres metteurs en scène reproduisent ce qu’ils savent faire ad nauseam et les programmateurs ne s’intéressent qu’à ce qui pénètre bien sagement dans des cadres, le théâtre est un entre-soi où la bourgeoisie moisit dans une eau stagnante, et nous-mêmes… Eh bien, nous-mêmes sommes au café le bien nommé No Problemo, où Lazare, auteur, metteur en scène, poète, n’arrête pas de bouger, se saoule de verres d’eau, se noie dans des flaques de soleil, se perd en imprécations qu’on note sagement. Il fait beau, on est en terrasse. On se tait en attendant que le volume sonore descende.
Il descend. Lazare, dont on vient de voir Sombre Rivière, créé au Théâtre national de Strasbourg, repris au Nouveau Théâtre de Montreuil, présenté par la MC93 hors les murs. Un spectacle archi-musical, effectivement inclassable, tonique et joyeux - «Ah non, ne dites pas cela, c’est atroce, "tonique et joyeux". Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes ! Ça parle des attentats et de l’amnésie, de tout ce que l’histoire oublie, de tout ce qui resurgit» - et même plein d’humour, maintient-on, en dépit de thèmes lourds et enchevêtrés : comment vit-on après les attentats ? Sur quel terreau se produisent-ils ? Quelles histoires ensevelies ? Et comment vit-on en particulier, lorsqu’issu de l’histoire coloniale, on devient, à ce titre, obligatoirement suspect dans la France actuelle ? Sombre Rivière, titre d’un standard de blues, parle de l’enfermement, avec ou sans murs. Mais comme toujours, chez Lazare, le multiple, le rythme et l’éclatement détournent la frontalité du propos. Une petite fille de 5 ans voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Cette petite fille est aussi bien une gamine d’aujourd’hui, témoin oculaire des attentats parisiens ou niçois, que la propre mère de Lazare, qui a vu son père se faire tuer lors des émeutes de Guelma en Algérie en 1945. Et de quoi se souvient-elle maintenant, cette enfant devenue femme âgée, qui a vécu «une vie de résistante pour tenir debout» ? Sur une vidéo, on voit l’image de la vraie mère de Lazare et ses paroles, empêchées par son rire. Elle répète : «Qu’est-ce que tu veux, t’es Arabe. Tu peux pas cacher tes joues, tu peux pas cacher ton sang. Y a Français français, et y a Français arabe.» Libellule, l’un des doubles de Lazare déjà déployé dans ses pièces précédentes, rétorque que personne ne doit savoir d’où il vient. Lorsque la pièce débute, de multiples Lazare envahissent la scène.
«Tourdi».
Pas de récits des origines donc, ailleurs que dans les pièces qu’il signe. Ce n’est pas pour rien que Lazare se revendique de Fernando Pessoa et puise certains de ses titres - Au pied du mur sans porte, par exemple - chez l’écrivain portugais. Les premières pièces de Lazare ne parlent cependant que de son enfance, des quartiers, et de l’inadaptation de Libellule, qui a «un retard de l’école» et qui est beaucoup trop «tourdi». On pense au Momo de la Vie devant soi, de Romain Gary, devant la profusion des inventions verbales, sauf que leur auteur n’a rien d’une construction. «J’écoute les gens. Je raconte l’histoire commune.» Anne Baudoux, comédienne, qui travaille avec lui depuis ses débuts il y a quinze ans, raconte comment les pièces s’écrivent : «Lazare écrit très vite, mais à voix haute. Et la plupart du temps, il y a une scribe face à lui, qui est moi.» Ensuite, il s’agit de voir si le texte passe l’épreuve du plateau. Anne Baudoux : «La particularité de Sombre Rivière est d’avoir d’abord pris la forme d’un long poème. Il s’est aussi servi de deux longs coups de téléphone, l’un passé à Claude Régy, l’autre à sa mère.»
Exclu.
S’il n’avait pas été happé par la scène et la matière vivante des mots, Lazare pense qu’il aurait été jardinier pour «offrir des fleurs à mes sœurs. J’en ai quatre». Cela fait une quinzaine d’années qu’il se «bagarre» pour faire du théâtre. Il en a perdu «quelques dents au point d’être édenté». Est-ce que ça va mieux aujourd’hui ? Lazare en doute. Il n’apprécie pas quand on lui fait remarquer qu’il n’est pas donné à tout le monde d’être en dialogue permanent avec Claude Régy, ou d’avoir le soutien quasi inconditionnel de Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg, ou d’Hortense Archambault, à la tête de la MC93 de Bobigny. «Oui, j’ai de la chance d’avoir des protecteurs. Mais pourquoi, à mon âge, en aurais-je besoin pour travailler ?» Oui, pourquoi ? «Je ne fais pas partie du milieu du théâtre. Je suis comme les gosses qu’on exclut du jeu et qui reviennent pour tenter d’y être quand même.» Lazare, qui se perçoit comme exclu, draine cependant un public toujours plus nombreux. Il est aussi adoubé par la critique. Hortense Archambault, qui l’a programmé quand elle codirigeait le Festival d’Avignon avec Vincent Baudriller : «J’ai vu tous ses spectacles. C’est un poète à vif et radical, mais qui n’est jamais dans une chose revancharde. Il a raison de dire que le système ne suit pas la progression de son travail. En France, les metteurs en scène qui ne dirigent pas un théâtre ou qui n’ont pas été labellisés "compagnie nationale" sont terriblement dépendants des autres.» C’est grâce à un éducateur de rue, le fondateur du Théâtre du Fil, Jacques Miquel, que Lazare a pu rencontrer la scène et l’écriture, quand il ne savait ni lire ni écrire couramment. L’éducateur est mort il y a quelques mois. Sombre Rivière lui est dédié.
Anne Diatkine
Sombre Rivière texte et m.s. Lazare Le 28 avril au Liberté de Toulon (83), en novembre à la Comédie de Valence (26), du 6 au 9 décembre au Grand T de Nantes (44), puis courant décembre à Grenoble (38).
Photo : Lazare, personnage inclassable du spectacle vivant, lors des répétitions de «Sombre Rivière». Photo Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 12:10 PM
|
Par Yves Poey pour son blog " De la cour au jardin" (c) Photo Y.P. -
Remplaçant pratiquement au pied levé Jacques Lassalle qui devait monter « La cruche cassée » de Kleist, le patron du Français Eric Ruf nous propose sa version de Bajazet, de Jean Racine.
Cette pièce, il la connaît bien, puisqu'en 1995, il en interprétait le rôle-titre, déjà au Vieux-Colombier, dans une mise en scène d'Eric Vigner.
Retour donc en pays ottoman, dans lequel on tue beaucoup, comme nous l'allons voir.`
Dans sa note d'intention, M. l'Administrateur rappelle les deux thèmes, (il parle même à juste titre de deux fantasmes), qui émergent de cette pièce très peu jouée : le Pouvoir et ses méandres, et surtout l'Amour et ses intrigues.
Pouvoir politique et amours domestiques : les deux vont s'entremêler, s'entrechoquer avec une force et une violence inouïes, au sein du lieu de l'intimité incarnée et feutrée : une chambre du gynécée, dans le palais du sultan Amurat.
Dans ce lieu unique, règle intangible du théâtre classique, dans ce lieu interdit en principe aux hommes et vecteur de tous les fantasmes, donc, règnent en maîtresses les courtisanes.
Eric Ruf a matérialisé cette chambre ô combien énigmatique pour la gent masculine par cinquante-quatre paires de chaussures féminines, qui attendent le public sur la scène du Vieux-Colombier.
A jardin, à cour, ainsi qu'au lointain, c'est une autre collection, de magnifiques armoires anciennes cette fois, qui nous est donnée à admirer.
Ces chaussures vides, et ces armoires évidemment remplies de lourds secrets confèrent au décor une puissance très mystérieuse, très étrange.
Dans cet espace très clos, les passions vont se déchaîner.
L'objet principal de ces passions, c'est évidemment Bajazet, le frère du sultan Amurat.
Ce ne sera pas pourtant le personnage qui parlera le plus.
Laurent Natrella confère à son personnage une sorte de fragilité, une espèce d'impuissance face aux événements, d'indécision vis-à-vis de la sultane Roxane et de la courtisane Atalide, envers qui il a du mal à exprimer ses véritables sentiments.
Il apparaît en grande chemise de nuit immaculée, pieds nus lui aussi, un peu comme un condamné à mort pour qui tout serait déjà joué d'avance.
Ce sont les deux rôles féminins principaux qui m'ont vraiment impressionné.
Clotilde de Bayser est une Roxane fière, altière. Elle va dire les sentiments de son personnage avec force et majesté, mais elle est également très émouvante en femme blessée n'hésitant pas à recourir à la violence pour se venger, délaissée qu'elle est au profit de sa rivale.
L'Atalide de Rebecca Marder est elle aussi bouleversante.
La jeune comédienne est réellement très à l'aise avec l'alexandrin racinien.
Une impression ambivalente de fragilité, de douceur, mais également de force intérieure se dégage de son interprétation. Elle est vraiment grandiose.
Elle rend la scène finale totalement crédible, utilisant pour se supprimer les lacets d'une paire de chaussures écarlates. Encore et toujours les chaussures... Fétichiste, M. Ruf ?
Denys Podalydes campe quant à lui le vizir Acomat, qui tire les ficelles. (Les lacets, devrais-je écrire... )
Il m'a fait peur, le comédien !
Il incarne ce fourbe comploteur politique avec parfois un ton très doucereux, très inquiétant. Un vrai et maléfique serpent, une vile araignée tissant sa toile.
Je dois mentionner également les excellentes Anna Cervinka, Cécile Bouillot (qui n'appartient pas à la troupe), et le toujours magnifique Alain Lenglet en serviteurs et confidents dévoués.
De ce Bajazet émane une impression de classicisme, de rigueur, voire d'austérité.
Ruf n'a pas fait dans la gaudriole, Racine est servi au mieux.
C'est une pièce assurément casse-gueule.
Il faut vraiment que tout soit millimétré et d'une grande justesse, si l'on ne veut pas se retrouver dans un grand-guignol de mauvais aloi. (Mme de Sévigné avait d'ailleurs qualifié la pièce de « grande-tuerie », les trois principaux personnages y trouvant la mort...)
Ici, il n'en est rien.
Tout concourt à ce sentiment d'inéluctabilité des sentiments et des passions humaines.
C'est très noir, c'est très désespéré, c'est très fort.
C'est très beau.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 9:00 AM
|
Par Stéphane Capron dans Sceneweb
Armand Gatti
L’immense Armand Gatti est mort ce matin à l’âge de 93 ans. La direction de La Parole errante à la Maison de l’arbre, le centre international de création qu’il dirigeait avec Jean-Jacques Hocquard à Montreuil nous a informé de cette triste nouvelle pour le monde du théâtre.
Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il passe son enfance dans le bidonville de Tonkin avec son père, Augusto Reiner Gatti, balayeur, et sa mère, Laetitia Luzano, femme de ménage. Il suit ses études au séminaire Saint-Paul à Cannes. Fils d’un anarchiste italien et d’une franciscaine, Armand Gatti poète, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste aura marqué l’histoire de théâtre français du 20ème siècle. En témoigne son impressionnante biographie ci dessous.
1924 26 janvier. Naissance de Dante Sauveur Gatti à Monaco, fils d’Auguste Rainier Gatti, éboueur, et Letizia Luzona, femme de ménage. Après avoir habité le bidonville du Tonkin, à Beausoleil, la famille s’installe dans la même banlieue monégasque, dans le quartier Saint-Joseph.
1941 Exclu du petit séminaire, il rentre en première au lycée de Monaco. Il écrit une épopée signée Lermontov où il se moque de ses professeurs, ce qui entraîne son exclusion le 14 juin.
1942 Il exerce divers petits métiers, dont celui de déménageur, et de sous-diacre à l’église Saint-Joseph. Le 2 mars, son père Auguste meurt des suites d’un tabassage lors d’une grève d’éboueurs. Il part alors en Corrèze, dans le maquis, avec la recommandation du père gramscien d’un de ses amis.
1943 Arrêté à Tarnac, il est emprisonné à Tulle, puis transféré à Bordeaux où il travaille à la construction de la base sous-marine. Transféré à Hambourg, au camp de travail de l’entreprise Lindemann, il s’en évade et rejoint en Corrèze l’un des nombreux maquis dépendant de Georges Guingouin.
1944-45 Parachutiste à Londres dans le Special Air Service (SAS), il participe à la bataille de Hollande. Renvoyé dans ses foyers le 1er novembre 1945, il passe la nuit de Noël avec Philippe Soupault, auquel l’a présenté un ami parachutiste. Celui-ci consacre quelques pages au « jeune homme » dans son « Journal d’un fantôme » : « Nous parlons de Rimbaud, de Lautréamont. (…) Ses jugements sont justes, parfois sévères lorsque les poètes l’ont déçu. (…) Ah ! Henri Michaux, dit-il, Michaux, lui il est bien ! »
1946-47 Sur recommandation d’un ami monégasque, il entre en janvier 1946 au Parisien libéré comme rédacteur stagiaire. Il y rencontre celui qui sera son ami de toujours, Pierre Joffroy. Pendant quelques mois, il est « locataire clandestin » à la Cité universitaire, au pavillon de Monaco. Puis il emménage sur l’île Saint-Louis, dans un hôtel meublé, quai d’Anjou, où sont logés Gilles Deleuze, Georges Arnaud, Karl Flinker, Georges Decaune, Michel Tournier, Yvan Audouar, Alejandro Otero et François-Jean Armorin. Kateb Yacine les rejoindra en 1952. Dans les salons de Mme Tézenas, il rencontre Henri Michaux, Pierre Souvchinsky, Yves Benot, Paule Thevenin, André Berne-Joffroy, Guy Dumur, Michel Cournot… Journaliste le jour, poète la nuit, il commence l’écriture de Bas-relief pour un décapité, puis d’une pièce intitulée Les Menstrues.
1948-49 Avec Pierre Boulez et Bernard Saby, devenus ses amis, ils accueillent John Cage, Morton Feldman, Merce Cunningham et Morton Brown. Nommé, le 1er janvier 1949, rédacteur au Parisien libéré, il y devient la même année reporter, statut qu’il gardera jusqu’à son départ du journal, en 1956.
1950-51 Reportages souvent cosignés avec Pierre Joffroy sur des sujets variés : spiritisme, justice, pauvreté, Collaboration, exploitation de la main-d’œuvre en Martinique… Fin 1951, il part pour l’Algérie où il rencontre Kateb Yacine. De son côté, Pierre Joffroy écrit sur les bidonvilles nord-africains en France. Ce double reportage qui prévoit l’insurrection et décrit la grande misère de la population nord-africaine ne sera pas publié, mais ils écrivent au président de la République, Vincent Auriol, pour l’alerter sur la situation.
1952 Création à Cologne de son poème Oubli signal lapidé, musique de Pierre Boulez, par l’ensemble vocal Marcel Courand. Il assiste à un concert de Pierre Boulez, au théâtre des Champs-Elysées, où il prend à partie les spectateurs qui protestent contre cette musique.
1953 Il assiste au procès d’Oradour-sur-Glane. « La Justice militaire », article publié dans Esprit, dénonce l’acquittement d’un capitaine de gendarmerie « coupable d’avoir fait passer de vie à trépas quelques maquisards ». Il poursuit sa réflexion sur la justice avec un réquisitoire virulent contre le déroulement du procès de Pauline Dubuisson (Esprit de janvier).
1954 Il apprend le métier de dompteur pour réaliser l’enquête « Envoyé spécial dans la cage aux fauves » qui lui vaut le Prix Albert-Londres. Devenu grand reporter, il voyage en Amérique latine (Costa Rica, Salvador, Nicaragua). Envoyé spécial au Guatemala, il assiste à la chute du gouvernement Arbenz et rencontre un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara, le futur Che. De retour d’Amérique centrale, il écrit dans Le Parisien libéré et Esprit et interviewe l’écrivain Miguel Angel Asturias pour Les Lettres françaises. Il commence à rédiger Le Quetzal puis Le Crapaud-Buffle et travaille avec Pierre Joffroy et Kateb Yacine sur une biographie de Churchill, publiée au Seuil.
1955 Il quitte le quai d’Anjou pour le 17e arrondissement. Retournant au Guatemala, il passe par Mexico. En Europe, dix ans après la fin de la guerre, il découvre des camps de « personnes déplacées », sur lesquels il écrit un article, « Malheur aux sans-patrie ».
Il entre à Paris-Match. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il part pour trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. À la découverte du théâtre chinois – et tout particulièrement de Kouan Han Shin, auteur du XIVe siècle – il rencontre Mei lan Fang, prodigieux comédien de l’opéra de Pékin, et retrouve son ami Wang, connu à Paris à la fin des années 40, qui l’introduit auprès de Mao Tsé-toung. Retour par le Transsibérien.
1956 Les journaux auxquels il collabore refuse son reportage sur la Chine, mais un livre paraît aux éditions du Seuil, dans la collection « Petite Planète » dirigée par Chris Marker. Il est naturalisé français. Pour France-Soir, il écrit une longue série d’articles « J’ai filé les détectives privés » et part en voyage avec Joseph Kessel à Helsinki.
1957 Il finit d’écrire la pièce Le Poisson noir, issue de son voyage chinois. L’Express et Détective lui offrent une place de rédacteur. En juin, il accepte le poste de rédacteur en chef de Libération (celui fondé par Emmanuel d’Astier de la Vigerie) et part en septembre en Sibérie avec Chris Marker pour le tournage du film Lettre de Sibérie et l’écriture du livre Sibérie, – zéro + l’infini. À son retour, envoyé à Nantes par L’Express pour rendre compte des grandes manifestations des ouvriers nazairiens, il est matraqué par la police. Sa tête entourée de bandages illustre son article. Il fait procès aux CRS, et perd.
1958 Il décline la proposition de la Guinée de créer un journal à Conakry. Il commence à travailler, avec Pierre Joffroy, au scénario de L’Enclos et finit d’écrire Don Tibério, qui deviendra Le Crapaud-Buffle.
Au mois de mai, départ pour la Corée du Nord et la Chine, avec une délégation où se retrouvent, entre autres, Chris Marker, Claude Lanzmann, Francis Lemarque et Claude-Jean Bonnardot. Le gouvernement nord-coréen lui propose de réaliser un film. Il en écrit le scénario et en commence le tournage en collaboration avec Bonnardot qui finira le film et en assurera le montage en France. Ce film, Moranbong, est interdit à sa sortie en 1960 et autorisé en 1964. Sur le chemin du retour, il séjourne en Chine, dans le Sin-Kiang et le Kiang-Si. Il rentre en France en novembre.
1959 Il écrit pour Libération – où sa longue absence lui a fait perdre son poste de rédacteur en chef – un reportage : « La Chine contre la montre ». Il suit le Tour de France à moto, interviewe Marlon Brando et écrit en décembre pour Paris-Match, où il est devenu grand reporter, son dernier article comme journaliste : « La France pleure Gérard Philipe ».
Avec Le Poisson noir, que le Seuil a édité l’année précédente, il obtient le prix Fénéon de littérature. Jean Vilar monte Le Crapaud-Buffle au Théâtre Récamier, Petit TNP. Malgré l’échec auprès de la critique, Jean Vilar l’incite à persévérer. Désormais, il se doit, lui dit-il, à un public, les onze mille personnes venues assister aux représentations.
Il part en Italie, dans la maison de sa mère, dans le Piémont, où il commence à écrire Auguste G. et l’adaptation du Château de Kafka pour le cinéma, film non réalisé avec Charlie Chaplin pressenti dans le rôle principal.
1960 Il réalise en Yougoslavie son premier film, L’Enclos, dont il a écrit le scénario et les dialogues avec Pierre Joffroy.
1961 L’Enclos est présenté dans plusieurs festivals où il obtient des prix : à Cannes, celui de la Critique ; à Moscou, celui de la mise en scène – la délégation polonaise, qui critique fortement le contenu du film, l’ayant empêché d’avoir le Grand Prix – et où il rencontre Nazim Hikmet ; à Mannheim, où il reçoit une Mention spéciale hors concours. Le film est accueilli par des critiques dithyrambiques.
1962 Trois spectacles sont créés : La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. à Villeurbanne (dirigé par Roger Gilbert et Roger Planchon), dans une mise en scène de Jacques Rosner ; La Deuxième Existence du camp de Tatenberg par Gisèle Tavet au Théâtre des Célestins à Lyon ; Le Voyage du Grand Tchou dans une mise en scène de Roland Monod au TQM de Marseille.
Il réalise à Cuba son second film, El Otro Cristobal, notamment avec des comédiens et le décorateur Hubert Monloup rencontrés sur le spectacle La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G.
1963 El Otro Cristobal représente Cuba au Festival de Cannes et y obtient le prix des Écrivains de cinéma et de télévision.
Pour la première fois, il met en scène une de ses pièces : Chroniques d’une planète provisoire, au théâtre du Capitole, à Toulouse.
Jacques Rosner crée au Festival de Berlin La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., et en reprend une version française au Théâtre de l’Odéon, à Paris, l’année suivante.
1964 Il met en scène Le Poisson noir au Théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. De retour d’Algérie, il écrit Selma, le scénario d’un film non réalisé sur la guerre d’Algérie.
1965 Il rencontre Erwin Piscator avec lequel il s’entretient à la télévision allemande. Sa pièce La Deuxième Existence du camp de Tatenberg est créée à Essen, en RFA. Il travaille à un projet sur Staline, Mort de Staline à travers l’œil d’une mouche, dont les seules traces écrites se trouvent dans le livre-mémoire d’Antoine Bourseiller, publié en 2007.
Il écrit le scénario de L’Affiche rouge, qui lui fait rencontrer de nombreuses organisations d’anciens Résistants de la MOI (Main-d’œuvre immigrée), dont Mélinée Manouchian et Arsène Tchakarian. Le sujet sera traité, dix ans après, avec La Première Lettre, série de six films à L’Isle-d’Abeau.
1966 Il crée deux pièces : en janvier, au TNP-Palais de Chaillot, Chant public devant deux chaises électriques et en mai, à Saint-Étienne, Un homme seul.
Le Poisson noir et Chroniques d’une planète provisoire sont montées en Allemagne, La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. en Angleterre et Chroniques d’une planète provisoire en Belgique.
Il écrit avec Pierre Joffroy une nouvelle version de L’Affiche rouge, Le Temps des cerises, qui obtient l’avance sur recettes du CNC, mais le film ne sera pas réalisé.
1967 Reprise à Toulouse de Chroniques d’une planète provisoire créé en 1963. À la demande du Collectif intersyndical d’action pour la paix au Vietnam, il écrit un texte sur la guerre du Vietnam : La Nuit des rois de Shakespeare par les comédiens du Grenier de Toulouse face aux événements du Sud-Est asiatique : V comme Vietnam, qu’il met en scène en avril, au théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. Le Groupe V se fonde à l’issue de la tournée de quarante-cinq dates en France, Belgique et Suisse.
À la demande du réalisateur Marcel Bluwal, pour l’ORTF dirigé par Emile Biasini, il écrit le scénario d’une série de trois émissions d’une heure sur la Commune de Paris, en vue de son centenaire. Les événements de Mai 68 mettront fin au projet.
La Passion du général Franco est créée à Kassel et Tatenberg II à Bradford, en Angleterre.
Inspiré par l’histoire de l’ingénieur Tsutomu Yamaguchi, un des rares hommes à avoir subi les deux explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, il écrit La Cigogne et offre le texte à Jean Hurstel qui le mettra en scène au printemps suivant au Théâtre universitaire de Strasbourg.
1968 À la demande de Guy Rétoré, Emile Copfermann, écrivain, critique théâtral et directeur de collection aux éditions Maspero, réunit des habitants du 20e arrondissement de Paris, afin que Gatti écrive, grâce à leurs témoignages et à travers leur imagination, une pièce sur les transformations urbaines du quartier. Ainsi naîtra Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mis en scène par Guy Rétoré au Théâtre de l’Est parisien. Dès le 11 mai, les représentations, qui trouvent de nombreux échos dans la rue, sont arrêtées, malgré le souhait d’Armand Gatti d’organiser des débats dans le théâtre. Il participe à plusieurs manifestations. Au cours de l’une d’elles, il se fait briser les mains en protégeant sa tête. Contraint à l’immobilité, il dicte le texte d’un spectacle de rue sur la Commune, représenté à travers Paris par son équipe.
La Naissance est créée par Roland Monod à la Biennale de Venise et V comme Vietnam montée en Allemagne (RFA et RDA).
La Passion du général Franco est retirée de l’affiche le 19 décembre, pendant les répétitions, sur ordre du gouvernement français, à la demande du gouvernement espagnol.
Un comité de soutien regroupant un très grand nombre de personnalités du monde culturel et artistique se forme. André Malraux, ministre de la Culture, propose des solutions de rechange, mais rien n’aboutit.
1969 Devant les difficultés rencontrées pour créer La Passion, il quitte la France et s’installe à Berlin-Ouest, invité à la fois par le Sénat et l’université où il a de nombreux amis. Il travaille auparavant à Stuttgart – où il retrouve son vieil ami Hans Christian Blech, interprète de L’Enclos et qui va jouer le rôle principal dans son troisième film, Ubergang über den Ebro (Le Passage de l’Èbre), produit par la télévision ZDF – puis à Kassel où il réécrit La Naissance, qu’il met en scène au Staatstheater.
Il est beaucoup joué : V comme Vietnam à Berlin, Un homme seul à Celle.
Avant de quitter la France, il a écrit L’Interdiction ou Petite histoire de l’interdiction d’une pièce qui devait être représentée en violet, jaune et rouge, dans un théâtre national, dont Jean-Marie Lancelot s’empare pour le présenter avec des comédiens rescapés de l’aventure du TNP au théâtre de la Cité universitaire, puis en tournée en RFA et en France.
Le groupe V, dont ce sera les dernières activités, produit La Journée d’une infirmière, qui tourne en France. Elle est aussi montée par Pierre Chaussat et par Viviane Théophilidès au Théâtre populaire des Pyrénées.
La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est jouée au Piccolo Teatro de Milan, dirigé par Paolo Grassi qui invite à la première la mère d’Armand Gatti, l’épouse d’Auguste.
1970 Il travaille comme OS à Berlin pendant plusieurs mois, aux usines Osram. Les pièces du Petit manuel de guérilla urbaine, écrites l’année précédente, sont jouées de nombreuses fois en Allemagne, à Hanovre et Bremerhaven. Dominique Lurcel monte Les Hauts Plateaux à la Maison des jeunes et de la culture de Fresnes. En juin, Le Chat sauvage, nouvelle version d’Interdit aux plus de trente ans, texte dit collectif, est créé par Jean-Marie Lancelot.
1971 Rosa Collective est créée par Kai Braak, Günter Fischer et Ulrich Brecht, à Kassel et La Cigogne par Pierre Debauche à Nanterre. Lucien Attoun, apprenant qu’Armand Gatti vient d’écrire un texte sur Rosa Luxembourg, l’invite à en faire une lecture au XXVe festival d’Avignon, dans le lieu qu’il vient d’ouvrir, la chapelle des Pénitents blancs.
1972-73 Invité par l’Université libre de Berlin, il y fait des conférences, en janvier et février 1972, sur le théâtre de rue (en URSS, Allemagne, Chine, USA, Vietnam, etc.) et sur sa propre expérience.
Henry Ingberg et Armand Delcampe, directeurs de l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Louvain, l’invitent à travailler avec leurs étudiants. C’est ainsi que vont naître : La Colonne Durruti ou Les Parapluies de la Colonne IAD (usine Rasquinet, quartier de Schaerbeek, à Bruxelles) et L’Arche d’Adelin (dans le Brabant wallon), travaux collectifs avec les étudiants, qu’il écrit et met en scène.
1974 Il rentre en France. Il finit d’écrire Quatre schizophrénies à la recherche d’un pays dont l’existence est contestée. Vu le succès de la lecture de Rosa Collective, Lucien Attoun l’invite au XXVIIIe festival d’Avignon, à la chapelle des Pénitents blancs, pour une nouvelle expérience : une mise en espace de son texte sur la colonne Durutti. Un stage, regroupant jeunes comédiens et élèves de l’IAD, s’organise en mai et juin, en Normandie. Cela donne La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?
Il travaille avec Marc Kravetz à un nouveau scénario sur une histoire de Mai 68 : Les Katangais, jeunes banlieusards engagés par les étudiants pour faire le service d’ordre de la Sorbonne.
1975 Devant le succès des représentations de La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?, le ministre de la Culture, Michel Guy, lui demande de lui proposer un projet. C’est ainsi que naît l’Institut de recherche des mass-média et des arts de diffusion. Cette structure, préfigurée par les expériences menées en Belgique, est présentée dans trois notes remises au cabinet du ministre.
Son retour en France correspond aussi à l’invitation de Jean Hurstel, directeur du Centre d’action culturelle de Montbéliard, qui lui commande « une pièce sur le monde ouvrier ». Ce projet se transforme en une vaste saga vidéo, Le Lion, sa cage et ses ailes, six films racontant une ville à travers son émigration. Pour produire cette série vidéo avec l’INA, il crée la société Les Voyelles avec Hélène Châtelain, Stéphane Gatti et Jean-Jacques Hocquard.
Avant de quitter l’Allemagne, il crée un dernier spectacle au Forum Theater sur les femmes résistantes allemandes : La Moitié du ciel et nous en hommage à Ulrich Meinhof.
Le festival d’Automne, dirigé par Alain Crombecque, lui propose de venir créer un spectacle. Il choisit de s’installer dans un CES à Ris-Orangis et de travailler à la fois avec des comédiens, les jeunes du CES et deux journalistes, Pierre Joffroy et Marc Kravetz, coauteurs et interprètes de l’une des pièces issues de l’expérience, Le Joint.
1976-77 Le théâtre Le Palace, dirigé par Pierre Laville, produit la nouvelle version de La Passion du général Franco par les émigrés eux-mêmes. Ne voulant pas s’installer dans un théâtre classique, il crée le spectacle dans les entrepôts Calberson. Parmi les spectateurs, Gilles Durupt et Gabriel Cohn-Bendit, responsables de la Maison des jeunes et de l’éducation permanente (MJEP) de Saint-Nazaire, veulent faire venir le spectacle dans leur ville.
De cette invitation, c’est un tout autre projet qui naît : Le Canard sauvage qui vole contre le vent, création collective autour de la dissidence soviétique. Viendront dans la ville ouvrière de nombreux invités : André Glucksmann, Franco Bassaglia, Robert Castel, Félix Guattari, Claude Lefort et plusieurs dissidents, dont Leonid Pliouchtch et son épouse Tatania Jitnikova, Victor Nekrassov, Vadim Delauney, Natalia Gorbanevskaïa, le syndicaliste Victor Feinberg et celui pour qui cette action a été imaginée, Vladimir Boukovsky. L’expérience commence en septembre 1976 et le travail sera présenté sous chapiteau au milieu d’une exposition en février 1977. Parmi les participants, les frères Dardenne, ses anciens élèves à l’IAD, et le jeune écrivain Michel Séonnet, dont les chroniques de l’événement seront publiées dans un livre… trente ans après.
1977 En début d’année, est projeté à Montbéliard, Le Lion, sa cage et ses ailes en présence des communautés avec lesquelles ce film a été tourné.
Faisant suite au travail de Saint-Nazaire, il écrit Le Cheval qui se suicide par le feu, que Lucien Attoun invite au XXXIe Festival d’Avignon, à la chapelle des Cordeliers. Ce spectacle est conçu comme une série de lectures et de séances de travail publiques, en présence de témoins : Alexandre Galitch, Tania et Leonid Pliouchtch.
Il est invité en Irlande, par l’University College de Dublin, à une représentation de La Cigogne traduite et mise en scène par Joseph B. Long.
1978 Invité une nouvelle fois par Joseph B. Long, il fait une tournée de conférences en Irlande et en Grande-Bretagne. Il rencontre alors Paddy Doherty, directeur du workshop de Derry (Ulster).
En octobre, la Tribu – nom qu’il donne aux personnes qui travaillent avec lui – s’installe dans la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau (entre Lyon et Grenoble) avec pour projet de « donner quelques instants de plus à vivre, à travers votre imaginaire » à Roger Rouxel, l’un des vingt-trois fusillés du groupe Manouchian au mont Valérien. Cette création débouche sur la réalisation de six films vidéo sous le titre La Première Lettre.
1979 Joseph B. Long donne deux représentations de La Deuxième Existence du camp de Tatenberg à Canterbury et Belfast, auxquelles il assiste. Il retourne en Ulster pour imaginer un projet de film et d’écriture avec le workshop de Paddy Doherty à Derry.
En août, il s’installe pour un an, avec une bourse d’écriture du ministère de la Culture, dans le Piémont, dans la maison héritée de sa mère décédée l’année précédente, à Pianceretto. La Première Lettre est diffusée sur FR3, et Libération publie alors un très long entretien, sur six numéros, avec Marc Kravetz (édité en 1985 sous le titre L’Aventure de la Parole errante).
1980 Huit versions de La Parole errante sont écrites. Les sept premières sont brûlées, la huitième restera à l’état de manuscrit jusque dans les années 1990. Il s’agit de la confrontation de « tous les Gatti ayant existé » avec l’Histoire, l’Utopie et l’Ecriture.
1981 Installation en Irlande du Nord (Derry) dès janvier, pour préparer le tournage d’un film. Commencé le jour de la mort du premier volontaire des grèves de la faim, Bobby Sands, le 5 mai, il se terminera le jour de la mort du dernier, Micky Devine, le 20 août. Nous étions tous des noms d’arbres est coproduit par la télévision belge, une société irlandaise spécialement créée par la communauté des habitants de Derry et la société de production des frères Dardenne.
1982 Le ministère de la Culture lui propose de s’installer à Toulouse pour y créer l’Atelier de création populaire. Appelé l’Archéoptéryx, cet atelier est inauguré, après travaux, dans un ancien restaurant universitaire.
Nous étions tous des noms d’arbres obtient le prix Jean-Delmas au Festival de Cannes et l’attribution du meilleur film de l’année au festival de Londres l’année suivante.
Le ministère des Relations extérieures l’invite à se rendre au Canada (Québec, Montréal, Winnipeg, Toronto, Ottawa), puis à Chicago où il recherche les traces du passage de son père.
Le Labyrinthe, pièce écrite en Irlande, est créée en mai, à Gênes, puis au Festival d’Avignon. Y sont invités, les familles des grévistes de Long Kesh et Paddy Doherty. Les personnages de l’histoire réelle sont confrontés à la pièce.
1983 Il commence l’écriture d’un nouveau scénario qu’il voudrait tourner à Toulouse, La Licorne, qui devient une pièce de théâtre : Opéra avec titre long.
L’Archéoptéryx programme un « Cycle des poètes assassinés » inauguré avec Bobby Sands et des poètes irlandais, dont la mise en scène de La Nuit de Cuchulain et du Seuil du royaume de W. E. Yeats. Suivent, Jacques Stephen Alexis, avec l’adaptation et la mise en scène de son texte La Sauterelle bleue, et Otto‑René Castillo : il crée, sous le nom de Blas Tojonabales, Retour à la douleur de tous ou la route de Zacapas et, sous le nom de Genitivo Rancun, La Crucifixion métisse. De mai à décembre, tous les mercredis et samedis après‑midis, ouverture de Radio Astrolabe sur les ondes de Canal Sud. Un journal est créé, L’Archéoptéryx et son œuf géant, dans lequel il publie un poème éditorial, Occitanie. Viennent pour des conférences et débats : Rafael Alberti, Jean‑Pierre Changeux, Serge July, la Fédération anarchiste, Michel Auvray, Jean Delumeau, Michel Vovelle, Philippe Ariès, Jean‑Paul Aron.
Accueil de Manuel José Arcé, poète guatémaltèque, jusqu’à sa disparition en 1985.
1984 L’atelier consacre son année à l’URSS sous le titre : «1905-Russie/1917/URSS-1935 » : exposition La Victoire sur le soleil : Khlebnikov/Malevitch, rétrospective du cinéma muet soviétique des années 1920-1930 avec la Cinémathèque de Toulouse, diverses créations dont La Révolte des objets de Maïakovski, dans laquelle il joue le rôle de l’auteur.
Premier stage avec le Collectif de recherche sur l’animation, la formation et l’insertion (Crafi) autour de Nestor Makhno : L’Émission de Pierre Meynard.
Accueil de Michel Serres, Jean-Michel Palmier, Michel Lépine et Alain Robbe-Grillet.
Le ministère des Affaires étrangères lui commande une présentation de l’ensemble de son œuvre audiovisuelle : Le Poème cinématographique et ses pronoms personnels dont le titre pourrait être l’Internationale.
Il est invité à lire Opéra avec titre long au Palais de Chaillot par Antoine Vitez (qui aurait voulu créer la pièce à la Comédie-Française). Voyageant en Autriche sur invitation du Centre culturel français de Vienne, il assiste à la générale de La Deuxième existence de Tatenberg à l’Akademie Theater.
1985 L’Archéoptéryx organise un mois sur la Résistance allemande, en collaboration avec le Goethe Institut et la librairie Ombres blanches.
Avec le deuxième stage du Crafi, il crée Le Dernier Maquis, représenté au Centre Georges-Pompidou, à l’invitation de Gabriel Garran, pour la première manifestation du Théâtre international de langue française (TILF), où il rencontre le poète québécois Garneau.
En août, fin de l’expérience à Toulouse.
1986 Naissance à Montreuil, à l’invitation du Centre d’action culturelle dirigé par Francis Gendron, de La Parole errante dont il est le directeur artistique et Jean-Jacques Hocquard le directeur administratif.
Invité par l’École nationale de théâtre de Montréal, il monte au théâtre du Monument national Opéra avec titre long, qu’il présente à cette époque comme « son testament ».
Réinvité par le Centre culturel français à Vienne, il anime un stage sur Ulrike Meinhof, présenté au Dramatisches Zentrum.
1987 À Montreuil, Les Arches de Noé, pièce créée par Hélène Châtelain lors du troisième stage du Crafi, est présentée au théâtre Berthelot dans le cadre de l’exposition 50 ans de théâtre vus par les 3 chats d’Armand Gatti. Des témoins de sa vie et de son œuvre en sont, pendant un mois, les guides : Robert Abirached, Lucien Attoun, Raymond Bellour, Alain Crombecque, Armand Delcampe, Bernard Dort, Gabriel Garran, Jean Hurstel, Pierre Joffroy, Marc Kravetz, Dorothy Knowles, Jean-Pierre Léonardini, Heinz Neumann-Riegner, Jack Ralite, Madeleine Rebérioux, Jacques Rosner, Max Schoendorff, Viviane Théophilides, Pierre Vial, André Wilms, Michel Simonot, Evelyne Didi, etc. L’exposition est invitée au XLIIIe Festival d’Avignon.
Invité par l’université de Québec à Montréal (UQM), il y crée Le Passage des oiseaux dans le ciel, adaptée du Poème cinématographique et jouée dans les locaux universitaires.
Pour une exposition à Turin, il écrit sur sa mère Ton nom était joie, poème édité par La Parole errante.
1988 Le ministre de la Culture, Jack Lang, lui remet le Grand Prix national du théâtre.
Invité à l’université de Rochester (État de New York), il y adapte Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz au contexte social américain.
De retour à Toulouse, il travaille sur la Révolution française et crée avec le quatrième stage du Crafi Nous, Révolution aux bras nus.
Il écrit la suite de Letizia : L’Homme qui volait avec des plumes de coq, sur son père. Ton nom était joie, scénario-poème filmé par Stéphane Gatti, obtient le prix Télérama du Festival de Montbéliard en septembre.
1989 Il célèbre le bicentenaire de la Révolution française en créant Les Combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec douze détenus.
Un colloque international « Salut Armand Gatti » est organisé par l’université de Paris 8 par Michelle Kokosowski et Philippe Tancelin. Il reçoit à Asti le prix Alfieri, récompensant « un grand poète français d’origine italienne ».
Jack Lang, ministre de la Culture, lui confie la mission de mettre sur pied un lieu où des auteurs de langue française pourront « confronter leur écriture avec des groupes aussi diversifiés que des jeunes éloignés de toute culture classique et certains professionnels du théâtre ».
Répondant à une commande de René Gonzales, directeur de la Maison de la culture de Bobigny, et de Robert Abirached et à la demande de Michelle Kokosowski, il écrit Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz qu’il lit à la Maison de la culture de Bobigny.
1990 Il s’installe à Marseille à l’invitation de Dominique Wallon, directeur des Affaires culturelles de la Ville. Traitant de la montée du fascisme et en souvenir de l’environnement de son enfance, il écrit sur Mussolini Le Cinécadre de l’esplanade Loreto reconstitué à Marseille pour la grande parade des pays de l’Est. Le spectacle est joué par un nouveau groupe de jeunes en stage de réinsertion.
1991 Alain Crombecque, voulant développer le Festival d’Avignon dans sa banlieue, fait appel à lui pour imaginer un travail avec des jeunes de la « périphérie ». C’est ainsi que naît Ces empereurs aux ombrelles trouées. Parution de OEuvres théâtrales aux éditions Verdier.
1993 À l’initiative de Philippe Foulquier, directeur de la Friche de la Belle de Mai et avec le soutien très actif de l’adjoint à la Culture, le poète Julien Blaine, Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz, parcours théâtral en sept lieux de Seine-Saint-Denis, est repris à Marseille. Il y devient Marseille Adam quoi ?, avec quatre-vingts jeunes. Le spectacle est présenté durant deux jours, dans dix lieux de la ville.
Invité en Egypte, il fait le voyage avec Michel Séonnet. Il y est nommé Chevalier du théâtre par le ministère de la Culture.
1994-95 Il reçoit la médaille de vermeil Picasso, attribuée par l’Unesco pour sa contribution exceptionnelle au développement du théâtre de notre temps.
Une fois encore, Jean Hurstel l’invite sur ses terres. Avec quatre-vingts stagiaires, il va créer à Strasbourg Kepler, le langage nécessaire, annoncé comme un work in progress sous le titre révélateur de son état d’esprit : Nous avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité. F. Nietzsche. Cette expérience sera très fructueuse en rencontres avec des scientifiques : Agnès Acker, Francis Bailly, Jean-Marie Bron, Guy Chouraqui, Baudoin Jurdant et Élisabeth Stengers. C’est le début de la saga de La Traversée des langages, marquée par sa découverte de la théorie quantique et de Jean Cavaillès.
1996-97 L’Enfant-Rat est créé à Limoges, au Festival des francophonies. Il crée L’Inconnu n° 5 du fossé des fusillés du Pentagone d’Arras à Sarcelles.
La Parole errante s’installe dans la Maison de l’Arbre, à Montreuil, sur l’emplacement des studios où Méliès inventa le cinéma de fiction, lieu que lui a attribué le conseil général de la Seine-Saint-Denis.
1998-99 Premier voyage en langue maya, expérience avec vingt-cinq jeunes de la Seine-Saint-Denis à La Maison de l’Arbre, est suivie, à Genève, de la création de Deuxième voyage en langue maya avec surréalistes à bord et des Incertitudes de Werner Heisenberg…
Parution de La Parole errante aux éditions Verdier.
Nommé chevalier de la Légion d’honneur, la décoration lui est remise par Dominique Wallon, directeur de la Musique, du Théâtre et des Spectacles au ministère de la Culture.
2000 Au Théâtre universitaire de Besançon, animé par Lucile Garbagnati, il participe au colloque « Temps scientifique et Temps théâtral » où il lit Incertitudes de la mécanique quantique devenant chant des oiseaux du Graal pour l’entrée des groupes de Galois dans le langage dramatique.
2001 À la Maison de l’Arbre, exposition-réponse à la question « Avec quels mots, avec quelles images inventer un lieu culturel ? »
Chant public pour deux chaises électriques est créé par Gino Zampieri à Los Angeles.
2002 Il lit Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide au Théâtre universitaire de Besançon.
2003 Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz est créé par Eric Salama à Genève, Incertitudes de la mécanique quantique… par Nicolas Ramond à Besançon et Le Couteau-toast d’Évariste Galois avec lequel Dedekind fait exister la droite en mathématiques… par lui-même au Théâtre universitaire de Franche-Comté, dans le cadre d’un stage réunissant des étudiants de quinze nationalités, au gymnase Fontaine-Écu, à Besançon.
2004-05 Il est fait commandeur des Arts et Lettres et reçoit le prix du Théâtre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).
2006 Il crée Les Oscillations de Pythagore en quête du masque de Dionysos à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, avec des étudiants français et étrangers. Il lit le poème Les Cinq Noms de Résistance de Georges Guingouin dans la forêt de la Berbeyrolle, sur le plateau de Mille-Vaches, en Corrèze.
2007 Première rétrospective complète de ses films au Magic Cinéma de Bobigny et lecture du Passage des oiseaux dans le ciel par la Comédie-Française, retransmise en direct sur France Culture.
À l’occasion d’une soirée poétique sur son œuvre à l’église Saint-Bernard (Paris 18e), la grande médaille de vermeil de la Ville de Paris lui est remise.
2008 Dans le cadre d’une exposition « Mai 1968-mai 2008 », lectures et mises en scène de quatre pièces du Petit manuel de guérilla urbaine au Nouveau théâtre de Montreuil. L’exposition Comme un papier tue-mouches dans une maison de vacances fermée sur Mai 68 se tient à la Maison de l’Arbre. Au vernissage, il lit le poème Révolution culturelle, nous voilà !, l’une des préfaces de La Traversée des langages. À la clôture de l’exposition, Pierre Vial, sociétaire de la Comédie-Française, lit Un homme seul.
2009 Il lit le poème Les Arbres de Ville-Évrard lorsqu’ils deviennent passage des cigognes dans le ciel à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.
Première résidence « Refuges des résistances » dans le Limousin. Il lit Mon théâtre ? Un théâtre quantique ? au Centre d’art contemporain à Meymac et Révolution culturelle, nous voilà ! à la Maison de la Poésie, à Paris.
Le Joint est mis en scène par Eric Salama, à la Maison de l’Arbre.
2010 À la Maison de l’arbre, dans le cadre de l’exposition 1954, 1965, 1968, 2006 – Amérique latine, miroir de nos engagements dans le temps, représentations de La Naissance, mise en scène de Mohamed Melhaa, et du Quetzal, mise en scène d’Eric Salama.
À l’issue de la deuxième résidence dans le Limousin, il crée Science et Résistance battant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d’oiseau des altitudes avec trente étudiants français et étrangers, au gymnase du lycée forestier de Neuvic.
2011 À la Cinémathèque française, à Paris, rétrospective et débats autour d’« Armand Gatti cinéaste, L’Œuvre indispensable ».
2012 À la Maison de l’Arbre, une exposition de Stéphane Gatti Hypothèses de travail pour entrer dans La Traversée des langages d’Armand Gatti, est associée à des rencontres, des projections et des représentations de Rosa Collective, mise en scène par Armand Gatti et de La Cigogne par Matthieu Aubert.
La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est mis en scène par Emmanuel Deleage à Los Angeles. La nouvelle promotion de L’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) à Lyon porte son nom.
Il lit Les Pigeons de la grande guerre après la projection du film Il tuo nom era Letizia au Théâtre de la Girandole, à Montreuil, avec la participation de la chorale de Pianceretto, le village de sa mère.
2013 Il lit Révolution culturelle, nous voilà ! à la Comédie de Saint-Etienne et Limoges, et le poème Mort-Ouvrier à Carcassonne. Il lit Le ?, un tableau de Bernard Saby à la galerie Aliceday de Bruxelles et à la Maison de l’Arbre, dans le cadre de l’exposition Bernard Saby Variations réalisée par Stéphane Gatti.
Prix du Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre
2014 Pour ses quatre-vingt-dix ans, en janvier-février à la Maison de l’Arbre, reprise de Ces empereurs aux ombrelles trouées, qu’il met en scène avec Matthieu Aubert, et de Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue, par Jean-Marc Luneau.
En mars, France Culture rediffuse Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue et Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide.
Juillet : Création de Résistance selon les mots, texte et mise en scène d’Armand Gatti avec avec les étudiants de la 74e promotion de l’ENSATT, l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne, l’Université de Lyon. Représentation le 29 juillet à l’ENSATT (studio Lerrant), Lyon, à l’occasion du Festival « Les Nuits de Fourvière ».
Décembre : sortie numérique de L’Enclos (Clavis Films)
2015 Janvier : Editions de deux textes inédits.
– La Mer du troisième jour, poème inédit d’Armand Gatti illustré par Emmanuelle Amann aux éditions Æncrages & Co.
– Ces empereurs aux ombrelles trouées aux éditions L’Entretemps. Pièce d’Armand Gatti. Création en 1991 au Festival d’Avignon. Nouvelle mise en scène en janvier 2014.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2017 7:43 PM
|
Par Patrick Sourd pour Les Inrocks
David Geselson s’empare d’une histoire vraie pour dire l’amour fusionnel qui amène un couple à se suicider ensemble, plutôt que d’accepter que la mort ne les sépare à jamais. Bouleversant.
Le spectacle commence dans l’ambiance d’une de ces soirées sans chichis où l’on convie aussi bien les voisins que le cercle des amis. Une grande table est dressée pour l’apéritif. Ce couple, qui souhaite à chacun la bienvenue, nous accueille dans le désordre de son salon, entre des piles de livres et la platine disques. “On a préparé du thé ; il y a du vin, c’est du bourgogne ; et il y a de la tarte aux cerises aussi.”
Avec Doreen, le metteur en scène David Geselson propose un théâtre documentaire cadrant la sphère de l’intime, pour revenir avec justesse et une grande délicatesse sur les conditions d’un suicide à deux qui défraya la chronique des faits divers en septembre 2007.
Un incroyable amour
C’était un an après le succès en librairie du livre du journaliste et philosophe André Gorz, qui sert de point de départ à cette enquête. Après cinquante-huit années de vie commune, Lettre à D. – Histoire d’un amour se présente comme une ultime déclaration d’amour faite à sa femme, Doreen Keir, atteinte d’une maladie incurable.
Suite à une piqûre de Lipiodol dans la nuque lors d’un banal examen radiographique, le destin de Doreen est scellé dès 1967. Le produit de contraste ne s’élimine pas et elle développe au cerveau une toile d’araignée kystique inopérable.
David Geselson et Laure Mathis n’ont pas l’âge de leurs personnages. Cette jeunesse flagrante brouille les pistes du réalisme pour inscrire la pièce dans un temps suspendu, celui de l’incroyable amour qui les unit. Bien plus qu’une cérémonie des adieux, Doreen s’attache, sur le ton de la confidence, à faire le récit des mille et une anecdotes qui racontent l’histoire d’une vie à deux.
Partager “l’impensable”
Bien avant de s’installer en France, ils se rencontrent à Lausanne. Elle est anglaise, il est né en Autriche. Ils se marient en 1949. On rit d’apprendre que la mère de l’écrivain, qui n’avait pas encore choisi de prendre pour nom de plume le pseudonyme André Gorz, avait alerté son fils sur le danger de ce mariage. Ayant commandé une analyse graphologique de l’écriture respective des futurs époux, elle était persuadée que leurs personnalités étaient incompatibles.
Du coup de foudre de leur première danse à l’enfer de partager son existence avec un écrivain, chacun raconte sa version des événements, et l’on s’amuse de la confirmation que la loi du genre est de n’être d’accord sur rien dans un couple. Elle nous confie ses rêves, lui cite Heidegger : “Notre tâche est de penser l’impensé et l’impensable de nos pensées.” Ni l’un ni l’autre ne croient en l’au-delà. On est bouleversé quand ils s’éclipsent. On sait juste qu’ils ont décidé de demeurer ensemble pour partager “l’impensable”. On les sait unis pour l’éternité.
Doreen d’après Lettre à D. – Histoire d’un amour d’André Gorz, mise en scène David Geselson, avec lui-même et Laure Mathis, les 5 et 6 avril à Rennes, Théâtre national de Bretagne, dans le cadre du Festival Mythos. En tournée jusqu’en mai 2018

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2017 3:04 AM
|
Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama
Il est convaincu que la culture peut résoudre beaucoup de choses. Et pourtant, faute de propositions fortes, l'homme de théâtre (et de gauche) ne s'y retrouve pas. Rencontre avec Stanislas Nordey.
Il assume déjà tous les métiers de la scène : directeur du Théâtre national de Strasbourg, metteur en scène, acteur chez les autres dès qu'il le peut… Néanmoins, Stanislas Nordey, qui appartient à cette génération de quinquas aujourd'hui au pouvoir dans l'institution, trouve du temps pour suivre de près la campagne présidentielle. Via la lecture quotidienne de la presse écrite, et à la source, sur les sites des candidats dont il a épluché par le menu tous les programmes.
Quel regard portez-vous sur la campagne ?
Elle existe, contrairement à ce que tout le monde dit, même si les grands médias mettent le paquet sur les affaires. Chacun des candidats trace des lignes auxquelles on peut s'identifier ou pas. En revanche, certains secteurs sont laissés de côté… comme la culture : le silence de tous sur ce sujet (y compris des petits candidats, car Yannick Jadot, quand il était encore en campagne, n'en faisait pas grand cas non plus), est frappant. La bonne surprise, si j'en juge par le prisme des médias car je ne suis pas immergé dans le réel des meetings, est que le thème sécuritaire n' a pas dévoré toute la place… On parle surtout social et économie.
“Si le mot ‘culture’ surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague !”
Comment expliquez vous une telle absence des sujets culturels ?
Absence telle que si le mot « culture » surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague ! Les politiques n'en sont pas les seuls responsables. Les éditorialistes et les commentateurs relèguent la culture dans un angle mort. Mais je ne devrais pas vous dire cela à vous, Télérama, qui en avez organisé Les Etats Généreux. Au vu des récents attentats et des fractures en cours dans la société, il est très dommageable, voire aberrant, d'assumer une telle impasse.
Sans être un doux utopiste, j'en suis convaincu : la culture est un terrain où l'on peut résoudre beaucoup de choses. Ce n'est pas davantage de plan vigipirate qu'il faut porter dans les territoires abandonnés, mais plus de culture et d'éducation. Les deux sont indissociables : transmission des savoirs et ouverture d'esprit passent par ce carrefour-là. Je le sais parce que je l'ai souvent expérimenté moi-même en faisant des ateliers dans les quartiers : des gamins que les profs disaient perdus, en proie à l'exclusion, à l'abandon, à l'intolérance et à la haine de l'autre se réveillent parce qu'ils rencontrent quelque chose qui les touche.
On voit pourtant dans beaucoup de programmes une volonté de renforcer la présence de l'art à l'école : chez Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, ou Emmanuel Macron par exemple…
Certes mais cela reste vague : aucun n'affiche clairement les moyens qu'il y met. Or il faut un arbitrage budgétaire, car cela coûte cher. Je ne sens pas émerger le désir d'un projet d'ampleur comme le fut le plan Lang-Tasca [en décembre 2000, ndlr]. C'est sans doute lié à l'affaiblissement, ces dernières années, du ministère de la Culture lui-même. Je n'ai rien à reprocher à François Hollande… L'une de ses grandes fautes, pourtant, est cette valse de trois ministres en cinq ans : un vrai manque de sérieux, car, pour construire, il faut du temps.
“J’aurais rêvé d’une candidature de Christiane Taubira, parce qu’elle aurait truffé ses discours de citations de poètes !”
Qu'est ce que vous attendez d'une élection présidentielle ?
Je suis un incorrigible gauchiste même si je n'ai jamais été encarté nulle part. J'ai été politisé très tôt : je défilais dans la cour d'école primaire en 1974 avec des pancartes « Mitterand Président/Giscard au placard » ! Si j'ai aimé Mitterrand, c'est parce qu'il lisait et écrivait lui-même. A l'inverse, pendant l'une des dernières mandatures, on a eu un président (Nicolas Sarkozy) qui ne finissait jamais ses phrases… Aujourd'hui, j'aurais rêvé d'une candidature de Christiane Taubira, parce qu'elle aurait truffé ses discours de citations de poètes ! Les candidats, toujours si prompts à parler de « LA » France, évoquent pourtant rarement sa langue et sa littérature…
Sur le plan politique, la présidentielle est un instant démocratique fort et j'y crois beaucoup : les citoyens se retrouvent ensemble pour parler du monde dans lequel ils vivent ou dans lequel il veulent vivre. Et des directions à prendre, en fonction de ce qui a été fait et de ce qui pourrait être fait. On attend toujours des candidats qu'ils définissent leur projet de société… Il y a bien des choses ici ou là. Mais la cohérence d'un geste fort se fait attendre.
Qu'est ce qui a changé depuis… 1974 ?
Ce qui ne change pas, c'est l'absence de femme ! Pourquoi donc, en politique, n'arrive-t-on pas à rendre effective la parité ? La diversité de la France multi-culturelle d'aujourd'hui n'est pas présente non plus ! Comme au parlement, tout cela reste très paresseux. La société civile bouge donc plus vite que nos responsables politiques. Le grand renouvellement n'est pas là : François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, sont tous en piste depuis plus de trente ans. Emmanuel Macron est le plus jeune, mais il est quand même loin du profil des Podemos ou des hommes de la société civile. Nous sommes encore encalminés dans quelque chose de très traditionnel.
“Je ne sais pas pour qui je vais voter, et vu la faiblesse des projets, ce n’est pas la culture qui déterminera mon choix”
Les querelles d'appareils, elles, sont toujours vivaces : en tant qu' homme de gauche, je ressens une colère très forte de voir que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont été incapables de fusionner. Ce sentiment est très partagé ; je l'entends beaucoup autour de moi. Visiblement, ces politiques n'ont pas compris ni écouté ce qui bouge dans la société : le rapprochement, le dépassement des barrières. On dirait qu'ils remettent des frontières partout ! Emmanuel Macron semble l'avoir senti, mais je ne sais pas s'il est capable d'incarner vraiment ces déplacements sensibles aujourd'hui dans la population… Des déserteurs du PS iront vers lui, d'autres vers Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Moi, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Au vu de la faiblesse des projets, ce n'est pas la culture qui déterminera mon choix.
Les artistes peuvent-ils prendre une place dans la campagne ?
Si la culture y avait toute sa place, cela aurait du sens, oui. Mais là, s'il s'agit de parler de l'ISF ou du terrorisme, ce n'est pas mon rôle. Soutenir tel ou tel candidat ? Ce n'est pas passionnant non plus comme position : s'agit-il de se faire plaisir ou de s'attirer les bonnes grâces de notre favori, s'il est élu ? Si d'aventures, de Fillon à Mélenchon, l'un ou l'autre parmi les principaux candidats avait besoin de mon éclairage pour bâtir son projet, je le ferais volontiers. Mais cela n'arrivera pas à l'occasion de cette présidentielle : quand les politiques cherchent à organiser des déjeuners avec les artistes, c'est surtout pour faire joli. Rarement pour engranger des idées nouvelles ou tenir compte d'expériences concrètes.
Vous êtes pessimiste…
Pas du tout ! Au fil des affaires, je vois poindre la nécessité d'un renouvellement profond de l'espace politique. La moralisation de la vie publique en est un aspect ; la façon de faire de la politique, encore un autre. La vieille manière d'exister sur ce terrain va disparaître avec la retraite des « éléphants » ! Si cela n'arrive pas dans cette présidentielle, ça sera pour la prochaine… ou pour la suivante.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 3, 2017 7:28 PM
|
Par Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale) dans Le Monde
Christine Letailleur met en scène la pièce de jeunesse de l’auteur allemand, servie par la magnifique interprétation de Stanislas Nordey.
Le jeune Brecht. Il a à peine plus de 20 ans. Il a l’œil canaille et aussi noir que sa veste de cuir. 1919, le monde sort de la guerre, de la boucherie, la jeunesse ne croit plus à rien. Le noir de l’anarchie revêt ce Brecht des débuts, qui n’est pas encore un héraut du communisme, et qui écrit Baal, sa première pièce.
Que faire quand on a 20 ans dans un monde en miettes, sinon bouffer la vie par tous les bouts, avec voracité ? C’est ce qu’il fait, ce premier (anti-)héros brechtien : Baal bouffe, baise et boit, Baal est bestial, mais il est aussi poète, il accueille en lui les ciels violets de la nuit, et les étés sauvages et rouges. Il ne s’attache à rien, et renvoie au monde, en pleine figure, sa médiocrité. Il y a en lui du Villon, du Verlaine, du Rimbaud.
Rien d’étonnant à ce qu’il revienne vagabonder sur les chemins du théâtre, ces temps-ci, un siècle après sa naissance. Après avoir déjà rôdé par-ci, par-là, ces dernières années, le revoilà, tel que le voit la metteuse en scène Christine Letailleur, et tel que l’incarne Stanislas Nordey. Le spectacle, qui a été créé au Théâtre national de Bretagne (TNB), à Rennes, est présenté au Théâtre national de Strasbourg, puis au Théâtre de la Colline, à Paris, jusqu’à fin mai.
STANISLAS NORDEY N’A A PRIORI NI LE PHYSIQUE NI L’ÂGE DU RÔLE, AVEC SON ALLURE CHRISTIQUE DE GRAND JEUNE HOMME DE 50 ANS
Et c’est un Baal surprenant, notamment pour ceux qui ont vu le film réalisé par Volker Schlöndorff en 1969, et dans lequel Rainer Werner Fassbinder jouait le côté bestial et jouisseur de Baal avec une violence opaque et dérangeante. Stanislas Nordey n’a a priori ni le physique ni l’âge du rôle, avec son allure christique de grand jeune homme de 50 ans.
Mais il s’agit ici non pas tant d’incarner des personnages que de déployer la pièce comme un paysage : non pas un paysage réaliste, mais un monde mental et onirique. Ce sont les ciels mauves et bleus, les lumières rouges des bouges qui nimbent la belle mise en scène de Christine Letailleur, qui va voir du côté du cinéma muet, du théâtre d’ombres et du cabaret.
Plus désespéré que débauché
Et le Baal de Stanislas Nordey, qui pourrait être le frère des personnages pasoliniens et du Hinkemann d’Ernst Toller déjà incarnés par l’acteur, tend ses longs bras vers les étoiles, plus qu’il ne s’incorpore à la terre brune de la forêt, à la sauvagerie de la nature. C’est un Baal plus poète que bête, plus désespéré que débauché, dont le long corps mince est comme une ligne pure qui viendrait trancher sur le magma humain.
« Vous vivez trop mal, dit-il au début de la pièce, alors qu’il a été invité en tant que poète dans ce genre de réception bourgeoise où les artistes jouent le rôle de cerise de gâteau. Pourquoi votre merde vaudrait-elle mieux que votre bouffe ? (…) Pas un ne vit. Tous veulent régner. Tous ne veulent que régner. Ce n’est pas de l’ambition. Rien que de la vanité. »
LES PERSONNAGES FÉMININS NE SONT PAS ASSEZ TRAVAILLÉS, ET LES ACTRICES EN ROUE LIBRE
Les plus belles scènes du spectacle, alors, sont celles qui voient Stanislas Nordey et Vincent Dissez, autre acteur magnifique, qui joue Ekart, double, ami et amant de Baal, se dresser dans l’immensité de la nuit, dans le ciel du théâtre et du monde, qui va bientôt les avaler. On aimerait que l’ensemble du spectacle soit à l’avenant, ce qui n’est malheureusement pas le cas, en raison de la trop grande disparité entre des acteurs insuffisamment dirigés. Les personnages féminins, notamment, qui certes n’ont pas le beau rôle dans la pièce, ne sont pas assez travaillés, et les actrices en roue libre.
C’est un Baal un peu trop sage, malgré l’excellente traduction d’Eloi Recoing, à la poésie concrète et tranchante. Reste la beauté d’une pièce qui n’a ni dieu ni maître, et cet autoportrait de Brecht en jeune poète maudit dans un monde ravagé. « Je vis de l’inimitié, moi, tout m’intéresse dans la mesure où je peux le bouffer. (…) Vos ventres je les bouffe et vos boyaux j’en garnis ma guitare, de votre graisse j’enduis mes chaussures si bien qu’elles ne me serrent pas quand je danse de joie ni ne craquent quand je fuis. » Baal le barbare sera bien achevé. Mais il meurt sous le scintillement des étoiles.
Baal, de Bertolt Brecht (traduit de l’allemand par Eloi Recoing, L’Arche éditeur). Mise en scène : Christine Letailleur. Théâtre national de Strasbourg, 1, rue de la Marseillaise, Strasbourg. Tél. : 03-88-24-88-24. Du 4 au 12 avril. Puis au Théâtre national de la Colline, à Paris, du 20 avril au 20 mai, et à Amiens, les 23 et 24 mai.
Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale)
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2017 5:14 PM
|
Rencontre le 8 avril à 14h au TNS
Rencontre avec Olivier Neveux, animée par Marie-José Sirach à l'occasion des représentations de Baal de Bertolt Brecht mis en scène par Christine Letailleur
Jean Genet représente la figure majeure de celui qui vécut terriblement entre révolte et littérature. Un point de départ, un modèle, un exemple pour insuffler une investigation et des questions qui portent sur cette articulation aussi rageuse que troublante.
Olivier Neveux, professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’École normale supérieure de Lyon et rédacteur en chef de la revue Théâtre/Public, il publie un essai "Le théâtre de Jean Genet" chez Ides et Calendes. Comment le théâtre peut-il être gros d’un potentiel de négativité et de révolte ?
Photo (c) Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2017 12:38 PM
|
Par Arnaud Maïsetti sur son blog arnaudmaisetti.net
Début du texte :
Genet, quelle leçon ? Aucune. Exemplaire au sens où il l’entendait – exemplaire unique, l’œuvre de Genet demeure sans exemple ni devenir, sans héritage. Mais lire Genet, après lui, encore, est un mouvement qui porte en lui une nécessité inquiète.
Le lire : et lire dans ces textes davantage que des textes, mais la pensée intraitable pour notre présent. Quelque chose qui s’expose à son propre risque, qui m’expose à ce qui déborde le seul acquiescement à un monde, à une œuvre. Et pourtant, retour incessant à Genet (ses romans, et puis, peu à peu ces dernières années, son théâtre de nouveau, que j’avais délaissé), retour qui est toujours de nouveau l’exposition au risque. Ne pas se payer de mots : aujourd’hui, Genet cité partout est devenu un classique, on lui arrache des phrases devenues des citations, on monte ses pièces dans les théâtres, on l’enseigne. Comment garder malgré tout — et même pour cette raison de la transmission — ce risque et cette inquiétude farouche ? Non pour le parfum du souffre, toujours à peu de frais rappelé et qui fait partie d’un discours officiel qui voudrait le cautionner aussi pour cela, mais dans l’impossible même de le lire. « Si mon théâtre pue, c’est que l’autre sent bon » [1] — parfum qui attaque.
Oui, que lire en lui, en nous, et dans ce monde qui est celui-là, qui a piétiné Genet et ne l’a pas convaincu, celui qui piétine à marche forcée tout ce qui nous rend ce monde encore désirable, et qui s’efface, que lire sinon cet effacement et ce crachat qui en lève la visibilité ?
On est après Genet — trente ans après, jour pour jour ou presque après la découverte de son corps dans cet hôtel du treizième arrondissement. Deux ans, j’aurais vécu tout près de cet hôtel sans grâce et sans lumière : on est trente après, mon âge presque, et on se demande si c’est après qu’on est, ou simplement dans cette fin interminée des choses qui a commencé avec le corps de Genet retrouvé seul, mort parce qu’il était seul dans cette chambre cette nuit-là où peut-être il a crié à l’aide : mais une mauvaise chute, seul, ne pardonne pas, et le cri était resté dans sa gorge peut-être, et dans sa solitude de l’hôtel triste du treizième arrondissement, la nuit du quinze avril — et on ne saura jamais, dans cette nuit, si c’était le quatorze ou le quinze : évidemment peu importe.
On est dans ce peu importe des choses quand elles sont mortes et que la vie seule demeure, encore, incertaine et fragile, mais essentielle, possible peut-être – qu’on est dans ce peut-être essentiel qui ne tiendrait qu’à nous, et qu’on cherche des forces dans des forces jetées sur la page non pour la réduire ou s’y réfugier, mais pour rendre cette vie inacceptable, inconvenante et impossible, essentielle malgré tout.
Et tout recommence alors, de Genet, et de ce qu’il laisse — de l’impossible vie contre laquelle il aura jeté toutes les forces, et d’abord contre nous.
Lire le texte complet sur son site d'origine : http://arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?article1893
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 9:35 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde :
Katharina Thalbach met en scène la pièce de Bertolt Brecht avec un parti pris trop appuyé pour convaincre.
La montée du nazisme fait une nouvelle fois l’objet d’un spectacle à la Comédie-Française, cette saison. A l’automne 2016, il y a eu Les Damnés, d’après le film de Luchino Visconti, mis en scène par le Flamand Ivo van Hove. Et voilà maintenant La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht, mise en scène par l’Allemande Katharina Thalbach. Le choix de ces textes et de ces metteurs en scène témoigne du renouveau souhaité et mis en œuvre par Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française : ouverture vers l’étranger, élargissement du répertoire.
La Résistible Ascension d’Arturo Ui n’avait jamais été présentée salle Richelieu, où Bertolt Brecht est entré avec Maître Puntila et son valet Matti, en 1976. Dans ces années-là, un brechtisme pur et dur régnait sur les scènes françaises, où on ne plaisantait pas avec l’orthodoxie du plus grand dramaturge allemand du XXe siècle (avec Heiner Müller, connu plus tardivement en France). Il a fallu beaucoup de temps pour que les metteurs en scène s’affranchissent de la rigueur grise et de la fameuse distanciation érigée en principe incontournable.
Héritage roboratif
Eric Ruf, qui est né en 1969, explique dans l’éditorial du programme de La Résistible Ascension… avoir été marqué, comme toute sa génération, par cet héritage roboratif. Parce qu’il voulait faire entendre Brecht aujourd’hui par quelqu’un qui lui redonne vie en partant du plateau, il a demandé à Katharina Thalbach de signer la mise en scène. C’est une première en France pour cette femme étonnante, qui n’a pas connu Brecht (elle avait 2 ans quand il est mort, en 1956), mais a grandi au Berliner Ensemble, dirigé par Helene Weigel, dont étaient membres ses parents, deux grands artistes, la comédienne Sabine Thalbach et le metteur en scène Benno Besson.
C’est peu de dire que les fées du théâtre se sont penchées sur le berceau de Katharina Thalbach, qui est elle-même devenue une comédienne exceptionnelle, et avoue avoir été fort surprise quand, étant passée à Berlin-Ouest, en 1976, avec son mari, l’écrivain Thomas Brasch, elle a découvert une vision de Brecht très éloignée de celle qu’elle avait. « Ils ne percevaient rien de son humour, de son intelligence, de sa modernité, de la précision avec laquelle, dans un langage éminemment poétique, il avait décrit les processus du capitalisme, un capitalisme qui continuait et continue à faire rage », déclare-t-elle dans un entretien à la Comédie-Française.
KATHARINA THALBACH A RACCOURCI LE TEXTE, DONT ELLE PENSE QU’IL DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS UN ESPRIT DE THÉÂTRE POPULAIRE
Katharina Thalbach, qui a très tôt fait de la mise en scène, n’avait jamais travaillé en France, ni monté La Résistible Ascension d’Arturo Ui, qu’elle a vue « des centaines de fois », dans son enfance, au Berliner Ensemble. Elle a raccourci le texte, dont elle pense qu’il doit être présenté dans un esprit de théâtre populaire, sans verser dans la psychologie ni s’accrocher au réalisme. Il y a ainsi, à la Comédie-Française, un côté théâtre de foire, un jeu très rapide, un goût marqué pour l’efficacité, et une vision revendiquée d’Arturo Ui : ce n’est pas seulement une figure politique – le double d’Adolf Hitler –, mais aussi une figure sociale – celle d’un gangster.
Noir, c’est noir : tout se passe sur un plateau noir, avec au sol un plan de Chicago, la ville où se situe l’action. Devant, une toile d’araignée recouvre l’ouverture de la scène. Le plateau, très en pente, recèle des trappes. Avec ce décor, signé Ezio Toffolutti, on entre immédiatement dans une zone à risques, une zone de déséquilibres, de pièges et de souricières, qui demande beaucoup d’adresse aux comédiens, vêtus à la manière des années 1930, maquillés d’une façon volontairement outrée et dirigés à la corde.
LES PERSONNAGES PRINCIPAUX AVANCENT À PEINE MASQUÉS : HINDSBOROUGH (HINDENBURG), GORI (GÖRING), ROMA (RÖHM), GOBBOLA (GOEBBELS), DULLFOOT (DOLLFUSS)
Katharina Thalbach ne veut pas donner une leçon sur la montée du nazisme, leçon à laquelle la pièce a souvent servi. Brecht a écrit La Résistible Ascension… quand il était sur la route de l’exil qui devait le mener d’Allemagne aux Etats-Unis, après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, en 1933. Il voulait « expliquer au monde capitaliste l’ascension d’Hitler en la transposant », selon ses mots. Autour d’Ui, le gangster qui veut prendre le pouvoir à Chicago, les personnages principaux avancent à peine masqués : Hindsborough (Hindenburg), Gori (Göring), Roma (Röhm), Gobbola (Goebbels), Dullfoot (Dollfuss).
Laurent Stocker exceptionnel
A la Comédie-Française, tous apparaissent comme des pantins pris dans les rets non pas de l’Histoire, mais d’une histoire que Katharina Thalbach traite comme une parabole sur les mécanismes implacables de l’argent et de la volonté de puissance. Ce parti pris pourrait être attractif. Il est décevant : trop lourd, trop énoncé, trop appuyé. Certaines scènes sortent du lot parce qu’elles s’accommodent de l’outrance, comme celle, fameuse, où Arturo Ui apprend grâce à un comédien l’art et la manière de parler et de se tenir si l’on veut devenir un homme politique.
Le reste du temps, on se demande pourquoi Katharina Thalbach demande à la troupe du Français de jouer comme si c’était une troupe allemande rodée à la tradition expressionniste. Quel que soit leur talent – et ils en ont à revendre –, les comédiens imitent cette tradition, sans la transcender. Sauf un : Laurent Stocker, exceptionnel dans le rôle d’Arturo Ui. Humanité défaite, virtuosité inquiétante, frilosité dangereuse, folie latente : dans son jeu, tous les éléments sont là, qui pourraient faire rire, tant l’homme paraît de piètre envergure. Ils mèneront au pire, parce que, hier comme aujourd’hui, « le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ».
« La Résisitible Ascension d’Arturo Ui », de Bertolt Brecht. Mise en scène : Katharina Thalbach. Comédie-Française, place Colette, Paris 1er. Mo Palais-Royal. Tél. : 01-44-58-15-15. De 5 € à 42 €. En alternance jusqu’au 30 juin. www.comedie-francaise.fr
Brigitte Salino
Journaliste au Monde
Photo (c) FRANÇOIS GUILLOT/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2017 11:26 AM
|
Sète veut se transformer... Un village culturel va sortir de terre à l'entrée Est de la ville. Ce pôle culture sera construit sur le site des anciens chais du quai des Moulins. Avec un objectif ambitieux : devenir le coeur d'un nouveau quartier qui accueillera 5.000 nouveaux habitants d'ici à 2020.
Par Fabrice Dubault Publié le 05/04/2017 à 08:48
Pour l'instant, le bruit des engins de chantier résonne sur le futur site du "village culturel" de Sète. Mais dans quelques mois, c'est une toute autre partition qui se jouera ici...
Le site fait 75 hectares. D'ici à 20 ans, il sera totalement réhabilité, restructuré et modernisé pour en faire un éco quartier, moderne et dynamique. Un nouveau pôle d'attraction éducatif, artistique et culturel de l'Île singulière.
Les anciens chais de la ville détruits par les pelleteuses vont laisser place au nouveau conservatoire de l'agglomération de Thau. Un édifice de 3.000 m2 qui pourra accueillir jusqu'à 1.600 élèves.
Ce conservatoire est la première pierre d'un projet global ambitieux pour l'entrée Est de Sète. Un chantier à plus de 10 millions d'euros.
Dans la partie voisine, un mécène va transformer ses entrepôts en lieu de culture. Le musée du MIAM devrait même y emménager...
Le nouveau complexe culturel sera composé d'un conservatoire, d'un musée, d'une salle de concert, de bars, le tout sur une friche industrielle.
Le projet sétois n'est pas sans rappeler les Docks des Suds à Marseille.
Il a d'ailleurs été conçu comme le coeur d'un nouvel éco quartier qui doit transformer cette entrée de la ville.
C'est l'architecte Rudi Ricciotti, l'auteur du Mucem de Marseille et du Mémorial de Rivesaltes qui a été sélectionné pour créer ce nouveau pôle culturel.
Voir le reportage de France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/anciens-chais-sete-vont-se-transformer-village-culturel-1227951.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 8:06 PM
|
Par Emilie Grangeray dans M le magazine du Monde
Allergique à l’autorité, le comédien a canalisé son ultrasensibilité dans le jeu. Il est à l’affiche de deux pièces à la Comédie-Française, dont il vient d’être nommé sociétaire.
En ce mardi 14 mars, Jérémy Lopez, 32 ans, a pour une fois mis un costume de ville. Nommé sociétaire de la Comédie-Française au 1er janvier 2017, comme sa camarade Georgia Scalliet, il apposera sa signature en bas de son contrat dans quelques instants. Pourtant, point de trac. Comme si le plus dur était derrière lui. Le comédien, qui joue actuellement dans La Règle du jeu et La Résistible Ascension d’Arturo Ui, n’était pas destiné au théâtre. « J’ai grandi en banlieue de Lyon, dans un milieu modeste. » Il dit cela avec la sincérité de celui qui a longtemps eu le sentiment de ne pas être à sa place. « J’avais un problème avec l’autorité, l’injustice. J’étais ultrasensible, ce que je n’arrivais pas à montrer en société, si ce n’est par la violence physique, verbale. J’ai arrêté l’école en seconde. »
Sur les conseils de sa mère, il s’inscrit à un cours de théâtre. Jérémy Lopez a 20 ans et, la rébellion chevillée au cœur, il manque se faire exclure. Mais il découvre qu’il aime ça, et s’accroche. Admis au conservatoire de Lyon, il enchaîne en 2007 avec l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Jean-Pierre Vincent et Alain Françon le repèrent et le recommandent à la Comédie-Française. Mais lui hésite à sauter le pas : « J’avais peur de quitter Lyon. Et puis j’avais une image du Français comme d’un lieu un peu ringard, pas sympathique. » Il faut l’entendre aujourd’hui parler de la maison. Avec tant d’amour et de reconnaissance !
« Populaire et classieux »
Il y est entré en 2010 pour jouer dans Un fil à la patte, de Feydeau, mis en scène par Jérôme Deschamps. Après avoir joué Horace dans L’Ecole des femmes de Molière, il « est » Ernesto dans La Pluie d’été, de Marguerite Duras. Un rôle dans lequel il a séduit Eric Ruf, l’actuel administrateur du Français : « Jérémy est un acteur à la fois populaire et classieux, ce qui est assez rare. Et puis j’adore ces comédiens dont on découvre les talents au fur et à mesure. » Il le choisit pour son Roméo et Juliette. « Roméo est un rôle-titre, mais ce n’est pas un rôle payant. Et Jérémy a réussi haut la main. » L’intéressé, lui, en parle comme d’une véritable « épreuve ». « Eric, en lequel j’ai une confiance aveugle, m’a demandé d’être un perdant. Ce qui m’a plu, bien sûr, mais c’est très dur de jouer 120 fois quelqu’un qui n’est jamais pris au sérieux et qui, quand il pleure, est moqué. J’y ai laissé énormément de plumes. »
Depuis, il est devenu Robert, personnage principal de La Règle du jeu, de Jean Renoir, mis en scène par Christiane Jatahy : « Avec elle, il faut incarner le personnage et non pas “faire” le personnage. Pour moi, c’est ça le travail de l’acteur : faire oublier la frontière entre fiction et réalité, montrer que le théâtre vit, que ça déborde même. » Le jeune homme n’en boude pas pour autant le cinéma. On le verra à partir du 12 avril dans C’est beau la vie quand on y pense, de Gérard Jugnot. Il aime se lâcher sur les plateaux de tournage – certains se souviennent du tandem hilarant qu’il formait avec Laurence Arné dans Filles d’aujourd’hui, minisérie diffusée sur Canal+.
Il reconnaît cependant avoir refusé plusieurs rôles au cinéma. Sa préoccupation, c’est surtout de ne pas perdre ce qu’il appelle son « premier monde », celui d’où il vient et où il retourne en août, quand le Français fait relâche. Il y a même embarqué le sociétaire Stéphane Varupenne, devenu l’un de ses amis : « Jérémy est quelqu’un de très famille, je pense que ça le rassure. Je joue auprès de lui un rôle de grand frère, mais il m’a apporté quelque chose d’inestimable : sa façon d’assumer pleinement qui il est. Sur le plateau, j’ai rarement vu un acteur aussi détendu, prêt à tout, et que rien ne déstabilise. »
« J’adore m’effacer pour le bien d’un spectacle, explique simplement Jérémy Lopez. Ça soulage de l’angoisse que l’on peut avoir. » L’entretien terminé, il croise un groupe de collégiens écoutant leur professeur. « Vous voyez, ça, ça m’angoisse encore. C’est l’école, pour moi. L’obligation d’être là, le devoir d’écouter. » Lui a choisi d’être ici.
« La Règle du jeu », de Jean Renoir, mise en scène Christiane Jatahy, jusqu’au 15 juin ; et La « Résistible Ascension d’Arturo Ui », de Bertolt Brecht, mise en scène Katharina Thalbach, jusqu’au 30 juin. Comédie-Française, Paris 1er.
Emilie Grangeray
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 6:29 PM
|
Sur le site de l'émission Ping Pong par Mathilde Serrell et Martin Quenehen, sur France-Culture :
A la table ce soir, Maripol, styliste et photographe pour l'exposition "Maripolarama", dans laquelle elle dévoile une série de Polaroïd pris à NY à la fin des années 70, jusqu'au 6 mai à la galerie Agnès b. à Paris et Laétitia Guédon, metteur en scène pour "Samo, A tribute to Basquiat", en tournée.
Emission à écouter en suivant ce lien : https://www.franceculture.fr/emissions/ping-pong/laetitia-guedon-maripol-sur-les-traces-de-basquiat
S P E C T A C L E : "Samo - A tribute to Basquiat" de Laétitia Guédon du 4 au 14 avril à La Loge à Paris, le 21 avril au Théâtre Victor Hugo, Bagneux, le 27 avril au Quai des Arts, Argentan.
Qui est samo ? Basquiat, Al Diaz et Shannon Dawson créent avec “ SAMO ” (anagramme de “Same Old Shit”), les prémices du graffiti. Basquiat est le moteur principal de ce projet et traduit son observation sensible du monde par des messages lapidaires inscrits, tagués, sur les édifices de l’environnement urbain new-yorkais. Les courts messages qu’il inscrit à l’époque sont déjà, avant ses toiles, des actes poétiques et politiques. La suite : la rencontre avec Warhol, la vitalité désespérée qui le conduit à cette production boulimique de tableaux, le succès, les trop nombreuses drogues et son entrée dans le funeste Club 27. Ce qui m’intéresse ici c’est l’avant, la période d’errance, de marche, de recherche, la période de signalétique, où à New York on se dit : “ qui est SAMO ? ” Ce moment où le très jeune homme au regard timide lance un mouvement artistique sans le savoir.
Une enquête : Une enquête pour savoir comment la parole, les mots de Koffi Kwahulé mettront un coup de poignard dans le silence du mur immaculé prêt à être peint. Une enquête pour savoir comment les torsions du corps du danseur Willy Pierre-Joseph viendront étrangler la sidération face au texte codé, ou prendre acte physique du jeune Basquiat errant de longues heures pour trouver le bon spot, la bonne place, le bon message. Une enquête pour savoir comment l’univers beat box et musical de Blade MC Ali M’baye viendra lapider le ghetto blaster d’époque crachant les prémices du hip hop de rue. Une enquête pour savoir comment Yohann Pisiou, comédien aux traits étrangement semblables à ceux du peintre, sait que “SAMO is not dead”. Une enquête avec le public pour se dire : Que laissons-nous comme trace pour nous raconter et raconter ce monde ? Laëtitia Guédon
Samo - A tribute to Basquiat• Crédits : Laétitia Guedon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 5:46 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Le « Programme commun » entre différents théâtres de Lausanne s’est achevé dimanche en beauté avec Rimini Protokoll, Milo Rau et Romeo Castellucci. Trois artistes, trois aventures qui creusent le fait théâtral. Rien ne les rassemble sauf l’essentiel : chacun de leurs spectacles ouvre une nouvelle brèche, fraie un nouveau sentier.
Midi à Vidy-Lausanne, un théâtre donnant sur le lac. René Gonzalès qui apercevait le lac depuis son bureau aurait apprécié ce que l’on peut voir dans la salle qui porte désormais son nom. C’est le privilège de certains morts. Leur nom survit au fronton d’une école, d’un gymnase, d’une rue, d’une salle de spectacles. Malade, René Gonzalès refusa jusqu’au bout de se préparer à sa mort qu’il savait proche. Il était trop dans la vie pour se soucier de sa postérité, se contentant du service minimum : ses proches.
Même si Gonzalès fut un mauvais client, le commerce de la mort est de plus en plus florissant comme tout ce qui tient à la fin de vie, laquelle va de bonus en bonus. Comment faire avec ce et ceux qu’on laisse ? C’est le sujet de Nachlass, le nouvel opus de Rimini Protokoll.
Post-scriptum de Rimini Protokoll
Comme toujours le metteur en scène Stefan Kaegi et son équipe – à commencer par le scénographe Dominic Huber mais aussi Katja Hagedorn (dramaturgie) et Bruno Deville (vidéo) – ont d’abord fait un énorme travail d’enquête auprès de ceux qui vivent avec la mort : unités de soins palliatifs, entreprises de pompes funèbres, cliniques suisses où l’on décide de sa fin, etc. Au final, un sas donnant sur huit petites pièces chacune fermée par une porte coulissante. Au-dessus de chaque porte, un compteur égrène le temps restant avant de pouvoir entrer. On va de pièce en pièce après un temps d’attente dans le sas.
Dans chaque pièce des objets, des meubles, parfois des chaises ou un lit où l’on peut s’asseoir. Un univers personnel. Et une voix off. Celle de celui, de celle qui va mourir. Alexandre Bergérioux nous parle de sa mort prochaine et de la façon dont il a pensé l’après. Atteint d’une maladie incurable, il tourne un film pour sa petite fille où on le voit pécher dans un torrent des poissons qu’il remettra à l’eau. C’est un souvenir qu’il partage avec sa fille, environ huit ans, suite au divorce du couple. On est assis dans sa chambre. Dans les tiroirs du lit, il a rangé la collection de mouches qu’il a lui-même fabriquées. Il se demande s’il sera mort quand on verra ce film. Renseignements pris, il ne l’est pas. Pas encore.
Jeanne Bellengi nous accueille autour d’une table jonchée de photos où on la voit rarement : c’est elle qui les prenait le plus souvent. Sur la table, deux réveils : elle travaillait dans l’horlogerie jusqu’à la retraite et vit à Neuchâtel. On entend sa voix. « Les photos sont un peu comme les corps des morts. On a un peu peur, mais après l’image est toujours très belle », dit-elle. Elle trouve que les photos embellissent les morts, « même les méchants ». Et confesse n’avoir jamais pleuré de sa vie, même en épluchant des oignons. Le jour où elle mourra, elle ne se pleurera pas.
Une date à graver
Cela Tayip est un commerçant turc à la retraite qui vit à Zurich. Il (sa voix) nous accueille sur un tapis comme chez lui, nous convie à manger un loukoum. Filmé, il effectue les repérages de ce qui sera son dernier voyage. On le voit chez un fabricant de cercueils aménager celui qui l’emmènera par fret aérien à Istanbul et de là dans un cimetière musulman où on l’enterrera dans un linceul, sans cercueil comme le veut la tradition musulmane, il sera allongé entre son père et sa mère. Tout est prêt, il n’y a plus que son nom et la date de sa mort à graver.
Une autre porte coulisse, nous voici dans un bureau de chef d’entreprise, un mobilier qui semble n’avoir pas bougé depuis des lustres. C’est celui du Dr Günther Wolfarth, président du conseil d’une banque du Bade-Wurtemberg à la retraite. Né en 1922, il a été blessé à la guerre. Membre du parti nazi ? Rien n’est dit. Sa voix alterne avec celle de son épouse, AnneMarie, un peu plus jeune que lui, ils ont décidé de mourir ensemble. Avec leur pactole constitué au fil des années, ils veulent financer les études de leurs petits-enfants en Europe et, entre autres, l’apprentissage de la langue allemande. La fille du couple est partie vivre au Brésil où elle a eu des enfants, lesquels ont appris le portugais. Elle a refusé qu’ils apprennent l’allemand.
Entre deux séjours (jamais plus de dix minutes) dans l’une des huit pièces, on se retrouve dans le sas aux lumières tamisées. Au plafond, une carte du monde fait le compte des morts au quotidien. A chaque fois, l’impression d’être dans une chambre mortuaire est de plus en plus prégnante ; on ne parle pas ou à voix basse, chacun est renvoyé à ses propres morts. Ce n’est pas morbide, c’est plutôt doux, apaisant. On vit de mieux en mieux avec la mort, nous disent les huit témoins en sursis.
Milo Rau, des handicapés et Pasolini
14h30, Théâtre de l’Arsenic, très actif centre d’art dans le haut de Lausanne, non loin de la gare. On est là pour voir Les 120 Journées de Sodome par Milo Rau. Tous les spectacles de Milo Rau opèrent un décalage, un décentrement qui éclaire le propos en lui donnant une forte tension dramaturgique. Ses sujets traversent l’actualité : la radio des mille collines au Rwanda à l’heure du génocide, « La déclaration de Breivit » (la défense du tueur norvégien lors de son procès), récemment les séquestrations et meurtres de Marc Dutroux, ou encore, régulièrement, les guerres des Balkans, de Syrie, d’Irak, l’exil, les réfugiés à travers des spectacles comme The Civils Wars ou Dark Ages (lire ici). Autant de sujets névralgiques abordés par le biais d’une mise en perspective narrative et d’une réflexion scénographique. Cette fois, Milo Rau – qui lui aussi travaille en équipe – part d’un film, pas n’importe lequel : le dernier film inachevé de Pier Paolo Pasolini, Salo ou Les 120 Journées de Sodome. Le cinéaste italien s’appuie sur Sade à la lumière de la République de Salo, dernier bastion du régime fasciste italien. Des jeunes gens des deux sexes sont séquestrés et obligés d’obéir au bon vouloir des maîtres de Salo. Jeux érotiques, rituels sexuels, tortures. Et au bout : la mort.
Milo Rau part de deux troupes existantes de Zurich, le Theater HORA, formé d’handicapés, et de la troupe du Schauspielhaus. L’un des handicapés a vu le film. Il se souvient d’un certains nombre d’images fortes. Et c’est cela qu’il rêve de mettre en scène et va filmer. Nous assistons donc au spectacle du tournage d’un film joué par une troupe de handicapés réputée, familière de la scène et de quelques acteurs d’une troupe professionnelle, réputée elle aussi. Le tournage reprenant certaines scènes de Pasolini : l’alignement des culs nus pour un concours, le jeune levant le poing avant qu'on ne lui tire une balle dans la tête, la copulation de deux jeunes gens devant les autres, la crucifixion du Christ. Jusqu’au festival des tortures : langue coupée, bite sectionnée, œil arraché, ventre ouvert dont on sort un fœtus, tout cela avec un art du détail réaliste qui va très loin mais s’arrête à la porte du supportable : cela semble vrai, mais c’est faux, c’est du théâtre. Et du théâtre, Milo Rau explore les limites. Conjointement, il questionne le voyeurisme au cœur même de tout théâtre. Le spectacle brouille les cartes : les acteurs du théâtre de Zurich qui semblent être les maîtres du jeu et qui le sont, font mine d’entrer dans la danse, filmés cul nus en train de se faire enculer par un un acteur handicapé à poil. Borderline ? Oui. Tout ce que fait Milo Rau se tient sur une ligne de crête. Où commence l’anormal ; où finit le normal ? C’est une des questions que pose Les 120 Journées de Sodome.
Romeo Castellucci lecteur rêveur de Tocqueville
17h30. Retour au bord du lac, au Théâtre Vidy : Democracy in America de Romeo Castellucci, spectacle librement inspiré de l’essai d’Alexis de Tocqueville. Second tome de cette somme à bien des égards prophétique, fin du chapitre 12 : « ...et si maintenant que j’approche de la fin de ce livre, où j’ai montré tant de choses considérables faites par les Américains, on me demandait à quoi je pense qu’il faille principalement attribuer à la postérité singulière et la force croissante de ce peuple, je répondrais que c’est à la supériorité de ses femmes. » Tocqueville consacre de nombreuses pages aux femmes américaines, il est sans doute l’un des premiers hommes à traiter longuement de ce sujet. D’une certaine façon, le spectacle de Castellucci lui rend hommage en accordant une place essentielle aux femmes, puisqu’elles y interprètent tous les rôles.
Scène du spectacle "De la démocratie en Amérique" © Guido Mencari
Tocqueville parle aussi longuement des Indiens, du sort qui leur est fait, ce qui inspire à Castellucci un dialogue entre deux ndiens de la tribu des Chippewa dans leur langue ojibwe. Le début du dialogue part d’une anecdote racontée par Tocqueville mais s’en éloigne très vite. Leur conversation tourne autour du langage. Faut-il que les Indiens apprennent l’anglais. Ils en discutent dans leur langue. Ils hésitent, ils savent le pouvoir des mots. « Babillage niin dibaajimo giin ji gibaakobidoon giiwose gaye ingiw, wiiji ikidowinan » (« Et je te dis qu’ils peuvent chasser avec eux, avec les mots »), dit Hokolesqua, « et que les mots peuvent tuer », ajoute-t-il. C’est un dialogue d’une lucidité calme et tristement désespérée. Les deux actrices se défont de leur peau d’Indien et, nues, les posent sur une barre, comme des peaux d’animaux morts que l’on va faire sécher et vendre. Le spectacle se termine ainsi actuellement. Cela ne sera peut-être pas le cas quand le spectacle viendra à Paris cet automne. Car Castellucci veut plus encore tendre son propos. Plusieurs séquences avaient été ajoutées, d’autres enlevées (comme celle d’un laboureur dont la terre noire de son champ disparaissait au fur et à mesure qu’il le labourait) au fil des premières représentations données lors de ce « programme commun » des théâtres de Lausanne où le spectacle a été créé.
Tout avait commencé par un chant enregistré dans une église Pentecôtiste à Oklahoma en 1980, une glossolalie chantée dans une langue que personne ne comprend. Une autre séquence nous montre deux paysans désargentés, au bord de la famine, qui en appellent à Dieu escomptant un miracle par la force de leurs mots. Plusieurs séquences souvent dansées se déroulent derrière un tulle qui nimbe les corps et les visages d’un halo. Comme si ces farandoles, ces femmes éplorées venaient d’un temps immémorial et gardaient une part de leur énigme, en appelant à un temps d’avant le théâtre. C’est là un spectacle des limbes dont Tocqueville serait le tocsin d’un contrepoint. A suivre.
Nachlass du Rimini Protokoll, du 20 au 27 mai au festival Théâtre en mai à Dijon ; du 1er au 11 juin au Maillon à Strasbourg ; du 16 au 24 au Weltanschauung de Dresde (Allemagne).
Democracy in America de Romeo Castellucci sera à l’affiche de la MC93 à la rentrée prochaine dans le cadre du Festival d’Automne.
Christopher Miles quitte le Ministère de la Culture pour devenir directeur délégué du Palais de Tokyo
Christopher Miles, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication depuis 2014, va être nommé directeur délégué du Palais de Tokyo, qui restera présidé par Jean de Loisy. Il succédera ainsi à Julie Narbey, qui prendra la direction du Centre Pompidou à partir du 1er mai 2017.
Via Aurelien Guillois

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2017 10:16 AM
|
Par Sophie Rahal pour le site web de Télérama
Avec un budget culture en hausse de 4 % pour 2017, Valérie Pécresse mise sur l’éducation artistique et le rééquilibrage de l’offre culturelle en faveur de la grande couronne parisienne. Quant au spectacle vivant, il respire mieux mais reste vigilant.
Après la pluie, le temps de l'éclaircie ? Arrivée fin 2015 à la tête de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse a mis fin à dix-sept ans de pouvoir socialiste et n'a jamais caché sa volonté de passer un coup de balai culturel. Dès juillet 2015, elle publiait dans Libération une tribune qui épinglait la « saignée budgétaire » du ministère de la Culture [sous Hollande, le budget a baissé durant les deux premières années avant d'être rétabli sur les trois suivantes, ndlr] et tançait la baisse des dotations aux collectivités locales. Elle prenait l'engagement d'augmenter de 20 % les crédits destinés à la culture pendant sa mandature.
« On aurait pu signer cette tribune ! se souvient Vincent Esches, représentant régional du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). Les collectivités locales, en difficulté, entraînent par ricochet une précarisation des artistes, et des budgets difficiles à tenir pour les lieux. » Deux mois plus tard, la future présidente précisait les contours de sa politique : renforcer l'accès à la culture sur tout le territoire francilien, soutenir la jeune création et développer l'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes.
Une première année anxiogène pour le spectacle vivant
De louables ambitions. Mais la ventilation du premier budget, voté en avril 2016, a refroidi certains espoirs. « Certes, il était en hausse [de 6,6%, ndlr] mais seulement du point de vue de l'investissement », souligne Vincent Esches : les coups de pouce sont allés au patrimoine, aux conservatoires et aux médiathèques, et à la création cinématographique et audiovisuelle, par un basculement des crédits en investissement.
Le milieu du spectacle vivant, lui, fait la grimace. « Les crédits de fonctionnement de la Permanence artistique et culturelle [Pac, principal dispositif régional de soutien au spectacle vivant, ndlr] et des lieux de fabrique ont baissé », poursuit le délégué du Syndeac. Depuis, la mobilisation de trois syndicats et d'élus UDI et EELV a permis de « récupérer » 3,5 millions de plus dans ce budget culture. « La Région n'aime pas beaucoup subventionner le fonctionnement, explique Mirabelle Rousseau, cofondatrice de la compagnie TOC. Or, c'est ce qui paye les salaires (permanents et intermittents) et nous permet de monter et diffuser nos spectacles. »
Bibliobus, muséobus, chapiteaux, écrans gonflables...
Le nouveau budget 2017 est plus complexe à analyser. « Globalement, il est en hausse de près de 4 %, c'est une réalité, commente Vincent Eches. Mais si on détaille un peu, cette augmentation est à nouveau ciblée sur le fonds d'aide à la création cinématographique, l'investissement et l'éducation artistique et culturelle. Les lignes dédiées aux arts de la scène et de la rue restent au niveau de 2016. »
Un effort est fait pour valoriser le patrimoine régional (via, notamment, un soutien à l'archéologie ou la restauration de monuments historiques) et pour la mise en marche d'un fonds d'investissement pour la culture, doté de 5 millions d'euros mais dont les objectifs restent vagues, mise à part la commande d'équipements mobiles qui favoriseront l'accès à la culture, type bilbiobus, muséobus, chapiteaux, écrans gonflables ou cinébus.
Fait nouveau : l'éducation artistique a été renforcée via un soutien en fonctionnement aux organismes associés (des structures essentiellement financées par la Région) que sont l'Orchestre national d'Ile-de-France (Ondif), le chœur Vittoria et le Fonds régional d'art contemporain. Ainsi, les 242 000 euros supplémentaires alloués à ce dernier financeront la mise en place de vingt conventions avec des lycées de territoires éloignés pour sensibiliser les élèves à l'art contemporain. Et les 150 000 euros de l'Orchestre serviront à sensibiliser les lycéens à la musique classique.
Rééquilibrage en faveur de la grande couronne
Quant au spectacle vivant, la Région a toiletté le dispositif d'aides, qui soutient en premier lieu le théâtre puis la musique, tout en apaisant certaines craintes. Il comporte désormais six aides (au lieu de onze) et réorganise la plus importante, la Pac, en trois catégories : l'aide aux lieux, aux fabriques de culture et aux équipes. Les conventions signées entre la Région et les structures passent de trois à quatre ans, selon le souhait des professionnels. Coordinatrice générale du réseau régional Actes if, Chloé Sécher salue ces décisions mais promet que les professionnels resteront attentifs à ce que la Région soutienne, sur le terrain, « une diversité de partenaires ».
Du côté des équipes de Valérie Pécresse, on assume la volonté de renouvellement des bénéficiaires, et le rééquilibrage en faveur de la grande couronne et des communes rurales. « Nous avons regardé ce qui s'est passé en Seine-et-Marne aux dernières départementales, souligne Agnès Evren, vice-présidente (LR) en charge de la culture et de l'éducation. Dans certains cantons, 40 % des électeurs votent FN. Les Franciliens de la grande couronne [dont fait partie la Seine-et-Marne, ndlr] n'ont pas d'équipements numériques, pas d'offre culturelle ni de de transports… L'égalité territoriale passe par celle de l'attribution des subventions. » Or, Paris et la Seine-saint-Denis captent déjà 42 % des aides régionales au spectacle vivant.
Le projet “Avignon en Ile-de-France” au point mort
C'est dans cet esprit qu'avait été pensé le projet théâtral « Avignon en Ile-de-France », annoncé d'emblée par Valérie Pécresse et doté dès 2016 de 300 000 euros, mais aujourd'hui contraint d'être revu. « Il était impensable de “déplacer” le festival d'Avignon en région Ile-de-France, explique Paul Rondin, son directeur délégué. Avec Olivier Py, nous avions donc formulé une contre-proposition qui s'appuyait sur des spectacles itinérants expérimentés depuis trois ans autour d'Avignon. Mais, alors que rien n'était engagé, les équipes franciliennes ont communiqué de leur côté ! Et puis la dissolution d'un autre festival [le Festival d'Ile-de-France, ndlr] par Valérie Pécresse a compliqué les choses : nous ne voulions pas que la suppression d'un événement aussi respectable serve la création d'un autre. Pour le moment, nous n'avons donc pas donné suite. »
Le Festival d'Ile-de-France en passe d'être liquidé par l'administration Pécresse
La Région reste droite dans ses bottes : « Il y aura une proposition de qualité dans les [bases] de loisirs fin août, assure-t-on avec optimisme. Des discussions seraient en cours avec un nouvel opérateur public. Elle vient aussi d'augmenter la subvention du festival musical Montereau Confluences, sur une terre éloignée de la grande couronne. Le festival Rock en Seine, dont la Région finançait 8 % du budget global en 2016, pourrait bénéficier des mêmes faveurs à condition que certains axes soient renforcés, comme l'encouragement des pratiques amateurs ou les opérations à destination de la jeunesse.
Pour soutenir la jeune création, deux autres projets ont fait leur apparition en 2016 : le Fonds régional des talents émergents et l'Ile des chances, une plateforme de financement participatif de projets qualifiée de « floue » par les professionnels, et de « télécrochet » par l'opposition. Est-ce le fait d'une communication précipitée, comme au sujet d'Avignon ?
Liquidation du Festival d'Ile-de-France
Personne n'a oublié comment Valérie Pécresse et Agnès Evren ont scellé le sort de certains organismes associés, telles ces structures de soutien au livre, à la musique, à l'art contemporain ou au spectacle vivant, dont la nouvelle présidente déplore le coût de fonctionnement élevé. Dans cette remise à plat, il y a eu les gagnants et les perdants. L'Ondif, le chœur Vittoria ou le Frac ont vu leur subvention augmenter en 2017, en échange de quoi ils renforceront leurs actions d'éducation artistique et culturelle (voir plus haut).
D'autres organismes associés ont fait les frais de l'alternance politique : le Festival d'Ile de France, qui conciliait pourtant programmation musicale de grande qualité et lieux patrimoniaux, a été liquidé au lendemain de ses 40 ans malgré le tollé général. L'Ariam, dont la qualité du travail de formation des enseignants en musique et l'action de prêt d'instruments rares aux professionnels sont unanimement reconnues, baissera le rideau à la fin de l'année. Son « parc instrumental ne fermera pas et nous travaillons actuellement à sa reprise intégrale », assure Agnès Evren. L'Ondif pourrait hériter de cette mission. Le Motif, qui accompagne les professionnels du livre, fermera ses portes à la fin de l'année également.
Menaces sur l'agence Arcadi
Tous les regards sont à présent tournés vers Arcadi, l'agence culturelle pour le spectacle vivant, qui emploie 44 salariés (38 d'après la Région), dont la subvention régionale est passée de 5,8 à 5 millions d'euros en deux ans. L'Etat a maintenu sa subvention à 400 000 euros. « Arcadi assure la diffusion de spectacles dans tout le territoire et accompagne une rare diversité de projets. Certaines critiques à son égard sont peut-être légitimes, mais sa disparition serait catastrophique car personne d'autre ne joue ce rôle », relève Juliette Prissard, du Syndicat national des scènes publiques. L'agence fait notamment l'objet de critiques relatives au poids de ses frais de fonctionnement ou à la faible représentation des arts de la rue. La légimité des comités d'experts dont dépend l'attribution des subventions est aussi questionnée. Reste que le flou dans lequel elle est plongée depuis des mois devient franchement délétère.
Au-delà des interrogations sincères qu'il soulève, le « projet Pécresse » souffre, à en croire différents acteurs culturels, d'un manque de clarté et d'une méthode parfois brutale. Le tout donnant l'impression « que les décisions sont prises sur un coin de table, alors même que l'on échange plutôt facilement avec les élus », dixit un bon connaisseur du milieu musical.
(1) Le Syndeac représente toutes les structures recevant des subventions publiques, y compris les compagnies.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2017 8:02 PM
|
Par Christophe Candoni dans Toutelaculture.com
Dans la joie et en musique, Lazare fait un sacré pied de nez à la « France bleu marine » avec Sombre Rivière, sa dernière création généreusement foutraque et festive présentée par la MC93 de Bobigny au Nouveau Théâtre de Montreuil.
Artiste associé au Théâtre National de Strasbourg, Lazare mène une troupe épatante. Toujours fidèle, Anne Baudoux joue sa mère. Julien Villa, Mourad Musset et Olivier Leite aux présences très physiques et concrètes, incarnent en trio le poète-prophète. Autour d’eux, des artistes aux horizons multiples, acteurs et musiciens hors-pair tels que Julie Héga, et la merveilleuse Ludmilla Dabo entre autres, sont les porte-voix d’une poésie logorrhéique caractéristique du style débordant de son auteur. À travers quantité d’histoires, Lazare catalyse et exorcise les maux d’une France rance qui digère difficilement son histoire passée et qui stigmatise les Arabes et les Français d’origine maghrébine. Passé-je ne sais où, qui revient racontait les massacres de Sétif et Guelma en 1945, la crise des banlieues était au cœur de son récent Au pied du mur sans porte, la guerre d’Algérie au centre de Rabah Robert – touche ailleurs que là où tu es né. Lazare s’empare de sujet d’actualité brûlants pour questionner le temps présent. Il parle aussi de lui, de l’ambivalence de son rapport au monde tel qu’il est surtout après les attentats de novembre 2015.
Pas de place pour la déprime, voici le temps du combat. Il faut en découdre avec la morosité. Cela passe par un souffle, un tapage, de la fièvre, de l’ivresse, communiqués avec une belle énergie vitale. Si le titre du spectacle est celui d’un blues, sa forme respire la gaieté. Elle est celle d’un théâtre hybride qui s’inspire du cabaret, de la foire, du carnaval. A la fois dramatique et bouffon, Sombre rivière multiplie des propositions aux dimensions shakespeariennes. Tout un univers débridé est convoqué sur le plateau. Dans ce tourbillon effervescent, se distingue une volonté quasi subversive d’unir, de réunir, de construire et de partager plutôt que d’exclure et diviser. « Je ne veux pas être prisonnier de l’angoisse ambiante. Je ne veux que proposer la rencontre du possible et de l’impossible loin de la tristesse, de l’effroi » dit-il. Pari gagné et manifestement nécessaire.
Photo © Jean-Louis Fernandez
Du 29 mars 2017 au 06 avril 2017 P Nouveau Théâtre de Montreuil Adresse : 10 place Jean-Jaurès, 93100, Montreuil Telephone : 01 48 70 48 90
Site web : www.nouveau-theatre-montreuil.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2017 3:43 AM
|
Par Stéphane Capron pour Sceneweb
Sombre Rivière, la nouvelle pièce de Lazare, n’est pas à l’image de son titre, elle est au contraire joyeuse, un peu désespérée mais vivifiante et menée par une troupe d’acteurs et de musiciens épatants.
Lazare a choisi la forme du cabaret pour son nouvel opus : la musique et la chanson pour exorciser la peur de vivre dans la France post attentats terroristes qui pointe du doigt les arabes. La pièce raconte le malaise de l’auteur, lui le français, reconnu par la famille théâtrale, intégré dans la société et qui porte sur son visage les origines de ses parents nés de l’autre côté de la méditerranée. Lazare a imaginé deux conversations, l’une avec sa mère, l’autre avec le metteur en scène Claude Régy (cette dernière est plus courte dans le spectacle et un peu moins bien exploitée que la première). Lazare enrobe le tout de chansons, de poèmes, de séquences vidéo dans une forme chorale chamarrée.
Julien Villa arrive affublé de plusieurs micros hf installés à la va vite sur son visage. « Ils datent de l’époque de Jean Vilar » résume avec perfidie le comédien proche de Jeanne Candel, de Sylvain Achache et de Sylvain Creuzevaul, rompu aux écritures de plateau et donc forcément très à l’aise en meneur de troupe. Il est accompagné de Anne Baudoux, figure indissociable de l’aventure artistique de Lazare – co fondatrice de la compagnie Vita Nova. Elle veille sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Des musiciens et des chanteurs encadrent les deux comédiens. Olivier Leite et Mourad Musset de La Rue Kétanou. Veronika Soboljevski joue de la contrebasse couchée, Laurie Bellanca à la flûte traversière ressemble comme deux goutes d’eau à Isabelle Huppert, Louis Jeffroy – à la batterie – et les voix lumineuses de Ludmilla Dabo et Laurie Bellanca complètent cette distribution éblouissante. Lazare ne les ménage pas pendant les deux heures de ce capharnaüm drolatique.
Lazare se filme faisant le zouave à Barbès ou sur le bord d’une falaise avec son chien. Le rire communicatif et rayonnant de sa maman, Ouria est l’un des moments le plus émouvant de ce spectacle surréaliste où l’on croise Olivier Martin-Salvan promenant un cheval le long du canal Saint-Martin mais aussi les figures de Sarah Kane, d’Antonin Artaud ou de Don Quichotte. On sort lessivé (car il n’y aucun temps mort) mais rasséréné devant tant de poésie et de fraternité. Ce spectacle mené tambour battant par une troupe flamboyante à l’énergie communicative est une réussite qui met en relief les doutes et les interrogations de Lazare sur l’époque troublante que nous sommes en train de vivre.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
Sombre Rivière
Texte et mise en scène Lazare
Avec Anne Baudoux, Laurie Bellanca, Ludmilla Dabo, Julie Héga, Louis Jeffroy, Julien Lacroix, Olivier Leite, Lazare, Mourad Musset et Julien Villa
Collaboration artistique Marion Faure
Lumières Christian Dubet
Scénographie Olivier Brichet en collaboration avec Daniel Jeanneteau
Costumes En cours
Son Jonathan Reig
Vidéo En cours
Chef opérateur Robin Fresson
Chef de chœur Samuel Boré
Production TNS — Théâtre national de Strasbourg, Compagnie Vita Nova.
Coproduction MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Grand T — théâtre de Loire-Atlantique, Le Liberté — Scène nationale de Toulon
Avec le soutien de Canal 93.
Durée: 1h50
Théâtre National de Strasbourg
Du 14 au 25 mars 2017
Nouveau Théâtre de Montreuil
Du 29 mars au 6 avril 2017
photo Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2017 2:58 AM
|
Publié le 03/04/2017 • Par Hélène Girard dans La gazette des communes
Lire sur le site de la Gazette des communes : http://www.lagazettedescommunes.com/498195/pourquoi-les-elus-a-la-culture-demandent-une-reconfiguration-de-la-rue-de-valois/
En clôture de son congrès réuni à Saint-Etienne les 30 et 31 mars 2017, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) a élaboré 5 chantiers assortis de propositions qui vont être envoyées aux candidats à l’élection présidentielle.
Les élus à la culture ne se retrouvent plus dans la structuration de leur ministère : eux qui plaident pour des politiques locales transversales, dans lesquels le prisme culturel éclaire les décisions en matière d’urbanisme, d’action sociale, d’éducation, de jeunesse, ou de santé, et qui revendiquent des politiques construites à partir des territoires, se sentent très à l’étroit dans le périmètre ministériel.
En effet, les associations, l’éducation populaire, et les initiatives de terrain en sont absentes.
Saint-Etienne, 31 mars 2017 : le CA de la FNCC sur la scène de l’auditorium de la Cité du Design pour s’adresser aux candidats à l’élection présidentielle
Mettre fin aux silos
« Pour avoir une politique culturelle partagée entre l’Etat et les collectivités qui soit vraiment assumée, le ministère de la Culture doit se mettre en symbiose avec les réalités du terrain, plaide Florian Salazar-Martin, président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC).
Or, depuis son origine, le ministère de la Culture fonctionne par strates thématiques (musées, monuments, disciplines artistiques du spectacle vivant, arts plastiques, architecture etc.). D’où ce hiatus que les professionnels et les élus appellent la production de politiques « en silo », dont certains estiment qu’il risque fort de conduire le ministère à « s’épuiser à petit feu ».
Education populaire
En outre, une partie des opérateurs sur lesquels reposent les politiques culturelles de proximité reste en dehors du périmètre ministériel de la Rue de Valois : les associations culturelles et d’éducation populaire, qui relèvent, notamment pour ce qui est de leur financement, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elus et professionnels s’accordent sur la nécessité d’intégrer ces structures dans le champ du ministère de la Culture.
Conformité avec la loi NOTRe
En vue de l’élection présidentielle, puis des législatives, la FNCC a affuté ses arguments pour convaincre le futur exécutif et les nouveaux parlementaires élus en juin.
Outre la nécessaire prise en compte des réalités du terrain, les élus à la culture pointent l’urgence d’une mise en conformité avec différents textes de référence.
A commencer par la réforme territoriale, et notamment la loi NOTRe (1), qui évoque la co-construction des politiques culturelles par l’Etat et les collectivités. Et ce, dans le cadre des droits culturels.
Pour la FNCC, l’action du ministère de la Culture doit donc se mettre en cohérence avec la diversité des pratiques culturelles sur les territoires, avec ce que les habitants vivent au quotidien en matière de patrimoine, de création, de spectacle, d’acquisition des savoirs, de relation aux paysages, de voyages, de dialogue interculturel…
«Ce qui veut dire que la Rue de Valois doit avoir une vision de la culture axée sur les personnes, leurs pratiques culturelles, et leur capacité à être acteur sur les territoires, insiste Florian Salazar-Martin. Avec la coproduction Etat-collectivités, qui a désormais une valeur légale, « l’Etat ne pourra pas nous dire : ‘ce n’est pas moi’ ».
Sent Pançard et ses « palhassos » au Carnaval Biarnés de Pau en 2016 – Crédit : Unuaiga CC BY SA 40 via Wikimedia
Engagements internationaux
A la dimension législative franco-française s’ajoute le respect de la parole internationale. Car la France est, notamment, signataire de la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle (2001) (2), qui évoque « outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. » Un texte où le mot « culture » a donc une acception beaucoup plus englobante que les questions traitées Rue de Valois.
FOCUS
5 chantiers et une série propositions phares pour l’Elysée
Dans les jours suivants son congrès des 30 et 31 mars, la FNCC va envoyer aux candidats à l’élection présidentielle un document présentant 5 chantiers à ouvrir :
«Responsabilité culturelle partagée»
«Démocratisation culturelle»
«Interculturalité et diversité culturelle»
«Dialogue ouvert et nouveaux réseaux (élus-professionnels, acteurs publics-acteurs privés etc.)»
«Promotion culturelle des espaces publics.»
Si les intitulés des chantiers peuvent sembler un peu vagues, les actions envisagées constituent pour certaines des propositions choc. Il en va ainsi de la redéfinition du périmètre de la Rue de Valois (lire ci-dessus), mais aussi d’un certain nombre de demandes :
le rééquilibrage de la répartition des crédits de l’Etat entre équipements nationaux – majoritairement parisiens – et politiques de proximité en région. Actuellement établis à 2/3 pour les premiers, 1/3 pour les secondes, la FNCC voudrait un ratio à 50-50. Consciente qu’une telle évolution n’est pas envisageable du jour au lendemain, la FNCC demande « l’amorçage d’un processus » (chantier 1).
l’affectation de 1% de tout investissement public vers une dimension culturelle du projet. Et la FNCC de prendre l’exemple des projets de rénovation urbaine de places, qui n’abordent quasiment jamais la question sous l’angle du patrimoine et du vécu : histoire de la place, rôle social pour les habitants, mise en partage de connaissances et d’événements etc. (chantier 2)
l’instauration d’un droit à l’expérimentation, accompagnée par l’Etat, sans nécessairement déboucher sur une généralisation nationale (chantier 2)
la mise à disposition des espaces ou bâtiments promis à de futurs travaux (squats temporaires ou éphémères). Objectifs : élargir les espaces disponibles pour les rencontres et le partage d’expériences et émotions culturelles.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2017 6:13 PM
|
Par Rick Panegy pour le blog Rick et Pick:
A la péniche La Pop, Le Birgit Ensemble, fondé par Jade Herbulot et Julie Bertin, a présenté Cabaret Europe : un récit mythologico-politique, où les auteurs posent leur regard sur une Europe en pleine mutation.
A La Pop, on a pu assister à une sorte de « teasing » excitant de ce que présentera Le Birgit Ensemble cet été au Festival d’Avignon : Cet été, Mémories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes feront les beaux jours du Gymnase Paul Giera. Deux spectacles qui viendront conclure la tétralogie entamée par Le Birgit Ensemble autour de l’Europe, après Berliner Mauer et Pour un prélude.
Ici, en résidence à La Pop, le Birgit ensemble a pu élaborer et mettre sur pied les prémices de ces deux spectacles, en en créant une forme hybride : intitulé Cabaret Europe, le spectacles englobe les deux longues formes qui seront présentées à Avignon. Une heure de cabaret où se mêlent les allégories de Europe, fille de Zeus, et son amertume face à ses errances en basculant dans le 21ème siècle ; son désarroi face au déclin économique de la Grèce, ou face à la guerre de Sarajevo, un Cabaret où se mêlent aussi les discours d’Alexis Tsipras, une incarnation ironique et pathétique d’Angela Merkel, une résurrection de Kurt Cobain décapante, ou des archives sonores des émissions de télévision ou de radio… On replonge dans le concours de beauté de miss Sarajevo improvisé, symbole d’une résistance éperdue de cette guerre des Balkans, qu’avait capturé en images le vidéaste Bill Carter, et dont nous pouvons voir dans un coin de la scène la célèbre photographie. « Don’t let them kill us » clame alors la bannière des miss, imaginée par l’activiste Janez Tadic. Des mots qui semblent se faire l’écho de ceux que prononcerait Europe, en contemplant le délitement de son union…
Sur scène, où les comédiens chantent, s’adressent au public comme à des témoins inactifs à qui on voudrait donner le souffle du courage et celui de l’agir, les musiciens accompagnent en live une partition scénique multiple et hybride, faite de théâtre, de chants, de discours d’archives… Faisant fi, comme toujours chez Le Birgit Ensemble du quatrième mur, et partageant avec le public regards, sourires, verre de vin, apéritif ou communion finale, la troupe engage un dialogue de conviction avec le spectateur, qui soudainement rappelé à son identité de citoyen européen, ne ressort pas indemne de toute réflexion autour de l’Europe…
A l’heure du Brexit et des volontés de repli de certains partis conservateurs, le travail de Jade Herbulot et de Julie Bertin prend une tout autre dimension… Le Cabaret s’achève sur 28 bougies encerclant Europe, chantant. Elles continuent, vacillantes, de briller. Cet été, il ne devrait peut-être plus en rester que 27 sur le plancher de la scène…
Voilà donc qui met l’eau à la bouche : vivement les formes finales présentées à Avignon, quand bien même ce Cabaret Europe se suffit déjà à lui-même. Et voila qui donnent envie de retourner sur cette péniche, qui (co)produit des formes ambitieuses
Avec Eleonore Arnaud, Antoine Louvard, Pauline Deshons, Anna Fournier, Marie Sambourg et Anaïs Thomas, tous formidables.
Rick Panegy

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2017 5:00 PM
|
En invitant à la Comédie Française l’artiste allemande Katharina Thalbach, proche du Berliner Ensemble, pour mettre en scène La résistible ascension d’Arturo U qui dénonce le mécanisme de la montée au pouvoir d’Hitler, Eric Ruf, son Administrateur, signe un coup de maître. La pièce comme la troupe y trouvent une nouvelle jeunesse : exit le dogmatisme de Brecht, place au théâtre populaire avec des rôles exigeants où le talent des sociétaires et pensionnaires explose.
Dans le Chicago des années qui suivent la grande crise de 29, les fonds commencent à manquer dans le trust du chou-fleur. Pour obtenir des crédits, les responsables du Trust corrompent le vieil et respectable Hindsborough en lui offrant une maison au bord du lac. Apprenant le scandale, le gangster Arturo Ui qui cherche à asseoir son pouvoir sur la ville, en profite pour prendre la main sur le trust. Il est entouré de fidèles sans scrupules, Ernesto Roma, Giuseppe Gobbola, Manuele Gori, qui l’appuient dans ses désirs d’expansion, non sans rivalités destructrices entre eux.
Rien de tel pour entrer dans une histoire qu’un conteur. Bakary Sangaré, grimé en clown coloré, se charge de l’introduction et de l’épilogue, et interpelle directement le public. Le parti pris pédagogique de la mise en scène souligne les parallèles entre les événements de la pièce et l’Histoire. Le livret de la pièce est explicite, les gangsters démarrent la pièce avec un masque de leur double historique, des références historiques sont ajoutées sur scène avec des banderoles de texte à lire. La lisibilité du texte de Bertolt Brecht est totale.
La scénographie est époustouflante. Le plateau est un plan incliné de Chicago avec des portes d’entrée et sortie, doublé d’une toile d’araignée où les personnages se fraient difficilement un chemin, tour à tour labyrinthe, hamac et siège. Ainsi dépouillé, le cadre permet d’enchainer les scènes à un rythme soutenu. Les acteurs maquillés en noir et blanc, ultra stylisés, dans une esthétique caricaturale qui renforce la distanciation, se lancent pleinement dans l’aventure. Gueule de singe pour Gobbola-Jérémy Lopez, mèche à la Trump pour Arturo-Laurent Stocker… Dans cette mécanique de précision où le jeu collectif est primordial, la troupe du Français est au sommet. La mise en scène donne une grande importance à tous les rôles, tous complices de l’ascension d’Arturo-Adolf. La distribution est brillante : en plus des trois acteurs déjà cités, se distinguent Thierry Hancisse dans le rôle d’Ernesto Roma, Serge Bagdassarian dans celui de Manuele Gori, Michel Vuillermoz en vieil acteur sur le retour. Le trio de dignitaires du trust du Chou-fleur composé d’Elliott Jenicot, Jérôme Pouly et Eric Génovèse est fantastique. La choralité de la pièce est une vraie réussite.
Quand Bakary Sangaré conclut « il est encore fécond le ventre de la bête immonde… », la mèche de Trump revient au galop. Les images de la nuit des longs couteux, jouée dans Les Damnés il y a quelques mois, ne sont pas loin non plus. L’époque est troublée.
Katharina Thalbach signe une très belle réalisation avec la Comédie Française, tirant le meilleur parti de son esprit de troupe. Sa version d’Arturo Ui insiste sur le ridicule du personnage, en appelant à l’action et à la résistance. Son chemin est moins féroce que la précédente mise en scène d’Heiner Müller, la peur est quelque peu éclipsée, la progression du personnage d’Arturo est moins visible mais il faut bien laisser la place à d’autres lectures et talents, et celle-ci se défend très bien. A voir.
La résistible ascension d'Arturo Ui, de Bertolt Brecht, mise en scène Katharina Thalbach à la Comédie Française du 1er avril au 30 juin 2017 (alternance).
Suivez l'étoffe des Songes sur Twitter, et consultez la sélection de spectacles à venir.
Publié il y a 18 minutes ago par M.A.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...



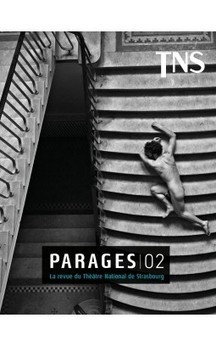

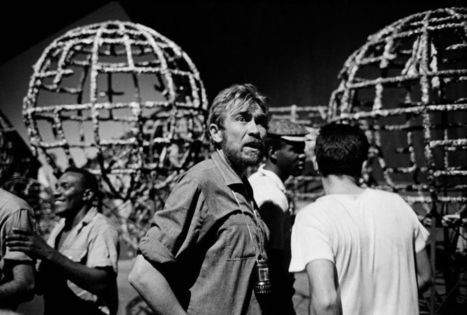



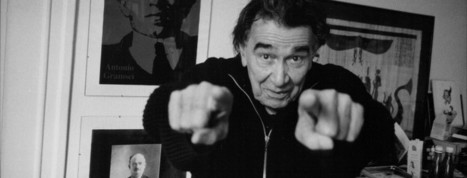




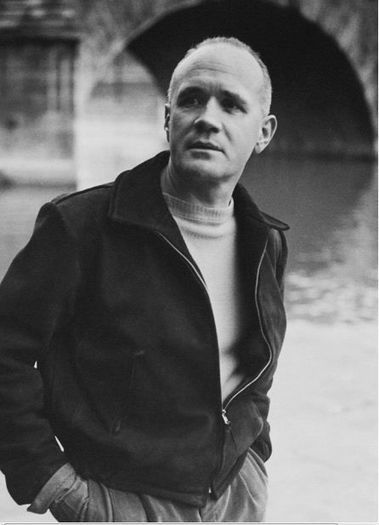



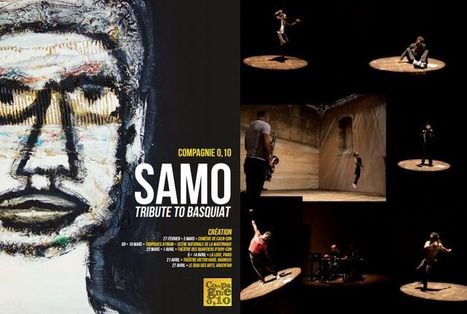
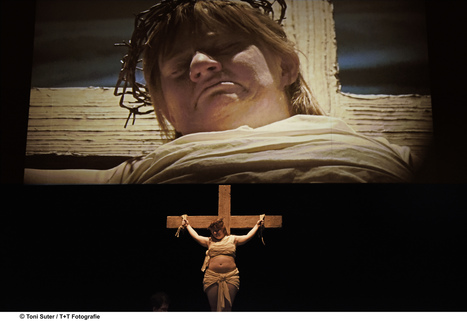


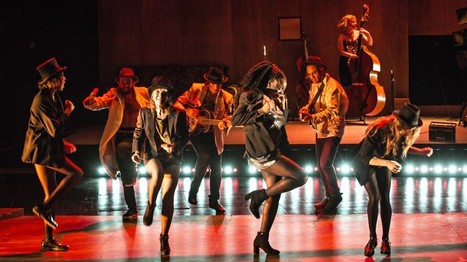


![[Théâtre - Critique] Cabaret Europe du Birgit Ensemble | Revue de presse théâtre | Scoop.it](https://img.scoop.it/_VPwqwF2PC1Y0rbLSzNcnjl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)





