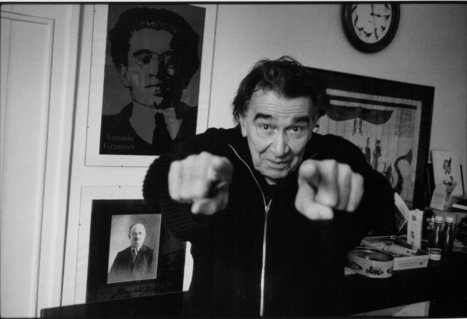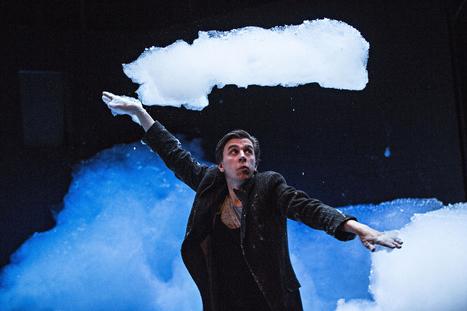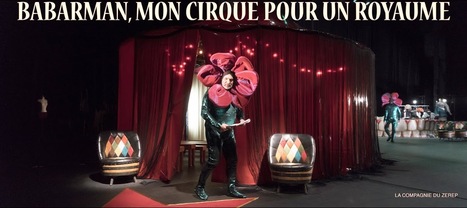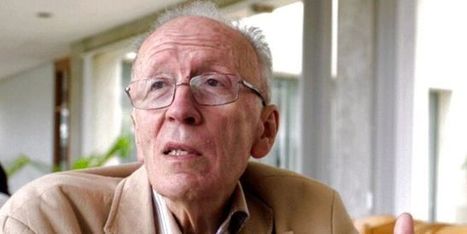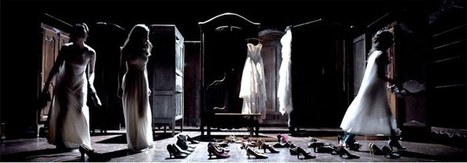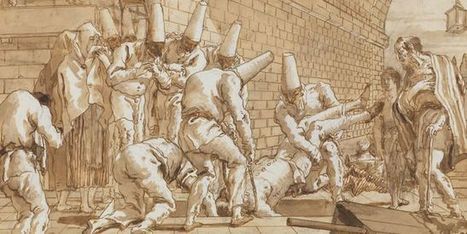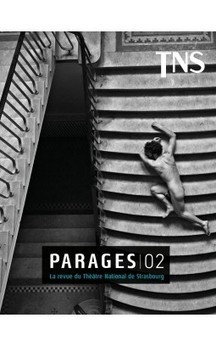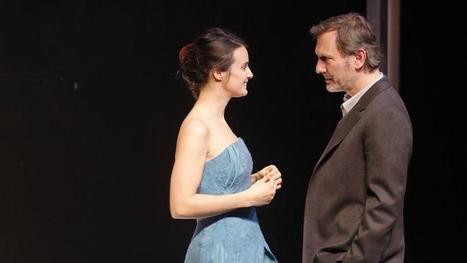Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 15, 2017 8:36 AM
|
Le jeune lieu du off qu’est Artéphile, ouvert en 2015, s’est dès ses débuts signalé au public friand d’écritures contemporaines de qualité, avec notamment King du ring. Et la programmation présentée à l’occasion du Festival d’Avignon 2017 montre une prometteuse progression en termes de maturité et de densité.
Parmi les douze pièces (quatre autres sont destinées au jeune public) sélectionnées par Anne Cabarbaye-Mange et Alexandre Mange, on remarquera la belle présence d’une sensibilité féminine, avec six textes dont l’auteur ou le co-auteur est une femme, et pas moins de neuf pièces dont le metteur en scène est une femme.
Il pourrait être tentant de placer en tête d’affiche Fille du Paradis (18h10), passé en juillet 2015 par le GiraSole alors dirigé par Fida Mohissen. L’adaptation, par Ahmed Madani, de Putain (Editions du Seuil) de Nelly Arcan, est un percutant seul en scène (la critique).
Les habitués de La Manufacture auront sans doute remarqué Séisme (13h00), première création en France de la pièce de l’auteur anglais Duncan MacMillan : la compagnie du Théâtre du Prisme et le metteur en scène Arnaud Anckaert y ont donné Constellations en 2014 et Revolt. She said. Revolt again. en 2016. On retrouve d’ailleurs dans Séisme deux des acteurs de Revolt, Mounya Boudiaf et Maxime Guyon, que Arnaud Anckaert dirige ici dans « une petite forme sans artifice, où l’on pourra suivre à travers des mots simples une humanité et une relation forte. »
Autre pièce qui pourrait faire parler d’elle, L’hiver de la cigale (19h45) de Pietro Pizzuti (texte chez Lansman Éditeur), auteur multi-primé en Belgique. Le texte que met en scène Maria Cristina Mastrangeli « pose la question politique de la légitimité de la révolte armée contre un pouvoir malveillant, mais aussi celle intime de la mémoire des aïeuls. » À noter que Armand Gatti, résistant et figure du théâtre français disparu en avril, prête sa voix à un enregistrement laissé par le dictateur assassiné.
L’imaginaire singulier de Pauline Sales est à découvrir (20h05) dans Le Groenland (Editions Les Solitaires Intempestifs), seul en scène dirigé par Anna Delbos-Zamore, fugue d’une mère animée par le « désir de se retrouver soi jusqu’à envisager de lâcher la main de sa fille. »
Cette programmation, courageuse par la complexité et souvent la noirceur des thèmes abordés, n’est pas dénuée d’éclaircies, même avec de sombres arrière-plans. Elles devraient venir de Contagion (16h10) de François Bégaudeau (dont le film Entre les murs reçut la Palme d’or au Festival de Cannes en 2008) où un professeur d’Histoire, confronté à des soupçons de radicalisation visant des élèves, est « piégé par ce sujet toxique », rendant « son besoin de fuir […] vital », dans une mise en scène de Valérie Grail qui vise « sensibilité et humour » ; de Ce quelque chose qui est là (16h45), d’après le roman La nuit tombée d’Antoine Choplin (Editions La Fosse aux ours), mis en scène par Chantal Morel, « l’histoire d’une amitié qui tient chaud » dans la zone interdite autour de la centrale de Tchernobyl ; de Le violoncelle poilu (18h35) de Hervé Mestro, mis en scène par Pascal Antonini, seul en scène « inspiré de l’histoire vraie du violoncelliste Maurice Maréchal » où le personnage principal est son violoncelle, sur fond de guerre de 14 ; ou encore de Micro crédit (21h35), de Pauline Jambet et Maxime Le Gall et mis en scène par la co-autrice, qui propose « un retour aux sources anthropologiques, mythologiques et même magiques du système monétaire » avec la volonté d’éviter l’écueil de l’exposé rébarbatif, la voix de l’acteur étant mixée et samplée dans un duel avec un musicien.
—Walter Géhin, PLUSDEOFF
(illustration: Fille du Paradis, Madani Cie, crédit photo : François-Louis Athénas)
ARTÉPHILE (7, rue du Bourg Neuf), Festival d’Avignon 2017 (off) du 7 au 28 juillet 2017, relâche les 12, 19 et 26.
Et aussi… L’autre fille (Annie Ernaux, m.e.s Nadia Rémita) à 12h40 / Un jour ou l’autre (Linda McLean, m.e.s Blandine Pélissier) à 14h10 / Ici-bas (Bruno Lajara, m.e.s Céline Dely et Perrine Fovez) à 15h00 / Entre eux deux (Catherine Verlaguet, m.e.s Adeline Arias) à 21h45 // JEUNE PUBLIC Pas de loup (m.e.s Alban Coulaud) à 10h00, à partir de 18 mois / La femme moustique (Mélancolie Motte) à 10h00, à partir de 9 ans / Elikia (m.e.s Marie Levavasseur) à 11h10, à partir de 11 ans / Rise up (m.e.s Vincent Vernillat) à 11h30, à partir de 8 ans.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 14, 2017 9:28 AM
|
Par Stéphanie Barioz dans Télérama
Pratique parfois folle qui associe désormais la créativité à la technique, le jonglage contemporain ne s'est jamais aussi bien porté. La preuve en vingt-six spectacles atypiques et diablement inventifs à voir lors de la 10e Rencontre des jonglages.
La Rencontre des jonglages est un festival tous publics qui démontre la vitalité du jonglage contemporain grâce à 26 spectacles, 45 représentations et 80 artistes du monde entier. Elle mixe pendant trois semaines des solos, des duos, du collectif, du participatif, des formes courtes, des grands spectacles, des ateliers inédits, des performances et des balades dans les rues.
Inventivité, poésie et humour
« La Rencontre affirme la place des jonglages de création, pas ou peu visibles dans les festivals de cirque et les conventions de jonglage, plus axés sur la technique, explique Thomas Renaud, directeur de l'événement. Le jonglage permet un haut niveau d'abstraction et de créativité et des expérimentations infinies. Ce qui nous intéresse, ce sont les propositions atypiques. »
Jeunes pousses et compagnies emblématiques
Sont invités des jeunes prometteurs et des compagnies emblématiques. Parmi elles, les Gandini Juggling, en collaboration avec le Royal Ballet de Londres, pour 4 × 4 Ephemeral Architectures ou le collectif belge Ea Eo, qui manipule objets en plastique et « blagues pourries » dans All the Fun. Le duo Boijeot.Renauld, un sociologue et un architecte, propose une performance inattendue : la lente transhumance de meubles en Seine-Saint-Denis. Les volontaires sont conviés à construire et à déplacer des espaces de convivialité, de rue en rue, jour et nuit !
Autour de la base historique qu'est la Maison des jonglages, à La Courneuve, la Rencontre se déroule sur dix scènes ou sites franciliens. A Paris, au Carreau du Temple, Jonglopolis lie pratiques amatrice et professionnelle durant quatre jours, avec des ateliers créatifs pour les jeunes et les familles, des défis, une convention décalée...
Voir la vidéo de présentation : https://vimeo.com/117536055
Y aller :
10e Rencontre des jonglages, jusqu'au 30 avril, 01 49 92 61 61,

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 13, 2017 5:04 PM
|
Par Ève Beauvallet (à Rennes) pour Libération / Next :
Les deux artistes ironisent sur leurs rôles respectifs d’Occidental et d’Arabe dans une pièce participative.
C’était censé être la poignée de main fortifiante, l’échantillon «témoin» visant à convaincre le monde de demain que la greffe est possible. Le metteur en scène égyptien Omar Gayatt et le performer néerlandais Yan Duyvendak, tous les deux installés en Suisse, ont décidé en 2008 de mettre en scène leur rencontre dans Made in Paradise. Sauf qu’en pleine préparation de la pièce, visant à catapulter la dichotomie manichéenne Islam/Occident, les deux amis se sont aperçus qu’ils ne pouvaient plus s’encadrer. La pièce a tourné une centaine de fois pendant six ans. Ambiance. Malice ou masochisme, une saison 2, Still in Paradise, a pourtant vu le jour sur les cendres encore fumantes des printemps arabes et l’inflation des discours identitaires.
Still in Paradise s’ouvre par une séance de vote, simulacre de démocratie. Le public choisit les cinq saynètes parmi la douzaine proposée, qui lui ont semblé les mieux pitchées. Façon de rappeler qu’on vend parfois l’histoire de son pays comme de la camelote ? Pendant que certains, à Rennes où était présentée la pièce, acquiesçaient à cette ironie le regard pénétré, d’autres commençaient à tourner de l’œil en comprenant que le spectacle serait «participatif» et «déambulatoire» - «l’enfer», souffle une voisine. Passons sur le dispositif, finalement anecdotique. Still in Paradise surprend davantage en laissant simplement s’affronter les deux protagonistes. Duyvendak déplore les prises de position de Gayatt sur l’immigration érythréenne (finalement proches des discours identitaires qui appellent à «aimer» les valeurs occidentales et non pas seulement à respecter les lois). Il se retrouve lui-même moqué par son collègue égyptien comme un parangon de bien-pensance molletonné dans sa culpabilité post-coloniale et sa contrition occidentale. «Qu’est-ce que tu veux faire ? lance Gayatt à Duyvendak, qu’on chante tous Imagine de John Lennon à la fin de la pièce en buvant un thé à la menthe ?» Quand la pièce se clôt précisément sur cette image, on se rappelle que deux autres artistes également programmés au festival Mythos de Rennes travaillaient pile le même thème : non pas celui du «choc des civilisations», mais des possibilités pour un artiste occidental, en particulier, d’en faire encore un sujet sans être dupe de ses propres fantasmes. La solution s’appelle ici l’autodérision.
Ève Beauvallet (à Rennes)
Still in Paradise de Yan Duyvendak et Omar Gayatt du 6 au 26 juillet à la Manufacture, dans le cadre de la sélection suisse du Festival d’Avignon.
«Still in Paradise» s’ouvre par une séance de vote, simulacre de démocratie. Photo Pierre Abensur

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 13, 2017 4:43 PM
|
En guise d’hommage à Armand Gatti, nous publions cet article d’Olivier Neveux, qui se conclut par ces mots : « Pourquoi le théâtre ? Car il est, chez Gatti, l’asile offert à l’utopie pour qu’elle trouve, enfin, place dans le temps. Rien n’aura eu lieu que le lieu utopique d’où s’écrit le présent. Il sera dit alors que les morts ne meurent pas tout à fait et s’ils ne se relèvent pas aux saluts, c’est qu’à l’illusion de leur incarnation, Gatti a substitué la verticalité de leur invocation. Le dernier mot est aux mots, pas à la mort« .
Ce texte est paru une première fois dans : C. Brun et O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « Arts », n°5-6, La Parole errante, 2015, pp. 68-103.
Lire l'article entier ici : http://www.contretemps.eu/impossible-theatre-armand-gatti/
Et maintenant, je vais dire une chose qui va peut-être stupéfier bien des gens. / Je suis l’ennemi / du théâtre. / Je l’ai toujours été. / Autant j’aime le théâtre, / autant je suis, pour cette raison-là, son ennemi[1].
Pourquoi sommes-nous devant une carte de Chine ? Pour y faire du théâtre ? Nous ne sommes pas des gens de théâtre ! Nous sommes des gens d’écriture[2].
La question est légitime : pourquoi, malgré tout, le théâtre ? Malgré sa nécrose et ses duplicités ? Malgré l’entre soi, la banalité, sa « sénilité[3] » ? Pourquoi s’obstiner ? Car les attaques régulières de Gatti contre le théâtre ne sauraient dissimuler un fait : il n’en a abandonné ni le terme ni le projet. Peut-être faut-il se demander alors ce qui pour lui se loge « à l’intérieur du mot théâtre »[4]. Comme toujours, asymétrique : la réalité que défie l’espoir.
Le théâtre n’est pas premier. Il y a tout d’abord l’écriture. Pourquoi écrire ? La question lui a été posée, dans la résistance, par son compagnon Ruben Muichkine :
Le soir même, il est venu me voir et m’a demandé à voix basse : “ pourquoi écris-tu ?” Et là aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais j’ai répondu : “pour changer le passé”. Il m’a remercié avant de partir. Je ne l’ai jamais revu. Etant juif, il a dû mourir à Auschwitz. J’ai su plus tard que toute sa famille avait été exterminée[5].
« J’écris pour changer le passé », déclare, alors, Gatti ; le projet, à ce jour, est le même. Le passé reste passé : il n’est pas question de le nier. Aucune parole poétique, aucune incarnation théâtrale ne peut avoir pour dessein de maquiller l’effroi et la désolation, de costumer les défaits en vainqueurs, les désastres en triomphes. Changer le passé, c’est s’opposer à son achèvement et s’impliquer, sans réserve ni retour, dans le présent : que ce dernier valide l’hypothèse mobilisatrice des combats défaits d’hier. « Les histoires doivent changer, il faut changer l’Histoire. Il faut arracher les événements à leur logique d’un jour pour les rendre habitables, pour les rendre respirables. Il faut, sous peine d’étouffement par l’Histoire, sous peine d’étouffement par tout ce que nous ne sommes pas » dira, en 1972, l’un des personnages de la Colonne Durruti[6].
Mais le théâtre ? En effet, rien n’en justifie l’usage ni le recours. La question lui est posée, en 1959 (l’année de la création du Crapaud-Buffle), Gatti répond alors : « C’est peut-être à cause des enterrements […] J’ai participé à des enterrements, oui… enfin, c’est une histoire très compliquée. Et je trouvais ça très beau, pas le contenu, mais le spectacle[7] ». Affirmation énigmatique mais qu’une part du théâtre à venir, fidélité aux morts et dialogue avec eux, ne démentira pas. Marc Kravetz, quelques décennies plus tard, l’interroge à son tour :
Parce que cette forme m’a paru à ce moment-là la plus directe pour communiquer. Ecrire un livre ? J’étais déjà enfermé dans Bas relief pour un décapité et je t’ai déjà raconté comment pendant sept ans j’avais trouvé la manière de retourner tous les soirs dans le camp. J’ai choisi le théâtre sans raison particulière. Je n’étais pas un homme de théâtre, je ne connaissais pas ce milieu, c’est né d’une nécessité de l’expression, d’une exigence du verbe, l’écrit me semblait insuffisant, c’est devenu du théâtre comme ça[8].
Nécessité, exigence : il semble qu’il n’ait pu échapper à cette écriure-là, particulière. Ce choix du théâtre cependant relève de l’intuition. Car que cela soit ses enjeux, sa pratique ou son monde, Gatti n’en a pas le goût. On ne trouve ainsi aucune empathie pour ses mythes, ses rites, ses légendes, son histoire. Ses œuvres lui sont bien souvent indifférentes — à l’exception de celles, rares, qui l’affrontent et le réinventent. Il lui est étranger. Sa classe sociale, tout d’abord, le tient à distance de ses imageries ; la vie, ensuite, le garde au loin de ses représentations. Et s’il est spectateur, ainsi que le révèlent les carnets de Pierre Jouffroy, il ne fait ni récit ni événements de ces représentations — sinon celles de Sibérie ou de Chine[9]. Des déclarations viennent d’ailleurs régulièrement stigmatiser le théâtre, lui reprocher sa médiocrité, ses écueils, sa complaisance, dessiner sa collaboration avec le nihilisme ou le cynisme[10], dénoncer sa participation à l’ordre des choses, sociale et politique, pourfendre ses étroitesses. A sa façon le théâtre fait corps avec la réalité et cela n’appelle, en conséquence, aucun égard. Qu’il illustre ou qu’il construise ce monde suffit à le discréditer. Il pactise. Il est trop compromis.
Quelques artistes tranchent, bien sûr, à raison de leur résistance au théâtre — son monde et sa pratique. Le Panthéon hospitalier de Gatti en accueille quelques-uns (bien peu en proportion) : les poètes Kateb Yacine, Vélimir Khlebnikov, Antonin Artaud ou, unique, le comédien Mei Lan Fang. Ces noms dessinent comme une splendide constellation : celle d’un inappropriable théâtre pour l’occident, qu’il en défie les formes et les fonctions ou qu’il lui soit radicalement étranger. Un « régisseur » cependant occupe une place décisive : Vilar, qui tel un « métal précieux, quelles que soient les circonstances, la façon dont il existait, réinterprétait, renvoyait le moindre trait de lumière[11] », « celui qui a changé s[a] vie[12] », le premier « père » de théâtre qu’il revendique[13] — et auquel, il sera, comme à chaque « père », d’une intraitable fidélité. C’est à son invitation, en 1959, que sa première pièce est créée au Théâtre Récamier[14]. Depuis cette rencontre, Gatti n’a cessé de louer son éthique, sa générosité, sa poésie[15]. Les dissemblances sont pourtant sensibles de l’un à l’autre, politiques ou esthétiques, et le travail théâtral de Gatti — ses mises en scène — ne sont d’évidence pas « vilariennes ». L’importance de Vilar se rapporte à sa fonction initiatrice — un père. Gatti lui doit la découverte du théâtre, sa pratique et son concret : « l’espace utopique, les voix, les personnages, les éclairages, bref, ce qui fait que le théâtre reste toujours dans les limbes s’il ne passe pas par là, s’il reste uniquement littéraire[16] ». Cruciale révélation qui indissocie matérialité et « utopie[17] » et indique les singularités du langage théâtral et de ses questions : « Comment essayer de dire dans l’espace. Et de quel espace s’agit-il[18] ? » Révélateur, Vilar fut aussi une figure consolatrice et encourageante — un père — lorsque la critique rageuse s’en prit au jeune dramaturge : « l’histoire de la critique théâtrale est jalonnée depuis la querelle du Cid d’erreurs parfois voulues, souvent de bonne foi […]. L’affaire « Crapaud-Buffle » vient d’entrer dans cette histoire[19] ». Son soutien sera déterminant. Gatti n’abandonnera pas le théâtre — il avait songé, un temps, le faire.
Quelques années après la violente charge critique contre Le Crapaud-Buffle, en janvier 1966, le Figaro Littéraire, titre à l’occasion de la création de Chant public devant deux chaises électriques au Théâtre National Populaire : « Armand Gatti n’est plus un auteur maudit[20] ». L’affirmation est exacte : Gatti est un auteur discuté, contesté — « Si l’art dramatique devait s’enliser dans une pareille gadoue, je renoncerais avec bonheur à aller au théâtre[21] » — dénoncé, mais il jouit d’une notoriété et d’une reconnaissance incontestables : « depuis la réussite de Villeurbanne [La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G.], tous les Centres Dramatiques se disputent ses pièces » relève Alfred Simon pour le déplorer[22]. Il est devenu, à part entière, un homme de théâtre, dramaturge et metteur en scène, joué sur des scènes prestigieuses. L’heure est, alors, en France, à la quête de nouveaux auteurs, d’un renouvellement de l’écriture théâtrale : qu’elle se transforme, quitte à balbutier ou échouer, qu’elle expérimente et invente. Gatti incarne la reviviscence de l’avant-garde : « théâtre des possibles », « selmaire », recomposition des temps et de l’espace. Simultanément, « une question hante le théâtre : celle de son aptitude à représenter la réalité contemporaine, à mettre sur la scène le monde dans lequel nous vivons[23] » et, par là, l’émergence d’un art, à hauteur des espérances et des luttes des années 1960, dans l’après-coup traumatisé des camps. Le théâtre de Gatti est aussi et simultanément ce théâtre politique. Pour autant, il se tient à distance de la dialectique et du réalisme brechtiens qui polarisent alors les discussions. Son œuvre s’avère plus proche de la démarche d’Erwin Piscator qu’il désigne comme son second père de théâtre — ou, plutôt, dont il est le fils[24], dans une filiation affranchie ; ses pères, en outre, ne seront jamais des auteurs mais des hommes de la scène comme si c’était là, et là seul, qu’il devait être précédé et initié[25]. Tous les deux, loin de définir ou de circonscrire les frontières du théâtre politique, se sont échinés à l’inventer, c’est-à-dire à en instaurer l’un des possibles et bien plutôt que d’arpenter ses terres, ils les ont libérées, l’un du naturalisme et de l’expressionisme, l’autre de la rationalité causaliste. A l’instar de Gatti, mais dès les années 1920, Piscator n’a jamais fait que plier le théâtre à la « nécessité de l’expression », de faire primer celle-ci, divergente chez l’un et l’autre, sur toute autre considération, de lui attribuer tous pouvoirs. Piscator entend montrer le destin de l’humanité, ses métamorphoses, ses rapports de classe, l’articulation des contradictions, la Totalité ; Gatti entend rendre justice à ce qu’implique une existence, dès lors qu’elle est envisagée à l’aune de ses possibles et de l’entrechoquement fécond de multiples temporalités : l’invention, dans l’un et l’autre cas, d’« une dramaturgie planétaire[26] » — « à l’assaut du ciel ». Car ils supposent un monde à dire en excès sur les proportions acceptables et des édifices théâtraux et du « bel animal » dramaturgique. Ainsi, il existe, de part et d’autre, — sans que le mot ait tout à fait la même signification — une volonté de rendre compte du macrocosme sur une scène de théâtre ; d’ouvrir le plateau et le théâtre à ce qui, par définition, les excède. Soit, chaque pièce disposera d’une construction singulières : « Sans être une cathédrale, un sujet théâtral détient des rapports, des harmonies, des structures qui lui sont propres. Couler n’importe quel sujet dans ce moule naturalisant que par habitude on continue à appeler le théâtre, me paraît d’un raffinement digne d’un meilleur sort[27] ». Cela suppose une indiscipline revendiquée à l’égard des normes et des contraintes théâtrales, le choix fait d’accorder toute puissance aux nécessités qu’induit « une théâtralité en quelque sorte immanente au sujet qu’elle aborde[28] », à son propre jeu de tensions et un acharnement à « développer une faculté en voie de disparition : l’imagination critique et politique[29] ». Gatti et Piscator se brouilleront. Le matérialisme historique de Piscator est, à terme, inconciliable avec l’orientation « blanquiste » — et christique[30] ? — d’un Gatti, toute en barricades, en « actions restreintes », en tutoiement de l’infini, de l’éternité et des astres. Ces œuvres, solitaires et autonomes, cohérentes et singulières, insistantes et inspirantes[31] ont en commun d’être inaugurales. Elles ont, l’une pour l’autre, dans l’histoire du théâtre politique, la fraternité des précurseurs — et une semblable difficulté à être reprise et répétée.
L’œuvre de Gatti occupe ainsi une place repérée mais isolée, dans la constellation du « théâtre politique ». En 1974, Jean Duvignaud et Jean Lagoutte écrivent :
Qu’importent les définitions : les pièces de Gatti sont des cris élaborés par un art très sûr de la mise en scène ; ses œuvres ont la liberté de l’imagination, c’est-à-dire la vivante et fébrile diversité de la vie réelle. Ce qu’Adamov n’a pu réaliser, soumis qu’il était à des normes trop intellectuelles, ce que Piscator ou Brecht, enserrés dans une gangue philosophique, n’ont pu complètement atteindre, Gatti y parvient peut-être. Ce visionnaire est sans doute le seul auteur politique — mais non idéologique — du théâtre contemporain[32].
Notes
[1] A. Artaud cité in J. Derrida, « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation », L’Ecriture et la différence, Paris, Editions du Seuil (« Essais »), 1967, p. 366.
[2] A. Gatti, La Parole errante, Lagrasse, Editions Verdier, 1999, p. 1346.
[3] A. Gatti, « Préface », Théâtre ***, Paris, Seuil, 1962, p. 9.
[4] « ALPHABET DE LA QUESTION . — Nous sommes des Alphabets. Nous n’allons pas entrer dans un théâtre, mais dans les différents sens du mot théâtre ». A. Gatti, « Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz », œuvres théâtrales. III, Lagrasse, Editions Verdier, 1991, p. 26.
[5] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, La poésie de l’étoile. Paroles, textes et parcours, Descartes & Cie, Paris, 1998, p. 49.
[6] A. Gatti, « La Colonne Durruti », Œuvres théâtrales. Tome II, Lagrasse, Verdier, 1991, p. 729.
[7] A. Gatti « Premier interview à « Bref » – 1959 » reproduit in S. Gatti, M. Séonnet, Gatti. Journal parlé d’une écriture, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « 50 ans de théâtre vus par les trois chats d’Armand Gatti », Montreuil, Centre d’Action Culturelle de Montreuil – La parole errante, 1987, p. 18.
[8] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, Toulouse, L’Ether Vague – La Parole errante, 1987, p. 96.
[9] Voir D. Knowles, Armand Gatti in the Theatre: Wild Duck Against the Wind, London, The Athlone press, 1989, p. 9 ; A. Gatti, Chine (1956), Paris, Editions du Seuil (« Petite Planète »), 1965,
[10] « Le théâtre de Beckett sous forme d’une bouffonnerie sinistre (et exténuée) exige une vision dérisoire de l’homme. C’est faire l’homme plus petit qu’il n’est ». A. Gatti, « Révolution culturelle nous voilà ! », La Traversée des langages, Lagrasse, Editions Verdier, 2012, p. 83.
[11] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 90
[12] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, op. cit., p. 107
[13] « Les deux autres étant Piscator et Mao Tsé-toung ». Idem, p. 107. Sur Piscator, voir infra.
[14] Voir C. Brun, « La Création du Crapaud Buffle », in C. Brun, O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « La Traversée des langages », n°3, 2012, pp. 263-271.
[15] « J’ai connu une évasion, elle a ouvert sur mes débuts au théâtre dans les réalités du système. Elle a eu lieu à Sète, pendant les vacances dans la maison de Jean Vilar… Chaque après-midi, je lui apportais un texte autour duquel j’avais tournoyé durant la nuit comme un papillon autour d’une lampe restée allumée, il avait trouvé une façon « théâtrale » d’établir le contact avec mes écritures. Le texte était punaisé à un pupitre. Je lisais d’abord. Puis Jean Vilar pointant une clarinette, jouait la lecture toujours avec grâce, inspiration, et fantaisie. Les personnes à ce moment-là présentes choisissaient un passage, et expliquaient pourquoi elles l’avaient choisi. La mort et la vie du chat de Schrödinger étaient débattues selon les passages lus. La clarinette multipliait les traductions. Parfois Oulipo était présent, riche de chiffres, et d’onomatopées. Discussions jusqu’à la tasse de thé vert, Artaud était parfois de passage. Il y eut des soirs où Artaud, Vilar, et Gatti devenaient le miroir éclaté l’un de l’autre ». A. Gatti, « Gomorrhe. Imaginer le possible pour réaliser le désirable », La Traversée des langages, op.cit., p. 28.
[16] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 89.
[17] « C’est donc par Vilar que je suis entré dans cette utopie là ». Idem, p. 89.
[18] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, op. cit., p. 108.
[19] J. Vilar, « messieurs les critiques, vous êtes cruels, c’est mauvais signe », Arts, n°748, 1959 repris in J. Vilar, Le Théâtre, service public (1975), présentation et notes d’A. Delcampe, Paris, Editions Gallimard (« Pratique du théâtre »), 1986, p. 415.
[20] S. Zegel, « Armand Gatti n’est plus un auteur maudit », Le Figaro littéraire, 20.1.1966. Sur Gatti et la critique, voir M. Consolini, « Du conflit aveugle au consensus vide », in C. Brun, O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « Du journalisme », n°4, La Parole errante, 2013, pp. 230-261.
[21] J.-J. Gautier, « Chant public devant deux chaises électriques », Le Figaro, 28 janvier 1966.
[22] A. Simon, « Sacco et Vanzetti au T.N.P. : complainte devant deux chaises vides », Esprit, mars 1966, p. 416.
[23] B. Dort, Théâtre réel. Essais de critique 1967-1970, Paris, Editions du Seuil, 1971, p. 7.
[24] « […] il m’a amené à la télévision et effectivement il a déclaré à la TV que j’étais son fils, que je venais d’achever une pièce L’Homme seul sur la Chine et là-dessus il est parti en flèche sur Brecht qu’il n’aimait pas du tout, faisant la comparaison entre les deux, me portant très haut, ce qui m’a plongé dans des sentiments mêlés, sans compter une certaine gêne et m’ a valu une amitié très réduite des brechtiens de l’époque. A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 93
[25] Voir ce qu’écrit E. Piscator sur le type d’auteurs espéré par lui en conclusion du Théâtre politique ; « En vérité, trop de choses manquent à ce théâtre. Tout d’abord un répertoire, où chaque pièce devrait allier la rigueur et la précision idéologiques à de fortes chances de succès. « L’article de fond » à lui seul ne suffit pas. Le théâtre a besoin d’être « théâtral ». C’est le seul moyen pour lui d’être efficace. Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se permettre d’être réellement un théâtre de propagande. Mais nous devons commencer par conquérir ce domaine-là. Des initiatives ont été prises dans ce sens pour développer la production des œuvres. Mais les auteurs doivent apprendre à traiter le sujet objectivement ; ils doivent comprendre d’abord la dramaturgie des phénomènes les plus simples et les plus grands de la vie. Le théâtre exige des effets proches de la nature, sans raffinement et sans « recherche » psychologique. De plus, la majorité des auteurs se fait une idée fausse du public. Il est plus facile à ce public de suivre et de contrôler un événement quotidien que l’Œdipe de Sophocle. […] J’ai toujours eu dans la tête ce plan qui s’impose toujours davantage et qui consisterait à distribuer aux auteurs des sujets choisis par et pour le théâtre, à procéder à leur mise en forme dramatique en collaboration étroite avec le théâtre, et à ne plus jamais accepter des pièces dites « achevées » ». E. Piscator, Le théâtre politique suivi de Supplément au théâtre politique, Paris, L’Arche Editeur, 1962, pp. 235-236.
[26] J.-P. Sarrazac, « Un art nouveau pour un nouveau monde », in R. Abirached (sous la direction de), Le Théâtre français au XXe siècle, Paris, Editions L’Avant-scène théâtre, 2011, p. 296.
[27] A. Gatti, « Préface », Théâtre ***, op. cit., p. 7.
[28] J.-P. Sarrazac, L’Avenir du drame. Ecritures dramatiques contemporaines, Belfort, Circé (« Poche » / « Penser le théâtre »), 1999, p. 22.
[29] M. Piscator, « L’itinéraire d’Erwin Piscator : une vie pour le théâtre », in M. Piscator, J.-M. Palmier, Piscator et le théâtre politique, Paris, Editions Payot, 1983, p. 207.
[30] « Une fois, il m’a fait un reproche. C’était à Francfort et de nouveau à propos de L’Homme seul : « Quelles différences fais-tu entre les héros de tes pièces, me demandait-il, et Jésus Christus ? C’est toujours le même idéaliste qui va mourir, abandonné de tous, trahi par les siens, c’est toujours l’histoire de Jésus Christ. Avec les morts, la discussion est plus facile. Essaie de discuter avec les vivants. Tu perdras peut-être en majesté, en grandeur, mais tu gagneras en vérité ». A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., pp. 94-95.
[31] Ainsi, par exemple, Antoine Vitez qui écrivait à l’occasion du colloque « Théâtre sur paroles. Salut Armand Gatti », le 14 avril 1988 « A toi, Dante, qui a connu l’Enfer véritable, et qui continue à déplier pour les générations le livre entier des blessures, j’envoie mon salut fraternel, et un peu filial, car nous sommes à ton école » (P. Tancelin (Sous la direction de), Théâtre sur paroles. Salut Armand Gatti, Toulouse, Patrice Thiery – L’Ether vague, 1989, p. 201). Ou, Alain Françon : « C’est un parcours qui m’aide à avoir mes propres repères », dans l’émission « Radio Libre » diffusée sur France Culture et consacrée à la parution de La Parole errante le 25 septembre 1999.
[32] J. Duvignaud, J. Lagoutte, Le Théâtre contemporain. Culture et contre-culture, Paris, Librairie Larousse, 1974, p. 202.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 13, 2017 8:26 AM
|
"Le Petit bain" par Johanny Bert, critique de Marie Plantain dans Pariscope.fr
C’est une expérience d’une poésie infinie qui attend enfants et parents en ce moment au Théâtre Paris-Villette. "Le Petit Bain" est un spectacle jeune public d’une délicatesse rare, accessible aux tous petits dès 2 ans.
On pense à Gaston Bachelard et son œuvre philosophique autour de l’imagination de la matière, à la vue de ce spectacle tout de mousse vêtu, imaginé par le metteur en scène Johanny Bert. Le plateau y est investi tout autant par son interprète, le danseur Samuel Watts, que par son élément principal, une montagne de mousse, partenaire imprévisible et pourtant domptable, tantôt compact, tantôt volatile, propice au jeu autant qu’à la rêverie.
Au commencement du spectacle, il y a la mousse. Décor immobile, contenu et enfermé entre quatre clôtures ajourées façonnant un cube. Puis un jeune homme entre en scène, depuis le public, il monte sur le plateau, comme venu de nulle part, avec son grand manteau et son sac à dos. Une sorte de clochard céleste rimbaldien au regard doux et angélique, qui commence à s’inventer un compagnon oiseau d’une poignée de mousse qu’il dépose tendrement sur son épaule. Et voilà que l’homme danse et que l’oiseau l’accompagne dans ses mouvements. Et voilà comme l’imaginaire nous cueille et nous fait traverser l’horizon du réel. C’est alors que l’homme ouvre la cage, la métaphore se file mais c’est dans un autre monde que nous pénétrons, celui où tout est possible. Il fend la mousse comme on fend les flots, se fait mousse justement, ou capitaine d’un navire, tente un pied dans l’eau trop froide, se réchauffe à un soleil tracé à la pointe de son doigt, la mousse devenant alors peinture blanche sur fond noir. Puis de l’océan on navigue vers le Pôle et sa banquise, la mousse devient neige et notre voyageur immobile grelotte au fond d’une grotte. Puis c’est un nuage qui flotte, une pluie de confettis, un chapeau, une paire de jumelles. "Le Petit Bain" est une épopée. Une épopée minuscule entraînée par un imaginaire galopant qui traverse la matière pour mieux voyager.
Le danseur Samuel Watts se meut avec une grâce enfantine un rien mélancolique, dans cet élément qui touche tout à la fois au quotidien du bain et à la rêverie illimitée. Surface de projection infinie, la mousse est en métamorphose perpétuelle, le moindre souffle la fait trembler, elle passe de la densité à l’effritement, fragile et multiple, elle se transforme au gré de l’imagination qui la fait décoller de son statut premier. On en suit les évolutions avec fascination. Elle est à la fois le paysage dans lequel évolue le personnage, son partenaire de scène, son liquide amniotique.
Ainsi "Le Petit Bain" touche autant aux rives de la danse, du mime que du théâtre d’objet. L’objet en question étant tangible tout autant qu’insaisissable, liquide et aérien, masse compacte et flocons épars. La bande son musicale ajoute à la subtilité de l’ensemble, on passe des volutes au saxophone de Colin Stetson aux partitions baroque d’Abel et c’est un régal. Sans parler du final qui est pure merveille.
Les enfants sont happés, les parents aussi. Rarement le théâtre jeune public n’aura touché des cordes aussi sensibles, universelles et intergénérationnelles. Une pépite.
Par Marie Plantin
Le Petit Bain
Du 6 au 23 avril 2017
Au Théâtre Paris-Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Photo © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2017 5:45 PM
|
Par Floriane Fumey pour I/O Gazette
Mon cirque pour un royaume
Un chapiteau pour les enfants, une coulisse pour les parents : l’idée n’est pas mauvaise et devient même carrément culottée quand c’est la compagnie du Zerep qui la met en scène. Ils sont tous là, toujours aussi hilares, prompts à l’improvisation, et costumés de la tête aux pieds. Ce double dispositif leur permet d’explorer le décalage entre deux espaces de jeu corsetés par des mœurs bien précises. Ils en profitent pour pousser au paroxysme la provocation, art dans lequel ils sont passés maîtres. Comment faire trembler les parents et régaler les enfants de ce qui est interdit (et peut-être même les choquer un peu au passage, pour mieux les déniaiser…) ? Alors oui, Babarman est une femme, tout se mélange et ça pète dans tous les sens. L’humour est graveleux et les bribes que l’on capte de la tente ne sont pas pour nous rassurer. Indignez-vous parents, le Zerep est de sortie ! Heureusement, pour une heure seulement.
EN BREF
Babarman, mon cirque pour un royaume
Auteur : Compagnie du Zerep
Genre : Spectacle pour enfants
Mise en scène/Chorégraphie : Sophie Perez, Xavier Boussiron
Distribution : Daniele Hugues, Françoise Klein, Gilles Gaston-Dreyfus, Marlene Saldana, Sophie Lenoir, Stéphane Roger
Lieu : Théâtre Nouvelle Génération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2017 7:42 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde
Peu connu du grand public, il s’est éteint, lundi 3 avril, à l’âge de 83 ans.
Il n’était pas connu du grand public, mais c’était un homme qui comptait : André-Louis Perinetti, mort lundi 3 avril, à 83 ans, a passé sa vie à travailler dans et pour le théâtre. Né le 7 août 1933 à Asnières (Hauts-de-Seine), ce fils de commerçant a étudié le droit, à Paris, où, comme beaucoup dans sa génération, il a découvert le théâtre à travers le Théâtre des Nations, qui a un rôle de premier plan dans les années 1960 en faisant venir des troupes étrangères et en offrant une université internationale permettant à toute une jeunesse de se former.
Très vite, André-Louis Perinetti dirige cette université, hébergée au Théâtre Sarah-Bernhardt (l’actuel Théâtre de la Ville). Quand cette salle ferme pour travaux, l’université déménage dans la cave d’un cinéma, à Gambetta (dans le 20e arrondissement de Paris), où elle continue à accueillir des stagiaires, dont beaucoup sont des étrangers. Certains repartent ensuite dans leur pays, d’autres restent en France, comme les Argentins Jorge Lavelli et Victor Garcia, un météore de génie dont les mises en scène ont durablement marqué. Côté français, il y a de jeunes metteurs en scène, tels Jean-Marie Patte ou Jérôme Savary, qu’André-Louis Perinetti aura largement contribué à faire connaître.
Homme de rencontres et d’action
Cette université internationale du Théâtre des Nations fait aujourd’hui rêver. Les stagiaires travaillaient sur des thèmes, entourés par des universitaires (dont Bernard Dort), des auteurs (Ionesco, Gatti, Césaire…), des metteurs en scène (Serreau, Vitez, Barrault…). En 1968, André-Louis Perinetti prolonge cette action d’une autre manière : il devient directeur de la Cité internationale, qu’il dote de plusieurs salles et impose comme « un théâtre d’art », dans l’esprit renouvelé des petites salles de la rive gauche. Au programme de sa deuxième saison, il y a une trentaine de compagnies étrangères – le Bread and Puppet Theatre, l’Odin Teatret – et françaises, dont celle de Patrice Chéreau, qui présente L’Héritier de village, de Marivaux.
Là encore, il faut louer André-Louis Perinetti pour l’essor qu’il a contribué à donner au Théâtre de la Cité internationale. Une renommée qui lui a valu d’être nommé à la tête du Théâtre national de Strasbourg (TNS), en 1972. En Alsace, cet homme de rencontres et d’action veut poursuivre le travail mené à Paris. Mais l’institution s’y prête moins. Et, surtout, André-Louis Perinetti est appelé, en 1974, à la direction du Théâtre national de Chaillot, où il remplace Jack Lang, que Michel Guy, ministre de la culture de Valéry Giscard d’Estaing, veut écarter. Ce n’est pas un lit de roses : des restrictions budgétaires sévères, une situation politique complexe, la salle Jean-Vilar en travaux…
ANDRÉ-LOUIS PERINETTI EST MOINS À L’AISE DANS DE « GRANDS » THÉÂTRES QUE DANS LES PETITES SALLES PROPICES À L’EXPÉRIMENTATION
La plupart des spectacles se donnent salle Gémier ou au Théâtre de la Cité internationale. André-Louis Perinetti continue d’inviter des Sud-Américains et l’underground américain, qui lui sont chers. Il invite aussi des artistes de l’est de l’Europe, comme le Polonais Tadeusz Kantor. Mais, comme au TNS et outre les difficultés, il est moins à l’aise dans de « grands » théâtres que dans les petites salles propices à l’expérimentation. De même, il est moins à l’aise quand il signe ses propres mises en scène que quand il programme celles des autres.
Quand il quitte Chaillot, où Antoine Vitez le remplace en 1981, André-Louis Perinetti change de route. Désormais, il ne dirige plus de salle, mais il s’active sans relâche à mettre en avant le théâtre, auprès de l’Unesco (en tant que secrétaire général de l’Institut international du théâtre), au CNRS (en tant que membre du directoire du Laboratoire de recherche sur les arts de la scène), dans de multiples colloques, en France et à l’étranger. Jusqu’au bout, il a parcouru le monde. C’était un voyageur, à travers les continents, et dans le continent du théâtre, sa terre de cœur et d’élection.
André-Louis Perinetti en quelques dates
7 août 1933
Naissance à Asnières (Hauts-de-Seine)
1968
Directeur du Théâtre de la Cité Internationale
1972
Directeur du Théâtre national de Strasbourg
1974
Directeur du Théâtre national de Chaillot
1984
Secrétaire général de l’Institut international du théâtre
3 avril 2017
Mort

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2017 6:50 PM
|
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog
L’une des pièces les moins jouées de Racine. Non sans raison: elle n’a pas la ligne forte d’un Britannicus ou d’une Andromaque, et Racine s’abuse sans doute en parlant de tragédie, quand il s’agit plutôt d’un drame. Aucun personnage n’évolue, il ne leur reste qu’à mourir ou à « persévérer dans leur être » ces intrigants infatigables qui sortent toujours leur épingle du jeu, sans parler de l’artifice d’une lettre perdue et trouvée. La pièce a quand même dû avoir son heure de gloire et on y entend quelques vers passés dans le domaine public comme le fameux: «Nourri dans le sérail, j’en connais les détours» du prudent Acomat.
Faut-il de la terreur et de la pitié pour qu’il y ait tragédie ? Bajazet, homme objet de deux passions antagonistes, n’inspire pas la pitié : trop borné à un courage sans emploi, séquestré par son frère le sultan qui craint en lui un rival, trop enfermé dans un amour de jeunesse dont il ne sait pas utiliser le potentiel de révolte. Comme Atalide, sa fiancée. Ils s’aiment par principe, c’est leur colonne vertébrale : prêts à mourir l’un pour l‘autre… Elle, révélant hors de sa présence toute sa frustration, lui, tout à sa « gloire », généreux tous les deux jusqu’à l’ennui.
Heureusement, ils se trouvent entre les mains d’une sultane qui introduit de la terreur dans l’affaire. Esclave élevée au plus haut rang du pouvoir par l’amour du sultan qui guerroie au loin, elle fait sa proie de Bajazet, prisonnier du sérail, dévirilisé. C’est l’amour ou la mort : aime moi, ou je te tue. Et cela fait un drame, à défaut d’une tragédie : on sait que l’amour ne se commande pas.
Blaise Pascal le dit mieux : l’amour, et le pouvoir ou la domination, ne sont pas du même ordre, et vouloir imposer l’un par l’autre, devient le propre de la tyrannie. Avec cela, à la fin, inévitablement, tous meurent, à l’exception, on l’a vu, de ceux qui tirent les ficelles et « songent à eux ».
Reste Roxane, le rôle-maître, à défaut d’être le rôle-titre. Clotilde de Bayser en donne peu à peu les facettes : dissimulation de la calculatrice (jamais longtemps : c’est une faible femme…), dureté de l’orgueil, atermoiements de l’ancienne esclave finalement peu sûre d’elle, passion dévorante… En un mot, elle arrive à exprimer l’extraordinaire vulgarité d’un pouvoir sans opposition, et domine la distribution. Mais son rôle est mieux écrit.
Rebecca Morder, (Atalide), sorte de Junie tétanisée par la colère, Laurent Natrella (Bajazet) réduit au silence par cette double convoitise de femmes, ont une palette beaucoup plus étroite. Denis Podalydès, presque trop sobre pour une fois, fait, de ce vizir qui voudrait bien être sultan à la place du sultan… le parfait politicien qui flotte sur tous les courants. En confident ou en faire-valoir, Alain Lenglet peine à dépasser la convention ; les suivantes habillées de gracieuses robes ont plus de chance, avec un moment dramatique à jouer (Anna Cervinka et Cécile Bouillot).
Eric Ruf a placé toute l’affaire dans ce qu’il appelle une « chambre sourde » du sérail. Cernée d’armoires avec des arrière-plans troubles, et encombrée d’un étalage de chaussures de femmes, symbole de leur pouvoir et de leur intimité. Cela fonctionne bien, mais les acteurs entrant sur le plateau du Vieux-Colombier ont souvent l’air trop grands pour le décor.
On peut aller voir cette pièce secondaire de Racine, surtout pour Clotilde de Bayser et pour cette vision catastrophique de la passion possessive et destructrice, celle d’une pure fiancée comme celle d’une sultane sans scrupules.
Christine Friedel
Théâtre du Vieux-Colombier, 21 rue du Vieux-Colombier, Paris VIème. T : 01 4439 87 00 jusqu’au 7 mai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2017 2:04 PM
|
Il était l’un des professeurs de théâtre les plus réputés de France. Jean Périmony est décédé dimanche à 86 ans. Ce Jurassien, formé au conservatoire a été le professeur de générations de comédien (ne) s tels que Fanny Ardant, Jean-Pierre Bacri ou encore Nicole Garcia.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2017 7:05 AM
|
Mathieu Dochtermann
En amenant Paysages de nos larmes jusqu’à nos rives, le collectif Kahraba (Liban) nous fait le présent d’un bijou infiniment précieux: poème sombre, mais traversé de la plus lumineuse pensée, violent, mais gonflé par l’espoir, âpre, mais porté par la beauté des images et de la musique. Chef d’oeuvre protéiforme, puisant à toutes les disciplines, les atours somptueux de la forme se drapent autour du squelette magistralement écrit par Matéi Visniec, qui revisite là le mythe de Job. Une brusque secousse, une expérience proche du mystique. L’humanité mérite-t-elle encore et toujours l’amour indéfectible que Job lui porte?
★★★★★
L’histoire de Job est l’un des plus cruels, des plus impressionnants, et des plus beaux récits bibliques, dont la trace, presque universelle, se trouve dans les trois grandes religions du Livre. Au travers de Job, dont cœur pur ne peut cesser de crier malgré lui son amour de l’Homme, se pose la question éternelle de la rédemption: comment avoir foi en l’Humanité, que peut-on attendre de notre espèce malgré l’horreur, malgré l’aveuglement, malgré l’égoïsme, malgré la laideur? De quelles violences ne sommes-nous pas capables, et, malgré cela, comment pouvons-nous continuer à nous aimer, condition indispensable à sortir du cercle de la destruction, pour construire un avenir commun?
A cette question, l’une des plus importantes posées à l’Humanité, ni Matéi Visniec, ni Eric Deniaud ne répondent par un dogme. Le premier est l’un des plus magnifiques auteurs de théâtre de langue française, un poète hors de pair; l’autre est un artiste visuel de talent, formé à l’ESNAM à Charleville-Mézières, établi à Beyrouth depuis 2007, où il est au cœur d’un foisonnement de projets artistiques, notamment portés par le collectif Kahraba. Présenté au Tarmac dans le cadre du festival Traversées du monde arabe, Paysages de nos larmes est le fruit de leur collaboration, et, aurait-on envie de dire, la pièce ne pouvait être autre chose que sublime.
Le texte est beau, dépouillé, fort, il va à l’essentiel et frappe au coeur, au creux de l’estomac, bref, il saisit le spectateur dans un étau viscéral. C’est Roger Assaf, comédien et metteur en scène libanais, figure du théâtre arabe, qui prête sa voix à Job, une voix enregistrée, qui mêle l’arabe et le français, une voix dense, à la tessiture riche, sur laquelle roulent les mots si beaux et si puissants de Matéi Visniec. A mi-chemin entre la voix intérieure et la narration, les paroles prononcées donnent à entendre les pensées de Job: malgré le fait qu’on lui ait percé les tympans, malgré le fait qu’on lui ait arraché la langue, malgré le fait qu’on lui ait coupé les doigts, ou, peut-être, justement, à cause de tout cela, son dialogue intérieur, désincarné, résonne à nos oreilles, dans l’obscurité du théâtre. Récit terrible dans ce qu’il condense d’horreurs; récit lumineux de confiance et d’amour.
Pour y faire écho, la scène plongée dans une quasi obscurité nous montre Job comme une marionnette frêle, aux mouvements mesurés, manipulée avec délicatesse par les trois comédiens-marionnettistes. C’est toute la fragilité de Job mutilé, de Job impuissant, de Job aux portes de la mort qui s’incarne dans ce pantin nu et maigre. Avec d’infinies précautions, la marionnette fait ses entrées et ses sorties, revient nous dérouler son histoire, tandis que se succèdent sur le plateau des images d’une ville qui croît puis se déchire, puis ressuscite dans l’anarchie, puis se transforme en une montagne de béton vigilant tandis qu’autour le blé repousse dans les champs. Le sol et le fond de scène sont en tissu fluide et froissé, la lumière danse, tout bouge et passe et se reforme dans une lumière de fin du monde, à moins qu’il ne s’agisse au contraire de l’aube des temps?
Au milieu de cela, les comédiens, sensibles et talentueux au-delà du dicible, se livrent à un méticuleux ballet, rituel animiste ou chamanique, tantôt servants de la marionnette dont ils recréent le mouvement comme pour tirer son image des ombres, tantôt dansant autour des maisons de la ville désertée, tantôt officiants d’une cérémonie expiatoire où les douleurs de l’humanité se concentrent dans les masques dont ils s’affublent. Les tableaux se suivent, rivalisent de beauté formelle et de force symbolique. Pour accompagner le déchirement des voiles, le déchirement des maquettes, et le déchirement des âmes perdues, le violon seul fait contrepoint à la voix de Job, et vient improviser un air klezmer, qui chante les tourments de l’humanité mais qui dit également l’espoir dans le secret des cœurs.
Qui, mieux qu’un collectif d’artistes libanais, pouvait libérer la puissance poétique brute de ce matériau? Comment rester impassible dans la salle de spectacle à ces paysages détruits, face aux supplices endurés par Job, tandis que nos fils d’actualités s’emplissent du bruit terrible des missiles, des enfants gazés, des camions qui foncent dans les foules?
Et pourtant, Job nous invite à ne pas céder à la tentation de la haine. Il n’offre aucune réponse, n’indique aucune méthode, mais plante là une foi lumineuse, qui brûle d’autant plus forte qu’elle contraste avec les intenses ténèbres qui semblent vouloir nous étouffer: « Moi je n’ai rien dit. Mais dans mon cœur il y avait une voix qui criait plus fort que moi: Oui, je crois en l’homme! »
Ce que nous dit Job, ce que nous affirment Matéi Visniec et Eric Deniaud, c’est que la poésie peut apporter des réponses, c’est que la philosophie peut sauver, c’est que la foi peut transcender les visions les plus apocalyptiques et restaurer l’espoir. Du danger et de la vulnérabilité peuvent naître les plus beaux des poèmes, doivent naître les plus beaux poèmes, car ils sont le ferment de l’espoir et le terreau sur lequel s’enracinent les possibles.
Au milieu des ombres, c’est la puissance de notre imagination, et l’authenticité de notre amour, qui, seuls, peuvent nous guider vers les champs de l’avenir.
Une oeuvre sublime, bouleversante, traversée à la fois par l’urgence du moment et par le souffle d’une sagesse ancestrale: c’est cela que propose Paysages de nos larmes. Une magnifique expérience de théâtre, à vivre absolument.
Trailer – Paysages De Nos Larmes from Collectif Kahraba on Vimeo.
https://vimeo.com/204870058
Mise en scène: Eric Deniaud
Texte: Matéi Visniec – Musique: Dominique Pifarély
Voix: Roger Assaf
Avec: Marielise Youssef Aad, Dana Mikhail, Dominique Pifarély, Aurélien Zouki
Création sonore: Christophe Hauser – Création lumière: Riccardo Clementi
Scénographie, marionnettes et videos : Eric Deniaud – Assistante construction et vidéo : Tamara Badreddine
Collaboration artistique : Cécile Maudet / Lena Osseyran / Ahmad Khouja
Traduction en langue libanaise: Chrystèle Khodr and Roger Assaf
Chargée de production : Virginie Crouail
Diffusion : MYND

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 10:51 AM
|
Par Vincent Bouquet pour son blog "Du théâtre par gros temps"
« Nachlass » / Crédit photo : Samuel Rubio.
Dans la galaxie théâtrale, Rimini Protokoll occupe une place fort singulière. A mi-chemin entre la performance participative et le théâtre documentaire, le collectif berlinois crée des installations où le spectateur, en totale immersion, doit interagir plus ou moins activement avec l’univers qu’il découvre. Cette fois, au Théâtre de Vidy, Stefan Kaegi et Dominic Huber s’intéressent au Nachlass, à cet ensemble de biens matériels et immatériels laissés par un défunt, à ces archives de vie léguées en héritage.
Invités à pénétrer dans une salle d’attente aux allures futuristes, les spectateurs se retrouvent face à huit portes. A côté de chacune, figure le nom d’une personne ; au-dessus, des comptes à rebours : blancs lorsque la pièce est libre, rouges lorsqu’elle est occupée. Dans l’ordre qui leur sied, ils vont, au gré de leur déambulation, faire la rencontre de Jeanne, Annemarie et Gunther, Alexandre, Gabriele, Richard, Nadine, Michael, et Celal. Aucun n’est physiquement présent, tous ont un rapport plus ou moins lointain avec la mort, certains, malades ou non, ont même décidé de la précipiter en ayant recours au suicide assisté, autorisé en Suisse. Dans ces pièces sans personnes, comme autant d’antichambres de la mort, ils donnent à voir, à toucher, à entendre leurs Nachlass, précipités de vies qui nous plongent dans leurs univers.
A l’heure du crépuscule
Voyeur, anecdotique, morbide, déprimant, penseront certains. Bien au contraire, la proposition de Rimini Protokoll, qui ne sombre à aucun moment dans l’apologie de l’euthanasie, s’érige en faux par rapport à ces préjugés primaires. D’abord, parce que ces pièces, qui n’ont rien de chambres mortuaires, sont pleines de vie. Parfois touchants, souvent bouleversants, les récits entrent en résonance unique avec le vécu et les obsessions de ceux qui les écoutent. Par ce procédé réflexif, ils deviennent universels et tout un chacun en vient à s’interroger sur son propre héritage, celui qu’il lèguera à l’heure du crépuscule. Sera-ce cette lutte contre l’idéologie, comme Annemarie et Gunther, ce goût pour la pêche à la mouche, comme Alexandre, cette bataille pour le développement de l’Afrique, comme Gabriele, ou plutôt ces photos de famille et ces petits réveils confectionnés par Jeanne durant toute sa vie ?
Il faut ainsi saluer l’immense travail fourni par Stefan Kaegi et Dominic Huber pour collecter et restituer l’ensemble de ces témoignages dans toute leur diversité. Loin d’être des sauts de puce de salle en salle, ces visites, soutenues par une scénographie au cordeau parfois subjuguante, sont autant de voyages dans l’intime. Paradoxalement, alors qu’on ne passe que huit minutes en leur compagnie, l’attachement à ces personnes est toujours immédiat, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. Difficile alors de s’extraire, a posteriori, de cet environnement et, dans le flot théâtral pourtant intense, il sera impossible, à l’avenir, d’oublier totalement Jeanne, Annemarie et Gunther, Alexandre, Gabriele, Richard, Nadine, Michael, et Celal qui, un samedi d’avril, nous ont ouvert leurs âmes.
Nachlass – Pièces sans personnes de et par Rimini Protokoll au Théâtre de Vidy (Lausanne) jusqu’au 2 avril, puis du 20 au 27 mai au Festival Théâtre en Mai (Dijon) et du 1er au 11 juin au Maillon (Strasbourg). Durée approximative : 1h30. ****

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 9:35 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde :
Katharina Thalbach met en scène la pièce de Bertolt Brecht avec un parti pris trop appuyé pour convaincre.
La montée du nazisme fait une nouvelle fois l’objet d’un spectacle à la Comédie-Française, cette saison. A l’automne 2016, il y a eu Les Damnés, d’après le film de Luchino Visconti, mis en scène par le Flamand Ivo van Hove. Et voilà maintenant La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht, mise en scène par l’Allemande Katharina Thalbach. Le choix de ces textes et de ces metteurs en scène témoigne du renouveau souhaité et mis en œuvre par Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française : ouverture vers l’étranger, élargissement du répertoire.
La Résistible Ascension d’Arturo Ui n’avait jamais été présentée salle Richelieu, où Bertolt Brecht est entré avec Maître Puntila et son valet Matti, en 1976. Dans ces années-là, un brechtisme pur et dur régnait sur les scènes françaises, où on ne plaisantait pas avec l’orthodoxie du plus grand dramaturge allemand du XXe siècle (avec Heiner Müller, connu plus tardivement en France). Il a fallu beaucoup de temps pour que les metteurs en scène s’affranchissent de la rigueur grise et de la fameuse distanciation érigée en principe incontournable.
Héritage roboratif
Eric Ruf, qui est né en 1969, explique dans l’éditorial du programme de La Résistible Ascension… avoir été marqué, comme toute sa génération, par cet héritage roboratif. Parce qu’il voulait faire entendre Brecht aujourd’hui par quelqu’un qui lui redonne vie en partant du plateau, il a demandé à Katharina Thalbach de signer la mise en scène. C’est une première en France pour cette femme étonnante, qui n’a pas connu Brecht (elle avait 2 ans quand il est mort, en 1956), mais a grandi au Berliner Ensemble, dirigé par Helene Weigel, dont étaient membres ses parents, deux grands artistes, la comédienne Sabine Thalbach et le metteur en scène Benno Besson.
C’est peu de dire que les fées du théâtre se sont penchées sur le berceau de Katharina Thalbach, qui est elle-même devenue une comédienne exceptionnelle, et avoue avoir été fort surprise quand, étant passée à Berlin-Ouest, en 1976, avec son mari, l’écrivain Thomas Brasch, elle a découvert une vision de Brecht très éloignée de celle qu’elle avait. « Ils ne percevaient rien de son humour, de son intelligence, de sa modernité, de la précision avec laquelle, dans un langage éminemment poétique, il avait décrit les processus du capitalisme, un capitalisme qui continuait et continue à faire rage », déclare-t-elle dans un entretien à la Comédie-Française.
KATHARINA THALBACH A RACCOURCI LE TEXTE, DONT ELLE PENSE QU’IL DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS UN ESPRIT DE THÉÂTRE POPULAIRE
Katharina Thalbach, qui a très tôt fait de la mise en scène, n’avait jamais travaillé en France, ni monté La Résistible Ascension d’Arturo Ui, qu’elle a vue « des centaines de fois », dans son enfance, au Berliner Ensemble. Elle a raccourci le texte, dont elle pense qu’il doit être présenté dans un esprit de théâtre populaire, sans verser dans la psychologie ni s’accrocher au réalisme. Il y a ainsi, à la Comédie-Française, un côté théâtre de foire, un jeu très rapide, un goût marqué pour l’efficacité, et une vision revendiquée d’Arturo Ui : ce n’est pas seulement une figure politique – le double d’Adolf Hitler –, mais aussi une figure sociale – celle d’un gangster.
Noir, c’est noir : tout se passe sur un plateau noir, avec au sol un plan de Chicago, la ville où se situe l’action. Devant, une toile d’araignée recouvre l’ouverture de la scène. Le plateau, très en pente, recèle des trappes. Avec ce décor, signé Ezio Toffolutti, on entre immédiatement dans une zone à risques, une zone de déséquilibres, de pièges et de souricières, qui demande beaucoup d’adresse aux comédiens, vêtus à la manière des années 1930, maquillés d’une façon volontairement outrée et dirigés à la corde.
LES PERSONNAGES PRINCIPAUX AVANCENT À PEINE MASQUÉS : HINDSBOROUGH (HINDENBURG), GORI (GÖRING), ROMA (RÖHM), GOBBOLA (GOEBBELS), DULLFOOT (DOLLFUSS)
Katharina Thalbach ne veut pas donner une leçon sur la montée du nazisme, leçon à laquelle la pièce a souvent servi. Brecht a écrit La Résistible Ascension… quand il était sur la route de l’exil qui devait le mener d’Allemagne aux Etats-Unis, après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, en 1933. Il voulait « expliquer au monde capitaliste l’ascension d’Hitler en la transposant », selon ses mots. Autour d’Ui, le gangster qui veut prendre le pouvoir à Chicago, les personnages principaux avancent à peine masqués : Hindsborough (Hindenburg), Gori (Göring), Roma (Röhm), Gobbola (Goebbels), Dullfoot (Dollfuss).
Laurent Stocker exceptionnel
A la Comédie-Française, tous apparaissent comme des pantins pris dans les rets non pas de l’Histoire, mais d’une histoire que Katharina Thalbach traite comme une parabole sur les mécanismes implacables de l’argent et de la volonté de puissance. Ce parti pris pourrait être attractif. Il est décevant : trop lourd, trop énoncé, trop appuyé. Certaines scènes sortent du lot parce qu’elles s’accommodent de l’outrance, comme celle, fameuse, où Arturo Ui apprend grâce à un comédien l’art et la manière de parler et de se tenir si l’on veut devenir un homme politique.
Le reste du temps, on se demande pourquoi Katharina Thalbach demande à la troupe du Français de jouer comme si c’était une troupe allemande rodée à la tradition expressionniste. Quel que soit leur talent – et ils en ont à revendre –, les comédiens imitent cette tradition, sans la transcender. Sauf un : Laurent Stocker, exceptionnel dans le rôle d’Arturo Ui. Humanité défaite, virtuosité inquiétante, frilosité dangereuse, folie latente : dans son jeu, tous les éléments sont là, qui pourraient faire rire, tant l’homme paraît de piètre envergure. Ils mèneront au pire, parce que, hier comme aujourd’hui, « le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ».
« La Résisitible Ascension d’Arturo Ui », de Bertolt Brecht. Mise en scène : Katharina Thalbach. Comédie-Française, place Colette, Paris 1er. Mo Palais-Royal. Tél. : 01-44-58-15-15. De 5 € à 42 €. En alternance jusqu’au 30 juin. www.comedie-francaise.fr
Brigitte Salino
Journaliste au Monde
Photo (c) FRANÇOIS GUILLOT/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2017 11:26 AM
|
Sète veut se transformer... Un village culturel va sortir de terre à l'entrée Est de la ville. Ce pôle culture sera construit sur le site des anciens chais du quai des Moulins. Avec un objectif ambitieux : devenir le coeur d'un nouveau quartier qui accueillera 5.000 nouveaux habitants d'ici à 2020.
Par Fabrice Dubault Publié le 05/04/2017 à 08:48
Pour l'instant, le bruit des engins de chantier résonne sur le futur site du "village culturel" de Sète. Mais dans quelques mois, c'est une toute autre partition qui se jouera ici...
Le site fait 75 hectares. D'ici à 20 ans, il sera totalement réhabilité, restructuré et modernisé pour en faire un éco quartier, moderne et dynamique. Un nouveau pôle d'attraction éducatif, artistique et culturel de l'Île singulière.
Les anciens chais de la ville détruits par les pelleteuses vont laisser place au nouveau conservatoire de l'agglomération de Thau. Un édifice de 3.000 m2 qui pourra accueillir jusqu'à 1.600 élèves.
Ce conservatoire est la première pierre d'un projet global ambitieux pour l'entrée Est de Sète. Un chantier à plus de 10 millions d'euros.
Dans la partie voisine, un mécène va transformer ses entrepôts en lieu de culture. Le musée du MIAM devrait même y emménager...
Le nouveau complexe culturel sera composé d'un conservatoire, d'un musée, d'une salle de concert, de bars, le tout sur une friche industrielle.
Le projet sétois n'est pas sans rappeler les Docks des Suds à Marseille.
Il a d'ailleurs été conçu comme le coeur d'un nouvel éco quartier qui doit transformer cette entrée de la ville.
C'est l'architecte Rudi Ricciotti, l'auteur du Mucem de Marseille et du Mémorial de Rivesaltes qui a été sélectionné pour créer ce nouveau pôle culturel.
Voir le reportage de France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/anciens-chais-sete-vont-se-transformer-village-culturel-1227951.html
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 14, 2017 3:54 PM
|
Par Nicolas Weill dans Le Monde des Livres
En méditant sur Tiepolo, Agamben opère un retournement joyeux de sa philosophie.
Polichinelle ou divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes (Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi), de Giorgio Agamben, traduit de l’italien par Martin Rueff, Macula, 108 p., 18 €.
Les horizons du philosophe italien Giorgio Agamben ont longtemps été sombres : Auschwitz et ses internés parvenus à l’extrémité de leurs forces ou de l’humanité, le martyre des corps, les dérives totalitaires de nos démocraties, etc. Son cycle en neuf volumes, Homo Sacer, a fait l’objet d’une publication intégrale au Seuil en 2016. L’un de ses tout derniers livres porte également un titre inquiétant : Le Mystère du mal. Benoît XVI et la fin des temps (Bayard, 120 p., 14,90 €). Or, voici que cet « avertisseur d’incendie » (comme disait Walter Benjamin), qui se défend d’être un mauvais coucheur, poursuit son parcours, non en farce, mais par une comédie divertissante.
D’où ce détour par la commedia dell’arte et la « joyeuse » peinture de Giandomenico Tiepolo (1724-1804) abordées d’un seul tenant dans une étude consacrée à la figure de Polichinelle chez cet artiste vénitien. La traduction française, par Martin Rueff, poète autant que chercheur, donne à ces pages une saveur rare. Elle passe notamment par le rendu du dialecte napolitain qu’Agamben a mis dans la bouche de ce personnage masqué, tout de blanc vêtu comme un spectre, bossu et ventru, une coiffe en forme de cône tronqué juchée sur le crâne. Mais Polichinelle parle d’égal à égal avec Tiepolo ou Leibniz. Il est une métaphore philosophique.
La vie dans sa nudité la plus crue
Car le but de ce Divertissement n’est pas – ou pas seulement – l’allégement, grâce à la comédie, des véhéments tableaux d’Homo Sacer. La marionnette à la voix haut perchée est un symbole dérisoire et bouleversant de l’homme, de la vie dans sa nudité la plus crue et même de l’indétermination des sexes. Polichinelle, nom tiré de l’italien pulcinello (« poussin »), a été féminisé en Pulcinella avant de faire son apparition en France aux alentours du XVIIIe siècle. La silhouette de ce curieux androgyne, né d’un œuf, rappelle autant celle d’un gallinacé que d’un être humain.
Tel que la convention fixe son caractère, Polichinelle efface les frontières trop tranchées entre l’homme et l’animal, le mort et le vivant, le héros et le pantin. Parvenu à l’âge d’Agamben lui-même, né en 1942, Tiepolo, choqué par l’autodissolution de la République de Venise (1797) sous la menace des armées de Bonaparte, fit proliférer les Polichinelle en lavis ou en fresques qui ornent aujourd’hui les murs de la Ca’Rezzonico, sur le Grand Canal. Toute l’entreprise d’Agamben s’efforce d’en expliquer les raisons. « Vivre, rendre sa propre vie possible, peut signifier seulement (…) se saisir de sa propre impossibilité à vivre » : telle serait pour Agamben la leçon de Polichinelle ou, mieux, son fameux secret.
Nicolas Weill
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 14, 2017 3:45 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :
Plus de vingt ans après la disparition de « Prospero » paraît « Parages », une revue vouée aux textes de théâtre, animée par des auteurs et qui parle d’eux mais aussi de maisons d’édition, d’écoles et de théâtres qui les concernent. Le premier numéro de « Parages » manquait de hauteur, le second n’en manque pas mais bute sur une marche glissante.
L’acteur, metteur en scène, directeur du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et gros dévoreur de textes de théâtre qu’est Stanislas Nordey l’a voulue, l’auteur Frédéric Vossier l’a conçue, la revue Parages, après un numéro 1 (juin 2016) qui fut un tour de chauffe, prend sa vitesse de croisière (un à deux numéros l’an) avec la présente sortie de son numéro 2.
De « Prospero » à « Parages »
Parages entend être « une revue de réflexion et de création » vouée au « théâtre de texte contemporain », dans la diversité de sa « galaxie » : « auteurs, textes, inédits » bien sûr, mais aussi « institutions, écoles, maisons d’édition ».
Il y a plus de vingt ans, quelques saisons durant, Prospero fut la revue (trimestrielle) du Centre national des écritures du spectacle (la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon), avec pour rédacteur en chef un auteur, Michel Azama. Elle se voulait « une revue d’écrivains de théâtre, conçue pour donner leur point de vue sur tous les aspects de la vie théâtrale et débrouiller ce qui se passe entre écriture et plateau ». De fait, on y vit des auteurs écrire des critiques de spectacles ou de textes de confrères auteurs. Dans Prospero n°1, Jean-Luc Lagarce racontait comment il écrivait et Didier-Georges Gabily s’entretenait avec Bernard Dort. Dans Prospero n°2, Claudine Galea se penchait sur une pièce d’Hubert Colas, Visages. Seule rescapée d’une autre époque, elle figure également dans Parages /02 avec l’un de ses textes.
Une autre époque ? « Beaucoup de directeurs de structures – CDN ou Scènes nationales – avouent n’avoir pas le temps, ou la compétence, pour lire les écrivains de théâtre d’aujourd’hui », écrivait Azama. La situation a-t-elle beaucoup changé ? En revanche, pour ce qui est des comités de lecture au sein de ces établissements dont Azama déplorait l’absence, la situation a évolué. De même, le rédacteur en chef de Prospero s’insurgeait contre le fait que la notion d’« artiste associé » soit réservée aux metteurs en scène, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec Claudine Galea, Marie Ndiaye et Pascal Rambert, auteurs associés au TNS mais cela reste une exception.
« Comité de rédaction » pour Prospero ou « Ensemble éditorial » pour Parages, les auteurs sont nettement majoritaires dans le pilotage de ces revues. Quatre (Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Lancelot Hamelin, David Lescot) sur six membres pour Parages, les deux autres étant des personnes sensibles aux écritures contemporaines : la journaliste Joëlle Gayot (France-Culture) et la maîtresse de conférences en arts de la scène Bérénice Hamidi-Kim (Université Lumière-Lyon-2).
« Le Bruit du monde », revue
Cette dernière entre dans le dédale d’une passionnante jeune autrice, Pauline Peyrade dont, pour l’heure, seules deux pièces Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées (ensemble, aux Solitaires intempestifs). La première a été mise en scène par Cyril Teste, la seconde a fait l’objet d’une mise en espace par Anne Théron. L’an dernier, Pauline Peyrade participait aux Sujets à vif du Festival d’Avignon, formant un attachant tandem avec la circassienne Justine Berthillot et l’on y entendait des extraits de Poings, son dernier texte (à paraître). En outre, Pauline Peyrade dirige une revue électronique Le Bruit du monde dont il existe une version papier. Chaque numéro est centré autour d’un axe (de « Prise de parole » pour le n°1, à « Censuré » pour le n°4, le plus récent) et est parrainé par un auteur : Philippe Malone, Sonia Chiambretto, Christophe Pellet, Magali Mougel pour les quatre premiers numéros. Des noms que l’on retrouve ou que l’on retrouvera dans Parages.
Suite du sommaire : Christophe Pellet et Eric Noël, auteur canadien, qui se sont rencontrés à Montréal lors d’une résidence d’écriture, proposent une savoureuse correspondance amoureuse fictive et par mail. C’est aussi par mail qu’Anne Théron et Alexandra Badea correspondent. Elles parlent d’amour, de politique, d’enfance, de larmes (elles ont un projet ensemble sur le rapport mère/fille) et de leurs lectures : Cynthia Fleury, W.G Sebald, Georges Didi-Huberman.
L’un des principes de la revue consiste à donner aux membres du comité la possibilité d’avoir un invité. Joëlle Gayot invite ainsi David Léon ; Claudine Galéa, Jean-René Lemoine ; David Lescot, Céline Champinot. Chaque invité apporte en cadeau un texte inédit ou un extrait d’une écriture en cours. C’est riche, souvent surprenant, toujours éclairant.
En 2003, l’auteur Enzo Corman fondait au sein de l’Ensatt, un département « écrivain dramaturge ». Magali Mougel, Pauline Peyrade et d’autres sont passés par là. Dans Parades/02, Corman raconte la genèse de ce département unique dans les écoles de théâtre françaises qu’il codirige aujourd’hui avec un ancien élève, Samuel Gallet.
De L’Arche au Rond-Point
Un focus est consacré à la maison d’édition L’Arche où sont publiés Badea et Pellet. Etude universitaire sur l’un des auteurs phares de la maison, Fabrice Melquiot ; portrait par ce dernier du directeur de la maison d’édition Rudolf Rach qui, lui, nous restitue une rencontre avec Thomas Bernhard où il est question de contrat et d’argent ; et enfin très beau portfolio de Jean-Louis Fernandez photographiant la petite équipe de L’Arche dans sa boutique-bureaux à deux pas de la place Saint-Sulpice.
Parages /02 s’achève par une incongruité qui s’étale sur 47 pages (c’est de loin l’ensemble le plus long du numéro) : un séjour « en immersion » de Lancelot Hamelin au Théâtre du Rond-Point, établissement dont Frédéric Vossier évoque sans rire « la démesure, l’aspect inclassable et hors du commun ». Il faut tout le talent de l’auteur Lancelot Hamelin pour retenir notre attention en parcourant ce lieu que l’on peut tout autant qualifier de fourre-tout, opportuniste et malin. Pourquoi parler de ce théâtre dans Partages alors que la question des auteurs et de leur traitement y est escamotée?
Comme c’était à prévoir, le directeur de l’établissement pressé et fort occupé, retarde le moment de rencontrer l’insaisissable dramaturge relooké en néo-journaliste gonzo. Hamelin en profite pour s’attarder au bar (passage obligé et prolongé de tout journaliste gonzo) dont les cocktails aussi compliqués qu’écœurants et les histoires pas tristes qu’il y entend dressent, par ricochets, un portrait en creux du théâtre assez croquignolesque. Assurément bien plus intéressant que l’entretien accordé enfin par le directeur dans son vaste bureau dont le journaliste occasionnel résume la décoration par un délicieux oxymore : « humble mégalomanie ».
Dans le numéro 7 de Prospero, Michel Azama saluait la disparition de l’auteur Heiner Müller devenu directeur d’un grand théâtre allemand. Et achevait ainsi son édito : « Nous voulons espérer qu’un jour nous verrons en France de grands auteurs à qui auront été accordés les moyens de travailler, de grandir, d’approfondir leur œuvre en dirigeant un théâtre. » Ce jour est arrivé en 2003 au Théâtre du Rond-Point et il perdure. Le directeur n’est peut-être pas un « grand auteur » mais c’est un auteur dont la « poésie » « atteint cet étrange tremblement proche du rire », si, si, c’est Lancelot Hamelin qui le dit. On a les Heiner Müller qu’on peut.
Parages /02, 190 p., 15 euros, revue distribuée par Les Solitaires intempestifs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 13, 2017 5:00 PM
|
Par Philippe Lançon dans Libération / Next
Ecrite en exil en 1941, aujourd’hui revisitée à la Comédie-Française, la pièce du dramaturge allemand s’inspire des films américains pour brocarder Hitler et ses sbires en gangsters grotesques. Une parabole intemporelle sur la fascination du pouvoir.
Une pièce politique de circonstance survit aussi mal aux circonstances que des asperges fraîches à la fin du printemps ; mais, quand l’auteur de la pièce est Brecht en exil, et les circonstances, l’ascension du nazisme qu’il a fui, il n’est jamais anodin ou inutile de la monter longtemps après sa création pour voir, non seulement si l’œuvre résiste à la disparition du contexte, mais aussi comment, au moment même où il l’écrit, l’auteur cherche à établir des perspectives et des formes qui dépassent sa portée immédiatement didactique.
Bertold Brecht écrit la Résistible Ascension d’Arturo Ui en trois semaines, en 1941 et en Finlande, peu avant son départ pour les Etats-Unis, où il compte la faire jouer. Il en avait l’idée depuis 1935. Elle ne sera créée qu’après sa mort en 1956, en Allemagne en 1958, puis en France deux ans plus tard par Jean Vilar et le Théâtre national populaire (TNP). Vilar joue sans moustache, mais avec mèche, le rôle de l’apprenti dictateur Arturo Ui, sosie de Hitler également inspiré par les figures d’Al Capone et des tueurs de films noirs américains des années 30 que Brecht appréciait. Il dit à cette occasion : «Ce que nous devons faire, nous, troupe française, qui nous adressons à un public qui ne connaît pas vraiment l’histoire du nazisme, c’est de traiter, comme le voulait Brecht, l’histoire des grands tueurs du passé, du présent et de l’avenir.» Brecht dit quelque part dans ses écrits : «Arturo Ui est une parabole dramatique écrite avec le dessein de détruire le traditionnel et néfaste respect qu’inspirent les grands tueurs de l’histoire. Elle se meut intentionnellement dans un cercle étroit au niveau de l’Etat, de l’industrie et de la petite bourgeoisie.» Message toujours valable : la résistible (donc évitable) ascension d’Arturo Ui peut avoir lieu n’importe quand, n’importe où.
Silhouettes proches de leurs modèles
La pièce transpose le hold-up nazi sur la société germanique (de 1932 à l’Anschluss de 1938) dans le monde des gangsters et des entrepôts de Chicago, réduits au commerce peu odorant du chou-fleur : la technique de la distanciation rejoint le sens anticapitaliste du combat. On vit comme Tintin en Amérique les pressions sur le vieil Hindenburg, l’incendie du Reichstag, le procès bidon qui suivit, la nuit des Longs Couteaux, l’assassinat du chancelier autrichien Dolfuss. Cette «parabole», tout en brèves scènes nerveuses et contrastées, est d’un dynamisme efficace : les dirigeants nazis avaient des pratiques de gangsters, même si leur idéologie débordait leurs intérêts, et Brecht savait quoi penser d’eux. Ce qu’il ignorait encore, c’est tout ce dont ils allaient se montrer capables. C’est la limite de la pièce : si son auteur a bien analysé dans ses textes, dès 1939, «la théâtralité du fascisme», il ne pouvait imaginer sur scène à quel point sa réalité allait dépasser toute fiction.
Des panneaux (indiqués dans le texte de la pièce) résument, comme dans les films muets, l’épisode historique auquel ce qu’on voit fait référence. Quand Brecht les écrivait, c’était pour clarifier une situation politique bien vivante, donc pour agir dessus. Aujourd’hui, ces panneaux sont plus que jamais conformes à la mission que se donnait Jean Vilar : ils servent de filet aux ignorants. Les personnages principaux ont des noms et des silhouettes qui rappellent de près leurs modèles. Ernesto Roma (Thierry Hancisse) est Röhm, le chef des SA et vieux compagnon sacrifié par Hitler. Le gros Manuele Gori (Serge Bagdassarian), avec son appétit cynique, est Göring. Le corbeau Giuseppe Gobbola (Jérémy Lopez), avec son pied-bot et son goût du mensonge, est Goebbels. Les acteurs sont au meilleur, comme si ces panoplies les attendaient depuis soixante-dix ans. Brecht utilise le ridicule pour agiter la pensée. Tout personnage historique entre en scène comme un poisson que la présence d’une proie - ou simplement d’une idée - fait enfler.
«Un comique non dénué d’effroi»
En 1960, François Mauriac voit la mise en scène de Vilar. Sa réaction résume ce que peuvent penser les gens qui n’aiment ni Brecht ni le théâtre de combat : «Signée d’un autre nom, la pièce n’eût pas trouvé un directeur pour seulement la lire jusqu’au bout. Il aurait fallu au moins accorder à Hitler et à son gang la dimension à laquelle ils ont droit dans l’infamie et dans le crime.» Est-ce sous-estimer la dimension des grands criminels que d’en faire des bouffons -ou, au contraire, à la manière du théâtre élisabéthain dont Brecht revendique les formes, la souligner théâtralement? Les ombres de Macbeth et de Richard III rôdent sur la pièce, mais elles ne sont plus là, comme l’histoire, que sous forme de caricatures. Brecht avait répondu par avance à Mauriac dans sa note d’intention : pour jouer la pièce, «il convient d’utiliser des masques, des accents et des gestes propres aux modèles, mais d’éviter toutefois le pur travestissement, et le comique ne doit pas être dénué d’effroi. Ce qu’il faut, c’est une représentation plastique sur le rythme le plus vif, avec des tableaux de groupes bien disposés dans le goût des histoires de foire annuelle.» C’est actuellement ce qu’on voit à la Comédie-Française. L’Allemande Katharina Thalbach, qui met la pièce en scène, avait 4 ans quand elle fut d’abord jouée par le Berliner Ensemble. Sa mère, l’actrice Sabine Thalbach, était dans la distribution.
La grande scène, sombre, est recouverte d’une toile d’araignée en cordes, suspendue plus ou moins haut. Les personnages s’y déplacent ou y sont pris, comme des araignées, des mouches ou des acrobates. Ils apparaissent et disparaissent par des trappes. De la musique les accompagne, du Schubert de Quat’sous et de la Veuve joyeuse. Leurs visages sont méconnaissables. Blanchis et fardés, ce sont des masques de clowns plus ou moins sinistres, des plâtres d’amuseurs meurtriers. On reconnaît des figures cinématographiques populaires : le dictateur de Chaplin, le Joker de Batman, le bonimenteur de foire qui attire Pinocchio et ses compagnons pour les transformer en ânes. Des répliques renvoient malgré elles au contexte électoral actuel. Arturo Ui : «Je suis un homme qui respecte les lois quand on lui épargne les rigueurs de la loi.» Accuse-t-il un journaliste de raconter les crimes qui ont eu lieu ? Celui-ci répond avec bon sens : «Il est facile de se taire sur ce qui ne se produit pas.»
Les poings sur les couilles
L’acteur Laurent Stocker, après avoir été Néron, est Arturo Ui. C’est Hitler et ce n’est pas Hitler. Mais qui est Hitler ? Et où commence la silhouette d’Arturo Ui ? Dans une scène, il prend des cours auprès d’un vieil acteur emphatique et ivrogne, enluminé jusqu’au burlesque par Michel Vuillermoz. Il apprend le pas de l’oie, les bras croisés devant lui, les poings sur les couilles pendant qu’il parle, l’éructation tandis qu’il déclame. Du théâtre comique dans le théâtre tragique, pour en revenir à la réalité : «Il y a des années, écrit Brecht dans un texte de 1939, un comédien m’a raconté qu’à Munich, Hitler avait même pris des leçons chez Basil, un "comédien de la cour", des leçons non seulement de diction mais de maintien. Il apprit par exemple la démarche de théâtre, la démarche caractéristique des héros, qui consiste à effacer le genou et à poser à plat la plante du pied pour avoir l’allure majestueuse. Il apprit aussi la manière la plus impressionnante de croiser les bras, on lui a même inculqué l’attitude du laisser-aller. Cela a quelque chose de risible, non ?»
Philippe Lançon
La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht m.s. Katharina Thalbach. Comédie-Française, Salle Richelieu, 75001. A 20h30, jusqu’au 30 juin. Rens. : www.comedie-francaise.fr
photo : La toile d'araignée où évoluent les personnages de la pièce. Photo Christophe Raynaud De Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 13, 2017 8:34 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog
Il est né à Téhéran, a appris le français à Paris, a vécu à Toronto où il a appris l’anglais et est devenu acteur dans une école de Montréal. Il est un et multiple. Et pas seul au monde, comme le prouve son surprenant spectacle « Trois précédé de Un et Deux ».
Il y a du bagout jusque dans son nom : Soleymanlou. S’il était français, dans la lignée des TPO (Tchatcheurs de Premier Ordre), on le situerait quelque part entre Philippe Caubère et Sébastien Barrier. Comme eux, il déborde de mots et quand il commence une phrase il ne sait pas exactement où cela le conduira. Une phrase en entraîne toujours une flopée d’autres, la petite entreprise ne connaît pas la rigueur, ni les restrictions.
Il est quoi, ce gars-là ?
Comme ceux de Caubère et Barrier, les spectacles de Mani Soleymanlou s’étalent en longueur et pas question de leur couper le sifflet. Sauf que Soleymanlou est seul en scène comme les deux autres pour commencer, puis il ne l’est plus, et à la fin plus du tout. Sauf que Mani Soleymanlou n’est pas un Français « de souche » (il déteste le mot souche), ni même un marseillais ou un ligérien d’adoption, c’est un Iranien qui vit au Québec au point de parler comme un Québécois. Alors il est quoi, ce gars-là ? Elle est où son identité ? C’est toute la question de son spectacle en trois parties dont la première est titrée Un, comme il se doit.
Sur la scène, faisant face au public, des rangées de chaises vides de couleur noire. Une quarantaine. Comme un miroir offert au public qui, lui, remplit la salle du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (où j’ai vu le spectacle) et prochainement celle de Chaillot puis celle du Tarmac. Un type barbu, plutôt corpulent, nerveux, chaussé de tennis noires rutilantes et portant un t-shirt noir lui aussi, apparaît furtivement dans la lumière, faisant mine d’être surpris d’être là. C’est un gag éculé mais increvable : tout de suite, l’acteur met le public dans sa poche. 55 minutes durant, il va parler du sujet qu’il connaît le mieux : lui-même.
Mani Soleymanlou est né en Iran à Téhéran. Ses parents, à l’heure où s’installe le nouveau régime des mollahs, prennent le chemin de l’exil : Paris. Dans la capitale française, avec son nom à coucher dehors, Mani Soleymanlou n’est cependant pas un SDF. Il ne passe pas non plus pour un bantou, un zoulou, ni même pour un beur, mot qu’il ignore (il ne connaît que le beurre). La langue française qu’il apprend ne lui pose pas de problème particulier, son nom sonne étranger, oriental, renseignements pris on le prend pour un Iranien. Il ne se souvient d’aucun délit de sale gueule et pour cause, peut-être à l’époque était-il encore imberbe et ne portait la barbe comme aujourd’hui.
Eille mon gars, t’es Québécois !
Il a neuf ans quand ses parents décident d’aller vivre au Canada, pays réputé accueillant. Ça se complique pour Mani Soleymanlou. Le Canada vit entre deux langues et il atterrit dans une ville anglophone, Toronto, où il apprend l’anglais, puis une autre, Ottawa, avant que la famille ne se fixe à Montréal, ville francophone, où il retrouve le français appris à Paris. Ce qui, dans sa bouche donne ceci :
« A Toronto, j’étais pendant quelque temps un Français-Iranien, ensuite Canadien that quickly became Canadian. A Ottawa, j’étais un Torontois-Français-Iranien. A Montréal, je suis un Torontois-Arabe-Iranien, qui a vécu en France et Ottawa... Et aujourd’hui, on me dit : eille mon gars t’es QUEBECOIS !!! ». Son identité est un tourniquet.
Bref : Un nous raconte par tous les bouts, à travers une foultitude de faits et d’anecdotes, comment il y a plusieurs un en un. C’est constamment truculent et cela tombe fort à propos dans une France où l’identité est devenue une question alors qu’elle ne devrait être que ce qu’elle est : une richesse.
Mani Soleymanlou est sorti de l’Ecole nationale de théâtre du Canada en 2008, il n’a guère cessé de jouer depuis. En 2011, il a fondé sa compagnie Orange Noyée dont Un fut la première production. Non préméditée.
De un à cent
En 2009, le théâtre de Quat’Sous de Montréal se proposait de « découvrir un artiste québécois issu d’un milieu culturel ». L’intitulé était un peu abscons. De quoi Soleymanlou était-il l’issue ? Cette année-là, son pays natal vivait de grands troubles suite à l’élection frauduleuse d’Ahmadinedjad, toute sa génération était dans la rue. Et il trouva une façon d’être solidaire en racontant les turbulences de son identité dans Un. Il pensait jouer ce spectacle une fois pour la commande ; il allait le jouer cent fois. C’est bien mais c’est lassant d’être tout le temps seul en scène à parler de soi, même si on le fait comme lui avec un entrain contagieux.
D’où l’idée de prolonger l’aventure à deux. Avec un autre que soi. Un Québécois pur jus dont le père est « marocco-berbère » et la mère « une Française élevée en Indochine » et vivant au Québec. C’est Emmanuel Schwartz, un acteur dont le surnom n’est autre que Manu. Autant le prénommé Mani est râblé et plutôt petit, autant le surnommé Manu est un grand gaillard dont la voix et la présence rappellent l’acteur français François Chattot. Les deux font la paire.
Astucieusement, Deux reprend l’espace (les chaises), la construction et les motifs de Un. On reprend des couplets (comme la chanson de Gilbert Bécaud « Je reviens te chercher »), on en ajoute d’autres, comme une visite du Persan au Palais de Chaillot.
On retrouve la « question de l’identité » mais le débat se déplace : autant la dite question occupe Soleymanlou, autant elle indiffère son acolyte. Le débat tourne court mais les ébats complices entre ces deux excellents acteurs donnent le change durant 1h10, même si cette partie pourrait être un poil écourtée. Soleymanlou le sait mais, comme dans Un, il joue cartes sur table : le processus de production, les hésitations dramaturgiques, les interrogations sur la nature du spectacle font partie de ce dernier.
Et c’est encore plus flagrant dans Trois qui amplifie et ramifie la « question » identitaire.
Le cheval de trois
Mani Soleymanlou dit avoir pensé à Trois tout de suite après avoir imaginé Deux. Cette fois, les quarante chaises sont occupées. Par les Mani et Manu, par des Québécois et par de nombreux Français des deux sexes, de tous les âges (mais plutôt jeunes), de toutes les couleurs (même si le blanc domine). Tous sont chaussés de tennis neuves noires, vertes ou rouges, tous sont vêtus de noir sauf un ; c’est le dramaturge, Gustave Akakpo qui ne parle que par proverbes (savoureux). Certains sont des acteurs que l’on a pu croiser ici ou là, tous ont été choisis après une première rencontre suivie de beaucoup d’autres. Soleymanlou a fait plusieurs voyages à Paris pour y créer la version française de Trois, assez éloignée du Trois québécois.
Chacun a reçu un long questionnaire tournant autour de son identité et présupposant souvent une origine étrangère de l’interlocuteur. Ce qui n’est pas le cas d’une jeune fille dont le nom sonne étranger mais qui est née en banlieue parisienne, parle français et aucune autre langue, ne pratique aucune religion, etc. Elle renvoie Soleymanlou dans les cordes de son obsession. Ce dernier ne cache rien de ses bévues, de ses questions restées sans réponses, de ses impasses.
Il a travaillé avec le groupe à partir d’improvisations, de discussions parfois très vives. Interrogé dans le programme par Marion Canelas, il explique sa façon de procéder : « J’enregistre tout, je réécris, on essaie ce nouveau texte en scène, on voit si les gens sont d’accord avec ce que j’ai remis dans leur bouche et puis on construit peu à peu l’articulation des moments. Mon travail consiste à trouver l’angle. » Ce qui évite au spectacle de tomber dans les conversations de comptoir, lui permet de sortir des poncifs et des « éléments de langage », de déployer des identités et des points de vue parfois loin les uns des autres mais globalement prônant une société ouverte et non repliée sur elle-même.
Au passage, comme dans les précédentes parties, on se moque de l’attitude de certains directeurs de théâtre face à un tel projet. Car tout est théâtre, tout le temps. A la fin, Victor Hugo vient dire tout le bien qu’il pense de ce spectacle aussi surprenant dans sa forme que tonique de bout en bout.
Les représentations au TGP-CDN de Saint-Denis sont achevées, le spectacle sera au Théâtre national de Chaillot du 18 au 22 avril, puis au Tarmac du 25 au 29 avril.
Photo : Scène de "Trois précédé de Un et Deux" © Pascal Victor/Artcom press

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2017 6:35 PM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks
Pour sa deuxième mise en scène d’une pièce de l’Anglais Dennis Kelly, Chloé Dabert joue sur l’humour pour dresser le portrait au scalpel d’un damné du système capitaliste.
Ne vous fiez pas au titre de la pièce. Ni mares de sang, ni dépeçage en règle ne sont au programme de L’Abattage rituel de Gorge Mastromas. Revisitant le mythe de Faust cher à Goethe, le dramaturge anglais Dennis Kelly prend un malin plaisir à garder ses distances vis-à-vis de son sujet, pour nous proposer une pièce qui hésite entre le récit littéraire et les scènes dialoguées. Une manière de ne jamais oublier que nos existences sont comparables à des destinées de fourmis, au regard de l’immensité d’un univers si vaste et si froid qu’il pourrait geler “l’eau qui se trouve dans vos yeux en un instant”.
Loup solitaire
Dennis Kelly choisit le point de vue de l’entomologiste. Pour parler de la vie de son héros, il va jusqu’à commenter le moment de jouissance qui préside à sa conception ; il jubile à décrire le banal de son enfance et les désordres amoureux de sa vie, jusqu’au jour où, lors de son premier job, une diablesse d’aujourd’hui déclare ne se fier qu’à son jugement pour décider de la vie ou de la mort d’une entreprise. Ayant compris que l’empathie était une voie sans issue, Gorge Mastromas devient un loup solitaire qui ne peut que réussir dans la jungle capitaliste.
Prix Impatience 2014 pour sa mise en scène des Orphelins, écrit en 2009 par Dennis Kelly, Chloé Dabert relève avec talent le défi de monter le nouvel opus de son auteur fétiche, signé en 2013. Tracer son chemin dans ce labyrinthe de mots est une drôle d’aventure. Chaque morceau de vie de Gorge Mastromas est une énigme. L’âpreté du propos n’excluant pas d’en rire, Chloé Dabert et ses comédiens multiplient les apartés. C’est en jouant sur l’ironie et la force comique des provocations distillées par Dennis Kelly que la troupe révèle la misère sans lendemain de devenir un Howard Hughes contemporain..
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly, mise en scène Chloé Dabert, avec Bénédicte Cerutti, Gwenaëlle David, Marie-Armelle Deguy, Olivier Dupuy, Sébastien Eveno, Julien Honoré, Arthur Verret, du 19 avril au 14 mai, au Théâtre du Rond-Point, Paris VIIIe
article issu du numéro 1115

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2017 10:37 AM
|
Par Marie Céline pour JustFocus :
C’est au théâtre de Belleville, dans un petit passage en face d’un cerisier en fleurs ce soir-là, que se joue Jardins suspendus. Dès l’entrée, grâce à cet arbre rose rappelant les sakura, il flotte un petit air de Japon et ça tombe bien puisque c’est le point de départ de cette pièce de Camille Davin.
Ce hasard qui n’est qu’un rendez-vous
Un japonais qui a fui son pays pour échapper au déshonneur de la perte de sa maison se retrouve à Paris. Au fil de ses déambulations dans les rues, l’on suit sa griserie et son angoisse. Et bien entendu un autre de ces hasards de la vie va le mener à une rencontre singulière avec une femme au corps « cassé ». En la suivant il se retrouvera, faute de pouvoir s’exprimer en français, dans un appartement où une femme plus âgée va lui faire jouer le rôle de modèle pour le cours de peinture qu’elle donne. Ce cours devient une réflexion sur l’art, les corps entre ombres et lumières, mais surtout sur la vie. Celle qu’il faut retranscrire, (re)trouver, ne pas laisser s’éteindre sur le papier et en nous.
Des destins entrecroisés, une quête commune
Au fil des séances et des rencontres, toujours rendues par bribes essentielles, un peu à l’instar de Nick Payne dans Constellations, l’on découvre la vie de ces personnages. Et dans chacune de ces vies, une blessure existentielle, une fêlure. Un accident, des peurs paralysantes, des deuils, le passé et l’abandon d’une famille dans un autre pays.
Les cours de dessin les lient. Un besoin de sens et de plénitude aussi. De façon extrêmement subtile et toujours avec une légèreté rappelant le titre de l’œuvre, le texte danse avec la philosophie la plus essentielle. Et les décalages entre ces personnages et l’incongruité de certaines situations génèrent des rires et, avec ceux-ci, beaucoup de tendresse pour l’humanité et de questionnements, qui nous renvoient aux nôtres.
Jardin Suspendus : un parcours initiatique et le salut dans l’art
La professeure de dessin semble jouer un rôle d’initiatrice aux grands mystères de la vie, sans tomber dans un côté didactique. Il s’agit ici de trouver, dans le dessin, sa liberté et c’est ce que les personnages vont réussir à faire. En faisant face au vide également, en l’acceptant pleinement.
« Le vide, il ne faut surtout pas chercher à le remplir, sinon cela devient du rien ».
La grande force et la poésie de cette ode vient également de la grande liberté scénique. Musicien et dessinateur œuvrent en direct avec les comédiens, en communion avec eux. Et l’Art s’invite sur scène sous toutes ses formes. La scénographie est d’une beauté et d’une précision époustouflantes. La poésie du texte s’est épanouie dans le jeu des acteurs et la mise en scène. Le moment de silence qui précède les applaudissements est d’une qualité suspendue qui en dit long.
L’avis de la rédaction :
Émotion assurée pour ce beau spectacle. Une pièce rare à voir sans hésitation tant l’élégance se mêle à la délicatesse et à la justesse. Le fond et la forme sont ici réunis à la perfection, un petit miracle d’extrait de vie. C’est le rôle du théâtre que de mettre des textes debout, en mouvement à l’instar de ce qu’enseigne cette professeure de dessin. Tout ceci est magnifiquement réussi dans Jardins suspendus. Coup de cœur absolu ! Bravo et merci à tous !
Jardins suspendus
Texte et mise en scène Camille Davin
Avec Romain Blanchard, Jana Klein, Esther Marty Kouyaté et Daniela Molina Castro
Musicien Léo Flank
Infos pratiques
Jardins suspendus au théâtre de Belleville
94 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris
Téléphone : 01 48 06 72 34
Du 4 au 15 avril 2017, du mardi au samedi à 21h15
Plein tarif : 25€ Tarif réduit : 15€ – de 26 ans : 10€
Durée : 1H20
Article rédigé par Marie Céline

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2017 6:57 PM
|
Par Rosita Boisseau dans M le magazine du Monde
La metteuse en scène Laëtitia Guédon retrace la jeunesse du peintre américain, dans les rues de Soho, à travers la danse, la musique et le jeu.
S’attaquer à la vie et à l’œuvre de Jean-Michel Basquiat (1960-1988) exige une jolie dose de témérité. Ou beaucoup de passion. Ou les deux à la fois. C’est le cas de la metteuse en scène Laëtitia Guédon qui signe avec SAMO un hommage tout personnel au peintre et graffeur qui mit le feu aux murs des rues de New York dès son adolescence.
« Parce que je le considère comme un artiste majeur du XXe siècle, mais aussi parce qu’il me renvoie directement à mon histoire, à mon enfance au début des années 1980, à Aubervilliers, dans la cité de la Maladrerie, où l’art s’activait partout et tout le temps, explique Laëtitia Guédon. Je voyais mon père peindre les murs de la cité. Les rues de New York étaient bien loin de celles de la banlieue parisienne, mais elles avaient pourtant en commun une certaine idée de la liberté. »
Nommée directrice de la salle Les Plateaux Sauvages, à Paris, Laëtitia Guédon revient à Aubervilliers, de temps en temps, pour intervenir en milieu scolaire dans le cadre des activités menées par le Théâtre de la Commune. Elle rembobine sa vie et retrouve certaines fresques murales, croisées dans sa jeunesse, intactes. « J’ai choisi de m’intéresser à la trace qu’on laisse pour se raconter et raconter le monde, explique-t-elle. J’ai décidé de traiter une période moins connue de la vie de Basquiat, celle de sa jeunesse, de la rue. Dans les années 1980, il sort à peine du lycée, fugue de chez ses parents et part à la conquête des rues de Soho. A cette époque, il signe SAMO [pour “Same Old Shit”] des messages lapidaires, poétiques et politiques, et se crée une identité d’artiste. »
Un danseur, un acteur, un musicien
Pour plonger dans les couches de cette vie à l’arrache, Laëtitia Guédon fait équipe avec l’écrivain Koffi Kwahulé et le vidéaste Benoît Lahoz. Elle déploie l’histoire de Basquiat entre trois interprètes, le danseur Willy Pierre-Joseph, l’acteur Yohann Pisiou et le musicien- slameur-beat boxer Blade MC Alimbaye.
« Je voulais travailler différemment une œuvre théâtrale, proposer un projet à la frontière d’un travail performatif, explique-t-elle. Nous sommes partis tous ensemble en résidence à la Chartreuse, à Villeneuve-lès-Avignon, pour écrire. Chacun a brassé des vidéos, des interviews, regardé des tableaux, des films sur le peintre et les années 1980. Et puis nous avons dû aussi nous interroger sur notre propre histoire. Nous sommes tous français, mais profondément nourris d’un métissage culturel. Basquiat fut sans cesse renvoyé à sa condition d’homme noir avant son engagement poétique. »
En pistant le jeune peintre, Laëtitia Guédon et son équipe s’aperçoivent qu’il fréquentait des boîtes de nuit, comme le Mudd Club. « Il enflammait les pistes de danse, mais à la suite d’un accident, il était blessé physiquement et psychiquement, poursuit-elle. C’est autour de ces axes que nous avons travaillé avec Willy Pierre-Joseph. C’est un double de Basquiat qui transcende et fait écho à la parole. » Avec ce spectacle, soufflé par la musique de Nicolas Baudino et Blade MC Alimbaye, au croisement du hip-hop et du jazz de Charlie Parker, Laëtitia Guédon ouvre aussi les bras aux habitants d’Aubervilliers. Certains formeront un « chœur urbain » autour de ce héros tragique qui introduira le spectacle.
SAMO, de Laëtitia Guédon. Jusqu’au 14 avril à La Loge, Paris 11e ; le 21 avril au Théâtre Victor-Hugo, à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; le 27 avril au Quai des Arts, à Argentan (Orne).
Rosita Boisseau
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2017 6:36 PM
|
Par Joël Morio dans Le Monde
L’arrivée des podcasts et d’une nouvelle génération de réalisateurs ont donné un nouvel intérêt aux feuilletons radiophoniques.
« Video killed the radio star », chantaient les Buggles à la fin des années 1970. Plus de trente ans après ce tube, même si ce média s’interroge sur son avenir, un genre qu’on croyait définitivement ringardisé connaît une nouvelle jeunesse. En dépit de la multiplication des écrans, la fiction radiophonique fait plus que de la résistance.
Il faut pousser une lourde porte en métal, comme celle d’un coffre-fort, pour pénétrer dans le gigantesque studio installé dans les sous-sols de la Maison de la radio. Une troupe y joue une scène censée se passer dans un hôpital. Aucune blouse blanche pourtant. Les acteurs sont en habits de ville et ils sont dirigés par Juliette Heymann qui, derrière son pupitre, donne ses instructions au micro.
Comme sur n’importe quel plateau de tournage, entre deux prises, elle descend parfois pour préciser ses instructions. La réalisatrice enregistre la troisième séquence de Canaan-Nouvelles lointaines, un feuilleton en cinq épisodes qui sera diffusé à partir du 17 avril sur France Culture. Ecrit par Fabrice Colin, un romancier et auteur de bande dessinée, Canaan se passe à New York. Après le suicide de Norman, Helen, son ex-femme, va découvrir une facette de l’homme torturé qu’elle croyait connaître. Et, en passant, l’homme avec qui elle s’est remariée.
« Sang neuf »
Juliette Heymann fait partie de la douzaine de réalisateurs de fictions radio qui a rejoint la Maison ronde depuis la fin des années 2000. « Cela faisait près de quinze que nous n’avions pas assisté à une vague de recrutements de cette ampleur », note Blandine Masson, directrice de la fiction à France Culture. Une génération qui a donné un nouveau souffle à un genre qui existe depuis la naissance de la radio.
« Ce sang neuf, avec de nombreuses personnalités différentes, a permis d’offrir de la variété dans ce qui est proposé », observe Juliette Heymann. « Tout part du texte qui m’est proposé. J’ai la chance de ne réaliser que ceux qui me plaisent », raconte cette ancienne actrice qui a fait ses premiers pas pour la radio en 2001 en tant qu’auteure et adaptatrice avec sa pièce La Frileuse et l’adaptation d’Œdipe sur la route, d’Henry Bauchau.
« Je travaille avec des images dans ma tête. A la radio, l’écran est plus grand qu’au cinéma », pointe encore la réalisatrice, citant Orson Welles qui a rendu célèbre la fiction radio avec sa version de La Guerre des mondes, de H. G. Wells. Pour elle, la distribution des acteurs est essentielle. « Cela représente 80 % du travail, mon rôle consiste ensuite à les accompagner. »
Alexandre Plank, la trentaine, a un style plus expérimental. Diplômé de l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, il a commencé à réaliser des fictions et des documentaires pour la radio en Allemagne avant de rejoindre France Culture. « Je cherche à m’échapper du réalisme académique pour apporter quelque chose de plus vivant. On improvise souvent autour de situations et j’essaye que les acteurs ne lisent pas leur texte afin d’obtenir plus naturel », explique-t-il.
Il a adapté la bande dessinée Le Chat du rabbin, de Joann Sfar, et il est à l’origine du nouveau concept « Fiction Pop » de France Culture qui mêle de la musique à un grand texte littéraire. Il a ainsi mis en scène L’Enfer de Dante composé par le groupe Syd Matters et interprété par cinq musiciens de la Maîtrise de Radio France. Depuis quelque temps, Alexandre Plank passe un jour par semaine avec un groupe d’autistes dont il enregistre les « papotins » qui serviront de matériau à une prochaine fiction.
Sur France Culture, sept heures par semaine dédiées à la fiction
Dans un registre plus classique, Sophie-Aude Picon a réalisé Debout les morts, une version audio du roman de Fred Vargas (J’ai lu), diffusée jusqu’au 14 avril. Natalie Dessay y interprète Sophia Siméonidis, une cantatrice qui découvre dans son jardin un arbre qu’elle ne connaît pas. C’est la seconde fois que France Culture adapte pour la radio une œuvre de la romancière de polar. La radio avait diffusé à l’automne 2013 Pars vite et reviens tard (J’ai lu). « Nous proposons aussi bien des créations originales, des lectures publiques enregistrées, des adaptations de grandes œuvres comme Madame Bovary qu’un album de Tintin », précise Blandine Masson.
Les fictions comptent pour un quart du budget de France Culture et en font le premier employeur de comédiens en France. Au total, la station en diffuse sept heures chaque semaine. Outre le feuilleton quotidien à 20 h 30, elle propose du lundi au vendredi à 10 h 50 une pastille de sept minutes baptisée « La Vie moderne » qui apporte un regard décalé, drôle sur notre quotidien. Un Atelier fiction à 23 heures le mardi, un polar le samedi à 20 heures et une retransmission de théâtre le dimanche à 21 heures constituent les autres rendez-vous.
Si les fictions ont disparu depuis longtemps des grilles de programmes des stations généralistes, France Inter continue d’en produire. Fabrice Drouelle en diffuse régulièrement dans « Affaires sensibles ». Stéphanie Duncan en présente quant à elle tous les dimanches soir dans « Autant en emporte l’histoire ». « L’idée est de construire une histoire autour d’un personnage et de créer une intimité avec l’auditeur », explique l’animatrice.
« Véritable renouveau »
Le développement des podcasts donne une nouvelle visibilité aux fictions radio. « Le véritable renouveau, c’est qu’elles sont devenues accessibles à tout moment alors qu’auparavant elles étaient diffusées toujours à des heures catastrophiques. Cela a révolutionné l’écoute », juge Marguerite Gateau, réalisatrice depuis trente ans à France Culture et qui vient de prendre sa retraite.
A la fin des années 2000, lorsqu’on a commencé à mesurer le téléchargement, l’étonnement fut grand à France Culture. « Ce fut un séisme car nous ne savions pas que ce genre était autant suivi », souligne Blandine Masson. En janvier, les fictions disponibles sur le site de la radio ont généré plus de 900 000 téléchargements. Ce qui a définitivement rasséréné les dirigeants de la station publique, car le genre a été longtemps vécu comme une contrainte. « Tous mes patrons à leur arrivée cherchaient à diminuer la production pour faire des économies », se souvient Marguerite Gateau.
Sur le Web, la fiction connaît un nouvel essor. Les Belges du collectif Wow ! ont été multirécompensés avec Beaux Jeunes Monstres, qui raconte la vie de William, un garçon infirme moteur cérébral privé de parole. Cette comédie musicale en cinq épisodes traite d’un sujet douloureux avec poésie et humour. D’autres s’essayent avec plus ou moins de professionnalisme au genre sur la Toile. Très populaires, les « sagas MP3 » développent des histoires dans l’univers de l’heroic fantasy. Réalisées par des amateurs, elles sont très prisées par les geeks.
Frémissement sur la Toile
En France, Arte Radio offre, depuis sa création en 2002, une production variée, abondante et de qualité. Plus de 200 œuvres sont actuellement disponibles sur la plateforme. « Nous travaillons avec des textes écrits pour nous sur des thématiques actuelles et qui peuvent être de formats très différents », indique Silvain Gire, le patron d’Arte Radio.
Les deux dernières fictions en témoignent. De guerre en fils raconte l’histoire de François Pérache – coauteur de ce feuilleton avec Sabine Zovighian –, qui échappe de peu aux attentats du 13 novembre à Paris. Pour lutter contre ses cauchemars, il rouvre une enquête sur le secret de famille de son grand-père et bute sur un autre massacre. Cent Façons de disparaître, de Claire Richard, est, lui, un texte onirique sur fond de musique électro où la narratrice cernée par les ondes, traquée par les réseaux sociaux, tente de s’extirper de cette surveillance généralisée.
D’autres plateformes de podcast s’intéressent aux fictions. Le site Slate, qui s’est converti aux podcasts en 2016, n’envisage pas d’en diffuser. En revanche, BoxSons, créée par Pascale Clark, l’ancienne animatrice de France Inter, qui débutera le 18 avril et proposera dans un premier temps des reportages et des documentaires radio, « ne s’interdit pas un jour » de produire des fictions. BingeAudio est en cours d’écriture d’un « soap opera urbain ». Cofondé par Joël Ronez, un ancien de Radio France, le diffuseur de podcasts va mettre en ligne à partir de la mi-avril un rendez-vous en partenariat avec Audible sur l’actualité de ces émissions disponibles sur le Net dont le premier sera consacré au renouveau de la fiction audio.
Le frémissement sur la Toile dans ce domaine est réel. Audible, qui commercialisait essentiellement des livres audio, a produit sa première série en dix épisodes, Alien : la sortie des profondeurs. Cette histoire, qui se situe entre les deux premiers volets de la saga, mélange des sons originaux issus des archives de films, des musiques et des performances d’acteurs comme Tania Torrens, la doublure voix française de Sigourney Weaver. Calls - Expérience auditive, de Timothée Hochet, a, quant à elle, été entendue sur YouTube plus de 400 000 fois. Elle devrait faire l’objet d’une série pour Canal+. Preuve que la vidéo n’a pas tué la fiction radio.
Joël Morio
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2017 9:54 AM
|
Par Armelle Heliot dans Le Figaro
Laurent Delvert met en scène Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée avec Jennifer Decker et Christian Gonon. Le charme du spectacle tient à l'interprétation fine et au texte aérien plus qu'à la transposition dans un monde moderne.
Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu ce délicieux «proverbe» d'Alfred de Musset qu'est Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Laurent Delvert, qui en signe la mise en scène pour le petit plateau du Studio-Théâtre, laisse sourdre, par-delà le dialogue étincelant, contrasté, tout en retournements, en esquives, en attaques feutrées, en traits incisifs, ce qu'il y a de grave, de mélancolique dans la jolie pièce en un acte, créée en 1848 et qui trouva immédiatement l'adhésion du public.
La situation est simple. On est en hiver. Un comte se rend chez une marquise. C'est son jour. Le jour où elle reçoit. Le temps est exécrable. Le comte sera le seul visiteur de cet après-midi. De l'extérieur filtrent des lumières qui évoquent celles des cieux de giboulées annonciatrices du printemps. Elles sont signées Nathalie Perrier. L'espace, lui, est imaginé par Philippine Ordinaire qui a choisi une rigueur assez froide. Dans cette version, nous sommes de nos jours et la jolie Marquise est tout occupée à sculpter. Elle est en tenue de travail et il faudra attendre un peu pour la voir surgir dans une robe magnifique. On se souvient alors que c'est le grand Christian Lacroix qui signe les costumes…
Le Comte et la Marquise se connaissent de longue date. Que vient-il faire ce jour-là? Tenter de la convaincre de se laisser séduire? Tester ses résistances. Jouer, tout simplement! S'engager dans une joute à fleurets mouchetés, un dialogue amoureux, léger et vif jusqu'à la cruauté.
Un badinage, un marivaudage
Laurent Delvert a réuni deux comédiens de grand tempérament. Dans la partition du Comte, Christian Gonon, sociétaire de la Comédie-Française, personnalité forte et discrète à la fois, rompu à tous les répertoires et dont on a pu admirer récemment l'interprétation puissante de Comédie de Samuel Beckett.
Jennifer Decker, la Marquise, est une toute jeune pensionnaire, brune beauté, avec quelque chose de naturellement farouche qui n'interdit pas un zeste d'espièglerie.
Ils sont très bien accordés. Le Comte est un homme jeune encore, mais qui a vécu. Elle est veuve. Il serait bien qu'elle se remarie. Marquise, elle est socialement supérieure, mais dépourvue de fortune. Elle est également supérieure par une détermination certaine. Une femme moderne, comme Musset les aime. Lui est moins sûr de lui que la belle. Il est dans la retenue, l'embarras même.
Les deux interprètes sont parfaits. Ils sont accordés à cette petite musique délicate et charmeuse qui est celle d'Alfred de Musset. Ils en détaillent à merveille les détails, les nuances. Rien ne pèse dans leurs manières de dire ce texte. Ils sont légers et pourtant graves.
À dire vrai, on se passerait de l'actualisation un peu lourde, de l'idée de la sculpture sur laquelle Jennifer Decker doit se concentrer. Ici, c'est la langue et la joute, l'art des acteurs qui enchantent.
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Studio-Théâtre, 99, rue de Rivoli, Carrousel du Louvre (Ier). Tél.: 01 44 58 15 15.Horaire: 18 h 30, du mer. au dim. Jusqu'au 7 mai. Durée: 55 min. Places: de 10 à 22 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2017 6:20 AM
|
Par Kathleen Garon pour France 3 Régions :
Medhi, Martine, Lina, Naziha habitent Vaulx-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. Bientôt ils joueront sur la scène des Célestins mais avant cela, suivons-les lors des répétitions et dans leur quotidien. Un long apprentissage du jeu mais également de soi. Lundi 10 avril après Soir 3
Durant 15 mois, une quinzaine de femmes et d’hommes, tous habitants de Vaulx-en-Velin, ont participé à la création d’un projet artistique et citoyen initié par le préfet du Rhône dans le cadre de la politique de la ville et orchestré par Claudia Stavisky, metteure en scène et directrice du théâtre des Célestins à Lyon.
Tous en scène
C’est à travers les portraits de Medhi, Martine, Lina, Naziha et quelques autres que la réalisatrice nous invite à suivre l’aventure de cette troupe mixte et intergénérationnelle baptisée La Chose publique. Elle les a suivis dans leur apprentissage et leur progression non seulement dans le monde du théâtre à travers les différents ateliers de réflexions, d’écriture et de pratiques théâtrales, mais aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur appréhension de l’autre et leur découverte de soi, jusqu’au lever de rideau.
Ils nous font partager leurs motivations, leurs objectifs, leurs ressentis, leurs espoirs, leurs craintes, leurs déceptions parfois, mais surtout leur incroyable volonté d’aller jusqu’au bout de ce véritable défi théâtral qui prouve que la diversité sociale, culturelle et générationnelle n’est pas un obstacle, mais bien une force. Un conte moderne qui jette un pont entre deux univers à la fois géographiquement proches et socialement étrangers l’un de l’autre que sont la banlieue lyonnaise et le théâtre le plus emblématique de la ville de Lyon.
Voir le reportage vidéo de France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/qui-sommes-nous/tous-scene-1228353.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 10:31 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog Le Grand Théâtre du monde :
Dans la salle Jean-Bouise du TNP, la compagnie Théâtre en pierres dorées présente la délicieuse comédie dans une mise en scène de Julien Gauthier, interprète du rôle-titre. Il est très bien entouré.
On les connaît ! On les connaît presque tous. La plupart sont issus de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), l'ancienne rue Blanche désormais sise à Lyon. La plupart ont travaillé dans la troupe créée par Christian Schiaretti. La plupart ont par ailleurs frayé leur propre chemin. Mais ils ne sont jamais loin les uns des autres.
C'est dans doute l'un des secrets de cette très séduisante production du Menteur de Pierre Corneille. Ils se connaissent, ils sont une troupe de fait. Laurence Besson, Amandine Blanquart, Clément Carabédian, Julien Gauthier, Damien Gouy, Rafaèle Huou, Clément Morinière, Juliette Rizoud, Julien Tiphaine.
Ils ont la trentaine. Ils sont brillants. Ils ont été à très bonne école, à l'ENSATT ou au Studio 34, ils ont travaillé avec des metteurs en scène exigeants, amoureux de la haute littérature, de la langue, du bien dire. De Christian Schiaretti à Bernard Sobel, mais également avec des gens de leur génération.
Ce Menteur est l'une des productions inscrites dans le cycle des "résidences de création" voulu par la direction du TNP. Après, entre autres un Roméo et Juliette par Juliette Rizoud, ou un spectacle signé Olivier Balazuc, voici une production de la jeune compagnie "Théâtre en pierres dorées" qui tire son nom d'un bel endroit du Beaujolais où Damien Gouy et ses amis ont créé un festival il y a quelques années. Le festival de Theizé.
C'est avec leurs propres deniers de compagnie, le soutien d'Agnès B. (pour les costumes) et la mise à disposition des équipements du TNP que les neuf ont monté ce délicieux spectacle.
Le Menteur a de quoi séduire. On le connaît. La pièce n'est pas très souvent jouée. Elle a été crée en 1643 au Théâtre du Marais, avec beaucoup de succès. Mais elle provoqua une polémique qui conduisit Corneille à écrire La suite du Menteur. Le jeune héros y est jugé plus sévèrement.
On avait vue cette pièce il y a longtemps et on n'oublie pas Richard Fontana, qui était Dorante, dans la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie-Française. 1986 ? Il y a quelques années, à Hébertot, théâtre privé, Dorante était joué par Nicolas Vaude dans une mise en scène de Nicolas Briançon et dans des costumes modernes.
Avec Julien Gauthier, on est encore plus près de notre temps. Les costumes des garçons, les robes des filles, ou la jupe et le petit chemisier de Clarice, sont signés Agnès B. Et cela nous va très bien car les atermoiements du menteur sont éternels...Et parce que Le Menteur est aussi une pièce sur la jeunesse, la vitalité, les hésitations...
Le décor est très malin. Jessica Chauffert. l'a dessiné d'un trait sûr, avec les indications du metteur en scène. Un tréteau sur lequel est posée une construction de bois très simple : une arche de porte cochère flanquée de deux esquisses de façades avec leurs portes et leurs indispensables dessus, puisqu'il y a une scène du balcon dans Le Menteur...
Parfois un encadrement d'ampoules donne un air de music-hall enjoué aux joutes et complète les plafonniers tout simples, étoffés de lumières changeantes signées Rémi El Mahmoud.
Dorante, qu'incarne Julien Gauthier, vif et enfiévré, a quitté Poitiers pour Paris. Aux Tuileries, accompagné de son fidèle Cliton, l'excellent Clément Morinière, il tombe raide amoureux d'une belle. Elle se nomme Clarice. Elle est assez insolente. C'est la blonde Amandine Blanquart. Dorante pense qu'elle se prénomme Lucrèce. Mais Lucrèce, c'est sa copine, la fine Rafaèle Huou -la nouvelle venue de la troupe !
L'imbroglio commence par cette méprise et s'enjolive des cascades de mensonges du cher Dorante. Quand son père lui propose une charmante qui se nomme Clarice, il va jusqu'à prétendre qu'il s'est marié à Poitiers...
Pendant ce temps là, Corneille s'amuse, Clarice demande justement à Lucrèce de tester les sentiments du jeune homme en organisant un glissement de prénoms...
Et ce n'est pas fini.
Clarice a un amoureux assez caractériel, un personnage épatant comme Corneille s'amuse parfois à en créer dans ses comédies.
Il se nomme Alcippe c'est le malicieux Clément Carabédian qui lui donne une alacrité digne des comédies de Shakespeare...
Ah ! La vie est bien compliquée quand on ment et quand on n'est pas sûr de son désir ou que l'on voudrait tout à la fois...
En père sérieux, Damien Gouy impose sa maturité sans pesanteur. Juliette Rizoud est une Sabine très ciselée, comme l'Isabelle de Laurence Besson et Julien Thiphane offre à Philiste sa belle présence.
Ils sont très bien dirigés par leur camarade Julien Gauthier. Il a choisi du jazz pour donner du nerf et de la mélancolie à la fois à cette belle représentation. Pierre-Alain Vernette est chargé du son.
Ce qui frappe le plus, dans ce travail, et réjouit le coeur et l'oreille, c'est la virtuosité et le naturel avec lequel tous ces jeunes gens -car on l'a dit, ils ont la trentaine- manient le vers, se jouent de l'Alexandrin et en font une langue d'aujourd'hui.
Alors que ce Corneille de la pleine maturité est aussi très baroque et que sa langue n'est pas toujours facile et que les retournements perpétuels des situations sont difficiles. Et bien eux, nos jeunes gens "en pierres dorées" rendent tout accessible, clair, délicieusement musicale et proche.
Il y a dans ce travail une franchise fraternelle, une intelligence des enjeux, une générosité formidable.
Théâtre national populaire de Villeurbanne, à 20h30 tous les soirs jusqu'à samedi 8 avril, et également à 14h30 les 4, 6, 8 avril. Durée : 1h45 sans entracte. Réservations au 04 78 03 30 00;
A noter : Les Cinquièmes rencontres de Theizé sont organisées par la compagnie Théâtre en pierres dorées du 23 juin 2017 au 25 juin 2017 au Château de Rochebonne (69620) à Theizé-en-Beaujolais. Le Festival est organisé sous la direction artistique de Damien Gouy assisté de Benjamin Kerautret.
Accessible À Tous. Des Déambulations, Des Lectures, Des Spectacles…
Photographie (c) Michel Cavalca.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2017 4:46 AM
|
Sommaire :
- Frédéric Vossier : Éditorial-Responsabilités, Variations
Ensemble éditorial
- Christophe Fiat : Miss Monde suivi de Cléopâtre. Give me some music !
- Mohamed El Khatib : Faut pas pleurer
- Joëlle Gayot : La phrase, la partouze
- David Léon : À corps perdu
- Claudine Galea : Faire l’expérience
- Jean-René Lemoine : Rite de passage
- Alexandra Badea et Anne Théron : Amour. Politique des larmes
- Éric Noël et Christophe Pellet : Amour. Membres fantômes
- Bérénice Hamidi-Kim : Pauline Peyrade, portrait(s) de femme(s). Politiques du désir
- Céline Champinot : La Bible. Vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable
- Bérénice Hamidi-Kim : Écrire ne s’apprend pas, mais écrire s’accompagne
Entretien avec Enzo Cormann et Samuel Gallet
- L’Arche éditeur – Focus : L’Éditeur absolu
- Marie-Amélie Robilliard : Incarner la mélancolie. Le Théâtre de Fabrice Melquiot
- Fabrice Melquiot : Portrait de Rudolf Rach en treize pièces détachées
- Rudolf Rach : Visite à Thomas Bernhard
- Jean-Louis Fernandez : Amor Mundi (Portfolio)
- Lancelot Hamelin : Rond-Point / Tabloïd. Un art français du théâtre. Chroniques
La revue est composée d'un Ensemble éditorial dont les membres sont :
Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Joëlle Gayot, Lancelot Hamelin, Bérénice Hamidi-Kim et David Lescot.
Parages, revue de création et de réflexion, s’est construit comme espace d’appartenance où l’on peut regarder, penser et écrire en toute liberté, et croiser autrui, à tout hasard, sans volonté idéologique.
Parages se veut être le surgissement de la pluralité, le règne improbable et titubant, mais tenace et solidaire, du «singulier pluriel». C’est donc un espace de singularités et de rôdeurs que le Théâtre National de Strasbourg, sous l’égide du locataire de la parole, Stanislas Nordey, accueille, le temps d’un numéro.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...