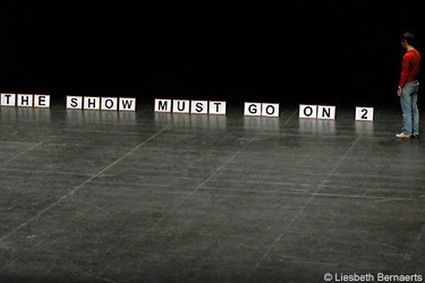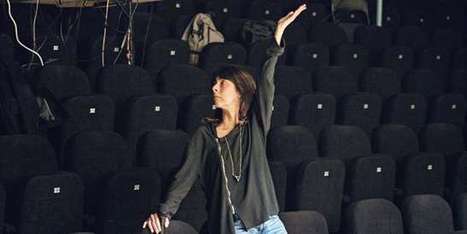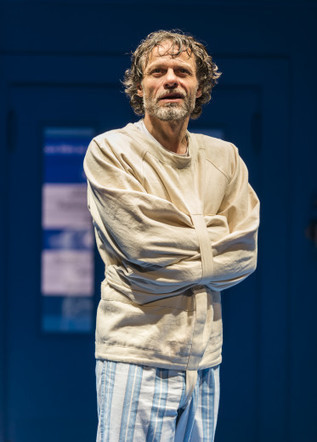Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 19, 2018 7:55 PM
|
Par Olivia Gesbert sur le site de son émission "La Grande Table" sur France Culture
Avec Marie-José Malis, metteuse en scène, directrice du théâtre « La Commune » à Aubervilliers, pour sa nouvelle mise en scène Vêtir ceux qui sont nus de Luigi Pirandello (jusqu’au 28/03)
Ecouter l'émission (28 mn) :https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/pirandello-par-marie-jose-malis
Le message de Pirandello face à la tentation du nihilisme est magnifique : pour devenir quelqu'un, faisons comme si nous avions à ''fictionnaliser'' notre propre vie, à en faire une œuvre qu'il faudrait réaliser sans cesse." Marie-José Malis
Marie-José Malis est à la fois metteure en scène, directrice du théâtre de la Commune à Aubervilliers et présidente du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) : trois bonnes raisons de la recevoir à la Grande Table. Elle est idéalement placée pour nous parler de Luigi Pirandello, monument de la littérature européenne et prix Nobel de littérature en 1934, dont elle adapte la pièce, Vêtir ceux qui sont nus, au théâtre de la Commune. Après On ne sait comment (2011) et la Volupté de l’Honneur (2012), c'est le troisième Pirandello qu'elle met en scène. Appuyée sur l'oeuvre de celui qu'elle qualifie de "révolutionnaire", elle a une position forte sur la politique culturelle et le rôle du spectacle vivant dans la société : comme lui, elle développe un théâtre populaire, proche du réel et des considérations quotidiennes, et qui questionne les grandes problématiques de la condition de l'Homme contemporain.
Ersilia, le personnage principal de ma pièce, est une métaphore des gens qui sont dans la précarité aujourd'hui ; les déshérités, les exclus, les migrants aussi." Marie-José Malis
INTERVENANTS
Marie-José Malis, metteur en scène
Légende photo : Vêtir ceux qui sont nus• Crédits : Willy Vainqueur

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 19, 2018 5:38 PM
|
Par Caroline Bongrand dans L'Officiel 19.03.2018
Disparu avant hier, Philippe Elkoubi était un être brillant, visionnaire et généreux, un homme qui ne vivait que par et pour la beauté et les émotions. Grand directeur de casting, c'était un champion de l'altérité. Il aimait "l'autre", la singularité, la bizarrerie, recherchait constamment la différence, car il savait que s'y nichait, pour celui qui sait s'y attarder, le talent.
Pionnier, plein d'audace, n'écoutant que son instinct et la profondeur des regards qu'il croisait, Philippe Elkoubi était un directeur de casting et un directeur artistique hors normes, d'un talent fou, probablement, et simplement, le meilleur. Il a imposé de nouveaux visages au cinema français, comme celui de Léa Seydoux, alors encore inconnu, et tant d'autres encore. Lui qui a fait confiance à de nouveaux cinéastes — il savait les repérer avant même l'éclosion, les aidant, avec tout son talent et sa modestie. Il avait un sens des histoires, une compréhension innée de la dramaturgie d'un film. De Jacques Audiard à Wing Kar Waï, David Lynch ou Rebecca Zlotowsky, les plus grands, en France mais de par le monde aussi lui faisaient confiance, mieux, le réclamaient. Son exigence était totale, et il savait imposer ses convictions, presque mystiques. Ses choix reposaient non sur une analyse mais sur un niveau de connection avec les êtres très particulier. Son regard était beau et perçant : il voyait tout. Il ne vivait que pour faire se rencontrer des gens entre eux, des gens et des projets.
Comment se nomme ce métier qui consiste à faire se rencontrer des gens, comme il le faisait, avec une telle générosité, constamment ? À l'été 2007, il m'a emmenée, moi qu'il ne connaissait que très peu, voire pas du tout, seulement par certains de mes livres, rencontrer Marie-José Jalou. Il venait d'être nommé, au milieu de ses nombreuses activités, directeur artistique du magazine, ce dont il était extrêmement heureux et fier. Un très beau magazine. Une légende de la mode. Je lui dois cette rencontre clé de mon existence. Peu de temps après, il est retourné au cinéma. C'était là tout lui : faire les présentations, puis s'éclipser. En 2012, il m'avait confié avoir envie de livrer qui il était, qui il était vraiment. Soudain, lui si discret, avait envie d'un portrait. Je m'étais précipitée, dans l'atelier d'Anne-Valérie Hash, son âme soeur depuis l'enfance, boulevard Bonne Nouvelle, pour passer trois heures avec lui, et écrire, ensuite, le texte ci-dessous. Philippe était très beau, c'était un être lumineux, peut-être parfois incompris comme ces météorites dont on comprend plus tard qu'ils portaient en eux quelque chose comme du génie. Disparu avant hier, nous nous devions et je me devais de partager ce portrait qu'il avait relu et dont il avait été ému: "je me suis vu", m'avait-il répondu. Ce texte date donc de 2012. Je n'en ai pas changé la moindre virgule.
Philippe, c'est pour toi. De notre part à tous, qui t'avons connu et aimé.
Confession d’un enfant du siècle : Philippe Elkoubi
Il est le directeur de casting que les réalisateurs étrangers nous envie. De Wong Kar Waï à David Fincher, David Lynch ou plus proche de nous, Sylvie Verheyde, Jean Baptiste Mondino ou Bettina Rheims, Philippe Elkoubi ne travaille pas tout à fait comme les autres. Rencontre avec un « homme de l’ombre » aussi respecté que secret, à l’occasion de la sortie du film Confession d’un enfant du siècle auquel il a participé.
Il a grandi dans un petit village au bord de l’Atlas, élevé par ses grands parents. D’extraction judéo-mystique – son arbre généalogique qu’il peut remonter jusqu’à l’an 1100 n’est constitué que d’une longue lignée de rabbins — il se dit d’une famille de penseurs. La religion est pour lui le lieu de connaissance d’un monde plus silencieux où l’invisible compte autant voire davantage que le visible. Pourtant Philippe Elkoubi n’a pas choisi la voie de ses aïeux. « Je suis la première génération à ne pas être rabbin ». Celui qui dit s’intéresser « aux identités, aux incarnations » a choisi un tout autre territoire. Directeur de Casting, cela semble trivial, réducteur. Pourtant ça ne l’est pas. Philippe Elkoubi va au plus profond mais aussi au plus instinctif. Il va au plus profond des êtres, dans ce qu’il nomme les arrière mondes, vers l’âme de chaque individu. Ainsi choisit-il, pour les plus grands réalisateurs du monde entier, les visages, les regards — les acteurs et les actrices. Agissant en véritable révélateur, il époustoufle ceux qui travaillent avec lui. Philippe les a « fait évoluer » sur la compréhension de leur scénario ». Rebecca Zlotowski le dit elle même : elle a plus appris sur ses personnages pendant le casting que pendant l’écriture du scénario. Pas en termes d’acteurs mais vraiment en terme de scénario. Il sait lire au delà. Sa vision d’un scénario, les acteurs qu’il propose sont une réalisation en soi. « Le cinéma, c’est le présent absolu. Je ne crois pas qu’il y ait de personnages. Ce que donnent les acteurs, c’est ce qui les traverse ». Ce « geste » du casting, comme il l’appelle, il dit en avoir hérité. Lire derrière les yeux, voir derrière la peau. « Dans mon métier, je me sens au plus proche de ma tradition juive ».
« Le cinéma, c’est le présent absolu. Je ne crois pas qu’il y ait de personnages. Ce que donnent les acteurs, c’est ce qui les traverse. » Il n’a pas fait d’école. Est arrivé au casting « par nécessité de comprendre quelque chose de l’ordre du langage humain », dit il. Enfant, il n’a jamais l’impression d’avoir accès à la vérité des êtres. Et cela l’obsède. Les admire-t-il ? Les craint-il ? Les deux à la fois ? Qui sont les gens ? Qui est-il celui là, en vrai, et moi, qui suis je ? « Quand des gens arrivent dans le studio, ils veulent être mieux que vrais, et ils sont tellement fragiles. On peut avoir accès à quelque chose d’essentiel. Quand quelqu’un s’abandonne à ce qui le traverse, tu filmes du cinéma. Certaines choses ne peuvent pas s’écrire, se disent depuis un rythme. Ce qui nous habite, c’est musical ». Il cite Jankélevitch, « ce qui est très beau dans la musique, c’est qu’elle a des causalités clandestines ». Pour lui, les êtres humains sont tous porteurs de quelque chose de l’ordre de la musique, du rythme, du tempo. « J’en apprend plus sur quelqu’un par le rythme de sa pensée que pare ce qu’il dit. » C’est cette petite musique, ce rythme intime qu’il perçoit, si clairement. Le visage qui le bouleverse le plus, c’est celui de Léa Seydoux. Il la connaît depuis ses 15 ans. « Elle peut tout être parce qu’il y a quelque chose d’une disparition dans son regard, c’est quelqu’un qu’on traverse. On peut l’imaginer comme ce qu’on veut. Elle a une qualité d’absence ou la projection est possible, c’est très étonnant. Dans les hommes, Lucas Pittaway, de Snow Town. Il a cette même chose qu’avait Heath Ledger. Incroyable ».
"Quelle tristesse... Philippe nous a quitté, son élégance, sa gentillesse et son intelligence vont nous manquer cruellement... il savait capter l’âme des personnes qu’il castait, et souvent les films qu’il me préparait d'eux était mieux que ce que j’allais en faire... Love for ever." Jean-Baptiste Mondino
Il a travaillé pour Wong Kar Wai, David Lynch, Jonathan Glazer, David Fincher, et dans le registre des photographes, Jean Baptiste Mondino, et Bettina Rheims. Mais Philippe Elkoubi aime aussi les moins connus, les originaux, les audacieux, les insolents. Comme pour Grand Central, sa deuxième collaboration avec Rebecca Zlotowky après Belle Epine, qui réunit Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Menochet, Guillaume Verdier. « C’est très beau, ça se passe dans une centrale nucléaire. C’est un film qui regarde un visage possible d’un certain prolétariat français, un film qui descend absolument dans la matière humaine, dans la relation amoureuse, dans les liens qu’entretiennent les personnages les uns avec les autres ». « Quand je travaille sur un film, je travaille sur une couleur. Je crois que chaque film parle sa propre langue. Pour Grand Central, cette langue, c’est la sauvagerie. La sauvagerie, c’est « se laisser être depuis ce que l’on sent ». Ca ne relève pas de la psychologie ». Pour le film, Philippe a vu 220 acteurs.
Il fait du casting depuis 17 ans. Son équipe compte 5 personnes. Ils sont installés dans le 11ème arrondissement de Paris. 15% seulement de ses clients sont français. Il s’occupe de 7 à 8 films par mois, dont des publicités pour les plus belles marques. Dior, Saint Laurent, Armani, Valentino. Il suggère les égéries. On l’écoute. Les formats n’ont aucune importance pour lui. Il filme des acteurs, avant de présenter ces films aux réalisateurs. Cela fait 5 ans maintenant qu’il fait du cinéma. Les réalisateurs commencent à lui proposer d’être associé à la production, voire d’être co producteurs, comme Philippe Grandrieux. Ils ont compris que l’homme a une vision qui va plus loin – plus loin que l’utilitarisme et l’efficacité. Pourtant, Philippe Elkoubi est discret. C’est un homme de l’ombre, un vrai, quelqu’un qui n’apparait pas, qui ne la ramène pas, qu’on ne croise pas sur les terrasses ni même sous le soleil. Il travaille comme un fou. Jour et nuit, ou presque. Organisé, il a des assistants dans de très nombreux pays. Les met à contribution, constamment. Aucun talent ne lui échappe, de la Chine à l’Australie, l’Espagne, la Suède, l’Allemagne ou les Etats unis. Il s’intéresse à tous. Va les filmer, lui même, où qu’ils soient. « J’ai filmé des gens sans aucun dispositif esthétique, sans lumière, comme ça, dans des voitures, sur des balcons, je ne parlais même pas leur langue. Mais paradoxalement j’avais accès à quelque chose d’extraordinairement cinématographique ».
Le verbal serait-il un obstacle à la communication entre les êtres ?
La thèse mérite que l’on s’y penche, car elle est pertinente. Langage du regard, du corps, des âmes, bien plus forts. Cela soudain semble une évidence. « Sylvie Verheyde avait très envie d’adapter Confessions d’un enfant du siècle, en prenant l’amour comme lieu du tourment absolu, en traitant l’amour comme un sujet de société ». Quelques mois plus tard, elle revient avec un scénario, des noms d’acteurs français pour incarner les personnages. Philippe Elkoubi craint que le Français et la France ne limitent l’accès à la pensée de Musset. Il a soudain l’idée que Pete Doherty serait un Octave incroyable, parce que lui même déjà porteur d’un néoromantisme. « Sylvie est restée bouche bée, elle ne le connaissait que comme un chanteur et elle ne parle pas Anglais. Moi je pensais que Musset en Anglais, ce serait réellement dire Musset ». Il connaît bien Pete Doherty, qui lui a confié un jour avoir envie de faire un film. C’est la rencontre, pense Philippe Elkoubi, et elle doit avoir lieu, malgré toutes les difficultés d’une communication minimale avec la réalisatrice. Doherty dit oui. Lily Cole le rejoint. Philippe Elkoubi poursuit son casting en Allemagne, en Grande Bretagne, en France. Cherche des acteurs excellents mais plus « clandestins ». Le casting emmène le film plus loin que prévu, plus haut, plus fort, et influence tant la vision du scénario et la réalisatrice qu’il se voit associé à la production. Confession d’un enfant du siècle passe d’un projet entièrement franco français à une dimension internationale. « Par un casting on crée les possibilités de la rencontre avec une économie, des distributeurs ». En même temps, ajoute-t-il, un grand casting n’est jamais la garantie d’un bon film. Philippe éprouve beaucoup de plaisir à fabriquer, pour le film, la « réalité des incarnations » malgré les différences de langues. Depuis le début, il veut Charlotte Gainsbourg. Elle est prise. Cela le contrarie beaucoup. « La rencontre entre elle et Pete était hautement signifiante pour elle comme pour lui. Non, c’était impossible que ça ne se produise pas. » Une fois de plus, il a raison. Charlotte Gainsbourg dit oui. Le film est sélectionné à Cannes, dans Un certain regard.
Il cite Pessoa. « Le plus bel endroit pour voir les gens, c’est de dos. Là, on est en dehors de la folie de l’époque. On est en dehors du contrôle. On ne se connaît pas de dos. » Dans son studio, il reçoit les gens une heure. Leur envoie l’information que la rencontre ne va pas s’effectuer avec lui, mais avec eux mêmes. « C’est très émouvant, le métier des acteurs, il faut toujours passer du réel à la réalité ». Et d’ajouter : je crois qu’on obtient rien dans l’exécution. On n’atteint rien d’exceptionnel depuis la performance. Il a travaillé avec John Strasberg, le fils de Lee. « J’avais l’impression que tout ce qu’il disait sortait de ma bouche. C’est tout ce que j’avais toujours pensé ». Ce qu’il aime plus que tout, c’est faire du « casting sauvage ». Arrêter des gens dans la rue. « Les gens ont dans l’idée que le cinéma c’est le lieu des gens très beau. J’ai arrêté des gens qui se pensaient laids et que je trouvais très beaux. Ils étaient très étonnés et me disaient « mais je ne suis pas beau ». « La beauté, c’est un grand sujet. Ce n’est pas un bien de consommation, cela relève de la mémoire, quelque chose de très profond ». Et il la côtoie aussi dans cette autre vie, que peu lui connaissent. Une histoire d’enfance, une histoire d’amour, d’amitié, de mode. Il est l’associé discret d’Anne Valérie H, marque de Haute Couture et maintenant de prêt à porter unanimement portée aux nues, du Harper’s Bazar à Vogue en passant par W. « On se connaît depuis qu’on a dix ans. Nous étions dans la même école. Je suis allée voir Anne Valérie et je lui ai demandé si elle voulait être mon amie. J’étais magnétisé par elle. On a découvert vingt ans plus tard que nos grand mères étaient voisines, au Maroc, et que mon père avait été très amoureux de sa mère, au point de vouloir l’épouser ». C’est une histoire d’âmes sœurs. Anne Valérie fait la Chambre syndicale de la Haute Couture. Puis va trouver Philippe : « Je veux créer ma maison de couture, mais je ne le ferai pas sans toi ». Il lui demande pourquoi elle veut créer sa maison. C’est important, cette question. « Elle me répond que petite, elle voulait couper les vestes de son père pour en faire des robes ». Voilà qu’ils travaillent à partit du corps d’une petite fille, ou plutôt, de la sensation d’être une enfant avec les vêtements de son père. Ils prennent une garde robe d’homme, font une robe à partir d’un pantalon, une jupe depuis une veste. Ils n’ont pas les moyens d’un défilé, alors ils font un premier livre. Il y a une garde robe marocaine, une autre d’ouvrier, une autre de matador, etc. Puis d’autres livres. Qui s’occupe du casting ? Devinez. Les plus belles top model – Stella Tennant en tête- les accompagnent, gratuitement, pour la marque. Ils créent des livres, font des présentations photographiques. Tout le monde adore. Pour la marque, c’est un triomphe. L’identité est là, claire et bien affirmée. « Les grandes choses, on les fait depuis les endroits où on les sent », dit-il. Avant d’ajouter « La vérité, ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce qui nous sait ».
Crédit photos : Philippe Abergel
Autre article en hommage à Philippe Elkoubi :

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 8:54 PM
|
Propos recueillis par Annick Cojean dans Le Monde 18.03.2018
La diva du jazz évoque dans un entretien sa renaissance après l’accident qui faillit lui coûter la vie à 19 ans.
En treize ans, la chanteuse, auteure et compositrice américaine Melody Gardot s’est imposée sur la scène mondiale du jazz. Elle sort un double CD issu de ses meilleurs concerts européens.
Je ne serais pas arrivée là si…
Si je n’avais rencontré sur ma route autant d’amour.
Où ? Quand ? De qui ?
Partout ! En permanence ! Derrière les épreuves ou les drames qui nous frappent, les gens ne voient toujours qu’âpreté et souffrance. Moi, je vois surtout l’amour. C’est lui qui m’a permis de me redresser et de remarcher après qu’un chauffard m’a renversée à bicyclette quand j’avais 19 ans et laissée polytraumatisée, en miettes, quasi-amnésique, sur la chaussée. Lui qui m’a orientée vers la musique alors que je pensais devenir artiste peintre. Lui qui m’a nourrie, protégée, aiguillonnée depuis ma naissance et me maintient encore debout.
A l’origine, de quel amour parlez-vous ?
De celui de ma mère, qui a mené un nombre incalculable de guerres pour que nous puissions survivre toutes les deux. Nous étions pauvres à Philadelphie. Une ou deux paires de chaussures, peu de vêtements, une boîte de conserve à nous partager le soir. Et un logement précaire qui nous obligeait à déménager fréquemment faute d’argent. Tout devait tenir dans deux valises ! Nous formions une petite cellule de deux personnes, une équipe soudée à la vie à la mort. Elle était artiste-photographe, mais prête à tous les jobs pour gagner un peu de fric. Je la regardais se démener, se fatiguer, faire des sacrifices, si seule et si combative. Et surtout si aimante. Cela vous donne de la force pour la vie, une mère comme ça !
Est-ce qu’il y avait des hommes dans cette micro-cellule ?
Non. En tout cas pas au début. Plus tard, quelques-uns sont passés. Et j’étais comme la petite voix de sa conscience : « Allons ! Tu lui donnes trop de chances à celui-là ! Tu t’égares ! » En tout cas, son amour m’a forgée. Comme celui d’autres gens qui ont pris le relais. Je suis comme un petit bateau dont la voile est gonflée par le souffle de l’amour. Je ne suis rien sans ce vent. J’ai beau avoir un caractère de rebelle, j’ai toujours besoin de sentir qu’on m’aime et qu’on me le démontre, comme savent le faire les enfants. Vous voyez ce que c’est, un câlin d’enfant ? C’est dix fois plus fort que tous les autres, plein de confiance, sans retenue, sans mesure. Alors que les adultes ont peur de rester dans les bras d’un autre, bourrés de doutes et de questions. Quelle erreur ! Moi, je refuse de refuser l’amour. Même si je sais que mes amoureux passeront toujours après la musique, car je suis mariée à mon instrument [la guitare]. Et même si ma vie de voyages me contraint à dire sans cesse au revoir à tous ceux que j’aime.
Pourquoi cette frénésie de voyages ?
D’abord pour le travail, les concerts, les enregistrements, les tournées. Et puis pour la curiosité. Je veux apprendre, apprendre. Je ne peux pas être satisfaite de ne parler que trois ou quatre langues. Et je veux connaître d’autres cultures, d’autres musiques. J’ai vécu à Rio, Buenos Aires, Lisbonne, Paris. Je veux découvrir et faire des croisements, suivre mon instinct, me perdre. Je ne suis pas docteur Freud, mais il n’est pas exclu qu’avoir été si longtemps coincée dans un lit y soit pour quelque chose…
Revenons donc à cet accident survenu en 2003. Vous auriez pu me répondre « je ne serais pas arrivée là si je n’avais pas croisé la route de ce chauffard en Jeep »…
C’est vrai. Ma vie a totalement basculé. Mais je crains que cette réponse minimise ou éclipse le rôle joué par ma mère. Je ne m’en serais pas sortie sans elle. Et donc une réponse sur l’amour permet de dépasser l’accident proprement dit. Mais vous imaginez bien que ce fut un séisme et chaque journée, dans les dix ans qui ont suivi, équivalait à gravir l’Everest ! Mon bassin a été brisé, ma colonne vertébrale atteinte, sans compter les lésions cérébrales et traumatismes multiples. Je suis restée un an à l’hôpital, allongée sur le dos, paralysée.
Le diagnostic était-il pessimiste ?
Désespéré ! Figurez-vous que, quelques jours après mon arrivée, il y a eu une inversion de dossiers médicaux avec une autre patiente. On m’a donc amenée à une séance de rééducation en tentant de me faire marcher. J’expliquais que je ne sentais rien à partir du bassin, mais on m’a forcée à bouger et je me suis mise à pleurer : c’était juste impossible. Les médecins, stupéfaits, ont alors compris leur méprise. Et en voyant mes radios, l’un d’eux m’a dit : « Tu ne remarcheras probablement jamais. » Eh bien c’est étrange : ces mots me sont passés au-dessus de la tête sans y pénétrer. Je ne sais pas si je ne comprenais pas ou si j’étais dans le déni. Cela n’avait tout simplement pas de sens. Et puis tout n’était pas perdu puisque j’avais mes mains ! Comme j’avais toujours voulu peindre, j’étais sauvée ! N’avais-je pas vu un reportage sur des handicapés qui tenaient leur pinceau entre leurs dents ?
Avez-vous connu des phases de déprime ou de désespoir ?
Non. Il y a eu des moments rudes, bien sûr. Etre dépendante de quelqu’un pour aller aux toilettes était abominable et m’incitait à ne pas manger ni boire pour limiter mes déplacements. Je dépendais essentiellement de ma mère, puis d’une petite infirmière qui est venue chaque jour à la maison à partir du moment où j’ai dû quitter l’hôpital, faute d’argent.
Faute d’argent ? N’étiez-vous pas assurée ?
Je n’avais pas de voiture, donc pas d’assurance auto. Quant à mon assurance-maladie, elle était sans effet puisque ce n’était pas une maladie mais un accident de voiture ! Si vous saviez le nombre de médecins qui, pour des raisons de fric, m’ont fermé leur porte et l’accès aux traitements ! Nous étions dans une situation financière désastreuse : je vivais avec 150 dollars par mois d’assistance publique, plus 150 de prime handicap. Mais ma perte de mémoire engendrée par le traumatisme crânien avait au moins un avantage, c’est que je ne me souvenais jamais de la veille ni de ce qui aurait dû être mon grand sujet d’inquiétude ! L’inconvénient, c’est que j’ai dû réapprendre à tout faire : parler, manger, me laver les dents… J’ai encore du mal avec la notion du temps et l’organisation d’un calendrier, y compris pour mes tournées. Et ma mémoire reste capricieuse. Il y a des moments où je ne me souviens de rien du tout, et quand je chante en concert, je peux me tromper de mots ou affronter le vide. C’est pour ça que j’aime le jazz. Un trou de mémoire survient, et je me tourne vers le bassiste : « Solo ! » Pendant qu’il joue, j’essaie de retrouver le fil des phrases dans ma tête. J’ai des petits trucs qui marchent, ni vu ni connu…
Vous dites souvent avoir été sauvée par la musique…
C’est vrai ! Parmi mes troubles neurologiques, il y avait l’anomie, un trouble grave de la parole. Un truc fou. Mon cerveau fonctionnait, mais j’étais incapable de formuler des mots. Je balbutiais comme un bébé : beup beup beup. Et c’est là que la musique m’a aidée. Ma mère m’a apporté une guitare et j’ai appris à en jouer, entièrement allongée, en collant des onomatopées sur des sons, un peu comme le scat : bap bap ta ta ta ba ba. Puis j’ai varié les syllabes. Et au bout de plusieurs mois, les mots ont surgi, incertains, sur des airs, ce qui en faisait des chansons. C’est ainsi que j’ai recouvré l’usage de la parole.
Est-ce une méthode que vous avez improvisée ?
Totalement ! Je l’ai découverte à l’instinct et je voudrais maintenant la développer dans des hôpitaux, surtout avec les enfants. Les bribes de mots arrivaient, accolés à des notes, chargés de mes émotions. C’était comme le miroir de mon âme. Comme j’oubliais tout au fur et à mesure, j’enregistrais trois notes avec un petit magnéto, puis cinq, puis de courtes phrases, je réécoutais et j’enchaînais. Je confiais ainsi à ma guitare ce que je ne pouvais dire à personne, moi qui avais 20 ans et vivais comme un petit chiot, au jour le jour, immobile, incapable de me projeter dans l’avenir. Ce lien fort avec mon instrument a perduré. Je continue de ne me confier qu’à lui et ça énerve mes proches. « Tu compartimentes ta vie !, s’est énervé un ami. Tu ne me dis rien de toi ! » Que lui répondre ? « Tu n’es ni un piano ni une guitare. Je suis incapable de te dire ce que je ressens. »
Comment en êtes-vous arrivée à partager ces chansons créées sur un lit d’hôpital ?
Un ami a mis sur le site Internet Myspace l’un de mes enregistrements qui n’était, au départ, qu’un exercice de mémoire. Puis quelqu’un m’a demandé si je ne voulais pas venir jouer deux ou trois chansons dans un concert de charité. J’ai été tentée, sachant pourtant que je ne pouvais pas rester assise plus de quinze minutes sur mon fauteuil roulant. Une radio de Philadelphie m’a alors réclamé un CD. Je n’en avais qu’un seul, enregistré sur mon pauvre ordinateur. Et ça a cartonné. Puis quelqu’un de merveilleux m’a proposé d’enregistrer un vrai disque, alors que je n’avais pas un rond, que j’étais toujours en fauteuil roulant, équipée d’un appareil auditif pour réguler l’intensité des sons qui résonnaient dans ma tête comme un haut-parleur détraqué, et de lunettes fumées pour protéger mon hypersensibilité à la lumière. Le CD a explosé, Universal m’a signée, et tout s’est enchaîné… L’amour, je vous dis. J’ai eu des anges sur mon chemin.
Le succès a été gigantesque et l’Europe vous a tendu les bras…
C’était si inattendu, tout ça ! Ces chansons si intimes qui devenaient publiques. Et ce corps disloqué que je travaillais à maintenir droit sur scène, soutenu par une canne si rassurante en cas de vertiges, et dont je ne me passe que depuis deux ans. J’ai pris de l’assurance, je sais que je peux faire ressentir au public un maximum d’émotions. C’est ce à quoi doit servir un concert, non ? Je ne suis pas une pianiste fabuleuse. Diana Krall me tue en trois notes ! Mais j’ai autre chose. Un feeling, une poésie, ma petite touche à moi.
Comment la définir ?
Lorsque j’écris, je suis en quête de vérité et de quelque chose qui me dépasse. Parfois, j’ai l’impression – fugace – d’être une marionnette : mes mains bougent toutes seules, mues par un truc mystérieux, venu de je ne sais où. Mais il me faut pour cela m’isoler du monde, me mettre en condition de capter ces étranges vibrations. Quel cadeau d’écrire !
En quoi le frôlement de la mort, l’expérimentation de la souffrance physique, toutes ces années de combat pour reparler, remarcher, être indépendante, ont-ils changé votre perception de la vie ?
J’ai l’impression d’avoir une deuxième vie. Le choc de l’accident m’a fait perdre la mémoire et a donc effacé toute trace de la première. Mes souvenirs d’enfance sont partis à jamais. J’en recrée quelques-uns, grâce aux récits de ma mère que j’écoute intensément, écris, relis. Ses histoires deviennent miennes. Je peux les partager, tout en étant incapable d’en donner les détails. Mais au fond, qu’importe ! Je suis bouddhiste et je crois que les vies se succèdent. A 19 ans je suis morte. A 19 ans, je suis née. Comme j’en ai aujourd’hui 33, du moins officiellement, cela signifie donc que je n’ai que 14 ans dans ma deuxième vie. Je suis une ado ! Une ado avec une vieille âme.
C’est-à-dire ?
Une ado qui sait le prix de la vie et qui a sans doute une hiérarchie de valeurs et de priorités différente de ses contemporains. Une ado énervée quand elle voit les gens se plaindre de la pluie, du métro ou des embouteillages. « Allez donc rendre visite aux enfants de l’hôpital Necker !, ai-je envie de leur crier ; vous saurez ce qu’est la vraie souffrance ! » Une ado stupéfaite du sort réservé aux migrants dans une ville aussi riche que Paris, dont les flics, m’a-t-on dit, détruisent couettes et campements. Moi, je leur distribue systématiquement vêtements et nourriture à l’issue de mes tournées, cela m’est une évidence. Une ado écœurée par la façon dont on laisse les malades croupir dans les hôpitaux, sans sortie, sans visite. A la moindre fête (celle des pères, des mères ou la Saint-Valentin), je prends ma guitare et je fais un tour dans les établissements à la ronde, quel que soit l’endroit où je me trouve dans le monde. Une ado, enfin, obsédée par son envie d’aider les enfants et les vieux. Je les adore. Les premiers pour leur innocence et leur drôlerie. Les seconds pour leurs histoires et leur fragilité. C’est nous, entre ces deux groupes, qui sommes merdiques et pathétiques, en faisant fi du cycle inéluctable de la vie et en jetant nos anciens.
Connaissez-vous les paroles de la chanson de Françoise Hardy : « On est bien peu de chose et mon amie la rose me l’a dit ce matin… » ?
Non ! Mais j’ai chanté C’est trop tard, celle de Barbara. Et j’ai fini en larmes, comme mes musiciens, mes producteurs, mes techniciens. « C’est trop tard pour verser des larmes. Maintenant qu’ils ne sont plus là. Trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas. »
Propos recueillis par Annick Cojean
Sortie d’un double CD « Live in Europe » (Decca-Universal)
A l’Olympia les 1er et 2 juillet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 1:12 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde 16.03.2018
Au Théâtre de la Colline, à Paris, Richard Brunel met en scène, avec un faux modernisme, un texte de Christine Angot.
Cécile est la plus grande actrice du théâtre en France. Elle vient d’un milieu privilégié ; elle est passée par le Conservatoire ; elle vit avec Stéphane, Martiniquais, ingénieur du son au chômage. Un soir, tous deux vont dîner chez Régis, qui travaille dans la mode. Il y a là Marie, professeure de médecine, et Florence, directrice d’une scène nationale en banlieue. Chacun a apporté un cadeau qui sera offert à un autre invité, et doit correspondre au thème de la soirée : « Politiquement correct ». Cécile arrive avec un petit carnet en papier recyclé et une plaque de chocolat siglée « commerce équitable ».
A elle, comme aux autres, Régis demande de deviner de qui est la sculpture dans l’entrée. « Brancusi, Arp, Serra ? », essayent-ils. « Mais non, vous n’y êtes pas, c’est une pierre que j’ai rapportée de la plage de Fécamp », répond Régis… Inutile d’aller plus loin, tout le monde a compris dans quel type de soirée Cécile, Marie, Florence et Stéphane sont embarqués : ils ne mangent pas chez quelqu’un, ils dînent en ville, comme on le dit dans un milieu bourgeois et cultivé qui respire l’entre-soi.
Un propos attendu
Respire ou transpire ? Toute la question est là, dans Dîner en ville, la nouvelle pièce de Christine Angot, mise en scène par Richard Brunel. C’est une pièce courte – autour d’une heure et quart –, mais court ne veut rien dire au théâtre, où le temps peut filer ou peser, selon l’intérêt ou l’ennui. Et là, on s’ennuie, parce qu’au bout de dix minutes on sait où on va ; parce que les protagonistes sont moins des personnages que des types ; parce que le propos sur la vanité de la sociabilité est attendu.
« J’ai vu Marine Le Pen à l’aéroport, elle a grossi » ; « On veut nous faire croire que François Mitterrand est un grand écrivain parce qu’il a écrit des lettres d’amour » ; « La discrimination positive, c’est bien, ou pas ? » Voilà le genre de propos que l’on entend, entre autres, au Théâtre de la Colline, où la pièce est jouée.
Alors, en rentrant chez soi, après la représentation, on lit le texte, qui s’avère beaucoup plus intéressant qu’à l’écoute : on y retrouve le don qu’a Christine Angot de pincer en tournant dans le jeu social. Organisé en séquences plutôt qu’en scènes, ce texte ferait un bon scénario pour un moyen-métrage. La représentation ne lui réussit pas, en tout cas, celle que propose Richard Brunel : son faux modernisme et sa direction d’acteurs transpirent le cliché.
Dîner en ville, de Christine Angot. Mise en scène Richard Brunel. Avec Emmanuelle Bercot, Valérie de Dietrich, Noémie Develay-Ressiguier ou Julie Pilod (en alternance), Jean-Pierre Malo, Djibril Pavadé. Théâtre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, Paris 20e. Jusqu’au 1er avril. Colline.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 10:56 AM
|
Par Frédérique Meichler dans L'Alsace
Pendant les vacances, une dizaine d’aspirants comédiens ont suivi un stage intensif de théâtre à Mulhouse, avec la metteuse en scène Blandine Savetier, artiste associée au Théâtre national de Strasbourg (TNS). La préfiguration d’une classe préparatoire aux concours des grandes écoles de théâtre, ouverte à des jeunes issus de familles modestes.
« Allez, redresse-toi ! Et reprends tout. Tu ne sais pas où poser ton regard, ça t’empêche de t’ancrer quelque part… Tu dois ouvrir les volets pour qu’on puisse voir ce qui se passe dans tes yeux ! » Cela fait dix jours que Blandine Savetier travaille avec les premiers candidats à la classe préparatoire de théâtre qui doit démarrer à la rentrée prochaine à Mulhouse (lire ci-dessous). La metteuse en scène associée au Théâtre national de Strasbourg (TNS), choisie pour être la première référente pédagogique du projet, ne mâche pas ses mots. Le ton est direct mais les stagiaires n’en prennent pas ombrage… La confiance est établie, ils boivent ses paroles et mettent toute leur énergie à faire mieux, en tenant compte de ses critiques.
« Envoie la pensée ! »
« Très bien, mais il faut plus d’engagement. C’est tout votre corps qui parle, il faut mettre de la matière. Tu vas voir, c’est très beau de faire entendre la langue comme Kate Tempest l’a dessinée » , commente-t-elle après la prestation d’une jeune fille qui n’a aucun accroc avec le texte mais demeure un peu dans la distance du récit, plus que dans l’incarnation du verbe.
« Reprends, sans le texte, tu le sais… » « P…, je suis nue ! » « Mais non, ne dis pas ça ! Tu le sais, assène la metteuse en scène. Je préfère une mémoire imparfaite à une lecture. Envoie les images, envoie la pensée ! Cette première pensée qui fait plusieurs vers et qui décrit la situation de Brian… Le cœur c’est Tommy, c’est l’acmé, l’endroit le plus haut. C’est là que tu dois arriver ! »
Blandine Savetier ne lâche pas et fait recommencer la scène, jusqu’au moment où elle perçoit que les choses bougent : « Adresse-nous ta pensée. Là, ton “ Il s’appuie contre le mur ” est trop automatique. Tu n’es pas assez dans l’image que tu décris. Soigne tes attaques ! Bien… Là, c’est plus actif, moins narratif. Pas mal du tout ! »
Même combat avec le stagiaire suivant : « Il faut te demander comment tu peux faire avec le côté artificiel des vers quelque chose d’organique, de naturel… Mary, c’est une nouvelle Médée qui veut aider Clyde à s’en sortir. Il faut prendre la question pour soi. C’est comme ça que tu vas nous attraper. Je veux que tu incarnes cette question ! » Le jeune homme tente de corriger. « C’est mieux, mais il faut que tu viennes nous chercher, en essayant de décrypter toi-même la situation de Mary. Quand tu dis “ La froide lumière du matin ”, par exemple, je ne la vois pas… J’essaie de te faire toucher à d’autres endroits que toi, plus intimes. Tu dois être connecté à chaque chose. Ne pense pas au résultat, pense au travail. Et tu rebosses ton texte ! »
Il y a aussi ceux qui ont un don pour ça. Dès qu’ils ouvrent la bouche, on est happé. Le visage de Blandine Savetier s’illumine, elle sait qu’elle découvre des pépites. Présents à ce qu’ils disent – même quand ce n’est pas leur langue maternelle… La qualité d’écoute des autres est le premier signe, tous les regards dévorent littéralement cette apprentie comédienne, l’émotion est palpable. « C’est très bien » , commente la metteuse en scène, qui ne renonce pas à dire cependant ce qui est perfectible.
« Parle avec ta chair, ton sang ! »
« La parole doit agir. Pas seulement l’énergie, il y a la pensée, la précision de l’image, ce que vous voulez dire de ce texte. C’est de l’intime. » Et encore : « C’est ton cœur. Parle avec ta chair, ton sang ! Il te manque parfois l’urgence. Allez, fais-moi sentir la naissance de l’amour pour cette fille… Sois plus amoureux, plus sensuel. Je veux tout voir : fais-nous trembler, brûle-toi à la flamme de l’amour ! »
Le jeune homme donne tout mais finit pas craquer dans un rire nerveux… « C’est horrible ce que tu fais… Je pourrais te battre !, se fâche – affectueusement – la metteuse en scène. Tu as peur de ton émotion, tu as peur de ce que tu ressens. Mais on vient au théâtre pour ça ! Bordel de m…, pourquoi tu ne le fais pas ? Juste que tu sentes quel bel homme tu es… »
Le stage s’est déroulé au foyer Sainte-Geneviève, à Mulhouse – qui devrait être le « QG » de la future classe préparatoire –, du 26 février au 9 mars dernier. Les participants ont travaillé également l’aisance corporelle avec Sylvain Boruel, du Centre chorégraphique de Strasbourg, et la voix avec Marie Schoenbock, qui est chanteuse et formatrice à Cadences, ex-Mission voix.
« C’est passionnant »
« En 15 jours, ils ont fait un sacré chemin, constate Blandine Savetier. Mon objectif, c’est que le théâtre agisse sur eux-mêmes. C’est aussi une question de maturité, ils sont jeunes, ils ne perçoivent pas encore toute la puissance, ils sont à la surface des choses. Mais ils ont une vitesse de progression exceptionnelle ! Là, ils sont déjà débarrassés de leur pudeur, ils sont engagés, ils ont compris aussi qu’être comédien, c’est très exigeant. C’est passionnant de travailler avec eux !
Légende photo : Pendant toutes les vacances, les jeunes ont travaillé dans la grande salle du foyer Sainte-Geneviève, à Mulhouse.Photo L’Alsace Photos : Darek Szuster

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 9:59 AM
|
Par Joëlle Gayot sur le site de son émission Une saison au théâtre sur France Culture
Aujourd'hui, pleins feux sur la salle. Pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait au moins un spectateur - un regard, une sensibilité : un sujet, auquel une pièce s'adresse. Notre encyclopédie du théâtre bien vivant s'ouvre à la page de ceux qui font que "quelque chose commence" : le spectateur.
Ecouter l'émission (30 mn) https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/le-spectateur
C’est ça le spectacle, attendre le spectacle […], attendre seul, dans l’air inquiet, que ça commence, que quelque chose commence, qu’il y ait autre chose que soi.
-- Samuel Beckett, L’innommable, éd. Minuit, 1953
Avec Christian Ruby, docteur en philosophie, médiateur culturel, auteur du livre Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel (éd. de L'Attribut, sept. 2017). Partant de ce livre dense sur le spectateur de théâtre, qui le place avec exigence dans la perspective d’une histoire culturelle, politique et philosophique de l’Occident, partant également de la perspective orientale qui a considéré autrement qu’en Europe sa position, nous discutons avec notre invité du “spectateur”, cette figure et ce corps bien réel sans lequel le spectacle vivant aurait lieu… Souvent réunis en assemblée hétéroclite, en “public” avec lequel il s’agit pourtant de ne pas toujours les assimiler, les spectateurs sont l’objet, au fil de l’histoire, d’enjeux complexes, passionnants, en miroir desquels le théâtre évolue et se transforme. Car le spectateur parle du spectacle, autant que le spectacle parle des spectateurs qui composent le monde. Petit tour d’horizon d’une question humaine, autant que politique et sociale, qui cristallise la relation théâtrale, entre une scène et une salle, voire au-delà...
Légende photo : "The show must go on II" (2004) de Jérôme Bel• Crédits : Liesbeth Bernaerts

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 8:44 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 16.03.2018
Entre réel et fiction, Christiane Jatahy s’inspire d’Homère pour son premier spectacle à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Est-ce déjà le spectacle ? Est-ce encore – et toujours – la vie ? Quand on entre dans la salle de répétition des Ateliers Berthier, à Paris, en ce jour froid de février, on est saisie par le trouble. Comme souvent dans les répétitions de théâtre, mais plus encore dans celles-ci, les frontières entre le réel et la fiction se brouillent. Les fauteuils en cuir râpé posés sur le plateau font-ils partie du décor ? Les comédiennes sont-elles en costume, ou leurs longues robes sont-elles juste celles que peuvent porter des actrices aux goûts bohèmes ? Et la chanson d’India Song chantée par Jeanne Moreau, qui passe en sourdine, fait-elle partie du spectacle ?
Christiane Jatahy sourit. Tout son travail repose justement sur cette frontière mouvante, poreuse, entre réel et fiction. La metteuse en scène brésilienne, qui s’est fait connaître ces dernières années avec une série de spectacles fracassants – qu’il s’agisse de Julia, d’après Strindberg, de What if They Went to Moscow ?, d’après Tchekhov, ou de La Règle du jeu, d’après Renoir, à la Comédie-Française –, est aujourd’hui artiste associée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe.
Pour son premier spectacle dans la prestigieuse maison, elle crée Ithaque, premier volet d’un diptyque inspiré de L’Odyssée, d’Homère. « C’est vraiment une inspiration, plus qu’une adaptation, précise-t-elle. Une traversée de L’Odyssée pour, à travers elle, rencontrer le monde d’aujourd’hui. L’Odyssée serait comme une barque avec laquelle je peux faire ce voyage pour parler de ce temps dans lequel nous vivons, de l’immigration, des réfugiés, des relations entre les hommes et les femmes – de ce monde en mouvement qui est déjà très présent dans mes précédents spectacles. »
Les répétitions ont elles-mêmes été une odyssée pour cette création jouée en portugais et en français, qui réunit les trois actrices fétiches de Christiane Jatahy, les Brésiliennes Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira, le comédien suisse Karim Bel Kacem, le Belge Cédric Eeckhout, et le Français Matthieu Sampeur. Ces trois derniers ont découvert la méthode de travail bien particulière de la metteuse en scène, qui nécessite un temps de création inhabituellement long.
Entretiens avec des migrants
« Nous avons commencé, en octobre 2017, par de nombreuses improvisations, racontent-ils. Mais Christiane [que tous appellent « Chris »] travaille avec une structure dramaturgique très forte, une sorte de scénario avec des éléments précis, mais qu’elle vient nourrir, de jour en jour, avec ce qu’elle voit en répétition : comme un squelette extrêmement solide, auquel nous sommes là pour donner de la chair. »
Cette « dramaturgie », comme elle l’appelle, Christiane Jatahy l’a écrite non seulement à partir de L’Odyssée, qu’elle a lue au plus près, mais aussi d’Ulysse, de James Joyce, et d’entretiens approfondis qu’elle a menés, ces dernières années, avec des migrants venus de Syrie et d’Afghanistan. « Lors de ces entretiens, je les ai beaucoup interrogés sur les détails concrets de ces odyssées d’aujourd’hui, mais aussi sur la notion de maison : quelle est-elle, cette maison ? Celle que l’on quitte, ou celle où l’on espère arriver ? C’est aussi pour cela que le spectacle s’appelle Ithaque. Dans ce premier volet, le matériel documentaire vient nourrir la fiction. Dans le deuxième, que nous créerons la saison prochaine, ce sera l’inverse : la fiction viendra en appui du documentaire, qui sera au premier plan. »
L’ESPACE, BIFRONTAL, OÙ LES SPECTATEURS POURRONT SE TROUVER D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE, EST LÀ DEPUIS LE DÉPART
Les comédiens vont et viennent, d’un côté à l’autre du plateau, entrent dans une scène, en sortent, plaisantent, jouent et rejouent. Le décor n’est pas encore complètement installé, mais l’espace, bifrontal, où les spectateurs pourront se trouver d’un côté ou de l’autre, est là depuis le départ, conçu avec les deux fidèles collaborateurs à la scénographie de Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani et Thomas Walgrave. Un côté Ulysse, un côté Pénélope. Même si tout est plus compliqué, bien sûr.
« Avec Christiane, il y a un jeu, un aller-retour permanent entre l’acteur et son personnage, observent Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira. Chez elle, c’est la vie qui est fondamentale. Elle a un regard infaillible pour voir qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter, les relations que nous tissons. La dramaturgie est constituée de ce qu’elle écrit sur le papier, mais il existe aussi une autre écriture, invisible, qui s’invente entre nous. »
Rapport entre théâtre et cinéma
Trois semaines plus tard, l’équipe a migré dans la grande salle de Berthier. L’ambiance est moins légère. « Hier, on a fait les premiers essais avec l’eau qui doit peu à peu envahir le plateau à la fin de la représentation, expliquent les deux régisseurs vidéo, Erwan Huon et Stéphane Trani. Les comédiens étaient transis et, en plus, on est très inquiets pour les deux caméras, qui ont elles aussi les pieds dans l’eau. »
Avec la structure dramaturgique, la conception de l’espace et le jeu d’acteur, le rapport entre théâtre et cinéma est le quatrième pilier du théâtre de Christiane Jatahy, qui, à chaque spectacle, invente de manière totalement organique une nouvelle relation entre le live et les images. Dans Ithaque, ce sont les comédiens eux-mêmes qui vont manipuler les caméras, en se filmant tout en étant dans l’action : un défi.
CHRISTIANE JATAHY, METTEUSE EN SCÈNE : « C’EST PAR LA CAMÉRA QUE LA GUERRE VA ENTRER DANS LE SPECTACLE »
« Il est impossible de montrer la guerre au théâtre, observe Christiane Jatahy. On ne peut parler que de la mémoire de la guerre, de la peur qu’on en a pour le futur, et de ce qu’elle peut produire entre un individu et un autre. C’est par la caméra que la guerre va entrer dans le spectacle : elle est manipulée comme une arme, un instrument de domination et de pouvoir. Mais c’est par elle aussi que va intervenir ce merveilleux univers imaginaire de L’Odyssée : dans le spectacle, il n’y a pas de cyclope ni de sirènes, on ne verra ni Athéna ni Télémaque, qui arrivera dans la seconde partie du diptyque. Cette poésie est prise en charge par les images, et par la manière dont elles sont projetées. »
Sur le plateau, la metteuse en scène travaille en lien étroit et constant avec Paulo Camacho, son jeune directeur de la photographie, son alter ego : ces deux-là n’ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Comme tout sera filmé et monté en direct chaque soir, Paulo et les comédiens enregistrent chaque geste, marquent sur le plancher de bois chaque placement, à l’aide de rubans adhésifs de couleur. « C’est cette précision dans la préparation qui doit permettre au spectacle d’être le plus libre et vivant possible chaque soir », indique la metteuse en scène.
Virtuosité des comédiens
Un tel dispositif implique une grande virtuosité chez les comédiens, mais ils n’ont pas l’air de s’en plaindre. Les trois femmes parlent le langage scénique de Christiane Jatahy couramment. Les trois hommes, qui le découvrent, s’en délectent. « On ne peut pas se réfugier derrière une quelconque fiction, parce que justement le travail de Christiane, c’est de la fiction qui fuit, tout le temps », analyse Matthieu Sampeur, qui a déjà travaillé, entre autres, avec Krystian Lupa et Thomas Ostermeier.
« C’est de la fiction qui est tout le temps rattrapée par le réel, ou du réel qui est rattrapé par la fiction, poursuit le jeune comédien. On ne peut à aucun moment se réfugier dans une théâtralité, même bien faite, d’un jeu qui serait “vrai” ou “quotidien”. Non, la seule raison d’être sur ce plateau, là, c’est d’être disponible au présent à tout ce qui se passe autour de nous. C’est passionnant, parce que cela veut dire qu’en tant que partenaires on va être dans la surprise permanente – si on y arrive… Et que le spectacle ne sera vraiment créé qu’en présence du public, qui est lui-même un véritable partenaire. »
Depuis les coulisses, Jeanne Moreau et Marguerite Duras se font à nouveau entendre. « Chanson,/De ma terre lointaine/Toi qui parleras d’elle/Maintenant disparue/Toi qui me parles d’elle/De son corps effacé/De ses nuits, de nos nuits »… Est-ce le spectacle ? Ou la vie ?
Ithaque – Notre Odyssée 1, un spectacle de Christiane Jatahy inspiré d’Homère. Odéon-Théâtre de l’Europe, aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suares, Paris 17e. Tél. : 01-44-85-40-40. Du 16 mars au 21 avril. De 8 € à 37 €. theatre-odeon.eu

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:59 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Hamlet était de passage à Vanves
Avec « Hamlet Unlimited », Yves-Noël Genod revient pour la quatrième fois à la pièce des pièces. Il met son exemplaire bilingue entre les mains d’un acteur qui nous sidère, Aïdan Amore. Et honore le festival Artdanthé à Vanves dont il est l’une des figures. La suite en novembre.
Sa nuque apparaît là-bas, au fond, à peine. La tête se tourne vers la gauche, lieu dit du passé immémorial. Au bout du bras, il tient un miroir. Non : un livre. C’est tout comme. Le livre des livres. La pièce des pièces. La bible du théâtre occidental. Hamlet se regarde. Hamlet lit Hamlet. La brume fait son boulot, elle assure le tempo.
Dans la traduction sublime d’Yves Bonnefoy (sublime, oui, sublime parce c’est celle qui nous a fait entrer dans Shakespeare il y a longtemps par une porte dérobée) et, le plus souvent, dans la musicalité à la fois douce, roucoulée et heurtée, comme accidentée et venteuse du texte anglais, l’acteur Aidan Amore, que l’on découvre et qui nous sidère, lâche les mots comme des brassées d’oiseaux traversant la nuit à l’heure des migrations. Son visage pâle et grimé de blanc m’a fait penser à celui de Bob Wilson interprétant La Dernière Bande. Hamlet, c’est cela : une dernière bande.
Le livre qu’il tient est épais, gavé de lignes surlignées, de pages collées, tel un vieux bréviaire hérité d’une grand-mère anglo-normande. Il le feuillette comme on feuillette Les Fleurs du mal. Il est Hamlet, il est Gertrude, Horatio, Ophélie et les autres ; le livre est aussi bien le crâne du vieux Yorrick. Il tutoie les fantômes, les cadavres. Le théâtre est une école de cadavres.
La pièce des pièces est ici comme un verre brisé dont l’acteur ramasse un à un les morceaux. Certains morceaux, plus coupants que d’autres, trouvent le chemin du sang et des larmes. Cet Hamlet (chacun le sien) est comme en deuil de lui-même, sa folie est un masque, sa dernière parade, une pirouette.
Tous les spectacles d’Yves-Noël Genod célèbrent le crépuscule du théâtre. Tous les spectacles d’Yves-Noël Genod ont pour exergue ces premiers mot que dit la reine à son fils : « Mon cher Hamlet, défais-toi de cette couleur nocturne. »
But the show must go on. Alors, place aux facéties. Le fossoyeur (Aurélien Batondor) est un clone burlesque, un garde du corps élastique du « cher Hamlet ». Rozencrantz et Guildenstern (Ricardo Paz et Stefan Kinsman) sont des danseurs musclés qui sautent par-dessus un rectangle de tables blanches – qu’on aura tôt fait de recouvrir de noir – formant comme le chemin de ronde d’une forteresse mais aussi, dans sa froideur, ce dispositif évoque des tables de négociations où en haut lieu on décide des guerres et des paix. Hamlet s’en affranchit. Il est ailleurs.
C’est la quatrième fois qu’Yves-Noël Genod traîne du côté d’Elseneur. Il y reviendra encore et encore. Comme un voleur, un rôdeur.
Avant que tout ne commence, dans une robe noire de veuve éplorée, de diva en jet lag ou de pleureuse grecque égarée au Théâtre de Vanves, en hommage et en préambule à ce que va faire Aidan Amore et qui touche à la grâce d’un onagata (ces acteurs japonais qui jouent les rôles de femmes dans le théâtre traditionnel), Yves-Noël Genod nous a dit que cela durerait autour de deux heures et demi, que la langue anglaise de l’auteur serait très présente, qu’il n’y aurait rien à comprendre, mais tout à entendre, « entendre à travers les mots quelque chose qui n’est pas audible ». Il nous a dit aussi que le spectacle devrait se poursuivre en novembre prochain à l’Arsenic de Lausanne, qu’il durera alors « quatre heures, peut-être cinq ». Le festival Artdanthé est son jardin. Il se devait de s’y promener. En compagnie d’Hamlet. Qui d’autre ?
Hamlet Unlimited, d’après Shakespeare, ne se donne plus mais le festival Artdanthé au Théâtre de Vanves continue.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:20 PM
|
Sur le site de l'émission de Laurent Goumarre "Le Nouveau rendez-vous" sur France Inter 14 mars 2018:
Après Lucrèce Borgia, Béatrice Dalle et David Bobée se retrouvent au théâtre pour la pièce Warm, au CDN de Normandie-Rouen. Ils nous parlent aussi de leurs projets personnels, Uccello, Uccellacci & The Birds pour elle, la tournée de Peer Gynt pour lui. Et en live dans l'instant V de Valli, la pop folk de Thousand !
Ecouter l'émission : https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-14-mars-2018
David Bobée a offert son premier rôle au théâtre à Béatrice Dalle en 2014. Elle incarnait Lucrèce Borgia, magnifique en mère incestueuse et empoisonneuse. Aujourd'hui les deux artistes se retrouvent pour la nouvelle pièce de David Bobée, Warm, pour laquelle Béatrice Dalle prête sa voix. Elle accompagne deux acrobates et fait résonner un poème de Ronan Chéneau, dans une atmosphère où la température augmente au fil des mots. Cette pièce a lieu dans le cadre du festival Spring, festival des nouvelles formes de cirque au Cendre Dramatique National de Normandie-Rouen (David Bobée en est le directeur).
Béatrice Balle est également interprète voix pour la pièce Uccello, Uccellacci & The Birds de Jean-Luc Verna, au centre Pompidou. Dans cette orgie chorégraphique, elle s'adresse à un répondeur pour raconter les souvenirs d'une histoire d'amour. Et on retrouvera bientôt l'actrice à la télévision pour les séries A l'intérieur et Dix pour cent.
Le Mix de nos réalisatrices Juliette Médevielle et Elsa Béranger :
ÉCOUTER
David Bobée nous parlera aussi de l'épopée de l'anti-héros Peer Gynt, son spectacle qui part en tournée ; et sa pièce Stabat Mater, toujours dans le cadre du festival Spring.
Légende photo Béatrice Dalle en 2015 au Royal Monceau à Paris © Maxppp / ARNAUD DUMONTIER

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:11 PM
|
Publié dans Actu Toulouse
Des machines monumentales en plein Toulouse : en novembre 2018, la compagnie La machine proposera un spectacle dans la Ville rose une semaine avant de s'installer à Montaudran.
Publié le 13 Mar 18 à 8:31
Quatre jours de spectacle pour fêter (enfin) l’arrivée de la compagnie La Machine à Toulouse. Quelques jours avant l’inauguration de la Halle de la Machine à Montaudran, les machines monumentales de la compagnie se produiront dans la Ville rose du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2018.
Un spectacle pendant lequel on verra le très attendu Minotaure : la machine de 47 tonnes sera au cœur de cette création qui porte pour titre Le gardien du temple.
Un avant-goût sur les réseaux sociaux
Pour mettre l’eau à la bouche du public, la compagnie a dévoilé un (petit) avant-goût de ce que sera le spectacle sur les réseaux sociaux, le lundi 12 mars 2018:
https://www.facebook.com/lamachine.fr/videos/10155590220517637/
Contenu mystérieux
À la tête de la compagnie, François Delarozière explique :
Ce sera en plein cœur de Toulouse, dans les rues historiques et les sites emblématiques : le centre ville ressemble étrangement à un labyrinthe…
Le directeur de la compagnie veut préserver le mystère quant au contenu de la création qui prendra place dans les rues de Toulouse : on sait seulement que Thésée et Ariane devraient être présents et que le spectacle s’achèvera par un grand final.
LIRE AUSSI : François Delarozière : « Avec nos machines à Montaudran, nous voulons un projet qui sera unique au monde »
Inauguration de la Halle les 9, 10 et 11 novembre
À l’issue de ces quatre jours, le Minotaure rejoindra la Halle de la Machine, à Montaudran. L’espace destiné à accueillir les machines de la compagnie de François Delarozière sera en effet inauguré une semaine plus tard, les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018. Le directeur de la compagnie précise :
Ce sera une écurie de machines, à la fois lieu d’exposition et laboratoire : c’est là que les machines seront préparées pour aller jouer dans le monde entier. On n’y fabriquera pas des machines, mais ce sera un lieu de fabrique d’imaginaire…
LIRE AUSSI : À Montaudran, la grande Halle de la Machine est achevée https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/a-montaudran-la-grande-halle-de-la-machine-est-achevee_3556422.html
220 000 visiteurs attendus en 2019
Le lieu sera ouvert au public 278 jours par an. À l’extérieur, le Minotaure et une araignée géante seront visibles gratuitement. Plus de 200 pièces pourront être exposées à l’intérieur, avec une collection en perpétuel mouvement.
Côté tarifs, il faudra compter entre 4,50 et 9 euros l’entrée. 220 000 visiteurs sont attendus à la Halle de la Machine en 2019.
La Piste des géants inaugurée en décembre
Pour rappel, cette Halle de la Machine fera partie d’un nouveau site culturel toulousain : la Piste des géants. Sur le site, on découvrira aussi un espace Mémoire dédié aux premiers temps de l’aéronautique, l’ensemble étant complété par les Jardins de la ligne ouverts en 2017. La Piste des géants dans son ensemble sera inaugurée le mardi 25 décembre 2018, pour les 100 ans du premier vol aéropostal Toulosue-Barcelone imaginé par Latécoère.
Combien ça coûte?
La Halle de la machine est un projet à 14 millions d’euros ; l’aménagement intérieur (qui commence à se mettre en place) doit coûter 1,08 millions d’euros (Toulouse Métropole participe à hauteur de 950 000 euros).
Le Minotaure coûte 2,5 millions d’euros ; les quatre jours de spectacle au cœur de Toulouse ont un coût légèrement supérieur à 2 millions d’euros.
Chaque année, Toulouse Métropole déboursera 577 000 euros pour faire vivre les lieux.
Des investissements justifiés pour jean-Luc Moudenc. « La culture est un facteur d’attractivité économique », estime le président de la Métropole. « J’aimerai qu’on travaille sur un parcours touristique entre la Piste des géants, Aéroscopia et la Cité de l’espace. Il y a un parcours à inventer, vendre et promouvoir ».
Selon une étude menée aux Machines de l’île, à Nantes (Loire-Atlantique), autre lieu touristique où sont visibles les machines de François Delarozière, chaque visiteur dépense 35 euros dans la ville, en plus de sa visite sur le site.
Légende photo : Les machines de François Delarozière se produiront dans le cœur de Toulouse. (©Jordi Bover)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 8:15 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 16.03.2018
Entre réel et fiction, Christiane Jatahy s’inspire d’Homère pour son premier spectacle à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Est-ce déjà le spectacle ? Est-ce encore – et toujours – la vie ? Quand on entre dans la salle de répétition des Ateliers Berthier, à Paris, en ce jour froid de février, on est saisie par le trouble. Comme souvent dans les répétitions de théâtre, mais plus encore dans celles-ci, les frontières entre le réel et la fiction se brouillent. Les fauteuils en cuir râpé posés sur le plateau font-ils partie du décor ? Les comédiennes sont-elles en costume, ou leurs longues robes sont-elles juste celles que peuvent porter des actrices aux goûts bohèmes ? Et la chanson d’India Song chantée par Jeanne Moreau, qui passe en sourdine, fait-elle partie du spectacle ?
Christiane Jatahy sourit. Tout son travail repose justement sur cette frontière mouvante, poreuse, entre réel et fiction. La metteuse en scène brésilienne, qui s’est fait connaître ces dernières années avec une série de spectacles fracassants – qu’il s’agisse de Julia, d’après Strindberg, de What if They Went to Moscow ?, d’après Tchekhov, ou de La Règle du jeu, d’après Renoir, à la Comédie-Française –, est aujourd’hui artiste associée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe.
Pour son premier spectacle dans la prestigieuse maison, elle crée Ithaque, premier volet d’un diptyque inspiré de L’Odyssée, d’Homère. « C’est vraiment une inspiration, plus qu’une adaptation, précise-t-elle. Une traversée de L’Odyssée pour, à travers elle, rencontrer le monde d’aujourd’hui. L’Odyssée serait comme une barque avec laquelle je peux faire ce voyage pour parler de ce temps dans lequel nous vivons, de l’immigration, des réfugiés, des relations entre les hommes et les femmes – de ce monde en mouvement qui est déjà très présent dans mes précédents spectacles. »
Les répétitions ont elles-mêmes été une odyssée pour cette création jouée en portugais et en français, qui réunit les trois actrices fétiches de Christiane Jatahy, les Brésiliennes Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira, le comédien suisse Karim Bel Kacem, le Belge Cédric Eeckhout, et le Français Matthieu Sampeur. Ces trois derniers ont découvert la méthode de travail bien particulière de la metteuse en scène, qui nécessite un temps de création inhabituellement long.
Entretiens avec des migrants
« Nous avons commencé, en octobre 2017, par de nombreuses improvisations, racontent-ils. Mais Christiane [que tous appellent « Chris »] travaille avec une structure dramaturgique très forte, une sorte de scénario avec des éléments précis, mais qu’elle vient nourrir, de jour en jour, avec ce qu’elle voit en répétition : comme un squelette extrêmement solide, auquel nous sommes là pour donner de la chair. »
Cette « dramaturgie », comme elle l’appelle, Christiane Jatahy l’a écrite non seulement à partir de L’Odyssée, qu’elle a lue au plus près, mais aussi d’Ulysse, de James Joyce, et d’entretiens approfondis qu’elle a menés, ces dernières années, avec des migrants venus de Syrie et d’Afghanistan. « Lors de ces entretiens, je les ai beaucoup interrogés sur les détails concrets de ces odyssées d’aujourd’hui, mais aussi sur la notion de maison : quelle est-elle, cette maison ? Celle que l’on quitte, ou celle où l’on espère arriver ? C’est aussi pour cela que le spectacle s’appelle Ithaque. Dans ce premier volet, le matériel documentaire vient nourrir la fiction. Dans le deuxième, que nous créerons la saison prochaine, ce sera l’inverse : la fiction viendra en appui du documentaire, qui sera au premier plan. »
L’ESPACE, BIFRONTAL, OÙ LES SPECTATEURS POURRONT SE TROUVER D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE, EST LÀ DEPUIS LE DÉPART
Les comédiens vont et viennent, d’un côté à l’autre du plateau, entrent dans une scène, en sortent, plaisantent, jouent et rejouent. Le décor n’est pas encore complètement installé, mais l’espace, bifrontal, où les spectateurs pourront se trouver d’un côté ou de l’autre, est là depuis le départ, conçu avec les deux fidèles collaborateurs à la scénographie de Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani et Thomas Walgrave. Un côté Ulysse, un côté Pénélope. Même si tout est plus compliqué, bien sûr.
« Avec Christiane, il y a un jeu, un aller-retour permanent entre l’acteur et son personnage, observent Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira. Chez elle, c’est la vie qui est fondamentale. Elle a un regard infaillible pour voir qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter, les relations que nous tissons. La dramaturgie est constituée de ce qu’elle écrit sur le papier, mais il existe aussi une autre écriture, invisible, qui s’invente entre nous. »
Rapport entre théâtre et cinéma
Trois semaines plus tard, l’équipe a migré dans la grande salle de Berthier. L’ambiance est moins légère. « Hier, on a fait les premiers essais avec l’eau qui doit peu à peu envahir le plateau à la fin de la représentation, expliquent les deux régisseurs vidéo, Erwan Huon et Stéphane Trani. Les comédiens étaient transis et, en plus, on est très inquiets pour les deux caméras, qui ont elles aussi les pieds dans l’eau. »
Avec la structure dramaturgique, la conception de l’espace et le jeu d’acteur, le rapport entre théâtre et cinéma est le quatrième pilier du théâtre de Christiane Jatahy, qui, à chaque spectacle, invente de manière totalement organique une nouvelle relation entre le live et les images. Dans Ithaque, ce sont les comédiens eux-mêmes qui vont manipuler les caméras, en se filmant tout en étant dans l’action : un défi.
CHRISTIANE JATAHY, METTEUSE EN SCÈNE : « C’EST PAR LA CAMÉRA QUE LA GUERRE VA ENTRER DANS LE SPECTACLE »
« Il est impossible de montrer la guerre au théâtre, observe Christiane Jatahy. On ne peut parler que de la mémoire de la guerre, de la peur qu’on en a pour le futur, et de ce qu’elle peut produire entre un individu et un autre. C’est par la caméra que la guerre va entrer dans le spectacle : elle est manipulée comme une arme, un instrument de domination et de pouvoir. Mais c’est par elle aussi que va intervenir ce merveilleux univers imaginaire de L’Odyssée : dans le spectacle, il n’y a pas de cyclope ni de sirènes, on ne verra ni Athéna ni Télémaque, qui arrivera dans la seconde partie du diptyque. Cette poésie est prise en charge par les images, et par la manière dont elles sont projetées. »
Sur le plateau, la metteuse en scène travaille en lien étroit et constant avec Paulo Camacho, son jeune directeur de la photographie, son alter ego : ces deux-là n’ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Comme tout sera filmé et monté en direct chaque soir, Paulo et les comédiens enregistrent chaque geste, marquent sur le plancher de bois chaque placement, à l’aide de rubans adhésifs de couleur. « C’est cette précision dans la préparation qui doit permettre au spectacle d’être le plus libre et vivant possible chaque soir », indique la metteuse en scène.
Virtuosité des comédiens
Un tel dispositif implique une grande virtuosité chez les comédiens, mais ils n’ont pas l’air de s’en plaindre. Les trois femmes parlent le langage scénique de Christiane Jatahy couramment. Les trois hommes, qui le découvrent, s’en délectent. « On ne peut pas se réfugier derrière une quelconque fiction, parce que justement le travail de Christiane, c’est de la fiction qui fuit, tout le temps », analyse Matthieu Sampeur, qui a déjà travaillé, entre autres, avec Krystian Lupa et Thomas Ostermeier.
« C’est de la fiction qui est tout le temps rattrapée par le réel, ou du réel qui est rattrapé par la fiction, poursuit le jeune comédien. On ne peut à aucun moment se réfugier dans une théâtralité, même bien faite, d’un jeu qui serait “vrai” ou “quotidien”. Non, la seule raison d’être sur ce plateau, là, c’est d’être disponible au présent à tout ce qui se passe autour de nous. C’est passionnant, parce que cela veut dire qu’en tant que partenaires on va être dans la surprise permanente – si on y arrive… Et que le spectacle ne sera vraiment créé qu’en présence du public, qui est lui-même un véritable partenaire. »
Depuis les coulisses, Jeanne Moreau et Marguerite Duras se font à nouveau entendre. « Chanson,/De ma terre lointaine/Toi qui parleras d’elle/Maintenant disparue/Toi qui me parles d’elle/De son corps effacé/De ses nuits, de nos nuits »… Est-ce le spectacle ? Ou la vie ?
Ithaque – Notre Odyssée 1, un spectacle de Christiane Jatahy inspiré d’Homère. Odéon-Théâtre de l’Europe, aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suares, Paris 17e. Tél. : 01-44-85-40-40. Du 16 mars au 21 avril. De 8 € à 37 €. theatre-odeon.eu

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:56 AM
|
Parution Livre
Entretien avec Lew Bogdan par Agnès Santi dans La Terrasse
Publié le 20 février 2018 - N° 263
Homme de théâtre accompli qui dirigea des structures et festivals emblématiques en France et en Allemagne, très actif dans le domaine de l’enseignement de l’art de l’acteur, Lew Bogdan publie une saga captivante et remarquablement documentée, un roman-récit éclairant à la fois l’histoire du théâtre et celle d’un siècle tragique. D’Odessa à Broadway et Hollywood, de Constantin Stanislavski à Stella Adler, le voyage nous embarque dans une aventure palpitante tissée de multiples filiations. A lire absolument !
Qu’est-ce qui a motivé votre désir d’écrire une telle saga ?
Lew Bogdan : J’ai voulu remonter les fils d’une histoire foisonnante qui traverse le XXe siècle et plusieurs continents. Une histoire qui tisse de fascinantes filiations, et éclaire l’importance fondatrice du Théâtre d’Art russe. Je me souviens qu’à la fin des années 1970, j’avais réussi à faire venir Lee Strasberg et plusieurs de ses collaborateurs en Allemagne, lorsque je dirigeais le Théâtre de Bochum. Ce fut un événement national qui attira des centaines de comédiens. C’est Strasberg lui-même qui m’a dit que si je voulais comprendre son enseignement, je devais m’intéresser à Stanivlaski. Comme le remarquait Bernard Dort, Stanislavski a été en effet enterré sous son mythe. J’ai donc suivi le conseil de Strasberg. Puis, en 1988, j’ai co-dirigé au Centre Georges Pompidou un symposium international, Le siècle Stanislavski, qui a donné lieu à diverses publications, dont Stanislavski. Roman théâtral du siècle (Editions L’Entre-Temps), que j’ai publié l’année suivante, et à un film produit pour ARTE. Et j’ai organisé pendant une dizaine d’années au sein de l’Institut Européen de l’Acteur, que j’ai fondé, des séminaires avec de grands maîtres russes et américains, auxquels participaient des comédiens de toute l’Europe. C’est un ami qui m’a suggéré de raconter l’ensemble de l’histoire : la saga russe et la saga américaine. Ce fut l’étincelle qui me mit au travail…
« Le théâtre est un sismographe relié au temps présent. »
Comment avez-vous procédé ?
LB. : J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce livre, qui fait suite à quatre ans de préparation. J’ai conçu une perspective chronologique et réalisé un vaste collage qui rend compte de l’ensemble du puzzle et raconte une multiplicité d’histoires. Au fil du temps, j’ai accumulé une documentation très importante, 95% de ce qui est mentionné dans le roman est vrai. Le personnage de Fenia Koralnik traverse toute la saga. Fillette, elle se trouva mêlée à l’émigration de la secte des Doukhobors au Canada en 1899, financée par Lev Tolstoï et organisée par Léopold Soulerjitski, puis fit partie du Premier Studio fondé par Stanislavski et Dantchenko, à la recherche de formes théâtrales nouvelles et d’un acteur nouveau.
Quelle a été votre ambition en écrivant cette épopée ?
LB. : J’ai voulu montrer à quel point la vie des acteurs et la vie du théâtre sont en osmose avec leur environnement. Le théâtre est un sismographe relié au temps présent. Il n’y a pas de génération spontanée au théâtre. On ne peut pas comprendre le théâtre russe si on ne connaît pas la tourmente de son histoire – la Révolution de 1905, celle d’Octobre, le léninisme, le stalinisme, les guerres… -, ni le théâtre musical de Broadway si on ne connaît pas l’histoire du théâtre yiddish, dont une figure, Jacob Adler, le Grand Aigle du théâtre yiddish, émigra aux Etats-Unis pour fuir les pogroms. De nombreux artistes et pédagogues russes poursuivirent et firent évoluer en Amérique leur art et leur enseignement dédiés à l’acteur. Ce que j’ai voulu montrer aussi, c’est que les recherches esthétiques sont toujours complexes, nées de révoltes contre le monde ancien et aussi d’une reconstruction de ferments du passé, d’une synthèse de divers éléments qu’il est vraiment passionnant de décrypter.
Propos recueillis par Agnès Santi
Fénia ou l’Acteur Errant dans un siècle égaré (M.E.O. Editions, février 2018)
Fénia ou l’acteur Errant dans un siècle égaré (M.E.O. Editions, février 2018)
http://www.meo-edition.eu/fenia.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2018 7:53 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog Hottello
Périclès, Prince de Tyr, de William Shakespeare, mise en scène de Declan Donnellan
Avec les pièces Cymbeline, Le Conte d’hiver, La Tempête, la tragi-comédie écrite vers 1608, Périclès, Prince de Tyr appartient au cycle final de William Shakespeare qui se plaît à mettre en scène de merveilleuses retrouvailles entre parents et enfants.
Le dramaturge ne fait pas allusion à Périclès, homme d’Etat athénien du V ème siècle, même si ses sources sont issues de chroniques historiques et de poésies.
La romance, tissée de mélodrame et de merveilleux, évoque les péripéties de Périclès, prince de Tyr, qui, héros épique, antique et presque homérique, voyage une décennie en Méditerranée, l’occasion d’en découdre avec les épreuves de la vie.
Rappel des événements et accidents improbables et incroyables des séries B d’aujourd’hui, des aventures extraordinaires et imprévisibles font du protagoniste une proie idéale. Périclès épouse la fille du tyran Antioche s’il résout l’énigme imposée, un mystère que le Prince de Tyr éclaircit d’emblée : le père couche avec sa fille.
Périclès se sent aussitôt menacé de mort et s’enfuit : l’errance marine ne saurait tarder avec son lot de rencontres, de catastrophes et de naufrages, un mariage malheureux puisque survient, en pleine tempête, la mort en couches d’une épouse aimée qui lui donne pourtant une fille, Marina. Puis, cette enfant confiée à des amis sera dérobée par des pirates qui voudront en faire une femme de mauvaise vie.
En dépit de tout, Marina, vertueuse et fille honnête, retrouve son père qui, porteur inespéré de moins de chagrins, entrevoit la fin de ses malheurs quand il retrouve son épouse – passée pour défunte, elle n’était qu’endormie dans son cercueil récupéré en mer par des pécheurs – ; à Ephèse, la ressuscitée est devenue vestale.
Son foyer retrouvé, Périclès peut enfin régner à Tyr ; Marina épouse un ancien habitué de la maison close où on la retenait, converti à l’amour plutôt qu’à la luxure.
Comment créer ce qui est inénarrable et invraisemblable, peu crédible et loufoque ?
Le metteur en scène aguerri Declan Donnellan voit en Périclès – figure d’errance – un être en « burn out » dont la dépression et le mal-être sont durablement installés.
Conditions de nos temps actuels particulièrement difficiles quand l’individu ne sait plus où donner de la tête et préfère s’exclure lui-même de toute communauté, préférant une solitude à la fois paisible et tendue plutôt que d’affronter la réalité.
Il gît sur un lit d’hôpital où médecin, infirmiers, amis et famille viennent le visiter. Les aides-soignants peuvent se transformer, à l’occasion, en mercenaires et prétendants, et l’acteur qui joue le rôle du tyran Antioche est plus tard un amoureux sincère.
Les acteurs se métamorphosent à vue avec et brio et fracas– personnages sages et raisonnables dans telle scène, dangereux ensuite, cruels et fous dans telle autre.
Alors que les visiteurs et soignants s’attardent autour de celui qui est maintenu dans un coma – choisi ou artificiel -, la radio diffuse ses informations concernant la réalité des migrants d’aujourd’hui, venant de Libye et passant par l’Italie et Lampedusa.
Commentaires, analyses, études, les spectateurs que nous sommes face à cette catastrophe humanitaire de grande ampleur témoignent aussi d’une posture vaine – incapacité à infléchir les événements de sorte que tous recouvrent toit et dignité.
La scénographie de Nick Ormerod est éloquente : un espace hospitalier avec portes battantes, une installation exactement adaptable à l’intérieur d’un vaisseau – la métaphore venteuse du chaos du monde où les embarcations précaires se multiplient sur l’aire planétaire marine. Lumières vertes d’un mal de mer chronique.
Balancement de l’habitacle du bâtiment, tempêtes qui font se lever et s’abaisser la coque marine, malmenée par les vagues, apparitions de figures de mauvais garçons, la vie de Périclès est entrelacée de harcèlements sans relâche, quand il ne dort pas.
A moins qu’il ne traverse un théâtre intérieur de cauchemars et rêves qui s’incarnent.
Declan Donnellan fait de Périclès, Prince de Tyr une comédie dramatique contemporaine – effets de réel avec la situation des migrants d’aujourd’hui qui n’en rappellent pas moins les migrations qu’ont connues les hommes de tous les temps.
Histoires de mensonges et de trahisons, de situations triviales et inavouables familières à l’histoire de l’humanité, en même temps qu’histoire d’un idéal existentiel à préserver, à travers le sentiment de l’amour, via aussi les liens fondateurs de toute famille, spontanément créée ou bien recomposée patiemment au cours du temps.
Humour, ironie et parodie, les scènes n’en restent pas moins efficaces et justes, grâce encore à d’excellents comédiens, Christophe Grégoire, Camille Cayol, Xavier Boiffier, Cécile Leterme, Valentine Catzéflis, Guillaume Pottier et Martin Nikonoff.
Véronique Hotte
Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux, du 7 au 25 mars 2018. Tél : 01 46 61 36 67. Maison des Arts de Créteil, du 28 au 30 mars. Théâtre de l’Archipel à Perpignan, les 3 et 4 mai. Théâtre du Nord à Lille, du 15 au 19 mai.
Crédit photo : Patrick Baldwin
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 19, 2018 6:22 PM
|
Par Thomas Ngo-Hong Roche dans son blog Hier au théâtre :
Christiane Jatahy semble raffoler des fêtes désabusées. Après La Règle du jeu alcoolisée de Renoir au Français, elle remet le couvert à l’Odéon cette fois-ci. En tentant de combler les zones d’ombre de L’Odyssée, la metteur en scène brésilienne s’éloigne de l’épique homérique. Ce qui la captive, c’est le domos, la maison, la vie hors des exploits guerriers. Sur le papier, l’idée est séduisante. Sur scène, l’écriture de plateau montre très rapidement ses limites.
Que retient-on de Pénélope ? Sa fidélité à toute épreuve, son art du tissage, sa volonté de fer. C’est la grande oubliée de L’Odyssée, qui célèbre la bravoure rusée d’Ulysse. Jatahy, tout à son honneur, recentre la femme au coeur du propos. Comment survivre face à cinquante porcs qui essayent de vous assaillir de toute part ? Comment maintenir la flamme d’un amour qui s’étiole ? Comment ne pas céder à la tentation d’une caresse malgré le dégoût de l’adultère ?
L’originalité de Jatahy est de se positionner franchement face à ces non-dits : Pénélope n’est pas parfaite non, ni irréprochable. Elle est humaine. Parfois enjouée, prête à danser avec ses prétendants, parfois révoltée, parfois abattue. Insaisissable. Les hommes, eux, n’ont pas fière allure. Ces clowns pitoyables sont loin d’inspirer de l’effroi. Eux aussi semblent vouloir en finir.
Cette envie de désacraliser un texte fondateur de notre culture occidentale, loin de constituer un geste provocateur, tend plutôt la main à une humanité en perte de repères face à l’attente du retour d’une ombre. Pas d’apparat ici, bien au contraire : le festin se limite à de l’eau et des chips.
Comment survivre face à l’ennui ? En se divertissant, au sens pascalien du terme. Pour éviter de broyer du noir, autant faire la fête. Mais quelle fête ! Sinistre, glauque au possible.
Pour varir les plaisirs, Jatahy a conçu un dispositif bi-frontal qui brouille les perceptions. Tandis qu’une partie du public assiste au dialogue entre plusieurs Pénélope (trois qui se relaient) et des prétendants, l’autre moitié se centre sur Ulysse et Pénélope. On oublie d’ailleurs très rapidement qui est qui et cette porosité identitaire tend à constater qu’on ne sait plus qui est la victime ou le bourreau, qui désire et qui résiste…
Le trio féminin tient la barre dans ce naufrage de l’amour : Stella Rabello, Isabel Teixera et Julia Bernat jouent avec intensité et presque nonchalence la mascarade du désir. Les trois garçons semblent phagocités par la présence de cette sororité.
À vau-l’eau
Lorsqu’on prend Homère comme point de départ, la forte attente du spectateur est légitime. Ici, la matériau antique sert de prétexte à une écriture de plateau qui ne casse vraiment pas des briques. La beauté de la langue homérique se confronte à la pauvreté des dialogues, ce qui fait qu’on écoute tout cela d’une oreille très distraite. Reste la majestuosité d’une scénographie qui en met plein la vue. C’est au moment de la réunion des deux groupes que la magie opère : tout part à vau-l’eau, les couples se délitent malgré un rapprochement qui s’avère vain. Du coup, l’élément liquide envahit le plateau et stagne. Les corps pataugent maladroitement, une langueur insupportable envahit le plateau. Des vidéos admirablement bien filmées alternent les prises de vue, les parties du corps, les visages à vif. Exténués et trempés, nos héros abandonnent la bataille.
C’est cet émouvant lâcher-prise qu’on retiendra de cet Ithaque. ♥ ♥ ♥
ITHAQUE de Christiane Jatahy, d’après L’Odyssée d’Homère. M.E.S de l’auteur. Théâtre de l’Odéon. 01 44 85 40 40. 2h.
Photo © Elizabeth Carecchio

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 19, 2018 4:47 PM
|
Par RFI Publié le 19-03-2018
Pour la cinquième année consécutive, les auteurs du monde francophone peuvent participer au Prix Théâtre RFI. Les auteurs ont cinq semaines pour envoyer leur texte puis le suspense durera cinq mois avant que le jury présidé cette année par Veronique Tadjo choisisse son lauréat !
Lire sur le site de RFI (avec liens actifs pour faire une candidature) http://www.rfi.fr/france/20180319-5e-edition-prix-theatre-rfi-appel-ecriture-decouvrir-nouveaux-auteurs?ref=fb
Cinq ans ! Si ce n’est pas encore un anniversaire rond, c’est un temps suffisant pour juger de la vitalité du théâtre francophone venu d’Afrique, des Caraïbes, de l’Océan Indien ou du Proche-Orient. En Guinée, au Cameroun, au Mali, une nouvelle génération d’auteurs apparaît … A Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Kigali, année après année, des festivals rencontrent un succès grandissant et s’imposent sur la scène internationale.
Participant de cette dynamique, nous organisons pour la cinquième année consécutive le « Prix Théâtre RFI » pour promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. A vos claviers, à vos histoires ! Vous avez jusqu’au 21 avril minuit pour nous envoyer votre texte.
Pour participer à ce Prix, les auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans, être originaires et installés dans un pays situé en Afrique, Océan indien, Caraïbes (hors Dom-Tom), Proche ou Moyen-Orient. Leurs textes doivent être originaux, inédits en France et rédigés en français. Comédie, tragédie, drame, monologue… Tout est possible, mais les écrits seront choisis en fonction de leur qualité dramaturgique, donc il ne peut s’agir de poème, de conte ou d’une scénette de quelques pages. Un minimum de 15 pages est exigé.
Pour participer :
♦ Envoi des textes jusqu’au 21 avril minuit à l’adresse suivante : prix.theatre@rfi.fr
♦ Remplir la fiche d’inscription
Le « Prix Théâtre RFI » sera remis le 30 septembre à Limoges dans le cadre du Festival Les Francophonies en Limousin. Le lauréat sera choisi par un jury de professionnels présidé cette année par l'auteure franco-ivoirienne Véronique Tadjo.
RFI et ses partenaires offriront ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, une dotation financière attribuée par la SACD ; l'organisation d'une résidence d’écriture en France, à la Maison des Auteurs de Limoges et/ou au Théâtre de l’Aquarium, financée par l'Institut français; ainsi qu’une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI.
En 2017, le « Prix Théâtre RFI » a récompensé « La poupée barbue » d’Edouard Elvis Bvouma, pièce éditée depuis chez Lansman. Ce jeune auteur camerounais a donc succédé au guinéen Hakim Bah, l’auteur de « Convulsions ». En 2015, c’était la première pièce de théâtre de l’auteure libanaise Hala Moughanie « Tais-toi et creuse ». Et en 2014, le congolais Julien Mabiala Bissila remportait la première édition avec « Chemin de fer ».
« La poupée barbue » d’Edouard Elvis Bvouma sera lue sous la direction d’Armel Roussel au Festival d’Avignon le 14 juillet 2017 dans le cadre du cycle de lectures RFI « Ça va, ça va le monde ! » et diffusée sur les antennes de RFI.
Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec l’Institut Français, le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, la SACD, le Festival des Francophonies en Limousin, le théâtre de l’Aquarium.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 8:29 PM
|
Entretien par Alexis Mullard dans le blog De cour à Jardin
À l’occasion de sa venue à Brest pour présenter le spectacle Une légère blessure, la comédienne Johanna Nizard s’est prêtée au jeu de l’entrevue. Une pâquerette en guise de broche, Johanna Nizard nous livre un peu d’elle, de son travail, et de son rapport au théâtre. Rencontre avec une femme et comédienne de caractère.
Qui êtes-vous Johanna Nizard ?
Je suis actrice depuis plus de vingt ans. Mes origines sont Niçoises, j’ai fait l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes) et puis la vie a commencé son chemin à mes vingt ans. Après l’ERAC, je suis partie à Paris où j’ai rencontré des gens et des auteurs différents. Et depuis plus de quinze ans je travaille avec des d’auteurs vivants.
C’est un choix ?
Non, ça s’est passé comme ça et je m’y retrouve. J’ai compris que les auteurs vivants me donnaient une totale imprégnation dans ce que c’est que de faire ce métier. C’est-à-dire travailler sur des textes ou des versions, travailler la langue, le phrasé, la musique. C’est précieux dans le parcours d’un acteur d’être à la rencontre des auteurs, comme Rémi de Vos, Laurent Mauvignier ou Nathalie Sarraute, que j’ai eu la chance de rencontrer à ses 98 ans. Elle a été un moment important dans ma vie. Ça a été une rencontre réelle avec le mouvement de la langue et ce qu’est le corps de la langue.
Avec ce texte, Une légère blessure, de Laurent Mauvignier, vous retrouvez cette langue particulière ?
En effet, je retrouve une terre commune entre Sarraute et Mauvignier. Notamment le passage qui est pour moi très révélateur de son écriture, lorsqu’elle attrape le regard des gens, et que dans ce regard de l’autre elle voit son propre échec. Son plaisir de la perte. Et cette chute est complètement Sarrautienne. Travailler avec des auteurs contemporains, vivants, c’est aussi explorer des textes qui n’ont jamais été interprétés. Faire des choses qui n’ont jamais été faites. C’est un cadeau d’avoir la primeur ou le privilège de créer et de voir naître un texte après un long temps de travail, sans savoir ce qui opérera sur les spectateurs et sur l’acteur. Des zones de l’inconnu qui s’offrent en chacun de nous…
Pouvez-vous raconter vos études à l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes) ?
C’était génial. Une époque de ma vie très riche, et j’en tire l’enseignement aujourd’hui. Ce qui est étrange c’est que quand on est jeune acteur on ne sait pas ce qu’on traverse, ce qu’on vit, ce qu’on entend. L’enseignement vient résonner dix ou quinze ans plus tard. C’est pas tout de suite qu’on comprend toute la transmission de chacun des professeurs qu’on a rencontré. J’ai eu comme intervenants Michel Duchaussoy, Jean Marais, Jacques Seller… Appréhender le théâtre sous toutes ses formes : le boulevard, la tragédie, le contemporain… À l’école, tu sais que tu es bien dans telle ou telle chose, que tu es à l’aise dans tel ou tel registre, mais tu ne sais pas ce que ça raconte. Par exemple jouer l’amoureuse au théâtre, n’était pas pour moi, ou ce que les autres en croyaient. Je n’ai jamais joué les jeunes premières. J’ai toujours été dans des rôles plus forts, plus caractériels. Mais cette figure de « l’amoureuse » dépourvue de naïveté, pointe son nez aujourd’hui dans Une légère blessure… Elle a mis vingt ans à arriver.
Qu’est-ce qui vous à séduit dans ce projet ? Le texte et l’auteur, ou le sujet ?
J’ai rencontré Laurent Mauvignier il y a seize ans à peu près. Il venait d’avoir le prix du Livre France Inter pour Apprendre à finir, et je l’ai entendu à la radio. Sa voix à travers mon poste de radio m’a appelé, et j’ai couru chercher son livre Apprendre à finir, il n’y en avait plus, alors j’ai pris Loin d’eux. En lisant ce livre j’ai eu une bascule dans ma vie, un vrai choc. Depuis ce jour, j’ai cherché Laurent Mauvignier. On s’est rencontré. J’ai fait une lecture-spectacle, une mise en espace de Loin d’eux au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Et depuis on ne s’est jamais quitté. C’est devenu un ami, un soutien, une écoute. Il a écrit Une légère blessure en se levant d’une sieste. Il l’a écrit et a entendu ma voix. Disons qu’en écrivant il s’est dit « c’est pour elle ».
Il s’est rendu compte que ses mots pouvaient vous correspondre ?
Je pense que cette histoire est encore plus belle que s’il avait vraiment été dans la volonté d’écrire un texte pour moi.
Une légère blessure est donc un « seule en scène ». Comment avez-vous abordé cette question-là ?
J’ai eu très peur, parce que la langue de Mauvignier est un rapport au vide. Ça a été très difficile de trouver l’endroit de ce monologue parce que c’est à la fois tendu et détendu. Quand on est trop détendu, ça ne va pas, et quand on est trop tendu, ça ne va pas non plus. Il a fallu trouver le milieu. Ce n’était pas un endroit simple, et on a travaillé beaucoup : des séances à la table, beaucoup de versions, de remaniements. Othello Vilgard, le metteur en scène, a effectué un travail de précision comme au cinéma, sur les regards, les mouvements, le corps. Tout paraît simple, évident et naturel. Mais rien n’est laissé au hasard. Othello Vilgard manie la langue comme une partition musicale et corporelle. Il façonne la langue et le corps de l’actrice comme une danse.
Vous voulez dire que le texte a été modifié pendant les répétitions ?
Oui, beaucoup ! Il y a eu une quinzaine de versions. Au démarrage Une légère blessure c’était une femme qui répondait à des questions qu’on n’entendaient pas. C’était une série de réponses : est-ce qu’elle parlait à une amie, à un psy ? Et petit à petit, Mauvignier a fait apparaître cette femme de ménage, qui parle une autre langue, et qui ne répond à rien. Cette présence permet toutes les provocations mais toutes les impudeurs aussi. C’est à la fois une contrainte et en même temps un espace de liberté. La femme de ménage prend la forme de la masse des spectateurs, et s’adresse à chacun.
Vous avez beaucoup de liberté avec ce texte-là ?
Je la cherche encore, tous les soirs. Elle me met au coeur de cette question-là. Qu’est-ce qu’être une femme libre au plateau ? Une femme seule, sans enfants, se déshabillant, parlant à la fois des hommes, de ses jouissances, de son plaisir, mais aussi de ses rages, de ses incompréhensions… Les gouffres ressurgissent, les silences, les absences… La question de la liberté est remise en question tous les soirs. Rien n’est fixé.
Cette liberté est sûrement due au fait que vous êtes seule sur scène ?
Oui, peut-être. Mais c’est toujours en rapport avec le spectateur. Ça fonctionne quand l’écoute est présente, quand les spectateurs font en même temps que moi la moitié du chemin : je vais à eux autant qu’ils viennent à moi. C’est une histoire de rencontre, et le texte en lui-même s’y invite naturellement. La traversée de cette femme ne se fait que si le spectateur lui-même fait la moitié du chemin. Je pense qu’Une légère blessure c’est vraiment « si vous n’êtes pas dans l’acceptation de faire aussi un travail d’écoute, de miroir, ça ne peut pas se passer ». On le sent immédiatement quand ça frotte. C’est un peu acide. Et quand c’est là, en ouverture, ça permet d’être dans un espace de travail. C’est tout le temps un miroir tendu : celui de notre société, de notre individualisme, de tout. Parler de ses parents, parler de comment on peut grandir à côté d’un frère qu’on ne connaît finalement pas, de sa mère, des enfants qu’on n’a pas eu… Parler de ses manques ça parle à tout le monde.
C’est un texte qui aborde des sujets d’actualité qui retentissent peut-être plus aujourd’hui qu’à la création du spectacle en 2016. Votre rapport au texte a-t-il changé avec cela ?
Ce texte est très fort. Il n’attend que de vieillir car le temps ne peut que lui faire du bien. Cette femme de ménage dont on ne sait pas trop d’où elle vient : est-elle venue en bateau ? Est-ce une migrante ? A-t-elle a ses papiers ? Est-elle musulmane ? On ne sait pas qui elle est. Mauvignier a la délicatesse de laisser ces questions en suspend… Mon personnage ne s’empêche pas de provoquer librement : « Et toi dans ton pays ils sont comment les hommes ? ». Comment aujourd’hui dans cette société on culpabilise les femmes de ne pas avoir d’enfants. Une société où si tu n’as pas d’enfants tu n’as pas rempli ton contrat de femme. Il y a une part de jugement sur l’égoïsme, comment peut-on dire « je suis une femme qui gagne beaucoup d’argent, je n’ai pas d’enfants, j’ai connu beaucoup d’hommes »… Elle expose clairement la femme qu’elle est, et de manière lucide, dans la jouissance de l’analyse. C’est une femme qui n’a plus peur de rien, et comme elle dit « moi je peux gaspiller mon temps à tout dire, rien ne me touche plus assez pour que j’ai peur de le perdre »… À partir de ça, plus rien ne compte. Que la femme de ménage soit de la Somalie ou d’ailleurs, rien ne l’arrête. Il n’y a pas de frontières, pas de limites.
Vous donnez la parole à un personnage féminin au théâtre pendant plus d’une heure. Est-ce que vous trouvez que c’est rare aujourd’hui au théâtre ?
Non, ça se fait de plus en plus. J’aime parler à l’oreille. Le Théâtre ne m’importe que si c’est pour se parler, qu’on cherche à se nommer ensemble, que ça résonne en chacun de nous. Faire parler une salle muette est le plus grand des paris. Et c’est la force d’écriture de Laurent Mauvignier.
Et n’est-ce pas ça qui vous a motivé à faire ce projet ? Se dire que c’est « l’occasion » de mettre la femme sur scène ?
Oui, c’est le plus beau moment. C’est un cadeau pour une actrice, à ce moment-là de l’expérience, de l’âge. Le moment est bon et juste. On est dans les temps ! (rires) !
Et vous, vous considérez-vous comme femme-artiste ou comme femme et artiste ?
Je ne fais pas de séparation. Tout est mêlé. Je crois que c’est un ensemble. Tout fait partie de tout, et c’est comme ça.
Et qu’est-ce qu’être une artiste femme aujourd’hui en 2018 ?
C’est essayer de tout se permettre. Travailler cette liberté-là. Essayer d’aller encore plus loin et de tenter, ne plus avoir peur. Ou justement, afficher ses peurs et les nommer, les dire, les chanter, les crier, les vivre. Si le théâtre existe, c’est pour délester la mémoire, la raviver. Travailler sur la mémoire, sur les secrets, sur l’humour, la connerie. Être là au monde et dire ces mots-là de Mauvignier, ou d’autres, c’est un acte fort. Et à mon avis le théâtre aujourd’hui peut soulever cela. C’est le seul art aujourd’hui qui est vivant et actif.
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Les gaffes. J’adore les gaffes, les chutes, la démesure. Quand on en fait trop, j’adore ça ! J’aime Jacqueline Maillant, j’aime ces acteurs du trop. Quand on peut tout se permettre, et qu’on a un auteur qui permet ça, c’est le pied total. Par exemple Rémi De Vos, qui a écrit Trois ruptures et que Othello Vilgard a mis en scène il y a trois ans, est un auteur qui me fait hurler de rire. Il a la gravité et l’acidité, c’est un grand dialoguiste.
Qu’est-ce qui vous fait pleurer ?
Alors là, il n’y a pas de recette… Je peux écouter une musique ou une chanson totalement kitsch et pleurer. Je peux écouter quelque chose que je n’écouterais jamais et tout d’un coup fondre en larmes. Ou croiser quelqu’un dans la rue, un regard échangé, et une histoire se raconte en l’espace d’une seconde, il se passe quelque chose…
Qu’est-ce qui vous révolte ?
Beaucoup de choses. La soumission, je crois, le fait de subir des choses. En fait tout me révolte. Je crois que plus le temps avance et plus la colère grandit. La colère est un moteur de création. En règle générale, le manque de classe me révolte.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un jeune garçon qui souhaite être acteur ?
« Le temps est notre allié », comme dit Laurent Mauvignier. Il faut être patient, et tenace. Il faut s’entêter comme la neige. Être culotté. Laisser la place à la belle connerie (rires). Être ni trop grave, ni trop con. Être juste un peu de tout. Et être patient. Puis il faut danser !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 11:08 AM
|
Publié dans Paris Match le 16/03/2018 avec AFP
Un théâtre en Belgique a publié une annonce pour recruter, dans le cadre d'un spectacle, des jihadistes ayant combattus pour l'Etat islamique.
Un théâtre de Gand en Belgique a fait publier une petite annonce pour recruter, dans le cadre d'un spectacle en préparation, des jihadistes ayant combattu pour le groupe Etat islamique (EI), avant de présenter des excuses pour cette «mauvaise communication». Le théâtre municipal NTGent «reconnaît qu'à travers son appel aux combattants de l'EI il a pu donner l'impression de vouloir leur donner une tribune, reconnaît sa mauvaise communication à cet égard et s'en excuse», selon un communiqué transmis vendredi à l'AFP.
L'initiative du metteur en scène suisse Milo Rau, qui prépare pour septembre 2018 au NTGent un spectacle autour de «L'Agneau mystique», célèbre peinture flamande du XVe siècle, avait provoqué un début de polémique. Le ministre de la Culture de la région flamande, Sven Gatz, avait rappelé mercredi que «la liberté artistique a ses limites».
"Vous vous battez pour vos convictions ? Pour Dieu ?"
Tout a démarré le week-end dernier avec la publication dans un hebdomadaire gratuit diffusé en Flandre d'une série de petites annonces pour recruter les futurs acteurs non professionnels du projet «Lam Gods» (L'Agneau mystique). «Vous vous battez pour vos convictions ? Pour Dieu ? Vous vous êtes battus pour l'EI ou pour d'autres religions ? Venez transmettre», disait l'une des annonces en néerlandais.
Sur une autre, on pouvait lire «Vous avez tué ou gravement blessé votre frère (ou soeur) ? Peut-être métaphoriquement ? Vous voulez en parler ?». La même adresse email du NTGent était associée au message pour répondre. Le polyptyque «L'Adoration de l'Agneau mystique», peint par les frères Van Eyck entre 1420 et 1432, représente différents groupes de personnes -notamment des figures bibliques- en prière autour d'un agneau, représentation symbolique du Christ.
Pour son adaptation scénique, Milo Rau, adepte du «théâtre témoignage» ancré dans l'actualité, recherche une douzaine de personnes susceptibles de remplir les principaux rôles, notamment «un Adam et une Eve, un Caïn» (fils des deux premiers, qui a tué son frère cadet Abel), a expliqué le NTGent. «Nous réinterprétons les croisés figurant sur l'Agneau mystique, et nous voyons qu'ils sont encore vivants aujourd'hui (...) Notre appel s'adressait tout autant aux catholiques extrémistes, protestants ou autres», a aussi souligné le théâtre, qui maintient le projet de M. Rau, son directeur artistique pour la saison 2018-2019.
Quelque 400 Belges sont partis combattre pour l'EI depuis 2013-2014, ce qui a fait de la Belgique un des principaux pourvoyeurs de jihadistes étrangers en zone irako-syrienne.
Légende photo Théâtre de Gand en Belgique Arterra /UIG/Getty Images

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 10:41 AM
|
The tragedy of Hamlet,
C’est au Théâtre des Bouffes du Nord, où le spectacle a été créé le 28 novembre 2000, que Peter Brook a filmé la version télévisée d’"Hamlet". Il a travaillé avec un groupe d’acteurs internationaux qui sert admirablement le texte.
Cette version, dépouillée à l’extrême, s’appuie sur une direction d’acteurs très précise centrée sur l’interprétation bouleversante d’Adrian Lester. Voir le film intégral : https://www.arte.tv/fr/videos/025323-000-A/the-tragedy-of-hamlet/
En anglais sur-titré
The tragedy of Hamlet, William Shakespeare
Musique : Toshi Tsuchitori
Réalisation : Peter Brook
Acteurs : Scott Handy, Jeffrey Kissoon, Adrian Lester, Bruce Myers, Natasha Parry, Shantala Shivalingappa, Rohan Siva, Asil Rais, Yoshi Oida, Akram Khan, Nicolas Gaster, Antonin Stahly
Auteur :
Costumes : Chloé Obolensky
Pays : France Année : 2001

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 8:50 AM
|
Par Gérald Rossi dans L'Humanité - 16 mars 2018
En racontant la vie de la sculptrice, Wendy Beckett, dénonce avec conviction le poids de la morale oppressant les femmes artistes jusqu’au XXe siècle et s’interroge sur les raisons d’un internement psychiatrique pendant les trente dernières années de sa vie.
Une destinée sombre mais une artiste lumineuse. La sculptrice et peintre Camille Claudel, née en 1864 et morte en 1943, a passé les trente dernières années de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques. Ainsi, la sœur de l’écrivain et diplomate Paul Claudel est-elle vite tombée dans les gouffres de l’oubli public, en dépit de ses œuvres exposées dans les musées, jusqu’à ce qu’en 1982 la comédienne Anne Delbée ne s’empare de cette aventure, puis après elle, en 1988, le cinéaste Bruno Nuytten ou encore Bruno Dumont en 2012. Aujourd’hui l’auteure et metteure en scène Wendy Beckett (assistée par Audrey Jean) propose, avec Camille Claudel, de l’ascension à la chute un portrait personnel de cette femme qui ne rêva sa vie durant que d’amour et de liberté. On ne peut que tomber sous le charme.
Dans une ambiance d’atelier, Célia Catalifo est une Camille pétillante, entourée de Marie-France Alvarez, Marie Brugière, Clovis Fouin, Christine Gagnepain et Swan Demarsan dans les habits de Rodin. Ainsi que les danseurs Sébastien Dumont, Audrey Evalaum et Mathilde Rance. Ces derniers, figurent les multiples sculptures réalisées par Camille dans ses ateliers. C’est là un parti pris de mise en scène original, mais qui gagnerait sans doute a être plus condensé.
Contre les interdits
D’abord élève de l’immense Auguste Rodin, rejetée par sa famille, particulièrement par sa mère, sinistre et prétentieuse bigote, préoccupée avant tout de « respectabilité », Camille, des années amante éprise de son maître (qui la considérait aussi comme sa muse), obtient une reconnaissance de son travail puissant et novateur, notamment en 1888 lors du Salon de peinture et de sculpture de Paris.
Créatrice infatigable, elle a déjà réalisé une production impressionnante quand elle est internée, à la suite de plusieurs crises, alors que son père, son seul soutien familial vient de mourir. « Il a toujours été évident pour moi que la condition mentale de Claudel a été mal diagnostiquée, et son internement bien trop commode » souligne Wendy Beckett pour qui de toute façon « il était certain qu’elle était capable d’exister au sein de la communauté ».
Pourtant, cette créatrice qui s’était imposée dans le monde des arts plastiques, qui avait brisé les règles interdisant par exemple aux femmes de modeler ou de peindre d’après des modèles humains, a été brisée. Wendy Beckett, qui aurait pu pousser plus loin la psychologie de ses personnages, défend cette mémoire, ce talent novateur et dénonce une société confite dans ses dogmes.
Jusqu’au 24 mars à l’Athénée Louis Jouvet, 7 rue Boudreau Paris IXe (mardi 19h, mercredi au samedi 20h, dimanche 16h). tél.: 01 53 05 19 19.
Gérald Rossi
Photo : Christine Coquilleau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 2018 8:37 AM
|
« Notre innocence » : une ode inaboutie à la jeunesse
Par Philippe Chevilley dans Les Echos
Issu d'un travail d'atelier avec des élèves du Conservatoire de Paris, le nouveau spectacle de Wajdi Mouawad souffre d'une écriture en dents de scie et d'une interprétation souvent maladroite. Restent quelques beaux gestes, comme le manifeste choral initial et la dernière partie, en forme de conte.
Plébiscitée par la critique et le public, « Tous des oiseaux » avait marqué le grand retour créatif de Wajdi Mouawad, en sa nouvelle maison de la Colline, à la fin de 2017. Son nouveau spectacle « Notre innocence », hélas, n'est pas de la même eau. Le projet s'annonçait il est vrai plus hasardeux, partant d'un travail d'atelier commençé en 2015 avec des élèves du Conservatoire national d'art dramatique de Paris.
Le spectacle raconte le traumatisme de jeunes apprentis-comédiens confrontés au suicide de l'une d'entre eux, Victoire, mère d'une fillette de neuf ans. Cette fiction s'inspire d'une triste coïncidence à plusieurs années de distance : le suicide d'un camarade de l'auteur, survenu lorsqu'il était lui-même en formation théâtrale au Québec ; et la mort récente, à la suite d'une crise cardiaque, d'une élève du CNSAD appartenant à la même promotion que les jeunes de l'atelier.
C'est l'histoire de cette étincelle tragique que détaille avec une sobre émotion Hayet Darwich, dans une introduction aux allures d'autofiction. Puis entrent en scène les dix-sept autres comédiens, alignés pour déclamer en choeur un long discours-manifeste sur leur génération privée d'espoir. Le propos n'est pas neuf, voire un brin démago, mais la verve de Wajdi Mouawad fait mouche. D'autant que ce chant belliqueux est modulé, psalmodié avec un bel ensemble, avant que le plateau se transforme en boîte de nuit.
MOMENT DE VÉRITÉ
Le spectacle se délite malheureusement dans la séquence, pourtant cruciale, où les jeunes héros de la pièce, terrassé(e)s par la défenestration de Victoire, se livrent à un examen de conscience autour d'une table. Les échanges sont le plus souvent maladroits, tant dans l'écriture que dans l'interprétation. A l'exception de quelques comédiens habités (tels Mohamed Bouadla, Hatice Özer ou Etienne Lou), la distribution, issue en grande partie du Conservatoire, manque de justesse et de conviction.
Wajdi Mouawad redresse un peu la barre dans une dernière partie qui flirte avec le conte, transformant la vraie-fausse petite fille de la suicidée en déesse. On replonge alors dans un théâtre d'ombres et de lumières, l'exercice d'élève devient fable. La petite fille est formidable et on se prend à rêver à la génération d'après... Certains apprécieront le côté expérimental et composite du spectacle, son esthétique épurée, ses odes sincères à la jeunesse malmenée. D'autres, dont nous sommes, miseront sur un prochain opus plus abouti du maître Wajdi.
NOTRE INNOCENCE
Texte et mise en scène de Wajdi Mouawad.
Paris, théâtre de la Colline (01 44 62 52 52).
Du 14 mars au 11 avril. 2 h 15.
Légende photo : Au discours-manifeste sur une jeunesse désespérée, succède une séance de danse échevelée. © Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:38 PM
|
Par Judith Sibony dans son blog Coup de Théâtre :
La femme est un loup pour l’homme
Hunter pourrait être une simple pièce d’horreur (comme on dit un film d’horreur), avec son héroïne qui se transforme en loup garou pour dévorer des humains, son hémoglobine et sa musique inquiétante. Ce spectacle qui mêle théâtre et tournage en live, pourrait n’être qu’une mise en abîme réussie, montrant « à vue » comment on transforme une comédienne en monstre par petites touches de maquillage successives, et comment on fait courir un acteur dans les rues d’une banlieue en lui faisant faire du surplace devant un font vert. Mais la pièce de Marc Lainé est bien plus qu’un exercice de style. C’est un vrai beau spectacle sur le féminin et le désir.
Sous couvert de jouer avec les codes du film d’horreur, de décrypter ce qu’est un monstre au cinéma, et de déconstruire le mythe du méchant loup dans les contes pour enfants, l’auteur se balade avec brio le long de la frontière entre le normal par excellence (une vie de couple bien rangée dans un pavillon de banlieue) et le pathologique (une femme qui bouffe des hommes, ou ce qui pourrait arriver si les pulsions sexuelles devenaient vraiment des pulsions de mort).
Dans son spectacle, l’auteur observe la banalité de la vie non pas par l’envers du décor, mais par l’envers d’un dressing, ce qui est joliment révélateur de son projet : déshabiller la civilisation pour révéler les fantasmes qui l’habitent. Ce placard rempli d’habits chics sert en effet de point de bascule entre le monde policé et celui des pulsions irrépressibles : d’un côté, il y a la chambre où une jeune femme est séquestrée et droguée par son père depuis vingt ans, de l’autre, la maison proprette d’un joli couple.
Ce couple (excellents David Migeot et Bénédicte Cerutti), on pourrait le qualifier de pavillonnaire en plagiant l’inoubliable expression d’Eric Chevillard parlant de « littérature pavillonnaire » à propos du romancier David Foenkinos : c’est un couple cliché, aux aspirations raisonnables, bien installé dans sa maison Ikea avec, au quotidien, juste ce qu’il faut de complicité, de mots gentils et d’érotisme pour ne pas être tout à fait médiocre. À partir de cette matrice qu’il peint de façon délectable, Marc Lainé s’amuse à multiplier les accidents, les mauvais rêves et les actes manqués : peu à peu, l’empire des pulsions s’impose ; autrement dit, ce qui échappe finit par reprendre ses droits.
Ici, la figure de « ce qui échappe », c’est donc une femme-loup, superbement interprétée par Marie-Sophie Ferdane qui n’a jamais été aussi impressionnante, même quand elle incarnait Nina dans La Mouette de Nauzyciel à Avignon (juillet 2012). À la fois athlétique et gracieuse, la jeune femme déploie magistralement son personnage aux multiples facettes : éternelle fillette terrorisée par son père ; femme sensuelle et ardente ; loup dévorateur. Elle rencontre le couple « pavillonnaire » parce qu’elle s’est « échappée » (justement) de sa geôle ; et à partir de là, tout le monde va perdre le contrôle : la fugitive mord le mari, qui sera dès lors hanté par la douleur, mais aussi par le plaisir qu’a suscité la blessure, tandis que l’épouse observera, impuissante, l’effondrement de son petit monde.
À plusieurs reprises, de façon très subtile, Marc Lainé superpose la figure de la louve-garou et celle de la femme « pavillonnaire ». Mais on l’avait déjà compris : ce fantasme ambulant aussi effrayant qu’irrésistible, cette bête traquée quoique indomptable, qui peut mordre autant que faire jouir, c’est tout simplement une image de la femme en général, prise au pied de la lettre et dans toutes ses acceptions : du sexe « faible » à la femme « fatale ». En quittant le théâtre, on se demande pourquoi le loup garou est un terme invariablement masculin. Et on est ravi qu’un metteur en scène se soit si délicatement emparé du sujet.
Hunter, de Marc Lainé, avec Geoffrey Carey, Bénédicte Cerutti, Marie-Sophie Ferdane, Gabriel Legeleux (dit Superpoze) et David Migeot. Au théâtre national de Chaillot (Paris 16e) jusqu’au 16 mars, puis en tournée.
crédit photo : Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 9:16 PM
|
Par Pascale Nivelle pour M le magazine du Monde | 16.03.2018
Dealer, gay, taulard, terroriste… Longtemps, il a accepté les rôles stéréotypés. Depuis, il a appris à choisir. Dans « Mektoub My Love. Canto Uno », d’Abdellatif Kechiche, il joue le rôle d’un beau gosse dragueur de filles.
Dans ce café parisien, couru des célébrités et où il n’est encore jamais entré, on le reconnaît. Les regards anonymes s’attardent, l’actrice Natacha Régnier lui fait un signe, un pensionnaire de la Comédie-Française lève un œil amical. Kader Aoun, producteur d’humoristes et créateur du « Jamel Comedy Club », bondit et l’étreint dans ses bras de géant. « Le meilleur acteur français depuis Alain Delon ! Ça roule pour toi beau gosse ! »
Ça roule en effet pour Salim Kechiouche : trois films en ce début d’année, Voyoucratie, Corps étranger et surtout le très attendu Mektoub My Love. Canto Uno, d’Abdellatif Kechiche (en salle le 21 mars). Dans cette fresque qui suit le parcours d’un jeune homme (joué par Shaïn Boumedine), il tient un second rôle important, celui du cousin du héros, un tombeur de filles pétri de doutes.
« Mon frère, je suis content pour toi », répète Aoun. Pour les « artistes rebeus, résume-t-il, c’est dur » : « On se tient les coudes comme des cousins de province qui se retrouvent à Paris. » Salim Kechiouche, 38 ans, solaire dans son pull mandarine, se montre imperméable à la dureté du monde, et à celle du cinéma. « C’est marrant la vie », dit-il simplement, son sourire d’acteur en étendard. La sienne est un conte d’aujourd’hui, parfois drôle et souvent triste.
« A 13 OU 14 ANS, IL ÉTAIT TRÈS HÂBLEUR, COMME LES MECS DES CITÉS DES ANNÉES 1990, ET EN MÊME TEMPS TRÈS MÉLANCOLIQUE, COMME S’IL PORTAIT QUELQUE CHOSE D’UN MONDE VIOLENT. » LE RÉALISATEUR GAËL MOREL
La première fois qu’il est venu à Paris, c’était au début des années 1990, dans un bus parti de Vaulx-en-Velin, qui avait roulé toute une nuit. Des milliers de jeunes recrutés par le ministère de la jeunesse et des sports pour la campagne « Avoir 20 ans en l’an 2000 » convergeaient vers la capitale. Dans la troupe des Lyonnais, Gaël Morel, cinéaste en devenir de 18 ans, contemplait Salim. « Il avait 13 ou 14 ans et était d’une beauté remarquable. Très hâbleur, comme les mecs des cités des années 1990, et en même temps très mélancolique, comme s’il portait quelque chose d’un monde violent », se souvient le réalisateur.
Fils d’un couple d’Algériens, père soudeur et mère au foyer, l’adolescent était très excité : « J’allais rencontrer Patrice Laffont, l’animateur qu’on regardait tous les jours à la télé avec ma maman », raconte-t-il. Plus tard, écrivant A toute vitesse, son premier scénario, Gaël Morel donnera les traits de Salim à un jeune dealer qui compose des poèmes dans une cave de sa cité. Et cinq ou six ans après, venu enfin tourner son film dans la région lyonnaise, il retrouvera Salim Kechiouche par miracle et lui donnera le rôle. « Il était toujours incroyablement beau, et encore plus mélancolique. Il semblait sous pression. »
Les Ritals de Scorsese comme modèles
A Vaulx-en-Velin, banlieue chaude des années 1990, l’ex-ado a pris des coups, et des muscles. Sa mère est morte d’un cancer dans ses bras, lui faisant promettre de s’occuper de ses deux petites sœurs. Après son bac littéraire, il a quitté son lycée catholique, havre où l’avaient confiné ses parents pour l’empêcher de « traîner avec les fouteurs de merde du quartier ».
Il s’est retrouvé à la dérive, vaguement inscrit en première année de fac d’histoire. Son père le presse de trouver un métier. Il renâcle. « Chez les Rebeus et les cathos, on m’avait enseigné la même chose, dire merci, être humble et bien travailler. Moi, je voulais me sauver, pas passer ma vie à travailler pour survivre comme mon père. »
Parfois, « Salim se bagarrait, il a fait des petites bêtises », se souvient sa jeune sœur Myriam, qui décrit aussi le plus attentionné des frères. Ses modèles sont les Ritals des films de Scorsese, Joe Pesci en mafieux, Robert De Niro dans Raging Bull.
Il se défoule sur les rings, champion de France de kick-boxing, deux fois deuxième au championnat de France de boxe thaï. Devant la caméra de Gaël Morel, Salim Kechiouche, profond, poétique, physique, tient ses promesses.
« A cette époque, les jeunes issus de l’immigration étaient représentés de façon caricaturale. C’étaient toujours des voyous ou des dealers, ou bien ils servaient d’hommes-sandwichs à la bien-pensance, raconte Gaël Morel. J’ai eu envie de montrer ce qu’ils avaient de beau, leur donner une image sensuelle et sexuelle. Salim Kechiouche a été à l’avant-garde de cela. »
Repéré par François Ozon, il tourne dans Les Amants criminels avec Natacha Régnier. Il découvre les palaces de Cannes, les smokings, les fêtes et les tapis rouges. « Il était grisé », se souvient Gaël Morel. Il l’avertit : « Ce n’est pas ça la vie. » « Peut-être, mais c’est marrant », s’était dit Salim Kechiouche.
« AU DÉBUT, J’EN AI VOULU AUX GENS DE ME CATALOGUER, C’ÉTAIT COMME S’ILS ME RAMENAIENT À VAULX-EN-VELIN. ET PUIS J’AI EU LE COURAGE D’EN SORTIR. » SALIM KECHIOUCHE
Retour à Vaulx-en-Velin en attendant la suite, qui ne vient pas. « Tu as eu un coup de chance, lui dit son père, cela ne va pas durer. » Deux petits rôles et puis s’en vont ? « Les débuts sont fragiles quand on est lesté du sac à dos des Rebeus, explique le producteur Kader Aoun. Au fond, on ne s’en débarrasse jamais. »
A 20 ans, déjà aussi couturé que Marcel Cerdan, Salim boxe pour ne pas aller tenir les murs de sa cité, comme ses potes. Et il danse, rêvant de voler sur les scènes de hip-hop, de smurf et de breakdance. Découragé, il passe une année dans le village de ses parents, près d’Oran, et finit par revenir dans sa banlieue. Il s’inscrit dans un cours de théâtre, La Scène sur Saône. Un an plus tard, il est à Paris. Dealer, taulard, racaille, les propositions se suivent et se ressemblent, il prend tout. « Au début, j’en ai voulu aux gens de me cataloguer, c’était comme s’ils me ramenaient à Vaulx-en-Velin. Et puis j’ai eu le courage d’en sortir. »
Recruté par Robert Salis (Grande école, 2004) et de nouveau par Gaël Morel (Le Clan, 2004), il endosse entre autres plusieurs rôles d’homosexuel, servi par sa plastique d’athlète et ses traits dessinés pour séduire.
Trop véridique pour être tout à fait fictionnel ? Quand il joue le voyou, on lui demande combien de casses, combien d’années en taule. Quand il pose pour Pierre et Gilles ou fait la « une » de Têtu, il devient une icône gay. « Pour embrasser les mecs comme ça, t’es pédé, c’est sûr », entend-il. Viendrait-il à l’idée, après Belle de jour, de demander à Catherine Deneuve si elle s’est prostituée ? Avec Salim Kechiouche, le fils d’Algériens, ça ne loupe pas.
« SALIM A LA MAÎTRISE TOTALE DU MÉTIER D’ACTEUR ET EN MÊME TEMPS L’INNOCENCE DE LA PREMIÈRE FOIS. ET IL A UNE GRANDE PART DE MYSTÈRE, QUI FAIT SA PROFONDEUR. » LE RÉALISATEUR ABDELLATIF KECHICHE
Père de deux enfants, compagnon d’Olivia Côte, artiste et scénariste, l’ancien boxeur a dû batailler pour sortir des clichés. « Une carrière se construit sur des refus. J’ai stoppé les rôles de taulards et d’homosexuels. » Aujourd’hui, ce sont les personnages de terroriste qu’il décline. Devant son miroir, Salim Kechiouche se trouve pourtant vieux et cabossé comme un ancien boxeur. « Quand je tourne avec des jeunes de 20 ans, j’ai la honte… »
Sur le marché des acteurs sexy, il reste pourtant très bankable. Cela n’a pas échappé au cinéaste Abdellatif Kechiche, adorateur de la beauté et de la sensualité, qui lui avait offert un petit rôle dans La Vie d’Adèle. Quand le réalisateur l’a rappelé pour jouer Tony dans Mektoub My Love. Canto Uno, Kechiouche a dansé dans sa cuisine. Il avait un rôle, qui n’était ni celui d’un taulard, ni d’un gay, ni d’un terroriste.
Ambiance presque aérienne sur le tournage
Le réalisateur qui lui a fait reprendre son rôle dans le deuxième volet de Mektoub My Love (déjà tourné) dit de lui : « Salim a la maîtrise totale du métier d’acteur et en même temps l’innocence de la première fois. Et il a une grande part de mystère, qui fait sa profondeur. C’est très rare de garder tout cela. »
Grâce à Salim Kechiouche, l’ambiance était presque aérienne sur le tournage : « Il sait s’effacer et trouve toujours une solution aux problèmes qui surviennent, avec une grande générosité. Je suis très admiratif de cette qualité car je ne l’ai pas », dit Abdellatif Kechiche.
Le film débute sur une scène d’amour très longue et très érotique. Les premiers retours qu’il a eus, avant la sortie en salle, étaient : « Le début, c’est pas du chiqué, hein ? Tu lui fais vraiment l’amour ? » Protestation de Salim : « C’est Tony, mon personnage ! Tu l’as vu bander, Tony ? Tu as vu une pénétration ? Non, bien sûr ! C’est un rôle, voilà tout. » Après vingt ans de carrière, il est toujours obligé de justifier son talent.
Lire le récit : A la Mostra, le sensuel hymne à la vie d’Abdellatif Kechiche
« Mektoub My Love. Canto Uno » (2 h 55), d’Abdellatif Kechiche, avec Shaïne Boumedine, Ophélie Bau et Salim Kechiouche… En salle le 21 mars.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 8:20 PM
|
Par Alice Zeniter photo Edouard Caupeil pour Libération
— 17 mars 2018
Dans un univers encore majoritairement masculin, la jeune femme a repris l’historique maison d’édition de L’Arche à seulement 32 ans.
«Ça n’a jamais été prévu.» Chaque fois que je pose une question sur son parcours aux abords classiques (prépa, Normale Sup, agrégation, thèse inachevée - que nous avons menée côte à côte), elle répond en évoquant ce qu’elle aurait voulu faire à la place : devenir comédienne à Berlin («me teindre les cheveux en rouge, tout ce que tu veux de cliché»), ou étudier la céramique grecque(«des scènes orgiaques ou d’une violence inouïe qui sont les premières œuvres d’art et à la fois des objets du quotidien»). C’est, à chaque étape, le sentiment qu’elle aurait pu être tout à fait ailleurs que là où elle se trouvait et que cette simple possibilité n’était pas loin de signifier qu’elle aurait dû être ailleurs. Jusqu’à l’arrivée à L’Arche où, pour la première fois, elle a la certitude «d’être à sa place». Ça n’a jamais été prévu qu’elle reprenne une maison d’édition spécialisée dans le théâtre : elle a grandi en ignorant leur existence. Son entourage lui demande souvent : «Comment ça va, avec la librairie ?»
C’est sa grand-mère, infirmière scolaire, et non ses parents divorcés, mère infirmière, père ingénieur informaticien, qui l’élève à Marseille. Elle lui transmet le goût de la littérature, lui apprend deux vers par jour.
Claire découvre l’allemand grâce aux rétrospectives du cinéma art et essai du quartier de la Vieille Charité. Quant au théâtre, c’est une passion précoce, «mais pour ma grand-mère, comédienne, ça voulait dire qu’on allait me mettre nue sur scène. C’était hors de question». Après avoir commencé sa prépa lettres à Marseille, elle la poursuit à Paris, au lycée Condorcet, où le sentiment de ne pas être à sa place culmine : issue des classes moyennes, elle évoque «la reproduction du même» chez cette jeunesse des rallyes «alors que moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire», les rires quand elle prend la parole avec son accent du Sud («mon premier exposé, c’était sur la débauche chez Plaute, imagine»). Elle vit dans un foyer tenu par des bonnes sœurs. «Porte-voix. Extinction des feux. La mesquinerie de cet endroit», dit-elle en écarquillant les yeux. Comme le foyer ferme fin mai, elle passe les concours en squattant les canapés des amis. «Enfant de divorcés, boursière, et arrivée de Marseille… Un jour, la CPE m’a qualifiée de "cas social" devant la classe.»
Une fois entrée à l’ENS, elle veut devenir traductrice. Elle a découvert un auteur autrichien, Clemens Setz. Ses droits ont été achetés par Jacqueline Chambon - passeuse en France de nombreux auteurs germanophones. Claire traduit fébrilement quelques pages pour les envoyer à cette femme qu’elle admire. «J’étais à Arles. On mourait de chaud, même à 2 heures du matin, on se faisait bouffer par les moustiques. Olivier relisait chaque ligne.» Olivier Dudas, son compagnon depuis des années, est mathématicien, chercheur au CNRS. Ils se sont rencontrés à l’ENS - où Claire a fréquenté davantage les étudiants de sciences que ceux des filières littéraires : «Chez eux, au moins, il y a de la mixité sociale !» Jacqueline Chambon accepte de lui confier la traduction, avec cette phrase : «Vous avez le mot juste.»
Claire me parle de Setz, de cette première expérience qui lui vaudra des rêves hallucinés en allemand peuplés d’animaux, et la tiendra plusieurs jours sans ressentir le besoin de manger ni de dormir. Elle essaie des collages à renfort de gestes virevoltants et aussitôt les balaie : «C’est Thomas Bernhard qui rencontre les jeux vidéo, c’est Sarah Kane mêlée à Star Trek.» Elle cherche encore un peu, parle des taches et du solipsisme d’une miette de pain. «Bon, il faut que tu lises ça.»
L’Arche, elle la découvre de l’intérieur lors d’un stage de master 2. C’est là que sont publiés les auteurs sur lesquels elle travaille. Le premier jour, elle ouvre un carton et tombe sur la réimpression d’un Brecht, «je ne saurais même plus te dire lequel», mais en rangeant les livres, elle pense qu’elle voudrait rester là, toujours. Seulement, elle a obtenu un contrat doctoral et ce n’est pas le genre d’offre qu’on refuse pour prolonger un stage. Elle se résigne à commencer sa thèse, avec encore et toujours cette impression qu’elle devrait être ailleurs. Elle reste en contact avec Rudolf Rach, le directeur de L’Arche. Alors qu’ils évoquent la possibilité de son retour dans la maison d’édition, celui-ci lui demande : «Ça vous intéresserait de la reprendre ?» Elle répond oui, sans réfléchir, «c’était L’Arche que je voulais, pas travailler dans le théâtre, ou dans l’édition de manière vague».
Alors que la soirée avance, elle reparle de cette décision subite : «On me parle de mon courage. Je ne comprends pas. Je t’assure. Je ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Pourquoi il faudrait un courage particulier pour reprendre une maison d’édition quand on est une femme de 32 ans ? Et quel courage ? Celui de ne pas être un homme d’une cinquantaine d’années ?»
Elle revient donc à L’Arche,en prend le contrôle en 2017 : «Je n’avais pas les moyens d’acheter un appartement à Paris, mais je pouvais me donner les moyens de reprendre cette maison.» Quand je lui demande sur combien d’années elle s’est endettée, elle refuse de répondre : «Je ne veux pas que les gens puissent attacher un prix à L’Arche. Sa valeur est inestimable.» Elle est la dépositaire de la mémoire de cette maison indépendante, créée en 1949, tout comme celle qui crée son futur. «Je ne suis pas une héritière, au sens bourdieusien du terme, mais la mémoire de cette maison me donne tout ce dont j’ai besoin», dit celle qui ne s’est pas augmentée entre sa première embauche et aujourd’hui. Sa lignée, désormais, c’est celle des auteurs de L’Arche : Brecht, Strindberg, Bernhard, Bond, Crimp… Ils sont plusieurs centaines, «tous très différents, mais tous très politiques», dit celle qui tait pour qui elle a voté parce que «les politiciens sont contingents», au contraire des idées. Mais précise : «En éditant Kroetz ou Jelinek, je ne peux qu’être de gauche…»
Elle parle de Kate Tempest, qu’elle édite depuis peu, de sa propension à décloisonner les publics comme les écritures, de sa place évidente à L’Arche. Pour définir son catalogue, elle lance une liste allitérative : «Décloisonner. Déterritorialiser. Décoloniser. Déposséder des héritages, justement, qu’on charrie comme des fatalités.» Claire accompagne les auteurs, se met au service de leur écriture, de leurs obsessions, court voir leurs pièces au théâtre. «Faire entendre des voix occultées, souvent par ignorance mais parfois aussi par volonté», dit-elle. Et quand je lui demande si elle n’a pas eu peur, au moment de rencontrer certains auteurs «monstres» de L’Arche, elle sourit. La première question que lui a posée le chorégraphe Jan Fabre, lors d’un rendez-vous à 1 heure du matin, c’était : «Are you happy ?» La réponse, aujourd’hui, est plutôt évidente.
16 août 1984 Naissance.
2006 Entre à l’Ecole normale supérieure.
2012 Stage d’été à L’Arche.
2017 Rachat de L’Arche.
Alice Zeniter photo Edouard Caupeil pour Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2018 8:12 PM
|
Par Joël Chapron dans Le Monde - 15.03.2018
L’acteur, qui a joué dans plus de 120 films après avoir incarné le renouveau du théâtre russe à la fin des années 1950, s’est éteint le 12 mars, à l’âge de 82 ans.
Avec sa bouille ronde et ses grands yeux étonnés, sans doute Oleg Tabakov restera-t-il chez les spectateurs étrangers l’incontournable Oblomov du film Quelques jours de la vie d’Oblomov que Nikita Mikhalkov tourna en 1979, adapté du roman éponyme d’Ivan Gontcharov. Mais, pour les Russes, Oleg Tabakov, qui est mort le 12 mars à l’âge de 82 ans, a avant tout incarné le renouveau du théâtre au moment du « dégel » khrouchtchévien de la fin des années 1950, avant de devenir l’un des acteurs les plus populaires de sa génération.
Né le 17 août 1935 à Saratov, il entre à l’Ecole-studio du Théâtre d’art académique de Moscou (MKhAT) en 1953 et, avant même de terminer ses études, joue pour la première fois au cinéma dans Le Nœud serré, de Mikhaïl Chveïtzer (1956), qui, considéré comme « idéologiquement corrompu », sort amputé et remanié sous le titre Sacha entre dans la vie, avant de retrouver sa version complète en 1988.
Un théâtre dans une cave
Le jeune acteur est, cette même année du XXe Congrès du Parti prônant la déstalinisation, l’un des cofondateurs du théâtre Sovremennik qui deviendra l’une des principales scènes moscovites. Il est l’un des acteurs phares de la troupe de 1957 à 1983, qu’il dirigera de 1970 à 1976. C’est dans ce théâtre que seront particulièrement appliqués les préceptes de jeu de Stanislavski et de Nemirovitch-Dantchenko.
Son interprétation de Khlestakov dans Le Revizor, de Gogol, qu’il jouera jusqu’à Prague en 1968, assoit sa notoriété nationale et internationale. Il fonde en 1977 son propre théâtre dans une cave de Moscou, surnommé Tabakerka (la « tabatière », en jeu de mots sur son nom), qui conquiert critiques et public, mais se voit refuser un statut officiel et condamner à fermer en 1982, avant d’être enfin reconnu pendant la période de la « perestroïka », en 1987.
Il prend la tête du théâtre d’art Anton-Tchekhov en 2000, sans avoir pour autant jamais cessé d’enseigner et de former des dizaines de jeunes acteurs (Evgueni Mironov, Vladimir Machkov, Alexeï Serebriakov – le héros de Leviathan, d’Andreï Zviaguintsev…) et metteurs en scène (Kirill Serebrennikov, assigné à résidence par la justice russe aujourd’hui, fut l’un de ses élèves).
Parallèlement, il joue dans plus de 120 films, criant au héros de Ciel pur, de Grigori Tchoukhraï (1961) « Et elle est où, ta justice ? », prêtant sa silhouette familière à Nikolaï Rostov dans Guerre et paix, de Sergueï Bondartchouk (1965-1967), au SS Walter Schellenberg dans la célébrissime série de Tatiana Lioznova Dix-sept moments du printemps (dont le succès télévisuel, en 1973, vida les rues du pays) puis à celle du père Fedor dans l’autre série culte de Mark Zakharov, sortie en 1976, adaptée des Douze chaises, d’Ilf et Petrov, au propriétaire du saloon dans la comédie-western L’Homme du boulevard des Capucines, d’Alla Sourikova (60 millions de spectateurs en URSS en 1987), à Son Excellence accueillant Marcello Mastroianni dans Les Yeux noirs, de Nikita Mikhalkov (1987), et même au chef de la garde rapprochée de Staline dans Le Cercle des intimes, d’Andreï Kontchalovski (1991).
Officier de la Légion d’honneur
Bien que la majorité de sa filmographie relève d’un cinéma plutôt commercial, ses incursions dans le cinéma d’auteur furent remarquées – Ça, de Sergueï Ovtcharov (1989) et Trois histoires, de Kira Mouratova (1997) –, mais trop rares à son goût : en pleine émission de télévision en 1993, il déclare sa flamme à Alexeï Guerman, implorant celui-ci de lui offrir un rôle… qu’il n’eut jamais.
Sa voix reconnaissable entre toutes lui avait également permis de se faire connaître du jeune public russe, car les metteurs en scène de dessins animés faisaient régulièrement appel à lui (près de 30 films à son actif, dont le chat de la série Prostokvachino avec lequel ont grandi des millions de jeunes Soviétiques dans les années 1970-1980).
Lauréat de multiples prix, maintes fois décoré par les différents dirigeants soviétiques puis russes, mais aussi élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur en 2013, Oleg Tabakov avait soutenu publiquement la politique de Vladimir Poutine vis-à-vis de l’Ukraine en 2014, mais aussi pris la défense de Kirill Serebrennikov après le déclenchement des opérations judiciaires contre le théâtre de ce dernier au printemps 2017.
Oleg Tabakov en cinq dates
17 août 1935 Naissance à Saratov
1956 Cofondateur du théâtre Sovremennik
1979 « Quelques jours de la vie d’Oblomov », de Nikita Mikhalkov
2000 Prend la direction du Théâtre d’Art Anton-Tchekhov
12 mars 2018 Mort à Moscou

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2018 7:56 PM
|
Par Kim Hullot-Guiot dans Libération— 16 mars 2018
Théâtre, danse, capoeira… Après des premiers pas dans la «jungle» de Calais, l’association Good Chance propose aux réfugiés hébergés dans le nord de Paris de sortir de leur condition par l’art. Un travail centré sur les gestes et le regard.
Deux immeubles aux couleurs délavées surplombent une station-service, le boulevard Ney en travaux et le bar Le Celtic, fréquenté des parieurs - canassons ou grilles de numéros, à chacun sa manière de titiller sa chance. Coiffés de grandes enseignes visibles depuis l’autoroute à la gloire de marques d’électroménager, leurs 27 étages sont comme les gardiens de la porte de la Chapelle (Paris XVIIIe), où, le long du tramway qui encercle la ville, on sent bien qu’on est de justesse dans la capitale.
Depuis l’hiver 2016, les résidents de ces immeubles à loyer modéré observent aussi les allées et venues devant le centre de premier accueil et d’hébergement temporaire pour migrants, installé par la mairie de Paris et géré par Emmaüs. Il y a un peu plus de deux mois, ils ont assisté à une arrivée plus inhabituelle, à côté de ce centre : un théâtre éphémère à l’usage des migrants, monté par l’association Good Chance, ouvert une fois par semaine aux Parisiens.
Un jeudi froid du mois de mars. Sous le dôme blanc qui sert aussi bien de lieu de création, de salle de spectacles que d’agora, Sofian Jouini, un chorégraphe basé à Nantes, anime un atelier à mi-chemin entre la danse, la capoeira et le théâtre gestuel. Face à lui, une vingtaine de migrants, des hommes en grande majorité afghans résidant dans le centre pour une ou deux semaines, et quelques bénévoles, qui assistent à la séance afin de fluidifier les contacts entre le chorégraphe et ses «élèves».
Les participants se mettent par deux, l’un manipule un bâton dont l’autre doit suivre les mouvements. Les plus timides se contentent de bouger la tête, les plus audacieux se meuvent dans tous les sens, semblables à des pantins désarticulés. «On travaille sur la conscience et la mobilité du corps. Cette improvisation, c’est ce que nous permet notre taf d’artiste : on se lance sans savoir à quoi ça va aboutir», détaille le chorégraphe.
«Se raconter sans parler»
Sans parler la même langue - le théâtre refuse de faire appel à des traducteurs pour ne pas «créer de la distance» -, les gestes et les regards revêtent une importance considérable. En duo avec Souleymane, l’acteur Corentin Fila (vu notamment chez André Téchiné), bénévole ces jours-ci au théâtre éphémère, juge l’exercice plus intéressant porte de la Chapelle qu’au cours Florent, qu’il a fréquenté : «Les regards prennent tout leur sens quand on ne peut pas aller boire des verres le soir pour connaître les gens. Ici il y a une énergie incroyable, chacun existe dans le groupe. Souvent il y a un moment de beauté, de grâce. Dans cet espace, ils peuvent se raconter sans parler, et repartir en ayant été quelqu’un.» Etre quelqu’un, pas seulement un exilé.
La productrice Claire Bejanin, qui préside la structure française de l’association, juge que «c’est la force du travail artistique d’être dans un état de présence, d’ouverture à l’autre. Il y a une grande simplicité finalement à s’apercevoir qu’on est si peu différents. Je suis toujours sidérée par la force intérieure des gens et leur capacité de création». «Etre ici donne l’occasion de faire partie d’une communauté, d’avoir un but, abonde l’un des cofondateurs du théâtre, Joe Robertson. Tout le monde donne à tout le monde, ce n’est pas de la charité. Et l’art a toujours été guérisseur, même si nous ne sommes pas des thérapeutes.» Navid, 23 ans, originaire d’Afghanistan, raconte qu’ici, il «oublie tout de [sa] situation» : «Je vis le moment présent. J’ai aimé dessiner des vêtements la semaine dernière [des étudiants d’une école de mode ont animé un atelier, ndlr], faire du théâtre. Tout le monde est ensemble et créatif.» Assis en retrait, Zahir, 29 ans, confirme : «J’aime bien venir ici, on se mélange. Je ne fais rien le reste de la journée…» Leur compatriote Malang, 27 ans, un pilier du théâtre : «J’avais un groupe de danse chez moi, mais les talibans ont dit que c’était mal. Ici, au théâtre je suis très heureux, ça me donne l’impression d’avoir un travail. En France, ma vie est sécurisante. On peut comprendre qui je suis.»
Dans la salle attenante, un plus petit dôme, un atelier sérigraphie est en cours. Presque tous les jours, des objets, qu’il s’agisse de dessins ou de masques, sont créés, et les résidents peuvent venir librement fabriquer ou peindre. Toutes les créations non récupérées par leurs auteurs pourraient d’ailleurs être archivées en ligne, afin de «raconter deux ans d’histoire de migrations en Europe», dixit Joe Murphy, l’autre cofondateur du théâtre.
Charpentiers
A côté, Claire Bejanin jette un œil aux cartons de costumes tout juste livrés, un grand sourire aux lèvres. «On vit beaucoup de dons mais il y a toujours une histoire», explique-t-elle. Celle, par exemple, de la directrice technique de la Comédie-Française qui vient visiter ce théâtre itinérant et décide d’envoyer sept cartons de costumes blancs et de chutes de tissus, de différentes tailles, couleurs et matières. On pourrait aussi raconter celle de l’association de charpentiers qui est venue construire le sol en bois du théâtre, ou celle des dizaines d’artistes, comédiens, metteurs en scène, producteurs, chorégraphes, venus de France, du Royaume-Uni, du Chili ou d’Espagne, qui s’y relaient pour assurer chaque jour la tenue d’un atelier artistique.
Une histoire qui a débuté dans la zone industrielle des Dunes, à Calais (Pas-de-Calais), il y a deux ans. On appelle alors «jungle» cette vaste étendue coincée entre l’autoroute et un quartier résidentiel, où vivent des milliers de migrants qui attendent de réussir le passage vers l’Angleterre. De l’autre côté de la Manche, deux artistes britanniques pas encore trentenaires, Joe Murphy et Joe Robertson, voient aux infos les images des migrants tentant de traverser la Méditerranée ou traînant dans le campement monstre de Calais, entendent des propos «hystériques ou apeurés» sur les exilés. Ils viennent de terminer une pièce à Manchester et décident de se rendre sur place. «On voulait savoir qui étaient ces gens, raconte Joe Robertson. C’était un peu naïf. On a trouvé des gens de partout qui avaient construit des magasins, des restaurants, un sauna, des stands de barbiers… Il n’y avait pas d’endroit pour réunir tout le monde et exprimer ce qu’était ce moment particulièrement difficile de leur vie. On a créé le dôme. Chaque ville devrait avoir son théâtre.»
Mi-salle des fêtes, mi-espace de création et d’expression artistique, le dôme trouve dans la jungle de Calais son public. Pendant des mois, il devient un lieu d’échanges et de rencontres, où les traditions artistiques de chacun nourrissent l’ensemble. On voit l’acteur Jude Law y passer une tête. Tout y est créé avec et par les exilés, qui, malgré le froid, l’attente, l’espoir qui s’amenuise et la boue, trouvent une nouvelle raison de se lever le matin. «L’art doit être dans les endroits où l’art n’est pas, où l’expression est menacée, où les voix ne sont pas entendues. Dire cela ne devrait pas être vu comme radical», estiment les deux Joe, qui ont tiré de cette expérience une pièce, The Jungle, donnée au National Theatre de Londres et que le Guardian qualifie d’«extraordinaire, riche et complexe». Après que le gouvernement a démantelé le camp de Calais, fin 2016, Good Chance démonte son dôme et le remonte à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Les deux Joe s’associent à trois curateurs basés à Paris : l’homme de théâtre britannique Jack Ellis (vu à la télé dans Bad Girls, la version originale d’Orange is the New Black), l’acteur Vincent Mangano (Théâtre du Soleil) et l’artiste Elisa Giovanetti. Avant d’atterrir porte de la Chapelle, début 2018.
Devinettes
Chaque samedi, le théâtre est ouvert au public. Plus de 1 000 personnes ont déjà assisté au Hope show, ou «démonstration d’espoir», qui n’est pas tant un spectacle qu’un moment de partage. Avec des participants qui ne restent que quelques jours au centre de la porte de la Chapelle avant d’être - au mieux - transférés vers d’autres dispositifs, impossible de répéter classiquement un spectacle figé de A à Z.
Ce samedi, c’est «open mic», «micro ouvert». Pour l’occasion, on a ajouté des rideaux façon coulisses entre les deux dômes et monté une petite scène. Pendant plus d’une heure et demie, face à quelques dizaines de Parisiens - essentiellement des moins de 40 ans, mais aussi quelques dames plus âgées -, des hommes de tous âges, venus d’Afghanistan, du Soudan, du Liban et d’ailleurs, se succèdent sur scène ou au milieu du dôme pour danser, lire un poème, raconter avec drôlerie des devinettes, chanter ou s’essayer au beat-box. Joe Robertson : «Ici, on comprend au quotidien, pas juste en théorie, la myriade de façons dont on exprime notre universalité.»Un trio de jazz, venu jouer en ami, séduit la salle. Spectateurs et participants se mêlent, dansent, on n’est alors plus vraiment au théâtre. «C’était un peu chaotique, mais il y avait de la poésie. On a existé ensemble», s’enthousiasme Corentin Fila. Dehors, les voitures continuent de filer sur le boulevard sans se douter que pendant quelques heures, sous le dôme blanc, c’est une grande fête qui s’est jouée.
Pour assister au Hope Show, tous les samedis à 15 h 30 jusqu’au 31 mars, réservation indispensable par mail : hopeshow@goodchance.org.uk.
Kim Hullot-Guiot
Légende photo : Lors d’un atelier capoeira. Les migrants ne restent qu’une à deux semaines dans le centre de la Chapelle. Photo Martin Colombet. Hans Lucas
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...