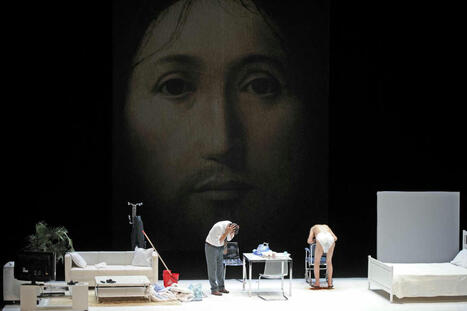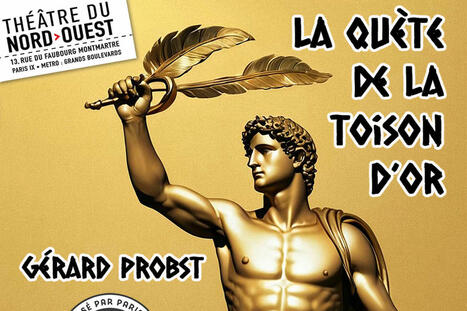Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 1, 2024 5:17 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde, publié le 28 août 2024 Dans la série d'été : « Les batailles du théâtre » (3/6). A la création en 1966, une galaxie d’opposants, notamment issus des rangs de l’extrême droite, s’en prend violemment à ce joyau noir auquel peu de metteurs en scènes osent se confronter par la suite. Mais une nouvelle génération prend aujourd’hui le relais.
Lire l'article sur le site du "Monde" https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/28/avec-la-piece-les-paravents-de-jean-genet-l-heritage-toujours-a-vif-de-la-guerre-d-algerie_6297651_3451060.html
Cernée par des cars de police, la place de l’Odéon, à Paris, est envahie par une foule de manifestants où s’affrontent deux camps : les partisans des Paravents et ses détracteurs, repérables à leurs drapeaux bleu-blanc-rouge. Ils hurlent : « Genet au poteau ! », « Genet pédé ! » D’une fenêtre du théâtre, Jean Genet les regarde. Il rit, leur lance un bras d’honneur. Le metteur en scène, Roger Blin, est à ses côtés. Il jubile aussi, mais il se tient sur le qui-vive. Chaque soir, les représentations sont perturbées, parfois très violemment, et les forces de l’ordre doivent intervenir. Annoncée comme l’événement théâtral de l’année 1966, la création des Paravents vire à l’événement politique. Jean Genet a écrit Les Paravents en 1961, mais Roger Blin attend cinq ans avant de monter la pièce. Le temps que la guerre s’achève, et de trouver un théâtre assez solide pour financer une production lourde, engageant une soixantaine de comédiens. Jean-Louis Barrault, alors directeur de L’Odéon-Théâtre de France – tout un symbole, que les adversaires de Genet ne se priveront pas d’exploiter –, accepte. Il sait qu’il risque gros. La France justement vit dans les débris de la guerre d’Algérie : Les Paravents sont créés quatre ans après les accords d’Evian qui, le 18 mars 1962, ont signé la fin de la colonisation. La pièce de Genet est habitée par des soldats, des « putains », des colons, et puis Saïd et sa mère, les plus pauvres des pauvres. Si pauvres que Saïd n’a pu s’acheter que la femme la plus laide. Il rêve de travailler de l’autre côté de la mer et de devenir riche. En attendant, il vole, indifférent au bruit du monde autour de lui, où les armes claquent. L’Algérie n’est pas citée dans Les Paravents, mais on y est, tout du moins dans un pays colonisé, au bord de l’insurrection. Genet, qui se défend d’avoir écrit une pièce politique, n’est tendre ni pour l’impérialisme des colons, ni pour la morale révolutionnaire. Pour lui, la révolte s’aliène dans la révolution. « Ne gauchissez pas ma pièce », dit-il à Roger Blin – un des signataires du « Manifeste des 121 », publié le 6 septembre 1960, qui réclame le droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. Blin connaît bien Genet. Il a créé Les Nègres en 1959. Il coupe dans Les Paravents afin de réduire la représentation à quatre heures, et décide de faire jouer sur le plateau une scène que Genet situe en coulisses : des soldats pètent sur le visage de leur lieutenant qui va mourir, pour qu’il respire une dernière fois l’air de France. C’est la scène qui va tout déclencher. Echauffourées sévères La presse est convoquée le quatrième jour. Les critiques sont tranchées, entre admiration (Le Monde, Le Figaro littéraire, Combat…) et répulsion. « Et Barrault appelle ça le Théâtre de France ! », titre Minute, l’hebdomadaire à la ligne éditoriale alors antigaulliste. Le Figaro accuse Barrault de « souiller le théâtre français ». « Je me suis fait gravement chier (comme dirait l’auteur) à la pièce du pétomane Jean Genet », persifle Le Canard enchaîné. Les milieux d’extrême droite n’attendaient que cela. Des membres de l’Organisation armée secrète, des élèves de l’école de Saint-Cyr, d’anciens combattants de 1939-1945, d’Indochine et d’Algérie… Une galaxie d’opposants lance l’attaque le soir de la douzième représentation. Ils sifflent, jettent des chaises et des bouteilles depuis les balcons. Un commando envahit l’allée centrale, lance des fumigènes. Bagarre. Un tapissier est légèrement blessé. Jean-Louis Barrault, qui joue La Voix, fait baisser le rideau de scène et prend la parole : « Au nom de la liberté humaine, je vous demande le calme. » La pièce reprend avec la réplique de Maria Casarès : « Et maintenant, causons un peu. » Les Paravents, qui ont commencé le 16 avril, sont perturbés jusqu’à la dernière, le 7 mai, avec des lancers d’œufs, de boulons ou de tomates… sans compter les menaces de mort. Les contre-manifestants s’organisent, des militants et des étudiants protègent le spectacle. Parmi eux, Daniel Cohn-Bendit et Patrice Chéreau. Les échauffourées sont sévères, mais toutes les représentations vont jusqu’au bout, devant des salles combles. Le 5 mai, Le Monde annonce que le député centriste du Morbihan Christian Bonnet demande au Parlement le retrait des subventions au Théâtre de France. Le 27 octobre, alors que la pièce est reprise depuis le 14 septembre et que des associations d’anciens combattants réclament son « retrait immédiat et définitif », la commission des finances de l’Assemblée nationale adopte l’amendement déposé par Christian Bonnet. André Malraux, alors ministre de la culture sous la présidence de De Gaulle, monte au créneau pour défendre Jean-Louis Barrault et Les Paravents. Devant les députés, il livre, le 6 octobre, un discours qui fait rêver aujourd’hui : « L’argument invoqué “Cela blesse ma sensibilité, on doit l’interdire” est un argument déraisonnable. L’argument raisonnable est le suivant : “Cette pièce blesse votre sensibilité. N’achetez pas votre place au contrôle. On joue d’autres choses ailleurs.” » Le 6 novembre, Malraux assiste à une partie de la dernière des Paravents, dont les représentations s’arrêtent plus tôt que prévu, le préfet de police de Paris déclarant qu’il ne pouvait plus assurer la sécurité. Joyau noir Il faut attendre dix-sept ans avant que la pièce soit reprise, par Patrice Chéreau, à Nanterre-Amandiers, en 1983. Pourquoi tout ce temps ? Parce que l’éclat de la création des Paravents reste dans les mémoires, et peut-être aussi, tout simplement, parce que le théâtre de Genet est un joyau noir auquel peu osent se confronter. Pas Chéreau. La guerre d’Algérie est fondatrice de son engagement à gauche. Ce fut son premier combat politique : élève au lycée Louis-le-Grand, il allait à toutes les manifestations. Qu’il présente Les Paravents l’année même où il arrive à Nanterre, là où les émigrés algériens s’entassaient dans des bidonvilles pendant la guerre d’Algérie, prend son sens. Roger Blin assiste à la première des Paravents de Chéreau, qui se donne dans la grande salle, maquillée en un cinéma décrépi. Il y a une alerte à la bombe, la salle est évacuée, puis le spectacle reprend. Deux autres alertes suivront. Aucune ne sera revendiquée. Le temps des commandos d’extrême droite est loin : la police soupçonne « un individu isolé voulant faire le malin », se souvient Philippe Coutant, l’administrateur de l’époque. Lycéen aux Ulis (Essonne), Arthur Nauzyciel vient voir le spectacle avec sa classe : « On est la génération “Touche pas à mon pote”, le mouvement né après l’élection de François Mitterrand en 1981. On parle alors des banlieues mais pas de travail de mémoire, ni de réparation. A Nanterre, je vois un plateau “colonisé” par des acteurs arabes qui jouent les Arabes, tandis que les comédiens jouant les colons sont dans la salle et les allées. Un choc. Cette inversion modifie mon regard sur la guerre d’Algérie. » Arthur Nauzyciel, 57 ans, dirige aujourd’hui le Théâtre national de Bretagne, à Rennes, et il vient de mettre en scène Les Paravents. Il a aussitôt pensé à cette pièce quand Stéphane Braunschweig, le directeur de L’Odéon-Théâtre de l’Europe (et non plus Théâtre de France) lui a proposé de faire un spectacle. Nauzyciel trouve magnifique de faire revenir Les Paravents sur leur scène natale. Nécessaire aussi : « On a besoin de fiction pour comprendre le monde, et Genet passe par la fiction. Il réinvente l’Algérie pour mettre au jour les rapports dominants-dominés, et il honore les personnages les plus misérables en leur donnant une langue fabuleuse. » Histoires familiales Une génération sépare Nauzyciel de Margaux Eskenazi, Baptiste Amann et Louise Vignaud. Chacun a consacré une pièce à la guerre d’Algérie. Plutôt que de remonter la fiction de Genet, ils préfèrent écrire eux-mêmes et fouiller le réel, relier ce qu’ils vivent aujourd’hui à ce qui s’est passé hier. « Le combat de notre génération est celui de la décolonisation, explique Margaux Eskenazi, et on ne peut pas la comprendre sans passer par la guerre d’Algérie. » Juive algérienne par sa famille maternelle, elle grandit en Seine-Saint-Denis. « Je n’avais à la maison qu’un aspect de l’histoire, celle du paradis perdu. Au lycée, toutes mes amies étaient arabes, subsahariennes ou d’outre-mer, et j’aimais cette France métissée. Mais c’était comme s’il y avait deux morceaux du puzzle qui ne pouvaient pas s’assembler. » Etudiante, Margaux Eskenazi découvre Aimé Césaire et Kateb Yacine, une autre histoire de la colonisation que celle qu’on lui racontait. En 2020, dans Et le cœur fume encore, elle recadre ce que l’on appelait « les événements », en s’appuyant sur des documents, archives et récits. « Pendant les répétitions, on s’est rendu compte que tout le monde avait un lien avec la guerre d’Algérie », constate Margaux Eskenazi. Louise Vignaud aussi. Pieds-noirs, pieds-rouges, militants pour ou contre l’indépendance : des histoires familiales, longtemps tues, sont ressorties. « Dans mon équipe, précise Louise Vignaud, il y en a un dont le grand-père fabriquait des chars, l’autre dont le père était à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. » C’est cette manifestation, suivie d’une nuit au cours de laquelle des dizaines d’Algériens furent tués par la police, que la metteuse en scène fait revivre dans la pièce Nuit d’octobre, écrite avec Myriam Boudenia et créée en 2023. « La guerre d’Algérie s’inscrit dans une histoire de la colonisation qui se traduit par une pensée raciste systémique toujours à l’œuvre. C’est pour cela que l’on s’y intéresse », explique Louise Vignaud. Baptiste Amann, lui, a été marqué par son enfance dans un quartier populaire d’Avignon, où ses parents étaient travailleurs sociaux. Il a appris la guerre d’Algérie à travers les microrécits de familles d’origine algérienne. « Je voyais comment la colonisation se poursuivait par la ghettoïsation et la stigmatisation. Mes amis étaient tiraillés entre les valeurs enseignées à l’école et celles transmises dans leurs familles. Ils me racontaient comment les questions du Moyen-Orient ou du foulard généraient des débats avec leurs parents, qui en même temps leur demandaient de s’assimiler. » En 2016, Baptiste Amann a créé le premier volet d’une trilogie, Des territoires – une sœur et deux frères qui voient leur quartier se replier sur des crispations identitaires. En 2023, il a présenté l’intégrale de sa trilogie au Festival d’Avignon, où il n’avait jamais vu de spectacle avant d’aller dans un lycée du centre-ville. « Il y avait deux mondes, comme quand j’étais enfant : ceux qui viennent des quartiers manger une glace, et ceux qui vont au spectacle. Je n’ai jamais idéalisé le théâtre dans sa capacité à changer le monde, mais je me disais : il y a encore du travail. » Ce n’est pas Jean Genet qui le contredirait. Brigitte Salino / LE MONDE Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Maria Casarès et Jean-Louis Barrault, dans la pièce de Jean Genet « Les Paravents », à Paris, le 16 avril 1966. BRIDGEMAN IMAGES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 1, 2024 4:50 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde publié le 31 août 2024 Dans la série d'été « Les batailles du théâtre » (6/6). En 1988, la pièce de l’écrivain suscite une tempête en dénonçant l’antisémitisme toujours vif en Autriche. Un sujet particulièrement sensible en France mais dont le théâtre a du mal à s’emparer.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/31/avec-place-des-heros-de-thomas-bernhard-la-dechirante-mise-en-scene-de-l-antisemitisme_6300331_3451060.html
Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. C’est un scandale magistral, à l’autrichienne. Il croise le théâtre et la politique, et éclate à l’automne 1988, avec la création d’une nouvelle pièce de Thomas Bernhard. Elle a été commandée à l’écrivain par le metteur en scène Claus Peymann, directeur du Burgtheater de Vienne – l’équivalent de la Comédie-Française – qui fête son centenaire. Seul son titre est connu : Place des Héros (Heldenplatz, en version originale), du nom de la place de Vienne où, le 15 mars 1938, une foule enthousiaste est venue acclamer Hitler après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie. Thomas Bernhard et Claus Peymann veulent que le contenu de Heldenplatz reste secret jusqu’à la première, prévue le 14 octobre, jour du jubilé. Ils demandent la discrétion la plus absolue à l’équipe de production. En vain. A Vienne, le théâtre fait partie de la vie quotidienne, et les journaux sont à l’affût. Ils annoncent que quatre comédiens du Burgtheater refusent de jouer la pièce, dont des extraits finissent par paraître : « L’Autriche est un cloaque sans esprit ni culture. » Les Autrichiens ? « Six millions et demi de débiles fous furieux. » Le président ? « Un menteur. » Le chancelier ? « Un boursicoteur. » L’antisémitisme ? « La haine des juifs est la nature la plus pure des Autrichiens (…). Il y a maintenant plus de nazis à Vienne qu’en 1938. Ils reviennent (…). Ils sortent de tous les trous (…). Ils n’attendent que le signal pour pouvoir agir tout à fait ouvertement contre les juifs. » Ces extraits mettent le feu aux poudres. Ils ravivent une blessure encore vive : l’affaire Waldheim. Né en 1918, Kurt Waldheim a mené une carrière de diplomate qui lui a valu une reconnaissance au plus haut niveau : de 1972 à 1981, il a été secrétaire général de l’ONU. En 1986, il fait campagne pour être élu président de son pays quand la presse révèle ses compromissions avec le régime nazi. Incorporé dans la Wehrmacht en 1941, Waldheim a été envoyé sur le front de l’Est où il a été blessé, puis il a été soigné à Vienne. Dans son autobiographie, Dans l’œil du cyclone (Ed. Alain Moreau, 1985), il écrit qu’il n’est pas retourné sur le front, mais qu’il est resté à Vienne où il a poursuivi ses études de droit jusqu’à la fin de la guerre. Pays bâillonné par l’hypocrisie catholique Les documents produits par les journaux le contredisent. Kurt Waldheim a servi de 1942 à 1945, son unité a été sous les ordres d’Alexander Löhr, « le boucher des Balkans », qui a commis des atrocités en Bosnie, et il a assisté à la déportation massive des juifs de Cordoue et de Salonique. Ces révélations indignent la communauté internationale et enflamment l’Autriche. Kurt Waldheim se défend en plaidant que, comme tous les « bons » Autrichiens de sa génération, il n’a fait « que son devoir ». Il est finalement élu, le 8 juin 1986, avec près de 54 % des voix, mais l’Autriche doit pour la première fois affronter son passé antisémite, qu’elle avait soigneusement enfoui. En rappelant ce passé, Place des Héros déclenche une tempête jusqu’au sommet de l’Etat. Si le chancelier, Franz Vranitzky, fait savoir que « les insultes de certaines personnes ne peuvent pas [l]’atteindre », Kurt Waldheim estime que la pièce ne devrait pas être jouée dans un théâtre national, parce qu’elle constitue « une insulte au peuple autrichien ». Le ministre des affaires étrangères réclame la censure. La ministre de l’enseignement, de l’art et du sport défend la liberté de la création, tout en précisant qu’à la place de Thomas Bernhard elle n’aurait pas écrit la pièce. Seule l’adjointe à la culture de la mairie de Vienne, qui, elle, a lu Place des Héros, dit qu’une interdiction serait catastrophique pour l’Autriche en tant que nation de culture. Ce n’est pas la première fois que Thomas Bernhard dénonce les relents nazis de son pays, avec lequel il entretient une relation ambivalente. Il a alors 57 ans, c’est une gloire européenne de la littérature qui n’a cessé, dans ses romans et récits (une quinzaine), et ses pièces (une vingtaine), de fustiger une certaine Autriche bâillonnée par l’hypocrisie catholique, engluée dans une médiocrité provinciale, dirigée par une classe politique veule. Les partisans de la censure échouent Claus Peymann, qui a créé quasiment toutes les pièces de Thomas Bernhard, s’est mis à dos une partie de la troupe du Burgtheater, qui ne supporte pas sa « clique des Prussiens » – Claus Peymann est allemand, il a été nommé à Vienne en 1984, où il est arrivé avec ses propres acteurs. Cette bronca attise le scandale autour de Heldenplatz, qui vaut à Thomas Bernhard des flots de haine. Un jour qu’il marche dans une rue de Vienne, un homme lui dit qu’on devrait l’abattre. Thomas Bernhard passe son chemin, sans lui répondre. Mais quelques jours plus tard, il riposte, à sa façon : il durcit le ton de sa pièce. « J’ai trouvé encore plus abominable », dit-il à Claus Peymann. La bataille fait rage, mais les partisans de la censure échouent. La première de Heldenplatz a finalement lieu, avec trois semaines de retard, le 4 novembre. Elle met en scène un professeur de philosophie qui a fui l’Autriche avec sa famille, en 1938. Il a passé des années en Angleterre avant de revenir à Vienne, où il s’est installé dans son ancien appartement, donnant sur la place des Héros. La pièce commence le jour de son enterrement. Il s’est jeté par la fenêtre, alors qu’il allait repartir pour l’Angleterre : il ne prévoyait pas que « les Autrichiens après la guerre seraient beaucoup plus haineux et encore plus antisémites qu’avant la guerre ». Thomas Bernhard salue à la fin de la première, qui se passe sans problème. Il a gagné, sa pièce est jouée. Ce sera la dernière. Il meurt quatre mois plus tard, le 12 février 1989. En France, Place des Héros est créé en 1991 au Théâtre national de la Colline, mis en scène par le Franco-Argentin Jorge Lavelli. En 2004, elle entre au répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène d’Arthur Nauzyciel. « Je ne voulais pas, se souvient ce dernier, réduire la pièce à une histoire de l’Autriche de Waldheim, passer pour un donneur de leçons – regardez, les Autrichiens sont de méchants antisémites – ni laisser entendre qu’on était impeccables en France. Je voulais mettre les spectateurs face à la douleur de la famille de la pièce, à travers laquelle se reproduit une histoire sans fin d’exode et d’antisémitisme. Place des Héros en parle d’une manière universelle, métaphysique. Sans cela, je ne l’aurais pas montée. » Tout est là : comment en parler ? L’universitaire Chantal Meyer-Plantureux travaille sur la question de la représentation du juif. Dans Les Enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène (Complexe, 2005), elle montre comment l’antisémitisme a contaminé la vie théâtrale des années 1880 à la seconde guerre mondiale, que ce soit dans le registre du boulevard ou celui de l’avant-garde. On ne compte pas les pièces qui furent écrites, ou détournées, pour exhiber et dénoncer le « type juif ». « Beaucoup de pièces sont traversées par la peur de l’autre, explique Chantal Meyer-Plantureux. Le juif, c’est quelqu’un dont on pense qu’il ne fait pas partie de la même culture, des mêmes coutumes – aujourd’hui, ce serait le môme de banlieue, ou le musulman. On ne le connaît pas, on ne le comprend pas, donc quand on le prend pour sujet, il est le fantasme de nos propres peurs. » « On ne traite pas assez la question en France » Après 1945, les pièces antisémites sont rarissimes. Encore plus depuis la loi mémorielle du 13 août 1990, qui réprime « tout acte antisémite, raciste ou xénophobe ». Mais dans le répertoire, il est une œuvre à part, rappelle Chantal Meyer-Plantureux, Le Marchand de Venise, de Shakespeare, « qui suscite toujours des polémiques ». En raison du personnage de Shylock, usurier juif, impitoyable avec ses débiteurs. Destin unique que celui de cette pièce, qui fut une des plus jouées dans l’Allemagne nazie, où elle a servi de propagande antisémite, en caricaturant Shylock, et qui est aussi régulièrement représentée en Israël, dans les théâtres nationaux. En France, la dernière fois où il a été à l’affiche d’un centre dramatique national, à Tours, en 2017, dans une mise en scène de Jacques Vincey, le Conseil représentatif des institutions juives de France avait distribué un tract aux spectateurs pour les mettre en garde contre l’antisémitisme de la pièce. Jacques Vincey avait discuté avec l’auteur du tract, et les choses s’étaient calmées. Stéphane Braunschweig, lui, n’a pas eu de problèmes quand il a présenté la pièce au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, en 1999. Mais les deux metteurs en scène reconnaissent que monter Le Marchand de Venise pose problème dans la France d’aujourd’hui. Surtout depuis le massacre en Israël du 7 octobre 2023, et la riposte qui a suivi. Jacques Vincey ne le reprendrait pas de peur de « rajouter de l’huile sur un feu épouvantable ». De son côté, Stéphane Braunschweig trouve que Shakespeare traite de l’antisémitisme d’une manière extrêmement subtile : « Si Shylock n’est pas un juif cupide et sanguinaire, il joue avec les clichés de l’antisémitisme. Dans un monde où la subtilité et la complexité des idées ne sont pas dominantes, on va dire, je me poserais la question avant de mettre en scène la pièce. » Margaux Eskenazi, 37 ans, est d’une génération qui la sépare de Jacques Vincey et de Stéphane Braunschweig. Et, comme nombre de femmes de son âge, elle préfère écrire ses propres pièces plutôt que de puiser dans le répertoire. Elle prépare pour 2026 la création de Kaddish, inspirée par l’œuvre du Prix Nobel de littérature le Hongrois Imre Kertész (1929-2016). « C’est parti de mon identité juive et du fait que je ne me reconnaissais pas dans ceux qui font l’amalgame entre l’antisémitisme et l’antisionisme. En écrivant sur l’Holocauste, Kertész parle de l’antisémitisme en Europe. Et c’est intéressant, parce que je trouve qu’on ne traite pas assez la question en France. » Des recherches universitaires ont montré que si, effectivement, il y a eu nombre de livres et de films sur l’antisémitisme, depuis 1945, peu de pièces ont été écrites sur le sujet. On les doit notamment à Liliane Atlan, à Armand Gatti, et surtout à Jean-Claude Grumberg. Dans le paysage théâtral, l’auteur de L’Atelier (1979), Zone libre (1990) ou La Plus Précieuse des Marchandises (2019) est l’exception magnifique. Même s’il ne se voit pas comme tel. « Pourquoi j’écris sur l’antisémitisme ? Parce je suis né en 1939 et que j’ai grandi avec. Parce que je suis fils de déporté, et que je vis dans le pays où les flics français ont arrêté mon père. » Brigitte Salino / LE MONDE Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Le dramaturge Thomas Bernhard et le directeur du Burgtheater Claus Peymann, après la première de « Place des Héros », à Vienne, le 4 novembre 1988. VOTAVA / APA-PICTUREDESK VIA AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 30, 2024 12:49 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - Publié le 29 août 2024 Série "Les batailles du théâtre (4/6) « Les batailles du théâtre » (4/6). Inspirée de l’histoire du tueur en série italien Roberto Succo, la pièce suscite une violente polémique à sa création en France en 1991. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/08/29/avec-roberto-zucco-de-bernard-marie-koltes-les-ondes-de-choc-du-fait-divers_6298574_3246.html
Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Les avis de recherche dans le métro sont rarissimes. Bernard-Marie Koltès en voit un, placardé à la station Anvers, à Paris, en février 1988. Il s’arrête, regarde. Une grande affiche, avec une photo en noir et blanc. Pas très nette. Le visage d’un jeune homme au regard pénétrant, insaisissable. Le texte précise qu’il est recherché pour le meurtre d’un inspecteur principal et pour la tentative d’assassinat d’un inspecteur divisionnaire. Il y a aussi son signalement, mais pas son nom : la police ne le connaît pas. Que se passe-t-il dans la tête de Koltès quand il voit cette affiche ? « Je ne sais pas », dira-t-il. Quelques semaines plus tard, alors qu’il regarde les informations à la télévision, il voit de nouveau le jeune homme. Filmé à Trévise, en Italie, sur le toit d’une prison, d’où il nargue et insulte journalistes et policiers. Il se déshabille, montre ses muscles, prend des poses de culturiste. Et le voilà qui saute, en direct. Il tombe dans le vide. Cette fois, Bernard-Marie Koltès sait. Il écrira une pièce. Vite. Il est pressé, il a le sida. Il demande à ses amis de chercher de la documentation. Il y en a peu. Quelques coupures dans Libération sur la cavale d’un « tueur fou ». Les quelques minutes vues à la télévision. Il faudra du temps pour que soit levée l’énigme du meurtrier recherché par toutes les polices d’Europe. Il s’appelle Roberto Succo. Né en avril 1962, à Mestre, près de Venise, il est le fils unique d’un père policier et d’une mère tricoteuse. Le 8 avril 1981, il les tue. Roberto Succo a 19 ans. Il s’enfuit. Arrêté trois jours plus tard, déclaré schizophrène par les psychiatres, il n’est pas jugé parce que « incapable d’entendre et de vouloir », selon la justice italienne, mais condamné à dix ans d’internement dans un hôpital psychiatrique. Il passe le bac et obtient, en 1985, un régime de semi-liberté pour suivre des études de géologie. Il doit rentrer tous les soirs, devrait être accompagné, mais on lui fait confiance. Un jour, il ne rentre pas. Le 17 mai 1986, Roberto Succo commence sa cavale. Il part pour Toulon, vit de vols et de petits boulots. Il va souvent en Savoie. Le 3 avril 1987, près d’Aix-les-Bains, il tue le policier André Castillo et s’enfuit avec l’arme de ce dernier. Le 27 avril, une jeune femme, France Vu-Dinh, disparaît au bord du lac d’Annecy. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le même jour, un médecin de 27 ans, Michel Astoul, disparaît près de Sisteron. Son corps décomposé est retrouvé près de Chambéry. Il a été abattu avec l’arme d’André Castillo. Le 27 octobre, Succo viole et tue Claudine Duchosal, 40 ans, au bord du lac d’Annecy. Le 28 janvier 1988, il abat l’inspecteur Morandin, à Toulon. Et ce, sans compter d’autres violences et agressions, sur l’axe Toulon-Savoie-Suisse, pays où il se réfugie un moment. La police aura beaucoup de mal à relier ces meurtres, viols et disparitions, et à en trouver le nom de l’auteur : pendant ses deux ans de cavale, Roberto Succo réussit à vivre sans autre identité que les surnoms qu’on lui attribue, « l’homme au treillis » ou « l’assassin de la pleine lune », et les prénoms qu’il se donne : Kurt, Fred ou André. Démagogie et récupérations En voyant l’avis de recherche, une adolescente de 16 ans reconnaît l’homme qu’elle a fréquenté pendant un an. Son témoignage permet d’identifier Roberto Succo, qui est arrêté à Trévise, en Italie, le 28 février 1988. C’est là qu’on le voit filmé sur le toit de la prison. Après sa chute, on le croit mort. Il est blessé. Transféré dans la prison de Livourne, il se suicide le 9 mai 1988. Il a 26 ans. Bernard-Marie Koltès ne cherche pas la vérité sur Roberto Succo, il s’en inspire pour construire un personnage. « Pour moi, expliquera-t-il, Succo est un mythe (…). Le meurtre, chez lui, est un non-sens. Il suffit d’un petit déraillement, d’une chose qui est un peu comme l’épilepsie chez Dostoïevski : un petit déclenchement, et hop, c’est fini. » Koltès garde des éléments disparates de la vie de Succo : le meurtre de la mère, l’assassinat d’un policier, l’histoire d’amour avec l’adolescente. Il puise également dans le drame de Gladbeck : en août 1988, en République fédérale allemande, deux gangsters qui avaient braqué une banque furent filmés en direct par les télévisions, pendant les deux jours de leur cavale avec prises d’otages. Koltès rencontre aussi une journaliste, Pascale Froment, qui mène une enquête sur Succo – il en naîtra un excellent livre, Je te tue. Histoire vraie de Roberto Succo. Assassin sans raison (Gallimard, 1991). Koltès intitule sa pièce Roberto Zucco, avec un Z, et non un S. Il ne la verra pas jouée. Il meurt le 15 avril 1989. La création mondiale a lieu juste un an plus tard, à Berlin, dans une mise en scène de Peter Stein. En France, la pièce est produite en 1991, au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne (Métropole de Lyon), dans une mise en scène de Bruno Boëglin. Le spectacle est ensuite joué à Nice. Il est prévu le 8 et le 9 janvier 1992, à la Maison de la culture de Chambéry. C’est là qu’éclate l’affaire. Elle commence des semaines avant ces dates, et oppose la liberté de création au respect de la vie privée – en l’occurrence la douleur des familles des victimes. C’est ce point sensible que met en avant la veuve de Michel Castillo, le policier tué près d’Aix-les-Bains. Pour elle, c’est trop tôt et trop près : quatre ans à peine séparent les meurtres commis par Succo dans la région, dont Chambéry est le centre. Dominique Jambon, le directeur de la Maison de la culture, souligne que son « premier souci est de respecter la douleur des familles » tout en rappelant qu’« il n’y a aucune glorification d’un assassin » dans la pièce. Pourtant les médiations tournent à l’aigre. Les prises de position caricaturales prennent le pas sur le débat éthique. Les syndicats de policiers embraient. Le plus violent, l’Union des syndicats catégoriels de la police, demande « l’interdiction pure et simple de la pièce », qui « fait offense à un collègue tué ». A Chambéry, l’ambiance est irrespirable avec son lot de démagogie, récupération, manipulation, surenchère… Le conseil d’administration de la Maison de la culture reçoit des appels anonymes et même des menaces de mort. Une pétition contre le spectacle est signée par 1 700 personnes, dans une ville de 55 000 habitants alors. La veuve de Michel Castillo annonce qu’elle viendra le soir de la première devant le théâtre, avec ses filles. Louis Besson, maire socialiste de Chambéry, exclut de faire intervenir la police pour protéger les représentations, que Dominique Jambon décide finalement d’annuler. Tribune salée Ce n’est pas fini. La représentation à Paris de Roberto Zucco, prévue du 5 au 29 février 1992, déclenche une tempête médiatique. La pièce doit être jouée au Théâtre de la Ville, qui appartient à la municipalité. Jacques Chirac, alors maire, et Gérard Violette, le directeur du théâtre, se rencontrent longuement, le 7 janvier, pour évoquer l’affaire de Chambéry. Il n’est pas question d’interdire la pièce, mais, deux jours plus tard, Roger Planchon, le directeur du TNP, où Roberto Zucco a été créé une bonne année plus tôt, signe une tribune salée dans Le Monde, dans laquelle il estime que les représentations sont déjà menacées par une « mafia » de policiers agissant dans l’ombre. La machine médiatique s’emballe, les enjeux politiques entre la gauche au pouvoir et la droite dominant la Mairie de Paris exacerbent le débat sur la liberté de création. Les communiqués et tribunes remplissent les pages culturelles des journaux, et finalement s’éteignent. Bruno Boëglin rappelle dans Libération que Patrice Chéreau, qui avait rendu Koltès célèbre en créant ses pièces précédentes, qualifiait celle-ci de scandaleuse, avant d’ajouter : « Ce mot peut être beau et fort, il faut l’expliquer davantage. » Trente ans plus tard, le sujet n’est pas épuisé. Au contraire, il rebondit, avec un théâtre qui aime toujours plus s’emparer du quotidien des gens et de faits divers récents : comment les mettre en scène en tenant compte de ceux qui les vivent, ou de leur entourage ? Le Français Mohamed El Khatib et le Suisse Milo Rau s’intéressent particulièrement à ces questions. Formés à la sociologie, marqués par Pierre Bourdieu, ils pratiquent un théâtre qui puise dans le réel. Pas celui que l’on est habitué à voir sur scène ; celui, plus invisibilisé, des vies anonymes ou des violences subies par des citoyens lambda dans l’Europe d’aujourd’hui. Et ils se donnent des règles pour l’aborder, la première étant de ne pas se réfugier dans la solitude de l’auteur. Qu’il mette en scène une femme de ménage, dans Moi, Corinne Dadat (2015), des supporteurs du club de foot de Lens, dans Stadium (2017), des enfants de parents séparés, dans La Dispute (2019), des parents ayant perdu un enfant, dans C’est la vie (2017), ou l’amour dans les Ehpad, dans La Vie secrète des vieux, présentée, en juillet, au Festival d’Avignon, Mohamed El Khatib écrit toujours à partir de témoignages qu’il fait valider par leurs auteurs, lesquels, sauf rares exceptions, viennent jouer leur propre rôle sur le plateau. « Théâtre de la catharsis » Désacraliser le geste artistique, remettre en question la notion de bon goût, changer le regard : tel est le credo de Mohamed El Khatib, qui se défend d’instrumentaliser les gens : « Je fais en sorte, au contraire, que chaque spectacle soit une œuvre d’émancipation, qu’elle suscite du désir chez ceux qui sont en scène. Qu’ils puissent se dire : oui, c’est possible. J’ai besoin de sentir qu’on fait presque œuvre d’utilité publique. » Milo Rau, lui, revendique un « théâtre de la catharsis ». Il n’a pas froid aux yeux. Dans Five Easy Pieces (2018), il dirige des enfants qui rejouent l’affaire Dutroux. Dans La Reprise (2018), il reconstitue le meurtre homophobe d’Ihsane Jarfi, commis près de Liège (Belgique), en avril 2012. Dans Familie (2020), une vraie famille, deux comédiens et leurs deux filles adolescentes, passe une soirée sans histoires, et se pend à la fin, comme le fit une famille, près de Calais (Pas-de-Calais), en 2007. Dans la dernière pièce en date, Les Enfants de Médée (2024), des enfants jouent les quatre filles et le fils de Geneviève Lhermitte, que leur mère a égorgés en 2007… Pour Milo Rau, le fait divers est à notre siècle ce que la tragédie fut pour la Grèce antique : il naît du hasard, comme ce hasard fou qui fit se rencontrer Œdipe et son père. Mais il ne se passe plus sous le regard des dieux : « Dans notre époque d’extrêmes solitudes, il se passe sous le regard du public. » Et avec l’accord des familles des victimes. Milo Rau ne fait pas de spectacle sans les prévenir, et il les associe au travail. Il arrive que ses pièces soient interdites. Familie l’a été aux Etats-Unis, au motif qu’elle peut inciter au suicide, La Reprise au Brésil, par certains maires proches de l’ex-président Jair Bolsonaro. Cela ne modifie pas la ligne suivie par Milo Rau : « Quelque chose a beaucoup changé depuis Koltès et Roberto Zucco, explique-t-il. L’approche est devenue beaucoup plus collective. A l’époque, un auteur pouvait écrire seul, et laisser éclater le scandale. Aujourd’hui aussi il y a des scandales, mais on les affronte ensemble, avec les victimes et leurs proches. » Brigitte Salino / Le Monde Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Roberto Succo, sur le toit de la prison de Trévise (Italie), en mars 1988. SIPA

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 28, 2024 4:12 AM
|
Par Sonya Faure dans Libération - 16 juillet 2024 La pièce plonge dans trois comparutions immédiates comme dans un cauchemar sans issue. Fuyant le réalisme documentaire, elle incarne la dureté et l’humiliation de ces procédures ultrarapides. Un corps, un ventre peut-être, une membrane rose chair qui nous enveloppe – quelle chaleur sous ce chapiteau. Un organe en tout cas qui dévore, déglutit et régurgite des hommes et des femmes vidés de leur substance, pantins dégingandés aux traits floutés. Condamnés. Les autres, avocats et magistrats en robes, défilent et nous regardent derrière des masques inquiétants tels de gros poissons le long de la paroi d’un aquarium. Avec Léviathan, créé au Festival d’Avignon, Lorraine de Sagazan s’engouffre dans la question de la violence judiciaire. Pendant plusieurs mois, avec Guillaume Poix qui signe le texte de la pièce, elle a assisté aux longues journées de comparutions immédiates, ces audiences qui font défiler des dizaines de prévenus au lendemain de leur garde à vue, accompagnés d’avocats commis d’office qui ont à peine eu le temps de prendre connaissance du dossier, devant des juges excédés par le nombre d’affaires à gérer – car alors il est plus juste de parler de gestion que de justice. Expéditives, les comparutions immédiates ne devaient être, à leur création en 1983, qu’exceptionnelles. Elles sont un lieu commun judiciaire aujourd’hui. «Un petit peuple de précaires plus ou moins violents», des hommes dans leur grande majorité, des sans domicile fixe souvent, qui se retrouvent dans une même pièce à attendre leur tour de passer dans le box. «On ne s’est pas lavé depuis plusieurs jours à cause de la garde à vue. Ça pue. La comparution immédiate, elle a une odeur», dit un triste Monsieur Loyal, le seul interprète à ne pas être masqué, dans un coin du chapiteau. L’impressionnante réussite de Sagazan est de faire avec Leviathan tout autre chose que du théâtre documentaire, tout autre chose qu’un âpre réalisme plus évident quand on parle de tribunaux. On est loin aussi de Délits flagrants, film essentiel de Raymond Depardon sur le sujet, loin et pourtant au même endroit, à ce lieu précis de la souffrance et de l’injustice qui prend ici la moiteur d’une cauchemardesque absurdité. Trois comparutions, deux hommes, une femme, se succéderont. Ils ont volé, insulté, conduit une moto sans permis. Trois fois, au terme de leur passage devant la juge, s’inscrira sur l’écran au fond de la scène, le nombre de minutes que celui-ci aura duré. Dix-neuf minutes, seize minutes, dix-neuf minutes… Trois fois leur peine s’inscrira – six mois, douze mois, huit mois de prison ferme. Et la présidente du tribunal qui ne cesse d’agrafer des documents, d’oblitérer des destins – crac, crac, crac. Double de chiffon Leviathan est une œuvre à la beauté plastique saisissante et inquiétante. Avec les masques réalistes qui redoublent leurs visages et les figent, les juges et les avocats deviennent les prêtres et prêtresses d’une terrible religion se nourrissant de sacrifices humains. Les prévenus ont les traits brouillés par des collants, comme lorsqu’on braque une banque, alors qu’ils n’ont volé que des vêtements d’enfants. Tels des zombies, un homme danse au ralenti avec son double de chiffon, une femme fait avancer avec peine la poussette d’une enfant qu’elle n’a plus. Sur l’écran, les images d’un jeune adulte zonant sur le tourniquet d’un square pour enfants redoublent avec beauté l’image du même homme, dans la salle du tribunal, qui se tortille en tentant de retenir son pantalon qui tombe – lors de la garde à vue, les policiers ne lui ont pas rendu sa ceinture. Il est d’ailleurs étonnant de pouvoir dire à quel point les acteurs parviennent à être excellents, donnant intensément à voir la singularité de leur personnage (Victoria Quesnel notamment dans le rôle de la juge pas loin de la crise de nerfs), malgré les masques et la mécanique de leur danse macabre. La pièce de Lorraine de Sagazan est une proposition forte pour envisager le monstre judiciaire, la justice pénale du quotidien tel qu’elle se donne à voir en France. On peut douter (mais c’est secondaire) de la nécessité de chanter l’une des audiences, en un Opéra de quat’sous tragique, discuter du rôle de cet homme sans masque, le seul à ne pas être un acteur professionnel mais un témoin distillant les éléments documentaires. Que dit-il aussi ? Qu’il ne faudra pas compter sur lui pour jouer son rôle, qu’on ne rattrape pas le temps qu’on a perdu à jamais. «J’utiliserai pas le théâtre pour rejouer ma vie, il n’y aura pas de restitution, pas de réparation.» Le voilà qui ferme le spectacle, ce grand carnaval triste et morbide. Aucune issue alors hors du chapiteau de chair, autre qu’un long, très long silence. Léviathan de Lorraine de Sagazan, dans le cadre du Festival In d’Avignon, les 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 18heures au Gymnase de lycée Aubanel à Avignon. Puis en tournée. Le spectacle s’accompagne de l’installation Monte di pieta, de Lorraine de Sagazan et Anouk Maugein, à la Collection Lambert d’Avignon jusqu’au 21 juillet. Les 20 et 21 juillet, entre 11h et 16h30, l’installation est activée par une performance poétique mêlant récits et improvisation à travers des textes de Laura Vazquez. Sonya Faure / Libération Légende photo : Trois comparutions, deux hommes, une femme, se succéderont. Ils ont volé, insulté, conduit une moto sans permis. (Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 27, 2024 12:30 PM
|
Par Joëlle Gayot dans la série d'été du Monde « Les batailles du théâtre » (1/6), article publié le 26 août 2024 En 2011, le metteur en scène affronte la colère de groupes religieux extrémistes avec « Sur le concept du visage du fils de Dieu ». Cette contestation fait entrer le théâtre dans un champ de mines où, accusé d’offenser des croyances ou des minorités, il doit rendre des comptes. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/26/au-theatre-le-retour-d-une-censure-qu-on-croyait-evanouie-avec-l-italien-romeo-castelluci_6295680_3451060.html La police qui protège des artistes et veille sur leurs spectacles ? Cette scène ne s’est pas déroulée sous une autocratie mais à Paris, la ville des Lumières. Elle n’a pas eu lieu une fois mais trois fois. Elle ne se conjugue pas au passé antérieur mais a surgi en 2011 puis en 2014, sur le parvis de théâtres. Le 20 octobre 2011, au Théâtre de la Ville, à Paris, l’artiste italien Romeo Castellucci présente Sur le concept du visage du fils de Dieu, un spectacle précédé d’une rumeur sulfureuse. Ce créateur de fastueuses cérémonies plastiques s’adonnerait au sacrilège en insultant la religion catholique. On voit dans sa pièce un vieillard dysentérique nettoyé par son fils. Et puis, affiché en fond de plateau, le visage géant du Christ : le Salvator Mundi d’Antonello de Messine, un tableau de la Renaissance. L’image est bombardée de pseudo-grenades par des enfants ; escaladée et lacérée, la peinture finit maculée de faux excréments. Jugé blasphématoire par des chrétiens fondamentalistes qui ont tenté – en vain – de le faire interdire par la justice, le spectacle va se heurter, chaque soir, à des perturbations. « C’était une attaque fasciste », juge Romeo Castellucci, qui se souvient d’un « tribunal idéologique » devant lequel il fallait tenir coûte que coûte. « Si nous avions renoncé, ils auraient gagné. La défense de l’art, quel qu’il soit, est un principe fondamental. » Fondamental mais contesté avec virulence par Civitas, mouvement d’extrême droite et catholique intégriste (dissout par le gouvernement en octobre 2023). Certains de ses membres payent leur place, s’introduisent dans le théâtre et envahissent le plateau en brandissant une pancarte : « Christianophobie, ça suffit ! » A l’extérieur, sur la place du Châtelet, leurs camarades se prosternent, les mains jointes, quand ils ne balancent pas des boules puantes ou du gaz lacrymogène pour dissuader le public d’entrer. Si aucune représentation n’est annulée, un scénario proche du chaos se réitère chaque soir, contraignant la direction du Théâtre de la Ville à placer les représentations sous la protection de CRS. Intégristes ulcérés Deux mois plus tard, le 8 décembre 2011, bis repetita à Paris. Rodrigo Garcia et sa pièce Golgota Picnic, présentée au Théâtre du Rond-Point, sont dans le collimateur. Civitas ne digère pas la charge au vitriol de ce trublion argentin fustigeant un christianisme coupable à ses yeux d’avoir sacrifié ses valeurs humanistes. L’auteur et metteur en scène, qui rebaptise Jésus « El Puta Diablo » (« la pute du diable »), n’y va pas de main morte. Sur la scène, un comédien est allongé bras en croix. Autour de lui, un amoncellement de petits pains. Sur son corps, une plaie dans laquelle pullulent les billets de banque. Une centaine d’intégristes ulcérés viennent s’agenouiller devant la porte du Rond-Point. Au soir de la première parisienne, 800 policiers veillent. L’entrée du public s’effectue au goutte-à-goutte. « J’ai honte de présenter une œuvre d’art avec de telles mesures de sécurité », confiera Rodrigo Garcia. Trois ans plus tard, le 27 novembre 2014, alors que la nuit tombe sur le Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), des manifestants massés derrière des barrières attendent les visiteurs du spectacle Exhibit B, du Sud-Africain Brett Bailey. Ils brandissent des pancartes : « Exhibition pour les privilégiés », « Respectez nos ancêtres », « Non au racisme déguisé », « Décolonisons les imaginaires ». Il ne s’agit pas, cette fois, de catholiques d’extrême droite mais de militants racisés ou décoloniaux, souvent de gauche, qui exigent l’arrêt d’un spectacle qu’ils jugent raciste. Ils vont même en justice mais seront déboutés. Ils dénoncent aussi un artiste qui s’approprie leur histoire. Il est vrai que Brett Bailey, concepteur d’une performance dans laquelle il entend dénoncer le colonialisme, est Blanc. Dans les sous-sols du théâtre, il a installé douze « tableaux vivants », soit des performeurs et comédiens noirs, certains à moitié nus, dans des rôles d’esclaves ou représentant des scènes issues de l’histoire coloniale et postcoloniale. « Zoo humain » La déambulation s’accomplit dans un silence total imposé par Bailey mais, à l’extérieur, le vacarme fait rage. Les manifestants, en majorité des afro-descendants, se disent indignés par un « zoo humain » qui donne des Noirs une image dégradante et confisque leur douleur. Des membres de la Brigade anti-négrophobie font le coup de poing, entraînant l’annulation d’une des représentations. Les forces de l’ordre restent aux aguets jusqu’au dernier jour du spectacle. Romeo Castellucci, Rodrigo Garcia, Brett Bailey : en trois ans, trois artistes d’envergure internationale accusent le coup de la contestation et sont sommés d’interrompre leurs spectacles. Murs de CRS à l’entrée des salles, portiques de sécurité, fouille des sacs : le spectateur a l’impression de franchir la douane. L’art entre dans un nouvel âge. La décennie qui suit verra des dizaines d’œuvres ou de spectacles pris dans des polémiques ou des tentatives de censure, pilotées par des groupes ou des communautés arguant ici de leurs identités bafouées, plus loin de leurs croyances profanées, dénonçant ailleurs des appropriations culturelles. Les exigences qui pleuvent depuis la société civile sifflent la fin de la partie pour la liberté de création. Le théâtre se heurte à ceux qui s’estiment, par sa faute, victimes d’abus, de trahisons ou de dépossessions. Les contestataires se recrutent partout dans l’éventail du champ politique, de l’extrême droite à la gauche radicale. Une palette trop large pour que les luttes y soient amalgamées. Tout oppose en effet un catholique intégriste, pour qui Dieu est intouchable, et un afro-descendant excédé par l’usage d’un « blackface ». Basculement vertigineux Selon Sylvie Chalaye, historienne et anthropologue, les manifestations contre le spectacle Exhibit B marquent un tournant fondamental. Car elles corrigent un retard historique : « Dans les années 1960, le metteur en scène Jean-Marie Serreau a construit une troupe cosmopolite de onze nationalités. Il voulait travailler à la décolonisation des imaginaires, faire entendre la voix des afro-descendants. Il a monté des textes d’Aimé Césaire ou de Kateb Yacine. Mais à sa mort, en 1973, tout se referme : la France traverse une crise économique, le chômage s’envole, on invente des questions migratoires liées aux enjeux économiques. Le théâtre se replie. Ne restent alors que Peter Brook et Ariane Mnouchkine pour encourager la diversité au théâtre. » Sylvie Chalaye, à qui on doit l’essai Race et théâtre. Un impensé politique (Actes-Sud, 2020), dénonce depuis longtemps l’usage du « blackface » et les successions d’acteurs blancs engagés pour jouer des Noirs (par exemple le rôle-titre d’Othello, le général maure shakespearien). Elle milite aussi pour la présence de Noirs sur scène et à la direction des théâtres. Pour l’historienne, les incidents de 2014 devant le Théâtre Gérard-Philipe résultent d’un désir qui a enfin pu et su s’exprimer : « C’était une levée de boucliers d’afro-descendants de France révoltés dont le ras-le-bol s’est traduit par une explosion de colère. Comment ne pas les comprendre, alors que l’installation de Brett Bailey, sous couvert d’évoquer la souffrance des personnes racisées, confisquait aux artistes noirs l’expression même de leurs douleurs ? En transformant des acteurs ou des figurants en objets, pour le plaisir de spectateurs en majorité blancs, en posant de surcroît ce geste à Saint-Denis, ville multiculturelle, Bailey a mis le feu aux poudres. Cette réaction contre lui a été salvatrice. » Salvatrice, peut-être. Mais assortie d’actions dont la radicalité peut inquiéter. Qui aurait cru qu’au XXIe siècle réapparaîtrait sur les scènes le couperet de la censure ? Suivant un basculement vertigineux, ce n’est plus l’Etat que l’on retrouve à la manœuvre pour interdire des œuvres (depuis juillet 2016, le principe de la liberté de création est inscrit dans la loi), mais des groupes divers qui font pression, menacent sur les réseaux sociaux, vont en justice parfois, en appellent à une « censure militante ». « Guérillas culturelles » A la différence de Sylvie Chalaye, l’universitaire Isabelle Barbéris ne fait pas de distinction : « Les censures de droite et de gauche ont tendance aujourd’hui à se recouper. Cette conjoncture entre les extrêmes impose une forme de cadre moral sur les œuvres. » Autrice de Censures silencieuses (à paraître en octobre aux éditions PUF), l’essayiste observe avec inquiétude les soubresauts d’un microcosme secoué par des « guérillas culturelles » où le jeu consiste à toujours accuser l’autre. Aussi Isabelle Barbéris dénonce tout autant « la censure qui défendrait la juste représentation de minorités dominées » que « celle émanant de groupements d’intérêts réactionnaires et conservateurs ». Entre ces deux pôles prospère désormais une sorte de chaos où l’art est pris en tenaille, tout en devant rendre des comptes. Dernier exemple en date : la représentation du banquet de Bacchus à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques conçue par l’homme de théâtre Thomas Jolly. Le corps nu et peint en bleu, Philippe Katerine prenait la pose au milieu d’un groupe de drag-queens. Confondu avec une parodie de la Cène (le dernier repas du Christ), ce tableau s’est attiré les foudres de l’extrême droite française et a choqué la Conférence des évêques de France qui a déploré des « scènes de dérision et de moquerie du christianisme ». Les partis pris artistiques de la cérémonie ont à ce point attisé les haines au point que Thomas Jolly, injurié et menacé de mort sur les réseaux sociaux, a porté plainte pour cyberharcèlement. Planant au-dessus de ce champ de mines se profile le spectre d’une autocensure aiguisée par la peur de blesser ou celle d’être pris dans une polémique. « L’autocensure est galopante. Elle se repère dans l’uniformisation des programmations », affirme Isabelle Barbéris, pour qui « les représentations sont de plus en plus dans le discours et de moins en moins dans l’image. Cela génère un art parfois donneur de leçons ». Faudra-t-il désormais apposer aux esthétiques transgressives un cartel explicatif ? « Dans une époque d’immense incertitude, nous projetons sur les œuvres d’art notre besoin de reconnaissance. Nous refusons la médiation par l’image qui dérange ou qu’on ne reconnaît pas », constate Isabelle Barbéris. Pour elle, ce climat délétère découle d’une absence regrettable : celle d’un Etat qui, n’ayant aucune politique ou vision culturelle, renonce peu à peu à son service public d’art et de création. « L’art produit une pensée, une pensée produit une critique, une critique produit une conscience », rappelle Romeo Castellucci. Cette belle suite d’évidences n’a-t-elle pas la tête sur le billot de l’époque ? Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Gianni Plazzi et Sergio Scarlatela dans « Sur le concept du visage du fils de Dieu », de Romeo Castellucci, lors du festival d’Avignon, le 19 juillet 2011. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 25, 2024 5:12 PM
|
Rentrée théâtrale en Ile-de-France - Une sélection pour le mois de septembre
Sélection (nécessairement subjective et forcément incomplète) élaborée par Alain Neddam pour la Revue de presse théâtre A partir du 27 août : A partir du 29 août : Samedi 31 août A partir du 1er septembre : A partir du 4 septembre : A partir du 6 septembre : A partir du 12 septembre : A partir du 13 septembre : A partir du 13 septembre : Les 13, 14 et 15 septembre : A partir du 14 septembre : A partir du 16 septembre : A partir du 18 septembre : A partir du 18 septembre : A partir du 19 septembre : A partir du 20 septembre : Les 20 et 21 septembre : A partir du 20 septembre : A partir du 21 septembre : Les 21 et 22 septembre : A partir du 23 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 25 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : les 26 et 27 septembre : A partir du 27 septembre : le samedi 28 septembre : le samedi 28 septembre : - Documenter l'intime et performer le réel
Journée Écho du monde #1

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 25, 2024 3:48 PM
|
Par Martine Robert dans Les Echos - 23 août 2024 Méconnu car noyé derrière le jardin Shakespeare, au sein du Pré-Catelan dans le bois de Boulogne, cet écrin bucolique a été confié pour cinq ans à la compagnie Théâtre Irruptionnel. Avec 120 levers de rideaux aux beaux jours et 5.000 spectateurs, des résidences d'écriture, des lectures, des répétitions ouvertes au public, le théâtre de verdure veut s'affirmer dans le paysage culturel de l'Ouest parisien. Un été intense pour Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon, cofondateurs de la compagnie Théâtre Irruptionnel. Depuis le 1er juin et jusqu'au 22 septembre, ils animent le théâtre de verdure dans le jardin Shakespeare, au Pré-Catelan lové en bordure du bois de Boulogne , à Paris. Le tout mené avec énergie, talent et engagement. La Ville de Paris en est consciente, qui a reconduit le tandem pour cinq ans aux commandes de ce théâtre de verdure. « Nous sommes un théâtre saisonnier aux 120 levers de rideau, pluridisciplinaire, ludique, populaire, sensible aux questions de parité, de diversité, d'accessibilité. Un théâtre multigénérationnel, pour les promeneurs de passage comme pour les connaisseurs, un lieu d'échanges convivial », pointent les codirecteurs. Dès leur nomination en 2021, Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, ont fait une large place à la création contemporaine - tout en gardant la dimension classique inhérente au lieu. « Il nous a semblé important d'imaginer des spectacles spécifiquement pensés pour ce lieu atypique. Nous passons commande à des auteurs et organisons des bourses et des résidences d'écriture. Le théâtre de verdure réinterroge en permanence nos modes de conception, de production et de diffusion », insiste Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre qui lui-même a écrit « La Petite Histoire secrète du bois de Boulogne » en s'informant auprès des jardiniers du Pré-Catelan, d'historiens du site, ou de gestionnaires de la forêt. « Un théâtre ouvert, en plein air, pendant l'été, casse les codes, il est moins intimidant qu'une salle fermée, et même apaisant. Et avec des tarifs de 8, 10 et 15 euros, des lectures gratuites, des répétitions accessibles au public, c'est un vrai outil de démocratisation culturelle. Mais le travail est énorme pour faire connaître le lieu, d'autant que la signalétique au Pré-Catelan est très stricte », insiste Lisa Pajon qui aimerait la mise en place de navettes avec l'aide de la Ville, à l'instar de celles qui desservent la Cartoucherie au bois de Vincennes. « Pour nous c'est trop lourd à financer, mais nous incitons au covoiturage de retour », assure-t-elle. Un théâtre ouvert, en plein air, pendant l'été, casse les codes, il est moins intimidant qu'une salle fermée Lisa Pajon Cofondatrice de la compagnie Théâtre Irruptionnel Le modèle économique est en effet fragile. Selon les codirecteurs, le budget est d'environ 120.000 euros dont 70.000 euros de la Ville de Paris, et 25.000 euros par an de la région Ile-de-France. L'Etat est présent via la DRAC Ile-de-France avec une aide à la transmission de 7.000 euros. Le reste provient de la billetterie, de la buvette et de la librairie. L'an dernier, 5.000 entrées ont été enregistrées, soit une hausse de 40 % en un an. « Nous sommes ancrés sur le territoire, désireux de créer un écosystème culturel dans l'Ouest parisien où il existe moins d'équipements subventionnés que dans l'Est », précise Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. C'est en 2000, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de la Ville de Paris, que Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre imaginent leur compagnie. Le duo a collaboré avec beaucoup de théâtres subventionnés (Maison de la culture de Bourges ou d'Amiens, Nouveau Théâtre de Montreuil, Cité internationale…) avant de candidater pour sa propre scène. Le théâtre de verdure du jardin Shakespeare a, depuis son inauguration en 1853, inspiré nombre d'artistes. Quand Nestor Roqueplan, futur directeur des théâtres des Nouveautés et des Variétés, obtient la concession du Pré-Catelan, il transforme ce marécage en un parc d'attractions avec vélodrome, aquarium, et Théâtre aux fleurs de 1.800 places qui deviendra au XIXe siècle un haut lieu de la création. Le compositeur Claude Debussy s'y produira. Mais le rideau se referme en 1900 sur cette scène qui tombe à l'abandon. Plantations inspirées des oeuvres de Shakespeare En 1952, Robert Joffet, le conservateur en chef des jardins de Paris, transforme l'ancien Théâtre aux fleurs en « jardin Shakespeare » de 2.000 mètres carrés dont les plantations s'inspirent de cinq oeuvres du dramaturge anglais : à l'entrée, la forêt d'Arden, en hommage à la comédie « Comme il vous plaira » ; sur la droite, une île méditerranéenne aux plantes odoriférantes pour illustrer « La Tempête » ; à gauche, la lande écossaise de « Macbeth ». Derrière la scène, la forêt féerique du « Songe d'une nuit d'été » ; enfin « Hamlet » reconnaissable au saule pleureur d'Ophélie et au ruisseau dans lequel elle se noie. Cet écrin « architecturé par la nature », avec sa haie semi-circulaire de charmes, son chêne rouvre centenaire au centre, son plateau de 22 mètres et sa fosse d'orchestre, s'inscrit dans une longue tradition de l'art des jardins, offrant 240 places assises et 400 debout. Y venir est une expérience sensorielle et esthétique. « Ce type de théâtre est en phase avec les préoccupations écologiques, économiques, et sanitaires actuelles », souligne Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. La compagnie compte d'ailleurs devenir un pôle ressource autour des théâtres de verdure et collabore activement avec le Resthever qui les regroupe au niveau européen. Il en existe une trentaine en région parisienne, environ 190 en France et 5.000 sur le Vieux Continent. Martine Robert / Les Echos

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 23, 2024 8:56 AM
|
Par Yann Plougastel dans Le Monde - 23 août 2024 Rock, révoltée, radicale, la pasionaria française est morte dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 82 ans. Elle arrivait sur scène les poings tendus. En noir. Des pieds à la tête. Avec une frange qui lui mangeait les yeux. Le regard d’une combattante. Le sourire d’une amante. La voix d’une militante. Les mots d’une magnifique perdante. Comme aurait pu l’écrire Leonard Cohen si elle avait été une égérie warholienne du Chelsea Hotel. Sauf qu’elle était debout. Plus pasionaria tumultueuse qu’éphémère superstar. Panthère prête à bondir sur tout ce qui peut faire mal ou salir la beauté. Rock. Révoltée. Radicale.
En l’écoutant, en la voyant, on se disait que cette femme-là ne devait rien à personne, quitte à en payer le prix. Elle était la Ribeiro, sœur des sans-grade, de ceux qui ont appris leur enfance face aux fumées d’usine, de ces écorchés vifs qui ont connu la douleur avant le plaisir. Mais aussi, la Grande Catherine, sorte de Janis Joplin saisie par Baudelaire, de Nico emportée par Rimbaud, de Piaf électrocutée par Apollinaire. Catherine Ribeiro est morte dans la nuit du jeudi 22 août au vendredi 23 août, selon une annonce de son entourage à l’Agence France-Presse. Elle était âgée de 82 ans.
« Les paroles ne sont qu’un accessoire, je préférerais qu’on en arrive presque à des onomatopées pour remplacer les paroles. On le fera peut-être. Il faudrait que la voix serve d’instrument… Ce que je cherche à faire, c’est détruire complètement la chanson classique, avec refrain et couplets réguliers », disait-elle dans un entretien en 1970. C’était un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Sur des musiques au bord de la transe qui provoquaient d’étranges bacchanales dans les villes et les campagnes, Ribeiro et ses camarades d’Alpes en appelaient à la liberté, à l’insurrection, à l’amour, à la poésie, à la colère…
Pendant dix ans, de 1970 à 1980, la télévision les ignora, la radio les bouda, la grande presse les regarda de haut. Ce qui ne les empêcha pas de donner des milliers de concerts, de remplir des salles aussi prestigieuses que l’Olympia ou Bobino, de vendre des dizaines de milliers d’exemplaires de leurs albums. La marginalité, ils ne la revendiquaient pas, elle leur fut imposée.
Rage inextinguible
Au départ, il y a une petite fille sauvage, qui grandit dans une famille modeste d’origine portugaise, à Saint-Fons, dans la banlieue lyonnaise. Père taiseux, ouvrier et proche des communistes à Rhône-Poulenc. Mère illettrée, qui la frappe et ne la comprend pas, mais lui transmet sa belle voix de chanteuse de fado. « J’ai appris ma naissance/A travers les lignes/D’un discours anguleux/Sur l’échec de l’amour/J’ai appris mon enfance/Face aux fumées d’usine/Par les chemins de grèves/Empruntés par mon père », chantera-t-elle dans La Vie en bref.
Ne pouvant ni pleurer ni rire, elle se rebelle contre ce monde sans tendresse et se retrouve quelques mois dans un hôpital psychiatrique où on lui inflige des électrochocs. D’où une rage, une révolte inextinguibles. « J’ai quitté le monde pitoyable, absurde et misérable des vivants du présent pour celui de l’imaginaire, avec Hugo, Aragon, Breton, Eluard, Cocteau, puis Lautréamont, Apollinaire, Soupault, Lorca », expliquera-t-elle dans son autobiographie, L’Enfance (L’Archipel, 1999). Paris prend dans ses bras cette longue jeune femme brune de 20 ans. Elle est chanteuse, tendance yéyé, reprend des titres de Bob Dylan, mais aussi mannequin, puis comédienne dans Les Carabiniers (1963), de Jean-Luc Godard, et dans Buffalo Bill, le héros du Far-West (1965), de Mario Costa.
Sur le tournage des Carabiniers, elle a rencontré un guitariste beatnik mutique, Patrice Moullet (frère du réalisateur Luc Moullet). Ils tournent ensemble le dos au show-biz et se lancent dans des expérimentations musicales, qui ressemblent à celles menées en Grande-Bretagne ou en Allemagne de l’Ouest par Pink Floyd, Van der Graaf Generator, Ash Ra Tempel et Tangerine Dream. Emportés par le souffle libertaire soulevé par Mai 68, Ribeiro et Moullet rejoignent une des premières communautés hippies de France, installée à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), dans une ancienne usine, au 2 bis, quai du Port.
Ils y enregistrent en 1969 un premier album sous le nom de Catherine Ribeiro + 2 bis, où figurent huit morceaux oscillant entre folk médiéval et envolées planantes, grâce à d’étranges instruments comme le cosmophone, une sorte de lyre électrique, et une trompe marine. L’année suivante, adieu 2 bis et communauté, place à Alpes : « Le nom d’Alpes s’est imposé, car, pour admirer le sommet d’une montagne, il faut lever le regard, c’est solaire. » Les sept morceaux qui composent l’album n° 2 de Catherine Ribeiro + Alpes torpillent les codes de la chanson. Long de dix-huit minutes et trente-six secondes, Poème non épique est la plainte douloureuse d’une femme de 30 ans sur le point d’être quittée par son compagnon.
Vivre pour ses idées
Il y a déjà en germe tout ce qui va constituer l’originalité du groupe. Une voix ample, solennelle, impérieuse, vibrante, enflammée, mordante, caressante. Ou d’une étonnante sensualité lorsqu’elle interprète, en portugais, Ballada das aguas, un fado de José Afonso, l’auteur de Grândola, vila morena, l’hymne de la « révolution des œillets » en 1974. La musique de Patrice Moullet semble une symphonie électrique insistante, où de lentes phrases d’orgue se déploient sur un tapis de percussions électroniques, appels à une prière païenne et à une transcendance échevelée. Ame debout (1971), Paix (1972), Le Rat débile et l’homme des champs (1974), Libertés ? (1975), Le Temps de l’autre (1977), où la chanteuse apparaît sur la pochette en Mona Lisa avec un joint à la bouche, approfondiront ce style, même si de nouveaux musiciens viennent s’associer au duo.
Il en reste des moments d’anthologie comme Paix. L’ère de la putréfaction (concerto en quatre mouvements !), Poème non épique n° III (concerto alpin en trois mouvements et un tombé) (22 minutes et 37 secondes…) ou Cette voix, avec ce refrain inouï : « J’ai chanté pour que vive l’amour/Un clitoris dans la gorge/J’ai joui de tous les plaisirs. » En rouge et noir, vigie scrupuleuse du sentiment amoureux et des passions politiques, Catherine Ribeiro clame son refus de l’indifférence, de la solitude, de l’oppression, de la mort, et la nécessité de vivre pour ses idées.
Deux albums suivront, Passions (1979) et le funky La Déboussole (1980), aux titres plus courts et plus classiques, où elle module de plus en plus sa voix, laissant percer une profonde humanité, comme dans Frères humains ou le torrentiel Tous les droits sont dans la nature (« Le droit de baiser, le droit de fondre en larmes, (…) le droit de l’arbre face à la tronçonneuse »). Abandonnant un instant sa posture de guerrière, elle exprime sa douleur d’être marginalisée : « J’ai mal à mon chant qui n’en finit pas de hurler/Pourquoi ces censures à mon égard/Que vous ai-je fait ? » (Détournements de chants). Ne pas partir ne pas mourir, chanson au sens strict du terme, annonce l’orientation qu’elle donnera ensuite à sa carrière sans Alpes et sans Patrice Moullet, en reprenant Brel, Ferré, Ferrat ou Manset.
Les décès successifs de sa fille Ioana (1971-2013) et de son mari, Claude Démoulin (1939-2009), ancien maire socialiste de Sedan, la poussèrent à s’enfermer chez elle, dans une maison en plein bois, à la frontière franco-allemande. Deux ultimes albums, Fenêtre ardente (1993) et Catherine Ribeiro chante Ribeiro Alpes, Live intégral (2007) témoignèrent qu’elle n’avait pas pour autant renoncé à changer le monde.
Yann Plougastel / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 2:45 PM
|
Par Mylène Wascowiski, publié par le magazine Geo le 22 août 2024 Lors de fouilles au cœur du théâtre St George’s Guildhall, dans le comté de Norfolk en Angleterre, des archéologues ont découvert la présence d’une arche vieille de 600 ans. Celle-ci aurait, par le passé, mené à une loge utilisée par Shakespeare lui-même. "Il est tout simplement stupéfiant qu’une légère bosse ou une forme étrange dans le mur se soit révélée être quelque chose de franchement extraordinaire." Tim FitzHigham, directeur artistique du théâtre anglais St George’s Guildhall, À King’s Lynn dans le comté de Norfolk, semble toujours sous le choc de la découverte. Lors de récentes fouilles archéologiques menées au sein du théâtre, une arche vielle d'au moins 600 ans a été retrouvée derrière deux couches de plaques de plâtre et un mur de briques, datant lui du XVIIIe siècle. Selon les archéologues à l’origine des recherches, l'arche aurait mené par le passé à la loge utilisée par Shakespeare et ses acteurs en tournée à King’s Lynn, rapporte The Guardian. Une loge où se changeaient les acteurs du théâtre Les fouilles ont débuté suite à la découverte d’une forme "étrange" dans un mur du théâtre situé au rez-de-chaussée. En retirant les plaques de plâtre et le mur de briques qui recouvraient le mur, les archéologues en charge des fouilles ont découvert une arche vielle de 600 ans. Celle-ci aurait, selon Jonathan Clarke, archéologue ayant participé aux recherches, conduit à une "salle de taille moyenne et de statut inférieur" et n’aurait probablement été, à l’époque, recouverte que par une tenture. Une découverte "ahurissante", selon les mots du directeur artistique du théâtre, Tim FitzHigham, qui estime que l’arche retrouvée "doit être antérieure à 1405 car le toit médiéval de la salle est soutenu au-dessus". "Nous avons ici une porte qui aurait donc certainement été là dans les années où nous pensons que Shakespeare a joué au théâtre et, selon toute vraisemblance, c’était la porte d’une pièce où les acteurs se changeaient et stockaient les accessoires", explique-t-il dans les colonnes de The Guardian. "Elle leur aurait donné un espace privé où ils pouvaient poser des affaires, se changer puis monter l’escalier pour apparaître au premier étage dans leur costume" précise Jonathan Clarke. Avant cela, cette porte aurait mené selon FitzHigham à une sorte de "salle de vestiaire" pour les membres les plus hauts placés de la guilde de St George : "Cette salle était utilisée par les membres les plus haut placés de la guilde pour s’habiller avant de festoyer à l’étage (…) Les guildes, apparentées aux clubs de membres des années 1400, ont cessé d’utiliser la salle, et la pièce a probablement pris le rôle de vestiaire ou de "salle de repos" pour les acteurs en visite." Le plus ancien théâtre en activité du Royaume-Uni Le St George’s Guildhall est le plus ancien théâtre en activité du Royaume-Uni, rappelle The Guardian. Considéré comme le plus grand hall de guilde médiéval intact d’Angleterre, le théâtre fait aujourd’hui l’objet d'importants travaux de conservation. Le lieu, qui a accueilli sa première représentation en 1445, a été le théâtre d’événements culturels majeurs du pays : à la fin des années 1500, les Queen Elizabeth’s Men, troupe d’acteurs formée sur ordre de la reine Tudor en 1583, y auraient notamment joué une dizaine de fois. En 1592 ou 1593, Shakespeare et sa troupe y auraient également joué alors que les théâtres de Londres étaient fermés en raison de l’épidémie de peste. C'est à cette époque que le dramaturge et ses acteurs auraient donc pu emprunter l'arche fraichement découverte. Selon des recherches menées l’année dernière, le théâtre accueillerait également des lames de plancher provenant d'une scène foulée par le poète. Le St George’s Guildhall semble avoir encore de nombreux secrets à révéler. Mylène Wascowiski / GEO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 11:32 AM
|
par LIBERATION et AFP le 22 août 2024 L’actrice Charlotte Arnould avait porté plainte contre le comédien de 75 ans en 2018. Elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier à Paris. Le parquet de Paris a demandé un procès pour viol contre Gérard Depardieu, révèle une source proche du dossier ce jeudi 22 août. Le ministère public a requis le 14 août le renvoi devant la cour criminelle départementale de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, précise la même source, confirmant une information de BFMTV. Il revient désormais à la juge d’instruction chargée de ce dossier d’ordonner ou non un procès. Ces réquisitions «sont le résultat d’une longue instruction qui a permis de rassembler les éléments qui corroborent la parole de ma cliente», a réagi auprès de l’AFP Me Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de Charlotte Arnould. «Pour elle, c’est un immense pas en avant plein d’espoir dans l’attente de l’ordonnance du juge d’instruction qui clôturera l’instruction». En août 2018, la comédienne Charlotte Arnould – aujourd’hui âgée de 28 ans – avait porté plainte contre l’acteur de 75 ans, qu’elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier, situé dans le 6e arrondissement de la capitale. En juin 2019, le parquet de Paris avait classé sa plainte sans suite, au motif que les faits paraissaient insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnould avait alors déposé, en mars 2020, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, laquelle entraînait la saisine d’un juge d’instruction. Fin juillet 2020, le parquet de Paris avait requis l’ouverture d’une information judiciaire après réexamen de la procédure et, en décembre 2020, l’acteur était mis en examen pour «viols» et «agressions sexuelles». Accusé par d’autres femmes de violences sexuelles, Gérard Depardieu conteste les accusations. «Jamais au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme», avait-il affirmé en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould. L’acteur sera aussi jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker, «Les volets verts», en 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 3:25 AM
|
Par Rafaële Rivais dans Le Monde - 21 août 2024 La faute d’imprudence commise par la victime exonère l’organisateur de sa responsabilité à hauteur de 80 %.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/argent/article/2024/08/21/quand-la-spectatrice-en-retard-chute-dans-l-escalier-de-la-salle-de-spectacle_6288609_1657007.html
Quand on va au théâtre, mieux vaut arriver à l’heure. Mme X l’a appris à ses dépens, le 26 mai 2019 : arrivée en retard au spectacle qu’organise l’Association pour l’animation d’Yzeure et du Bourbonnais, auquel elle accompagne sa petite-fille, elle descend, dans l’obscurité, l’escalier qui conduit à la salle et rate une marche. Elle se blesse aux deux poignets. Considérant que le dispositif de sécurité de l’amphithéâtre était défaillant, elle demande que l’association et son assurance, la MAIF, l’indemnisent des conséquences de son accident. Ces dernières s’y refusent. Elles estiment que si Mme X avait fait plus attention, elle ne serait pas tombée. Elles ajoutent qu’elle pouvait attendre l’arrivée d’un bénévole qui l’aurait guidée dans l’obscurité. Elles font valoir que la salle est, par ailleurs, équipée de rampes d’accès pour handicapés et d’un plan incliné permettant un accès sécurisé. En 2021, Mme X les assigne. Elle invoque l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Obligation de sécurité de moyens Le tribunal judiciaire de Moulins, puis la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme), le 27 mars 2024, considèrent que Mme X, arrivée en retard, a « commis une faute d’imprudence ayant contribué à son propre dommage », en prenant « l’initiative de s’avancer au sein de la salle qui se trouvait dans l’obscurité, sans l’accompagnement d’un représentant de l’organisateur ». Mais, que de son côté, l’association, « débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers les spectateurs, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme X ». En effet, « les escaliers menant aux fauteuils n’étaient dotés que de quatre rampes en leur extrémité et une des marches en était dépourvue » ; en outre, « s’il existait un plan incliné, celui-ci était situé à l’extrémité droite de l’escalier lorsque le spectateur faisait face à la scène, et il n’était pas en évidence ». Les deux juridictions considèrent que « la faute d’imprudence » de la victime « présente un degré de gravité suffisamment caractérisé pour aboutir à un partage de responsabilité » : 80 % pour elle, et 20 % pour l’association. La prochaine fois, Mme X prendra de l’avance. Rafaële Rivais / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 19, 2024 4:31 PM
|
Publié par Sceneweb le 18 août 2024 Alain Delon est mort à l’âge de 88 ans, ont annoncé ce dimanche 18 août ses trois enfants dans un communiqué commun à l’AFP. Monstre sacré du cinéma français, le comédien est aussi monté régulièrement sur les planches. Il a tourné plus de 80 films, dont beaucoup de chefs d’oeuvre, il est aussi monté plusieurs fois sur scène dans sept pièces. Sa carrière au théâtre débute en 1961 dans Dommage qu’elle soit une putain au théâtre de Paris aux côtés de Romy Schneider dans une mise en scène de Luchino Visconti qui venait d’achever avec lui au cinéma Rocco et ses frères (1960), avant Le Guépard (1963). En avril 1968, Alain Delon désormais star, joue dans Les Yeux crevés de Jean Cau dans une mise en scène de Raymond Rouleau au théâtre du Gymnase à Paris. La pièce devait initialement se créer en novembre 1967 au théâtre Montparnasse avec Curd Jurgens, c’est finalement Jacques Dacqmine qui incarne le rôle de Gottfried, mais les événements de Mai 68 interrompent les représentations. Après une très longue pause, Alain Delon revient au théâtre en 1996 au théâtre Marigny dans Variations énigmatiques avec Francis Huster. Une pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt dans une mise en scène Bernard Murat. La pièce sera reprise en 1998 avec Stephane Freiss. En 2004 au théâtre Marigny, Anne Bourgeois le met en scène dans Les Montagnes Russes d’Éric Assous. « Un de mes plus beaux souvenirs lorsqu’on jouait au Théâtre Marigny : la tête d’Alain Delon recevant les hurlements de rire de la salle. Oui, c’était la première fois qu’il jouait dans une comédie au théâtre, et forcément, il a découvert ce bonheur-là : entendre une salle réagir. Magnifique » explique la metteuse en scène sur son site. La création de La Route de Madison en 2007 est un évènement. Mireille Darc et Alain Delon qui ont formé un couple de 1968 à 1983, se retrouvent dans cette adaptation du roman de Robert James Waller par Didier Caron et Dominique Deschamps. Avec Anne Bourgeois à la mise en scène. « J’ai souvent demandé à Alain pourquoi avoir choisi cette oeuvre-là, et pas une autre, pour retrouver Mireille sur un plateau. Parmi tous ses arguments d’amour en faveur de cette histoire tellement triste, il y avait aussi cette chose qui le bouleversait : « dans la vie, j’ai quitté Mireille, je lui ai fait beaucoup de peine. Dans la pièce, c’est elle qui refuse de me suivre. On inverse. » Je pense que peut-être, il réparait quelque chose, à travers le théâtre » commente la metteuse en scène. En 2008, il partage la scène avec Anouk Aimée dans Love Letters au Théâtre de la Madeleine. Enfin en 2011, il retrouve la plume d’Eric Assous dans Une journée ordinaire avec sa fille Anouchka. Tout d’abord dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, puis en 2013 dans une nouvelle mise en scène d’Anne Bourgeois au Théâtre des Bouffes Parisiens. « C’est une aventure qui m’est arrivée dans la douleur, car Alain avait déjà joué cette pièce deux ans plus tôt. A ce moment-là je n’étais malheureusement pas libre pour les accompagner lui et sa fille dans cette création qui avait été inventée pour eux par notre regretté Eric Assous. J’en étais malade, Alain Delon en était très fâché, mais j’avais signé bien en amont pour un autre spectacle et pas question pour moi de répéter autre chose en même temps qu’une pièce avec Alain » se souvient Anne Bourgeois. « Je garde le souvenir d’Anouchka serrant son père dans ses bras juste avant que le rideau ne se lève : cette complicité douce et infiniment respecteuse entre les deux partenaires; l’un dévorant l’autre des yeux aux saluts, ne cessant de se remercier; Les yeux d’Alain sur sa fille en essayage costumes, devant cette robe rouge tellement féminine : il n’a jamais désapprouvé, il nous faisait confiance, mais il recevait à chaque seconde le sujet de la pièce comme un coup de poing: son enfant était devenue une femme. » Légende photo : Alain Delon aux côtés de Jacques Dacqmine dans une scène de la pièce "Les yeux crevés" (1968) © photo Bernard Allemane

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 11, 2024 9:25 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 11 août 2024
Le danseur-breakeur-contorsionniste de 32 ans tient le rôle principal dans « Records », le spectacle imaginé et mis en scène par Thomas Jolly.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/sport/article/2024/08/11/arthur-cadre-homme-caoutchouc-et-golden-voyageur-de-la-ceremonie-de-cloture-des-jo-de-paris_6276353_3242.html
Lorsque Arthur Cadre déplie tranquillement son presque double mètre – 1,86 m précisément sous la toise –, on a du mal à superposer les images des invraisemblables acrobaties dont ce danseur-breakeur-contorsionniste est capable. La vedette de Records, qui incarne le « golden voyageur » (« voyageur en or ») du spectacle de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 sous la direction de Thomas Jolly, est un homme-caoutchouc dont le répertoire gestuel stupéfiant, visible sur les réseaux sociaux, entre extrême flexibilité et tension graphique, éblouit. « Il faut mettre plus d’efforts dans les mouvements évidemment, car, quand on est grand, tout prend plus d’ampleur, glisse-t-il. Mais après, les lignes sont plus longues. » Voir la vidéo Dans un agenda blindé – il annonce trois cents jours de voyage en tournée par an dans le monde entier –, cet artiste de 32 ans, également architecte, metteur en scène, acrobate de cirque, photographe et mannequin, a répondu illico oui à la proposition de Thomas Jolly deux mois seulement avant le show. « J’avais très envie de travailler avec lui », confie-t-il. C’est après être allé voir Starmania – à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en 2023 – « magnifique ! » – qu’il entre en contact avec Thomas Jolly par Instagram. Et la suite file. Les deux artistes se rencontrent, et voilà Arthur Cadre au cœur de la « dystopie » imaginée par Thomas Jolly qui, dit-il, lui a laissé « beaucoup de liberté créative » : « Je lui propose des choses et il me donne un retour. » Arthur Cadre, cité en 2022 parmi les trente jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui comptent par le magazine américain Forbes, affiche calme et sérénité. Mercredi 7 août, il émerge d’une répétition de nuit au Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Impressionné par les 2 800 mètres carrés du plateau et par les 80 000 spectateurs attendus ? Arthur Cadre est un habitué des maxiformats scéniques. Celui qui se consacre « à la création du spectacle de demain », comme il le déclare sur son site Internet, a déjà du très lourd derrière lui. Parmi une liste d’événements énormes et prestigieux, entre Venise et Los Angeles en passant par Zanzibar, il évoque, par exemple, son rôle principal dans La Perle, créé en 2018 à Dubaï par Franco Dragone (1952-2022), le fondateur du Cirque du Soleil, qui le remarque en 2015 au Festival mondial du cirque de demain, à Paris. Il jouera mille fois ce mégashow. En mars, il a conçu la production Asayel, avec quarante danseurs et vingt-cinq chevaux, à Riyad, en Arabie saoudite. En décembre, il sera à Las Vegas en tant que « concepteur créatif » sur Hope Road, autour de Bob Marley, produit par la famille du musicien, au Mandala Bay. Breakeur d’abord, Arthur Cadre a démarré la danse hip-hop à l’âge de 9 ans dans sa chambre, à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), où il a grandi et où il retourne régulièrement. La famille baigne dans le sport. Son père, champion de planche à voile, a participé aux Jeux olympiques en 1988, à Séoul. Sa mère était dans l’équipe de France de volley-ball. C’est la vision du clip Freestyler de Bomfunk qui lui donne envie de plonger dans le breaking. Vite, il a 13 ans, lorsqu’il participe à des compétitions de breakdance, où son profil et ses enchaînements de pas vertigineux le distinguent. « La culture hip-hop vous forge en matière de motivation, dit-il. On est directement confronté aux gens, au public, et l’aspect communauté est vraiment intéressant… » En 2007, il apparaît pour la première fois dans l’émission « La France a un incroyable talent ». Rebelote en 2015, où il se qualifie en finale. Entre-temps, en 2011, une de ses vidéos de « yoga breakdance » devient virale. La même année, il débarque à Montréal, où il vit jusqu’en 2015, y décroche son diplôme d’architecte tout en finançant ses études en participant à des pubs, des performances. « L’architecture a beaucoup d’influence sur mon mouvement en matière de lignes, de rythmes, de volumes… », précise-t-il. Baptisé « Lil Crabe » – ce qui en dit long sur sa signature stylistique –, il déploie une gestuelle variée et complexe où le breaking s’enrichit des multiples techniques engrangées au fil du temps, dont celles de la danse classique et contemporaine, des claquettes, du cirque, de la magie, du yoga qui nourrissent l’imaginaire et l’écriture de cet autodidacte. Curieux, il travaille actuellement sur la lévitation. « C’est un outil pour raconter des histoires et transporter les gens », souligne celui qui aime bien mélanger tous ses pinceaux : la danse, l’architecture, le cirque, le théâtre, la photo, la mode… Et incarner ses visions mirifiques. Voir la vidéo Légende photo : Le danseur, contorsionniste et architecte français Arthur Cadre, artiste principal de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 23 juillet 2024. JOEL SAGET / AFP
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 1, 2024 5:01 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 30 août 2024 Dans la série d'été « Les batailles du théâtre » (5/6). En 1830, le drame fait entrer avec fracas l’idéal romantique sur les scènes. Depuis, des auteurs ont su imposer d’autres façons de représenter et de jouer, mais sans scandale.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/30/depuis-hernani-de-victor-hugo-deux-siecles-de-revolutions-dramaturgiques_6299566_3451060.html
Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Victor Hugo ne ménage ni ses effets ni sa peine pour que son Hernani, drame passionnel créé le 25 février 1830 à la Comédie-Française, s’accompagne d’un vacarme monstre afin d’en assurer le lancement en fanfare. « Je remets ma pièce entre vos mains, entre vos mains seules, écrit-il à ses camarades romantiques. La bataille qui va s’engager à Hernani est celle des idées, celle du progrès. C’est une lutte en commun. Nous allons combattre cette vieille littérature crénelée, verrouillée. Saisissons-nous de ce drapeau usé hissé sur ces murs vermoulus et jetons bas cet oripeau. Ce siège est la lutte de l’ancien monde et du nouveau monde, nous sommes tous du monde nouveau » (Victor Hugo raconté par Adèle Hugo, 1863). Quels sont ces mondes anciens dont le poète et dramaturge prétend s’émanciper ? Et de quel monde nouveau se revendique-t-il ? Chef de file du romantisme français, dont il a, en 1827, théorisé le genre dans sa Préface de Cromwell, Hugo milite pour un style débarrassé de ses oripeaux. Il a 27 ans et le désir d’un théâtre vibrant, grotesque, pathétique, lyrique, trivial, inconvenant, excessif. En un mot : vivant. Avec Hernani, drame en cinq actes et plus de 2 000 vers, il torpille le classicisme et anéantit les règles de lieu et de temps qui ordonnent encore au XIXe siècle la marche des tragédies. L’histoire de la pièce n’a rien de révolutionnaire. En 1519, Hernani gagne l’amour de Doña Sol, que lui cède son rival, le roi d’Espagne, mais il est tué au soir de ses noces et sa promise le suit dans la mort. La forme, en revanche, décoiffe. Hugo balaie déjà l’unité de lieu et de temps. Les scènes se passent en Espagne et en Allemagne, les héros courent d’une ville à l’autre, ce qui suppose une multiplicité de décors. Et puis la langue navigue du prosaïque au poétique, les vers sortent de leurs gonds. « J’ai disloqué ce grand niais d’alexandrin », s’amuse le poète. Hugo enfin prend ses aises avec la stature politique d’un roi dominé par son rival, qui le traite de « petit » ou de « chétif ». Eminente spécialiste de l’auteur, Anne Ubersfeld (1918-2010) écrit dans son Dictionnaire du théâtre (Albin Michel, 1998) : « La vigueur provocante du style, l’audace des situations, la grandeur paradoxale des personnages, l’amour impossible, la présence permanente de la mort ravirent une jeunesse qui voyait dans l’œuvre (…) l’étendard enfin brandi de la liberté dans l’art. » Hernani est un manifeste pour un théâtre total adressé à un public populaire et moderne. Un tel manifeste se doit de faire scandale. Pour la première, Hugo convoque ses soutiens, qui investissent la Comédie-Française sept heures avant le lever de rideau. Des célébrités comme Alexandre Dumas et Gérard de Nerval, des inconnus aussi, sont priés de faire la claque. Chauffés à blanc par l’attente, ils chahutent aux balcons. Honoré de Balzac aurait même reçu un trognon de chou sur la tête. Les défenseurs hugoliens, vêtus de gilets rouges taillés sur mesure, surjouent les « flamboyants » face aux « grisâtres » et autres « chauves » néoclassiques. Soirée houleuse « Il suffisait de jeter les yeux sur ce public pour se convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une représentation ordinaire ; deux systèmes, deux partis, deux armées, deux civilisations mêmes – ce n’est pas trop dire – étaient en présence, se haïssant cordialement, comme on se hait dans les haines littéraires, ne demandant que la bataille, et prêts à fondre l’un sur l’autre », témoignera le poète Théophile Gautier (Histoire du romantisme, 1874). La soirée est houleuse et son issue triomphale. Hugo fait entrer avec fracas l’idéal romantique sur les scènes. Pendant un siècle, jusqu’à 1927 exactement, Hernani est repris quasiment chaque année à la Comédie-Française. Et puis l’intérêt des artistes, de moins en moins sensibles aux audaces formelles de l’auteur, s’émousse. A peine plus de dix mises en scène depuis les années 1950. Plus personne ne s’indigne d’un roi qui, demandant « Quelle heure est-il ? », témoignait d’un intérêt pour la vie ordinaire choquant et trivial à l’époque. En 1985, tout en saluant la mise en scène d’Antoine Vitez au Théâtre national de Chaillot, le critique Michel Cournot constate que « les cartes ont beaucoup changé ». La bataille d’Hernani a vécu. Au XXe siècle, pourtant, des auteurs ont su faire bouger les lignes et imposer par la seule force de leur écriture d’autres façons de représenter et de jouer le théâtre. Pas de scandale désormais. Pas de déchaînement de foule au soir d’une création. Le théâtre ayant perdu de son impact dans la société, les torsions exercées sur la dramaturgie s’adressent à un public plus confidentiel. Elles n’en sont pas moins décisives dans l’art de mettre en scène ou d’interpréter. Parmi les rénovateurs, surgit d’abord le nom de Samuel Beckett (1906-1989), qui en finit pour de bon avec les trois unités : après le temps et le lieu torpillés par Hugo, l’Irlandais expédie l’action aux orties. « Ce dernier verrou saute en 1948 lorsqu’il écrit En attendant Godot, raconte l’universitaire Catherine Naugrette, autrice de l’ouvrage Le Théâtre de Beckett (Ides et Calendes, 2017). Dans Godot, par définition, il n’y a pas d’action. Cette rupture est fondamentale du point de vue de la dramaturgie. » Pour les acteurs, jouer ce théâtre de l’attente pure est une épreuve formatrice. Une ascèse. « Certains refusent de disparaître derrière une sorte de masque neutre, d’autres doivent accepter d’être anonymisés ou de jouer dans des postures physiques impossibles », commente Catherine Naugrette. Les metteurs en scène doivent manœuvrer sur un territoire ultraverrouillé. Les didascalies beckettiennes font autorité : impossible d’esquiver ses consignes de jeu, de postures, de décors ou de costumes tant les ayants droit français veillent. Théâtre dépouillé de son superflu Les contraintes ne freinent pas les élans vers une œuvre pourtant insondable, où les questions oscillent entre absurde et métaphysique. Toutes œuvres confondues, près de 550 représentations de Beckett auraient été données en 2023. Les artistes reviennent aux pages de l’Irlandais « comme à un grand classique ou une tragédie grecque », affirme Catherine Naugrette, qui voit en lui « un pilier et un fondateur ». L’écrivain dépouille le théâtre de son superflu. Après Godot, créé en 1953, Fin de partie (1957) et Oh les beaux jours (1961), il rétrécit de plus en plus l’univers scénique. « Il veut faire de l’échec l’argument même de la représentation », dit Catherine Naugrette. Exit la psychologie des personnages, l’opulence de descriptions, le flux de dialogues. Exit les corps en scène. Ce théâtre à l’os chemine vers l’anéantissement jusqu’au radical Pas moi (1972), monologue dans lequel ne subsiste qu’une bouche qui éructe. Impressionné, le philosophe Gilles Deleuze notait : « Il a épuisé au fur et à mesure tous les langages, les formes, les modalités, jusqu’au bout, et c’est remarquable » (Quad, de Beckett, suivi de L’Epuisé, de Deleuze, Editions de Minuit, 1992). Comment l’écriture dramatique de la fin du XXe siècle pouvait-elle rebondir après cette tabula rasa ? Le trop-plein de Valère Novarina sera une des réponses au vide beckettien. Un trop-plein gorgé de mots en cascades, de listes de néologismes, de phonèmes exotiques et d’inventaires délirants qui déferlent sous la plume de cet écrivain de 77 ans. Ce dernier « a produit de l’inouï dans l’écriture et il est à l’origine d’une vraie révolution poétique », assure Céline Hersant, autrice de L’Atelier de Valère Novarina, recyclage et fabrique continue du texte (Garnier, 2016). Une révolution qui n’est pas née ex nihilo : « Ses pièces sont des objets non identifiés qui anéantissent la fable avec des personnages qui deviennent des figures parlantes, ce qui est typiquement beckettien. » L’exercice exige des performances d’acteur – on les nomme les « novariniens ». Aux avant-postes de cette tribu, on trouve André Marcon, qui a créé, en 1985, Le Monologue d’Adramélech, et à qui nous avons demandé comment il restitue une écriture quasi rabelaisienne : « Cette langue permet de renouer avec le corps. Elle lui dicte sa loi, le dirige dans l’espace. J’ai parfois l’impression d’être un musicien de jazz qui improvise, joue fortissimo un soir et, le lendemain, pianissimo. Mes marges de manœuvre sont très grandes. » Oralité débridée Qu’il soit homme ou femme, jeune ou vieux, l’interprète novarinien est un « corps tuyau » dont l’anatomie est vampirisée par les mots. Il se repère à son endurance, son oralité débridée, le don absolu de sa personne à des monologues qui pulvérisent les records de longueur. « Il faut du souffle, des corps et des gueules particulières », explique Céline Hersant. Alpha et oméga de représentations qui s’organisent autour de lui, l’acteur est la voix des auteurs, lesquels assument de plus en plus la fonction de metteur en scène. Et pour cause, l’architecture de leurs phrases provoque les formes esthétiques et sort les spectacles de leurs zones de confort. Plus réformateur que révolutionnaire, Joël Pommerat, 61 ans, est de ceux qui auront métamorphosé le théâtre en l’exfiltrant loin de ses rivages littéraires pour l’amener vers une terre de taiseux. Au commencement n’est pas le verbe, rappelle cet auteur et metteur en scène, mais la présence, le corps, la voix et le geste de l’acteur. « J’ai assumé de plus en plus ma critique d’un théâtre de la parole. » Depuis toujours, Pommerat affirme écrire des spectacles. Pas des pièces. Ce projet, nourri d’images déployées dans l’espace et rivalisant avec les mots, a gagné, le temps passant, une envergure politique. En dotant ses comédiens d’un lexique limité – mots maigres et verve en berne –, Pommerat leur fait incarner des femmes et des hommes souvent muselés et à qui manque la rhétorique. « Avoir les outils du langage est un levier du pouvoir. Pourquoi le théâtre ne donnerait-il pas plus de place à ceux qui ne savent pas dire ou disent mal ? », s’étonne-t-il. Le résultat est saisissant : sur ses plateaux, le peuple des invisibles a droit de cité. Il apparaît dans sa diversité et surgit d’autant mieux que les acteurs, sonorisés, pianotent sur les nuances en évitant l’artifice de la profération. Banalité ciselée de la prose, virgules pesées au trébuchet, jeu de l’acteur au plus proche du réel : la grâce désenchantée de l’écriture de Pommerat est un terreau fertile où naissent des humanités complexes qui peuvent enfin se faire voir, entendre et comprendre. Rien d’étonnant à ce que ce théâtre de la rupture, comme en son temps celui de Victor Hugo, rencontre l’adhésion populaire. Joëlle Gayot / LE MONDE Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende image : Dessin de Paul Albert Besnard montrant la première représentation d’« Hernani », de Victor Hugo, à la Comédie-Française, à Paris, en 1830. PHOTO JOSSE / BRIDGEMAN IMAGES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 30, 2024 6:49 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 29 août 2024 Le comédien, conteur et metteur en scène, tétraplégique à la suite d’une chute, revient sur la scène du Théâtre du Nord-Ouest, à Paris, pour narrer la mythique quête de la Toison d’or.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/08/29/avec-gerard-probst-la-passion-de-conter-au-dela-du-handicap_6298580_3246.html
Gérard Probst a toujours eu en lui la passion de raconter des histoires, et ce depuis l’époque où il a suivi le cours Simon (de 1965 à 1969) puis des stages auprès d’Ariane Mnouchkine, Jacques Lecoq (1921-1999), Catherine Dasté ou Carlo Boso. Quand une chute dans les escaliers l’a laissé tétraplégique, il s’est battu pour pouvoir remonter sur une scène et continuer à vivre sa passion en la partageant avec son auditoire. Dans le cadre de l’Olympiade culturelle et en parallèle avec la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, mercredi 28 août, Gérard Probst a enfin concrétisé son rêve de revenir sur les planches, avec la première d’une série de neuf représentations (jusqu’au 17 septembre) de sa nouvelle création La Quête de la Toison d’or dans la petite salle (accessible de plain-pied) du Théâtre du Nord-Ouest, à Paris. Quoi de mieux, en effet, que de se glisser dans la peau d’un héros de la mythologie grecque comme Jason, pour faire oublier, le temps d’un spectacle, la situation de handicap et embarquer le public dans le récit d’aventures extraordinaires à bord du navire Argo en compagnie des Argonautes, ses célèbres compagnons de route. Voix mélodieuse Un pari un peu fou que le comédien a relevé avec panache et un brin d’humour en déclarant, dès le début de la représentation, à propos de son fauteuil roulant : « Moi qui ai toujours rêvé d’arriver en voiture jusqu’à la scène, je suis comblé. » Pendant un peu plus d’une heure, seule compte la voix de Gérard Probst, restée intacte, mélodieuse et envoûtante, pour conter les exploits de Jason, l’homme avec une seule sandale, qui doit affronter une série d’épreuves afin de rapporter la Toison d’or au roi Pélias et récupérer ainsi le trône du royaume d’Iolcos dérobé à son père. Pour les mener à bien, il reçoit en particulier l’aide de la fille du roi de Colchide, Médée, tombée amoureuse du jeune Argonaute. Une femme au destin tragique marqué par une succession de meurtres, dont ceux de ses propres enfants. Mais ceci est une autre histoire que Gérard Probst pourra raconter lors d’un prochain spectacle. Cristina Marino / LE MONDE La Quête de la Toison d’or, par Gérard Probst. Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9e. Les 29 et 30 août, puis les 1er, 2, 3, 4, 7 et 17 septembre à 18 h 30. Dans le cadre de l’Olympiade culturelle. Tarifs : 11 €, 13 € et 25 €.
Légende image : Affiche du spectacle. THÉÂTRE DU NORD-OUEST

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 28, 2024 7:50 AM
|
par Jean-Marie Durand dans Les Inrocks - 27 août 2024 Les théâtres font leur rentrée, et annoncent un programme prometteur, malgré la fragilisation du secteur. Tour d’horizon.
Publié le 27 août 2024 à 10h36
Tout est fini : les festivals de l’été sont derrière nous, comme l’hypershow de Thomas Jolly lors de la cérémonie d’ouverture des JO, qui jouait avec tous les codes du spectacle vivant – parade populaire, cabaret parisien, comédie musicale, théâtre politique, performance vocale, danse sous la pluie… Mais tout recommence aussi : le spectacle continue, avec la rentrée théâtrale. Non sans une certaine inquiétude, par-delà la nostalgie d’un monde réanimé par Thomas Jolly. Car comme le révélait en mars dernier une enquête de l’Association des professionnels de l’administration du spectacle, la saison 2024-2025 devrait compter 54 % de représentations de moins que la précédente. Fragilisées par les coupes budgétaires dans le spectacle vivant, 40 % des compagnies ne pensent même pas pouvoir maintenir les emplois de leurs équipes administratives. Cette crise économique qui impacte le monde du spectacle formera l’un des sujets de discussion les plus forts de l’année à venir, en espérant que la gauche, si elle arrivait enfin au pouvoir, prenne à bras-le-corps cet enjeu culturel pour rassurer un peu la famille appauvrie du théâtre. Un programme riche En attendant – catastrophes ou miracles –, la nouvelle saison démarre en septembre sur les chapeaux de roues avec plusieurs spectacles excitants, souvent très politiques, (comme le dévoile notre nouveau supplément sur la rentrée scènes). À l’image de Julie Duclos, qui monte la pièce mythique de Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du IIIe Reich, au Théâtre national de Bretagne à Rennes, du 24 septembre au 3 octobre, ou de Rébecca Chaillon, qui présente son nouveau spectacle Whitewashing (prolongeant son formidable Carte noire nommée désir), au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre du festival Actoral, les 25 et 26 septembre. À l’image aussi de Christian Hecq et Valérie Lesort évoquant aux Célestins-Théâtre de Lyon, du 19 au 29 septembre, la vie des Sœurs Hilton, monstres de foire du film Freaks, et de Gwenaël Morin adaptant Don Quichotte, de Cervantès, au Théâtre Paris-Villette, du 26 septembre au 12 octobre, avec Jeanne Balibar dans le rôle-titre. Mohamed El Khatib questionnera la sexualité des ancien·nes dans La Vie secrète des vieux aux Abbesses, du 12 au 26 septembre, avant de monter Stand-up au Théâtre du Rond-Point du 15 au 19 octobre. Pluraliser le monde Ce même théâtre du Rond-Point accueillera du 18 au 29 septembre l’Argentine Marina Otero avec sa trilogie fiévreuse Fuck Me, Love Me et Kill Me. Sans oublier, en danse, le spectacle de François Chaignaud et de Geoffroy Jourdain, In Absentia, à l’abbaye de Royaumont, le 8 septembre, ou celui de Saša Asentić, Dis dis contact, au Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt, du 12 au 15 septembre. Par le recours à l’imagination, au récit et à fable, le théâtre peut, comme le soulignait récemment dans Libération Frédérique Aït-Touati, autrice de Théâtres du monde : Fabriques de la nature en Occident (La Découverte), “poursuivre son travail de reconfiguration et de pluralisation des mondes et lutter contre l’unification et l’amincissement du nôtre”. Les scènes qui nous attendent en septembre proposeront d’autres cérémonies, qui même sans la dimension festive de Jolly, travaillent aussi à cette idée de pluraliser nos mondes. Délaissant la Seine, nous resterons pour autant attaché·es à ces scènes ouvertes à la fable et à l’imagination.
Légende photo : “Fuck Me” de Marina Otero (© Matias Kedak © Sofia Alazraki)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 27, 2024 1:06 PM
|
Par Joëlle Gayot dans la série d'été du Monde « Les batailles du théâtre » (2/6), article publié le 27 août 2024 « Les batailles du théâtre » (2/6). En 1662, date de la création de la pièce, l’envol du personnage d’Agnès vers la liberté est un pavé projeté sur le patriarcat. Longtemps négligée ou minorée, la force émancipatrice de l’héroïne s’impose avec le mouvement #metoo.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/27/quand-moliere-s-attaquait-a-la-querelle-des-sexes-avec-l-ecole-des-femmes_6296830_3451060.html Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. « Le petit chat est mort. » Cette réplique d’Agnès a volé la vedette à un vers moins fameux, mais plus vénéneux de L’Ecole des femmes : « Je vous épouse, Agnès. » Acte III, scène 2 : la messe est dite, Arnolphe a parlé. Ce tuteur autoproclamé d’une enfant de 4 ans, cloîtrée entre les murs d’un couvent jusqu’à ce qu’il l’en sorte pour l’enfermer chez lui, ce barbon sûr de lui endosse, d’une phrase, d’une seule, les habits du mari. Arnolphe a 40 ans, et Agnès 17. Peu lui importe : sa petite protégée a été éduquée pour devenir une idiote qui ne le cocufiera pas. Cette comédie de Molière passerait-elle sans encombre sous les radars des combats actuels contre les violences sexistes et sexuelles ? Qu’on se rassure. La tentative de prédation sera déjouée par une postadolescente qui se révélera moins sotte que ne le supposait son geôlier. On peut même lire la pièce comme le récit d’une émancipation féminine, sexuelle et intellectuelle, qui a, du reste, déclenché, en son temps, une interminable querelle dont l’auteur a su se défendre avec un talent de grand communicant. Que se passe-t-il le 26 décembre 1662, lorsque Jean-Baptiste Poquelin donne ses cinq actes versifiés devant un Louis XIV hilare, dit-on, « jusqu’à s’en tenir les côtes ». Trop de rires, justement, de la part de Son Altesse. Ce succès déplaît aux frères Pierre et Thomas Corneille, à la troupe concurrente de l’hôtel de Bourgogne, et enfin aux dévots, furieux d’entendre, ânonnées par Agnès, des maximes du mariage parodiant, selon eux, les préceptes religieux. A mesure qu’elles montent en puissance, les critiques volent de plus en plus bas. Un comédien, Montfleury, envoie une requête au roi où (rapporte Racine dans une lettre à son ami Le Vasseur) il accuse le dramaturge d’avoir « épousé la fille et d’avoir autrefois couché avec la mère ». Molière vient en effet de se marier avec Armande, la fille de son ancienne compagne Madeleine Béjart. La querelle littéraire vire à la calomnie, on hurle au plagiat, à l’indécence, à l’impiété. Des feux de paille, relativisait toutefois l’historien Georges Forestier (1951-2024), spécialiste de l’œuvre, pour qui Molière, seul, a créé l’esclandre en provoquant frondeurs et censeurs. En réponse à ses détracteurs, il écrit La Critique de l’école des femmes, puis L’Impromptu de Versailles. Ce fin stratège sait souffler sur les braises. La cabale porte ses fruits : l’envol d’Agnès vers la liberté, hors des griffes d’Arnolphe, est un pavé projeté sur le patriarcat. D’autant qu’au XVIIe siècle, on ne plaisante pas avec la toute-puissance masculine. Sortant d’une éclipse de près de trois cents ans, la pièce rebondit, en 1936, sur les planches du Théâtre de l’Athénée, où Louis Jouvet la remet au goût du jour. Représentations triomphales, jeu sobre de Jouvet en Arnolphe, décors légendaires de Christian Bérard, réception élogieuse. Dans les commentaires, rien ne détaille ce rapport trouble entretenu par un homme d’âge mûr avec une très jeune femme. Multiples relectures « Lorsque Jouvet met le texte en scène, c’est lui qu’on vient voir », et pas Madeleine Ozeray en 1936 ou Dominique Blanchar en 1950 dans le rôle d’Agnès, explique l’universitaire et dramaturge Anne-Françoise Benhamou. « En revanche, lorsque, en 1973, Jean-Paul Roussillon [1931-2009] propose sa version à la Comédie-Française, avec Isabelle Adjani, c’est elle qu’il met au centre et que le public veut découvrir. » La bascule est d’autant plus forte que deux comédiens, Michel Aumont et Pierre Dux, se partagent alternativement le rôle d’Arnolphe face à Adjani, ce qui atténue la mise en vedette du héros. Grâce à Roussillon, en conclut Anne-Françoise Benhamou, Agnès devient un personnage qui intéresse. « Il a fallu ce spectacle, réalisé dans un moment de féminisme actif, les années 1970, pour transformer le regard sur elle et sur la pièce. » Cette adaptation est le prélude à de multiples relectures de l’œuvre. Une soixantaine depuis 1973, dans le théâtre public comme privé. Si la plupart sont tombées dans les oubliettes, d’autres font date. Dominique Valadié est de la distribution des « quatre Molière » montés en tir groupé, en 1978, par Antoine Vitez (1930-1990) : Le Misanthrope, Dom Juan, Le Tartuffe et donc L’Ecole des femmes. Pour cette dernière pièce, Vitez ne tranche pas entre le féminisme et la misogynie du texte. Il veut aller à l’os de l’écriture. Comme le souligne alors Colette Godard dans Le Monde, il entend « retraverser les couches d’interprétations accumulées depuis trois siècles ». Sans qu’Agnès soit effacée, Arnolphe reprend de l’importance, et sa douleur est mise au jour. Dominique Valadié, qui incarnait Agnès, se souvient de son partenaire, Didier Sandre : « Il était jeune et beau. Il jouait un Arnolphe dont l’âge n’importait pas. Seule comptait l’innocence d’Agnès. Une jeune fille se livrait, sans retenue, à celui qui pour elle était un père ou un grand frère. Mais Arnolphe, peu à peu, était gagné par une souffrance terrible. Il y avait quelque chose de profondément tragique entre cet homme qui voulait façonner une femme, la rendre idiote au sens de pure, et l’émancipation de cette femme. » « Arnolphe est la légalité » Le psychanalyste Jacques Lacan, quant à lui, préfère disserter sur la nature authentiquement comique de l’amour dans L’Ecole des femmes sans pour autant contester la sincérité des émotions du héros : « Il préfère encore être cornard (…) plutôt que de perdre l’objet de son amour. » (Le Séminaire, livre V, Seuil, 1998.) Cette thèse est reprise à la volée par le metteur en scène Eric Vigner qui, en 1999, privilégie une approche onirique et poétique de L’Ecole des femmes : « Si Arnolphe est présenté comme un pervers, ça n’a aucun sens de monter la pièce, dit-il aujourd’hui. Cet homme a un projet personnel et utopique. Il éduque cette jeune fille en étant mû par une pensée à la Descartes : je pense, donc je suis. Il fait d’elle une femme, et elle devient un être complet. Parce qu’il réussit son projet, ce projet lui échappe. Alors il préfère la donner à son jeune rival, Horace. » Qu’on le blâme ou qu’on l’encense, Arnolphe prend toute la lumière, d’autant qu’Agnès ne parle que dans six scènes sur les trente-deux que compte la comédie. Même Coline Serreau, l’une des rares femmes à avoir monté la pièce, plaide sa cause : « Arnolphe me touche infiniment. Il est la légalité. Ni un escroc ni un fourbe, pas même un illuminé, mais un homme qui pousse jusqu’à l’absurde un système. Il affirme pouvoir acheter un être humain. Il en a le droit (…). Il est l’Occident. Il a le savoir, le pouvoir, la technologie (…). On voit où ça le mène : au désastre » (Le Figaro, 10 mars 2006). Coline Serreau ajoute : « Il ne comprend pas son naufrage. » A quel moment le héros, Arnolphe, que le critique du Monde Michel Cournot n’hésitait pas, en 2001, à qualifier de « pédophile », à propos d’une mise en scène de Jacques Lassalle, cesse-t-il de monopoliser l’attention des metteurs en scène ? Pas simple d’oxygéner un répertoire qui confine le féminin dans les marges. « Tant que l’on montera des pièces du théâtre classique avec des distributions genrées, les femmes seront toujours reléguées au rang d’accessoire », explique Reine Prat, autrice d’Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture (Rue de l’Echiquier, 2021). Le théâtre, écho de l’indépendance de la femme Il n’est pourtant pas d’usage qui tienne, face aux préoccupations contemporaines : en 2014, réitérant le geste d’Antoine Vitez, Gwenaël Morin monte les « quatre Molière », sauf que les filles y jouent les hommes (et inversement), la distribution résultant d’un tirage au sort effectué, chaque soir, par les comédiens. Moins tapageuse, mais plus révolutionnaire sera l’approche, en 2019, de Stéphane Braunschweig à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Le mouvement de libération de la parole des femmes est passé par là. Le hashtag #metoo incendie les réseaux sociaux. Les mécanismes de l’emprise et la notion de consentement s’imposent. Le spectacle de Braunschweig s’inscrit dans un contexte où la relation hommes-femmes se redéfinit. Sur le plateau, Agnès (interprétée par Suzanne Aubert) apparaît sur un écran vidéo. Elle est filmée dans la chambre où l’assigne Arnolphe (Claude Duparfait). Même mutique, elle impose sa stature, sa présence et son poids de réalité. Elle n’est pas une coquille vide, mais un sujet pensant. Pour Anne-Françoise Benhamou, collaboratrice artistique de Stéphane Braunschweig, il n’était pas question de sous-traiter l’héroïne : « Dès le début du spectacle, nous avons voulu montrer son point de vue, rendre sensible son malaise, sa compréhension, même confuse, que rien ne va dans la situation où elle se trouve. C’était une façon de renverser d’emblée les perspectives. » Pour Anne-Françoise Benhamou, L’Ecole des femmes porte un enjeu politique plus profond : restaurer la subjectivité des personnages féminins issus du répertoire et de la tradition. « Il est temps de cesser de prendre la domination comme une évidence, mais de l’observer depuis les consciences des héroïnes féminines en pointant leurs endroits de lutte et de résistance. » Sans nier la violence qui lui est faite, le personnage d’Agnès ne peut plus se réduire à un statut victimaire : quatre siècles après son écriture, la comédie de Molière coïncide avec une évolution des mœurs qui encourage l’indépendance de la femme plutôt que sa soumission. Le théâtre dans son ensemble se fait du reste l’écho de cette avancée. Les héroïnes des textes contemporains sont cheffes d’entreprise, responsables politiques, célibataires ou sans enfant. En un mot : autonomes. Quant aux héroïnes classiques, elles ont beau dépendre d’hommes dont elles sont les épouses, les filles ou les mères, elles sont animées de vies intérieures. Ce sont ces vies échappant au contrôle masculin que les artistes d’aujourd’hui cherchent à révéler par leurs mises en scène. Que pensent-elles, que vivent-elles, que veulent-elles ? Ces questions-là sont loin d’être vaines. Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Pierre Dux et Isabelle Adjani, dans « L’Ecole des femmes », de Molière, mis en scène par Jean-Pierre Roussillon, à la Comédie-Française, à Paris, en mai 1973. ANGELO MELILLI/ROGER-VIOLLET

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 26, 2024 12:21 PM
|
Par Thibaut Sardier et Sonya Faure dans Libération - 26 août 2024 La chercheuse au CNRS et metteuse en scène, qui a travaillé avec Bruno Latour, montre dans son dernier essai comment la séparation «nature» et «culture» s’est aussi inventée dans les théâtres italiens au XVIIe siècle. Le monde dans lequel on vit, c’est avant tout des histoires qu’on se raconte. Et les pensées écologiques sont formelles : pour lutter contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité, il va non seulement falloir réfléchir à des solutions techniques et à des programmes politiques, mais aussi changer de mots pour décrire et se représenter le monde. La révolution écologique aura donc aussi lieu… au théâtre. Metteuse en scène et historienne des sciences, proche de Bruno Latour avec lequel elle a beaucoup travaillé, Frédérique Aït-Touati en est persuadée. Dans Théâtres du monde. Fabriques de la nature en Occident (La Découverte, 2024), elle montre comment la séparation moderne entre «nature» et «culture» s’est aussi inventée dans les théâtres italiens, où la mise au point de décors de fond de scène et l’invention de machines pour représenter des tempêtes ont réduit le monde non humain à un simple décor. Pour la spécialiste, tout ne se joue pas dans la tête des philosophes ou les laboratoires des scientifiques, et pour créer un monde nouveau, les arts vont devoir venir à la rescousse… L’idée qu’il va falloir réinventer nos modes de vie pour lutter contre les crises écologiques est désormais admise. On ne sait pas toujours comment s’y prendre, mais on entend beaucoup parler de «bifurcation». Est-ce un bon mot pour parler des changements urgents à entreprendre ? Il est intéressant que ce mot revienne aujourd’hui pour désigner un geste politique : ce sont les jeunes «bifurcateurs» qui décident de ne pas suivre la ligne tracée, qui pensent que ce n’est pas parce qu’ils ont été formés pour travailler dans les grandes entreprises qu’ils sont obligés de le faire. C’est une puissance historique qui se réveille. Ce mot vient de loin : il y a un siècle, le philosophe britannique Alfred North Whitehead (1861-1947) l’utilisait pour parler de la séparation qui s’est opérée au XVIIe siècle entre la nature et les humains, lorsqu’on a commencé à tout diviser : esprit et corps, science et imaginaire… Peut-être sommes-nous sur le point de vivre une autre bifurcation, qui contredirait la première, puisque ce rapport dualiste à la nature et au vivant est remis en cause. La «bifurcation» serait une sorte de «révolution» ? Oui, si on tient compte de tous les sens du terme. Il y a la révolution politique, bien sûr. Mais il y a aussi le sens astronomique, lorsqu’une planète commence un nouveau cycle autour de son étoile. Les révolutions scientifique, sociale et politique vont souvent de pair. Notre période, comme le XVIIe siècle, semble bien être en train de basculer. On sent que les choses bougent, et les jeunes qui choisissent un autre mode de vie le sentent aussi. Il ne s’agit pas de revenir aux périodes antérieures, mais de continuer à chercher ce qu’elles peuvent nous apprendre. Parmi ces pistes à reconsidérer, il y a justement l’idée que la nature est vivante, et qu’elle ne peut plus être considérée comme le simple décor du théâtre de nos vies… La nature tremble aujourd’hui, s’agite sous nos yeux : elle refuse d’être traitée comme l’arrière-plan inerte des activités humaines. L’idée que «la nature n’est plus un décor» apparaît dans un nombre considérable de textes, de Michel Serres à Bruno Latour en passant par Isabelle Stengers… Cette phrase est le point de départ de mon enquête. J’ai choisi de la prendre au sérieux en faisant l’hypothèse que la rupture de la modernité, bien connue et bien étudiée en sciences, en mathématiques, en philosophie, est aussi une rupture esthétique. Cette «nature décor» émerge dès la Renaissance avec l’histoire de la peinture, grâce à la perspective et au paysage. Dans les salles de théâtre, elle prend des formes très singulières : c’est une nature mécanisée. Dès la fin du XVIᵉ siècle en Italie, elle devient littéralement un décor à travers la création de toiles peintes, puis de mécanismes qui animent de spectaculaires machines de scène. Il y a un lien très fort entre les débuts de la science moderne où la nature est reproduite dans des laboratoires, et sa mise en scène dans les coulisses des théâtres : dans les deux cas, ce sont des petits mondes contrôlés. Que change le théâtre italien par rapport aux autres traditions théâtrales ? Il invente la salle fermée et la scène qui sépare les comédiens des spectateurs : le «quatrième mur». Cette clôture implique de reproduire la nature à l’intérieur d’une boîte noire. On met en scène les puissances de la nature qui nous dépassent, comme les nuages et les tempêtes. Le scénographe italien Nicola Sabbatini (1574-1654) théorise cela en expliquant comment faire surgir la Lune, ouvrir des gouffres, avec des poulies, des cordages et des toiles peintes. Ce faisant, on redirige notre attention : de l’admiration pour les choses de la nature à l’admiration pour l’ingénieur. Pourquoi avoir choisi de travailler sur les machines de théâtre plutôt que sur les textes des pièces ? Parce que derrière ces machineries se révèle un rapport à la nature comme machine. De Francis Bacon (1561-1626) à Leibniz (1646-1716) en passant par René Descartes (1596-1650) et Fontenelle (1657-1757), de nombreux philosophes du XVIIe siècle utilisent cette métaphore : «La nature est un théâtre, on peut donc la reproduire par la technique». Il faut se souvenir que le théâtre est alors un lieu de modélisation, d’invention esthétique et politique extrêmement puissant. Au même moment, la science moderne invente le laboratoire. J’ai voulu faire l’histoire de cette étonnante coïncidence. Chez Descartes, la première formulation de sa physique (dans le Monde, qu’il ne publie pas de peur de connaître le même sort que Galilée condamné en 1633) est présentée comme une fable, comme un spectacle. Il imagine comment l’Univers entier s’est formé : c’est une cosmogonie, une nouvelle genèse. Mais on découvre, au fil des textes, que cette genèse fabuleuse se transforme subrepticement en une description réaliste du fonctionnement de la nature. La matière est décrite comme un ensemble de petites machines sans capacité d’action propre. Un nouveau récit s’amorce, séparant définitivement la matière de la vie. Descartes commence par un petit théâtre et termine avec une théorie de la matière : on est passé de la fiction à la physique. Faut-il «canceller» Descartes, responsable de la réification de la nature ? Ce serait un très mauvais procès à lui faire et lui donner une influence beaucoup trop grande. Il n’y a pas une cause unique, bien sûr, à la situation que nous connaissons aujourd’hui. Lorsqu’on fait de Descartes le responsable, c’est notre culte du grand homme qui continue à nous aveugler. Dans tous les changements de monde, c’est la superposition de transformations scientifiques, philosophiques, esthétiques et économiques qui opère. Le XVIIe siècle nous donne un bon exemple de cela. Une nouvelle cosmologie se met en place, ainsi qu’une nouvelle conception de la Terre, qui s’articule à une nouvelle physique. Ces bouleversements scientifiques vont être repris par le pouvoir, qui trouve son intérêt dans cette cosmologie centraliste, puis dans un grand récit d’expansion spatiale et économique qui sera déployé au XVIIIe et au XIXe siècles. Le théâtre peut-il à nouveau, aujourd’hui, contribuer au changement de nos représentations du monde, pour mieux faire face aux crises écologiques ? Ce qui est à l’œuvre dans le théâtre contemporain, c’est un profond travail de reconfiguration des relations entre humains et autres que humains, entre le monde biotique et abiotique [où la vie est impossible, ndlr], entre le temps humain et le temps géologique… Le monde ordonné et hiérarchisé dans lequel notre génération est née est en train d’être complètement bousculé. C’est l’occasion de repenser la scénographie classique de l’homme face à une nature à exploiter. Ce temps de redéfinition, d’ébullition, de potentialités est fascinant. La scène est un laboratoire précieux pour faire place à ces mondes inconnus, ou méconnus. C’est ce qui nourrissait nos réflexions, avec Bruno Latour, lorsque nous avons créé la Trilogie terrestre. Dans le troisième volet, Viral, créé en pleine pandémie au printemps 2021, on se demandait ce que signifiait partager la scène avec les virus. Dans mes dernières mises en scène, je continue à explorer l’idée que l’espace et les choses sont eux-mêmes des personnages. Earthscape interroge nos manières d’habiter le monde grâce à une maison faite uniquement de sons. Dans le Bal de la Terre, les corps en mouvement des danseurs et des spectateurs composent un paysage vivant. Il n’y a plus de décor dans ces pièces, mais des récits, des danses et des interactions qui se déroulent autour et au milieu des spectateurs, et avec eux. La mise en scène de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris vous semble-t-elle porter des pistes intéressantes pour réinventer le théâtre ? Avec ses défilés, banquets, succession de tableaux vivant dans l’espace public, cette cérémonie m’a rappelé une ancienne tradition théâtrale, celle des mystères médiévaux, pendant lesquels toute la ville se réunissait pour assister à un spectacle dans les rues. Transformer la Seine en scène, c’était donc une proposition à la fois logique et audacieuse par rapport à l’idée du théâtre clos : le point de vue était diffracté, la pluie était présente, incontrôlable, et les puissants n’avaient pas plus que les autres accès à l’intégralité du spectacle. La cérémonie d’ouverture démontre avec éclat que le spectacle vivant n’est pas une forme fixe, aux conventions figées, mais une manière plastique, joueuse. Qu’un spectacle puisse mettre en émoi la fachosphère, être censuré dans plusieurs pays, susciter tant de débats, rappelle que les arts n’ont rien d’anecdotique, qu’ils façonnent, plus et mieux que d’autres discours, les imaginaires et les désirs. Avec la cavalière remontant la Seine sur un bateau invisible, et l’envol final de la flamme, j’ai retrouvé le goût des inventions merveilleuses où se croisent science, art et politique depuis la Renaissance. C’est une veine joyeuse et irrévérencieuse qui nous rappelle la puissance politique du spectaculaire, de la fête et du plaisir. En 2015, six mois avant la COP 21 de Paris, Bruno Latour et vous aviez monté le Théâtre des négociations, au Théâtre des Amandiers à Nanterre, avec des étudiants de différents pays. De quoi s’agissait-il ? C’était à la fois une expérimentation politique et une tentative pour donner à voir, par le théâtre, ce que Bruno appelait «le Parlement des choses». Nous avons voulu représenter les êtres et les entités qui étaient en jeu dans les négociations climatiques : non seulement les Etats-nations, mais les fleuves, les animaux… Nous voulions tester la puissance de la fiction, sa capacité à ouvrir brusquement la question politique à d’autres êtres. Comme dans un gigantesque jeu de rôle, chaque étudiant représentait une force en présence – un Etat, le lobby des hydrocarbures ou le fleuve Amazone, et, pendant trois jours, les négociations ont débordé dans les couloirs, les jardins, les bureaux, les ateliers… C’est ce qui m’a passionnée : la question écologique percute le théâtre au point d’en modifier les formes. Le théâtre est donc devenu, à cette occasion, un laboratoire esthétique, mais aussi philosophique et politique. Bruno Latour y a mis à l’épreuve certaines des idées qu’il développera ensuite dans Face à Gaïa, Laurence Tubiana a proposé d’y tester des protocoles de négociation qui allaient être appliqués dans la délégation française quelques mois après. Dix ans plus tard, on peut voir à quel point cette idée matérialisée par la fiction scénique, celle d’une assemblée des êtres de la nature et de leur légitimité à être représentés, politiquement ou juridiquement, a pris de l’ampleur, et n’a cessé d’être débattue, élargie, affinée, et parfois mise en œuvre… Faut-il littéralement détruire les théâtres pour les reconstruire différemment ? Surtout pas. Ils font partie des lieux où s’élabore une pensée collective, démocratique, forte, comme pendant les semaines de mobilisation avant les élections législatives. Mais il faut continuer à étendre les espaces dans lesquels nous pensons le monde. Espaces numériques, urbains, ruraux, espaces d’exposition, espaces sonores : partout où l’imagination, le récit et la fable peuvent se glisser, le théâtre peut poursuivre son travail de reconfiguration et de pluralisation des mondes, et lutter contre l’unification et l’amincissement du nôtre. Observer les métamorphoses simultanées des scènes politiques, scientifiques et esthétiques du passé nous permet d’aiguiser notre regard sur les bouleversements que nous vivons aujourd’hui. On diffracte les points de vue et les lieux du spectacle, on invente des laboratoires d’un genre nouveau pour explorer autrement la Terre. La planète entière est devenue une terre inconnue à découvrir, une scène de théâtre potentielle, à ciel ouvert. Propos recueillis par Thibaut Sardier et Sonya Faure dans Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 26, 2024 9:44 AM
|
Par Cristina Marino (Le Grand-Bornand [Haute-Savoie], envoyée spéciale du Monde) le 26 août 2024 Pour sa 32ᵉ édition, jusqu’au 29 août, la manifestation reste fidèle au projet d’origine de son fondateur et directeur, Alain Benzoni : proposer du spectacle vivant de qualité au jeune public.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/08/26/au-grand-bornand-le-festival-au-bonheur-des-momes-invite-a-lacher-les-ecrans-en-famille_6295388_3246.html Quand on découvre Le Grand-Bornand pour la première fois, on est d’emblée frappé par le côté carte postale de ce petit village touristique de Haute-Savoie – environ 2 100 habitants et autant de vaches –, niché dans l’écrin naturel de la chaîne montagneuse des Aravis. Fidèle à sa réputation de station de ski, berceau de plusieurs champions comme Tessa Worley ou Benjamin Daviet, et de traditionnelle étape du Tour de France. On s’attend moins à y voir débarquer quelque 60 000 festivaliers chaque année pendant cinq jours sur la dernière semaine d’août, « une bulle de détente » avant la rentrée scolaire. Et ce pour participer à la plus importante manifestation internationale et pluridisciplinaire de spectacles jeune public, mêlant théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque et arts de la rue. Avec un mot d’ordre affiché fièrement un peu partout : « Lâche tes écrans, viens voir du vivant ! » Né en 1992, le festival Au bonheur des mômes est avant tout le fruit du rêve un peu fou d’un « saltimbanque », comme il aime lui-même se qualifier, Alain Benzoni, surnommé « Benzo ». Né en 1955 à Chamonix (Haute-Savoie), il a fondé, en 1977, le Théâtre de la Toupine (d’abord appelé le Théâtre du petit rond, jusqu’en 1979), installé depuis 2004 à Evian (Haute-Savoie). Fidèle depuis toujours à une phrase d’Oscar Wilde, qu’il se plaît à citer – « La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit » –, Alain Benzoni n’a jamais fait les choses à moitié, notamment en tant que directeur général et artistique d’Au bonheur des mômes. L’échec d’une première mouture de cette manifestation en 1985-1986, baptisée le Festival en culottes courtes, ne l’a guère empêché à l’époque de persévérer dans sa volonté de créer un événement avant-gardiste pour les enfants. Plusieurs rencontres décisives lui ont permis de mener à bien ce projet et de l’inscrire dans la durée dans les années 1990. Notamment avec le maire actuel du Grand-Bornand, André Perrillat-Amédé (divers droite), réélu depuis mars 2014, après déjà trois mandats à son actif, de 1989 à 2008. Ce dernier a su voir l’intérêt pour sa commune de développer une politique culturelle ambitieuse à l’époque où d’autres stations de la région préféraient tout miser sur « l’or blanc », en privilégiant les activités liées à la neige. Autre rencontre importante pour la pérennité d’Au bonheur des mômes, celle avec l’office de tourisme du Grand-Bornand, plus particulièrement avec sa directrice, Isabelle Pochat-Cottilloux, en poste depuis 2005, également directrice générale et administrative du festival. « Respect mutuel » Cette alliance entre une compagnie théâtrale et un village semble fonctionner à merveille depuis plus de trente ans au Grand-Bornand. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 300 bénévoles, véritables chevilles ouvrières du festival, sans qui rien ne serait possible ; 150 professionnels, employés municipaux et techniciens ; près de 300 programmateurs ; 84 compagnies (dont 16 venues d’Europe et d’ailleurs) attendues cette année pour 97 spectacles, soit 597 représentations. Avec, en outre, des réalisations concrètes, comme La Source, un parc d’attractions alternatif ouvert en 2021 pour mettre en valeur le patrimoine régional. La clé de cette réussite ? Sans doute « le respect mutuel des valeurs fondamentales, de ce qui fait l’âme même de notre festival », comme le souligne Alain Benzoni. « Jamais, dans l’histoire d’Au bonheur des mômes, je n’ai connu de pressions de la part du maire ou de l’office de tourisme, j’ai toujours joui d’une totale liberté pour ce qui concerne la programmation artistique, précise-t-il. Cette confiance réciproque entre tous les partenaires est essentielle pour la bonne organisation de l’événement. » Des valeurs essentielles que le fondateur et directeur artistique tient à rappeler : le respect du jeune public, qui, contrairement aux idées reçues, est plutôt difficile et exigeant – « Ici, on ne prend les enfants ni pour des imbéciles ni pour des porte-monnaie sur pattes » ; la qualité des spectacles proposés (pas de « off », car Alain Benzoni veut assumer pleinement tous les choix de programmation) ; le souhait de former les spectateurs de demain et de s’inscrire dans une démarche de transmission entre les générations. Eclectisme Comme chaque année, la programmation de cette 32e édition s’annonce placée sous le signe de l’éclectisme, de la diversité artistique et linguistique (avec plusieurs compagnies venues d’Italie, d’Espagne, de Suisse et de Belgique). Des thèmes d’actualité seront abordés, mais toujours sous un angle ludique et pédagogique, accessible même aux tout-petits. Ainsi, le Théâtre des Marionnettes de Genève traitera de l’un des sujets forts de cette édition, le harcèlement scolaire, sous un angle original dans son spectacle Ultra Saucisse (2021), présenté pour la première fois en France : une petite chipolata, Charlie, est la cible des moqueries et des humiliations de ses camarades dans la devanture d’une boucherie. Une autre spécificité d’Au bonheur des mômes est la collaboration de la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos, fondatrice des espaces solidaires pour les familles Les Pâtes au beurre et marraine du festival. Après y avoir lancé en 2022 un plaidoyer national intitulé « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? », elle participera, mercredi 28 août, à une conférence-débat avec le philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Viveret sur « Ce que les enfants nous enseignent », animée par Eric de Kermel, directeur du magazine Terre sauvage. Enfin, le festival doit s’achever cette année par une manifestation contre le harcèlement scolaire et numérique organisée jeudi 29 août dans les rues du village, avec une « Fabrique à slogans ». Histoire de rester fidèle à l’esprit rebelle et militant des origines. Au bonheur des mômes, Le Grand-Bornand (Haute-Savoie), jusqu’au 29 août. Passe journée : 7 € et passe semaine : 24 €. Puis tarification spécifique de 4 € à 14 € pour les spectacles hors accès libre. Cristina Marino / LE MONDE (Le Grand-Bornand [Haute-Savoie], envoyée spéciale) Légende photo : « Fabulleux !!! », une déambulation avec bulles de la compagnie Un nouveau regard, dans la rue principale du Grand-Bornand Chinaillon (Haute-Savoie), lors de la parade d’ouverture du festival Au bonheur des mômes, le 25 août 2024. T. VATTARD/AU BONHEUR DES MÔMES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 23, 2024 9:05 AM
|
A l’occasion des vingt-cinq ans de sa compagnie de théâtre, que vient résumer une belle monographie, Sophie Perez a reçu «Libération» dans son atelier pour une rencontre décoiffante. «It’s…» Un vieil homme en guenilles s’approche de la caméra, haletant, à bout de forces, comme incrédule d’arriver au terme d’un très long périple. Alors qu’il n’est plus qu’à quelques pas de l’objectif, le générique du Monty Python Flying Circus retentit en fanfare. Chaque épisode démarre ainsi, avec un Michael Palin hagard déboulant d’un massif de fougères ou d’un sentier rocheux, se traînant vers l’émission et le spectateur, sans qu’on puisse savoir vraiment : est-ce que la chose qu’il désigne dans un dernier râle est la cause de ses souffrances ou son salut ? Est-ce que «c’est» le Flying Circus qui a fait de lui une loque en le pourchassant parmi les rochers de l’absurdie ? Ou bien est-ce que «c’est» le Flying Circus qu’il cherchait depuis tout ce temps, un refuge merveilleux de fantaisie dans un monde hostile ? Il en va de même avec la compagnie de théâtre de Sophie Perez, le Zerep, qui célèbre son quart de siècle d’existence dans une épaisse monographie où sont documentées toutes les outrances de cet étrange organisme en tension permanente entre le séduisant et le repoussant. Ouvrez au pif ce pavé de 300 pages et vous tomberez sur d’affreux gobelins endormis dans un cloître des Célestins miniature, ou des silhouettes dans leur plus simple appareil celluliteux, coiffées de perruques pastel, fausses dents à gogo, animaux empaillés, substances visqueuses, monticules, soupe d’organes… On entrait dans la Meringue du souterrain, jouée le mois dernier au théâtre du Rond-Point, avec la certitude d’une connivence esthétique et humoristique, mais le havre était truffé de pièges, d’éléments qui pouvaient se mettre soudain à enfler, jusqu’à exploser et en foutre partout sur les parois de nos cervelles frites – au hasard, ce moment où la comédienne Sophie Lenoir crible le public de questions de culture G, suscite l’hilarité à chacune de ses réactions outrancières («Yeah ! Fucking cool man !»), et puis, à force de répétition forcenée, les rires s’essoufflent, pour ne laisser planer plus qu’un malaise pesant. «Elle fout la trouille, Sophie», constate Perez avec un sourire admiratif, tirant sur sa 189e clope depuis le début de la conversation. Nous sommes mi-juin dans son atelier parisien dont les murs et les étagères dégueulent d’images et de bibelots accumulés comme dans un grand chaudron où la metteuse en scène pioche pour prendre un truc, l’agréger à un autre truc puis frotter ce nouveau truc à un autre truc en attendant qu’un suc finisse par en couler. Même appétit pour les frictions qui ont lieu au sein même de Stéphane Roger, autre membre central de la troupe : «Il peut faire le canard qui pète et, immédiatement après, être dans une sorte d’austérité. Il est drôle, mais aussi ténébreux. Des fois, c’est comme si ça le faisait chier d’être sur scène. Et il te le fait payer. Et j’adore ce truc. Parce que c’est monstrueux d’être sur scène, en fait.» L’azimutage peut jaillir n’importe où – de sa chienne Fendi tout comme d’un pichet à tête de clown posé en face d’elle et qui s’avère, quand on le retourne, équipé d’un mécanisme de boîte à musique… L’objet se met à égrener une petite mélodie désuète et l’artiste se réjouit : «Ça, ça fout le blues, hein !» La chienne, elle, après une heure à sommeiller sur le canapé, décide en pleine discussion de se mettre à creuser un trou dans le tissu, avec la même frénésie que quand elle entreprenait, un peu plus tôt, de se jeter sur notre mollet pour y effectuer un va-et-vient coïtal tout à fait inhabituel de la part d’une femelle. On emprunterait bien à Sophie Perez l’expression de «bamboula psychique» qu’elle-même emploie à propos de son éducation. Elle parle de «carnaval» aussi, ou de «cirque», quand elle évoque le foyer parental où «il y avait toujours des timbrés ; mon oncle, quand il sortait de prison, il se déguisait en prisonnier, avec un boulet en polystyrène, et on faisait la fête. Et en même temps, ils m’ont mise chez les bonnes sœurs. Tu vois le truc ? Le dernier coup qu’ils m’ont fait, j’arrive et puis il y a un mec dans le salon, il pue la pisse, il a pas de dents… Et mon père me dit : tu sais, c’est pas n’importe qui, c’est le puisatier qui a retrouvé la fille de Roland Giraud.» Eclat de rire éraillé. «J’ai été biberonnée à ça. Peut-être que c’est une histoire d’origines populaires ou que sais-je, ils étaient tous immigrés italiens et espagnols, ils étaient tous en clan ; une fournaise, quoi. Et c’est un drôle de truc, parce que mon père était quand même ingénieur, hein, ils ne vivaient pas dans une caravane à jouer du flamenco. C’est juste qu’ils sont marrants, ils s’arrêtent jamais.» Plus tard, elle nous fait plonger avec enthousiasme dans son «livre de chevet», un recueil de photos de figurants dans les films de Fellini, s’émerveille devant chaque «gueule» ou «dégaine» dont elle connaît par cœur les moindres détails, ce goitre moelleux, ces rouflaquettes géantes, ce brushing cartonné, ces sourcils trop épilés, et on a un peu le sentiment que c’est l’album photo de sa famille qu’elle est en train de feuilleter pour nous. A 11 ans, elle rêve de «faire des films de comédies musicales» et commence par apprendre les claquettes parce que «ça fait un bruit génial». «Mon truc, c’était le spectacle, quoi. Après, j’ai pris des cours de théâtre et là on te fait jouer un vieux Pinter, le prof te drague un peu, et tu te dis : quel horrible métier ! Puis j’ai fait du dessin et tout s’est imbriqué assez vite.» Bien que renvoyée sans arrêt des écoles jusqu’au bac qu’elle peine à obtenir, sa quête de «résoudre ce truc entre la peinture, le dessin, les claquettes, le théâtre» la mène à l’Esat (Ecole supérieure des arts et techniques, à Paris) où elle étudie la scénographie avant d’être acceptée à seulement 23 ans, l’année de son diplôme, à la Villa Médicis. Là, elle imagine sa première pièce inspirée d’une méthode pour apprendre à nager sans eau, mais surtout, organise des «fêtes de sauvages» dans son atelier. «Je suis arrivée là-bas, j’ai claqué tout le fric. Je faisais venir mes potes, j’ai acheté plein de billets d’avion… Je suis la seule où la banque m’a appelée au bout d’un mois et demi en me disant qu’ils n’avaient jamais vu ça, et que dès maintenant, ils allaient me donner une enveloppe par semaine avec du cash, pour que je ne puisse pas dépenser plus.» De retour à Paris, elle se rencarde avec le scénographe Carlo Tommasi qu’elle a rencontré pendant son année romaine. Celui-ci, qui a travaillé avec Fellini et Tarkovski, propose à Sophie Perez de l’épauler dans la conception de décors pour l’opéra Bastille. «Mais comme il était alcoolo et complètement à l’ouest, j’y allais toute seule et je me retrouvais à diriger des corps d’ateliers avec vingt mecs.» Une école qui confirme son goût pour un spectacle d’ampleur, «pas juste avec un transistor et un faux nez, quoi», où fricotent «un truc opératique et un truc expérimental». «C’est…» Beaucoup de ses phrases commencent comme ça, parce que parler d’elle seule n’est pas envisageable sans parler de cette extension d’elle-même qui pousse depuis 1997 comme un furoncle géant autour duquel rôde la conversation en tentant de saisir ce truc. Bien sûr, le Zerep, sur le papier, c’est une compagnie de théâtre, mais ne serait-ce pas aussi un esprit ? Un lieu ? Une condition ? Une communauté ? Un système ? Une substance ? Pour certains, c’est «une honte», pour elle, «c’est Frankenstein» comme le collage périlleux de Gisèle Vienne et d’un problème de hanche, ou encore «c’est la mise en abyme du foutage de gueule» comme Brando obèse avec un saladier sur la tête dans l’Ile du docteur Moreau, ou encore «c’est ce truc qui est en même temps dégoûtant et sublime» quand elle observe au restaurant un couple mal assorti, lui rongé de tics et elle «chaudasse» et considérablement plus âgée que lui. «C’est le mystère, aussi», d’arriver à donner «une forme impensable à des notions hyper respectables», c’est sa grand-mère qui danse avec un masque de DSK, c’est «tellement débile et tellement vertigineux», c’est «l’idiotie au rang d’art suprême, en fait». Au fil de la trentaine de pièces et performances produites par le Zerep, sa fondatrice voit s’accroître la reconnaissance du milieu, plutôt à l’abri des huées désormais et entourée de toute une petite escorte de théoriciens venus du monde de l’art, qui dissèquent non sans humour son œuvre dans la monographie fraîchement sortie. Mais là où jouer au festival d’Avignon ou dans tel théâtre représente pour certains un accomplissement symbolique, elle ne peut pas s’empêcher de vouloir «saboter le truc» et tire sa satisfaction plutôt de moments dans lesquels sa pile d’éléments disparates se met à tenir debout toute seule. Comme quand le Zerep investit Beaubourg en 2009 avec un festival de performances dans le socle d’une statue-théâtre, ou quand elle monte Jambon Birds au Palais de Tokyo avec un fauconnier, en 2012. «On est allés le voir à côté de Lourdes, sa femme est une ancienne patineuse cul-de-jatte, les mecs qui s’occupaient des cages, c’était Délivrance, un œil crevé, des dents en moins… Et au milieu de ça, il y avait Marlène [Saldana], habillée en Arlequin pour habituer les rapaces à son costume, avec des poussins morts dans la main… Le jour de l’ouverture, l’aigle royal est parti à travers le palais de Tokyo [elle mime un battement d’ailes majestueux, ndlr] et a foncé dans les vitres, Tex Avery quoi. Il est revenu en titubant à côté des lilliputiens qu’on avait fait venir pour un spectacle, et là je me dis : c’est bien, là, c’est normal, c’est là où on doit être.» Elle convient volontiers avoir «un drôle de rapport à la chose sociale», férue de virées shopping «dans les magasins de pompes pour vieilles» avec Sophie Lenoir. «La semelle en crêpe, un peu compensée mais pas trop, les scratchs, la couleur un peu tristoune entre le saumon et le brique… ça nous rend dingues !». Elle halète de rire et puis s’étonne : «Mine de rien, on a chacune réussi à faire des enfants, ce qui est quand même miraculeux, vu comme on est.» Au-dessus de son bureau, au pied d’une momie et d’une paire d’yeux de poupée qui ressemblent aux siens, sont épinglées des listes de mots mystérieuses : «des vagins dans les arbres /cacher des cadavres /bonne dégustation /sécrétions /éblouissant /on ne met pas ses gougoutes dans l’assiette /sur la table /les pelotons d’exécution du saucisson […]». La formule alchimique du Zerep ? Le Zerep : Le Théâtre et son Double-fond. Œuvres complètes 1998-2024 (Manuella Editions), 304 pp., 45 euros. Marie Klock / Libération Légende photo : La metteuse en scène Sophie Perez photographiée dans son atelier à Paris, le 18 juin 2024. (Romy Alizée/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 23, 2024 8:43 AM
|
De la fin de Boris Eltsine à l’avènement de Vladimir Poutine, le spectacle nous entraine dans les sphères opaques du pouvoir russe. Il donne à voir comment, sous l’influence de quelques hommes dont Vadim Baranov, le mystérieux Mage du Kremlin, un homme insignifiant peut devenir un président tout puissant, exerçant ses pleins pouvoirs dans la solitude, la violence et le sang.
Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli -plus de 600 000 lecteurs, a obtenu Le Grand prix du roman de l’Académie française et finale du prix Goncourt.
Le Mage du Kremlin
Un spectacle de Roland Auzet
Librement adapté du roman de Giuliano Da Empoli (Ed Gallimard)
Avec
Philippe Girard, Hervé Pierre, Stanislas Roquette, Irène Ranson Terestchenko, Karina Beuthe Orr, Claire Sermonne, Andranic Manet et la voix de Jean Alibert.
Du 4 septembre au 3 novembre 2024
La Scala – Paris
Du mercredi au samedi à 21h.
Le dimanche à 17h https://lascala-paris.fr/programmation/le-mage-du-kremlin/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 11:43 AM
|
par Eloïse Duval, envoyée spéciale à Bordeaux pour Libération, publié le 22 août 2024 Depuis près de deux ans, à Bordeaux, des ateliers permettent aux personnes atteintes de la pathologie de danser. Un moyen d’aider les participants à se réapproprier leurs mouvements. C’est une histoire de corps et de regard. De corps cessant peu à peu d’obéir sous l’effet de la maladie, qui attaque les cellules du cerveau indispensables au contrôle des mouvements. Et d’un lieu où ces personnes cessent d’être perçues uniquement comme des patients ou des malades. C’est pour déplacer le regard et aider les individus vivant avec Parkinson à se réapproprier leurs mouvements que, depuis bientôt deux ans, l’association Danse Parkinson France fait danser les personnes atteintes de cette pathologie neurodégénérative ainsi que leurs aidants. Mis en place par Muriel Maffre, ancienne danseuse étoile du ballet de San Francisco aujourd’hui directrice des études chorégraphiques au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ces ateliers ont également vocation à ouvrir la porte du réseau d’institutions des arts à ces personnes souvent marginalisées. Ce jeudi-là, dans le studio de danse niché sous les toits de l’annexe du conservatoire de Bordeaux, entre un hôtel aux façades ondulées et des échoppes typiques de la région, une douzaine de chaises sont installées en cercle. Muriel Maffre est déjà là, sourire aux lèvres. Au fond de la pièce, l’accompagnateur Adrien Bernège fait monter et descendre ses gammes au piano. Au compte-goutte, les danseurs pénètrent dans la salle, ôtent leurs chaussures et rangent leurs affaires. Il y a Jacques, qui va «comme ça peut», Hervé, une casquette rouge vissée sur le crâne, un peu fatigué par ses examens médicaux, et Marie-Noëlle, tout en gris, qui s’excuse cent fois d’avoir manqué les ateliers du mois de mars. 16 heures, tout le monde est là. Le silence se fait et le son du piano s’élève en même temps que les corps commencent à se mouvoir. «Il n’y a que des danseurs et des artistes» Assistée par Gaël Cardoso, Clarisse Pinet, professeure de danse contemporaine au conservatoire de Bordeaux, donne le tempo. Tendus vers le ciel, les corps s’étirent, se courbent, puis ploient et se déploient dans de larges ports de bras. Portés par les battements d’une batterie tantôt groovy tantôt jazzy, les pieds des danseurs frappent le sol en chœur. Tous expirent en même temps que la clarinette basse dans laquelle souffle Adrien Bernège entre deux coups de grosse caisse, homme-orchestre attentif aux sursauts des participants. Puis viennent les duos. Face-à-face, les danseurs se contemplent et, tour à tour, improvisent. «Ça vibre à l’intérieur de votre corps», lance Clarisse Pinet. Hervé plante ses yeux dans ceux d’un danseur qui écarte les bras, les ouvre encore et encore, faisant parfois frémir ses mains, mais volontairement cette fois. «Cet atelier de danse nous permet d’oublier, pendant un moment, que notre corps nous échappe», sourit Marie-Noëlle. A 74 ans, cette ancienne institutrice vit avec Parkinson depuis 2018. «On oublie qu’on est malade, parce qu’on se concentre sur le potentiel qu’il y a en chacun de nous. Et puis, au fil des ateliers, nos mouvements gagnent en aisance.» Pour Julia, c’est la toute première fois. Elle avoue avoir eu du mal à sauter le pas. «Venir à ce genre d’atelier, c’est passer de l’autre côté, celui des malades. Alors tant que je ne le faisais pas, j’avais le sentiment de faire encore partie du reste du monde», livre-t-elle. A 62 ans, cela fait bientôt dix ans que le diagnostic s’est mué en quotidien. «Dans la rue, comme on ne marche parfois pas très droit ou qu’il nous arrive de perdre l’équilibre, la plupart des gens pensent qu’on a trop bu», raconte Julia. «Je suis souvent dans les vapes alors on croit que je suis sous substances illicites», articule Hervé à son tour. Parfois, ils disent à Gaël Cardoso, l’assistant, les vertiges et les malaises, les pertes de contrôles ou encore les médicaments qui vous shootent complètement un jour et vous transforment en pile électrique le lendemain. Mais la plupart du temps, une fois franchi le seuil du studio, «il n’y a plus de patients ni de malades. Il n’y a que des danseurs et des artistes», tranche Muriel Maffre. Culture chorégraphique et connaissance du répertoire Avec un âge moyen de déclenchement à 58 ans, vivre avec Parkinson est à la fois un handicap moteur et social. «La plupart des personnes vivant avec cette maladie sont encore loin d’être en Ehpad, comme les gens l’imaginent. Mais la lenteur et le manque de contrôle du mouvement et du langage que provoque cette pathologie les isolent», déplore Muriel Maffre. Le studio permet d’échapper à un quotidien très médicalisé, rythmé par les rendez-vous chez le kiné et la prise des médicaments. «Quand ils dansent, ils ne tremblent plus. Ils se libèrent vraiment du carcan dans lequel la maladie peut enfermer leur corps», se réjouit la professeure Clarisse Pinet. En France, selon le ministère de la Santé et des Solidarités, 272 500 personnes vivent avec Parkinson, et 25 000 nouveaux diagnostics sont posés chaque année – contre 14 000 il y a dix ans. Et si l’aspect thérapeutique de la danse commence à être documenté par la littérature scientifique, pour Muriel Maffre, l’enjeu est aussi artistique : «La plupart des élèves qui peuplent ce cours n’avaient jamais dansé. Mais au même titre que les autres élèves du conservatoire, ils sont formés à travers les méthodes des danseurs professionnels.» De l’improvisation à la co-création, les participants acquièrent une culture chorégraphique et une connaissance des pièces du répertoire : «Nous travaillons avec des motifs de Balanchine, Béjart, Pina Bausch ou Keersmaeker, énumère la fondatrice de l’association. Et certains élèves sont même assez impatients de monter sur scène et de présenter leur travail.» Pour Muriel Maffre, qui aimerait voir le dispositif s’étendre dans le territoire, «les conservatoires ont un rôle à jouer dans ce qui est un problème de santé publique». «L’idée, c’est que cette initiative ne soit plus la seule dans le paysage culturel, et que vous puissiez prendre des cours de danse comme n’importe quel autre élève. Car même si vous avez Parkinson, vous faites toujours partie de la société. Vous avez une place dans ce réseau d’institutions des arts, et vous avez le droit à la musique, à la danse, à la beauté.» Elïse Duval / Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 3:32 AM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 21 août 2024 Pour célébrer ses quinze ans, la troupe du NTP plonge dans l’univers de Balzac et retrace, à travers trois spectacles comme autant d’épisodes d’une série théâtrale, l’itinéraire tumultueux de Lucien de Rubempré. Entre opérette, comédie et tragédie, les metteurs en scène et comédiens alternent les styles, allient haute exigence dramatique et accessibilité littéraire, et s’adonnent à quelques paris, majoritairement réussis. Malgré sa beauté manifeste, l’écrin de Fontaine-Guérin ne protège pas le Nouveau Théâtre Populaire (NTP) des difficultés économiques qui, de part en part, traversent le monde du spectacle vivant. Fin juillet, quelques heures avant l’ouverture de la billetterie de la XVIe édition de son festival annuel, la troupe a adressé, par courriel, une « Lettre au public » en forme de signal d’alarme. « Notre festival est aujourd’hui en danger, annonce-t-elle. Malgré une attention particulière à la réduction des coûts du festival, nous constatons que nous allons à brève échéance au-devant de grandes difficultés financières. Dans ces temps incertains, nous vous appelons à soutenir financièrement l’aventure du Nouveau Théâtre Populaire, et à nous aider à pérenniser sa démarche. » Pour cela, le collectif a invité les spectatrices et les spectateurs à choisir « les tarifs les plus élevés de [sa] grille de tarification libre », qui, depuis 2018, propose des places à 5, 10, 15 ou 20 euros, ou à « faire un don à l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire » qui, depuis sa fondation en 2020, abonde le budget de la troupe de quelque 10 000 euros par an. Résultat, le public a répondu présent à cet appel et, au mitan du festival, le prix moyen de la place payée dépassait la barre symbolique des 10 euros, contre 8,10 euros les années précédentes, tandis que les dons à l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire connaissaient, eux aussi, une belle dynamique. Salutaire, cette bulle d’air financière, qui repose sur « une solidarité intra-public », selon les mots de la co-directrice du NTP, Lola Lucas, n’est, par essence, pas pérenne et ne lève pas toutes les menaces qui pèsent sur l’avenir du festival. « Depuis plusieurs années, le festival est structurellement déficitaire d’environ 20 000 euros par an, mais nous parvenions jusqu’ici à combler ce manque, notamment grâce aux activités de méditation et aux actions culturelles que nous menons sur le territoire, détaille-t-elle. Si, pour cette édition, le déficit avait été anticipé et sera majoritairement absorbé par l’aide à la création qui nous a été accordée grâce à la tournée qui s’annonce, il en va tout autrement des deux prochaines années où nous nous préparons à un déficit d’environ 60 000 euros ». En cause, comme pour tant d’autres structures : l’inflation, qui a renchéri les coûts de l’énergie et entraîné une augmentation des salaires minimaux accordés aux comédiennes et comédiens, mais aussi une stagnation, voire une baisse des aides publiques. « Avec notre budget d’1 million d’euros, dont 150 000 euros de charges fixes, nous sommes devenus une très grosse institution sur un tout petit territoire, observe Lola Lucas. Alors, lorsque nous sollicitons nos tutelles, le discours est le même partout et beaucoup de collectivités rechignent à nous soutenir à l’endroit de la tarification libre et accessible qui fait partie de la base de notre projet. » Quant à la DRAC, elle refuse, depuis plusieurs années, de reconnaître le Nouveau Théâtre Populaire comme une compagnie – ce qui ferme la voie à toute possibilité de conventionnement – au motif qu’il s’agit d’un « collectif ». Pis, elle a fait passer de 20 à 10 000 euros l’aide aux festivals qui, depuis trois ans, est accordée, année par année, au NTP – une baisse compensée par l’augmentation de 10 à 14 000 euros de l’aide au fonctionnement de la Région Pays-de-la-Loire et par l’arrivée du Département du Maine-et-Loire, et de son enveloppe de 6 000 euros, parmi les partenaires publics. De Chardon à Rubempré En dépit de ces nuages noirs, la troupe de Fontaine-Guérin n’a, pour célébrer ses quinze ans, cédé aucun millimètre d’audace artistique. Comme chaque année, pas moins de cinq créations sont à l’affiche de cette XVIe édition : deux spectacles jeune public tirés, pour l’un, du Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et, pour l’autre, du Pinocchio de Joël Pommerat, et une série théâtrale baptisée Notre Comédie humaine. Contrairement à son habitude, et comme il l’avait fait à l’occasion de sa formidable saga Molière, Le Ciel, la Nuit et la Fête, en forme d’audacieuse traversée du Tartuffe, de Dom Juan et de Psyché, le Nouveau Théâtre Populaire a concentré tous ses efforts sur un auteur unique, Balzac, et plus particulièrement sur la trajectoire de l’un des personnages parmi les plus fameux de sa fresque littéraire, Lucien Chardon, mieux connu sous le nom de Lucien de Rubempré. À partir d’une adaptation, publiée chez Esse Que Éditions, d’Illusions perdues et de Splendeurs et misères des courtisanes, sont nés trois spectacles, comme autant d’épisodes, tout à la fois autonomes et intimement reliés, d’une aventure hors norme, mais aussi un trio d’apéro-spectacles – qui prendront la forme de prologues ou d’intermèdes au cours de la tournée –, baptisé La Dernière nuit (Paradis/Purgatoire/Enfer). Mettant en scène l’auteur, tel un démiurge littéraire au soir de sa vie, autant accroc au café que perclus de douleurs, ces trois formes courtes, pilotées par Pauline Bolcatto, ont le mérite, si elles paraissaient un peu brouillonnes et malhabiles dans leur adresse public aux soirs des premières, de poser l’esthétique singulière de chacune des pièces qui prennent leur suite, à la manière de sas préparatoires à une épopée formelle où alternent comédie, tragédie et… opérette. Les Belles Illusions de la jeunesse, le temps (pas si) béni d’Angoulême Car c’est bien avec ce genre si particulier, qui, avant le début des hostilités, a pu inquiéter une partie du public du NTP, qu’Émilien Diard-Detoeuf a choisi d’ouvrir le bal de cette Comédie humaine qui ne tardera pas à s’imposer, malgré les près de deux siècles qui nous séparent de Lucien de Rubempré, comme la nôtre. Fondée sur la première partie d’Illusions perdues, intitulée Les Deux Poètes, ces Belles Illusions de la jeunesse remontent aux origines du parcours de ce jeune provincial qui ne rêve pas encore de monter à Paris. Fils d’un modeste pharmacien, Lucien Chardon s’ennuie ferme dans son fief natal d’Angoulême, supporte mal sa condition sociale et aspire à rejoindre la « partie haute » de la ville et sa grande bourgeoisie. Grâce à l’aide de sa soeur, Eve, et de son beau-frère imprimeur, David, mais aussi à l’entremise de Sixte du Châtelet, qui voit, dans un premier temps, dans l’apprenti poète un moyen de conquérir Madame de Bargeton et d’arriver à ses fins politiques, le jeune homme parvient à s’introduire dans ce cénacle, à y faire résonner sa poésie – aux fondations faiblardes – et à emporter l’oreille et les faveurs de la dame d’Angoulême qui, pour échapper à son vieux mari, entend bien s’enfuir vers la capitale. Pour traduire le relief de cette période faste qui, au regard de ce qui va suivre, à l’allure d’un temps béni, Émilien Diard-Detoeuf fait donc le pari osé, mais réussi, de l’opérette. En quatre actes et dix-sept airs, interprétés au piano par Sacha Todorov, le metteur en scène joue à fond la carte de ce style singulier, tout en respectant la totalité de ses codes, comme l’exacte parité entre les parties parlées et chantées. Sans jamais sombrer dans le ringard, au rythme des rengaines et des ritournelles qui, bientôt, deviennent entêtantes, au gré des rimes qui relèvent volontairement de la rimaille qui fait sourire, voire rire, c’est tout le petit théâtre de la « partie haute » d’Angoulême qui se fait jour, avec son côté un peu miteux, un peu bas de gamme, un peu médiocre, mais en même temps déjà cruel. Alors que la collection de personnages convoqués jouent les rôles que la société attend d’eux dans le petit théâtre de Guignol qui occupe l’essentiel de la scène, les faux-semblants et les dangers qui, plus tard, causeront violemment sa perte, semblent déjà menacer Lucien, pris, pour ne pas dire perdu, dans ce maelström tourbillonnant d’un monde dont il n’a ni les codes, ni les clefs. Tandis que l’intellectualisme parisien paraît bien loin, mais que la bassesse des hautes sphères est déjà là, notamment à travers ce choeur de nobliaux angoumoisins qui aspirent à la chute de ceux qui réussissent, l’opérette, rondement menée par Émilien Diard-Detoeuf et interprétée avec gourmandise, et un brin de folie encore sous le pied, par les comédiennes et les comédiens – à commencer par Elsa Grzeszczak, succulente en Madame de Bargeton vénéneuse et pathétique –, caractérise et singularise l’ensemble des personnages, et pose, en sous-main, les bases de ce que Lucien vivra à Paris. Illusions perdues, traquenard contemporain Fondées sur un même travail d’adaptation de l’oeuvre d’origine, aussi drastique que limpide, capable d’allier accessibilité et haute exigence, notamment de la langue, les Illusions perdues tricotées par Léo Cohen-Paperman, avec la complicité de Julien Campani à l’écriture, opèrent une double translation : vers la capitale, que Lucien rejoint en compagnie de Madame de Bargeton, et vers notre époque, dont avec ses tenues, ses accessoires et ses gimmicks – selfies, smartphones, cocaïne… – le metteur en scène reprend les codes. Scindé en trois étages, le plateau a l’allure d’une pyramide sociale, la forme d’une maison sociétale fragmentée où chaque pièce serait occupée par l’un des maillons d’une chaîne alimentaire : pendant que les intellectuels engagés, façon pauvres zonards, et Balzac, reconverti en cuisinier chez Flicoteaux – devenue une friterie –, se partagent le bas de l’échelle, les journalistes Emile Blondet, Etienne Lousteau et Andoche Finot campent à l’échelon intermédiaire avec l’auteur à succès Raoul Nathan, l’éditeur sans scrupules Dauriat et la comédienne Coralie, accompagnée de son pygmalion Camusot, et La Marquise d’Espard, avec ses airs d’Anna Wintour, trône tout en haut de l’édifice, avec Madame de Bargeton et Sixte du Châtelet en guise de modestes convives et tristes courtisans, passés maîtres dans l’art du faire-valoir. Avec l’air de ces vautours assis sur leurs privilèges et prêts à dévorer la carcasse de ceux qui tombent au champ d’honneur, tous trois observent la meute de la strate du dessous, et en particulier Lucien de Rubempré, s’égayer, se battre et se débattre. Rejeté d’entrée de jeu par La Marquise d’Espard pour défaut de noblesse, le jeune homme trouve finalement sa planche (temporaire) de salut et sa voie d’accès à la haute société grâce au journalisme critique qui, dans cette période où les gazettes font florès, fait la pluie et le beau temps dans le monde du théâtre. En même temps qu’il s’amourache de Coralie, Lucien joue alors pleinement le jeu de ce monde sans foi, ni loi, où tout n’est que corruption, combinaison d’intérêts et renvoi d’ascenseur entre copains éphémères. Faute d’en maîtriser véritablement tous les codes, il ne tarde pas à s’y brûler les ailes, a pêché par cet excès de naïveté propre au « petit provincial » qui, une fois monté à Paris, accède à des sphères qui vont s’empresser de le broyer. Sans totalement larguer les amarres avec Balzac, Léo Cohen-Paperman et Julien Campani se plaisent alors, avec justesse et malice, à cultiver les jeux de miroirs entre ce monde et le nôtre, et avant tout celui des journalistes. Particulièrement bien dessinés, avec un caractère social sous-jacent clairement identifiable, qui tend à dépasser leur individualité, tous les personnages qui s’ébrouent dans ce marigot apparaissent venimeux et mus par une dynamique d’attraction-répulsion qui parvient à se propager jusque dans l’esprit du public. Par ce procédé scénique qui impose à toutes et tous d’être constamment en scène, Léo Cohen-Paperman réussit à créer un effet de masse, mais aussi d’engrenage. Si, au soir de la première, la proposition paraissait encore en phase de rodage, handicapée par cette segmentation scénographique qui réduit l’espace d’expression de chacune et de chacun et empêche les corps, et donc le jeu, de se déployer pleinement, tous les ingrédients sont présents pour qu’au fil des représentations, et a fortiori sur un plateau moins étroit lors de la tournée, cette comédie noire trouve toute son aisance et sa puissance, capables de générer ce cruel tourbillon qui propulse Lucien, avant de l’aspirer. Splendeurs et misères, la rançon de l’audace Contrairement à Illusions perdues qui, ces dernières années, a inspiré nombre d’artistes, à commencer par la metteuse en scène Pauline Bayle et le réalisateur Xavier Giannoli, sa suite directe, Splendeurs et misères des courtisanes, n’a pas connu le même destin. Il faut dire que l’oeuvre de Balzac à laquelle s’attaque Lazare Herson-Macarel est, avec sa galaxie d’innombrables personnages, encore plus retorse, et sans doute encore plus noire et complexe que celle qui la précède. Après être tombé en disgrâce, Lucien tente de surnager dans les bas-fonds de la société parisienne, avec l’aide du faux abbé Carlos Herrera, qui tente, en sous-main, de briser sa relation amoureuse avec Esther. Pour essayer de se refaire, le jeune homme, qui a perdu de sa superbe mais souhaite devenir riche, ambitionne de se marier avec Clotilde de Grandlieu. Pour emporter l’adhésion de ses parents, il doit amasser une fortune personnelle et suit les conseils de son sournois protecteur : faire chanter le baron de Nucingen en prostituant Esther dont le vieil homme s’est entiché, jusqu’à causer leur triste perte commune. Pour adapter théâtralement ce monstre littéraire, Lazare Herson-Macarel est, comme Émilien Diard-Detoeuf et Léo Cohen-Paperman avant lui, contraint d’opérer des choix draconiens, sans doute moins habiles et féconds que ceux de ses deux compères. Sous sa houlette, les personnages de Splendeurs et misères des courtisanes sont relégués au rang de figures, tout de noir vêtues, leurs visages grimés en blanc ou recouverts d’un demi-masque noir. Dans ce bal de créatures cruelles, qui n’ont plus d’humain que leur coeur qui batte, toutes les relations sont, à plus ou moins grande échelle, intrinsèquement corrompues, à l’image de celle de Lucien et de Vautrin qui, d’entrée de jeu, semblent passer un pacte comparable à celui de Faust et de Méphistophélès, et ne peuvent déboucher que sur des coups de Trafalgar en cascade, qui précipitent vers l’abîme celles et ceux qui en sont victimes. Comme pour prendre le contrepied de la scène particulièrement chargée d’Illusions perdues, et traduire le vide qui s’ouvre sous les pieds de Lucien, le metteur en scène fait le choix du plateau totalement nu, habité par un unique piano. Si sa proposition plastique s’avère, sans doute, la plus audacieuse des trois composantes de cette Comédie humaine, par sa radicalité esthétique comme par sa capacité à générer quelques belles images, son spectacle peine, sur la durée, à s’épanouir et à offrir à Splendeurs et misères des courtisanes toute l’ampleur qu’il mérite. Le jeu des comédiennes et des comédiens, toujours impeccable, en particulier celui de Kenza Laala, bouleversante en Esther, n’est pas en cause, mais l’ensemble, en dépit de son bel épilogue, ne trouve pas l’énergie scénique nécessaire pour imprimer un rythme convaincant. Tant et si bien que, par trop déconnecté du cadre naturel offert par Fontaine-Guérin, et émaillé de moments chorégraphiques hasardeux, il perd en limpidité, jusqu’à dissoudre Lucien et sa trajectoire en cloche dans un trop-plein de noirceur, dont, une fois englué, il ne pourra réchapper. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Les Belles Illusions de la jeunesse
d’après Illusions perdues de Balzac
Adaptation et mise en scène Émilien Diard-Detoeuf
Musique Gabriel Philippot
Avec Valentin Boraud, Thomas Durand, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Julien Romelard, Sacha Todorov
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière Thomas Chrétien
Costumes Zoé Lenglare, Manon Naudet
Chorégraphie Georgia Ives
Maquillage et coiffure Pauline Bry
Régie générale et plateau Marco Benigno, assisté de Thomas Mousseau-Fernandez
Chef de chant Antoine Philippot
Régie son Lucas Soudi
Assistanat à la mise en scène Louise Bachimont Production Nouveau Théâtre Populaire
Coproduction Le Quai – CDN d’Angers, La Criée – CDN de Marseille, Théâtre de Caen, CENTQUATRE-PARIS, Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire
Avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium et du Théâtre de la Tempête Le Nouveau Théâtre Populaire est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Pays-de-la-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le Département du Maine-et-Loire et l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon, La Ménitré), et soutenu par les communes de Loire-Authion et de Baugé-en-Anjou et l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire. Durée : 1h30 Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Fontaine-Guérin
les 13, 16, 20, 23 et 27 août 2024 La Criée, CDN de Marseille
le 2 octobre et en intégrale le 5 octobre Théâtre de la Tempête, Paris
les 6, 13 et 20 novembre, et en intégrale les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 novembre Le Quai, CDN d’Angers
le 11 décembre et en intégrale le 14 décembre Théâtre de Caen
le 29 janvier 2025 et en intégrale le 1er février Illusions perdues
d’après Balzac
Adaptation et mise en scène Léo Cohen-Paperman
Collaboration à l’écriture Julien Campani
Avec Valentin Boraud, Philippe Canales, Émilien Diard-Detœuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Julien Romelard, Charlotte Van Bervesselès
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière Thomas Chrétien
Costumes Zoé Lenglare, Manon Naudet
Son Camille Vitté
Maquillage et coiffure Pauline Bry
Régie générale et plateau Marco Benigno, assisté de Thomas Mousseau-Fernandez
Assistanat à la mise en scène Louise Bachimont Production Nouveau Théâtre Populaire
Coproduction Le Quai – CDN d’Angers, La Criée – CDN de Marseille, Théâtre de Caen, CENTQUATRE-PARIS, Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire
Avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium et du Théâtre de la Tempête Le Nouveau Théâtre Populaire est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Pays-de-la-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le Département du Maine-et-Loire et l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon, La Ménitré), et soutenu par les communes de Loire-Authion et de Baugé-en-Anjou et l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire. Durée : 2h Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Fontaine-Guérin
les 14, 17, 21, 24 et 28 août 2024 La Criée, CDN de Marseille
le 3 octobre et en intégrale le 5 octobre Théâtre de la Tempête, Paris
les 7, 14 et 21 novembre, et en intégrale les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 novembre Le Quai, CDN d’Angers
le 12 décembre et en intégrale le 14 décembre Théâtre de Caen
le 30 janvier 2025 et en intégrale le 1er février Splendeurs et misères
d’après Splendeurs et misères des courtisanes de Balzac
Adaptation et mise en scène Lazare Herson-Macarel
Avec Marco Benigno, Valentin Boraud, Philippe Canales, Émilien Diard- Detœuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Thomas Mousseau-Fernandez, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Julien Romelard, Sacha Todorov, Charlotte Van Bervesselès
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière Thomas Chrétien
Costumes Zoé Lenglare, Manon Naudet
Son Camille Vitté
Chorégraphie Georgia Ives
Maquillage et coiffure Pauline Bry
Régie générale et plateau Marco Benigno, assisté de Thomas Mousseau-Fernandez
Assistanat à la mise en scène Janna Behel Production Nouveau Théâtre Populaire
Coproduction Le Quai – CDN d’Angers, La Criée – CDN de Marseille, Théâtre de Caen, CENTQUATRE-PARIS, Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire
Avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium et du Théâtre de la Tempête Le Nouveau Théâtre Populaire est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Pays-de-la-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le Département du Maine-et-Loire et l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon, La Ménitré), et soutenu par les communes de Loire-Authion et de Baugé-en-Anjou et l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire. Durée : 2h Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Fontaine-Guérin
les 15, 18, 22, 25 et 29 août 2024 La Criée, CDN de Marseille
le 4 octobre et en intégrale le 5 octobre Théâtre de la Tempête, Paris
les 8, 15 et 22 novembre, et en intégrale les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 novembre Le Quai, CDN d’Angers
le 13 décembre et en intégrale le 14 décembre Théâtre de Caen
le 31 janvier 2025 et en intégrale le 1er février La Dernière nuit (Paradis / Purgatoire / Enfer)
Conception et mise en scène Pauline Bolcatto
Collaboration artistique Sacha Todorov
Avec Valentin Boraud, Philippe Canales, Émilien Diard- Detœuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Julien Romelard, Sacha Todorov, Charlotte Van Bervesselès
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumière Thomas Chrétien
Costumes Zoé Lenglare, Manon Naudet
Son Camille Vitté, Lucas Soudi
Maquillage et coiffure Pauline Bry
Régie générale et plateau Marco Benigno, assisté de Thomas Mousseau-Fernandez
Assistanat à la mise en scène Janna Behel Production Nouveau Théâtre Populaire
Coproduction Le Quai – CDN d’Angers, La Criée – CDN de Marseille, Théâtre de Caen, CENTQUATRE-PARIS, Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire
Avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium et du Théâtre de la Tempête Le Nouveau Théâtre Populaire est subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Pays-de-la-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le Département du Maine-et-Loire et l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon, La Ménitré), et soutenu par les communes de Loire-Authion et de Baugé-en-Anjou et l’Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire. Durée : 30 minutes Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Fontaine-Guérin
du 13 au 29 août 2024 La Criée, CDN de Marseille
du 2 au 5 octobre Théâtre de la Tempête, Paris
du 2 au 24 novembre Le Quai, CDN d’Angers
du 11 au 14 décembre Théâtre de Caen
du 29 janvier au 1er février 2025

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 19, 2024 4:38 PM
|
Publié le 13 juin par Sceneweb Il dirige le Théâtre de la Porte Saint-Martin et le Petit Saint-Martin, Jean Robert-Charrier prend la direction du théâtre des Bouffes Parisiens. Comme à la Porte St-Martin, il souhaite proposer un virage à la fois radical et en douceur de la programmation de ce théâtre qui avait été dirigé par Jean-Claude Brialy de 1986 à 2007. Son parcours a tout d’une success-story à faire rêver chaque jeune de province montant à Paris : « je suis entré au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 2004 pour payer mes cours de comédien : je déchirais les tickets à l’entrée, puis j’ai gravi les échelons en occupant tous les postes en cinq ans ». Un parcours singulier que le directeur attribue à la force de son travail et à la chance d’être arrivé au bon endroit au bon moment : « quelques jours après mon entrée dans les lieux, j’ai écris à l’administratrice de l’époque pour lui dire que j’avais eu une révélation et que je voulais diriger un jour un théâtre, et pourquoi pas la Porte Saint-Martin ! ». Il est le directeur de l’un des fleurons de l’industrie du théâtre privé parisien, et fait fi de toutes les barrières. Il a permis aux productions de Joël Pommerat de trouver ces dernières années un nouveau public. La nouvelle version de La Réunification des deux Corées est actuellement un succès à la Porte Saint-Martin. « J’ai visité de nombreuses salles, porté mes espoirs sur plusieurs projets passionnants, et puis Marc Ladreit de Lacharrière m’a fait cette magnifique proposition de reprendre la direction des Bouffes Parisiens. J’ai pris le temps d’aller visiter ce lieu que je connaissais mal. J’en avais été rarement le spectateur » explique son nouveau directeur. Comme à la Porte St-Martin, il souhaite « proposer un virage à la fois radical et en douceur, que ma première année de projets soit « Ceci et Cela » avec comme seuls points communs, l’exigence et la popularité. » Et fait sienne la parole de Laurent Terzieff aux Molières 1993. « J’ai envie que les premiers spectacles présentés aux Bouffes Parisiens en 2025 soient à l’image de mes influences très diverses de spectateur. Il se trouve que l’un de mes premiers souvenirs de théâtre, c’est Isabelle Nanty dans le Tartuffe mis en scène par Jacques Weber au Théâtre Antoine. À la fin de la représentation je suis allé faire signer mon programme à l’entrée des artistes par Isabelle Nanty qui m’a dessiné « un soleil pour ta vie, Jean ». Alors après m’avoir ainsi illuminé, je lui dois bien d’ouvrir ma programmation avec elle. Ce sera son grand retour seule en scène dans un spectacle écrit et mis en scène par Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau. » Ce seule en scène sera programmé du 7 janvier au 16 février 2025. Puis Emmanuel Noblet mettra en scène Encore une journée divine d’après le roman de Denis Michelis (du 30 janvier au 17 avril 2025) avec François Cluzet, le spectacle sera créé début janvier à Aix-en-Provence au Théâtre du Jeu de Paume. Comme il l’a fait avec Joël Pommerat, Jean Robert-Charrier souhaite que les oeuvres circulent. Ainsi il va programmer La Tendresse de Julie Berès, pièce créé en 2022 au CDN Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, qui tourne depuis en France, et qui avait repris la saison dernière aux Bouffes du Nord. Et pour la rentrée de … septembre 2025, il a confié à Alain Françon, qui lui a porté chance cette année avec la création de Un Chapeau de paille d’Italie, le soin de mettre en scène l’unique pièce de Claude Simon, La séparation avec Catherine Hiegel et Léa Drucker. Par l'équipe de Sceneweb Crédit photo : © Photo Laurent Champoussin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 11, 2024 9:54 AM
|
Par Marina da Silva dans L'Humanité - 6 août 2024 Bussang (Vosges), correspondance particulière. Le Théâtre du Peuple fêtera ses 130 ans l’an prochain. Nommée en octobre 2023, Julie Delille est la première femme à le diriger. Elle y monte avec éclat le Conte d’hiver de Shakespeare, traduit par Koltès.
Pour sa première programmation au cœur de Bussang, Julie Delille n’a pas seulement imaginé le Conte d’hiver pour la scène, mais rêvé de faire du Théâtre du Peuple un « lieu poreux au monde extérieur » depuis lequel penser « en compagnie d’artistes, de poètes, de chercheurs et des habitants du territoire ». Un engagement pour lequel elle était prête à tout quitter, sauf sa compagnie, le Théâtre des trois Parques, qu’elle va conserver. Un appel du destin auquel elle répond corps et âme. Pour la metteuse en scène, investir Bussang est un projet total qu’elle veut construire à partir de l’écologie environnementale, sociale et mentale, qu’elle conjugue en trois axes : la saisonnalité, la sensibilité et l’organicité. Une nécessité qu’elle met aussi à l’œuvre poétiquement au plateau, secondée par la dramaturge Alix Fournier-Pittaluga et la scénographe Clémence Delille, pour tirer du conte tragi-comique de Shakespeare, traduit par Koltès en 1988 pour Luc Bondy, une fable mordante d’aujourd’hui où les femmes sont audacieuses et puissantes. Vingt comédiens sur scène On était impressionné par ses précédentes créations, qui se déroulaient dans une sorte de « boîte noire » pour un ou deux comédiens ; ici, elle en orchestre une vingtaine, dont quatre acteurs professionnels qu’ont rejoints, selon le protocole bussenet, les comédiens amateurs de la troupe 2024 du Théâtre du Peuple, et des figurants, hommes et femmes. La pièce est l’une des dernières écrites, vers 1610, par le dramaturge britannique, en même temps que la Tempête, davantage représentée. Elle démarre dans le palais fastueux de Léontes (Baptiste Relat), roi de Sicile, qui reçoit, en compagnie de son fils et de sa femme enceinte, son ami d’enfance Polixènes (Laurent Desponds), maître de la Bohème. Hermione (Laurence Cordier, subtile) va intercéder pour retenir Polixènes et suscite la jalousie folle de Léontes, convaincu que l’enfant à naître n’est pas le sien. Polixènes ne devra sa survie qu’à sa fuite éperdue. Hermione, arrachée à son fils Mamillius, est emprisonnée et accouchera d’une petite Perdita, promise à l’abandon. Le jour de son procès, la déclaration d’innocence du dieu Apollon arrive trop tard, tout a été anéanti. Les trois premiers actes déployés dans des boiseries et vitraux avec des temps de silence et des ruptures musicales originales signées de Julien Lepreux impressionnent. L’auteur-compositeur a créé une partition – traversée par la voix de Gaëlle Méchaly – où l’orgue occupe une place magnétique, même si l’alliance jeu-musique semble parfois interrompre la dynamique des acteurs. « La création, l’expérimentation et la transmission » Les lumières d’Elsa Revol, la scénographie, les costumes, le point de vue sur les enjeux contemporains du Conte d’hiver captivent l‘attention et l’émotion du spectateur. On remarque particulièrement Élise de Gaudemaris, qui interprète Paulina, la fidèle et téméraire servante d’Hermione, et Sophia Daniault-Djilali, dans ses multiples rôles. Lorsque se produit l’ouverture tant attendue du fond de scène sur la forêt, pour la fête de la tondaison qui fait défiler un troupeau de brebis – à l’extérieur et à l’intérieur de la salle –, le public est en délire. Après l’entracte seize années auront passé et la pièce se révélera plus limpide et joyeuse, offrant un véritable espace de jeu et de danse aux comédiens et comédiennes, professionnels ou débutants, pour explorer les constructions et les contradictions de leurs personnages. Perdita, recueillie par un berger, en Bohème, est devenue une magnifique jeune fille dont Florizel, le fils de Polixènes, est tombé éperdument amoureux. Les deux jeunes gens devront s’enfuir pour pouvoir vivre cette passion transgressive, qui finit bien et répare le passé. Pour Julie Delille, les thèmes de la pièce confortent « la triple vocation de cet équipement unique : la création, l’expérimentation et la transmission ». Si elle entend privilégier des temps de recherche, elle veut aussi programmer sur le territoire tout au long de l’année des propositions diverses et multiples. À partir du 7 août et jusqu’au 30 août, le public pourra voir ou revoir Les gros patinent bien, d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois (qui dirigea le Théâtre du peuple de 2005 à 2011), assister à des impromptus, à un récital du pianiste Jean-Claude Pennetier ou aux premières Journées du matrimoine, qui se dérouleront les 14 et 15 septembre. Marina da Silva / L'Humanité Jusqu’au 31 août, à Bussang. Rens. : theatredupeuple.com
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...