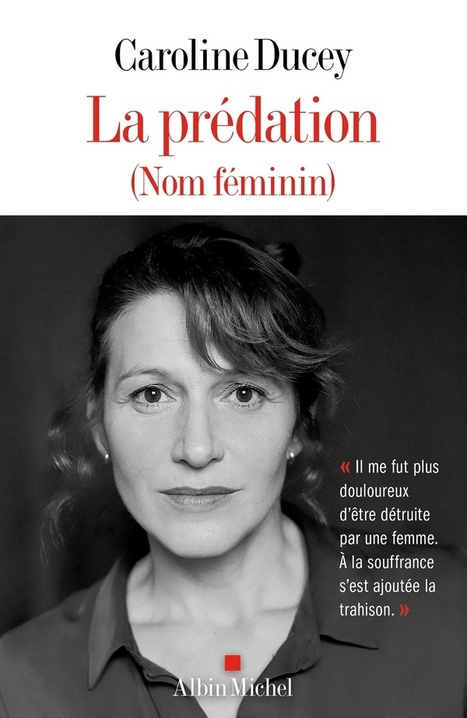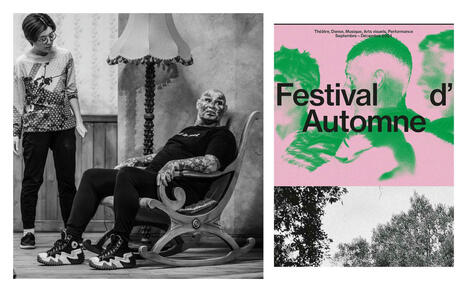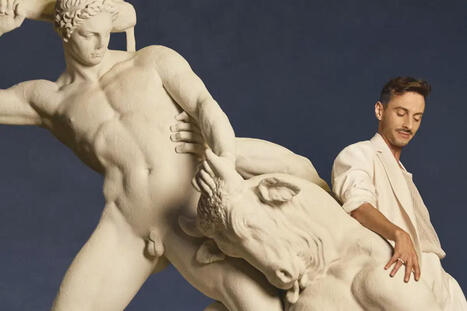Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2024 3:51 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 17 septembre 2024 L’auteur et metteur en scène, qui signe avec « Portrait de famille, une histoire des Atrides » l’un des meilleurs spectacles de la rentrée, cultive l’éclectisme et se plaît à transformer la scène en espace de plaisir et de joie.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/17/jean-francois-sivadier-accoucheur-des-possibles-de-l-acteur_6321963_3246.html
A l’heure de parler de Jean-François Sivadier, on se retrouve face à un paradoxe. L’homme est à la fois transparent en apparence et énigmatique. Lumineux et semblant préserver jalousement ses zones d’ombre et de secret. Sa présence, minérale, massive, habite l’espace, banal, où il a donné rendez-vous, tout en se dissolvant de manière aérienne et rêveuse. Il est l’un des plus grands metteurs en scène français de théâtre et d’opéra, l’un des plus célébrés, doublé d’un auteur, mais… Mais quoi ? Il échappe, y compris à ses proches, qui témoignent de cette dimension insaisissable. En attendant, l’impétrant signe l’un des meilleurs spectacles de la rentrée, avec ce Portrait de famille, une histoire des Atrides, à voir au Théâtre de la Commune (jusqu’au 29 septembre), à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), puis en tournée partout en France jusqu’à la fin de la saison : quatre heures de plaisir chimiquement pur, qui retournent les spectateurs comme une crêpe entre rire et effroi. Le spectacle, créé avec une promotion d’élèves-acteurs du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, s’offre comme une quintessence de son art de metteur en scène-auteur, où les paradoxes dansent la sarabande, entre tragédie et comédie, théâtre savant et fête populaire, énergie fracassante et mélancolie. « Espace de liberté » Est-ce parce que le théâtre lui colle à la peau depuis toujours ou presque qu’il peut ainsi en faire un vaste terrain de jeu où tout est possible, pour la plus grande joie des spectateurs ? « Je ne sais pas ce qui a tissé cette fibre artistique qui nous a contaminés, mon frère [Pierre-Michel Sivadier, pianiste, compositeur, chanteur et auteur] et moi, s’interroge-t-il. Peut-être s’est-elle formée dans un épisode un peu mythique de notre famille : avant notre naissance, nos parents ont sillonné l’Afrique centrale, de village en village, avec leur petite entreprise de cinéma ambulant. » Quand les deux frères Sivadier naissent, l’aventure est terminée, qui laisse sans doute ses effluves de nostalgie. Les parents gèrent un garage station-service au Mans. Du plus loin qu’il s’en souvienne, Jean-François Sivadier a créé des pièces pour marionnettes dans sa chambre et fondé un club théâtre à l’école dès l’âge de 10 ans. Premier spectacle : une adaptation de Peau d’âne, assortie d’imitations de Claude François. Cet éclectisme et ce goût pour la variété française seront toujours là, au fil d’un parcours où le théâtre a été comme un ventre maternel qu’il n’a plus jamais quitté. Jouer, mettre en scène, écrire, associer théâtre et musique, tout était là depuis le départ. « Le spectacle, c’était un espace de liberté incroyable, un peu transgressif. Une manière d’être au monde plus intense, plus déraisonnable, plus folle », note-t-il. A partir de là, il a traversé des univers de théâtre très différents, qui semblent s’être agrégés pour former sa propre pelote, dans cette ville du Mans où, dans les années 1980, se côtoient le classicisme du metteur en scène André Cellier (1926-1997), qui dirige le Centre théâtral du Maine, et la radicalité du Théâtre du Radeau, avec l’artiste François Tanguy (1958-2022) à sa tête. Le Mans où, surtout, une météorite du théâtre français commence à débouler : Didier-Georges Gabily (1955-1996). L’auteur et metteur en scène, à la fois star et un peu maudit, est l’un des trois grands dramaturges apparus dans ces années 1980, avec Koltès et Lagarce, mais c’est aussi le moins connu, en raison de sa mort prématurée, à 40 ans. « Sa rencontre a changé ma vie et ma vision du théâtre, assure Jean-François Sivadier. Il avait un rapport au texte, à la langue, à la prise de parole totalement différent de l’approche classique. Quelque chose d’archaïque, de “tripal”, de tribal, d’organique. Un rapport au corps qui faisait qu’on était toujours d’une certaine manière en train de danser. Il nous dirigeait comme des danseurs, lourds, puissants, un peu comme des monstres. Il n’expliquait rien, mais il portait sur nous un regard on ne peut plus amoureux et intense : on commençait un mouvement, et lui le continuait, nous suggérait sa suite, et c’était exactement ce qu’on avait envie de faire sans le savoir. Il mettait les acteurs au centre et les rendait immenses. C’est vraiment ce que j’ai gardé de lui : quelque chose de l’ordre d’un accoucheur des possibles de l’acteur. » « Fête du plateau » Jean-François Sivadier a fait mieux que retenir la leçon. Après la mort de Gabily, en 1996, il aurait pu se contenter d’être l’héritier en chef de cette étoile filante. Mais il avait d’autres désirs. Celui d’un théâtre plus ludique, plus joyeux, plus composite, notamment. « Le rapport au plaisir, il est fondamental pour moi. Brecht explique très bien à quel point le plaisir au théâtre est un outil de travail, qui permet au spectateur de rentrer dans la fable et dans les personnages. Et je me dis toujours qu’il y a peut-être un enfant de 10 ans dans la salle, qui ne va pas forcément comprendre telle pièce de Shakespeare ou d’Ibsen, mais qui, en éprouvant cette fête du plateau, pourra avoir un chemin avec le théâtre. Ce qui fait la principale particularité du jeu dans mes spectacles, c’est que le plaisir et la joie de prendre la parole sont le premier enjeu. » Alors ce grand admirateur d’Antoine Vitez et d’Ariane Mnouchkine a inventé son propre théâtre, un théâtre où les cloisons tombent entre les acteurs et les spectateurs, qui sont convoqués comme des participants actifs à la représentation – sans qu’il s’agisse aucunement de théâtre participatif. « C’est une façon de mettre en scène le public tout en respectant sa place de public, détaille-t-il. De titiller sa capacité, son désir de jouer. Michel Bouquet disait que, au théâtre, on ne va pas assister à une représentation, mais jouer la représentation avec les acteurs. C’est tellement vrai… C’est une façon de dire aux spectateurs qu’on n’est pas là parce qu’on a un produit à leur montrer, mais pour faire une expérience qui ne peut advenir que parce qu’ils nous regardent. Cette idée de faire de la représentation un moment d’expérience, c’est un moteur extraordinaire : il s’agit de montrer les hypothèses que l’on met en jeu, plutôt que de définir une logique du comportement des personnages, et de créer un espace qui n’est qu’un décor, des accessoires qui ne sont qu’accessoires. On fuit alors l’illustration pour mettre en jeu l’énergie que l’on prête aux auteurs, la joie de leur geste originel d’écriture. » Ce postulat mené tambour battant a produit nombre de spectacles réjouissants, qu’il s’agisse de pièces personnelles comme Italienne avec orchestre (1997) ou Sentinelles (2021), ou des mises en scène de grands classiques de Molière, de Shakespeare ou de Brecht. Des spectacles où, toujours, se mêlent le tragique et le comique, qu’il s’agisse d’injecter toute la dimension dérisoire et folle de l’humain dans La Mort de Danton (2005) ou dans Le Roi Lear, ou de gratter l’abyssale noirceur de Feydeau tout en laissant le public plié en deux de rire, dans une Dame de chez Maxim (2009) d’anthologie. Ce mix and match comico-tragique a pu être reproché au metteur en scène, qui l’assume pourtant totalement, de même que le travail sur le clown, qui sous-tend son parcours et celui de ses acteurs, Nicolas Bouchaud en tête. « On ne parle pas là du clown à nez rouge, mais de ce qu’il en est pour un acteur de trouver son clown, précise-t-il. C’est comme un garde-fou : le meilleur moyen d’aller très loin dans la tragédie ou dans une figure d’une extrême violence, c’est d’avoir son clown en tête. D’avoir conscience qu’on pourrait faire la même chose de manière dérisoire, ridicule, grotesque. C’est lié à notre manière de mettre en jeu le rapport au public, aussi : les spectateurs savent très bien que, dans la vie, la comédie et la tragédie sont inextricablement mêlées. Pourquoi voudrait-on qu’au théâtre elles soient séparées ? » Dont acte, avec ces Atrides en folie qu’est Portrait de famille. Jamais on n’avait autant ri devant la tragédie grecque. Et jamais, pourtant, on n’avait aussi bien compris l’enchaînement fatal des violences et des vengeances, en son mélange indissoluble d’intime et de politique. « Les Atrides parlent de toutes les formes de guerre, observe Jean-François Sivadier : entre les hommes et les dieux, entre les peuples, entre parents et enfants, frères et sœurs, hommes et femmes… Il y a en eux un motif universel, qui est celui de la famille comme premier foyer du rapport à l’autre, du traumatisme. Mais, pour autant, on est au théâtre et nulle part ailleurs, donc dans le jeu. Le philosophe Jacques Rancière dit que l’art n’est pas politique quand il essaie de retranscrire les conflits du monde mais, au contraire, quand il s’en écarte : en s’écartant, il leur donne plus de présence. » Le paradoxe est bien le motif central du théâtre de Sivadier, tout autant que de sa personne. « Il y a chez lui une forme d’opacité, confirme son ami Nicolas Bouchaud, qui le connaît depuis plus de trente ans. Il garde une part d’enfance, d’innocence, et je crois que le mystère qui l’entoure sert à cela, à défendre ce noyau de l’enfance. » Fabienne Darge / LE MONDE Légende photo : Jean-François Sivadier, à Paris, le 9 septembre 2024. ADRIENNE SURPRENANT/MYOP POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 17, 2024 10:57 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 14 sept. 2024 Pour L’Avare de Molière mis en scène par Clément Poirée, le public est invité à apporter les vêtements et accessoires qui vont servir aux comédiens. Source de rires, de gags. Mais rien qui puisse empêcher la troupe excellente de servir le chef-d’œuvre. Et rien pour distraire l’interprète du rôle-titre. Il impressionne.
De « A » comme aiguilles ou argile, à « V » comme vaisselle ou veste, en passant par papier, lampe, casserole, drap, on accepte tout à l’entrée du plateau de la salle Jean-Marie-Serreau, au Théâtre de la Tempête. Aussitôt déposées, les pièces sont triées et jetées dans des caisses de carton et d’autres, installées sur les étagères d’armoires ouvertes, métalliques et mobiles. Ces meubles sont tout le décor. Les interprètes, qui nous accueillent en petites tenues blanches, choisissent les vêtements ou étoffes qui pourront habiller leur personnage. Harpagon ne participe pas à cet exercice de déguisement. On l’a vu passer. Il a disparu en coulisses. Tandis que chacun tente de composer son costume, une femme en nuisette, micro à la main, détaille l’arrivée des objets, commente les essayages. Une vraie bonimenteuse, une fausse Madame Loyale. Elle est celle que Molière désigne comme « femme d’intrigue », Frosine. Ici incarnée par l’épatante Anne-Elodie Sorlin, l’une des fondatrices de la compagnie Les Chiens de Navarre. Son énergie chaleureuse illumine ce prologue. Tout démarre. Molière est là, formidable. Voici que se parlent les amoureux, survoltés et contrariés. Une comédie en prose, L’Avare, et qui date de 1669, mais semble, sur bien des points, s’adresser au pur présent de nos sociétés. De l’appel (paradoxal) à la décroissance, à l’incapacité des plus âgés à céder la place aux jeunes, on peut être ici et maintenant. C’est joué juste et vif, sensible. Drôle bien sûr, aussi. Et l’on n’oublie pas de rire dans cette version un peu désordonnée, apparemment, déjantée, mais qui est d’une stricte fidélité à l’écriture de Molière et n’écrase en rien les scènes et les dialogues aussi efficaces qu’irrésistibles. Clément Poirée ne perd jamais le fil de la comédie ; il a réuni de très bons acteurs, jeunes le plus souvent. Ils sont à la fois très à l’aise dans le comique, et très fins dans la sensibilité. Tout le monde est sur le plateau. Comédiens, techniciens-comédiens, tout est dans le partage, l’entente, la fusion. Citons Mathilde Auneveux, Elise, Pauline Bry-Martin ou Sylvain Dufour, maquillage et La Merluche, Pascal Cesari, Cléante, Erwan Creff ou Caroline Aouin, scénographie, Yan Dekel, régie générale et Brindavoine, Stéphanie Gibert assistée de Farid Laroussi, musique, son, Pauline Labib-Lamour, collaboration artistique, Emilie Lechevalier ou Solène Truong, habillage et Dame Claude, Virgil Leclaire, La Flèche, Nelson-Rafaell Madel, Valère, Laurent Ménoret, Maître Jacques, Maître Simon, Marie Razafindrakato, Marie, Hanna Sjödin ou Camille Lamy, pour les costumes, Guillaume Tesson ou Marine David, lumières. La représentation brille de mille et une trouvailles de jeu, de mise en scène, de clins d’œil. La machine est lancée à toute allure : nous avons assisté à la première représentation publique, et l’on ne peut que saluer la virtuosité joyeuse du groupe, son engagement dans la centrifugeuse des cinq actes qui s’apaisent en un dénouement de conte de fées : retrouvailles d’un père, d’un frère, d’une sœur… Le groupe : les comédiens, mais aussi toute la bande des techniciens, maquilleurs, chargés de son, de la musique, des lumières, etc…, et qui vont et viennent ici. Mais avant cela, il aura fallu en passer par la violence d’Harpagon, dévorateur d’enfants, sa maladie d’avaricieux forcené, son aveuglement narcissique qui lui fait désirer la très jeune femme que son fils a élue, sa hargne destructrice, sa solitude amère, sa panique épouvantable si sa chère cassette disparaît. Il aura fallu découvrir Harpagon. Cet Harpagon arraché à l’histoire des interprètes, de Molière lui-même à Michel Bouquet en passant par Charles Dullin. Un très grand Harpagon, impressionnant dans la peur qu’il inspire, comme dans la rage, bouleversant dans la perdition du petit enfant inconsolé, qu’il est aussi. Un être humain. John Arnold est magnifique, qui joue, des années après ses débuts, en face, chez Ariane Mnouchkine, au Théâtre du Soleil, petit jeune homme dans Méphisto, d’après Klaus Mann, en 1979, cette partition dont son maître au Conservatoire et dans la vie, Michel Bouquet, fit une immense création, sous la direction de Pierre Franck. Dans cette production de 1989, John Arnold était Cléante. Le fils maltraité… Courez, courez, courez à la Tempête. Quant aux objets que vous apportez, ils sont tous remis ensuite à l’une des très grandes ressourceries solidaires de Paris, La Petite Rockette. Rien ne se perd ! Théâtre de la Tempête, du mardi au samedi à 20h00, dimanche à 16h00. Durée : 2h30 (compte tenu de l’installation). Jusqu’au 20 octobre. Tél : 01 43 28 36 36. Adresses : La Rocquette Père Lachaise (11ème), La Rocquette Mongallet (12ème) et aussi « La Trockette », café-atelier et restaurant anti-gaspi de quarante couverts. La Cyclette (11ème), atelier vélo participatif et solidaire. La Cadette (12ème), friperie solidaire et atelier de réparation. Armelle Héliot Légende photo : John Arnold en Harpagon -Crédit © Agathe Poupeney

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 16, 2024 6:30 AM
|
Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 14 septembre 2024 Pour la rentrée du Théâtre de l’Aquarium, Jeanne Candel propose à toutes et tous (à partir de 6 ans) de se laisser surprendre par les aventures foutraques de deux astronautes coincés, en apesanteur, dans une navette spatiale. Une ode au théâtre, à la musique, à l’imaginaire : pour rire et rappeler, en cinquante minutes, les dilemmes de la condition humaine. Un piano fait irruption sur le plateau. Cet instrument sur roulettes, en partie désossé, est déplacé avec difficulté par une musicienne (Claudine Simon) qui plaque sur le clavier — quand elle peut, comme elle peut — des accords courant après un extrait de musique orchestrale enregistrée. Fusées vient à peine de débuter et, déjà, une impression de joyeux déséquilibre est là. Une sensation de confusion malicieuse, de savant bricolage. Cette façon faussement naïve de faire du théâtre donne lieu à un spectacle-éclair extrêmement réussi. La nouvelle création de Jeanne Candel ne s’appesantit sur rien. Elle commence par nous raconter succinctement, sans se prendre au sérieux, comment s’organise le système solaire et, au-delà, notre galaxie et l’univers entier, comment l’être humain, cette bête sauvage vaguement civilisée, a toujours rêvé d’explorer le cosmos pour savoir d’où il vient. Puis, elle nous place face à l’errance spatiale de Boris (Vladislav Galard, en alternance avec Marc Plas) et Kyril (Jan Peters), deux astronautes loufoques qui apprennent devant nous, une nuit de Saint-Sylvestre, que leur retour sur Terre n’est plus possible. Un art du déséquilibre et du retournement Livrés à leur impuissance et leur maladresse, ne pouvant plus dialoguer qu’avec l’intelligence artificielle qui les accompagne dans leur mission (Sarah Le Picard, en alternance avec Margot Alexandre), Boris et Kyril tentent de réinventer leur vie loin de chez eux. La représentation imaginée par Jeanne Candel et ses talentueux interprètes, elle aussi, se réinvente sans cesse. Elle use de différents types d’adresse, fait s’élever la belle mélancolie du cinquième concerto pour clavier de Bach ou la pureté d’un chant sacré de Schütz, s’appuie sur les facéties burlesques de scènes nourries de mime, crée d’ingénieux contrastes, à la limite de l’absurde. Les tableaux s’enchaînent dans un à-peu-près volontaire. Ici, rien n’est caché. Tout se déploie à vue. Cet enchaînement de dérapages contrôlés ne se contente pas de divertir. Il engendre de la profondeur. Jamais démonstratifs, des éclats de tendresse se nichent dans les interstices du rire. Ils éclairent la beauté singulière d’êtres humains qui confrontent leur petitesse à l’appel de l’immensité. Manuel Piolat Soleymat / La Terrasse Fusées
du vendredi 13 septembre 2024 au dimanche 15 septembre 2024
Théâtre de l’Aquarium
2 route du champ de manœuvre, 75012 Paris
Également du 24 au 28 septembre 2024 au TJP - CDN de Strasbourg – Grand Est (Festival Musica), du 6 au 9 novembre au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, du 18 au 21 décembre au Théâtre Garonne à Toulouse, les 9 et 10 janvier 2025 au Malraux - Scène nationale Chambéry – Savoie, les 30 et 31 janvier au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence, du 5 au 7 février à Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, du 12 au 15 février au T2G à Gennevilliers.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 15, 2024 4:25 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 14 septembre 2024 Dans « Fusées », un spectacle pour tous, des primo chiards aux hyper retraités, Jeanne Candel et sa bande de La vie brève au Théâtre de l’Aquarium s’aventurent dans l’infiniment grand (l’espace) avec les moyens de infiniment petit (un castelet). Le théâtre et la musique comptent les rires, ça fuse.
Soit un castelet d’un mètre sur un mètre soixante, planté à la va comme je te pousse au milieu d’une scène et qui n’en finit pas de s’édifier en se désarticulant. C’est là une commande faite par Jeanne Candel à l’ingénieuse Sarah Jacqemot-Fiumani, pour ce spectacle pour tous, de la post maternelle à l’ après retraite, au titre cosmique : Fusées. C‘est un castelet plus facilement démontable que montable comme le prouvent les deux acteurs et les deux actrices (dont une pianiste) qui mettent à profit le comique de répétition en tentant de monter le dit castelet. La chose ayant été accomplie, non sans mal et autant de gags, la bande des quatre passe à une leçon de choses déglinguée, sorte de version zozo de « L’espace pour les nuls ». Après quoi il sera temps de partir pour la voie lactée à demi écrémée -à deux pas de là, en fond de scène et à quatre pattes - pour suivre la ballade et la balade des deux cosmonautes Boris et Kyril (qui vont par deux comme Laurel et Hardy) dans leur navette spatiale (une sorte de table renversée) en mimant l’apesanteur (bras et jambes en l’air). Avant cela, Jeanne Candel et sa bande évoquent, en lui rendant hommage, le premier animal à être allé dans l’espace bien avant les humains : la chienne Laïka et son retour tragique (brûlée vive) à bord de Spoutnik 2 en 1967. Nous sommes tous les chiots de mère Laïka semblent dire les deux cosmonautes et leurs acolytes. Soit : Vladislav Galard (en alternance avec Marc Plas) et Jan Peters, leur assistante communiquant avec la terre (Sarah le Picard en alternance avec Margot Alexandre) et la pianiste à tout faire même des accords cosmiques (Claudine Simon). Il y a une douzaine d’années, dans un spectacle de la Vie brève (tous sont des créations maison où la part du travail créatif de chaque interprète, comédien.ne et.ou musicien.ne, est décisif) figurait une scène avec deux cosmonautes se souvient l‘acteur violoncelliste et occasionnel mémorialiste Vladislav Galard entre deux spectacles de Creuzevault. La scène était drôle et même drôlement belle mais brève. Les deux cosmonautes attendaient plus. Plus patients que les étoiles qui n’en finissent pas de s’éteindre, ils ont allumé la bougie de la mémoire et attendu qu’on lui souffle dessus. L’attente valait la chandelle. C’est un couple d’acteurs et un duo comme on les aime : aussi plausible qu’invraisemblable. Et entouré en sus par deux fées du logis dont l’une loge dans un satellite (une table de camping) et est une fan de Heinrich Schütz et l'autre joue du piano comme en apesanteur. Jeanne Candel dit vouloir depuis toujours « expérimenter des processus de recherche très variés, des formes libérées de tout dogme car ancrées dans l’empirisme du plateau et son bricolage ». Bingo, on y est, en plein. Ça gargouille, ça roucoule, ça facéties, et youp. Ça vole haut sans oublier le bas. C’est bath comme disait Laïka en 1957. C’est ouf comme disaient des spectateurs en sortant de Fusées. Jean-Pierre Thibaudat Au Théâtre de l’Aquarium, aujourd’hui sam à 18h, demain dim à 17h. Puis tournée : du 24 au 28 sept au TJP de Strasbourg / Festival Musica ; du 6 au 9 nov au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers : du 18 au 21 déc au Théâtre Garonne à Toulouse ; les 9 et 10 janv au théâtre Malraux de Chambéry; les 30 et 31 janv au Théâtre du Bois de l'Aune d’ Aix-en-Provence ; du 5 au 7 fév à Bonlieu, Annecy ; du 12 au 15 fév au T2G, Gennevilliers Légende photo : ©Vladislav Galard et Jan Peters dans Fusées, mis en scène par Jeanne Candel. Crédit : Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 13, 2024 11:08 AM
|
Par Fabienne Pascaud, Emmanuelle Bouchez, Kilian Orain “Illusions perdues”, “Les gros patinent bien”, “La Joie”... Découvrez les meilleures pièces qui jouent ce mois-ci à Paris, et ce que “Télérama” en a pensé. 4211 km Quatre mille deux cent onze kilomètres, soit la distance entre Paris et Téhéran, c’est la longueur du chemin que Mina et Fereydoun ont parcouru au début des années 80 pour échapper à la République islamique, qui, après la monarchie du shah, mettait leur existence en danger. Arrivés en France, ils tentent de se reconstruire, sous le regard de leur fille, Yalda, qui aujourd’hui les raconte, et se raconte, pour décrire ce lien indéfectible qui unit les exilés à leur pays d’origine et révéler sa transmission de génération en génération. À partir de son histoire familiale, Aïla Navidi tisse un grand récit qui bouleverse, grâce à sa fluidité remarquable et à l’engagement des acteurs. Jusque dans les effets de mise en scène, tout est juste, savamment dosé et mû par une émotion retenue. De cette pudeur émanent la beauté mais aussi la force d’un combat pour la liberté, plus essentiel et d’actualité que jamais. — V.B. TTT De et par Aïla Navidi. Durée : 1h30. À partir du 12 sept., 21h (du jeu. au sam.), 15h (dim.), Théâtre Marigny, Carré Marigny, 8e, 01 86 47 72 77. (25-57 €). Chers Parents Deux frères et leur sœur traversent la France pied au plancher pour rejoindre leurs parents, qui les ont sommés de venir les voir sur-le-champ. La progéniture, inquiète, se prépare au pire. Et tombe à la renverse lorsqu’elle comprend ce qui se passe : les parents, à la retraite, partent ouvrir un orphelinat au Vietnam. Pourquoi ? Comment ? N’allons pas plus loin dans les détails de cette farce jubilatoire qui démantèle le lien familial sans s’encombrer d’inutiles tabous. D’une manière ou d’une autre, chaque spectateur se reconnaîtra dans les coups de griffe que s’échangent les personnages. Ce spectacle, malin, fin et vif, écrit à deux mains par Armelle et Emmanuel Patron (ils sont frère et sœur), convoque sur scène cinq comédiens dont le plaisir est communicatif. Aucun dialogue ne sonne faux. Aucun cliché qui ne vole en éclats. La dernière scène est savoureuse. Un régal. — J.G. TTT D’Emmanuel et Armelle Patron, mise en scène d’A. Patron et Anne Dupagne. Durée : 1h30. À partir du 12 sept., 20h30 (du jeu. au sam.), 17h (sam.), 15h30 (dim.), Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, 9e, 01 86 47 72 49. (33-48 €). Les gros patinent bien Un personnage barbu, rondouillard et en costard-cravate, qui ne bouge jamais. Son très agité et maigrissime compère, lui, est juste revêtu d’un slip de bain. Ces deux-là réarchitecturent notre imaginaire avec une folie burlesque. Il faut voir le premier raconter leurs épiques aventures dans un anglais shakespearien totalement réinventé ; et le second faire vivre l’action en se démultipliant avec ses bouts de carton où sont inscrits noms de lieux, objets, animaux et personnes. Exercice d’une démoniaque virtuosité, où les deux larrons nous baladent du Grand Nord à l’Espagne, quêtant le grand amour ou autre dépassement héroïque de soi. Le rire surgit du décalage entre la passivité apparente du gros et l’énergie désespérée du maigre, préposé aux décors de cette donquichottesque épopée. De leurs disputes aussi, de ces délirants moments où ils sortent de leurs rôles pour avouer qu’ils sont crevés. Pourtant, avec leur théâtre pauvre, ils ont créé un monde ; et retrouvé le nôtre, avec ses inégalités, ses aveuglements. Nier la réalité permet au théâtre de mieux la voir. — F.P. TTT De et par Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan. Durée : 1h20. Jusqu’au 31 déc., 20h (mer., ven., sam., mar.), Théâtre Saint-Georges, 51, rue Saint-Georges, 9e, 01 48 78 63 47, theatre-saint-georges.com. (12-44,50 €). Illusions perdues Pauline Bayle reprend Illusions perdues, spectacle créé en 2020. Adaptée du roman-fleuve publié par Balzac à partir de 1837, sa mise en scène est un ring théâtral où la verve piquante de l’auteur résonne. Cette génération d’interprètes trentenaires en costumes d’aujourd’hui, qui ont quitté leur province, comme le jeune Lucien de Rubempré, pour partir à l’assaut des scènes parisiennes sur fond de concurrence cruelle, se retrouve-t-elle à ce point dans le miroir tendu par l’écrivain romantique ? Pauline Bayle insiste sur la violence de la capitale, où des êtres s’assemblent par communautés d’intérêt quand d’autres sont renvoyés à leur solitude. Comme dans les collectifs les mieux soudés, les comédiens (doués) ne quittent pas la scène et se métamorphosent à vue. Une réussite. — E.B. TTT D’après H. de Balzac, adaptation et mise en scène de Pauline Bayle. Durée : 2h30. Jusqu’au 6 oct., 20h (du mar. au ven.), 18h (sam.), 16h (dim.), Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, 18e, 01 46 06 49 24. (10-38 €). La Joie Encadré, protégé par un angle de murs blancs qui ouvrent pourtant l’imaginaire à tous les horizons, Solaro, seul en scène, nous raconte sa vie. Et comment, de tout, même du pire, il parvient à faire joie. Jusqu’à ce qu’on le prenne pour fou… Admirablement interprété par Olivier Ruidavet, qui joue son personnage avec une simplicité radieuse et nous dit à merveille le texte lumineux de Charles Pépin, ce spectacle nous fait pénétrer dans un drôle d’univers. Trop solaire pour être vrai. Et pourtant… Ne serait-il pas facile, encore, de s’émerveiller de la beauté du monde, malgré toutes ses tragédies ? De cette heure joliment mise en scène par Tristan Robin, on sort le cœur ouvert à tous les possibles, les lumières et les sons. Étrange et belle expérience. — F.P. TTT De Charles Pépin, mise en scène de Tristan Robin. Durée : 1h10. Jusqu’au 12 oct., 20h (sam., mar.), Théâtre de la Reine-Blanche, 2 bis, passage Ruelle, 18e, 01 40 05 06 96. (10-20 €). Oublie-moi Dans son décor en camaïeu de roses, Oublie-moi ressemble d’abord à une histoire d’amour idéale. Dragueur et blagueur un peu lourd mais touchant, Arthur a su conquérir Jeanne, qui, en retour, lui oppose une résistance complice. Ces deux-là forment un tandem complémentaire, telles les deux parties d’un même symbole. Puis d’infimes dérèglements s’invitent dans leur quotidien : Arthur se focalise sur des détails, oublie la liste des courses… À bas bruit, Alzheimer progresse en lui, et met le couple à l’épreuve. Inspirée d’In Other Words, de Matthew Seager, la pièce se transforme alors en marée montante ; tandis que la maladie submerge les personnages, l’émotion fait chavirer les spectateurs, jusqu’à les toucher au cœur. Jamais mièvre, toujours juste, ce pas de deux est porté avec finesse par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. À chaque instant, le duo tient intensément la barre, celle d’un amour qui survit, envers et contre tout. — V.B. TTT De Matthew Seager, mise en scène de Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. Durée : 1h15. Jusqu’au 31 déc., 19h (du mar. au ven.), 18h30 (sam.), Théâtre actuel La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 9e, 01 48 74 76 99. (24-49 €). Le Tour du théâtre en 80 minutes Le monde du théâtre ne s’est pas fait en un jour. Christophe Barbier, journaliste et passionné d’un art vieux de deux mille cinq cents ans, nous le démontre avec passion. Il égraine avec humour et engagement une myriade d’anecdotes à partir de son Dictionnaire amoureux du théâtre, publié en 2015. De Molière aux stars du boulevard, des amphithéâtres romains aux théâtres parisiens, du politique au divertissement, ce Tour du théâtre embrasse large. Et apporte son lot de réponses à des questions aussi terre à terre que passionnantes : pourquoi dit-on « merde » aux comédiens avant qu’ils entrent en scène ? Qu’est-ce qui caractérise les grands auteurs ? Une exploration aussi instructive que captivante ! TTT De et par C. Barbier. Durée : 1h20. Jusqu’au 4 nov., 21h (lun.), Théâtre de Poche-Montparnasse, 75, bd du Montparnasse, 6e, 01 45 44 50 21. (10-28 €). La vie est une fête Un débat hystérique à l’Assemblée nationale. Au milieu des spectateurs, les acteurs-députés invectivent les ministres et parlementaires qui tentent vainement de s’exprimer sur le plateau. Dans le théâtre devenu forum politique, nos représentants sont au bord de la crise de nerfs. Et c’est justement aux urgences psychiatriques que se poursuit l’irrésistible dernière création des barbares Chiens de Navarre. Partir de la dinguerie du pouvoir incarné par un parlement survolté pour aboutir à la déliquescence d’un hôpital, raconter combien nos maux privés sont liés à nos folies publiques, tel est le canevas ordinaire de cette troupe essentielle. Ses excès mêmes, entre farce potache et cinéma gore, appartiennent à la joyeuse tradition du spectacle bordélique et se concentrent en une seule question : dans quelle démocratie vivons-nous donc ? — F.P. TTT Mise en scène de J.-C. Meurisse. Durée : 1h40. À partir du 12 sept., 20h (du jeu. au sam., mar.), Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Chapelle, 10e, 01 46 07 34 50. (12-38 €). Légende photo : Dans « Les gros patinent bien », les deux interprètes reconstruisent notre imaginaire avec une folie burlesque. À voir au Théâtre Saint-Georges. Photo Fabienne Rappeneau.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 11, 2024 7:23 PM
|
Propos recueillis par Louise Chevillard dans La Terrasse - 23 août 2024 Avec cette création, Anne Courel met en jeu la joie, une émotion organique, théâtrale, à la fois éphémère et résistante. Pourquoi avoir mis en scène ce texte ? Anne Courel : Ce texte de Mariette Navarro, issu de dialogues avec de nombreux enfants, adolescents et adultes, est né en proximité avec un projet que j’ai mené au Théâtre de Saint-Priest de 2010 à 2014. C’est un texte profondément intergénérationnel, né d’un partage unissant des gens qui vivent avec ce qu’ils ont, à savoir un cœur et des relations, et parfois des difficultés à se sentir vivant. La trame narrative déploie six fêtes, la dernière arrivant après une mystérieuse nouvelle qui permet à tous de se rassembler, soulagés et apaisés. Le sentiment de joie que nous célébrons dans ce spectacle est très proche de ce que j’appelle mon cœur de métier. « CETTE FABRICATION COLLECTIVE DONNE À LA PIÈCE LA COULEUR D’UNE COMPLICITÉ PARTAGÉE. » De quelle manière mobilisez-vous votre public ? A.C. : J’ai eu envie de travailler en dehors du plateau, de m’éloigner du texte, en allant vers autre chose qu’un récit. D’un point de vue personnel, lorsque je suis mal à l’aise quelque part, je me mets à rendre service, c’est de là qu’est partie cette idée de faire essuyer des verres au public, pour l’aider à ce qu’il trouve sa place. À l’issue de rencontres que l’on a faites en amont, nous faisons intervenir le public au micro. Là aussi c’est périlleux, car c’est un exercice libre pour eux. Ils s’impliquent en tant que personne, dans l’idée qu’on ne peut pas faire de fête sans aller vers l’autre. Ils se laissent porter par les situations et interviennent de manière singulière. Après une représentation à Marseille, j’ai noté des idées que j’ai trouvé très stimulantes. Cette fabrication collective donne à la pièce la couleur d’une complicité partagée. Vos comédiens sont mobilisés sur tous les fronts ! A.C. : Je pars de plusieurs situations de vie très différentes. Pour les comédiens, c’est un travail difficile. Cela implique de jouer quelque chose d’intime tout en se rendant totalement disponible pour le public, qu’il s’agit de mobiliser. C’est un sacré exercice qui ouvre sur ce qu’on ne peut pas maitriser. La pièce convoque également le maniement des objets, la musique, le mouvement… Le spectacle a demandé à tous beaucoup de pas de côté. L’écriture de Mariette Navarro est très littéraire, nous l’avons adaptée à la scène en créant un spectacle participatif, accessible à des enfants dès 9 ans – et cela fonctionne ! Propos recueillis par Louise Chevillard / La Terrasse Six fêtes pour rester vivantdu mercredi 16 octobre 2024 au vendredi 18 octobre 2024Château Rouge1 route de Bonneville, 74112 Annemasse le 16 octobre 2024 à 19h30, le 17 à 14h30 (scolaire) et à 19h30, le 18 à 9h30 et 14h30 (scolaires). Tel : 04 50 43 24 24. Le Grand Angle, 6, rue du Moulinet, 38500 Voiron, le vendredi 22 novembre 2024 à 14h30 (scolaire) et 20h. Tel : 04 76 65 64 64. En tournée en 2025/2026. Légende photo : Anne Courel ©Crédit : DR
:

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 11, 2024 11:03 AM
|
Publié dans Sceneweb le 21 juillet 2024 Deux hommes, Kyril et Boris, sont perdus dans le cosmos. L’un sombre dans sa mélancolie, l’autre jouit de sa puissance. Une femme, restée sur terre, communique avec eux en vidéo-conférence. Cette passeuse se fait tour à tour la voix des scientifiques, d’adolescents passionnés de la vie dans l’espace, de l’enfant de Boris et raconte le monde qui s’émiette. Boris en pleure quand Kyril s’en moque. Plus l’un est fort, plus l’autre est faible et plus on rit !
Ces aventures galactiques, inspirées du film d’Andrej Ujica (1995), Out of the Present, se déploient autour du duo comique aux gestes héroïques ou amoindris diamétralement opposés. Les mélodies de Schütz, Bach, Tom Waits ou Schumann gravitent sur les notes d’un piano retourné ou d’une cithare bricolée.
La metteuse en scène Jeanne Candel et l’équipage de Fusées opèrent un jeu malicieux avec notre imagination : mimer les technologies de pointe, rejouer la conquête de l’espace avec les outils artisanaux du théâtre et de la musique. La scène devient alors le parfait espace pour faire advenir des éclats d’humanité et de beauté avec les moyens du bord. Un poème concret et jubilatoire pour conjurer les ténèbres. Fusées
Une création tout public à partir de 6 ans de Jeanne Candel, Vladislav Galard, Sarah Le Picard, Jan Peters et Claudine Simon Mise en scène : Jeanne Candel
Avec (au Théâtre de l’Aquarium) : Vladislav Galard, Sarah Le Picard, Jan Peters et Claudine Simon
Avec (en tournée) : Margot Alexandre, Jan Peters, Marc Plas et Claudine Simon (en cours) Scénographie : Jeanne Candel
Régie générale et construction du décor : Sarah Jacquemot-Fiumani
Toile peinte : Marine Dillard
Lumières et régie générale : Vincent Perhirin
Costumes : Constant Chiassai-Polin
Regard extérieur en tournée : Juliette Navis Production : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium Coproduction : TJP, CDN de Strasbourg – Grand Est ; Bonlieu, Scène nationale d’Annecy ; Malraux, Scène nationale Chambéry – Savoie ; Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
Avec le soutien du Centre National de la Musique et de la SPEDIDAM Durée : 50 minutes environ Création au Théâtre de l’Aquarium à Paris
Vendredi 13 septembre à 19h30
Samedi 14 septembre à 18h
Dimanche 15 septembre à 17h du 24 au 28 septembre 2024
TJP, CDN de Strasbourg – Grand Est / Festival Musica ≈ du 6 au 9 novembre 2024
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers du 18 au 21 décembre 2024
Théâtre Garonne à Toulouse les 9 et 10 janvier 2025
Malraux, Scène nationale Chambéry – Savoie les 30 et 31 janvier 2025
Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence du 5 au 7 février 2025
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy Du 12 au 15 février 2025
T2G, Gennevilliers Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 10, 2024 5:27 AM
|
par Copélia Mainardi pour Libération - 9 septembre 2024 Le Moulin de l’Hydre, ancienne filature normande reconvertie en lieu de résidence théâtrale, accueillait ce week-end son festival annuel. Le metteur en scène y a présenté sa dernière création, un détour prometteur par la comédie. Il est des lieux qui façonnent le destin d’une troupe, où s’ancrent les aventures passées et à venir, où se fondent les contours des âmes qui les font grandir. L’auteur et metteur en scène Simon Falguières a projeté dans le Moulin de l’hydre des rêves aussi larges que les épais murs de pierre qui le soutiennent. Cette ancienne filature de coton à la frontière de l’Orne et du Calvados est son île d’utopie : une «fabrique théâtrale», inaugurée en mai après deux ans et demi de chantier participatif colossal. Espace de création, de stockage, de construction, d’hébergement, le Moulin est le fruit d’un rigoureux travail de bâtisseurs, habitués des aventures collectives et des projets déraisonnables. Les fenêtres de la grande salle de répétition offrent une vue imprenable sur le bien nommé mont de Cerisy-Belle-Etoile, contre les flancs duquel semblent appuyés les gradins de la scène extérieure. Au fond du jardin serpente le Noireau, dont le glou-glou a des airs de seconde bénédiction. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Il faut pour s’y rendre sillonner les routes sinueuses de cette Suisse normande vallonnée et surtout ne pas craindre la pluie – aujourd’hui torrentielle, de l’aveu de locaux qui n’en sont pourtant pas à leur première averse. Concert écourté, spectacle mis sur pause, public massé sous des barnums et autour de braseros, taux d’humidité record : les conditions un peu âpres font partie de l’expérience. Ni lumière ni décor Les gradins sont pourtant pleins à craquer quand débute Molière et ses masques, la nouvelle création de Simon Falguières, auteur et metteur en scène de 36 ans révélé par son Nid de cendres, une épopée théâtrale de treize heures écrite par ses soins qui avait conquis le public avignonnais il y a deux ans. Ni lumière ni décor cette fois, seulement du jeu, des costumes, et basta : du pur théâtre de tréteaux, démontable en un rien de temps et exportable un peu partout. Molière, le «plus connu des chefs de troupe français», a passé la moitié de sa carrière sur les routes et c’est donc en itinérance que son histoire se racontera. La petite troupe se produira dans les villages du coin en septembre avant de partir dans la Meuse et, au printemps, de gagner Caen à pied, cheminant le long de l’Orne aux côtés de qui voudra. Si ces formes nomades sont généralement économes en moyens humains, ce n’est pas le cas ici : il fallait à Falguières un minimum de six acteurs, des fidèles de la première heure, aussi enthousiastes à raconter l’histoire d’une troupe qu’ils l’ont été à construire la leur, désormais constituée en compagnie, Le K. Maîtrise d’équilibriste Le choix, forcément, interroge : pourquoi Molière, figure tutélaire d’un théâtre classique vu et archi-revu ? «C’est un passe-droit, reconnaît-il. Pour la vie de Molière jouée sur la place du village, les gens se déplacent. Peu de noms font le même effet.» Pragmatisme mis de côté, l’auteur reconnaît s’être pris aux jeux des parallèles entre cette époque et la nôtre, et avoir trouvé dans le XVIIe siècle, «période de changements climatiques, de résurgences obscurantistes et d’instabilité politique», une puissante matière théâtrale qui puise aux sources de l’épopée, du tragique, mais surtout de la comédie. «De nature optimiste», selon ses dires, mais jusqu’ici plutôt adepte des formes graves, Falguières a voulu se frotter à ce genre et ses contradictions, en livrant une farce sur celui qui les abhorrait autant qu’il y excellait. La comédie requiert une maîtrise d’équilibriste, mais cette proposition resserrée et efficace, tenue de bout en bout et en parfaite adéquation avec ce qu’elle prétend être, a vite balayé nos réserves. Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse : seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Avec son Molière (Anne Duverneuil dans le rôle-titre), Simon Falguières affirme son goût pour un «théâtre populaire» – expression galvaudée, mais qui recouvre une réalité avec laquelle il entend renouer sans polémiquer – et s’enracine un peu plus dans ce bocage normand qui l’a vu grandir. En parallèle de son travail d’écriture et de mise en scène, il mène de lourdes démarches administratives pour subventionner les prochains travaux du Moulin, qui n’en est qu’à ses débuts : la suite prévoit la création d’un théâtre intérieur, qui gardera les murs de pierre, les grandes fenêtres (rendues occultables)… Et tentera une ouverture sur la forêt, dans l’esprit du Théâtre du Peuple de Bussang. «Nous ne sommes pas Molière, mais notre art est le même», nous met-on en garde dans le prologue. Nous voici avertis : un chef de troupe peut en cacher un autre. Molière et ses masques, mise en scène Simon Falguières. Avec Antonin Chalon, Louis de Villers, Anne Duverneuil, Charly Fournier, Victoire Goupil, Manon Rey. En itinérance autour du Moulin les 13-14 septembre, avec Transversales Scène conventionnée de Verdun la semaine du 23 septembre, et avec la Comédie de Caen sur la saison 2024-25. Légende photo : Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse. (Xavier Tesson)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 9, 2024 6:16 AM
|
Les cérémonies orchestrées par le metteur en scène ont célébré les corps – des sportifs, des interprètes et aussi celui, collectif, du public.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/09/paris-2024-le-spectaculaire-marathon-creatif-de-thomas-jolly_6308386_3246.html
En dramaturge subtil, Thomas Jolly, 42 ans, aura su écrire les temps des quatre cérémonies de ces Jeux olympiques (JO) et paralympiques comme autant de chapitres d’un récit dont il a été l’auteur principal. La beauté de Paris, la célébration d’une France qui n’est pas une mais multiple, l’utopie fédératrice des Jeux, l’inclusion des personnes en situation de handicap… Tout en basculant de la Seine à la place de la Concorde pour boucler la boucle au Stade de France (Seine-Saint-Denis), la trame imaginée par le metteur en scène a associé de plus en plus étroitement le sport, la musique et la danse. Au bout du bout, c’est vers une célébration du corps qu’auront tendu les étapes de ce marathon créatif. Corps des sportifs, corps des interprètes en scène et, enfin, corps collectif du public, qui, après avoir écouté Aya Nakamura et Céline Dion, lors de la cérémonie d’ouverture des JO le 26 juillet, puis chanté en chœur de grands tubes iconiques français, s’est dressé pour danser, bras levés, la nuit du 8 septembre, au Stade de France à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Le producteur Romain Pissenem s’inquiétait de la possibilité de « rendre le spectacle immersif » même pour ceux qui sont « perchés en haut des gradins ». Cette préoccupation fut une obsession identique chez Thomas Jolly. Sauf qu’en ce qui concerne ce dernier, le désir de toucher chaque personne assise dans la salle déborde le lieu géographique de la représentation pour gagner celles et ceux qui n’en franchissent pas les portes. S’il faut toucher les présents, il faut surtout convaincre les absents de venir. Ce que Romain Pissenem appelle « spectacle immersif », le metteur en scène le nomme, pour sa part, « théâtre populaire ». Intellect et l’émotionnel Depuis qu’il met en scène, Thomas Jolly cherche à rallier le plus grand nombre de spectateurs. Et y parvient. La jeunesse, au premier chef, qui plébiscite des spectacles que ne renieraient d’ailleurs pas des chanteurs rock rompus aux concerts live. Fumigènes, jets de laser, lumières qui sculptent l’espace, bandes-son musicales et comédiens qui se jettent dans la bataille des mots et des actions sans jamais s’économiser. Qu’il propose un marathon shakespearien d’une durée de dix-huit heures (Henri VI) ou qu’il revisite l’opéra rock Starmania, en convoquant, entre autres effets pyrotechniques, l’hologramme de France Gall, l’artiste provoque l’intellect et l’émotionnel. Les larmes, les rires, l’effroi, l’émerveillement, il n’y a pas de sentiments devant lesquels il recule. Et pas de défis, aussi démesurément olympiques soient-ils, qui ne l’effraient. Le défi a brillamment été relevé. Vidéo : les grands moments de la cérémonie d'ouverture des JO (4 mn30) Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympique Paris 2024, au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 8 septembre 2024. MATHIAS BENGUIGUI POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 8, 2024 4:26 AM
|
Par Hélène Kuttner dans Artistik Rezo - 7 septembre 2024 Le metteur en scène Roland Auzet donne à voir, dans une libre adaptation théâtrale, le roman magistral de Giuliano da Empoli, succès mondial qui fut couronné du grand prix du Roman de l’Académie française. Une plongée dans les eaux glacées du pouvoir russe en compagnie d’un spin Doctor qui raconte la fin d’Eltsine, le passage du totalitarisme au capitalisme sauvage jusqu’à l’avènement d’un nouveau Tsar, Vladimir Poutine. Incarnée par de brillants comédiens, la pièce de deux heures prend place dans une scénographie qui multiplie les écrans et les micros de manière quasi oppressive.
Maitre du temps La Russie fascine autant qu’elle effraie. L’écrivain italien Giuliano da Empoli en a démonté brillamment les mécanismes politiques, la terrible machinerie d’oppression populaire, à travers une fresque éblouissante qui se déploie sur plusieurs décades, des années 1990, celles de la libéralisation des moeurs et du pouvoir, jusqu’à la reprise en main autoritaire de l’ex-fonctionnaire du KGB, devenu Président de toutes les Russies, Poutine. Ce que détaille avec un génie historique et une gourmandise pleine d’un humour très noir l’auteur, ce sont les intrigues, les manoeuvres des personnages qui ont oeuvré à l’édification d’un Tsar moderne, avec la propagande télévisuelle, les réseaux sociaux, les cadeaux de cour aux flatteurs. Un personnage énigmatique, Vadim Baranov, autrefois metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité, devient progressivement l’éminence grise de Poutine, surnommé le Tsar. Ce personnage fictif est très inspiré de Vladislav Sourkov, amateur de rap, artiste et homme d’affaires, qui fut l’homme de l’ombre de Poutine. Comment des poètes deviennent de véritables loups féroces ? Comment des machines, des écrans manipulés, des ambitions démesurées, qui n’ont d’égal que le mépris cynique vis à vis des masses populaires, parviennent à édifier des gouvernants tout puissants qui menacent violemment notre monde ? Une mise en scène cinglante et crue Dans une scénographie constituée de miroirs et d’écrans, des lumières éclatantes nous aveuglent, tandis que des les panneaux lumineux s’affichent en rouge et en noir. Le sol est noir de jais, les canapés modernes d’un blanc cru : des studios de télévision, des appartements à la froideur clinique font surgir une faune de personnages grouillant dans les sphères du pouvoir et des médias. Il y a là Baranov, qu’incarne avec fureur le grand comédien Philippe Girard, que vient interviewer un journaliste français, Pierre Barthélémy, joué par Stanislas Roquette. Ksénia, la femme de Baranov, une vestale russe qui le met systématiquement en joue, manie l’agressivité comme un couteau suisse. Irene Ranson Terestchenko, excellente pianiste, campe la jeune femme, tandis qu’Hervé Pierre incarne le rond et sympathique Boris Berezovsky qui perdra la vie par trop de candeur. Claire Sermonne, qui joue et chante merveilleusement en russe et en français, et Andranic Manet, physique terrifiant de magnétisme, qui incarne à la perfection le jeune Poutine, complètent avec Anouchka Robert, la blonde Anja, et Jean Alibert, Prigogine, ces personnages hors normes. Catch verbal Du naufrage du Koursk, le sous-marin nucléaire qui explosa mystérieusement dans la Mer de Barents, en laissant sans vie 118 membres de l’équipage en août 2000, à la terrible guerre de Tchétchénie, pour arriver aujourd’hui à l’invasion de l’Ukraine, qui se trouvait en germe dans le livre avec l’invasion de la Crimée, les événements traumatiques agissent comme des claques violentes, en réponse à une paranoïa permanente qui fait voir au Tsar des ennemis partout. Les comédiens virtuoses prennent en charge ces histoires, dans des discours parfois débordants de mots qu’ils s’échangent comme des combats de catch, laissant parfois le spectateur exsangue. Il se trouve que le son, la musique, les projecteurs qui multiplient effets de lumières stroboscopiques et vidéos d’archives, viennent amplifier l’outrance des discours et la violence des ruptures scéniques. Malgré tout, l’effervescence des effets spéciaux et la lourdeur du texte, le spectateur aguerri et curieux trouvera dans ce spectacle de quoi nourrir ses interrogations sur la longévité du totalitarisme russe, et sur la spécificité des pouvoirs totalitaires dont nulle démocratie n’est à l’abri. Il pourra savourer l’incroyable paradoxe entre l’appétence russe à la soumission à un tyran, et une sophistication éminente de la pensée qui tend à nier l’individu. Face à un Occident en perte de repères, la Russie reste nostalgique d’Ivan le Terrible. C’est un combat sans limites. Hélène Kuttner / Artistik Rezo Auteur : Giuliano da Empoli Metteur en scène : Roland Auzet Distribution : Hervé Pierre, Karina Beuthe Orr, Philippe Girard, Andranic Manet, Stanislas Roquette, Claire Sermonne, Irène Ranson Terestchenko Du 04 Sep 2024 Au 03 Nov 2024 Réservations par téléphone :
+33 (0)1 40 03 44 30

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 6, 2024 11:27 AM
|
Par Samuel Douhaire dans Télérama - 30 août 2024 L’actrice fait le récit du tournage du film “Romance” et révèle le viol subi lors d’une scène du film. Un nouveau témoignage saisissant sur l’emprise exercée, cette fois de la part d’une cinéaste, sur une jeune comédienne. Après Judith Godrèche, Isild Le Besco ou encore Sarah Grappin (liste, hélas, non exhaustive), une autre actrice ayant percé à l’écran dans les années 1990 révèle l’emprise dont elle a été victime à ses débuts. Avec une différence de taille : le grand nom du cinéma d’auteur français que met en cause Caroline Ducey est une femme. Dans La Prédation (nom féminin), la comédienne raconte comment Catherine Breillat l’a « détruite » pendant le tournage, puis lors de la sortie en salles, de Romance (1999). À travers cette chronique d’une jeune femme en quête radicale du plaisir sexuel, la réalisatrice de Parfait Amour ambitionnait de « montrer qu’il existe un au-delà de la représentation du sexe, que l’on ne voit jamais dans les films pornographiques et où se tiendrait la beauté ». Avec un joli sens de la provocation, elle avait confié un petit rôle à un certain Rocco Siffredi, la superstar du cinéma X… Caroline Ducey, alors âgée de 21 ans, était fière d’être au centre d’une œuvre qui, elle en était persuadée, « devait promouvoir la liberté des femmes à disposer de leur corps, sans soumission ». Or, le tournage « a été en totale contradiction avec les prétendus enjeux féministes » du film. Pendant la préparation puis lors des premiers jours sur le plateau, la réalisatrice va entretenir le flou sur les nombreuses scènes de sexe prévues dans le scénario, malgré les demandes d’explication répétées de sa jeune comédienne. Pour Caroline Ducey, il n’a jamais été question que ces séquences soient non simulées. Arrive le jour du tournage de « l’inconnu dans l’escalier », une scène très forte où son personnage couche avec un homme qui doit la brutaliser. Une heure avant la prise de vues, l’actrice entend que la scène est désormais désignée comme celle « du viol »… qui ne sera pas du cinéma : Caroline Ducey affirme avoir subi un cunnilingus par surprise de son partenaire (un acteur non professionnel recruté dans un club d’échangisme) avec l’assentiment, voire à l’instigation de Catherine Breillat. Qui aurait ensuite masturbé le jeune homme « pour qu’il maintienne son érection » entre deux prises… Dépression et toxicomanie Dans des pages glaçantes, puis poignantes, l’actrice détaille les conséquences de ce traumatisme sur sa vie et sur sa carrière, la plongée dans la dépression et la toxicomanie l’ayant peu à peu éloignée du cinéma. Ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte. Son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, pendant lesquels elle est passée « par toutes les étapes de la déconsidération » , autant « par fierté et par déni d’être victime – pour ne pas mourir » que par peur de tout perdre : « Ma jeunesse, mon dénuement, mon absence de protection, je ne faisais pas le poids. [L’âge de Breillat,] sa fortune, sa notoriété, ses soutiens… on aurait eu ma peau pour de vrai. » Des mots qui rappellent ceux d’autres jeunes comédiennes abusées par des réalisateurs tout-puissants… Caroline Ducey raconte ensuite sa longue et patiente reconstruction qui est, d’abord, passée par une demande d’explications à la cinéaste, longtemps restée sans réponse. Jusqu’à ce que, après des années sans contact, elle reçoive en juillet 2023 un message de Catherine Breillat. Dans son livre, Caroline Ducey reproduit alors les échanges sidérants entre les deux femmes, où, entre autres amabilités, Breillat la compare à Myriam Badaoui, la mythomane de l’affaire Outreau, « qui est finalement une figure pathétique [qui] s’est prise au jeu du mensonge pour en surajouter ». L’actrice, de son côté, a des mots très durs sur la cinéaste, comparée à « un vampire » en quête de « chair fraîche », qui a « tout simplement commis un crime sur [sa] personne en abusant de [sa] confiance »… À lire aussi : #MeToo cinéma : Caroline Ducey et Marianne Denicourt, des paroles enfin entendues ? Dans son parcours de résilience, Caroline Ducey a heureusement découvert les poèmes et écrits intimes de Marilyn Monroe, qu’elle a adaptés pour un spectacle et qui lui ont permis de reprendre confiance. Avant, dans la foulée de la libération de la parole impulsée par le mouvement #MeToo, d’écrire ce récit intense non pas « pour détruire [Breillat] et son œuvre », mais pour « enfermer » sa propre douleur, « réunir le temps fracturé et dépasser l’effroi ». Et, au-delà de Catherine Breillat, interpeller tous les artistes sur leur responsabilité : « Que fait-on du pouvoir symbolique, social, financier, affectif dont on dispose ? […] L’utilise-t-on pour la création, l’utilise-t-on pour jouir de détruire l’autre, l’utilise-t-on pour assouvir une vengeance, l’utilise-t-on pour faire subir à d’autres ce que l’on a subi soi-même ? » Samuel Douhaire / Télérama La réponse de Catherine BreillatCatherine Breillat a réagi au livre de Caroline Ducey dans les colonnes du Nouvel Obs, qui revient sur le tournage de Romance. Selon la réalisatrice, les séquences avec des actes sexuels non simulés avaient été « acceptées » par la jeune actrice, « mais ce n’était pas stipulé dans son contrat, elle était donc libre de ne pas les tourner ». Catherine Breillat réfute tout viol sur le tournage et, quand la comédienne se souvient l’avoir vue masturber un acteur entre deux prises, la cinéaste annonce son intention de porter plainte pour diffamation – « C’est une accusation délirante qui vise à me nuire et à me rabaisser ». Breillat précise enfin : « Seul le film compte et Caroline y est sublime. Je ne doute pas que le cinéma soit un art carnivore et même anthropophage, mais je réfute les mots de “trahison”, de “prédation”, et tout ce fatras populiste bien dans l’air irrespirable de ces temps rétrogrades, où l’on essaie de faire plier le cinéma d’auteur sous le joug d’un totalitarisme puritain. » PLUS D'INFOS -
Titre La Prédation -
Auteur Caroline Ducey -
Editeur Albin Michel -
Prix 16.9 € -
Collection Documents Légende image : Dans ce récit intense, Caroline Ducey raconte son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 4, 2024 5:44 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 3 septembre 2024 L’ardente comédienne et chanteuse interprète la légendaire tragédienne dans une pièce écrite et mise en scène par Géraldine Martineau.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/03/au-theatre-du-palais-royal-a-paris-sarah-bernhardt-reenchantee-par-estelle-meyer_6303034_3246.html
Elle s’appelle Estelle Meyer et pourrait bien devenir l’une des figures majeures de la rentrée du théâtre privé parisien. En choisissant cette ardente comédienne et chanteuse pour le rôle-titre de sa nouvelle création, L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt, Géraldine Martineau, autrice et metteuse en scène, a réussi son casting. Il fallait une sacrée personnalité pour incarner « la Divine » Sarah Bernhardt (1844-1923), la légendaire tragédienne, interprète notamment de Phèdre et de L’Aiglon, dont les funérailles attirèrent à Paris une foule de quelque 400 000 personnes. Raconter en une heure cinquante l’incroyable parcours de celle que Jean Cocteau (1889-1963) qualifia de « monstre sacré » relève du challenge. Sur la scène de l’historique Théâtre du Palais-Royal, à Paris, on est tout de suite saisi par la singularité d’Estelle Meyer. Sa voix, sa manière d’être, sa présence, tout chez elle dégage une fougue généreuse, une puissance baroque mais sans esbroufe. Autour d’elle, accompagnés de Florence Hennequin au violoncelle et de Bastien Dollinger au piano et à la clarinette, virevoltent sept comédiennes et comédiens interprétant avec aisance trente-quatre rôles. Une troupe parfaitement accordée et joliment costumée par Cindy Lombardi pour un récit mis en scène avec une épatante fluidité. De sa scolarité au couvent de Grandchamp à Versailles à sa tournée américaine, de sa démission fracassante de la Comédie-Française à la direction du Théâtre des Nations (devenu Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt), de son audition au Conservatoire à sa rencontre avec Victor Hugo (1802-1885) qui l’encensera, une succession de tableaux, ponctués de très réussis intermèdes chantés, déroule les épisodes marquants de la vie artistique et surtout intime d’une femme en avance sur son temps. Si la logique de cette pièce est chronologique et biographique, elle ne se veut pas exhaustive mais centrée sur la soif de liberté et les combats de Sarah Bernhardt. Femme pionnière Le rythme de ce spectacle à la fois exigeant et accessible à tous est à l’image de l’impétuosité de cette artiste hors norme : fantaisiste et plein de vitalité. On ne s’ennuie jamais à suivre l’épopée de cette femme pionnière qui n’avait que faire des conventions et du qu’en-dira-t-on, prête à jouer des rôles d’hommes, à partir aux quatre coins du monde, à diriger avec poigne des théâtres. Estelle Meyer y est pour beaucoup tant elle sait, au fil de ce parcours de vie trépidant, alterner les émotions, distiller ce qu’il faut d’humour ou de douleur, et éviter toute caricature du modèle. Si cette pièce rend un bel hommage à cette figure théâtrale dont on mesure l’incroyable force de caractère, elle pèche parfois par manque de contextualisation. Le poids de l’époque conservatrice et patriarcale n’apparaît malheureusement qu’en filigrane. La traversée de deux guerres dans lesquelles elle s’engagea à sa manière – installant une infirmerie dans le Théâtre de l’Odéon en 1870 et participant à une tournée théâtrale pour soutenir le moral des soldats en 1916 –, la lutte contre l’antisémitisme et sa défense de Dreyfus au côté de Zola sont rapidement évoquées. En revanche, sa relation avec son amour de fils, Maurice – formidablement interprété à tous les âges par l’espiègle Sylvain Dieuaide –, ou avec ses sœurs offre de très beaux moments d’intimité. Après l’adaptation de La Petite Sirène, d’Andersen, et de La Dame de la mer, d’Ibsen, pour la Comédie-Française, Géraldine Martineau, 39 ans, confirme son talent de metteuse en scène mais aussi d’autrice, et sa capacité à sans cesse se renouveler. Elle offre à Estelle Meyer un rôle sur mesure dans lequel cette artiste polymorphe (récemment remarquée dans son spectacle Niquer la fatalité), à l’allure de gitane et au timbre de voix inoubliable, peut déployer toute son humanité. Quant à Sarah Bernhardt, elle revient à la mode un siècle après sa mort. En 2023, une exposition a été consacrée à ce modèle féminin d’émancipation au Petit Palais, à Paris. Et le 18 décembre sortira Sarah Bernhardt, la Divine, le nouveau film de Guillaume Nicloux avec Sandrine Kiberlain. On pourrait aisément reprendre la devise de la tragédienne : « Quand même ! », il était temps de redonner vie à cette artiste flamboyante. Sandrine Blanchard / LE MONDE « L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt », texte et mise en scène de Géraldine Martineau. Avec Estelle Meyer, Marie-Christine Letort, Isabelle Gardien, Blanche Leleu, Priscilla Bescond, Adrien Melin, Sylvain Dieuaide, Antoine Cholet, Florence Hennequin, Bastien Dollinger. Théâtre du Palais-Royal, Paris 1er. Jusqu’au 22 décembre. Tarifs : de 18 € à 65 €. Le texte de la pièce est publié par L’Avant-Scène théâtre agrémenté des croquis des costumes (120 p., 14 €). Légende photo : Estelle Meyer (deuxième à gauche) dans le rôle de Sarah Bernhardt, dans « L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt », mise en scène par Géraldine Martineau, au Théâtre du Palais-Royal, à Paris, le 24 août 2024. FABIENNE RAPPENEAU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 3, 2024 7:23 AM
|
Par Hélène Kuttner dans Artistik Rézo - 1er sept. 2024
Au Théâtre du Palais Royal, Géraldine Martineau met en scène le mythe de la comédienne intégrale, avec la passion et l’expertise mêlées à l’écriture d’une formidable pièce. La comédienne et chanteuse Estelle Meyer donne corps à la star, avec une vitalité et un talent explosif, entourée d’une brochette de comédiens virevoltants et sensibles. Une création qui rend la rentrée effervescente.
L’invention d’une star
Qu’est-ce qu’une star ? Selon Sarah Bernhardt, l’impact d’un comédien doit être évalué à l’aune d’un personnage qui s’identifie à un nom, un être qui évoque un souvenir ». Le mystère, la multiplication des poses et des images, la liberté extrême, sont les éléments de la définition de la star, dont Greta Garbo et les producteurs américains se saisiront au début du XX° siècle. En 1844, en plein milieu du XIX° siècle, naît une petite fille toute rousse au tempérament de feu, à la sensibilité ardente, qui va marquer l’éternité du sceau de son talent. Du collège religieux où elle reçoit une éducation stricte, elle n’aura de cesse de clamer son libre-arbitre, son désir de liberté et d’appropriation de tous les codes sociaux. Celle qui a 16 ans obtient le prix de tragédie au Conservatoire, rentrera à 17 ans à la Comédie Française qu’elle quittera, à la suite d’une rixe avec une sociétaire, un an plus tard. Après des débuts plus glorieux à l’Odéon, notamment dans le rôle de la reine de Ruy Blas que lui offre en mains propres le grand Victor Hugo, la voici revenant à la Comédie Française dont elle deviendra sociétaire. Pour en démissionner cinq ans plus tard. La vie fabuleuse, la carrière fulgurante de Sarah, qui enflammera aussi le public dans le monde entier, Europe, Amérique du Nord et du Sud, ne va pas une utilisation judicieuse de la publicité et de la photographie, dont les Nadar, Félix et Paul, seront les ardents serviteurs et amis. Une météorite chevauchant deux siècles « Madame Sarah Bernhardt présentait ce phénomène de vivre à l’extrémité de sa personne, dans sa vie et sur les planches » écrivait le poète Jean Cocteau. Celle qui s’évanouissait dans la Dame aux Camélias, qui tenait à braver le public londonien avec une jambe amputée, ne semblait reculer devant rien pour assouvir la perfection de son art et le don d’elle même. On sait moins que Sarah, lors des guerres de 1870 ou en 1914, s’est livrée corps et âme dans le feu du conflit en installant une infirmerie dans le théâtre de l’Odéon. Qu’elle a subi de lourdes attaques antisémites, auxquelles elle a résisté avec force. Mettre en scène une telle vie, à cheval entre le 19° siècle encore classique et le 20 siècle bouillonnant, relevait donc d’un défi total, que Géraldine Martineau, qui fit un passage remarqué, elle aussi, à la Comédie Française, relève avec panache. Dans l’écrin velouté d’or et de rouge du splendide théâtre du Palais Royal, l’histoire d’une star déploie des tableaux plus que vivaces : entourée de ses soeurs et d’une mère fantasque, le pied de nez au pensionnat tenu par des nonnes, le face à face avec la mort, l’émancipation au Conservatoire et le scandale de la Comédie Française où sa personnalité fait déjà des ravages, avant de s’affirmer avec les plus grands et sur les plus grandes scènes du monde. C’est Estelle Meyer, comédienne au talent puissant et sauvage, à la personnalité hors-normes, qui vient habiter littéralement le personnage en y inventant son double moderne. Une troupe haute en couleurs Et elle est formidable de liberté, d’énergie et de générosité, cette comédienne qui porte le rôle d’une vie en une heure et quarante cinq minutes, avec un humour et une bonne humeur toujours en berne. Car elle le fait avec une simplicité et un naturel évident, sans chichis, dans des costumes épatants et une chorégraphie de Caroline Marcadé qui embarque toute la troupe brillante de toutes les personnalités qui la constituent. Marie-Christine Letort, extravagante Youle, la mère de Sarah, épaulée par Isabelle Gardien, ex-sociétaire de la Comédie Française, qui incarne la chaleureuse Madame Guérard. Blanche Leleu et Priscilla Bescond sont les inséparables et fantaisistes sœurs. Coté garçons, Sylvain Dieuaide campe avec ferveur le fils chéri de Sarah, Maurice, avec Adrien Melin et Antoine Cholet pour camper les autre personnages. Mais la musique ici est très présente avec un savant duo, Florence Hennequin au violoncelle et Bastien Dollinger au piano et à la clarinette. Ça chante et ça danse, sans une seconde d’ennui, et c’est la qualité de ce spectacle tout public, précis et historique, qui redonne à Sarah Bernhardt toute sa lumière et son panache pour le bonheur de tous. Hélène Kuttner / Artistik Rezo L'Extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Texte : Géraldine Martineau Mise en scène : Géraldine Martineau Distribution : ESTELLE MEYER, MARIE-CHRISTINE LETORT, ISABELLE GARDIEN, PRISCILLA BESCOND, BLANCHE LELEU, SYLVAIN DIEUAIDE, ANTOINE CHOLET, ADRIEN MELIN, FLORENCE HENNEQUIN ET BASTIEN DOLLINGER Du 27 Août au 30 Déc 2024 Réservations par téléphone :
01 42 97 40 00 Légende photo : Estelle Meyer ©Fabienne Rappeneau
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2024 3:43 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 12 sept. 2024 Depuis vingt-cinq siècles, Les Atrides et leurs héritiers projettent leur ombre sur l’histoire du théâtre et du monde. Grande fresque théâtrale inspirée des textes d’Euripide, d’Eschyle, de Sophocle, de Sénèque, Portrait de famille revisite avec espièglerie l’histoire épique et tragi-comique des Atrides, confiée à quatorze jeunes actrices et acteurs du Conservatoire National Supérieur de Paris – spectacle de sortie de la promotion 2023. Une histoire où, dans l’affrontement des hommes et des dieux, se confondent le fantastique et le politique, l’intime et l’universel. Sacrifices, infanticides, parricides, viols, incestes, cannibalisme : rien ne fait peur à cette famille sans scrupules : «Oeil pour œil, sang pour sang ». Une matière prolixe et débridée, dont Jean-François Sivadier se saisit à travers un théâtre généreux, exigeant et populaire. Portrait de famille retrace l’histoire épique et tragi-comique de la famille infernale d’Atrée – voyage traversant, entre terreur et allégresse, la Guerre de Troie jusqu’au retour à Argos. Le destin des Atrides, machine rêvée pour un jeu démultiplié, présente une matière hétéroclite aux figures démesurées, à la liste de crimes sans fin, au souffle épique et aux accents tragi-comiques: des défis à relever pour les quatorze jeunes interprètes. Selon le principe de prédation – « Tuer ou être tué » –, les héros antiques sont, sous la plume alerte et amusée de l’auteur-metteur en scène, les portraits en pied d’une famille barbare. Entre les crimes passés et ceux à venir d’un monde dominé par un Olympe de divinités exigeant le sacrifice renouvelé pour relancer les relations de pouvoir, le protagoniste s’avance sur scène dans l’angoisse d’être la prochaine victime sur la liste. Les Atrides se mènent une guerre interminable, dont chaque combattant redéfinit l’origine, en déclinant, jusqu’à l’absurde, l’argument : « C’est pas moi qui ai commencé » A bon entendeur, salut. L’équipe des quatorze jeunes acteurs dispose d’un matériau halluciné de rêve et de cauchemar, un chantier chaotique de vertiges pour un jeu scénique renouvelé, un tableau généreux suscitant l’intérêt du public agrippé à cette histoire qui le révulse et le fait rire. Les acteurs sont forts d’un jeu libre, conscients de l’extravagance de leurs propos incongrus, assumant leur singularité pour dénoncer la cruauté des hommes, quand la guerre est reine, hier comme aujourd’hui, note Jean-François Sivadier, « guerre entre les peuples, entre les hommes et les dieux, entre les membres d’une même famille ». Excès, démesure et cruauté, le tragique est rejoint par le comique, l’humour et la dérision face à la trivialité des enjeux – affaires d’Etat et complots de famille, intérêts du peuple et intérêt personnel, persécution gratuite des hommes par les dieux sous couvert d’idée, d’idéal, de mythe et de religion. Les hommes sont mis à la peine et le théâtre les relève. Le spectacle enjoué est un capharnaüm d’images et de représentations de la pitié et de la terreur, stimulé par la statuaire des héros antiques – immobile et mobile, sur piédestal ou déboulonnée, en toge ou dénudée, des mises en majesté plastiques et picturales se tenant à bonne distance de tout sérieux et de moralisme pour privilégier raison et humour. La drôlerie se tient dans les gestes et les manières – les saluts militaires réinventés de b.d. soulignant la dimension collective et chorale joliment assumée par la troupe. A travers encore une appropriation cocasse de la langue, pleine de jeux de mots et de bouffonnerie: répétitions, bégaiements, inversion des syllabes, provoquant le rire en cascade du public. Et les références à Shakespeare sont pléthore, le spectre du père dans. Hamlet, la scène de théâtre dans le théâtre pour révéler le vrai à travers le faux – les crimes commis etc… La scène tient d’un théâtre artisanal de tréteaux, habillé de panneaux, de bannières de guerre et de toiles peintes qui cachent l’horreur des crimes sanglants, sur un sol noir et somptueux de cendres qui chatoient d’éclats scintillants – traces divines et musiques toniques. Un spectacle ludique et bienfaisant de retrouvailles avec l’art du jeu – pensée et moquerie. Véronique Hotte / Hottello Texte et mise en scène de Jean-François Sivadier, collaboration artistique Rachid Zanouda, lumière Jean-Jacques Beaudouin, scénographie étudiants en 4e année à l’Ecole des Arts Décoratifs – Paris, Xavi Ambroise, Martin Huot, Violette Rivière, costumes Valérie Montagu, son Jean-Louis Imbert. Avec 14 actrices et acteurs de la promotion 2023 du ConservatoireNational Supérieur d’Art Dramatique de Paris (CNSAD-PSL), Cindy Almeida de Brito, Manon Leguay, Arthur Louis-Calixte, Alexandre Patlajean,… Du 18 au 29 septembre 2024, du mercredi au vendredi à 19h, samedi à 18h, dimanche à 16h, relâche lundi et mardi,au Théâtre de la Commune – CDN Aubervilliers. Les 4 et 5 octobre 2024, Le Carré Sainte Maxime. Les 13 et 14 novembre 2024 à La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle. Les 7 et 8 février 2025 Le TAP, Scène Nationale de Poitiers. Les 12 et 13 février 2025 L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry. Du 19 au 21 mars 2025 à La Comédie de Béthune, CDN Hauts de France. Du 19 au 29 juin 2025, Le Théâtre du Rond-Point à Paris. .

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 16, 2024 12:41 PM
|
IA : Ange ou démon Par Hugues Le Tanneur dans Transfuge, le 22/08/2024 Dans Maître obscur, sa première création en français, le dramaturge japonais Kurō Tanino interroge les possibilités fascinantes ou inquiétantes de l’intelligence artificielle. Quatre personnages se retrouvent dans un appartement pour y cohabiter un certain temps. Ils ne se connaissent pas et vont, par conséquent, devoir s’habituer les uns aux autres. L’idée imaginée par le dramaturge et metteur en scène Kurō Tanino évoque à la fois une émission de téléréalité type Loft ou la pièce Huis Clos de Jean-Paul Sartre ; mais la comparaison s’arrête là car l’expérience que vivent les protagonistes de Maître obscur est d’un autre ordre. Les trois femmes et l’homme réunis plus ou moins contre leur gré sont des marginaux, peut-être pour certains des criminels. Surplombant la scène un écran offre des vues de l’appartement, le salon, la chambre à coucher, la cuisine, comme si les personnages étaient surveillés à leur insu. Sans vraiment le savoir, ils sont pris en main par une intelligence artificielle qui ne se contente pas de les observer mais oriente leurs actions comme si elle pénétrait à l’intérieur de leurs cerveaux. Il y a quelques années Kurō Tanino avait déjà présenté au théâtre de Gennevilliers The Dark Master, un spectacle où un homme était dominé par un maître invisible qui lui donnait des ordres. Dans Maître obscur, la question de la domination et de la soumission est de nouveau abordée, mais cette fois sous un angle différent. Créée en français, cette pièce met en situation des personnages – interprétés par Stéphanie Béghain, Lorry Hardel, Mathilde Invernon, Jean-Luc Verna et Gaëtan Vourc’h – dans le contexte d’une « cure » visant à les aider à se sentir mieux et à réintégrer la société. Que cette cure soit administrée par une intelligence artificielle apparaît bien sûr hautement problématique, même si Kurō Tanino se garde de trancher la question de savoir si les effets sur ses héros sont bénéfiques ou au contraire aliénants. Car non seulement cette IA ne manifeste aucune agressivité, mais elle semble même plutôt bienveillante. De là à penser que le dramaturge est un doux rêveur, il y a un pas qu’il faut se garder de franchir. Interrogé sur le fait de savoir si l’on a affaire à une utopie ou une dystopie, il répond : « La pièce pose précisément cette question. Est-ce qu’une telle IA un peu humaine, empathique, très évoluée pourrait être présente dans nos sociétés ? Tolérante, généreuse, elle pourrait petit à petit pénétrer les consciences sans que nous nous en rendions compte. Peut-être même existe-t-elle déjà et elle est un moyen de contrôle. Un peu comme un dominateur qui appâte avec des friandises dont ceux qui les goûtent ignorent les effets à long terme. Dans la pièce, je ne porte pas de jugement de valeur. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Je ne tranche pas ». D’une manière générale Kurō Tanino préfère dans ses spectacles maintenir une certaine ambiguïté plutôt que d’analyser situations et personnages. Il y a dans son théâtre une qualité singulière qui consiste à installer une forme de flottement où les situations se développent presque imperceptiblement à la manière dont on se familiarise peu à peu avec un paysage et ses infimes variations. Il s’agit de ne jamais forcer le trait, ni d’affirmer, mais de laisser être. Une approche d’autant plus intéressante qu’avant de se lancer dans le théâtre, il a longtemps exercé comme psychiatre. Kurō Tanino : « En tant que médecin, je me posais beaucoup de questions sur la valeur des soins que nous apportions aux patients. Qu’est-ce que ça voulait dire de soigner des personnes qui ont des troubles mentaux. Depuis que je suis étudiant, je m’intéresse au théâtre que je pratiquais en amateur. Avec la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011, je me suis dit : la vie est courte, je dois me consacrer à ce qui compte le plus pour moi, c’est-à-dire le théâtre. C’était un moment difficile de bascule, de remise en question. Aujourd’hui je suis heureux d’avoir franchi le pas. » Traduction du japonais Miyako Slocombe Maître obscur, de et par Kurō Tanino, du 19 septembre au 7 octobre au Théâtre de Gennevilliers. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Le spectacle présenté par Kuro Tanino (lien vidéo) Présentation sur le site de France Culture

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 15, 2024 4:54 PM
|
Publié par Sceneweb le 15 septembre 2024 Jean-Michel Dupuis, est mort à l’âge de 69 ans, des suites d’une longue maladie, a fait savoir sa dernière compagne. En près de 50 ans de carrière, il aura marqué l’histoire du théâtre français, alternant les scènes publiques et privées, de la Cour d’honneur du festival d’Avignon, au TNP de Roger Planchon, en passant par le théâtre Édouard VII, sous la direction de Bernard Murat. Formé dans les Conservatoires de Rouen et de Paris, Jean-Michel Dupuis avait commencé sa carrière dans les années 70. Il joue sous la direction de Daniel Benoin en 1976 dans Le Roi Lear de William Shakespeare à La Comédie de Saint-Étienne. A la fin des années 70, il est de l’aventure du TNP à Villeurbanne avec Roger Planchon. Sa rencontre avec Patrice Kerbrat en 1987 est importante. Il joue dans Conversations après un enterrement de Yasmina Reza au théâtre Montparnasse, puis dans Retours de Pierre Laville en 1988 au Théâtre de l’Odéon. Ils continueront de travailler ensemble au fil du temps. En 1996 dans En attendant Godot au théâtre du Rond-Point et en 2006 dans La Danse de l’albatros de Gérald Sibleyras au théâtre Montparnasse. En 1992, Jean-Michel Dupuis ouvre le festival d’Avignon dans la cour d’honneur du Palais des Papes aux côtés de Jean-Marc Barr dans Le Chevalier d’Omedo, de Lope de Vega, dans une mise en scène de Luis Pasqual, au milieu d’un champ de blé, scènographie signée Ezio Frigerio qui aura marqué l’histoire du festival. Dans les années 2010, Jean-Michel Dupuis enchaîne les succès au Théâtre Edouard VII sous la direction du metteur en scène Bernard Murat. Il créé en 2010, Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière et en 2014, Le Mensonge de Florian Zeller. Sceneweb Légende photo : Jean-Michel Dupuis et Jean-Marc Barr dans Le chevalier d’Olmedo dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en 1992
photo Eric Cabanis AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 14, 2024 12:57 PM
|
Propos recueillis par Nadja Pobel / Le Petit Bulletin Lyon, publié le 11 septembre 2024 Entretien / Le metteur en scène et ancien directeur du théâtre du Point du Jour redevient acteur pour la création, aux Célestins, de Ma Chambre rouge (fantaisie), qu’il a commandé à sa complice autrice Marie Dilasser. Il joue « Moi » sans pour autant raconter sa vie. Explications à quelques jours de la première. Vous avez dit il y a quelques mois que cette nouvelle pièce n’était pas autobiographique. Pour autant, vous êtes en scène et incarnez un personnage qui se nomme « Moi ». Quelles pistes avez-vous donné à l’autrice Marie Dilasser lors de cette commande d’écriture ? Michel Raskine. La toute première envie, au départ, c’est de jouer un texte de Marie Dilasser (avec qui c’est notre 5ᵉ spectacle ensemble depuis notre rencontre quand elle sortait de l’ENSATT – les deux versions de Quoi être maintenant ?, Le Sous-locataire, Treize à table, Blanche-Neige). Je lui ai donné beaucoup de cartes dont la base était : un mec qui s’enferme pour toujours dans une chambre. Elle n’a pas du tout été impressionnée par la vastitude de mes autres demandes. Ça ne la tétanise pas et ça me donne toutes les audaces, je ne me censure pas. Il y a eu un ping-pong entre nous, elle réagit très vite. Je voulais par exemple qu’il y est un adolescent et un vieux et que ce soit explosif et un peu tendre. Je ne voulais pas que ça dure plus d’une heure [au final, c’est 1h15 ndlr] et je voulais aussi danser. Et il fallait des subterfuges pour que je ne parle pas en permanence. Il y a notamment une voix, celle de « Maman », Marief Guittier. Et un 3ᵉ personnage qui apporte des lettres, Mitou. Par ailleurs, il se trouve que j’ai dû reprendre le rôle dans Blanche-Neige [NDLR, sa précédente pièce qui est programmée au théâtre de la Croix-Rousse cette saison], avec le texte à la main, suite à un désistement et j’ai été extrêmement à l’aise avec l’écriture burlesque. Je n’avais pas joué depuis 15 ans et Le Jeu de l’amour et du hasard. C’est très étrange le rapport au jeu car j’ai beaucoup joué (notamment sous la direction de Roger Planchon) mais quand je suis devenu metteur en scène, ça ne me manquait pas. J’ai toujours pris soin de jouer un peu dans les spectacles des autres (Gwenaël Morin…) pour ne pas perdre la main en rapport avec qui m’avait toujours fasciné chez Chéreau. Patrice, sans le théoriser, y revenait régulièrement et je suis me suis toujours dit que c’est quand même pas mal que des metteurs en scène montent sur scène régulièrement, pas pour un plaisir manquant car y’a toujours un plaisir qui en remplace un autre – je n’étais pas du tout frustré de ça, je travaillais beaucoup et mes spectacles marchaient – mais parce que jouer c’est un métier et que je suis très admiratif et celles et ceux qui osent aller sur scène. Par rapport à l’autobiographie, je me suis blindé en lui disant qu’elle pouvait prendre ce qu’elle voulait dans ma vie, comme par exemple le fait que ma mère soit revenue des camps de déportation de Ravensbrück. Je ne suis pas contre l’autofiction mais je ne pense pas que ce texte en soit. J’ai en moi, profondément ancré, qu’au théâtre il n’est que fiction. J’ai vraiment un problème avec le théâtre documentaire car, dans les cas les moins réussis, ça ne m’intéresse pas ; j’aime les spectacles à base de documentaires mais avec une très forte présence de l’art théâtral. Ce n’est pas parce que mon personnage s’appelle Moi que c’est Michel. Je me suis vite défendu et protégé de ça. Ce spectacle ne s’adresse pas à mes amis. J’abhorre l’entre-soi. Le théâtre s’adresse à tous. Malgré tout, ça relate la vie d’un vieux personnage, Moi. Quelle part y’a-t-il pour la nostalgie dans ce spectacle ? Elle est évoquée dans le texte. Je crois qu’elle s’est imposée et que je ne voyais pas comment elle ne pouvait pas s’imposer. J’ai 73 ans et la lutte contre la nostalgie me revient dans la gueule tout le temps, c’est totalement inévitable et c’est pas très grave. Mais si ça devient un carburant à la vie d’aujourd’hui, alors là c’est non. Deux mots sont proches et n’ont pas le même sens, nostalgie et mélancolie. La mélancolie je ne la crains pas du tout car le monde est dur et ça peut être un refuge provisoire. La nostalgie c’est pas terrible mais c’est très intéressant théâtralement. C’est tous les Alceste, le prototype de l’isolé dans le monde, seul parmi les autres et pour qui c’est toujours mieux avant. Ce n’est pas ma vie ça. Ça ne m’appartient pas du tout, ça appartient au personnage qui la combat par le burlesque. C’est ma commande aussi à Marie de faire un spectacle de cabaret. C’est pour ça que très vite le titre s’est imposé avec le mot de « fantaisie » qui pour moi est majeur. Je me rends compte qu’en vérité les spectacles qui me plaisent ont de la fantaisie. Chez les très grands du théâtre il y a toujours un moment de rêverie ou d’humour. Je ne conçois pas le théâtre sans humour. Ça me parait impensable. Comme les spectacles de Pina Bausch qui sont d’une noirceur totale sur les rapports entre les hommes et les femmes et qui sont aussi ceux où il y a le plus d’humour au monde. Vous dites avoir voulu danser dans cette création. Il est aussi question de corps « qui tombe ». « T’es vieux, tu dégringoles / ta chair craque, pète, grogne (…) ton squelette s’effrite, se tasse … » lit-on. Vous avez guidé Marie Dilasser vers cette thématique ? Tout ça c’est le miracle de Marie. Ce qu’elle veut dire ne m’appartient pas du tout mais s’accorde avec moi. Je voulais danser car, longtemps, ça a été très important pour mon travail de metteur en scène d’être spectateur de danse. Ça m’a vraiment éduqué à la mise en scène. Parfois, inconsciemment, je parle de chorégraphie pour mon travail. Et puis j’ai toujours pensé que le corps raconte des choses très puissamment et ça fait un équilibre avec la langue extrêmement présente de Marie Dilasser. Il y a trois moments dansés dans le spectacle. Denis Plassard est venu travailler avec moi. J’avais des idées précises d’un fox trot puis d’un solo sur une musique de Scarlatti par exemple. Il y a des fantômes aussi dans ce texte (Shakespeare, Beckett et la citation de « oh les beaux jours »…). Comment sont-ils apparus ? C’est nous deux, Marie et moi. On s’est renvoyé des fantômes, nos inspirateurs plutôt. Avec ce trio (le vieux, l’ado et un qui s’introduit de force dans la chambre), elle a fabriqué une famille recomposée. Ils veulent tous s’adopter, être les parents des uns des autres. Le théâtre c’est génial car ça fabrique des familles. Fin de partie l’a beaucoup inspirée. J’ai toujours aussi été un grand lecteur d’Hervé Guibert. Elle l’a fait rentrer dans la pièce. Est-ce qu’avec ce spectacle peuplé de vos inspirateurs, vous signez vos adieux à la scène ? Je travaille déjà à faire celui-là, ça prend une énergie folle. Je n’ai pas de projets de d’avance mais j’ai beaucoup d’envies de théâtre. Cependant les conditions économiques du théâtre ont changé. Les spectacles sont de moins en moins joués et c’est une catastrophe. Il y a une concurrence de beaucoup de bons spectacles. Donc je ne sais pas si c’est le dernier, notamment pour des raisons économiques. Puis je ne dois pas sous-estimer ma santé physique. Mettre en scène n’est pas si dur mais jouer n’est pas un métier de vieux. C’est extrêmement fatiguant physiquement. Et en France, comme il n’y a pas de troupe en dehors de la Comédie-Française, il n’y a pas de confrontation entre les jeunes et les vieux. Un des effets secondaires des écritures de plateau et de la difficulté des jeunes à trouver du travail, c’est que ça produit – souvent avec de la réussite – des spectacles générationnels. Je vais voir encore de nombreux spectacles, en les choisissant plus qu’avant. Je suis absolument admiratif de cette génération de jeunes femmes qui font des pièces de 4h (Lorraine de Sagazan, Ambre Kahan, Tiphaine Raffier, Julie Deliquet, Caroline Guiela Nuguyen…). Par ailleurs, tous les gens qui me défendaient et me protégeaient sont soit morts soit à la retraite mais j’aimerais continuer à faire des spectacles même si mourir sur scène comme dit Dalida ce n’est pas mon truc. Toutefois il faut qu’on m’accorde que ce spectacle est une expérience, une « épreuve » dans le sens de Marivaux, une expérimentation. Et d’ailleurs, il faudrait que chaque spectacle soit une expérience. Trop de spectacles ne le sont pas, ils "déroulent ", sont dans une norme. On ne peut pas dérouler un spectacle, ni baliser. J’espère que le mien ne balise pas trop même si quand est metteur en scène, on organise le plateau. Mais ma porte ouverte c’est l’écriture de Marie. Ce n’est pas ma pièce même si je l’ai inspirée. Il ne me viendrait jamais à l’idée de co-signer la pièce même s’il y a à l’intérieur une foultitude de choses qui m’appartiennent. Ce texte n’est pas de moi. C’est sa langue et la défense de la langue au théâtre est un militantisme. La Chambre rouge (fantaisie) de Marie Dilasser, mise en scène Michel Raskine
Aux Célestins, Théâtre de Lyon, du 18 au 29 septembre https://www.theatredescelestins.com/fr/programmation/2024-2025/celestine/la-chambre-rouge-fantaisie Célestins, 2 salles, 2 bombances Grande rentrée pour les Célestins qui proposent deux créations en attaque de saison. Outre celle de Michel Raskine et Marie Dilasser, les artistes associés Christian Hecq et Valérie Lesort donnent le coup d’envoi des Sœurs Hilton (du 19 au 29 septembre) avant que ça ne file aux Bouffes du Nord à Paris et en large tournée. Après avoir présenté ici 20 000 lieues sous les mers (repris une seconde fois il y a quelques mois), La Mouche, Le Voyage de Gulliver, ils font revivre la tragédie des sœurs siamoises Hilton utilisées dans les foires et cabaret du début du XXe siècle et filmées par Tod Browning dans Freaks. Pour parfaire la magie qu’ils intègrent toujours à leur travail, ils s’entourent pour la première fois de l’excellent comédien Yann Frisch dont Le Syndrome de Cassandre émeut encore.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 12, 2024 3:38 AM
|
Propos recueillis par Joëlle Gayot pour Le Monde - 12 septembre 2024 Dans un entretien au « Monde », le chef d’orchestre des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques revient sur cette aventure.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/12/thomas-jolly-directeur-artistique-de-paris-2024-si-on-veut-une-democratisation-a-grande-echelle-il-faut-tout-revoir_6314290_3246.html
En novembre 2022, tout juste nommé directeur artistique des Jeux olympiques (JO), Thomas Jolly change de vie. Il démissionne du Quai, à Angers (le centre dramatique national qu’il dirige depuis 2020), et se lance dans l’aventure des JO. Un défi de plus pour cet artiste de théâtre qui, en 2014, proposait au public dix-huit heures d’une représentation shakespearienne hors norme (Henri VI). Le metteur en scène aime franchir les limites. Créateur d’opéras, il est aussi celui qui a redonné vie, en 2022, à la comédie musicale Starmania. Autant d’expériences qui l’ont conduit à prendre en main les quatre cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques. Il revient sur les moments forts, règle quelques comptes avec le théâtre, tout en regardant l’avenir d’un œil encore incertain. Avez-vous toutes les cartes en main pour faire un bilan de l’aventure des JO ? Honnêtement ? Pas du tout ! Tout s’est enchaîné dès ma nomination en septembre 2022. Depuis fin juillet, il a fallu sortir une cérémonie tous les quinze jours. Je n’ai même pas eu le temps de les regarder à la télévision. J’ai assisté aux trois dernières de la régie ou des gradins, à la Concorde et au Stade de France. C’était comme un mix entre la mise en scène d’un opéra XXL et mon expérience de la Cour d’honneur d’Avignon. A l’opéra, une centaine de personnes se coordonnent. Ici, elles étaient 20 000. C’est énorme, ça n’a rien à voir avec un spectacle ordinaire. L’aventure relevait-elle du marathon ou du sprint ? Il s’agissait plutôt d’un marathon avec, à la fin, quatre sauts de haies. Un nombre invraisemblable d’idées étaient alignées sur la ligne de départ et un nombre incalculable d’obstacles se sont présentés en face de chacune d’elles. Le budget, la technique, mais aussi la météo, le patrimoine, la sécurité, le fleuve et ses ponts, la stabilité des quais, et ainsi de suite. Le marathon a consisté, pour moi et mon équipe, à transformer nos idées sans renier nos intentions de départ, tout en passant au travers des filets. Nous y sommes parvenus, même le 26 juillet sous une pluie tenace. J’étais dévasté. J’ai pleuré toute la journée. Mais, en réalité, cette pluie nous a donné l’instantanéité. Nous étions tous, public, équipes techniques, sportifs, sous une même eau fédératrice. Elle nous a rassemblés. Ce jour-là, la météo parisienne a décidé de la narration. Comment avez-vous vécu la curiosité croissante autour du projet ? Il y avait quelque chose de l’ordre de l’impossible dans le projet de Thierry Reboul, le directeur exécutif des cérémonies des JO. Cet homme déplace les cadres. En annonçant une ouverture sur la Seine, il a créé un tel choc de réalité que le scepticisme a surgi. Beaucoup pensaient que nous n’y arriverions pas. D’où cette volonté pernicieuse de vouloir tout savoir avant le jour J, et d’y parvenir parfois en gâchant les effets de surprise. Nous n’avons pas réussi à garder secrets les noms de Lady Gaga et de Céline Dion. C’est dommage. En avez-vous été affecté ? Oui, car j’ai travaillé dans ce bruit ainsi que dans le vacarme d’une actualité politique qui nous a rattrapés. Je n’ai pas échappé au climat de suspicion et d’inquiétude. Quelles incidences les élections législatives et la perspective d’une victoire du Rassemblement national ont-elles eu sur la cérémonie d’ouverture ? Si Jordan Bardella avait été premier ministre, je n’aurais rien changé au contenu. De toute façon, c’était trop tard. Mais ce contexte politique anxiogène a probablement influé sur la réception des spectateurs. Ils ont été encore plus sensibles à la joie, à l’apaisement et au sentiment d’unité que nous souhaitions propager. Certaines séquences, comme celles des drag-queens ou du chanteur Philippe Katerine nu en Bacchus, ont choqué. Cette cérémonie d’ouverture se voulait-elle politique ? Bien sûr que c’était politique, même si je ne fais pas de prosélytisme. Ma mission était de dire qui nous sommes. Dans tous les tableaux apparaissaient des corps différents, de la diversité, des femmes et des hommes maquillés ou costumés. Le théâtre était partout, la question des genres également. Les rois français se poudraient et portaient des talons. Jeanne d’Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire, n’a-t-elle pas été condamnée parce qu’elle était vêtue en homme ? Notre culture est faite de cette fluidité de genres. Quant aux réactions suscitées par l’image arrêtée de Philippe Katerine, il ne s’agissait ni d’une polémique ni d’une critique mais d’une vague de haine. La provocation ne fait pourtant pas partie de mon vocabulaire et je ne cherche à nuire à personne. J’ai fait sonner les cloches de Notre-Dame. J’ai conclu la cérémonie par les mots d’Edith Piaf, « Dieu réunit ceux qui s’aiment », chantés par Céline Dion. Pas pour mettre en valeur la religion catholique. Mais pour terminer par un hymne à l’amour. Avez-vous eu carte blanche en ce qui concerne les moyens financiers ? Je n’ai jamais eu un budget sous les yeux et j’avais de quoi créer. Mais les moyens étaient contraints. Lorsqu’on met en scène, au théâtre, à l’opéra ou aux Jeux olympiques, le mot qu’on entend le plus souvent est « non ». J’ai renoncé à certaines séquences. Par exemple, le survol de la Seine par Zinédine Zidane en porteur de flamme olympique, car il est interdit de faire voler un hélicoptère au-dessus du public à basse altitude. Je n’ai pas eu mon mot à dire sur l’intervention de Tom Cruise au Stade de France, c’était une carte blanche de Los Angeles 2028. Je n’ai rien à voir avec ça. Mais mon dépit le plus vif a surtout été l’absence de textes. Nous aurions tant voulu un grand moment de théâtre. Faire entendre du Molière ou le discours d’un poète, d’une poétesse, devant l’Assemblée nationale. Mais nous nous adressions à la planète entière. Tout le monde n’aurait pas compris. Les cérémonies se sont déroulées dans trois lieux, la Seine, la place de la Concorde et le Stade de France. Lequel d’entre eux avez-vous préféré ? La Concorde est l’endroit le plus puissant. La Seine, ce grand ruban de six kilomètres, est magnifique, mais on perd la convergence des regards. Or, je suis plus sensible à un spectacle que tout le monde regarde en même temps qu’à une parade. En outre, à la Concorde, la ville entière nous faisait de l’œil. Selon l’endroit où l’on était placé et selon les angles de réalisation, on pouvait apercevoir des bouts de la tour Eiffel, de l’Assemblée nationale, de l’Arc de triomphe. Même, un peu de la verrière du Grand Palais. Cette place, si bien nommée, en plein centre de la capitale, stimule l’imaginaire. Il y avait une dimension quasiment ésotérique. Je le dis d’autant plus volontiers que c’est le chorégraphe Alexander Ekman qui a pris en main le spectacle. Je n’ai fait que lui fournir le concept et la dramaturgie, ce qui était ma mission en tant que directeur artistique. Quelle est, selon vous, la plus grande réussite de ces cérémonies ? Nous voulions créer de l’unité. Cette unité a pu exister parce que nous avons montré et traité la pluralité sans jamais négliger la singularité. Au contraire. Beaucoup de gens m’ont écrit pour me dire qu’ils s’étaient sentis représentés et avaient eu le sentiment de faire partie d’un grand « nous ». L’universalisme sort plus fort de ce dialogue entre le commun et le singulier. De même, l’association heureuse de la culture et du sport, deux ciments pour faire société. Les politiques devraient retenir cette leçon. Pourquoi n’y aurait-il pas une Coupe du monde de théâtre ? Elle a existé, autrefois, avec les Dionysies. Le théâtre se jouait dans des stades de 20 000 places, soit dix fois plus de spectateurs que dans les plus grands théâtres de France. Je ne dis pas qu’il faut toujours réunir sport et culture. Mais si ces cérémonies ont prouvé quelque chose, c’est que le spectacle vivant est porteur d’outils pour mieux être ensemble. Quittez-vous les Jeux olympiques avec une vision neuve de la démocratisation culturelle ? Ma vision n’a pas changé. Le choix, porté par Jeanne Laurent, Jean Vilar ou Jean Dasté, d’aller faire du théâtre partout après la seconde guerre mondiale pour réconforter les gens et les consolider en tant que nation était et reste le bon. Mais comment élargir et diversifier les publics des théâtres, alors que les spectacles, aujourd’hui, ne jouent que quelques jours ? On tourne en rond devant les mêmes spectateurs avec lesquels nous sommes toujours d’accord. Ce n’est pas comme cela que je conçois mon travail. Je sais bien que les directeurs de théâtre public doivent partager leur maison avec des compagnies qui ont un besoin vital de scènes pour exister. Les projets affluent, les propositions se succèdent à un rythme effréné dans les saisons théâtrales. Mais rien ne peut se construire avec le public lorsqu’on ne reste qu’une poignée de jours dans une ville. Pour jouer longtemps, aujourd’hui, il faut aller dans le théâtre privé. Sauf qu’au privé il n’existe aucune réflexion sur les publics ou la formation de l’esprit critique. Je ne suis pas ministre de la culture, mais il me semble urgent d’inventer une troisième voie. Si on veut une démocratisation à grande échelle, il faut tout revoir : nos fonctionnements, nos habitudes, nos rythmes, changer nos modes d’adresse au public, incarner de plus en plus les lieux. Je précise que je défends l’institution, et d’autant plus que certains, à droite, comme en région Auvergne-Rhône-Alpes, lui retirent les subventions. Mais cette institution a besoin de se décloisonner. Que voulez-vous dire par là ? Elle est merveilleuse mais bien trop hermétique. Un exemple : le ministère de la culture et le président de la République souhaitaient que je reprenne mes fonctions de directeur du Quai, à Angers, après les JO. Il ne s’agissait pas d’une demande de ma part, même si revenir m’aurait plu, car j’aimais être là-bas. Lorsque j’ai demandé leur soutien à mes camarades directeurs, membres de l’Association des centres dramatiques nationaux, ils me l’ont refusé. Pourquoi ? Est-ce parce que j’avais créé une comédie musicale [Starmania] et étais nommé directeur artistique aux JO ? Ces deux éclairages ont pourtant permis de faire venir encore plus de gens dans les salles. Mais rien n’y a fait. La porosité entre différents univers artistiques, aussi vertueuse soit-elle, pose un problème aux gens de théâtre. Où est le hic ? Vient-il de moi ou d’eux ? Est-ce que je suis celui qui désaxe le système ? Si tel est le cas, c’est sans malice de ma part. De la même manière, des membres de l’équipe du Quai m’ont accusé d’utiliser le théâtre pour mon image personnelle et pas pour un projet de service public. Tout ça parce que je postais des « stories » sur Instagram afin de convaincre le public de venir. Or, des murs et des équipes, aussi impliquées soient-elles, ne suffisent pas à populariser un lieu. Pour ma part, je suis convaincu, et de plus en plus, qu’il faut de l’incarnation, une voix, un visage, des discours. Participez-vous à la conception de la parade des athlètes qui se tiendra le 14 septembre, à Paris ? Je suis invité à défiler avec mon équipe mais je ne m’en occupe pas. Je n’en suis plus là. J’avais programmé mon corps et mon cerveau jusqu’au 8 septembre. Je suis en pleine descente. Je vais prendre le temps de voir ma famille. Puis je partirai en vacances. Qu’allez-vous faire plus tard ? Prendre une autre direction de lieu ? Je n’en sais rien. Je dois réfléchir à tout ça. Je n’ai pas de plans. Je ne fais pas ce métier pour ma pomme mais pour que mon travail serve. Que ce soit demain dans un théâtre en région, ou n’importe où ailleurs. Je n’ai pas envie de me battre pour démontrer à des gens que j’ai ma place là où je suis. J’ai réalisé plein de rêves, accompli des désirs fous. Mon travail est de raconter des histoires. Même si j’adorerais me glisser dans le rêve de quelqu’un, redevenir acteur sous la direction d’un autre metteur en scène ou cinéaste, je peux aussi quitter le théâtre pour écrire des pièces, des scénarios, réaliser des films ou concevoir des jeux vidéo. On n’a qu’une vie. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Thomas Jolly, à Paris, le 11 septembre 2024. AUDOIN DESFORGES POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 11, 2024 6:17 PM
|
Saisons raccourcies, créations moins nombreuses, reprises tous azimuts… Quand les subventions fondent et que les frais explosent, la scène s’en ressent immédiatement. Les établissements se voient contraints de repenser leurs propositions. De nombreuses directions de scènes l’avaient annoncé : la saison théâtrale 2024-2025 serait problématique en raison de l’érosion de leurs moyens et elles devraient privilégier des spectacles peu onéreux, avec un minimum d’acteurs, et un tabouret en guise de décor. La direction des théâtres nationaux – en particulier l’Odéon, la Colline, la Comédie-Française, tous trois coproducteurs essentiels pour les compagnies – avait quant à elle hurlé dans le désert que les répercussions seraient immédiates, lorsqu’elle a appris tardivement, en avril 2024, que le milieu allait subir une restriction de la moitié de son budget de programmation pour l’année en cours. Nous y voilà. En consultant les programmes qui envahissent les bureaux et les présentations de ladite saison, une injonction contradictoire saute aux yeux : il s’agit à la fois d’attirer la curiosité des publics et des médias, de ne pas crier misère et de ne surtout pas sous-entendre que la programmation serait au rabais. Tout en laissant voir mutatis mutandis le nœud coulissant qui menace en particulier les artistes les plus jeunes, les moins connus, les plus précaires, forces vives de demain. A ce titre, la programmation de cet automne à la Colline brille par son absence d’hypocrisie. Il n’y a plus d’argent ? Il ne faut pas prendre de risque, déconcerter avec des noms peu connus, et débuter la saison avec une salle possiblement à moitié pleine ? «OK boomer !» semble lancer l’équipe dirigeante à la ministre déjà démissionnaire de la Culture, Rachida Dati. Pourquoi ne pas programmer pendant un trimestre une pièce qui a déjà été créée pendant deux mois dans le même théâtre il y a deux ans ? Et c’est ainsi que du 20 septembre au 22 décembre, la saga autobiographique de Wajdi Mouawad, Racine carrée du verbe être, se déploiera encore une fois en majesté dans la grande salle de 650 places. On n’a évidemment rien contre cette pièce du directeur de la Colline, qui imbrique l’intime et le politique et prend de nouvelles résonances avec l’actualité, et il est sans doute heureux que d’autres spectateurs puissent la découvrir. Il n’empêche : le geste est d’autant plus ostentatoire qu’est attendue, en fin de saison, Journée de noces chez les cromagnons, pièce du même auteur qui aurait dû être créée au Liban, et qui se donnera du 29 avril au 22 juin 2025 dans la même grande et belle salle, après avoir été montrée au Printemps des comédiens. Autrement dit, presque la moitié de la saison est, cette année, consacrée à cet aimant à public qu’est Wajdi Mouawad, sans même qu’il s’agisse de créations ! Le secrétaire général de la Colline, Arnaud Antolinos, assume pleinement sa programmation : «Quand on a reçu l’annonce en avril de la réduction de moitié de notre disponible artistique, soit 730 000 euros, on a été obligés de revoir toute la programmation de l’automne. On essaie de sanctuariser celle qui court de janvier à juin. De s’assurer d’avoir une activité de création alors qu’on n’en a plus les moyens.» Les projets n’ont pas été décommandés mais reportés aux saisons suivantes. L’établissement dédié aux écritures contemporaines, situé dans le quartier encore populaire de Ménilmontant, a bien une seconde (petite) salle, qui lui permet de continuer à inviter en 2024-2025 des artistes moins connus, en les coproduisant ou les produisant. Mais la création contemporaine est-elle vraiment la priorité de la ministre de la Culture, qui fréquente avec parcimonie les scènes subventionnées, n’ayant pas jugé bon, par exemple, de faire le moindre (petit) saut au dernier Festival d’Avignon – ni même à la Colline, pourtant sous sa tutelle directe ? Rappelons que, faute d’être ardemment protégé, le budget du ministère de la Culture a été délesté de 200 millions d’euros, «ce qui n’est jamais arrivé [aux] prédécesseurs [de la ministre], sans doute plus promptes à défendre leur budget» remarque un habitué de la rue de Valois. Moins de spectacles, moins de coproductions Stéphane Braunschweig, qui vient de passer la main à la direction de l’Odéon à Julien Gosselin, n’a quant à lui pas attendu les restrictions budgétaires historiques d’avril pour annoncer dès décembre les raisons de sa démission : plus aucune marge artistique pour se projeter l’année qui suit, aucuns moyens pour répondre aux différentes missions du théâtre de l’Europe et en particulier honorer son projet d’un théâtre largement ouvert sur l’accueil des artistes étrangers. Avant de faire ses bagages, Braunschweig a bien dû concevoir avec son adjoint Didier Juillard l’entièreté de la programmation 2024-2025, qui ne comporte donc aucune création entièrement produite par l’Odéon : la Mouette de Tchekhov, que Stéphane Braunschweig présente à partir du 7 novembre, est en effet financée pour un tiers par les deniers de sa propre compagnie et n’aurait pas été possible autrement ! La variété du programme, plus patrimonial que les autres années, garantit ses arrières par de grands noms – Tchekhov, Feydeau, Duras, Brecht. Ils dissimulent certains faits arithmétiques. Les vaches maigres se répercutent dans le nombre des spectacles proposés : 12 cette saison contre 14, 15, ou 16 les années précédentes, et 245 représentations au lieu des 300 auparavant, ce qui constitue une «régression» note Didier Juillard, le programmateur lui aussi sur le départ. Qui ajoute : «On produit en général deux spectacles à 100%, et donc cette année, on n’en a aucun. On a réduit systématiquement le montant de nos sept ou huit coproductions et les séries sont plus courtes.» Ainsi, quand l’Odéon soutenait une création à hauteur de 50 000 euros, le théâtre n’en donne plus que 30 000, et quand elle en offrait 30 000, sa participation a été divisée par deux. Les compagnies sont obligées de chercher d’autres coproducteurs, et de vendre leurs spectacles plus cher tout en réduisant leur ambition – biffer des acteurs, des décors. L’Odéon accueille cependant comme chaque année, en les coproduisant, des reprises très attendues (Lacrima de Caroline Guiela Nguyen et Dämon d’Angélica Liddell) mais aussi, dans le cadre du Festival d’automne, Parallax, mis en scène par le Hongrois Kornel Mundruczo, Grand-Peur et Misère du IIIe Reich de Brecht, montée par Julie Duclos, ou dans un tout autre genre l’Amante anglaise de Duras, par Emilie Charriot. Cette pièce sera incarnée par trois stars du théâtre subventionné, Dominique Reymond, Laurent Poitrenaux, et Nicolas Bouchaud. De quoi masquer la disette budgétaire. «Cette longue crise nous oblige à sortir de la compétition entre théâtres» Les autres scènes publiques, dont les subventions sont partagées avec les municipalités ou régions, n’ont pas perdu de financements étatiques. Pour autant, comment ne pas s’interroger sur la saison très courte de la Mac de Créteil, qui ne débute que le 6 novembre par l’efficace Los Dias Afuera de Lola Arias, découvert au dernier Festival d’Avignon, et se conclut le 23 mai ? En effet, avec l’inflation, la hausse des frais de fonctionnement inéluctable, toutes les directions contemplent, selon la formule imagée de Claire Dupont, à la tête de depuis un an et demi du toujours dynamique théâtre de la Bastille, «la tragédie du théâtre en ordre de marche qui dévore, à subventions constantes, la marge artistique». «Oui, ajoute-t-elle, cet appauvrissement a un impact sur la manière de programmer. Le nombre de dates qu’on peut proposer aux compagnies se réduit et la plupart d’entre nous se résout à faire des séries un peu plus courtes.» La saison très courte de la Mac de Créteil débute le 6 novembre par l’efficace «Los Dias Afuera» de Lola Arias, découvert au dernier Festival d’Avignon, et se conclut le 23 mai. (Carlos Furman) Du coup, les tournées s’étiolent, les compagnies sont obligées d’augmenter le prix de cession de leurs spectacles, ce qui a des répercussions en particulier sur les théâtres comme la Bastille ou le Rond-Point, qui ne sont pas ou peu des structures de production, mais achètent les spectacles. Pour sa part, Claire Dupont a choisi de jouer plusieurs fois les formats scéniques qu’on qualifiera de «classiques», tout en introduisant des formes plus performatives, éventuellement déconcertantes pour le public du théâtre de la Bastille. Citons entre autres l’intriguant Je te chante une chanson toute nue en échange d’un verre, titre à prendre au pied de la lettre, nous promet-on, par Vanasay Khamphommala, lors d’une journée consacrée à l’écriture de soi le 28 septembre ; ou Boujloud (l’homme aux peaux) de Kenza Berrada, du 25 au 30 novembre, preuve qu’en dépit de la crise, la Bastille n’a pas l’intention de renoncer à sa mission de défrichage. Face à l’obligation de toutes les scènes subventionnées d’augmenter leurs recettes propres, Claire Dupont note un progrès et un danger mortel. Le progrès ? «Cette longue crise, qui ne date pas d’hier, nous oblige à mutualiser nos efforts, à sortir de la compétition entre théâtres, à trouver d’autres relais artistiques.» A lire aussi 19 mai 2024 - édition abonnés Comme Hortense Archambault, à la tête de la MC93 à Bobigny, elle note l’importance croissante du Festival d’automne – dont Francesca Corona est depuis deux ans la directrice artistique – qui accompagne la logistique des tournées de plusieurs dizaines de pièces, accroît leur visibilité… et permet d’accueillir des spectacles que ces théâtres n’auraient plus les moyens de recevoir aujourd’hui. Le danger ? «On nous demande d’augmenter nos fonds propres. Or, un théâtre comme la Bastille n’attirera jamais les grands mécènes, et on se refuse à grignoter notre vocation de théâtre de service public en le louant pour des événements privés. Ne reste donc pour augmenter nos recettes que l’augmentation du prix du ticket. Mais l’une de nos missions principales est de rester accessible à chacun. Comment donner aux jeunes adultes envie de fréquenter nos théâtres, si la billetterie est hors de leur portée ?» Ce point tient tant à cœur à Claire Dupont qu’elle a fondé Prémisses, structure de production pour les artistes émergents : «A succès égal et avec une jauge pleine, le théâtre n’a pas du tout les mêmes recettes s’il est rempli de jeunes spectateurs ou d’un public grisonnant. Pourtant si on n’est plus en capacité de travailler sur le renouvellement des publics, on rate un virage essentiel et une partie de notre mission.» Présenter des reprises, une démarche finalement vertueuse Ça n’aura échappé à aucun maniaque des brochures : cette année, les reprises grandes et petites sont légion. Rien qu’à la Bastille, citons notamment un «vieux» spectacle peu joué de Tiago Rodrigues, Antoine et Cléopâtre du 27 février au 14 mars, le merveilleux et immanquable seul en scène En addicto de Thomas Quillardet créé la saison dernière, hélas sur seulement deux jours, les 18 et 19 décembre, ou encore les Bijoux de pacotille de Céline Milliat-Baumgartner, par Pauline Bureau, du 28 avril au 17 mai. Oh joie, si l’on se tourne vers la MC93 à Bobigny, on pourra voir le déjà mythique et rarement présenté in extenso Laboratoire Poison d’Adeline Rosenstein en avril, tandis que bien plus tôt cet automne, on aura entamé une autre traversée de l’histoire grâce à Banquet capital de Sylvain Creuzevault, du 27 septembre au 6 octobre – à l’origine conçu pour être joué dans un hall et non sur le plateau – puis saisi au vol les Historiennes, que Jeanne Balibar reprend le 13 octobre. Non, disent les divers directeurs et programmateurs de lieux, la prolifération des reprises n’est pas qu’une réponse à la paupérisation qu’il faut bien affronter. Mais bien une prise de conscience que l’optique consumériste est un leurre, et que construire un répertoire est nécessaire aux compagnies. La démarche serait vertueuse plutôt que contrainte. Hortense Archambault le constate : «En sortant du confinement, on a eu des saisons très chargées de spectacles qu’on ne pouvait donner que sur des durées très courtes. Les reprendre, c’est les faire vivre.» En France, contrairement à d’autres pays d’Europe, les spectateurs sont revenus massivement au théâtre. La directrice juge d’autant plus «triste» que, malgré cet afflux, elle soit, comme la majorité de ses collègues, obligée d’offrir moins de places aux publics que l’année précédente – «environ 10 000 en moins», calcule-t-elle. Et pour des raisons budgétaires, faire le choix de présenter moins de spectacles. Légende photo : L’Odéon accueille comme chaque année, en les coproduisant, des reprises très attendues (ici «Dämon» d’Angélica Liddell). (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 11, 2024 8:41 AM
|
Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat pour La Terrasse, publié le 27 août 2024 En duo avec la comédienne Léna Bokobza-Brunet, Elise Vigier crée Nageuse de l’extrême – Portrait d’une jeune femme givrée*. Un texte sur les combats de deux femmes (contre la maladie, contre des conditions de nage extrêmes) que la cofondatrice du Collectif Les Lucioles a écrit et qu’elle met en scène à Théâtre Ouvert. « L’idée de ce spectacle est liée à une expérience personnelle. Ayant eu un cancer, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler, sur un plateau, de ce que j’avais vécu. Car j’aurais alors ajouté du silence à du silence. Il m’a semblé important de trouver comment m’emparer de cette chose théâtralement. Je me suis souvenue de femmes qui, après avoir eu un cancer du sein, avaient traversé la Manche. Et puis, le hasard de la vie a fait que j’ai rencontré Marion Joffle, une nageuse de l’extrême de 25 ans qui, ayant elle-même été atteinte par un cancer quand elle était petite, a traversé la Manche à l’âge de 18 ans à l’occasion d’un événement dédié à la lutte contre cette maladie. À présent, elle fait le tour du monde en nageant dans les eaux les plus froides du globe. Son parcours rejoint exactement l’endroit de ma recherche, qui est celui du corps mis à l’épreuve, de la façon dont il fait face à la maladie comme à l’endurance extrême. J’ai ainsi conçu un spectacle nourri de deux récits parallèles. L’expérience du corps fragilisé, diminué, transformé, augmenté… Sur scène, dans un dispositif trifrontal qui instaure une grande proximité avec le public, deux personnages sont présents. Une femme dans une salle d’attente d’hôpital, qui s’inspire de ma propre expérience, et une jeune nageuse de l’extrême, qui s’inspire de la vie de Marion Joffle, jouée par Léna Bokobza-Brunet. La première est suspendue au verdict des médecins, à leurs diagnostics, à toutes les étapes du parcours médical. La seconde raconte sa traversée de la Manche ainsi qu’une nage dans les eaux glacées de l’Arctique. Les deux solitudes que représentent ces deux femmes finissent par se rencontrer dans un endroit totalement fictif, la salle d’attente se transformant en une piscine ou un espace maritime imaginaire. J’ai demandé à Etienne Bonhomme de réaliser une composition sonore qui nous plonge dans divers climats. Peu à peu, les réalités deviennent poreuses et créent un espace qui pourrait, par exemple, être une salle d’attente en Arctique ! Cet espace partagé est aussi celui du corps métamorphosé, de la douleur, de l’amputation, mais aussi celui de la lumière. Marion Joffle se surnomme elle-même le « Pingouin souriant ». Elle a choisi de sourire au monde. » Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat / La Terrasse * Texte écrit à partir d’entretiens avec Marion Joffle, publié chez esse que Editions en septembre 2024. Le lundi, le mardi et le mercredi à 19h30 ; le jeudi et le vendredi à 20h30 ; le samedi à 18h. Tél. : 01 42 55 55 50. Durée estimée : 1h15. Légende photo : L’autrice, comédienne et metteuse en scène Élise Vigier. Crédit : © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 10, 2024 5:11 AM
|
Par Igor Hansen-Løve dans Les Inrocks - Le 9 septembre 2024 Christian Hecq et Valérie Lesort aux Célestins, le seul en scène de Solal Bouloudnine au Théâtre Lepic ou encore le spectacle de Kurō Tanino au Festival d’automne… Quels spectacles vont faire le mois de septembre ? Notre sélection.
Les Sœurs Hilton, par Christian Hecq et Valérie Lesort Valérie Lesort et Christian Hecq forment un tandem du genre inclassable. Un peu metteur·euses en scène. Un peu magicien·nes. Grand·es créateur·ices d’univers enchanteurs. elle et il sont au théâtre ce qu’est Tim Burton au cinéma ; parfaitement singulier·ères, et immédiatement identifiables. Dans leur dernière création, elle et il mettent en scène l’histoire vraie des sœurs siamoise Hilton, abandonnées à leur naissance, transformées en bête de foire par leur mère adoptive, triomphantes sur les planches de Broadway et sur les écrans de cinéma, avant qu’elles ne sombrent dans l’oubli et la misère. En les plaçant dans un décor de cirque, Valérie Lesort et Christian Hecq traiteront des thèmes de la différence, du handicap et des phénomènes d’emprise. Du 19 au 29 septembre, aux Célestins, Théâtre de Lyon et du 10 octobre au 3 novembre aux Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. La Fin du début, par Solal Bouloudnine Cet excellent comédien reprend son seul en scène au fil duquel il raconte sa découverte de la mort, à travers celle de Michel Berger. Solal Bouloudnine est en quelque sorte l’esprit de Woody Allen dans un corps des Chiens de Navarre (dont il fut l’un des membres). On aime son jusqu’au-boutisme punk, et son humour grinçant. On aime aussi cette autodérision salvatrice propre à l’humour juif, qu’il travaille avec singularité et intelligence. À partir du 23 septembre, au Théâtre Lepic. À Paris, 18e Maître obscur, par Kurō Tanino Retour au Festival d’automne de l’artiste japonais après The Dark Master (2016). Kurō Tanino met en scène des acteur·ices français·es dans un établissement de réadaptation à la vie quotidienne dirigée par une IA solitaire. Cet ancien psychiatre de formation cherche à comprendre comment les machines changent notre comportement, de quelle façon nous nous robotisons à leur contact, et quelle peut être la dimension poétique de cette interaction. Sur le papier, ce projet évoque le film Her de Spike Jonze. On a hâte de découvrir ce huis clos futuriste sur scène. Du 19 septembre au 7 octobre. Au théâtre de Gennevilliers
En tournée : les 16 et 17 octobre 2024 au Centre Dramatique National Orléans / Centre-Val de Loire – Les 6, 7 et 8 novembre 2024 à Bonlieu Scène Nationale d’Annecy – Du 5 au 7 février 2025 à la Comédie de Genève Grand-peur et misère du IIIe Reich Rendez-vous à Rennes, pour la dernière création de l’excellente Julie Duclos (Kliniken, Pelléas et Mélisande…), artiste associée au TNB et impliquée dans l’école du théâtre. Dans ce spectacle prochainement programmé à l’Odéon et en tournée dans toute la France, il sera question des répercussions du nazisme sur la vie de gens ordinaires, de 1933 à 1938. Signé Bertolt Brecht, le texte est composé de plusieurs tableaux réalistes : un juge, un couple, des parents… Elle mettra en scène les rapports impossibles entre les êtres sous le fascisme : la paranoïa, le mensonge et la peur. Du 24 au 3 octobre. Au Théâtre National de Bretagne

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 9, 2024 4:03 AM
|
Propos recueillis par Fabienne Pascaud dans Télérama - 9 septembre 2024 Il a ébloui le monde en orchestrant les cérémonies des Jeux de Paris 2024. Alors que la parenthèse olympique se referme, le metteur en scène fait le bilan de deux années de travail fortes en émotions. Quatre cérémonies olympiques durant, il aura étonné, enchanté, rassemblé tous les publics. De Paris, de France, du monde. Magicien d’une démesure généreusement partagée. Comme au théâtre, où monter l’intégrale du Henri VI de Shakespeare en dix-huit heures n’a pas fait peur à Thomas Jolly, 42 ans aujourd’hui. Pour le Centre dramatique d’Angers qu’il dirige jusqu’en 2022, il y ajoute même Richard III, qu’il interprète avec insolence : vingt-quatre heures de spectacle fracassant. Thomas Jolly quittera quand même Angers. Le bosseur inspiré au style tout ensemble ténébreux et flamboyant est trop demandé. Pour la comédie musicale Starmania, pour l’opéra Roméo et Juliette à l’Opéra Bastille. Et vient encore la nomination à la direction artistique des jeux Olympiques ! Il démissionne pour ne pas troubler davantage ses équipes. L’artiste a tous les courages, et pas seulement une énergie passionnée et un imaginaire délirant. Il l’a prouvé cet été. Vous avez fait rayonner les JO. Êtes-vous sportif ?
Pas du tout. Pas de sport en salle, pas de piscine. Du ruban, autrefois, ma passion ; mais j’étais le seul garçon. J’avais déjà arrêté la danse enfant, quand j’avais appris que je ne porterais pas de tutu ! Quand j’entends les sportifs parler du geste parfait, de la qualité de la respiration, de la concentration, je vois des points communs avec les acteurs, et une même philosophie. Il ne s’agit pas de prôner la perfection du corps, mais l’épanouissement de l’être au monde. Pourquoi ne ferions-nous pas nous aussi une coupe du monde du spectacle vivant ? Comme au temps des Grecs. Les gradins des JO ressemblent à ceux d’un théâtre.
La direction artistique des JO a-t-elle été votre aventure la plus excitante ?
La plus dense, la plus vertigineuse, la plus complexe, oui. C’est Thierry Reboul, directeur exécutif de Paris 2024, qui a eu la magnifique idée de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, de sortir la suivante des stades où cela se faisait traditionnellement pour mettre les festivités dans la ville, épreuves sportives comprises. En septembre 2022, quand il m’en a proposé la direction artistique, j’ai immédiatement pensé que j’en étais incapable, mais j’ai eu confiance en sa folie. Ce projet démesuré n’avait pas d’équivalent et paraissait irréalisable vu la somme des contraintes climatiques, techniques, patrimoniales, financières, sécuritaires. Bizarrement, je me fais davantage confiance quand je ne maîtrise pas l’aventure au départ. J’aime travailler, et un travail acharné permet toujours de trouver.
Avez-vous conçu les quatre cérémonies comme des mises en scène de théâtre ?
J’aime raconter des histoires. Dans mes spectacles, je donne toujours une place énorme à la fiction. Le théâtre est le seul art qui donne plus de poids au « croire » qu’au « savoir ». Mais quelle histoire raconter pour ces JO, sachant que nous allions travailler sur la Seine devant des lieux symboliques, Conciergerie, Notre-Dame ou l’Assemblée nationale ? Comme au théâtre, où je pars toujours d’un texte, je me suis vite entouré d’auteurs complémentaires et différents que j’estimais – la scénariste Fanny Herrero, la romancière Leïla Slimani, l’historien Patrick Boucheron et un jeune dramaturge qui a souvent travaillé avec moi, Damien Gabriac. L’essentiel de notre récit devait tourner autour de cette simple thématique : « Bonjour à tous les pays, bienvenue en France, voilà ce que nous sommes. » Mais qu’est-ce que la France ? Emmanuel Macron, qui m’avait reçu à l’Élysée pour me féliciter de ma nomination par le CIO, m’a répondu : « Un récit en perpétuel mouvement dans le grand récit mondial. » Exactement ce que je pensais déjà. Commence alors avec les auteurs la période la plus excitante, la plus libre : l’écriture collective des cérémonies qu’il s’agissait de concevoir globalement sans plaquer de clichés.
La pluralité crée de l’unité, c’est une leçon que j’ai tirée des JO : l’adhésion populaire qu’ils ont suscitée vient de là. Selon quelle ligne maîtresse ?
Saisir dans chaque cérémonie ce grand « nous » qui nous constitue. S’adresser au plus grand nombre, sans exclure personne : mon obsession depuis que je fais du théâtre. C’est en affirmant nos différences respectives que naîtra en effet la fierté d’appartenir à une collectivité qui les respecte. Comme je le disais en jouant naïvement sur les mots dès la présentation de mon projet au CIO, en août 2022 : « Des Jeux, un nous. » Autrement dit : « Des je, un nous. » La pluralité crée de l’unité, c’est une leçon que j’ai tirée des JO : l’adhésion populaire qu’ils ont suscitée vient de là. « Grâce à votre cérémonie, je me suis enfin senti intégré », ou encore « grâce à votre spectacle, je me suis reconnu », ou « la soirée m’a fait pleurer, je suis fier d’être français »… J’ai reçu des milliers de messages. Cette fierté retrouvée m’a bouleversé, et donne sens à notre métier d’artiste : moins on exclut, mieux on rassemble en profondeur.
Avez-vous connu des désaccords lors de l’écriture ?
Non. Seul le réel a rendu certaines idées impossibles. Comme la reprise de cette « rue de l’avenir » qui avait enchanté l’Exposition universelle de Paris en 1900 : un tapis roulant de 3,5 kilomètres installé sur un viaduc autour du site avec neuf stations. Impossible aussi, à cause du vent, cette forêt de montgolfières porteuses d’écrans de cinéma au-dessus du jardin des Tuileries. La vasque imaginée par Mathieu Lehanneur l’a remplacée. Des installations de miroirs sous la tour Eiffel, des ballets nautiques dans la Seine ont été aussi irréalisables. Et le survol de la flamme portée par Zinédine Zidane suspendu à un hélicoptère à trop basse altitude au-dessus de Paris – il était OK. Nous avons beaucoup discuté aussi du choix des dix statues de femmes ayant marqué l’histoire de France, d’autant que notre projet initial était de rétablir la parité avec les deux cent soixante statues d’hommes célèbres que compte Paris ! Impossible d’en installer autant…
Pourquoi aimez-vous la démesure ?
Je m’ennuie si je ne me lance pas de défis. Et j’avoue qu’un théâtre de cinquante places me fait plus peur que la Cour d’honneur du palais des Papes, à Avignon. Dans un espace gigantesque, on n’entend pas tousser, respirer les spectateurs. Enfin, affronter la démesure me rapproche de l’essence même du théâtre : ces tragédies grecques jouées à Athènes devant vingt mille personnes, ce théâtre populaire et politique qu’imagina après guerre Jean Vilar. Je voulais faire revivre cette démesure. Devenir l’artisan, avec toutes les équipes, d’une cérémonie d’ouverture qui aura touché 326 000 spectateurs sur les quais de Paris et 24,4 millions de téléspectateurs en France a été pur vertige. Nous avons même battu le précédent record d’audience télé hexagonal : la finale France / Argentine du Mondial de football 2022 !
Qu’en gardez-vous aujourd’hui ?
La sensation d’avoir vécu une expérience artistique que je ne connaîtrai plus. Le bonheur d’avoir perçu dans l’engouement du public une force fédératrice et le désir, la capacité de faire mieux société ensemble. Grâce au spectacle vivant. N’oublions pas que les premières cités grecques ont bâti simultanément un stade et un théâtre. Sport et scène étaient aussi essentiels à la cité. Que s’est-il passé ? Si le sport, plus que le théâtre, s’est adapté à la marchandisation et au capitalisme, on a mesuré aux JO combien le spectacle pouvait fédérer et unir. « Allez au public ! » recommandait Jean Vilar. Après guerre, les pionniers de la décentralisation culturelle ont tout inventé pour le conquérir. Au fil des ans, beaucoup d’entre nous ont hélas considéré que le travail était fait sans imaginer d’autres formes pour s’adapter à la société nouvelle.
Je n’ai jamais accédé à mes rêves de la manière que je souhaitais. Et du côté des politiques ?
La plupart d’entre eux cherchent à longueur de programmes à définir ce que sont les Français. Or le succès de nos cérémonies a montré que le sentiment d’unité nationale ne renaîtra que si l’on pose d’emblée notre diversité et non une définition restrictive. Voyez la polémique déclenchée par la montée sur le podium de l’athlète voilée marathonienne néerlandaise Sifan Hassan. Sans prendre parti, je trouve bien que son sourire étincelant fasse réfléchir et participe à la circulation des idées. La violence commence quand s’arrête la pensée.
Le « bashing » qui a précédé les Jeux vous a-t-il atteint ?
Les dénigrements, le « bashing » traversés ont été identiques à Londres en 2012. Tant que rien n’est concret, la magie des JO est difficile à imaginer. Même si le CIO avait annoncé que ceux de Paris révolutionneraient le genre : parité chez les athlètes hommes et femmes, mise en parfait miroir des jeux Olympiques et Paralympiques, fin du déroulement classique des cérémonies, si ennuyeux. D’autant que, pour la première fois, elles étaient organisées au cœur de la cité, passé et présent conjugués sur une Seine dépolluée pour l’occasion. Mais l’ambiance était à la crise sociale, politique surtout après les élections européennes et législatives. Peut-être ce contexte nous a-t-il été favorable. Nous avions tous besoin de retrouver une unité malmenée.
À lire aussi : Cérémonie d’ouverture des JO : Thomas Jolly victime de cyberharcèlement, une enquête ouverte Finalement, vous n’aurez jamais pu répéter une cérémonie ?
Non, je les ai découvertes en temps réel face à un mur de cinquante écrans dans la salle de commandement, une sorte de régie d’où sont envoyés les top départ des séquences et prises les décisions urgentes avec Thierry Reboul. Je n’ai même pas entendu les réactions du public. J’aurai mis en scène un spectacle vivant sans le vivre. Ni suivre sa réalisation télévisée qu’on me dit décevante, sur laquelle nous avions pourtant tant répété. Mais pas de regret, quand on prépare une fête, le plus important est que les invités s’amusent, tant pis pour celui qui fait les courses, la cuisine et le ménage après. Bien sûr j’avais vu répéter tous les morceaux, mais dans des ateliers. Tout s’est ensuite monté en kit. Certes on avait « l’animatique », la 3D, qui nous permettait de nous balader visuellement partout pour anticiper la mise en scène, mais ça n’a pas empêché les effets de réel. La pluie a annulé la séquence des breakers, skateurs et BMX comme l’évocation de Louis XIV et de Napoléon.
Vous en avez pleuré de désespoir ?
J’étais hébété. J’ai tout de suite vu que les artistes se surpassaient pour triompher des éléments. La pluie rendait notre travail héroïque. La cantatrice Axelle Saint-Cirel a expliqué qu’elle avait à peine cligné des yeux, une heure durant sur le toit du Grand Palais, pour ne pas faire couler son maquillage. Et tous ces danseurs qui auraient pu glisser. Mais moi, après ces années d’investissement — démission du CDN d’Angers, déménagements à Paris, éloignement de ma famille, de mes amis —, j’ai revu brutalement mon parcours. Avais-je fait les bons choix ?
C’est l’émotion qui a provoqué cette réflexion ?
J’étais à un moment culminant de ma vie artistique et tout m’était contraire. Comme lorsque je candidatais à l’école du Théâtre national de Bretagne et que ma lettre de candidature avait été égarée. Comme lorsque, sorti de cette école, je fus un des rares à n’être engagé nulle part, forcé de créer ma compagnie à Gaillon. Et toujours échouant, même le succès venu, à diriger les institutions dont je rêvais : Théâtre national de Bretagne, Théâtre national populaire de Villeurbanne, Théâtre national de Strasbourg, Odéon. Je n’ai jamais accédé à mes rêves de la manière que je souhaitais. Je voulais jouer avec le monde, et le monde se jouait de moi. Où trouver ma place ? J’apparais fugitivement en Quasimodo lors de la cérémonie d’ouverture sur les toits de Notre Dame… Rétrospectivement, je remercie la pluie. Non seulement elle nous a reliés dans la difficulté, mais à moi qui veux toujours tout maîtriser, l’existence a rappelé que c’était elle qui décidait. Tant mieux. J’adore être un funambule entre les risques, les aléas. Je fais du théâtre pour travailler au présent, avec le vivant.
Aviez-vous imaginé que certaines séquences provoqueraient de tels scandales ?
Pas du tout. D’abord, il ne s’agissait pas de Marie-Antoinette, mais d’aristocrates emprisonnées qui vivaient la Révolution française depuis la Conciergerie. Qu’on ait pu penser à une apologie du terrorisme qui a coûté la vie à Samuel Paty m’a consterné. Je voulais juste théâtraliser la Révolution à l’extrême, comme on le faisait au début du XIXe siècle sur le « boulevard du crime », à Paris. En plus, à ce moment-là, sur la façade de la Conciergerie se déchaînait aussi le groupe de death metal Gojira, tandis que Marina Viotti passait sur le bateau symbolisant Paris et sa devise Fluctuat nec mergitur (« Il est battu par les flots mais ne sombre pas ») tout en chantant Carmen et la liberté de l’amour. L’idée était de mélanger les formes, les genres pour témoigner d’un gigantesque bouleversement, d’un peuple acquérant ses droits dans la violence.
À lire aussi : Une cérémonie généreuse et insolente, le pari follement réussi de Thomas Jolly Certains ont aussi cru voir une caricature de La Cène de Léonard de Vinci avec des drag-queens.
Loin de moi d’y avoir pensé. Je voulais figurer les dieux de l’Olympe, mais un zoom de caméra malencontreux a fixé la scène en banquet alors qu’il s’agissait juste d’un catwalk de défilé de mode. Et qui dit banquet, en France, fait immédiatement référence à la Cène. Quant aux drag-queens, le cabaret, le transformisme font totalement partie de notre culture ! Je ne suis pas un provocateur, je ne l’ai jamais été : je cherche trop à n’exclure quiconque. En plus, comment aurais-je pu faire la satire des chrétiens tout en faisant retentir Notre-Dame ? Ce serait incohérent. On ne peut jamais anticiper la réception des images. Alors que Jeanne d’Arc et la déesse gauloise Sequana confondues étaient censées chevaucher la Seine et porter le drapeau sur ce magnifique cheval d’acier, certains ont vu un cavalier de l’Apocalypse.
Vous avez été victime de centaines de menaces homophobes, antisémites sur les réseaux sociaux…
Nous sommes plusieurs à en avoir reçu dans l’équipe. Mais je ne veux plus en parler, les messages de remerciements furent plus nombreux. Pourtant j’ai porté plainte. Pour l’exemple. La République doit protéger tous ses enfants et personne ne doit tolérer d’être harcelé par les ouvriers du chaos. Traité de pédale quand j’ignorais même ce que cela signifiait, je l’ai trop été durant toute ma petite enfance.
Quelles qualités faut-il pour être directeur artistique ?
De l’obstination, du flair pour recruter sa garde rapprochée et ses équipes, de la combativité.
Avez-vous subi des pressions du président de la République, de la maire de Paris ou des grands sponsors ?
Aucune. Je ne dépendais de toute façon que du CIO.
L’art peut créer de l’unité dans la diversité. Mais une fois cela posé, que fait-on maintenant ? Emmanuel Macron avait évoqué Aya Nakamura.
C’était mon choix premier, et elle chante Aznavour — et non pas Piaf comme il le souhaitait. J’admire depuis toujours son travail sur la langue française. Pour moi, elle va chercher ses mots dans les profondeurs de l’imaginaire et allie à son dialecte malien à la fois Pierre Guyotat et Valère Novarina. Voilà pourquoi je voulais la faire sortir de l’Institut de France et rencontrer la Garde républicaine, autre symbole de notre pays. J’ai adoré cette séquence.
Finalement, que vous restera-t-il des JO ?
Un grand apaisement. Le spectacle a permis aux gens de se sentir vivants et ils ont trouvé ça beau de se sentir vivants ensemble, en même temps. Preuve que la culture peut faire nation en donnant sa place à chacun. Ce constat est merveilleux pour nous les artistes. L’art peut créer de l’unité dans la diversité. Mais une fois cela posé, que fait-on maintenant ?
Et vous, que faites-vous ?
Rachida Dati comme Anne Hidalgo m’ont fait de magnifiques propositions que je ne vous dirai pas. Moi, j’ai aussi fait une contre-proposition. Et peut-être vais-je me lancer dans un livre. J’ai besoin de partir en vacances et de digérer l’héritage immatériel des JO. Le succès comme la lumière sont souvent difficiles à vivre. Même si, depuis longtemps, j’ai appris à m’en passer.
On garde la vasque sur les Tuileries ?
Non ! La beauté du spectacle vivant, c’est l’éphémère. Lui seul permet d’entrer dans la légende, d’être sacralisé. À l’image de tous ces spectateurs qui se taisaient quand s’élevait dans le ciel la vasque olympique. Pareil silence ne se reproduira plus si ce moment devient quotidien. Je sais maintenant que la pluie a rendu la cérémonie bien plus belle.
Propos recueillis par Fabienne Pascaud / Télérama Thomas Jolly en quelques dates
1982 Naissance à Rouen.
2006 Crée La Compagnie Piccola Familia.
2014 Henri VI, de Shakespeare.
2018 Thyeste, de Sénèque, à Avignon.
2020-2022 Dirige le Centre dramatique national d’Angers.
2022 Directeur artistique des cérémonies des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon, à La Seine musicale.
2023 Roméo et Juliette, de Charles Gounod, à l’Opéra Bastille.
Légende photo : Thomas Jolly dans le jardin des Tuileries (domaine du musée du Louvre, à Paris), auprès de « Thésée combattant le Minotaure », de Jules Ramey. Photo Jean-François Robert pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 6, 2024 6:39 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 6 septembre 2024 Dans un décor aux airs de laboratoire, Roland Auzet met en scène l’histoire fictive d’un faiseur de tsar du XXIᵉ siècle qui nous entraîne dans les arcanes du fascisme. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/06/le-mage-du-kremlin-une-plongee-glacante-au-c-ur-du-pouvoir-russe_6305788_3246.html
La Russie n’est pas un pays où il fait bon vivre, ainsi que le suggère la mise en scène glacée du Mage du Kremlin par Roland Auzet. Librement adapté du roman de Giuliano da Empoli (Gallimard), dont la sortie, en avril 2022, avait été saluée par le Grand Prix du roman de l’Académie française, ce spectacle ouvre par une note de franche gravité la saison de la Scala Paris. Presque deux heures d’une représentation qui se veut sérieuse sur l’état politique délétère de la Russie contemporaine. L’analyse du régime poutinien, sa dimension fasciste, ses épigones dispersés un peu partout dans le monde : le projet n’incite pas à la légèreté, alors que bien des autocrates se tiennent en embuscade de part et d’autre de l’Europe. On sourit d’autant moins que la mise en scène use et abuse d’artifices vidéastes et sonores pour amplifier la portée dramatique du propos. Le spectacle s’inscrit dans un dispositif impressionnant de froides vidéos, de lumières aveuglantes ou de projections stroboscopiques agressives. Une scénographie dont la force de frappe visuelle prend avec autorité le public en otage. L’image ne se fait pas discrète, alors même que les mots dits par les comédiens se dérobent à la compréhension. Or des mots, il y en a beaucoup qui déferlent en français, voire s’éructent en russe (pas toujours traduit), sur le plateau de la Scala. Des torrents de phrases qui ne parviennent pas à s’émanciper de leur matrice littéraire. Enigme insondable Le style de Giuliano da Empoli, qui flambe à l’écrit, alourdit à l’oral la profération des acteurs. Pourtant équipés de micros HF, et dirigés sur scène comme s’ils jouaient un épisode de série télé, ils doivent braver de tortueuses logorrhées et courent derrière les points finaux en quête d’oxygène. Pour certains, cette traversée relève d’un infernal marathon. Ce qui n’aide pas à saisir la portée des discours théoriques énoncés sur la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Mais il serait injuste d’imputer aux seuls interprètes les difficultés d’approche que pose le texte. Le problème est plus vaste. Sommes-nous, en effet, capables d’appréhender en deux heures la nature profonde d’un pays dont l’histoire passée ou actuelle nous est étrangère ? Tsarisme, communisme, URSS, perestroïka et pour finir Vladimir Poutine : qu’il évolue en démocratie ou subisse la dictature, le peuple russe tient, mais, courbé ou debout, il ne se laisse pas facilement décrypter. L’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch a eu beau livrer un portrait édifiant de la Russie post-soviétique dans son livre La Fin de l’homme rouge (Actes Sud, 2013), sa réalité reste une énigme insondable. C’est cette énigme que soulève le roman de Giulano da Empoli et que relaie, au risque de s’y engloutir, le spectacle. Voici donc l’histoire fictive d’un faiseur de tsar du XXIe siècle. Il s’appelle Vadim Baranov. L’homme n’a pas existé. Le romancier lui a inventé une biographie, des convictions et des reniements. Mais il aurait pu être l’un de ces oligarques qui, en 2000, une fois actée la chute de Boris Eltsine, ont propulsé Poutine du KGB au Kremlin, l’ont installé à la présidence, l’ont fabriqué à leur idée avant de comprendre que leur créature s’était émancipée et qu’ils avaient perdu le contrôle pour de bon. Strates cadenassées du pouvoir Découpé en trois périodes, le temps présent encadrant un flash-back vers les années 2000, le spectacle convoque les souvenirs de Vadim Baranov, qu’incarne, avec un sens aigu du tragique, le comédien Philippe Girard. Sur un parquet d’un noir luisant où s’exhibe, entre canapés chics, tables basses et piano demi-queue, le salon feutré des élites, la foule des protagonistes surgit. Journalistes, horde de motards à la solde du chef (les Loups de la nuit), écrivain (Edouard Limonov), chef de la milice Wagner (Evgueni Prigojine), ou encore milliardaire affairiste (Boris Berezovsky, à qui l’acteur Hervé Pierre prête sa bonhomie en trompe-l’œil). Tous ont été (ou sont encore) complices du régime. Certains (dont Berezovsky) ont basculé dans l’opposition. Et sont morts. Suicide, assassinat, maladie, on ne sait pas. Le Mage du Kremlin entraîne ainsi le lecteur dans les strates cadenassées d’un pouvoir dont Poutine seul détient les clés, tandis qu’autour de lui ses sbires sèment le chaos en Ukraine ou ailleurs. On comprend l’envie de Roland Auzet d’en découdre au théâtre avec de telles figures et, au-delà, de donner corps aux processus du fascisme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le décor aseptisé a des airs de laboratoire où les âmes seraient disséquées. Pas un hasard non plus si les acteurs prennent lourdement le public à partie en le scrutant dans le blanc des yeux pour faire passer le message : plus personne n’est à l’abri du danger (on s’en doutait un peu). Mais cette mise en scène se heurte surtout à une sorte d’aporie. Comment glisser de l’humain dans un contexte où cet humain n’est qu’une variable d’ajustement ? Comment créer, sur scène, le sentiment de la vie, quand le sujet même du propos est la négation de l’individu ? Ce paradoxe-là n’est pas résolu. Le Mage du Kremlin. D’après le roman de Giuliano da Empoli (Gallimard, 2022). Adaptation et mise en scène : Roland Auzet. Avec Karina Beuthe Orr, Philippe Girard, Andranic Manet, Hervé Pierre, Irène Ranson Terestchenko, Stanislas Roquette, Claire Sermonne, et, à l’écran, Jean Alibert et Anouchka Robert. La Scala Paris. Jusqu’au 3 novembre. https://lascala-paris.fr/programmation/le-mage-du-kremlin/ Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Boris Berezovsky (Hervé Pierre, à gauche) et Vadim Baranov (Philippe Girard) dans « Le Mage du Kremlin », d’après le roman de Giuliano da Empoli, adapté et mis en scène par Roland Auzet, à la Scala Paris, le 14 août 2024. © THOMAS O’BRIEN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 4, 2024 12:00 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez, Fabienne Pascaud, Kilian Orain dans Télérama - paru le 3 septembre 2024 Reprise d’une pièce d’Eschyle, de Marguerite Duras ou bien l’adaptation du premier roman de Panayotis Pascot, la rentrée théâtrale s’annonce prometteuse. Notre sélection à Paris et dans toute la France.
SEPTEMBRE “Les Sœurs Hilton”, mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort Elles ont réellement existé, les deux sœurs Hilton de la prochaine fantasmagorie circassienne des Hecq-Lesort. Elles ont été exhibées dans les foires, et jusqu’à Broadway, les héroïnes siamoises (1908-1969) du couple désormais irrésistible du spectacle vivant. Qu’ils émerveillent dans Vingt Mille Lieues sous les mers (2015), fassent frissonner et rire dans La Mouche d’après David Cronenberg (2020), La Petite Boutique des horreurs d’Alan Menken (2022) ou Le Bourgeois gentilhomme (2021), Christian Hecq, 60 ans, sociétaire surdoué de la Comédie-Française, et son inventive épouse plasticienne-comédienne et metteuse en scène Valérie Lesort, 49 ans, réussissent à tous les coups de magiques divertissements. C’est qu’ils haïssent l’ennui. Et aux personnages normaux, préfèrent les handicapés de la vie. « Pas d’humour sans horreur, susurre Christian Hecq. Les monstres fascinent, effraient, font rire puis culpabiliser d’avoir ri. Quelle mine de sentiments ! » À lire aussi : Christian Hecq et Valérie Lesort : “Nous sommes devenus une sorte de monstre à deux têtes” Entre music-hall et cabaret, seront ainsi célébrées les deux sœurs abandonnées à la naissance par une mère célibataire qui voyait une punition divine dans leur difformité. Plus maligne, sa patronne Mary Hilton (qu’interprète Christian Hecq) réalise la fortune à tirer des deux ravissants bébés, vite ravissantes jeunes filles. Elle les adopte, leur fait apprendre chant et danse : de quoi triompher dans les tournées de cirque de par le monde. Sans toucher un sou. Si Tod Browning les immortalise dans Freaks (1932), le cinéma parlant aura raison de leur gloire. Strip-teaseuses puis caissières d’épicerie, Daisy et Violet meurent dans la misère. « Finalement la troupe de cirque leur offrait une existence sociale, une famille, à l’heure où l’on enfermait les gens différents. J’ai voulu lui rendre hommage. Et à notre troupe aussi, fondée en 2016 avec Christian, et où abondent les artisans de génie capables de créer l’illusion : Les Sœurs Hilton est sa première production. » Il faudra en effet de la virtuosité à la costumière et scénographe Vanessa Sannino pour les quatorze changements de costumes des sœurettes, attachées du début à la fin d’un spectacle burlesco-tragique, où devraient se conjuguer épouvante, rire et tendresse. Défenseurs de la différence, Hecq et Lesort sont eux-mêmes très différents. Ils ne visent qu’à susciter la joie dans des spectacles qui parlent à tous. – F.P. --------------------------------------------------------------------------- “Portrait de famille, une histoire des Atrides”, mis en scène par Jean-François Sivadier Le metteur en scène a choisi quatorze comédiens issus de la promotion 2023 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. En seront pour leur frais les pisse-vinaigre qui imaginaient colossalement ennuyeuse et sinistre l’antique saga des Atrides. L’atroce et mythique famille grecque — déjà portraiturée par Eschyle, Sophocle, Euripide, Sénèque et jusqu’à Racine — n’a jamais lésiné en effet sur le cannibalisme, les fratricide, viol, inceste, infanticide, sacrifice humain, matricide, violences conjugales en tout genre. De quoi transformer en foudroyante matière à théâtre ces tourments insensés. Adapté et mis en scène dans de baroques décors de bric et de broc par Jean-François Sivadier — avec quatorze éblouissants jeunes comédiens de la promotion 2023 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique —, le spectacle brosse avec une fantaisie délirante des destins hors norme, aux fondements de notre culture occidentale. De la guerre de Troie à la naissance de la démocratie, en passant par moult épisodes rougeoyants de sang et transgressions variées, la bande conduite par Sivadier, maître d’un théâtre d’émotions exigeant et accessible à tous, nous entraîne dans de joyeuses terreurs, d’oniriques affrontements entre privé et politique, hommes et dieux. – F.P. Portrait de famille, une histoire des Atrides, d’après Eschyle, du 18 au 29 septembre, au Théâtre de la Commune, Aubervilliers (93) ; les 4 et 5 octobre à Sainte-Maxime (83) ; les 13 et 14 novembre à La Rochelle (17) ; les 7 et 8 février 2025 à Poitiers (86) ; les 12 et 13 février à Antony (92) ; les 19 et 21 mars à Béthune (62) ; du 19 au 29 juin au Rond-Point, Paris 8ᵉ. ------------------------------------------------------------------------- “Who’s Afraid of Representation ?”, mis en scène par Rabih Mroué et Lina Majdalanie En 2007, le couple d’auteurs-acteurs libanais Rabih Mroué et Lina Majdalanie était invité pour la première fois au Festival d’automne, à Paris, avec ce spectacle qu’ils reprennent aujourd’hui tel un manifeste. Dans leur théâtre, les guerres libanaises, pendant lesquelles ils ont grandi, font toujours irruption. Aussi confrontent-ils ici le récit d’une tuerie perpétrée au Liban dans les années 1970 au mouvement du body art, dans lequel, à la même période, des artistes placent le corps au centre de leurs performances, quitte à le mettre en danger. À la limite de l’acrobatie, cet art de l’équilibre participe de leur façon de fabriquer du théâtre, entre ironie et tendresse, tout en mettant les pieds dans le plat. – E.B. ---------------------------------------------------- “La serva amorosa”, mis en scène par Catherine Hiegel Catherine Hiegel a joué en 1992 le rôle qu’Isabelle Carré s’apprête à jouer sous sa direction. 1992. Alors sociétaire de la Comédie-Française, Catherine Hiegel est une Serva amorosa stupéfiante. On connaissait peu jusqu’alors cette comédie de l’Italien Carlo Goldoni (1707-1793) que Jacques Lassalle monte avec noirceur. La servante Coraline y est totalement dévouée à un jeune maître que son père, manipulé par une seconde épouse, s’emploie à déshériter. Éprise du fils en secret, Coraline s’acharne à le rétablir dans ses droits et… à rendre possible l’amour de ce dernier pour sa maîtresse. La tragique générosité d’un de ces personnages du peuple, que le réaliste Goldoni fut un des premiers à mettre en scène, se révèle sublime. Comment Catherine Hiegel dirigera-t-elle Isabelle Carré dans son rôle d’autrefois ? Tout est possible et la pièce, magnifique. – F.P. ---------------------------------------------------- “Grand-peur et misère du IIIe Reich”, mis en scène par Julie Duclos Le titre de cette pièce, écrite entre 1935 et 1938, ne suscite rien d’amusant. Et pour cause : Bertolt Brecht y dévoile la mécanique fasciste à l’œuvre dans la société allemande. L’auteur allemand explore la manière dont l’idéologie mortifère s’immisce dans le quotidien, la parole, la chair, jusqu’à modifier considérablement les rapports entre les personnes. Mis en scène par Julie Duclos, ce spectacle à la scénographie épurée fera la part belle aux acteurs et devrait fortement entrer en résonance avec notre actualité. – K.O. Grand-peur et misère du IIIe Reich, de Bertolt Brecht, du 24 septembre au 3 octobre, Théâtre national de Bretagne, Rennes (35) ; les 9 et 10 octobre, Quimper (29) ; les 16 et 17 octobre, Grenoble (38) ; les 4 et 5 décembre, Lorient (56) ; du 10 au 12 décembre, Saint-Étienne (42) ; du 18 au 20 déc., Reims (51) ; du 11 janv. au 7 février, Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris 6ᵉ… ---------------------------------------------------- “La Symphonie tombée du ciel”, mis en scène par Samuel Achache L’acteur-auteur-musicien et metteur en scène Samuel Achache nous avait déjà réjouis avec Sans tambour… Il a fini par monter son orchestre, ironiquement baptisé La Sourde. Avec Ève Risser, Florent Hubert et Antonin-Tri Hoang, ses trois talentueux complices, à la fois compositeurs et improvisateurs, il poursuit l’idée d’une dramaturgie nourrie par la musique. Et, pour exprimer les rêves ou les expériences sensibles, s’appuie cette fois sur des témoins rencontrés dans des maisons de retraite, des prisons ou des lieux du quotidien. Une façon d’unir toutes les « voix » dans un grand élan consolateur, puisque tel est le pouvoir de la musique. – E.B. -------------------------------------------------------------------- “Sur tes traces”, de et par Gurshad Shaheman et Dany Boudreault Les deux récits sont dits simultanément sur scène, aux spectateurs de naviguer entre les deux. Ils sont partis durant un mois sur les traces l’un de l’autre, et en ont tiré deux fascinants monologues. Au moyen de casques distribués à l’entrée, les spectateurs pourront librement naviguer entre les deux récits, dits simultanément sur scène. Le Franco-Iranien Gurshad Shaheman, 46 ans, et le Canadien Dany Boudreault, 41 ans, se dévoilent sous un jour peu commun. Et soulèvent une question aussi vertigineuse que passionnante : peut-on réellement connaître quelqu’un ? Pour tenter d’y répondre, les deux artistes ont rencontré, chacun de leur côté, parents, amis ou ex-compagnons à travers le monde, récoltant autant de fragments qu’une identité peut en compter. En résulte une expérience émouvante, et forcément unique. Chapeau ! – K.O. ---------------------------------------------------- “Le Mage du Kremlin”, mis en scène par Roland Auzet Le protagoniste de la pièce est un homme de l’ombre de Poutine. Dès sa parution en 2022, l’ouvrage de Giuliano da Empoli Le Mage du Kremlin a affolé les libraires — et s’est vendu, en France, à plus de cinq cent mille exemplaires. Le voici transposé au théâtre, sous la direction de Roland Auzet avec l’assentiment de l’écrivain italo-suisse. On retrouvera sur scène Philippe Girard dans le rôle de Vadim Baranov (cet homme de l’ombre de Poutine, personnage fictif et principal de l’ouvrage), ainsi qu’Hervé Pierre, ancien sociétaire de la Comédie-Française, qui jouera l’homme d’affaires Boris Berezovsky, artisan de l’arrivée de Poutine au Kremlin. Autour d’eux, Karina Beuthe Orr, Andranic Manet, Stanislas Roquette, Claire Sermonne et Irène Ranson Terestchenko incarneront l’incroyable galerie de visages qui composent le roman. L’idée de voir ces fascinants personnages prendre chair au théâtre nous égaye fortement. – K.O. ---------------------------------------------------- “L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt”, de et par Géraldine Martineau On en rêvait depuis des lustres : voir traduit à la scène le destin extravagant de sa plus fabuleuse championne, Sarah Bernhardt (1843-1923). L’actrice et metteuse en scène Géraldine Martineau s’y est collée, choisissant pour incarner la comédienne qui a tout réinventé la très étonnante Estelle Meyer dans un spectacle où dix artistes joueront trente-cinq personnages. Brièvement prostituée, plus longuement actrice sans talent, Sarah a forgé son art par un travail acharné, un sens de la communication hors pair, une ambition vorace qui lui a fait prendre jusqu’à la fin tous les risques. Elle n’avait peur ni de se travestir pour incarner les héros du répertoire, ni de défendre le capitaine Dreyfus, ni de lancer de jeunes auteurs tel Rostand, ni de diriger des théâtres, ni de multiplier les amants ou de se lancer dans d’interminables tournées pour gagner de l’argent. Un génial phénomène que portait l’amour fou de la scène… – F.P. L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt, Jusqu’au 31 décembre, Théâtre du Palais-Royal, Paris 1er, en alternance avec la pièce Edmond, à partir du 6 octobre. ---------------------------------------------------- À lire aussi : Festival d’Avignon : où voir les pièces du IN à la rentrée 2024 et en 2025 OCTOBRE “L’Amante anglaise”, mis en scène par Jacques Osinski Sandrine Bonnaire, tête d’affiche de la pièce. Dans la petite ville fictive de Viorne, les morceaux d’un cadavre se retrouvent dispersés à bord de trains passant sous le viaduc d’où ils ont été jetés. Comment ? Pourquoi ? Voilà un mystérieux thriller psychologique façonné par Marguerite Duras. La romancière, disparue il y a vingt-huit ans, s’est inspirée d’un fait divers, en a tiré une première pièce de théâtre, Les Viaducs de la Seine-et-Oise (1960). Elle réitéra sept ans plus tard avec cette sordide histoire, publiant L’Amante anglaise, roman qu’elle adapta l’année suivante au théâtre. Jacques Osinski s’en empare aujourd’hui. Le metteur en scène, qui avait fait sensation la saison dernière avec la reprise de Fin de partie, a choisi pour tête d’affiche la comédienne Sandrine Bonnaire. Elle sera accompagnée sur scène par Frédéric Leidgens et Grégoire Oestermann. Le trio devrait donner souffle et relief à la langue durasienne. – K.O. ---------------------------------------------------- “Le Suicidé”, mis en scène Stéphane Varupenne Cette pièce géniale du dramaturge russe Nicolaï Erdman (1900-1970), écrite en 1928, n’a pas eu la chance d’être mise en scène par son ami Vsevolod Meyerhold, contrairement à son autre farce tendue par la même ironie absurde, brillante et libre, Le Mandat, trois ans plus tôt — la violence des purges staliniennes s’étant vite abattue sur la société soviétique. On y voit un pauvre chômeur (interprété par Jérémy Lopez) courtisé par toutes les strates de la société, qui veulent en faire leur « héraut » depuis que court le bruit de son envie de suicide. Ce pauvre « héros »-là n’en demandait pas tant… Stéphane Varupenne, sociétaire de la Comédie-Française qui avait endossé avec succès le rôle de Gainsbourg dans Les Serge (repris cette saison, tant mieux !) réalise ici sa première mise en scène d’envergure. – E.B. Le Suicidé, de Nicolaï Erdman, du 11 octobre au 2 février, Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1ᵉʳ. ---------------------------------------------------- “Dolorosa, Trois anniversaires ratés”, mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo C’est la première création que signe l’artiste argentin Marcial Di Fonzo Bo au Centre dramatique national d’Angers, qu’il dirige depuis septembre 2023. Nul doute que cet acteur à la puissance mystérieuse, metteur en scène audacieux — Copi, Genet, Loren, Minyana, Crimp ou Lorèn —, y impose son univers à l’ironie acidulée et à la noire mélancolie. Il aime les écritures contemporaines. Aux Trois Sœurs, d’Anton Tchekhov, il a préféré la variation très actualisée qu’en a tirée l’Allemande Rebekka Kricheldorf, 50 ans. Sous leurs patronymes allemands, le mal-être d’Olga, Macha, Irina, leur inadéquation au présent, n’en résonnent que plus fort. Bourgeoises sans but, elles errent à la villa Dolorosa et dans la société de leur temps. Mais du pire, Marcial du Fonzo sait l’art de faire rire… – F.P. Dolorosa, Trois anniversaires ratés, de Rebekka Kricheldorf, du 1ᵉʳ au 4 octobre, Le Quai-CDN d’Angers (49), reprise du 25 au 28 fév. 2025 ; du 6 au 8 nov. à Bordeaux ; du 5 au 15 mars au Rond-Point, Paris 8ᵉ ; du 19 au 27 mars à Rennes (35) ---------------------------------------------------- “Contre”, mis en scène par Constance Meyer et Sébastien Pouderoux Quand le théâtre s’inspire du cinéma pour mieux s’interroger sur l’art… Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie-Française, et Constance Meyer, réalisatrice, projettent leurs propres intuitions, sensations, réflexions, sur le couple le plus créatif du cinéma américain des années 1960-1970 : la sublime comédienne Gena Rowlands et John Cassavetes, son talentueux réalisateur de mari, qui tournèrent ensemble une dizaine de longs métrages dont Une femme sous influence (1974). Le film et son tournage servent d’argument à ce spectacle, où les déboires d’une femme au foyer en quête d’émancipation et le combat d’un couple défendant mordicus son indépendance face à l’industrie hollywoodienne se répondront en miroir. À l’affiche, Sébastien Pouderoux lui-même, Marina Hands, Nicolas Chupin ou Dominique Blanc… Alléchant ! – E.B. “Contre”, du 25 septembre au 3 novembre, Comédie-Française, salle du Vieux-Colombier, Paris 6ᵉ. ---------------------------------------------------- “Le Spleen de l’ange”, mis en scène par Johanny Bert Vers quel monde va nous entraîner Johanny Bert, avec cette création pour « anges, humains et marionnettes » ? Si son adaptation récente de La Ronde, de Schnitzler, était délicieusement provocatrice, ce nouveau spectacle s’annonce, lui, très onirique. Seul en scène, il sera à la fois comédien-chanteur et manipulateur de marionnettes, ces petits êtres qu’il connaît comme personne jusqu’à les rendre si étrangement familiers. Johanny Bert dit s’être inspiré – de loin – du film de Wim Wenders Les Ailes du désir (1987) pour raconter l’histoire d’un ange qui, lassé de l’immortalité, voudrait bien devenir « humain ». Pour l’aider à s’incarner, violon, violoncelle et vibraphone vont résonner sur scène et y prendre, eux aussi, leur place. Prometteur. – E.B. À lire aussi : Théâtre et danse : nos coups de cœur des grandes salles parisiennes pour la saison 2024-2025 NOVEMBRE “La Mouette”, mis en scène par Stéphane Braunschweig Stéphane Braunschweig a monté pour la première fois cette pièce en 2001. Alors tout jeune directeur du Théâtre national de Strasbourg, en 2001, Stéphane Braunschweig avait monté La Mouette. Vingt-trois ans plus tard, le désormais ex-directeur de l’Odéon, 60 ans, remonte ce classique d’Anton Tchekhov (1860-1904). L’auteur russe lui plaît. En 2020, il avait mis en scène Oncle Vania dans un geste centré sur l’environnement, prenant pour appui l’inquiétude écologique du personnage du Dr Astrov. Même philosophie ici. Cette nouvelle proposition réunira, autour d’un lac asséché, Sharif Andoura, Jean-Philippe Vidal, Boutaïna El Fekkak ou encore Jules Sagot, qui jouera l’écrivain Treplev. Stéphane Braunschweig n’a pas l’habitude de remonter des pièces qu’il a déjà portées sur scène. Mais en relisant La Mouette, la petite pièce écrite par Treplev, dans l’acte I, a retenu son attention. Esquissant un monde allant vers sa destruction, elle fait pleinement écho aux enjeux de notre temps. Voilà une porte d’entrée toute trouvée pour le metteur en scène, qui va s’employer à intégrer l’immense pièce de Tchekhov dans celle, brève, de son personnage. Périlleuse inversion dramaturgique… Gageons que cette nouvelle Mouette à la sauce Braunschweig saura déployer tout en grandeur l’envergure du génie de l’auteur russe. – K.O. ---------------------------------------------------- “Pessoa – Since I’ve Been Me”, mis en scène par Bob Wilson Robert Wilson fait évoluer sept personnages dans un cabaret étrange. Un spectacle testamentaire, tant il synthétise, autour de Fernando Pessoa (1888-1935), le génie de Robert Wilson, 82 ans ? La mélancolique poésie de l’écrivain aux soixante-douze hétéronymes colle à son art ultra stylisé. « Mes pensées sont toutes des sensations. Je pense avec les yeux et avec les oreilles et avec les mains et avec les pieds », déclare ici un personnage au visage blanc. Bob Wilson n’a cessé lui aussi de créer des spectacles qui mettent les sens en éveil, où l’espace naît des lumières, et la perception du temps, d’un jeu sculptural et purement sonore de comédiens aux voix amplifiées, lentes ou accélérées. Dans cet étrange cabaret, sept personnages chantent, dansent, brassent les langues dans de joyeux vertiges. « Rien n’est savoir ! Tout est fiction ! Vis entouré de roses, aime, bois. Et tais-toi. Le reste n’est rien », répète Pessoa. – F.P. ---------------------------------------------------- “Les Fausses Confidences”, mis en scène par Alain Françon C’est la troisième fois qu’Alain Françon s’empare d’une pièce de Marivaux. Il a monté les contemporains comme les classiques, la tragédie comme le vaudeville. Alain Françon, 79 ans, est un de nos maîtres de théâtre, capable de faire entendre le verbe et ses résonances dans le corps, dans l’âme et dans l’inconscient. C’est un bonheur d’entendre un texte qu’il met en scène, d’en saisir des sens et échos insoupçonnés. Il s’attaque pour la troisième fois aux duplicités sentimentales, aux douloureux arrangements amoureux et sociaux de Marivaux. Avec une troupe comme toujours exceptionnelle : Dominique Valadié, Georgia Scalliet, Pierre-François Garel, Gilles Privat entre autres… À travers l’histoire d’une riche veuve bourgeoise, Araminte, que tous convoitent — toujours des histoires d’argent chez Marivaux ! — il saura nous faire sourire des cruautés du désir et des malheurs du bonheur. – F.P. ---------------------------------------------------- “Une trilogie new-yorkaise”, mis en scène par Igor Mendjisky Paul Auster vient de disparaître, et l’audacieux metteur en scène Igor Mendjisky, habitué des sagas généalogiques (la vie de son père lui avait inspiré un spectacle plein de charme) et des jeux de miroirs entre réalité et illusion (il a monté Le Maître et Marguerite, de Boulgakov), plonge avec gourmandise dans la Trilogie new-yorkaise du grand écrivain américain. Pour donner corps à l’univers des trois romans parus entre 1985 et 1987, il fera aussi l’acteur, épaulé et entouré par son équipe habituelle de complices (Ophélia Kolb, Gabriel Dufay, Thibault Perrenoud…) où s’est aussi glissé Pascal Greggory. Un pari que cette enquête monstre, en forme d’introspection aussi sombre que métaphysique, mise en scène en moins de trois heures ! – E.B. ---------------------------------------------------- “La prochaine fois que tu mordras la poussière”, de Panayotis Pascot Le phénomène littéraire La prochaine fois que tu mordras la poussière, avec plus de deux cent mille exemplaires vendus, débarque au théâtre. À sa sortie en août 2023, l’humoriste Panayotis Pascot, 26 ans, y dévoilait publiquement son homosexualité, analysait sa relation aux hommes, et à son père en particulier, ainsi que son douloureux cheminement après une interminable dépression. C’est à son frère Paul auteur-metteur en scène et comédien, que le jeune homme a confié cette adaptation. Sur scène, il sera incarné par Vassili Schneider, tandis que Yann Pradal jouera son père. Populaire, notamment parmi les jeunes et la communauté gay, le livre avait su créer l’émotion. On lui présage donc un beau succès au théâtre. – K.O. ---------------------------------------------------- “Marius”, mis en scène par Joël Pommerat Ressusciter un mélo de Pagnol dans le Marseille de 2024 : c’est le défi réussi de Joël Pommerat, inspiré créateur de Cendrillon, Ça ira (1) Fin de Louis ou Contes et légendes. Les détenus de la maison d’arrêt d’Arles, avec lesquels il a commencé le projet, trouvaient pourtant démodés la pièce comme le film. Mais il les a convaincus, dès 2017, des enjeux de Marius : la filiation, l’engagement, l’amour, la fuite, la réussite. Dans la version reprise au Festival d’automne, comédiens professionnels et ex-détenus incarnent à merveille l’histoire de ce Marius si attiré par l’ailleurs qu’il quitte lâchement père et fiancée (César et Fanny). Jean Ruimi est un César d’une puissance impressionnante. Tous redonnent une violence, une émotion frémissante à la tragédie du Vieux-Port. Tous jouent comme s’il était question de vie et de mort. Le théâtre redevient brûlant. – F.P. Marius, de Marcel Pagnol, mise en scène Joël Pommerat, du 29 novembre au 8 décembre, MC 93, Bobigny (93) ; 12 au 14 déc., Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; 18 au 19 déc., Noisiel (77) ; 8 au 12 janv., Marseille (13) ; 29 au 31 janv., Limoges (87) ; du 4 au 5 mars, Alès (30)… ---------------------------------------------------- “Les Forces vives”, de et par Camille Dagen Camille Dagen a créé sa pièce au Théâtre du Maillon, à Strasbourg, en mars dernier. C’est l’une des plus brillantes femmes de lettres de notre histoire. L’écrivaine Simone de Beauvoir a légué quantité d’ouvrages — Le Deuxième Sexe, Cahiers de jeunesse, Mémoires d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge ou encore La Force des choses. Et c’est grâce à cette matière littéraire que Camille Dagen et Emma Depoid plongent dans les Mémoires de cette pionnière et tentent d’en restituer le destin. En trois heures et trente minutes avec entracte, cette foisonnante traversée, vivifiante expérience scénique créée en mars dernier au Théâtre du Maillon, à Strasbourg, devrait rappeler l’extraordinaire écrivaine et penseuse du féminisme qu’était Beauvoir. – K.O.
Par Emmanuelle Bouchez, Fabienne Pascaud, Kilian Orain dans Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 3, 2024 11:27 AM
|
Par Catherine Robert dans La Terrasse - 28 août 2024 Dans une nouvelle distribution, Pauline Bayle reprend son adaptation de la deuxième partie d’Illusions perdues, qu’elle dirige avec une maestria époustouflante. Un chef-d’œuvre, à voir absolument ! En octobre 1917, Proust disait, dans une lettre à René Boylesve, son « admiration infinie » pour Illusions perdues. Un siècle plus tard, Pauline Bayle signe une version théâtrale de ce roman qui provoque le même enthousiasme ! Après avoir déjà très largement prouvé son intelligence de l’adaptation et sa maîtrise de la mise en scène en portant la geste homérique au plateau, Pauline Bayle a récidivé avec le récit de l’ascension, du triomphe et des déboires de Lucien de Rubempré. Elle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce qui réussit à lier une insolente audace artistique à une accessibilité totale. L’excellence à la portée de tous : peu d’artistes méritent une telle estampille ! Sur le plateau nu, il suffit de quelques chaises pour faire surgir la conférence de rédaction de Finot, et d’une petite estrade pour faire renaître la scène du Panorama-Dramatique où Coralie séduit Lucien. Le meilleur de Balzac, et plus encore ! Le théâtre, « trône de l’illusion », disait Balzac : rarement plus brillants princes l’ont occupé que les cinq complices de cette exploration des heurs et malheurs d’un poète de province monté à Paris pour y conquérir la gloire et se brûler les ailes… « Balzac, grand, terrible, complexe aussi, figure le monstre d’une civilisation et toutes ses luttes, ses ambitions et ses fureurs. » disait Baudelaire. L’ascension et la chute de Rubempré se passe sous la Restauration. Serait-ce parce que cette période se termina par les Trois Glorieuses ou seulement parce qu’elle se caractérisa par le règne des petits esprits, étriqués, mesquins, égoïstes et médiocres : toujours est-il que ce que décrit Balzac résonne étonnamment à notre époque. Gabegie politique et mise à l’encan de la culture : l’actualité du propos est stupéfiante et le choix des costumes, du phrasé et de la gestuelle contemporaines renforcent cette évidence. « C’est l’œuvre capitale dans l’œuvre » disait Balzac à Madame Hanska à propos d’Illusions perdues. De cette œuvre capitale, Pauline Bayle et les siens font un chef-d’œuvre ! Catherine Robert / LA TERRASSE Illusions perdues
du samedi 7 septembre 2024 au dimanche 6 octobre 2024
Théâtre de l’Atelier
1 place Charles Dullin, 75018 Paris du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 18h, le dimanche à 16h. Tél : 01 46 06 49 24. Durée : 2h30. Spectacle vu à l’Espace 1789 de Saint-Ouen.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...