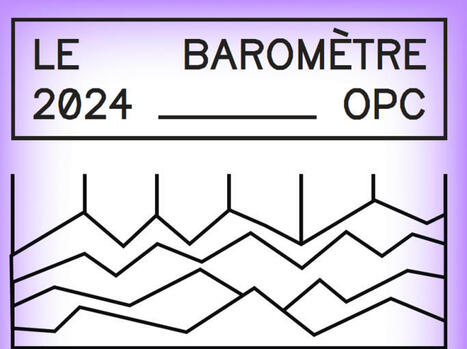Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2024 10:25 AM
|
Par Amélie Blaustein-Niddam dans Cult.news - 5 nov. 2024 Une nouvelle fois, le plus grand musée du monde et le Festival d’automne font alliance pour le meilleur. Le danseur et chorégraphe François Chaignaud nous invite dans les bas-fonds, pire, au donjon, pour une déambulation immersive dans les figures folles d’un Moyen Âge contemporain. Passer l’hiver au Donjon Tout l’hiver, le Louvre expose ses fous. Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques est un monument qui rassemble plus de 300 œuvres, dont un fonds d’enluminures du XIIIe siècle à se damner aux enfers. L’exposition est magistrale, elle donne à voir les dessins super queer du Maître E. S., les espiègleries de Jérôme Bosch, les anthropomorphies du duc de Berry, et tant d’autres. Tout cela est la matière première du spectacle. L’idée est de performer en résonance avec cet événement. Dans l’exposition, de façon brillante, le fou est vidé de la maladie, il est une figure à côté, qui déborde, qui révèle. Il est celui à combattre avant de devenir un modèle à suivre. Petites joueuses raconte exactement cela. La pièce nous fait passer symboliquement de l’ombre à la lumière. Elle se tient dans les excavations des soubassements du Louvre avant le Louvre, quand il était un château. C’est un endroit du musée qui n’est pas un musée, il n’y a aucune œuvre d’art. Cet espace est un monument en soi. Nous entrons par le donjon où, subjugué.e.s, nous regardons ébahi.e.s « Les Ballonnées ». Samuel Famechon et Pierre Morillon jouent pieds nus dans la terre et sur la pierre, s’envoyant l’un à l’autre un énorme ballon de baudruche rouge. Leur visage toujours un peu penché vers l’arrière, la bouche effacée et les yeux immenses. Ils deviennent immenses, les bras vont haut, les dos se courbent comme dans les représentations de satyres. Mais déjà une voix nous appelle : juchée sur des échasses (dont une à l’effigie de Mirium, le chien de François), Maryfé Singy nous appelle. Elle penche, elle aussi, comme si elle était devenue elle-même une enluminure vivante ornant le texte « à la marge ». Selon les moments, vous la trouverez errante entre deux murs, enfermée dans sa démence, ou bien elle avancera décidée sur ses échasses, ou encore elle chante, envoûtante. Nous continuons, suivons les voix et les mélodies. Dans les représentations de la folie, les partitions sont omniprésentes, comme les instruments de musique. Écouter la folie C’est ainsi que nous avançons et sortons du donjon. L’espace est plus ouvert, on y croise Cassandre Munoz qui s’amuse à enfoncer son corps et ses doigts dans une immense toile de parachute rose pâle qui s’étend comme un sexe difforme construit par Abigail Fowler. À côté, au-dessus, ça grouille. Cécile Banquey, Florence Gengoul, Marie Picaut, Alan Picol, Ryan Veillet surgissent d’en haut du chemin de garde ou s’extraient d’un trou que nous n’avions pas encore vu. Ils et elles se mettent à chanter, en chœur polyphonique médiéval, des recoins. Bientôt iels activeront des aquariums où nagent, heureux, des vibromasseurs clitoridiens tout aussi roses que le parachute précédent. Le son nous envoûte, nous rend fous et folles nous-mêmes. Et puis nous accédons au cœur de la performance. « Les Éventées » est un trio composé d’Esteban Appessèche, François Chaignaud, Antoine Roux-Briffaud. Vêtu.e.s tout en rouge comme dans la peinture de fin de l’exposition, Stańczyk de Jan Matejko. Iels dansent macabre, se chevauchent comme « Aristote et Phyllis ». Iels s’amusent de tresques, fuites et maurèques. Les portés étonnent. En pont, au sol, iels se soutiennent par les épaules les uns des autres, l’image est… folle. Leur danse est un tourbillon de puissance et de liberté. Solide, le trio danse comme si plus rien ne comptait et font de l’espace et du public une aire de jeu indivisible. La partition est envoûtante. Iels sont les deux fous dansants d’Hendrik Hondius, le genou haut, le pied pointu, le menton en avant. La performance se termine par la première œuvre de l’exposition : c’est un personnage en pierre assis, tranquille, qui souffle dans une espèce de cornemuse. Elle devient vivante dans L’Exhalée, portée par Marie-Pierre Brebant Petites joueuses est un monument pour un monument. Un pur chef-d’œuvre qu’il faut prendre le temps d’explorer. Nous vous conseillons de commencer par voir l’exposition, particulièrement les trois premières salles, et de vous glisser dans la performance vers 21 h 30 et d’en ressortir à la toute fin, vers 23 heures. Vous deviendrez un peu fous et folles, pas vraiment sûr.e.s de ce que vous avez vu apparaître et disparaître. Vous verrez des faunes et des fantômes, des corps tordus aux yeux bizarres. Dément !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2024 9:06 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 20 oct. 2024 Delphine et Carole, création de Marie Rémond et Caroline Arrouas. Lutte politico-artistique pour le droit des femmes. Delphine et Carole, la création de Marie Rémond et Caroline Arrouas, installe la scène en 1974 : Carole Roussopoulos (1945-2000) a acheté la dernière caméra de Sony, la portapark, dont Jean-Luc Godard vient d’acquérir un premier exemplaire. L’appareil a fourni la capacité de produire et de distribuer des vidéos hors des sociétés de production établies, aux artistes, expérimentateurs et commentateurs sociaux, des générations nées avec la télé et qui créaient enfin à leur tour. En même temps, raconte Carole Roussopoulos, il faut fait preuve de modestie et d’humilité, face à la triste réalité des rushes vidéo jetés et perdus par l’usure, la nécessité de restaurer tout ce qui n’a pu être sauvé du temps. La pionnière de la vidéo donne des cours vidéo à des femmes désireuses de se saisir de cet outil d’émancipation, telle Delphine Seyrig (1932-1990), qui a joué au cinéma pour les femmes-cinéastes, Marguerite Duras, Liliane de Kermadec, Chantal Akerman. Carole, qui a travaillé pour Vogue, fonde en 1971 avec son compagnon, Paul Roussopoulos, le collectif Vidéo out – la parole donnée à ceux qui en sont privés – luttes conduites par les Palestiniens, Black Panthers, après-68, luttes ouvrières, féministes et homosexuelles (Le F.H.A.R., 1971 ; S.C.U.M. Manifesto, avec Delphine Seyrig, 1976). Elle enseigne à Vincennes et lutte pour la contraception et l’avortement. En 1982, avec Delphine Seyrig encore et Ioana Wieder, Carole Roussopoulos fonde le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, pour une approche historiographique de la lutte des femmes, Debout ! Une histoire de mouvement de Libération des femmes 1970-1980 (1999). Pour Vidéo out, elle capte la parole des sans-abri, toxicomanes, détenus, victimes d’inceste, femmes excisées. Grâce à la découverte d’un usage subversif de la partapak qui donne voix et image aux invisibles, Delphine et Carole inventent, créent, montent, diffusent – sûr moment irréversible. Avant sa mort, la seconde a souhaité faire le portrait de la première, projet inachevé, repris par ses enfants et sa petite-fille Callisto Mc Nulty, réalisatrice du documentaire « Delphine et Carole, Insoumuses ». Au théâtre, cette fois, Marie Rémond et Caroline Arrouas, inspirées par ce docu, rendent hommage à ces femmes libres, impertinentes, anticonformistes qui ont donné à voir et à entendre les luttes féministes. La scène est alors un espace de vie et de travail – caméras et outils d’enregistrement, rayonnages de bibliothèque et bon nombre de livres et de cassettes accumulés. Elles travaillent en bonne entente – spontanéité et bonheur -, réunies par une vision du monde à rééquilibrer du côté des femmes, pour que celles-ci ne soient plus les irresponsables supposées. Les interprètes passent d’une époque à l’autre, le temps d’une perruque enlevée, des années 1970 à 2023, les prises de conscience s’affinant ou bien se radicalisant, respirant librement. Marie et Caroline sont Delphine et Carole, intensément créatives, libres et fantasques, à la belle colère claire qu’elles métamorphosent en énergie radieuse – un humour souriant. Elles recréent la mémoire par la parole, lui donnent vie, prolongent l’aventure initiée par les plus anciennes. D’un médium à l’autre, du film vidéo au théâtre : les femmes se reconnaissent dans d’autres portraits d’elles non conformistes – le voeu de Delphine Seyrig. Le 30 décembre 1975, Bernard Pivot invite Françoise Giroud, alors première secrétaire d’État à la condition féminine, pour une émission misogyne : Encore un jour et l’année de la femme, ouf ! c’est fini. Françoise Giroud ne répond pas aux questions attendues, et le couturier Louis Féraud se fait méprisant, les prestations sont désinvoltes : la réalité des femmes encore incomprise et niée. Le collectif les Insoumuses recycle l’émission par des interventions pleines d’humour et fait « la preuve officielle que le secrétariat d’État à la condition féminine est une mystification ». S’emparant de la vidéo de l’émission, elles la « re-montent », loin de toute complaisance ou condescendance. Les moments de lecture des livres significatifs pour enfants sont aussi savoureux : « Papa se promène en forêt, admire la faune et la flore, tandis que Maman reste à la maison faire la cuisine.» Caroline Arrouas incarne, avec délectation et plaisir manifeste, Carole Roussopoulos, la dame de l’art audiovisuel, heureuse de vivre et d’agir en conformité avec ses engagements féministes et politiques, donnant en même temps au public la pleine mesure et la distance d’une réflexion sûre. Et, à la manière de l’héroïne fascinante de L’Année dernière à Marienbad (1960), Marie Rémond – perruque et diction soignée – se fait, avec brio, figure éthérée à la voix musicale et non réaliste. Un spectacle facétieux et pertinent, qui revient aux éveils féministes des seventies, manifestes et décidés, et s’entretient librement avec le présent. Bel hommage pétillant rendu aux luttes des femmes – regards bienveillants et paroles universelles acidulées où chacune peut se retrouver. Véronique Hotte / Hottello Du 8 au 23 novembre 2024, du mardi au jeudi et samedi 20h, vendredi 19h et dimanche 15h30, au Théâtre Paris-Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris | Tel : 01 40 03 74 20. Delphine et Carole, création de Marie Rémond et Caroline Arrouas, sur une idée de Marie Rémond d’après « Delphine et Carole, Insoumuses », un documentaire réalisé par Callisto Mc Nulty. Avec Marie Rémond et Caroline Arrouas. Collaboration artistique Christophe Garcia, scénographie Clémence Delille, costumes Marie La Rocca, création son Margaux Robin, création lumière Thomas Cottereau, création vidéo collective, perruques Phenoey Tehitahe.
Crédit photo : Simon Gosselin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 3, 2024 11:13 AM
|
Par Sonya Faure dans Libération - 3 nov. 2024 «Libé» a assisté aux répétitions du nouveau spectacle du danseur et chorégraphe. En marge de l’exposition «Figures du fou», l’artiste conçoit un cheminement dans les boyaux du Louvre médiéval aux côtés d’étranges créatures, de ballon roses et de chanteurs lyriques. Longtemps François Chaignaud a préféré tenir le sujet à distance. «La folie était pour moi un terme repoussoir. L’association entre l’artiste et le fou était étouffante, elle venait recouvrir n’importe quel geste de création, dans la danse contemporaine notamment, d’une couche visqueuse : la souffrance psychique, l’aliénation, l’enfermement asilaire…» Et puis le Louvre a proposé au chorégraphe, cabarettiste et chanteur lyrique, nourri d’Isadora Duncan, de musique baroque comme de Zizi Jeanmaire, de créer un spectacle en marge de sa grande exposition du moment : «Figures du fou, du Moyen Age aux romantiques». L’année dernière déjà, toujours dans le cadre du Festival d’automne à Paris, Jérôme Bel et Estelle Zhong Mengual avaient performé devant la Victoire de Samothrace. François Chaignaud a suivi l’élaboration de l’exposition, avec ses fous gouailleurs et fantaisistes, et la folie s’est soudain débarrassée de sa gangue gluante. «Au Moyen Age surtout, le fou est une figure centrale, celle de la marge. Exubérant et fantasque, faisant de sa vie un spectacle, c’est la voix qui s’exprime hors des conventions, questionnant les hiérarchies. Alors là, oui, je me sens hyper proche de cette vision de la folie.» Il a eu carte blanche pour choisir l’espace du palais où il présenterait Petites Joueuses, son spectacle, déambulation libre en six petites pièces, en six stations. Il a vite choisi le Louvre médiéval, un Louvre enterré, les fondations de pierre du donjon et de l’ancienne forteresse recouverts par le Palais-Royal. «Une partie souterraine méconnue, une strate un peu oubliée, justifie-t-il. Le seul endroit du musée où il n’y a pas de grands maîtres.» Le seul endroit où il n’y a pas d’œuvres du tout, mais de vigoureuses murailles étêtées. «Pourtant, ici aussi il y a des signatures, des marques sur les pierres taillées, gravées par les tacherons pour être payés pour leur travail. Des gens qui ont fait des gestes, utilisé leurs corps pour créer. Mais dans cette grosse machine à fabriquer de la valeur et des chefs-d’œuvre qu’est le Louvre, leurs signatures, elles, n’ont pas pris de la valeur.» Chimère moderne Dans un creux de la muraille, une femme joue d’un concertina, c’est la Soufflante. Un peu plus loin, une forme gonflable respire et éclaire faiblement ce boyau du Louvre. Une danseuse tourne autour de cette chimère moderne et tente d’y accorder son souffle. Des airs des XIVe et XVe siècles s’élèvent encore un peu plus loin, cinq chanteurs lyriques en toges ou combinaisons rouges déambulent, des bouées de plage en forme de flamant rose nouées sur la tête. C’est du Brueghel. Des sex-toys flottent et crachotent dans leurs petits aquariums (cette pièce-là s’appelle la Vibrante, jeux pour bacs d’eaux et aspirateurs clitoridiens), évoquant furieusement les formes blanchâtres et flottantes du Jardin des délices de Bosch. Ce soir de répétition, c’est tout un petit peuple souterrain, de tendres créatures, des fols dansant la mauresque dans leurs costumes bicolores (l’attribut de l’insensé, une fois encore) qui tiennent autant du capuchon du fou médiéval, de la combi du plongeur (écho du lointain passé aquatique du lieu et de ses douves) et, ajouterait-on, de Star Trek. Les Ballonnées, l’Exhalée, les Eventées : le souffle relie chacune des performances et des jeux. Le souffle du fou. L’image du fou comme une soupape, comme une respiration nécessaire au reste de la société est elle aussi un écho de l’exposition, à l’étage supérieur. Le fou, avec sa tête pleine de vide et de courant d’air, qui ne jouait, au Moyen Age, que d’instrument à vent, cornemuse ou accordéon. Le souffle, c’est aussi ce matériau fondamental à la danse et au chant, et au travail de Chaignaud en particulier. Dans Sylphides en 2010, avec Cécile Bengolea, il dansait sous vide, le corps emprisonné dans une seconde peau de latex, ses capacités respiratoires réduites au minimum vital. Trouver une certaine quiétude Le nom de son nouveau spectacle au Louvre, Petites Joueuses, était au départ un nom de code. Celui qu’il s’était donné pour travailler autour de pratiques de danse et d’écriture «modestes, mais souveraines». «Des formes de faible intensité, à petite échelle, qui instaurent une autre hiérarchie et me pousse à réfléchir à mon propre rapport à la virtuosité et à l’effort.» Chaignaud et ses danseurs en ont fait un manifeste : pourquoi faire de l’art en petite joueuse ? «Parce que les petites joueuses n’acceptent pas les règles du grand jeu. Parce qu’elles refusent de suivre le groupe quand il s’enhardit, refusent parfois de prendre des risques, de conduire vite ou de sauter du train, et ont parfois raison.» Souvent, pendant la répétition, il guide l’un des performeurs en lui disant qu’il faut s’attacher à trouver une certaine quiétude. «Je te promets que tu vas gagner des choses en en enlevant», dit-il à une danseuse à qui il propose de mesurer ses gestes, d’en faire moins. «Tu ne perdras rien», jure-t-il tranquillement, à voix douce. Retrancher pour faire rejaillir davantage les petits gestes, une respiration, un regard plongeant dans les yeux du spectateur qui cheminera les entrailles obscures de ce Louvre. Etre un peu plus paresseuse en somme, telle la petite joueuse, tel le fou «qui dort au mauvais moment, qui ne veut pas travailler, qui remet en cause les normes productives de la société». Les visiteurs du soir de Petites Joueuses entreront un à un dans le parcours, toutes les 20 secondes. Ils y resteront autant de temps qu’ils le souhaitent. A la fin, une porte s’ouvre vers l’étage et l’exposition, à laquelle le billet du spectacle donne droit, dans des conditions privilégiées – moins de monde, et le souvenir des regards des créatures de Chaignaud qui se superposent à ceux des fous sculptés ou entoilés, au mur du musée. Cette danseuse, surtout, la tête pendante sur l’épaule, claudicante sur ses échasses qui sont tout aussi bien des béquilles. «Une manière très petite joueuse d’accomplir le rêve de toujours de la danse et des ballets, dit le chorégraphe. Dormir un peu plus près du ciel.» Sonya Faure / Libération Petites Joueuses de François Chaignaud, du 4 au 16 novembre au Louvre médiéval. Neuf créneaux par soirées sont proposés à la réservation, de 19 h 30 à 22 h 10, et le billet comprend la visite de l’exposition «Figures du fou». Quelques places sont encore disponibles pour ce spectacle coproduit par le Louvre et le Festival d’automne à Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2024 4:38 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 1er novembre 2024
Créé en 2022, ce seul-en-scène a changé de titre (il s’appelait auparavant Seras-tu là ?), mais sa qualité reste intacte. L’irrésistible Solal Bouloudnine soigne son angoisse maladive de la mort dans un solo drolatique, inventif et poignant. Cette autofiction cocasse a la particularité de commencer par la fin et de se terminer par le milieu. Sans doute parce que, au milieu de la vie, on en comprend mieux le début. Cela vous semble complexe ? Pas d’inquiétude, ce procédé de déconstruction du récit fonctionne à merveille. Le comédien nous embarque dans sa chambre d’enfant des années 1990, hanté par la mort de Michel Berger, en osant se grimer, se déguiser, en étant foutraque quand il le faut, en jouant avec une fougue déconcertante. Mélangeant adresse directe au public et personnages pittoresques formidablement interprétés, Solal Bouloudnine parvient à renvoyer les spectateurs à leur propre jeunesse et à ce qui les a construits. Il nous fait rire et pleurer. Sandrine Blanchard / Le Monde Théâtre Lepic, Paris. Jusqu’au 5 janvier 2025. Lire l'article complet du Monde en suivant ce lien : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/01/seize-spectacles-a-reserver-les-fausses-confidences-edgar-ihsane-le-debut-de-la-fin_6369825_3246.html Légende photo : Solal Bouloudnine dans « Le Début de la fin », à Angers, en mai 2024. MARIE CHARBONNIER

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2024 5:38 PM
|
Par Louis Juzot dans le blog Hottello - 28 oct. 2024 Si tu t’en vas, texte Kelly Rivière, mise en scène Philippe Baronnet. Avec Kelly Rivière et Pierre Bidard. Lumière Eliah Elhadad Ramon, vidéo Pauline Gallinari. Si tu t’en vas nous immerge dans un dialogue en forme de controverse entre un élève de terminale, Nathan, et l’un de ses professeurs, Madame Ogier. Nathan est venu voir Madame Ogier après lui avoir adressé une lettre lui faisant part de son abandon de sa scolarité. Ce n’est pas de prime abord le prof qui démissionne de l’Education Nationale, c’est le lycéen, qui a trouvé un emploi lucratif, la revente de sneakers sur internet . Au fil de leur «querelle» pleine de rhétorique et d’envolées lyriques, on apprend que Nathan vit seul avec son père; sa mère a quitté le foyer familial devant une vie trop difficile. Le père agriculteur noyé sous le travail et les dettes n’a pas le temps de s’occuper de son fils. Nathan s’est converti à l’économie parallèle, gagne de l’argent et cette facilité l’entraine vers un rêve chimérique de businessman au Quatar. Face à lui, Madame Ogier va essayer de faire comprendre à Nathan qu’il risque de regretter sa décision, qu’il doit avant tout passer son bac, continuer à apprendre et former son esprit , à vivre avec ses copains, à ne pas penser qu’au fric facile. Mais Madame Ogier a aussi ses failles. Elle est tout aussi malheureuse que Nathan. Elle aurait voulu être basketteuse ou peut-être créatrice d’objets, elle ne semble pas comblée par la vie, donnant l’image d’une grande solitude malgré une vie en couple. Nathan est cruel et renvoie à Madame Ogier le fait qu’elle n’a pas été jusqu’au bout de ses rêves, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Elle va craquer mais Nathan l’écoutera quand même. Elle aura tenu au-delà des limites son rôle d’enseignante , engagée et responsable, jouant sur tous les registres du tragique à la moquerie. Nathan lui aura en contre-partie ouvert les yeux sur ses propres désirs oubliés avec la gravité qui sied à l ’adolescence. Match nul, si l’on peut dire, entre la raison et l’émotion. Pierre Bidard incarne bien Nathan, à la fois gauche et décidé, fragile et brutal. Kelly Rivière, qui a écrit le texte, joue Madame Ogier, une professeure à l’ancienne, gentille mais décalée, investie dans sa mission au détriment de sa propre vie. Les comédiens et le metteur en scène, Philippe Baronnet, ont partagé la pièce dans une résidence au lycée de Coutances en Normandie pour en tester l’impact en milieu lycéen. Cela les a rassurés. Parallèlement Philippe Baronnet a interviewé des jeunes et des enseignants sur leurs attentes à l’école et dans la vie, sur les contraintes ressenties. Ces interviews filmées par Pauline Gallinari introduisent la pièce et mettent en résonance la fable de Nathan et de Madame Ogier. Un travail sensible et respectueux de chacun. En posant de façon simple et accessible, les enjeux de l’éducation, il se prête bien à des ateliers scolaires et offre aussi au public un échange réconfortant – la communication a bien lieu -, inhabituel sur la difficulté actuelle d’enseigner et d’être enseigné. Louis Juzot Du 4 novembre 2024 au 25 juin 2025, à 19h15 ou 21h15, à La Scala Paris 13, boulevard de Strasbourg 75010 – Paris. Tél: 01 40 03 44 30. Crédit photo : Victor Tonelli.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2024 4:49 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 27 octobre 2024 Une interprète exceptionnelle, Agathe Quelquejay, qui aime le poète depuis l’adolescence, un metteur en scène ultra-sensible, Guy-Pierre Couleau, une salle faite pour l’intimité, l’Essaion. Un titre qui peut interloquer, Rossignol à la langue pourrie. Mais chacun reçoit au plus profond les poèmes, les visions, d’un écrivain qu’il faut lire et relire sans cesse. Quand on se rend chaque soir au théâtre et qu’enfin l’on a le privilège d’assister à un moment aussi sublime que ce Rossignol à la langue pourrie, on s’en veut d’avoir tant tardé. D’avoir raté un rendez-vous avec une heure bouleversante de théâtre, de poésie pure. Grandeur, beauté, sincérité, perfection de l’interprétation, tout, ici, subjugue. Une heure dans une semi-pénombre, avec un éclairage très équilibré de flammes vacillantes dans leurs verres de différentes tailles. Une installation de Laurent Schneegans. Une heure en six mouvements séparés par de brèves, mais très prenantes, interventions de la musique, puisée avec pertinence dans les nappes mélancoliques de notre temps, voix sourdes et belles, déchirantes. Le titre des textes est projeté sur le mur. Tout est donné dans une fluidité enivrante. Guy-Pierre Couleau est un metteur en scène au trait sûr. Il sait utiliser les espaces, décider des enchaînements, trouver les mouvements. Il dirige, comme un chorégraphe et musicien, Agathe Quelquejay, elle-même portée par le souffle profond de Jehan-Rictus. Les poèmes s’enchaînent en une fluidité fascinante, tandis que l’interprète, fine, frêle, magnifique, se plie aux passages. Les vêtements s’effacent, se complètent, dans un registre assez asexué, qui se clôt dans les plis d’une robe, sculpture fragile et pourtant majestueuse, dessinée par Delphine Capossela. C’est comme un chant qui ne finirait jamais. La langue inventive, la langue vraie du peuple, nous parvient avec une précision d’autant plus magnifique qu’Agathe Quelquejay a intériorisé ces textes depuis l’adolescence. C’est alors qu’elle a découvert Jehan-Rictus, c’est alors qu’elle s’est dit qu’un jour elle porterait ces textes sur scène. Comment être à la hauteur de ce moment si haut, si beau, tellement accessible, en même temps. La suite des textes est finement organisée. Ils viennent du recueil Le Cœur populaire. Ainsi s’enchaînent « Les Petites baraques », « La Frousse », « Idylle », « La Charlotte prie Notre-Dame durant la nuit du réveillon », « Berceuse pour un Pas-de-Chance », « Jasante de la vieille », texte qui date de 1902. « BONJOUR… C’est moi… moi ta m’man
J’suis là… d’vant toi… au cimetière
(Aujord’hui y’ aura juste un an
Un an passé d’pis ton affaire.)
Louis?
Mon petit… m’entends-tu seul’ment ?
T’entends-ty ta pauv’moman d’mère
Ta » Vieille « , comm’tu disais dans l’temps
Ta » Vieille « : qu’alle est v’nue aujord’hui
Malgré la bouillasse et la puïe
Et malgré qu’ça soye loin… Ivry ! » Ecoutez ces « récits d’amour et de misère en langue populaire », écoutez Agathe Quelquejay, lisez Jehan-Rictus. Nombre de ses textes, de ses poèmes, sont accessibles gratuitement sur internet. Et les livres sont édités en formats très accessibles. Voyez ce spectacle qui nous entraîne au plus haut des sentiments humains et nous parle d’aujourd’hui même. Armelle Héliot Théâtre Essaion, jusqu’au 2 novembre, les vendredi et samedi à 21h00, puis du 8 novembre au 4 janvier 2025, les vendredi et samedi à 19h15. Tél : 01 42 78 46 42. essaionreservations@gmail.com https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1040_rossignol-a-la-langue-pourrie.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2024 10:18 AM
|
Par Samuel Gleyze-Esteban dans L'Humanité - 27 oct. 2024 Iconoclaste et subversif, le duo formé par Marion Duval et Cécile Laporte pour Cécile secoue les scènes francophones avec une volonté non dissimulée de casser les normes. Quand la metteuse en scène suisse Marion Duval vient la voir en lui proposant un seul-en-scène sur sa vie, Cécile Laporte croit rêver. En 2019, le spectacle naît pourtant bien. Depuis, le public, à son tour, hallucine. Révélé pour de bon à Avignon en 2023, Cécile est un mélange inouï de performance, de théâtre documentaire et de spectacle de clown passé au shaker du stand-up. La comédienne, jusqu’alors méconnue, prend les spots trois heures durant, égrenant les souvenirs de sa vie picaresque, non sans déborder sur le public. Son apparition sur nos plateaux à la fois éclaire les contours du théâtre politique et interroge la place respective de l’interprète et de la metteuse en scène. Il fallait donc rencontrer le duo. Rendez-vous a été pris au Théâtre de la Bastille, dont elles ont occupé le plateau en octobre, avant une étape nantaise du 5 au 7 novembre. Vous vous connaissiez dans la vie avant de monter cette pièce ensemble. Les possibilités offertes par Cécile en tant qu’interprète sont-elles venues épouser une quête artistique préexistante ? Marion Duval : On s’est rencontrées à Toulouse, il y a longtemps. On traînait dans les mêmes endroits, on faisait tout et n’importe quoi. En rencontrant Cécile, j’ai observé combien les gens, moi y compris, avaient tendance à s’ouvrir et à devenir plus aimables en sa présence. J’ai aussi vu sa capacité à vivre puis à raconter des histoires qui sortaient du cadre. Cécile a fait de la place dans sa vie à des choses auxquelles je n’avais pas laissé de place. Ça me donnait donc l’occasion d’embrasser ce qui me tient à cœur, comme la ZAD et d’autres mouvements qui dépassent les questionnements liés à sa petite individualité. En quelque sorte, c’est un spectacle à la gloire de Cécile. Le travail de l’actrice y est moins policé qu’ailleurs. Cécile, en racontant sa propre vie, s’expose pendant trois heures de spectacle. Avez-vous posé des limites ? Marion Duval : Il y a un contrat de confiance sous-jacent, même s’il peut être mis à l’épreuve parce que ça peut faire peur de monter sur scène. Tout cela est aussi une blague : c’est un peu grotesque d’en faire autant autour de Cécile, même si elle est fantastique. Il y avait quand même aussi la volonté de faire un cadeau, parce que j’aime la scène, je sais que ça peut être beau et je crois que l’on peut s’en sortir avec le sentiment d’être vivant. Cécile Laporte : Je prends ce cadeau, même s’il est parfois empoisonné. Ce n’est pas évident de gérer la scène aussi longtemps. À un moment, tu ne sais plus trop jusqu’où tu te répands. Une image bizarre me vient : c’est comme si ton toi était une sorte de boue qui s’écoule et passe sous les portes. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir la rattraper et tu sais que tout le monde va en emporter des morceaux. J’ai quand même eu de gros vertiges, je l’avoue. Il y a l’équipe, il y a de l’amour mais, parfois, je me piège moi-même. Parce que si je peux tout balancer, je peux aussi chuter. On imagine le mélange de plaisir et d’épreuve que représente chaque représentation pour vous, Cécile. Comment le vivez-vous ? Cécile Laporte : À chaque fois que je joue, je me demande : comment est-ce que je vais le vivre cette fois ? Qu’est-ce qui va se passer ? Je réalise combien j’ai envie de revivre cette expérience tous les soirs. Il y a à la fois l’excitation du défi, le vertige de l’inconnu et la volonté de profiter. Je sais que le spectacle bouge des choses en moi, mais je ne sais pas exactement comment. Comment appréhendez-vous la fonction politique du théâtre ? Marion Duval : Je me fâche quand je ne sens pas de porosité entre la scène et la salle. Chaque fois qu’est refusée cette relation, on perd une grosse occasion d’être ensemble. Nous organisons parfois des scènes ouvertes où l’on s’oblige à applaudir indépendamment de la qualité des prestations. C’est presque le meilleur spectacle qui soit, tant il fait du bien aux gens qui le font. Ce sont des personnes qui ont des vies atypiques, et ça change la donne. Début octobre, lors de la première au Théâtre de la Bastille, votre intervention en soutien à la Palestine a provoqué quelques remous. On vous a accusées de ne pas assumer le débat. Cécile Laporte : Je ne sais plus exactement ce que j’ai dit ce soir-là, mais cela se résumait en quatre ou cinq phrases assez directes. La manière dont je l’ai amené a peut-être provoqué une latence dans laquelle deux spectateurs se sont engouffrés. Les autres soirs, il n’y a pas du tout eu ce type de réaction : c’était clair, net, il n’y avait pas à tortiller. On a toujours senti une grande adhésion, de celles qui font du bien et donnent du courage. Si les gens ne sont pas d’accord, ils peuvent quitter la salle. Ou pas. Et feuilleter toute une documentation sur le sujet à disposition à la fin du spectacle. « Les spectacles sont de bons accélérateurs de vie. » Marion Duval Marion Duval : Cécile établit un rapport direct avec la salle. Il est possible d’intervenir, car tout ce qui peut surgir, rompre avec cette politesse du théâtre, tout ce qui fait qu’on se fait prendre par la vie quand on est dans le spectacle, pour nous, est bon à prendre. Dans ce cas présent, il s’agissait, à son initiative, d’un hommage à ceux qui résistent en Palestine, avec des drapeaux palestinien et libanais. Que certains balancent « et les otages ? » ou se sentent interpellés par une partie de la salle, cela ne nous concerne pas tellement. Après Cécile, vous avez créé ensemble le Spectacle de merde. De quoi s’agit-il ? Marion Duval : Au départ, c’est un peu une suite de Cécile. Je n’y présente plus une amie, mais une bande d’amis, et cela produit quelque chose d’assez semblable à l’endroit de la joie, de l’amour et du soulagement. Mais c’est une autre dimension, on est nombreux, ça se passe dans la rue, où on est tous et toutes beaucoup plus à l’aise et où l’infini des possibles est encore plus palpable. Je crois que c’est un bon remède contre la morosité ambiante et contre un tas d’injonctions – le conformisme, le professionnalisme, les rapports de pouvoir, toutes ces choses qui nous esseulent, nous attristent et nous enchaînent. C’est brut esthétiquement et politiquement, alors ça risque de prendre un petit moment avant de commencer à cartonner comme Cécile. Alors on peut faire confiance au temps… Mais c’est vrai qu’on a envie de vivre. Et les spectacles sont de bons accélérateurs de vie. Propos recueillis par Samuel Gleyze-Esteban / LHumanité
légende photo : Cécile est un mélange inouï de performance, de théâtre documentaire et de spectacle de clown passé au shaker du stand-up. Photo © Mathilda Olmi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2024 5:22 AM
|
par Laurent Goumarre dans Libération - 28 oct. 2024 Dans sa chambre d’enfance recréée sur scène, Solal Bouloudnine replonge, au travers d’une enthousiasmante galerie de personnages, dans ses années 90 hantées par la mort de Michel Berger. Le décor ? Une chambre d’enfant, avec un lit côté cour ; oreiller Schtroumpfs, poster Stallone côté jardin ; des peluches et figurines. Et puis rangé sur l’étagère bourrée de BD, le détail aux allures d’indice : la boîte du Mastermind, jeu de plateau, de logique et décodage. C’est pile-poil ce que met en scène Solal Bouloudnine dans sa comédie géniale la Fin du début. Au commencement était la fin : le précepte a des allures de métaphysique religieuse, le principe va en libérer l’énergie burlesque. Mais c’est quoi cette fin qui commence avec Solal en tenue de tennis dégueulasse, raquette à la main, le bras levé, service gagnant ? La mort le 2 août 1992 de Michel Berger à Ramatuelle, crise cardiaque après une partie de tennis. Solal Bouloudnine a 6 ans, 11 mois et 20 jours, passe ses vacances dans la maison voisine, assiste à tout, l’ambulance, l’arrivée des médias, des fans. La fin et son spectacle font leur entrée dans son monde d’enfant, désormais les paroles des chansons de Berger résonneront comme un mantra ; il lui faudra, comme dans le Paradis blanc, «recommencer /Là où le monde a commencé». Rabbin prophète et coach de foot A l’origine donc une tragédie traumatique que la pièce se donne pour mission de conjurer. A toute allure, car le temps est compté. D’ailleurs, Solal Bouloudnine n’arrête pas de compter combien il lui reste de minutes jusqu’à la fin de la fin. Il écourte des scènes trop longues, il en expédie d’autres en moins de deux minutes top chrono, on passe à autre chose : un rêve avec une France Gall sourde et muette, hilarant ; et puis l’histoire de Simon propriétaire d’un magasin de jouets envieux du papetier d’en face qui a tout gagné au Loto, et qui va demander des comptes à Dieu – on ne dévoilera pas la chute, juste que c’est une histoire de jeu. Solal Bouloudnine a bien retenu la leçon et joue à fond les personnages de sa vie : sa mère typiquement juive, son père tellement médecin, le rabbin prophète, le coach de foot qui ne veut pas d’un naze sur le terrain, jusqu’à se jouer lui-même, Solal, rejouant le souvenir de son premier one-man-show joyeusement débile, Seras-tu là ? En ex des Chiens de Navarre, il ne lâche rien, se met au piano-jouet, chante le Monde est stone en arabe. Il y a des rires malaisants, qui très vite se taisent, l’émotion envahit la salle, car toutes et tous nous savons ce qui se dit : «J’ai la tête qui éclate /J’voudrais seulement dormir /M’étendre sur l’asphalte /Et me laisser mourir.» C’est pas encore la fin, mais on est loin du début. Laurent Goumarre / Libération La Fin du début de Solal Bouloudnine au théâtre Lepic (75018) tous les lundis, mardis à 21 heures, et à partir du 3 novembre aussi les dimanches à 19h30. Jusqu’au 5 janvier. https://theatrelepic.com/2024/06/27/la-fin-du-debut/ Légende photo : Solal Bouloudnine va jusqu’à se jouer lui-même enfant. (Marie Charbonnier)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2024 8:07 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 27 octobre 2024 Le premier écrit, met en scène et joue, très bien accompagné. A deux, ils ont imaginé une formidable scénographie de carton, qui ajoute au charme de la représentation.
Sollicité par des dizaines de productions, on laisse passer des pépites. Des productions d’excellence que l’on découvre un peu tard. Fourmi(s) est un spectacle qui a été joué avant d’être à l’affiche du Lucernaire et une longue tournée attend les deux artistes que vous prendrez plaisir à applaudir. Florian Pâque est un artiste qui a suivi une forte formation littéraire et dramatique. Il a fondé une compagnie, Le Nez au milieu du village, qui a pour objet notre société même et ses actuelles dérives dont l’ « ubérisation » est la plus emblématique. Dans Fourmi(s), texte justement nourri de conversations avec des jeunes embarqués dans un rêve fallacieux d’indépendance et de réussite matérielle, on saisit au plus près la réalité. On a beau connaître la vérité des plates-formes, on est saisi par ce que nous raconte Fourmi(s) car on est touché par le jeune homme dont on suite le rêve et qu’incarne avec sensibilité, subtilité, profondeur, Nicolas Schmitt. Dans une scénographie formidable, inventive et simple comme une évidence, carton et lumières dessinant une forêt de gratte-ciels, les deux personnages se réfugient en haut d’un immeuble, sur une terrasse qui attise leurs rêves, avec vue sur la ville, au-delà de la ville, et vue sur le ciel. Ils vont et viennent. Se retrouvent. Discutent. Florian Pâque, d’une simple perruque, d’un blouson, d’une manière de se tenir, change de personnage. Il est le père, il est l’ami, il est le manipulateur, le mauvais génie. Une cascade de figures que Florian Pâque a dont écrites et auxquelles il donne une vie forte, comme spontanément. Face à lui, Nicolas Schmitt excelle à donner le sentiment des fêlures du jeune homme qui, peu à peu, deviennent des crevasses… De la virtuosité, de la vérité, de l’émotion, du théâtre pur et solide. En une heure dix, un grand moment d’intelligence et d’art. Dépêchez-vous ! Armelle Héliot Théâtre du Lucernaire, salle Paradis, à 21h00 du mardi au samedi, 17h30 dimanche. Durée : 1h10. Jusqu’au 3 novembre. Tél : 01 45 44 57 34. Une longue tournée suit. Texte publié par les éditions Lansman.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2024 9:26 AM
|
Par Hélène Bekmezian dans Le Monde - 26 octobre 2024 Jadis cantonnées à l’art-thérapie, les personnes en situation de handicap sont désormais reconnues comme professionnelles à part entière. Cinéma, rock, journalisme : dans tous les milieux, leur différence électrise.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2024/10/26/les-neuroatypiques-bouleversent-la-societe-du-spectacle_6360133_4497916.html
On l’a vue virevolter et se pavaner dans sa longue robe blanche sur le tapis rouge du dernier Festival de Cannes, souriante et fière. Marie Colin était l’une des stars d’Un p’tit truc en plus, la comédie d’Artus devenue véritable phénomène avec près de 11 millions d’entrées. Une actrice atypique, porteuse de trisomie 21, comme on en voit encore peu au cinéma. « C’était moi la star, c’était magnifique », se souvient-elle quatre mois plus tard, pas encore tout à fait descendue de son nuage. Les flashs, les autographes, les interviews, rien de tout cela ne l’a vraiment déstabilisée : « Je n’étais pas du tout intimidée ! », clame-t-elle. Il faut dire qu’à 52 ans cette comédienne professionnelle est loin d’être une jeune première ; elle est même la plus ancienne membre de la compagnie du Théâtre du Cristal, qui accueille à plein temps quinze comédiens en situation de handicap. Derrière le succès inattendu de ce film, il y a dans le monde de la culture et du divertissement des dizaines de structures, de troupes ou de collectifs qui travaillent avec des artistes comme elle, qui ont un truc pas tout à fait comme les autres. On pourrait le résumer au handicap mental, mais le terme est réducteur et sous-entend une déficience, quand il s’agit surtout d’une différence, une façon de voir et de comprendre le monde en décalage avec ce que l’on considère comme la norme. Ceux qui sont impliqués dans ce milieu depuis longtemps ne croient pas au grand soir ou à un événement qui fera tout changer. On se souvient du Huitième Jour, un film qui racontait l’amitié entre un businessman désespéré et un jeune homme porteur de trisomie 21, qui avait aussi connu un franc succès et offert à ses acteurs principaux, Daniel Auteuil et Pascal Duquenne, le Prix d’interprétation masculine à Cannes, en 1996. Sans faire franchement bouger les lignes sur le sujet du handicap et de l’art. Au contraire, le contrecoup peut être difficile, reconnaît Vincent Chalambert, l’un des acteurs d’Un p’tit truc en plus : « On a atteint le monde des stars, c’est rare, c’est éphémère. » Diagnostiqué porteur d’autisme dans l’adolescence, le jeune homme de 29 ans aux cheveux grisonnants, qui se décrit comme quelqu’un de « très renfermé », a déjà trois autres longs-métrages à son actif. Malgré cela et sa « fierté » de voir le succès du film d’Artus, « il y a encore des gens fermés, réticents », regrette-t-il. Il marque une pause avant de citer un exemple tout simple : « Dans les transports, il arrive que les gens changent de place pour ne pas être assis à côté de moi. » Pour autant, les choses évoluent, lentement, mais sûrement, et le cinéma tout comme les Jeux paralympiques de Paris contribuent à faire changer le regard, selon l’expression consacrée. Ils habituent nos yeux à voir la performance et l’émotion avant le handicap. Tolérance et solidarité En ce jour pluvieux de septembre, dans un quartier résidentiel d’Eragny (Val-d’Oise), le directeur du Théâtre du Cristal, Olivier Couder, est en pleine répétition de la pièce Le Loup, la jeune fille et le chasseur, quelques jours avant la présentation au public. Il donne ses instructions, les comédiens les intègrent, proposent des idées, modulent des intentions dans leur façon de dire le texte… Certains ont peut-être une gestuelle un peu gauche ou ont besoin d’entendre la consigne une deuxième fois, mais, dans le fond, rien ne diffère vraiment d’une séance de travail classique. Si ce n’est qu’il y a sans doute plus de tolérance et de solidarité ici qu’en « milieu ordinaire ». « J’ai toujours aimé la scène, transmettre une passion, voir que les gens ont les yeux qui brillent », rapporte Elie Collard, volubile artiste qui se définit comme non binaire. Elie ne veut pas en dire plus sur son handicap mais assure que le Cristal lui a permis de s’affirmer, ses différences étant pleinement acceptées. Entre deux scènes, Eléa Folcher raconte elle aussi comment la scène lui a permis de revivre, après sept années difficiles comme aide-soignante, où elle était « harcelée par les collègues » : « Le théâtre m’a permis d’acquérir de la confiance dans la vie de tous les jours et de me réapproprier mon corps, qui ne m’appartenait plus », détaille cette femme énergique de 38 ans au blond vénitien, qui souffre de dyslexie et de dyspraxie. Mais pas question pour autant de parler d’art-thérapie, il s’agit bien d’un métier rémunéré, pour lequel elle travaille énormément – « matin, midi et soir ! », confirme Olivier Couder. Pour le metteur en scène, qui a fondé la compagnie en 1989, un « vrai virage » s’est opéré au début des années 2000 : « Est arrivé un moment où on a inversé la proposition : on a parlé du projet artistique d’abord et signalé dans un petit coin que la troupe était composée de personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, nous avons de plus en plus un public lambda qui vient voir nos pièces par saine curiosité. Parfois uniquement parce qu’ils aiment l’auteur qu’on joue, sans même rien savoir de la compagnie. » C’est l’hésitation souvent évoquée dans les échanges sur le sujet : faut-il mettre en avant la différence comme une force pour faire avancer la cause ou, au contraire, chercher à l’invisibiliser pour éviter toute forme de discrimination ? On pourrait répondre que la première proposition est le point de départ et la seconde, l’objectif à atteindre. Depuis 2016, Olivier Couder codirige le Festival Imago, un événement artistique bisannuel qui coordonne et met en avant des créations inclusives en Ile-de-France. Si le projet rencontre de plus en plus de popularité, il est aussi vu d’un mauvais œil par d’autres acteurs du secteur, qui y perçoivent une forme de ghettoïsation. Pour l’édition de cette année, qui se tient jusqu’en décembre, le mot « handicap » a d’ailleurs disparu de l’affiche officielle, alors qu’il y était encore en 2022. Cette année, il s’agit uniquement de faire « bouger les esthétiques ». « Vraie reconnaissance » A 200 kilomètres de là, au cœur d’un quartier en brique rouge de Roubaix (Nord), Léonor Baudouin fait partie de ceux qui ne sont pas très à l’aise avec ce genre d’événement. Directrice de l’Oiseau-Mouche, une compagnie théâtrale inclusive créée en 1978, elle aimerait qu’on arrête de considérer ces artistes comme étant à part. Ici, les dix-neuf comédiens atypiques sont également permanents, mais ils n’ont pas de metteur en scène ou de directeur artistique spécifique ; ceux-ci sont des invités extérieurs, qui viennent avec un projet pour lequel ils choisissent des comédiens qu’ils font ensuite jouer sur des scènes nationales ou internationales, dans des productions qui peuvent être mixtes. Récemment, l’un des membres de la troupe, Thierry Dupont, a joué au Festival d’Avignon dans Quichotte, avec Jeanne Balibar, quand d’autres étaient sur les planches du Théâtre de la Ville, à Paris, pour Loin dans la mer, montée par Lisa Guez. Cette collaboration avec des professionnels parfois très réputés constitue pour eux « une vraie reconnaissance et l’assurance d’une exigence », témoigne Kévin Lefebvre, à l’affiche de cette pièce. Son ambition ? « Que l’on me dise “j’ai été pris dans l’histoire, je n’ai pas vu de différence”. » Le conventionnement par le ministère de la culture, obtenu en 2013 et renouvelé depuis, est là aussi « un gage de sérieux et de professionnalisme », selon Léonor Baudouin, qui insiste sur le fait que « l’Oiseau-Mouche n’est pas un lieu de création adaptée » : « On ne veut pas que le public vienne applaudir des acteurs handicapés. » « Quand je viens ici au travail, on parle de théâtre, on parle de notre métier, on ne parle pas de handicap. J’ai choisi ce projet parce que c’était une troupe professionnelle », appuie Marie-Claire Alpérine, membre depuis 2008. Sans pour autant ignorer les obstacles : « Quand il y a une difficulté, on la dépasse. Si quelqu’un ne sait pas lire ou écrire, on enregistre son texte au dictaphone. C’est très simple, très naturel », assure la Parisienne de 43 ans. Pour apprendre ses répliques, Thierry Dupont utilise par exemple un système de rébus, tandis qu’au Cristal Eléa Folcher stabilote ses textes avec différentes couleurs pour ne pas se mélanger les pinceaux. Il faut aussi parfois s’armer de patience, comme on peut le voir sur une vidéo de making-of d’Un p’tit truc en plus, où Artus rame pour arriver à faire dire son texte à Marie Colin. En 2022, France 2 a montré pour la première fois au grand public la réalité d’une autre création culturelle singulière avec « Les Rencontres du Papotin ». Dans cette émission, qui a tout de suite été un succès, la rédaction du Papotin, composée de journalistes non professionnels atteints d’autisme, rencontre une personnalité pour un grand entretien. Si l’interview est sérieusement préparée avant, la liberté est quasi totale pendant l’enregistrement : d’ailleurs, le tournage dure plus de deux heures et demie pour un rendu de trente minutes, un ratio exceptionnel à la télévision. Cette volonté de ne pas altérer l’authenticité du moment est défendue jusque dans la réalisation : l’émission est enregistrée au dernier étage de l’Institut du monde arabe, dans une grande pièce vitrée baignée de lumière naturelle, ce qui donne un aspect documentaire. Sept cadreurs gravitent autour des participants avec des caméras en longue focale pour capter des gros plans en restant à distance, avec un effet flou en arrière-plan. Le rédacteur en chef, Julien Bancilhon, également psychologue, distribue la parole avec un micro, mais il n’intervient quasiment pas, n’interrompt pas les propos labyrinthiques ou laborieux et laisse les silences s’installer, parfois jusqu’au malaise. Un journaliste passe d’une question sur le harcèlement scolaire à une autre sur les toilettes sèches, un deuxième termine son propos en imitant Bruce Willis, un troisième s’embarque dans une thèse improvisée sur les révolutions féministes… Ils ont des places attitrées et leurs noms sont scotchés sur les chaises installées en cercle, mais ceux qui ne tiennent pas en place sont libres d’aller et venir. Quand l’invité accepte de se laisser déstabiliser et de fendre l’armure, cela donne lieu à des moments exceptionnels, comme lors de l’enregistrement avec Clara Luciani, qui sera diffusé le 9 novembre. La chanteuse s’est livrée sans retenue, passant du rire aux larmes, répondant sincèrement à chacun des 32 journalistes qui se sont succédé pour savoir, entre autres, si elle aimait se déguiser en Mickey quand elle était petite, ce qu’elle pensait des voitures allemandes, quelle était sa nationalité préférée, mais aussi l’interroger longuement sur la façon dont elle a appris à s’accepter et à s’aimer. « Vous êtes les meilleurs journalistes que j’ai rencontrés parce qu’être un bon journaliste ce n’est pas seulement poser les bonnes questions, mais aussi savoir faire en sorte d’avoir les bonnes réponses », telle fut sa conclusion. « Arguments artistiques » Assumer le décalage comme expression artistique, c’est aussi le credo d’Antoine Capet, qui s’est lancé, il y a quinze ans, dans le projet de « faire de la musique bizarre avec des gens bizarres ». Ce week-end d’automne, on le retrouve en train d’arranger une drôle de guitare en bois à deux cordes dans une cacophonie ambiante de percussions, de sifflets et de bruits blancs, à Mains d’Œuvres, un lieu de résidence artistique à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). C’est la Kermesse Sport et Noise, un événement musical un peu loufoque organisée par BrutPop, le collectif qu’il a cofondé. Cet éducateur spécialisé ne voulait pas que la musique inclusive reste coincée dans le sociomédical et l’art-thérapie. Amateur de musique expérimentale, il cherchait au contraire à « faire quelque chose de fun, avec légèreté », partant du principe que « tout son est intéressant, cela peut créer une sorte de poésie dissonante qui n’est pas forcément dans la mélodie ». Aujourd’hui, Antoine Capet intervient à la demande dans des structures pour produire des albums avec de petits groupes et le moins de contraintes possible : « On commence par mettre un micro, et il se passe tout de suite plein de trucs. Puis j’enregistre tout en multipiste, et après j’essaie de trier pour que ce soit audible, mais sans couper ni faire un montage déconnecté de ce qu’il s’est passé. » Il a bricolé des instruments de musique adaptés, comme cette guitare à deux cordes, qui facilite la prise en main et permet d’aller « direct dans la puissance sonore sans s’emmerder avec un apprentissage complexe ». Grâce au numérique, il est même devenu possible de faire de la musique à partir de presque rien : « On a parfois des jeunes qui ne font que tourner autour de la table sans arriver à se fixer ; leur truc, c’est de déambuler. Alors on met des capteurs par terre et finalement le fait de tourner autour de la table devient un instrument. » Au bout du compte, les artistes atypiques nous rappellent que les normes ne sont qu’une construction sociale qui ne sert pas forcément la création. La première fois qu’Olivier Couder a travaillé avec eux, il a « été saisi par un univers où toutes les distorsions qui sont liées au handicap dans la vie deviennent des arguments artistiques ». « J’ai vu de vraies particularités du jeu d’acteur qui étaient passionnantes : l’absorption dans l’émotion intérieure, la force de l’expressivité et le fait d’être vraiment authentique, ce qui est très compliqué pour un comédien. » Le Théâtre du Cristal, l’Oiseau-Mouche ou les ateliers d’Antoine Capet ne sont que des exemples de la richesse des initiatives mises en place en France. Une offre qui reste difficile à quantifier, faute de données et d’une grande stratégie nationale pour orchestrer le tout. « Il y a plein de belles expérimentations, mais cela tient beaucoup à des personnes. Il existe un vrai dynamisme qui reste sous-financé, car cela n’est pas un axe stratégique de la culture », résume Marie-Aude Torres Maguedano, directrice exécutive de l’Unapei, l’un des principaux réseaux d’associations consacrés au handicap mental. Au ministère de la rue de Valois, le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, Noël Corbin, reconnaît qu’« une impulsion ministérielle volontariste est indispensable ». « Le handicap mental nécessite une approche globale tant en matière d’accessibilité que d’inclusion : il ne faut pas seulement compenser, mais penser autre chose. Le chemin est certes encore long, mais la volonté politique est bien réelle, et de nombreux projets sont d’ores et déjà en cours », assure-t-il, ajoutant que le sujet s’inscrit dans le souhait du premier ministre, Michel Barnier, de faire de la santé mentale la grande cause 2025. Des lacunes dans l’accompagnement Au-delà de la volonté politique, des lacunes dans la formation et dans l’accompagnement freinent une réelle professionnalisation des artistes hors norme. « Les accompagnants s’arrêtent au bac, il n’existe rien dans l’enseignement supérieur ni dans le milieu professionnel, déplore Léonor Baudouin, de l’Oiseau-Mouche. Il y a des éducateurs spécialisés dans les institutions qui pourraient travailler dans le milieu ordinaire, mais comment ? En free-lance ? Qui prendrait en charge ? » Des initiatives existent, mais elles sont souvent le fruit de personnes militantes et n’ont pas toujours d’assise juridique. Embauchée sur le tournage d’Un p’tit truc en plus pour accompagner les acteurs et, au besoin, faire le lien avec le reste de l’équipe, Margault Algudo-Brzostek a ainsi dû créer sa propre fiche de poste de « coordination régie-handicap ». Au Théâtre du Cristal, Olivier Couder a monté une agence, en 2021, la première – et la seule – à ne représenter que des comédiens en situation de handicap. En plus de trier et de traiter les propositions de rôles, dont certaines sont encore caricaturales, une grande partie du job consiste à accompagner les talents sur les tournages, à s’assurer que tout est bien compris, à repérer les signaux de fatigue, etc. Pour quelques-uns qui arrivent à travailler, combien sont encore coincés dans des institutions et des modèles inadaptés, voire rigides ? L’histoire de la poétesse Babouillec, emmurée dans le silence jusqu’à ses 20 ans, est en cela exemplaire. Atteinte d’autisme sévère, ne parlant quasiment pas et ayant une motricité limitée, elle a vécu en institution jusqu’à ses 14 ans, avant que sa mère ne décide de s’occuper d’elle à plein temps. Ce n’est que six ans plus tard, et par hasard, qu’elle s’est rendu compte que sa fille savait lire sans qu’on le lui ait appris ; elle lui a alors fabriqué un alphabet adapté, avec de petites lettres découpées qu’elle peut placer pour former des phrases. A 39 ans, elle est désormais reconnue comme une autrice à part entière, à l’expression singulière et profonde, portée par une pensée complexe et articulée. Elle participe également aux « Rencontres du Papotin », où sa mère reste à ses côtés pour l’aider à former ses questions. L’aspect laborieux du processus crée parfois un moment suspendu dans l’émission : de petites lettres de papier jetées les unes après les autres sur la table, jusqu’à ce que, tout à coup, la question éblouisse par sa fulgurance. Comme lorsqu’elle avait soumis ces interrogations à Virginie Efira, qui en était restée interdite : « Penses-tu que la mort sociale puisse être une solution de survie ? », « La soif d’exister à l’écran donne-t-elle une bonne image de soi ? » Clara Luciani a semblé basculer elle aussi dans un autre état de conscience dès la première intervention de Babouillec, qui lui a instantanément embué le regard. La question, qui faisait référence à son titre La Grenade, l’a ébranlée profondément, et pour tout le reste de l’émission : « On tue nos démons silencieux avec des grenades. Penses-tu que de les faire exploser libère ou peut nous condamner socialement ? » Hélène Bekmezian / LE MONDE Légende photo : Clara Luciani et la poétesse Babouillec (tee-shirt gris), lors de l’enregistrement de l’émission « Les Rencontres du Papotin », à l’Institut du monde arabe, à Paris, le 7 octobre 2024. CHA GONZALEZ POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2024 9:07 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 21 oct. 2024 Magnétique, très intelligente, ultra-sensible, elle s’est éteinte dans la nuit, emportée par une insuffisance respiratoire. Une comédienne rare qui avait préféré le théâtre au cinéma, malgré les films très brillants qu’elle avait tournés. Une femme. Rieuse et profondément triste. Désespérée et gaie. Une femme complexe qui aura séduit réalisateurs, metteurs en scène, spectateurs. Une beauté singulière, silhouette idéale, brune au regard à la Vénus, corps parfait, beau visage, voix d’enchanteresse, et rire. On le répète. On la revoit, malicieuse, insolente, désirant follement être libre et aimant follement. Christine Boisson, parfois, se ligotait elle-même. « Un homme ça s’empêche », disait Camus, qu’elle lisait comme un frère. Mais elle, Christine, elle se sera trop empêchée. Elle s’est éteinte la nuit dernière, emportée par « la maladie des fumeurs » a dit sa fille, Juliette Kowski, aussi blonde que sa mère était brune. Même forme de visage, même front haut légèrement bombé. Comédienne, elle aussi. Juliette a demandé que l’on parle de la « grâce » de sa mère, femme gracieuse, pleine de grâces, effectivement. Christine Boisson était née le 8 avril 1956 à Aix-en-Provence. Son père est pilote de chasse. C’est au Maroc qu’elle grandit. Avant dix ans, elle revient en France et accomplit ses études secondaires à Paris avant de tenter sa chance de jeune fille des sixties dans l’agence de mannequins de Catherine Harlé. On en parle dans une chanson de Dutronc…c’est dire. Pas même le temps de faire ses premières photos, Just Jaeckin la remarque et la convainc de jouer dans le film qu’il veut tourner depuis pas mal de temps…Emmanuelle. Avec la sortie du « remake », on pensait à Christine comme à la survivante. Morte, Sylvia Kristel, mort Alain Cuny, mort Just Jaeckin, morte Emmanuelle Arsan et son mari, sans doute l’auteur véritable d’Emmanuelle, Louis-Jacques Rollet-Andriane. Et puis voici que le souffle lui manque et que cette femme-flamme s’éteint pour toujours. Sa fille annonce la triste nouvelle. Après Emmanuelle, Christine Boisson aurait pu continuer à tourner, tourner encore. Comme dans Le Jeu avec le feu d’Alain Robbe-Grillet. Mais elle comprend que c’est son physique ravissant qui lui ouvre les plateaux. Elle ne veut pas. Elle passe le concours du conservatoire et le réussit. Dès lors son chemin se confond avec le plus exigeant du théâtre de l’époque. Années 70, années 80. Elle reçoit l’enseignement de maîtres : Antoine Vitez, Roger Planchon qui la dirigera dans Antoine et Cléopâtre et dans Périclès, Prince de Tyr. Mais c’est par le cinéma qu’elle va, dans ces années-là, voir sa notoriété exploser. Extérieur nuit de Jacques Bral –elle est conductrice de taxi- la propulse. On est en 1980, à peine. Elle va, dès lors, passionner de très grands cinéastes, tel Michelangelo Antonioni dans Identification d’une femme ou se voir offrir des rôles âpres, tel celui d’Emma La Rouge dans Rue Barbare de Gilles Béhat, en 1982. Une interprétation qui lui vaudra le prix Romy Schneider. Elle est très demandée, au théâtre comme sur les plateaux. Elle n’arrête jamais. Elle n’arrêtera jamais et ce n’est pas à l’occasion de ce bref message, que nous reprendrons tous les titres. Des dizaines de films, de beaux rôles à la télévision, également, et sur les scènes de théâtre, des personnages magnifiques. Qu’elle rend magnifiques. Au cours de ce parcours, un moment plus intense que les autres : Harold Pinter l’admire. Il la dirige lui-même en une soirée inoubliable, au Rond-Point avec Lambert Wilson. Ashes to ashes, déchirant. On comprend que le dramaturge aime cette femme extraordinaire. Comme tiennent à elle Claude Régy, Otomar Krejka, Jérôme Savary, Gérard Desarthe, beaucoup d’autres beaux artistes. Elle a beau s’imposer une discipline dure, physiquement, intellectuellement, parfois elle craque. Elle bascule dans certains excès ; elle est dans un processus vertigineux d’autodestruction. Cela ne la rend pas toujours facile. Mais elle est aimée. Des années après Garrel, Lelouch, Boisset, Chouraqui, Assayas, Laetitia Masson, Maïwenn Le Besco l’engage dans Le Bal des actrices, Eric Valette la dirige dans Une affaire d’état. Et, au théâtre, elle trouve sa famille. C’est celle de Jean-Marie Besset, en son royaume du sud, du Théâtre des Treize Vents de Montpellier aux délicieux sites de son pays natal, Limoux et son festival NAVA. Elle a le sentiment d’être au coeur d’une troupe. Elle travaille beaucoup. Elle est impressionnante. Si impressionnante et si vulnérable à la fois. Déchirante et inoubliable. Mais souriante aussi. Grâcieuse et souriante. Armelle Héliot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 24, 2024 5:30 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 23 oct. 2024 La comédienne revient au théâtre dans une pièce de Marguerite Duras tirée d’un fait divers où elle incarne merveilleusement une femme qui cherche avec son interrogateur les motifs d’un assassinat qu’elle a commis. Une heure s’est peut-être écoulée quand le beau rideau de fer un peu rouillé du théâtre de l’Atelier, devant lequel se joue l’Amante anglaise, se relève et laisse découvrir un plateau entièrement vide, une cage de scène dépouillée, riche de sa vétusté, pleine de poussière noire agglomérée, dont les fissures feraient passer les emblématiques Bouffes du Nord cramées pour un palace récemment rénové. On est face aux entrailles du théâtre comme devant un écorché ou quelqu’un qui se livre entièrement, sans aucun filtre. On distingue quelques cordes, des poulies, des trous dans les murs qui diffractent parfois des reflets dorés. Et c’est dans cet espace sans ornement qui pourrait être carcéral que Sandrine Bonnaire ou plutôt le personnage de Claire Lannes surgit à tout petits pas rapides, robe noire intemporelle, tête baissée, pour s’asseoir sur la chaise bistrot sur le devant de la scène où un interrogatoire l’attend. Par sa sobriété, son éclat, les variations extrêmement rapides et contrastées de ses émotions qui font parfois apparaître ses fossettes, sa légèreté intense, son regard, la comédienne est magnifique et elle est surtout exactement le personnage. Bribe de vérité Elle restera assise durant tout le temps restant, et quelque chose se ranime dans l’écoute. Ce n’est pas qu’on s’ennuyait, loin de là, dans cette mise en scène fort intelligente de Jacques Osinski. Mais on l’attendait, elle, cette Claire Lannes, qui depuis une soixantaine de minutes déjà faisait l’objet d’une conversation acérée entre son mari Pierre Lannes, joué par Grégoire Oestermann et un interrogateur non spécifié, installé dans le public, à la diction aussi envoûtante qu’urticante, celle de Frédéric Leidgens, qui, stylo noir à la main, détache lentement chaque syllabe. Claire Lannes a donc tué, découpé, puis jeté par-dessus un pont sur différents trains de marchandises les morceaux de sa cousine sourde et muette que son mari a installée à demeure pour qu’elle fasse le ménage et la cuisine. Marguerite Duras ne juge pas la criminelle. Elle l’invente à partir d’un fait divers ayant eu lieu en décembre 1949, qui la passionna tant lors du procès qu’elle écrivit trois versions de l’histoire, dont une première pièce, les Viaducs de la Seine-et-Oise, qu’elle renia au point d’en interdire l’exploitation. Dans le crime réel, une femme a tué son mari. Dans l’Amante anglaise, l’assassinat est donc celui de la tierce personne, handicapée qui supplée à l’absence de talent culinaire et ménager de l’épouse. Pourquoi Claire Lannes a-t-elle tué sa cousine ? La meurtrière l’ignore, mais elle est aussi intéressée que l’interrogateur d’en saisir les motifs, de tirer son propre crime au clair. Où a-t-elle mis la tête qu’elle n’a pas jetée avec le reste des paquets ? Claire Lannes gardera son secret, mais dans l’histoire vraie, elle avait été jetée dans une bouche d’égout, oreilles coupées pour qu’elle passe. Par ses questions, l’interrogateur peut aussi bien appartenir à la sphère judiciaire – un juge d’instruction, un policier – qu’être un médecin psychiatre chargé de l’expertiser. Mais le plus souvent, on le confond avec Marguerite Duras elle-même tant sa manière de manier l’entretien et les réponses géniales qu’il suscite rappellent Outside et le Monde extérieur, deux recueils qui reprennent les entretiens parus dans la presse de l’écrivaine avec des enfants, un funambule, une carmélite. «Pourquoi l’avez-vous tuée ?» «Si j’avais su le dire, vous ne seriez pas là à m’interroger. Pour le reste, je sais.» L’interrogateur revient à la charge quelques minutes plus tard : «On ne vous a jamais posé la bonne question sur ce crime ?» «Non. Si on me l’avait posée, j’aurais répondu.» Et cette réponse merveilleuse : «Vous savez, monsieur, sur ce banc, à force de rester immobile, j’avais des pensées intelligentes. Ma bouche était comme le ciment du banc.» Et l’air de rien, peu à peu ce ciment se désagrège. Le surgissement d’une bribe de vérité qui l’éclaire à elle-même fait advenir à Claire Lannes une émotion joyeuse. Face à l’Amante anglaise, on prend donc également une leçon d’interview. «Comment jouer la folie sans jouer l’évanescence» Quand elle a lu la pièce, Sandrine Bonnaire a pensé à trois personnes, «une fictive et deux réelles» confie-t-elle lorsqu’on la rencontre chez elle, le lendemain. La fictive, c’est Sophie dans la Cérémonie de Claude Chabrol, qui, tue avec la postière jouée par Isabelle Huppert, la famille bourgeoise qui l’emploie. La seconde, c’est Sabine, sa sœur autiste sur laquelle Sandrine Bonnaire a réalisé un documentaire impressionnant, Elle s’appelle Sabine, et qui lui rappelle «comment jouer la folie sans jouer l’évanescence». Et la troisième, «c’est ma mère, qui avait cette même légèreté enfantine tout en étant très responsable, et qui comme Claire Lannes avait connu une grande passion dont elle était nostalgique, avant son mariage». Trois êtres aussi intimes qui traversent un personnage sont une bonne raison de revenir au théâtre que Sandrine Bonnaire avait déserté depuis une dizaine d’années. Elle fait cependant des lectures musicales avec son compagnon, le musicien de jazz et compositeur Erik Truffaz. Depuis le début des représentations, Sandrine Bonnaire arrive au théâtre en même temps que ses partenaires de jeu, pour «les embrasser, les encourager» et saisir le rythme qui peut varier d’un soir à l’autre. Elle profite de son temps d’attente pour revisiter furtivement son texte. «Ne bougeant pas sur le plateau, seule, je ne peux pas me raccrocher à la mémoire corporelle.» C’est «le souvenir de la place des mots dans la page» qui aiguise sa mémoire. Le premier soir, avant de jouer, elle a cru que le texte s’était évaporé, elle ne savait plus rien, et il a suffi qu’elle entre sur le plateau, pour s’apercevoir que le texte faisait partie d’elle, qu’il s’était logé en elle sans qu’elle n’y prenne garde. Anne Diatkine / Libération L’Amante anglaise de Marguerite Duras, mise en scène de Jacques Osinski, au théâtre de l’Atelier (75018) jusqu’au 31 décembre, puis en tournée. https://www.theatre-atelier.com/event/lamante-anglaise-2025/ Légende photo : Sandrine Bonnaire dans «l'Amante anglaise», mis en scène par Jacques Osinski. (Pierre Grosbois)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 22, 2024 1:20 PM
|
Par Véronique Hotte dans WebThéâtre - 20 oct. 2024 Une exploration éloquente de la condition ignorée d’une femme en 1968. Après l’emblématique Fin de Partie de Beckett, Jacques Osinski s’empare d’un autre grand classique, L’Amante anglaise de Marguerite Duras. Inspiré d’un fait divers authentique, ce thriller psychologique autour de la personnalité énigmatique de Claire Lannes invite le spectateur à explorer les méandres de l’âme humaine. Le fait divers concerne le meurtre par Amélie Rabilloud de son mari, qui dépeça le cadavre et en évacua les morceaux un par un en les jetant depuis un pont dans différents trains. Duras en écrivit une pièce, les Viaducs de la Seine-et-Oise, puis un roman L’Amante anglaise, qu’elle re-transforma en pièce de théâtre - une forme nouvelle et radicale sans nul décor ni costume. « Un théâtre à l’état pur », selon le metteur en scène Jacques Osinski, qui oeuvre à « comprendre l’in-comprenable ». Dans le fait divers, Amélie Rabilloud a tué un mari tyrannique. Dans la pièce, le mari est vivant, et le meurtre de Claire Lannes concerne sa cousine sourde et muette. Sans raison apparente, « en tuant la sourde muette, c’est tout ce qu’elle ne peut dire que Claire tue », écrit le metteur en scène. Pierre Lannes, le mari, et Claire Lannes investissent la scène, successivement, séparément, assis sur leur chaise, à découvert, démunis, entiers, disponibles, face à l’Interrogateur qui intervient depuis la salle - un reflet du public -, « passeur » fervent, désirant savoir, sans sans juger, tendu par la quête de sens. Beckett, Duras, le questionnement est le même, à travers le verbe et la parole d’un être en dialogue intérieur avec soi, dans l’attente, le silence, l’isolement. Opacité et transparence, évidence « claire » des mots simples, précis et approximatifs, qui ourlent la pensée de celle qui réfléchit à part soi, sans écho. Dans un lien distendu au monde, avec une rare résonance profonde, depuis cette énigme existentielle des rapports de soi avec les autres, sur scène et dans la salle, advient pas à pas le cheminement d’une révélation que l’art du théâtre consent. Il y eut l’événement fondateur de ce qui révéla l’être-au monde de Claire, l’amour fou éprouvé pour l’agent de Cahors, ville dont elle est originaire, et qui la quitta, puis le mariage avec Pierre Lannes sans passion, et la vie dès lors à Viorne dans la circonscription de Corbeil, où la présence d’Alfonso, coupeur de bois, la réconforte. La voix off du fidèle Denis Lavant expose objectivement dans le prologue les faits et le crime, puis le mari - Grégoire Oestermann - survient précautionneusement d’une porte qui s’ouvre, depuis un mur de lointain rapproché de la salle. Il s’assied, à la fois humble et d’une dignité naturelle, s’attachant à élucider le geste de l’épouse. Duras, rapporte Jacques Osinski, définissait Pierre, tel un « petit-bourgeois haïssable », reconnaissant sa présence véritable, sans faux-semblant. L’acteur concentre à merveille - paroles et gestuelle - la difficulté d’expliciter toute motivation, ménageant doutes et suppositions, silences et sentiment de culpabilité. Frédéric Leidgens est le Maître des Jeux, paradoxalement discret et pudique dans cette traque systématique, jusqu’au-boutiste, mais pleine de tact, de la personnalité de la criminelle : tenue sobre et distinguée, délicatesse et prévention, voix profonde qui énonce ce goût affirmé, réitéré, revendiqué d’un art de dire qui résonne profond.
Quant à Sandrine Bonnaire pour Claire, elle est infiniment juste dans cette indétermination à se connaître, impuissante en même temps qu’intense, à l’écoute ultime de cet interlocuteur privilégié qu’elle aurait tant aimé rencontrer dans la suite de ses jours.
Le plaisir du public intrigué tient à cette quête patiente d’un théâtre épuré via l’écoute verbale de l’exemple énigmatique d’une errance existentielle éprouvée. Véronique Hotte / Webthéâtre L’Amante anglaise de Marguerite Duras (éditions Gallimard), mise en scène de Jacques Osinski, lumières Catherine Verheyde, costumes Hélène Kritikos, dramaturgie Marie Potonet. Avec Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann. Du 19 octobre au 31 décembre 2024, du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h, au Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dullin 75018 - Paris. Tél : 01 46 06 49 24, billetterie@theatre-atelier.com Crédit photo : Pierre Grosbois.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 5, 2024 10:14 AM
|
Par Kilian Orain dans Télérama - 5 nov. 2024 Joël Pommerat à la centrale d’Arles, Valérie Dassonville à Fleury-Mérogis… Des grands noms du théâtre s’invitent en prison pour créer, avec les détenus, des spectacles forts. D’où naissent, parfois, des vocations. «En prison, on trouve la quintessence du théâtre. » Voilà résumées par la metteuse en scène Valérie Dassonville les raisons de son choix de travailler en milieu carcéral. Elle est loin d’être la seule à le penser : ces dernières années, plusieurs auteurs et metteurs en scène ont investi les lieux de privation de liberté, bravant des difficultés – obtenir des autorisations d’accès, introduire du matériel, gérer des relations parfois difficiles avec les surveillants ou les détenus, pourtant sélectionnés par l’administration – qui en auraient rebuté plus d’un. Caroline Guiela Nguyen, Pascal Rambert ou Mohamed Bourouissa semblent, eux, y avoir trouvé un carburant pour leurs créations. L’exemple le plus emblématique est celui de Joël Pommerat. Depuis 2014, le metteur en scène collabore avec la maison centrale d’Arles (Bouches-du-Rhône), un établissement réservé aux peines les plus longues, aux détenus les plus durs. Sollicité par Christine Charbonnier, qui la dirige alors, il y trouve un nouveau souffle. « J’étais grillé, déprimé, à bout. Je n’avais plus goût au théâtre, explique-t-il. Je suis sorti de ma torpeur en fréquentant ces prisonniers, dont Jean Ruimi. » Ce dernier rencontre Pommerat lors de son transfert à Arles. Là, il soumet au metteur en scène son idée de monter une pièce qu’il écrirait. Débute une fructueuse aventure théâtrale, qui se prolonge encore puisque l’ex-détenu est devenu comédien à plein temps dans la compagnie de Pommerat. « Auparavant, je faisais du théâtre bourgeois, avec des bourgeois, pour des bourgeois. Grâce à cette expérience, j’ai élargi ce cadre et découvert d’autres corps, d’autres langages, des vécus différents. J’avais perdu la nécessité de créer, mais ces détenus m’ont poussé, jusqu’à me redonner foi dans le théâtre. Ils ont été une chance incroyable pour moi », confie le metteur en scène de 61 ans. À Arles, il a œuvré aux côtés de la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen. De leur collaboration naîtront deux pièces : Désordre d’un futur passé, en 2015 (écrite par Jean Ruimi), et Marius, inspirée du chef-d’œuvre de Marcel Pagnol et réécrite avec les détenus, autour de la question de l’évasion. Créée une première fois en 2017, cette dernière est à l’affiche en ce moment dans une nouvelle version. Joël Pommerat a aussi imaginé deux autres spectacles et Caroline Guiela Nguyen, un court métrage de fiction mêlant détenus et acteurs professionnels, Les Engloutis (2021). Elle n’a jamais oublié cette expérience arlésienne, « l’une des plus marquantes de [s] a vie ». « Je me rappelle l’angoisse qui m’a étreinte dès l’entrée en détention, ces portes à passer pour arriver dans une salle d’à peine 20 mètres carrés où nous répétions avec les détenus, raconte celle qui dirige le Théâtre national de Strasbourg depuis 2023. Le bruit causé par l’écho de toutes les voix mêlées était si intense que je me gavais de Doliprane en sortant. Mais je me souviens aussi qu’Arles était le seul endroit où j’avais envie d’être à ce moment, auprès de ces détenus pour qui le théâtre était devenu essentiel. » Essentiel, vraiment ? « Pendant les quatre heures de répétition, ils étaient plongés dans un autre espace-temps. Il n’était plus question pour eux que de la fiction sur laquelle on travaillait. Leur motivation était telle qu’elle semblait parfois dépasser la mienne ou celle de Joël. » Sans se connaître, artistes et détenus font naître de la poésie dans un lieu qui, a priori, ne s’y prête pas. Valérie Dassonville Pour Pascal Rambert, le travail en prison a été si fort qu’il ne souhaite pas renouveler l’expérience. Entre septembre 2021 et janvier 2023, il mène un projet avec son fils réalisateur au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne). Ils s’y rendent une ou deux fois par mois pour « écouter des détenus » et « rapporter les récits de vie qui s’y trouvent ». Il en a tiré Je te réponds, spectacle dans lequel six détenus racontent tour à tour l’enfermement, la douleur de ne pas être avec ses proches, les corps qu’on ne peut plus toucher, les visages à jamais figés dans les mémoires, les stratégies pour surmonter les années sans liberté… À leur manière, tous livrent un regard nouveau sur la détention. Le soir de la création, à Paris, « toute la salle des Bouffes du Nord était debout, bouleversée ». « Monter un spectacle en prison, c’est une promesse, avance Valérie Dassonville. Sans se connaître, artistes et détenus font naître de la poésie dans un lieu qui, a priori, ne s’y prête pas. Ça ne fonctionne pas toujours, le Covid ou les grèves du personnel pénitentiaire ont parfois bousculé les projets, mais quand on y arrive, c’est souvent d’une intensité rare. » La directrice artistique du Théâtre Paris-Villette sait de quoi elle parle. Après avoir dirigé plusieurs ateliers à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), plus grande prison d’Europe, elle a lancé, en 2016, le festival biennal Vis-à-vis, qui programme exclusivement des spectacles créés dans des établissements pénitentiaires. « Je crois que je suis allée chercher en prison une humanité commune. Je travaillais avec dix détenus, dans une toute petite pièce parfois dépourvue de chaise ou de table, dans une propreté très relative. Il fallait vraiment en avoir envie ! Dès lors, tout devenait possible. Un peu comme pour une histoire d’amour. » À lire aussi : “Là c’est pas du faux, c’est du réel” : un mois d’atelier d’écriture en prison avec Thomas B. Reverdy Des histoires, Zazon Castro et Mohamed Bourouissa en ont récolté plus d’une dizaine, dans une prison pour femmes en France –ils ne souhaitent pas révéler laquelle –, qu’ils donnent à voir dans un seule-en-scène intitulé Quartier de femmes. Mais, à l’inverse de beaucoup d’artistes, l’autrice et le metteur en scène ont engagé une comédienne professionnelle, Lou-Adriana Bouziouane (repérée dans la série La Fièvre), pour les incarner. « C’est un parti pris, tranche Mohamed Bourouissa. Ce spectacle raconte ce que c’est d’être une femme en détention : le contrôle plus fort que pour les hommes, la honte d’être en prison, la maternité. » « Et tout ça sur le mode de l’humour », complète Zazon Castro. Qu’il s’agisse de déjouer les clichés concernant les prisons, de donner de son temps à la société ou de venir y trouver un nouveau souffle, le travail opéré par ces metteurs en scène participe avant tout au renversement des perspectives. La prison y joue un rôle important, certes. Mais l’effet produit, lui, se glisse dans le sillage de n’importe quelle œuvre d’art. Trois pièces à voir actuellement. Je te réponds, texte et mise en scène de Pascal Rambert, les 3 et 4 décembre au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 10e. Marius, d’après Marcel Pagnol, mise en scène de Joël Pommerat (avec Caroline Guiela Nguyen), du 14 au 16 novembre au Théâtre des Louvrais, Pontoise, puis en tournée. Quartier de femmes, de Zazon Castro, mise en scène de Mohamed Bourouissa, du 5 au 17 novembre au Théâtre du Rond-Point, Paris 8e. Kilian Orain / Télérama Légende photo : Jean Ruimi (à droite), détenu à la prison centrale d’Arles, en 2017, répétant « Marius ». Il est libre aujourd’hui, et le théâtre est devenu son métier. Christophe Loiseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2024 4:08 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 3 nov. 2024 Proposer au public de combiner la visite d’une exposition et la participation à une chorégraphie séduit de plus en plus les musées. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/03/quand-la-danse-sort-du-cadre_6373637_3246.html
Les Nymphéas s’évanouissent dans la pénombre. Dans la salle ovale du Musée de l’Orangerie, à Paris, les panneaux aquatiques réalisés par Monet à la fin de sa vie, entre 1890 et 1926, se dissolvent en une nuée cosmique dont on ne perçoit plus les contours. Ils enveloppent une silhouette sombre, étrange et surdimensionnée qui semble s’extraire de l’environnement pour vivre sa vie. Deux ombres en émergent qui retournent bientôt se fondre dans la nébuleuse ambiante. Cette performance intitulée Figures, dansée et imaginée par Dalila Belaza avec Aragorn Boulanger, était à l’affiche, lundi 14 octobre, du cycle chorégraphique « Danse dans les Nymphéas ». Devant un public assis en demi-cercle sur des coussins, le rituel de métamorphose proposé par Belaza s’auréole de solennité. Le défi de se mesurer au chef-d’œuvre de Monet tapissant les murs courbes était ici presque gommé. « Je ne voulais pas me laisser piéger dans cet écrin et que les Nymphéas servent de décor à mon geste, explique Dalila Belaza. En les obscurcissant – ce qui n’a apparemment jamais été fait auparavant –, il s’agit pour moi de trouver un équilibre entre eux et mon travail. L’atmosphère des toiles, en revanche, et le lieu créent une résonance particulière et ouvrent un nouveau récit à ma pièce. » Ce fondu au noir est effectivement une première dans le cadre de cette opération lancée en 2018 qui a vu défiler des stars comme Carolyn Carlson, la Canadienne Marie Chouinard, habituée des musées au Canada et aux Etats-Unis, ou encore l’Israélienne Sharon Eyal. « Jusqu’à présent, les panneaux peints de Monet étaient toujours mis en lumière et en mouvement par les chorégraphes, tant ils sont émerveillés de se confronter à ce chef-d’œuvre connu dans le monde entier, glisse Isabelle Danto, programmatrice. C’est un espace inspirant même si très intimidant. Danse et peinture fonctionnent le plus souvent en vases communicants entre contemplation et action. » Challenge excitant Ce rendez-vous à l’Orangerie, très couru par le public, prend place dans un agenda muséal, en France comme à l’étranger, de plus en plus blindé par des pièces chorégraphiques en tout genre. D’Orsay au Louvre en passant par le Centre Pompidou, à Paris, de la Tate Modern, à Londres, au MoMA, à New York, qui possède, par ailleurs, un département dévolu à la performance et à la danse, la programmation de spectacles fait désormais partie de la routine et prend de l’ampleur depuis une dizaine d’années. « La danse se cherche toujours de nouveaux territoires », explique Isabelle Danto. Sollicités par les institutions, les chorégraphes, très en demande également, répondent présent. Créations spécialement conçues pour le lieu, adaptations de pièces déjà existantes, opérations participatives, présence permanente dans les galeries : révéler le mouvement en l’incrustant devant des œuvres d’art se révèle un challenge terriblement excitant. Le phénomène ne date pas d’hier. Quelques dates emblématiques scandent l’histoire croisée de la danse et du musée. En 1905, Mata Hari est dans la bibliothèque de Guimet, à Paris. En 1964, la tête chercheuse Merce Cunningham (1919-2009) prend d’assaut le Museum des 20. Jahrhunderts, à Vienne. Trois ans après, Anna Halprin (1920-2021) investit le Museum of Modern Art, à San Francisco, puis le Berkeley Art Museum, en 1970. Plus récemment, à Paris, le dispositif « Chaillot nomade », créé en 2001 par Agnès Chemama, alors directrice des publics et conseillère à la programmation de Chaillot-Théâtre national de la danse, a égrené de multiples performances de chorégraphes au Louvre, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, ainsi qu’au Musée de l’homme. « Rencontrer un nouveau public » Du côté des institutions, les enjeux s’additionnent. Pour Antonine Fulla, directrice de la programmation culturelle et des auditoriums à l’Orangerie et à Orsay, qui a invité, en 2024, Josépha Madoki, experte en « waacking », et Mourad Merzouki, figure de la scène hip-hop, à Orsay, « il s’agit de faire dialoguer des œuvres anciennes avec la création contemporaine afin de prouver que les premières ont encore beaucoup de choses à nous dire aujourd’hui ». Elle poursuit : « Faire bouger l’air en quelque sorte autour des peintures permet un autre point de vue en leur apportant une vitalité nouvelle. Le mouvement leur offre une troisième dimension. » Parallèlement, « les institutions ont besoin des regards des artistes pour évoluer, et la danse permet de rencontrer un nouveau public », ajoute Luc Bouniol-Laffont, directeur de l’auditorium et des spectacles au Louvre. « C’est un apport absolument nécessaire afin que le Louvre, avec ses 30 000 visiteurs par jour, ne devienne pas qu’un musée pour touristes et s’enferme là-dedans, insiste-t-il. C’est le risque que nous courons, et les propositions de performances, comme les concerts qui s’y déploient, permettent aux visiteurs de proximité de se réapproprier le Louvre et d’en faire un Louvre qui leur ressemble. » Au Louvre, avec la complicité du Festival d’automne, à Paris, après Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret, qui ont conçu la déambulation Forêt, en 2022, puis Jérôme Bel et Estelle Zhong Mengual, pour Danses non humaines, en 2023, c’est au tour de François Chaignaud de se saisir de la carte blanche lancée par Luc Bouniol-Laffont. Avec Petites joueuses, pour treize danseurs et chanteurs, conçue en écho à l’exposition « Figures du fou », il répond en biais à cette luxueuse commande. « Le Louvre est une machine à fabriquer des grands noms, souligne-t-il. En tant qu’artiste vivant, s’y confronter, c’est consentir à se soumettre à tout ce système de valeurs et de hiérarchies que le Louvre consacre et naturalise. C’est problématique, vertigineux et un peu effrayant. » Pour éviter ce piège, ainsi que celui de devoir « imaginer une danse dont le seul enjeu est de dialoguer avec un tableau », il rend hommage aux « petites joueuses » de l’art dans le Louvre médiéval, un lieu brut, rude, qui donne à voir les fortifications du château, excavées au moment de la construction de la Pyramide. « Cette zone étrange, presque une sorte de non-lieu, semble le seul espace du Louvre sans œuvres, raconte Chaignaud. Pourtant, en regardant bien, on découvre des signatures, mais pas celles des grands maîtres consacrés par l’histoire de l’art. Sur les pierres apparaissent des cœurs ou des croix, qui sont les marques laissées par les tailleurs pour se faire payer. Ces signes me bouleversent, ils conservent la mémoire du travail et de l’effort musculaire de ces tâcherons et dialoguent ainsi avec l’art que nous inventons. » Parallèlement à cette immersion d’une durée d’environ trois heures trente, on peut aller admirer l’exposition « Figures du fou ». Un formidable appel d’air Si ces dispositifs exigent notamment la mise en place de nouveaux protocoles de sécurité, ils dégagent un formidable appel d’air. Pour le public, qui fait d’une pierre deux coups, ils rafraîchissent l’usage de la balade au musée et la vision du geste chorégraphique. Un hybride surgit, mi-spectateur, mi-visiteur, qui circule en filmant librement, portable au poing. Cette saveur ludique et animatoire reflète bien l’air du temps. Quant aux interprètes, qui doivent aussi intégrer les déplacements et les humeurs des gens, ils apprécient cette bascule hors du plateau qui casse le quatrième mur. « Sortir de la boîte noire et entrer dans l’intimité des spectateurs, les voir de très près, est vraiment formidable », s’enthousiasme Carolyn Carlson. Fraîchement arrivée sur le terrain, la Fondation groupe EDF affiche, depuis vendredi 18 octobre, une série de pièces autour des œuvres liées à la lumière de sa collection permanente (Raoul Dufy, Man Ray…). Sous la direction d’Agnès Chemama, certaines se déroulent au milieu des œuvres ; d’autres dans une petite salle entourée par le public, qui va flâner ensuite dans la galerie. « Au regard de la dimension sociale de la fondation et des nombreuses associations avec lesquelles nous collaborons, la danse est, selon nous, un réel facteur d’émancipation, affirme Alexandre Perra, délégué général de la fondation. C’est pour cela que, parallèlement à leurs créations, les chorégraphes mènent aussi des ateliers. » Carolyn Carlson travaillera avec des réfugiés tandis que Jann Gallois retrouvera des jeunes gens sur la question des troubles alimentaires. Une soirée clubbing, dont la moitié des tickets sera proposée gratuitement aux associations, est annoncée pour samedi 16 novembre. Regarder la danse et danser soi-même au musée. Cycle « Danse dans les Nymphéas ». Musée de l’Orangerie, Paris 1er. Jusqu’au 2 juin 2025. Petites joueuses, de François Chaignaud. Musée du Louvre, Paris 1er. Du 4 au 16 novembre. Dans(e) la lumière. Fondation groupe EDF, Paris 7e. Jusqu’au 31 janvier 2025. Rosita Boisseau / LE MONDE Légende photo :François Chaignaud pendant une répétition de « Petites joueuses », au Louvre, à Paris, en juin 2024. FLORENCE BROCHOIRE/MUSÉE DU LOUVRE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 3, 2024 11:04 AM
|
Propos recueillis par Sandrine Blanchard / Le Monde - 3 nov. 2024
« Je ne serais pas arrivé là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Le directeur du Théâtre national de la Colline, à Paris, revient sur son enfance marquée par la guerre civile au Liban.
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/03/wajdi-mouawad-dramaturge-l-exil-m-a-apporte-le-desir-et-la-curiosite-d-aller-vers-l-autre_6373295_3246.html Metteur en scène, dramaturge, comédien, Wajdi Mouawad dirige, depuis 2016, le Théâtre national de la Colline, à Paris, voué aux écritures contemporaines. A 56 ans, cet auteur libano-canadien, dont la famille a vécu deux exils, y présente, jusqu’au 22 décembre, sa pièce Racine carrée du verbe être. Je ne serais pas arrivé là si… … Si, en 1983, ma famille était partie, comme c’était convenu, vivre au Texas. Après cinq années passées en France pour fuir la guerre civile au Liban, nous n’avions pas obtenu le renouvellement de nos cartes de séjour. La situation libanaise était si épouvantable qu’y retourner n’était pas envisageable. Mon père a alors fait une demande d’immigration pour que nous puissions rejoindre deux de mes tantes et oncles, installés aux Etats-Unis, en banlieue éloignée de Houston. Mais, au même moment, une nouvelle loi texane interdisait les enfants de famille de migrants âgés de plus de 24 ans d’entrer sur le territoire. Or, ma sœur avait 25 ans. Pour ma mère, il était hors de question de partir sans elle. Il a fallu trouver une solution rapidement. Ce fut Montréal, où nous avions aussi une tante. A cette époque, c’était très « simple » d’immigrer au Canada. Pourquoi les Etats-Unis auraient-ils tant modifié votre destinée ? D’abord, il aurait fallu changer de langue, passer du français à l’anglais, alors que je n’étais pas très bon à l’école. Ensuite, ma famille n’était pas portée sur les arts. Je n’aurais pas fréquenté le monde culturel, je ne serais devenu ni auteur ni metteur en scène. J’aurais sans doute choisi un chemin professionnel très différent, comme mes cousins, qui ont travaillé à l’aéroport ou dans la restauration. La banlieue où nous aurions vécu a voté à 87 % pour Donald Trump en 2020. Quels souvenirs gardez-vous de vos dix premières années au Liban ? Mon enfance libanaise a plutôt été heureuse. Je n’étais pas un enfant sensible, doué d’empathie. Je ne pensais qu’à jouer et à être avec mes copains. Il y avait des bombardements, mais j’étais comme un bout de bois, les événements choquants ne me pénétraient pas. J’allais vers mon plaisir, ça m’a étrangement protégé. J’étais inconscient, je ne voyais pas ce que mes parents subissaient. Je voulais faire comme les grands. J’avais hâte d’avoir une Kalachnikov, de pouvoir moi aussi être un milicien. Ça me fascinait de les voir. Je voulais, comme eux, être un combattant. En 1978, la guerre civile au Liban pousse votre famille à l’exil… Mes parents ne voulaient pas quitter le Liban. Ce qui a provoqué notre exil, ce n’est pas la guerre, mais l’école. A cause des bombardements et des conflits, nous étions sans cesse obligés de changer d’établissement. Mes parents ne supportaient pas que notre éducation scolaire soit perturbée. Mon père, né sous le mandat français, est le premier de sa famille à avoir été alphabétisé. Grâce à ma grand-mère paternelle, qui obligeait ses enfants à étudier plutôt que de les envoyer travailler, il est allé jusqu’au brevet, est devenu comptable puis représentant commercial dans le domaine du plastique, et est sorti de la misère. Pour mon père, l’école était la valeur essentielle, la plus importante. Il n’était pas question que nos études soient affectées par la guerre. Comment s’organise le départ de votre famille pour la France ? C’était l’été, nous étions dans un village du Chouf [région au sud-est de Beyrouth]. Un matin, un avion de chasse syrien est passé à basse altitude au-dessus du village, et les vitres de la maison ont explosé. Ma mère a dit : « On part, tout de suite ! » Mon père, qui par précaution avait fait faire des visas pour la France et l’Italie, a envoyé mon grand frère acheter des billets d’avion : « Rome ou Paris, choisis le premier avion qui décolle. » Le lendemain de notre départ, l’aéroport fermait pour six mois. Mes parents ont profité d’une loi française de 1978 qui permettait aux familles libanaises de s’installer en France sans permis de travail, mais avec la possibilité d’inscrire leurs enfants à l’école publique. Mon père a envoyé notre famille à Paris, où habitait un de mes oncles, et lui est resté au Liban pour travailler. La seule chose qui m’angoissait dans ce départ, c’était la langue. Je ne parlais du tout français. Nous sommes partis dans l’idée de rester trois mois en France, mais le conflit au Liban a duré, et finalement nous sommes restés cinq ans. A l’issue de ces cinq années, nous devions renouveler nos permis de séjour. Ma mère m’a emmené à la préfecture. Une fonctionnaire lui a demandé sa date de naissance. Ma mère a répondu : « 32. » La dame lui a dit : « 1932 ? » Et là, ma mère a pété un câble, comme si les cinq années d’inquiétude et d’angoisse qu’elle venait de vivre explosaient. Résultat : refus de rester sur le territoire. Votre arrivée à Paris correspond à votre « entrée dans le tragique », dites-vous. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? Ma mère, son inquiétude. Elle ne supportait pas de savoir mon père au Liban et de ne pas avoir de nouvelles. Les lignes téléphoniques étaient coupées. Nous n’avions que les informations des journaux télévisés de 20 heures : « Bombardement à Beyrouth, le quartier chrétien a été fortement touché »… Ma mère devenait folle, violente. Je vivais une schizophrénie entre notre appartement et l’école, où j’étais avec de petits Parisiens qui n’avaient aucune notion de ce qui se passait à la maison. Sortir de chez moi, c’était sortir d’un hôpital psychiatrique. Paris fut la fin de l’enchantement parce que, tout à coup, je prenais conscience qu’on était une famille malheureuse. J’ai redoublé mon CM2, puis, au collège, tout s’est mieux passé. J’avais des amis, je parlais très bien français, je devenais bon élève et je faisais du rugby. Mais il a fallu de nouveau partir… A 14 ans, comment vivez-vous ce nouvel exil ? J’ai beaucoup de peine, de chagrin. Paris, mes amis, le fait d’avoir réussi à m’intégrer, tout me manque. Quand on arrive au Québec, ma mère est malade, il fait − 30 °C, les gens parlent un autre français que celui que j’ai appris, ils font du hockey et ne connaissent pas le rugby. Mais ce nouvel exil est une chance phénoménale par rapport aux Libanais qui sont restés au pays. Donc je n’ai pas le droit de me plaindre. On n’a pas d’argent, alors je distribue les journaux, le matin, aux abonnés. Je suis mauvais à l’école, mes parents m’engueulent : « Pourquoi on a fait de tels sacrifices si c’est pour que tu aies des notes pareilles ? » J’ai une image qui illustre ce que je vis alors : c’est comme si une première avalanche vous avait recouvert, vous réussissez à vous en sortir mais, à peine rescapé, une autre avalanche vous tombe dessus. Je n’ai plus le courage de m’intégrer à nouveau. Je ne fais plus aucun effort, je sèche les cours, passe des journées entières au cinéma, le seul endroit où je me sens bien. Puis je suis renvoyé du lycée. Pourquoi candidatez-vous à l’Ecole nationale de théâtre du Canada ? Ma mère est en train de mourir d’un cancer. Je sais que je n’aurai jamais mon équivalent du bac, je n’ose rien dire à mes parents, je ne trouve pas de solution. Et, un jour, je passe devant l’Ecole nationale de théâtre – j’en avais fait un peu au lycée. J’entre dans l’établissement et découvre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le bac pour candidater ! Je trouve ça génial. Je m’inscris et je suis retenu à l’issue de la première audition. Pour être définitivement admis, je dois réussir un stage de cinq jours. Quand je découvre la feuille des résultats, mon sang se fige, ma vie se joue là. Je vois un « W », je sais qu’il n’y avait que moi avec un « W » dans son prénom. J’ai hurlé, un hurlement qui venait de loin ! Ma mère n’a jamais su que j’allais intégrer cette école. Je lui ai dit que j’étais pris dans une université en lettres. Je ne voulais pas entrer en conflit avec elle. Elle est morte trois mois plus tard, le 17 décembre 1987. Votre mère n’aurait pas été heureuse de vous savoir admis dans cette école ? Je ne serais pas arrivé là si ma mère n’était pas morte. Une grande partie de mon bonheur d’aujourd’hui repose sur d’anciens malheurs. Cela est très long à assumer. Ma mère, très conventionnelle, ne m’aurait jamais permis de faire du théâtre, parce qu’elle ne supportait pas la vie d’artiste. Pour elle, c’étaient des incapables, qui ne gagnaient pas leur vie, c’était la perdition. Mes parents – ma mère chrétienne orthodoxe, mon père chrétien maronite – étaient issus d’un milieu extrêmement conservateur. Quand ma mère est décédée, tout est parti aux quatre vents parce qu’elle était la force, le socle de la maison. Je me suis installé en colocation avec des copains. Ce fut le début de mon émancipation. D’où votre passion pour la mythologie et la tragédie grecques vient-elle ? Elle vient d’un autre « si » majeur, peut-être finalement le plus important : je ne serais pas arrivé là si je n’avais pas rencontré François Ismert. J’avais 22 ans, lui, 44. A cette époque, il était réalisateur à Radio Canada. Au cours d’une émission consacrée aux relations entre les différentes générations artistiques, à laquelle on m’a demandé de participer, arrive la question « comment définiriez-vous le rôle de l’artiste ? ». Je ne sais pas trop quoi répondre et dis : « Ça me fait penser à une phrase de Kafka : “Dans ton combat contre le monde, seconde le monde.” » Trois jours plus tard, je trouve un message de François Ismert sur mon répondeur : « J’ai été touché par ce que vous avez dit à propos de Kafka, pourrions-nous prendre un café ensemble ? » On s’est rencontrés et on a beaucoup échangé. Il me parlait de littérature avec une liberté de pensée et d’esprit comme je n’en avais jamais connu. Il me disait : « Le travail n’est pas une valeur. Une valeur, c’est le courage, la liberté, l’égalité. » Il me fait lire l’Iliade et l’Odyssée, il me pousse à écrire, me dit de ne pas douter. C’est lui qui me donne confiance. Il m’engage pour lire des textes à la radio, et me demande d’interroger des personnes de mon âge sur ce que c’est d’être jeune. On en fera une émission. De cette émission est née l’idée de ma première pièce, Littoral [Actes Sud, 2009], d’où va émerger tout mon travail de théâtre. François m’a révélé. Qu’est-ce que l’exil vous a le plus apporté ? Le désir et la curiosité d’aller vers ce qu’on m’a appris à détester, c’est-à-dire l’étranger, l’autre. Comme beaucoup de Libanais, j’ai été éduqué à croire que ceux qui n’étaient pas comme moi étaient menaçants, que nous étions les victimes et que les autres étaient les bourreaux. J’ai eu le désir d’aller vers les sunnites, les chiites, les Palestiniens, les Israéliens, les juifs, tous ceux qu’on m’a appris à détester. Non seulement j’ai eu envie de les connaître, mais j’en ai fait les personnages principaux de mes pièces. La question de la réconciliation, de la concorde, est vraiment venue par l’exil. Que ressentez-vous face au retour de la guerre au Liban ? La bestialité seule a droit à la parole. La légitimité des dirigeants à conduire les Etats semble être leur capacité à la brutalité. La bestialité règne. Celle du 7 octobre 2023, celle de la destruction de Gaza, de ses 43 000 morts, celle que subissent les otages israéliens, celle de la colonisation de la Cisjordanie et celle, aujourd’hui, de la destruction systématique du Liban. Depuis un mois, Israël tape sur les musulmans et protège les chrétiens avec le désir de moins en moins voilé que le Liban sombre à nouveau dans une guerre civile. Il suffira pour cela qu’Israël arme les milices à mesure que le Hezbollah se fissure. Nourris par un sentiment d’impunité, tous ces meurtriers, Benyamin Nétanyahou [le premier ministre israélien] en tête de ce macabre peloton, s’adonnent à une boucherie avec d’autant plus de jouissance que chacun est convaincu d’être innocent, de se tenir du bon côté de la justice et d’être la pauvre victime, revendiquant pour soi le droit à la destruction impitoyable de l’autre, et qu’importent les dommages collatéraux. C’est le sentiment d’une déshumanisation qui se pense morale. Avec la probable victoire de Donald Trump, nous allons entrer dans une ère où la violence comme mode d’expression va se dessiner comme un droit allant de Washington à Moscou, de Tel-Aviv à Téhéran, de Pékin à Washington. Le cercle se referme sur notre époque. Entre la crise climatique et la crise géopolitique, la faillite de cette époque est d’autant plus abyssale que nous élisons ceux qui voient cette faillite comme une victoire. Nous allons devoir faire preuve d’une grande solidarité pour passer à travers le cloaque qui approche et continuer à poser des gestes, si petits soient-ils, pour sauvegarder notre rapport à l’autre. Un rapport où la bonté et l’affection, comme des insectes en voie de disparition, devront être préservées pour être repollinisées plus tard. Sans doute pas de notre vivant. Pour nous, je crains qu’il soit un peu trop tard. « Racine carrée du verbe être », texte et mise en scène de Wajdi Mouawad, jusqu’au 22 décembre au Théâtre national de la Colline, Paris 20e. Sandrine Blanchard /LE MONDE Légende photo : Wajdi Mouawad, en 2022. ERWAN-FLOCH

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 1, 2024 4:29 AM
|
Par Sonya Faure dans Libération - 31 oct. 2024 La pièce pour enfants aborde avec finesse et humour la disparition des proches. «Mustapha, ton papa a eu un accident.» Ainsi commence OISEAU, présenté ces jours-ci au Théâtre Paris-Villette et qui entame une longue tournée. Un spectacle jeunesse qui parle de la mort, des morts et de la manière dont la plupart d’entre nous les ignore. D’ailleurs dans OISEAU, les défunts ont de sérieuses récriminations à nous faire. Et d’une, les vivants que nous sommes sont inconséquents : on pleure, on s’échine à dire qu’on ne veut pas que les gens qu’on aime meurent, mais une fois qu’ils ont passé l’arme à gauche, voilà que nous faisons comme s’ils n’existaient pas. Or les morts existent. Et de deux, quel ami digne de ce nom oserait offrir à l’un de ses proches des livres en porcelaine et des fleurs en tissu fané du genre de ceux dont on orne les tombes ? Mais reprenons par le début. Au début, le père de Mustapha meurt. A l’école, le garçon rencontre Pamela, elle aussi marquée par le deuil (celui de Calamar, son chien) et la «petite Françou» qui connaît des êtres qui peuvent emmener les vivants «de l’autre côté». C’est le début d’une grande confrérie à l’école – «Si tu aimes tes morts, viens avec nous.» Les enfants se mettent à organiser une grande fête dans le cimetière, avec du surimi et des Oréo, graffent les murs («Police partout, nos morts nulle part») et partent, la nuit, depuis leur lit, retrouver leurs défunts (et ceux des autres). Sous le regard sévère et interdit de la directrice, pour qui la mort n’est tout de même pas un jeu d’enfants (et pourtant) et les yeux éternellement larmoyants de leur institutrice (mais que cachent donc ces pleurs à la fin ?). Sur scène, jouant du décalage, deux actrices bien plus âgées que ces collégiens (Kate France et Sofia Hisborn) jouent et disent tous les rôles du texte d’Anna Nozière, publié aux Editions théâtrales, qui travaillait lui aussi la distance en recourant au style indirect (c’est Mustapha et Pamela qui racontent). On avait admiré la finesse et l’humour de cette pièce de théâtre, on en apprécie maintenant l’intelligence de la mise en scène, par Anna Nozière elle-même, jouant de tous les codes du théâtre et de la vidéo, notamment, qui fait surgir de belles images d’enfants au cœur du spectacle. Sonya Faure / Libération OISEAU, d’Anna Nozière, jusqu’au 3 novembre au Théâtre Paris-Villette, puis les 15 et 16 novembre au théâtre Claude Debussy de Maisons-Alfort (94), les 20 et 21 novembre au théâtre Jean-François Voguet de Fontenay-sous-Bois, du 28 au 30 novembre au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin, les 10 et 11 décembre au théâtre Jean-Vilar de Vitry sur Seine, puis en 2025 à Verdun, Angers, Nanterre, Sartrouville, Lorient, Marseille etc

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2024 5:00 PM
|
Publié sur le site d' ARTCENA - 28 octobre 2024 ÉTUDE Si le Baromètre publié par l’OPC atteste de budgets culturels stables au sein des collectivités territoriales, le contexte inflationniste suscite néanmoins des inquiétudes. Chaque année, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) publie son Baromètre, qui explicite les budgets dont disposent les collectivités territoriales pour mener à bien leur politique culturelle, et les choix qu’elles opèrent. Son enquête s’appuie en 2024 sur les données transmises par un échantillon de 202 collectivités, contre 179 l’an passé, ce qui lui permet d’offrir des résultats très complets pour les différents échelons territoriaux. Ce sont ainsi 13 Régions, 68 Départements, Chaque année, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) publie son Baromètre, qui explicite les budgets dont disposent les collectivités territoriales pour mener à bien leur politique culturelle, et les choix qu’elles opèrent. Son enquête s’appuie en 2024 sur les données transmises par un échantillon de 202 collectivités, contre 179 l’an passé, ce qui lui permet d’offrir des résultats très complets pour les différents échelons territoriaux. Ce sont ainsi 13 Régions, 68 Départements, 73 communes de plus de 50 000 habitants (dont 23 communes de plus de 100 000 habitants et 50 communes de moins de 100 000 habitants), 45 intercommunalités (dont 19 métropoles, 3 communautés urbaines et 23 communautés d’agglomération) et 3 collectivités d’outre-mer à statut particulier qui ont communiqué leurs budgets primitifs et fait part de leur positionnement culturel. À noter, par ailleurs, que cette édition du Baromètre comporte un Focus inédit sur deux préoccupations actuelles majeures : la transition écologique et les entraves à la liberté de création et de diffusion. Une stabilité des budgets mais des inquiétudes L’examen des évolutions des budgets (budgets primitifs totaux, budgets culturels de fonctionnement et d’investissement), des emplois et des subventions culturels des collectivités entre 2023 et 2024 témoigne, comme sur la précédente période observée (2022-2023), d’une stabilité. « Le cumul des réponses indiquant une hausse est supérieur à celui des déclarations de baisses », ajoutent les auteurs de l’enquête. Au regard des flambées inflationnistes, ce maintien ne saurait toutefois dissiper les inquiétudes exprimées par plusieurs Directeurs et directrices des affaires culturelles (Dac), qui « insistent dans leurs réponses sur le contexte financier dégradé de leur collectivité, avec des perspectives pessimistes pour l’avenir » ; notamment, adaptation aux contractions budgétaires oblige, « la reconfiguration ou l’arrêt de certains dispositifs de soutien ». S’agissant des budgets primitifs culturels de fonctionnement (hors masse salariale), la stabilité prévaut également pour 49% des collectivités et intercommunalités – contre 43% l’année précédente. 30% indiquent une augmentation (en retrait de 8 points par rapport au Baromètre 2023) et 21%, une baisse. La situation apparaît plus dégradée pour les Régions (plus de deux fois plus de baisses) et pour les Départements. La part des Départements ayant baissé leurs budgets de fonctionnement a en effet doublé, passant de 9% dans le Baromètre 2023 à 20% dans l’enquête 2024, tandis que celle des Département les ayant augmentés chute de 49% à 27%. Les intercommunalités sont les plus nombreuses à déclarer une augmentation entre 2023 et 2024 : 34% de l’échantillon des communautés urbaines et d’agglomération (au lieu de 20% précédemment) et 42% de métropoles (contre 39% sur la période antérieure). Encourageantes sont les réponses apportées par les communes de plus de 50 000 habitants, le pourcentage de celles indiquant baisser leur budget primitif culturel de fonctionnement étant passé de 34% dans la précédente enquête de 2023 à 21% aujourd’hui. « C’est une indication importante au regard de la structuration budgétaire des politiques culturelles, fait valoir l’OPC, puisque le bloc communal représente environ 80% des dépenses culturelles des collectivités territoriales, devant les Départements (12%) et les Régions (9%). » L’évolution des budgets de fonctionnement par domaine d’intervention culturelle cette fois montre que les augmentations les plus fréquentes concernent les festivals et événements, l’Éducation artistique et culturelle (EAC), comme constaté en 2023. Les baisses, quant à elles, se répartissent de manière plus homogène entre les domaines que l’an passé, période durant laquelle le spectacle vivant apparaissait très impacté.
En ce qui concerne à présent les budgets culturels d’investissement, la stabilité prédomine là encore : 42% des collectivités et des intercommunalités l’indiquent entre 2023 et 2024. 37% signalent une augmentation, et 22% une baisse. Si les différentes catégories de collectivités sont affectées par des baisses entre 2023 et 2024, les métropoles en pâtissent le plus. Elles sont ainsi davantage à diminuer leur budget culturel d’investissement cette année, et moins nombreuses à l’augmenter qu’entre 2022 et 2023. À l’inverse, les Régions et les communes sont celles qui affichent le plus d’augmentations en investissement. Enfin, les montants alloués aux associations culturelles ont, eux aussi, peu varié entre 2023 et 2024 pour près de 60% des collectivités. On observe néanmoins des disparités. Les Départements se distinguent de façon négative en mentionnant le plus grand nombre de baisses de subventions. En revanche, on constate davantage de hausses de la part du bloc communal (communes et intercommunalités). La politique culturelle, toujours une priorité Malgré le contexte morose, 67% des Dac interrogés (contre près de 60% en 2023) considèrent que la politique culturelle constitue autant une priorité qu’avant pour leur collectivité et 23% qu’elle l’est même davantage – contre toutefois 30% en 2023, ce qui autorise l’OPC à parler de « légère érosion » de l’importance accordée à la politique culturelle. Comme l’an passé, les objectifs qui orientent prioritairement l’action publique culturelle des collectivité et intercommunalités sont l’accessibilité, l’EAC et le territoire. Des variations apparaissent cependant selon les échelons de collectivités : pour les Régions, ce sont les logiques territoriales, l’accès à la culture, la création artistique et les transitions qui arrivent en tête ; pour les Départements, le territoire et l’accès sont également prioritaires, devant l’éducation et la jeunesse et l’impact social ; pour les communes (dont la palette des registres prioritaires est la plus large), l’accès, l’éducation et la jeunesse dominent, bien que la démocratie culturelle y soit plus affirmée que dans d’autres collectivités ; les métropoles, quant à elles, sont surtout préoccupées par des logiques territoriales, souvent dans une perspective de rayonnement, « avec également une place notable des orientations visant à infléchir les pratiques de gouvernance et de coopération dans le secteur culturel, ainsi que d’y promouvoir des principes généraux d’action publique (développement, intersectorialité, complémentarité) », observe l’OPC ; les communautés urbaines et les communautés d’agglomération enfin plébiscitent les logiques territoriales, puis l’offre et l’éducation-jeunesse. Toutes se montrent, en outre, sensibles au soutien apporté aux pratiques artistiques en amateur, 57% des collectivités et intercommunalités indiquant maintenir leurs efforts dans ce domaine et 24% les avoir renforcés. Soulignée par le Baromètre 2023, la « repolitisation » de l’action politique via le conditionnement des aides financières à certains critères faiblit quelque peu. En 2024 en effet, les répondants qui font valoir une absence de critères sont plus nombreux : 43%, contre 34% l’an dernier. Parmi ceux qui en déclarent, la promotion de la diversité (citée par plus d’un tiers) est la plus prisée, devant l’égalité entre les femmes et les hommes et l’impact écologique – celui-ci étant « étonnamment en retrait » par rapport à 2023, note l’OPC. Les Régions, les communes et intercommunalités en quête d’autonomie Un peu plus de la moitié des DAC estime que la coopération avec l’État n’a pas évolué, un peu moins de la moitié qu’il en va de même avec les autres niveaux de collectivités territoriales, et 39% qu’elle s’est même accrue dans les deux cas. En outre, 57% des collectivités disent ne pas rechercher une plus grande autonomie dans la conduite de leur politique culturelle par rapport à celle de l’État, et 63% par rapport aux autres collectivités territoriales. Seule exception, les Régions, qui sont plus nombreuses (plus des deux tiers) qu’en 2023 à la réclamer vis-à-vis de l’État. « Faut-il y voir une volonté de leur part de jouer un rôle différent dans la gouvernance des politiques culturelles territoriales, ou un souhait d’une délégation accrue de compétences de l’État ? », s’interroge l’OPC, notant une appétence à l’autonomie plus marquée également de la part des communes de plus de 100 000 habitants. Les communes et intercommunalités affichent le même désir vis-à-vis des autres échelons de collectivités, à la différence des Département (seuls 4% l’éprouvent), ce qui pourrait laisser augurer, avance l’OPC, de « l’émergence de nouveaux équilibres et de nouvelles configurations de coopération entre collectivités dans la culture ». Transition écologique et liberté de création Dans sa dernière partie, l’enquête s’est intéressée, d’une part aux problématiques liées à la transition écologique, et d’autre part aux atteintes à la liberté de création et de diffusion. La place accordée aux enjeux de transition écologique est jugée plus prépondérante pour les communes de plus de 100 000 habitants (note évaluée à 3,8 sur une échelle de 0 à 5), devant les Régions (3,2), les métropoles (3), les communes de moins de 100 000 habitants (2,6), les communautés urbaines et d’agglomération (2,4) et les Départements (2,1). Si 18% des collectivités confient n’avoir pas mis en place de démarche spécifique, celles qui l’ont fait ont privilégié les mesures de sobriété énergétique (plus de la moitié des 202 répondants à l’enquête, et deux tiers des communes et des métropoles), devant les concertations avec les acteurs culturels du territoire (citées par 85% des Régions) et la formation des agents. Concernant les entraves à la liberté de création/diffusion, les réponses s’avèrent surprenantes au regard des nombreux événements relatés ces derniers mois dans la presse, par des lieux de diffusion ou des compagnies. Une grande majorité de responsables culturels (quelque 8 sur 10) affirme en effet ne pas constater de tels phénomènes sur leur territoire en 2023-2024. Seules plus ou moins 10% des collectivités et intercommunalités sondées les jugent en augmentation.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2024 4:24 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 29 oct. 2024 Les deux comédiens afrodescendants entremêlent présent et passé, souvenirs d’enfance et images d’archives, pour aborder avec humour des sujets comme l’immigration, l’intégration et la double culture.
Lire l'article sur le site du "Monde"
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/10/29/avec-france-lamine-diagne-et-raymond-dikoume-explorent-l-heritage-de-la-colonisation_6365324_3246.html
Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, à Marseille, Lamine Diagne et Raymond Dikoumé ont rapidement compris que, malgré leurs différences de parcours, ils appartenaient à une seule et même grande famille, celle des enfants nés en France de parents venus d’ailleurs : le Cameroun pour ceux de Raymond Dikoumé, le Sénégal pour le père de Lamine Diagne (sa mère est française). Et c’est précisément ce terme de « famille » qui apparaît, dès le début de leur création commune, Françé, dans une sorte de préambule projeté sur un écran et dit en voix off : « Dans cette histoire, il y a de la place pour tout le monde, tous les humains, mais on va s’intéresser à une famille en particulier : notre petite famille française. Et comme dans toutes les familles, il y a des secrets, des choses que nos parents et nos grands-parents ont vécues. Il va falloir descendre à la cave, fouiller les cartons, déballer nos héritages… » Et des cartons, il y en a plein, de toutes les tailles, qui jonchent le plateau au moment où les comédiens font leur entrée sur scène. Ils symbolisent avant tout cette cave d’immeuble où le duo est censé descendre, à l’origine pour chercher une bouteille de vin à partager entre amis. Mais de ces cartons va jaillir toute une série d’objets du passé qui vont les obliger l’un comme l’autre à affronter leurs souvenirs d’enfance et à déballer leurs histoires intimes, toujours en équilibre entre fiction et réalité (un avertissement au début du spectacle explique que certains des récits relatés sont vrais, d’autres faux). Des cartons comme écrans Pour Raymond Dikoumé, c’est d’abord un casque colonial puis un crâne qui va lui permettre d’évoquer les membres de sa famille restés au Cameroun, notamment un oncle employé à la régie des transports camerounaise, et de se reconnecter aux rituels pratiqués par ses ancêtres autour de la mort. Pour Lamine Diagne, ce sont, entre autres, un chandelier en or, vestige de l’héritage familial de sa mère qu’elle a vendu pour un euro – elle ne voulait rien devoir à son propre père qui s’était enrichi grâce à l’exploitation des colonies françaises – et des lettres de son père qui retracent son parcours d’immigré venu du Sénégal, tombé amoureux d’une fille de bonne famille et mort dans des circonstances tragiques au Congo. Raymond Dikoumé comme Lamine Diagne entretiennent un rapport complexe avec ces pays, le Cameroun et le Sénégal, qu’ils ne connaissent que très peu, car ils n’y sont pas nés et n’y ont pas grandi (le premier a vu le jour à Paris, le second, à Lyon). Sur la forme, Françé mêle habilement sons et images d’archives, avec quelques jolies trouvailles visuelles, par exemple l’utilisation des nombreux cartons comme autant d’écrans pour projeter des vidéos en noir et blanc, notamment celles de tirailleurs sénégalais (comme le grand-père de Lamine Diagne), et des photos également en noir et blanc. Sur le fond, les deux comédiens invitent le public, avec une bonne dose d’humour, à s’interroger sur cette épineuse « question noire » française et à se méfier des idées reçues. Le poids du colonialisme dans l’inconscient collectif est toujours très présent, comme le montre, entre autres, le discours édifiant du grand-père maternel de Lamine Diagne, interprété sur scène par Raymond Dikoumé : il assume, sans aucun complexe, s’être enrichi en étant « assis du bon côté de la table » et en faisant tomber dans son escarcelle les richesses issues de l’exploitation des pays africains colonisés par la France. Et il n’hésite pas à proposer au compagnon de sa fille venu du Sénégal d’en faire de même. Françé, de et avec Lamine Diagne (L’Enelle Cie) et Raymond Dikoumé. Mise en scène : Jessica Dalle. Théâtre du campus, université Sorbonne-Nouvelle, 8, avenue de Saint-Mandé, Paris 12e, le 7 novembre à 18 heures. Auditorium, Palais de la Porte-Dorée, 293, avenue Daumesnil, Paris 12e, le 8 novembre à 20 heures. Puis en tournée de janvier à mars 2025. Cristina Marino / LE MONDE Légende photo : Lamine Diagne (à gauche) et Raymond Dikoumé, lors d’une répétition du spectacle « Françé ». ÉRIC MASSUA

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2024 9:52 AM
|
Par Le Figaro avec AFP - Publié le 28 oct. 2024 La grande parade a été victime de son succès ce week-end, obligeant les organisateurs à adapter le circuit des trois créatures géantes : Astérion, Ariane et Lilith. La parade urbaine La Porte des ténèbres , conçue par la compagnie de théâtre de rue La Machine, a rassemblé 1,2 million de personnes dans les rues de Toulouse de vendredi à dimanche, a annoncé sur les réseaux sociaux le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc. Cette épopée, dont les scènes se sont déroulées dans l’ensemble du centre historique de la Ville Rose, a rencontré un immense succès et a obligé les organisateurs à adapter leur programme. Astérion, un minotaure de bois et d'acier de 47 tonnes pour 14 mètres de haut, n’a pas été en mesure d’effectuer l'intégralité de son parcours dimanche après-midi, face à une foule trop compacte. « Il nous a été impossible de ramener Astérion au Capitole, car nous aurions perdu trop de temps et n’aurions pas pu être à l'heure pour le final », a expliqué à l'AFP le concepteur et metteur en scène de l'opéra François Delarozière. « La magie de l’opéra de rue » La Porte des ténèbres, second opus de l'opéra urbain Gardien du temple, intervient six ans après le premier qui avait rassemblé environ 800 000 spectateurs en 2018. Astérion, devenu lors de la première édition le protecteur de Toulouse, s'est cette fois efforcé, avec l'aide d'Ariane l'araignée, d'empêcher Lilith, monumentale femme-scorpion de 14 mètres de haut, « d'ouvrir un passage vers l'au-delà » pour soumettre de nouvelles « âmes damnées » et ainsi étendre son pouvoir, raconte le livret de l'opéra. « Je voyais les gens pleurer, me remercier avec les larmes aux yeux » François Delarozière De la place du Capitole à la basilique Saint-Sernin, en passant par le Pont-Neuf, ce récit épique qui a coûté 4,7 millions d'euros à la métropole toulousaine s'est inscrit dans de nombreux lieux emblématiques de la Ville Rose. « Nous avons un peu été victimes de notre succès et tout le monde a joué le jeu patiemment », s'est réjoui François Delarozière, saluant la « bienveillance » du public. « Nous avons encore vécu des moments absolument merveilleux, (...) des tableaux qui s'enchaînaient, empreints de poésie. Je voyais les gens pleurer, me remercier avec les larmes aux yeux. Et ça, c'est vraiment la magie de l'opéra de rue », a ajouté le metteur en scène. Les élections municipales et la pandémie de Covid-19 avaient contribué à retarder le retour des créatures mythiques de la Machine dans les rues toulousaines. Reviendront-elles de sitôt ? « Nous rêvons de faire un troisième et un quatrième opus, a confié M. Delarozière. C'est au maire et président de la métropole Jean-Luc Moudenc de décider s'il a envie de continuer l'aventure avec nous ! » Voir la vidéo

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2024 5:17 AM
|
Tribune de Françoise Benhamou publiée par Le Monde - 27 oct. 2024 L’économiste Françoise Benhamou estime, dans une tribune au « Monde », que, face aux défauts constatés du Pass culture, la ministre Rachida Dati propose des ajustements qui relèvent du bricolage. L’économiste avance trois mesures qui relanceraient ce dispositif. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/10/27/acces-des-jeunes-a-l-art-recentrons-le-pass-culture-sur-ce-qui-a-fait-ses-preuves_6361305_3232.html
Longtemps critiqué comme privilégiant les artistes au détriment du public, le ministère de la culture a inauguré en 2019, sous la présidence d’Emmanuel Macron, un véritable renversement de paradigme au terme duquel la politique de la demande devenait une priorité devant la politique de l’offre. Du moins souhaitait-on un rééquilibrage, avec cela de magique que les achats effectués par les jeunes de 18 ans, grâce au Pass culture, seraient « en même temps » un outil de soutien à l’offre. Deux objectifs étaient visés pour le prix d’un, avec en plus le projet, tout en diversifiant les publics, de diversifier les pratiques effectives des jeunes ! A trop vouloir embrasser, on ne sait plus étreindre. On a donc révisé la copie : de 500 euros pour accéder à des sorties, pratiques ou biens culturels lors du lancement des expérimentations du passe, on est passé à 300 euros en 2021, car la somme était rarement dépensée. D’une durée d’un an, on est passé à deux afin de laisser au jeune le temps de faire ses choix. D’une politique exclusivement centrée sur l’individu, on est passé à une logique hybride alliant l’octroi de la somme individuelle et d’une part collective gérée par les établissements scolaires (25 euros par élève pour les 4es et les 3es, 30 euros pour les 2des, 20 euros pour les 1res et les terminales, gérés dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle). De 18 ans, on est aussi descendu dans les âges pour une part individuelle. D’une application centrée sur une logique marchande, on a tenté de faire aussi un outil d’éditorialisation et d’information, un « GPS de la culture ». Mais l’application de ce dispositif souffrait de divers maux : difficulté à rassembler suffisamment de lieux intéressés par l’opération, pratiques de détournement (reventes) que l’on avait observées en Italie, où le gouvernement de Matteo Renzi avait lancé un Bonus cultura dès 2016, propension à consommer des biens stars plutôt que de la diversité et faible effet de diversification des choix, car le temps passé sur le passe est très court, etc. Usine à gaz Pire encore, les fondamentaux étaient discutables : mépris des résultats de la recherche, alors que la sociologie a montré de longue date que le goût pour la culture s’acquiert au plus jeune âge, mépris des corps intermédiaires et des fonctionnaires (associations, médiateurs, bibliothécaires) dont on découvre bien tardivement le travail, sous-estimation du temps long nécessaire à l’évolution des pratiques effectives, mythe de l’argent réparateur, absence d’hésitation devant la mise en place de dispositifs excessivement complexes, confusion des objectifs (diversifier les pratiques culturelles des jeunes et en accroître l’intensité, démocratiser la culture) comme s’il s’agissait des deux faces d’une même pièce. Deux rapports (inspection générale des affaires culturelles, Cour des comptes) ont fait le constat des défauts du dispositif, constat au goût d’autant plus amer que son coût est élevé à la fois du point de vue des sommes distribuées et de sa mise en œuvre : quelque 260 millions d’euros au total, dont il était prévu qu’ils soient assumés par les distributeurs et les grandes plateformes numériques à hauteur de 80 % et qui, in fine, sont pris en charge par l’Etat (ministère de la culture et ministère de l’éducation nationale). Le passe ne démocratise guère les pratiques culturelles, et les choix des jeunes démontrent que ce n’est pas par l’argent qu’on résout la question de la diversification de leurs pratiques. La ministre de la culture, Rachida Dati, se désole de constater qu’ils ne dépensent pas assez pour le spectacle vivant ; et, à mots à peine couverts, le président de la société responsable du dispositif, Sébastien Cavalier, pointe les offreurs, trop peu allants pour cet outil des temps modernes. A lire la récente tribune de la ministre dans les colonnes du Monde, on comprend qu’il n’est guère question de revenir sur cette mesure phare d’un projet présidentiel qui prend l’eau de toutes parts. Alors on bricole : elle annonce que l’on va conserver un passe universel mais introduire un dispositif plus avantageux pour les plus modestes afin de compenser un effet d’aubaine, qu’une part sera désormais réservée au spectacle vivant, que l’on va « faire des données culturelles le socle d’un nouveau contrat social pour la culture », au risque de complexifier un dispositif qui ressemble à bien des égards à une usine à gaz. Renforcer la culture à l’école Pourquoi ne pas se recentrer sur ce qui a fait ses preuves ? Un volet est intéressant, celui d’offrir un outil performant pour « géolocaliser toute l’offre culturelle près de chez soi, organiser un covoiturage pour un concert, partager des recommandations ». Car, s’il n’y a pas de désert culturel à proprement parler dans notre pays, on manque d’information dans certains territoires sur une offre dispersée, et l’on hésite devant des déplacements parfois compliqués. En proposer l’information et la mutualisation est une bonne mesure. Deuxièmement, les jeunes ont massivement poussé la porte des librairies afin d’acheter des mangas et de la romance, mais aussi d’autres ouvrages, le livre ayant représenté 46,5 % des achats effectués en 2022 par des jeunes de 18 ans avec le passe. La politique de soutien au livre et à la librairie aura été une belle réussite depuis 1981 ; il faut la consolider et bâtir une relation plus vertueuse encore entre les librairies, l’école et les bibliothèques. Troisièmement, la part collective du passe, celle qui passe par le truchement des établissements scolaires, est saluée de tous côtés. Il faudra en évaluer les effets sur le temps long, mais pourquoi ne pas la renforcer dès à présent, et accomplir enfin ce rêve d’une école qui donne toute leur place aux arts et à la culture, en faisant en sorte que les pratiques et les sorties culturelles, ainsi que l’accueil des artistes, deviennent des obligations inscrites dans les programmes et dotées des moyens qu’elles méritent ? Françoise Benhamou est professeure émérite à l’université Sorbonne-Paris-Nord, présidente du Cercle des économistes Françoise Benhamou (Présidente du Cercle des économistes)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2024 7:54 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 26 oc. 2024 L’excellent metteur en scène Jacques Osinski a proposé à Sandrine Bonnaire de revenir au théâtre avec cette pièce, l’une des plus belles de Marguerite Duras. Elle est entourée par deux grands acteurs rompus à la scène, Frédéric Leidgens et Grégoire Oestermann. Sublime, forcément sublime.
Avant de partir pour le théâtre de l’Atelier, je me suis souvenu que les premiers mots d’Espaces perdus, le premier livre publié par Claude Régy en 1991 évoquaient la pièce de Marguerite Duras, alors j’ai emporté le livre dans le métro et j’ai lu : « Je suis à la campagne. Avant de partir j’ai revu une photo. Depuis je la vois sans cesse. Une personne dans une lumière, Madeleine Renaud se tient là, sur un seuil, elle sort de scène, mais pas comme d’habitude on sort de scène, elle entre dans la salle, c’est son apparition au début de la deuxième partie de L’amante anglaise, en 1968, à la salle Gémier ». Claude Régy avait déjà entamé son long compagnonnage avec Duras en mettant en scène Les Viaducs de la Seine-et-Oise, première version de L’amante anglaise. Duras s’était inspiré d’ un fait divers et du procès qui s’en suivit consigné par Jean-Marc Théolleyre « le génial chroniqueur du Monde » (Duras) : une femme avait tué puis dépecé son mari et jeté les morceaux de son corps dans différents trains de marchandises de la région parisienne. Le spectacle avait eu du succès mais Duras reprit sa pièce, en changea le titre et bien des aspects , y compris l’intrigue. Dans L’amante anglaise, Claire Lannes garde son mari et tue sa nièce sourde et muette venue de Cahors pour s’occuper du logis (cuisine, ménage). On apprendra que Claire Lannes avait longtemps vécu à Cahors où Claire possède toujours une maison, elle y avait a connu l’amour deux ans durant avec un homme avant de se marier avec un autre, Pierre Lannes. Le couple marié avait quitté Cahors pour venir vivre dans la région parisienne, à Vorne. Les années ont passé ; le mari a eu bien des aventures extra conjugales passagères sans pour autant songer à divorcer. Claire, moins instruite que son mari, aimait s’occuper du jardin. Marie-Thérèse Bousquet, la nièce soude et muette qu’ils avaient accueillie entretenait une vague relation sexuelle avec Alfonso, un Portugais de la localité que Claire Lannes croisera une nuit sur la route après être allée disperser une partie du corps de sa nièce. Vingt ans durant, Madeleine Renaud (Claire Lannes) joua cette pièce à travers le monde avec Claude Dauphin (Pierre Lannes) et Michael Lonsdale (l’interrogateur) à la création puis, au fil du temps, avec d’autres partenaires La mort de Madeleine Renaud ouvrit la voie à d’autres mises en scène. Elles furent nombreuses. Dernière en date à Paris, celle de Marie-Louise Bischofberger au Théâtre de la Madeleine avec Ludmila Mikaël (Claire Lannes) ,Ariel Garcia-Valdès (Pierre Lannes) et André Wilms (l’interrogateur). Avant Emilie Charriot prochainement au Théâtre de Vidy-Lausanne puis à l’Odéon (au printemps) avec Dominique Reymond, Nicolas Bouchaud et Laurent Poitrenaux, Jacques Osinski, après un long compagnonnage avec Beckett aborde les rives de la Duras avec L’amante anglaise en ayant eu la bonne idée de proposer le rôle à Sandrine Bonnaire que l’on n’a plus revue sur une scène depuis longtemps. L’ actrice avait débuté au théâtre avec La bonne âme de Setchouan de Brecht dans une mise en scène de Bernard Sobel au Théâtre de Gennevilliers en 1990 et on l’avait rarement revu au théâtre par la suite. Elle a aujourd’hui plus de la cinquantaine, l’âge du personnage. Pour Pierre Lannes, Osinski a fait appel au parfait Grégoire Oestermann (l’un des créateurs du beau Voyage en Ataxie, lire ici) et pour l’interrogateur, il retrouve l’incomparable Frédéric Leidgens qui l’avait récemment accompagné dans Fin de partie de Beckett (lire ici), spectacle repris dernièrement au Théâtre de l’Atelier à Paris , là où vient d’être créée sa mise en scène de L’amante anglaise. La pièce n’est pas un procès, on est loin de « faites entrer l’accusée », il n’y a pas de tribunal, pas d’effets de manche. Dans une première partie « l’interrogateur » au statut indéfini (ni flic, ni procureur, un poil psy, un poil curieux) interroge le mari, puis, dans une seconde partie, il interroge Claire Lannes. Comme le souhaitait Duras, la pièce est représentée « sur un podium avancé, devant le rideau de fer, dans une salle restreinte,sans décors ni costumes ». Au début, une voix enregistrée raconte brièvement le fait divers, à la création c’était la voix de Marguerite Duras. L’interrogateur est assis dans la salle devant les premiers rangs de spectateurs mais comme émanant d’eux. L’interrogatoire commence avec la voix claire et précise de Leidgens, ses gestes rares et assurés, stylo en main. Devant lui, le surplombant sur le devant de la scène, assis sur une simple chaise devant le rideau de fer baissé, Oestermann donne corps à un Pierre Lannes, calme, n’ignorant pas que sa femme avait eu une histoire d’amour avec un « agent de Cahors » et ne s’embarrassant pas pour la tromper. « Vous êtes d’un caractère à éviter de parler de ce qui vous fait souffrir ? » lui demande l’interrogateur. « Oui, je suis comme ça » répond Pierre Lannes. Les questions et les réponses se succèdent, il n’y a pas d’éclats, de fuites, ni d’effet de manche : c'est un interrogatoire, une lente tentative d’introspection, pas un procès. On s’enfonce dans les méandres de cet homme, du couple qu’il forme depuis longtemps avec Claire et on commence à cerner en creux cette dernière que son mari considère du haut de sa supériorité de mâte dominant (de plus, il est plus instruit qu’elle). Cela dure près d’une heure et c’est fascinant. L’interrogatoire de Pierre Lannes est terminé, l’acteur sort, la chaise reste en place. Alors le rideau de fer se lève. Claire Lannes-Sandrine Bonnaire arrive par le fond du plateau devant un mur ocre sans relief. Elle s’ avance à pas ni lents, ni vifs, vêtue de façon plutôt neutre, chandail et jupe droite allant du gris au noir, s’assoit sur la chaise. Droite, légèrement maquillée, les sourcils sombres. Elle ne croisera jamais ses jambes, ne lèvera jamais ses bras (sauf une fois, brièvement), ne détournera pas la tête, gardera toujours ses mains sur ses genoux, nouées, à demi dénouées, jamais ouvertes, jamais libres de souligner tel ou tel mot. Elle regarde droit devant elle, vers l’interrogateur peut-être, vers nous peut-être, un demi sourire crispé ici et là la traverse, brièvement, un bref éclair. Le théâtre atteint là le point extrême de son affirmation dans son dénuement. Le seul à se mouvoir, jusqu’à la rejoindre à la fin sur le plateau, c’est l’interrogateur, celui qui pose les questions mais qui n’écoute pas toujours bien ce que sous-tendent les réponses ou les réponses biaisées ou à côté de Claire Lannes. Peut-être est-ce la première fois depuis longtemps qu’elle parle, qu’elle a des choses à dire sur son amour du jardin par exemple ,« Il y a un banc en ciment et des pieds d’amante anglaise » commence-t-elle On l’écoute ou elle croit qu’on l’écoute. Car celui qui l’interroge cherche autre chose, il veut savoir pourquoi Claire Lannes a tué cette « grosse femme » sourde et muette et où est cachée la tête qui n’a pas été retrouvée. Et puis, il se lasse. Elle lui échappe. « Écoutez moi, je vous en supplie », ce sont les derniers mots de Claire Lannes. Et ceux de la pièce. Sous la direction parfaite de Jacques Osinski, Grégoire Oestermann et Frédéric Leidgens accompagnent on ne peut mieux, on ne peut plus délicatement, le retour au théâtre de Sandrine Bonnaire, bouleversante et troublante de simplicité, sinon comme complice de Claire Lannes, du moins en fraternité avec elle, assise sur sa chaise, seule face au monde, voulant être entendue. Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan Théâtre de l’Atelier, 21h du mar au sam, le dim à 15h, jusqu’au 31 déc. La pièce est disponible en Folio-Théâtre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2024 9:22 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 25 oct. 2024
Pas besoin d’avoir vécu sous les mandats des personnalités évoquées pour apprécier la série de spectacles imaginés par Léo Cohen-Paperman et Julien Campani, en tournée à travers la France.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/10/25/les-presidents-de-la-v-republique-un-epatant-terrain-de-jeu-theatral-en-huit-chapitres_6359480_3246.html
Une série théâtrale en huit épisodes et six spectacles consacrés aux chefs d’Etat de la Ve République, du général de Gaulle à Emmanuel Macron : voici le projet fou dans lequel s’est engagé Léo Cohen-Paperman. Son titre : Huit rois (nos présidents), « parce que le pouvoir en France se fait par incarnation et implique une idée sacrificielle, il renvoie à des hommes providentiels qui deviennent des boucs émissaires », résume le metteur en scène, cofondateur du Nouveau théâtre populaire et directeur artistique de la compagnie des Animaux en paradis. Plus prosaïquement, parce que la couronne est, d’un point de vue dramaturgique, plus excitante que la cravate. Originalité de cette saga : chaque chapitre peut se voir de manière indépendante et chaque président est abordé dans une forme théâtrale différente. Opéra qui tourne court pour de Gaulle, documentaire en super-8 pour Pompidou, vaudeville pour Giscard, drame familial pour Mitterrand, comédie onirique pour Chirac, stand-up pour Sarkozy, clown beckettien pour Hollande, science-fiction pour Macron. Ce sont comme des fables qui ne cherchent pas à singer ces figures présidentielles mais à donner un concentré subjectif d’un mandat, d’une époque et de la trace laissée par ces « monarques » dans l’inconscient collectif. Trois de ces spectacles tournent actuellement en France : La Vie et la Mort de Jacques Chirac, Génération Mitterrand et Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing. Les trois autres (centrés sur De Gaulle-Pompidou, Sarkozy-Hollande, Macron) sont en cours d’écriture avec l’objectif de terminer cet ambitieux programme en 2027, avec la fin du second mandat macronien. « Notre création n’a pas été chronologique parce que tout est parti de Jacques Chirac, le président de notre enfance et de notre éveil à la politique, avec les manifestations contre la guerre en Irak et l’effroi du score du Front national à la présidentielle de 2002. L’idée de la série est venue après », explique Julien Campani, coauteur de plusieurs épisodes et remarquable comédien, aussi bien dans le rôle de Jacques Chirac ou de l’enfant de la famille accueillant Giscard. Mise en scène ingénieuse « Il ne s’agit surtout pas d’un théâtre militant qui voudrait affirmer des vérités », précise Léo Cohen-Paperman. « Nous ne sommes ni journaliste, ni politicien, ni historien, ni chroniqueur politique. Notre credo est de ne jamais regarder d’en bas, ni d’en haut mais dans les yeux. Quoi qu’on pense de ces chefs d’Etat en tant que citoyen, on essaie de se mettre à la place du personnage avec aussi le goût de penser contre soi-même et d’y inviter également le spectateur », complète Julien Campani. Pari jusqu’ici relevé. Le repas giscardien met en scène une famille française ordinaire sur quatre générations, du grand-père gaulliste au gendre communiste, autour du président et de sa femme qui vont devenir leurs têtes de Turc. Ce dîner de facture inégale, en forme de farce vaudevillesque flirtant avec le boulevard, est à l’image du septennat de Giscard : il commence bien et se finit mal. Derrière son côté « Au théâtre ce soir » virant à la fable grinçante, cette incursion du couple Giscard d’Estaing dans la salle à manger d’agriculteurs normands avec leur fille soixante-huitarde et leur beau-fils ouvrier a le mérite d’esquisser le portrait d’une France en pleine transition économique et sociétale. L’itinéraire chiraquien prend, lui, le chemin d’une passionnante et haletante tragi-comédie. Aux côtés de son fidèle chauffeur Jean-Claude Laumond, de son conseiller de l’ombre Pierre Juillet ou de son parrain politique Charles Pasqua (tous incarnés par Clovis Fouin en alternance avec Mathieu Metral), Jacques Chirac apparaît comme un animal politique insaisissable, pétri de contradictions. Dans un décor de loge de théâtre, où le « jeune loup » devenu président se mue en clown triste, on assiste à ses réussites et à ses échecs, sur fond de bouleversements historiques (la chute du mur de Berlin, le traité de Maastricht). Grâce à une mise en scène ingénieuse, le public est comme la métaphore du peuple, tantôt plein d’espoir, tantôt en colère. Quant à l’épisode mitterrandien (le seul que nous n’avons pas vu), il met en scène trois trentenaires qui ont voté Mitterrand en 1981, puis Macron, Le Pen et Mélenchon en 2022 et raconte la sociologie de la « génération Mitterrand ». Plaisir et réflexion Si cette saga présidentielle fait appel à la mémoire collective et a un rôle de catharsis, pas besoin pour autant d’avoir vécu sous les mandats de ces présidents pour en apprécier la teneur. En transformant ces personnages réels en personnages de théâtre, en leur donnant une humanité sans cacher la part de cynisme du monde politique, en mêlant l’exercice du pouvoir à la mentalité d’une époque, c’est toute une France électorale qui est ici racontée de manière à la fois profonde et cocasse. Attaché à un théâtre populaire, mêlant plaisir et réflexion, Léo Cohen-Paperman s’est saisi des présidents pour en faire « un sujet universel qui nous englobe tous ». Le plus délicat à monter sera sans doute celui consacré à Emmanuel Macron. « Plus le personnage est dans l’actualité, plus on a besoin d’un pas de côté poétique, reconnaît Julien Campani. La science-fiction nous permet de donner un coup de pied dans la fourmilière des infos en continu. » Cet épisode devrait nous plonger en 2058. « Dans un monde où la France n’existerait plus, mais où des gens continueraient à fêter le centenaire de la Ve République, le président, réélu pour un nouveau mandat écourté entre 2040 et 2043, serait devenu un romancier à succès. » Vaste programme. La Vie et la Mort de Jacques Chirac, jusqu’au 28 décembre au théâtre du Petit Saint-Martin, Paris 10e, puis en tournée. Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing, le 22 novembre à Colombes (Hauts-de-Seine), le 13 décembre à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), le 17 décembre à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise). Génération Mitterrand, les 19 et 20 novembre au théâtre Serano à Toulouse, le 10 décembre à Privas (Ardèche). Sandrine Blanchard / LE MONDE Légende photo : Jacques Chirac (Julien Campani) dans « La Vie et la Mort de Jacques Chirac », de Léo Cohen-Paperman et Julien Campani. SIMON LOISEAU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 24, 2024 6:35 PM
|
Propos recueillis par Alexandre Demidoff dans Le Temps.ch - le 23 octobre 2024 Choisi en juin pour diriger la grande maison jurassienne, le metteur en scène romand a dû renoncer à son poste en septembre. A l'origine de ce coup de théâtre, une lettre anonyme adressée au conseil de fondation de l’institution le présentant comme un harceleur. Alexandre Demidoff Publié le 23 octobre 2024 à 06:16 _Photo Erika Irmler Pas une victime, non, surtout pas. Dorian Rossel, 49 ans, ne veut pas de cette étiquette. Mais un homme ébranlé à l’évidence. Le metteur en scène romand essuie la tempête depuis cet été. A l’origine, un baiser forcé il y a quatre ans. Une faute déplorable, il le reconnaît. La victime, comédienne, a souhaité tourner la page très vite. Stupeur: en mai, l’affaire remonte à la surface. A Genève, deux affiches montrant son visage en grand pour son spectacle Tous les poètes habitent Valparaiso sont maculées d’injures. Des mots sans commune mesure avec l’acte. Le 27 juin, le conseil de fondation du Théâtre du Jura annonce sa nomination au poste de directeur. Stupeur (bis), le 6 septembre: cette même instance annonce que d’un commun accord avec elle, Dorian Rossel renonce à son poste. Lire: Sur fond d’accusation de harcèlement sexuel, le Théâtre du Jura renonce à son futur directeur Le Temps révélait alors les dessous d’une affaire qui remonte à ce baiser contraint en décembre 2020. Dans un milieu longtemps gangrené par le sexisme, des esprits justiciers ont voulu instrumentaliser cet égarement. Leur réussite est totale tant ses conséquences paraissent aujourd’hui exorbitantes, symptômes d’une époque où les passions funestes l’emportent. L’artiste, qui ne s’était pas exprimé, dénonce un flot de calomnies et plaide pour la mesure. Lire aussi: Une carrière brisée pour un baiser forcé, vraiment? Le Temps: Que s’est-il passé au mois de décembre 2020 avec la jeune comédienne que vous mettiez en scène dans un spectacle de l’Ecole Serge Martin? Dorian Rossel: Le spectacle de sortie de l’école n’avait pas pu avoir lieu en juin à cause du covid. Sept mois plus tard, Serge me demande d’en faire un avec les diplômés de la volée, afin de leur offrir de la visibilité. Le dernier soir des représentations, il pleut, je suis en voiture. Je ramène des interprètes, dont la comédienne en question… Au moment de nous dire au revoir, nous nous sommes pris dans les bras pour un hug. J’ai cru qu’il y avait quelque chose entre nous et je l’ai embrassée. C’était un baiser forcé… J’ai réalisé rétrospectivement que c’était un baiser non désiré, oui. Je n’ai pas usé de force, mais je n’ai pas été assez sensible à elle. Il y a eu même deux baisers d’après l’audit? Mon souvenir est que nos lèvres se sont touchées et que ça s’est arrêté là. J’ai su deux ans après qu’elle avait un souvenir différent. Je ne conteste évidemment pas, il se peut que j’aie fait un déni, la mémoire pouvant s’altérer dans un sens comme dans l’autre. La chose qui est sûre est que j’ai manqué de sensibilité, que je me suis trompé. Ce qui me navre, c’est d’avoir fragilisé un être, de l’avoir plongé dans l’insécurité. Je n’ai jamais voulu ça de ma vie. Vous étiez son prof, ce qui rend l’acte encore moins admissible… Non, je n’étais pas son professeur. Les acteurs n’étaient pas mes étudiants et ne l’ont jamais été. Elle avait 30 ans, j’en avais 45. Mais il est vrai qu’entre un metteur en scène et des acteurs il y a aussi une hiérarchie et je l’ai compris en faisant un travail d’introspection. J’ai commis une faute, je le répète. Avez-vous fait votre mea culpa auprès de l’intéressée? Oui, dès le lendemain, on a échangé des textos. Je lui ai dit que j’étais désolé, que je m’étais fourvoyé et j’ai présenté mes excuses. Elle m’a répondu que c’était réglé pour elle. Que s’est-il passé ensuite ? Deux ans plus tard, Delphine Lanza, ma compagne qui codirige la compagnie, donne un stage à l’Ecole Serge Martin. Elle me demande de la remplacer pour un cours. Ce jour-là, quatre étudiantes me boycottent, parce qu’elles ont entendu parler de cette histoire. Je suis sous le choc, j’envoie un message à la comédienne que j’ai embrassée. Je lui demande s’il y a encore un problème. Elle me répond que non et qu’elle souhaite, depuis le début, passer à autre chose. Il n’empêche que la rumeur était lancée. Qui a décidé de commanditer l’audit mené par Cécile Pache de CP Conseil ? Cet audit a été décidé au sein de la compagnie, par Delphine, le comité de notre association et moi. Nous en avons informé les autorités subventionnantes qui ont gelé leurs aides le temps de l’enquête, soit six mois. Qu’attendiez-vous de cette démarche ? Personnellement, je voulais nettoyer mon nom et ma pratique. En vingt ans de compagnie, il nous est arrivé d’engager jusqu’à 60 personnes par an. Et il n’y a jamais eu la moindre plainte, la moindre insécurité dans le travail. Ce bien-être est une valeur cardinale pour moi. Nous visons à la parité homme-femme à tous les postes. La compagnie, c’est Delphine et moi. Quelle remise en question ça a impliqué pour vous ? Je fais une thérapie individuelle et en couple pour analyser ce qu’il s’est passé. Je crois aujourd’hui mieux comprendre les rapports systémiques de domination patriarcale, qu’ils soient visibles et invisibles. Je suis convaincu que la libération de la parole des femmes est une bénédiction. Il est évident qu’il faut que ça change dans notre milieu. Tout exemplaire que vous souhaitez être, Cécile Pache conclut que le cas s’apparente à du harcèlement sexuel en vertu de la loi sur l’égalité… Oui, elle utilise l’intitulé légal: en Suisse, un baiser non consenti est considéré ainsi. L’audit conclut à un acte déplorable, mais isolé qu’il faut rapporter à vingt ans d’exemplarité dans la compagnie. Les autorités subventionnantes – les ville de Genève, de Lausanne, de Meyrin ainsi que le canton de Genève – ont alors pris leurs responsabilités: elles ont débloqué la subvention au début de 2023. Rien ne nous interdisait dès lors de nous porter candidats à une nouvelle convention pour la période 2025-2027. L’avez-vous fait? Oui, à la fin du mois de juin. Nous venons de recevoir la réponse. Elle est négative. Est-ce une conséquence de l’affaire selon vous? C’est un concours, beaucoup de compagnies postulent. Nous avions cette convention depuis 2009. Cela ne nous empêchera pas de demander des aides au projet. Pourquoi n’avoir pas dit à la commission qui vous auditionnait pour la direction du Théâtre du Jura que vous aviez fait l’objet d’un audit? L’histoire était close à mes yeux. Nous avions agi au mieux compte tenu des circonstances. Il n’y a jamais eu de plainte. Nous avons aussi pris des mesures à l’intérieur de la compagnie pour être sûr que ce genre d’événement ne puisse pas se produire, avec la désignation d’une personne de confiance. Deux affiches de votre visage taguées en mai au moment de la présentation à Carouge de votre spectacle «Tous les poètes habitent Valparaiso» vous rappelaient pourtant que tout le monde n’avait pas oublié… J’ai trouvé l’acte grave, relevant de la diffamation, voire de la calomnie. Effectivement, deux affiches sur 500 ont été maculées et cela m’a affecté. J’ai déposé plainte. Si je l’avais su plus vite, la police aurait pu identifier l’auteur de ces calomnies grâce à des caméras de surveillance, mais elles ne conservent pas les images au-delà de sept jours. Comment expliquez-vous que fin juin le conseil de fondation du Théâtre du Jura vous nomme pour succéder à Robert Sandoz et que deux mois plus tard il annule la décision? Il a reçu une première lettre anonyme le 10 juillet dans laquelle son auteur annonçait qu’il alerterait la presse. Il a demandé à lire l’audit et a appelé Cécile Pache. Il s’est réuni finalement le 23 août et m’a reçu. Comme par hasard, la veille, il a reçu une deuxième lettre anonyme avec des informations «envue de votre rencontre avec Dorian Rossel». Comment cette personne pouvait-elle être au courant de la réunion de l’instance? A la fin de sa lettre, elle déclare qu’elle reste à disposition pour parler de l’affaire. Je pense que la décision finale a été purement politique et guidée par la peur. Avez-vous l’impression qu’il vous sera plus difficile de travailler en Suisse romande? J’espère que les professionnels sauront faire la part des choses. J’ai perdu le Théâtre du Jura, c’est une sanction assez lourde. Est-ce que ma condamnation doit être éternelle? Je veux espérer qu’on est dans un pays où on peut croire à la justice. Avez-vous échangé depuis cette affaire avec des associations luttant contre les abus dans le milieu artistique, le groupe Arts Sainement par exemple? Oui, je leur ai dit que leur combat était le mien. Mais pour que la libération de la parole continue d’être prise au sérieux, il faut être vigilant sur les moyens mis en œuvre. J’ai lu les deux lettres anonymes, elles sont diffamatoires et mensongères. Nous avons déposé plainte. Le combat de celles et ceux qui veulent en finir avec les abus et les discriminations vaut la peine, on peut prendre le risque de le mener à visage découvert. Pourquoi prendre la parole aujourd’hui? Je ne peux accepter qu’on me calomnie ainsi sur la place publique. J’ai pu lire sur les réseaux: «Bravo au Théâtre du Jura d’avoir préservé la Suisse romande de ce prédateur qui a abusé de tant de jeunes filles!» C’est fou! Je ne veux pas qu’en Suisse romande on puisse dire impunément des choses aussi fausses sur les gens. Et qu’on écrive des lettres anonymes pour faire tomber des personnes. J’ai l’impression que les auteurs de cette campagne se sont trompés de personne. Je combats les harceleurs. J’ai fait une faute, je la reconnais, je la déplore. N’en faites-vous pas trop? Je ne crois pas. La libération de la parole des femmes est fantastique. Que cela change les rapports de domination sexiste, je ne peux qu’approuver. Tout le monde doit être féministe. C’est l’écrivaine et essayiste afro-américaine Bell Hooks qui dit ça. Mais il est capital de faire preuve de justice, de mesure et de proportionnalité. Y aura-t-il des suites juridiques de votre fait, hormis la plainte contre inconnu pour diffamation? Non. J’ai suffisamment de rêves et de projets en cours. Toute mon équipe est soudée et elle compte sur moi. Je ne veux pas et ne peux pas la décevoir. Quelles leçons tirez-vous de cette affaire? Nous avons tous une responsabilité dans la profession pour mettre fin à des pratiques aussi anciennes que dégradantes. Mais nous devons tous faire en sorte, y compris les autorités subventionnantes, qu’il n’y ait pas de dérive car cela dessert la cause. Parce que malheureusement d’une calomnie il reste toujours une suspicion. Propos recueillis par Alexandre Demidoff / Le Temps Légende photo : Dorian Rossel, 49 ans: «La décision de m'écarter de la direction du Théâtre du Jura est purement politique et guidée par la peur.»

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 23, 2024 1:28 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 21 oct. 2024 Dans une mise en scène épurée de Jacques Osinski, Sandrine Bonnaire incarne magistralement la folie criminelle de l'héroïne de Duras. Avec Frédéric Leidgens et Grégoire Oestermann, elle forme un trio d'exception, porteur de tous les non-dits d'un drame qui interroge l'absurdité de l'existence. Elle se tient immobile, assise sur une chaise, seule sur le devant de la scène du Théâtre de l'Atelier. Le regard fixe, intense, par instants perdu vers un ciel lointain, elle répond d'une voix limpide à l'Interrogateur. Parfois, elle sourit, lorsqu'elle parle de son jardin refuge et de « la menthe anglaise » qui poussait au pied de sa maison de Viorne… Puis, elle se fait grave, visage fermé, tressaillant à peine quand elle évoque son crime, atroce… Sandrine Bonnaire est impressionnante dans le rôle de Claire Lannes, héroïne de « L'Amante anglaise », coupable d'avoir sans raison apparente trucidé et dépecé sa cousine sourde et muette. Par son jeu concret, jamais éthéré, mettant en relief méthodiquement les non-dits du texte, elle donne une densité phénoménale à son personnage tutoyant la folie et confère une fulgurante modernité à la pièce de Marguerite Duras, créée en 1968. Le public ne perd pas une miette de ses mots et de ses gestes en suspens. Il réserve la même écoute à l'interrogatoire serré, mené de sa voix sortilège par Frédéric Leidgens, et aux justifications embarrassées du mari qui n'a rien vu venir, Pierre, incarné avec une distance subtile par Grégoire Oesterman. Cette « quintessence du petit-bourgeois haïssable » selon Duras est saisie dans sa mâle assurance, soudainement ébranlée. Le comédien le montre plus décontenancé que vraiment attristé par ce crime qui va le débarrasser de sa femme dérangée. Variation sur un fait divers, sujet déjà d'une première pièce de l'écrivaine en 1949, « Les Viaducs de la Seine-et-Oise », « L'Amante anglaise » est une mécanique implacable. Ce vrai faux drame policier, divisé en deux interrogatoires d'égale longueur (le mari, puis la meurtrière) exige l'épure. Jacques Osinski est un maître en la matière comme en témoignent ses récentes mises en scène de l'oeuvre de Beckett. Il s'est donc effacé derrière le texte. Il a réuni un trio d'acteurs hors-norme et les a accompagnés avec soin dans toutes les nuances d'un drame où chaque réplique ouvre des abîmes, chaque silence nous renvoie à la folie qui rôde aux confins du monde. Un seul effet spectaculaire marque le spectacle : quand le rideau de fer bornant le premier interrogatoire se lève sur la scène vide et laisse apparaître tout au fond Sandrine Bonnaire, avançant tel un ange noir surgi de l'enfer. Evidemment, ce qui vient à l'esprit quand la représentation s'achève est la célèbre formule de Duras, « sublime, forcément sublime », qui fit scandale en 1985 au moment de l'affaire Grégory et alors mal à propos. Elle sied mieux à cette « Amante anglaise », insaisissable et tragique, transcendée par trois comédiens incandescents. L'AMANTE ANGLAISE de Marguerite Duras Mise en scène de Jacques Osinski Paris Théâtre de l'Atelier www.theatre-atelier.com A Versailles - Montansier du 9 au 11 janvier. A Poitiers (le 14), à Toulon, les 16 et 17, et à Deauville (Franciscaine) le 8 février, etc. 2 h 10. Légende photo : Par son jeu concret, jamais éthéré, Sandrine Bonnaire donne une densité phénoménale à son personnage sombrant dans la folie. (© Pierre Grosbois / Théâtre de l'Atelier)
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...