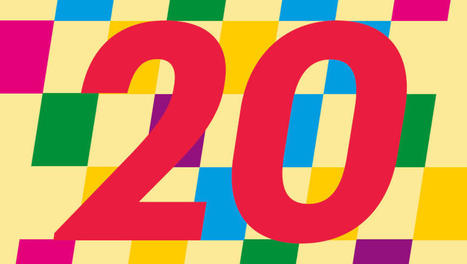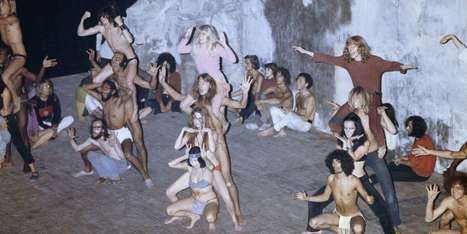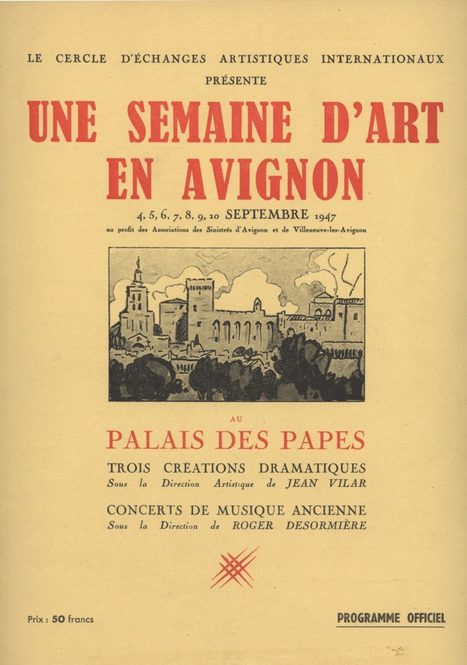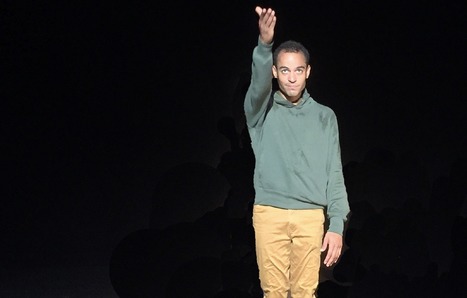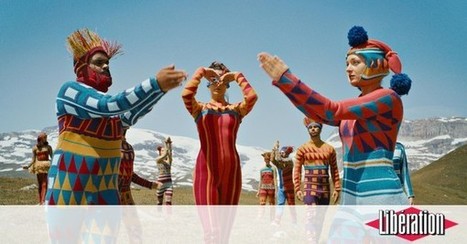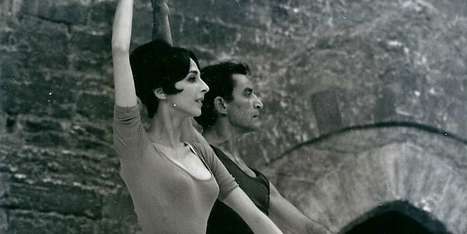Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 11, 2020 12:04 PM
|
Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 8 juillet 2020
L’auteur et metteur en scène a réouvert hier avec émotion le théâtre de la Colline devant un public qui lui a très chaleureusement manifesté son soutien. Créée en 1997 au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, dans le cadre du Festival des Théâtres des Amériques, l’oeuvre marqua ses premiers spectateurs, malgré -et peut-être grâce à- une durée peu banale pour l’époque (presque cinq heures). Explosait à la scène un talent littéraire évident et l’œuvre était portée par une équipe de jeunes acteurs qui osait tout. Mention spéciale à Steve Laplante dont l’interprétation restera dans les mémoires.
Wajdi Mouawad reprit Littoral à diverses périodes de sa vie : au Festival d’Avignon puis à celui des Francophonies en 1999. Ensuite à Rome, Bruxelles, Beyrouth, Chambéry… Dix ans plus tard, artiste associé au Festival d’Avignon, il fut invité à y présenter l’ensemble des quatre pièces du Sang des promesses dont Littoral constituait le texte inaugural : un fleuve émotionnel à qui il fit subir une cure d’amaigrissement. Aujourd’hui, vingt-trois ans après sa création, le directeur de La Colline propose une nouvelle approche de son histoire et oriente le miroir vers le monde féminin. Wilfrid, interrompu au moment d’un coït mémorable par l’annonce de la mort brutale de son père, devient Nour, un soir sur deux. Une belle idée qui permet de rassembler deux distributions en alternance et de regrouper la plupart des jeunes acteurs de Notre innocence à sa création. Ce qui redonne à l’effet de génération 97, le souffle de la jeunesse d’aujourd’hui.
Avec la même économie : trois chaises, deux seaux et un balai, il retrouve l’état de nécessité qui a baigné la création de cette pièce, avec à la fois l’urgence de prendre la parole et une pauvreté totale des moyens. Ironiquement il fait descendre des cintres, en ouverture, une centaine d’accessoires et de costumes disponibles, sur le très grand plateau de La Colline, pour retourner ensuite à ces modestes accessoires et à un trait sur le sol aux dimensions initiales de la scène de Montréal. Retour aux sources affirmé…
Le voyage de Wilfrid/Nour pour aller enterrer son Père, est une sorte d’Odyssée du temps présent, depuis le monde occidental vers le monde oriental. Il accostera aux rivages dévastés, familiers de nos écrans : guerre civile, villages détruits, assassinats sauvages, disparition de familles entières. « Dans les villages, les morts ont pris toute la place » et tous les jeunes sont orphelins. Le père mort de Wilfrid/Nour devient le père de chacun. A mesure des rencontres, les patronymes de ceux qui ont été vaincus, sont criés à la face du ciel. Partis ou morts ? L’appel de ces noms, simplement énoncés, devient le monument aux morts virtuel d’une génération perdue. Et nous sommes glacés devant ces presque encore enfants qui cherchent à rester vivants avec tout ce qui est mort en eux. Wajdi Mouawad ne donne aucune précision géographique sur ces univers traversés qui sont autant ceux de la mémoire que du rêve. Mais comment garder la puissance de sa mémoire et de ses rêves d’il y a vingt ans ? Il réussit à mettre à distance toute nostalgie et fait confiance à cette bande de jeunes gens auxquels il a remis sa jeunesse.
Des décalages se font pourtant sentir, le temps et l’espace diffèrent… Wajdi Mouawad lui-même a opéré sa propre translation géographique : il n’est plus au Québec mais en France. Et les rivages où accoste Wilfrid/Nour sont plus connus du public français, que de celui de Montréal, une ville qui n’a pas connu la guerre et qui fut peu concernée par l’actualité du Moyen-Orient.
Cette œuvre, reçue au Québec comme la recherche identitaire du personnage central assimilé à l’auteur, devient à Paris une forme de confrontation politique avec une partie du monde en décomposition. La violence n’est plus tant celle du malheur familial de Wilfrid/Nour (mère morte à la naissance, père enfui) que celle d’une innocence tranquille, brutalement sommée de se confronter aux effets de la guerre.
Ces glissements sensibles n’entament pas l’intérêt que l’on porte au spectacle et il y a la verdeur audacieuse des moyens employés et la fantaisie débridée des acteurs. Wilfrid est encore un peu dans les rêves de l’enfance et se croit accompagné d’un « Chevalier » protecteur, grandiloquent et bagarreur (une « Chevaleresse » pour Nour) tout comme il s’imagine héros d’un film en train de se tourner. Sans souci des conventions habituelles du théâtre, Wajdi Mouawad use des champ et contre-champ du cinéma. Citation des temps héroïques de son théâtre, retour aux fondamentaux du théâtre de tréteaux : l’imagination est au pouvoir. Reste la question de l’exil qui traverse encore et encore la vie et les créations de Wajdi Mouawad. Ici, au tout premier plan, celui volontaire de Wilfrid/Nour vers des racines familiales pour enterrer enfin le corps du Père. Au bout du voyage, la découverte que la guerre pouvait être aussi parfois, le temps de l’enfance et de l’amour.
Et alors la figure du Père, toujours présent et loquace, même mort, prend toute sa place poétique : il ne veut pas être emmené par les flots, il ne veut pas disparaître. Il aime encore trop les femmes, la vie, le hasard et les souvenirs de son enfance. Il faudra bien pourtant que cette jeunesse se décide à le faire couler au fond de la mer pour espérer construire autre chose…
Wajdi Mouawad sera-t-il un jour le Père qui accepte enfin de disparaître ? A la cinquantaine, il est au milieu du gué et son théâtre porte, tout en délicatesse, la marque du temps qui passe.
Marie-Agnès Sevestre
Jusqu’au 18 juillet, Théâtre National de la Colline, 15 rue Malte-Brun Paris (XX ème)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 10, 2020 3:09 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos, publié le 10 juil. 2020
L'institution parisienne n'a pas attendu l'automne pour rouvrir. La reprise de la pièce culte de Wajdi Mouawad « Littoral » par une jeune troupe, tour à tour féminine et masculine, est tout un symbole. Honorer les pères, compter ses morts, rebâtir un nouveau monde… Le théâtre reprend la parole et ça fait du bien.
Dehors c'est le crépuscule, mais dans la grande salle de la Colline c'est plutôt le « point du jour », l'aube d'un recommencement. Après quasiment trois mois de confinement dû à l'épidémie de Covid, le théâtre parisien rouvre ses portes. Il présente une version à l'arraché d'un des spectacles fondateurs de son directeur Wajdi Mouawad, « Littoral » (1997). Ce premier volet de la trilogie du « Sang des promesses » parle d'une autre épidémie, celle de la guerre, qui tue les pères, les mères et rend la jeunesse orpheline. Les jeunes comédien(ne)s réuni(e)s par l'entremetteur en scène devait jouer en mars « Notre innocence », texte parlant de leur présent dans le « monde d'avant ». Ils ont préféré, pour cette session de renaissance, s'atteler à une tragédie universelle qui évoque la mort, la peur, la quête de sens et la résilience, en résonance avec la crise sanitaire.
Devant une salle pleine, nonobstant les sièges vides marquant la distanciation physique, Wajdi Mouawad, tout joyeux en ce soir de première, a donné le top départ, déclarant avec humour qu'il s'était évertué à faire durer la pièce le plus longtemps possible mais qu'il n'avait pas réussi à aller au-delà de 2 h 40. Une bonne façon de vérifier que le masque (non obligatoire une fois assis à sa place, mais recommandé) est tout à fait supportable, même lors de représentations longues. Pour cette recréation de « Littoral », deux distributions alternent, l'une masculine, fidèle à l'originale, et l'autre majoritairement féminine. C'est cette dernière que nous avons découverte le soir de la première ; le héros, Wilfrid, cédant la place à une héroïne, Nour.
Plateau nu
Un petit prologue en forme de bal des accessoires nous permet de renouer avec notre statut de spectateur. Pour le reste, Wajdi Mouawad a joué la carte du dépouillement maximum. L'action se déroule sur le plateau nu. Les acteurs/actrices délimitent les lieux avec des rouleaux adhésifs (blanc pour l'espace de jeu, bleu pour la piscine et la mer). Un velum éclairé par l'arrière crée des ciels changeants. Rien de révolutionnaire dans la mise en scène, centrée sur le jeu intense de la troupe (belle performance d'Hatice Özer dans le rôle de Nour) et d'entêtantes boucles musicales.
Les voix se perdent parfois sur la grande scène vide, le rythme est en dents de scie. Mais quel bonheur de renouer avec l'énergie et l'émotion du théâtre ! De suivre Nour/Wilfrid dans sa quête épique d'identité et d'amour. Toute la fougue de « Littoral », « road-play » humaniste qui voit une fille/un fils arpenter un pays détruit par la guerre pour y enterrer son père et fonder une tribu, s'exprime à plein. Wajdi Mouawad a bien fait de baptiser sa saison d'été impromptue « Au point du jour ». Au théâtre, le soleil se relève toujours.
Philippe Chevilley
LITTORAL
écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad
Paris, La Colline , 01 44 62 52 52
jusqu'au 18 juillet Durée : 2 h 40
Légende photo : La mise en scène, dépouillée, repose sur le jeu intense de la troupe. Hatice Özer (à gauche) incarne avec conviction le personnage de Nour. (© Tuong-Vi Nguyen)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 9, 2020 6:21 AM
|
Publié par la rédaction de Télérama, le 9 juillet 2020 Pendant toute une semaine, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, Télérama a organisé des débats avec des artistes, des scientifiques, ou des philosophes, pour réfléchir à ce que sera la culture dans le monde de l’après covid. Voici en 10 mots clés, les 20 propositions qui en ressortent. ALLIANCE Les médecins avec les artistes, les artistes avec les enseignants, les artistes avec les spécialistes de l’écologie, les uns comme les autres avec les patients, les élèves, les étudiants, les citoyens ou citoyennes : le désir d’alliances est le grand gagnant de nos échanges. Réaction à la distanciation sociale et à l’isolement du confinement ? Plus encore volonté d’ancrer dans une vie qui se réinvente l’autre mot-clé de la pandémie : la solidarité. Proposition 1 Former localement un grand réseau d’alliances entre les acteurs de la culture, de la santé, de l’environnement, de l’éducation et les associations d’usagers et d’habitants • Construire des partenariats sur mesure entre structures culturelles – musées, théâtres, centres chorégraphiques, cinémas, galeries d’art, associations culturelles – et établissements de soins – hôpitaux, cliniques, Ehpad et centres médico-sociaux qui accueillent les adolescents et les enfants.
• Fédérer les centres de ressources et de conseil aux acteurs de la culture pour limiter leur impact environnemental, avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Environnement.
• Organiser des ateliers multidisciplinaires pour les jeunes en rupture scolaire, associant artistes, enseignants et éducateurs. Proposition 2 Encourager la formation au plan régional de pôles mutualisés de production, de diffusion et de soutien à la création artistique • Mutualiser à l’échelle régionale la production et la diffusion des spectacles et productions artistiques de toutes disciplines.
• Stabiliser les emplois culturels non délocalisables et consolider les bassins d’emplois culturels.
• Repenser l’exigence d’exclusivité d’un artiste que pratiquent aujourd’hui certains lieux subventionnés. Parce qu’ils produisent ses spectacles, ils lui interdisent de jouer ailleurs, pensant éviter la concurrence. Cette manière de témoigner leur attachement à un créateur l’empêche de tourner dans un périmètre proche, ce qui devient contraire aux contraintes environnementales et favorise la surproduction de spectacles. Privilégier un droit aux premières représentations – au lieu des exclusivités – permettrait de mieux faire tourner les œuvres. Et de toucher ainsi un plus large public. De plus les frais engagés seront diminués puisque supportés par d’autres lieux partenaires.
• Sortir du goulot d’étranglement entre surproduction et sous-diffusion du spectacle vivant. La plupart des créations sont vues par un nombre restreint de publics, faute de tourner suffisamment dans d’autres lieux. Imaginer des moyens de faire circuler ces projets en passant par d’autres circuits que les théâtres. Par exemple en investissant les universités où ne se déroule presque plus aucune activité artistique. CHARTE Toute période de refondation appelle sa charte, ou ses chartes. Et un regard critique sur les réformes passées, à réviser ou à compléter. Le grand vide du confinement a fait apparaître en creux la nécessité d’une politique culturelle vraiment coordonnée entre acteurs publics. L’urgence sanitaire et climatique vient percuter cet enjeu avec celui de la responsabilité. Personnelle et collective. Proposition 3 Repenser une vraie politique culturelle dans les écoles, les universités, les centres de soins et les entreprises • Engager l’acte III de la décentralisation culturelle, redéfinir le sens de la mission des collectivités publiques autour d’une priorité : assurer la présence des œuvres et des artistes au plus près des populations concernées, dans les écoles, les universités, les centres de soins et les entreprises.
• Réaffirmer la mission et soutenir l’action des associations culturelles et sociales qui jouent un rôle essentiel d’intégration dans les territoires. Les doter d’une instance de coordination entre les multiples silos ministériels (Culture, Éducation, Enseignement supérieur, Économie, Environnement, Industrie) et territoriaux (Villes, Régions, Départements) concernés. Proposition 4 Intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et lui donner les moyens effectifs de contribuer à la maîtrise du risque sanitaire et du changement climatique • Généraliser le bilan carbone dans l’ensemble des établissements culturels.
• Créer une charte Risque sanitaire pour encourager la responsabilité individuelle sur les lieux de fabrication et de diffusion de la culture (répétitions, tournages, représentations, tournées) avec l’aide des médecins responsables.
• Diffuser les bonnes pratiques, en rassemblant l’ensemble des chartes déjà existantes, qui proposent des mesures concrètes pour réduire l’empreinte écologique des acteurs culturels.
• Créer et animer une charte éthique du financement de la culture par le mécénat et le partenariat pour contrôler l’écoblanchiment par les entreprises qui utilisent l’argument écologique comme outil de marketing. CORPS Isolés, disciplinés, confinés et malades, nos corps ont souffert. Ils ont été réduits à l’état d’objets. Il est temps d’en refaire des sujets qui pensent, parlent, partagent et se touchent. Entre le présentiel et le distanciel, le choix est fait, toujours en maîtrisant le risque. La culture est la solution, pas le problème. Proposition 5 Faire des festivals et événements culturels des relais d’information santé et environnement • Engager l’ensemble des festivals de musiques actuelles, théâtre, cirque et arts de la rue dans une pédagogie de terrain, particulièrement en direction des jeunes générations, avec l’aide de médecins référents.
• Organiser des « académies santé et culture » avant la rentrée scolaire et universitaire, portées par les hôpitaux et les établissements culturels référents. Proposition 6 Oser la prescription. Mettre en place des référents et des projets « culture » dans les établissements de soins, et des référents et projets « santé » dans les établissements culturels et d’enseignement. • Décliner en France, dans tous les domaines artistiques, l’initiative du musée des Beaux-Arts de Montréal : permettre aux médecins de ville de prescrire une visite gratuite dans un musée, un théâtre, une salle de musique, en accord avec ces établissements qui la prennent en charge. Cet acte de prescription au bénéfice du patient n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.
• Développer le dispositif Culture et Santé. Attacher à chaque hôpital un(e) référent(e) « culture » chargé(e) d’assurer une programmation légère mais régulière d’événements artistiques à destination des patients, des soignants et des personnels. Attacher à chaque institution culturelle ou d’enseignement importante un référent « santé » en charge de ces actions.
• Faire essaimer dans les hôpitaux le dispositif des consultations poétiques et scientifiques initiées par le Théâtre de la Ville avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. ÉVEIL Viser l’inclusion par l’éducation et la transmission est parfois devenu lettre morte. L’urgence de faire sortir la culture de ses murs et de son périmètre est aujourd’hui nécessité. Le but n’est pas d’assigner à l’art une mission sociale. Voir revenir en force les notions d’éducation populaire et d’éducation artistique et culturelle est au contraire la promesse d’une grande rencontre artistique et humaine pour les artistes de toutes disciplines, professionnels et amateurs. Proposition 7 Relancer un programme ambitieux d’éducation à l’art et par l’art • Inscrire enfin dans les programmes la réalisation de projets artistiques menés conjointement par des enseignants et des artistes.
• Mobiliser les crédits nécessaires pour rendre effectif le parcours artistique et culturel inscrit dans la loi de Refondation de l’école.
• Organiser des chantiers d’été (dès cet été) associant artistes, enseignants, éducateurs sociaux et jeunes amateurs en s’appuyant sur les infrastructures des établissements chargés d’une mission de service public (lycées agricoles, universités, établissements culturels).
• Organiser des ateliers hebdomadaires pluridisciplinaires 15-18 ans pour les jeunes décrocheurs, destinés prioritairement aux lycéens issus des filières professionnelles où se concentrent les jeunes en rupture scolaire, réunissant trois ou quatre artistes (comédiens, musiciens, chorégraphes, écrivains ou réalisateurs).
• Clarifier les conditions de rémunération des artistes intervenant dans ces projets d’éducation artistique et culturelle, et augmenter le quota d’heures éligible pour les intermittents.
• Conforter l’action, trouver un toit pour les « écoles de la première marche », qui permettent à de nombreux jeunes issus de la diversité sociale et culturelle de se former aux métiers du théâtre, du cinéma et de la danse, et d’accéder aux écoles supérieures artistiques. Proposition 8 Organiser la formation des formateurs et mettre en place le label 100 % Éducation artistique et culturelle • Croiser les formations des enseignants, des artistes et des éducateurs sociaux, déployer à l’échelle nationale les formations du futur Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle qui ouvrira ses portes à Guingamp en septembre 2021. Sensibiliser dès les IUFM les futurs enseignants à la pratique de l’art.
• Faire parrainer tous les établissements scolaires et universitaires par des artistes et inversement faire parrainer tous les établissements culturels par des professeurs.
• Créer un label 100% EAC pour marquer la mobilisation autour d’un engagement partagé pour l’éducation artistique et culturelle de tous les acteurs d’un territoire, collectivités, communauté éducative, monde culturel, acteurs sociaux, secteur associatif, société civile et État. LABORATOIRES DE CRÉATION Aider la recherche et la création, c’est bien. Les abriter dans des lieux, c’est mieux. Mieux encore : ouvrir ces lieux au grand public. Le temps de la pandémie a totalement déréglé celui des artistes et des chercheurs. Il les a enfermés en leur laissant pour seule fenêtre celle de leurs smartphones et ordinateurs. Priorité au large essaimage des lieux où peut se déplier la pulsion de vie de la recherche et de la création. Investir dans la curiosité et le partage des savoirs est le bon choix, pour aujourd’hui et pour demain. Proposition 9 Faire vivre les laboratoires de création dédiés à l’expérimentation et aux croisements arts-sciences-technologies-société dans les établissements de soins, les écoles, les universités, les laboratoires scientifiques, les entreprises • Trouver et réserver dans ces lieux des espaces dédiés à l’accueil d’artistes et de formes de création légères : expositions, musique, danse, théâtre.
• Organiser des résidences d’artistes dans ces mêmes lieux et dans les laboratoires de sciences fondamentales, sciences pour l’ingénieur et sciences humaines et sociales.
• Inscrire dans la charte de ces lieux d’expérimentation le droit à l’erreur, la nécessité de la durée et le respect de la singularité des démarches artistiques et scientifiques.
• Ouvrir la science, partager les données, faire connaître les initiatives d’éducation populaire par les sciences et les laboratoires de pratiques innovantes tels La Main à la pâte, Les Petits Débrouillards, La Paillasse, Makery. Proposition 10 En finir avec la traditionnelle séparation création-patrimoine • Faire de la commande artistique un vrai outil de fabrication du patrimoine de demain en multipliant les commandes croisées qui permettent aux artistes de travailler dans la durée et aux œuvres de vivre plusieurs vies au-delà de la « première », encourager ces commandes croisées entre associations et acteurs culturels, mais aussi avec les acteurs de la santé, de l’environnement, de l’éducation et du monde de l’entreprise.
• Encourager une politique de commandes par les nombreux festivals qui animent partout en France les monuments historiques et lieux patrimoniaux, souvent dans une logique d’où la création est absente.
• Soutenir l’action des centres de ressources qui recueillent les traces de la recherche scientifique comme celles des formes de création éphémères vouées à l’oubli (danse, théâtre, musique, cirque, marionnettes) ou arts technologiques menacés par l’obsolescence de leurs supports. Ils fabriquent notre mémoire du présent et notre patrimoine de demain. MONDIALITÉ Le repli identitaire et nationaliste est une réalité européenne et mondiale, pas un mauvais rêve de nos imaginations inquiètes. La double crise de la pandémie et du dérèglement climatique a révélé nos interdépendances et la vulnérabilité de nos démocraties. La seule position tenable et durable est offensive, pas défensive : ouvrir nos frontières physiques, mentales et culturelles. Proposition 11 Écouter la langue de l’autre, favoriser la mobilité des textes et des visions du monde • Faire entendre les littératures étrangères, classiques et contemporaines, dans leur langue originale, partout sur le territoire national, dans les écoles et universités comme en dehors du champ de l’enseignement.
• Préserver et redéployer, dès que les conditions le permettent, les programmes de mobilité de jeunes européens mis en péril par la situation sanitaire et plus encore par le repli des nations dans leurs frontières. Proposition 12 Renforcer les programmes européens de soutien à l’émergence de jeunes artistes, rayonner à l’international • Faire connaître et mieux utiliser les programmes transversaux européens associant un consortium d’artistes, d’ingénieurs et de scientifiques.
• Organiser un véritable soutien technique et d’ingénierie, sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication pour aider les artistes et les acteurs culturels à obtenir les financements des programmes européens.
• Organiser à l’échelle nationale, sous l’égide de ce même ministère, le soutien à l’international des réseaux d’acteurs culturels. Ces derniers étant engagés dans les enjeux environnementaux, le dialogue arts-sciences ou les arts numériques, tels Exoplanète Terre, la Transversale arts-sciences ou le Réseau national des arts numériques et des cultures hybrides. NUMÉRIQUE Par obligation ou par choix, le confinement a fait exploser nos connexions sur les réseaux et nos abonnements aux plateformes culturelles en ligne. Il a aussi révélé l’ampleur des fractures numériques : inégalités sociales et générationnelles d’accès aux outils numériques, déficit général et spectaculaire de l’appropriation de ces outils. Le numérique façonne nos vies comme nos imaginaires, au quotidien. Il y a urgence à en maîtriser les apports comme les risques. Proposition 13 Doter la création et la culture de leur batterie d’outils et de ressources numériques • Créer une plateforme culturelle éditorialisée du spectacle vivant, comportant outre un catalogue étoffé, des ressources artistiques, pédagogiques et scientifiques.
• Organiser un « Valois du numérique » qui abordera la question critique de la rémunération des auteurs et interprètes dans le contexte de l’explosion des plateformes de streaming et de la crise de l’économie de la diffusion du disque, du livre et du spectacle vivant.
• Mieux faire connaître, mutualiser et démocratiser les outils numériques pour l’ensemble des artistes (sonores, visuels, du spectacle vivant) et des populations : outils de la réalité augmentée, outils de la spatialisation, de l’intelligence artificielle. Pour voyager intelligemment dans l’ingénierie sonore ou visuelle – studios en ligne ou salles virtuelles. Proposition 14 Consolider le réseau des initiatives et des lieux dédiés aux usages et à l’appropriation des outils numériques, à leurs enjeux artistiques, sociétaux et éthiques • Élargir le réseau des Fablabs, Livinglabs, Expelabs dédiés aux usages du numérique aux écoles, collèges, lycées, universités et dans les structures associatives locales.
• Au croisement de l’action des ministères de la Culture, de l’Éducation, de la Recherche et de l’Économie, fédérer les festivals et les lieux de création qui engagent les citoyens dans un débat critique sur la technoscience, leur proposent des actions concrètes d’appropriation des outils numériques, alertent sur leur potentiel d’aliénation, éclairent leur pouvoir d’émancipation.
• Mutualiser ces expériences et bonnes pratiques sur une plateforme collaborative art-sciences-technologies-éthique-société à l’échelle nationale, connectée à l’international. PERMACULTURE Inventons la génération des « permaculturels », ces citoyens qui savent qu’ils ne sont qu’une partie du vivant. Elle permettra la bifurcation nécessaire et vitale qu’imposent les risques de pandémie et la certitude des transformations durables de l’environnement. Penser ensemble culture et nature, création et transition, résilience et biodiversité est un enjeu majeur pour les artistes comme pour leurs publics. Une révolution culturelle qui invite à repenser les cycles de vie – des individus comme des œuvres – à l’aune du bouleversement de notre rapport à notre environnement. Proposition 15 Éduquer une génération 100 % permaculturelle • Inscrire au carnet de santé de tout jeune enfant la notion d’éveil culturel, prévoir une consultation longue une fois par an pour observer son développement global, qui inclut l’éveil sensible et culturel.
• Inclure les images et représentations de la biodiversité dans ces activités d’éveil, revoir l’iconographie traditionnelle de la basse-cour pour y inviter l’infinie diversité des espèces animales et végétales menacées.
• Encourager la création d’œuvres artistiques pour les tout-petits.
• Engager des artistes (comédiens, musiciens, chorégraphes, plasticiens, auteurs ou réalisateurs) pour travailler aux côtés des éducateurs sur le volet biodiversité et développement durable de l’« été apprenant » et des « colonies apprenantes » lancés par le gouvernement.
• Associer les écoles d’art aux écoles supérieures d’agronomie et aux établissements de recherche dédiés aux sciences du vivant. Proposition 16 Maîtriser le cycle de vie des œuvres • Créer des lieux d’approvisionnement en écomatériaux coconçus par des artistes, les départements recherche et développement des entreprises et les start-up éco-innovantes, destinés aux acteurs du secteur culturel (arts plastiques, arts vivants, mode, architecture, urbanisme).
• Créer, avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Environnement, un centre de ressources et de conseils pour aider les artistes et responsables culturels à réduire l’impact environnemental de leurs activités, avec l’aide d’experts en écoconception et en stratégie bas-carbone.
• Engager les artistes et responsables culturels à examiner les possibilités de réemploi, de prêt ou d’échange de matériaux au lieu de réfléchir en termes de tri des déchets.
• Construire la bibliothèque idéale des prisons, en organisant et en éditorialisant les dons de livres, à l’initiative d’associations ou d’établissements culturels. RÉCIT Nous avons un besoin vital de nouveaux récits. Savoir nous représenter dans notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. L’image de l’homme « maître et possesseur de la nature », que l’on doit au philosophe René Descartes, a été ébranlée par la pandémie. Elle s’est brisée dans notre course effrénée à l’exploitation des ressources naturelles. Par quoi la remplacer ? La bataille des représentations est ouverte. Problème : la production de récits et d’imaginaires est entre les mains des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui véhiculent surtout un idéal de consommation. Comment dessiner l’incertain, comment écrire les récits et mythologies du monde d’après, dont nous avons tant besoin pour nous aider à nous reconstruire ? Proposition 17 Repenser l’enseignement de l’histoire des sciences et de l’art à travers les notions de récit et de regard critique • Privilégier l’enseignement des sciences à travers la notion de récit, rendre à cette pédagogie sa fonction inclusive, au lieu d’en faire un instrument de discrimination sociale par la mémoire et le bachotage.
• Intégrer la culture et l’histoire de l’art à l’enseignement des médecins, organiser des rencontres entre étudiants de la filière santé et des écoles d’art, en présence des artistes.
• Expérimenter avec des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des designers et avec le grand public de nouvelles formes de partage de la science, questionner la rigidité de ses protocoles de communication, transformer le résultat scientifique en culture, par le récit et l’imagination.
• Compléter les cursus scientifiques de formations en art, en histoire, philosophie et sociologie des sciences. Proposition 18 Lancer un vrai et ambitieux programme de commandes publiques aux artistes de toutes générations • Pour soutenir l’activité des créateurs et des écrivains, faire aussi bien ou mieux que le Federal Project Number One de Roosevelt, groupe de projets culturels mis en place après la crise de 1929 dans le cadre du New Deal. Soit développer et stimuler, par un grand programme de commandes publiques porté par l’État, la production d’œuvres dans toutes les disciplines artistiques.
• Assurer, par ce programme, la vitalité de la création artistique française et la protection de la rémunération des artistes, lourdement impactée par la pandémie. VILLES Comment inventer un nouveau projet pour nos villes, entre le grand projet hygiéniste d’aménagement urbain né au XIXe siècle et l’obsession technophile de la Smart City, qu’on serait tenté de remiser sur les étagères du XXe siècle ? Quelle place pour l’art et la nature dans les villes du XXIe siècle qui concentrent plus de la moitié de la population mondiale ? À quoi ressemblera la France post-exode urbain à l’heure de l’urgence climatique ? Proposition 19 Engager des ateliers collaboratifs sur les enjeux culturels et sociaux des mutations urbaines • Remettre la solidarité intergénérationnelle au cœur de nos chantiers sur la ville de demain, cibler les deux maillons de décrochage dont la pandémie a révélé cruellement toute la fragilité, adolescents et personnes âgées, mobiliser les ressources de l’art et des technologies pour faire des Ehpad des lieux de vie, accompagner les travaux des scientifiques sur la prévention de la fragilité chez les seniors.
• Repenser la présence de l’art dans la ville, engager une réflexion sur une nouvelle conception de l’espace public associant artistes, architectes, paysagistes, designers et habitants.
• Examiner l’impact du développement exponentiel des tiers-lieux et autres espaces collaboratifs dans la transformation culturelle et sociale des villes. Proposition 20 Développer la commande sociale et les commandes artistiques dans le secteur privé • À l’image du programme des Nouveaux Commanditaires porté par la Fondation de France, encourager la commande sociale dans tous les lieux de la vie collective, avec l’aide de médiateurs responsables du dialogue avec les artistes et de l’intégration de l’œuvre au sein de la communauté dans laquelle elle s’inscrira.
• Élargir le dispositif actuel du 1 % artistique – qui associe à la réalisation ou à l’extension d’un immeuble public par un promoteur la commande d’une œuvre d’art – à tous les projets de rénovation ou d’aménagement urbain dans le secteur privé. Pour que soit constitué un fonds d’activité artistique et culturel qui promeuve de nouvelles relations sur un territoire entre la population, les artistes, les investisseurs privés et les acteurs publics, et assure des revenus aux artistes.
• Profiter des transformations urbaines à l’œuvre (Grands Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille) pour mettre à contribution promoteurs et aménageurs. Cette action, qui repose jusqu’ici sur le volontariat et la bonne volonté, pourrait devenir un objectif d’action publique, mené par un État chef d’orchestre qui le rendrait obligatoire. La rédaction de Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2020 9:59 AM
|
Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 7 juillet 2020 Un cycle de lectures proposé par Radio France Internationale : Ca va, ça va le monde !
Le festival d’Avignon, annulé, devient cette année Un rêve d’Avignon. Tout au long du mois de juillet, des créations uniques (podcasts, documentaires, fictions), et des pièces qui ont marqué l’esprit des spectateurs, seront diffusées sur les stations et plateformes de l’audiovisuel public partenaires du festival, dont Radio France Internationale.
Le programme de lectures publiques d’auteurs francophones, accueilli rituellement au Jardin de Mons, avec le chant des cigales et parfois l’irruption intempestive des cloches des églises voisines, se transporte cette semaine à la Cartoucherie de Vincennes, avec la complicité du Théâtre de la Tempête. La décision a été prise dans l’urgence, alors même que la réouverture des théâtres n’était pas actée, dit Pascal Paradou en charge et à l’initiative du cycle de ces lectures. Sans les trompettes de Maurice Jarre annonçant le début des spectacles mais « avec la ferveur d’une aventure radiophonique sans cesse réinventée ». Les enregistrements publics, en très petit comité, permettront à R.F.I. d’être au rendez-vous de son auditoire, présent sur les cinq continents. Les lectures sont dirigées alternativement par François Rancillac et Catherine Boskowitz, deux familiers des territoires lointains de langue française, deux voyageurs du théâtre contemporain. En ce début juillet, dans la fraîcheur d’une soirée en plein air légèrement venteuse et un quasi huis-clos de plein air, imposé par les conditions sanitaires, François Rancillac a lancé la première lecture du cycle avec Zone franc(h)e du jeune auteur camerounais Edouard Elvis Bvouma. Lauréat du prix S.A.C.D. de la dramaturgie francophone 2016 pour A la Guerre comme à la game boy, puis du prix R.F.I. théâtre 2017 avec La Poupée barbue, il est très souvent accueilli en résidence d’écriture, entre autres aux Francophonies de Limoges. Ses œuvres sont publiées par les éditions Lansman. Donc ce n’est pas un inconnu pour qui a un œil attentif aux écritures venues d’Afrique et assurément c’est une voix originale. Le texte est porté par Ibrahima Bah, Fatima Soualhia-Manet et Claude Guyonnet. Cela se passe dans un centre de rétention : zone pas très claire entre ailleurs et ici, hier et aujourd’hui, pour qui essaye d’obtenir le droit d’asile. Histoire malheureusement bien connue à laquelle l’auteur ajoute le piquant d’un demandeur obstiné, un peu poète et très roublard, qui déclare sa flamme à Madame la France… « L’Inspecteur de la brigade des refoulements » joue son rôle, un peu pervers, de débusqueur de fausses motivations tandis que l’Avocate commise d’office finit, elle, par tomber amoureuse de son drôle de client et voit en lui l’opportunité de changer de vie et, pourquoi pas, de filer… en Afrique ! Savoir où vivre, quelle mémoire trimballer avec soi et quelles ruses employer pour être au rendez-vous de ses désirs, tels sont les talents que doivent déployer tous les candidats à l’exil européen… Le texte n’est sans doute pas le plus original d’Edouard Elvis Bvouma, dont on avait apprécié l’implacable vision des déchirements dus aux guerres civiles africaines. Ici, il laisse un peu traîner des situations tristement bien connues et mobilise plus que nécessaire les explications de son candidat au visa. Mais on se laisse prendre par le personnage le plus original : L’Avocate, qui trouve chez son client une possible pirogue pour ses désirs refoulés. Edouard Elvis Bvouma reste un auteur à suivre. On aimerait que les metteurs en scène français, assez frileux quand il s’agit de monter des textes africains contemporains, fassent voyager son théâtre au-delà des cercles habituels du réseau dit francophone. Marie-Agnès Sevestre Diffusion vidéo sur Facebook mercredi 15 juillet à 11 h : Un Rêve d’Avignon et sur R.F.I. samedi 8 août à 17h 10. A suivre :
Victoria K, Delphine Seyrig et moi et la petite chaise jaune de Valérie Cachard, texte lauréat du Prix R.F.I. Théâtre 2019 (Liban), mise en voix de Catherine Boskowitz. Diffusion vidéo sur Facebook lundi 13 juillet à 11 h et sur RFI samedi 25 juillet à 17 h 10. Traces, discours aux Nations africaines de Felwine Sarr (Sénégal), mise en jeu d’Aristide Tarnagda.Diffusion vidéo sur Facebook mardi 14 juillet à 11 h. et sur R.F.I. samedi 1er août à 17 h 10. Entre deux souffles, le silence… de Pierrette Mondako (République du Congo), mise en voix de François Rancillac. Diffusion vidéo sur Facebook jeudi 16 juillet à 11h. Et sur R.F.I. samedi 15 août à 17 h 10. Démocratie chez les grenouilles de Jérôme Tossavi (Bénin, mise en voix de Catherine Boskowitz. Diffusion vidéo sur Facebook vendredi 17 juillet à 11 h. Et sur R.F.I. samedi 22 août à 17 h10. Les Filles de Salimata Togora (Mali), mise en voix de François Rancillac. Diffusion vidéo sur Facebook samedi 18 juillet à 11 h. Et sur R.F.I. samedi 29 août à 17 h 10.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2020 11:24 AM
|
Mathieu Touzé et Edouard Chapot : « C’est une chance qu’il n’y ait pas de programmation dans le Off d’Avignon » En juillet, le monde du théâtre gesticule normalement sous la canicule avignonaise. Et c’est comme ça depuis 1947. Il y a des exceptions. 2003, et…2020. Mais le Théâtre 14 a décidé de prendre le tournant positif des choses en organisant un Off d’Avignon à Paris, avec un Paris Off Festival. Rencontre. Alors que les États généraux du Off viennent de s’ouvrir vous réalisez ce que cette association n’a jamais réussie à faire : une programmation. N’est-ce pas un tour de force incroyable ? Pour un théâtre faire une programmation est quelque chose d’accessible, la plupart des lieux d’Avignon proposent d’ailleurs des programmations. Faire un festival permet de programmer avec beaucoup moins de contraintes que lorsque nous construisons une saison. Nous avons essayé d’être éclectiques et d’organiser une diversité de propositions qui fait la force et la joie du OFF d’Avignon. C’est une chance qu’il n’y ait pas de programmation dans le Off d’Avignon. Cela permet que tous les types de Théâtre soient représentés. La grande anarchie du festival d’Avignon permet aux nouveaux entrants d’être vus et entendus, qu’ils aient leur chance. Cette chance là existe de moins en moins en dehors du festival. Le Tour de force, s’il doit en avoir un, est de réussir à organiser ce festival dans un laps de temps très court. Même si ce n’est qu’une petite goutte d’eau (nous n’accueillons que 15 spectacles sur les 1500 propositions) du festival d’Avignon. Nous avons reçu beaucoup de soutien, ce qui montre qu’il y a un vrai besoin de lieu de rencontre entre les artistes et les programmateurs. C’est peut-être à ce type d’espaces qu’il nous faut réfléchir. Là où nous agissons en revanche c’est sur les conditions. Bien que le coût du festival soit très important pour nous, nous avons tenu à donner aux compagnies un minimum garanti, un temps long de montage et de démontage, nous avons pris en charge la communication, les frais sanitaires, etc. Je pense que ce qui manque le plus à Avignon ce n’est pas une ou des programmations, c’est que les Théâtres s’engagent solidairement avec les artistes. Et justement qu’elle est la ligne programmatique de ce festival à Paris ? Nous avons essayé d’être le plus éclectique possible pour entraîner les habitants de la Porte de Vanves dans la magie des journées du festival: des spectacles pour enfants, du théâtre subventionné, du théâtre non subventionné, des personnalités reconnues, des nouveaux entrants. Nous allons du spectacle à partir de 3 ans le matin au cabaret transformiste le soir. Vous avez été les premiers à réagir après le confinement. Avec un peu de recul comment percevez-vous vos nouvelles pratiques ? Nous n’avons pas vraiment de nouvelles pratiques. Nous sommes encore vert dans la profession, alors nous continuons à être en réactivité sur le monde dans lequel nous vivons. Le Théâtre 14 est une toute petite équipe (et beaucoup d’amis), les décisions se prennent très simplement. Nous appelons ensuite notre Présidente et la Mairie de Paris qui sont toujours très enthousiastes et les choses se mettent en place. Après, ce n’est qu’une question d’intendance. Nous avons eu beaucoup de joie à mettre en place le spectacle post-confinement avec Johanny Bert, là nous avons beaucoup d’excitation à mettre en place le Festival. J’espère que nous continuerons à être en connexion avec le réel qui nous permet de faire naître des idées. Et puis tant le festival que le spectacle pour les familles, ce ne sont pas des choses très compliquées à faire. Il n’y a pas vraiment de nouveauté, beaucoup de metteurs en scène ont déjà questionné la place du spectateur, beaucoup de Théâtre organise des festivals. D’ailleurs, nos initiatives sont déjà reprises. D’ailleurs pardon pour ce retour en arrière mais vous avez ouvert avec un jeune public et lors du festival il y a pas mal de spectacles qui sont dédiés aux enfants et aux adolescents. Avez-vous envie que le théâtre 14 soit une scène privilégiée pour la jeunesse? Nous avons des partenaires qui font des spectacles pour enfants et qui le font très bien comme le TPV, le Dunois, etc. Le théâtre pour la jeunesse n’est ni notre ligne, ni notre projet mais nous n’aimons pas non plus les limites ou les cases. Nous avons proposé le spectacle pour les familles parce que nous avons senti que c’était ce qu’il fallait faire à ce moment là. Nous avons à cette occasion compris qu’il y avait un demande de spectacles à voir en famille. En conséquence, nous avons gardé une place dans le festival pour les spectacles destinés aux enfants et adolescents (qui se remplissent très vite). Nous avons aussi programmé un spectacle pour les familles dans notre saison de la rentrée BLA BLA BLA d’Emmanuelle Lafon en partenariat avec le Festival d’Automne. Quand nous avons constaté la demande qu’il y a eu sur Elle pas princesse, lui pas héros, on s’est dit que nous reprendrons ce spectacle pendant les vacances scolaires à destination des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, c’est notre mission de théâtre publique et ça nous fait plaisir. Nous n’avons pas vocation à devenir un théâtre pour la jeunesse mais nous avons très envie de proposer des actions à destination de la jeunesse. Il y aura deux projets co-construit avec des adolescents la saison prochaine, des cours de théâtre à destination de toutes les classes d’âge, etc. Comment on percevez-vous la rentrée au 14 ? Avez-vous déjà précisé les choses ou attendez-vous d’y voir plus clair? Nous avons renoncé à y voir clair. Depuis que nous avons été nommés il y a eu les grèves, les gilets jaunes, un espace de deux mois où nous avons ouvert puis le COVID. Nous sommes dans l’accueil du présent et nous avançons avec les moyens qui sont les nôtres. Nous envisageons tous les scénarios possibles, nous restons très flexibles, à l’écoute des signaux faibles, de l’air du temps, de l’actualité. Nous avançons pas à pas. Nous avons beaucoup discuté avec nos partenaires sur le fait que les initiatives pourraient très bien ne pas voir le jour, et tout le monde à accepter ce paramètre. Nous sommes là pour travailler, tenter, essayer, faire et défaire et c’est ce que nous faisons. Du 13 au 18, Au Théâtre 14 et au Gymnase. Et tout le programme est ici !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2020 7:54 PM
|
Par Gilles Renault dans Libération — 5 juillet 2020 Béatrice Macé, cofondatrice et directrice des Transmusicales de Rennes, Christian Allex, directeur artistique indépendant et programmateur de festivals, et Olivier Poubelle, gérant de salles parisiennes et producteur, analysent l’impact de l’annulation de festivals et des concerts sur leur profession
Dans la vie d’avant, en ce début juillet, il aurait été ici question du Festival d’Avignon, des Eurockéennes de Belfort, des Nuits de Fourvière à Lyon, du Main Square Festival à Arras, du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, des Tombées de la nuit à Rennes ou de Montpellier Danse. Pourtant, comme de coutume, la place et le temps auraient néanmoins manqué pour évoquer tous les événements souhaités, sans même songer à une exhaustivité d’autant plus vaine que la carte estivale est désormais autant constellée de rendez-vous culturels, qu’il y a de points lumineux observables durant la Nuit des étoiles par temps dégagé. Mais 2020 restera comme un annus horribilis, pour une sphère artistique percutée de plein fouet par la comète Covid. Depuis le début du confinement, mi-mars, le spectacle vivant broie du noir, le Prodiss, syndicat des professionnels du secteur, le décrétant même d’emblée en «danger absolu». L’assouplissement progressif des restrictions, annoncé le 11 mai, a redonné un peu d’oxygène à plusieurs domaines. Les musées, les cinémas ou les libraires ont pu rouvrir et, dans quelques jours, après les zoos et les parcs à thème, les stades et les hippodromes feront de même. Pendant ce temps, la musique n’en finit plus de chanter sa complainte. A la fermeture printanière des salles a succédé l’annulation de la quasi-totalité des festivals d’été, la définition des événements jugés viables par le ministre de la Culture («une scène, un artiste, cinquante spectateurs dotés de masques qui se tiennent à une distance d’un mètre…») finissant de plonger jusqu’aux moins éclairés des amateurs dans un abîme d’incrédulité et de consternation. Pris dans la nasse, le monde populaire des concerts s’époumone. Par visioconférence interposée, Libération a mixé les points de vue croisés de trois acteurs reconnus et respectés du milieu : Christian Allex, directeur artistique indépendant et programmateur des festivals le Cabaret vert à Charleville-Mézières, Magnifique Society à Reims, VYV à Dijon, ainsi que des Scènes de musiques actuelles (Smac) à la Cartonnerie de Reims et Paloma à Nîmes ; Béatrice Macé, cofondatrice et directrice des Transmusicales de Rennes, qui gère également la salle de l’Ubu ; et Olivier Poubelle, gérant des salles parisiennes les Bouffes du Nord et la Maroquinerie, et producteur de spectacles via diverses sociétés, dont Astérios. Que vous inspire la réflexion de Christophe Girard, adjoint à la culture de la Ville de Paris : «L’Etat a fait une erreur honteuse d’annuler trop vite les gros festivals» ? Béatrice Macé : S’il y a eu un flottement quant à la signification de «gros festivals», cela n’en a pas moins rendu la décision logique pour autant. Du reste, face à tant d’incertitudes liées à une crise sanitaire pour laquelle nous ne disposions d’aucun point de comparaison, tous les pays ont pris la même. Comment, dans un tel contexte, imaginer raisonnablement réunir 70 000 ou 100 000 personnes au même endroit ? Olivier Poubelle : Tout le problème étant de savoir comment la suite va s’organiser. Or, pour l’heure, nous n’en avons pas la moindre idée, sinon que ces supposés 4 m2 par personne, qui donneraient par exemple un concert à la Maroquinerie devant 100 spectateurs, au lieu de 500, sont inapplicables. Il faut prendre avec modestie la manière dont toutes ces données évolutives liées à la pandémie peuvent être analysées, mais cela n’exonère pas pour autant le gouvernement de toutes les maladresses et imprécisions commises. Christian Allex : On aura beau retourner la question dans tous les sens, ce virus est antinomique avec la conception que nous avons de notre métier et il nous empêche tout bonnement de fonctionner. Quand on voit la situation des casinos, des hippodromes, et même d’autres secteurs culturels, estimez-vous que la musique a pâti d’un traitement de défaveur ? O.P. : J’ignore si on nous a mal traités, mais il n’est pas impossible que la musique ne soit pas le secteur le plus performant en matière de lobbying. Les autorités gardent toujours une défiance pour ces événements, perçus comme anecdotiques, qui rassemblent un public jeune, debout, qui va danser, chanter, postillonner, et les imprécisions observées trahissent une méconnaissance de notre discipline. Mais, oui, malgré les efforts de certains syndicats, notamment, il doit manquer le poids de quelques leaders et artistes emblématiques pour porter notre parole et je crains que le ministère de la Culture ait moins l’oreille de Bercy et du ministère du Travail que les parcs d’attractions, par exemple. Combien de temps avons-nous tous passé dans des commissions dont il s’est avéré qu’elles ne servaient au final absolument à rien ? D’ailleurs, il n’est pas anodin d’observer que la nouvelle génération qui incarne ce métier ne se donne même plus la peine de s’y rendre. C.A. : On prend notre public pour des gamins dans une cour de récré, alors qu’il est hyperresponsable, comme nous, organisateurs. Regardez comment nous avons su appliquer les consignes de sécurité après les attentats, ou la manière dont un festival tel que le Cabaret vert tient ses engagements écolos. A l’inverse, le risque, si on ne peut pas vite reprendre notre activité, c’est que fleurissent quantité d’événements clandestins, sans encadrement. Plutôt que d’imposer des règles rigides, pourquoi ne pas nous faire plus confiance ? B.M. : C’est un peu comme si on n’était pas allés au bout de la dé-hiérarchisation du corpus artistique, entreprise dans les années 80 sous Jack Lang. Les autorités continuent de fonctionner sur des idées préconçues, avec une perception de l’art conservatrice, traditionnelle, plutôt qu’anthropologique. Nous sommes rentrés les derniers et on reste un peu au bord. O.P. : Tout cela n’étant que le reflet de la manière dont la société est structurée. Et encore, la situation des arts de la rue est bien pire que la nôtre : eux sont encore plus infantilisés et en manque d’interlocuteurs. La lecture de l’art qui nous réunit et la façon dont on le produit et l’organise restent très formatées, le débat existait avant la pandémie et il ne faudrait pas que celle-ci occulte la réflexion de fond dont nous avons besoin et qui pourrait notamment induire la nécessité d’être mieux regroupés que nous ne le sommes. C.A. : Une autre crainte serait que les protocoles mis en place pour contrer la pandémie tendent à exacerber une volonté d’uniformisation. Or, par-delà le drame économique dont certains ne se relèveront pas, je crois qu’il faudrait au contraire en profiter pour revaloriser les structures indés qui incarnent l’avenir. Regardez tous ces petits festivals qui se créent partout. Depuis la mi-mars, plein d’idées ont germé, il faudrait profiter du contexte pour tenter de les mettre en place et se réinventer. Quand pouvons-nous espérer revoir des artistes étrangers ? B.M. : Si on savait… Les multiples questions que nous posons restent pour l’heure sans réponse, sachant que la problématique ne sera pas la même pour les artistes de l’espace Schengen que pour les Américains, les Anglais ou les Canadiens. Le maître-mot sera la faculté d’adaptation, à mesure que la situation va évoluer. O.P. : La réalité, c’est qu’actuellement personne ne réserve de salle. Les producteurs français s’obstinent à maintenir des dates, mais lorsqu’on parle avec les agents, américains, par exemple, ils ne se font aucune illusion. Sur les 110 concerts prévus à la Maroquinerie, je suis, en l’état, bien incapable de dire combien existeront réellement. La vraie crainte, une fois de plus, n’étant pas de savoir quand on pourra recommencer, mais avec quelles contraintes, les nouvelles normes sanitaires, ajoutées à celles préexistantes, risquant de rendre la situation insurmontable. Pour l’instant, nous sommes condamnés à éplucher tous les documents qui nous submergent. Pourtant, je reste persuadé que tous les millions de vues sur Internet ne feront jamais autant rêver qu’une heure trente de concert réussi. En se faisant l’avocat du diable, pourrait-on imaginer que le contexte autarcique favorise la scène française ? O.P. : Les rencontres nourrissent les esthétiques, la curiosité et, en ce sens, les étrangers tirent nos artistes vers le haut. Je crains au contraire qu’il ne faille y voir la perspective d’un appauvrissement. A la limite, on pourrait imaginer fonctionner de la sorte pendant quelques mois, une demi-saison tout au plus, d’autant que le public lui-même ne suivra pas forcément. Et comment j’explique à Rilès, dont l’album est sorti aux Etats-Unis et en Angleterre, ou à Petit Biscuit, qui est allé dans quatre pays différents enregistrer son nouveau disque, qu’ils doivent se satisfaire du territoire hexagonal ? Même moi, dont le parcours professionnel est somme toute «franchouillard», je ne sais pas si j’aurais fait ce métier si on m’avait privé de l’opportunité de côtoyer les Anglo-Saxons. B.M. : Concernant les Trans, se poserait en outre la question de la transformation, donc de la détérioration du projet. Les artistes que nous recevons sont des prototypes, des artisans. Serons-nous en mesure de présenter le festival en fin d’année ? Sincèrement, je l’ignore. Nous travaillons chaque jour en ce sens. Depuis début janvier, la programmation est en cours d’élaboration, des groupes sont déjà confirmés, a priori, en prenant en compte ce qui semble raisonnablement envisageable en matière de circulation selon les zones géographiques concernées. Nous avons établi un prédossier sécurité en incluant le protocole sanitaire. Mais on ne peut pas non plus faire de miracle. Si le schéma économique apparaît trop fragile ou si la vocation artistique est altérée, il nous faudra renoncer. En ce sens, nous attendons des engagements et des directives clairs de la part des pouvoirs publics et, mi-septembre, nous trancherons. Vous posez-vous la question d’une éventuelle réticence, côté public, à revenir dans les salles ? C.A. : La réponse est générationnelle. Pour ce qui est des jeunes, je n’ai aucun doute. Au contraire, je perçois même une forme d’excitation. Après avoir annulé 2020, Primavera, à Barcelone, a annoncé son édition de juin 2021 : en trois jours, tout était complet. Quand je reprogramme le rappeur Maes à Nîmes, il n’y a aucune demande de remboursement. Après, pour quelqu’un comme Arno, qui attire dans la même salle les plus de 40-50 ans, c’est vrai que certains manifestent une pointe d’inquiétude. O.P. : Charge aussi aux autorités de transmettre un message constructif, et à nous, responsables de structures, de trouver la communication adéquate : parmi les nombreuses plaquettes de théâtres présentant leur programmation à venir, que d’éditos anxiogènes ! Moi, pour les Bouffes du Nord, le message que je veux transmettre est simple : notre nouvelle saison est magnifique et on espère bien pouvoir la tenir. L’hypothèse d’un public masqué vous semble-t-elle plausible ? O.P. : Sérieusement, qui va imaginer 6 000 jeunes gardant leur masque dans un concert de rap au Zénith ? On peut exiger de nous une obligation de moyens, pas de résultats. On ne va pas fliquer les gens et il ne faudrait pas que notre responsabilité pénale soit engagée. C.A. : Par ailleurs, il faudra qu’un jour on m’explique en quoi la personne assise pendant deux heures à vingt centimètres de moi dans un TGV pose moins problème que les gens que je croiserais dans une salle de spectacle. B.M. : Nous sommes en train de nous poser cette question du masque. Pour l’heure, nous ignorons comment le public va réagir, dans un contexte où chacun aimerait reprendre ses habitudes sans courir de risque pour autant. Peut-être faut-il avant tout tenir compte du souhait des spectateurs, dans un sens ou dans l’autre. C.A. : Ou établir une charte qui garantit de notre part un certain nombre d’engagements. Libre ensuite à chacun de rentrer dans la salle, ou pas. La crise sanitaire aura-t-elle selon vous une incidence sur les cachets ? O.P. : Soyons clairs : un spectacle que je vends 10 000 euros ne peut pas être bradé à 6 000. Les gens ne se rendent pas compte à quel point nos marges sont faibles, y compris les directeurs de Smac [Scènes de musiques actuelles, ndlr] dont la méconnaissance de notre métier me sidère. Car sur ces 10 000 euros, il ne m’en restera guère que 1 000, ou 1 200, qui serviront pour l’essentiel à rémunérer les équipes. Et encore, cette somme correspond-elle à un artiste déjà établi, la plupart ne gagnant parfois que 200 ou 300 euros de cachet. Nous sommes dans un milieu où, hormis les grosses têtes d’affiche, les salaires sont globalement peu élevés. C’est une économie tendue et il faut faire attention à tout : le prix des places, l’hébergement, les transports… C.A. : A priori, les us et coutumes des agents anglo-saxons n’ont guère changé. La question restant toujours celle de l’équation entre le prix qu’on nous demande et la somme qu’on est en mesure de mettre. En raisonnant à l’échelle européenne, si nous faisons des offres trop basses, les artistes préféreront aller dans d’autres pays. Je n’ai d’autre choix que celui de l’admettre, en sachant par ailleurs que nous avons perdu beaucoup d’argent durant le confinement et qu’il y a des offres que je ne pourrai pas renouveler. La période à venir ne sera assurément pas propice aux gros investissements, et il faudra être sélectif. B.M. : Quant aux Trans, étant situées en amont du marché avec, dans leur quasi-totalité, des artistes en devenir, elles ne sont pas trop impactées par la dérive inflationniste. Toutefois, j’observe que, depuis quatre ou cinq ans, le point d’équilibre est plus compliqué à atteindre : de 60 ou 70 %, nous sommes passés à un taux de remplissage supérieur à 90 % nécessaire pour amortir les frais engagés. Le code du travail est lourd, étant à la fois ERT [Etablissement recevant des travailleurs] et ERP [Etablissement recevant du public]. Nous fonctionnons sur des budgets que je qualifie de «contraints», avec des marges de négociation très faibles et la crise ne fera évidemment qu’accentuer la problématique. O.P. : Et demain, on va nous demander deux tours bus au lieu d’un, plus de loges, du Plexiglas dans les zones techniques, un long temps de désinfection du matériel… Quatre mois après l’arrêt de votre activité, dans quel état d’esprit êtes-vous ? O.P. : Suffisamment de choses m’énervent pour que je puisse me déclarer combatif. Ne serait-ce qu’en raison de l’engagement moral que j’estime avoir envers les artistes et les salariés avec lesquels je travaille. B.M. : Je dirais «résolue», bien que me sentant à bord de montagnes russes avec des gouffres paraissant de plus en plus profonds, et des sommets de plus en plus élevés. Il y a de longs moments d’isolement, on cogite sans cesse. C’est d’autant plus moralement épuisant qu’étant suspendus aux informations, nous n’avons pas la liberté mentale de déconnecter. C.A. : Ce que j’appellerais une énergie de survie. Les grandes dégringolades psychologiques, quand trop d’annonces déprimantes s’accumulent, sont contrebalancées par un entourage qui donne envie de s’accrocher. Quelle date souhaitez-vous fixer au public qui fréquente vos salles ? O.P. : Le 8 septembre aux Bouffes du Nord, avec la pièce de Joël Pommerat Contes et Légendes. C’est l’échéance que j’ai fixée à mon équipe et je ne peux pas me permettre d’imaginer un redémarrage ultérieur. B.M. : Le 5 septembre, pour une soirée associative à l’Ubu. Plus tôt on rouvrira avec du public, meilleure sera notre appréciation de la manière dont les mesures prises fonctionnent, ou doivent être adaptées. C.A. : Aloïse Sauvage et Izia seront en résidence fin août, respectivement à la Cartonnerie de Reims et à Paloma, à Nîmes, et elles donneront des concerts début septembre. Nous souhaitions faire des ateliers /spectacles jeune public dès juin, mais nous n’avons pas eu l’autorisation. Et sans attendre ces dates de rentrée escomptée, nous organisons des concerts gratuits chaque jeudi à Reims sur le parking de la Cartonnerie, avec des carrés de pelouse pour symboliser la fameuse distanciation sociale. Gilles Renault Légende photo : Le 8 décembre 2013 aux Transmusicales de Rennes, le public patiente entre deux concerts. Photo Thomas Brégardis. AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2020 4:56 PM
|
Rencontre avec Julien Gosselin animée par Arnaud Laporte sur la scène de l'Odéon-Théâtre de l'Europe en septembre 2017 L'entretien est entrecoupé par plusieurs lectures : Textes tirés d'œuvres de Roberto Bolaño, Michael Haneke, Michel Houellebecq, Don DeLillo, Elfriede Jelinek, Didier-Georges Gabily et Pierre Bergougnioux lus par Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Géraldine Roguez, Maxence Vandevelde. Ecouter l'émission en ligne (1h58)
A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste.
A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste. Il s’agit finalement de s’interroger sur un « art d’hériter » et sur la nature d’une forme de transmission livresque pour des metteurs en scène qui ont choisi de mettre le texte au cœur de leur pratique artistique.
Sera composé un portrait dessiné sur le vif de Julien Gosselin, à travers un entretien, des musiques et des extraits d’œuvres qu’il a choisis et qui sont lus par des acteurs qui lui sont chers.
« Adolescent, quand j'ai découvert la littérature, j'ai eu la conviction intime que la poésie que je ressentais pouvait être transmise et rendue publique. »
Je ne crois pas que la fiction en tant que telle, les personnages qui racontent une histoire, soient le point de départ de mon travail : il y a des acteurs qui jouent des personnages qui racontent une histoire, mais ce n’est pas la finalité de mon travail. Pour me faire plaisir, des gens me disent : « Toi, tu es un metteur en scène qui nous raconte des histoires », mais ce n’est pas ce que j’essaie de faire. J’essaie de créer un rapport extrêmement physique et direct à la littérature. Quand vous êtes chez vous, que vous lisez, il y a une musique, une lumière particulière, vous arrivez à créer une combinaison entre tous ces éléments, toutes ces informations, et quelque chose se crée qui est de l’ordre d’une émotion très fine, très précise, à un instant fugace. La lecture du livre va se trouver modifiée par ce moment que vous avez vécu : si vous lisez ce livre le lendemain dans le train vous aurez encore cette sensation, cette chaleur, ces couleurs. J’essaie de créer cette sensation-là chez le spectateur, à des niveaux d’intensité plus élevés, mais pas tant de raconter des histoires.
Entretien avec Julien Gosselin par Arnaud Laporte
Lectures par Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Géraldine Roguez, Maxence Vandevelde (acteur / musicien)
En mai 2009, à leur sortie de l’École professionnelle supérieure d’art dramatique de Lille (EPSAD), Guillaume Bachelé, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Julien Gosselin, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier fondent Si vous pouviez lécher mon cœur. Ils baptisent leur collectif d’après une phrase que leur citait souvent Stuart Seide, directeur du Théâtre du Nord : « Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné. » Emprunté à Shoah, le film de Claude Lanzmann, ce nom de troupe marque aussi pour Gosselin son envie d’un théâtre documentaire, son souci de parler de notre monde en termes non pas métaphoriques mais réels. Leur premier spectacle, Gênes 01 de Fausto Paravidino, est présenté en 2010. L’équipe crée ensuite Tristesse animal noir d’Anja Hilling au Théâtre de Vanves en 2012. Julien Gosselin a 26 ans quand Les Particules élémentaires, troisième spectacle de la compagnie, le fait connaître d’un très large public au Festival d’Avignon 2013, puis aux Ateliers Berthier en octobre et novembre 2014. 2666 est créé à Valenciennes en juin 2016, puis joué au festival d’Avignon et à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Réalisation : Baptiste Guiton
Equipe technique : Hervé Dubreuil, Sébastien Royer
Assistante à la réalisationSophie Pierre
Enregistré en public à l’Odéon-Théâtre de l’Europe le 26 septembre 2017 Dans le cadre des Traverses - coproduction France Culture / Odéon-Théâtre de l’Europe.
Légende photo : Julien Gosselin à Lille en 2013• Crédits : Philippe Huguen - AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2020 4:55 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde publié le 3 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 5/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur la 57e édition de la manifestation qui, deux jours après son ouverture, prend fin, empêchée par la colère des intermittents.
Ce 10 juillet 2003, vers 13 heures, une foule se presse au cloître Saint-Louis, le centre névralgique du Festival d’Avignon. L’ambiance est lourde, et la chaleur, accablante. Bernard Faivre d’Arcier donne une brève conférence de presse, qu’il conclut par : « Le 57e Festival est clos. » C’est la phrase que le directeur aurait voulu ne pas prononcer. Elle tombe comme un couperet : deux jours après son ouverture officielle, empêchée par une grève des intermittents du spectacle, le festival est annulé. Depuis sa fondation par Jean Vilar, en 1947, ce n’était jamais arrivé, même en 1968, où il avait tangué, mais tenu bon. Lire le récit (en juillet 2003) : Le Festival d’Avignon à grands pas vers l’annulation Pour Bernard Faivre d’Arcier, le coup est particulièrement rude. « Une grande douleur », dit-il aujourd’hui. Cette édition est la dernière de son mandat. Avant de passer la main à Hortense Archambault et Vincent Baudriller, il a conçu sa programmation comme « un feu d’artifice » intergénérationnel : Ariane Mnouchkine, Jean-Claude Gallotta et Bartabas côtoient Stanislas Nordey, Eric Lacascade, Yann-Joël Collin et des plus jeunes… Les étrangers sont nombreux, et pas des moindres : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Alain Platel, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Rodrigo Garcia… Fin juin, tout est en place, les salles sont aménagées, les équipes travaillent, les spectateurs s’apprêtent à arriver. Mais une fronde gronde, qui vient de loin. Lire l’entretien avec Bernard Faivre d’Arcier (en juillet 2003) : Sous la pression, Avignon jette l’éponge Depuis le début de l’année, les intermittents du spectacle sont sur le qui-vive : l’accord sur leur système d’indemnisation chômage doit être renouvelé. Financé par l’Unédic, il est régi par deux annexes (8 et 10) qui en définissent les modalités : 507 heures de travail dans une année ouvrent droit à une année d’indemnisation. Plus favorable que le régime général, ce régime a été mis en place pour tenir compte de la spécificité du travail des artistes, acteurs, danseurs, chanteurs, circassiens, techniciens, éclairagistes, costumiers, metteurs en scène… Mais, au fil des années, le nombre des intermittents a considérablement augmenté – il a triplé entre 1991 et 2003 – et le trou de l’Unédic s’est dangereusement creusé : 828 millions d’euros en 2002, contre 217 en 1991. Au nom de la rentabilité, le patronat voudrait en finir avec ce régime déficitaire des intermittents. Il s’oppose à tous ceux qui le défendent, au nom d’une exception française. Lire la tribune (en juillet 2003) : Sauver ou brûler les festivals d’été ?, par Bernard Faivre d’Arcier Voilà pour le cadre. Le contexte est celui du second mandat de Jacques Chirac : Jean-Pierre Raffarin premier ministre, François Fillon ministre des affaires sociales, Jean-Jacques Aillagon ministre de la culture. Lors de la 28e cérémonie des Césars, le 22 février, ce dernier est vigoureusement pris à partie. Deux jours plus tard se tient une première journée d’action : 15 000 artistes sont dans la rue. Le mouvement est lancé, il monte en puissance au fil du printemps, mais personne ne pense alors qu’il va conduire à l’annulation de la plupart des festivals de l’été, et encore moins à celui d’Avignon, jugé insubmersible. C’est pourtant ce qui va se passer, en bonne partie par manque d’information, de concertation et de considération. Lire le compte-rendu (en juillet 2003) : M. Aillagon souhaite maintenir le système actuel d’indemnisation des intermittents jusqu’à fin 2003 Le 27 juin, un accord est conclu entre les partenaires sociaux et trois syndicats minoritaires, la CFDT, la CFTC et la CGC, sous l’égide de l’Unédic. FO et la CGT ont refusé de le signer. Un point central met le feu aux poudres : désormais, 507 heures ouvriront droit à huit mois d’indemnisation, au lieu de douze. La CGT estime, au risque d’exagérer, que 40 % des intermittents vont être exclus du régime. Sans sourciller, Ernest-Antoine Seillière, le patron du Medef, déclare que « trop de gens, parmi les intermittents, vivent de l’assurance-chômage au lieu de vivre de leur travail ». Favorable à l’accord, Jean-Jacques Aillagon veut croire que le mouvement va s’éteindre. Il n’entend pas quand Bernard Faivre d’Arcier annonce un « incendie ». Non sans raison : le directeur est aux premières loges, et il sait que le sujet de l’assurance-chômage des intermittents est un serpent de mer. Rôle déterminant des collectifs « En 1992, les syndicats menaçaient d’annuler le festival, dirigé par Alain Crombecque, relate-t-il aujourd’hui. J’étais directeur du théâtre au ministère de la culture, et je suis venu à Avignon négocier discrètement avec les syndicats. » Cette année-là, un compromis est trouvé : une seule journée de grève, le 16 juillet. Jean-Pierre Vincent est chargé de rédiger un rapport sur l’intermittence, que les gouvernements successifs prendront soin d’oublier. En 2003, il apparaît vite qu’il n’y aura pas de compromis. Les pouvoirs publics restent sourds aux appels d’artistes et de personnalités qui demandent que l’accord, par ailleurs mal expliqué, soit revu. Venus de toute la France, des collectifs rejoignent Avignon pour prêter main-forte aux équipes en place, dans le « in » et le « off ». Ils vont jouer un rôle déterminant, en débordant les syndicats qu’ils ne contestent pas, mais dont ils refusent la parole dirigiste. Ils ne militent pas seulement contre l’accord, mais contre la précarité qui gagne du terrain dans la société. Lors d’un forum organisé par les intermittents au cloître des Célestins, le 2 juillet, on sent que le vent tourne : sous le slogan « No culture, no future », il est question de retraites, d’éducation, de recherche… Ariane Mnouchkine appelle au dialogue pour ne pas donner l’image d’une profession qui s’entre-déchire. Elle est interrompue par un « C’est maman qui parle ». « Oui, j’en ai l’âge », répond-elle. Patrice Chéreau, qui n’est « pas choqué » par l’accord, se fait siffler quand il taxe de « démagogique » l’appel de la CGT à une grève qu’il juge « suicidaire ». Ce jour-là se dégage une ligne claire entre ceux qui sont taxés de « nantis », et les « sans-grade ». Le maintien du festival apparaît improbable. Le ministère de la culture ne prend pas la mesure du désarroi des intermittents qui se sentent considérés comme ne valant rien – des vauriens, au sens propre Tout s’accélère dans les jours qui suivent. Des médiations sont tentées pour calmer le jeu. Le ministère de la culture reçoit les syndicats pour identifier les points qui pourraient être améliorés, en particulier la lutte contre les abus du système d’indemnisation, qui englobe l’audiovisuel, et le soutien aux jeunes créateurs. Mais il ne prend pas la mesure du désarroi des intermittents qui se sentent considérés comme ne valant rien – des vauriens, au sens propre. Il croit encore d’ailleurs que « de tout cela on ne parlera plus dans trois jours, ça va se calmer, le Tour de France arrive », comme il le fait savoir à Bernard Faivre d’Arcier, le 4 juillet. Mais le 7, une grève reconductible de jour en jour est votée, lors d’une assemblée générale. L’ouverture du Festival d’Avignon, qui devait se tenir le 8, avec Wolf, mis en scène par Alain Platel dans la Cour d’honneur, n’aura pas lieu. Le lendemain, un nouveau vote reconduit la grève. Lire le portrait (en 2005) : Alain Platel, chorégraphe du chaos Pour Marie-Josée Roig, la maire (UMP) d’Avignon, c’est une catastrophe : elle redoute plus que tout l’annulation, pour des raisons politiques et économiques. Pour Bernard Faivre d’Arcier, c’est un échec. Il soutient les intermittents à qui il a proposé de jouer, et « de transformer le festival en un vaste forum, pour faire pression sur le patronat et le gouvernement », rappelle-t-il aujourd’hui. Il n’a pas été suivi, la grève « même la mort dans l’âme », comme il a été beaucoup dit, étant la seule solution pour des metteurs en scène comme Stanislas Nordey et Yann-Joël Collin, qui veulent remplacer les spectacles par un festival « en lutte ». Ariane Mnouchkine n’est pas sur cette ligne : il faut se battre mais jouer, pour le public. Bartabas, qui avait déclaré « J’envoie c… tous les gens de la CGT », veut lui aussi jouer : « Les chevaux ne font pas grève. » Un trou de 2,5 millions d’euros Dans le « off » aussi, où 565 spectacles sont annoncés (contre 1 592 en 2019), les discussions sont vives. Faire grève, ou pas ? Pour des troupes qui souvent s’endettent pour venir à Avignon, l’enjeu financier est vital. Se défendre l’est tout autant : les artistes du « off » comptent parmi les plus précaires. Tous les jours, des manifestations ont lieu dans les rues d’Avignon, où les intermittents s’allongent sur la chaussée, en gisants. La tension monte, elle est à son comble le 9 au soir, où une foule se masse devant la porte fermée du verger du Palais des papes : le risque d’un accident guette. La chorégraphe Régine Chopinot a souhaité « transformer cette crise désespérée en une crise inespérée » Bernard Faivre d’Arcier estime qu’il ne peut maintenir le festival dans ces conditions. L’annulation s’impose. Elle met fin au souhait émis par les intermittents de « transformer cette crise désespérée en une crise inespérée », selon les mots de la chorégraphe Régine Chopinot. Il y a bien, jusqu’à mi-juillet, des initiatives de « contre-festival », certaines très belles, mais elles sont bientôt vaincues par le départ des troupes qui, les unes après les autres, quittent Avignon. Dans les bureaux du festival, les équipes remboursent les 74 000 billets vendus. L’annulation creuse un trou de 2,5 millions d’euros qui pourrait être fatal au festival. Il est en grande partie compensé par une aide de la mairie d’Avignon (363 000 euros), de la région PACA (300 000 euros), et surtout de l’Etat, qui vote une subvention exceptionnelle de 1,27 million d’euros. Le « off », lui, continue dans des conditions difficiles : deux troupes sur trois jouent, et la moitié des festivaliers ont déserté la cité des Papes. Triste ambiance. Mais le Festival d’Avignon a survécu, il aura lieu en 2004, et, à terme, le régime d’assurance-chômage des intermittents a été pris en considération. Brigitte Salino ------------------------- Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Légende photo : Une manifestation d’intermittents du spectacle, le 9 juillet 2003, contre le projet du gouvernement pour réorganiser leur système de protection sociale, à Avignon. BORIS HORVAT/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2020 4:36 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - publié le 01 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 3/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur l’année où la 22e édition a été maintenue en dépit des événements de Mai 68.
« Béjart, Vilar, Salazar ! » C’était en 1968, au Festival d’Avignon. La rime était facile et résonnait méchamment pendant les échauffourées qui faisaient du petit bois des chaises des cafés de la place de l’Horloge. « Ce slogan a énormément blessé Maurice, se souvient la danseuse Dominique Genevois, interprète de Béjart au Ballet du XXe siècle. Il revendiquait avec sincérité un art pour le peuple, comme Vilar, et il était mis dans le même sac que le dictateur portugais lorsqu’on ne le traitait pas en plus d’artiste bourgeois. » N’empêche que la formule demeura, stigmatisant cet été avignonnais dévasté où la danse emporta le morceau. Lire la nécrologie : Maurice Béjart, l'homme qui a bousculé la danse Envers et contre tout, alors que le Festival de Cannes avait abdiqué devant les événements de Mai 68, Jean Vilar maintient la 22e édition de la manifestation. Avec deux troupes internationales seulement à l’affiche, le Ballet du XXe siècle de Béjart, installé à Bruxelles, et le Living Theatre, groupe américain légendaire créé au début des années 1950 par Julian Beck (1925-1985) et Judith Malina, associées à des films et à des concerts. Un programme court mais suffisant pour susciter des conflits. « Malheureusement, à l’exception de quelques courtes études et allusions journalistiques, peu a été écrit sur juillet 1968 à Avignon, raconte Emeline Jouve, maître de conférences à l’université Toulouse-II, autrice du livre Avignon 1968 et le Living Theatre (Deuxième époque, 2018). Pourtant, les tensions qui ont traversé le festival, trop souvent réduites au statut d’anecdotes, rendent compte d’une hystérie collective. Il y avait les Avignonnais qui se plaignaient au maire de la façon dont les acteurs du Living se touchaient et du bruit que faisaient leurs performances, les gauchistes et les anars qui mettaient le bazar, mais aussi l’extrême droite qui était présente. Ça bastonnait de tous les côtés et c’était la confusion. On traitait Vilar de “chien de communiste” et de “commerçant”. Mais certains Avignonnais se retrouvaient aussi à la piscine avec des comédiens du Living et les danseurs de Béjart. » « Une explosion physique » Dans la Cour d’honneur, six ballets de Maurice Béjart, dont Messe pour le temps présent et Bhakti, étaient programmés ; au Cloître des Carmes, le Living, féru d’improvisation, proposait trois spectacles : Mysteries and Smaller Pieces, Paradise Now, Antigone. Entre les deux, de multiples passerelles. Béjart était très admiratif de la compagnie américaine. Il avait rencontré les acteurs lors de leur passage à Bruxelles quelques mois auparavant et tissé des liens avec eux. Dans le livre Béjart, d’Antoine Livio (La Cité Editeur, 1970), le chorégraphe confie : « Le Living nous a appris beaucoup, à nous tous, à tous les gens de théâtre. Nous ne pourrons plus jamais compter sans son passage. Et je crois que ce n’est pas uniquement moi, mais tous les directeurs de troupe, tous les metteurs en scène, je dirais même tous les artistes qui ont assisté à un spectacle du Living, qu’ils soient comédiens, chanteurs, danseurs, doivent obligatoirement avoir subi une influence en voyant cette profondeur de sentiment et d’extériorisation par le geste… » Concrètement, au début de la manifestation, certains danseurs du Ballet du XXe siècle passaient dans la même soirée des pièces de Béjart aux performances du Living auxquels ils participaient. « Nous étions sept ou huit à être sur les deux fronts, se souvient Daniel Lommel. J’interprétais la Messe et je filais ensuite jouer Antigone. D’un côté, c’était l’abstraction, et de l’autre, une explosion physique. Du jamais vu. J’ai beaucoup aimé collaborer avec le Living. C’était très bizarre, aussi bizarre que l’époque que nous traversions mais très engagé politiquement. On parlait des personnes qui ne pouvaient pas entrer dans un pays, de la situation des Noirs aux Etats-Unis… L’atmosphère était dure, à Avignon. On attaquait la police. La révolte était partout. » Plus de 60 000 spectateurs Un incident met le feu aux poudres. Un spectacle du jeune Gérard Gelas intitulé La Paillasse aux seins nus, que devait jouer la compagnie avignonnaise du Chêne noir, à Villeneuve-lès-Avignon, est interdit. « Les acteurs bâillonnés de Gelas se sont retrouvés sur le plateau de la Cour d’honneur et celui du Cloître des Carmes pour rappeler cette censure, explique Emeline Jouve. Quelques jours après, l’interdiction de Paradise Now, du Living, pour cause de « trouble à l’ordre public », envenime la situation. Le Living propose une représentation gratuite et en plein air qui est aussi interdite par la mairie. De fil en aiguille, la troupe, qui avait débarqué dès mai à Avignon, repart dès le 28 juillet, avant la fin des représentations prévue le 14 août. « Et le Living s’en alla avec les recettes, pointe en riant Emeline Jouve. Ce qui fit aussi beaucoup parler. Certains les traitant de voleurs et les autres de Robin des bois ! » Maurice Béjart, solidaire de Jean Vilar, va jusqu’au bout des dix-neuf représentations avec un taux de remplissage à 100 % – soit plus de 60 000 spectateurs au total. Pendant qu’une affiche claironne : « Non à la culture de papape », Vilar tient le cap vaille que vaille. Chaque jour, au Verger d’Urbain-V, où se déroulent les assises du théâtre sur le thème « Le théâtre dans la société », il débat avec les jeunes de la liberté d’expression, questionne « contestation et destruction »… Lors de sa conférence de presse bilan, relayée dans Le Monde du 15 août 1968, il fait remarquer que « compte tenu des circonstances, le nombre des spectateurs était plus important que celui de l’an dernier ». Et déclare dans la foulée : « Nous avons frôlé souvent le danger et le pire pouvait arriver. A tort ou à raison, nous n’avons pas cédé devant qui que ce soit et nous avons tenu nos engagements. » Jean Vilar, créateur du Festival d’Avignon : « Il faut continuer le théâtre jusqu’au moment où la collectivité le rend impossible parce que je crois que c’est un moyen d’information, de réflexion » Pour réjouir le public dans ce contexte troublé, un spectacle de Béjart est donné en plein air et gratuitement le 6 août sur le pont d’Avignon. « Ceci pour de multiples raisons, rappelle Vilar dans Le Monde. Et notamment rappeler que, parmi les difficultés de tous ordres, nous n’avons pas changé. Bien sûr, nous sommes pris dans une société de consommation mais lorsque nous le pouvons, nous tenons à rappeler l’esprit populaire de ce festival qui, je le précise à nouveau, est le meilleur marché du monde. » Et pour pimenter la soirée chorégraphique, une dégustation d’aïoli combla le public. Quelques années plus tard, Béjart témoignera ainsi dans le livre Béjart. Le démiurge, d’Ariane Dollfus (Arthaud, 2017) : « Mai 1968 fut un moment capital de l’histoire française. Mais juillet 1968, ce fut une imposture. Ces enragés, ce n’était que des acteurs médiocres, des artistes sans travail. » Quant à Vilar, qui meurt trois ans plus tard, il affirmait lors d’un entretien avec Bertrand Poirot-Delpech, le 27 juillet 1968, dans Le Monde : « Il faut continuer le théâtre jusqu’au moment où la collectivité le rend impossible parce que je crois que c’est un moyen d’information, de réflexion. Je pense encore une fois que s’il n’y avait pas eu le festival, certaines gens qui ne sont pas protestataires n’auraient pas réfléchi sur les problèmes qui se posent. Sur le nombre, il suffit pour moi qu’il y en ait seulement dix qui aient bien réfléchi. » Rosita Boisseau - Le Monde Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets Légende photo : Une représentation de « Paradise Now », de la compagnie de théâtre américaine Living Theatre, en juillet 1968, au Festival d’Avignon. KEYSTONE-FRANCE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2020 5:26 AM
|
Par Martine Robert dans Les Echos - 2 juillet 2020 Une étude du ministère de la Culture dresse une première estimation globale de l'impact économique du Covid-19 sur le secteur, soit 22,3 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires pour 2020. Parallèlement Franck Riester a précisé avoir déjà mobilisé 5 milliards d'euros pour soutenir ce dernier.
Le service des études et statistiques du ministère de la Culture a mené l'enquête auprès de 7.800 acteurs pour évaluer l'étendue des dégâts financiers et les conséquences à court et moyen terme sur l'emploi.
Quel est l'impact économique de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels ? Dès mars, après le début du confinement, le service des études et statistiques du ministère de la Culture a mené l'enquête auprès de 7.800 acteurs pour évaluer l'étendue des dégâts financiers et les conséquences à court et moyen terme sur l'emploi.
Le résultat est édifiant : si moins de la moitié (46 %) des acteurs a recouru au chômage partiel, la crise va engendrer une baisse moyenne de chiffre d'affaires de 25 % au moins en 2020, soit un recul à attendre de plus de 22,3 milliards d'euros.
Avant la pandémie, le secteur affichait un chiffre d'affaires de 97 milliards d'euros pour une valeur ajoutée de 47 milliards. Le poids de la culture était estimé à 2,3 % de l'économie, avec un secteur marchand composé de 79.800 entreprises. Et 635.700 personnes occupaient un emploi à titre principal dans la culture.
Quatre secteurs en première ligne
Le Covid a des conséquences diverses selon les spécialités mais quatre secteurs contribuent à 70 % de cette perte de chiffre d'affaires : l'audiovisuel et le cinéma pour 22 %, le spectacle vivant pour 19 %, les agences de publicité pour 18 % et les arts visuels pour 13 %.
Seuls le jeu vidéo et les plates-formes numériques n'ont pas souffert voire ont profité de la crise. En revanche, l'effet négatif du virus a été significatif pour le livre, la presse, la production audiovisuelle à la fois pendant le confinement et par un retour à la normale très progressif attendu d'ici la fin de l'année. Le Covid-19 s'avère plus néfaste encore et jusqu'en 2022, pour l'édition musicale, le spectacle vivant, les musées, les galeries d'art, le patrimoine et l'architecture victimes de l'arrêt des chantiers.
Chute de 72 % pour le spectacle
Sans surprise, le monde du spectacle est le plus touché, avec une perte de chiffre d'affaires estimée à 72 % en 2020 soit 4,2 milliards - fermeture des salles, annulation des festivals , puis jauges réduites obligent.
Pour les arts visuels, le manque à gagner est évalué de 31 %, soit 3 milliards : les galeries d'art et les maisons de vente aux enchères devraient voir leur activité diminuer respectivement de 44 % et 37 % - les secondes étant plus actives en ligne -, les musées et monuments de 65 % avec l'effondrement de la fréquentation, notamment internationale. Enfin, il faut s'attendre pour les cinémas à une baisse de chiffre de 42 %, pour les disquaires de 29 %, pour les cabinets d'architectes de 28 % et les libraires de 24 %.
Autre sujet d'inquiétude : les secteurs les plus sensibles sont de gros employeurs . Ainsi, 322.800 personnes occupent un emploi principal dans le spectacle, le patrimoine, les arts visuels, l'architecture. La moitié de ces emplois sont en danger.
5 milliards injectés par l'Etat
Au regard du désastre annoncé, le ministre de la Culture a rappelé avoir mobilisé 5 milliards. « Face à la déstabilisation brutale et durable de la culture et des médias, le gouvernement s'est mobilisé de façon inédite pour protéger les artistes et les acteurs culturels et préserver les emplois. Nous devons défendre notre modèle culturel, et en faire un pilier de la relance », a rappelé Franck Riester.
Quelque 2,9 milliards ont été injectés au travers des dispositifs de soutien : activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'Etat, exonérations de charges. Le reste correspond à des mesures spécifiques comme les 950 millions pour l'intermittence.
Sur l'enveloppe globale, 706 millions d'euros ont été dirigés vers le spectacle vivant et la musique enregistrée, 525 millions vers le patrimoine et l'architecture, 391 millions vers les arts visuels. L'industrie du cinéma et de l'image animée a quant à elle bénéficié de 320 millions d'aide, la chaîne du livre de 217 millions. Enfin, 985 millions ont été mobilisés en faveur des médias et de la communication et 666 millions en faveur de la presse. Photo (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2020 4:18 AM
|
par Lola Ruscio dans L'humanité 2 juillet 2020
Des députés de gauche ont dévoilé mercredi une proposition de résolution visant à soutenir le monde de la création, sinistré par la crise.
Ni le maigre plan présenté en mai par Emmanuel Macron ni la timide reprise de ses activités n’ont permis au monde de la culture de sortir la tête de l’eau. À l’Assemblée nationale, le député PCF Pierre Dharréville a présenté mercredi, avec ses collègues Marie-George Buffet (PCF), Caroline Fiat (FI), Marie-Noëlle Battistel (PS) et Dominique Potier (PS), une proposition de résolution pour développer les arts, la culture, la création et l’éducation populaire.
Ils plaident pour l’organisation d’ « états généraux » afin de « réinventer une politique culturelle d’avenir ». Car, selon Marie-George Buffet, le temps de la crise sanitaire est propice pour repenser le processus de création, et mieux repartir. « Cela ne peut pas se faire sans les travailleurs et les travailleuses » de la culture, assure Pierre Dharréville, insistant sur l’extrême précarité dont ils sont victimes. Tout en saluant cette « année blanche », annoncée par le gouvernement et très attendue par les intermittents essorés par les annulations liées au confinement, l’élu communiste constate que beaucoup n’entrent pas dans les clous. Il cite le cas particulier des artistes auteurs, qui ne bénéficient pas du régime des intermittents, pour lesquels il faut « une intervention publique forte ».
« Il y a eu des plans pour l’industrie et l’aéronautique, la culture mérite aussi un plan de relance important », insiste-t-il. D’autant plus que les règles sanitaires empêchent encore la tenue de représentations. « On peut prendre l’avion, le train, mais on ne peut pas être les uns à côté des autres dans un théâtre ou un cinéma », relève la députée insoumise Caroline Fiat, soulignant le besoin de retrouver le chemin des salles de spectacles après cette période anxiogène. « Quoi de mieux que la culture pour retrouver le moral ? interroge-t-elle. C’est du bon sens de rapprocher les Français des artistes, qui ont besoin eux aussi de retrouver les spectateurs. »
Lola Ruscio

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 1, 2020 9:25 AM
|
Sur le site de l'émission de Laure Adler sur France Inter - 23 juin 2020 Ecouter en ligne l'émission "L'heure bleue" de Laure Adler, avec Ariane Mnouchkine invitée - 23 juin 2020 Ariane Mnouchkine dirige depuis des décennies et d'une main de fer le Théâtre du Soleil à Vincennes : une structure qui se déploie comme une coopération de travailleurs. Ce soir, elle vient nous dire sa colère face à la situation difficile que nous traversons depuis le début de la pandémie. Inscrite dans la tradition théâtrale de Jean Vilar, qui avec le Théâtre National Populaire développe une certaine manière de faire théâtre, Ariane Mnouchkine créé en 1970 le Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes. Le principale credo du lieu étant l'égalité entre chaque salarié. Pour se faire, elle instaure un salaire fixe, le même pour chaque personne travaillant à la réalisation des spectacles, et devient une figure de proue pour de nombreux directeurs et metteurs en scène de théâtre. Dans un entretien qu'elle a donné à Télérama le 9 mai dernier, elle commence par dire sa colère envers les politiques du gouvernement qui fragilisent le monde du spectacle depuis le début de la crise sanitaire, avant de se questionner : Comment reprendre le théâtre, qui ne se nourrit pas que de mots mais surtout de corps ? Quelles conditions sanitaires mettre en œuvre sans qu’elles ne deviennent une censure insupportable ? Le but premier pour Ariane Mnouchkine étant de protéger l'art vivant essentiel à nos vies. Dans la nouvelle formule de l'Heure Bleue, un texte est proposé par nos invités. Ariane Mnouchkine a choisi un extrait de La ville parjure ou le réveil des Erinyes d'Hélène Cixous. Lecture par deux comédiennes du Théâtre du Soleil. Légende photo : Ariane Mnouchkine en tournage © Radio France / Vincent Josse

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2020 2:53 PM
|
Par J. CHASSING Publié dans Le Monde le 12 septembre 1947 Pour la première fois dans notre histoire, le palais des papes d'Avignon a été le siège pendant une semaine de manifestations dramatiques, elles-mêmes exceptionnelles.
Pour créer simultanément, un drame historique anglais, le drame sacré de Tobie et Sara, et une tragédie psychologique française, loin des scènes parisiennes, hors des saisons théâtrales, dans un cadre jamais utilisé encore pour des manifestations dramatiques, il fallait un metteur en scène d'une audace exceptionnelle et de talent : Jean Vilar (qui mit en scène à Paris Shakespeare, Strindberg, Anouilh, d'autres encore, comme T.-S. Elliott, auteur du Meurtre dans la cathédrale), entouré d'une équipe d'artistes dont la valeur et le dynamisme forcèrent l'admiration et les applaudissements de l'assistance.
Le public a su apprécier les efforts et les risques courus par ces comédiens jouant de nuit, en plein air, dans une ville nettement plus éprise d'art lyrique que de théâtre.
Dans le cadre du palais des papes l'acteur n'est plus défendu par le rideau, la rampe, le barrage de lumière, la scène encadrée et protégée par le décor. Il n'a plus l'appui du souffleur. Il ne peut compter sur le concours des éléments qu'ailleurs meuble un plateau. Il doit exécuter ses entrées et ses sorties au vu des spectateurs. Il doit remplir seul une immense scène presque nue, s'avancer largement parmi les premiers rangs du public, avec lequel il se trouve de plain-pied. Il faut qu'il possède assez de force, de présence d'esprit, d'énergie verbale pour se servir de la grandeur du cadre au lieu de se laisser écraser par elle, le seul butoir du fond étant une muraille de quelque trente mètres... et plus.
Mais qui ne connaît la douceur de la nuit provençale, la majesté de la pierre de cette forteresse extraordinaire qu'est le palais des papes, la résonance de l'air méridional, la tendresse des gazons et des bosquets, ne peut imaginer le surcroît de beauté que peut recevoir une interprétation digne des œuvres qui ont été présentées pour la première fois au public au cours de celle grande semaine d'art. Semaine qui nous valut également deux auditions fort appréciées des artistes de l'orchestre de la Radiodiffusion française - station de Marseille - sous la direction du maître Roger Désormière, avec le concours d'Irène Joachim, cantatrice, et d'André Audoli. Ces deux auditions de musique ancienne furent vivement goûtées de nos hôtes et des Avignonnais dans le jardin Urbain V du palais des papes.
J. CHASSING
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 10, 2020 5:07 PM
|
Interview réalisée par Thierry Jallet pour Wanderersite le mercredi 8 juillet 2020
Nouveau dialogue avec le comédien, metteur en scène et enseignant, Assane Timbo. Nous l’avions particulièrement remarqué dans l’impressionnante mise en scène des Trois Sœurs de Simon Stone d’après Tchekhov, que nous avions vue au TNP de Villeurbanne en janvier 2018. Assane Timbo fait partie des artistes qui multiplient les points de vue sur le théâtre depuis le plateau jusqu’à la salle, en passant par les centres de formation. Les collaborations artistiques qui jalonnent son parcours sont nombreuses. Au cours de la saison prochaine, elles le conduisent aussi bien à être dirigé dans Tropique de la violence, adapté du roman de Natacha Appanah dans une mise en scène d’Alexandre Zeff (au théâtre Romain Rolland de Villejuif, puis en tournée à partir de Novembre 2020) que dans Antoine et Cléopâtre de Shakespeare que Célie Pauthe met en scène (au CDN de Besançon Franche Comté dès janvier 2021, puis en tournée). En parallèle, il continue d’accompagner ses étudiants au Cours Florent et prépare un diptyque sur des textes de Daniel Keene et Marie NDiaye qu’il mettra lui-même en scène.
Thierry Jallet :
Pendant la période de confinement on a pu revoir en streaming sur le site de l’Odéon, L'École des femmes dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig (Compte-rendu : http://wanderersite.com/2018/11/lecole-des-marris/ ). Vous y jouiez Chrysalde. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?
Assane Timbo :
C'est avant tout un formidable souvenir de troupe ! C’était fabuleux de découvrir de l’intérieur le travail de Stéphane Braunschweig et de retrouver chaque soir cette équipe au plateau. Cette magnifique aventure a commencé dès le travail minutieux à la table, traversé dans la joie, alors même que nous redécouvrions la violence du texte de Molière. En effet, la pièce entre en résonance sinistre avec l’époque en général, et la question du genre, en particulier. Nous nous sommes très vite rendu compte que cette mise en scène allait plonger en profondeur dans des problématiques intemporelles, d’ordre moral, social et identitaire. La pièce renseigne sur une partition du monde qui est à mon sens, la première de toutes : la différence de genre. Beaucoup d'autres s’y enracinent. Travailler à ce spectacle sous la direction de Stéphane, se saisir de la dramaturgie brillante d’Anne-Françoise Benhamou, s'engager dans le déploiement de ce très beau dispositif fait de transparences et d’opacités, tout cela s’est révélé unique et tout à fait passionnant. La tournée a naturellement été extraordinaire de joies et de rencontres chaleureuses avec le public. Elle aurait dû s’achever au Festival International des Arts de Hong Kong au mois de février 2020 mais la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous y rendre.
TJ :
Vous avez joué Molière mais aussi Corneille, Shakespeare, Tchekhov. C’est un bel itinéraire dans le répertoire classique. Que gardez-vous de chacune des rencontres avec ces auteurs et leurs textes ?
AT :
C'est peut-être un cliché attendu mais je répondrai ici que j’en garde la possibilité de tracer la ligne de nos humanités. De la voir en filigrane par les personnages traversés. C’est une rencontre sans cesse renouvelée avec l’être humain. C'est très intéressant d'y découvrir comment se jouent nos joies, nos drames, nos idées ; de voir comment s’élabore l’architecture pauvre de nos existences. C’est apprendre à mieux nous connaître en définitive.
TJ
Vous jouez également des textes plus contemporains comme Le Sang des Amis de Jean-Marie Piemme mis en scène par Jean Boillot…
AT
Le fait de travailler avec des auteurs vivants est un privilège. J’ai eu la chance de travailler avec Jean-Michel Ribes lorsqu'il montait Musée haut, musée bas, son premier spectacle à la tête du Théâtre du Rond-Point. Je l'ai vu écrire, rectifier le texte… C’est particulièrement enrichissant d’assister à ce processus de création dans l’instant. J'ai rencontré aussi Guillaume Poix, pour Waste, un projet extraordinaire qui mêlait jeu et marionnette, dans une mise en scène de Johanny Bert, dont je crois décidément qu’il peut tout inventer entre arts plastiques et poésie! En outre, j'ai mis en scène ma propre langue avec Nain, un texte que j'ai écrit au sortir de la Classe Libre. J'aime les mots quelles qu’en soient leur époque ou la forme qui les utilisent. Curieusement, ils font toujours écho avec ce que je porte en moi, que ce soit par des textes venus de très loin comme Pseudolus le truqueur de Plaute mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman, ou comme plus récemment dans la nouvelle traduction d’Othello par Sacha Todorov pour Leo Cohen-Paperman. En somme, tous ces textes me renseignent autant sur l'état du monde que sur le mien. Je fais peu de distinction entre textes classiques et contemporains. Tous sont matière à jouer et à trouver du sens.
TJ :
En 2018, vous évoquiez votre parcours dans Le Monde et vous disiez notamment que « le corps noir charrie tout un tas de clichés et présupposés ». Le théâtre ne tend-il pas à neutraliser cela finalement ?
AT :
Ce que je disais là est vrai pour moi depuis que je suis au monde. Cependant, cela change tout le temps de nature, de place dans la société, en fonction de qui porte la question. Je me dis désormais que je devrais passer plus de temps à parler de théâtre plutôt que d’évoquer en mon nom ces questions qui renforcent ce qu’elles dénoncent. Le fait que je suis un homme noir et que vous êtes un homme blanc, parce que nous nous le disons. Au sortir du confinement, le meurtre de George Floyd a une fois encore douloureusement réveillé et accentué ces distinctions. Je pense que si nous voulons faire société tous ensemble, il faut que les personnes de bonne volonté, quelle que soit la couleur de leur peau, ne jouent plus le jeu des couleurs. Depuis que je suis enfant, je n’ai pas l’impression que la situation ait beaucoup changé, même s’il y a eu de nombreuses déclarations et des avancées en ce sens. En posant la question des couleurs, on passe à côté d’urgences réelles : écologiques, politiques, sociales et culturelles. On se retrouve tout simplement englué dans le raisonnement obtus de ceux qui pensent qu’être noir ou blanc dit quelque chose d’un être humain. Je reconnais qu’on m’a certainement proposé des rôles en raison de ma peau, mais je sais aussi que le plateau de théâtre peut parfois abolir ces distinctions. Le geste artistique le peut, oui. Il est ce que nous avons tous en partage, au fond. Nous. Pas la peau. C’est pourquoi, dépassant ces distinctions par mon métier d’artiste, je veux exister pleinement là où on m’invite à l’exercer. Je ne veux plus me débattre vainement dans ces questions absurdes. Aujourd’hui, je ne veux plus les aborder autrement que par le théâtre.
TJ :
Vous êtes également enseignant au Cours Florent. C’est une activité qui vous tient à cœur et à laquelle vous accordez une importance toute particulière dans votre cheminement artistique.
AT:
Le théâtre m’est venu par l’école alors que j’étais enfant, avec un spectacle de marionnettes et la découverte de grands textes du répertoire. En outre, j’ai toujours aimé me plonger dans les récits. Et les récits se partagent. Ma tante nous racontait beaucoup d’histoires à ma petite sœur et à moi-même, les contes de ma part malienne, ces récits proches des Fables de La Fontaine avec des animaux incroyables. Et c’était magique ! Il est bien possible qu’en souvenir de ces moments de partage, j’aie eu envie de transmettre, de partager moi aussi quelque chose avec les autres. Enfant, je crois que j’avais déjà cette envie. Mais j’ignorais que ce serait par le théâtre. J’ignorais à quel point ce serait déterminant pour me renseigner sur ma propre identité : par la pédagogie, je me suis rencontré. Je vis mieux avec moi-même et avec les autres, à la ville comme au plateau. Enseigner, c’est apprendre à être ensemble. Mon activité de pédagogue est l’authentique prolongement à mon métier d’acteur. Comme lui, le pédagogue nous inscrit dans un récit, une tradition, une cosmogonie que nous partageons tous. Cela me paraît important au moment où, me semble-t-il, nous avons justement moins d’histoires à partager, chacun se contentant trop souvent de la sienne. Nous avons besoin de territoires à défricher ensemble, de rêves dans lesquels nous projeter ensemble. Un peu comme une boîte à l’intérieur de laquelle regarder ensemble l’infini et l’éternité, le trivial et le sublime. On y voit les autres et avec un peu de chance, on s’y tient soi-même. C’est dans tous les cas, ensemble que cela se passe.
TJ :
Le spectacle vivant traverse une période particulièrement difficile en cette année 2020 : quel théâtre pour après ?
AT :
Il me semble difficile de faire la synthèse de toutes les formes de théâtre avant comme après 2020. En revanche, je peux m’exprimer sur les conditions dans lesquelles nous exerçons nos métiers. Nous étions jusqu’à présent relativement protégés par des statuts résultant d’une politique culturelle de premier ordre si on la compare à celle de nos voisins, et je redoute que dans cet après, le théâtre, l’art en général, ne devienne la part sacrifiée du retour à la normale. J’ai peur que le théâtre devienne l’objet exclusif de promoteurs, et que la création qui se cherche, ait vécu. Cela étant, les intermittents restent vigilants et personne ne baisse les bras. Il y a chez tous une volonté d’aller vers plus de solidarité, plus d’écoute, à moins que les craintes des uns et des autres n’encouragent le repli et l’entre-soi. En tant que spectateur, je rêve le théâtre d’après, sous la forme d’un spectacle magnifique que je n’ai pas encore vu ! Quelque chose d’inédit, quelque chose qui fasse briller nos yeux dans l’obscurité et qui raconte une fois encore l’histoire de nos vies.
TJ :
Y a-t-il un texte qui pourrait être celui de ce spectacle magnifique, selon vous ?
AT :
Il y a un texte important pour moi auquel je reviens toujours : c’est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman que j’ai déjà mis en scène et joué. Il pose magnifiquement les questions existentielles relatives à notre condition humaine. J’ai l’impression qu’on se retrouve tous dans ces lignes-là. Je rêve aussi de monter un diptyque s’articulant sur Dernier Rivage, un monologue de Daniel Keene, et la pièce Papa doit manger de Marie NDiaye. Je veux y interroger l’homme noir dans l’espace public et l’homme noir dans l’espace intime, et répondre enfin à ces questions qui me sont souvent posées, mais par le plateau. J’ai tout simplement très envie de revenir à la mise en scène. Mais j’aimerais aussi jouer Claudel ou Maeterlinck. Ce sera à voir dans le théâtre d’après ! (Rires)
Au Pied de la Montagne noire de Régis Martrin-Donos, mise en espace de l’auteur pour une lecture-spectacle au festival Nava de Limoux, les 24 et 26 juillet 2020.
Tropique de la violence, adaptation et mise en scène d’Alexandre Zeff, d’après un roman de Natacha Appanah, du 4 au 10 novembre 2020 au théâtre Romain Rolland de Villejuif ; le 13 novembre à l’espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge ; du 19 novembre au 03 décembre 2020 au théâtre de la Cité Internationale.
Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mise en scène de Célie Pauthe, spectacle créé le 21 janvier 2021 au CDN Besançon Franche-Comté en tournée notamment du 03 au 05 février 2021 à la Comédie de Valence et du 07 mai au 05 juin 2021 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 9, 2020 7:22 AM
|
Par Yves Poey dans son blog De la cour au jardin, 1er juillet 2020 Nous sommes deux faux-jumeaux, nés sous le signe des non-mots...
Les non-mots. Le mensonge.
Celui que leurs parents ont cru bon d'asséner à Akouélé, la jumelle, le jour où elle n'a plus revu son frère Akouété.
Ils lui ont dit, à Akouélé, qu'Akouété était parti dans la forêt noire, toute noire, couper du bois.
Et depuis, elle l'attend, Akouélé. En silence, sans parler, sans grandir. Durant de longues années.
Un temps long, un temps d'épreuves difficiles.
Akouété, il est devant nous. Akouété va tout nous expliquer.
Lui, il sait. Il est mort.
Il sait pourquoi sa sœur ne va pas bien.
Les parents, croyant protéger la petite, lui ont non seulement caché la vérité, mais ils ne lui ont pas sculpté le venavi.
Au Togo, le venavi, c'est la sculpture qui remplace le jumeau mort, le demi-dieu qui s'est envolé, le demi-héros qui n'est plus.
Ainsi, il est toujours aux côtés de celui ou celle qui reste.
C'est ce conte que l'auteur togolais Rodrigue Norman nous raconte.
Un conte initiatique, un conte qui va nous montrer qu'on peut parler de bien des choses aux enfants, y compris les plus sérieuses. Y compris la mort.
Vouloir trop protéger les enfants conduit souvent à créer involontairement bien des troubles et bien des soucis.
Vouloir faire en sorte que les petits se construisent sur des secrets n'est pas la meilleure façon de leur faire appréhender l'avenir.
Alors bien entendu, Catherine Verlaguet a adapté le propos de l'auteur pour des petits spectateurs, à partir de 7 ans.
Les choses seront dites, bien dites, de façon souvent très drôle, parfois très émouvante.
Et ce, sans jamais avoir recours à un pathos de mauvais aloi.
En prenant toujours les jeunes spectateurs pour ce qu'ils sont, c'est à dire des êtres doués de raison, qui comprennent les choses, les métaphores, les raccourcis et les non-dits.
La pièce a été créée voici dix ans, dans le cadre d'une commande du CDN de Sartrouville, et est re-créé aujourd'hui au Théâtre de la Ville, dans le cadre de l'opération Un été solidaire.
Akouété, c'est le comédien Alexandre Prince. C'était sa première. Il reprend en effet le rôle.
Souple, félin, gracieux, il va remplir la salle de sa présence, de son grand charisme.
Dès les premiers mots, il nous attrape pour ne plus nous lâcher.
De sa voix claire, chaude, il nous raconte. Il est Akouété-le jumeau-griot revenu nous dire, nous expliquer, nous dévoiler les choses tues.
Durant quarante minutes, le comédien ne va pas ménager sa peine.
La mise en scène d'Olivier Letellier est exigeante en terme de dépense énergétique.
Exigeante également en terme de précision.
En effet, Alexandre Prince évolue dans la remarquable (je pèse cet épithète) scénographie de Sarah Lefèvre.
Le bois sera présent sur scène, le bois qui se transforme, l'essence balsamique qui emplit la forêt, le bois qui se transforme en maîtresse d'école, en maman, en chemin, ou encore en cageot d'oranges.
Tout ceci est très beau et très ingénieux. Et je n'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir.
Le comédien va nous faire rire, dans des tableaux jubilatoires : le ventre de la mère, la scène des remèdes, la scène du guérisseur spécialisé dans les maladies spéciales du cerveau, j'en passe et non des moindres.
Il va nous émouvoir également. Beaucoup. Toujours avec une grande justesse et une grande sensibilité vraie.
Il incarne tous les personnages de façon viscérale. Nous croyons en permanence à ce qu'il nous montre. Le « duo » entre l'épouse, maîtresse femme, et le mari, plutôt lâche, ce duo-là est formidable !
Il faut mentionner également les très belles et très subtiles lumières de Sébastien Revel qui permettent de matérialiser des lieux et de souligner finement les émotions que nous transmet le comédien.
De la très belle ouvrage, là aussi.
Il serait vraiment dommage de laisser cette belle fable, ce conte initiatique aux seuls petits spectateurs.
Ce qui nous est montré de façon si subtile et si réussie m'a complètement séduit.
Cette histoire humaine, qui mêle et unit la vie, la mort, l'enfance et le monde des grands, ce spectacle qui part de la culture togolaise pour dégager un message universel est une totale réussite.
Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien
Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien
C'est l'histoire d'une petite fille qui apporte deux assiettes quand on ne lui en demande qu'une. C'est l'histoire d'une petite fille qui attend que son frère jumeau rentre à la maison pour pouvoir
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/theatre-

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2020 12:13 PM
|
Entretien radiophonique par Guillaume Erner pour France Culture 7 juillet 2020 Récemment nommée à la direction du théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, la metteuse en scène Julie Deliquet sort son premier film en salles demain, un des quatre court-métrages de "Celles qui chantent", film en sélection officielle du festival de Cannes. Écouter l'émission en ligne (17 mn) Juxtaposition frappante de la réalité de l'hospitalisation et des entrailles de l'opéra, Violetta, le premier film de Julie Deliquet sort en salles le mercredi 8 juillet 2020. Ce court-métrage devait voir le jour plus tôt dans l'année, en sélection officielle du festival de Cannes, aux côtés de trois autres qui forment ensemble un film : Celles qui chantent, réalisé par Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui, Jafar Panahi, et Julie Deliquet, suite à une initiative de la 3e Scène, la scène digitale de l'Opéra de Paris. C'était une double provocation, de s'emparer de la notion d'opéra en m'exprimant à travers un nouveau support, le cinéma. Julie Deliquet Des couloirs de l'hôpital à ceux de l'opéra A cheval entre la fiction et le documentaire, le film suit la chanteuse d'opéra Alexandra Kurzak au cours de son travail d'interprétation de Violetta dans la Traviata de Verdi. Dans cette oeuvre adaptée de La dame aux camélias, roman d'Alexandre Dumas dont le personnage central affronte la maladie, à l'instar de l'autre femme que suit la caméra de Julie Deliquet, la comédienne Magaly Godenaire, alors qu'elle s'apprête à suivre une chimiothérapie. Un fil s'est tissé entre l'interprétation de la maladie à travers le territoire du répertoire artistique et la réalité de la maladie, sur un territoire contemporain et sociétal. L'enjeu était de déterminer comment brouiller les frontières entre les deux, entre la réel et la fiction. Julie Deliquet En plongeant entre les couloirs de l'opéra Bastille, à Paris, et ceux de l'Institut Gustave Roussy, centre de cancérologie à Villejuif, se construit, sur un parallèle entre deux femmes et deux mondes, une rencontre au sein et autour de l'opéra. Une association qui est née dans l'esprit de la réalisatrice dès les premiers moments de la préparation du film : En visitant l'Opéra Bastille, à Paris, ses couloirs labyrinthiques m'ont immédiatement frappée : ils me rappelaient les couloirs de l’hôpital. Julie Deliquet BANDE ANNONCE DU FILM "CELLES QUI CHANTENT" Metteuse en scène d'un réel à défricher Avant de s'essayer au cinéma, Julie Deliquet est surtout connue pour son travail de metteuse en scène de théâtre. Elle réalise sa première mise en scène à la Comédie-Française en 2016, Vania, d'après Oncle Vania du dramaturge russe Anton Tchekhov. En 2019, elle y met également en scène une adaptation de Fanny et Alexandre, film du cinéaste suédois Ingmar Bergman. Avec son collectif In Vitro, créé en 2009, elle adapte le film Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, adaptation qui était en tournée en France jusqu'à ce que survienne le confinement. Je cherche toujours à partir du réel. Au théâtre, c'est le réel de la représentation partagée directement avec le spectateur. Mais la force du cinéma, c'est que le réel peut être mis en boîte, capturé. Un support m'apporte une liberté que l'autre m'interdit. Julie Deliquet Nouvelle direction pour le théâtre Gérard Philipe En mars 2020, Julie Deliquet a été nommée à la direction du théâtre Gérard-Philipe, centre dramatique national situé à Saint-Denis. Prenant ses fonctions dans le contexte particulier du confinement, elle s'est entourée d'une auteure et comédienne, Leila Anis, et d'une metteuse en scène, Lorraine de Sagazan. Aujourd'hui, le théâtre est à nouveau ouvert aux équipes, aux répétitions, et propose des ateliers d'été gratuits pour enfants et adolescents. Pour l'équipe du théâtre Gérard-Philipe, c'était une reprise, mais pour moi, c'était une découverte. Cet état de crise nous a fait revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes partagés entre l'enthousiasme de retrouver le public et l'incertitude concernant les impacts financiers. L'ancien directeur du théâtre, Jean Bellorini, parti vers le théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, laisse place à une artiste attachée à un service public qui accompagne autant les auteurs que le public, dans une logique d'accès universel à l'art populaire et à la culture. Le théâtre, ce sont des métiers extrêmement artisanaux qui défendent des grandes idées républicaines. Julie Deliquet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2020 5:41 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama le 7 juillet 2020 La pandémie a conduit les théâtres, publics et privés, à s’adapter. Tous rivalisent d’idées originales pour accueillir le public en septembre, transformant souvent les contraintes en atouts. Tour d’horizon. Lorsqu’on évoque l’après-confinement, ils répondent en stratèges rompus au jeu de dominos. Normal : devenus des experts dans l’art de passer de plan A en plan B, les directeurs de théâtre multiplient les scénarios face aux caprices de l’épidémie. Masque ? Distanciation ? Tout est possible. Tout plutôt que la paralysie de leurs activités. Qu’ils soient responsables d’institutions publiques ou privées, à Paris, en banlieue, en région, ces patrons scrutent le mois de septembre, moment où, ils l’espèrent, se dérouleront des retrouvailles dignes de ce nom entre leurs lieux et le public. Les voilà donc qui s’adonnent à une acrobatique gymnastique mentale qui les balade d’expectative en hypothèse. C’est le corollaire de cette imprévisible pandémie qui a fait voler en éclats les habitudes acquises. Ils sont désormais obligés de tout repenser : le rapport au public, la relation aux artistes et aux compagnies, l’architecture des lieux, le bien-fondé des abonnements, la conception des saisons. Le théâtre de la Porte-Saint-Martin entend montrer qu’il est économiquement viable de créer des spectacles sans têtes d’affiche. Est-ce qu’ils vont faire la révolution ? Non. Ils optent pour l’évolution. Ils s’adaptent. Il y a tant à faire : retrouver la confiance du spectateur, rassurer les artistes, sécuriser les espaces, éponger les déficits. Ce chantier, ils sont prêts à le mener avec ou sans l’aide des puissances publiques (ils préféreraient avec). Ils ont retenu la leçon : le théâtre, qu’ils croyaient invincible, a dû, comme l’école, les restaurants, les stades de foot, courber l’échine devant une épidémie planétaire. Ils ne veulent plus jamais être tétanisés, chassés de chez eux, privés de leur art. Où qu’ils exercent, quels qu’ils soient, ils cherchent la parade. Les plus optimistes entament d’ailleurs un bras de fer avec le Covid. Laurence de Magalhaes, codirectrice du Monfort Théâtre, à Paris, refuse ainsi d’annuler la venue de danseurs chinois en décembre. Seule concession qu’elle fera à l’épidémie : l’aménagement provisoire d’un chapiteau et d’un bar à l’extérieur de son théâtre. En verrouillant les portes des salles, le virus a ouvert celles qui mènent au plein air et a remis au goût du jour la pratique des tréteaux. La directrice du Monfort opérera dedans comme dehors. « À Paris, il y a trop de concurrence. Nous devons être présents sinon nous n’existons plus. Nous devons aussi faire rentrer de l’argent. Le théâtre dépend des recettes de la billetterie. » “Je dois renoncer à des projets excitants pour privilégier ceux qui marcheront.” Éric Ruf, Comédie-Française Même urgence à la Comédie-Française, théâtre national pourtant richement doté par la puissance publique avec une subvention de 24,5 millions. Pas assez pour assumer le coût de la masse salariale qu’en temps normal mécénat et vente des billets permettent de compenser. C’est évident : tous les mécènes ne reviendront pas. Quant à la billetterie, elle affiche une perte de 2,8 millions. Comment résorber le déficit ? En sacrifiant la prise de risque au pragmatisme. « Je dois renoncer à des projets excitants pour privilégier ceux qui marcheront, explique l’administrateur, Éric Ruf. Je jongle avec des critères qui ne sont pas les plus heureux. Je choisis les créations dont le potentiel de reprises les années suivantes ou de captation vidéo est quasi assuré. » Car l’engouement du public pour les interventions quotidiennes de la troupe sur Internet l’a surpris : « Huit cent mille spectateurs ont suivi le programme de La Comédie continue ! » Pas de doute, les partenariats à venir avec les chaînes de télévision vont être étudiés avec vigilance. le Monfort Théâtre refuse d’annuler la venue de danseurs chinois en fin d’année. Le succès des captations vidéo et des podcasts audio est l’une des rares bonnes nouvelles du confinement. Le numérique s’est imposé en alternative crédible. Et peut-être en recours si les troupes étrangères ne peuvent plus venir en métropole. Jean-Michel Ribes, patron du Théâtre du Rond-Point, à Paris, improvise des issues de secours : « Pourquoi ne pas remonter, en France, avec des acteurs français, des spectacles filmés à l’étranger dont nous récupérerions les captations ? » Le système D est un remède comme un autre. Il peut aider les directeurs à déjouer les chausse-trapes qui s’amoncellent devant eux. Dont l’embouteillage annoncé de spectacles en raison des reports effectués depuis la mi-mars. Un casse-tête pour Benoît Lavigne, directeur du Lucernaire, salle hyperactive de la rive gauche, qui n’a d’autre solution que de se projeter : « Je commence à réfléchir à 2021-2022. » L’engorgement se jugulera sur deux, voire trois saisons, histoire de lisser le trop-plein de propositions. “Le Covid a brisé un rythme qui était devenu effréné.” Jean Bellorini, Théâtre national populaire de Villeurbanne À moins, murmurent certains, de tourner le dos à la surproduction de spectacles, c’est-à-dire à cet enchaînement permanent de représentations à flux tendu dans les théâtres. Trop ? La décélération est un refrain qui fait son chemin. Nommé en 2019 au Théâtre national populaire de Villeurbanne, Jean Bellorini y songe, lui qui ne concède qu’une vertu au Covid : « Il a brisé un rythme qui était devenu effréné. » Directeur du Théâtre-Studio d’Alfortville, scène expérimentale en banlieue parisienne, Christian Benedetti chante la même mélodie : « On nous demande de recommencer comme si la suractivité était la seule voie possible. » Il réclame du ministère de la Culture une « charte d’improductivité », façon de substituer à la loi du chiffre l’impérieuse nécessité de l’art, lequel n’a pas pour mission d’être rentable. La Maison des arts de Créteil souhaite redistribuer son espace en zones distinctes, investies par des performances itinérantes pour de petits groupes de spectateurs. Reste que si le bouton pause est activé sur ce tempo fou des saisons on se demande ce que deviendront les compagnies en quête de salles, de producteurs et de diffuseurs. Sans lieu pour accompagner leurs projets, elles n’auront d’autre choix que de baisser le rideau. Ce qui serait sans doute la mort de l’exception culturelle française, dont la vitalité tient au foisonnement de ses créateurs. N’en déplaise aux esprits chagrins, leur multitude et leur diversité sont l’assurance d’une offre artistique sans égale dans le monde. Christian Benedetti le sait. Pour l’heure il fait et défait les plannings en cherchant où, quand, comment déposer l’intégrale des pièces de Tchekhov qu’il devait créer dans ses murs. Et puisque son temps de répétitions est amputé de précieuses semaines de travail, le metteur en scène convertit les entraves en atouts. Il proposera, à la place du spectacle prévu, la répétition d’une partie de ce spectacle. Des spectacles sans têtes d’affiche ? “Si ça marche, ce sera la preuve qu’on peut réussir économiquement sans avoir de stars sur le plateau.” Jean Robert-Charrier, Théâtre de la Porte-Saint-Martin Le confinement aurait-il libéré les imaginaires ? La pandémie invite chacun à rebondir en transformant les dégâts en matière artistique. Éric Ruf réfléchit à un festival de lecture des récits tragiques où les héros viennent « raconter ce qu’on ne voit jamais, les guerres et les intimités, là où s’échangent des miasmes de toutes sortes ». Jean-Michel Ribes inaugure une saison bis, en septembre, dans les jardins attenants au Rond-Point. Et Jean Robert-Charrier, à la tête du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, veut profiter du séisme pour extirper sa maison des griffes du divertissement et du vedettariat, les deux mamelles du privé. Prise de conscience ? « Il est temps de rendre ce théâtre plus accessible à tous, et notamment aux jeunes. » Alors il baisse le prix des places, programme un texte de Thomas Bernhard avec des acteurs qui ne sont pas des têtes d’affiche. « Si ça marche, ce sera la preuve qu’on peut réussir économiquement sans avoir de stars sur le plateau. » On le lui souhaite. Bien que soutenu par un actionnaire solide — le dirigeant d’entreprises et mécène Marc Ladreit de Lacharrière —, le théâtre vit « un enfer économique avec un déficit monstrueux » qu’il mettra l’année 2021 à tenter de rattraper, avec l’espoir d’être rentabilisé à partir de 2022 seulement. Mais malgré les pressions financières et leur cortège légitime d’inquiétudes, personne ne veut d’épilogues au rabais. Jean Robert-Charrier n’ira pas moissonner dans les champs du comique, genre pourtant fédérateur. Benoît Lavigne exclut d’augmenter le tarif des billets. Les spectateurs n’ont pas à payer le coût du confinement. Ni financièrement, ni qualitativement. “Accueillir le public comme on accueille chez soi quelqu’un à dîner.” Jean Bellorini, Théâtre national populaire de Villeurbanne Le public est plus que jamais le Graal. D’où une angoisse perceptible : comment se comportera-t-il en septembre ? Que les salles soient démesurées ou les jauges minuscules, la santé est une obsession. À Créteil cependant, les mille places disponibles de la Maison des arts ne seront pas scindées en îlots pour répondre aux normes de sécurité. Le directeur et chorégraphe José Montalvo s’y refuse. Et préférerait redistribuer en zones distinctes, investies par des performances itinérantes pour groupes restreints de spectateurs, les innombrables mètres carrés de la salle. L’architecture des bâtiments est en effet dans le collimateur. L’alpha et l’oméga que constitue le couple scène-gradin perd son exclusivité : tous les espaces sont susceptibles d’être utilisés pour faire théâtre. Le jeu doit se faufiler partout, des coulisses aux terrasses en passant par les loges. Cette ambition dit l’essentiel : le Covid-19 a replacé au centre du terrain celui que des années de routine avaient pu marginaliser : l’art. Piqûre de rappel salutaire qui percute de plein fouet la perception du public. Fini la masse qui s’abonne dès l’ouverture de la billetterie. Il est temps d’apprendre à vendre les places non pas six mois avant et en bloc, mais au coup par coup et au dernier moment à un spectateur volatil que l’épisode Covid va inciter à la prudence. D’où la nécessité de développer avec lui une relation privilégiée et de « l’accueillir comme on accueille chez soi quelqu’un à dîner » : Jean Bellorini, à Villeurbanne, ne fait pas de l’hospitalité un vain mot. À Créteil, José Montalvo va plus loin et rêve d’un « spectateur acteur » associé à la conception des saisons. Liens L’Urgence des alliances : nos 20 propositions pour relancer la culture Arts et scènes 17 minutes à lire Abonné Après le confinement, un New Deal pour nos artistes, c’est urgent ! Lorraine Rossignol 5 minutes à lire Abonné Emmanuel Demarcy-Mota, patron du Théâtre de la Ville : “Notre système culturel est à refonder !” Fabienne Pascaud 13 minutes à lire Photos Cyril Zannettacci pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2020 12:15 PM
|
Tribune, par Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon le 4 juillet 2020
Alors que la crise sanitaire a durement touché le secteur culturel, le directeur du Festival d’Avignon appelle à un nouveau pacte entre les pouvoirs publics et le monde de la culture.
Tribune. Le 3 juillet aurait dû s’ouvrir la 74e édition du Festival d’Avignon. Je partage le désarroi des spectateurs, des artistes et de toutes celles et ceux qui rendent possible ce rendez-vous unique. Je pense à la ville d’Avignon et au Vaucluse qui, depuis soixante-treize ans, deviennent chaque été festival. Le Festival d’Avignon n’est pas qu’une liste de beaux spectacles, il est le lieu où les défenseurs de la culture tous azimuts pensent la culture comme la plus haute ambition politique.
Pour la culture le « monde d’après » ressemble au monde d’avant mais en ruine.
L’étendue du désastre, symbolique, politique et financier est sans commune mesure, et il faut commencer par reconnaître l’ampleur des dégâts : l’annulation historique de tous les festivals, le déficit abyssal de grandes institutions, les inquiétudes sur le dialogue avec les publics…
Pouvons-nous rêver que l’après-Covid soit l’occasion d’un nouveau pacte entre les pouvoirs publics et le « monde de la culture » ? Pour qu’au moins nous trouvions sens à la catastrophe ? La culture a de nombreuses définitions, mais si nous demandons aux pouvoirs publics d’intervenir et de reconstruire c’est en premier lieu pour défendre le service public de la culture car c’est lui, le premier, qui risque d’être oublié dans l’organisation et les ambitions post-épidémiques, et pourquoi le devrait-il ? Commençons par le sommet. A ce jour, le président de la République n’a pas fait de grand discours, n’a pas dessiné les lignes d’un projet pour la France en matière de culture. Pourquoi ? Cela reste une énigme, aucun de ses prédécesseurs ne l’avait oubliée. On l’attendait dans le début de son mandat, sachant qu’il était à titre personnel un homme de culture. On l’attend toujours mais cette fois avec une inquiétude sans limite. L’engagement du président de la République manque et rien n’est possible sans lui. Il n’est jamais trop tard. La culture n’appartient pas à telle ou telle gouvernance, elle est un projet de la République et la continuité de ce projet doit être assurée. En deuxième lieu, défendons le ministère de la culture. Il n’a cessé de voir son périmètre augmenter et ses budgets réduits. Il reste un second rôle du gouvernement, ce qui est absurde au regard d’un pays comme le nôtre. C’est absurde politiquement, car ce ministère est un des plus médiatisé ; c’est absurde territorialement, ne serait-ce que pour les collectivités locales qui sont en demande d’égalité et ne ménagent pas leurs efforts ; c’est absurde financièrement puisque la culture est un coût dérisoire dans le budget de l’Etat et fait plus pour le PIB que l’industrie automobile ; c’est absurde diplomatiquement puisque le monde entier voit la France comme LE pays de la culture ; c’est absurde socialement quand on sait que l’inclusion est d’abord une question culturelle. La culture n’est pas un luxe mais un devoir impérieux. Les forces en présence sont pourtant importantes. L’Hexagone regorge de talents et de compétences, les institutions sont nombreuses, ouvertes, et engagées, elles touchent un très large public. Le monde entier admire cette réussite. Les festivals, chaque été, accueillent, de manière exigeante autant que festive, des milliers de spectateurs passionnés et les efforts pour rendre les publics plus jeunes et plus représentatifs de la société ont été récompensés de succès. Rien ne manque pour que cette force soit l’énergie d’un bien-être social. Rien ne manque si ce n’est parfois la décision politique. Quatre perspectives sont indispensables à une véritable ambition culturelle. La première, c’est la définition de la culture comme un service public, car dans nos démocraties ce n’est pas l’Etat qui est dangereux mais le monde marchand ; c’est lui qui risque de transformer l’art et la pensée en biens de consommation et avec eux le sens même de notre société. Appartenir au service public donne des droits et des devoirs. Le droit de vivre dignement de nos pratiques, le droit de parler sans censure, le droit de créer sans rentabilité immédiate. Quant aux devoirs, ils sont à l’égard de l’exigence artistique autant que du public. La deuxième perspective est la démocratisation culturelle. On en fait jamais trop dans ce domaine. Politique tarifaire, événementiel, communication, tout est à élargir. C’est un combat de chaque jour pour les travailleurs du secteur culturel. La troisième perspective, c’est la décentralisation. Elle n’est jamais finie, le spectateur parisien reste toujours plus subventionné que celui de Dijon. Les théâtres, les musées, le patrimoine, les outils de créations doivent être des ambitions nationales en régions. Et le dialogue avec les collectivités locales doit être construit, reconstruit, agrandit. Les dotations à la baisse ont impacté la culture en région, et si les budgets des collectivités dépassent aujourd’hui ceux de l’Etat, ce dernier demeure le garant de l’égalité d’accès sur tous les territoires. La quatrième perspective est notre rayonnement à l’étranger, notamment par la francophonie. C’est un projet d’avenir pour la France, une chance que nous devons saisir aujourd’hui, accueillir et être accueillis. Au delà de ces quatre axes, les défis sont innombrables : la révolution numérique pour tous, l’éducation culturelle, l’avenir du livre et des libraires, le patrimoine, l’émergence et l’accompagnement des talents, l’emploi, les grandes institutions, la diversité sur les plateaux, la parité, la recherche… et tant d’autres. Mais beaucoup de ces combats n’ont de sens que dans une logique interministérielle, avec le ministère du travail, de l’éducation, de l’égalité des territoires… En un mot, il n’est pas possible que l’Etat n’imagine pas une culture d’avenir et un avenir culturel. Ce serait synonyme d’un renoncement aux valeurs humanistes les plus profondes, d’un abandon de notre propre intelligence culturelle. Nous nous décevrions nous-même, nous décevrions nos enfants et nous décevrions le monde. La France doit et peut mettre en place le plus grand projet culturel de son histoire. Ce n’est ni utopique, ni pharaonique, c’est le point d’horizon de notre destin national. En parlant avec les citoyens, dans les régions, les quartiers, dans les collèges et les prisons, pendant trente ans, je n’ai jamais été confronté à de la défiance vis-à-vis de la culture. Cette défiance ne vient pas du public le plus populaire parfois éloigné de nos institutions. Mais combien de fois ai-je été confronté à un ricanement devant une véritable ambition culturelle de la part des gouvernants et des élites. Disons les choses encore plus simplement : la démocratie sans la culture risque de devenir un mot vide de sens. Sans culture, la liberté devient un asservissement aux valeurs marchandes. Sans culture, la politique est le chemin le plus court vers les populismes. Enfin, sans culture, la France deviendrait un pays sans âme et indigne de son histoire. Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, est également dramaturge, metteur en scène, acteur et poète.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2020 5:14 PM
|
Propos recueillis par Maryse Bunel dans Relikto le 1er juillet 2020 Avec la saison n°7 du CDN de Normandie Rouen, on traverse le temps. Les artistes piochent dans leur mémoire pour réveiller la nôtre, questionner nos choix et entrevoir un avenir. Une nouvelle programmation d’une structure culturelle ouvre des possibles, surtout en période de pandémie. Celle-ci va nous emporter, interroger, charmer, émerveiller. Entretien avec David Bobée, directeur du CDN de Normandie Rouen. Est-ce une saison que vous avez construite, déconstruite et reconstruite en raison de l’épidémie du coronavirus ? Non, c’est une saison sur laquelle nous travaillons depuis un an et à laquelle je n’ai pas voulu renoncer. J’ai refusé de réduire la voilure pour des formes compatibles au virus. Il y a un plan A avec la saison que nous avons rêvée, des spectacles de qualité et une jauge qui sera à 70 %. C’est le scénario idéal. Avec un plan A’, on s’adaptera aux conditions sanitaires du moment si elles évoluent. Le plan B, c’est le retour du virus qui appelle à l’annulation. On pourra alors reconduire notre geste : on annule tout et on paie tout le monde. Personne ne doit subir les ravages économiques d’une nouvelle vague. J’écoute ma responsabilité artistique qui est de soutenir la création et ma responsabilité de directeur qui doit assurer aux artistes de quoi vivre. Si on propose une saison réduite, on participe à un carnage social. Un CDN doit maintenir un volume d’emploi pour accompagner la communauté artistique. Un plan A permet une réflexion, le remplacement d’un spectacle par une autre proposition. Avec Le Iench, Eva Doumbia peut jouer au pied des tours dans les cités. Nous savons nous adapter. Mais il faut le faire en temps et en heure. Nous ne pouvons pas partir sur le pire des scénarios. Les saisons du CDN se caractérisent aussi par une dimension internationale. Comment la préserver ? La dimension internationale se situe davantage dans les collaborations. La première partie de la saison fait la part belle aux compagnies régionales. Nous avons fait attention aux personnes qui sont tout d’abord à côté de nous. Le 55 répond ponctuellement à cela. Il donne les moyens de production, de création et de monstration. Les proportions restent les mêmes : 1/4 de compagnies régionales, 1/4 de spectacles internationaux et une moitié de compagnies nationales. C’est le meilleur de ce qui se crée aujourd’hui. Est-ce que des spectacles ont été annulés après un manque de temps de répétition ? Non, sauf la mienne, Ma Couleur préférée. Cette création est reportée d’un an. Les acteurs congolais sont prisonniers chez eux en raison des annulations de vols. Comme la période crée des tensions budgétaires, j’ai choisi de donner une souplesse aux autres compagnies. Des thèmes traversent cette nouvelle saison. Plusieurs spectacles évoquent la famille. Cela n’a pas forcément été pensé comme cela. La famille, ce sont les racines, les origines. Nous avons souhaité valoriser les racines multiples. Dans cette saison, il y a trois grosses thématiques : se souvenir d’où l’on vient, le temps présent, savoir où on va parce qu’il faut penser à l’avenir. La mémoire n’est pas simplement un regard sur le passé. Elle agit en permanence. Elle donne des forces pour vivre aujourd’hui et demain. Comme dans Mémoire de Fille, un texte d’Annie Ernaux, ou Ombres de Nicolas Moumbounou qui résonne fort avec l’actualité, la mort de George Floyd, et interroge sur la négritude. Marc Lainé revient sur l’histoire du bloc soviétique dans Nosztalgia Express. Edward Aleman parle de la jeunesse dans Éternels Idiots. Se souvenir d’où l’on vient est un miroir de notre époque. Au CDN, nous avons cette politique. Cela devient absolument nécessaire de traiter cette question du racisme. La question du virus se retrouve aussi dans plusieurs créations. Tristesse animal noir parle de la manière dont la nature se venge et impose à un groupe de trouver une façon de survivre. N’essuie jamais de larmes sans gants revient sur une autre épidémie, celle du sida. Tous ces épisodes troublent une humanité et obligent à trouver des moyens de s’accrocher à la vie. “la violence d’une dictature qui condamne un artiste” Comment envisager l’avenir ? Il ne fait pas se figer dans le présent mais voir demain. Le spectacle de Wilmer Marquez invite à dépasser les Barrières. DeLaVallet Bidiefono donne à penser l’avenir dans Utopia/Les Sauvages. Une Épopée est une piste de réflexion sur le développement durable. Je trouve qu’il y a dans cette saison des couleurs plus positives que précédemment. Des sujets s’ouvrent. Comme la question du féminisme, cette façon dont la parole s’arrache. Le débat sur le racisme est nourri de longue date. La vague verte fait que la question du devenir de la planète et de l’humanité ouvre beaucoup de chantiers. Trois spectacles de la saison, Camp Sud, Transe-Maître(s) et aussi le prix RFI sont issus du festival des langues françaises. Est-ce que le festival a aussi pour vocation à nourrir la programmation ? Le but du festival des langues françaises est de donner à entendre des écritures d’aujourd’hui, de célébrer le français dans toute sa diversité. À l’intérieur de cela, il y a la découverte de grands textes qui s’imposent. On voit quand le plateau parle. Quand Destin Destinée Mbikulu Mayemba propose Camp Sud, il se passe quelque chose. Nous lui avons proposé de mettre en scène ce magnifique texte de Joël Amah Ajavon. Quand Marc Agbedjidji parle de l’école, il évoque la violence et montre une langue comme un instrument de contrôle. La saison se termine avec un spectacle de Kirill Serebrennikov qui vient d’être condamné dans son pays, la Russie. Cela fait un bon moment que nous souhaitions accueillir ce spectacle traitant de la violence qui s’abat contre la liberté d’expression des artistes. Dans certains pays, on condamne même si on est innocent. Kirill devait travailler avec un photographe chinois, Ren Hang, qui s’est défenestré. Il y a quelques jours, il a été reconnu coupable mais il ne va pas être emprisonné. Ce qui va lui sauver la vie. Il est heureux de pouvoir survivre et travailler même s’il est paniqué à l’idée de devoir verser une somme impayable. Il est aussi interdit de diriger une institution publique. C’est la violence d’une dictature qui condamne un artiste.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2020 9:42 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 5 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 6/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947, à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, une 59e édition éruptive : spectacles hués, public qui déserte, violentes critiques dans la presse. Cette année-là, il a fallu jeter son corps dans la bataille. 2005, année explosive, éruptive, inflammable : le Festival d’Avignon y connaît une de ces batailles d’Hernani dont le théâtre, régulièrement, a besoin pour s’interroger sur lui-même, se régénérer et se prouver qu’il est bien vivant. L’était-il encore, vivant, dans ces années 2.0 dopées aux industries culturelles et au virtuel ? Il lui fallait une bonne bagarre pour trancher dans le vif : ce fut le festival de 2005, et ce que l’on a désormais coutume d’appeler la « querelle d’Avignon ». L’année précédente, pourtant, le festival avait pris un nouveau départ. Avignon revivait, après l’annulation traumatique de la manifestation en 2003, due au conflit des intermittents du spectacle. Les deux jeunes directeurs fraîchement nommés pour succéder à Bernard Faivre d’Arcier, Vincent Baudriller (37 ans) et Hortense Archambault (34 ans), avaient, de l’avis général, bien réussi leur coup, en compagnie de leur « artiste associé », le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier. Il y avait bien eu quelques grincheux pour contester le regard très politique proposé par ce festival 2004, mais sans que cela tire à conséquence. Pour 2005, Archambault et Baudriller choisissent comme artiste associé, concept au cœur de leur projet, le chorégraphe, metteur en scène, auteur et plasticien flamand Jan Fabre. Avec lui, c’est toute l’effervescence de la scène flamande depuis les années 1980 qu’ils veulent présenter au public d’Avignon, une mouvance qui a mis le théâtre cul par-dessus tête, en l’hybridant avec la danse, la performance, le rock et les arts plastiques. Spectacles improbables, inaboutis La mèche est allumée bien avant le début du festival, dès la présentation du programme, le 4 mars. Le Figaro et Le Nouvel Observateur, notamment, dénoncent les choix des deux codirecteurs, et un parti pris jugé « hermétique » ou « élitiste ». Ce qui choque une bonne partie de la presse, de la profession et du public, c’est notamment qu’aucun spectacle de théâtre au sens strict ne soit prévu dans la Cour d’honneur du Palais des papes : dans le saint des saints du festival sont en effet programmés une création et une reprise de Jan Fabre, L’Histoire des larmes et Je suis sang, et une création de la chorégraphe française Mathilde Monnier, Frère et Soeur. A la veille de l’ouverture, la presse locale prend le relais. « Une édition à risques, radicale, qui créera sans doute la polémique. Ce “in” s’ouvre sur du soufre », annonce La Provence dès le 8 juillet. Le soir de la première dans la Cour, ce même 8 juillet, la création de l’artiste flamand déçoit. « Le corps selon Jan Fabre laisse Avignon perplexe », titre Le Monde. Lire aussi Le corps selon Jan Fabre laisse Avignon perplexe Dans les jours qui suivent, les spectacles improbables, inaboutis ou inutilement prétentieux s’accumulent. Et beaucoup d’entre eux dégagent une violence sans recours, incapables d’offrir une forme artistique ouvrant sur une médiation par rapport à la dureté, à la perte de sens du monde contemporain. Les corps souffrants se ramassent à la pelle, en cette édition 2005, et laissent sur le flanc nombre de spectateurs. Ajoutez à cela que la modestie n’est pas la qualité première du personnage Jan Fabre, et il n’en fallait pas plus pour que la mèche s’enflamme, au risque de tout faire exploser, et notamment la direction du festival. Artistes, directeurs de théâtre, universitaires, journalistes, spectateurs, tout le monde se jette dans la bataille, dans ce grand forum qu’est Avignon. En surchauffe jusqu’au bout Les soirées dans la Cour sont régulièrement huées, les spectateurs désertent certains spectacles par grappes. Lors d’une représentation d’After/Before, spectacle de Pascal Rambert, une femme se lève et explose : « Mais qu’est-ce qu’on vous a fait pour mériter ça ? Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça depuis une heure et demie ? » On sait maintenant que cette femme n’était pas tout à fait une spectatrice ordinaire, puisqu’elle était la compagne de Jacques Livchine, directeur du Théâtre de l’Unité. Mais elle devient l’emblème de la bronca contre les choix de la jeune direction d’Avignon, chez ceux qui ont intérêt à l’entretenir. Au bar du « in », le rendez-vous des professionnels, les discussions, âpres, douloureuses, durent jusqu’à l’aube. « Ça n’arrêtait plus, racontait, dans nos colonnes, Jacques Blanc, alors directeur du Quartz, scène nationale de Brest. Il faut comprendre : nous vivons une vraie crise. Une crise douloureuse mais j’espère salutaire, car elle pose toutes les questions. Et, comme toujours, Avignon, c’est la brûlure. » Lire aussi : Festival d’Avignon : l’an I de la nouvelle direction Les esprits raisonnables ont beau rappeler que la danse était présente à Avignon dès l’année 1966, avec Maurice Béjart qui fut une sorte d’artiste associé avant l’heure, ainsi que le cinéma, avec la projection de La Chinoise, de Godard, dans la Cour d’honneur en 1967. Qu’en cette année 2005 il y a aussi du théâtre « de texte », et des spectacles formidables – Kroum, par Krzysztof Warlikowski, La Mort de Danton et La Vie de Galilée, par Jean-François Sivadier, Les Vainqueurs, d’Olivier Py… Rien n’y fait : Avignon sera en surchauffe jusqu’au bout, cet été-là, laissant le monde du théâtre bouleversé par la violence de la polémique. Un texte qui a fait date De quoi Avignon 2005 a-t-il été le symptôme ? Querelle des anciens et des modernes ? Du théâtre de texte face au théâtre visuel et corporel ? Opposition entre la médiation et la sublimation offertes par l’art et des formes plus littérales, qui se veulent plus efficaces pour parler du monde contemporain ? Conflit de générations, bataille pour le pouvoir ? Tout cela à la fois, sans doute. Au-delà, ce festival 2.0 a synthétisé une inquiétude majeure, celle du lien entre l’appauvrissement du langage et la recrudescence de la violence. Olivier Py, qui prendra la succession de Vincent Baudriller et d’Hortense Archambault à la tête du festival en 2013, l’a exprimé dans un texte qui a fait date, Avignon se débat entre les images et les mots, publié dans Le Monde le 29 juillet 2005. Lire aussi Avignon se débat entre les images et les mots, par Olivier Py Il s’y interroge sur cette question anthropologique d’importance : traditionnellement, le langage, au théâtre comme dans la vie, est ce qui permet de surmonter la violence inhérente à la vie humaine. Qu’en est-il quand le langage traditionnel – celui des mots – est supplanté par d’autres formes d’expression, à savoir les images ? Cris, larmes et invectives Dans cette dernière bataille d’Hernani qu’ait connu l’art théâtral, Avignon a joué, plus que jamais, son rôle de miroir de la société de son temps. Le théâtre, qui en 1947 s’était refondé dans la nuit, dans les pierres, s’est ici repensé dans les cris, les larmes et les invectives, mais il s’est repensé. Il y a gagné à la fois une nouvelle reconnaissance de la place du texte, et un formidable élargissement de ses moyens, à l’œuvre depuis quinze ans. C’est comme s’il s’était augmenté de toutes parts, prouvant qu’il est bien un art total, capable d’accueillir tous les autres en son sein, selon une conception d’ailleurs ancienne et largement partagée, notamment en Orient. Vincent Baudriller et Hortense Archambault, lors de ce festival 2005 qu’ils avaient placé sous le patronage d’Antonin Artaud, ne manquaient jamais de rappeler que ce terme de « radical », dont on avait qualifié leur festival, est de la même famille que « racine », et qu’il désigne « ce qui tient à l’essence, au principe d’un être ou d’une chose ». Fabienne Darge Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets Légende photo : « L’Histoire des larmes », de Jan Fabre, le 7 juillet 2005, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2020 4:45 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde 2 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 4/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, la section parallèle publie en 1982 son premier programme de spectacles. Devenue pléthorique, elle cherche à se réinventer.
La progression est insensée. En 1982, le premier programme du festival « off » d’Avignon répertoriait quelque cent quarante spectacles. Ce qui ne constituait alors qu’un encart dans le quotidien Le Provençal a pris, au fil des décennies, l’allure d’un annuaire. En 2019, pas moins de 1 592 spectacles se sont livrés concurrence dans ce marché théâtral qu’est devenue la section parallèle du « in ». Né en 1967, d’un geste de révolte d’un artiste avignonnais, André Benedetto, contre l’« institution », le « off » a troqué ses racines libertaires contre un système anarcho-capitaliste dont on dit, depuis les années 1980, qu’il est au bord de l’implosion. Quand, en 1982, le comédien Alain Léonard, habitué du « off », lance un programme exhaustif du festival, fonde l’association Avignon Public Off et crée la carte du même nom pour permettre aux spectateurs de bénéficier de tarifs réduits, tout part d’un bon sentiment : « Rassembler les compagnies et les rapprocher du public. » Pas de sélection, pas de programmation, ce marché libéral peut devenir un tremplin ou un gouffre financier Car le paysage est en train de changer : dans la cité des Papes, les nouveaux lieux se multiplient. Ce ne sont plus seulement des théâtres créés par des artistes, mais aussi des « garages à spectacles » qui louent à prix de plus en plus fort des créneaux horaires. Nous sommes au début des années Lang, le ministère de la culture a carte blanche et un budget multiplié par deux. Le nombre de compagnies et de troupes de théâtre ne cesse d’augmenter. « Il leur reste à faire connaître leur travail et à être diffusées, au-delà de leur seule région. Le meilleur moyen, et même souvent le seul, c’est de « faire Avignon », rappelle Joël Rumello, dans son livre Réinventer une utopie, le Off d’Avignon (Ateliers Henry Dougier), qui retrace avec justesse la complexité de cette histoire théâtrale. Une « jungle » En un peu moins de quarante ans, le « off » est devenu une gigantesque scène, ouverte à toutes les disciplines du spectacle vivant et à tous ceux qui veulent tenter l’aventure des planches. D’aucuns le comparent à une « jungle », où se côtoient des propositions aussi diverses que Trop bonne, trop conne, Dans la solitude des champs de coton ou Le Bourgeois gentilhomme. Pas de sélection, pas de programmation officielle, ce marché libéral peut devenir un tremplin – comme ce fut le cas pour l’auteur et metteur en scène à succès Alexis Michalik ou, plus récemment, pour Emmanuel Noblet et son adaptation de Réparer les vivants – ou un gouffre financier qui contraint des comédiens à jouer sans être payés. Car « faire Avignon » coûte cher, et le public n’augmente plus dans les mêmes proportions que l’offre de spectacles. « Aujourd’hui, les trois semaines du “off” correspondent à trois millions de sièges à vendre, or un million sont vendus », constate Pierre Beffeyte, président, depuis 2017, de l’association Avignon Festival & Compagnie (AF&C) qui tente de coordonner le festival. Pierre Beffeyte, président de l’Avignon Festival & Compagnie : « Aujourd’hui, les trois semaines du « Off » correspondent à trois millions de sièges à vendre, or un million sont vendus » Si la crise sanitaire n’avait pas mis à l’arrêt ce rendez-vous hors norme, plus de 1 500 spectacles auraient dû de nouveau se jouer cet été dans plus de cent quarante lieux (cinq nouvelles salles devaient ouvrir cette année). Au-delà du cauchemar vécu par les compagnies privées de représentations, cette annulation forcée pousse les professionnels à questionner et à « rêver » l’avenir du « off ». En ce mois de juillet, deux initiatives distinctes, mais animées par la même volonté réformatrice, sont lancées pour réfléchir à un nouveau modèle de festival. Ainsi, l’association AF&C vient de recevoir quelque sept cents réponses à la suite de sa consultation publique organisée mi-mai. « Il faut changer la philosophie du “off”, car la liberté artistique initiale a dévié vers une dérégulation et un modèle économique aberrant », considère M. Beffeyte qui prévoit l’organisation de tables rondes, à la fin du mois, à Avignon. De leur côté, quatre organisations professionnelles, Actrices et acteurs de France associés (AAFA ), Ecrivains associés du théâtre (EAT ), Les Sentinelles-Fédération de compagnies du spectacle vivant et le Syndicat national des arts vivants (Synavi) lancent, jeudi 2 juillet, un appel à des états généraux du festival « off ». « Plus de 1 600 professionnels (artistes, théâtres, programmateurs) ont répondu “partant” », assure Eric Verdin. « Il s’agit de s’interroger collectivement sur le destin de ce festival que personne ne contrôle, et de réunir tous ceux qui ne veulent plus être condamnés à subir la loi du marché. Le Covid est un épiphénomène, ce festival, par son gigantisme et son chacun-pour-soi, court à sa perte, alors que c’est quand même un très bel outil », poursuit ce comédien, membre des associations Sentinelles et EAT. « En participant au “off”, on a le sentiment de cautionner un système qu’on pourrait dénoncer dans un spectacle, c’est schizophrène », déplore la comédienne Sophie-Anne Lecesne, coprésidente de l’AAFA. Les mêmes problématiques Comment transformer le « off » en modèle vertueux, en bien commun qui profite à tous ? « La liberté de créer, oui, mais il faut l’associer à des notions d’égalité et de collectif », prône Pierre Beffeyte. « Trop souvent, seul l’artiste prend des risques », regrette-t-il. Le président d’AF&C avance quelques pistes : diminuer le nombre de créneaux horaires (actuellement, chaque salle programme un spectacle toutes les deux heures), augmenter le nombre de coréalisations (pour que les risques soient partagés), créer une billetterie centralisée sur laquelle seraient ponctionnés un ou deux euros par billet pour abonder un fonds de soutien en faveur des compagnies émergentes. Ce n’est pas la première fois que le « off » fait son autoanalyse. Déjà, en 2007, des états généraux avaient été organisés autour de problématiques qui sont quasi les mêmes treize ans plus tard… « On est face à une montagne, mais on espère que notre appel débouchera sur un nouveau modèle », veut croire Eric Verdin. Comment concilier les intérêts de théâtres permanents, de producteurs privés (de plus en plus présents) et de loueurs de salle dans un festival où, sur le plan artistique, on trouve le pire comme le meilleur ? Comment empêcher, dans un système privé, un nouveau lieu d’ouvrir ? Qui pourrait s’arroger le droit de sélectionner les spectacles, et sur quels critères ? Greg Germain, président d’AF&C de 2009 à 2016, ne se fait guère d’illusion sur les possibilités de réguler le « off ». « Comment reprocher à un pays qu’il y ait trop de créateurs ? », s’interroge ce comédien et directeur du théâtre avignonnais la Chapelle du verbe incarné. Ce festival, à ses yeux, a aussi des vertus qui expliquent pourquoi tant de compagnies y viennent : « C’est l’unique marché du théâtre en France qui permet de vendre et de diffuser son spectacle, c’est l’un des seuls lieux où l’on peut jouer vingt-trois jours de suite, la relation y est directe entre les artistes et le public, et c’est le seul endroit où de jeunes inconnus peuvent espérer être repérés par les médias. » Greg Germain considère qu’« une des voies possibles serait de développer plusieurs temps de festival », ciblés sur des thématiques. Et il regrette surtout que le ministère de la culture ne se soit jamais intéressé au « off » : « Cela l’arrange bien de ne pas mettre les mains dans le cambouis ! » Sandrine Blanchard Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Légende photo : Une femme marche près d’un mur avec des affiches de pièces de théâtre, à la veille du 60e Festival international de théâtre d’Avignon, le 5 juillet 2006. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2020 7:36 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 3 juillet 2020 Comment construire la future année théâtrale avec un calendrier bouleversé ? A l’heure où les théâtres dévoilent leur programmation, tour d’horizon des projets pour tenter de résorber les pertes financières consécutives à la crise sanitaire.
Soudain, la vie reprend dans les théâtres. Elle reprend plus vite que prévu, les artistes répètent, les attaché(e) s de presse ont du travail, des spectacles inattendus se nichent à des dates où, d’habitude, on ronronne vers la fin de saison et les principaux intéressés semblent les premiers surpris par cette activité buissonnière, comme si les ruches s’étaient remises à bourdonner d’elles-mêmes, sans préméditation. Des spectacles incongrus, qui surgissent telles des herbes folles, dans le calendrier des vacances ? Ce sera le cas, par exemple, à Annecy avec une Grande Balade fin juillet, parcours de 4 km de chemins de randonnée à 900 m d’altitude, avec une cinquantaine d’artistes, de Philippe Decouflé à François Chaignaud. Ou encore à la Colline à Paris (XXe), avec la recréation de Littoral, créé en 1997 par Wajdi Mouawad (aujourd’hui directeur de ce théâtre national), qui montre des jeunes gens se questionner sur leurs peurs, tandis qu’ils enterrent leurs pères. La pièce, conçue avec une double équipe de 17 acteurs, est présentée du 7 au 18 juillet, à l’intérieur d’une mini-programmation estivale intitulée Au point du jour, imaginée il y a seulement un mois. Double équipe, donc, pour Littoral, double répétition, pour un spectacle léger, qui pourrait être joué en extérieur, s’il est interdit de se rassembler dans des endroits clos, et qui peut tourner facilement à l’automne, au cas où… A la Colline, où le principe de l’abonnement a été abandonné dès l’arrivée de Wajdi Mouawad à la direction, on réfléchit sérieusement à annoncer la programmation tous les trois mois et non annuellement. Le secrétaire général de la maison, Arnaud Antolinos, explique que même la manière de produire et de montrer chaque spectacle risque d’évoluer : «On va tenter des séries beaucoup plus longues, sur un trimestre entier.» De manière à éviter leur disparition en cas de nouvelles catastrophes. Une baisse des productions qui entraînerait un changement considérable puisque les subventions sont majoritairement accordées à l’aide à la création. Annulations Travailler avec une double distribution est l’une des ruses pour s’adapter aux nécessités sanitaires et faire face aux imprévus - un acteur malade par exemple. Le principe est également adopté par Stéphane Braunschweig, directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris VIe), qui a dû bousculer pendant le confinement sa programmation déjà bouclée en mars. S’infiltreront donc en septembre des représentations d’Iphigénie de Racine, qu’il répète en ce moment, selon une impulsion prise en avril, quand il n’avait aucune visibilité sur les conditions d’accueil du public et les jeux possibles sur le plateau. Tandis qu’il s’affairait au casse-tête des annulations, paiements de cession, reports, remboursement des billets, il lui était impossible de rester les bras ballants à attendre de voir si les spectacles prévus à l’automne seraient jouables. Pour Iphigénie, il conçoit donc une mise en scène compatible avec un virus possiblement actif. Les gradins des Ateliers Berthier (Paris XVIIe) ont été remplacés par des fauteuils éloignés les uns des autres, disposés en bi-frontale afin que les spectateurs restent proches de la scène quoi qu’il en soit. «C’est plus facile de garder une distanciation sociale avec Racine qu’avec Tchekhov», remarque Braunschweig. Qui ajoute que monter cette histoire de vents arrêtés par les dieux qui immobilisent toute action, dont l’écrasement de Troie, à moins d’effectuer un sacrifice pour que le monde reprenne lui semblait pertinent. «J’ai imaginé une grande distribution, pour permettre à un maximum d’acteurs de jouer… Et c’est une expérience que j’aimerais réitérer - sans le Covid. Pendant que les acteurs regardent l’autre équipe jouer, ils travaillent…», assure-t-il. Braunschweig a également demandé à Sylvain Creuzevault, qui doit présenter, «si tout va bien», une adaptation d’envergure des Frères Karamazov, d’occuper l’Odéon dès le 25 septembre, en développant une forme plus modeste du Grand Inquisiteur tiré du texte de Dostoïevski, les deux spectacles étant coproduits par le Festival d’automne à Paris. «Si par hasard on était dans l’impossibilité de montrer les Frères Karamazov, on pourrait continuer à jouer avec le Grand Inquisiteur.» Iphigénie et le Grand Inquisiteur ont en commun d’être quasiment sans décor, l’énergie et le talent des acteurs suppléant au peu de moyens - le théâtre, non éligible au chômage partiel, a un trou de 600 000 euros avec l’interruption des représentations. Impossible d’être exhaustif. Gigantesque est le nombre de scènes subventionnées, habituellement fermées en été, qui choisissent d’ouvrir en grand leurs portes, notamment aux résidences de création et répétitions qui n’ont pu se tenir au printemps. Le Théâtre national de Rennes restera ainsi ouvert tout l’été «parce qu’il était impossible, à partir du moment où le théâtre rouvrait mi-mai, que les artistes en soient absents», explique Arthur Nauzyciel, qui a un temps imaginé une année sans programmation annoncée. A Rennes ou ailleurs, comme en Seine-Saint-Denis, où les Centres dramatiques nationaux (CDN) resteront actifs l’été en juillet-août, «on sait qu’un certain nombre de gens ne partiront pas en vacances. On a donc décidé de laisser le théâtre ouvert pour que les gens puissent reprendre en douceur ce chemin jusqu’à septembre, quand la saison sera annoncée». Chemin qui les amènera à slamer à l’intérieur du théâtre, à déambuler avec l’artiste plasticienne Valérie Mrejen dans le quartier de Maurepas, à suivre nombre de répétitions, dont celles de la chorégraphe Gisèle Vienne ou de Mes Frères, de Pascal Rambert, à revoir d’anciens spectacles - puisque Arthur Nauzyciel défend l’idée que les mises en scène doivent vivre une bonne décennie, plutôt qu’être jetées après exploitation. Spectacles gratuits ou presque, ouvertures des salles de répétitions au public, rentrée qui commence, contrairement aux habitudes, dès le début du mois de septembre : tout se passe comme si, dans un geste volontairement optimiste, le monde théâtral cherchait à concevoir coûte que coûte une programmation aussi dense que d’habitude, malgré les gouffres financiers causés par l’arrêt brutal des billetteries. Jauge réduite Gouffres qui se transforment en abîmes pour les théâtres privés non subventionnés. Ainsi, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Jean Robert-Charrier doit se remettre d’une perte de 2 millions d’euros dont 854 000 rien qu’avec la suppression des représentations de la Carpe et le Lapin avec Catherine Frot et Vincent Dedienne, qui faisait salle comble. En contrepartie, il a reçu du fonds d’urgence Covid 56 000 euros - et le chômage partiel. Le directeur, qui produit 100 % de sa programmation, lance : «On nous laisse ouvrir en ce moment, mais c’est trop tard pour lancer des productions et on n’a pas d’argent pour le faire.» Malgré tout, c’est pendant le confinement qu’il a concrétisé un projet qui lui tenait à cœur : monter Avant la retraite, de Thomas Bernhard, dans une mise en scène d’Alain Françon avec Catherine Hiegel, André Marcon et Noémie Lvovsky. Pour autant, il est en retard sur sa programmation de janvier, notamment parce qu’il est difficile d’imaginer des distributions avec des acteurs qui sont dans l’incertitude des reprises de tournage. Le public, quant à lui, va-t-il revenir dans les salles ? Autre inconnue. Jean Robert-Charrier a ouvert la billetterie du théâtre il y a deux mois, et pour l’instant, seules 27 places d’Avant la retraite ont été achetées… «Pendant le confinement, on a beaucoup glosé sur ce qui devait changer. C’est le moment d’observer si les actes correspondent aux discours. Je souhaite franchir le cap d’un théâtre plus politique et contemporain.» Peut-être en faisant découvrir une pièce pour 12 actrices de la dramaturge, Lucy Kirkwood, qu’il a repérée à Londres. Contrairement à ses collègues, le directeur de la Porte-Saint-Martin n’envisage pas une jauge réduite : «Je n’en ai pas les moyens, et la séparation n’est pas l’idée du théâtre. Si on ne peut pas accueillir tout le public, on ne jouera pas.» Pratiques inédites Sans surprise, les propositions qu’on ne verra pas la saison prochaine sont d’abord des créations étrangères. Exit le Silence et la Peur, de David Geselson sur Nina Simone avec une distribution franco-américaine, reportée sine die et coproduite par le Théâtre de la Bastille. Lequel théâtre a également dû renoncer à This Song Father Used to Sing (Three Days in May), du Thaïlandais Wichaya Artamat, invité par le Festival d’automne à Paris. Lequel festival a également annulé une production créée en Chine du grand metteur en scène polonais Krystian Lupa - coproduite par l’Odéon - qu’on ne verra sans doute jamais. Tout comme l'exposition de l’artiste américaine Zoe Leonard qui, pour des questions d’agenda, ne peut être reportée. Marie Collin, programmatrice du Festival d’automne à Paris, explique : «Notre festival coproduit beaucoup d’artistes internationaux sur tous les continents ! Il a fallu tout revoir. Or, les artistes européens et français n’étaient pas non plus en très grande forme. On s’est appliqué à trouver des lieux de répétitions l’été, à reconstruire un programme qui tienne la route, solidaires avec eux.» Là encore, étonnement, le Festival d’automne à Paris débutera plus tôt que d’habitude, et avec des pratiques inédites. Politique tarifaire avantageuse, spectacles dans des jardins gratuits, ou encore rupture des habitudes, puisque Gwenaël Morin présentera son prochain spectacle à 7 heures du matin en région parisienne. Anne Diatkine Grande Balade Les 17 et 18 juillet dans le cadre du festival Annecy paysages, Bonlieu-Scène nationale Annecy (74). Littoral de Wajdi Mouawad Théâtre national de la Colline (75020). Du 7 au 18 juillet. Légende photo : Vivaldis, de Philippe Decouflé, par la compagnie DCA. Photo DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2020 8:32 AM
|
Frédéric Esquerré nommé directeur du Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées
SPEC - Paris - jeudi 2 juillet 2020 - Mouvement n° 187381 Publié par NewsTank le 2 juillet 2020 Frédéric Esquerré est nommé directeur du Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées), à partir de septembre 2020, apprend News Tank le 02/07/2020. Il succédera à Marie-Claire Riou, qui occupe ce poste depuis 2009. Elle avait rejoint la Scène nationale en 2007 comme directrice adjointe auprès de Marc Bélit, fondateur et directeur du lieu (1987-2009). Frédéric Esquerré est, depuis 2012, secrétaire général de la Scène nationale d’Albi où il a travaillé pendant 21 ans.
Le Parvis a été inauguré en 1973 au cœur du centre commercial Le Méridien à Ibos et a obtenu le label « Scène nationale » en 1991. Outre sa programmation de spectacles, Le Parvis accueille en son sein un espace d’art contemporain ainsi que de trois salles de cinéma art et essai. Il exploite par ailleurs un réseau de 11 salles art et essai dans le département des Hautes-Pyrénées.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 1, 2020 6:56 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde, 30 juin 2020 Les grandes heures d’Avignon 2/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur l’année où le chorégraphe Maurice Béjart est acclamé, tandis qu’André Benedetto crée le « off ». Un doigt dans la bouche comme en signe de réflexion, les lunettes sur le front, Jean Vilar (1912-1971) observe le cours de danse donné par Maurice Béjart (1927-2007) à sa compagnie, le Ballet du XXe siècle, dans la Cour d’honneur du palais des Papes. Les barres auxquelles les danseurs s’accrochent sont parfois de simples bancs, mais l’échauffement maintient son rythme horloger sous la direction aiguisée du chorégraphe. Ces images filmées en 1966 par la Radio-Télévision suisse (RTS) plongent dans cette époque effervescente. Le festival d’Avignon fête ses 20 ans. C’est la grande bascule. Jean Vilar déroule pour la première fois le tapis rouge à Béjart et à la danse. Un coup de tonnerre dans le ciel théâtral avec neuf spectacles à l’affiche qui font claquer autrement le décor brut de la Cour d’honneur. « J’ai cherché un peu à faire ce que Vilar a fait au théâtre, commente Béjart dans ce reportage de la RTS. C’est-à-dire du ballet populaire, pour tout le monde… et Avignon répond à ce désir. Ce qui est important, c’est aussi d’élargir ce festival et de montrer comment la danse a pris sa place dans le théâtre. Il ne s’agit pas de faire des ballets spécialement pour le public mais aussi des ballets bon marché pour qu’il puisse venir. Donc beaucoup de places et très bon marché. Ballet populaire ne veut pas dire ballet facile. » Lire aussi Maurice Béjart, l'homme qui a bousculé la danse Parallèlement, la même année, le metteur en scène André Benedetto, installé en 1963 avec la Nouvelle Compagnie d’Avignon dans la cité des Papes, décide d’ouvrir le Théâtre des Carmes pendant l’été pour y poursuivre le travail mené le reste de la saison. Il y crée Statues, une pièce sur l’absurdité existentielle jouée par deux comédiens. Au grand dam des responsables de la programmation officielle. « Paul Puaux, alors administrateur du Festival d’Avignon, est même venu demander à mon père d’arrêter, se souvient Sébastien Benedetto, fils du metteur en scène. Il lui semblait impossible et même sacrilège que des amateurs défient Vilar sur son terrain. Mais Vilar lui-même n’a jamais reproché à mon père d’avoir joué. Il a même parlé du Théâtre des Carmes lors de la conférence de presse en février 1968. » Le « off », qui n’avait pas encore de nom, s’ouvre avec une seule troupe sur le front. Nouvelle ère Vingt ans après les débuts du festival, Jean Vilar entend trouver « comme un nouveau départ », déclare-t-il lors de la présentation de l’édition. « Quatre semaines au lieu de deux, trois compagnies au lieu d’une, six spectacles au lieu de trois mais la mission reste la même : être un lieu privilégié du loisir populaire et de la réflexion. » C’est bien dit. Et pour enclencher cette nouvelle ère, Maurice Béjart. « Vilar a rencontré Béjart en 1963 grâce à Maria Casarès, avec laquelle le chorégraphe avait collaboré pour le ballet La Reine verte, raconte Ariane Dollfus, auteur du livre Béjart. Le Démiurge (Arthaud, 2017). Il lui a écrit une lettre magnifique où il évoque ce qu’il appelle “l’art de demain”, cet hybride entre théâtre et danse. » Dans ce texte de trois pages, Vilar progresse par palier pour tenter de saisir le geste béjartien. « Je vous avoue tout bonnement ce matin que votre spectacle m’a dérangé. Du moins au cours du premier acte. Je ne savais comment faire le chemin avec vous… Pourtant, j’étais très disponible, très gentil dans la salle. Ceci, jusqu’au moment où j’ai pensé un peu primairement sans doute que j’étais en présence de nouveaux signes, d’un nouvel alphabet aussi bien. (C’est très beau à voir, l’alphabet cyrillique, l’alphabet hébreu, l’alphabet chinois. Et le grec, donc ! Encore faut-il savoir les lire !) » Ariane Dollfus, auteur du livre « Béjart. Le Démiurge » : « C’était un hymne à la jeunesse que les œuvres de Maurice à l’époque » Vilar a programmé Georges Dandin ainsi que Richard III, mis en scène par Roger Planchon, Les Troyennes, par Michel Cacoyannis et Dieu, empereur et paysan, sous la direction de Georges Wilson. Molière, Shakespeare, Euripide… Du texte, du grand, de l’histoire, face à la narration sensuellement abstraite du mouvement dansé et le désir « d’art total » de Béjart dont Vilar apprécie « la polygamie artistique ». Le pari est lancé avec Variation pour une porte et un soupir, L’art de la barre ou encore Boléro avec un casting ébouriffant dont l’hypnotique Jorge Donn. « Pas de création car ce premier rendez-vous à Avignon était un test pour Béjart, poursuit Ariane Dollfus. Résultat : succès bouillant. Les places s’envolent : 3 200 tickets vendus pour le premier soir alors que la jauge était de 3 000 et il fallut mettre les « marches » à la vente. « Le public est là comme je l’attendais, déclarait Béjart à la RTS. Il est vivant, sympathique, jeune, chaud, passionné. » Et Ariane Dollfus d’ajouter : « Il faut dire que c’était un hymne à la jeunesse que les œuvres de Maurice à l’époque. Il était en plein dans sa période mystique, écoutait de la musique indienne à fond dans sa chambre à l’Hôtel d’Europe qui sentait fort le santal. Son côté hippie, ses danseurs en jeans et torse nu parlaient directement à chacun. » Pendant ce temps-là, au Théâtre des Carmes, la fièvre grimpe avec Benedetto. C’est grâce au père Jacques de la Celle, curé de la paroisse des Carmes, que l’auteur et metteur en scène a pu enraciner sa troupe dans ce qui était d’abord une salle paroissiale à Avignon. Dès 1963, il y revendique un théâtre politique. Avec « quelque chose de toujours très urgent à dire et en donnant régulièrement la parole à ceux qui ne l’avaient pas » , résume Sébastien Benedetto, qui a pris les rênes du lieu. La première pièce de son père, Le Pilote d’Hiroshima (1963) évoquait « l’histoire d’un pilote qui se sent coupable d’Hiroshima et qui voudrait être jugé. Mais quel juge, quel jury accepterait de juger un héros de guerre ? » . Plus abstraite, Statues, sous influence beckettienne avec ses phrases courtes et allusives, tend un piège au néant de l’activité humaine. « La salle n’était pas pleine mais certains spectateurs, au théâtre et dans la rue, insultaient régulièrement les acteurs en les traitant de voyous et délinquants parce qu’ils jouaient en même temps que Vilar », raconte Sébastien Benedetto. « Mettre les classiques au poteau » Statues fait écho au Manifeste de Benedetto qui, en avril 1966, balance un texte qui tape frontalement sur « l’institution ». « Il en avait assez de ne voir jouer que des classiques et trouvait important de présenter des pièces contemporaines, poursuit Sébastien Benedetto. Déflagrant, Le Manifeste éclabousse loin. Il décrit le théâtre de l’époque comme « un gaz délétère, hilarant et paralysant, asphyxiant… Il ne sert que de digestif, de purgatif et de somnifère… Il endort les consciences… extirpe du cœur du citoyen les dernières fibres révolutionnaires qui avaient survécu au laminage scolaire… » Et encourage chacun à « mettre les classiques au poteau », « la culture aux égouts … » Dans la foulée de ce premier « off », André Benedetto commence à répéter sa pièce Napalm, sur la guerre du Vietnam, jouée en 1967. Il rappelait, dans un texte écrit pour fêter les 40 ans de sa compagnie, que « la contestation de 1968, c’est la suite de 1966, parce que la grande année de la contestation, c’est 1966. Pas seulement à Avignon mais un peu partout. » Deux ans après, on y est. La Journée nécessaire, déambulation et performances dans la ville autour de textes d’André Benedetto. Le 10 juillet, Théâtre des Carmes, à Avignon. -
Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Rosita Boisseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 1, 2020 7:45 AM
|
Par Antoine Oury avec AFP dans Actualitté 01-07-2020
La Comédie-Française indique, dans un message publié sur le réseau social Twitter, être « profondément choquée à la découverte des faits de violence insupportables attribués à l’un de ses salariés ». Plain Chant, YouTubeuse spécialisée sur le théâtre, avait dénoncé quelques heures plus tôt des faits de violences qu'elle attribue à « un acteur de la Comédie-Française ».
Marie Coquille-Chambel, sous le pseudo de Plain Chant, propose des interviews de personnalités du théâtre sur une chaîne YouTube. Dans une série de messages publiés ce 29 juin, elle raconte les agressions multiples dont elle a été victime, perpétrée par un acteur de la Comédie française.
« Aujourd’hui j’ai été porter plainte contre un acteur de la Comédie-Française pour : “violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours” », a indiqué sur Twitter l'utilisatrice Plain Chant, qui anime également une chaine YouTube consacrée au théâtre.
Dans une série de messages, elle affirme avoir « été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai » et assure détenir des enregistrements audio de son agresseur, dans lesquels ce dernier la menace de mort à plusieurs reprises.
Les propos sont porteurs d’une haine sans borne : « Pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Tu vas voir comme c’est beau la vie quand tu vas la perdre. Tu vas regretter pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Dégage. »
Ou encore : « Tu veux pas que je filme ton assassinat ? Comme ça tout le monde saura ce qu’il s’est passé, pas comme pour Bertrand Cantat. Il y aura moins de doutes. J’ai très envie que tu meures. »
« Je crois que l’omerta n’est plus possible dans le théâtre et je refuse qu’une autre puisse subir de telles violences de la part d’un homme, qu’importe son influence et sa notoriété », explique encore l'utilisatrice sur le réseau social.
Quelques heures après la publication de ces messages, la Comédie-Française a réagi en publiant à son tour sur Twitter, indiquant que l'institution « condamne avec la plus grande fermeté [les faits rapportés] et prendra toutes les mesures qui s’imposent ». La Comédie française, contactée par ActuaLitté, n’a pour le moment pas répondu à nos demandes de précisions.
Outre l'intervention de la Comédie-Française, les faits seront sans doute suivis d'une enquête. Marie Coquille-Chambel, qui se présente comme Youtubeuse théâtre, affirmait que sa plainte n’a pas pu être reçue intégralement, et qu’il lui faudrait retourner au commissariat ce 30 juin. ActuaLitté n'a pas réussi à la joindre.
Image : photo d'écran du compte Twitter "PlainChant" de la plaignante Marie Coquille-Chambel
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...