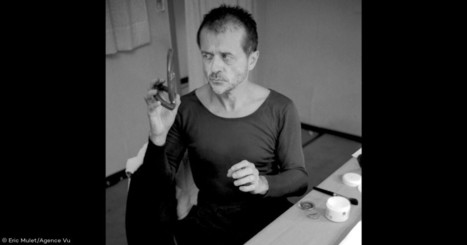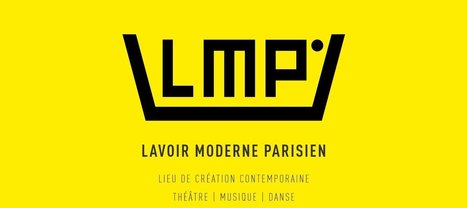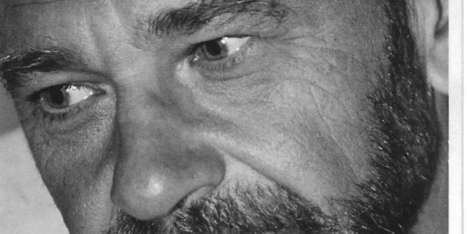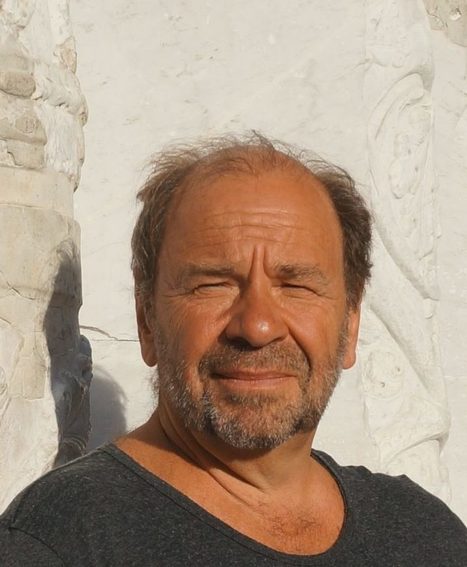Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 23, 2020 1:53 PM
|
Publié à l'occasion des 25 ans d'Inrockuptibles hebdo, le 20 juillet 2020 [25 ans d’Inrockuptibles hebdo] En novembre 1995, le metteur en scène monte pour la troisième fois Dans la solitude des champs de coton de son ami Bernard-Marie Koltès. Il accepte de nous rencontrer pour évoquer son parcours de jeune surdoué autodidacte devenu un maître adulé de la scène. Patrice Chéreau — Très tôt, j’ai eu envie de faire des spectacles. En cinquième, à 12 ans, je faisais répéter mes camarades dans la cour de récréation. A cet âge-là, le cinéma ne s’impose pas, on n’a pas de caméra : j’ai fait avec ce que j’avais sous la main. Du fait de l’activité de vos parents, votre statut d’artiste était-il déjà établi ? Il y a une filiation totale entre mes parents et moi. Grâce à mon père qui m’a emmené au Louvre régulièrement quand j’étais très petit et me disait : “Ça c’est de la mauvaise peinture et ça c’est de la bonne peinture.” Mon père peignait, tous les amis qui venaient à la maison étaient peintres. On allait dans toutes les galeries, tous les musées. C’était un dialogue permanent entre la peinture et moi à travers mon père et ma mère. Mais je serais incapable de refaire les aquarelles que je faisais il y a vingt ans, je n’ai pratiquement plus touché un pinceau. Par contre, je dessine toujours des mises en place. … Etes-vous d’accord avec Genet lorsqu’il disait qu’on ne peut pas être un grand artiste sans qu’un grand malheur s’en soit mêlé… En faisant ce métier, j’ai l’impression d’avoir donné un contrepoison au malheur que j’avais en moi. Le poison, c’était la difficulté de communiquer. Je garde un souvenir apocalyptique de mon adolescence, terrible d’absence de communication et de tristesse totale. Je n’en suis peut-être pas tout à fait sorti. Pourquoi avoir choisi le théâtre ? Le théâtre, c’était “faire”. Après, par contre, la grande expérience que j’ai eue entre 12 ans et 18 ans, c’est le cinéma : la Cinémathèque française où j’allais tous les soirs, parfois même deux fois par jour. J’ai vu tous les films qu’il fallait voir dans cette période-là, tout le cinéma américain, mais surtout l’expressionnisme allemand – ce qui m’a le plus frappé. Et puis, je voyais beaucoup de spectacles de théâtre : petit, j’y allais au moins une fois par semaine, avec mon argent de poche. Je ne peux pas dire pourquoi, c’était devenu une obsession monomaniaque. J’allais tout voir. Et j’ai eu deux chocs : le premier spectacle que Planchon avait fait venir à Paris, vers 1958 ; et, dans les années 1960 – j’étais encore au lycée –, le Berliner Ensemble de Brecht. Ça m’a ramené au cinéma parce que Brecht y avait beaucoup réfléchi. Le cinéma, j’en ai fait un usage immodéré : tout ce que je sais, tout ce que j’ai appris, c’est très peu de spectacles de théâtre et énormément de films. J’ai choisi le théâtre parce qu’il était à portée de la main. Je n’ai pas eu envie de jouer, mais de faire des spectacles. En troisième, au lycée Montaigne, je voyais arriver les affiches du groupe de théâtre amateur de Louis-le-Grand et je me disais : “J’irai les voir quand j’y serai.” En seconde, personne ne voulait de moi car j’étais très introverti, et faire du théâtre est devenu une thérapie incroyable. Je n’étais même pas mauvais élève, tout m’intéressait, mais j’étais seul, j’avais des problèmes de relations, pas d’amis, je me renfermais en moi. Et quand j’ai commencé à faire du théâtre, je me suis senti un autre homme, un autre jeune homme. Je me suis sorti de l’ornière dans laquelle j’étais. Je suis toujours un peu deux personnes : facilement handicapé par des choses de tous les jours ou des relations avec les gens dans la vie, et pas du tout sur un plateau de théâtre ou de cinéma. “J’ai eu une révélation le jour où j’ai commencé à diriger des acteurs sur un plateau, je me suis dit : ‘Mais ça change la vie !” Avez-vous essayé d’être acteur à cette époque ? Oui, on me faisait faire de la figuration. J’étais monstrueusement timide, donc pas facile. J’ai gravi les échelons : des figurations avec un mot, puis deux, puis un jour on m’a donné le rôle d’un vieillard. En jouant un vieillard quand on a 18 ans, on apprend beaucoup : on est désinhibé parce qu’on ne se présente pas soi-même. Ce qui est toujours mon problème aujourd’hui en tant qu’acteur. Je n’aime pas la façon dont je marche, la façon dont je parle, la façon dont je me tiens. Les rôles de composition, c’est plus facile. A la fin de Louis-le-Grand, j’ai commencé ma première mise en scène, en 1964 : un inédit de Victor Hugo, Une intervention. Et là, j’ai découvert non pas que je savais faire, mais que j’avais des idées tout le temps. J’ai eu une révélation le jour où j’ai commencé à diriger des acteurs sur un plateau, je me suis dit : “Mais ça change la vie !” : je savais organiser, je savais conduire et j’inventais. J’avais de l’invention alors que je n’en avais pas dans la vie. … “Etre écrivain est une passion totale et obsessionnelle qui ne laisse place à aucun autre travail” Monter une école de comédiens à Nanterre, c’était la volonté de transmettre ? Non, s’il y a eu un élève dans cette école, c’est moi. La décision est venue de la personne qui a eu en charge cette école, qui y a tout fait : Pierre Romans, qui disait toujours que ce qui fait un grand comédien est mystérieux – on ne comprend pas les mécanismes tellement c’est caché, lointain. C’est le produit de toute une vie, ce sont les sédimentations de toute une existence qui ressortent. Ce qui est fascinant avec les jeunes, c’est qu’on découvre ce que c’est que d’être comédien tous les jours, quels sont les mécanismes, les blocages, la difficulté qu’il y a à travailler sur soi tout le temps, c’est-à-dire d’être à l’écoute de l’outil de travail qui est en soi. Il n’y en a pas d’autre : un instrumentiste a un instrument, il en joue bien ou mal, mais pour un comédien, il faut jouer de soi. Ça, c’est très mystérieux et très éprouvant. … Pourquoi n’avez-vous jamais tenté d’être l’auteur de vos pièces ? Je ne suis pas écrivain. Un scénario, on n’a pas besoin d’être écrivain pour le faire : l’écriture définitive du film est au tournage, dans le montage, le produit final. Je ne suis pas écrivain et je n’ai pas envie de l’être. Il faut avoir une langue, je ne l’ai pas. Koltès, je voyais bien qu’il était hanté par l’usage de la langue, l’usage du français, il se battait tous les jours avec des mots sur une page. Etre écrivain est une passion totale et obsessionnelle qui ne laisse place à aucun autre travail. … “On peut ne pas aimer ‘La Reine Margot’, mais il y a un cinéaste dans ce film” N’est-ce pas ces grands écarts qui brouillent votre image de metteur en scène ? Des pièces de Koltès aux opéras à Bayreuth, de L’Homme blessé à La Reine Margot ? Il n’y a pas de message. Je crois qu’il y a un monde cohérent, qui est le mien, qui réapparaît dans tous les films et toutes les pièces. Je suis la même personne dans tous les cas. Je ne suis pas l’auteur des spectacles de théâtre que je fais, je n’en suis que le metteur en scène mais, par contre, j’essaie d’être l’auteur de mes films. Je suis long au cinéma, alors qu’au théâtre je suis très rapide. On peut ne pas aimer La Reine Margot, mais il y a un cinéaste dans ce film, il y a de vrais, de longs moments de cinéma, je le sais. Je n’ai peut-être pas réussi à faire un film complet qui serait un événement de cinéma total. Un jour ou l’autre, on finira bien par me considérer comme un metteur en scène qui fait les deux. Ça ne se fait plus, alors que tous les exemples que j’ai, comme Welles ou Visconti, Bergman ou Kazan – je ne me compare pas –, ont fait les deux. Le cinéma mène un mauvais débat avec le théâtre : il est obsédé par l’idée de ne surtout pas être théâtral, alors qu’il y a de très grands films très théâtraux et que le cinéma est né du théâtre. Je revendique cette filiation et je revendiquerai toujours le passage de l’un à l’autre. Je ne ressens pas un manque de reconnaissance, pas depuis La Reine Margot en tout cas. Mais comme je risque toujours d’alterner, je resterai à part. Attendons que je fasse encore trois, quatre films et on en reparlera. >> A lire aussi : Patrice Chéreau, en 2003 : “Je vais toujours vers les choses les moins confortables”

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 22, 2020 5:02 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 22 juillet 2020 Privés de représentations en salle, comédiens, danseurs et circassiens investissent l’espace public
Jamais vu ça ! La rue, poumon du confinement, génère un formidable appel d’air. Depuis quelques semaines, l’invasion d’artistes de tout poil sur les places, les marchés, au pied des immeubles, mais aussi dans les parcs, les jardins, prend une ampleur saisissante. L’espace public devient la scène estivale numéro 1. Privés de théâtres, les comédiens, les danseurs, les circassiens s’y précipitent et se retrouvent au coude-à-coude avec les artistes de rue. Nécessité pour les premiers « poussés par le besoin de renouer avec le métier et les spectateurs », selon le metteur en scène Samuel Sené, auteur de la performance C-o-n-t-a-c-t, visible à Paris et Vichy (Allier), bientôt à Londres. Evidence pour les autres qui, comme la chorégraphe Nathalie Pernette, ont choisi depuis longtemps le plein air « parce que plus envie du confort des salles et désir d’aller à l’aventure dans des lieux toujours différents ». Ce débordant été culturel, « brassage stimulant pour tout le monde », selon Fred Rémy, directeur du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac (Cantal), souligne un mouvement esthétique de fond : « Il y a depuis quelque temps chez les artistes travaillant dans les théâtres un véritable appétit pour la rue qui permet de sortir des conventions scéniques et de casser enfin le quatrième mur. » De fait, les performances in situ proposées de plus en plus souvent par des chorégraphes installés – par exemple, José Montalvo et Boris Charmatz – ou par le metteur en scène de cirque Yoann Bourgeois, témoignent de cet attrait pour des terrains de création plus escarpés que la boîte noire. « Le plein air permet d’amener les œuvres là où elles ne vont pas et offre des rencontres avec de nouveaux spectateurs en haussant leurs promenades quotidiennes d’un ton », estime José Montalvo. Bouleversement sanitaire oblige, cette saison se construit à l’arrache. Alors que la plupart des 70 manifestations des arts de la rue ont été annulées, comme Chalon dans la rue (Saône-et-Loire) et Aurillac, ou reportées, la liste des nouveaux rendez-vous en extérieur s’allonge. De Paris, avec Un été particulier piloté par la mairie, à Mon été à Nice en passant par L’Eté à volonté, à Créteil (Val-de-Marne), sans oublier L’Eté culturel du ministère de la culture, les opérations spéciales s’additionnent. « Réjouissant et nécessaire » Cette reprise des activités, même fragile, est évidemment une excellente nouvelle. « C’est réjouissant et nécessaire, s’enthousiasme Pascal Le Brun-Cordier, directeur du Master Projets culturels dans l’espace public, à la Sorbonne. L’espace public a été inaccessible pendant le confinement, puis réduit à une distanciation sanitaire, à une technique de flux et à la surveillance policière. Il est temps de retrouver ses trois vraies dimensions : poétique, sociale et politique. » « Il faut restaurer le lien social qui est très abîmé, mais c’est un peu la panique tout de même, renchérit la comédienne de rue Laetitia Lafforgue. On avait fait un trait sur notre été et il faut maintenant réagir vite et bricoler des interventions. » Curieusement, dans cette ruée, les professionnels de l’espace public ne semblent pas avoir été les premiers mis dans la boucle. « J’ai été très peu contacté par ceux qui organisent soudain des manifestations dans la rue », constate Mathieu Maisonneuve, directeur de l’Usine, Centre national des arts de la rue, à Toulouse, et président du réseau des 14 Cnarep. Même commentaire de Caroline Loire, directrice de la saison d’Art’R, trente ans d’expérience tout terrain sur l’Ile-de-France : « Ça m’agace un peu que les directeurs de salles et les politiques ne fassent pas appel aux opérateurs qui connaissent le sujet. On dirait que c’est facile techniquement de planter des spectacles in situ, alors que c’est loin d’être le cas. » Seraient-ils « dépossédés » de leur expertise, comme le résume mi-figue mi-raisin Caroline Loire ? Si cette offensive est « géniale pour créer des passerelles entre les arts » comme le reconnaît Jean-Luc Prévost (de la compagnie Les Goulus), président de la Fédération des arts de la rue, elle génère des frictions. Lui s’agace de « ceux qui viennent des salles et découvrent la rue car ils y sont contraints, comme par exemple le metteur en scène Thomas Jolly à Angers. Ils inventent l’eau chaude et leur ignorance est un peu affligeante. Que l’art bourgeois découvre l’espace public et s’en empare, avec plaisir, mais un peu d’humilité ! » Egalement remonté, le metteur en scène Pierre Berthelot, de la troupe Générik Vapeur, prépare pour le 6 novembre un « grand raout » pour « alpaguer les politiciens » : « C’est le chaos. Je n’ai quasiment aucune date cet été et je vais me retrouver en octobre le bec dans l’eau sans avoir bossé alors que les autres vont jouer en salle. On est les grands oubliés mais aussi les grands énervés de quarante ans de pratique de la rue. » Un statut marginal Ces tiraillements rappellent combien le secteur le moins aidé de la culture (10 246 766 euros pour 1 000 compagnies répertoriées), possède un statut marginal. Et pourtant, comme le rappelle Mathieu Maisonneuve, « nous sommes les premiers produits culturels à l’exportation. » « Jouer dans la rue, ce n’est pas faire du théâtre dehors comme certains le pensent, affirme Laetitia Lafforgue. Il faut beaucoup de conviction et de militantisme. Si on choisit ce secteur par défaut, c’est bien simple, on n’y reste pas. » José Montalvo, chorégraphe : « Le plein air permet des rencontres avec de nouveaux spectateurs en haussant leurs promenades quotidiennes d’un ton » A quoi Nathalie Pernette ajoute : « Et si on y reste, c’est qu’on aime le danger du hasard. » Impossible en revanche « d’aller au contact des spectateurs », comme cette dernière aime le faire. La pandémie, après le terrorisme et Vigipirate en 2016, brime à son tour la liberté. « Alors même que l’espace public est démocratique et permet de casser tous les cercles, comment va-t-on interagir cet été ?, s’interroge Jack Souvant, de la compagnie Bonheur intérieur brut, également chroniqueur sur France Inter. « Avec cette crise de l’interdiction, j’ai la sensation que l’espace public, de plus en plus policé, n’appartient plus aux artistes mais à la loi et au ministre de l’intérieur, et que l’on spécule sur la peur en déresponsabilisant les gens, ce qui arrange bien certains politiques, analyse Jean-Marie Songy, directeur du festival Furies de Châlons-en-Champagne (Marne). Il faut que nous retrouvions le théâtre d’intervention, que nous redevenions des hors-la-loi. » Dans ce contexte de résistance, la notion de surprise chère à la rue resurgit, ainsi que des rendez-vous non annoncés. « Pour ne pas provoquer de gros rassemblements mais aussi pour détourner les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, précise Claude Guinard, directeur du festival Les Tombées de la nuit, à Rennes. L’espace public est sensible et encore plus après le confinement. Il y a eu beaucoup d’angoisse. Les gens ont besoin de formes, plus furtives, plus douces. » Avec des SDF parisiens Les petits formats et les performances légères tirent évidemment leur épingle du jeu. « Et c’est une bonne chose car les spectacles intimes ont souvent un peu de mal à trouver leur place dans les festivals de rue », commente l’universitaire Pascal Le Brun-Cordier. Parmi celles-ci, une tendance se détache depuis quelques années, celle des créations enracinées dans un territoire et une population. Actuellement en répétition et programmée à la rentrée, la compagnie Rara Woulib travaille avec des SDF parisiens pour son spectacle Moun Fou tandis que Julie Desprairies, habituée à vagabonder de la plage à la bibliothèque, est en immersion dans une ferme du Vercors pour Tes jambes nues, autrement. Article réservé à nos abonnés Cette évolution a aussi pour conséquence de fragiliser les grosses parades et productions ambitieuses, à la dimension des villes. « Cela risque aussi de creuser le fossé entre les formes de proximité et celles plus classiques des arts de la rue, en limitant les esthétiques », s’inquiète Pierre Boisson, directeur du festival de rue de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Indispensables pourtant sont les œuvres imposantes de Royal de Luxe, Générik Vapeur ou Oposito, qui génèrent des émotions collectives. Et ce frisson-là est unique ! Rencontre nationale des arts de la rue, le 6 novembre, Cité des arts de la rue, à Marseille. Réservation sur www.c-o-n-t-a-c-t.fr. L’Eté à volonté, Créteil (Val-de-Marne). Master class danse, en accès libre, dans différents quartiers, du 21 juillet et 26 août. Compagnie Bonheur intérieur brut. Jack Souvant, le 6 août, à Clermont-Ferrand. Rosita Boisseau Lire aussi Sur les hauteurs d’Annecy, un rando-spectacle dans les alpages Lire aussi Pour la danse et le cirque, le délicat équilibre entre création et sécurité sanitaire Lire aussi « Je ne vois pas pourquoi un théâtre serait plus risqué qu’un supermarché » : la réouverture complexe des salles de spectacle Légende photo : « 360 degrés » par Générik vapeur, le 30 juin à la cité des arts de la rue, à Marseille. CAROLINE GENIS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 5:56 PM
|
Propos recueillis par Anaïs Héluin dans La Terrasse - 13 juillet 2020 Avec La Brèche de Naomi Wallace, Tommy Milliot poursuit l’exploration des écritures contemporaines qu’il mène depuis la naissance de sa compagnie Man Haast en 2014. Tragédie de quatre adolescents, cette pièce déconstruit le rêve américain grâce à une mécanique implacable. Depuis Lotissement de Frédéric Vossier, prix du jury Impatience en 2016, jusqu’à Massacre de l’auteure catalane Lluisa Cunillé créé au Studio de la Comédie-Française la saison dernière, en passant par Winterreise du Norvégien Fredrik Brattberg, vos choix de mises en scène se portent généralement sur des auteurs méconnus. Comment les découvrez-vous ? Tommy Milliot : À l’origine de Man Haast, il y a en effet le désir de porter des textes d’auteurs vivants, en prise avec notre monde. Avec Sarah Cillaire, la dramaturge de la compagnie, nous formons tous les deux un micro comité de lecture. Nous lisons de très nombreuses pièces, grâce à diverses structures – la Maison Antoine Vitez, Théâtre Ouvert ou encore le festival Actoral – qui font dans l’ombre un formidable travail de mise en valeur des écritures contemporaines. Nous mettons en commun nos découvertes, et finissons par faire nos choix. La Brèche semble se démarquer de vos choix habituels. Le texte est de facture plus classique, il est aussi moins abstrait que les autres. Son auteure, l’Américaine Naomi Wallace, est également plus connue que ceux qui ont jusque-là attiré votre attention. T.M. : Si Naomi Wallace est assez célèbre dans son continent d’origine, elle est peu montée en France, bien qu’inscrite au répertoire de la Comédie-Française en 2009 avec Une puce, épargnez-la. Quant à La Brèche, je suis à ce jour le seul à l’avoir mise en scène. Cette pièce est en effet de facture plus classique que Lotissement, Winterreise ou Massacre. Ce qui m’intéresse chez elle, c’est ce qu’elle raconte : la tragédie de quatre adolescents, parmi lesquels une jeune fille, Jude, qui se sacrifie au nom du Rêve américain. En vain. Cette tragédie brasse de nombreux sujets. Avez-vous cherché à en mettre certains en valeur plus que d’autres ? T.M. : Tous les thèmes abordés dans La Brèche – l’instrumentalisation du corps féminin, la violence des laboratoires pharmaceutiques ou encore les rapports homme-femme – nourrissent selon moi une réflexion sur la domination. Mais je ne veux jamais faire passer de message. La mise en scène, pour moi, doit simplement ouvrir à chacun une voie personnelle au texte, à la fiction. « LA MISE EN SCÈNE, POUR MOI, DOIT SIMPLEMENT OUVRIR À CHACUN UNE VOIE PERSONNELLE AU TEXTE, À LA FICTION » La scénographie tient dans votre travail une place centrale, à l’égal du texte. Comment avez-vous imaginé celle de La Brèche ? T.M. : Notre exploration des dramaturgies contemporaines, au sein de la compagnie Man Haast, est associée à des textes contemporains, mais elle ne s’y limite pas. La construction de l’espace scénique est pour nous aussi importante que l’approche du texte, du jeu, de la lumière et du son. Avec Jeff Garaud, concepteur et constructeur des décors de la compagnie, c’est en travaillant avec les acteurs et un noyau de collaborateurs fidèles (Sarah Cillaire à la dramaturgie, Sarah Marcotte à la lumière, Adrien Kanter au son, Matthieu Heydon à l’assistanat à la mise en scène) que nous avons imaginé la dalle de béton qui sert de scénographie à La Brèche. Je voulais un espace qui soit concret pour de jeunes acteurs, dont c’était au moment de la création du spectacle la première expérience professionnelle. Elle représente la notion de fondation, ou plus précisément de « basement » en américain. La pièce est construite selon un aller-retour entre deux époques, 1977 et 1991. Comment les avez-vous fait cohabiter au plateau ? T.M. : Naomi Wallace souhaite voir jouer ses quatre personnages par deux distributions différentes. J’ai suivi ce désir, qui me semble très juste car en 14 ans, les corps et les personnalités changent. D’autant plus lorsqu’une telle période est marquée par une tragédie. Davantage qu’une ressemblance entre les quatre protagonistes des deux époques, j’ai recherché une vraisemblance. Toujours dans le but de permettre au spectateur de tracer son propre chemin dans l’histoire. Parmi les points communs que l’on peut trouver entre les différents textes que vous avez montés, il y a le trouble et le secret. Comment définiriez-vous ceux de La Brèche ? T.M. : Le secret, dans La Brèche, est particulier en ce qu’il est dévoilé d’emblée. La pièce n’est en est pas moins troublante, au contraire : ce qui perturbe, ce sont les 14 années auxquelles nous n’avons pas accès. La capacité de ses personnages à se détruire sans s’en rendre compte est un mystère épais. Propos recueillis par Anaïs Heluin La Brèche de Naomi Wallace Mise en scène Tommy Milliot
du Mercredi 7 octobre 2020 au Samedi 17 octobre 2020
Le Centquatre
5 rue Curial, 75019 Paris
à 20h30. Tel : 01 53 35 50 00. www.104.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 4:02 PM
|
Par Mireille Davidovici et Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog - 21 juillet 2020
La Grande Balade proposée par Bonlieu Scène Nationale d’Annecy
A la sortie du confinement, Salvador Garcia a lancé l’équipe de Bonlieu à l’assaut du Semnoz, un plateau qui domine la rive ouest du lac d’Annecy et qui offre un vaste domaine skiable en hiver et des chemins de randonnée en été. Son idée : proposer dans ces alpages, une manifestation pluridisciplinaire, itinérante, sous forme d’une grande balade à la rencontre d’une centaine d’artistes, toutes disciplines confondues.
Aucun programme n’était annoncé, de sorte que les marcheurs, guidés par le son des instruments ou des voix, vont de surprise en surprise. Habitants des environs, spectateurs fidèles ou randonneurs de passage, ont répondu à l’appel. Et quelque vingt-cinq mille personnes venues respirer l’air des cimes sur ces deux jours et humer les arômes de la Culture, ont rencontré des artistes aussi exigeants sur les sentes qu’à la scène. Preuve qu’une importante scène nationale peut proposer une manifestation de grande qualité ouverte à tous. Rien de mieux pour réveiller le théâtre de la stupeur où l’a plongé le virus et décloisonner les publics. L’événement a mobilisé l’équipe de Bonlieu au grand complet, des dizaines d’intermittents et de bénévoles, sans compter chauffeurs de bus et opérateurs de la télécabine pour monter les visiteurs au sommet, la balade s’effectuant à la descente …
Au sortir de la télécabine, à 1.600 mètres d’altitude, les nuages descendent, déception : on ne verra pas le Mont-Blanc… Mais dans le coton blanc, la batterie de taïkos japonais, grands et petits tambours de la compagnie Taikokanou. Puissants battements de bras de Fabien Kanou, petits coups de baguettes secs de Mayu Sato pour une cavalcade rythmique avant de finir au gong et à la flûte, tandis que se dispersent les brumes matinales. Les spectateurs, déjà nombreux, sont rassurés par la réapparition d’un ciel bleu.
La musique accompagnera toute la descente coordonnée par Blaise Merlin. Avec L’Onde & Cybèle, il organise des itinéraires artistiques (prochainement à Paris : une déambulation le long de l’ancienne voie de chemin de fer, la Petite Ceinture). Il a su enchanter la forêt en postant des chanteurs et des instrumentistes dans les branches, avec Fanny Perrier-Rochas et ses airs byzantins, le Duo Ishtar (luth et harpe) de Maëlle Duchemin et Maëlle Coulange. Suivront des solos de violoncelle, violon et clavecin, au détour d’une clairière, et des duettistes qui mêlent ces cordes suédoises que sont les nickelharpas, à la guitare et la mandole. Le bien nommé Guillaume Loizillon, lui, peuple les herbes hautes de ses Zoophonies, clameurs électroniques d’une faune imaginaire…
Les cailloux roulent sous nos pieds, on s’arrête et on tend l’oreille aux « jingles » sonores qui jalonnent la descente. Au fur et à mesure, les techniciens finissent d’installer quelques structures complexes et on ne verra donc pas toutes les propositions…
La musique guide aussi les nombreuses pièces présentées sur le chemin. Le saxophoniste Peter Corser soutient d’un souffle continu une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta. Arlaud, Angèle Methangkool-Robert et Bruno Maréchal s’accordent et se désaccordent en solo, duo et trio pour une danse narrative fluide sur les vicissitudes de l’amour à trois.
Plus loin, trois musiciens loufoques coiffés de branchages disent la solitude de deux campeurs un peu paumés. En tenue parodique d’Adam et Eve, ils s’interrogent sur l’existence de Dieu. On reconnaît le style déglingué d’Yves Fravega et de sa compagnie l’Art de vivre … Plus poétiques, Les filles du Renard Pâle : Johanne Humblet, haut perchée pendant plus de quatre heures sur un fil tendu entre deux épicéas, manie lentement sa perche en se lovant autour du câble accompagnée par des berceuses au ukulélé.
Sur ce parcours de sept kilomètres, des bénévoles agitent au-dessus de la tête des marcheurs des pancartes invitant à la prudence et à rester à un mètre les uns des autres. Chacun cherche sa place dans l’herbe, au milieu des gentianes, en évitant les chardons et les bouses de vaches, un enfant sur les épaules ou lové sur les genoux. En contre-bas, parviennent les applaudissements du groupe qui précède : on se sent nombreux et heureux dans cette nature sylvestre. Les artistes ont d’ailleurs joué les ambiguïtés de la faune et de la forêt : ils présentent presque tous une hybridation animale et/ou feuillue qui réveille les enchantements des contes et les peurs de l’enfance.
Des marcheurs prévoyants ont emporté un pique-nique et composent çà et là des campements provisoires…Les multiples propositions que danseurs, acrobates comédiens et performeurs enchaînent cinq à six fois dans la journée, jouent la forêt comme espace poétique et lieu de l’invisible, des esprits et des légendes. Le Semnoz se prête aux créations in situ, inspirées par le relief et la végétation alentour : la danseuse Sandrine Abouav devient une femme-gentiane, ondulant et rampant dans les hautes herbes entre chardons et fleurs des Alpes… Face à elle, Jade et Cyril Casmèze de la compagnie Le Singe debout se sont métamorphosés en homme-loup et femme-renard, insolites et glapissants. Lise Ardaillon et Sylvain Milliot, de la compagnie Moteurs multiples, mettent en scène une absence avec une tente vide, des bois de cerf menaçants, une voix off : le campement mystérieux de Sophie, disparue depuis quelque temps déjà ?
Une histoire à imaginer comme celle de cet homme qui, descendu de l’arbre en dansant au bout d’un fil, gravit un immense talus qu’il débaroule pour regagner son perchoir et, tel Sisyphe, recommence ad libitum… Poétique comme Camille Boitel sait l’être ! Métaphorique aussi, la performance en plein champ de Yoann Bourgeois et Marie Vaudin : sur un plateau carré oscillant sur un pivot central, ils peinent à se rejoindre pour s’asseoir à la table placée au milieu du dispositif, douce ironie sur le couple et ses incertitudes …
Sur un petit terre-plein de gazon, entouré de fleurs blanches, dansent Hafiz Dhaou et Aïcha Mbarek, en habits de mariés. La voix de Marguerite Duras aux sonorités sèches, commentant Détruire, dit-elle, nous invite à revenir à l’état d’avant l’éducation, à retrouver la vie intérieure comme facteur de changement de soi…
Dans une clairière, François Veyrunes a ménagé une échappée belle d’une grande douceur. Un duo féminin, tendre et félin, dansé par Francesca Ziviani et Emily Mézières : la nudité des corps, l’un blond et l’autre brun, qui se mêlent en arabesques sur l’herbe verte, se confond avec la nature bienveillante. Un parapente glisse langoureusement au-dessus d’elles ajoutant une caresse imprévue à la caresse du vent. Age d’or ou paradis perdu… comme en réponse à la pièce ironiquement tourmentée d’Yves Fravega …
En clôture, Philippe Decouflé, sur un large plateau, joue avec le mode plus classique de la représentation. Huit danseurs pour des pièces courtes aux registres variés qui traversent des périodes de son travail. Peut-être la moins surprenante des propositions réunies au Semnoz.
Nous n’avons pu voir le travail de François Chaignaud, de Fanny de Chaillé et Jérome Andrieu, ni apprécié Chloé Moglia suspendue à son arche, ni le funambule Nathan Paulin. Certains espaces n’étant pas encore prêts au moment de notre passage, ou trop bien cachés !. Impossible de citer tous ces artistes ni toutes les propositions. Chacun a répondu à sa manière à l’invitation, avec une forme d’humilité, un souci de retour aux sources. Aussi avons-nous vécu cette magnifique balade comme une offrande des artistes aux dieux du vent et de l’été, aux arbres et aux oiseaux.
Mireille Davidovici et Marie-Agnès Sevestre pour Théâtre du blog

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 11:37 AM
|
Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 21 juillet 2020 Dans le cadre du programme Un été particulier de la Ville de Paris, Antonin Chalon recrée After the end, de l’auteur anglais Dennis Kelly, au sein d’un container installé dans l’enceinte du Square Wyszynski. En 2019, à La Manufacture, dans le Festival Off d’Avignon, Antonin Chalon créait After the end, thriller psychologique de Dennis Kelly plaçant deux personnages — Louise et Mark — dans un “hors le temps” entre réalité et illusion. Cet été, le jeune metteur en scène adapte son spectacle pour une nouvelle version programmée par la Ville de Paris, en plein air, dans le XIVème arrondissement de la capitale. Installé sur des gradins, devant un container au sein duquel les comédiens Marie Petiot et Nicolas Avinée se font face, le public assistera aux impulsions vertigineuses de ce « huis clos à l’hyperréalisme glaçant ». Un huis clos à travers lequel l’auteur anglais (né en 1970) explore les tensions que mettent en jeu deux individus réfugiés, suite à une attaque terroriste, dans un abri souterrain antiatomique. « Tout oppose Mark et Louise, explique Antonin Chalon. Lui est plutôt introverti, un peu geek. Elle est très à l’aise en société. Le rapport de force qui se joue entre eux évolue constamment. » Une jeune génération en perte de repères « La victime peut ainsi se changer en bourreau, poursuit-il. La maîtrise de la situation échappe tour à tour à l’un, puis à l’autre. » Dans l’espace confiné de ce bunker coupé du monde, les deux personnages d’After the end laissent ressurgir leurs instincts primaires : désirs, manipulations, luttes de pouvoir et de territoire… « Dennis Kelly explore avec beaucoup de justesse les contradictions d’une jeune génération en perte de repères, fait remarquer le metteur en scène. Une génération bouleversée par la violence, la xénophobie et l’omniprésence des médias. (…) Nous avons réalisé un travail très rigoureux sur les dialogues, envisageant le texte comme une véritable partition de musique, avec ses temps, ses silences et ses crescendos. » Centrant sa représentation sur la direction d’acteur, Antonin Chalon s’attache ici à éclairer « la fragilité de personnages dépeints avec une précision toujours teintée d’une grande humanité ». Manuel Piolat Soleymat After the end
du Mardi 1 septembre 2020 au Samedi 12 septembre 2020
Square Wyszynski
rue Vercingétorix, 75014 Paris.
à 20h45. Relâche le 06 septembre. Entrée libre. Réservation obligatoire : reservationsaftertheend@gmail.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 6:14 AM
|
Par Stéphane Capron dans Sceneweb - 21 juillet 2020 La ville de Paris a préempté les immeubles de la Rue Léon dans le quartier de la Goutte d’or qui abrite le théâtre. Ils avaient été mis en vente pendant le confinement par son propriétaire, une holding luxembourgeoise. Le Lavoir Moderne Parisien, lieu de création dirigé par Julien Favart va ainsi pouvoir poursuivre son travail de dénicheurs de talents.
Cet hiver, juste avant le confinement, Etienne A, la pièce de Florian Pâque et Nicolas Schmitt créée au Lavoir Moderne Parisien a créé le buzz, à tel point que le pièce est reprise dans le privé au Théâtre La Scala. Le Lavoir Moderne Parisien sert à cela, à permettre à des jeunes compagnies à montrer leur spectacle.
Ancien lavoir de la fin du 19ème siècle, Le Lavoir Moderne Parisien est devenu un théâtre en 1986 et reste à ce jour l’unique théâtre du quartier de la Goutte d’Or. Le LMP est géré par l’association Graines de soleil qui fonctionne avec deux salariés permanents et des intermittents, qui vont pouvoir souffler, tout comme son directeur, Julien Favart qui va pouvoir continuer “à dénicher des pépites“, même s’il sait qu’il va falloir encore “se battre pour faire vivre l’équipe et convaincre tous les subventionneurs de la structure“. Mais la préemption du bâtiment par la ville de Paris est un premier pas. “Ce théâtre est un symbole de la lutte pour l’indépendance de la culture. Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page, ambitieuse et sereine, de son histoire” écrit sur son compte twitter, Christophe Girard, l’adjoint à la culture d’Anne Hidalgo. Le bâtiment sera rénové par un bailleur social qui en deviendra le propriétaire. La direction du LMP et la Ville de Paris doivent désormais se revoir pour évoquer le fonctionnement de l’association.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 5:16 AM
|
par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore, envoyé spécial à Villeurbanne - publié dans l'Oeil d'Olivier le 21 juillet 2020 En confiant à Valère Novarina la tâche de revisiter le mythe d’Orphée et d’Eurydice, Jean Bellorini souhaitait un voyage au pays des songes, des mots et des sombres merveilles. Encore en répétitions, Le jeu des ombres, dont la première était prévu dans la cour d’Honneur du Palais des Papes dans le cadre du Festival d’Avignon, semble dépasser toutes les espérances secrètes du nouveau directeur du TNP. Poétique épopée dans l’enfer des amours sacrifiées ! Au cœur du quartier des Gratte-ciel de Villeurbanne, aux faux airs de Manhattan, se niche dans une immense bâtisse blanche à l’architecture art déco, le TNP. Construit dans les années 1930 à la demande de Firmin Gémier et remanié à plusieurs reprises depuis par ses directeurs successifs, le lieu, gardien d’une certaine idée du théâtre, qui se veut « élitaire pour tous », comme dirait Antoine Vitez, dégage une aura singulière. L’arrivée en janvier de Jean Bellorini s’inscrit dans cette belle continuité. Jean Bellorini aux manettes Après avoir admiré la façade, il est temps de pénétrer dans l’antre. Coronavirus obligé, c’est par l’entrée de service que l’on s’engouffre dans le bâtiment. La visite est rapide, dans quelques minutes, salle Roger Planchon, les répétitions du Jeu des ombres vont débuter. Sur scène, les comédiens en costume déambulent. Ils s’échauffent la voix, prennent possession des lieux, les apprivoisent. En chef d’orchestre, Jean Bellorini rassure les uns, encourage les autres, donne ses dernières recommandations, ses dernières notes. Le chant de Verdi, les mots de Novarina Chacun prend place dans un décor épuré rappelant quelques vieux greniers, quelques brocantes dédiées à la musique. La pièce plonge dans la pénombre. Un faisceau de lumière éclaire un petit groupe d’acteurs dont s’extrait Hélène Patarot. Regard déterminé, pas mesurés, elle s’avance vers les spectateurs. Madame Loyale du spectacle à venir, elle délivre avec délicatesse les tenants et aboutissants des amours du tendre Orphée et de la belle Eurydice. C’est le commencement d’un rêve ouaté où les chants opératiques de Monteverdi accompagnent les mots fantasques de Valère Novarina. Son écriture prolixe, extravagante et jubilatoire s’accorde à merveille avec les notes jouées en direct par trois musiciens. Des images à couper le souffle Les images défilent, les tableaux s’enchaînent. De partout jaillit une troublante beauté. L’émotion est là palpable dans chaque intonation, chaque apparition. La scénographie d’une beauté tragique autant qu’onirique, signée Jean Bellorini et Véronique Chazal, envoûte, hypnotise. Le tout porté par d’épatants artistes : l’éblouissante Karyll Elgrichi, l’ahurissant Jacques Hadjaje, le gracile François Deblock, l’habité Marc Plas, la détonante Anke Engelsman, l’épatant Mathieu Demonté, l’étonnante Clara Mayer, l’extraordinaire Liza Alegria Ndikita, le prodigieux Ulrich Verdoni et la lumineuse chanteuse Aliénor Feix. Le rêve manqué d’Avignon Encore à l’état d’ébauche, le spectacle saisit par son épure et son lyrisme. Comment ne pas penser à ce qu’aurait pu donner une telle œuvre, si riche, si intense dans l’écrin de pierres de la Cour des Papes. Profondément conquis par le travail de Jean Bellorini, on ne peut qu’avoir hâte d’assister à la première en octobre prochain, lors de la semaine d’art du Festival d’Avignon. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Villeurbanne Le Jeu des Ombres de Valère Novarina
Répétitions au TNP
Semaine d’art en Avignon – Festival d’Avignon
Diffusion le 25 juillet 2020 sur France 5 à 23h20
Durée 2h00 environ
mise en scène Jean Bellorini assisté de Mélodie-Amy Wallet
avec Liza Alegria Ndikita, François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Hélène Patarot, Marc Plas, Ulrich Verdoni
euphonium Anthony Caillet
piano Clément Griffault
violoncelle Barbara Le Liepvre
percussions Benoit Prisset
collaboration artistique Thierry Thieû Niang
scénographie Jean Bellorini, Véronique Chazal
lumière Jean Bellorini, Luc Muscillo
vidéo Léo Rossi-Roth
costumes Macha Makeïeff
coiffure et maquillage Cécile Kretschmar
musique extraits de L’Orfeo de Claudio Monteverdi
direction musicale Sébastien Trouvé en collaboration avec Jérémie Poirier-Quinot Crédit photos © Pascal Victor

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 20, 2020 7:30 PM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier - 20 juillet 2020 La vie reprend dans les théâtres. Partout en France, des initiatives voient le jour pour donner un nouveau souffle au spectacle vivant. A Paris, le metteur en scène David Lescot présente, au Théâtre de la Ville et à Paris l’été, son diptyque jeune public, J’ai trop peur et J’ai trop d’amis. Entretien avec un artiste vibrant.
Est-ce que cette période étrange a changé votre façon d’envisager le théâtre ? David Lescot : je ne dirais pas ça directement. Je ne crois pas que cela ait eu un effet direct sur le contenu de ce que j’ai envie de faire que ce soit sur la forme ou le fond. C’est un coup d’arrêt assez violent. Évidemment, comme tout le monde j’ai été sonné au début, mais, très vite, je me suis dit que je pouvais profiter de ce moment suspendu pour me reposer un peu. J’ai accepté ce temps, j’ai fait avec. Il me semblait inconcevable de tenter de lutter contre cette chose beaucoup plus grave que nous. Bien sûr, cela a eu et a toujours des incidences énormes sur nos activités d’artistes, mais je trouvais plus utile de reprendre des forces aux vues des signes avant-coureurs d’un désastre annoncé pour nos métiers. Après un tel choc, la reprise ne pouvait être que compliquée et chaotique. Bien sûr, cette crise sans précédent fait émerger des thèmes que l’on va reconnaître et retrouver dans ce que l’on a produit, écrit ou monté. En tout cas, je ne suis pas pour le volontarisme dans ce domaine. Je préfère laisser venir les choses. L’inconscient et la passivité de l’inspiration sont très importants dans mon processus créatif. Le monde se charge de décider sur quoi il met l’accent. Ce n’est pas à moi de la faire. Un exemple tout bête, on a joué début juillet, à 3 heures du Matin, dans le cadre de la grande veillée du théâtre de la Ville, Portrait de Ludmilla en Nina Simone. On ne pouvait imaginer qu’entre le moment où on l’a créée, il y a trois ans, et maintenant, la question des Black lives Matter, un mouvement mondial pour protester contre les actes violents contre toute une population, aurait une telle résonnance. A l’époque, l’accent était ailleurs. En ce qui concerne la pandémie que nous traversons, je trouve que la recherche du patient zéro est un très bon thème. De manière symbolique métaphorique, il pourrait apparaître dans des spectacles que je commence à imaginer. Un peu partout, tout repart, n’y a-t-il pas un risque d’embouteillage scénique ? David Lescot : Pas du tout. Je pense vraiment que la question qui se pose depuis l’annonce de la réouverture des théâtres, était comment faire pour repartir après cette période de coma, comment relancer les choses. Ce qui a lieu actuellement, les endroits où on accueille du public de manière restreinte, sont des ballons d’essai, des reprises d’activités expérimentales, qui vont permettre de voir comment les gens sont attachés à l’idée d’aller au théâtre, de ressortir, d’assister ensemble à une représentation. En fait, on essuie les plâtres en espérant des mois meilleurs. Et c’est vraiment cette notion-là qui m’intéressait. J’ai vraiment manqué de théâtre, de cette activité si particulière que l’on fabrique entre nous et que l’on montre ensuite au gens. C’est mon oxygène, ce qui me fait vibrer.
Dans le cadre de la veillée du Théâtre de la Ville, j’ai pu voir quelques spectacles. Quel bonheur retrouvé, d’être assis dans une salle et de communier avec d’autres. Dans le cadre de l’été solidaire du théâtre de la Ville et du festival Paris l’été, vous présentez deux spectacles plutôt jeunesse. Qu’est-ce qui vous a inspiré ? David Lescot : L’idée est partie d’une discussion avec Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du théâtre de la Ville, qui avait l’envie dans son mandat de développer l’offre théâtre pour le jeune public. J’ai tout de suite été intéressé, car je n’avais jamais fait ce genre de spectacle. L’attrait de l’inconnu m’a tout de suite stimulé. Auparavant, je m’étais intéressé à des œuvres pour ados, car je trouvais le répertoire pauvre. Mais je ne m’étais pas penché à l’époque sur des spectacles qui s’adresseraient à des plus jeunes. J’ai trop peur et sa suite J’ai trop d’amis, parle du passage en sixième et donc peuvent être vus dès l’âge de sept ans.
En parallèle, du travail de la fiction de la langue pour ces générations-là, j’avais depuis longtemps dans mes bagages l’idée de créer des personnages d’enfants. C’est un autre endroit que j’avais à cœur de découvrir, un nouvel horizon dramaturgique à explorer, une veine humoristique à creuser. C’est une dimension à laquelle je suis très attaché car c’est un lien fondamental avec le public de tout âge. Comment s’est fait l’invitation à Paris l’été, festival qui dans un premier temps a été annulé avant d’être de nouveau programmé dans une version très resserrée ? David Lescot : Au départ, nous ne devions pas participer à l’édition 2020 de Paris l’été. Puis, j’ai été contacté par Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, les directeurs du Monfort Théâtre et de cet événement culturel estival. Après la déception d’avoir dû annuler les festivités, ils avaient la volonté de faire quelque chose, de ne pas laisser la pandémie gagner. Ils ont donc ouvert leur horizon vers d’autres formes théâtrales, et notamment avec des spectacles pouvant s’adresser au jeune public. Et comme nous avions déjà joué cette pièce au Monfort, il y a quelques années, ils souhaitent la reprendre, pour une journée spéciale, le 2 août, au Lycée Jacques Decour.
Nous sommes assez proches artistiquement parlant, puis nous devons reprendre Une Femme se déplace la saison prochaine, dans le cadre du Hors les murs du théâtre de la Ville, dans leur lieu. Du coup, tout cela fait sens. En parlant de ce spectacle, votre Comédienne Ludmilla Dabo, vient d’être sacrée meilleure comédienne par le syndicat de la critique, qu’est-ce que cela vous fait ? David Lescot : Bien évidemment, je suis très heureux pour elle. C’est un prix emblématique qui pour ce spectacle particulier sonne parfaitement juste. Parce que quand tu écris une pièce, avec ce titre, pour une comédienne qui est de toutes les scènes et qui tient sur ses épaules toute la représentation, c’est une belle consécration qu’elle soit récompensée. Par ailleurs, quand on regarde le palmarès, cette année, il est très orienté vers les femmes, vers le féminin. C’est donc d’autant plus touchant que Ludmilla obtienne ce prix. Je suis très fier pour elle, pour l’actrice qu’elle est, pour la femme qu’elle est. Comment s’est fait votre rencontre ? David Lescot : On s’est rencontré à la Mousson d’été, il y a huit ans. On avait bien sympathisé. Et quand la Comédie de Caen m’a proposé de faire un portrait de Nina Simone, j’ai tout de suite pensé à elle, car notamment je savais qu’elle était une très bonne chanteuse. En travaillant étroitement, l’un avec l’autre, je me suis aperçu qu’elle était bien plus forte encore que ce que je pensais. Elle a des qualités rythmiques, une puissance de jeu, un torrent d’émotions qu’elle est capable de susciter et de contrôler, qui me touche particulièrement et m’impressionne. Alors qu’on répétait Nina Simone, j’étais en train d’écrire Une femme se déplace, sans savoir qui jouerait ce rôle. On était à Avignon en 2017, et c’est devenu une évidence. Entretien réalisé par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore J’ai trop peur de David Lescot
Paris l’été – Lycée Jacques Decour – 2 août 2020
Mise en scène de Véronique Felenbok
Scénographie de François Gautier-Lafaye
Lumières deRomain Thévenon
avec Théodora Marcadé, Lyn Thibault et Marion Verstraeten J’ai trop d’amis de David Lescot
Théâtre de la Ville – été solidaire
mise en scène de David Lescot assisté de Faustine Noguès
Avec en alternance Suzanne Aubert, Théodora Marcadé, Elise Marie, Camille Roy & Marion Verstraeten
Création lumières de Guillaume Roland
Costumes de Suzanne Aubert Portrait de David Lescot - Crédit photo © Pascal Victor

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 19, 2020 2:45 PM
|
Entretien entre Thierry Jallet et Marc Lainé publié le 16 juillet 2020 sur Wanderersite Les entrevues théâtrales de l'été: Marc Lainé, metteur en scène, nouveau directeur de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
"Nous trouverons les moyens de faire communauté. Pour que le réel tremble. Pour que le doute surgisse. Pour qu’on s’interroge. "
Thierry Jallet — 16 juillet 2020
Entretien réalisé le 10 juillet 2020
Pour ce nouvel entretien estival, nous avons pu dialoguer avec Marc Lainé, le nouveau directeur de la Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, c’est d’abord en tant que scénographe puis en participant à diverses mises en scène qu’il a approché le spectacle vivant. Ses collaborations lui ont permis de travailler aussi bien au théâtre qu’à l’opéra avec plusieurs autres artistes comme Marcial di Fonzo Bo, Richard Brunel, David Bobée ou encore Madeleine Louarn. Recherchant le croisement des formes artistiques les plus diverses, Marc Lainé crée maintenant ses propres spectacles depuis plus de dix ans, à la tête de sa compagnie « La Boutique Obscure »1. Et c’est, comme il le dit, avec une certaine continuité dans son itinéraire qu’il a souhaité diriger une structure comme le CDN à Valence où ses premiers spectacles ont d’ailleurs tourné par le passé en Comédie itinérante. Comme un cycle ouvrant instantanément sur un autre à la direction. En parallèle, poursuivant sa propre démarche de création – il prépare notamment Nosztalgia Express dont la création aura lieu en janvier 2021 ainsi qu’un triptyque qu’il nous présente et dont il nous réserve la primeur– au sein d’un ensemble artistique résolument pluridisciplinaire, il nous relate les premiers mois dans ses nouvelles fonctions, les exigences requises, les difficultés rencontrées ce printemps. Il exprime aussi son enthousiasme intact, sa confiance en ceux avec qui il s’engage à faire vivre pleinement la Comédie. Entretien.
THIERRY JALLET
Vous voici installé dans vos fonctions de directeur de la Comédie de Valence. Comment vivez-vous ces débuts ?
MARC LAINÉ
Si on fait abstraction de tout ce qu’il s’est passé ce printemps, je me sens infiniment chanceux d’être le locataire d’une institution comme le CDN, au milieu de sa formidable équipe permanente. Comme j’ai signé mes premières scénographies ainsi que ma première mise en scène à la Comédie, je connaissais déjà les membres de cette équipe. Et ce lien avec eux est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité être candidat à la direction de la Comédie de Valence. Ce sont des personnes très engagées et qui ont en commun un désir réel et constamment renouvelé pour accompagner les artistes, pour accompagner la création. Prendre la direction du CDN me rend vraiment très heureux car je me sens totalement en confiance. Comme chez moi en quelque sorte. Et ce, même si cette prise de fonction s’est instantanément complexifiée, avec la mise en œuvre des travaux absolument nécessaires que mes prédécesseurs avaient initiés avant mon arrivée, et qui concernent entre autres la grande salle. Il s’agit d’améliorer l’isolation thermique des locaux, indispensable pour l’équipe d’une part, et l’accessibilité indispensable pour toute personne à mobilité réduite venant à la Comédie, d’autre part. Le projet architectural est parfaitement conduit dans le service de l’institution, donc du public. Tout le monde devrait apprécier ces travaux conséquents. Sans doute, les spectateurs seront-ils notamment satisfaits des nouveaux fauteuils prévus pour la grande salle.
TJ
La période de confinement qui a débuté à la mi-mars a sans aucun doute été tout aussi difficile…
ML
Sans référence préalable mais formidablement accompagné par l’équipe très professionnelle de la Comédie ainsi que par Claire Roussarie, ma directrice adjointe, j’ai pu absorber ces chocs successifs en limitant leurs impacts. Par ailleurs, cette rude période a révélé une forme de solidarité manifeste entre la plupart des grandes institutions appartenant à l’écosystème du spectacle vivant. Nous étions tous soucieux des techniciens, des artistes et des compagnies mais aussi des structures n’ayant pas toutes les mêmes moyens de résister. Le dialogue a été constant et il y a eu tout de suite une volonté globale de s’en sortir ensemble. Comme tous nos collègues, nous avons pris la décision de nous placer immédiatement en soutien des équipes paralysées par la situation. En tant que directeur de compagnie, j’ai dénombré soixante-cinq dates qui ont été annulées. Et si les structures qui les accueillaient n’avaient pas développé ces réflexes de solidarité, ma compagnie aurait sans aucun doute connu des difficultés bien plus graves encore. En définitive, cette période a permis de prendre conscience de l’extraordinaire maillage des institutions culturelles françaises et d’une forme de responsabilité réciproque les unissant. Cette crise a par ailleurs aiguisé encore plus en moi la responsabilité vis-à-vis du public. À certains endroits, on sent combien le théâtre reste indispensable, combien il participe de l’élaboration d’une pensée commune. J’ai ressenti aussi une autre responsabilité vis-à-vis des équipes sidérées par ce qui nous arrivait à tous en mars. Tous étaient décontenancés d’être brutalement coupés de la création, coupés des artistes, coupés du partage de l’art avec les publics. C’est pourquoi j’ai absolument tenu à maintenir une activité de création, même avec des moyens réduits, même par une diffusion exclusive sur les réseaux sociaux. Une activité que l’équipe pourrait défendre et partager. En raison de cette crise, j’ai finalement appris mon métier de directeur à très vive allure.
TJ
Et être directeur dans ce contexte au cœur d’un territoire incluant la Drôme et l’Ardèche est de surcroît très particulier…
ML
Tout est effectivement très corrélé. Lors de ma candidature à la direction du CDN, j’ai exprimé une volonté claire et affichée de dialogue avec les autres institutions sur l’ensemble de ce territoire. Comme nous serons hors les murs lors de la saison prochaine en raison des travaux que j’évoquais, ce dialogue a donc été vite engagé. Et j’ai été immédiatement touché par la solidarité qui émanait de toutes ces équipes : accueillir le CDN était une évidence ! Comme nous sommes pleinement conscients de cette hospitalité, dès le début de l’année 2020, nous avons cherché à travailler avec nos partenaires dans plusieurs coréalisations fondées sur des choix communs d’artistes, de projets. Je tenais à ce que cet accueil ait du sens pour nous tous et ces collaborations m’ont vraiment impressionné. Au début de la crise sanitaire, nous avons maintenu cette communication régulière les uns avec les autres, tous placés en apnée, attendant fébrilement les décisions officielles. Et chacun d’entre nous nourrissait finalement la réflexion des autres, ce qui a favorisé l’émergence d’une pensée commune : nous nous demandions quel sens nous pourrions trouver à ce que nous traversions. Les échanges ont été nourris aussi car cette crise nous a tous ramené à la question du territoire où nous nous trouvons. À ce sujet, on m’a demandé plusieurs fois s’il ne fallait pas arrêter les grandes tournées pour se centrer sur des territoires plus réduits et dans des productions plus locales justement. Cette forme d’injonction me paraît tout à fait dangereuse : il convient de ne pas choisir et de faire les deux sans distinction, car le spectacle vivant se doit d’être diffusé partout, à l’échelle locale comme internationalement. Son extraordinaire pouvoir de fédération doit être préservé partout coûte que coûte.
TJ
Dans ce contexte porteur de tant d’incertitudes pour les mois à venir, la nouvelle saison a quand même été annoncée sur le nouveau site de la Comédie de Valence. Qu’est-ce qui la caractérise ?
ML
D’abord, comme nous n’avons pas la grande salle à disposition, nous accueillons des formes plus légères qui sont également susceptibles de faciliter l’adaptation aux éventuelles contraintes sanitaires en vigueur. Par exemple, on inaugurera la saison avec des spectacles en extérieur. De la même manière, nos deux premières productions sont en Comédie itinérante, par conséquent prévues pour un nombre réduit de spectateurs. Dans un sens, les contraintes liées aux travaux en facilitent certaines autres liées à l’épidémie de Covid. À propos de cette saison, je dois dire que j’en suis assez fier pour des raisons artistiques mais également pour des raisons politiques. Elle témoigne pour une bonne part d’une volonté d’éclectisme qui renvoie au projet pour la Comédie que j’ai voulu transdisciplinaire, celui d’un théâtre qui se réinventerait par les croisements entre différentes disciplines. Et nombre d’artistes y portent haut cette volonté. De la même manière, cet éclectisme se perçoit dans le positionnement des artistes qui questionnent le monde avec radicalité parfois – et il est important pour moi que le théâtre soit un lieu de confrontation des idées – ou bien des artistes qui ont une approche plus esthétique afin d’atteindre directement la sensibilité artistique de chacun. En somme, j’ai souhaité une première saison qui permette aux spectateurs de la Comédie de découvrir la création théâtrale et la création chorégraphique contemporaines, françaises et le plus possible internationales dans toute leur passionnante diversité, malgré les limitations imposées par les conditions sanitaires que nous connaissons actuellement. Je tiens tout de même à signaler que je m’inscris totalement dans la lignée de mes prédécesseurs en cherchant à offrir au public du territoire de la Drôme et de l’Ardèche le panorama le plus large possible. À mon niveau et d’un point de vue plus strictement politique – c’est très important pour moi, je le redis – j’ai tenu à affirmer la parité autant dans l’ensemble artistique que dans cette première programmation. Si on ne la décide pas, je crois fermement qu’elle n’adviendra pas du tout. D’où cette attention particulière qui pour moi, va bien au-delà du politiquement correct et d’un simple procédé de communication. Ensuite, j’ai tenu à y défendre la représentation de la diversité tout aussi essentielle, à la fois dans l’origine des artistes de l’ensemble mais aussi au sein des spectacles qui seront proposés. Le projet que je porte développe les croisements, fait dialoguer les disciplines entre elles. Et les cultures entre elles de la même façon. Tout cela est donc cohérent.
TJ
Vous y revenez souvent, l’ensemble artistique et pluridisciplinaire autour de vous est essentiel…
ML
Absolument essentiel ! En tant que scénographe comme en tant que metteur en scène, j’ai grandi dans les CDN. J’ai fait partie de la première vague d’artistes associés, voulue par le ministère, pour que ces institutions deviennent d’authentiques outils en partage. Je sais à quel point cela a été important dans mon désir de prendre la tête d’un de ces lieux puisque j’y ai appris à faire grandir mon travail artistique grâce à ces collaborations passées. En ce sens, il était fondamental pour moi de reconduire pour d’autres cette expérience qui m’a tellement apporté. Je tiens à ce que le CDN soit un véritable lieu de création en partage pour aboutir in fine à des spectacles inédits. La nouveauté consiste à ce que de nombreuses disciplines, de divers horizons esthétiques soient présentes dans l’ensemble. Voici la marque signifiante et revendiquée que je tiens à imprimer par ma direction. Cela permettra de nourrir la pensée comme la recherche autour des liens multiples qui se tisseront.
TJ
Deux de vos spectacles déjà créés seront joués à nouveau pendant la saison auxquels s’ajoute la répétition publique de Nosztaglia Express, votre prochaine création. Vous poursuivez votre propre cheminement artistique à Valence ?
ML
Une chose est ici à prendre en compte : la programmation de mes spectacles dans la prochaine saison découle essentiellement de circonstances exceptionnelles. La Chambre désaccordée d’abord, est un spectacle qui a déjà été programmé au cours de la saison 2019-2020 par Richard Brunel et Christophe Floderer. Nous avons finalement dû l’annuler en raison des mesures sanitaires de confinement lors de ce printemps. Toutefois, nous l’avons reprogrammé afin que cette rencontre avec le public ait bien lieu en fin de compte. Pour Nosztalgia Express maintenant, il est nécessaire de disposer du grand plateau. Or, quand les travaux seront achevés, les comédiens ne seront plus disponibles pour sa création : c’est la raison pour laquelle nous le créerons ailleurs – au CDN de Normandie-Rouen où j’ai été artiste associé pendant longtemps. En raison de cette contrainte, j’ai tenu à ce que le public de la Comédie accède tout de même à ma démarche par le projet qui en était finalement le plus emblématique : voilà pourquoi Vanishing Point est également entré dans la programmation. Il faut considérer combien ce spectacle est important dans mon parcours, tout à fait représentatif de mon approche artistique transdisciplinaire puisque la vidéo et la musique y croisent pleinement le théâtre. Pour revenir à Nosztalgia Express, je précise qu’après sa création, il va connaître une belle tournée en France, notamment au Théâtre de la Ville, à Paris. Et nous le présenterons ensuite à Valence au cours de la saison 2021-2022. Je précise maintenant et il me semble que c’est la première fois que j’en parle, que dans le cadre de ma candidature j’avais exprimé la volonté de créer un triptyque sur la durée de mon premier mandat. Il s’agira de fictions qui s’inscriront sur le territoire valentinois, en collaboration avec son public. Ma première création pour la saison 2021-2022 en tant que directeur de la Comédie de Valence sera un O.V.N.I. (Objet Valentinois Non-Identifié) et s’intitulera Sous nos yeux. Ce premier volet tout à fait caractéristique du nouveau projet, ne sera pas un spectacle mais un roman graphique qui sera écrit avec les habitants de Valence et dessiné par Stephan Zimmerli. En quelques mots, l’histoire sera celle de l’enquête menée par un journaliste au sujet de la mystérieuse disparition d’un homme – ayant les traits de Bertrand Belin, et c’est important à savoir pour la suite du triptyque – racontée par les derniers témoins à l’avoir vu dans Valence. Nous irons donc dans la ville à la rencontre des gens qui auront à choisir un lieu ayant une puissance dramatique certaine pour eux, et ce lieu sera précisément celui de leur dernière rencontre avec le disparu. Stephan dessinera à la fois les participants valentinois, témoins interrogés par le journaliste, et le lieu décrit. Avant la publication probablement aux éditions Actes Sud, nous souhaiterions exposer les dessins de Stephan dans la ville, sur le lieu même pour lequel chaque participant a opté. Tout cela évoque un peu la démarche d’Ernest Pignon-Ernest. Étant donné que le plateau n’est pour le moment pas accessible, mon idée consiste à déployer mes histoires dans la ville même, qui se trouvera en quelque sorte tatouée par ces fictions. Le titre du deuxième volet pour la saison suivante, sera En travers de sa gorge et racontera comment la femme du disparu est hantée par son fantôme. La création se fera au plateau cette fois tandis que le troisième volet sera une installation purement plasticienne.
TJ
Voilà qui est très enthousiasmant pour les saisons à venir. À ce propos, on parle beaucoup du théâtre d’après cette sombre période traversée depuis plusieurs semaines. Quel peut-il être selon vous ?
ML
Il est absolument crucial de se souvenir que le théâtre d’avant était merveilleux et qu’à cause de circonstances exceptionnelles, il ne faut pas tout jeter. Ce serait un réflexe dommageable. Certes, le Covid constitue une contrainte à laquelle nous devons tous nous adapter mais ce qui fait l’essence du théâtre ne doit surtout pas changer. On doit continuer à créer des espaces de réunion afin de rêver et de réfléchir ensemble. Cela doit persister quoi qu’il advienne ! Nous trouverons les moyens de faire communauté. Pour que le réel tremble. Pour que le doute surgisse. Pour qu’on s’interroge. Cela ne changera pas fondamentalement quelle que soit l’évolution de la situation. Depuis l’antiquité, le théâtre a toujours la même fonction de raconter des histoires pour qu’elles apparaissent dans le réel. C’est très certainement un besoin archaïque de l’être humain et rien ne pourra l’empêcher, selon moi.
Propos recueillis par Thierry Jallet pour Wanderersite
La Chambre désaccordée, création à la Scène nationale 61 en octobre 2018, en tournée à la Comédie de Valence du 11 au 13 mars 2021 (Théâtre de la Ville) et à Bernay le 19 mars 2021
Vanishing point, création au CDDB-Théâtre de Lorient en 2015, à la Comédie de Valence du 27 au 30 avril 2021
Nosztalgia Express, création au CDN Normandie-Rouen en janvier 2021, répétition publique au Théâtre de la Ville, à Valence, le 26 novembre 2020 ; en tournée en France notamment au Théâtre de la Ville, à Paris en avril 2021
Marc Lainé © Pascale Cholette

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 17, 2020 9:39 AM
|
par ARMELLE HÉLIOT dans son blog, le 14 juillet 2020
Depuis hier, 13 juillet, les directeurs de l’institution parisienne, proposent un choix de spectacles que l’on aurait dû voir à Avignon. Pari réussi ! Le public est là, dans une atmosphère heureuse. C’est ParisOFFestival.
Il faisait beau, très beau. Chaleur et vent léger. Dans Paris, un peu vidé de ses habitants par les vacances et le week-end prolongé du 14 juillet, il y avait du monde du côté de l’avenue Marc Sangnier, du côté de la Porte de Vanves.
Les amateurs de théâtre connaissent le coin ! C’est celui du Théâtre 14. Mathieu Touzé et Edouard Chapot ont succédé à l’entreprenant Emmanuel Dechartre, qui a fait vivre ce lieu près de trente ans durant.
On change de génération et d’inspiration. Les deux jeunes gens ont pris les choses en mains portés par la confiance des tutelles. Des travaux conséquents ont été menés. La salle possède désormais une pente et l’allée centrale a disparu. Le plateau n’a pas changé.
Pour le moment, on pénètre dans les lieux par le jardin, à l’arrière. A la belle saison, c’est plaisant. On verra en hiver, car le métro est assez loin…
Les deux directeurs ont déjà organisé quelques séances destinées au jeune public, il y a quelques semaines, après le déconfinement. Des gestes ponctuels mais fertiles.
Ces temps-ci, c’est donc un véritable festival qui nous est proposé. Et disons-le d’emblée, le public était au rendez-vous, en particulier, évidemment, le soir car les spectateurs travaillent pour la plupart et n’ont pas tous la possibilité de consacrer des journées entières au théâtre.
Avec beaucoup d’intelligence, les directeurs et leur équipe, ont décidé d’un autre lieu, le gymnase Auguste-Renoir. A une certaine distance, mais il permet de franchir le boulevard des Maréchaux et de faire signe aux habitants des immeubles qui ne sauraient pas qu’un théâtre palpite non loin d’eux. Et on trouve facilement le chemin…Entre les deux lieux, une rue rendue piétonne, la rue Prévost-Paradol, est dévolue à un espace de repos et de pause, avec chaises longues élégantes et confortables, restauration légère avec même, venue tout exprès du Vaucluse, une cargaison de « Pac » ou mieux nommé « Pac à l’eau », le sirop de citron du sud, boisson des festivaliers d’Avignon !
Il s’agit en effet de donner leur chance à certains spectacles d’Avignon, que l’on aurait dû applaudir dans le off. De bonnes adresses telles le Train bleu, Artéphile, l’Oulle, le Théâtre Transversal, le Théâtre des Brunes (on connaît moins bien ces deux derniers).
Quinze spectacles programmés du 13 au 18 juillet, selon un calendrier qui permet des parcours divers. Pour monter ce festival, les directeurs ont convaincu d’autres soutiens : l’Adami, l’Onda, la Ville de Paris, la SACD, notamment.
Les artistes, jeunes eux aussi, peuvent donc présenter leurs spectacles dans d’excellentes conditions. Mais évidemment avec de raisonnables distances dans les salles et des masques pour la plupart des spectateurs.
Dans la salle « historique » nous avons découvert Une goutte d’eau dans un nuage d’Eloïse Mercier. Un moment assez fragile, mais conçu comme tel par la jeune auteure et interprète soutenue par Charles Berling, directeur du Théâtre Liberté à Toulon. Elle s’est inspirée d’un séjour qu’elle a fait au Vietnam. Elle s’inscrit dans la lumière de Marguerite Duras, tresse des liens de l’histoire qu’elle nous raconte jusqu’à L’Amant, notamment.
Un travail soigné sur le son, le bruit, les voix, un enveloppement intéressant. Vincent Bérenger, conception avec Eloïse Mercier et Charlie Maurin, arrangements et mixage, sont précis et éloquents dans ce travail.
Mais la représentation que nous avons vue manquait un peu de densité. Le texte mériterait d’être travaillé encore. Plus tendu, il serait plus fort. Eloïse Mercier se met elle-même en scène. Elle est précautionneuse, protégée par son micro sur pied ou manipulant des objets. Ce travail minimaliste est dangereux : il alourdit le spectacle au lieu de l’aérer.
Défaut de jeunesse. Il est toujours plaisant de découvrir des jeunes qui se lancent sur scène et font du théâtre leur pays…
D’un tout autre genre est le très déjanté Ultra-Girl contre Schopenhauer. L’auteur et metteur en scène, Cédric Rouillat, est photographe. Ce spectacle est le premier qu’il ait signé, mais ce moment de folie enjouée a déjà été présenté il y a quelque temps dans la programmation du Théâtre des Célestins de Lyon, mais hors murs du théâtre, au Point du Jour.
On est au début des années 80 dans un studio décoré à la mode des années 70, avec un papier peint assez kitsch. Une scénographie de Caroline Oriot et Guillaume Ponroy. Trois protagonistes. Edwige, la très belle Sahra Daugreilh, traductrice qui travaille pour un éditeur de bandes dessinées et qui sa vie durant a été obsédée par les héroïnes telle celle qui va surgir et bousculer son calme présent. Sanglée dans une combinaison moulante qui évoque le drapeau américain, cuissardes rouges, Laure Giappiconi, longs chevaux bruns et lisses de parfaite créature de fiction, est donc Ultra-Girl ! Entre les deux fausses jumelles, David Bescond interprète avec finesse tous les rôles masculins : un voisin, un prof, un plombier, etc.
Un peu de flottement dans l’écriture rend le spectacle parfois plus pesant qu’il n’est en réalité. Il y a beaucoup de références et il faut très bien connaître ses classiques hollywoodiens et son jazz pour comprendre toutes les allusions. Mais cela fonctionne par-delà l’exacte signification car le jeu est survolté et les « personnages » rendus très attachants par les interprètes. Les filles sont superbes et fines et le garçon très subtil ! Plaisir du jeu tenu par un trio irrésistible ! Cela chante, cela danse, on s’envole sur les morceaux en playback, on incarne de toutes ses fibres, voix bien placées et humour ! Bref, du théâtre.
« Une goutte d’eau dans un nuage » sera repris à Châteauvallon les 6 et7 octobre 2020, puis dans le cadre de « l’itinérance » de cette scène nationale également dirigée par Charles Berling. Au centre culturel de Porrentruy, en Suisse, les 3 et 4 décembre et le 20 avril 2021 au Théâtre du Rocher, à La Garde. Autres dates certainement à venir. Durée : 1h10.
« Ultra-Girl contre Schopenhauer » : on vous recommande la bande-annonce très sophistiquée de cet objet théâtral bousculé ! Durée : 1h15.
Renseignements sur le festival « Paris OFFestival » au 01 45 45 49 77.
Légende photo : « Ultra-Girl contre Schopenhauer », des héroïnes très différentes, mais bien accordées….Crédit Julien Benhamou. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 2020 6:12 PM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 12, 2020 5:57 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans le Monde 11 juillet 2020 En Saône-et-Loire, la metteuse en scène Léna Bréban a conçu un spectacle tendre et spontané pour aider à vaincre l’isolement des personnes âgées. Et soudain, la vie s’adoucit. Lundi 6 juillet, à l’Ehpad Charles-Borgeot, dans le village de Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), les pensionnaires sont de sortie. Oh, pas loin, juste sur le balcon de leur chambre ou dans le jardin au pied de leur maison de retraite. Mais les voir dehors, pour assister à un spectacle imaginé pour eux, éloigne, le temps d’une parenthèse joyeuse, l’isolement qu’ils ont vécu pendant le confinement. Du rideau rouge monté sur la pelouse surgissent six artistes entonnant un air de Joe Dassin : « Salut, c’est encore moi ! Salut, comment tu vas ? Le temps m’a paru très long ». Tour à tour chanteur, danseuse, musicien, comédienne, clown, ils embarquent pendant une petite heure les pensionnaires et les soignants dans un joli tourbillon musical et théâtral. Ce Cabaret sous les balcons, qui s’amuse des gestes barrières tout en les respectant scrupuleusement, est à la fois simple et allègre, tendre et spontané. « Ce moment permet au public et aux artistes de se sentir mutuellement vivants », résume Léna Bréban, initiatrice et metteuse en scène du spectacle. Si le Covid-19 n’avait pas fermé les théâtres, elle devait créer à Paris une adaptation de Comme il vous plaira, de Shakespeare : « Mes projets se sont annulés ou reportés, alors je me suis dit qu’il fallait inverser la manière de travailler, jouer dehors, et faire quelque chose pour ces personnes âgées privées de leurs proches », détaille Léna Bréban. Artiste associée de l’Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, elle contacte alors le directeur du théâtre, Nicolas Royer. « En moins de quarante-huit heures nous avons décidé de produire cette création et avons très vite obtenu le soutien de la communauté d’agglomération du Grand Chalon », se souvient le responsable de l’Espace des arts. « De la contrainte de ne pas se toucher les artistes ont fait une force », constate-t-il. Des sourires naissent Pendant que Léna Bréban constitue son équipe (Cléo Sénia, Antonin Maurel, Adrien Urso, Alexandre Zambeaux, Léa Lopez) et débute les répétitions en visioconférence, le théâtre contacte les Ehpad de Saône-et-Loire. « Ils étaient ravis du projet, cela les changeait de leur réunion Covid ! », raconte Nicolas Royer. La première a lieu le 20 mai, à la résidence pour personnes âgées de Givry. Puis, les dates ont commencé à s’enchaîner, et le département a commandé vingt-cinq représentations qui s’échelonneront tout au long l’été. « C’est la persévérance des machines à coudre », aime à dire le directeur de la scène nationale. Une formule qui résume bien la philosophie de « théâtre citoyen » qui a guidé Nicolas Royer dès les premiers jours de la crise sanitaire. « Nous n’avons pas fait appel au chômage partiel. On s’est tout de suite mis à fabriquer des masques avec les tissus qu’on avait, et on a été les premiers à en fournir à la mairie. On voulait être en mouvement, faire, et ne pas tout attendre du ministère, défend le directeur. Puis cela a été réjouissant de se remettre aussi vite au travail en produisant cette création. » Nicolas Royer, directeur de l’Espace des arts, Scène nationale de Châlon-sur-Saône : « On voulait être en mouvement, faire, et ne pas tout attendre du ministère » Ce cabaret burlesque et chanté, qui fait notamment revivre le mélancolique Petit bal perdu de Bourvil, l’érotique C’est extra de Léo Ferré, l’entraînant Chante la vie chante de Michel Fugain, ravive des souvenirs dans les yeux des spectateurs. Certains corps, dans les chaises roulantes, se balancent doucement et des mains se lèvent pour applaudir les performances dont une version a cappella de Over The Rainbow. Des sourires naissent quand le clown éternue des confettis ou lorsque Roméo s’adresse à une Juliette dans le public. « On tente de faire rêver, de redonner le sourire, on se sent utile », témoigne Léna Bréban, qui, à la rentrée, répétera une adaptation de Sans famille pour la Comédie-Française. « Ne jamais avoir entendu le mot “culture”, si essentiel, pendant le confinement, c’était violent », ajoute-t-elle. Pour Nathalie Bernadat, directrice de l’Ehpad, « après trois mois sans intervenant extérieur, ce genre de rendez-vous, qui s’inscrit dans un retour à la normale, est très important pour nos résidents ». « Partout où un tréteau peut être posé, il peut y avoir théâtre », rappelle Nicolas Royer. Cet été, L’Espace des arts restera ouvert pour des ateliers de création réservés aux jeunes. « N’ayons pas peur, faisons », insiste-t-il. Que le public ait 10 ans ou 100 ans. Sandrine Blanchard (Pierre-de-Bresse - Saône-et-Loire, envoyée spéciale) Légende photo : « Cabaret sous les balcons », de Léna Bréban, dans un Ehpad de Chalon-sur-Saône, le 26 mai. Julien PIFFAUT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 11, 2020 12:04 PM
|
Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 8 juillet 2020
L’auteur et metteur en scène a réouvert hier avec émotion le théâtre de la Colline devant un public qui lui a très chaleureusement manifesté son soutien. Créée en 1997 au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, dans le cadre du Festival des Théâtres des Amériques, l’oeuvre marqua ses premiers spectateurs, malgré -et peut-être grâce à- une durée peu banale pour l’époque (presque cinq heures). Explosait à la scène un talent littéraire évident et l’œuvre était portée par une équipe de jeunes acteurs qui osait tout. Mention spéciale à Steve Laplante dont l’interprétation restera dans les mémoires.
Wajdi Mouawad reprit Littoral à diverses périodes de sa vie : au Festival d’Avignon puis à celui des Francophonies en 1999. Ensuite à Rome, Bruxelles, Beyrouth, Chambéry… Dix ans plus tard, artiste associé au Festival d’Avignon, il fut invité à y présenter l’ensemble des quatre pièces du Sang des promesses dont Littoral constituait le texte inaugural : un fleuve émotionnel à qui il fit subir une cure d’amaigrissement. Aujourd’hui, vingt-trois ans après sa création, le directeur de La Colline propose une nouvelle approche de son histoire et oriente le miroir vers le monde féminin. Wilfrid, interrompu au moment d’un coït mémorable par l’annonce de la mort brutale de son père, devient Nour, un soir sur deux. Une belle idée qui permet de rassembler deux distributions en alternance et de regrouper la plupart des jeunes acteurs de Notre innocence à sa création. Ce qui redonne à l’effet de génération 97, le souffle de la jeunesse d’aujourd’hui.
Avec la même économie : trois chaises, deux seaux et un balai, il retrouve l’état de nécessité qui a baigné la création de cette pièce, avec à la fois l’urgence de prendre la parole et une pauvreté totale des moyens. Ironiquement il fait descendre des cintres, en ouverture, une centaine d’accessoires et de costumes disponibles, sur le très grand plateau de La Colline, pour retourner ensuite à ces modestes accessoires et à un trait sur le sol aux dimensions initiales de la scène de Montréal. Retour aux sources affirmé…
Le voyage de Wilfrid/Nour pour aller enterrer son Père, est une sorte d’Odyssée du temps présent, depuis le monde occidental vers le monde oriental. Il accostera aux rivages dévastés, familiers de nos écrans : guerre civile, villages détruits, assassinats sauvages, disparition de familles entières. « Dans les villages, les morts ont pris toute la place » et tous les jeunes sont orphelins. Le père mort de Wilfrid/Nour devient le père de chacun. A mesure des rencontres, les patronymes de ceux qui ont été vaincus, sont criés à la face du ciel. Partis ou morts ? L’appel de ces noms, simplement énoncés, devient le monument aux morts virtuel d’une génération perdue. Et nous sommes glacés devant ces presque encore enfants qui cherchent à rester vivants avec tout ce qui est mort en eux. Wajdi Mouawad ne donne aucune précision géographique sur ces univers traversés qui sont autant ceux de la mémoire que du rêve. Mais comment garder la puissance de sa mémoire et de ses rêves d’il y a vingt ans ? Il réussit à mettre à distance toute nostalgie et fait confiance à cette bande de jeunes gens auxquels il a remis sa jeunesse.
Des décalages se font pourtant sentir, le temps et l’espace diffèrent… Wajdi Mouawad lui-même a opéré sa propre translation géographique : il n’est plus au Québec mais en France. Et les rivages où accoste Wilfrid/Nour sont plus connus du public français, que de celui de Montréal, une ville qui n’a pas connu la guerre et qui fut peu concernée par l’actualité du Moyen-Orient.
Cette œuvre, reçue au Québec comme la recherche identitaire du personnage central assimilé à l’auteur, devient à Paris une forme de confrontation politique avec une partie du monde en décomposition. La violence n’est plus tant celle du malheur familial de Wilfrid/Nour (mère morte à la naissance, père enfui) que celle d’une innocence tranquille, brutalement sommée de se confronter aux effets de la guerre.
Ces glissements sensibles n’entament pas l’intérêt que l’on porte au spectacle et il y a la verdeur audacieuse des moyens employés et la fantaisie débridée des acteurs. Wilfrid est encore un peu dans les rêves de l’enfance et se croit accompagné d’un « Chevalier » protecteur, grandiloquent et bagarreur (une « Chevaleresse » pour Nour) tout comme il s’imagine héros d’un film en train de se tourner. Sans souci des conventions habituelles du théâtre, Wajdi Mouawad use des champ et contre-champ du cinéma. Citation des temps héroïques de son théâtre, retour aux fondamentaux du théâtre de tréteaux : l’imagination est au pouvoir. Reste la question de l’exil qui traverse encore et encore la vie et les créations de Wajdi Mouawad. Ici, au tout premier plan, celui volontaire de Wilfrid/Nour vers des racines familiales pour enterrer enfin le corps du Père. Au bout du voyage, la découverte que la guerre pouvait être aussi parfois, le temps de l’enfance et de l’amour.
Et alors la figure du Père, toujours présent et loquace, même mort, prend toute sa place poétique : il ne veut pas être emmené par les flots, il ne veut pas disparaître. Il aime encore trop les femmes, la vie, le hasard et les souvenirs de son enfance. Il faudra bien pourtant que cette jeunesse se décide à le faire couler au fond de la mer pour espérer construire autre chose…
Wajdi Mouawad sera-t-il un jour le Père qui accepte enfin de disparaître ? A la cinquantaine, il est au milieu du gué et son théâtre porte, tout en délicatesse, la marque du temps qui passe.
Marie-Agnès Sevestre
Jusqu’au 18 juillet, Théâtre National de la Colline, 15 rue Malte-Brun Paris (XX ème)
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 22, 2020 5:09 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 21 juillet 2020
Auprès de mon arbre (2/6). L’unique élément de décor d’« En attendant Godot » est au cœur des questionnements de l’auteur sur l’existence. « Route à la campagne, avec arbre. Soir. » En 1952, Samuel Beckett révolutionne le théâtre, avec une pièce qui met en scène deux clampins perdus au milieu de nulle part. Deux clowns métaphysiques lâchés dans le vide insondable du temps et de l’espace, seuls, absolument – ou presque. Seuls avec un arbre. Et deux autres zozos qui ne feront que passer. Au premier acte, l’arbre est mort. Au deuxième, « l’arbre porte quelques feuilles », indique la didascalie de l’auteur. Une seule nuit, pourtant, est supposément passée entre ces premier et deuxième actes. Dans le grand art minimaliste de Beckett, homme d’une culture abyssale, l’arbre d’En attendant Godot occupe une place considérable. Un seul élément de décor, un seul symbole, mais plongeant ses racines au plus profond de mythes et de représentations multiples et millénaires. L’arbre devant lequel Vladimir et Estragon attendent Godot, avant d’envisager de s’y pendre, est au cœur de l’interrogation de Beckett sur l’existence et le néant, la damnation et le salut de l’homme. Beckett lui-même, d’ailleurs, aimait les arbres. Il en avait planté dans le jardin de sa maison d’Ussy-sur-Marne (Seine-et-Marne), où il se battait contre les taupes qui ravageaient son terrain. « Deux négundos, un prunus, deux tilleuls et un cèdre qui commencera à ressembler à quelque chose cinquante ans après ma mort, s’il ne me précède pas dans l’au-delà », racontait-il. « Pauvres arbres, ils vengeront le saule de Godot », ajoutait Beckett. Symbole d’immortalité en orient Pourtant, l’inspiration de Beckett, pour cette pièce qu’il écrit entre la fin de 1948 et le début de 1949, est d’abord artistique, comme toujours chez lui. L’idée visuelle, apparemment, sort de deux tableaux du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich, admirés par Beckett à Berlin et à Dresde : Deux hommes contemplant la lune (1818) et Un homme et une femme contemplant la lune (1824). Les deux œuvres montrent deux humains seuls face à l’astre, dans l’unique compagnie d’un arbre qui ressemble à un saule pleureur. Sur le premier, l’arbre apparaît comme mort, ou dépouillé par l’hiver. Sur le second, il est bien vivant, couvert de feuilles. En Russie, on a coutume de dire que « qui plante un saule prépare la bêche pour sa tombe » Un saule, donc. Pleureur, a priori, mais dans En attendant Godot il n’est même plus en état de pleurer. Tellement étique et décharné qu’on ne peut pas s’y pendre, ou même se cacher derrière lui. « Décidément cet arbre ne nous aura servi à rien », remarquera Vladimir, s’adressant à son compère Estragon. Un saule, et donc un arbre tout sauf anodin, chargé de significations religieuses et mythologiques, toutes liées à la mort. En Orient, il est symbole d’immortalité, sans doute parce qu’il est particulièrement vivace – un rameau planté en terre n’a besoin que de peu d’humidité pour revenir à la vie. Au Tibet, il joue ainsi clairement le rôle d’Arbre de vie. Chez les Indiens d’Amérique, c’est un arbre sacré, symbole du renouveau cyclique. « Cap au pire » En Europe en revanche, il incarne la mort, vraisemblablement en raison de sa morphologie, qui appelle des sentiments de tristesse. En Russie, on a coutume de dire que « qui plante un saule prépare la bêche pour sa tombe ». En Allemagne, comme nous l’apprennent les contes de Grimm, les vieilles légendes disent que les sorcières habitent dans la cime des saules, et qu’il faut donc tailler des flûtes en bois de saule pour chasser le diable. L’Irlandais Beckett, né dans une famille protestante, nourri par la Bible, la philologie, la poésie, la philosophie, passionné par les langues, n’ignore rien de ces significations. Quand il écrit sa pièce, « le monde est encore sous le choc des terribles révélations sur les camps et des scènes d’horreur filmées par les libérateurs de Belsen, de Dachau, d’Auschwitz », écrit James Knowlson dans sa remarquable biographie de Beckett (Actes Sud, 2007). Un des amis proches de l’écrivain, Alfred Péron, est un survivant de Mauthausen. L’arbre de Godot est donc bien au centre de la dialectique très fine tressée par Beckett. L’humanité sera-t-elle sauvée ou damnée, après une catastrophe qui a nié ses valeurs les plus fondamentales ? Est-elle morte avec les camps ? Comment peut-elle revivre après avoir frôlé le néant à ce point ? Beckett met « cap au pire », pour reprendre le titre d’un autre de ses textes. Et pour mettre à l’épreuve cette humanité, il y a l’arbre et ses quelques malheureuses feuilles. « Intarissables » Un des plus beaux passages de la pièce l’atteste. C’est au début du deuxième acte, Vladimir et Estragon constatent que, s’ils sont « intarissables », « c’est pour ne pas penser », « c’est pour ne pas entendre ». Ne pas entendre quoi ? « Toutes les voix mortes ». « Ça fait un bruit d’ailes. – De feuilles. – De sable. – De feuilles. (Silence.) – Elles parlent toutes en même temps. – Chacune à part soi. (Silence.) – Plutôt elles chuchotent. – Elles murmurent. – Elles bruissent. – Elles murmurent. (…) – Ça fait comme un bruit de plumes. – De feuilles. – De cendres. – De feuilles. » Ainsi se mêlent le bruissement des feuilles et celui des voix mortes, avec cet arbre qui a subi bien des avatars au fil des mises en scène de la pièce, comme le rappelle Nathalie Léger dans un précieux petit livre, Les Vies silencieuses de Samuel Beckett (Allia, 206). « L’arbre a été tour à tour un réverbère, un poteau télégraphique, un panneau de signalisation, un transformateur électrique, un portemanteau, une plante verte, un simple piquet, un épouvantail, une croix, encore une croix, il a été fait en métal, en fibre de verre, en plâtre, en vrai bois ramassé dans la forêt, en chêne menuisé, en fer forgé, etc. » « Arbre quand même », conclut-elle. De nos jours, dans une interprétation écologique et même survivaliste, on pourrait se dire que Beckett laisse entendre que le règne végétal survivra à celui de l’humanité « Seul l’arbre vit », constate Vladimir en le regardant, à la fin de la pièce. A ce stade d’En attendant Godot, l’arbre est bien la seule chose qui semble porter une – fragile – renaissance. De nos jours, dans une interprétation écologique et même survivaliste, on pourrait se dire que Beckett laisse entendre que le règne végétal survivra à celui de l’humanité. Chaque époque apporte ses représentations. Mais pourtant ils sont bien vivants, ces deux clodos célestes perdus entre l’horizontalité de la route sans fin et la verticalité de l’arbre et du ciel. Ils paraissent même en pleine forme, lorsque se clôt cette pièce inépuisable. « Alors on y va ? », demande Vladimir. « Allons-y », lui répond Estragon. Au paradis ou en enfer, dans le monde des vivants ou dans celui des morts, telle est la question que pose un auteur qui s’est demandé si l’humanité valait l’arbre pour se pendre. Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 8:32 PM
|
Entretiens avec Alain Cuny par Fernande Schulmann - 1976 sur le site de France Culture 3/5. Dans ce troisième entretien, le comédien évoque ses rapports avec les psychanalystes René Laforgue et Françoise Dolto, son entrée et ses débuts au théâtre chez Charles Dullin. (1ère diffusion : 07/01/1976), Ecouter l'émission (28 mn)
Si Alain Cuny a été l'un des considérables comédiens de son siècle, il aurait pu suivre une toute autre voie, comme nous allons l'entendre dans le troisième des cinq entretiens qu'il accordait en 1975 à Fernande Schulmann. Encouragé par René Laforgue, l'un des pionniers de son introduction en France, Alain Cuny aurait pu notamment exercer la psychanalyse. * Il évoquait d'ailleurs dans cette émission son amitié de toute une vie avec Françoise Dolto.
Mais pour le plus grand bénéfice du théâtre, et du cinéma, ce fut bien comédien qu'il devint. Par hasard, si l'on peut dire, puisque le hasard avait le visage d'une jeune fille dans les pas de laquelle, comme va magnifiquement le raconter Alain Cuny, il débarqua un jour dans le cours de Dullin, dont le premier coup d'œil mesura sans hésiter la valeur de la pépite tombée du ciel sur son plateau. Et alors que j’allais la quitter, c'était au théâtre de l'Atelier, Dullin est entré. Et Dullin entrant, un silence n'est-ce pas s'est établi, personne n'a plus bougé, et moi-même je n'ai pas pu me lever et m’en aller. Si bien que Dullin a cru que j'étais un nouveau. Il m'a demandé si j'avais déjà travaillé, je lui ai dit non. Alors il m’a conseillé de travailler un passage d'une pièce élisabéthaine de Ford qui est 'Dommage qu’elle soit une Putain'. (…) Je n'avais aucune idée de ce que c'était que de faire du théâtre, je ne savais pas ce que ça signifiait." Pour conclure cet entretien, Alain Cuny disait sa passion pour l'alexandrin : Un beau vers dit dans l’intimité, dans l’intuition, dans le discernement de l’esprit de l’auteur, quand on arrive à cette perception, on peut presque suivre l’exercice déchirant nécessaire à la réalisation, à la naissance d’un beau vers. Et c’est tellement poignant qu’il suffit de l’avoir compris pour devenir poignant à notre tour. Par Fernande Schulmann - Avec Alain Cuny Entretiens avec Alain Cuny 3/5 (1ère diffusion : 07/01/1976) Indexation web : Sandrine England, Documentation sonore de Radio France Archive Ina-Radio France

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 4:20 PM
|
Par Catherine Robert dans La Terrasse - 21 juillet 2020 Yann Frisch reprend le spectacle Baltass, grâce auquel il est devenu champion de France et d’Europe de magie en 2011, puis du Monde en 2012. Avec presque rien sinon le charisme stupéfiant de ceux qui parviennent à tromper les foules ravies d’être crédules, Yann Frisch transforme la magie en art poétique, fissure la réalité et se plaît à transformer les vessies en lanternes… Une simple tasse, une balle et un broc suffisent au magicien pour plonger le public « dans un univers kafkaïen, où la magie, la manipulation d’objet et le jeu burlesque sont au service d’une écriture millimétrée ». Avis aux esprits forts : inutile de chercher le truc derrière la poésie ! Le travail artistique commence avec l’oubli de la maîtrise technique et le plaisir pris à l’histoire que raconte cet ancien élève de l’École de cirque du Lido à Toulouse, qui considère que la magie est un langage capable de jeter des ponts entre les arts : mieux qu’un simple prestidigitateur, Yann Frisch est un véritable magicien ! Catherine Robert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 3:43 PM
|
Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse 21 juillet 2020 Seul sur la scène du Théâtre de Belleville, au sein d’un espace scénographique quasi vide, Gérard Potier interprète et met en scène Une Vie de Gérard en Occident, texte adapté d’un roman de François Beaune. Entre humour et réalisme social, une échappée dans la vie de « vrais gens » appartenant à la France que l’on dit « d’en bas ». Une table. Une cagette. Quelques boites de biscuits apéritif. Des gobelets en plastique. La voix, le corps, la présence d’un comédien qui arrive sur scène en nous souhaitant la bienvenue dans la salle des fêtes d’un bourg imaginaire de Vendée, Saint-Jean-des-Oies, où doit se tenir une rencontre politique. Cet acteur, c’est Gérard Potier. En un peu plus d’une heure, il nous fait voyager dans l’existence d’un autre Gérard (Airaudeau), qui donne lui-même naissance à une galerie de personnages inventés par l’auteur François Beaune à partir d’histoires vraies collectées auprès de populations locales, lors d’une résidence effectuée à la Scène nationale de la Roche-sur-Yon. Des années 1970 à nos jours, c’est ainsi une vision du monde ouvrier de la France rurale que cette adaptation scénique d’Une Vie de Gérard en Occident* nous présente au Théâtre de Belleville, scène ayant rouvert ses portes aux publics dès le début du mois de juillet. Ce monologue s’y joue durant tout l’été. Sur un ton badin qui finit par glisser, l’air de rien, vers les territoires crus et troublants de réalités sociales souvent dramatiques, Gérard Potier nous parle ici des malheurs et des joies, des déterminismes qui orientent le cours des vies ordinaires, dont le texte de François Beaune s’attache à rendre compte. La dureté de la condition ouvrière Quelques faiblesses dans le texte et la mise en scène pourraient faire craindre, en début de représentation, à une création usant de facilités. Il n’en est rien. Car, peu à peu, l’univers auquel donne corps Gérard Potier se clarifie, s’affine, s’approfondit pour nous gagner à la cause des récits à hauteur d’homme qui se révèlent à nous. De l’enfance de Gérard Airaudeau dans un bar PMU à sa vie d’intérimaire balloté d’entreprise en entreprise, de l’accident de travail d’un employé de l’agro-alimentaire à son suicide après deux ans d’inactivité, de plans de licenciement en plans de licenciements qui laissent au bord de la route toute une génération de travailleurs, Une Vie de Gérard en Occident porte un regard simple et authentique sur la dureté de la condition ouvrière. Un regard sans pathos et sans misérabilisme. Un regard qui n’omet rien des petits et grands bonheurs formant aussi la matière de destins traversés, comme tous les autres, par la question du bonheur, de la mort, du racisme, de l’orientation sexuelle… Tout ceci nous est offert, sur scène, avec netteté et sincérité. Gérard Potier gagne le pari de la justesse. En toute sensibilité, il nous transporte du rire au sourire. Et du sourire à l’émotion. * Le roman adapté pour le spectacle a été publié, en 2017, aux Editions Verticales Manuel Piolat Soleymat Une Vie de Gérard en Occidentdu Mercredi 8 juillet 2020 au Dimanche 27 septembre 2020Théâtre de Belleville94 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris. Du mercredi au samedi à 19h30, le dimanche à 17h. Durée de la représentation 1h05. Tél. : 01 48 06 72 34. www.theatredebelleville.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 10:56 AM
|
Par Philippe du Vignal dans Théâtre du blog - 21 juillet 2020 L'hommage de Philippe du Vignal : Elle avait cinquante neuf ans. Cette metteuse en scène française de théâtre, était aussi scénariste et professeur d’art dramatique. Diplômée du Conservatoire National et de l’Université Hébraïque de Jérusalem, elle avait aussi suivi en Angleterre une formation au théâtre shakespearien. Elle joua dans Jamais plus Jamais, un James Bond avec Sean Connery et ensuite mit en scène Le Marchand de Venise de Shakespeare au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis puis en 84, Docteur X Hero ou le dernier client du Ritz de Mériba de Cades au festival d’Avignon et en 87 Bastien et Bastienne de Mozart.
En 1988, elle vécut en Nouvelle-Calédonie où elle travailla à la préparation du Festival des arts du Pacifique. Elle mit en scène au studio des Champs-Élysées, Le Banc d’Alexander Gelman et travailla ensuite avec Patrick Grandperret à un scénario sur l’Afrique contemporaine, puis avec Xavier Castano à l’écriture de Veraz dont le rôle principal est interprété par Kirk Douglas. Saskia Cohen-Tanugi fut ensuite chargée d’une étude sur la programmation du Théâtre 13 à Paris. Elle travailla ensuite à l’élaboration du Vieil Homme et le Molosse pour Greg Germain, l’actuel directeur de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon.
Puis elle enseigna quelques années à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. En 1999, elle adapte Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler au théâtre, une pièce récompensée par plusieurs Molière. En 2000, elle dirige un atelier de théâtre à l’Université hébraïque de Jérusalem et écrira plusieurs œuvres sur le Proche-Orient : Caleb et Yoshua, Judith Epstein, La Vieille Femme du 55 rue Gabirol, Les Deux Jeunes Filles de Netanya, Avant qu’Ophélie ne…, Lettres d’intifada…
Personnalité attachante, d’une grande culture théâtrale et artistique, elle avait choisi depuis une vingtaine d’années de vivre et enseigner en Israël.
Philippe du Vignal ------------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Patrick Sommier : Elle s’appelait Saskia Cohen Tanugi. Elle vient de mourir, en Orient, en Israël. Elle avait mis en scène au conservatoire, avec ses amis, au début des Années 1980, un époustouflant Roméo et Juliette rempli de fureur et de bruit. Un oratorio punk qui célébrait la jeunesse, la beauté et le théâtre. Le théâtre pour lui-même, comme une charge de centaures, l’explosion joyeuse d’une cartoucherie, une délivrance. C’est Rémy Kolpa qui m’avait alerté parce que c’était autant du théâtre que de la musique. René Gonzales lui a ouvert la scène du TGP à Saint-Denis où elle créa le Marchand de Venise, un autre Shakespeare au cordeau, au stylet, à coups de surin, violent, follement sensuel comme un tableau orientaliste. Elle continua, à Avignon où l’attendaient les garçon- bouchers de l’art théâtral ; Elle était follement belle, ça les rendait agressifs. Elle continua mais comme elle avait tout balancé dans son Zeppelin, elle erra longtemps dans les régions froides où l’oxygène se fait rare. Il lui aurait fallu plusieurs vies. Elle avait quelque chose de Rimbaud qui avait tout donné puis s’était perdu dans les sables. C’était un météore, un arc en ciel de nuit. Dans le ciel et la nuit où elle est retournée. Là ou ailleurs. (publié sur sa page Facebook)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 5:27 AM
|
Par Philippe-Jean Catinchi dans Le Monde - 20 juillet 2020 Professeur à Nanterre, où il a enseigné l’histoire et l’esthétique du théâtre, auteur de plusieurs livres sur la littérature du XVIIe siècle, il a publié en 2006 « Qu’est-ce que le théâtre », ouvrage devenu référence. Il est mort le 13 juillet, à l’âge de 68 ans. Spécialiste de la littérature du XVIIe siècle comme de l’histoire et de l’esthétique du théâtre, Christian Biet est mort des suites d’un accident de la route, à Poitiers, le 13 juillet, à l’âge de 68 ans. Né à Paris le 12 mai 1952, au sein d’une famille où l’école est centrale (une mère directrice, un père professeur en collège), Christian Biet perd son père à 14 ans, milite à la fin des années 1960 à Lutte ouvrière – l’ère du temps –, entre en hypokhâgne au lycée Condorcet et, auditeur libre à l’ENS Saint-Cloud, obtient l’agrégation de lettres en 1975. Il enseigne une dizaine d’années en banlieue parisienne, collège et lycée, tout en poursuivant un 3e cycle en littérature comparée, avant d’être chargé de cours à l’ENS, maître de conférences en 1986. D’emblée le jeune chercheur s’oppose à la doxa pédagogique, rêve d’autres voies d’apprentissage, d’un regard actualisé sur le savoir à transmettre. Avec des camarades de son âge, Jean-Paul Brighelli et Jean-Luc Rispail, il entreprend pour Magnard une série de manuels « Texte et Contextes », exigeants au risque que ne pas « sécuriser » le lycéen. Qu’importe ! Avec ses complices, que la nouvelle collection « Découvertes » chez Gallimard, enthousiasme, Biet prêche le savoir autrement. Il publie Les Miroirs du Soleil (1989), sur Louis XIV et « ses » artistes, plus tard un décapant et radical Don Juan (1998) et cosigne en bon camarade les titres consacrés à Dumas, Malraux et les surréalistes. Le partage est essentiel. Avec la sociologue Irène Théry, Christian Biet livre un collectif, La Famille, la loi, l’Etat. De la Révolution au code civil (1989), proche des préoccupations de l’universitaire, qui avait consacré sa thèse de 3e cycle à Œdipe en monarchie. Publiée chez Klincksieck en 1994, elle abordait la périlleuse réception de la tragédie de Sophocle sous l’absolutisme quand les dramaturges osent présenter un roi fautif, une reine incestueuse et des héritiers illégitimes, exorcisant les terreurs propres à la famille et à l’Etat. Energie et enthousiasme Sans doute Biet aurait-il pu être éditeur – il le fut un temps pour Larousse, créant une éphémère collection de biographies, « La Vie, la légende », qui astucieusement mettait en balance le factuel d’un parcours réel et sa reconstruction dans l’imaginaire collectif, où lui-même signa un Henri IV, tandis qu’il confiait à l’ami Brighelli un Sade recommandable (2000). Renouant avec son goût des monographies accessibles, Biet signe un ultime « Découvertes », Moi, Pierre Corneille (2006) peu avant d’intégrer comme membre senior l’Institut universitaire de France. Mais, si prenante soit-elle, l’activité éditoriale comme universitaire ne l’enferme pas. Et dès l’année suivante, Christian Biet entre au comité de rédaction de Théâtre/Public, revue créée en 1974 mais menacée, qu’il contribue par son énergie et son enthousiasme à relancer, assurant le soutien de l’équipe de recherche « Représentation » de l’université Paris-X-Nanterre qu’il dirige. Des trésors dramatiques oubliés aux aventures contemporaines extra-européennes (Inde, Japon, Chine récemment), Biet s’attache à ce qu’on ne voit pas. Ou pas assez. Ainsi ce mémorable Théâtre de la cruauté et récits sanglants en France XVIe-XVIIe siècle (Laffont, 2006), qui interroge la portée morale du spectacle de l’effroi, exhumation capitale d’un répertoire négligé qu’il poursuit chez Garnier en 2009 avec Marie-Madeleine Fragonard en codirigeant Tragédies et récits de martyre en France (fin XVIe-début XVIIe siècle). Une façon de pourfendre les lieux communs et de décaper la vision des enjeux scéniques, tant pour comprendre le passé que pour se confronter au contemporain. Interrogeant inlassablement l’hétérogénéité de ceux qui font le théâtre (auteurs, acteurs, metteurs en scène, régisseurs, mais aussi lecteurs et spectateurs), Christian Biet a défendu une perspective capable de mobiliser tous les enjeux (écriture, architecture, voix et gestuelle, esthétique et idéologie) du spectacle vivant. Largement traduit tant il est indispensable, Qu’est-ce que le théâtre ? (Gallimard, 2006), l’ouvrage capital qu’il cosignait avec Christophe Triau, reste une référence pour son propos comme pour l’audace de son regard qui voit la scène comme le lieu même de la vie. Consulté par d’exigeants metteurs en scène (Olivier Py, Stanislas Nordey), Christian Biet était un interlocuteur ouvert et stimulant. Nous reste son message. Philippe-Jean Catinchi
Christian Biet en quelques dates 12 mai 1952 Naissance à Paris 1989 « Les Miroirs du Soleil » 1994 « Œdipe en monarchie » 1995-2020 Enseigne l’histoire et l’esthétique du théâtre à Paris-X-Nanterre 2006 « Qu’est-ce que le théâtre ? » 13 juillet 2020 Mort à Poitiers Légende photo : Christian Biet Collection privée

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 5:02 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde, 20 juillet 2020 « La Grande Balade » a réuni une centaine d’artistes pour une échappée enchantée. Cloches de vache à l’arrivée comme au départ. Bienvenue à la station du Semnoz, sur les hauteurs d’Annecy. Entre ces sonnailles, toute une gamme d’instruments se sont faufilés parmi les sapins : gros tambours, koto japonais, saxo, guitare, harpe, clavecin, viole de gambe… Cacophonie dans les alpages ? Jeu d’échos subtilement diffusés par monts et par vaux pour La Grande Balade, rando-spectacle de deux heures avec 24 performances et une centaine d’artistes, proposée les 18 et 19 juillet, sur 9 kilomètres de sentiers. On chemine tranquille, on s’assoit dans l’herbe, on rêve et contemple les performers et les paysages. On rit de temps en temps Un coup de télécabine et hop, on atterrit à 1 700 mètres d’altitude. A la seconde, on respire mieux, on ventile fluide, on s’aère les neurones en profitant d’un point de vue magique sur la vallée avec, lorsque le temps est dégagé, la possibilité d’apercevoir le mont Blanc à l’horizon. La première image de cette opération inédite pilotée par Salvador Garcia, directeur de Bonlieu-Scène nationale d’Annecy, nous cueille et nous souffle. Planant plein ciel au-dessus d’un cirque de verdure, le funambule Nathan Paulin, petite silhouette lointaine épinglée tel un drôle d’oiseau dans l’azur, se balance. Sur son câble situé à 40 mètres de hauteur, relié par un harnais de sécurité, celui qui a parcouru sur un fil les 670 mètres entre la tour Eiffel et le Trocadéro pour le Téléthon en 2017 progresse pieds nus. De légers coups de vent soulèvent régulièrement son tee-shirt blanc, mais tout va bien. Sa voix remplit soudain l’espace. « Quand j’étais jeune, j’ai eu de mauvaises expériences avec le vide, confie-il. Quand on arrive à maîtriser une peur, on peut en maîtriser d’autres… » Le voilà qui s’assoit, puis s’accroche par un seul bras avant de s’allonger sur le filin. Il nage dans l’air. Pour ce moment simple et sublime, très émouvant, Nathan Paulin a collaboré avec Rachid Ouramdane, codirecteur du Centre chorégraphique national de Grenoble. Il ouvre cette balade suivie, samedi 18 juillet, entre 11 heures et 17 heures, par 10 000 personnes. Sur les sentiers caillouteux du Semnoz, petits groupes d’amis, familles en vacances et habitants du coin se croisent. On chemine tranquille, on s’assoit dans l’herbe, on rêve et contemple les performers et les paysages. On rit de temps en temps. Les enfants ont peur du loup-garou qui soudain surgit. La circulation est fluide sous la houlette de guides qui régulent les flux des randonneurs et le planning des performances. Un incroyable portique La suspension, l’apesanteur et le vertige sont régulièrement au rendez-vous. Dans une clairière, la trapéziste et artiste de cirque Chloé Moglia a installé son immense perche incurvée baptisée « la Courbe » et pédale dans le vide, tranquillement sensuelle. Un parterre de personnes assises en tailleur l’accompagne en apnée dans ses évolutions méditatives. Quelques pas plus loin, on passe sous un incroyable portique. Une banderole clamant « Tout va bien » chute d’un fil tendu à neuf mètres de haut entre deux immenses sapins. En action, la funambule Johanne Humblet y avance avec sa perche tandis qu’en contrebas, installée sur une balançoire, une jeune femme revêtue d’un paletot en fourrure joue de la guitare, et c’est superbe. Pour cette Grande Balade, première du genre, imaginée pendant le confinement, Salvador Garcia a fait appel aux danseurs, chorégraphes et metteurs en scène avec lesquels il collabore régulièrement. « Ce rendez-vous sur deux jours fait partie de la manifestation Annecy-Paysages et se déroule d’habitude dans les rues de la ville, raconte-t-il. A cause du Covid-19, j’ai pensé qu’on pouvait la déplacer en montagne. J’ai appelé la mairie et la préfecture, et c’était bon. En mai, j’ai fait les repérages dans les alpages et envoyé à chaque artiste des petits films montrant les sites où j’imaginais que sa performance pouvait se dérouler. Chacun a un rapport sincère avec le paysage, et cette proposition leur a donné l’occasion de développer cette relation avec la nature. J’ai aussi appelé les alpagistes pour que leurs troupeaux de vaches restent exceptionnellement un peu éloignés des sentiers de la randonnée. » On déambule, enveloppé par les sons qui semblent jaillir du creux même des branches L’inclusion dans la forêt de musiciens juchés et dissimulés dans les arbres est un délice. On déambule, enveloppé par les sons qui semblent jaillir du creux même des branches. Dans une clairière, l’équipe de circassiens de Saief Remmide se jette dans une envolée bondissante. Un trio de danseurs, sous la houlette de Jean-Claude Gallotta, lui succède et se risque à des étreintes tourbillonnantes et voltigeuses, signatures du chorégraphe, pendant que le saxophoniste Peter Corser improvise en douceur. Carrément installé au milieu du chemin avec sa plaque en bois comme caisse de résonance, le danseur et chorégraphe François Chaignaud, à demi-nu, frappe son plancher et cherche la voie de sa transe. Posés telles des sculptures sur les prés, l’escalier-trampoline blanc de l’acrobate et metteur en scène Yoann Bourgeois, codirecteur du CCN de Grenoble avec Rachid Ouramdane, et le jeu de cubes renversés, également blanc, de l’artiste de cirque Jean-Baptiste André, claquent sur le ciel bleu, composant un étrange alliage d’art et de nature. Qu’il s’agisse d’extraits de pièces déjà existantes, de tentatives de performances inédites ou encore des répétitions d’une recherche en cours, ces morceaux choisis s’offrent une mise en beauté unique avec ce déplacement dans des paysages somptueux. Jusqu’au plateau installé spécialement pour le chorégraphe Philippe Decouflé et sa troupe qui semble serti dans un incroyable (mais) vrai fond d’écran verdoyant et montagneux. Et, lorsqu’on grimpe sur un tertre pour s’offrir un panorama d’ensemble, on profite à fond d’un tableau incrusté d’éléments insolites parmi lesquels, ici et là, les grappes de spectateurs multicolores se détachent, faisant vibrer la peinture pointilliste d’une Grande Balade infiniment miroitante. La Grande Balade. Avec Bonlieu-Scène nationale d’Annecy, dans le cadre de l’opération Annecy-Paysages, à Semnoz jusqu’au 27 septembre. Rosita Boisseau(Annecy - Haute-Savoie)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 20, 2020 6:49 AM
|
Par David Rofé-Sarfati dans Toutelaculture.com 17 juillet 2020 Avec « Frigide » Malkhior réactualise Copi
|
Parce que le combat de Copi a perdu de son sens, son œuvre avait besoin d’un toilettage que Malkhior ose nous proposer dans un seul en scène foutraque mais émouvant. Cela se passe encore une fois au ParisOFFestival du Théâtre 14
L’œuvre protéiforme de Copi, auteur argentin francophone des années 80 et proche du FHAR (front homosexuel d’action révolutionnaire), fut en son temps perçue comme subversive, provocante, dérangeante. Son invitation insurrectionnelle à regarder l’étrangeté des sexualités signait une nouvelle partition des rapports sexuels et au loin des rapports humains. Dans sa pièce Frigo, L., une transsexuelle vulgaire, reçoit un frigo comme cadeau d’anniversaire. La présence de cet appareil va déclencher chez L. un bombardement d’hormones qui va le/la plonger peu à peu dans la folie. À la fin de la journée, L. découvrira l’amour sous les traits d’un rat.
Aujourd’hui, la représentation de l’homosexualité et de la transidentité ne soulève plus les peine-à-dire de l’époque de Copi. Désormais, un chat est un chat. La société a su penser la réalité de nos pluralités. Il n’empêche ; Malkhior sait que le combat mérite une piqûre de rappel. Frigide est un seul en scène délirant, adaptation très libre du Frigo de Copi. Une star déchue de l’underground pédé, désormais baptisée M. vit recluse dans sa tanière. M. y affronte seul -justement- ce qu’il est : un être étrange et esseulé, sui generis. Alors que sa mère lui offre un frigo qui trône à son réveil au centre de son salon, il fera face à son propre mystère. Dans une performance hilarante et décalée, Malkhior incarne cette créature exubérante qui interroge notre regard sur l’altérité, mais aussi sur nous même. Il ajoute à la charge de Copi une dimension actuelle. Les hormones ne se déchaînent plus, l’époque n’est plus à une sexualité réprimée; maintenant que tout est possible, seule la frigidité nous guette. Copi attaquait son public sans le saisir, Malkhior décide de nous attraper en complicité. Il abandonne le personnage de la doctoresse Freud, remplace l’effondrement psychotique par une tendre adresse au public ; il rompt avec une psychologisation devenue inutile. Le message de Copi est préservé. Son désir de nous émerveiller et son amour du foutraque et de l’hallucinatoire également. En plus, une joie d’être là et une empathie pour le public qui fait crème.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 18, 2020 8:04 AM
|
Information NewsTank - vendredi 17 juillet 2020
Arnaud Meunier est nommé directeur de la MC2, Scène nationale de Grenoble (Isère), apprend News Tank le 17/07/2020. Le metteur en scène succèdera, en janvier 2021, à Jean-Paul Angot, qui occupe ce poste depuis janvier 2013. Il est directeur de la Comédie de Saint-Étienne (Loire) depuis 2011. Son dernier mandat qui devait s’achever au 31/12/2020, avait été prorogé d’un an jusqu’au 31/12/2021.
« Le choix d’Arnaud Meunier a fait l’unanimité parmi l’ensemble des partenaires publics de l’EPCC MC2 : État, Région, Département, Métropole, Ville de Grenoble. Je me réjouis de cette décision collégiale autour d’un projet généreux, qui fait le pari de l’humain dans ce qu’il a de multiple. La Ville de Grenoble sera un partenaire actif de l’établissement, dans une approche de partenariat et de coopération, au service de la vitalité de Grenoble et de son agglomération comme de la scène artistique nationale et européenne », déclare Éric Piolle, maire de Grenoble.
Diplômé de Sciences Politiques, Arnaud Meunier commence une formation de comédien, puis fonde en 1997 la Compagnie de la Mauvaise Graine. Sa compagnie a notamment été accueillie en résidence au Forum du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et soutenue par le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sous la direction de Stanislas Nordey. Elle a également été en résidence à la Maison de la Culture d’Amiens (Somme), puis associée à la Comédie de Reims (Marne) et à la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines).
Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site
Arnaud Meunier
Date de naissance : 20/02/1973
MC2 Maison de la Culture de Grenoble - Scène nationale
Directeur
À partir de Janvier 2021
Association nationale des écoles supérieures d’art dramatique
Président
Depuis Décembre 2014
-
La Comédie de Saint-Étienne - Directeur
Depuis Janvier 2011
-
École de la Comédie de Saint-Étienne
Directeur
Depuis Janvier 2011
-
Compagnie de la Mauvaise Graine
Fondateur
Depuis 1997
-
Association des Centres dramatiques nationaux
Coprésident
de Janvier 2015 à Décembre 2017
Mises en scène :
- Candide de Voltaire (2019)
- J’ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melquiot (2019)
- Fore ! de Aleshea Harris (2018)
- 66 pulsations par minutes de Pauline Sales (2018)
- Je crois en un seul dieu de Stefano Massini (2017)
- Truckstop de Lot Vekemans (Festival d’Avignon, 2016)
- Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès (2015)
- Ali Baba (opéra) (2014).
2014 : Grand prix du Syndicat de la critique pour la mise en scène de Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers, de Stefano Massini.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 16, 2020 5:43 PM
|
Publié par la rédaction de Théâtre / Public le 15 juillet 2020
C’est avec tristesse et douleur que nous avons appris la disparition brutale de Christian Biet ce lundi 13 juillet 2020.
Membre du comité de rédaction depuis 2007, il avait œuvré, avec son énergie habituelle, et en compagnie de Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil, à la création de l’association Théâtre/Public.
La revue, après plus de trente ans d’existence, était alors menacée.
C’est cette collaboration avec les membres fondateurs de Théâtre/Public, Bernard Sobel, Alain Girault, Michèle Raoul-Davis, qui a permis à celle-ci de renaître, grâce au soutien de l’équipe de recherche « Représentation (Recherches théâtrales et cinématographiques) » de l’université Paris-X – Nanterre qu’il dirigeait. C’est lui, encore, qui a initié le partenariat si fécond et pérenne avec les Éditions Théâtrales.
Il était devenu l’une des figures décisives de cette revue, enthousiaste et généreux. On repère sa présence de numéros en dossiers, d’articles en entretiens, attentif à l’art théâtral contemporain qu’il suivait, amical et exigeant, armé de son humour, de sa curiosité et de sa science du XVIIe siècle.
On lui doit de beaux dossiers, qu’il avait coordonnés seul ou avec d’autres, et qui témoignent de son intérêt, vaste et renouvelé, pour tout l’art dramatique : « L’avant-garde américaine et l’Europe », « Scènes chinoises contemporaines », « Le répertoire aujourd’hui », « Nouvelles écritures dramatiques européennes » ou «Internationale situationniste.Théâtre, performance». Les études théâtrales doivent beaucoup à sa vitalité. Des collèges témoigneront ces prochains temps de l’importance de ses recherches. Nous y reviendrons.
Il fut un infatigable compagnon de travail drôle et affectueux. Il avait un goût immodéré pour les aventures collectives. Il faisait et il donnait confiance.
Nous n’avons pas idée de ce que sera désormais le comité de rédaction sans lui. Nous n’avons pas l’imagination de son absence.
Nous adressons toutes nos pensées à sa compagne, à ses enfants et à ses proches, parmi lesquels il y avait tant d’anciens et d’anciennes doctorant·e·s.
Il préparait, ces jours-ci, un numéro : « Jouer » . Il verra le jour tel qu’il l’avait souhaité.
À l’heure de mettre en page son dernier texte « Conduite (théâtrale) à tenir face à l’épidémie (de 1580) », nous nous sentons terriblement seul·e·s.
La nouvelle est inconcevable et notre gratitude, sans mesure.
Pour Théâtre/Public,
Pierre Banos-Ruf, Brigitte Benard, Jean-Louis Besson, Rose Boursier-Mougenot, Sylvie Claval, Clare Finburgh Delijani, Judith le Blanc, Olivier Neveux, Michèle Raoul-Davis, Bernard Sobel.
Légende photo : Christian Biet © DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 2020 3:21 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 13 juillet 2020 Ancien danseur, le réalisateur s’est spécialisé dans la captation de séquences chorégraphiques.
Bien filmer la danse, cela veut dire quoi exactement ? Saisir l’ensemble du corps en mouvement jusqu’au bout des orteils, happer l’élan d’un geste, se focaliser sur une partie seulement de l’interprète, tenter de rendre compte de la dramaturgie globale d’un spectacle ou encore s’attacher à sa géométrie dans l’espace ? Une seule question : un puits sans fond. « A mes débuts, il y a douze ans, on m’a souvent dit comment filmer la danse et cela correspondait à une vision en pied très classique du mouvement, se souvient le réalisateur Tommy Pascal. Cela ne me convenait pas et je n’avais pas envie de suivre ces conseils. J’ai commencé à filmer à l’instinct, comme je le sentais, en rentrant dans les corps avec des gros plans. Cela permet de redonner du rythme au montage. » Et cela marche formidablement. Qu’il capte aujourd’hui les spectacles de la Canadienne Crystal Pite, du Suédois Alexander Ekman ou de l’Israélien Ohad Naharin, tous trois régulièrement invités à l’Opéra national de Paris, Tommy Pascal, 45 ans, en réveille le frisson du vivant. Allant jusqu’à scruter les visages dans l’effort. « Il faut comprendre la relation entre les corps, leurs déplacements, la vitesse, l’énergie, l’espace sur le plateau mais aussi celui entre les interprètes », glisse-t-il. Pour faire surgir la pression d’une étreinte, la texture épidermique d’un geste, la masse musculaire d’un tracé, mais encore l’épaisseur de l’air. « J’ai été danseur et je me mets toujours à la place de l’interprète, dit-il. Je partage aussi le même vocabulaire que les chorégraphes avec lesquels je travaille. J’écoute ce qu’ils veulent et je suis leurs désirs. Ce sont eux qui valident la réalisation à la fin. Je reste fidèle à l’œuvre avant tout. » Carte blanche aux artistes Sans spectacles à se mettre sous la caméra depuis le confinement, Tommy Pascal, tranquille mais prêt à bondir, n’est pas resté les mains dans les poches. Il a mis au point, avec des chorégraphes comme Honji Wang et Sébastien Ramirez, un dispositif modeste et excitant qui a abouti à une série de six clips intitulée Dance, Dance, programmée sur le site de France Télévisions. Il a donné carte blanche aux artistes pour se filmer chez eux avec les moyens du bord – généralement le téléphone portable – et monté ensuite les images. « Il y avait peu de moyens et c’est le montage, le plus important selon moi dans un film de danse, qui a rassemblé les différentes propositions », commente-t-il. Parallèlement à la création d’une nouvelle collection intitulée Cypher, avec des interprètes électro, hip-hop et krump, actuellement en cours de tournage, il a signé, le 17 juin, une performance chorégraphiée par Saïdo Lehlouh intitulée #RevivreLaScène, réalisée aux Folies-Bergère, au Casino de Paris et au Bataclan, et visible aujourd’hui sur les réseaux de ces théâtres. Il y emporte dans un tourbillon grisant 50 hip-hopeurs. « L’enjeu pour moi était que le steadicamer [caméraman portant son appareil en harnais] soit immergé au milieu des interprètes en train d’improviser. » #REVIVRELASCENE Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, retrouvez l’intégralité de la performance chorégraphique... Publiée par Folies Bergère sur Jeudi 18 juin 2020 Cette fibre dansée sensible, Tommy Pascal l’assouplit depuis l’âge de 9 ans. Il prend ses premiers cours de modern jazz à Cannes, où il intègre l’école de Rosella Hightower, enchaîne avec Rudra Béjart, à Lausanne, puis intègre le Béjart Ballet. « J’ai eu la chance d’interpréter Le Sacre du printemps ou encore le Boléro, avec Sylvie Guillem. Béjart reste un coup de tampon, une carte de visite. » Il collabore ensuite avec le Ballet Preljocaj, entre 1999 et 2001. « Mais je n’étais pas un danseur technique et après Preljocaj, je savais que je ne pourrais rien faire de mieux. Comme j’ai toujours une caméra entre les mains, j’ai décidé de me former au cinéma. » Il additionne alors les contrats dans les comédies musicales Roméo & Juliette, Les Demoiselles de Rochefort, dans les mises en scène de Redha, ou Le Roi Soleil, de Kamel Ouali, pour se financer des stages de scénario, cinéma expérimental, montage… En 2007, il range les chaussons et suit Christophe Maé en tournée, pour lequel il conçoit des making of et des clips. « Faire partager l’expérience » Pas d’esbroufe chez Tommy Pascal mais la détermination fervente d’un bosseur. Et un peu de chance pour fluidifier le tout. Elle s’appelle deux fois Dubois. Olivier, d’abord, chorégraphe, qu’il a rencontré lorsqu’ils étaient tous deux interprètes chez Angelin Preljocaj. En 2013, Olivier Dubois, avec lequel il planche sur un projet intitulé Le Porc qui danse, lui propose de filmer Tragédie, son spectacle créé en 2012 au Festival d’Avignon. Le DVD atterrit sur la table du producteur Xavier… Dubois, chez Bel Air Media, qui l’appelle. « Il m’a demandé les trois artistes avec lesquels j’aimerais travailler et j’ai répondu Pina Bausch, William Forsythe et enfin Ohad Naharin. Ça a été Ohad. » Et en avant. « Ce qui fait la force de Tommy, c’est qu’il voit les choses comme elles se vivent et je n’ai pas rencontré beaucoup de réalisateurs depuis vingt ans qui aient cette qualité pour la danse, analyse Xavier Dubois. Les captations de spectacles chorégraphiques sont souvent rasoirs. Respecter la figure dansée en la mettant dans un cadre ne suffit pas. Il faut réussir à faire partager l’expérience et la rendre accessible à tout le monde, ce que réussit Tommy selon moi. » Concrètement, quelle est la méthode de Tommy Pascal ? Plusieurs prises dont une sans public ; toujours la même équipe de techniciens depuis dix ans « et sans laquelle mon travail ne serait pas le même » ; caméras de type cinéma… « Laisser le champ libre à la caméra permet de chercher en même temps. Je laisse libre les cadreurs, précise-t-il. J’aime qu’ils partent à gauche lorsque je dis à droite simplement parce qu’ils ont senti que quelque chose se passait par là et en général, cela permet ensuite d’avoir des pépites. Mes captations se construisent vraiment au montage, en fouillant la matière. Je regarde toutes les prises et recrée le film. » Pour y faire circuler un nouveau souffle chaud et vif. Lire aussi Des idées pour continuer à se cultiver en ligne A voir : Body and Soul, de Crystal Pite. Sur le site de l’Opéra national de Paris jusqu’au 24 octobre. Ghosts et Hedda Gabler, par le Ballet national de Norvège. Plate-forme VoD Bel Air Classiques. En DVD, Play, d’Alexander Ekman, et Naharin’s Virus, d’Ohad Naharin (Bel Air Classiques). Dance, Dance, sur France.tv. Site : tommypascal.fr Rosita Boisseau Légende photo : Tommy Pascal à Tours, en 2020. Tommy Pascal

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 11, 2020 12:05 PM
|
Publié par NewsTank le 10 juillet 2020 Maël Grenier directeur du Carré, Scène nationale et centre d’art contemporain de Château-Gontier
Maël Grenier est nommé directeur du Carré, Scène nationale de Château-Gontier et centre d’art contemporain d’intérêt national de Château-Gontier (Mayenne), apprend News Tank le 10/07/2020. Il succède à Babette Masson, en poste depuis 2006, qui fait valoir ses droits à la retraite. Il est directeur adjoint de la Maison de la culture de Nevers Agglomération depuis 2016. Auparavant, il a été administrateur puis directeur adjoint du Centre dramatique national de l’Océan Indien à La Réunion (2011-2016), administrateur de production dans plusieurs structures, et directeur de l’association Jour de Fête à Crozon (Finistère).
Maël Grenier souhaite « construire la programmation du Carré en suivant le rythme des saisons ». Deux temps forts seront créés : l’un réunissant des propositions artistiques à destination des familles et des jeunes, l’autre croisant plusieurs problématiques : artistique, écologique et citoyenne. L'événement Gontierama (parcours d’œuvres contemporaines au sein d’espaces culturels et patrimoniaux du territoire) et la Biennale Onze (dédiée aux marionnettes) seront conservés.
Créé en 1991, Le Carré occupe une partie de l’ancien couvent des Ursulines, classé Monument historique. Il est à la fois une Scène nationale (label obtenu en 2002) et un centre d’art contemporain (label obtenu en 2003). Deux autres lieux disposent de cette double labellisation : La Ferme du Buisson à Noisiel (Seine-et-Marne) et Le Parvis à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...