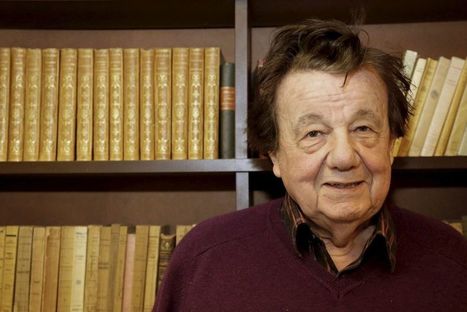Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2020 12:58 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde le 29 juin 2020 Les grandes heures d’Avignon 1/6 - « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur la naissance de l’événement. « Voilà, c’est tout simple. Il était une fois un homme et une ville qui se rencontrèrent, s’aimèrent, se marièrent et eurent un enfant nommé Festival. » C’est Jean Vilar lui-même qui l’écrit, en 1963. Seize ans après avoir posé la première pierre du Festival d’Avignon, avec la Semaine d’art qui s’est tenue du 4 au 10 septembre 1947, le ton est déjà à la légende. Le mythe fondateur, déjà construit. Comme toujours, l’histoire est un peu plus compliquée que la légende, même si elle en épouse largement les contours. Le coup de foudre entre la cité des Papes et le fondateur du Festival n’a, au départ, rien d’évident. Jean Vilar a beau être originaire de Sète, il est, en 1947, bien loin de cette Provence sèche, pierreuse et austère. A 35 ans, il s’est fait connaître, à Paris, pour ses mises en scène d’auteurs nordiques ou élisabéthains. Il vient de signer une version remarquée de Meurtre dans la cathédrale, de T. S. Eliot, au Théâtre du Vieux-Colombier. Article réservé à nos abonnés Lire aussi " Meurtre dans la cathédrale " au Vieux-Colombier La cour, « un lieu informe » « La bonne chance voulut que tout naquît d’une rencontre avec le poète », écrit-il quelques années plus tard. Le poète : René Char (1907-1988), natif de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), résistant – chef du secteur Durance Sud sous le nom de capitaine Alexandre –, ami des peintres et du critique d’art et éditeur Christian Zervos (1889-1970). Or, en ce printemps 1947, Zervos prépare une ambitieuse exposition de peinture moderne pour la grande chapelle du Palais des papes. Il songe à accompagner l’exposition d’une manifestation théâtrale. René Char lui souffle le nom de Jean Vilar. « Un jour d’avril 1947, rue du Bac, au-dessous d’un mobile de Calder, Christian Zervos, à mi-voix, me proposa de donner une – oui, une seule – représentation de Meurtre dans la cathédrale dans le Palais », a raconté le metteur en scène. Jean Vilar part voir le Palais, qu’il avait visité enfant. Quand il entre dans la cour, un soleil de printemps dore les murs. Et Vilar se met à dessiner un plan de la scène et de la salle Vilar refuse. « Je suis trop jeune pour faire des reprises », argue-t-il. Et puis la cour lui semble un endroit impossible : « C’est un lieu informe, je ne parle pas des murs, mais du sol ; techniquement c’est un lieu théâtral impossible, et c’est aussi un mauvais lieu théâtral parce que l’histoire y est trop présente. » Et pourtant, il est tenté. Quinze jours plus tard, il propose à Zervos de venir à Avignon avec trois créations : Richard II, de Shakespeare, alors jamais joué en France, et deux œuvres françaises d’auteurs vivants, Histoire de Tobie et de Sara, de Paul Claudel, et La Terrasse de midi, du tout jeune Maurice Clavel. « A jouer l’aventure, il fallait la jouer complètement », expliquera-t-il plus tard. Reste que le sol de la cour, tout en pente, excavations et talus, est « injouable ». Et Zervos refuse sa proposition : il n’a pas le budget pour un tel plan. Mais il conseille à Vilar de rencontrer le maire d’Avignon, le docteur Georges Pons, et son premier adjoint, Etienne Charpier. Eux aussi sont issus de la Résistance. Jean Vilar prend le train pour Avignon – une nuit de voyage alors, pour arriver au petit matin dans la cité des Papes. Il part voir le Palais, qu’il avait visité enfant. Quand il entre dans la cour, un soleil de printemps dore les murs. Et Vilar se met à dessiner un plan de la scène et de la salle. C’est alors qu’intervient l’homme providentiel, le maire d’Avignon, dans une ville encore très meurtrie par la guerre. Pons soutient Zervos et Vilar, débloque 300 000 francs – tandis que le ministère de la jeunesse, des arts et des lettres en apporte 500 000, et que Vilar met 300 000 francs de sa poche –, et demande aux soldats du régiment du 7e génie de venir mater ce sol redoutable de la cour. Vilar annexe aussi, de l’autre côté du Palais, en contrebas, le jardin Urbain-V, et le Théâtre municipal. Des tréteaux, des pliants et le mistral Mais c’est la cour qui est au cœur du défi que Vilar veut relever : « Donner des spectacles capables de se mesurer, sans trop déchoir, à ces pierres et à cette histoire. » C’est pour elle qu’il choisit Richard II, et un théâtre shakespearien à même de dialoguer d’égal à égal avec la nuit, les étoiles, l’épaisseur du temps et l’histoire de la guerre dont le pays porte encore les stigmates. Jean Vilar : « Il va de soi que les conditions étaient celles de l’aventure. Et du romanesque. » Et c’est pour elle, encore, qu’il invente une scène immense, occupant la moitié de la cour, appuyée au mur sur lequel s’ouvre la fenêtre de l’Indulgence. Le plateau vide de 10 mètres sur 8 est précédé d’une passerelle de 28 mètres sur 4, qui relie les deux côtés de la cour. C’est un tréteau nu, posé sur des tonneaux, des rails et des madriers trouvés par le régiment. Avec lui, Vilar radicalise son esthétique : pas de décor, mais des costumes colorés peints sur des sacs de toile par Léon Gischia (1903-1991), et un espace en forme de ring délimité par quatre mâts surmontés d’oriflammes : « La masse à peine visible mais toujours présente du Palais ne pardonnerait aucune tricherie, aucune facilité », résumait Léon Gischia, en un constat que feront par la suite nombre de metteurs en scène et de décorateurs. L’austérité, la célèbre austérité vilarienne, est d’ailleurs de mise à tous les niveaux. Les comédiens savent à quoi s’attendre. Ils sont pour la plupart très jeunes, à peine 20 ans, comme Michel Bouquet, Jeanne Moreau ou Bernard Noël, ou guère plus, comme Jean Négroni, Alain Cuny, Silvia Monfort, Germaine Montero ou Béatrix Dussane, de la Comédie-Française. Vilar raconte, en 1963 : « Pas de défraiement journalier. Nous mangions tous à la table commune. Un comité composé de personnalités avignonnaises, charmantes absolument et hospitalières, nous avait invités à accepter telle chambre dans tel hôtel… ou chez eux. Il n’y eut guère de discussion concernant le logement, cette table d’hôtes, les contrats. Il va de soi que les conditions étaient celles de l’aventure. Et du romanesque. » Et l’aventure commence, donc, le 4 septembre, avec Richard II, et Vilar lui-même dans le rôle du roi. Corps sec de chat efflanqué, visage aux lèvres minces, lyrisme retenu, et ce regard à la fois brûlant et froid, visionnaire et inquiet. Michel Bouquet, qui ne jouait pas dans Richard II mais incarnait, dans La Terrasse de midi, un Hamlet moderne, se souvenait dans Le Monde, en 2002 : « J’ai été ébloui par le travail de Vilar. Il a trouvé le nombre d’or en simplifiant. C’était comme si on lisait la pièce sur un très beau vélin, avec des caractères magnifiques. Tout devenait clair, dans cette histoire qui ressemblait étrangement, par certains côtés, à ce qu’on venait de vivre. » Jeanne Moreau aussi rassemblait les fils de la mémoire, en 2007, pour les 60 ans du Festival. Lors de cette ouverture de 1947, elle jouait une suivante dans Richard II, et un double d’Ophélie face à Bouquet-Hamlet dans La Terrasse de midi : « La cour n’était pas aménagée, les gens apportaient leurs pliants, leurs chaises. Le plateau, c’était un vrai tréteau en bois qui craquait quand on marchait, cela faisait partie du charme. Quand le mistral soufflait, on avait froid, les gens étaient emmitouflés dans leurs couvertures. Nous portions de grands hennins et les voiles s’envolaient. On avait des gens de la ville, des gens de passage. Mais déjà la musique de Maurice Jarre, les oriflammes, c’était beau. » « Le concours des éléments » Voilà, Avignon et le théâtre se sont réinventés l’un dans l’autre, avec cette doctrine qui tient dans l’économie de mots de Vilar : « Le ciel, la nuit, la fête, le peuple, le texte ! » Et le public, écrit le critique du Monde, le 8 septembre 1947, « a su apprécier les efforts et les risques courus par ces comédiens jouant de nuit, en plein air. Dans le cadre du Palais des papes, l’acteur n’est plus défendu par le rideau, la rampe, le barrage de lumière, la scène encadrée et protégée par le décor. Il ne peut compter sur le concours des éléments qu’ailleurs meuble un plateau. Il doit remplir seul une immense scène presque nue, avancer largement parmi les premiers rangs du public, avec lequel il se trouve de plain-pied. Il faut qu’il possède assez de force, de présence, d’esprit, d’énergie verbale pour se servir de la grandeur du cadre au lieu de se laisser écraser par elle, le seul butoir du fond étant une muraille de quelque trente mètres et plus. Mais qui ne connaît la douceur de la nuit provençale, la majesté de la pierre de cette forteresse extraordinaire qu’est le Palais des papes, la résonance de l’air méridional, ne peut imaginer le surcroît de beauté que peut recevoir une interprétation digne des œuvres qui ont été présentées au public au cours de cette grande semaine d’art ». La légende est née, qui prendra toute sa dimension avec l’arrivée de Gérard Philipe (1922-1959) dans la troupe, en 1951, pour jouer Le Cid et Le Prince de Hombourg, et s’inscrira dans une série de clichés : Vilar, sa pipe, son chapeau de paille et ses espadrilles, les photos d’Agnès Varda (1928-2019) en noir et blanc (à partir de 1948), « Maria Casarès en salopette, Philippe Noiret en culotte de peau », comme l’écrira Philippe Caubère. Une légende née d’un combat, comme toutes celles de l’après-guerre. « C’est par ce combat quasi mythologique pour faire d’Avignon un théâtre qui soit à la fois “le” lieu du théâtre par excellence et un espace de théâtre unique, car il n’est pas fait pour ça, que le Festival est devenu une légende. Le théâtre s’y est comme forgé et refondé dans la nuit, dans les pierres, dans la ville, soudain partagé par un public qui sortait enfin des salles fermées », écrivent Emmanuelle Loyer et Antoine de Baecque dans leur livre-somme, Histoire du Festival d’Avignon (Gallimard, 2007). « Voilà, c’est tout simple… », disait Vilar. Vraiment ? L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Fabienne Darge Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets Liens Lire l’entretien avec Michel Bouquet : Une vie sous l'empire du jeu Lire aussi Agnès Varda expose la mémoire d'un théâtre devenu mythique Lire le compte-rendu du 8 septembre 1947 : LA SEMAINE D'ART en Avignon Lire aussi "Je revois Jean Vilar, son jansénisme, son ironie" Lire aussi Théâtre : une « semaine d’art » à Avignon à la Toussaint Légende photo : Léone Nogarède et Jean Vilar dans « Richard II », au Palais des papes d’Avignon, en septembre 1947. MARIO ATZINGER

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2020 10:58 AM
|
Par Thierry Jallet dans Wanderersite le 27 juin 2020 Il y a des présentations de saison plus attendues que d’autres en cette fin d’année. Celle de la Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche était de celles-ci. Nouvelle saison bâtie sur un nouveau projet autour de Marc Lainé qui succède à Richard Brunel, futur directeur de l’Opéra de Lyon, et qui s’est entouré d’un ensemble de douze artistes de différentes disciplines comme la littérature, la musique, les arts visuels, la danse ou encore le cinéma. Le 22 juin à 19h00, le public a pu découvrir le tout nouveau site internet présentant les perspectives de la saison 2020-2021. À cette occasion, Marc Lainé émet le souhait que la Comédie devienne « une fabrique de création permanente » mêlant continuellement ces différents champs artistiques. « Pour inventer des spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. » Relatant un rêve où l’esprit d’aventure de deux jeunes explorateurs rivalise avec la farouche volonté de rêver du vieillard qu’ils rencontrent et qui n’est autre que Marc Lainé lui-même, ce dernier salue « l’incroyable vitalité » de toutes ses équipes pendant ce sombre printemps, si atone et si plein d’incertitudes. Et découvrant la première saison qu’il présente, il faut reconnaître que nous partageons amplement sa « hâte » de commencer.
Marc Lainé
Outre les zones d’ombre qui entourent encore le retour dans les salles de spectacle, surviennent d’autres contraintes avec les travaux annoncés sur le bâtiment et la grande salle de la Comédie afin d’en améliorer encore l’accessibilité pour tous. C’est pourquoi la saison se déroulera en partie hors les murs, dans d’autres lieux sur le territoire des deux départements au sein desquels certains spectacles ont d’ailleurs été coréalisés – ce qui s’inscrit dans un « joyeux maillage de propositions artistiques » pleinement en lien avec le projet du CDN. Parmi ces coréalisations, on peut mentionner par exemple, le concert de Bertrand Belin – faisant partie de l’ensemble artistique de la Comédie – en compagnie des Percussions Claviers de Lyon, avec le Théâtre de la Ville de Valence ; avec le Train-Théâtre de Portes-lès-Valence, le projet très original pour enfants et adultes de Johanny Bert intitulée Une Épopée, s’appuyant sur des textes de Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguer, Arnaud Cathrine et Thomas Gornet ; ou encore avec la FOL 26 à l’Espace Liberté de Saint-Marcel-lès-Valence, Kamuyot de Ohad Naharin, dirigé par Josette Baïz avec treize danseurs de la compagnie Grenade pour « entraîner les spectateurs qui entourent l’espace de jeu, dans une énergie festive et électrique ».
La Comédie itinérante se prolonge également au cours de la prochaine saison avec des spectacles dont plusieurs créations, présentés dans différents lieux de la Drôme et de l’Ardèche comme La Vie invisible spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan de l’ensemble artistique de la Comédie, prenant appui sur un texte de Guillaume Poix à partir de témoignages de personnes non et mal-voyantes de la région, dans le but « d’inquiéter la perception » du public ; Tarfuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière conçu et joué par Guillaume Bailliart dans « une version de poche » et énergique de la célèbre comédie moliéresque ; Je suis une fille sans histoire d’Alice Zeniter – elle aussi dans l’ensemble artistique de la Comédie – pour un seul en scène sous forme d’une « conférence performée » cherchant à percer les arcanes de l’art du récit ; Et puis on a sauté ! mis en scène par Odile Grosset-Grange, sur un texte de Pauline Sales et une scénographie de Stephan Zimmerli faisant lui aussi partie de l’ensemble artistique, relatant l’authentique chute de deux enfants dans l’univers de leurs émotions, dans leur perception du monde si éloignée de celle des adultes parfois trop débordés. Voici que s’annoncent de beaux moments de théâtre, en itinérance hors le site de la Comédie. Marc Lainé poursuit donc ce dispositif afin de consolider certains partenariats, d’en développer de nouveaux. Afin de « commencer à penser des projets en commun ». Soulignons d’ailleurs combien le choix de cette démarche fédératrice paraît tout à fait signifiant dans un territoire où les distances géographiques creusent de plus grands fossés entre les publics et l’expression artistique. De cette façon, dans la richesse des propositions transdisciplinaires, le théâtre comme « formidable outil de compréhension du monde et de soi » devient possible et ce, dans de nombreux endroits pour le plus grand nombre.
Jusqu’ici nous avons déjà signalé la présence de plusieurs membres de cet ensemble artistique extrêmement cohérent autour de Marc Lainé. Cette douzaine d’artistes engagés interviendra beaucoup tout au long de la saison : Silvia Costa avec la création française du texte de Samuel Beckett Comédie / Dry smile Dry sob en novembre au Théâtre de la Ville ; Penda Diouf a écrit un texte qui évoque la Namibie et s’interroge sur le courage dans Pistes… mis en scène par Aristide Tarnagda à la Fabrique entre fin novembre et début décembre ; Tünde Deak crée un espace en suspension dans lequel évoluent les œuvres de Frida Kahlo avec D’un lit l’autre au Théâtre de la Ville en janvier ; Éric Minh Cuong Castaing mêle chorégraphie et art numérique dans une performance intitulée L’Âge d’or (avec Silvia Costa), et retrace son expérience auprès d’enfants atteints de troubles moteurs, en avril à la Bourse du travail ; Marc Lainé présente la répétition publique de Nosztalgia Express, « une enquête rocambolesque » où il joue avec les archétypes et les conventions génériques, au Théâtre de la Ville le 26 novembre ; puis en report de la saison 2019–2020, La Chambre désaccordée où partition musicale et chemins de vie s’entrecroisent, en mars au Théâtre de la ville ; enfin, il reprend Vanishing Point, cette sorte de road-movie théâtral inquiétant créé en 2015, avec pour cette saison Tünde Deak, Marie-Sophie Ferdane et Stephan Zimmerli, à la Comédie fin avril ; la programmation s’achève à la Comédie avec le répertoire de Tchékhov qu’abordent d’abord en mai, Cyril Teste en adaptant La Mouette, puis Lorraine de Sagazan (et Guillaume Poix).en juin, avec L’Absence de père « librement inspiré de Platonov ».
D’autres artistes de passage à la Comédie ne manqueront pas non plus de marquer fortement cette saison. Citons les deux danseurs François Chaignaud et Akaji Maro dans Gold Shower en octobre au Théâtre de la Ville ; Pippo Delbono rend hommage à son ami Bobò ancien SDF et acteur qui l’a accompagné pendant plus de vingt ans dans La Gioia au Train-Théâtre en novembre ; le lauréat du prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu propose une lecture musicale avec Florent Marchet de Leurs enfants après eux, en novembre à l’Auditorium de la Médiathèque Latour-Maubourg (sous réserve) ; toujours en novembre, Julien Gosselin met en scène Le Marteau et la Faucille d’après une nouvelle de Don de Lillo sur fond de crise financière, dans la continuité de la trilogie du même auteur qu’il avait montée au Festival d’Avignon en 2018 ;
Valérie Dréville dirigée par Jérôme Bel
le chorégraphe Jérôme Bel va certainement enchanter la scène du Théâtre de la Ville en décembre, avec Danses pour une actrice (Valérie Dréville) dans une démarche artistique où théâtre et danse se confondent dans l’interprétation de la comédienne ; Eric Vigner poursuit son exploration du répertoire racinien avec Mithridate, dans lequel on peut retrouver notamment Stanislas Nordey et Thomas Jolly, au Théâtre de la Ville, fin décembre ; dans le même lieu, en janvier, Chloé Dabert s’arrête à Valence avec Orphelins de Dennis Kelly, créé en 2013 et pour lequel elle a remporte le prix du Jury du Festival Impatience l’année suivante ; le chorégraphe Josef Nadj fait retracer la formation de l’univers à huit danseurs d’origine africaine, au Train-Théâtre en janvier ; au Train-Théâtre aussi, Célie Pauthe met en scène Antoine et Cléopâtre de Shakespeare en février ; citons encore Philippe Quesne toujours en février mais au Théâtre de la Ville avec Farm Fatale, « une fable écologique aux accents felliniens » dans un monde imaginaire comme seul sans doute, le metteur en scène de La Mélancolie des dragons sait le faire surgir.
Devant la richesse de ce premier programme tout à fait enthousiasmant, souhaitons la bienvenue à Marc Lainé, à ses équipes, aux membres de l’ensemble artistique qui l’entourent à la Comédie de Valence. Souhaitons-leur également dans des temps plus sereins, d’autres beaux rêves pour d’autres belles saisons à l’image de celle qui s’annonce et dont évidemment Wanderer ne manquera pas de suivre le déroulement.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 24, 2020 2:44 PM
|
Par Luc Leroux dans Le Monde, 24 juin 2020 Lectures en extérieur, one-man-show, fêtes, présentations… Dans la cité des Papes, où la 74e édition du Festival a été annulée le 15 avril, des directeurs de compagnie ont improvisé une programmation bis. Pour redonner voix au théâtre et sauver la saison. Les vitrines sont poussiéreuses et les affiches des théâtres d’Avignon invitent à des représentations pour le mois de… mars dernier. Les terrasses de la place Pie sont bondées de lycéens mais les comédiens et techniciens du Festival « off », qui les envahissent traditionnellement à cette période de l’année, n’y sont pas. Juin 2020 ne ressemble en rien à un mois de juin à Avignon. Même les directeurs artistiques ont « tout le temps qu’il faut » pour discuter avec les journalistes quand habituellement ils n’auraient « même pas deux minutes » à leur consacrer, happés par le montage des spectacles. « Bouh ! Ça sent le renfermé ici », soupire Laetitia Mazzoleni en ouvrant la porte du Théâtre Transversal, qu’elle dirige. Ses deux petites salles d’une quarantaine de places chacune, à deux pas des Halles, devaient accueillir seize spectacles par jour du 3 au 26 juillet. Elle a remboursé quelques-unes des huit compagnies qui avaient réservé des créneaux, mais la majorité a fait le choix de reporter à l’année prochaine. « Un “off” sans le “in”, ça aurait été compliqué et je ne souhaitais pas un Festival qui se raccroche aux branches, sans l’ambiance, et surtout, pour les compagnies qui investissent énormément l’été à Avignon, sans la certitude d’être vues par les professionnels. » Un spectacle sur quatre joués en France serait choisi à Avignon. Un « murmure théâtral » Le « off » et ses 1 500 spectacles programmés ont été annulés le 15 avril, quelques jours après l’annonce que la 74e édition du « in » n’aura pas lieu. Pas question pourtant d’éteindre le phare que représente Avignon pour le théâtre. C’est en se retrouvant seul dans la Cour d’honneur du Palais des papes, sans les gradins, « telle que Jean Vilar et René Char l’avaient découverte en 1947 », que Serge Barbuscia, le directeur du Théâtre du Balcon, a eu l’idée du « Souffle d’Avignon ». Un joli titre pour se remettre d’une maladie respiratoire. Ses complices de quatre autres théâtres, qui forment le collectif Les Scènes d’Avignon, ont rallié le projet : une semaine de lectures, en extérieur, dans le cloître du Palais des papes, du 16 au 23 juillet. Pas un mini-Festival, pas un ersatz de Festival, juste « un murmure théâtral » pour entretenir « le feu sacré d’Avignon », comme le dit le codirecteur du Théâtre du Chêne Noir, Julien Gelas, où son dernier texte, Le Rêve de Spinoza, sera lu. Pour autant, personne ne sait à quoi va ressembler Avignon cet été. Des compagnies viendront travailler les spectacles de leur prochaine tournée et, ici et là, devraient s’improviser des sorties de résidence. À l’Artéphile, les directeurs Anne Cabarbaye et Alexandre Mange sont en quête d’un lieu en extérieur, un parc, pour présenter, Buffalo, de Frank H. Mayer (1850-1954) mis en scène par Julien Defaye et Nicolas Gautreau. Sinon, le spectacle sera joué dans la salle de 94 places, avec la distanciation s’il le faut. D’autres, avec des compagnies prêtes à se déplacer, ont même cuisiné une petite programmation, sans rapport avec celle initialement prévue et qui fait normalement le chiffre d’affaires annuel des lieux du « off ». « Ne pas abandonner le terrain » Au Pixel Avignon, « il y va de notre survie de rouvrir », déclare Anaïs Gabay qui, avec Jérôme Tomray, dirige ce théâtre permanent très ouvert aux amateurs. Jérôme Tomray peste contre une décision d’annulation prise trop tôt : « On a la chance d’avoir des remparts, est-ce qu’on n’aurait pas pu prendre la température de tous ceux qui rentrent ? », lance-t-il. Du 24 juin au 14 juillet, le Pixel proposera une programmation variée incluant jeune public, one-man-show, musique, mais, mettent en garde ses deux directeurs artistiques, « ça ne va pas être un “off” ». Le Théâtre du Verbe Fou prendra le relais pour ses Estivales, (du 15 au 31 juillet). Pour Fabienne Govaerts, directrice de ce théâtre littéraire qui vit à Bruxelles mais passe tous ses étés depuis quarante et un ans à Avignon, « c’était inimaginable qu’il n’y ait rien. On y laissera des plumes, mais on aura le plaisir d’être ensemble ». À petites touches, les choses se précisent. La Factory de Laurent Rochut organisera sa fête, quatre jours autour du 14 juillet et des work in progress des compagnies qu’il soutient seront montrés au Théâtre de l’Oulle, à un public masqué ou pas, on verra bien… « Ne pas abandonner le terrain », c’était l’obsession d’Alain Timár, qui livrera quelques représentations de Sosies, la pièce de Rémi De Vos, actuellement en répétition à Châteauvallon (Ollioules, Var), mais aussi des sorties de résidence des deux ou trois compagnies que son Théâtre des Halles va accueillir cet été, « car si elles ne finalisent pas leurs spectacles maintenant, c’est la tournée 2021 qui sera par terre ». Et l’auditoire d’Avignon ? C’est la grande inconnue. « Il y a le public du territoire », se rassure Laurent Rochut, en se référant aux 70 % des spectateurs du « off » venant des départements limitrophes du Vaucluse. Et puis, glisse-t-on à l’Office du tourisme, bon nombre de festivaliers n’ont pas annulé leur location. Du coup, tout le monde espère que le « murmure » trouvera son oreille. Certes, le public ne courra pas d’un spectacle à un autre, mais des spectateurs sont prêts à jouer le jeu de la solidarité avec les comédiens. Et si ce non-Festival « off » permettait d’en revenir à quelque chose d’authentique, aux sources du théâtre ? « La relation qu’on va avoir avec le public sera d’une grande rareté », confie Alain Timar, qui se prend à rêver. Luc Leroux (Marseille, correspondant) Lire aussi Comment le Festival d’Avignon fait face aux conséquences de l’annulation Légende photo : Serge Barbuscia, directeur du Théâtre du Balcon, est l’instigateur du projet de lectures publiques « Souffle d’Avignon », qui se tiendra du 16 au 23 juillet dans le cloître du Palais des papes. Anaïs Boileau pour M Le magazine du Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 20, 2020 1:55 PM
|
Par Pascale Nivelle dans Le Monde, publié le 19 juin 2020
PORTRAIT A 52 ans, la comédienne césarisée pour « Barbara » s’engage autant par ses choix audacieux au cinéma et au théâtre que par ses coups de gueule politiques. Elle fut à l’initiative de la tribune, publiée fin avril, fustigeant Macron pour son oubli de la culture dans la gestion du Covid-19.
Il ne fallait pas enfermer Jeanne Balibar. Trente ans qu’elle donne de la voix de Paris à Berlin, sur scène ou au cinéma. A rester recluse dans son appartement du 11e arrondissement à Paris, contrainte à faire « des gestes barricades qui n’ont rien de révolutionnaire », elle est partie en toupie. Fin avril, tournant à grandes enjambées dans son salon, Marlboro entre les doigts, elle commence à écrire un texte dans son coin, puis tonne de sa voix de tragédienne au téléphone auprès de quelques amies : « Dix-sept millions pour Air France, sept pour le tourisme, cinq pour Renault… Et rien pour la culture ! »
La comédienne Marina Foïs applaudit, la réalisatrice Catherine Corsini est raccord avec l’actrice en pleine tempête shakespearienne : « C’est l’état d’urgence ! Exigeons un New Deal, un plan Marshall pour la culture ! » La cinéaste Pascale Ferran, camarade de lutte pour les sans-papiers, la pousse à monter au front. « Ecris et on en fera une tribune, ta voix va porter. » En fin d’après-midi, Jeanne Balibar se met au clavier : « Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » « Depuis six semaines, le ministre de la culture ne dit strictement rien. Des “je ne sais pas” à la pelle, quelques mots sur les théâtres privés, semble-t-il, de vagues encouragements, peut-être, aux assureurs pour assurer contre le Covid-19… »
Elle voit le paquebot de la culture sombrer avec, à son bord, les acteurs bankable et ceux qui doivent se contenter de seconds rôles, mais aussi les chauffeurs, les ouvreuses, les cuisiniers, les attachés de presse, les agents, les auteurs… Surtout n’oublier personne : « Comment feront les intermittents pour continuer à manger ? Comment feront les auteurs qui ne bénéficient même pas de ce régime ? tape Jeanne Balibar. Comment feront toutes celles et tous ceux que vous oubliez avec nous et dont l’emploi est comme le nôtre, discontinu ? » Festivals annulés, tournages interrompus, concerts supprimés, théâtres et salles de spectacle fermés, près de deux millions de travailleurs vont basculer au RSA, selon elle.
Une « trahison sociale »
Le réalisateur Michel Hazanavicius, souvent en pointe des combats de la profession, rallie la bande des quatre femmes. Jeanne Balibar, dit-il, « a eu l’intuition de montrer le vide total de la politique culturelle ». Il fallait du courage à une époque où « la moindre prise de position d’un acteur est moquée et vole en éclats » : « Il n’y a que des coups à prendre ». Du temps de Piccoli, Montand ou Signoret, ajoute le réalisateur, « la parole des artistes était légitime, les politiques s’arrachaient leur soutien. Aujourd’hui, ils nous fuient ».
La tribune, lestée dans un premier temps de 250 signatures illustres et inconnues, est publiée sur le site du Monde le 30 avril. Le lendemain, jour de Fête du travail sans muguet ni cortèges, coup de fil matinal chez Jeanne Balibar. Une conseillère de l’Elysée, d’un ton ampoulé : « Nous avions quelque chose en préparation pour la culture, mais votre tribune a accéléré le mouvement… » Quelques jours plus tard, le président organise une consultation en visioconférence avec quelques artistes réputés sympathiques, tels Sandrine Kiberlain, Eric Toledano et Olivier Nakache. Jeanne Balibar n’a pas été invitée.
Le 6 mai, Emmanuel Macron, en bras de chemise, son ministre au teint pâle à ses côtés, annonce « une année blanche » pour les intermittents et les incite à « enfourcher le tigre ». Les courtisans applaudissent, les optimistes reprennent espoir. Comediante ! Tragediante ! protestent Jeanne Balibar et ses amis. Le président a sauvé les intermittents du RSA, mais il n’a pas eu un mot pour les petites mains en contrat court. Ils flairent une « entourloupe », Jeanne Balibar se remet à son clavier.
« J’ai été virée enceinte, harcelée sexuellement… et maintenant je subis l’invisibilité des actrices de 50 ans. »
Jeanne Balibar
Nouvelle tribune, proposée cette fois à Libération, où elle n’a que des amis. Mais les journaux préfèrent les premières, les mots neufs. Son texte en faveur des sans-grade est publié en bas de page, sans les signatures pourtant encore plus nombreuses. Le chef de service de Libé a gardé un bon moment l’oreille endolorie après son coup de fil aux aurores : « Elle hurlait et m’a traité comme un valet qui aurait fait couler un bain un peu trop froid », raconte-t-il en riant. Laurent Joffrin, le directeur du journal, a lui aussi eu droit à la colère théâtralisée de Jeanne Balibar : « Trahison sociale ! » Elle sait parler très fort, peut hurler en allemand, chanter en italien, pleurer en récitant Shakespeare dans le texte. Et elle manie aussi très bien la rhétorique marxiste-léniniste.
L’amour du risque
Les enjeux de la culture, côté marge, l’actrice connaît. Vingt-cinq ans de cinéma d’auteur (chez Arnaud Desplechin, Jacques Rivette, Raoul Ruiz, Olivier Assayas…), un César en 2018 (pour Barbara, de Mathieu Amalric), des performances de légende dans les pièces de Frank Castorf (La Dame aux camélias, Les Frères Karamazov, Bajazet), deux albums (Paramour, Slalom Dame), un film en tant que réalisatrice (Merveilles à Montfermeil, sorti en janvier), de la danse également. Jeanne Balibar, c’est une star à l’ancienne, une Jeanne Moreau dopée à la prise de risque.
D’ailleurs, c’est en voyant l’actrice de Buñuel jouer le Récit de la servante Zerline, mis en scène par Klaus Grüber en 1987, qu’elle a décidé de grimper sur les planches. À 52 ans, sa silhouette de longue dame brune, sa voix inimitable, ses choix artistiques fantasques et chatoyants, sa fantaisie, sa liberté la classent en haut des marches. « Elle a un côté Ava Gardner, très hollywoodien, décrit Carole Bellaïche, sa photographe et amie. Et en même temps on la sent prête à prendre tous les risques, partir dans toutes les aventures, même au plus profond de l’abîme. » Autre proche, Bulle Ogier la voit « en diva rock’n’roll », et Emmanuelle Béart, héroïne douce-dingue dans son film Merveilles à Montfermeil, en « réjouisseuse qui fait s’envoler ».
Cela ne va pas sans angoisses qui, chez Balibar, prennent la forme de nœuds gordiens dans la tête. Marina Foïs résume cette peur des acteurs : une « terreur du projet qui ne vient pas qui nous envahit ». Et cette « sensation que tout est construit sur du sable » est démultipliée chez son amie : « Artiste comme elle est dans la vie, elle avance sans filet ni plan de carrière. » Au cours Florent, où elles se sont connues au début des années 1990, Balibar, « très belle, très mince, très singulière », était une star en puissance. « On savait tous qu’elle deviendrait une grande. » Déjà une voix, et une grande gueule, engagée dans la lutte contre le sida, pour les sans-papiers, contre la loi Hadopi…
En ce mois de juin, elle relaie sur Instagram la parole d’Assa Traoré réclamant justice pour son frère. « Elle s’engage dans tout ce qu’elle fait, avec une pensée politique permanente, assure son proche ami le penseur Philippe Mangeot, président d’Act Up à la fin des années 1990. Quelle actrice prend autant de risques aujourd’hui ? » Pour autant, Balibar n’est pas une forcenée du militantisme. Les tractages et les manifs, elle les laisse aux plus motivés. Quand elle s’engage, elle aime être sur le devant de la scène.
Dépendance aux Assedic
Et pourtant, sous ces airs de diva haut perchée, Balibar a des angoisses très terre à terre. Et l’angoisse est parfois matérielle, la vie en liberté rendant les fins de mois compliqués. « Quand on réussit à échapper à certaines normes artistiques, on se trouve pris dans les normes sociales… J’ai une image de femme libre, mais la vérité, c’est que j’ai très peu de propositions, je ne vis pas de mon travail. » Désignant son appartement, les meubles seventies, les livres, les DVD, le piano Gaveau, la photo de Robert Frank tirée de la série The Americans, elle assure : « Tout ce luxe, c’est le père de mes enfants [Mathieu Amalric] qui le permet. »
Jeanne Balibar a connu Avignon, la Comédie-Française, l’amour inconditionnel des critiques de Télérama, des Inrocks et des Cahiers du cinéma. Mais elle voudrait tout : la gloire et l’argent, Hollywood et le théâtre radical allemand… Tout, sauf sa dépendance financière « aux Assedic », comme elle dit, et à Mathieu Amalric. Là-dessus, la féministe s’emballe. « Mère, c’est le mauvais rôle », lâche-t-elle en paraphrasant Delphine Seyrig, une de ses rares idoles. Sa carrière étincelante et pourtant si modeste sur son compte en banque ? La faute à la misogynie : « J’ai été virée enceinte, harcelée sexuellement… et maintenant je subis l’invisibilité des actrices de 50 ans. »
Regard noir, bouche serrée, elle se prédit une funeste traversée du désert post-épidémie : « Je n’ai plus aucun projet, sinon de devenir junkie à Instagram. » D’ici à la fin de 2020, encore quelques dates incertaines pour la tournée de Bajazet, la sortie sine die de deux films, l’un de Xavier Giannoli adapté des Illusions perdues, de Balzac, avec Gérard Depardieu et Vincent Lacoste, et Memoria, une fable signée du cinéaste thaïlandais palmé à Cannes, Apichatpong Weerasethakul, où elle partage l’affiche avec son double blond, Tilda Swinton. « Un an de chômage devant moi et puis rien », lâche-t-elle de sa voix grave.
L’aventure « Bajazet »
2019 avait pourtant été une année faste, dans la dynamique du succès de Barbara. Dans la pièce Bajazet, présentée en décembre par Frank Castorf à la MC93, à Bobigny, l’actrice a repoussé les limites. Nue la plupart du temps, présente pendant les cinq heures du spectacle, corps et visage sous les néons, elle joue un texte impossible à retenir pour le commun des mortels, mix de Racine et d’Antonin Artaud. « Elle était totalement engagée, raconte Hortense Archambault, directrice de la MC93. C’est elle qui a poussé Castorf à monter la pièce en français, et cela a été une grande traversée dramaturgique ! Il y a eu une première réunion, les acteurs se sont saisis de la matière et sont montés sur le plateau au fur et à mesure. Et c’est tout, très peu de répétitions… Seuls les immenses acteurs sont capables de cela, c’est terriblement risqué. »
Bulle Ogier, fascinée par ses facilités et sa mémoire – « Jacques Rivette avait été stupéfait de la voir apprendre l’italien en quinze jours, il était très admiratif » – l’a vue évoluer en vingt ans, « passer d’une diction durassienne au registre de Delphine Seyrig, avant de devenir elle-même dans les spectacles de Castorf ». Dans Bajazet, Bulle Ogier a découvert chez Balibar une violence qu’elle ne lui soupçonnait pas : « Je ne pouvais imaginer qu’elle irait aussi loin. »
A la fin de l’année, l’actrice était sur le flanc. « J’étais surmenée, mon histoire d’amour avec Castorf était terminée, j’ai décidé de faire un break, en attendant les propositions, nous dit-elle. Puis le Covid est arrivé. » Elle se tait et verse des larmes en silence, sur son histoire d’amour défaite. « Celui qui rompt est parfois le plus malheureux, il porte la responsabilité des choses. »
Attaques sur la Macronie
Jeanne Balibar est sans filtre, comme les clopes de Michel Piccoli dans Les Choses de la vie, ce Piccoli qui vient de mourir et qu’elle pleure comme une orpheline, lui qui était, comme elle, toujours prêt à dégoupiller une vérité. En 2018, recevant le César de la meilleure actrice pour Barbara, ruban blanc contre les violences faites aux femmes sur sa robe de star, elle cite Jeanne Moreau et Delphine Seyrig et improvise un époustouflant plaidoyer féministe dans lequel elle évoque entre autres la solidarité entre les actrices.
Un an plus tard, quand Emmanuel Macron s’épanche, déclarant avoir pleuré en regardant Les Misérables, film de Ladj Ly dans lequel elle tient le rôle de la commissaire, elle riposte dans So Film : « Tant qu’il n’y aura pas de bouleversement de la politique fiscale, ça ne sert a rien d’aller voir un film et dire “je suis bouleversé”. C’est de la merde. »
En janvier, dans « Clique », l’émission présentée par Mouloud Achour sur Canal+, où le gouvernement a l’habitude d’en prendre pour son grade, elle en rajoute une couche : « Mes enfants m’ont demandé de dire un truc. “C’est vraiment un pur schlag, ce mec”. » « Schlag », dans les quartiers, c’est le mec largué, qui fait n’importe quoi, l’épouvantail des fils de Mathieu Amalric et Jeanne Balibar, l’un rappeur, l’autre redevenu étudiant après avoir passé un CAP de cuisinier. Tous deux militent à l’extrême gauche, on les soupçonne d’inspirer leur mère, qui ne demande pas mieux.
« Ce n’est pas une muse. C’est une coautrice, capable de se livrer sans limites aux hommes qui la dirigent. » Philippe Mangeot
Dans les Cahiers du cinéma, elle provoquait encore, en janvier : « Si on interdit le voile dans l’espace public comme signe d’adhésion à une religion, il faut aussi interdire le complet cravate des banquiers et PDG comme signe d’adhésion à la religion de l’argent. » En mai, interrogée dans son salon, elle s’en est prise de nouveau au premier de cordée sur France Inter : « Le 17 mars, on a entendu le président de la République dire que personne ne serait laissé sur le bord de la route, mais on n’a toujours rien entendu sur la culture ni le pain de ceux qui sont en contrat court… Tous ces gens vont crever ! »
Premiers engagements
A quelques arrondissements de chez Jeanne Balibar, l’historienne Emmanuelle Loyer sourit en écoutant sa vieille amie entonner la Révolution. Elles étaient ensemble en khâgne à Henri-IV, au temps où Charles Pasqua faisait la chasse aux étudiants dans le Quartier latin. Fille unique, Jeanne habitait rive gauche, elle avait une mère magnifique, Françoise Balibar, qui enseignait la théorie de la relativité en tailleur Saint Laurent. La khâgneuse avait aussi un père célèbre et communiste, Etienne Balibar, professeur à la Sorbonne et auteur, avec Louis Althusser et d’autres, de Lire le Capital (éditions François Maspero, 1965). Sa réputation, bien qu’un peu en baisse après la chute du Mur, résistait du côté de la rue d’Ulm.
Jeanne avait fait une croix sur une carrière de danseuse étoile, ses parents ayant refusé qu’elle entre à l’Opéra de Paris, et préparait Normale-Sup, son tribut à sa famille d’universitaires. « J’avais arraché de haute lutte de faire sport-études en danse au lycée, mais, après le bac, il m’a fallu rentrer dans le rang, raconte-t-elle. Dans ma famille, l’art était sacralisé, mais ce n’était pas pour nous, il fallait être bien prétentieux pour se croire artiste. »
Manifester sur le boulevard Saint-Michel, risquer les coups de matraque et les lacrymos étaient permis. Fin 1986, Jeanne Balibar et Emmanuelle Loyer, 18 ans, défilent contre le projet de loi Devaquet, visant à réformer l’université, pleurent Malik Oussekine mort rue Monsieur-le-Prince sous les coups de CRS et lisent les romantiques allemands pendant des nuits entières. « Un peu trop sans doute, remarque Emmanuelle Loyer. L’amour-passion nous a joué des tours. »
Une actrice incendiaire
L’amour, pour Jeanne Balibar, n’est pas du marivaudage. Elle y a laissé quelques plumes, et gagné des galons. A 20 ans, fraîche normalienne, elle s’est enfuie du domicile familial pour suivre un amoureux à Cambridge, au prétexte de préparer l’agrégation d’histoire. L’exil, loin de la rue d’Ulm et des exigences familiales, a décidé de son destin. En rentrant à Paris, elle s’inscrit au cours Florent et, trois mois plus tard, réussit le Conservatoire. Puis elle est recrutée sans période d’essai à la Comédie-Française, d’où elle s’envole vite, comme Isabelle Adjani en son temps.
« Les gens qui prétendent tout expliquer me dérangent, ce n’est pas le rôle de l’art. » Jeanne Balibar
Sa carrière décolle à Avignon en 1993 dans Dom Juan, mis en scène par Jacques Lassalle. Ses cothurnes du cours Florent, Sandrine Kiberlain, Marina Foïs, Eric Ruf, Edouard Baer, sont aux premières loges dans la Cour d’honneur du Palais des papes. Au cinéma, ses rôles au côté de Mathieu Amalric puis sous sa direction notamment font d’elle une actrice de premier plan.
A 45 ans, nouvel amour, nouveau pays. Elle rejoint Frank Castorf à Berlin et joue dans les dernières productions de la Volksbühne, institution du théâtre engagé berlinois dont la dissolution, fin 2019, sonne la fin de l’histoire d’amour. Amoureuse, Balibar n’est jamais potiche. « Ce n’est pas une muse, assure Philippe Mangeot, qui l’a connue à Cambridge et a suivi ses aventures artistiques et amoureuses. C’est une coautrice, capable de se livrer sans limites aux hommes qui la dirigent. »
Que serait le film Barbara sans elle ? Et Les Frères Karamazov, mis en scène en 2016 par Castorf dans une friche industrielle glaciale de la Seine-Saint-Denis ? Politique à fond, la pièce de l’ex-citoyen d’Allemagne de l’Est l’a mise sur la voie des artistes engagés. « Elle y était centrale, magistrale, une vraie machine intellectuelle », témoigne Hortense Archambault, qui a produit le spectacle à Bobigny.
Utopie politique
Mais rien, ajoute Philippe Mangeot, l’ami de toujours, ne décrit mieux Jeanne Balibar que son propre film, Merveilles à Montfermeil, sorti en janvier. Elle y a travaillé pendant sept ans, y a rassemblé toutes ses convictions, a réuni ses amies Bulle Ogier et Emmanuelle Béart, sa troupe d’acteurs de théâtre, Valérie Dréville et Jean-Quentin Châtelain. Et presque tous ses hommes, Amalric, Katerine, Castorf, jusqu’à son père, Etienne Balibar, incarné par un buste de Lénine qui traîne dans plusieurs scènes.
Les critiques, certaines très enthousiastes et d’autres sévères, ont parlé de « comédie loufoque », ce qui l’a énervée. « Est-ce qu’on dit de Nanni Moretti qu’il est loufoque ? C’est parce que je suis une femme qui fait du cinéma ? C’est un film politique, un manifeste ! » Loufoque, peut-être pas, mais fantasque sûrement et mystique un brin, cette histoire d’une maire de Montfermeil (Emmanuelle Béart) qui veut réenchanter la politique en instaurant entre autres la sieste quotidienne obligatoire ou une fête de la brioche.
On ne comprend pas tout – pourquoi Jeanne divorce de Ramzy alors qu’ils s’aiment, pourquoi des œufs sont écrasés sur une effigie de Macron comme dans un rite vaudou (référence au réalisateur et ethnologue Jean Rouch), pourquoi les habitants dansent seuls à la fin… Elle assume : « Les gens qui prétendent tout expliquer me dérangent, ce n’est pas le rôle de l’art. » Elle confie, sans qu’on soit plus avancé : « Ça raconte mon expérience de la maternité, je ne comprends pas tout et je ne cherche pas à comprendre. »
Il suffit de se laisser porter par la poésie, faire comme Emmanuelle Béart, la maire qui finit en burn-out, débordée par ses administrés comme une mère par sa marmaille. Merveilles à Montfermeil exprime « l’incompréhensible », définition de la culture pour laquelle elle se bat. Sorti début janvier, le film a connu une carrière modeste. Et s’est retrouvé confiné, comme sa réalisatrice. Depuis, la cage s’est rouverte. Mais la liberté a un goût amer, et l’espoir d’un grand soir pour la culture risque de s’évanouir dans l’indifférence.
Pascale Nivelle
Liens Lire aussi
« Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » Lire aussi
Frank Castorf, le théâtre de Racine et son double Lire aussi
Jeanne Balibar, la belle échappée Remerciements, Jeanne Balibar, César 2018 de la Meilleure Actrice dans BARBARA from Académie des César on Vimeo.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2020 1:04 PM
|
Par Marie Richeux sur le site de France Culture - 18 juin 2020 écouter l'entretien (17 mn) Faire soin | Que peut la danse face à la maladie, au corps abîmé ou vieillissant ? C’est la question que se pose le chorégraphe Thierry Thieû Niang et à laquelle il tente de répondre en amenant le mouvement et le geste dans des hôpitaux, des prisons ou des maisons de retraite.
Septième temps de notre notre série "Faire soin" qui donne la parole à des artistes dont la pratique se situe à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale, du soin et de la création. Aujourd’hui, Marie Richeux productrice de "Par les temps qui courent" s’entretient avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Il évoque l’expérience fondatrice menée il y a quelques années avec quatre enfants autistes, dont il a gardé les traces d’un monde sans parole. Danser, quand on est malade, exilé, fatigué, c’est troquer les mots, parfois indicibles, contre un geste qui parle autant.
Thierry Thieû Niang est danseur et chorégraphe. Pour cette saison artistique 2019/2020 - désormais si particulière - il est artiste associé de l’Hôpital Avicenne, par l'intermédiaire de la MC93 à Bobigny en Seine-Saint-Denis.
Quand on entre à l’Hôpital Avicenne, on pénètre dans un monde à part entière. Chaque soignant y parle au moins une autre langue ou dialecte, et peut y avoir recours pour décrire un symptôme, expliquer un protocole, ou parler d’une maladie. Thierry Thieû Niang, qui a fréquenté les scènes du Festival d’Avignon ou des théâtres nationaux, connaît aussi les couloirs désinfectés, les box de chimiothérapie, les chambres stériles en hématologie. Partout, il danse, il ouvre le temps déplié de la chorégraphie, fait doucement peser son corps, reçoit celui de l’autre, porte, déplace, joue. Dans cet entretien, il s’agit avec lui de n’attendre rien et ne pas avoir peur, de danser trois heures, - le temps d'une perfusion par exemple - et de faire surgir une écriture des gestes pour, à chaque fois, augmenter le présent.
Marie Richeux : Comment votre pratique de la danse a-t-elle croisé pour la première fois le monde du soin ?
Thierry Thieû Niang : J'ai rencontré le monde du soin à travers une résidence à l'hôpital 3bisf à Aix-en-Provence, un lieu d'art contemporain implanté au cœur même d'un hôpital psychiatrique et qui propose à différents artistes, écrivains, plasticiens, chorégraphes, d'investir ses services et de rencontrer ses équipes au travail. J'ai tout de suite demandé s'il y avait un endroit où je pouvais rencontrer des enfants. On m'a proposé le service de psychiatrie des enfants autistes. J'ai été le premier artiste que recevait ce service, et une équipe très, très émouvante m'a laissé carte blanche pour travailler avec cinq enfants. Ils avaient entre cinq et dix ans, et je pouvais passer presque une heure, une heure et demie avec chacun d'eux, chose qu'on ne fait jamais, et vivre dans un espace qui était une espèce de salle fermée. Et j'ai dansé avec chacun de ces enfants pendant une heure à essayer un pas-de-deux, plus ou moins chaotique. Il fallait s'apprivoiser l'un et l'autre. C'est comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser à d'autres corps, à d'autres mouvements pour en faire de la danse.
MR : Quelqu'un était-il là pour assurer une sorte de médiation entre vous et ces enfants ?
TTN : Un infirmier ou une éducatrice étaient présents pour faire le lien entre l'enfant et moi, donc se mettant elle-même ou lui-même en mouvement. Je devais passer par un autre corps pour pouvoir atteindre celui de l'enfant. D'autres fois, cela se faisait directement entre l'enfant et moi, le plus souvent en silence, parce que la musique pouvait effrayer certains, ou interférer entre eux et moi. L'objet même grâce auquel on faisait écouter la musique créait une interférence : l'enfant venait y jouer, le frappait ou le mettait en bouche. J'ai donc décidé qu'il n'y ait rien, que le silence, un bonjour au départ et ensuite, du mouvement pur. Et voilà.
MR : Qu'avez-vous appris grâce à cette expérience initiale - dont vous dites qu'elle vous a ouvert à un champ chorégraphique plus large, mais aussi à des rencontres dans ces différents mondes du soin ? Et comment vous a-t-elle conduit à intervenir auprès de patients Alzheimer ?
TTN : J'ai appris qu'il me fallait un autre corps pour danser, pour continuer à inventer ma danse. Cette expérience m'a décomplexé par rapport à la question de la spécialité, de la hiérarchie. Quelque chose, tout à coup, me poussait dans le métier, il fallait être chorégraphe. Il fallait produire une pièce, une création et un jeu, et là je pouvais expérimenter un autre temps, le temps d'un corps, d'un corps fatigué, d'un corps empêché, d'un corps chaotique. Je voyais en littérature, au cinéma, et même au théâtre, des tentatives d'amener des corps amateurs, fragiles, sur un plateau ou dans un récit, et ça m'a donné envie d'aller vers ces hommes et ces femmes de théâtre, et vers ces écrivains. Sur ce projet avec l'enfant autiste, j'ai eu envie d'inviter Marie Desplechin, puisque je savais qu'elle-même avait traversé une expérience de séparation avec l'enfance. Cela m'a amené à collaborer avec d'autres artistes, à oser entrer dans les prisons, les maisons de retraite, les services de gériatrie. Et aujourd'hui dans les services d'hématologie, d'oncologie et de chercher dans ces lieux un mouvement qui ne soit pas réparateur. Je ne me sens pas thérapeute du tout, je ne guéris rien mais j'accompagne un geste qui amène du présent, et ce présent c'est la vie.
MR : Vous êtes actuellement en résidence à l'hôpital Avicenne, par le truchement de la MC 93 à Bobigny. Que signifie être artiste associé dans un hôpital comme celui-là ?
TTN : C'est vertigineux parce que cet hôpital est un monde, il a une histoire très forte puisqu’il a été créé après la Première Guerre mondiale, il était "l'hôpital franco-musulman" à l'époque. Etre artiste ici, c'est d'abord être témoin. Je participe à la vie du service, j'ai la possibilité, guidé par les soignants, d'accompagner tel ou tel patient, de passer trois heures dans sa chambre pendant une chimiothérapie, ou lors de séjour en chambre stérile, et de pouvoir proposer d'écouter de la musique, de lire des textes, de danser ou de faire des massages. Et, avec des patients qui ne parlent pas français, donc aidé par des soignants qui parlent la langue, je cherche un mouvement, je danse avec eux, d'abord un petit mouvement, puis un plus grand. J'essaie toujours de danser en partant. Quand je pars, ils choisissent une musique que je danse, et pour eux, c'est une imprégnation, une traversée qui me permet de reconnaître ce qu'est un corps fatigué, et de voir comment l'imaginaire porté par la danse, par le geste, remet tout à coup du présent, de la joie, et crée des sursauts où le geste se réorganise. Il y a comme ça pleins de mouvements qui naissent parce qu'il y a eu une rencontre autour d'un imaginaire.
MR : Ce qui m'émeut en vous écoutant, c'est votre façon d'affirmer avec beaucoup de douceur que l'imaginaire, le mouvement, son histoire, voire l'histoire de l'art, ont leur place à l'hôpital, dans un endroit où on vient se faire transfuser, soigner, voire se faire annoncer une maladie grave. Là où on trouverait la démarche incongrue vous la présentez comme allant de soi.
TTN : Je suis persuadé que, à tout endroit de notre société, à tout endroit où il y a du commun, de l'en-commun - y compris dans des endroits fragiles, vulnérables, comme la prison ou l'hôpital - l'histoire de l'art a sa place, parce qu'elle est un lien avec le dedans et le dehors, avec les récits intimes et collectifs. D'autant plus à Avicenne où beaucoup de soignants sont issus d'autres cultures, d'autres pays. Nous, artistes, ne venons pas simplement égayer ces endroits-là, y ouvrir des fenêtres, accompagner le processus de la maladie - avec guérison ou non. Nous venons accompagner en proposant nos imaginaires, mais aussi en convoquant l'histoire de l'art, la peinture, la danse, et les danses d'aujourd'hui. Je me rends compte qu'avec n'importe quelle personne, qu'elle ait 14 ou 87 ans, à l'hôpital, il y a quelque chose qui est partagé, et qui du coup déplace la relation : on est au même endroit, dans le même bateau, dans la même chambre. On est collés l'un contre l'autre sur le coin du lit, à regarder une vidéo de danse, à écouter de la musique, à regarder un tableau, et quelque chose circule, se raconte. Et je m'agrandis autant qu'eux, on s'enrichit l'un l'autre. Souvent, je quitte l'hôpital pour la MC93 où je retrouve le studio de danse et, soit je m'allonge sur le sol, je ferme les yeux et me laisse traverser par tout ce qui s'est passé, soit je danse et je sens que, dans la danse qui m'habite à ce moment-là, je n'ai pas besoin de m'étirer, de m'échauffer, de me préparer, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà été dans le mouvement et dans la danse.
Extraits
Une jeune fille de 90 ans, documentaire réalisé par Valéria Bruni Tedeschi et Yann Coridian. VOIR L'EXTRAIT VIDEO
Références musicales
Eve Risser, Des pas sur la ville
Sandra Nkaké, No more trouble
Eve Risser, Des pas sur la neige
"Faire soin", un rendez-vous aux frontières de la création et du soin
Chaque lundi et chaque jeudi, "Faire soin" (*) vous propose un entretien de Marie Richeux avec un ou une artiste qui expérimente, depuis longtemps, à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale, du soin et de celui de la création.
Tous les épisodes de "Faire soin" sont à retrouver ici
L'équipe : Jeanne Aléos, Romain de Becdelièvre, J. Hascal, Lise-Marie Barré, Charlotte Roux et Marianne Chassort
Légende photo :Thierry Thieu Niang• Crédits : Vincent Josse

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2020 11:28 AM
|
Par Nathalie Dray dans Libération du 16 juin 2020 Le road-movie endeuillé et habité de Mohamed El Khatib emmène le spectateur sur la piste d’un mystérieux héritage marocain.
Par quelle grâce une œuvre nous ensorcelle et vient nous rappeler que le cinéma n’a besoin que de nous, de notre regard, de notre croyance surtout, pour exister, quand, à peine terminée elle nous échappe encore ? L’image se fige, le générique de fin défile, des noms d’acteurs apparaissent et l’on reste comme stupéfait. Du temps a passé mais qu’a-t-on vraiment vu ? Quelle est la part de fiction et de réalité dans ce que l’on croyait jusque-là être un documentaire au sens strict ? Manipulation ? Fi des étiquettes trop convenues, Renault 12 est une splendeur, précisément parce que son auteur, Mohamed El Khatib, qui est aussi metteur en scène de théâtre, n’aime rien tant que brouiller les pistes pour laisser émerger une vérité dans ce moment de flottement, une émotion bouleversante, faisant écho aux fracas de la vie.
Fantômes.Il y a là un peu de la démarche d’Alain Cavalier, que Mohamed El Khatib a rencontré - notamment sur scène, dans son spectacle Conversation en 2018. Chez l’auteur de Renault 12 comme chez celui d’Irène, même économie de moyens, même petite caméra numérique, mêmes dispositifs simples, presque enfantins, aux confins de l’intime, la mort comme hantise et cette façon de croire aux fantômes, d’invoquer par toutes sortes de fétiches un être cher disparu, dont on ne peut ni ne veut faire son deuil. Pour El Khatib, l’impossible oubli, c’est celui de sa mère, Yamna, décédée à 61 ans dans un hôpital d’Orléans où elle avait passé les deux dernières années de sa vie. D’elle, il a gardé une pièce d’identité, beau visage fatigué, le bracelet d’hôpital qu’elle avait au poignet et quelques enregistrements, car le grain de la voix, la signature vocale, qui est aussi ce qui nous distingue, finit toujours par s’effacer avec le temps. Sur une carte de la région, il dispose ces maigres reliques… Une petite voiture en plastique à la main roule sur le papier, le long des routes départementales, Beaugency, Meung-sur-Loire où il passa son enfance, Orléans, comme on parcourt un territoire mental, le chemin qu’il a fallu accomplir pour se construire une vie entre deux cultures. Dès lors, ces objets qui servaient à identifier cette mère aimée le renvoient à sa propre identité, à ses origines mélangées, culturelles et sociales - devenir un intellectuel franco-marocain, prof de fac, homme de théâtre, en étant issu d’une famille modeste… Un dialogue intérieur se noue, mais chacun sait que le chagrin ne remplit pas tout, qu’il est sans cesse parasité par des démarches administratives, cérémonies funéraires, rapatriement du corps au Maroc… Le tête-à-tête avec la mort est sans cesse court-circuité par la vie, par les autres, les coups de téléphone, on n’a jamais la paix. Sans oublier la succession, les biens qu’on a en partage, un patrimoine dont on ignore tout et qui lui aussi vous appelle, et vous encombre en même temps. Cocasse. Au bout du fil, l’oncle de Mohamed lui demande de venir à Tanger récupérer un mystérieux héritage, mais, chose primordiale, il doit absolument faire le trajet en voiture et pas n’importe laquelle, en Renault 12, ce véhicule qui fit les grandes heures du constructeur automobile dans les années 70, et qui est particulièrement prisé au Maroc pour sa résistance tout-terrain et sa vélocité sur les pistes cahoteuses de l’Atlas… Sans trop savoir dans quoi il s’embarque, El Khatib en déniche une, traverse la France puis l’Espagne, jusqu’au rif marocain, avec la procession des Renault 12 au soir tombé… Et le film prend alors la forme d’un road-movie intime et burlesque, parfois malaisant au fil des rencontres - une amie qui trouve inconvenant de ne pas pleurer ; sa sœur qui lui reproche d’utiliser l’image de sa mère pour construire son œuvre ; cet ami, Daniel, qui lui demande de remiser la culpabilité complaisante et mortifère du fils endeuillé, etc. Et jusqu’au dénouement surprenant, la découverte cocasse du fameux héritage - qu’il fallait bien évidemment entendre dans tous les sens du terme - et dont on préfère réserver la surprise, pour ne pas déflorer l’effet de sidération jubilatoire. Nathalie Dray Renault 12 de Mohamed El Khatib (1 h 30) sur Arte le 15 juillet à 23h20. Film disponible sur le site d'Arte à partir du 8 juillet 2020 :
Légende photo : Extrait du film de Mohamed El Khatib qui évoque, entre la France et le Maroc, les ponts entre deux nationalités, à travers ce qui sera probablement un road-movie surprenant.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2020 11:42 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - Sortir, le 17/06/2020 Il en rêvait depuis l’enfance. Si les théâtres rouvrent, l’auteur Alexis Michalik créera à la rentrée une comédie musicale, “Les Producteurs”, inspirée d’un film hilarant de Mel Brooks. Avez-vous repensé ce spectacle à la lueur du confinement ?
Je ne ferai pas intervenir le coronavirus ou le confinement dans « Les Producteurs ». Je monterai la pièce telle qu’elle est. De manière générale, j’ai toujours besoin d’un peu de recul pour parler d’un sujet et je n’aime pas les gags qui font référence à l’actualité. Tout simplement parce que ça donne des spectacles qui vieillissent vite. Donc vous ne francisez pas cette pièce américaine ?
Non, même si les chansons et les textes seront, bien sûr, en français. En revanche, je veillerai à ce que les références soient accessibles au public. Les Producteurs est un spectacle qui se passe dans les années 50 à Broadway. La pièce prend tout son sens dans ce contexte. Elle parle d’un producteur qui essaie de monter la pire pièce du monde,
Des fleurs pour Hitler, une comédie musicale sur l’ascension du Führer et sur son amour pour Eva Braun. L’histoire est beaucoup plus drôle si elle se passe juste après-guerre à New York plutôt qu’en France. Qu’est-ce qui vous a conduit vers cette comédie, qui n’a jamais été montée en France ?
Un vieux rêve. Depuis que je suis enfant, je suis passionné de comédie musicale, surtout celles de l’âge d’or américain, qui va des années 30 aux années 60, avec Ginger Rogers, Fred Astaire, Gene Kelly. En France, nous aimons surtout les tours de chant, comme Notre-Dame de Paris. J’ai donc cherché ce qui pouvait séduire un public français. Il fallait une comédie qui fasse rire et permette ainsi au spectateur d’accepter des codes tels que la durée. À Broadway, ce type de spectacle dure 2h30 avec entracte. Êtes-vous fidèle au film de Mel Brooks ?
Oui, mais il existe des différences entre ce film, qui se passe en 1968, et sa version en comédie musicale, celle que je crée. Cette dernière est plus populaire ; l’auteur a réécrit des scènes, coupé ou étoffé certains rôles. Les Producteurs ont connu une histoire incroyable : en 1969, Mel Brooks tourne son film. À la fin des années 90, il l’adapte en une comédie musicale qui se joue plus de 2 000 fois à Broadway et obtient dix Tony Awards [l’équivalent de nos Molières, NDLR]. Le succès est tel qu’en 2005, un film, pas terrible, est même réalisé à partir de la comédie musicale. Thomas Jolly veut monter « Starmania », Ivo van Hove veut créer « West Side Story ».
Quel est cet engouement des metteurs en scène de théâtre pour la comédie musicale ?
Notre intérêt vient sans doute du fait qu’il s’agit d’un spectacle total. Non seulement il faut une bonne histoire mais également de bons acteurs qui savent aussi chanter. Pour tout metteur en scène, le challenge est intéressant. “Sa maîtrise des espaces et de sa troupe est fascinante” Avez-vous travaillé à distance avec les acteurs ?
Pendant le confinement, une chorégraphe leur a envoyé tous les deux jours des tutoriels vidéo de claquettes afin que le jour J, ils soient capables de danser. Est-ce que cette création marque un tournant dans votre rapport à la scène ? D’habitude vous montez vos propres textes !
Il s’agit, au contraire, d’un retour vers mes premières amours. J’ai toujours aimé le show et eu envie d’être aux commandes d’une grosse machine. La comédie musicale est un art exigeant et très hiérarchisé : il y a les personnages principaux, les personnages secondaires et l’ensemble. Je veux développer une harmonie entre tous les membres de la troupe. Lorsque j’écris, je fais en sorte qu’il n’y ait pas de premiers ou de seconds rôles. Les acteurs sont tous payés pareil. Vous citez souvent Ariane Mnouchkine parmi vos influences. Pourquoi ?
Elle réinvente le théâtre à chacun de ses spectacles. Elle réinvente même le Théâtre du Soleil, puisqu’elle le repeint, en change la configuration. Elle repart toujours de zéro. Sa maîtrise des espaces et de sa troupe est fascinante. Son lieu, où se mélangent les nationalités, aussi. En réalité, la metteuse en scène et la personne m’inspirent. Comme elle, je cherche à faire un théâtre populaire exigeant, qui ne laisse personne à la porte. Pour moi, elle est la patronne ! Vous dites que vous ne voulez pas diriger de théâtre. Mais le Soleil ?
Aucun sauf le Soleil ! Si un jour elle veut que je le reprenne, pas de problème, je suis là ! Comment avez-vous vécu le confinement ?
Il a été difficile pour tous, comédiens, auteurs, metteurs en scène, directeurs ; chacun s’interroge sur l’avenir. Je ne suis pas le plus à plaindre. J’ai la chance de faire partie des auteurs qui gagnent bien leur vie. J’ai consacré cette pause à l’imaginaire, au calme et à la réflexion. Les Producteurs, du 11 sept. 2020 au 31 jan. 2021. Du mardi au samedi, 20h, samedi et dimanche, 15h. Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, 9e. 01 48 74 25 37 (20-125 €) ----------------------------------------------------- Le phénomène Alexis Michalik : comment fait-il pour remplir les théâtres parisiens ? Article de Fabienne Pascaud le 6/02/2020 dans Télérama Insolent de réussite, le comédien et auteur franco-britannique compte actuellement cinq pièces à l’affiche dans les théâtres parisiens. Portrait d’un jeune homme surdoué. Alexis Michalik est un phénomène. Un ovni. Une boule d’énergie et de santé dans le petit monde anémié et souffreteux du théâtre privé parisien. Les cinq pièces que ce comédien auteur franco-britannique de 37 ans a mises en scène lui-même tambour battant ne sont-elles pas toujours, simultanément, à l’affiche de cinq théâtres de la capitale ? Et en faisant le plein ! Du jamais-vu. La Scala se targue même déjà crânement de dix mille spectateurs pour le dernier opus du surdoué, Une histoire d’amour, tout juste créée en janvier. Et le Palais Royal a fêté le 5 février la 1 000e représentation d’Edmond, qui aura rassemblé 1 million de spectateurs avec les tournées… Le recordman au physique de jeune premier bon chic bon genre – cheveux blonds, yeux bleus, dents blanches, gentillesse, politesse et sourire éclatant – aurait-il des secrets ? Tout semble lui réussir avec une chance insolente. À 22 ans, avec une bande de copains issus comme lui du conservatoire d’art dramatique du 19e arrondissement de Paris, il revisite à l’arrache et réécrit Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, et une Mégère à peu près apprivoisée, de Shakespeare. Bingo dans le Festival Off d’Avignon ! Voyant que l’écriture ne lui sied pas si mal, celui qui fut le Roméo d’Irina Brook (2001) et qui quitta le Conservatoire national d’art dramatique sitôt admis – sans doute parce que ça n’allait pas assez vite – se lance dans ses premiers textes. Il a le sens du spectacle. Sa mère anglaise et traductrice, son père peintre d’origine polonaise l’ont mené tôt au Soleil d’Ariane Mnouchkine, aux Bouffes du Nord de Peter Brook. Il y apprend que le grand art au théâtre est d’émerveiller, d’étonner, de faire penser et rêver sans jamais ennuyer. Alexis Michalik déteste s’ennuyer et ennuyer. Ce passionné d’histoire – surtout celle du XIXe siècle, qui hante ses créations – est pourtant un artiste d’aujourd’hui. Continuellement pressé. Il veut que ses intrigues démarrent au quart de tour et enivrer son public de rebondissements toujours recommencés. C’est sans doute une des clés de son succès. On s’ennuie rarement aux comédies extraordinairement enchevêtrées, explosées dans le temps, l’espace et sans aucune unité d’action d’Alexis Michalik. On y retrouve le goût des trépidants contes d’enfance, cheminant ardemment sur des routes pleines de tours et détours, de surprises et de curiosités. Les jeunes (et les moins jeunes) générations aiment à écouter ses récits comme elles aimaient que papa maman leur content des histoires, autrefois, avant de s’endormir. Alexis Michalik ou un certain bonheur d’enfant retrouvé. Plaisir régressif ? Pas seulement. Du Porteur d’histoire, créé en 2011 (au Théâtre des Béliers Parisiens), à Une histoire d’amour, qui vient de débuter à la Scala, du Cercle des illusionnistes, créé en 2014 (actuellement au Théâtre de l’Œuvre), à Edmond, depuis 2016 au Théâtre du Palais Royal, sans oublier Intra Muros, né en 2017 et qu’on peut encore voir à la Pépinière Opéra, l’efficace faiseur de théâtre est un compositeur de motifs dramatiques dont les infinies arborescences évoquent les jeux vidéo ou les séries. Alexis Michalik incarne à merveille, reproduit à merveille la culture d’aujourd’hui, les formes, goûts et plaisirs d’aujourd’hui. Certes Edmond mettait en scène la première représentation apocalyptique et triomphale du Cyrano d’Edmond Rostand, en décembre 1897. Mais montée avec le rythme de 2016, le sens du clip et de la vidéo de YouTube. Il est magiquement de son temps, capte nos usages culturels et y adapte ses créations avec une habileté et un opportunisme consommés. Il sait faire, il sait plaire. En témoigne encore son Histoire d’amour, où se lançant pour la première fois dans le mélodrame et les larmes, il a compris que dans nos sociétés inquiètes le public avait besoin de partager de communes émotions. Et à travers des sujets, des thèmes actuels : l’amour de deux femmes et la grossesse médicalement assistée, le cancer, les accidents de voiture… Plus qu’un cynique à recettes patentées, Michalik est finalement un joueur. Qui tente, ose. Plein de désirs et d’ambitions. De vitalité. Il a voulu adapter à grands frais Edmond au cinéma (c’était au départ un scénario de film), le résultat public n’a pas répondu à ses espérances. Il s’est lancé en littérature avec un très long premier roman un rien embarrassé et touffu, Loin, qui n’a pas remporté de prix mais cinquante mille lecteurs. Il avance. Il ne reste pas en place. Il se réinvente en permanence. Autre raison de son succès que cette infernale énergie et volonté de conquête ? L’artiste pourtant est fidèle. Celui qui aime tant construire et déconstruire dans ses textes aux allures de Rubik’s Cube, travaille toujours avec la même troupe de comédiens, certes forcément renouvelée vu les succès et les reprises. Des comédiens peu connus au physique banal et familier qui nous ressemblent et dans lesquels on ne peine guère à se retrouver. On est comme chez soi dans les spectacles de Michalik. Ses délires dramatiques n’entraîneront que mieux et plus loin. Surtout que le chef de troupe pratique un art de la direction d’acteurs et de la mise en scène d’une efficacité et d’un pragmatisme extrêmes. Situations courtes et ciblées, changements de décors accélérés, la représentation répugne au temps mort. Toujours cette hantise enfantine de l’ennui… Ensuite, quand il ne joue pas avec eux – comme dans Une histoire d’amour –, Michalik dirige ses acteurs avec une sensibilité complice, sans à-coup. On sent l’habitude de travailler ensemble, l’envie de partager sans rivalité. À quoi ? À la simplicité d’être qui règne sur le plateau. Le metteur en scène sans visionnaires ambitions artistiques, esthétiques, se plaît juste aux idées qui créent la connivence. Entre acteurs, et avec le public. Il aime ainsi casser en permanence le drame par l’humour. Faire rire aux pires moments. Comme on peut le faire entre copains. Ou il débute encore Une histoire d’amour par ce vieux tube d’Aznavour chanté successivement par toute la troupe au micro, face spectateurs. Pour un peu l’assistance s’y mettrait à son tour. D’emblée. Du théâtre pour vivre ensemble, à consommer ensemble. Dans la nuit obscure de la salle où tout est possible. Ce n’est pas rien. Crédit photo : Alexis Michalik. Photo: Jérome Lobato pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 1:30 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama 12/06/2020
Fort en langue et en gueule, généreux, il était doté d’une extraordinaire palette qui lui a permis d’évoluer dans de nombreux registres. Le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, créateur de La Criée, à Marseille, vient de disparaître à l’âge de 83 ans.
L’œil gourmand et le sourire goguenard, la tignasse bouclée enfantine et la bouille réjouie – qui savait aussi se faire colérique et terrible, voir son interprétation du roi Lear… –, Marcel Maréchal fut un tonitruant et généreux acteur. De la veine des bateleurs, de la grande tradition des tréteaux. Mais avec une palette de toutes les couleurs, de toutes les matières, de toutes les fureurs. De Scapin au Malade imaginaire, d’Arnolphe à Sganarelle, de Fracasse à Falstaff, de maître Puntila à Cripure, cet amoureux de Molière comme des contemporains forts en langue et en gueule – de Jean Vauthier à Louis Guilloux, sans oublier Jacques Audiberti – fut un admirable serviteur des textes et de leurs musiques scéniques. Il les laisse orphelins. Il vient de disparaître à 83 ans.
Un amoureux des mots en effet. Cet autodidacte lyonnais né en 1937 sut les faire rayonner comme des soleils ou des plats raffinés de sa ville. C’est l’amour même de cette parole, de ce dialogue à faire naître avec le public qu’il aimait tant, qui le poussa, dès 21 ans, à diriger des théâtres. Et le meilleur, le plus savoureux de son parcours artistique rabelaisien se niche dans ces années 1950 où s’invente la décentralisation imaginée après guerre.
C’est à Lyon, au Théâtre du Cothurne qu’il fonde en 1958 – dans la lignée de son aîné Roger Planchon, autre fameux homme de théâtre lyonnais – que commence l’odyssée théâtrale populaire du prodigieux cabot. Sa passion des poètes lui fait programmer d’emblée contemporains et classiques dans des mises en scène qui n’ont pour ambition que de faire sonner le texte et réjouir les spectateurs.
Spectacles hauts en couleur
À La Criée, qu’il ouvre sur le Vieux-Port de Marseille en 1981 – après avoir dirigé, à Lyon toujours, le Théâtre du Huitième, puis le Gymnase à Marseille –, il saura cultiver les mêmes bonheurs de jeu et de spectacles hauts en couleur et pêchus, ouvertement hérités d’un théâtre populaire à la Jean Vilar, où flamboient uniquement jeu de l’acteur et respect de l’auteur. D’Alexandre Dumas à Bertolt Brecht, de Shakespeare à Jean Vauthier, de Beckett à Jean Genet, de Novarina à Tchekhov, ses programmations étaient toujours ambitieuses et pleines de drames et de joies.
Hélas, Marcel Maréchal rêva un jour de quitter les territoires pour monter à la capitale. L’aventure ne lui réussit pas. Il n’en possédait pas les codes. Nommé au Théâtre du Rond-Point en 1995, il ne sut guère réveiller le palais endormi que lui avaient laissé les Renaud-Barrault et y accumula les spectacles médiocres, dépourvus de cet esprit flambant qu’il avait eu autrefois. L’air de Paris allait mal au tribun des planches. La critique l’abandonna, le public aussi.
Galère parisienne
La qualité exceptionnelle de son parcours passé lui valut quand même de diriger, à partir de 2001, les Tréteaux de France. Jusqu’à 2011, il n’y fit pas non plus merveille, reprenant de vieilles recettes, aigri peut-être de n’avoir jamais eu la reconnaissance méritée…
Mais après des parcours lyonnais et marseillais fondateurs et exemplaires, que diable Marcel Maréchal allait-il faire dans la galère parisienne ? Elle broya ses gourmandises, ses générosités, ses ambitions.
Reste un homme de scène qui jamais ne lâcha le plateau, un acteur metteur en scène qui eut jusqu’au bout la passion de jouer les spectacles qu’il montait, souvent autour de lui. Narcissisme ? L’homme avait trop à cœur d’embarquer son public dans l’aventure du verbe. Plutôt feu sacré. Et il est essentiel qu’il continue partout d’en brûler.
Légende photo : Cripure de Louis Guilloux. Mise en scène de Marcel Maréchal. Paris, Petit T.N.P., avril 1967. © Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 6:25 PM
|
Marcel Maréchal, biographie et hommages publics
Marcel Maréchal - Biographie concise Né le 25 décembre 1937 LYON (1958-1975) : 1958 - Fondation de la Compagnie des Comédiens du Cothurne. 1960 - La troupe s’installe rue des Marronniers. Elle passera huit ans dans le petit théâtre où avait débuté Roger Planchon. Elle y créera notamment Badadesques et Capitaine Bada de Jean Vauthier et Cripure de Louis Guilloux. 1968 - Ouverture du Théâtre du Huitième avec la création de La Poupée de Jacques Audiberti. L’année suivante, Marcel Maréchal joue Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis en scène par Patrice Chéreau, puis il monte Le Sang de Jean Vauthier. Il commence alors à constituer son répertoire. FESTIVAL D’AVIGNON (1973-1974) : Dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, en 1973 avec Cavalier seul d’Audiberti et en 1974, avec Holderlin de Peter Weiss, La Poupée de Jacques Audiberti et Fracasse. COMÉDIE FRANÇAISE (1975) : En 1975, sous la direction de Pierre Dux, Marcel Maréchal met en scène La Célestine avec Denis Gence dans le rôle-titre. MARSEILLE (1975-1994) : En 1975, Marcel Maréchal et sa compagnie quittent Lyon pour Marseille. Ils s’installent au Théâtre du Gymnase en attendant que s’ouvre, en 1981, sur le Vieux-Port, dans l’ancienne Criée aux poissons, le nouveau grand théâtre dont ils ont rêvé. La compagnie porte désormais le nom de son créateur et acquiert le statut de Théâtre National de Région. À Marseille, il y aura Molière, Brecht (La Vie de Galilée), Beaumarchais, Tchekhov, ainsi que les grandes fresques populaires comme Les Trois mousquetaires, Fracasse ou le Graal-Théâtre. Mais il y aura surtout, et en nombre, ces auteurs d’aujourd’hui que Marcel Maréchal s’attache à faire connaître : Valère Novarina, Jean Genet, (Les Paravents) David Mamet, Sam Shepard, Nella Bielsky, John Berger, Jean-François Josselin, Marcel Jouhandeau, Pierre Laville et bien sûr Jean Vauthier. Avec Pierre Arditi, Don Juan de Molière et Puntila et son valet Matti de Brecht. PARIS (1995-2000) : En janvier 1995, Marcel Maréchal prend la direction du Théâtre du Rond-Point. Il transforme totalement la grande salle, multiplie les activités et présente en cinq saisons plus de 50 spectacles, pour la plupart des créations contemporaines. Il met lui-même en scène Paul Claudel, Jacques Prévert, David Mamet, François Billetdoux, Jean Vauthier, Jacques Audiberti et joue En attendant Godot de Samuel Beckett, Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg avec Pierre Arditi. Il offre une saison entière à Harold Pinter et fait rencontrer au public, avec France Culture, une trentaine de poètes d’aujourd’hui. LES TRÉTEAUX DE FRANCE (2001- 2010) : En janvier 2001, Marcel Maréchal succède à Jean Danet à la direction des Tréteaux de France, Centre Dramatique National. Il fonde une nouvelle troupe, monte et interprète successivement L’école des femmes de Molière, Ruy Blas de Victor Hugo, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, George Dandin de Molière, Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Lettres d’une mère à son fils de Marcel Jouhandeau, La Maison du peuple de Louis Guilloux, Audiberti & fils, Le Bourgeois gentilhomme de Molière repris au Théâtre 14 à Paris en janvier 2012. Dans le cadre des Tréteaux de France, il a créé et dirigé le Festival Théâtral de Figeac de 2001 à 2010. OEUVRES : La Mise en théâtre (1974), Une anémone pour Guignol (1975), L’Arbre de mai (1984), Fracasse, Un colossal enfant, Rhum-Limonade, Cripure, d’après Louis Guilloux, opéra, musique de François Fayt (création prochaine) DISTINCTIONS : Prix de la Critique dramatique 1969 et 1983 ; par trois fois, Molière de la Décentralisation ; nomination au Molière du meilleur acteur pour le rôle de Puntila… TOURNÉES À L’ÉTRANGER : Russie (Moscou, Saint-Petersbourg), Ukraine, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Allemagne de l’Ouest, Allemagne de l’Est, Amérique du sud (Brésil, Argentine, Urugay, Chili), USA, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Togo, Niger, Nigeria, Japon, Chine… Décès le 11 juin 2020 Biographie détaillée : http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html ------------------------------------------------------------ HOMMAGES DANS LA PRESSE ET SUR LES RESAUX SOCIAUX Dans la presse : Hommage de Fabienne Pascaud / Télérama : Mort de Marcel Maréchal, acteur tonitruant et directeur de théâtre contrarié Hommage d'Armelle Héliot / Le Figaro : Marcel Maréchal, poète des tréteaux Hommage de Brigitte Salino / Le Monde : Marcel Maréchal, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, est mort Hommage sur le site France TV INFO https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/marcel-marechal-comedien-metteur-en-scene-et-fondateur-de-la-criee-a-marseille-est-mort_4005953.html Hommage de Jacques Nerson dans l'Obs : Jusqu’au revoir, Monsieur Marcel Maréchal Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est mort, ce jeudi 11 juin, d’une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans. C’est l’une des figures majeures de la décentralisation culturelle d’après-guerre qui disparaît. Marcel Maréchal (1937-2020), ici en 2012 dans « Cher menteur », de Jean Cocteau, au Théâtre La Bruyère, dans une mise en scène de Régis Santon. (DELALANDE RAYMOND/SIPA / SIPA) Dans les années 1960-1970, le petit milieu du théâtre lyonnais avait deux pôles. D’un côté les fidèles de Roger (Planchon), de l’autre les partisans de Marcel (Maréchal). Le premier exerçait ses talents au Théâtre de la Cité de Villeurbanne qui allait reprendre le sigle TNP en 1972, le second, de six ans son cadet, dirigeait le Théâtre du Cothurne, puis à partir de 1968 le Théâtre du 8ème à Lyon. Rares étaient les acteurs à faire la navette entre les deux troupes. Au-delà d’une rivalité anecdotique de chefs de bandes, il y avait entre Planchon et Maréchal de profondes divergences. Divergences politiques : l’un et l’autre étaient de gauche, mais Planchon était marxiste, et Maréchal, chrétien de gauche. Divergences esthétiques surtout : Maréchal n’avait pas la rigueur de Planchon. Disons qu’il était plus dionysiaque qu’apollinien. Autrement dit, plus dans la lignée de Jean-Louis Barrault que dans celle de Jean Vilar. De fait ses spectacles n’atteignait jamais la perfection formelle de ceux de Planchon ou, moins encore, ceux de Chéreau ou Strehler. En revanche, grand découvreur de textes, il avait un goût très sûr pour les poètes baroques comme Jacques Audiberti (« le Cavalier seul », 1963, « la Poupée », 1968, « Opéra parlé », 1980) et Jean Vauthier (« Badadesques », 1965, et « Capitaine Bada », 1966, « le Sang », 1970, « Ton nom dans les nuées, Elisabeth », 1976, « les Prodiges », 1997), ou encore pour Louis Guilloux (avec « Cripure », 1967, adapté de son grand roman « le Sang noir », puis « la Maison du peuple », 2002). Un comédien chimiquement pur En réalité Maréchal était, comme Barrault, plus animateur que metteur en scène. Et comédien avant tout. Un comédien chimiquement pur. Nul n’a oublié ses envolées lyriques dans le rôle de Cripure. Courtaud, affligé d’un physique ingrat à la Charles Laughton, il était doté d’un charme irrésistible. Son sourire jovial, ses yeux plissés par la ruse, ce mélange unique de trivialité et de poésie, en faisaient un Falstaff natif. Ajoutez à cela son accent de gone de la Croix-Rousse, jamais tout à fait perdu, même quand il a quitté Lyon pour Marseille où il a fondé et dirigé La Criée (de 1981 à 1994), puis laissé Marseille pour Paris où il a repris le Rond-Point (1995-2000), et enfin pris la tête des Tréteaux de France (2001-2011) dont la mission itinérante s’accordait bien avec le talent baladeur de ce fils de chauffeur routier. J’ai dit qu’aucun de ses spectacles n’était parfait et ne m’en dédis pas. Mais il faut ajouter que ce saltimbanque avait un tel sens de la scène, un tel amour du public, qu’il n’ennuyait jamais. C’est grâce à vous, Marcel, et à Roger aussi, ne vous en déplaise, que m’est venue la passion du théâtre. Mes parents vous ont maudit mais moi, je vous rends grâce. Par Jacques Nerson Publié dans l’Obs le 12 juin 2020 -------------------------------------------------------------------------------- Hommage de Michaël Mélinard / L' Humanité : Marcel Maréchal, L'homme théâtre Metteur en scène et comédien, auteur et adaptateur, directeur, Marcel Maréchal est mort le 11 juin. Il a tout fait sur les planches au fil d’une carrière débutée à Lyon et poursuivi à Marseille, Paris et sur les routes de France. Il a beaucoup travaillé à la reconnaissance d’auteurs contemporains en revenant régulièrement aux classiques. Marcel Maréchal, metteur en scène, acteur, auteur, adaptateur et directeur de compagnie et de théâtre, est mort le 11 juin. « Si, pari stupide, je devais choisir entre toutes mes casquettes, c’est sûr que je choisirais d’être comédien. Parce que jouer est aussi aventureux que les exploits de Bombard ou de Thor Heyerdal » révélait-il dans « un colossal enfant », un livre d’entretiens. Avec lui, disparaît l’un des grands chantres de la décentralisation du théâtre opéré après guerre et un défenseur acharné du théâtre public. Pourtant, ses relations avec le ministère de tutelle n’ont pas toujours été au beau fixe. Né en 1937 à Lyon, il y fonde et dirige le théâtre du Cothurne en 1958. Il met en scène Beckett, Goldoni, Anouilh, Audiberti, Ionesco, Marlowe ou Louis Guilloux. Une ancienne halle aux poissons C’est là que débutent Pierre et Catherine Arditi, Marcel Bozonnet ou Maurice Benichou. En mai 1968, il inaugure le théâtre du Huitième, toujours dans la capitale des Gaules. Avec sa troupe de la compagnie du Cothurne, il revisite Shakespeare, Nazim Hikmet, Georg Buchner ou Kateb Yacine, continuant un travail axé sur les auteurs contemporains, sans délaisser le théâtre classique. L’aventure théâtrale se poursuit à Marseille, d’abord au théâtre du Gymnase à partir de 1975. Mais son grand œuvre reste la fondation du théâtre de la Criée, une ancienne halle aux poissons, située sur le vieux port. Inauguré en 1981, il offre à la cité phocéenne un espace à la hauteur de ses ambitions culturelles. Il y demeure près de 15 ans. Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Dumas ou Théophile Gautier y côtoient Sam Shepard, David Mamet, Jean Genet ou Valère Novarina. Lieu itinérant En 1995, il est nommé à la tête du théâtre du Rond-Point à Paris. L’exercice n’est pas de tout repos entre les critiques pas toujours tendres avec lui et les cafouillages de Catherine Trautmann, la ministre de la culture, au moment de sa succession. Il a tout de même contribué à rénover ce lieu, situé à côté des Champs-Elysées et devenu aujourd’hui l’une des salles parisiennes les plus courues. En 2000, à l’issue de son mandat parisien, Maréchal espère faire son retour à Lyon au théâtre des Célestins. Il hérite finalement en 2001 du théâtre des Tréteaux, lieu itinérant comme un pied de nez à son histoire familiale. « L’aventure sous chapiteau me fait rêver depuis longtemps. J’ai deux souvenirs magiques de théâtre rattachés à cette forme de présentation, La Bonne Âme de Se-Tchouan, montée par Jean Dasté, et Richard III, avec Vittorio Gassmann, qui a mené une expérience de théâtre populaire en Italie. J’avais très envie de jouer sous chapiteau. Mon père, qui possédait une petite entreprise de camionnage, aurait bien ri de ma promotion » confie-t-il alors au Figaro alors que son aventure mobile commence. L’histoire se poursuit jusqu’au début des années 2010 où le Bourgeois gentilhomme conclut son parcours aux Tréteaux. S’il a beaucoup joué dans ses mises en scène, il a aussi été dirigé par d’autres : Chéreau dans Don Juam en 1969, Vitez à Avignon, dans la cour des comédiens de Lavaudant en 1996 ou encore dans une adaptation d’Israël Horovitz, Opus Cœur, mise en scène par Caroline Damay en 2015. Affaibli depuis quelques années, il s’est éteint à l’âge de 82 ans. ------------------------------------- Hommage de Stéphane Capron / Sceneweb Un grand nom de la décentralisation théâtrale française vient de mourir, le metteur en scène Marcel Maréchal. Il est décédé à l’âge de 83 ans. Il a dirigé des théâtres prestigieux comme la Criée à Marseille ou les Tréteaux de France. Avec la disparition de Marcel Maréchal, c’est l’un des derniers pionniers de la décentralisation qui s’éteint. Il débute sa carrière à Lyon à la fin des années 50 et fonde le Théâtre du Cothurne qu’il dirige pendant 17 ans. C’est dans cette troupe que Pierre Arditi fait ses premiers pas d’acteur. Lorsqu’il inaugure en 1968, le Théâtre du 8ème toujours à Lyon, il ouvre la programmation à la musique. Il est le premier à accueillir en France Mick Jagger, les Who ou les Pink Floyd… On est alors très loin du théâtre de Jacques Audiberti dont il présente deux pièces dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en 73 et 74. Dans les années 80, avec le développement de la décentralisation, Marcel Maréchal fonde La Criée, le Théâtre national de Marseille. Il y joue pendant 13 ans, les plus grandes pièces du répertoire. Puis on lui confie en 95 le théâtre du Rond-Point dont il fait moderniser la grande salle qui prend alors le nom de Renaud-Barrault.
En 2001, à 64 ans, il devient le directeur des Tréteaux de France, le seul centre dramatique de France itinérant. Marcel Maréchal peut ainsi continuer de sillonner pendant 10 ans la France en interprétant ses pièces fétiches de Molière, Dandin ou Le bourgeois gentilhomme.
Stéphane Capron ---------------------------------------- Sur les réseaux sociaux : Jack Lang, sur Facebook : Marcel Marechal, celui pour qui Molière et tant d’autres grands dramaturges n’avaient pas de secrets ne rugira plus sur les planches. Quelle tristesse pour le théâtre français. Tout au long de sa vie, il s’est engagé pour celui-ci. Grand militant de la décentralisation culturelle, de Lyon, à Marseille, à Paris, il aura tant oeuvré pour faire vivre les tréteaux de France ! Acteur, metteur en scène, écrivain, j’aimais sa poésie, immense et généreuse, et sa vigueur contagieuse. C’était un prince intrépide et expressif des mots. Comme le mistral qui souffle à Marseille, Il avait la voix forte, orageuse et la faconde si belle, si méditerranéenne. Combien de talents nous a fait découvrir Marcel Maréchal ? Des acteurs, comme Pierre Arditi ou Maurice Bénichou, mais aussi des auteurs, comme Jean Vauthier ou Louis Guilloux. Optimiste déterminé, il avait le goût de la vie et de la joie. Il aura été un artiste total, un homme-orchestre entièrement dédié aux arts et à la culture. Il me manquera beaucoup. Toutes mes pensées vont aujourd’hui à sa famille et à son fils Mathias. ------------------------------------------------------ Le metteur en scène Renaud-Marie Leblanc J'étais encore un jeune adolescent très mal dégrossi, gauche et inculte lorsque dans les années 80, je pénétrais pour la première fois une salle de théâtre. C'était Le Théâtre La Criée à Marseille, dans cette grande salle aux allures de paquebot. On y jouait Capitaine Bada de Jean Vauthier. Je ne connaissais rien du théâtre. Je n'y étais jamais allé. Sur scène, #marcelmaréchal, acteur, metteur en scène et directeur du théâtre. Je me souviens encore de lui comme si c'était hier, virevoltant, incandescent, libre! oui libre. c'est le souvenir que je veux emporter de Marcel, et qui a bouleversé ma vie ce jour-là. Plus tard, il m'aura croisé sur un travail d'atelier où je travaillais Capitaine Bada, justement. C'était très mauvais. il avait été d'une bienveillance extrême, de celle qui n'existe presque plus aujourd'hui. Plus tard, encore, je participerai à l’aventure. Cripure, Tartuffe, Le Malade Imaginaire, La Paix, Les Paravents, Falstafe. Tout cela de mes 21 à mes 25 ans. Marcel enthousiaste, Marcel qui m'appelait Monsieur l'évêque à cause de ce Marie dans mon prénom, Marcel qui me dit un jour à une lecture de note " c'est très bien, je n'ai rien à te dire", Marcel colérique et il fallait déguerpir vite, Marcel te faisant une blague juste avant que tu rentres sur le plateau avec lui, Marcel n'arrivant pas à retenir son texte du monologue du Malade Imaginaire, Marcel farceur, Marcel joyeux, Marcel en apesanteur, un soir, sur scène, réinventant tout... Marcel, chef de troupe : toutes ces rencontres, tous ces gens, toutes ces humanités partagées, ces fêtes aussi, chez lui, dans sa famille; Marcel et sa famille si accueillante, si fragile aussi. Cet homme aura bouleversé ma vie, il m'aura fait aimé le théâtre comme personne. je me souviens aussi de la fascination qu'il avait pour les auteurs, pour la langue. Je crois qu'il restait toujours impressionné par les mots, par la poésie, comme un enfant qui découvre les pouvoirs du langage. Audiberti, Vauthier, Novarina ( oui , on oublie qu'il a été l'un des premiers à faire découvrir l'écriture de Novarina). Plus tard, comme metteur en scène, j'ai monté le Malade Imaginaire de Molière. je me suis souvenu de ce qu'il disait : c'est la pièce la plus Shakespearienne de Molière. Quelque part, Molière , c'était lui, dans ses excès, sa générosité, son élan solaire. Un soleil, oui c'est ça. Marcel, c'était un soleil qui aimait les gens. Simplement. Marcel était autodidacte, il ne faisait rien comme personne. C'était sa force. La liberté. Je t'ai aimé Marcel, comme un autre père, même si tu ne l'as jamais su. et je crois que mon père, le vrai, t'as aimé aussi de m'aimer quelque part un peu. Aujourd'hui Marcel Maréchal s'en est allé. Pas pour moi. Pas pour nous, tous ceux qui ont vibré un jour dans une de tes aventures théâtrales. Tu resteras une étoile incandescente dans la constellation du théâtre. J'ai une pensée émue et profonde pour ses proches et ses enfants, Mathias Maréchal et Laurence. Au revoir Marcel Renaud-Marie Leblanc ----------------------------------------------------------- Marcel Maréchal est mort. S’il y a une origine, c’est celle-ci : 1983 ? 1984 ? Un soir, mes parents nous emmènent, mon frère et moi, voir une représentation des « Trois Mousquetaires » à la Maison des Arts de Créteil. Je crois que c’est le premier spectacle que je vais voir, qui n’est pas spécifiquement destiné aux enfants. Ce que je vois me bouleverse ; tout est merveilleux et magique. Ça y est, je veux être acteur, ou mousquetaire, je veux être là, sur scène, avec eux, courir, combattre, aimer, sous le faux soleil du théâtre, ovationné par huit cents personnes. Cette soirée va, littéralement, changer ma vie. Mes parents vont m’inscrire à l’atelier théâtral d’Ivry ; moi, petit garçon introverti, enfermé en lui-même, je vais découvrir que je peux parler. Surmonter ma peur, la transformer - aller sur scène et parler ! Être regardé, écouté. Jouer avec les autres. Dire les mots des autres. Être plus heureux, plus fort, sur scène - avec eux. Merci maman, merci papa. Et merci, Monsieur Maréchal. Adrien Michaux --------------------------------------------------- Page des Tréteaux de France Si cher Marcel... De grand et de tout coeur avec nos si grands si beaux moments de notre jeunesse... dix-huit ans de partage, côte à côte... le meilleur du théâtre. Mes plus chaleureuses pensées à Luce, Mathias, Laurence. Pierre LavilleNous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de Marcel Maréchal ce 12 juin 2020.
Il aura été un grand comédien, auteur, metteur en scène passionné et un découvreur de talents. Depuis sa compagnie du Cothurne créée à Lyon en 1958, jusqu’aux Tréteaux de France qu'il dirigea de 2001 à 2011, en passant par le Théâtre de la Criée à Marseille et le Théâtre du Rond-Point à Paris, il laissera le souvenir de nombreuses mises en scène foisonnantes et débridées. On se souviendra de ses adaptations des Trois Mousquetaires et de Capitaine Fracasse, de son grand amour pour Alexandre Dumas et Théophile Gautier mais aussi de sa passion pour Audiberti, Louis Guilloux, Kateb Yacine… Toute l'équipe des Tréteaux de France - Centre dramatique national adresse à sa famille et à ses proches leurs pensées de soutien et de réconfort les plus affectueuses. Robin Renucci Comédien, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France CDN ----------------------------------------------------- Merci Marcel ! Marcel Maréchal a quitté la scène du monde.
Avec lui, part un pan de l'histoire d'un théâtre de création populaire de haute tenue.
Avec lui, part un pan de l'histoire de Marseille, de ce Théâtre du Gymnase à cette Criée qu'il a rêvée, inaugurée et dont il a encré définitivement la nature profonde sur les quais du port...
Il y a impulsé et créé, joué et dirigé avec une énergie belle et des envols de poésie touchant, les publics les plus variés si bien qu'il a « fabriqué » durablement le public marseillais.
Incroyable « bête de scène », son sens du plateau l'amenait immanquablement à faire mouche à chaque mot ou regard…
En tant que « patron » et meneur d'équipes, s'il pouvait paraître parfois ailleurs – main sur les babines, brouillant ses traits, regard perdu, cheveux en bataille, au fond, il était là, aux côtés de chacun dans sa singularité et sa capacité à se mettre au service du projet artistique qu'il portait... et partageait d'abord avec ses équipes, ensuite avec le public. Au-delà de son côté un peu ours timide, homme du monde, il savait s'ouvrir et accueillir l'Autre.
C'est comme çà que je l'ai connu alors que, jeune étudiante en Arts plastiques, j'avais demandé à son décorateur de l'époque, Alain Batifoulier, quel chemin prendre, quelle formation effectuer, pour devenir décoratrice de théâtre comme on disait à l'époque... Deux semaines plutard, j'étais assistante de décoration pour les trois créations du Graal théâtre. C'est là qu'entre Marcel, Alain, Bernard Ballet et Gaston Serre, j'ai appris un métier d'humanité, de solidarités et de créativité. Homme de fidélités, il m'a intégrée pour cinq années décisives pour mon parcours personnel à ses équipes dans lesquelles j'alternais entre l'assistanat de décoration et la réalisation des archives du TNM sous la direction du regretté Jean Rouvet, un être hors du commun s'il en fut. Homme de la main tendue, il a accueilli le Théâtre de la mer et les créations d'Akel Akian dans ses programmations, lui ouvrant large les portes de sa « Petite salle ». Nous sommes encore quelques uns à nous souvenir des youyous des mamans des Quartiers Nord à La Criée, que ce soit lors de la conférence de presse de « Baisers d'hirondelles » ou dans la salle au milieu des applaudissements en fin des représentations. Je me rappelle aussi... C'est la dernière fois que je l'ai vu... c'était à la Librairie des Arcenaulx, lors d'une de ses lectures... Il commence à lire, lève les yeux, son regard tombe sur moi... Il s'interrompt... et lance un vibrant hommage à Akel Akian... Sans aucun doute, ces deux anciens lyonnais, l'un des traboules, l'autre émigré des oueds et terres rouges du Maroc, se sont reconnus, rencontrés, à Lyon, à Marseille, sur les scènes et dans ces mondes de poésies où ils respiraient ensemble. Avec Marcel Maréchal une part du théâtre du XXéme siècle s'est refermée. Gageons que chaque parcelle de théâtralité qu'il a semée sur sa trajectoire inspirée germe et germera encore.
Avec lui, s'est écrite une part de mon histoire professionnelle, la plus fondatrice.
A toi, Marcel, reconnaissante !
Que les scènes de l'imaginaire te fassent une place de choix où continuer à jouer, à l'infini...
Frédérique Fuzibet, metteuse en scène, scénographe ------------------------------------------------------------ Mon Merlin l’enchanteur C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés.
Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…
Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !
Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. A ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie. Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui. Agnès Freschel, journaliste, directrice du magazine Zibeline -------------------------------------------------------------- La chose que je voudrais ajouter concernant Marcel Maréchal, c'est qu'il était le plus fidèle à Jean Vilar au regard des nombreux metteurs en scène de sa génération qui lui avaient tourné le dos voire qui le dénigraient. Bruno Boussagol, metteur en scène -------------------------------------------------------------- Serge Pauthe, comédien MARCEL MARÉCHAL NOUS A QUITTÉS Sa vie s’est envolée cette nuit et tous les souvenirs qui me rattachent à lui à l'instant me reviennent. Afflux d'émotions reliées autant à la vie tout(e) court(e) qu’au théâtre partagé quelques années ensemble à Lyon, puis à Marseille. Ce fut mon patron pendant 8 ans. A Lyon, au Théâtre du Huitième. Puis à Marseille au Théâtre de la Criée. D’abord, j’étais l’un de ses spectateurs au petit théâtre de la rue des Marronniers à Lyon. J’ai vu son « Capitaine BADA » de Jean Vauthier. En compagnie de Luce Mélite, il interprétait ce personnage, déchiré par la souffrance d’un amour absolu. Porté par une voix intérieure semblable à un murmure, parfaitement timbrée et teintée d'un lyrisme qui sera toujours reconnaissable dans ses rôles futurs. Je ne le cache pas. J’étais un fana de ce nouveau comédien et je ne manquais aucune de ses créations. Particulièrement au Festival de Couzan, un petit village du Haut-Forez à quelques encâblures de Saint-Etienne. Là-haut, dans les ruines d’un château médiéval, il joua LA MOSCHETA de l’auteur Ruzante, ce noble Vénitien qui montrait comment vivent les pauvres à toutes les Seigneuries, Doges en tête, dans la Venise du XVème Siècle. Nous n’étions pas loin de 1968 et Maréchal, avec Bernard Ballet, Jean-Jacques Lagarde et Jacques Angéniol, décorateur et acteur, avaient assemblé, au milieu des murailles moyenâgeuses éparpillées sur le sol, tout un fatras de matériaux que les pauvres du monde entier récupèrent dans les poubelles pour se construire une maison, dans les bidonvilles des banlieues de Paris ou de Mexico. Le cri de Ruzzante se propageait ailleurs qu’à Venise et vous emplissait de fureur et d’émotion. Voilà l’artiste tout neuf dont je fis connaissance en ce temps-là. Il vint jouer en 1972 son « FRACASSE » à la Comédie de Saint-Etienne. Heureux de nous revoir, il me demanda si je voulais le rejoindre à Lyon au Théâtre du Huitième. J’acceptais à condition qu’il me permette de monter un spectacle poétique à partir de l’œuvre de Nâzim HIKMET, ce poète turc que je chérissais comme un frère. Promesse tenue. Geste fraternel d'un comédien hors-pair envers un poète universel. Cela restera gravé en moi et j'aurai toujours pour Marcel une reconnaissance éternelle. Marcel Maréchal, c'est un artiste né à Lyon, le soir de la Noël. Il s’appelait parfois Marcel-Noël Maréchal, c’est joli, non ? Il admirait Laurent Mourguet, le créateur du Guignol Lyonnais au temps de la Révolution. Son coté râleur et bon vivant l'inspirera au point qu’il écrivit une pièce pour raconter sa vie. Mais Marcel était fait de chair, d’os, de rires et de larmes. Il porta sur la scène les plus grands textes devant un public immense qui savait l'apprécier. Il était populaire au meilleur sens du terme. Il bannissait les méchantes critiques par un surcroît de travail. Toujours inspiré par la lecture permanente de ses poètes et auteurs favoris. Je cite au hasard Rimbaud, Audiberti, Molière, Guilloux et son Cripure.. Ah! Cripure! Surnom donné par les élèves du lycée de Saint-Brieuc au Professeur Merlin, objet de moqueries. Ce prof’ adorait enseigner Kant et sa « Critique de la Raison Pure » et les chenapans l’avait donc surnommé « Cripure »…Donc, Maréchal interpréta magistralement ce personnage. Y a t'il dans la vie d'un acteur une telle fusion avec un personnage né dans l’imagination d’un auteur ? Peut-être entre Knock et Jouvet? Ou Luchini avec…Luchini ? Au temps où Maréchal vivait à Lyon, la vie théâtrale ne manquait ni d’émulation, ni de confrontation. En 1968, le Ministère nomma Maréchal à la tête du Centre Dramatique de Lyon. Mais à Villeurbanne, Roger Planchon et son Théâtre de la Cité avait « pignon sur rue » depuis les années 50. Maréchal était son cadet et il lui fallait exister à coté de son génial voisin. On disait parfois que Brecht était à Villeurbanne et Aristophane dans le 8ème Arrondissement de Lyon. C’était parfois comme deux navires au large de Saint-Malo qui se tiraient la bourre pour arriver bon premier. Mais heureusement, l’ami Jean-Jacques Lerrant, fin critique au « Progrès de Lyon », les aimait bien tous les deux. Et le public ne désertait aucune des salles. Il ne choisissait pas selon l’humeur du moment. C’était encore le beau temps du Théâtre Populaire. Maréchal créait une pièce de Kateb et invitait Gatti. Planchon « Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale » de Brecht avec Jean Bouise dans le rôle titre… J’ai vécu toutes ces années au cœur de ce creuset théâtral et je le dois tout de même à Marcel qui donna tout son talent pour que vive une intense activité théâtrale. Qui donna lieu à l’éclosion de nouveaux artistes. Toutes mes pensées émues vont ce matin vers son fils Mathias, sa sœur et sa maman. Et à tous ses compagnons qui sont restés si proches de lui. Et à tous mes ami..e…s Lyonnais qui ont vécu ces années-là et que j’embrasse affectueusement. Serge PAUTHE ------------------------------------------ Marcel Maréchal, un grand homme de théâtre qui a fait vibrer plein de belles nuits du Théâtre de la Mer à Sète. Il a enchanté nos jeunes années d'élèves de ce métier. Je me souviens du "Fracasse", et de toutes ses géniales mises en scènes, comme "La moscheta" de Ruzzante, "Godot,"Les prodiges" de Vauthier"... où nous apprenions tant. Énergie, invention, audace, sens du plaisir. Un de nos maîtres. Moni Grégo, comédienne -------------------------- Documents audio et vidéo, liens : Archive INA-France Culture 5 entretiens radiophoniques de 28 minutes : https://entretiens.ina.fr/en-scenes/Marechal/marcel-marechal Archive Ina : La Puce à l’oreille par la Comédie-Française, 1985 : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00377/la-puce-a-l-oreille-de-georges-feydeau-mise-en-scene-par-marcel-marechal.html Archive vidéo « Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg, avec Marcel Maréchal et Pierre Arditi : https://www.youtube.com/watch?v=iRVkieN8p9U Rencontre avec Marcel Maréchal, masterclass en février 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=96zJdlVQ4N8 Présentation de « En attendant Godot » de Beckett, avec Pierre Arditi, Robert Hirsch, Jean-Michel Dupuis, Marcel maréchal, mise en scène Patrice Kerbrat au Théâtre du Rond-Point (1997) : https://www.ina.fr/video/I00013833 En 2009, dans l'émission de France 3 "Les Mots de minuit", il évoque Jacques Audiberti :
"Audiberti avait une sorte de fils spirituel : Marcel Maréchal, un saltimbanque coloré, joyeux et angoissé. Celui-ci a lui-même un fils, spirituel et biologique cette fois, un jeune homme gracieux. Tout cela, c’est la même famille poétique, venue de la Méditerranée. Audiberti et fils. Ils sont tous réunis sur la scène, corps et âme. Et dans une adaptation ingénieuse et une mise en scène délicate, signées François Bourgeat, ils chantent la chanson de la filiation, la chanson de l’humanité, de l’origine à l’éternité, la chanson du mystère de l’homme et de sa reproduction. Le père apprend la vraie vie à son fils qui rêve la vie.”
Philippe Tesson. Le Figaro, 15 octobre 2007. En lien une vidéo extraite des "Mots de minuit" en 2007, où Marcel Maréchal évoque son rapport à l'oeuvre et la personne d'Audiberti. http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 10, 2020 5:36 AM
|
Par Maïa Bouteillet dans Paris Mômes le 8 juin 2020 Il se voit de loin et surtout il s’entend : le chariot des quartiers d’Ivry sillonne les rues depuis le déconfinement et jusqu’au 26 juin, avec bœuf final à la clé. Et si d’autres villes s’en inspiraient ?
Peut-être l’avez vous croisé au fil des rues d’Ivry, chargé d’artistes, petits et grands, et parfois même de marionnettes ? Depuis le déconfinement, un chariot festif sillonne les quartiers d’Ivry, les mardis et vendredis, pour apporter des spectacles au pied des immeubles, sous les fenêtres des habitants, à bonne distance et sans provoquer de rassemblement. C’est une sorte de caravane, toute décorée de rouge comme une scène de théâtre, et tractée par une camionnette, devant lesquels des gamins s’arrêtent le temps d’une chanson. A son bord, des musiciens dont le chanteur Merlot, des acteurs, des amateurs, des élèves du conservatoire… Le programme s’invente à mesure et change presque à chaque fois.
C’est une initiative solidaire née du confinement et de la bonne entente de toutes les structures culturelles qui, dès le début de la crise sanitaire, se sont mutuellement interrogées pour construire quelque chose ensemble. La solidarité est le maître mot du projet qui implique le Théâtre Antoine Vitez, la compagnie El Duende, le Théâtre des Quartiers d’Ivry, l’association Bergers en scène, le Conservatoire, la scène de musiques actuelles Le Hangar, la compagnie La Foraine, de même que la ville d’Ivry par le biais des maisons de quartier, et occasionnellement d’autres associations. Solidarité avec les artistes et avec les habitants d’Ivry, solidarité entre les lieux et entre les pros et les amateurs. Sur le chariot on peut voir aussi bien la jeune chanteuse qui monte Léopoldine HH, les Avengers qu’une harpiste de 8 ans ou des danseurs ados.
Un projet éphémère et nomade, qui s’invente au fur et à mesure, et pourtant pas aussi léger qu’il en a l’air, selon Lucie Cabiac, du Théâtre Antoine Vitez : « c’est hypercomplexe et très fragile. Il n’y a pas de programmateur, c’est vraiment collectif. Nous devons composer à plusieurs, entre des structures qui toutes se connaissent bien mais qui sont très différentes. Tout le monde met la main à la pâte avec beaucoup de bienveillance. Le chanteur Merlot, qui a beaucoup été sur le plateau au début, se range désormais plus du côté de l’organisation pour laisser le micro aux autres. Avec la carriole, il y a aussi des contraintes de logistique importantes ». Le projet d’un grand bœuf final avec tous les participants est à l’étude pour le 26 juin à l’occasion du marché matinal, mais rien n’est confirmé. Très investis dans l’aventure, les organisateurs s’interrogent déjà pour relancer cette scène collective une fois par an, au printemps, à l’occasion des fêtes de quartier.
Volontairement confidentiel, pour ne pas susciter de rassemblement, le chariot est annoncé par voie d’affiches, sur les immeubles du quartier concerné, ainsi que sur le Facebook des différentes structures, on peut aussi téléphoner au théâtre Antoine Vitez. Mardi il sera à 18h30 dans la Cité Spinoza et à 20h dans le quartier Truillot. Ouvrez l’œil !
Maïa Bouteillet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 12, 2020 9:42 AM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro 12 juin 2020 DISPARITION - Le metteur en scène et comédien s’est éteint, à Paris, dans la nuit du 10 au 11 juin, à l’âge de 83 ans.
Son regard, son sourire le disaient: il y avait en Marcel Maréchal une alliance profonde de candeur et de savoir, d’intelligence et d’innocence. Un livre d’entretiens que lui avait consacré, il y a une vingtaine d’années, la regrettée Nita Rousseau, s’intitulait Un colossal enfant. Un rejeton de François Rabelais et de Jean Vauthier, Marcel Maréchal. L’une des plus fortes personnalités du théâtre européen, de 1958, ses débuts, jusqu’à ces derniers temps puisqu’il était sur la scène du Poche-Montparnasse, il y a un an, en 2019, lisant Mon père, récit de Jean Renoir sur son père peintre. Avec son fils, Mathias Maréchal, celui qui avait dirigé la Criée de Marseille et le Rond-Point à Paris figurait, six années plus tôt, dans la distribution du Mal court d’Audiberti, mise en scène de Stéphanie Tesson.
Jacques Audiberti, l’une des grandes passions de Marcel Maréchal qui, toute sa vie durant, aura défendu avec force des écrivains qu’il contribua à imposer. Jean Vauthier, Louis Guilloux, Florence Delay et Jacques Roubaud, Valère Novarina. D’autres encore, tels Pierre Laville, Jean-Louis Bourdon, Jean-François Josselin. Ce qui ne l’empêcha jamais de mettre en lumière le grand répertoire, et de le jouer: Molière comme Brecht, Shakespeare comme De Filippo, et les contemporains étrangers, Nella Bielski, Sam Shepard, David Mamet.
Comment circonscrire un tel chemin? Marcel Maréchal était né à Lyon le 25 décembre 1937. Son père, Georges, est chauffeur routier. Une famille modeste et très aimante. L’enfant est très bon élève, l’adolescent apprend le grec et le latin dans un collège catholique. Il découvre alors Paul Claudel comme Arthur Rimbaud et le théâtre! Il réussit le concours d’entrée à l’Idhec (cinéma), mais il doit rester à Lyon et s’engage dans le droit. Une troupe de théâtre universitaire lui demande de mettre en scène Robinson de Jules Supervielle. Ils obtiennent un prix. Marcel Maréchal a trouvé sa voie.
Il fonde et dirige le Théâtre du Cothurne. On est donc en 1958. Il monte Anouilh comme Arrabal et, en 1963, Le Cavalier seul de Jacques Audiberti. Puis Obaldia, Beckett, Limbour, Vauthier. Le public est vite au rendez-vous.
Il irradie. Il partage. Il écrit
Marcel Maréchal aime les poètes de la scène, mais aussi ses camarades interprètes et aime faire débuter les jeunes talents. Parmi eux, Catherine Arditi et son frère, Pierre Arditi. Une indéfectible amitié les lie et, dans les années 1990, alors que Marcel Maréchal a pris, neuf ans plus tôt, la direction d’un théâtre flambant neuf, le centre dramatique La Criée de Marseille, il monte Dom Juan de Molière: Arditi rôle-titre et lui, Sganarelle, et Maître Puntila et son valet Matti, dans une relation inversée.
Entre-temps, après Le Cothurne, il a dirigé avec grand succès, à partir de 1968, le Théâtre du Huitième, toujours à Lyon. Il y accueille des rockers qui deviendront des stars, Mick Jagger, notamment! Puis en 1975, on lui offre le Gymnase, à Marseille. Marcel Maréchal travaille sans cesse. Il met en scène des dizaines de spectacles. Il joue, toujours impressionnant. Il émane de toute sa personne une bonté. Il irradie. Il partage. Il écrit. Des pièces, des souvenirs qu’il livre à de fidèles observateurs, tel Michel Pruner.
En 1995, il est nommé à Paris, à la tête du Rond-Point. Il propose une programmation ambitieuse mais le théâtre a perdu une partie de son public en devenant, juste avant, après le départ des Renaud-Barrault, la Maison des cultures du monde. Malgré la qualité des propositions, le lieu ne retrouve pas sa dynamique. Le 1er juin 2000, ce baladin magnifique est nommé à la direction des Tréteaux de France. Un centre dramatique itinérant, avec son grand chapiteau, ses gradins de cirque, sa scène de commedia dell’arte. Il retrouve une fougue de jeune homme. Il est heureux. Onze années durant.
Dans les dernières années de sa vie, il voit grandir avec bonheur l’aura de son fils Mathias, excellent comédien qui a, comme son père, le sens de la troupe. Il joue un peu, notamment au privé. Mais la maladie le surprend, hélas. Il s’est éteint dans la nuit du 10 au 11 juin, à l’âge de 83 ans, chez lui, à Paris, entouré de sa famille. Dans la paix, notre Capitaine Bada, notre comédien si sensible, désarmant de fraîcheur enfantine jusqu’à son dernier souffle.
Légende photo : Marcel Maréchal en 2011. Hannah Assouline/©Hannah Assouline/Opale/Leemage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 9, 2020 6:06 PM
|
Par Thierry Voisin dans Télérama Publié le 09/06/20
Le directeur de la Villette veut tout bousculer. Cet été, comédiens, danseurs, musiciens, plasticiens…auront pour mission d’innover. Quelle est la vie à La Villette depuis trois mois ?
Rappelons d’abord qu’il s’agit d’un parc de cinquante-cinq hectares, sans clôture. Aux premières heures du confinement, il a fallu donc en interdire l’accès en l’encerclant par quatre kilomètres et demi de barrière. Ce qui n’a pas empêché certains hurluberlus d’y venir à la nage ou en barque par les canaux (canal de La Villette, de l’Ourcq). Nos vingt concessionnaires (la Philharmonie, le Zénith, la Cité des sciences et de l’industrie, le Théâtre Paris Villette, les cinq restaurants, la librairie, le centre équestre…) ont cessé leurs activités et tous les bâtiments (folies, bureaux, locaux techniques) ont été fermés. Une équipe en assure la sécurité et la maintenance, et entretient les pelouses et les jardins du site, en pleine végétalisation. Êtes-vous prêts à rouvrir ?
Dès que nous aurons l’autorisation de la préfecture de Paris, nous serons en capacité de le faire, à la minute près. Il va falloir néanmoins être très vigilants sur les conditions sanitaires et le respect des règles de distanciation, car je veux éviter à tout prix de fermer des lieux ouverts la veille, comme on a pu le constater sur certaines plages. À ce jour, on ne connaît toujours pas les consignes gouvernementales sur la gestion des parcs. Quelle est la teneur du projet de plaine artistique que vous envisagez de mettre en place pour l’été ?
Confronté à l’annulation de tous les festivals de l’été, j’ai imaginé un événement original à l’échelle du parc, sur le modèle du Bâtard Festival de Bruxelles, où je suis allé fin janvier. On ouvre le champ des possibles dans une quinzaine de lieux corona-compatibles, indoor et outdoor. Pour une journée, une semaine, un mois, le temps qu’ils veulent, des artistes de tous horizons (metteurs en scène, comédiens, chorégraphes, musiciens, plasticiens…) vont offrir au public ce qu’il n’a pas l’habitude de voir, une autre face de la création, de la répétition au format inédit en passant par une simple lecture. On n’est plus dans le temps de la représentation mais dans une autre forme de durée et de contact. Le public vient quand il veut entre 14 h et 21 h, goûte aux propositions qu’il souhaite, à son rythme, et repart quand bon lui semble. La jauge est de quinze personnes à la fois, avec trois mètres de distance entre elles. Ce projet sera-t-il en libre accès ?
Oui. Il n’y aura donc pas de recettes car tout sera gratuit. Pour le budget, on travaille avec les moyens du bord, comme l’a suggéré Bernard Blistène, directeur du musée national d’Art moderne du Centre Pompidou, l’un de nos partenaires. On voit à minima ce que l’on peut mettre en place pour éviter que cela soit morne plaine. Même si l’été à La Villette est toujours un moment fort, on n’a vraiment aucune idée de la fréquentation possible dans le contexte actuel. Mais nous restons optimistes. Notre ambition est d’offrir au public un peu de sérénité, de lui proposer d’être heureux pendant l’été malgré des conditions terrifiantes. Quels artistes vont y participer ?
De nombreux créateurs ont répondu à l’appel, prompts à ouvrir le champ des possibles. On peut déjà citer le plasticien Christian Boltanski, les metteurs en scène Ivo van Hove (Still Life), Anne-Laure Liégeois et David Bobée, la comédienne Norah Krief (lectures), le magicien Thierry Collet et ses comparses, le chorégraphe Angelin Preljocaj (avec une variation sur la musique d’Igor Stravinski)… Il y aura du design végétal avec l’Ircam, des projections nocturnes sur les arbres, du cinéma en plein air (du 23 juil. au 22 août), un studio de musique animé par Le Mouv’… Chaque jour apporte son nouveau lot de propositions. Je suis fasciné de voir les artistes saisir l’opportunité de créer de nouveaux formats, d’inventer un autre rapport au public, alors qu’ils vivent un drame très lourd lié à la crise sanitaire et ses impacts économiques. Est-on dans une refondation du modèle français de la culture ?
Nous n’avons pas cette prétention. Nous nous efforçons juste de nous adapter à une situation inédite dans l’histoire de notre pays. Je ne sais même pas s’il y aura une reprise à l’automne ni une saison 2020-2021. Au vu de ce qui se passe dans le reste de l’Europe, je ne suis pas sûr que le public se précipite dans les théâtres à leur réouverture. Il faudra peut-être aussi réinventer un modèle de saison avec moins de spectacles, présentés sur un calendrier plus long. La Plaine artistique | Du 1er juil. au 1er sept., à partir de 14h | La Villette, 211, avenue Jean-Jaurès, 19e | 01-40-03-75-75 | Entrée libre. Légende photo : Didier Fusillier. Photo: Jean-François Robert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 8, 2020 6:31 PM
|
La chronique de Jean-Pierre Léonardini dans L'Humanité 8 juin 2020 « SEUL CELUI QUI AGIT APPREND »
Un catalogue détaillé d'expérimentations sur des thèmes donnés.
L’improvisation, c’est comme le chinois et la peinture selon Picasso. Ça s’apprend. C’est, dans un ouvrage au titre parlant, L’improvisation ne s’improvise pas , la thèse d’Alain Knapp (1). Auteur, metteur en scène, pédagogue émérite, il a dirigé l’École du Théâtre national de Strasbourg, enseigné à Lyon à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi qu’à Paris-X. En 1968, il fondait le Théâtre-Création, première compagnie à mettre en jeu des spectacles entièrement improvisés. Ce livre constitue une mine de réflexions pertinentes, d’exemples concrets et d’exercices raffinés sur ce qu’il convient d’effectuer en la matière. Chemin faisant, il dessine une éthique de l’interprétation basée sur la patience et la régularité de l’effort, sans négliger les vertus de la contrainte et la nécessité de prendre en compte l’existence des partenaires. Véritable vade-mecum de la discipline, L’improvisation ne s’improvise pas s’inscrit d’emblée en faux contre les poncifs de la spontanéité brute, de l’anecdote piquante et du pittoresque narcissique. Pour Knapp, fin dialecticien, imprégné de la pensée de Brecht, « l’attitude artistique est une manière d’être devant l’ordinaire. Elle ne requiert pas de grandes idées. Elle appartient à tout le monde. Les exercices de création concourent à l’éveiller, la stimuler ».
En première partie, c’est écrit à quatre mains, au cours d’un dialogue avec Elsa E., l’une de ses anciennes étudiantes. Il s’agit notamment, à partir d’un canevas « minimaliste » décidé en commun, de s’attacher au pourquoi et au comment imaginer, créer et jouer des improvisations théâtrales. Knapp, expert en maïeutique, amène progressivement son élève à faire surgir d’elle un monde fictif auquel donner corps. Vient ensuite un catalogue extrêmement détaillé d’expérimentations sur une infinité de thèmes donnés, à pratiquer seul, à deux ou à plusieurs, dans le dessein de mettre en œuvre la gestuelle, l’art du récit, le monologue, le dialogue et la mémoire, afin de mettre au jour l’essence même du théâtre, en ses rapports avec le temps, l’espace, le personnage et le verbe. Cela passe par de précieux conseils et de fécondes subtilités d’analyse, dès lors qu’il convient de scruter le réel jusque dans le détail, en ne cherchant rien d’autre que « la transformation de l’insignifiant en signifiant théâtral ». Knapp préconise d’interroger « ce qui est tenu pour indiscutable » et laisse à Nietzsche le dernier mot : « Seul celui qui agit apprend . »
Un catalogue détaillé d’expérimentations sur des thèmes donnés.
(1) Actes Sud-Papiers, collection « Apprendre », 196 pages, 20 euros.
Chronique théâtrale de Jean-Pierre Léonardini dans l'Humanité
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2020 1:03 PM
|
Par Benoît Vitkine dans Le Monde le 27 juin 2020 Poursuivi pour détournement de fonds, le réalisateur et metteur en scène russe, qui a toujours clamé son innocence, échappe à la prison.
« Coupable » de détournement de fonds, Kirill Serebrennikov n’ira pas en prison. La justice russe a rendu, vendredi 26 juin, un verdict en demi-teinte contre le réalisateur et metteur en scène russe, l’un des plus doués et des plus prolifiques de sa génération, qui a passé près de deux ans assigné à résidence, entre 2017 et 2019. Lire le récit (en 2018) : A Moscou, le procès kafkaïen du réalisateur Kirill Serebrennikov Le tribunal Mechtchanski de Moscou a condamné Kirill Serebrennikov, 50 ans, à trois ans de prison avec sursis. Ses trois coaccusés – ses adjoints au sein de la troupe 7e studio et du théâtre Centre Gogol – ont également reçu des peines avec sursis et des amendes. Lire le témoignage de Kirill Serebrennikov : « Je n’ai commis aucun crime » Les mots de la cour avaient pourtant été très durs, le matin même, pour dire la culpabilité du metteur en scène et de ses « complices ». Ceux-ci auraient prémédité leur escroquerie, « d’une ampleur particulièrement importante », « de longue date », et se seraient constitués pour cela en un « groupe criminel très bien organisé ». Signe du soulagement suscité par ce verdict, mais aussi de la bizarrerie de la situation, la décision a été accueillie par des cris de joie et des applaudissements des quelques centaines de personnes présentes devant le tribunal : le parquet avait réclamé, lundi, une peine de six ans ferme contre le principal accusé, et il est rarement contredit. Lire la critique : « Leto », le soleil du rock dans la grisaille soviétique Dans la foule, le chanteur Roma Zver, acteur dans le film Leto (2018), de Serebrennikov, résumait le sentiment général : « On est heureux avec sursis. » Parfaitement calme durant la dernière audience comme durant les trois années qu’aura duré la procédure, Kirill Serebrennikov est sorti libre, son éternelle casquette vissée sur la tête, masque noir sur le visage, appelant à poursuivre le « combat pour la vérité ». Son avocat comme ceux des autres condamnés ont annoncé leur volonté de faire appel. Mobilisation internationale Est-ce le soutien populaire, certes modeste mais couplé à une mobilisation internationale, qui a permis au réalisateur d’échapper à la prison ? Impossible à dire, d’autant que la justice russe est devenue ces derniers mois coutumière de ces demi-mesures, dans certains dossiers perçus comme sensibles. L’affaire est aussi tortueuse qu’un exercice de comptabilité russe. Selon l’accusation, les « conjurés » ont détourné 133 millions de roubles (environ 1,7 million d’euros) de subventions publiques entre 2011 et 2014, dans le cadre du projet Plateforme, soutenu par le ministère de la culture. Selon la justice, le nombre et le coût des événements organisés dans le cadre de ce projet ont été exagérés par le biais de contrats fictifs. Ils devront d’ailleurs rembourser les sommes en question. Lire le compte-rendu : Le réalisateur Serebrennikov clame son innocence Serebrennikov a toujours clamé son innocence et accusé les enquêteurs d’avoir fait pression sur le principal témoin, l’ancienne comptable de la troupe. La justice elle-même s’est parfois montrée incertaine. Un premier juge avait ainsi estimé le dossier incomplet pendant qu’une expertise concluait à l’absence de malversations. Le verdict a été rendu sur la base d’une troisième expertise. Selon le journal Kommersant, ce document ne conclut pas lui-même à une action intentionnelle d’enrichissement. Echanges surréalistes Le procès a aussi donné lieu à des échanges surréalistes, comme lorsque l’accusation affirme qu’une pièce comme Le Songe d’une nuit d’été n’a jamais été produite sur scène, alors que la première a eu lieu à l’automne 2012 et que le spectacle a connu le succès pendant plusieurs années. On a aussi pu entendre la juge interroger les accusés : « Pourquoi avoir acheté un piano ? Pourquoi une troupe de théâtre a-t-elle besoin d’un piano ? » Dans le monde entier, de nombreuses personnalités du cinéma ou du théâtre ont publiquement défendu Kirill Serebrennikov. Lundi, une pétition signée par 3 000 personnalités russes de la culture appelait encore à la fin des poursuites dans une affaire qualifiée de « fabriquée ». Autre geste symboliquement fort, l’ambassadrice de France à Moscou a remis à Serebrennikov, en octobre 2019, les insignes de commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. Lire le focus : Mobilisation des artistes français pour le metteur en scène Kirill Serebrennikov Le ministre russe de la culture sous lequel a démarré le projet Plateforme, Alexandre Avdeev, a également fait part de son soutien appelant à « ne pas poursuivre les créateurs ». C’est sous son successeur qu’ont été lancées les poursuites. Vladimir Medinski, qui a quitté son poste au début de l’année, ne cachait pas son intention de faire de son ministère un instrument au service du conservatisme et du nationalisme. Plusieurs médias russes ont attribué la responsabilité des poursuites directement à M. Medinski. Pièces parfois osées Pour ses partisans, Kirill Serebrennikov paierait ainsi sa liberté de création et ses pièces parfois osées, mêlant politique, sexualité et religion, dans un pays où les autorités poussent pour un retour en force des « valeurs traditionnelles ». L’artiste est l’un des plus audacieux créateurs russes, tant dans le domaine du théâtre que du cinéma, et il est largement plébiscité par le public, en plus d’avoir reçu de nombreuses récompenses internationales. Il s’est attaqué aussi bien à la réinterprétation des classiques, comme Un héros de notre temps, qu’à des thématiques plus actuelles, avec Ordures, sur la violence policière. Depuis le début de l’affaire, Kirill Serebrennikov est d’ailleurs resté un créateur prolifique. Il avait été arrêté durant le tournage de Leto, sur le rock underground des années 1980 et le chanteur Viktor Tsoï. Le 4 novembre 2018, à Zurich, en Suisse, avait eu lieu la première de l’opéra Cosi fan tutte, de Mozart. Son ballet Noureev a connu un destin plus agité, déprogrammé du Bolchoï de Moscou autant à cause des démêlés de son auteur que d’une présentation jugée trop « favorable » de l’homosexualité. En 2019, sa pièce Outside était jouée à Avignon. Lire le compte-rendu : Le ballet « Noureev » censuré au Bolchoï pour « propagande homosexuelle » Lundi 22 juin, l’homme a profité de ses rituels « derniers mots » à la cour pour déclamer un poème de Joseph Brodsky. Il a aussi dissimulé, dans cette intervention destinée à se disculper, un message plus personnel à la cour. En retenant la première lettre de chaque paragraphe, on pouvait comprendre : « Je ne regrette rien, j’ai de la peine pour vous. » Lire la critique d’« Outside » : Au Festival d’Avignon, Kirill Serebrennikov s’évade en beauté Benoît Vitkine (Moscou, correspondant) Légende photo : Kirill Serebrennikov à la sortie de son procès devant le tribunal Mechtchanski de Moscou, le 26 juin. PAVEL GOLOVKIN / AP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 24, 2020 5:59 PM
|
Par Anne Diatkine photo Bruno Amsellem pour "Libération"
— 24 juin 2020
Cette brillante metteure en scène, réputée pour son recours à l’improvisation, prend la tête du Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis. Pour qualifier la metteure en scène Julie Deliquet, plusieurs ont cette même réflexion : «Elle est hype.» Hype ? C’est curieux. La toute nouvelle directrice du Théâtre Gérard-Philipe (TGP), qui a pris ses fonctions le 1er avril en plein confinement, ne correspond pas à l’idée qu’on se fait de cette épithète, par ailleurs désuet, un oxymore à lui tout seul. Quoi que : Julie Deliquet a cette particularité de transbahuter, de manière encore plus visible que quiconque, l’épaisseur d’une histoire et les contradictions de plusieurs époques mêlées. Faute de café, faute de terrasse libre, faute d’appartement disponible, on se rencontre sur un banc, un vieux banc vert d’un jardin public du début du siècle dernier. Des clochards, des oiseaux, des enfants, des vieux isolés, un couple d’amoureux anglophones qui se bécotent masqués et avec un gobelet à la main. Comment vont-ils introduire la paille dans leur bouche ? Des bruits d’explosions rompent l’ambiance bucolique. Elles proviennent de la place de la République où les manifestants pour Adama Traoré sont nassés. Julie Deliquet songe : «Si mon sexe dans mon métier m’est sans cesse rappelé, ma couleur de peau n’est pas une question. J’ai vraiment pris conscience que j’étais blanche il y a peu.» Julie Deliquet a été nommée directrice du TGP à la suite du départ de Jean Bellorini pour le TNP à Villeurbanne. Prendre ses fonctions en milieu de saison est toujours une étrangeté puisqu’on assume les choix d’un autre. Mais paradoxalement, l’inédit de la période a été un atout. «On n’est pas formé pour diriger un théâtre. Mais je prends ce poste alors que chaque responsable de scène est face à l’inconnu.» Le confinement la surprend à La Rochelle, où In Vitro, le collectif qu’elle a créé en 2009, vient de jouer Un conte de Noël d’après le film d’Arnaud Desplechin. Elle se retrouve à Niort avec son compagnon, le comédien Eric Charon et leurs fils de 7 ans et 14 ans dans une maison vétuste et inhabitée. La maison est gentille, elle accepte les visiteurs, mais elle n’est connectée à aucun réseau. Un billard en plastique devient sa table de travail et le grenier son bureau. Elle s’y enferme de 8 heures à 20 heures, tandis que leurs fils jouent au ballon. Pas de réunion sur Zoom, pas de télé-école, pas de streaming, pas d’autres écrans que le recours à une grosse télé ronde qui crache Louis de Funès. Si la nouvelle directrice est accaparée par «l’hyperprésent», elle expérimente un retour vertigineux dans les années de son enfance. Un téléphone basique donc, pour «rencontrer» un à un la totalité des 30 salariés. Julie Deliquet est une femme à qui tout réussit. Du moins réussit-elle à donner ce sentiment sans que ce soit prémédité. Elle vient d’avoir 40 ans, et sa carrière est exemplaire. Si exemplaire qu’une ombre passe sur son visage. «Je n’ai jamais pensé carrière solo. Et aujourd’hui, mon nom passe avant celui d’In Vitro… C’est une question qui peut me réveiller la nuit.» Elle a fondé In Vitro parce qu’elle «adorait» le temps des répétitions et beaucoup moins celui des représentations quand elles se figent dans une forme. L’une des singularités de ses créations est que ni le texte ni le jeu ne sont fixés. Une part d’improvisation persiste, y compris lorsqu’elle travaille avec la Comédie-Française. Denis Podalydès, distribué dans Fanny et Alexandre, son adaptation de Bergman, évoque «un cadre hyperprécis… pour accueillir les inventions les plus incongrues, des sorties de route incroyables». Il demeure surpris de la confiance faite aux acteurs. «On partait dans des improvisations d’une heure trente à 19 sur le plateau, et elle en tirait un jus. Quand on reprenait, on s’apercevait qu’elle avait tout entendu dans ce brouhaha.» Elle résume : «Mes répétitions ne font que créer une mémoire collective.» Denis Podalydès : «Elle m’a appris à faire la planche avec l’attention du public.» Julie Deliquet continue d’analyser son parcours, avec ce léger pincement au cœur : «Au Français, je me suis autorisée à dire "je". Pour la première fois, j’ai eu un décor. Auparavant, j’étais cheffe de troupe mais pas vraiment metteure en scène.» Dans la maison de Molière, elle s’entoure de quelques complices d’In Vitro, et bagarre pour l’égalité salariale entre elle et eux, qui est la règle dans le collectif. Julie Deliquet ne vient pas du sérail. Elle a opté pour un cours de théâtre à la maison de la culture de Lunel (Hérault), vers 10 ans, parce qu’elle n’avait «pas envie de faire de la danse classique». Et, jusqu’à ses 17 ans, elle a peu l’occasion d’être spectatrice. Une enfance heureuse, avec sa petite sœur, dans le lotissement d’un village. Les deux se distribuent les rôles. L’une est excellente élève et sait ce qu’elle veut faire, l’autre déroute et construit depuis peu «des petits objets en macramé». Qui pourraient appartenir aux décors de la première. Leurs parents enseignent en zone d’éducation prioritaire, «le service public est la mission de ma mère». C’est aussi celle de Julie Deliquet, qui serait «instit» si elle arrêtait le théâtre. «Je crois à l’hôpital public, à l’école publique et à la culture pour tous. Mais comme à une donnée si précieuse qu’elle exige d’être réinterrogée en permanence.» Pour autant, elle ne pense pas que la question du théâtre populaire se pose de manière différente depuis Jean Vilar, qui estimait qu’il avait vitalement besoin des classes laborieuses. Elle-même n’est pas issue des grandes écoles. «Je garde un petit sentiment d’illégitimité qui me pousse à toujours vouloir aller plus haut. Avec In Vitro, on est nés de la galère.» Elle s’enflamme tout d’un coup : «Alors quand le Président nous explique qu’il faut s’adapter, jouer hors les murs dans des formes plus légères… Ne serait-ce que pour des raisons financières, tout ça, on l’a fait et on continue. On va proposer des ateliers gratuits aux enfants et aux parents pendant l’été. C’est une nécessité. […]. Ça a été difficile pour notre métier d’être aussi peu considéré. Je crois profondément au lien entre le théâtre et l’école mais nous ne sommes pas des animateurs. On ne crée pas de l’élitisme mais de l’exigence. Une société sans culture serait une société tout aussi malade.» Le 8 juillet, son premier film Violetta sera en salles dans le cadre du programme collectif Celles qui chantent, où signe entre autres l’Iranien Jafar Panahi. Il met en relation l’Opéra de Paris et l’hôpital public, le personnage de femme malade par excellence et une femme malade qui ressemble à la cantatrice. Julie Deliquet a le projet d’adapter Huit heures ne font pas un jour, d’après un feuilleton inédit en France de Fassbinder avec beaucoup d’acteurs. A ou avait ? «Je n’ai pas osé entamer la distribution.» Ce sera un hommage à l’intelligence collective dans une usine d’outillage, où des gens se demandent comment être plus heureux et plus justes. Anne Diatkine photo Bruno Amsellem pour "Libération" 19 juin 1980 Naissance.
19 juin 2009 1er spectacle d’In Vitro.
19 juin 2016 Répétitions de Vania.
19 juin 2020 1er déjeuner avec l’équipe du Théâtre Gérard-Philipe.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 21, 2020 5:02 PM
|
Par Laurent Telo et Grégoire Biseau pour M le magazine du Monde Publié le 19 juin 2020
C’est un malaise persistant que la crise sanitaire a transformé en franche hostilité. Amateur de théâtre et de littérature, le président semblait vouloir incarner une ambition culturelle. Que les acteurs du secteur jugent incompréhensible.
A quelques mètres du canal Saint-Martin, à Paris, dans un deux-pièces sous les toits qui lui sert d’atelier, Mathieu Sapin regarde Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux. Il est 15 h 53, ce lundi 8 juin. L’auteur de BD termine les dernières planches de son livre Comédie française. Il y sera question de politique, de courtisans, de Macron, mais aussi de Louis XIV et de Racine. Depuis qu’il a suivi la campagne de François Hollande, puis raconté le quotidien de l’Elysée dans Le Château, Mathieu Sapin est devenu, presque malgré lui, le dessinateur à l’œil affûté et décalé de la chronique du pouvoir sous la Ve République. Il a aussi croisé Macron à plusieurs reprises. « Les chefs d’Etat ont toujours besoin de draguer les artistes. Ils envient leur liberté, le fait qu’ils soient admirés alors qu’eux-mêmes sont souvent détestés. »
Mathieu Sapin en sait quelque chose. Le 3 mai 2017, à quelques minutes du débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle, assis dans un coin de la loge, au milieu du premier cercle d’Emmanuel Macron, il sort son crayon et son carnet de croquis. Il pense dessiner incognito quand le candidat se tourne vers lui : « Ah ! mais vous savez que je suis en train de lire votre BD sur Depardieu. C’est super. » Le numéro de charme le laisse sans voix. Le 6 mai 2020, il a évidemment regardé, comme beaucoup d’artistes traumatisés par la violence de la crise, l’intervention télévisée lyrique et un peu lunaire d’un Macron en bras de chemise qui demandait, après avoir annoncé une série de mesures de soutien, aux artistes de se « réinventer » et d’« enfourcher le tigre ». Sapin n’a rien compris. Il n’est pas le seul. Le secteur culturel a pris ce numéro comme un camouflet. « Quand on est face à un milieu hostile, on ne se met pas en scène. Sinon on prend le risque d’en sortir perdant », estime Sapin. Il ne sait pas s’il faut parler d’occasion manquée ou de rencontre impossible. Signe en tout cas du malaise, dimanche 14 juin, à l’occasion de son intervention télévisée, Emmanuel Macron n’a prononcé que deux fois le mot « culture », à chaque fois perdu au milieu d’une énumération. Un casting prometteur Et pourtant… « Voilà notre homme ! », s’extasiaient les « cultureux », après la campagne de 2017. Un président livresque qui citait Jean Giono ou André Gide. Un président, jeune et forcément connecté, qui a fait ses humanités en tant qu’assistant du philosophe Paul Ricœur. Un président dont l’épouse est une ancienne professeure de lettres. Une somme de vertus qui ravivait l’espoir, toujours douché depuis quarante ans, de revivre les fantasmatiques années 1980 de Jack Lang à la rue de Valois. Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg, engagé à gauche depuis toujours, avait lu Révolution (novembre 2016), le livre manifeste du candidat Macron : « J’étais quand même agréablement surpris qu’il cite des écrivains. C’est tellement inhabituel dans la classe politique, à part peut-être Christiane Taubira. Mais j’en attendais aussi peu de chose… et certainement pas de grand soir. De toute façon, s’il devait y en avoir un, on l’aurait vu tout de suite… après son élection. » Pourtant les premiers signes sont plutôt encourageants. Françoise Nyssen, nommée ministre de la culture, n’est pas une femme politique mais une éditrice respectée. Claudia Ferrazzi devient la conseillère culture et communication de l’Elysée. Certes, c’est une diplômée de l’ENA, où elle a rencontré Macron, mais c’est aussi une ancienne secrétaire générale de la Villa Médicis. Aujourd’hui, Claudia Ferrazzi habite dans un grand loft parisien aussi lumineux qu’une galerie d’art. Celle qui jusqu’ici ne s’est jamais exprimée depuis son départ de l’Elysée, en novembre 2019, parle toujours aussi bien le macronisme avec un accent italien chantant. « La culture était, avec l’éducation, un socle important du programme présidentiel. Avec trois piliers : l’émancipation grâce à l’accessibilité à la culture, l’équité territoriale, la souveraineté et le dialogue entre les cultures. Alors, c’est sûr, ce n’est pas aussi spectaculaire que la pyramide du Louvre, mais tellement fondamental si on veut réfléchir à un autre projet de société. » De nombreux projets avortés Deux ans plus tard, le bilan est aussi maigrichon que la réfection d’un château presque en ruine, celui de Villers-Cotterêts, future cité de la francophonie, que des bibliothèques incitées à ouvrir le dimanche ou que le retour des chorales à l’école. Sans parler du Pass culture qui devait incarner à lui seul l’ambition culturelle du quinquennat. Cette application qui permet aux jeunes de 18 ans de pouvoir consommer jusqu’à 500 euros de biens ou de spectacles culturels, testée dans 17 départements, a disparu des radars nationaux. Deux coups d’éclat, tout de même : la restitution des œuvres africaines et un combat européen sur les droits d’auteur gagné de haute lutte. « Est-ce que tout a fonctionné ? s’interroge Claudia Ferrazzi. Certainement pas, mais je me refuse à dire que ça n’a pas existé. On aurait dû peut-être prévoir des moments de discours programmatique sur la culture. » « Nyssen arrive avec la fraîcheur de la société civile mais elle n’a pas les codes. Elle se fait broyer. » Jean-Marc Dumontet En tout cas, l’incarnation de cette politique, elle, est illisible. A défaut de grande figure culturelle, les soutiens « people » de la campagne sont devenus incontournables : son grand copain Jean-Marc Dumontet, propriétaire de théâtres privés, devient l’organisateur en chef des sorties du couple Macron, Stéphane Bern est nommé à la tête de la Mission patrimoine. Puis Macron essaie, en vain, d’envoyer l’écrivain Philippe Besson au consulat de France à Los Angeles… Et, quand il faut choisir un responsable en chef de l’immense chantier de Notre-Dame, il nomme un général de l’armée. Le milieu de la culture se crispe. « Mais le président n’oppose pas culture exigeante et culture populaire ! », s’emporte Claudia Ferrazzi, qui nous dresse une longue liste de rencontres pas forcément médiatisées avec des artistes plus pointus les uns que les autres. Pour la panthéonisation, prévue en novembre 2020, de l’écrivain et poète Maurice Genevoix, Macron passe commande à un couple inédit : le compositeur de musique contemporaine Pascal Dusapin et le plasticien allemand Anselm Kiefer. Du très haut de gamme. « Il a toujours eu des relations avec les différents secteurs de la culture, confirme Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, ancien directeur de cabinet de Françoise Nyssen et “référent culture” du candidat Macron. Il a besoin de se nourrir de ces contacts directs. » Le fiasco Nyssen Dans cette improbable tranche napolitaine, entre Johnny Hallyday et Line Renaud, on trouve le peintre Pierre Soulages ou l’écrivain Pierre Michon. Cette référence de la littérature contemporaine a déjeuné deux fois avec Macron. On était curieux de savoir ce que ces deux-là avaient à se dire : « Au départ, j’étais stressé, raconte l’écrivain. Je ne savais pas trop quoi dire. Parler de Stendhal ou de Bonaparte, dont je partage l’admiration avec lui, ça ne mange pas de pain. Et, à un moment, on se lève et je dis : “Quelles belles pompes d’énarques. Vous ne voulez pas les échanger avec les miennes ?” “Pourquoi dites-vous ça ?”, répond le président. Quelque chose s’est décoincé. Et j’ai commencé à parler normalement. Il m’a demandé un texte sur ce que je pense de la France. On a aussi parlé des Francs parce que j’avais lu le bouquin de Patrick Boucheron sur Saint Ambroise qui en parlait. Macron était fasciné. Il a pris des notes. Ça prouve qu’il sait entendre. En lui, il y a quelqu’un qui sait aller à l’école où qu’il soit. » Entre Michon et Johnny, faut-il choisir ? « On ne peut pas comprendre la déception du monde culturel à l’égard d’Emmanuel Macron sans prendre en compte les attentes qu’il a suscitées au début de son quinquennat, puis l’empilement de réformes peu cohérentes portées par des ministres politiquement faibles », analyse Vincent Martigny, professeur de science politique à l’université de Nice et spécialiste des questions culturelles. Sans compter que le milieu de la culture, à gauche, rejette en bloc beaucoup de mesures du gouvernement : sa politique migratoire, fiscale, sa réforme des retraites… Le mandat de Françoise Nyssen, très mal à l’aise dans son costume de ministre, est un fiasco à lui tout seul. Jean-Marc Dumontet décrypte : « Nyssen arrive avec la fraîcheur de la société civile mais elle n’a pas les codes. Elle se fait broyer. Le président veut aller vite sur l’économie et le social et la culture ne semble pas la priorité. Une petite musique s’installe : en fait, Macron ne s’intéresse pas à la culture. Ce qui est faux. » Communication de crise Le remplacement de Claudia Ferrazzi, partie monter son entreprise, par Rima Abdul-Malak en décembre 2019, est l’occasion d’un nouveau départ. Cette Franco-libanaise de 41 ans, débarquée à Lyon à l’âge de 10 ans, attrape le virus du théâtre grâce à un professeur de français « déjanté ». Elle sera secrétaire générale de l’association Clowns sans frontières, puis la conseillère culture de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, avant de devenir attachée culturelle à New York. Un autre style souffle sur l’Elysée. Plus direct, plus engagé. Stanislas Nordey confirme : « Elle est devenue un relais très réactif. Ça a changé beaucoup de choses. » Le monde culturel croit y voir un signal. Jack Lang, qui reste un bon thermomètre du milieu, est dithyrambique. « Rima est une personnalité remarquable qui a une connaissance intime et fine de la vie culturelle. Sa présence, c’est un signe, et un test. » La culture française a, enfin, l’impression d’être un peu entendue sinon comprise. Enfin… jusqu’au déclenchement de la crise sanitaire, et ce 30 avril 2020. Dans une tribune publiée sur Lemonde.fr dans Le Monde daté 2 mai, un collectif assez représentatif du cinéma français et du spectacle vivant, allant de Jeanne Balibar à Omar Sy, en passant par Jean Dujardin, tire la sonnette d’alarme pour un secteur à genoux et à boulets rouges sur un ministre jugé « fantomatique ». L’effet de souffle est immédiat. Alors que Rima Abdul-Malak travaillait depuis plusieurs jours à l’organisation d’une table ronde avec les acteurs de la culture, la voilà obligée d’ajuster son dispositif. Elle compose un savant cocktail d’une quinzaine de noms. Des signataires – Stanislas Nordey, les actrices Norah Krief et Sandrine Kiberlain, les réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano, la chorégraphe Mathilde Monnier – et des non-signataires. Macron exige la présence de Catherine Ringer, la moitié des Rita Mitsouko. La plupart n’ont jamais échangé un mot avec le chef de l’Etat. Le plateau est de choix, le moment suffisamment dramatique : tout devait faire de ce 6 mai une occasion en or. Celle de restaurer un lien, pour le moins abîmé, avec un milieu traumatisé. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, Macron s’est laissé convaincre par son ministre de la culture de débourser un milliard d’euros pour permettre aux intermittents de continuer à toucher leur indemnité pendant un an. Un secteur très remonté Le 6 mai, en direct sur les chaînes d’info, pendant vingt-cinq minutes, Macron, en bras de chemise, échevelé comme jamais, hésite entre lectures de fiches, annonces de mesures, banalités creuses et envolées lyriques. A ses côtés, Franck Riester, mutique, prend des notes tel un collégien appliqué. L’impression générale est aussi catastrophique qu’unanime : désinvolture, mépris, dilettantisme… Bref, à côté de la plaque et du moment. Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et lobbyiste culturel influent depuis quarante ans, résume le sentiment général : « Ça faisait vraiment improvisation débraillée. Sans grand plan, sans grande vision… D’accord, il y a eu quelques annonces importantes, comme le maintien des droits pour les intermittents. Mais son histoire de renvoyer les créateurs se réinventer sur les plages et puis sa décision de rouvrir uniquement le Puy du Fou… À la SACD, qui regroupe beaucoup de catégories d’auteurs, ça a vraiment choqué. Les gens de la culture veulent du respect. Sarkozy, Hollande ou Chirac n’auraient jamais fait ça. » Dans l’après-midi, la grande prêtresse du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, appelle, furieuse, la conseillère culture du chef de l’Etat. La performance d’Emmanuel Macron et sa définition du génie français (« de l’inventivité et du bon sens ») ne l’ont pas calmée. Rima Abdul-Malak prend le temps de lui rappeler la grande victoire de la journée : l’année blanche pour les intermittents, que le secteur revendiquait sans trop oser y croire. Improvisation ratée Un mois plus tard, dans son bureau du premier étage qui donne sur la cour de l’Elysée, la conseillère est fataliste : « Pourquoi ils critiquent la forme de l’intervention du président ? Parce que le fond est inattaquable. » Et de nous glisser un tableau Excel récapitulant l’ensemble des mesures de soutien pour le secteur : 3,5 milliards d’euros TTC. Un simple malentendu ? Un ex-conseiller du chef de l’Etat rebondit : « Emmanuel Macron n’a probablement pas pris la mesure de l’Etat d’angoisse dans lequel était la culture. Je comprends très bien que ça a pu être mal pris, mais il était juste en mode travail. Je l’ai vu des centaines de fois comme ça. » « Macron voulait démontrer qu’il connaissait tous les dossiers culturels, jusqu’à proposer aux artistes une autre manière de travailler. » Jean-Jacques Aillagon Tout le monde a cru voir une mise en scène alors que c’était, en réalité, une improvisation. Tellement improvisée que Franck Riester, lui-même, ignorait tout du dispositif de communication. La seule chose qui avait été calée était simple et claire : le président devait conclure les deux heures de table ronde par une intervention de cinq minutes retransmise en direct. Ensuite, Riester devait détailler les mesures depuis le perron de l’Elysée. Sauf que les cinq minutes se sont transformées en vingt-cinq minutes de one-man-show. Avec un effet déformant qui va clouer au pilori médiatique le ministre. Rima Abdul-Malak : « Dire que Franck Riester a été humilié parce qu’il prenait des notes… C’est vraiment n’importe quoi. La réalité, c’est que les annonces du président résultent de propositions faites par le ministère de la culture. » D’ailleurs les participants de la table ronde n’ont pas eu la même perception. « Nous, on n’a pas du tout trouvé ça humiliant ou énervant, confirme Stanislas Nordey. Peut-être parce qu’on était dedans et que l’on discutait avec lui depuis deux heures… A la fin, il s’emballe un peu mais, pour moi, c’est plus de la maladresse. » Un président un peu trop présent Ce n’est pas la première fois. C’est même presque une marque de fabrique. Le simple contact d’artistes ou d’intellectuels électrise Macron. C’était le cas, fin janvier, lors de l’inauguration du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, où celui-ci n’a pas résisté au plaisir d’un selfie avec le dessinateur Jul, qui présentait pourtant un tee-shirt dénonçant les violences policières. Ou encore un an auparavant, à l’occasion d’une table ronde organisée à l’Elysée avec une soixante d’intellectuels qu’il va étirer pendant plus de huit heures. « Pour Macron, l’artiste se situe tout en haut de sa pyramide personnelle, analyse un ex-conseiller. Il ne faut pas oublier qu’il a des velléités littéraires, et donc une forme d’ambition artistique… » D’où peut-être cette difficulté à se tenir à la bonne distance. Ex-ministre de la culture de Jacques Chirac, Jean-Jacques Aillagon abonde : « Cette intervention du 6 mai est la démonstration de cet excès de captation de responsabilité directe du président à l’égard de tout et de rien. Il voulait démontrer qu’il connaissait tous les dossiers culturels, jusqu’à proposer aux artistes une autre manière de travailler. » Oui, mais Macron est tellement frustré… « Une fois, il m’a dit : “Je n’ai pas mon Jack Lang” », raconte Stéphane Bern. Le Lang en question ne commente pas cette sentence irrévocable mais voudrait quand même « redonner une ambition, une vision d’ensemble, une perspective et des moyens à ce pauvre ministère progressivement dépenaillé, raboté, après trente ans d’indifférence de la plupart des présidents ». Sauf que la culture, c’est Macron. « Le chef de l’Etat a théorisé le fait qu’une politique culturelle n’était pas seulement définie par le ministère. Qu’il peut revenir au président de donner l’impulsion et de l’incarner », assure Sylvain Fort, ancienne plume du président. La bataille des nominations C’est évidemment vrai des nominations. Les candidats ont compris qu’il fallait prendre rendez-vous rue du Faubourg-Saint-Honoré plutôt que rue de Valois. Pour trouver un successeur à Stéphane Lissner à l’Opéra de Paris, Franck Riester avait composé un jury pour soumettre une short list à l’Elysée. Sauf que seul le nom du patron de l’Opéra-Comique sort du chapeau du jury. Alors, l’hyperprésident a dit : « Ce n’est pas ce que j’ai demandé. » Il a tout repris depuis le début, il a reçu lui-même les candidats et choisi l’Allemand Alexander Neef. « Beaucoup de nominations sont toujours remontées à l’Elysée, assure l’universitaire Vincent Martigny, mais, là, ça a pris des proportions incroyables. Sous Lang, la politique était coconstruite avec les acteurs du secteur. Cette ultraprésidence au contact d’un milieu aussi complexe empêche de penser une politique culturelle partagée. Et, avec ces “faits du prince”, Macron prend le risque de cristalliser les mécontents. » « Il faut un ministre de combat et de campagne. Qui doit gagner ses arbitrages contre Bercy, surtout en période de crise, avec un secteur touché de manière inouï. »
Aurore Bergé Stéphane Bern nous raconte ses coupe-files : « Pour l’opération “On redécouvre notre patrimoine” de cet été, j’ai passé un coup de fil au président pour que ça se fasse. Tout ce qui m’intéresse, c’est de sauver le patrimoine, pas d’être ministre. C’est pour ça que je n’ai pas ma langue dans ma poche. Lors des réunions auxquelles j’ai pu assister, les représentants du ministère ne mouftaient jamais. C’est fascinant. Ils attendent docilement les décisions de l’Elysée. » Et, quand le milieu du cinéma apprend la nomination à la tête du Centre national du cinéma de Dominique Boutonnat, le candidat (et participant actif à sa campagne) du président suspecté de soutenir une approche trop consumériste du secteur, c’est une bronca quasi générale, mais qui ne dissuade pas le chef de l’Etat. « Lors de l’accession de Macron à la présidence, il y a eu une forme d’improvisation assez séduisante, conclut le compositeur Jean-Michel Jarre. Mais qui devient une faiblesse quand on ne trouve pas les bonnes personnes, même si c’est bourré de bonnes intentions. » Jarre échange régulièrement avec Macron. Il a délaissé un instant ses claviers pour imaginer au téléphone avec nous la création d’un collège culturel autour du président, avec des membres de la société civile. « Avec Lang. Comme ça, Macron aurait son Lang ! » Un ministre sur la sellette ? A quelques semaines d’un remaniement très probable, nous sommes invités à déjeuner au ministère de la culture. Franck Riester a tombé la veste mais surtout pas retroussé les manches de sa chemise. Pour dissiper cette incompréhension tenace qui perdure entre Macron et la culture, il a une idée toute simple. « Je l’ai dit plusieurs fois au président : “Il faut trouver un moment fort, solennel, durant lequel il puisse expliciter sa vision culturelle.” C’est vrai que ça a pu manquer… » La veille, devant l’Assemblée, nous avions discuté avec la députée LRM Aurore Bergé, rapporteuse du projet de la loi sur l’audiovisuel et chargée d’une mission sur l’émancipation et l’inclusion culturelle. Elle a aussi une énorme envie qu’elle sous-entend à peine : devenir ministre de la culture. Et pense avoir tout compris de ce qu’attendait le président : « Il faut un ministre de combat et de campagne. Qui doit gagner ses arbitrages contre Bercy, surtout en période de crise, avec un secteur touché de manière inouïe. » Elle n’est pas la seule à postuler. Tout le milieu culturel est en ébullition. En plein déjeuner, Franck Riester se lève de table pour aller chercher ses lunettes. Il tente de démontrer qu’il est d’une sérénité sans faille, qu’il n’est surtout pas cette silhouette fragile de figurant déjà condamné. « Je suis très calme dans un milieu qui parle et qui se parle beaucoup. » Il a probablement entendu que plusieurs signataires de la tribune faisaient maintenant passer des messages à l’Elysée pour défendre son maintien. « Plutôt Riester qu’encore un(e) nouveau (elle) ministre ! », nous confirme Stanislas Nordey. Riester chausse ses lunettes pour nous montrer un SMS envoyé par Jack Lang comme un signe irréfutable d’optimisme. Dans l’élan, il s’apprête à nous en lire un second. Du président lui-même. Mais il se reprend : « Non. Le SMS est trop beau. » Laurent Telo et Grégoire Biseau
Légende illustration : PHOTO COLLAGE CAMILLE DURAND /M LE MAGAZINE DU MONDE D'APRES UNE PHOTO DE LUDOVIC MARIN / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 20, 2020 12:08 PM
|
Publié par Courrier International à partir d'un article de Reinhard J. Brembeck dans la Süddeutsche Zeitung
Cette année, le festival autrichien, l’un des plus célèbres du monde, fête ses 100 ans. Il est l’un des rares à n’avoir pas été annulé à cause de la crise sanitaire. Le laxisme des autorités, au nom du tourisme, fait grincer quelques dents.
Oui, le Festival de Salzbourg sera l’un des rares à avoir lieu cette année. D’accord, il sera limité au mois d’août [il durera trente jours au lieu de quarante-quatre] et comptera 90 représentations [de théâtre, d’opéra et de musique classique] au lieu de 200, avec une jauge maximum de 1 000 spectateurs, mais ce qui est plus intéressant que cette annulation, seulement partielle, ce sont les décisions politiques qui ont permis ce miracle autrichien. On se croirait devant la notice de montage d’un Ischgl Inferno II [une référence à la station de ski autrichienne d’Ischgl, qui, pour avoir refusé de fermer ses pistes et ses bars au début de l’épidémie, est devenue un important foyer de contamination en Europe].
Le ministre de la Santé, Rudolf Anschober, et la puissante secrétaire d’État à la Culture, Andrea Mayer, ont modifié, pour ne pas dire fait sauter, le mantra de la distance minimale de sécurité. Pour que les salles soient au moins remplies à moitié, les spectateurs seront disposés en damier et séparés par une place vide. Si celle-ci fait moins d’un mètre de large, comme c’est en général le cas dans les théâtres, le public devra porter un masque.
Acteurs, embrassez si vous voulez
Sur la scène, ce sera encore plus souple. Andrea Mayer compte sur la responsabilité des artistes. Si le metteur en scène veut un baiser, les intéressés pourront décider de leur propre chef s’ils veulent s’embrasser ou non. Après tout, un peu plus de démocratie ne peut pas faire de mal dans le monde du théâtre, toujours dominé par les hommes. Pour information : une séance de chants religieux a provoqué une contamination massive à Francfort [le 10 mai, le jour de réouverture des lieux de culte en Allemagne] ; ce n’était pas un chœur professionnel mais quand même.
Les entractes et les buffets seront bien entendu autorisés [même si les programmateurs ont de leur côté privilégié des pièces courtes, sans pauses, pour éviter un brassage du public] ; les opéras et les théâtres allemands sont à cet égard nettement plus limités dans leur nouveau départ hésitant. L’idée que des hordes humaines puissent se presser à nouveau dans les ruelles étroites de la vieille ville et devant les entrées réduites des trois salles de Salzbourg semble tirée d’un chapitre de l’Apocalypse. Même si l’Autriche a un taux d’infection très faible et déplore bien moins de victimes que la plupart des autres pays, c’est le tourisme artistique qui a dû emporter la décision : il est essentiel pour les finances de Salzbourg. La peur de la maladie a disparu aussi vite que le confinement avait été décrété.
Que le monde assoiffé d’art vienne et admire cette Autriche aussi heureuse qu’insolite ! Il faudra juste que le virus se montre coopératif.
Reinhard J. Brembeck
L'article original (en allemand) ------------------------------------------------------------- Contexte DES ANNULATIONS EN SÉRIE Tour à tour, ces dernières semaines, les grands festivals et foires de l’été ont annoncé leur annulation ou leur report, pour cause de pandémie. Les Eurockéennes, Avignon, les Vieilles Charrues ou encore Rock en Seine en France. Au Royaume-Uni : Glastonbury (qui devait fêter ses 50 ans cette année), The Fringe à Édimbourg, le carnaval de Notting Hill. Le Montreux Jazz Festival ou la foire d’art contemporain de Bâle en Suisse. La Biennale d’architecture de Venise. Le Sziget en Hongrie. Les Rencontres théâtrales de Berlin. Burning Man aux États-Unis – les organisateurs ont annoncé une édition virtuelle. Le Primavera Sound en Espagne. Fuji Rock au Japon. Chaque fois prédominent la tristesse, celle de voir réduit à néant le travail d’une année, et l’inquiétude pour l’avenir, car le coup est rude pour les finances des événements concernés. Légende photo : 13 novembre 2019, à Salzbourg (Autriche). La directrice du Festival de Salzbourg, Helga Rabl-Stadler (2e en partant de la droite), tient une conférence de presse pour présenter l’édition 2020 de l’événement dont elle a la charge. Quatre jours plus tard, un premier cas de Covid-19 sera diagnostiqué en Chine. Photo by BARBARA GINDL / APA / AFP.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2020 10:00 AM
|
Publié dans Sceneweb le 19 juin 2020
Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent reporte la création de son Antigone de Sophocle. Il devait la créer au Théâtre National de Strasbourg à l’automne 2021, Stanislas Nordey l’avait annoncé lors de la présentation de sa saison. “Fragilisé par la COVID 19, Jean-Pierre Vincent souffre de séquelles qui ralentissent son rétablissement” explique le TNS dans un communiqué qui reporte la création à la saison 2021/2022.
photo Vincent Lucas

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2020 11:53 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama 17/06/2020 Équipes qui se croisent peu, marquage au sol… À la MC 93, l’objectif est de maîtriser les règles sanitaires comme on parle une nouvelle langue. Quatorze spectacles supprimés, soit quatre-vingt-quatre représentations annulées. Une perte de recettes de 105 700 €. Lorsqu’on l’a retrouvée dans son théâtre, fermé au public depuis la mi-mars, Hortense Archambault avouait sa fatigue. Mais il faut plus qu’une épidémie et le désastre économique qui en découle pour décourager la combative directrice de la MC93. Dès l’annonce du déconfinement, le 11 mai, en concertation avec son équipe, elle a battu le rappel d’une partie des troupes : « Ceux qui sont en télétravail sont restés chez eux. Les équipes technique, administrative, les gardiens, les membres de la billetterie sont de retour. Les seuls qui demeurent en chômage partiel sont les restaurateurs. Ils reviendront en juin et cuisineront des plats à emporter pour les salariés et les artistes, et contribueront à l’aide alimentaire qui s’organise dans le département de Seine-Saint-Denis. » Réparer le vivant Le 12 mai, Maurizio Moretti, responsable de l’atelier décor, a donc enfourché son vélo flambant neuf et pédalé depuis la porte de Clignancourt, où il habite. Puis il a rangé sa bicyclette auprès d’une dizaine d’autres dans le hall du théâtre : « On a peur de se les faire voler à l’extérieur. » Enfin, il a gagné les trois étages de son atelier et renoué avec les odeurs familières du bois, du fer et de la peinture : « Nous fabriquons le décor d’un spectacle qui va se jouer à Béthune. Les nouvelles règles de sécurité ne nous gênent pas. Nous avons l’habitude de porter des masques. Ce qui nous manque, c’est le moment convivial du repas, que nous aimions partager. Désormais les journées sont continues, nous faisons une pause de quinze minutes pour déjeuner et partons plus tôt. » Recruté en 2017 à la MC 93, le jeune homme porte un masque siglé à son nom. Pas question de le confondre avec celui du voisin. Ici, on ne plaisante pas avec les consignes sanitaires. Portes ouvertes, circulation fluide, gel hydroalcoolique dès l’entrée dans le bâtiment, marquage au sol, chaises et tables espacées. À chaque secteur ses sanitaires. Laïs Foulc, directrice technique adjointe, a sécurisé le site et conçu un protocole sur mesure pour le personnel. Dans la grande salle, qui peut accueillir jusqu’à huit cents spectateurs, Joris Lacoste, auteur et metteur en scène, se plie sans rechigner aux restrictions : « On a nos propres toilettes, nos propres loges ; même chose pour les techniciens ou les administratifs. Les groupes sont séparés pour éviter les contaminations. » L’artiste, dont huit spectacles sont (en principe) programmés à la rentrée dans quinze théâtres d’Île-de-France à l’occasion d’un portrait que lui consacre le Festival d’automne, fait contre mauvaise fortune bon cœur : « Si tout s’annule, nous aurons des problèmes. Nous avons quatre-vingts représentations prévues à l’automne. Nous devons jouer pour financer nos spectacles. Notre subvention n’est pas suffisante pour couvrir nos frais. Notre budget prévisionnel connaît déjà un manque à gagner. » En dépit (ou à cause) des incertitudes, il s’engouffre dans chaque promesse d’avenir. Lorsque Hortense Archambault lui a proposé de venir répéter Suite nº 4 (la création, annulée en mai à Bruxelles, puis à Vienne, doit avoir lieu en septembre à Strasbourg, puis en novembre à Bobigny), l’artiste n’a pas hésité. Et passe outre les retards avec fatalisme : « Le montage du décor a pris plus de temps que la normale. Les équipes son et lumière, qui d’habitude travaillent en parallèle, ne doivent pas se croiser. » L’essentiel, ajoute-t-il, « est d’être ensemble et de recommencer ». Pas si simple de reprendre lorsque les musiciens employés dans le spectacle sont bloqués dans leurs pays respectifs, l’Autriche et la Belgique, obligeant le metteur en scène à recourir à des doublures pour simuler leurs déplacements sur le plateau. Les réponses apportées à cette situation hors norme sont à inventer par chacun. À Bobigny, l’envie n’est pas de subir, mais d’agir. D’entreprendre sans attendre. D’apprivoiser la langue des gestes barrières et de la distanciation sociale pour, au jour des retrouvailles, savoir la parler parfaitement et ne pas être piégé par l’étau de contraintes mal maîtrisées. Hortense Archambault place l’attention à l’autre au centre de ses journées : « Nous sommes devenus un corps commun, soumis aux mêmes impératifs de précaution et de vigilance. Plus nous aurons assimilé les restrictions sanitaires, plus nous pourrons accueillir les gens. Nous devons apprendre à utiliser ces nouvelles règles du vivre ensemble. » “Nous cochions toutes les cases d’une mission rendue impossible par les consignes sanitaires” Sans le Covid-19, Patrick Pineau, acteur, aurait interprété du 18 au 28 juin Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin, un monologue de Mohamed Rouabhi. Le spectacle est reporté en septembre. « Je serai seul sur scène, placé loin des premiers rangs du public. » Le comédien n’est pas du genre à vouloir jouer à tout prix. Mais les mots de ce texte, écrit il y a plus d’un an, le troublent. Ce sont les mots « d’un homme, le dernier, qui vit sur un rocher après une catastrophe et parle d’une planète en grande souffrance ». Alors oui, Patrick Pineau a envie de « déposer cette parole », même si, en face de lui, « les rangs du public doivent être clairsemés ». Le Théâtre de Bobigny reprend sa place dans l’espace public. Et glisse une activité de plus à chaque assouplissement des règles sanitaires. Aujourd’hui l’atelier, les artistes en répétition ; en septembre, les spectacles qu’Hortense Archambault parviendra à replacer dans une programmation forcément bouleversée. La directrice ne lâche rien. Son soulagement est sensible : « Nous cochions toutes les cases d’une mission rendue impossible par les consignes sanitaires. J’ai eu profondément peur que le spectacle sorte très blessé du confinement. Rouvrir, c’est une façon de se réparer. » Pour se réparer, il faut se préparer. C’est ce que fait la MC 93. Maison de la culture de Seine-Saint-Denis 9, bd Lénine, 93 Bobigny | 01 41 60 72 72 Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin, du 26 sept. au 3 oct. Suite nº 4, mise en scène de Joris Lacoste, du 19 au 22 nov. (Dans le cadre du Festival d’automne). | 9-25 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2020 6:08 PM
|
Publié sur le site de France3 PACA - Marseille le 12 juin 2020 Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est décédé à l'âge de 83 ans. Macha Makaïeff, directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille, dont il fut le fondateur, se souvient d'un homme de troupe, un ogre de théâtre, désormais hanté par son "bon fantôme". "Mon père est mort cette nuit chez lui à Paris des suites d'une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans", a indiqué son fils Mathias, également comédien. Metteur en scène, comédien et écrivain, Marcel Maréchal était né en 1937. Fondateur du théâtre du Cothurne à Lyon, il avait fait débuter de nombreux artistes dont Pierre et Catherine Arditi, Maurice Bénichou ou encore Bernard Ballet. Après Lyon, où il avait dirigé le Théâtre du Huitième, il se rend à Marseille où il est nommé à la tête du Théâtre du Gymnase. En 1981, avec François Bourgeat, il fonde La Criée, Théâtre national de Marseille. Quatorze ans après, toujours avec François Bourgeat, il devient le directeur du Théâtre du Rond-Point, jusqu'en 2001 avant de prendre la tête des Tréteaux de France (jusqu'en 2011). Auteur, Marcel Maréchal a notamment écrit "Une anémone pour Guignol" (1975), "Conversation avec Marcel Maréchal" (1983), "Rhum-Limonade" (1995) et "Saltimbanque" (2004). Il s'était également livré à des adaptations de grands classiques comme "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas ou "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier. En tant que metteur en scène, Marcel Maréchal n'a eu de cesse d'alterner création de textes classiques et contemporains. Il a ainsi monté "Cavalier seul" et "Opéra du monde" de Jacques Audiberti, "Badadesques" de Jean Vauthier, "Cripure" de Louis Guilloux ou les grands textes de Musset et Molière. Un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique. A la Criée, l’homme de théâtre a laissé une trace indélébile derrière lui. Macha Makeïeff, l’actuelle directrice, affirme que le théâtre est désormais hanté par son "bon fantôme". "Tous les acteurs ou régisseurs qui ont travaillé avec lui m’en parlent souvent. Ils évoquent un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique". Actuellement à Lyon, où elle prépare des ateliers au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’auteure raconte : "Même ici, quand je dis que je viens de La Criée, les régisseurs viennent me dire ‘Moi j’ai connu Marcel Maréchal’. En plus de l’œuvre qu’il a laissé, il y a cette trace de chaleur, de proximité, d’entraînement". Admirative, elle ajoute : "C'était un homme de troupe, qui savait fédérer. Il a laissé des traces d'effervescence et de bienveillance, presque charnelle". Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat. La metteuse en scène garde "une haute estime" pour cet homme qui vivait par et pour le théâtre. "Quand on voit le nombre de pièces et de projets qu'il a monté, c'était presque un ogre ! Il était dans un appétit immense de théâtre, de troupe et de scène." Marcel Maréchal laisse derrière lui le souvenir d'une personnalité puissante, mais non sans finesse. Macha Makeïeff se rappelle une anecdote touchante sur le metteur en scène. "J'étais à la Criée depuis quelques mois. On traversait une période difficile, avec des travaux et des problèmes d'amiante. Il est venu m'apporter une lettre d’une extrême bienveillance. Elle se terminait par ces mots : 'Vous savez Macha, les initiales M.M ça porte bonheur'. Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat". Le théâtre marseillais songe déjà à lui rendre hommage. "On va prendre le temps de bien le faire. Ça ne se fera pas avec des salles fermées. Il faut attendre de retrouver les usages normaux du théâtre". Légende photo : Marcel Maréchal, comédien et metteur en scène, à la librairie des Arcenaux, à Marseille, en mars 2015. • © Valérie Vrel / MaxPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2020 8:59 AM
|
Par Agnès Freschel, journal Zibeline, le 13 juin 2020
Hommage à Marcel Maréchal
Mon Merlin l’enchanteur
C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés. Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…
Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !
Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. À ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie.
Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui.
AGNÈS FRESCHEL
Juin 2020
--------------------------------
Par Dominique Bluzet, directeur des Théâtres (Gymnase et Bernardines à Marseille, Jeu de Paume et Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence) Salut patron, Ciao l’artiste… Tu t’en vas le jour où nous allons annoncer la construction d’un nouveau théâtre. Tu t’en vas, tu me laisses mais tu es toujours là. Ce que nous créons, ce que nous inventons, c’est une part de ce que tu m’as enseigné. Tu as incarné pour moi l’état tripale du théâtre : comment avoir ça dans le sang, comment le vivre avec ses tripes, comment ne pas pouvoir vivre sans, comment être dans le théâtre, comment vivre avec… Tu as été le héraut, le porte-voix du théâtre marseillais. J’ai essayé, à ma manière, de prendre ta suite. Tu as été l’artiste, le patron, l’ouvrier, le spectateur, la grande gueule de cet art dans notre ville. Aujourd’hui, alors que je me rends à une conférence de presse pour annoncer quelque chose qui t’aurait enthousiasmé, je me sens à la fois vide et plein de toi. Un théâtre populaire, une grande baraque en bois, du maquillage et des costumes, du cirque et du guignol… Je vais demander que la rue qui y mènera porte ton nom… Salut l’artiste, salut patron, salut à toi qui fut mon père du théâtre… Filialement. DOMINIQUE BLUZET
Directeur des Théâtres
Photo : Marcel Maréchal et Louis Guilloux © X-D.R.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 2:31 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde 13 juin 2020 Pionnier de la décentralisation théâtrale, il a marqué de nombreux rôles et mises en scène de sa truculence généreuse. Il est mort, jeudi 11 juin à l’âge de 82 ans.
C’était un homme qui aimait de gourmandise le théâtre et la vie. Il portait les cheveux en crinière, au vent, et il avait le goût des écritures ensoleillées qu’il a servies, comme comédien et metteur en scène, au long d’une carrière de cinquante ans qui lui a valu de diriger plusieurs institutions. Né un jour de fête, le 25 décembre 1937, à Lyon, Marcel Maréchal est mort un jour gris à Paris, jeudi 11 juin, à 82 ans, des suites d’une fibrose pulmonaire, a annoncé son fils Mathias Maréchal, lui-même acteur. Depuis quelques années, on ne le voyait plus guère sur les plateaux, comme s’il était effacé, dans un contexte qui ne ressemblait plus au théâtre qu’il avait connu et aimé, et qui aujourd’hui appartient définitivement au siècle dernier.
Par sa biographie, Marcel Maréchal est rattaché à la génération des pionniers de la décentralisation. Il a 10 ans quand Jean Dasté prend la direction de la Comédie de Saint-Etienne, l’un des tout premiers centres dramatiques nationaux. A 21 ans, il fonde la Compagnie des comédiens du Cothurne à Lyon, qui s’installe deux ans plus tard dans une toute petite salle où Roger Planchon a fait ses débuts, rue des Marronniers, à deux pas de la place Bellecour. C’est là que Marcel Maréchal crée en 1963 Le Cavalier seul, de Jacques Audiberti (1899-1965), dont la lecture lui a provoqué « un éblouissement ». Le jeune homme de théâtre lyonnais a trouvé son père spirituel : un auteur d’Antibes à la langue imprudente, qui manie l’excès en entrelaçant la tragique et la bouffonnerie. Le succès public et critique du Cavalier seul valent à Marcel Maréchal d’émerger. Désormais, il compte dans la galaxie du théâtre, et il reçoit ses premières subventions.
Bada, c’est lui
Jusqu’en 1969, il reste rue des Marronniers, où il crée les auteurs qui complètent sa trilogie d’élection et de cœur : Jean Vauthier (1910-1992) et Louis Guilloux (1899-1980). Comme il l’avait fait avec Le Cavalier seul, Marcel Maréchal s’empare du personnage de Bada, René Dupont dit « Badaboum », fou stellaire qui ne veut voir d’autre monde que celui qu’il s’invente, et auprès de qui sa femme (Martine Pascal) joue le jeu de l’imposture, à la vie, à la mort. Le lyrisme teinté d’angoisse de Jean Vauthier colle telle une peau à Marcel Maréchal : Bada, c’est lui, tant et si bien qu’il y reviendra, vingt ans plus tard. Et toujours émerveillera. Avec Cripure, adapté du roman Le Sang noir, de Louis Guilloux, c’est dans une autre peau, grotesque, déchirée et grandiose, qu’entre le comédien. Il a trouvé les rôles qui façonnent son style.
Marcel Maréchal cherchait sur le plateau à rendre l’intensité de « la vie portée au rouge », selon ses mots
Jean Vauthier ne cessera d’accompagner l’acteur-metteur en scène, pour qui il écrira plusieurs adaptations d’auteurs élisabéthains, en particulier Thomas Middleton (La Tragédie du vengeur), et Shakespeare (Romeo et Juliette, Le Roi Lear). Cela se fera au cours des années qui vont mener Marcel Maréchal à la direction du Théâtre du Huitième, à Lyon, de 1968 à 1975, puis à celle du Théâtre du Gymnase, à Marseille, qu’il quittera pour le Théâtre de la Criée, nouvellement construit, sur le Vieux-Port. L’inauguration, en 1981, a lieu avec un hommage à Scapin, un des personnages de Molière qui convient le mieux au style de l’acteur, avec celui de Sganarelle. Patrice Chéreau l’avait compris très tôt, en lui confiant dès 1968 le rôle qu’il reprend en 1988, dans sa propre mise en scène, et avec, dans le rôle de Dom Juan, Pierre Arditi qu’il dirigera également dans Maître Puntila et son valet Matti, de Bertolt Brecht.
Marcel Maréchal cherchait sur le plateau à rendre l’intensité de « la vie portée au rouge », selon ses mots. Il a particulièrement réussi avec Capitaine Fracasse et Les Trois Mousquetaires, galvanisés par la truculence généreuse qui a assuré ses plus grands succès. Quand il a quitté Marseille pour diriger le Théâtre du Rond-Point, à Paris, en 1994, Marcel Maréchal a eu du mal à retrouver ses marques. Question d’époque, d’esthétique, de répertoire. Une nouvelle génération occupait le devant de la scène, le vent avait tourné, qui a mené l’acteur metteur en scène à prendre en 2002 la direction des Tréteaux de France, où il a œuvré jusqu’en 2010. Et où il est revenu à Louis Guilloux, avec La Maison du peuple, en 2002.
Marcel Maréchal en quelques dates
25 décembre 1937 : Naissance, à Lyon
1963 : « Le Cavalier seul », d’Audiberti
1981 : Prend la direction du Théâtre de la Criée, à Marseille
1987 : « Capitaine Fracasse », d’après Théophile Gautier
11 juin 2020 : Mort, à Paris
Brigitte Salino
Légende photo :
Marcel Maréchal lors de la 14e Nuit des Molières, le 12 juin 2000 à l’Opéra-Comique de Paris. JEAN-PIERRE MULLER / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 24, 2020 3:31 PM
|
Par Alix de Boisset dans le blog Ikoness le 21 mars 2016 Lire sur le blog d'origine, avec de nombreuses photographies de scène d'Eric Génovèse
Sociétaire de la Comédie Française depuis 1998, diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et Chevalier des Arts et Lettres., Eric Génovèse mène en parallèle trois activités : comédien, récitant dans des ouvrages musicaux, et metteur en scène au théâtre et à l’opéra. En tant que comédien, il se voit proposer immédiatement des rôles majeurs dans des productions remarquées ; il joue ainsi Pasolini et aborde Corneille (Cléandre de “La Place Royale” et Ptolomée de “La Mort de Pompée”) mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman et Stanislas Nordey. En 1993, année de son entrée à la Comédie-Française, il est Louis Laine dans “L’Échange” de Claudel à la Comédie de Genève. Depuis, il interprète au Français les grands rôles du répertoire classique et contemporain sous la direction de metteurs en scène comme Youssef Chahine, Jorge Lavelli, Georges Lavaudant, Roger Planchon, Daniel Mesguich, Anatoly Vassiliev, Lukas Hemleb, Joël Jouanneau, Jean-Luc Boutté, Denis Podalydès, Andrei Serban ou Robert Wilson… Son répertoire comprend des auteurs aussi divers que Shakespeare (Hamlet et “La Tempête”), Molière évidemment (Cléante de “L’Avare”, Covielle du “Bourgeois Gentilhomme”, le rôle-titre du “Tartuffe”, Philinte du “Misanthrope”, Amphytrion…), les tragiques, Racine (Hippolyte de “Phèdre”, Oreste d’”Andromaque” et Xipharès de “Mithridate”), Corneille encore (“Tite et Bérénice”, Clitandre), mais aussi Feydeau, Rostand, Duras, Tony Kushner, Copi, Lars Noren ou La Fontaine… On l’a vu au cinéma et à la télévision sous la direction de James Ivory, Benoît Jacquot, Gérard Vergez entre autres. On a pu le voir sur les scènes de la Comédie-Française dans “La Grande Magie” d’Eduardo De Filippo, dans “Les Naufragés” de Guy Zylberstein, dans “La Pluie d’été” de Marguerite Duras, “Peer Gynt”, “La Place Royale”, “Phèdre”, “Les Trois Sœurs”, “Cyrano de Bergerac”, “L’Anniversaire” d’Harold Pinter, “Phèdre”, “Lucrèce Borgia”, “Le Misanthrope”, “La Double Inconstance”. Il se produit en outre dans un spectacle de cabaret réunissant les comédiens du Français autour des chansons de Georges Brassens. Cette saison en 2016, avec la Comédie-Française il participe au “Misanthrope”, “La Double Inconstance”, “Lucrèce Borgia”, “La Mer” de Edward Bond et jouera dans “Les Damnés” de Visconti au Festival d’Avignon (Palais des Papes).
Son activité musicale, née d’un apprentissage du piano dès l’enfance, se concrétise par une intense participation en tant que narrateur lors de concerts ou des versions scéniques d’œuvres comme le “Lélio” de Berlioz, “Le Martyre” de Saint Sébastien de Debussy, “Le Roi David” de Honegger, “L’Histoire du Soldat” de Stravinsky, “Le Serment de Tansman”, “L’Histoire de Babar” de Poulenc, “Pierre et le Loup” de Prokofiev, “L’Enlèvement au sérail” de Mozart, “Hydrogen Jukebox” de Philip Glass, The Young Person’s Guide to the Orchestra de Britten, “Peer Gynt” de Grieg… avec les orchestres philharmoniques de Radio-France, du Luxembourg, de Lorraine, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre National de France, à l’Opéra de Rome, Salle Gaveau, au Capitole de Toulouse et au Théâtre des Champs-Elysées sous la direction notamment de Kurt Masur, John Nelson, Emmanuel Krivine, Alain Altinoglu, Jean-Christophe Spinosi, Vladimir Cosma… ou en formation chambriste avec le Trio Wanderer, Gordan Nikolitch, Claire Désert, Muza Rubackyté ou encore avec le baryton Matthias Goerne. Au cours de l’été 2012, il fait ses débuts au Japon dans “Jeanne d’Arc au Bûcher” d’Honegger (Frère Dominique) dans le cadre du Saito Kinen Festival de Matsumoto, production reprise lors de la saison 2014-2015 à l’Opéra de Monte-Carlo, à la Halle au Grain de Toulouse, à la Philharmonie de Paris (Orchestre de Paris, dir. Kazuki Yamada) puis au Lincoln Centre de New York (New York Philharmonic, dir. Alan Gilbert), aux côtés de Marion Cotillard. Il prête sa voix lors de l’enregistrement de “Une Journée” de Martial Caillebotte avec le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France et l’Orchestre Pasdeloup et retrouve l’Orchestre National de France pour “La Machine de Trurl” de Pascal Zavaro à Radio-France.
Enseignant l’art dramatique en lycée et au Cours Florent, il signe sa première mise en scène, “Les Juives” de Robert Garnier au Théâtre du Marais en 2001. Il met en scène avec la collaboration de l’IRCAM “Le Privilège des Chemins” de Fernando Pessoa à la Comédie-Française en 2004 et met en scène la pièce “Erzulie Dahomey” de J.-R. Lemoine à la Comédie Française en 2012. L’Opéra National de Bordeaux lui confie sa première mise en scène lyrique, “Rigoletto”, en 2007. En début de saison 2008-2009, il met en scène “Cosí fan tutte” au Théâtre des Champs-Elysées repris en avril 2012. Il est réinvité par l’Opéra National de Bordeaux pour mettre en scène l’opéra “L’Ecole des Femmes” de Rolf Liebermann lors de la saison 2010-2011, et met en scène “Anna Bolena” de Donizetti à la Staatsoper de Vienne.
1. Vous considérez-vous comme une figure du Théâtre ?
Eric Génovèse : Une figure, incontestablement puisque j’ai la chance d’y jouer sans discontinuer depuis bientôt 20 ans. Mais de quelle importance, je l’ignore… ça n’est pas à moi d’en juger ! (rires). Disons que j’y ai une activité très intense, que je suis dans un théâtre approximativement 300 jours par an, que je croise mon nom sur pas mal d’affiches dans les rues….
2. Comment définiriez-vous votre style ?
Eric Génovèse : Il est assez difficile pour un comédien de définir ce qui fait son originalité, ce qui fait qu’on le demande, qu’on l’imagine ici ou là… Sa faculté à faire naître le désir. A vrai dire, j’attaque toujours les répétitions en essayant d’oublier tout, en étant le plus disponible, le plus vierge possible. Comme c’est de toute façon impossible car la technique et l’expérience que l’on a sont gravées et difficilement effaçables, je tends au style “page blanche”. C’est assez inconfortable mais j’aime assez vagabonder d’un style à l’autre : épouser celui qui convient à ce que je suis censé défendre. Il faut pour cela se permettre la perméabilité, donc, éprouver ses propres limites. Chaque metteur en scène avec qui j’ai travaillé m’a raconté de moi des caractéristiques différentes…
Je ne pense pas être un intellectuel. Un homme qui pense, oui mais avec tous ses sens. Peut-être, sans doute même, je suis un acteur de texte. Mon rapport à la matière textuelle m’a souvent été cité comme un point fort. On m’a même parlé de” Touche de texte”, comme on parlerait d’un toucher pour un pianiste ou d’un trait pour un peintre. C’est le plus beau compliment que l’on m’ait fait… Je pense ne pouvoir parvenir à rien sans un bon texte. Le silence qui précède et suit une phrase est pour moi le gage de la qualité, de la portée de cette phrase et c’est lui que je vise en réalité lorsque je travaille. J’aime dire, par dessus tout pour faire vivre l’intensité de ce silence, le trouble qu’il convoque. Cela peut sembler paradoxal mais c’est ainsi que je vis les choses.
J’entends souvent qu’il y aurait un style Comédie Française, ce qui ne veut à peu près rien dire, en tous cas aujourd’hui. En étant tout à fait sincère, je ne vois chez tous mes camarades que deux points communs: la rapidité et la souplesse. Certaines approches sont diamétralement opposées au sein même de cette troupe. Et je ne considère pas qu’un style soit façonné par un lieu dans lequel on travaillerait. Il est le fruit d’une réflexion, d’une expérience, de ce que l’on vit et de comment on le vit, donc, propre à chacun. Si je devais me choisir un Style, il faudrait qu’il soit suffisamment identifiable mais qu’il ne ressemble en rien à une étiquette. Un style complexe à déchiffrer mais évident à recevoir.
3. Le Théâtre… Une vocation ?
Eric Génovèse : A priori, je n’y étais pas pré-disposé : Je suis issu d’une famille plutôt modeste et peu encline à l’art théâtral. Quelques indices cependant : Ma grand mère paternelle ne savait ni lire, ni écrire, mais regardait “des chiffres et des lettres” tous les soirs avec gourmandise. Ma grand mère maternelle chante Werther ou Rigoletto sans avoir jamais mis les pieds dans un Opéra…. Ma mère était couturière. Elle avait des doigts d’or. Mon père lui, né italien et naturalisé français à l’âge de 11 ans était parti pour faire des études. Il était à peine devenu ingénieur en électronique lorsque je l’ai perdu, j’étais encore un petit enfant. J’ai retrouvé cependant deux livres qui lui appartenaient, très tard, des pièces de Hugo et de Marivaux, cela m’a beaucoup ému et intrigué. Ma tante m’emmenait très jeune voir des expos de Giacometti, Miro, Picasso, Ernst… Et des concerts de Lou Reed, Patty Smith, Jaco Pastorius, Keith Jarrett….. A l’âge de 9 ans un panneau affichant “cours de théâtre” m’a frappé et j’ai demandé à ma mère de m’y inscrire ainsi qu’à des cours de piano… Elle a accepté sans me poser de questions. Pourquoi cet appel ? Je l’ignore. Je n’avais jamais vu une pièce de théâtre ! Une nécessité secrète donc : nécessité, je préfère d’ailleurs ce terme à celui de vocation.
4. Racontez nous votre parcours…
Eric Génovèse : A l’âge de 17 ans j’ai décidé d’arrêter mes études; j’avais beaucoup de problèmes de communication avec les gens de mon âge et pour me faire accepter je faisais le pitre et ruinais mes possibilités que l’on disait grandes. J’étais inadapté, malheureux et très seul, avec un grand manque de confiance en moi. J’ai demandé à ma mère de monter à Paris (nous vivions à Nice) pour y prendre des cours de Théâtre. Elle l’a accepté avec confiance et s’est dévouée pour financer mes études. Deux ans de Cours Simon, une première tentative au concours du Conservatoire National : un échec ! Je suis ensuite admis par François Florent en deuxième année dans la classe de Denise Bonal puis après quelques mois, je rencontre par le biais d’un ami Isabelle Janier et Tania Torrens, toutes deux à la Comédie Française. Elles me font travailler dans leur loge mon deuxième concours du Conservatoire National et je suis admis, à ma grande surprise. Là, je rencontre Viviane Théophilidès, Pierre Vial, Jean-Pierre Vincent, Bernard Dort et Madeleine Marion qui me forment et je travaille comme un dingue pendant trois ans !
En troisième année ma chère Madeleine Marion, qui est devenue ma maman de Théâtre et mon amie proche – elle nous a quittés en 2010 – me choisit pour être “Oreste” dans l’Oreste de Vittorio Alfieri dans les ateliers de sortie duConservatoire. C’est là que tout commence sérieusement à changer. Stanislas Nordey qui est mon Pylade me propose de jouer “Bête de Style” de Pasolini au TGP de Saint-Denis, Redjep Mitrovitsa me voit jouer et parle de moi à Brigitte Jaques qui m’auditionne et m’engage pour jouer Cléandre dans “La place royale“et Ptolomée dans “La mort de Pompée” de Corneille la saison qui suit ma sortie du Conservatoire. Suivent tout naturellement, Louis-Laine dans “L’échange” de Claudel à la comédie de Genève et plusieurs reprises et un film avec Benoit Jacquot de “La Place Royale” qui est un grand succès. Trois années d’intermittence, mais cinq mois seulement d’Assedic (histoire de ne pas perdre de vue la précarité qui menace, j’ai gravé ces mois très fort dans mon esprit) !
En 1993, Georges Lavaudant monte “Hamlet” à la Comédie-Française et cherche un acteur pour jouer Fortinbras et La Reine de Comédie (deux rôles aux antipodes l’un de l’autre). C’est à nouveau Redjep Mitrovitsa qui lui conseille de venir me voir dans “La Place Royale” et quelques jours plus tard, je reçois un télégramme de Jean-Pierre Miquel qui était Directeur du Conservatoire lorsque j’y étais élève et qui vient d’être nommé Administrateur de la Comédie Française qui me propose d’y entrer comme Pensionnaire pour jouer ces deux rôles, ainsi que celui de Scipion dans le “Caligula” de Camus que met en scène Youssef Chahine. En quatre ans à peine dans les lieux, je suis nommé 499éme Sociétaire, élu par mes pairs. J’y joue de nombreux rôles et y rencontre des metteurs en scène et des camarades formidables. Cela fait seize ans que ça dure…..et je souhaite y demeurer tant que je progresse et que l’équilibre entre les raisons de partir et les raisons de rester penchent du côté de la seconde option !
J’ai eu aussi besoin d’aller voir du côté de l’enseignement et de la mise en scène. A vrai dire c’est l’enseignement, le goût de diriger les acteurs qui m’a fait sauter le pas ! François Florent m’a demandé d’animer un Stage sur la Tragédie en 1999 et j’y ai rencontré une équipe avec qui j’ai monté “Les Juives” de Robert Garnier au Théâtre du Marais. Cinq heures de spectacle dans une langue sublime mais horriblement difficile, une entreprise folle et d’une difficulté sans nom, un pari impossible, un suicide pour un début ! Mais monter quelque chose de plus habituel ne m’excitait pas. J’avais choisi ce répértoire précisément pour la raison qu’il est si difficile et iconoclaste que personne ne le monte ! C’est un répertoire que j’aime et je pouvais me permettre d’y aller en laborantin. Marcel Bozonnet m’a ensuite proposé de travailler avec L’Ircam et d’imaginer un spectacle issu de cette collaboration. J’ai donc à nouveau choisi un objet étrange : “Le privilège des chemins” de Fernando Pessoa et nous l’avons joué au Studio Theatre de la Comédie-Française. Entre temps, Michel Glotz – grand impresario de musique qui nous a quitté lui aussi ces jours derniers – m’avait admis dans son agence en tant que Récitant. J’avais besoin de retrouver la musique ! Le Théâtre et le Piano, avais-je dit à 9 ans ! Il semblerait que je sois déterminé !
J’ai collaboré et collabore encore avec des musiciens et des orchestres extraordinaire pour des oeuvres mêlant musique et textes parlés (“Le Martyre de Saint Sebastien” de Debussy, “Lélio” de Berlioz, “Peer Gynt” de Grieg, “L’histoire de Babar” de Poulenc, “l’Enlèvement au sérail” de Mozart et autres, jusqu’a “Hydrogen Jukebox” de Philipp Glass que j’ai crée en France dans une mise en scène de Joel Jouanneau…..) avec des grands chefs comme Kurt Masur, Emmanuel Krivine, John Nelson, Alain Altinoglu, Jean-Christophe Spinosi… ou en récitals aux cotés de chanteurs fantastiques comme Matthias Goerne, Camilla Tilling entre autres, sans oublier des concerts que je donne régulièrement avec le Trio Wanderer, Philippe Berrod ou Muza Rubackyté… Toutes ces activités m’ont mis au contact de Directeurs de Théâtres et j’ai manifesté mon envie de mettre en scène de l’Opéra, qui est pour moi la forme la plus aboutie de l’expression scénique, le vecteur d’émotion le plus puissant. “Rigoletto” de Verdi a été mon premier essai grâce à Thierry Fouquet à L’Opéra National de Bordeaux.
Quelques mois plus tard, Dominique Meyer me proposait mes débuts au Théâtre des Champs Elysées à Paris avec “Cosi fan tutte” de Mozart ! Encore une fois, je n’ai pas commencé par le plus simple. Des oeuvres sur lesquelles les références pleuvent ! Mais finalement quitte à prendre des risques, je suis heureux d’avoir commencé en devant plonger sans bouée et en étant au contact des plus grands (compositeurs, musiciens, chanteurs) car c’est ainsi que l’on apprend le mieux ! Et j’adore apprendre. On me propose de continuer, je continuerai. Les choses faciles, si tant est qu’elles existent, ne m’intéressent pas, ne m’intéressent plus ! J’aime les enjeux de taille, même si j’ai conscience de mes limites. Il m’est cependant arrivé de refuser des propositions. Je ne peux pas, personne ne peut TOUT faire, TOUT incarner, être l’homme de tous les auteurs ou compositeurs. Mais tendre à repousser ses limites intelligemment ou apprendre à faire avec, à en faire des atouts, cela me semble nécessaire. De très grandes carrières se sont faites sur des limites ! En somme, apprendre à se connaître et à se surprendre est un équilibre vital mais assez difficile car il demande un instinct sûr et une conscience aiguë des obstacles à franchir. J’ai un contact avec les chanteurs si facile, si galvanisant, si extraordinaire que je vais continuer à avancer, à apprendre et à avoir du plaisir ! Donc nous nous apprenons mutuellement, j’admire ce qu’ils sont capables de faire : C’est un partage sensationnel, une véritable histoire d’amour.
J’ai l’immense chance d’avoir rencontré dans mon parcours des êtres fidèles qui m’ont invité et réinvité à partager des aventures artistiques. Tout est là, dans cette fidélité, dans ce regard et cette confiance que certains vous donnent. Car sans celui ou celle qui sait vous regarder, vous n’êtes qu’un être amputé lorsque vous êtes un comédien ou un metteur en scène. Lorsque je lis mon CV, je réalise que j’ai eu un parcours très privilégié. Et pourtant que de doutes et de tentations de tout abandonner ! J’oublie les embûches… Elles m’ont apparemment toujours fait rebondir. Mais j’ai toujours dans un coin de ma tête la conscience que tout peut s’arrêter demain.
5. La journée type d’un comédien du Français ?
Eric Génovèse : Cela dépend des périodes. Et cela dépend des comédiens. Il serait illusoire de penser que tous les comédiens du Français ont le même rythme. Certains jouent plus, d’autres moins. Les Statuts attribuent à l’Administrateur Général de décider des distributions. Très souvent, – et plus lorsque l’on est jeune ou nouveau – on joue le soir et répète en meme temps une autre piéce l’après-midi. On peut jouer aussi plusieurs pièces en alternance dans la même semaine et en répéter encore une autre l’après midi ! Parfois même, en jouer six dans un week end : une à 14h à la salle Richelieu, une à 18h30 au Studio théâtre et une à 20h30 à nouveau à Richelieu. Et Pareil le lendemain ! Les pensionnaires ont pour seul devoir d’activité de jouer. Les Sociétaires, eux, peuvent être appelés à d’autres devoirs. De coutume, il n’y a pas de répétitions le matin mais parfois des enregistrements à la radio, ou des comités d’administration qui régissent le fonctionnement de la Maison. Ce sont des sociétaires élus à moitié par leurs camarades, à moitié par l’Administrateur Général ainsi que le Doyen des Sociétaires qui y siègent, des comités de Lecture pour accepter ou non les pièces que l’Administrateur général propose pour l’entrée au répertoire, des assemblées générales…
Etre un comédien Sociétaire au Français demande beaucoup d’aptitudes à autre chose que le seul métier de comédien. C’est une troupe qui a un fonctionnement unique et particulier. On y est juge et partie. On peut aussi devoir assister à toutes les représentations pendant une semaine, plusieurs fois dans l’année, pour veiller au bon déroulement des spectacles, de leur évolution, de leur suivi technique. Personnellement, je n’ai jamais joué plus de trois pièces en même temps, et je ne le souhaiterais pas ! Je me contrains beaucoup car je suis plutôt un couche-tard et un lève-tard ! Il arrive aussi que certains tournent le matin ou ne jouent pas pendant des mois (ce qui est toujours très mal vécu, il n’est paradoxalement pas aisé d’être payé pour ne rien faire ! C’est même très humiliant pour un artiste ! ). La chose la plus fatigante est l’irrégularité des activités car il est difficile de régler son horloge interne ! En résumé, il faut une bonne santé, une bonne disponibilité aux autres, des nerfs solides, une bonne dose d’enthousiasme et une souplesse certaine.
6. Quels sont les univers littéraires ou artistiques qui vous influencent dans votre travail de comédien et de metteur en scène ?
Eric Génovèse : Tout ce qui fait partie de la vie me sert en règle générale. M’informer de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se fait artistiquement est essentiel. Je suis très curieux et une vie ne me suffira pas à étancher ma soif de connaissance et d’émotions. Je lis beaucoup, j’écoute énormément de musique et je voyage beaucoup, sillonnant les architectures, les modes de vie et les musées. Mes goûts sont très éclectiques. Voyager est vital pour moi ! Il est inenvisageable de ne pas aller découvrir un pays nouveau chaque année et de ne pas retourner dans d’autres le plus souvent possible !
Ma vie entière se nourrit de l’Art. Au quotidien, j’alterne entre mes artistes favoris et ceux que j’ai envie de découvrir. Je relis ” Les affinités électives” de Goethe et “La légende des siècles” de Hugo, vais voir “Le jardin des délices” de Bosch, les statues du Bernin, la “sagrada familia” à chaque passage à Madrid, Rome ou Barcelone… Je revois tous les films de Dreyer, de Fellini ou Bergman, écoute Nina Simone, Billie Holiday, Monteverdi, Haendel, Bartok ou Mozart régulièrement… Je lis des polars scandinaves, ne manque pas un Echenoz, feuillette toutes les rentrées littéraires, ne manque pas un Tarentino, un Almodovar, un Haneke, un Gondry, un Gus Van Sant, un film Scandinave… ! J’adore la peinture contemporaine, la Photo, la musique répétitive, les films d’animation. Je vais au concert ou à l’opéra plusieurs fois par mois. J’ai raté Piaf et la Callas, ça me rend dingue !
Je ne peux pas voir toutes les expos, entendre toutes les voix, voir jouer tous les acteurs, ça me désole. Ce qui est terrible c’est qu’il me faut du temps pour faire le vide, regarder l’horizon et ses imperceptibles nuances pendant des heures et laisser le soleil et la mer me réchauffer le coeur ! Je suis totalement schizophrène : un contemplatif, affublé d’une curiosité et d’une soif de communication humaine inextinguibles… Lorsque je travaille sur une oeuvre, je me focalise sur l’univers sonore, pictural et littéraire qui couvre l’époque de l’écriture de celle -ci mais des références tout à fait hors époque peuvent m ‘inspirer. Par exemple lorsque j’ai joué “Tartuffe”, ce sont les écrits de Louis Jouvet et” Théorème” de P.P Pasolini qui m’ont donnés les clefs du personnage. Il serait injuste de ne pas mentionner le regard de mon metteur en scéne et de mes partenaires car rien n’advient de par soi seul. Lorsque je jouais une piéce de Guy Zylberstein sur le monde de l’art, mis en scène par Anne Kessler et nous échangions ou regardions ensemble des films. Ca va de “L’année dernière à Marienbad” de Resnais, à Kate Winslett dans” The Reader”. Nous regardons des tableaux, des documentaires sur Rembrandt, Pollock, allons regarder les gens dans le hall de l’hotel Lutétia, c’est trés passionnant ! J’ai eu un choc esthétique en découvrant le film de Peter Watkins, “Munch”. En fait tout converge. Une création est faite d’une somme incommensurable de références, de moments de vie et de relents inconscients.
7. Que ressentez-vous lors de cette osmose éphémère que vous vivez avec le public le temps d’un soir ?
Eric Génovèse : Il se passe énormément de choses au cours d’une représentation. Certains soirs, on peut avoir le sentiment d’une porte définitivement close : le public est agité, bruyant, indisponible. Il est très compliqué dans notre monde d’aujourd’hui de trouver des espaces de silence, des endroits ou l’on se pose pour s’ écouter, s’évader du bruit, se retrouver.
Je déteste le bruit. Celui qui brouille tout, qui meuble, qui dissipe. Tout est construit pour que l’homme se dérobe à lui même. Tout se vaut. La vérité comme le mensonge, la musique comme le bruit, le plus précieux comme le plus abject. C’est pourquoi je deteste la télévision. C’est un faux ami, quelque chose qui vous abrutit, vous aide à passer a coté de vous, vous sature d’informations jusqu’à vous rendre incapable de réfléchir, de déméler le faux du vrai.
Ce qui me bouleverse au théâtre, c’est la disponibilité au silence. La qualité de l’écoute. Le fait que l’on soit venu, que l’on se soit déplacé, que l’on ait choisi d’être là pour vous écouter. Une représentation, c’est l’heure de vérité. La qualité du silence est mon seul baromètre. C’est ce sentiment qui est jouissif, cette communion dans l’importance de ce qui se dit. Car entre deux silence, un mensonge proféré est une fausse note qui tinte à l’oreille de chacun.
Lorsque l’espace de quelques secondes tout se tait et que toute une salle reste suspendue à la résonnance de la parole ou du geste que vous avez donné , alors vous vous sentez plus léger. Il y a eu un moment de grâce et cela valait la peine d’etre là tous ensemble. C’est pour ces moments là que j’aime jouer.
8. A quoi pense un comédien sur scène, une fois que la concentration a pris le pas sur le trac ?
Eric Génovèse : A ce qu’il dit de préférence !! Comment penser à autre chose ? Idéalement, il parle, il écoute son partenaire et il répond. Lorsque le travail de répétition à été bien mené, il ne reste plus que cela à faire : se rendre disponible, tout oublier et retrouver la spontanéité. Bien entendu, il y a une veille permanente, un état de conscience aigu qui permet au comédien d’accueillir un accident, de le rétablir ou de l’utiliser. On appelle ça “le troisième oeil” : une sorte d’élasticité temporelle, de distance entre le conscient et l’inconscient. On doit être totalement maître de soi mais se laisser surprendre. Cela fait partie de l’état de jeu. Mais il n’y a pas à s’en soucier,c’est un état naturel lorsqu’on a bien travaillé et que l’on est au bon endroit. C’est une gymnastique et c’est à cela que servent les répétitions : à établir les règles du jeu.
9. Comment séparez-vous vos rôles de votre vie privée ?
Eric Génovèse : Celui qui est sur scène c’est moi et pourtant pas exactement le même que celui qui est devant son café le matin ! Il m’arrive de jouer trois rôles en même temps, il faut donc faire appel à des aspects de moi différents, à des énérgies différentes. Il y a un grand fantasme autour du rôle qui façonnerait votre vie… Si je devais être déprimé chaque fois que mon personnage meurt ou est malheureux, je pense que je serais deja interné (rires).
Personnellement, il m’arrive de ne pas réaliser que j’ai joué la veille au soir devant des gens. Lorsque quelqu’un me fait comprendre qu’il me reconnait, j’ai toujours un temps de latence, je me demande pourquoi. Un jour, quelqu’un m’a abordé dans un magasin en faisant référence au personnage que je jouais la veille, et je n’ai absolument pas compris de quoi et pourquoi il me parlait ainsi… Il a dû me prendre pour un fou ! Mais c’est un métier relativement proche de beaucoup d’autres, on convoque certaines choses de soi à un moment donné, programmé, avec tout un contexte autour puis on est différent lorsqu’on fait la cuisine ou prend sa douche.
Ce qui se passe au moment du jeu est une alchimie assez complexe mais canalisée. C’est peut être en période de répétitions que les choses sont plus compliquées, car la recherche vous obsède et ne vous quitte pas à la porte du théâtre… En terme d’humeur, il y a des spectacles qui vous donnent de l’énergie, d’autres qui vous la pompent ! Mais c’est d’avantage une ambiance de spectacle ou de répétition qui interagissent avec votre vie privée, qu’un personnage en particulier.
10. Votre meilleur souvenir sur scène ?
Eric Génovèse : J’aime à penser qu’il est pour demain…
11. Quelles missions donnez-vous au Théâtre ?
Eric Génovèse : Celle d’un révélateur face au mystère de l’humanité, je crois. Pour moi le Théâtre est un barrage contre l’ignorance, la bêtise et l’instrumentalisation des êtres .S’il peut aider à complexifier un peu le débat ambiant, s’il pose des questions, lutte contre les raccourcis démagogiques en interrogeant les énigmes, s’il porte le trouble, émeut, réjouit ou indigne, s’il n’est pas simplement rassurant mais perturbant, vivant, alors il est utile voire indispensable. Malheureusement, on le pousse régulièrement à devenir un “produit”, un outil de consommation comme un autre et cela est insupportable ! Il doit garder, revendiquer sa spécificité, son espace propre qui est celui du partage et de la réfléxion collective. C’est une place fragile et c’est pour cela qu’elle est belle. Parce qu’elle n’est pas quantifiable ou rentable de manière certaine et rapide ! Parce qu’elle demande une ouverture des consciences et que c’est un travail de longue haleine, un acte de résistance.
On n’interroge pas le monde avec des formules magiques, avec des slogans miracles.. On participe en cherchant, parfois laborieusement, à rendre une parole audible, à accueillir des petits instants de grâce qui, avec le concours de chacun, donneront peut-être naissance à d’autres pousses d’espoir, qui feront leur chemin vers de nouveaux commencements.
12. Pourriez-vous expliquer votre mise en scène pour le Théâtre et l’Opéra ?
Eric Génovèse : Je n’ai pas de recettes particulières. J’arrive en répétitions très préparé. Il me faut une longueur d’avance sur tout le monde et je travaille avec mon équipe très en amont. Je me considère avant tout comme le réceptacle d’une parole ou d’une musique que j’interprète avec mon entendement, ma sensibilité, et que je tâche de transmettre à ceux qui vont l’interpréter. J’essaie d’être le premier spectateur, de leur dire ce que j’entends mal ou n’entends pas, ce que je crois qu’il faudrait faire entendre ou mieux entendre. Je cherche le moyen de leur en donner la possibilité. Il faut pour cela repérer assez vite comment s’adresser à chacun, comment l’aiguiller ou le laisser avancer. Je crée un cadre, un angle de vue. Le Théâtre et L’Opéra sont très différents.
Au Théâtre, on écrit ses silences et l’on impose son rythme, on le choisit, de même que l’on choisit ses interprètes, le metteur en scène est aussi le chef d’Orchestre. L’Opéra demande une grande humilité, le temps est écrit et les contraintes sont plus nombreuses, plus éprouvantes pour les interprètes qui ont des degrés divers de connaissance de l’oeuvre selon qu’ils l’ont déja chantée ou non. ll faut pour le metteur en scène, mettre en jeu, trouver son espace et prendre en compte les difficultés liées à l’exercice du chant et le temps de répétition est court. Le danger c’est que cela réduit parfois le rôle du metteur en scène à une idée de surface. Souvent une transposition d’époque n’est-elle que le critère d’appréciation d’une mise en scène. Un emballage, vide d’intentions profondes est parfois plus séduisant qu’une direction rigoureuse… Toutes les oeuvres n’y résistent pourtant pas, comme elles ne résistent pas au même traitement. Parfois c’est très extraordinaire, si la réflexion sur l’oeuvre est intelligente et que la direction d’acteur suit.
Je ne suis pas un adepte de la reconstitution historique parfaite, une idée poétique d’une époque me séduit davantage que son copier-coller. Mais je ne cherche pas à étonner pour étonner, à faire “des coups” comme on dit ! Je cherche ailleurs, là ou cela me semble juste et opportun sur le moment quitte à me casser la figure et à me compliquer la vie. Je veux pouvoir assumer mes choix parce qu’ils correspondent à une sincérité, même si rétrospectivement je peux me dire que je me suis trompé. Se tromper avec sincérité est toujours moins dangereux pour soi. Il faut du temps, je crois, pour imposer un style lorsque l’on n’est pas un génie. Et cela, je ne le suis pas, je suis un travailleur acharné et enthousiaste. J’ai des obsessions, oui, j’aime la précision et la vérité. J’ai aussi un certain rapport à l’espace, il y a des distances qui à mes yeux tuent les rapports. J’aime que les interprètes soient heureux. Tout cela est assez difficile à conjuguer mais je ne m’en sors pas si mal pour l’instant et chaque expérience me fait abandonner certaines choses et me conforte dans d’autres.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 9, 2020 6:27 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - Publié le 09/06/20
Affaires Polanski et Matzneff, polémiques sur l’appropriation culturelle, crise des Gilets jaunes, Covid-19… Depuis quelque temps, l’image de l’artiste tout-puissant est écornée. Doit-il plus s’engager ou rester en retrait pour retrouver prestige et crédibilité ? Le Covid-19 sonnera-t-il le glas de l’artiste ? Abasourdi par le confinement qui l’a assigné à demeure, privé de son public et expédié dans la précarité, il est devenu une espèce menacée. De tous côtés surgissent des récusations de son statut et de sa toute-puissance. Les créateurs ne sont pas à la fête. Procès en appropriation culturelle : en 2019, le metteur en scène Philippe Brunet est accusé de racisme par des associations d’étudiants de la Sorbonne pour avoir grimé de noir le corps et le visage des interprètes blanches des Danaïdes dans Les Suppliantes d’Eschyle. Appels à ne plus séparer l’homme de l’artiste dans les affaires Roman Polanski et Gabriel Matzneff : les créateurs sont désormais sommés de rendre des comptes. Leurs œuvres sont jugées à l’aune de critères qui n’ont rien d’esthétiques. Elles sont révoquées au nom de la morale ou dénoncées comme illégitimes. Fabienne Brugère, philosophe de l’art spécialisée en esthétique, prend acte : « Au tournant des années 2010, est apparue l’idée, portée le plus souvent par des groupes activistes, que l’artiste n’est pas au-dessus des lois et des comportements moraux auxquels les femmes et les hommes ordinaires sont socialement tenus. Il est un justiciable comme un autre. Les interventions peuvent aller jusqu’à la mise en cause d’expositions. Ce fut le cas, en 2017, au Metropolitan Museum of Art de New York : une pétition a exigé le retrait de Thérèse rêvant, une toile de Balthus suspecte d’inciter à la pédophilie. » “Après la Révolution française, on voit la montée en puissance des écrivains, des poètes, des peintres, des sculpteurs et des compositeurs de musique.” Nathalie Heinich, sociologue Si le mythe du démiurge transgressif à qui tout est permis était amené à se dissoudre dans les remous du XXIe siècle, il emporterait avec lui près de deux siècles d’histoire. Le temps qu’a mis la France pour lui bâtir le socle sur lequel a été édifiée sa statue. « Après la Révolution française, rappelle la sociologue Nathalie Heinich, on voit la montée en puissance des écrivains, des poètes, des peintres, des sculpteurs et des compositeurs de musique. À partir des années 1830, ils acquièrent un prestige qu’ils n’avaient pas jusque-là. La prééminence accordée à l’élite aristocratique s’est déplacée sur celle des créateurs, pourtant sans argent ni pouvoir, mais jouissant d’un grand prestige parce que ne devant son talent qu’à elle-même et à ses propres dons. C’est donc une élite adaptée aux idéaux démocratiques, et en marge. Voilà pourquoi elle continue d’être très forte dans les imaginaires. » Ce prestige a de beaux restes mais vacille. Dans une France où l’élite – politique, intellectuelle, culturelle – suscite les colères populaires, l’immunité de l’artiste n’est plus garantie. Il n’a plus tous les droits. D’autant moins que de cette marge qui lui valait le respect, il a dérivé vers une sorte d’autarcie. On le voit ainsi rarement prendre part aux mouvements sociaux. À l’exception d’Ariane Ascaride, d’Annie Ernaux, de Vincent Lindon, d’Ariane Mnouchkine ou de Joël Pommerat, quelles sont les figures médiatiques qui prennent la plume pour défendre les travailleurs ou s’insurger contre les injustices ? La mobilisation des artistes transparaît dans leurs œuvres plus que dans des tribunes publiques. Appréciée pour ses textes engagés, la chanteuse Jeanne Cherhal essaye « de ne pas parler à tort et à travers ». Sans s’enfermer dans une tour d’ivoire : « Le rôle de l’artiste est de se positionner. Mais ma façon de le faire passe par le filtre de mes chansons. Je suis plus à l’aise en chantant un texte sur l’excision qu’en signant un éditorial dans la presse. Nous n’avons pas tous la puissance d’analyse et la pertinence de Vincent Lindon. » On compte sur les doigts des deux mains les descendants de Victor Hugo, écrivain et tribun qui haranguait l’opinion depuis l’Assemblée nationale. Au point qu’en janvier 2019, tandis que les Gilets jaunes défilaient sur les Champs-Élysées, il fallait se rendre à l’évidence : seul Thomas Ostermeier injectait leur révolte à même son spectacle, Retour à Reims. Ostermeier, un metteur en scène allemand ne cachant pas son engagement à gauche et qui est, de plus, l’héritier d’une histoire de théâtre marquée par le communisme à travers la figure du dramaturge Bertolt Brecht (1898-1956), fondateur du Berliner Ensemble. Pas sûr que dans le XXe siècle théâtral français, la lutte contre le capitalisme ait produit de tels maîtres à penser. L’artiste hexagonal, enfant du dadaïste Marcel Duchamp (1887-1968) plus que du marxiste Bertolt Brecht, a fait de l’art pour l’art son Graal. De quoi s’éloigner de ses contemporains pour se vouer à une pratique narcissique. Jusqu’à frôler le point de rupture avec un monde qui a appris peu à peu à se passer de lui. Pour se reconnecter aux gens, revenir au centre d’une société qu’il n’éclaire plus de ses lumières, doit-il se convertir à un art engagé ou social ? Jouer les missionnaires militants ? Pour Stéphane Brizé, cinéaste attentif aux dérives du libéralisme, comme le prouvent La Loi du marché et En guerre, « l’art accomplit sa mission quand il crée des émotions. Il est ce qui exalte notre condition d’humain. Il peut le faire en témoignant, en questionnant et en dérangeant. Mais les causes dites politiques au sens premier du terme — c’est-à-dire la vie de la cité — ne sont pas ses seuls endroits de légitimité. L’intime, les rêves, les relations entre les individus, le temps qui passe : l’art peut et doit se saisir de tout ce qui est notre vie. » Le rôle des créateurs n’est sans doute pas de coller au présent pour en faire le sujet de leurs œuvres. Metteur en scène dont les adaptations de Michel Houellebecq (Les Particules élémentaires) ou de Roberto Bolaño (2666) ont marqué les esprits, Julien Gosselin ne se considère pas comme un passeur de messages : « J’essaye de me poser des questions qui sont des questions de vérité avec ce que je ressens intimement. Mon métier n’est pas de relayer esthétiquement ou pédagogiquement une forme de pensée contemporaine. En France, les gens ont tellement peur que le théâtre disparaisse qu’il leur faut sans cesse le défendre en montrant son côté utile. » Subventionnant ses artistes de théâtre, la France pose aussi des limites à ce magnifique système : comment conserver son intégrité lorsqu’on dépend des subsides de l’État qui, en retour, vous demande de jouer les assistantes sociales ? Pour Fabienne Brugère, « on transforme de plus en plus l’artiste en médiateur culturel. Or, dans l’art règnent une transgression et l’introduction d’un désordre dans le monde. On ne les retrouve pas dans la culture, davantage du côté d’une vision policée de l’humain. » “Si l’État de mon pays veut subventionner ses artistes, il faut qu’il le fasse, c’est important. Mais je n’ai aucun compte à lui rendre.” Julien Gosselin, metteur en scène Métamorphosé en éducateur qui doit panser les plaies des citoyens, l’artiste pactise avec la bien-pensance. Et se perd. À ce jeu, l’ingratitude n’est-elle pas un mal nécessaire ? Julien Gosselin n’hésite pas : « Si l’État de mon pays veut subventionner ses artistes, il faut qu’il le fasse, c’est important. Mais je n’ai aucun compte à lui rendre. » Une radicalité à laquelle fait écho Stéphane Brizé : « Le politique a des comptes à rendre à ses électeurs sur ses engagements pris. L’artiste ne promet rien. Il impose et il partage. » En 2015, Thomas Schlesser, critique et historien d’art, en-joignait aux créateurs de se préoccuper de l’intérêt général. Cinq ans plus tard, il dresse le bilan : « À l’époque, l’art tournait en rond dans une forme de nombrilisme esthétique. Il se préoccupait davantage de lui-même que du devenir des sociétés et de l’écoute du public, bref de problématiques relevant de l’intérêt général, par exemple, les thèmes scientifiques ou biologiques de notre temps. » Paru en 2016, L’Univers sans l’homme (éd. Hazan) appelait à un « retour du sérieux de la part des artistes ». Retour, depuis, spectaculairement opéré, au point de sidérer l’historien : « Nous sommes tombés dans l’excès inverse comme on l’a vu aux dernières biennales de Venise ou de Lyon avec une monomanie d’enjeux contemporains d’ampleur universelle et une propension presque caricaturale à ne s’occuper que de questions politiques. » Entre le néant et le trop-plein de messages, l’artiste cherche à faire entendre sa voix. Pas facile dans une société qui cultive, regrette le plasticien Pascal Convert, « une simplification, façon BFMTV, qui nous envahit, handicape notre pensée et nos capacités de création ». Sculpteur et auteur de films documentaires, il sait de quoi il parle. En 2018, son travail sur les bouddhas de Bamiyan (trois statues monumentales détruites en Afghanistan par les talibans) n’a pas été sélectionné pour la Biennale de Venise. La raison ? « Après les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan, en plein contexte d’élection présidentielle française, il était hors de question d’avoir des Afghans dans le pavillon français de la Biennale. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, a tranché en ce sens. » Comme quoi l’art, lorsqu’il met les pieds dans le plat de l’actualité, agace le politique. Ce qui prouve qu’il n’est pas moribond. “Les artistes se politisent, mais autrement”En 2006, le metteur en scène Claude Régy (1923-2019) s’exclamait : « Si les artistes ne dérangent pas, si les artistes ne font pas crier, ce n’est pas la peine qu’ils existent, ils n’ont qu’à être épiciers ! » Quatorze ans plus tard, qu’ont à nous dire ces créateurs qui ne vendent ni fruits ni légumes mais partagent avec nous des œuvres censées transfigurer le réel et stimuler nos consciences ? Qu’ont à transmettre les auteurs, les metteurs en scène de théâtre, les plasticiens, les chanteurs qui puisse, encore, nous faire hurler ? Au Festival d’Avignon qu’il dirige depuis 2013, Olivier Py note un changement de taille : « La lutte des classes n’est plus la seule grille de lecture. La société s’est élargie au monde. Aujourd’hui, les artistes s’intéressent à des sujets sociétaux comme les droits des LGBT, le nouveau féminisme, ou à la mondialisation à travers les migrants. Ils se politisent mais autrement. » Du péril écologique à la défense des minorités, tous prennent désormais le pouls d’un monde qui va mal. Et transforment des enjeux consensuels en cérémonies théâtrales où la recherche d’empathie et d’œcuménisme flirte avec l’angélisme. Auteur d’un essai magistral, Contre le théâtre politique (éd. La Fabrique), Olivier Neveux scrute le paysage avec lucidité : « On nous a raconté l’histoire du théâtre au XXe siècle comme relevant de deux grandes catégories : le théâtre d’art et le théâtre politique. Sous-entendu : le premier était dépourvu de politique. Et le second ne se posait pas de questions d’art. Manière erronée de présenter les choses que nous payons encore aujourd’hui, à l’heure où nous devrions inventer d’urgence un théâtre d’art politique. »Théâtre d’art politique : le triptyque ne veut pas dire que doivent surgir des représentations militantes. Il ouvre plutôt la porte à des projets dont la forme saura déranger. Auteur d’une chanson érotique (69) sur son dernier album, Jeanne Cherhal avoue : « Je ne me mets aucune barrière pour aborder un sujet. Dans mon cas, s’il y a transgression, elle est dans la forme, bien plus que dans le fond. » Cette forme est-elle encore à venir ? Dans le domaine des arts plastiques, les remous du monde sont tels qu’ils la figent sur place. Conséquence : rien ne s’invente. Les créateurs semblent sidérés par l’accumulation inouïe de crises. Pour le plasticien Pascal Convert, « dans une époque passionnante et tragique où les conflits se multiplient entre hommes et femmes, dominants et dominés, riches et pauvres, contexte où l’on voit surgir les Gilets jaunes, les affaires #MeToo, ou même le Covid-19, il est étrange de constater que les formes d’art contemporaines sont à l’arrêt et quasi aplaties. Si les thématiques changent, la forme, elle, change peu. » Voués à coller à un réel qui les prend constamment de vitesse, les artistes passent plus que jamais par l’intime pour tenter de dire l’universel. « La fibre chanson sociale, poing levé, lutte des classes n’est plus d’actualité. » Jeanne Cherhal, chanteuse féministe pourtant « biberonnée » au répertoire libertaire de François Béranger, préfère « revendiquer dans ses textes une liberté dans sa façon d’être au monde plutôt qu’aborder de front des sujets politiques ». Si ses prises de position féministes sont connues, elle refuse tout prosélytisme : « Quand je commence une chanson, je n’ai pas de sujet, c’est la matière des mots qui m’apporte le sens. » Une méthode à laquelle elle ne déroge pas. Sauf quand des événements la mettent hors d’elle. Alors elle prend la plume et livre des textes « épidermiques ». Sa façon de crier, pour éviter de pleurer. Joëlle Gayot / Télérama Sortir 09/06/2020 Légende photo : En 2019, alors que les Gilets jaunes défilent sur les Champs-Élysées, seul l’Allemand Thomas Ostermeier injecte leur révolte à même son spectacle, Retour à Reims.
@ Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 11, 2020 8:17 PM
|
Communiqué du ministère de la Culture, 11 juin 2020 Franck Riester, ministre de la Culture, en plein accord avec Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Denis Bouad, président du conseil départemental du Gard, et Pascale Bories, maire de Villeneuve-lez-Avignon, a donné son agrément à la nomination de Marianne Clévy au poste de directrice du Centre National des Ecritures du Spectacle de la Chartreuse du Val de Bénédiction à Villeneuve-lez-Avignon. Cette nomination a été soumise à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement, placé sous la présidence de Pierre Morel, le 11 juin 2020.
Ayant été notamment directrice du festival Terres de parole en Normandie et secrétaire générale de la Maison Antoine Vitez – centre international de la traduction théâtrale, Marianne Clévy s’est attachée, tout au long de son parcours, à accompagner les auteurs d’aujourd’hui, et à partager le plaisir des textes avec un public le plus large possible. La nomination à la tête de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Centre Culturel de Rencontre, doté d’un bâtiment patrimonial exceptionnel, lieu de résidence pour auteurs, et lieu de partage du théâtre, s’inscrit donc dans la continuité pour cette passionnée de littérature dramatique.
Marianne Clévy a proposé un projet qui s’appuie sur le très solide bilan de l’actuelle direction. Elle propose de renforcer encore le rayonnement de la Chartreuse, en la faisant connaître d’un public toujours plus large, en y accueillant des auteurs et des artistes toujours plus divers. Par un renforcement des collaborations et des partenariats (bibliothèques, comités de lecture, associations, établissements scolaires), elle souhaite favoriser l’appropriation des textes par les habitants, dans le cadre d’un travail de territoire à la fois intense et minutieux. Dans un second temps, elle souhaite poursuivre le travail mené par la précédente direction à l’international, notamment avec les pays de la francophonie, pour laquelle la Chartreuse a été définie par le ministère de la Culture comme pôle de référence.
Franck Riester tient à exprimer toute sa reconnaissance à Catherine Dan pour le travail remarquable mené depuis septembre 2013 à la tête de l’établissement. Par son engagement sans faille, par sa bienveillance, par sa très haute idée du service public et de l’exigence qu’il implique, elle a su faire du Centre national des écritures du spectacle une ressource incontournable, à la fois havre propice au travail des auteurs et tremplin au service du déploiement de leur création, dans un rapport étroit au public. C’est ce travail exemplaire qui permet aujourd’hui à la Chartreuse d’envisager une nouvelle étape de son développement.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...