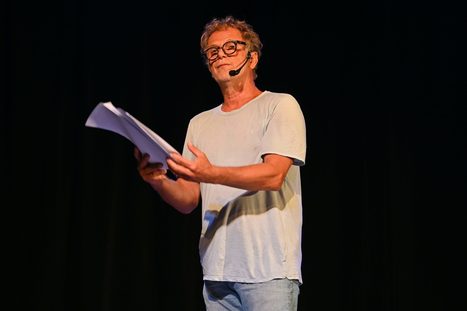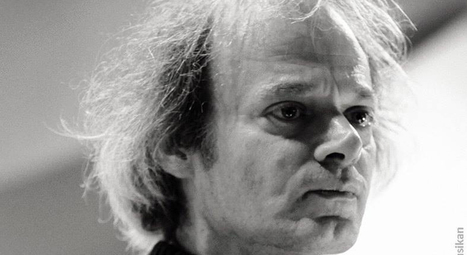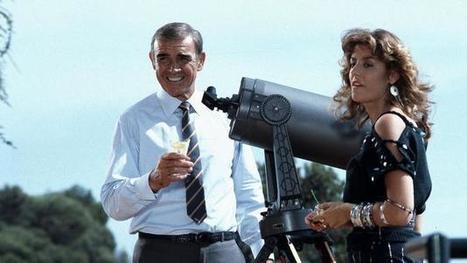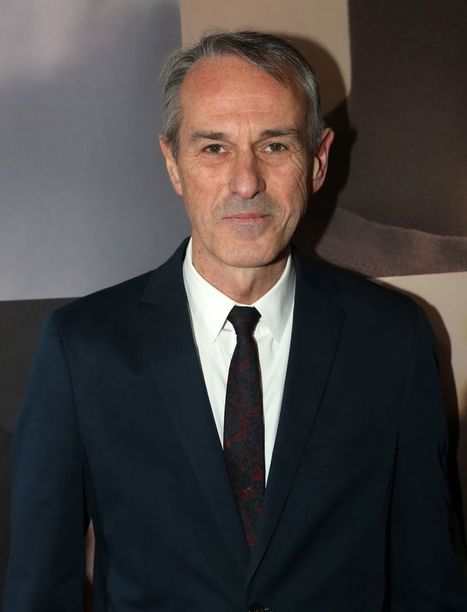Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 29, 2020 9:19 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 28 août 2020 Dans les villages du Grand Est, Michel Didym remet en selle « Comment réussir un bon petit couscous », bijou écrit et mis en scène il y a huit ans par Fellag avec et pour l’acteur Bruno Ricci. L’acteur revient nous faire savourer ce texte au nez fin.
C’était une soirée de cette fin août. Venus de Nancy, via Pont-à -Mousson, ils montèrent jusqu’à Atton, un petit village de Meurthe et Moselle qui espère, un jour lointain, atteindre les mille habitants. Là, les attendait une femme blonde et souriante, Marlène Carina, Prilleux, Madame le maire- l’enseignante qu’elle est, tient à cette appellation. A peine élue aux dernières élections municipales, Madame le maire s’était rendue à Nancy, à une poignée de kilomètres d’Atton, voir le directeur du théâtre, Michel Didym, et son administrateur, Jean Balladur, le Centre d’Art dramatique de cette ville étant le plus proche grand théâtre du petit village. Sa demande était simple et belle : elle voulait que le théâtre entre à Atton. Il y avait bien une compagnie amateure qui s’y produisait de temps en temps, mais Marlène voulait plus, du « théâtre professionnel » , a t-elle dit. Il n’y en avait jamais eu à Atton. Ses habitants en méritaient autant que ceux de la ville, question de justice culturelle.
L'homme au 147 couscous
Bingo, le CDN était en train de mettre sur pied une tournée pour l’été d’un « spectacle pouvant se déplacer aussi bien en plein air, sur les places, que dans les salles et dans les établissements scolaires, qui soit un moment de culture et d’apprentissage mais aussi de partage avec les spectateurs » écrivait Didym en parlant de Comment réussir un bon petit couscous de Fellag conçu avec et pour Bruno Ricci..
Le spectacle, créé il y a plus de huit ans, avait beaucoup tourné avant d’être remisé dans la malle aux souvenirs. Michel Didym a eu la bonne idée de lui donner une seconde vie en allumant le gaz sous ce plat préféré des français. C’est du moins ce qu’affirmait un sondage, lu dans la presse de l’époque par Fellag et c’est ce qui donna le déclic pour écrire cette pièce à l'auteur algérien, réfugié en France depuis longtemps (le régime au pouvoir à Alger rudoie artistes indépendants) et écrivant aussi en français. Le couscous, venu du Maghreb, écrasait de sa superbe avec le steak-frites à demi belge, la paella espagnole, la pizza italienne et le pot au feu « bien d’cheu nous ».
Bruno Ricci se souvient de ces jours passés en résidence à Châteauvallon avec Fellag. « Au départ c’était un spectacle fait pour être joué en appartement. Fellag écrivait le matin, je répétais l’après- midi et je jouais le soir dans des villages, cela durait vingt minutes. Je revenais vers Fellag pour lui dire les moments qui fonctionnaient bien et ceux où j’avais merdé, il rectifiais le tir le matin suivant jusqu’à ce qu’on parvienne à une forme qui dure environ une heure dix qui fonctionne aussi pour les grands plateaux. On l’a joué plus de deux cents fois. La moitié du public c’était la communauté maghrébine, venue sur le nom de Fellag. On faisait travailler les associations et avant le spectacle une petite maman venait dans la loge et me disais « après le spectacle il y a une petite surprise... » Un couscous pour tous bien sûr. Je me souviens avoir mangé 147 couscous. c’était magnifique, tout le monde ressortait avec un sourire énorme. j’ai retrouvé à travers cette tournée tout ce dont mon père et la mère italiens me parlaient. »
Ca tombe bien Marlène, pardon Madame le maire, est aussi d’origine italienne. Elle avait bien fait les choses. Dans la très grande cour de l’école primaire entourée d’arbres ( un vaste espace a rendre jalouses bien des cours de récréation), une scène sommaire a été dressée par l’équipe technique du CDN, avec vue sur la mairie et le clocher de l’église. Les employés de la mairie ont installé des sièges espacés en principe (mesures sanitaires) mais bientôt rapprochés ( rapprochent familial ou amical). Il a fallu bientôt ajouter des bancs. Et le théâtre est entré dans Atton en apportant avec lui des effluves de couscous. Seule contrariété, en raison de ce que vous savez, le « couscous citoyen » devant suivre la représentation a dû être annulé. En guise de compensation chaque spectateur est reparti avec un paquet d’épices de ras el hanout pour cuisiner un couscous maison. L’acteur n’ a pas pu « échanger » autour d’un repas comme il le fait habituellement après chaque chaque représentation.
"Mais où sont-ils?"
« Quand on va dans des lieux comme Atton en dehors des grandes améliorations, on sait que les gens n’ont guère la possibilité d’aller à 20, 30 kilomètres voir un spectacle dans un théâtre, alors on vient chez eux. Il suffit que le théâtre vienne à eux et qu’ils l’accueillent pour qu’ils ressentent tout. Je viens d’une famille d’émigrés italiens où mon père me disait : « le théâtre c’est pas fait pour nous ». Mais si, c’est fait pour nous, pour nous tous. Il se sera passé quelque chose entre nous, une émotion nous aura traversée en commun, au même moment. C’est de l’humanité, de la fraternité, de la convivialité, de la chaleur humaine, j’adore» s’enthousiasme Bruno Ricci.
« Le fait d’accepter que nous faisons désormais partie de votre environnement social et culturel, ça va vous rasséréner, vous faire du bien en nous intégrant, vous nous oublierez comme vous avez oublié les Italiens, les Espagnols, les Russes, les Chinois, les Bretons, les Normands et les Wallons...un jour viendra où en regardant autour de vous vous direz : « mais où sont-ils ? Où sont nos maghrébins ? » lance Fellag tout en racontant en détails la recette du couscous. Entre deux grains de semoule, il multiplie les digressions, les histoires, les réflexions malines. « C’est fin, diabolique, intelligent, Fellag envoie plein de messages, poursuit Ricci. On retrouve souvent cela chez ces auteurs de l’ancienne école « coloniale ». Il s ont un rapport à la langue qui est quasiment perdu. Dans son texte, j’ai des phrases qui font six lignes. Avec le sens qui vient, qui part, revient, c’est une ode à notre langue. Dire Fellag, c’est très agréable en bouche, comme un bon vin que l’on ferait rouler sur le palais pour en découvrir les saveurs. »
Il y a huit ans, une bande son accompagnait l’acteur. Aujourd’hui c’est un musicien, Taha Alami. Le spectacle y gagne en souplesse et la musique live fortifie sa belle amicalité. En bon conteur et en fin politique, tout en nous faisant saliver, Fellag raconte ce qui se trame depuis des lustres entre la France et l’Algérie. Un double régal.
La tournée de Comment réussir un bon petit couscous se poursuit ; ce soir à Châlons-en-Champagne, demain à Blénod-lès-pont-à-Mousson, le 9 septembre au CDN de Nancy et le 11 septembre à Dieulouard (54). Suite cette nouvelle saison en cours d’ élaboration.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 2, 2020 3:24 PM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 31/08/20
Prouvant une fois encore sa créativité sans borne, Lætitia Dosch porte au plateau un drôle de spectacle collaboratif, qui prend la forme d’une radio libre consacrée aux arbres.
C’était fin mai. Juste après le déconfinement. Lætitia Dosch proposait au Théâtre Vidy-Lausanne un projet monté en quelques semaines, en réponse à l’inédit du confinement que la terre entière – ou presque – vivait simultanément. Les arbres vous parlent (par Zoom) déplaçaient la scène du théâtre en extérieur pour faire entendre les arbres bordant le lac Léman. Une version virtuelle utilisant l’application Zoom que nous avons tou·tes testée le printemps dernier, donnant vie à un projet qu’elle mijotait depuis un an : faire venir des arbres sur scène pour que les humains les écoutent enfin. Quelques jours avant la première, Lætitia Dosch nous confiait comment le projet initial s’était modifié avec l’apparition du Covid : “Je parlais aux gens en téléconférence, et ils me disaient que tout d'un coup ils regardaient la nature, les arbres différemment, comme s’ils attendaient d’eux une réponse.
Peut-être parce que nous, les humains, nous nous retrouvions tous confinés, enterrés, enracinés, à échanger des nutriments par les réseaux numériques, et que le parallèle était alors plus facile à faire.” “Zoom faisait de nous des forêts d'arbres immobiles, meublant notre solitude en nous interconnectant par sa toile, comme les racines sous terre forment un réseau s’étendant sous les paysages. Tout en nous gardant en contact avec notre solitude. Comme les arbres, nous restions en terre, solitaires introspectifs dans nos appartements, liés du bout des doigts à l'autre.
L’écho avec mon projet était fort tout d'un coup.” Il prit la forme d’une révélation : “Nous n’avons jamais été aussi arbres que maintenant. Aussi réceptifs aux arbres que maintenant. Aussi en mal de réponses. Et de théâtre.” “Mettons-nous ensemble dans la peau des arbres” Durant l’été, l’expérience a encore changé de forme et de format. D’abord pour des raisons financières : le projet nécessitait la participation d’autres partenaires ; difficile à trouver au vu du contexte du spectacle vivant. Décision fut prise alors de s’associer à des radios, locales ou nationales, pour proposer une émission participative. Créée à Lille le 23 juillet avec Radio Moulins et reprise le 31 juillet dans le cadre de Paris l’été avec Radio Nova, Radio Arbres est de retour en septembre à Vidy-Lausanne avec Thierry Sartoretti de Radio suisse romande. L’écoute des podcasts est réjouissante, tant les auditeur·trices se prennent au jeu du double déplacement proposé : se mettre à la place d’un arbre, écouter ses sensations, émotions et rêves pour nous en faire part et se placer, au moment de l’émission, devant l’arbre en question. Bonus pour le public : il devient actif en participant, s’il le désire, et en envoyant un mail en amont de l’émission à radioarbres@gmail.com. La règle du jeu est simple : “Faites une expérience ! Mettez-vous dans la peau d’un arbre. Mettons-nous ensemble dans la peau des arbres le temps d’une émission radio, qui plus est, libre antenne. Radio Arbres, c’est une émission des arbres pour les arbres ! Enfin une manière de pouvoir nous parler, nous les humains, en arbres, immobiles ! Votre arbre a besoin de vider son sac sur les humains, faire une déclaration d'amour, parler de ce qu’il aime, il a des problèmes de voisinage, sexuels, est inquiet pour l'avenir ; il en a ras le bol, ou au contraire il veut parler de son environnement, du monde sous terre, ou juste chercher une oreille attentive et curieuse pour combler le vide, échanger les solitudes. Radio Arbres l'écoutera.” Ceux·celles qui écrivent un mail sont ensuite appelé·es pour préparer l’émission, mais les auditeur·trices libres peuvent aussi téléphoner en direct. Radio Arbres se déroule dans des jardins et obéit à la construction dramaturgique d’une émission de radio, animée par Lætitia Dosch et des membres de son équipe, mêlant chroniques et appels d’auditeur·trices auxquels répondent les animateur·trices-arbres. “Une chronique nutrition, une autre sur d’autres espèces de la faune et de la flore, une sur les humains, l’eau, le vent, le soleil, la rubrique voyance pour s’interroger sur l’avenir et de la musique pour les arbres." Au final, bien sûr, dans ce projet, ce qui touche le plus Lætitia Dosch, ce sont les rapports très forts qui se développent avec ces auditeur·trices qui deviennent acteur·trices et “découvrent des choses qu’ils ne savent pas qu’ils savent, exactement comme les acteurs. C’est précieux et c'est vraiment un travail qu’il faut faire en ce moment : tisser des liens pour faire avancer la pensée.” Radio Arbres un projet de Lætitia Dosch et autres arbres. Le 11 septembre, Théâtre Vidy-Lausanne

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 27, 2020 6:11 AM
|
Propos recueillis par Rosita Boisseau - Le Monde du 27 août 2020 Nouveau directeur du Centre national de danse contemporaine d’Angers, le danseur et chorégraphe explique comment il voit son rôle et envisage sa pédagogie. La rentrée au Centre national de danse contemporaine (CNDC) d’Angers, pôle de premier plan pour la formation des danseurs contemporains depuis 1978, a lieu sous la houlette d’un nouveau directeur, le chorégraphe Noé Soulier, nommé fin 2019 et en fonctions depuis le 1er juillet. A 32 ans, ce jeune artiste régulièrement programmé au Festival d’automne, succède à Robert Swinston, ex-interprète de l’Américain Merce Cunningham (1919-2009). Pour quelles raisons, jeune chorégraphe, avez-vous postulé à la direction du Centre national de danse contemporaine d’Angers ? Le CNDC est unique en son genre, en France mais aussi à l’international. Il rassemble trois missions : la création, l’enseignement dans le cadre d’une école pour former des danseurs professionnels, et la diffusion avec l’élaboration de saisons pour Le Quai [son espace culturel]. Ces trois dimensions se retrouvent dans la démarche chorégraphique que je mène depuis dix ans. Je suis en train d’élaborer un vocabulaire et une technique autour de gestes familiers ; je développe une recherche théorique avec l’écriture de livres, comme Actions, mouvements et gestes, publié en 2016 [Centre national de la danse, « Carnets »]. Enfin, l’aspect curatorial fait aussi partie de mon travail. C’est donc très enthousiasmant de créer une synergie entre ces trois missions qui seront unies par une vision commune. Quels sont les axes autour desquels vous avez élaboré le programme pédagogique de l’école ? Il s’agit pour moi de comprendre et de montrer ce qui se joue depuis quelques années dans l’approche du mouvement. Nous ne sommes plus dans l’opposition entre danse conceptuelle et écriture chorégraphique. On ne sait pas toujours, lorsqu’on commence un cursus à 20 ans, ce que l’on est ou veut devenir J’ai défini trois axes pédagogiques avec un parti pris général, celui de commencer à partir de la rupture postmoderne des années 1960-1970. Le premier axe est centré sur l’enseignement de techniques et de répertoires, comme ceux des Américains Steve Paxton ou Trisha Brown [1936-2017], avec l’ambition d’ouvrir le champ des références au-delà de la danse occidentale. Il inclura des pratiques contribuant à enrichir le rapport au corps comme le yoga ou les arts martiaux… Le deuxième axe est consacré à l’analyse concrète de la composition d’œuvres chorégraphiques, par exemple celle de la pièce la plus récente de William Forsythe, A Quiet Evening of Dance, qu’il considère comme l’une de ses plus pédagogiques, mais aussi d’œuvres musicales, littéraires ou cinématographiques. Enfin, l’aspect théorique sera exploré à partir de problématiques centrales dans la danse contemporaine, telles que le rapport de l’art au pouvoir, qui mobilisent des disciplines comme la philosophie, la sociologie… Comment votre parcours d’interprète, entre danse classique, contemporaine et philosophie, a-t-il influencé l’élaboration de ce cursus pédagogique ? Mon parcours a sans doute contribué à imaginer ce projet, car je me suis rendu compte de la diversité des manières d’aborder le mouvement. Ce qui me semble important, c’est de ne pas déterminer dès l’école l’étudiant comme interprète danseur ou chorégraphe. On ne sait pas toujours, lorsqu’on commence un cursus à 20 ans, ce que l’on est ou veut devenir. Je pense que la théorie peut être réellement émancipatrice, et c’est ce que j’espère démontrer Sans compter que, dans les créations contemporaines, depuis quelques années, les frontières entre les rôles sont de plus en plus poreuses. Des chorégraphes se retrouvent à être interprètes dans des pièces signées par d’autres artistes. Il ne s’agit pas non plus pour moi de former des danseurs qui appliquent les recettes de travail qu’on leur a apprises, mais des personnes qui progressent dans la réflexion et une forme d’artisanat de la danse. Jeune élève, j’ai aussi constaté que certains étudiants trouvaient les cours théoriques intimidants. Soit par manque de confiance en eux ou par rejet d’une sorte d’intellectualisation. Je pense que la théorie peut être réellement émancipatrice, et c’est ce que j’espère démontrer au CNDC. Quel est aujourd’hui le profil de l’interprète contemporain, dont on sait qu’il est de plus en plus techniquement outillé ? Selon une enquête menée auprès de nombreuses compagnies de danse en France par la direction générale de la création artistique du ministère de la culture, réalisée en 2018, la qualité la plus recherchée chez les danseurs et danseuses aujourd’hui est la singularité. Il ne s’agit plus uniquement de maîtriser un large éventail de techniques, mais de développer un profil unique Il y a une trentaine d’années, l’expertise technique était au premier plan. Il ne s’agit plus uniquement de maîtriser un large éventail de techniques, mais de développer un profil unique. J’ai donc décidé d’être très attentif à la spécialisation des danseurs. Si quelqu’un a envie de creuser une voie spécifique, je veillerai à ce qu’il puisse personnaliser son parcours au CNDC. En tant que chorégraphe, selon quels critères choisissez-vous les danseurs avec lesquels vous collaborez ? Le travail que je développe repose sur une virtuosité motrice liée à des mouvements familiers comme frapper, éviter… qui, sortis de leur contexte, possèdent une puissance d’évocation. Sur cette base, je développe un vocabulaire de distorsion. Je tente de renouveler l’approche du mouvement pour capturer la sophistication, la poésie et les émotions que peuvent susciter ces actions quotidiennes. J’ai besoin de danseurs qui ont un gros bagage technique et beaucoup de précision. Mais si ma démarche va évidemment nourrir chacune des missions du CNDC, il n’est pas question de calquer mon seul travail sur cet outil. Dans le contexte de la crise sanitaire, de nombreux artistes se retrouvent à performer en extérieur. Un élan déjà présent dans l’art chorégraphique qui s’affirme en ce moment. Allez-vous proposer des interventions in situ à Angers ? Nous allons faire exister la danse dans la ville d’Angers et dans la région Pays de la Loire. A l’automne, je vais présenter Passages, en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, qui est destiné à tourner dans toute la France, et pourquoi pas dans le cadre du château d’Angers. Les élèves vont, dès la rentrée, interpréter la performance Roof Piece (1971), de Trisha Brown, sur les toits de la ville. Le désir de présenter cette pièce est né pendant le confinement où j’ai eu la sensation d’un effacement des corps. Pendant cette crise sanitaire, au-delà du fait que ces opérations en plein air occasionnent la rencontre avec de nouveaux publics, confronter le corps aux éléments naturels, au vent, à la pluie, avec ces danseurs-vigies en action sur les toits va tout simplement permettre de se sentir vivant. Rosita Boisseau Passages, de Noé Soulier. Les 9 et 10 septembre à 20 heures (45 min), à La Conciergerie, Paris 1er, dans le cadre CDCN Atelier de Paris. De 10 € à 20 €. Performing Art, de Noé Soulier. Du 10 au 12 septembre, Festival Actoral, au Mucem, Marseille 2e. De 9 € à 12 €. Roof Piece, de Trisha Brown, par les étudiant.e.s du CNDC d’Angers sur les tours du château d’Angers, la terrasse du Quai et les rives de la Maine. Les 19, 20 et 26 septembre, 3 et 10 octobre à 16 heures (30 min). Gratuit.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 25, 2020 5:37 PM
|
Chronique des revues et des livres par Philippe du Vignal dans Théâtre du blog 25 août 2020 Revue Frictions n° 32
Covid ou pas covid, ce nouveau numéro est d’une aussi belle qualité picturale et textuelle que les précédents. Avec d’abord un montage que n’aurait pas renié un graphiste comme Roman Cieslewicz et où on voit Mussolini le point droit levé, avec à l’arrière-plan, une photo de manifestation où une jeune femme brandit un carton avec ces seuls mots: Black lives matter. Juste en dessous de Benito Mussolini, un Donald Trump, le visage et les mains aussi jaunes que son visage crispé. Et visiblement très en colère, brandissant son poing droit. Et sur la page de gauche, la fameuse phrase de Bertolt Brecht en 1941: “Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde.” Et illustrant l’éditorial de Jean-Pierre Han, un fragment de la non moins fameuse fresque de Michel-Ange où un Dieu barbu touche du doigt un homme nu mais qui, ici porte un masque anti coronavirus. Entre ces deux illustrations, une photo d’un troupeau de moutons en noir et blanc avec, en encadré, celle d’une tête de mouton écorchée et sanguinolente. Et sur la page de gauche, un court texte (1888) d’Octave Mirbeau, sur l’électeur “plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutonniers, qui nomme son boucher et choisit son bourgeois.” En trois fortes images, tout est dit ou presque de la situation actuelle. Dans un remarquable édito, Jean-Pierre Han dénonce entre autres l’incontournable vidéo qui a tant sévi ces dernieres temps. François Le Pilllouer, l’ancien directeur du Théâtre National de Bretagne, se méfiait terriblement , il y a déjà quelque trente ans, de celles que les compagnies lui envoyaient à l’appui d’une proposition de spectacle… Réalisées avec quelques extraits trop bien filmés et ne correspondant jamais à la réalité, ou mal filmées donc finalement nuisibles au développement du projet , dans un cas comme dans l’autre, ces vidéos ne reflétaient en rien l’exacte qualité de la proposition théâtrale. Pour Jean- Pierre Han, le “piège de la captation est un véritable révélateur de ce qui ne devrait jamais l’être, la mort saisissant le vif .” “Nous n’aurons jamais eu, ajoute le rédacteur en chef de Frictions, que des squelettes de spectacle, ce qui, au bout du compte, n’est pas très charitable par ces temps d’épidémie. Pour les autres actions, ce fut un déferlement à nul autre pareil, une débauche d’imagination plus ou moins pertinente, mais enfin l’essentiel était dans le geste, semble-t-il, histoire de s’étourdir. “ Effectivement nous avons été submergés pendant le confinement et après, de vidéos de soi-disant spectacles tournés en appartement avec un ou deux acteurs maximum ou de captations de réalisations présentées dans des jardins ou des cours intérieures dont l’entrée était gratuite. Bien entendu, rien de très intéressant là-dedans à quelques exceptions près comme ce cabaret monté par Léna Bréban devant l’E.P.H.A.D. de Chalon-sur-Saône (voir Le Théâtre du Blog). Comme si les compagnies tenaient absolument à combler le vide actuel et à montrer à leurs clients (pardon: à leur spectateurs!) qu’elles existaient bien encore et qu’il ne fallait surtout pas les oublier… Ce numéro s‘ouvre sur un clin d’œil : un texte court mais étonnant d’Heiner Müller: Guerre des virus. C’était un projet de dernière scène de Germania 3-Les spectres du Mort Homme qui n’avait pas été retenu dans l’édition en 96 à l’Arche, un an après le décès de l’auteur et représenté au Portugal dans une mise en scène de Jean Jourdheuil. Le texte avait été publié en 2001 dans la revue Théâtre public: “Dieu n’est ni homme ni femme, c’est un virus.” Suit un article de Jean Lambert-wild, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Limoges, A la guerre comme à la guerre. Il rappelle cette célèbre et très belle phrase d’Héraclite:” Les hommes dans leur sommeil travaillent fraternellement au devenir du monde” et souligne les bienfaits dune sieste d’une heure trente selon Winston Churchill. Jean Lambert-wild a une réflexion lucide sur la guerre qui, dit-il, de par sa nature destructrice, peut nous convaincre que nous pouvons, pour un temps, faire l’impasse de notre conscience en brouillant généreusement les lois de tous et les devoirs de chacun. “ Nous ne pouvons citer tous les articles de ce riche numéro mais il y a une belle réflexion sur la mise en espace/mise en scène de Thierry Besche, artiste assembleur de son, cofondateur et ancien directeur du Centre national de création musicale d’Albi. L’auteur analyse en particulier de façon très perspicace les rapports d’interdépendance entre son, lumière, image, texte et jeu des acteurs dans Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mise en scène de Julie Duclos et Sous d’autres cieux de Kevin Keiss d’après Virgile, mise en scène de Maëlle Poésy (voir Le Théâtre du Blog) . Signalons aussi un beau portfolio de photos et textes de Tristan Jeanne-Valès sur des hommes (tiens, aucune femme?) entre autres : Christophe Tarkos, Raoul Vaneignem, Marcle Hanoun, Jean-Jacques Lebel… Frictions . 27 rue Beaunier, 75014 Paris. frictions@revue-frictions.net T. : 01 45 43 48 95. Le n°: 15 €.
Les sommaires détaillés de tous les numéros parus sont consultables sur : www.revue.frictions.net -------------------------- Magie numérique Les arts trompeurs. Machines. Magie. Médias, sous la direction de Miguel Almiron, Sébastien Bazou et Guisy Pisano Comme ils le relèvent dans l’introduction de cet ouvrage touffu mais passionnant écrit par une quinzaine de spécialistes, ceux qui l’ont dirigé, accoler le terme: magie au mot numérique peut paraître étrange puisque le premier relève de l’illusion visuelle et l’autre de la technologie la plus récente. Mais pourtant l’introduction de ces nouveaux outils numériques a nettement influence à la fois le processus de création comme le résultat final. En fait, c’est l’accentuation des effets magiques et non le mode de création que l’on observe ici, la technologie, même sommaire d’autrefois (déjà au Moyen-Age, avec des jeux de lumière) puis avec les merveilleux trucages de Georges Méliès a toujours été partie lié avec l’art du magicien. Mais depuis une dizaine d’années que ce soit dans les spectacles de magie ou de théâtre pur, on a vu ces dispositifs se developer de façon radicale… Il y a maintenant un dialogue permanent entre magiciens et praticiens travaillant dans le domaine du numérique qui a bouleversé la création des effets d’illusion, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, avec des personnages ou des objets sur un plateau. On se souvient encore de l’effet-surprise que provoqua l’apparition d’un hologramme remplaçant Jean-Luc Mélenchon lors d’une tournée électorale… Dans Maîtrise de la distance, ubiquité et jeux avec le cadre, André Lange retrace le parcours qui des effets d’optique grâce à un miroir ou à une loupe. Et cela ira du tableau défini par Alberti puis aux effets de cadrage chez Vermeer à l’écran de ciné puis à celui de la télévision il y a presque un siècle, à celui de l’ordinateur et à l’image ainsi créée et lancée sur grand écran scénique… Le grand moteur originel étant bien la mise en perspective d’un lieu ou d’un bâtiment, ou comment on est passé d’un univers à deux dimensions à tout un autre espace. L’auteur dans cet article très fouillé met en valeur l’emploi du miroirs magiques capables de modifier en profondeur la notion de réalité. Il rappelle justement l’essai bien connu que Walter Benjamin, L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité, même s’il ne parle pas de la transmission des œuvres, ni de la radio ni de la télévision. Paul Valéry comme il le rappelle aussi avait-il sans doute mieux perçu l’importance de de la magie sonore puisqu’on pouvait déjà à son époque reproduire et conserver des sons. Ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité… En fait c’est toute l’abolition de la distance pour le son comme pour l’image qui va s’imposer rapidement. Avec comme autre conséquence de l’emploi des technologies numériques, la disparition de la contrainte de l’espace unique d’un écran et l’échappée belle du cadre, jusqu’aux images de synthèse diffuses par un casque. Ce qui est devenu monnaie courante en quelques années. Et souligne l’auteur, les magiciens ont vite compris tout l’intérêt qu’il pouvaient tirer des effets de réalité augmentée. Y compris en remettant au gout du jour l’effet de théâtre dans le théâtre ou de cinéma dans le le cinéma… un effet qui remonte au XVI ème siècle! Le domaine chorégraphique semblant y échapper…Refrain connu: c’est (y compris en matière artistique) dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleures soupes. Cela dit, on peut se se demander –et c’est aussi une véritable question philosophique- jusqu’où ira ce développement technologique foudroyante. Le très riche article qui suit L’Installation miroir comme mise en espace d’un entresort technologique signé Sophie Daste, de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et de Karleen Groupierre, de l’Université Savoie Montblanc aborde de façon très technique la scénographie du dispositif miroir qu’utilise bon nombre d’œuvres d’art actuelles avec des exemples très parlants d’effets d’illusion avec sonorisation spatiale. Les auteurs rappellent que le miroir, notamment en littérature: Lewis Carroll, le studio Disney, et plus récemment J.K. Rowling avec Harry Potter comme en art avec la galerie des Glaces, a toujours été un des éléments moteurs de l’illusion. Roman Lalire, magicien et créateur d’images poétiques, parle très bien de l’association vidéo associée à la technologie. Il travaille avec des compagnies de théâtre pour créer une émotion magique. Grâce notamment à un outil comme l’iPod Touch qui lui permet de manipuler une image, de la grossir ou de la rétrécir. En fait l’auteur analyse très bien le rapport à l’image que nous avons tous avec ce que cela comporte de crédibilité, même si on sait très bien que c’est faux. Comme au théâtre, nous savons que l’assassinat auquel on assiste n’est pas réel mais nous avons envie d’y croire. Il nous souvient d’une de nos étudiantes que j’avais invitée à aller voir un Néron et qui s’est évanouie quand un flot de sang a jailli du cou de Britannicus percé par le poignard de l’empereur… La magie et la vidéo donnent comme l’auteur le remarque, la possibilité de passer très vite d’une réalité à une autre par plusieurs strates sans qu’on sache bien où on en est. D’où une approche poétique quand on invente un tour de close up (magie de proximité) fondé sur la technologie. On ne peut citer tous les articles de ce vraiment très riche volume mais on retiendra celui très technique, de Chanhtthaboudtdy Somphour sur La Pensée magique des interfaces cerveau ordinateur: l’évolution de cette illusion dans l’art numérique. L’auteur consacre une vingtaine de pages sur ces interfaces crées par l’art numérique à partir d’un casque. C’est un texte qui demande une certaine attention quand on ne fait partie de la paroisse électronique mais qui a le mérite d’ouvrir un certain nombre de réflexions quand aux relations entre les ondes transmises par un cerveau humain et la création d’une musique comme chez Alvin Lucier. Ou chez David Rosenbaum . ..
L’auteur commente très clairement l’installation de Valéry Vermeulen qui propose à un spectateur de composer une performance son et image grâce à ses émotions. Là il s’agit encore de “magie” mais à base d’interactivité virtuelle. Le tableau virtuel VAnité Interactive s’engage dit l’auteur dans une démarche proche de celle des vanités au XVII ème siècle. Avec une installation à base de crânes mettant en regard la vie et la mort sous un aspect artistique.
On va sans doute encore plus loin dans cette démarche à laquelle Patrick Modiano l’écrivain des souvenirs et de la mémoire personnelle ne serait sans doute pas insensible. Fito Segrera propose de mettre en images les chutes d’attention qui symbolisent pour lui la perte d’un souvenir. Et grâce à des algorithmes, ces souvenirs sont ensuite rendus sous forme de fragments photographiques. Ce livre de 240 pages est parfois difficile d’accès et manque un peu d’illustrations mais quand même pas besoin d’être un spécialiste de la magie, il est à lire et à consulter. Et encore une fois tout à fait passionnant. Il ouvre la porte à un réflexion philosophique sur toutes les interactions possibles entre magie et art numérique, mais aussi sur la réalité virtuelle en général qui, il y a à peine une vingtaine d’années s’est vite invitée chez les créateurs d’illusion, voire dans notre quotidien. Et toutes les écoles d’art devraient mettre à la disposition de leurs élèves cet ouvrage passionnant. Philippe du Vignal Editions Septentrion Collection arts du spectacle. 25 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2020 12:23 PM
|
PAR DAVID ROFÉ-SARFATI dans Toutelaculture.com - 22 AOÛT 2020
A la Mousson d’été, Charles Berling saisi par le texte du jeune Valérian Guillaume.
Il pleuvait ce soir-là à l’abbaye des Prémontrés, mais une certaine chaleur s’est lentement diffusée pour y régner au sein du public réfugié au fond de la promenade des chanoines autour de Charles Berling pour entendre le texte adapté de son premier roman du jeune auteur Valérian Guillaume : Nul si découvert.
Il salive devant les produits alignés sur les rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d’un jeu-concours organisé par une marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent à l’entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de friandises, les buffets en libre-service et les stands de dégustation.Il sue à grosses gouttes et rit lorsque l’on se moque cruellement de lui. Habité par ce qu’il appelle son démon, affrontant cette chose étrange autant que familière il cherche compulsivement la chaleur humaine dans les allées du centre commercial. Lorsqu’il croise Leslie à l’accueil de la piscine, sa vie trouve un sens ou du moins son esprit trouve une chaude rumination. Leslie est un ange, une fée qui le rend fou d’amour. Pour la conquérir, il lui faudra lutter contre le démon qui s’empare de lui dans les pires moments. Il luttera sans y croire contre cet empêchement névrotique étrange et ses symptômes. Nul si découvert nous fait voyager au sein même du cerveau de ce personnage traversé par une pulsion qui déborde, qui le déborde. Son imaginaire s’embrase pour le brûler et par une sorte de rêve, ou pas, il rencontrera son destin, et saluera son démon dans une merveilleuse scène finale.
Le mystique psychiatre Carl Gustav Jung écrivait : ce que l’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l’extérieur comme un destin. Le roman théâtral de Valérian Guillaume construit un récit parabole en écho à la phrase de Jung. Le texte colle au plus près de l’intime du héros, dissèque, déplie puis ausculte le démon névrotique au sein même de la psyché. Les énumérations, l’importance donnée aux détails, l’impudeur et la finesse du choix des mots assure une plongée au plus profond de l’être. Surtout, la grammaire qui adhère au pulsionnel saisit le public qui retient son souffle. Le destin arrivera de l’extérieur sous forme d’une descente aux enfers en même temps qu’aux ordres du penchant secret du personnage.
Charles Berling offre sa voix, son corps et son talent ; il sera lui-même saisi par le texte en ce qu’il raconte cette pulsion qui déborde. Le comédien est rattrapé par une quinte de toux et sans quitter son personnage se précipite sur une bouteille d’eau dissimulée dans le décor. Par ce geste il nous rappelle qu’un grand acteur sait se laisser surprendre et accueillir le symptôme enfermé au sein même d’un texte. Nous rappelle aussi que La mousson d’été reste un lieu unique où ces choses-là adviennent.
Nul si découvert
Valérian Guillaume
lu par Charles Berling
mes par Michel Didym
Credit photo : Boris Didym
Fondée en 1995 par Michel Didym, son directeur artistique, La Mousson d’été constitue l’un des événements européens majeurs en matière de découverte, de formation et de promotion des nouvelles écritures théâtrales. Pendant dix jours, au coeur de la Lorraine, l’Abbaye des Prémontrés ouvre ses portes aux auteurs dramatiques, aux metteurs en scène, aux universitaires, aux comédiens et au public pour venir écouter le théâtre d’aujourd’hui. C’est autour de lectures, de mises en espace – de textes inédits ou traduits pour la première fois en français -, de conversations et de spectacles que La Mousson d’été organise ce terrain de rencontres.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 21, 2020 8:34 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 22 juillet 2020
Dans la solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès, musique et mise en scène de Roland Auzet.
Dans la solitude des champs de coton, poème en prose oratoire, entre éthique et pathétique, né de la griffe admirable de Bernard-Marie Koltés, est livré sur la scène, comme une longue apostrophe à teneur philosophique, qui engage intimement les deux partenaires en lice à travers ce beau discours ciselé. Un dialogue ouvragé à entaille existentielle qui interpelle l’autre – être bien réel -, un monologue encore adressé à soi, la condition même de tout échange verbal dont on ne voudrait qu’il s’arrête, entre provocation, incantation, prière, imprécation, invocation désespérées. Selon la grammaire classique, l’apostrophe est la production d’un être extrêmement ému qui se tourne de tous côtés, s’adressant au Ciel, à la terre, aux rochers, aux forêts, aux choses insensibles, aussi bien qu’aux sensibles.
Dans la mise en scène contemporaine de Roland Auzet, la Nature romantique et les champs de coton, métaphores de tous les décors possibles et inégalitaires de notre présence au monde, se sont transformés, de façon brute et naturaliste, en quartier urbain de fébrilité parisienne, vers 21h, « à cette heure du jour et de la nuit » – territoire indien et divers, pour la reprise exceptionnelle du spectacle à Paris, dans les arrondissements parisiens des 5 ème, 13 ème et 14 ème, sur le Parvis de l’Institut du Monde arabe, sur le Ponton Milan du Quai d’Austerlitz et sur la pelouse du Stade Didot.
Les adversaires surgissent du lointain d’une rue bruyante et commerçante d’où les voitures défilent, deux figures errantes qui viennent de trajectoires opposées, arrêtées selon les feux de la circulation, mêlées à la foule désordonnée – et les deux femmes finissent forcément par se rapprocher.
Les spectateurs qui portent un casque aux oreilles, suivent les comédiennes : ils saisissent ainsi les moindres signes sonores – gestes, intonations, exaspérations et adoucissements auxquels se livrent les deux combattantes, en même temps que l’on entend la musique composée par Roland Auzet.
Les duettistes, Anne Alvaro – le dealer – et Audrey Bonnet – le client -, s’apostrophent et s’invectivent, répondant à l’expression d’une émotion vive ou profonde, l’élan spontané de leur âme affectée sur la question traitée de la valeur marchande du désir, qu’il soit drogue, drague, arme – objet illicite – ou regard trop appuyé jeté sur l’autre : « Je ne voudrais jamais de cette familiarité que vous tâchez, en cachette, d’instaurer entre nous. Je n’ai pas voulu de votre main sur mon bras. »
Le poids de cette main fait tout le contentieux de l’affaire, une appréhension physique et symbolique, comme celle du bandit sur sa victime ; le client ne le supporte pas, souffrant de ne pas savoir de quelle blessure il est meurtri.
Dealer ou client, brute ou demoiselle, selon la terminologie de l’auteur, chacun est à la fois l’un et l’autre, ne craignant pas ce qu’il est capable d’infliger mais craignant bien ce dont il est incapable – les douleurs distribuées au hasard des rencontres aléatoires. L’instance ultime se tient sur le fil coupant d’une existence ressentie à fleur de peau :
« Alors ne refusez pas de me dire l’objet, je vous en prie, de votre fièvre, de votre regard sur moi, la raison, de me la dire. » Si l’on voulait enfin couper la boucle infernale de la parole, il reviendrait de se raconter un peu, en ne livrant pas tout, en en gardant en réserve pour soi, hors des mensonges et contre les apparences ludiques – respect, douceur, humilité, amour.
Le dealer d’Anne Alvaro fait entendre les ruptures et les déchirements dont sa voix terrestre et grave est capable, sous les reflets mêmes de l’apparence de l’amour, tandis qu’Audrey Bonnet se rebelle, baroque, contournant sa complice, telle une gazelle qui se cabre, se lance, disparaît puis revient à l’attaque. Un match sublime.
Véronique Hotte
Dans le cadre du « Mois d’août de la culture » à Paris
25 juillet > 1er août 2020
25 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e
26 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e
27 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e
29 juillet – Ponton Milan, Quai d’Austerlitz, Paris 13e
30 juillet – Ponton Milan, Quai d’Austerlitz, Paris 13e
31 juillet – Stade Didot, Paris 14e
1er août – Stade Didot, Paris 14e
Nouvelles représentations :
2 septembre – Parvis de la BNF, Paris 13e
3 et 4 septembre – lieu surprise
(réservations ouvertes à partir de la fin août)
Entrée libre sur réservation, nombre de casques limité. https://www.billetweb.fr/dans-la-solitude-des-champs-de-coton-roland-

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 20, 2020 6:46 AM
|
Propos recueillis par Lionel Chiuch pour le site Comedien.ch 20 août 2020
Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Cet homme-là est un puissant élixir de jouvence. Rencontre.
Au début, on s’est dit : « Tiens, si l’on titrait : Valletti, le ponte d’Avignon ! ». D’abord, ça nous faisait marrer, et puis il y a une certaine vérité à affirmer que, cet été, l’homme d’influence à Avignon s’appelait Serge Valletti. Sauf que voilà : le gaillard, soixante balais et des poussières d’étoile, n’est pas du genre à jouer les pontes ni à pontifier. Son verbe truculent n’affecte aucune pose et, quand il cingle, c’est pour mieux gourmander le pouvoir.
Il y aurait pourtant de quoi pavoiser : faute de festival, si la bonne parole s’est répandue sur la cité des papes en cette maudite année, c’est en partie grâce à lui ! Et à cette vieille fripouille d’Aristophane (- 450 – 385), poète comique et géniteur de la comédie, dont Serge Valletti a soigneusement entretenu la progéniture prosodique pour mieux la hisser sur scène. Pendant une décennie, en effet, l’auteur de Saint-Elvis s’est consacré à la réécriture de l’œuvre du dramaturge grec. Une tâche titanesque que seuls la ténacité et le soutien des Nuits de Fourvière (Lyon) ont permis de mener à bien.
En toute logique, ce travail – du moins quelques échantillons – devait trouver sa place dans « Le Souffle d’Avignon », un projet de lecture publique initié par les 5 théâtres permanents et conventionnés d’Avignon. Du souffle, oui, pour compenser celui qui a manqué à un festival réduit au silence. C’est donc un rire cathartique, tonitruant mais jamais méchant, qui a résonné sous les voûtes du cloître Benoit XII – lequel, soit dit en passant, en pinçait plus pour l’Inquisition que pour la satire des mœurs. Réunis sur scène, Philippe Caubère, Ariane Ascaride, Mourad Boulhali et quelques autres ont ainsi livré les meilleurs moments de Les Marseillais (d’après Les Cavaliers) et de Las Piaffas (d’après Les Oiseaux). En congé imposé, Olivier Py est venu saluer l’initiative des Scènes d’Avignon tandis que Roselyne Bachelot, fraîchement nommée Ministre de la Culture, s’est offert l’une de ses premières virées officielles pour goûter l’esprit aristophanesque. Toutes choses au menu de notre rencontre…
Tu es maintenant installé ici depuis quelques années. Comment as-tu perçu Avignon sans son festival ? – Premièrement, triste. Avec des moments de fulgurante beauté. Justement, ça n’arrive jamais de voir Avignon ainsi, depuis 60 – 70 ans, ça n’existe pas… Sans les affiches, sans les parades, sans le bruit, sans la nuit. Donc, de la tristesse et en même temps Avignon était très très belle… Une beauté un peu mélancolique ? – Non, parce que la mélancolie renvoie à un temps que l’on regrette. Alors que là, on assistait à quelque chose d’exceptionnel et d’inouï. Bon, c’est vrai que ce qui est extraordinaire, c’est que c’était comme tous les autres mois. Mais il y avait un manque, on sentait que tout le monde était resté sur les starting-block. Je ne comprenais même pas pourquoi c’était dans un tel état : parce que si quelqu’un était venu jouer de la musique dans un coin, il aurait fait la quête et ça aurait marché. Il y avait quand même des gens… Par rapport à cette situation, à ce silence de la scène, la voix d’Aristophane semblait la plus à même de ranimer les esprits? – Eh bien, ça c’est trouvé comme ça. Aristophane est dans un marathon de 2500 ans, donc il a tout vu. C’est puissant parce que c’est fondamental. C’est le début du théâtre, en tous cas le début du théâtre « écrit ». Nous avons ses pièces, ce sont les seules qui sont restées. A cette époque-là, tu as les trois grands tragiques : Euripide, Sophocle et Eschyle. Et tu as un seul comique qui est Aristophane. Alors, avant ça, il y avait des auteurs, mais il n’y a pas les textes. Donc c’est une sorte de borne, de limite. Et comme avec cette année on a aussi atteint des limites, on se retrouve, c’est une évidence, avec Aristophane. C’est le théâtre dans ce qu’il a de plus charnel, de plus spectaculaire – c’est un pléonasme! – : des acteurs parlent devant d’autres personnes, masquées ou pas. Qui est masqué dans cette affaire ? Avant, c’était les acteurs, pas les spectateurs… Et ils étaient combien ces spectateurs, avec les mesures sanitaires ? – Au Cloître Benoit XII, la jauge c’était au départ 100, puis 150, et on a dû finir à 200, parce que le protocole (ndlr : la venue de Roselyne Bachelot) est arrivé. Il a fallut rajouter des sièges. Mais revenons aux bases. Bon, il se trouve que j’étais là et que je viens de finir cette aventure aristophanesque*. Et il y avait Les Marseillais, la transposition des Cavaliers, et dans les mois qui ont précédé il y a eu cette espèce de pièce de théâtre absolue qu’étaient les élections. Et puis il y a quelque chose de profond avec la Méditerranée et les Papes… Disons qu’Aristophane était chez lui. Ses pièces n’ont plus été jouées depuis leur création. C’est étonnant ! Les premières représentations en France se donnent en grec jusqu’en 1500. A cette date, il y a la première édition d’Aristophane en bilingue, grec-latin, et ça reste en latin pendant 200 ans. Puis il y a une première tentative de faire comprendre l’esprit d’Aristophane au XVIIIe siècle, avec Racine et Les plaideurs. Ce n’est pas une adaptation mais il transpose la première partie des Guêpes. Le premier a tout traduire, c’est M. Artaud à la fin du XVIIIe siècle. Marivaux s’y intéresse, Goethe aussi. Le premier écrit La colonie et La nouvelle colonie à partir de L’assemblée des femmes mais ça n’a aucun succès. Et tout ça fait que ces pièces ne sont pas jouées. Ensuite, au XIXe, il y a effectivement des revues où l’on introduit quelques passages d’Aristophane, notamment un passage de Lisystrata, où des femmes se mettent nues sur scène, et ça dans le théâtre, c’est… disons que ça permet de dire : « On va voir de l’Aristophane ». Mais surtout on va voir des femmes nues. Finalement, la première en France, c’est Dullin, dans les années 30, qui monte Les oiseaux. Donc, c’est un théâtre très frais, qui n’est pas connu. Et puis c’est le comique : se moquer des puissants. Un de ses premières pièces, c’est une charge contre les diplomates, les militaires, mais aussi les antimilitaristes. Alors là, quand on me propose de faire ça, Les Marseillais s’imposent. C’est à sa place. “Cinéma et théâtre, c’est une autre économie, une autre façon de procéder. D’abord, pour le cinéma, tu n’es pas tout seul, et puis tu ne fais pas quelque chose de fini. Tu ouvres des pistes. Le film qui sort, ce n’est pas le scénario. C’est le scénario plus plus plus. Et parfois moins moins moins. Tu ne maitrises pas. Si tu compares, les deux c’est de la course à pied, mais il y a le marathon et le sprint” Comment expliques-tu que la comédie a plus de mal à s’inscrire dans l’histoire ? – Non, je ne pense pas que c’est juste. Molière, c’est comique. Et c’est plus grand que Racine et Corneille. Il y a Beaumarchais qui est aussi un grand comique. Le comique a toujours compté, mais il n’a pas besoin de glose. Les gens rient, terminé. Le plus grand, c’est Shakespeare : il alterne le comique et le tragique. C’est un grand tragique et un grand comique. Disons que le principe du comique on s’en fout, le principal c’est que les gens rient. Tandis que le tragique, tu peux dire « ah oui, j’ai pleuré, c’est très beau », mais bon, il n’y a pas la réaction tripale du rire qui fait que, si tu es comique, ça se voit. Il est possible que dans les institutions, l’éducation, ou l’apprentissage, on privilégie le tragique parce que c’est plus intellectuel. C’est la “langue”. Mais je ne crois pas que le comique soit mis de côté. Pour moi, il tient le haut du pavé depuis toujours. En même temps, tout le monde peut pleurer pour les mêmes choses, alors que tout le monde ne rie pas des mêmes choses. Il y a quelque chose de très personnel dans le rapport à l’humour… – C’est vrai qu’il y a des rires différents. Des manières de rire agréables, d’autres moins. C’est cette ambiguïté qui fait que c’est éternel. Le tragique n’est pas sujet à ça : il y a la sensiblerie, les mélodrames. Mais après, pour relier à notre conversation, je dirais que l’écriture c’est la vie. Et on est tributaire de la vie. Et il y a des moments où c’est cohérent. Faire Aristophane là, au Palais des Papes en 2020, c’est cohérent. Justement, avec la pandémie il y a la notion de mort. Celle, relative, du festival. Et toi tu parles de vie. Est-ce que lire Aristophane c’est affirmer la vie par rapport à un festival donné comme mort cette année. Je pense à Bataille et à sa formule : « L’érotisme, c’est l’affirmation de la vie jusque dans la mort ». Est-ce que l’on peut dire la même chose de la comédie ? – Je pense que c’est comme ça que les dinosaures ont disparu : ils étaient trop puissants, trop lourds. Effectivement, ils ne sont pas réactifs. Quand Olivier Py décide d’annuler en avril, il ne sait pas qu’un mois après on va autoriser Le Puy du Fou. Ça change la donne. Maintenant, sur des tréteaux, lire un texte devant des gens, il n’y a pas besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de la chair et de la voix des acteurs. Et la chair des spectateurs. Il y a besoin d’un endroit un peu plus surélevé. Il y a besoin d’un cloître fermé où le virus n’entre pas parce qu’on lui a interdit. Le théâtre se niche dans des endroits improbables, toujours. Alors, comment est né ce “Souffle d’Avignon” ? – Avignon est une ville spéciale où il y a quand même 5 théâtres permanents. Qui sont des structures dirigés par des gens qui ont fondé leur théâtre… Ces gens, ce sont André Benedetto – même si c’est son fils qui a repris les rênes -, Alain Timar, Serge Barbuscia, Gerard Vantaggioli et Gérard Gelas, qui sont là depuis 30-40 ans, qui reçoivent des spectacles et qui les créent. Évidemment, chaque année le festival crée un focus, mais c’est exceptionnel. Et c’est ce collectif qui dit : on peut lire des textes devant des spectateurs, même s’il n’y en a que cinquante. Faisons notre métier. Alors, après, c’est aussi pour payer des acteurs qui n’ont plus de travail. Parce que si on dit zéro spectateurs, les acteurs ils deviennent quoi ? Il y a donc des partenaires qui ont donné de l’argent pour payer des acteurs. Et accessoirement des auteurs. Cela témoigne aussi d’une volonté politique. C’est ce que traduit la présence de la nouvelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot ? – C’est en même temps la seule manifestation à Avignon, elle a donc une valeur symbolique : Avignon n’est pas complètement mort. Le projet s’est monté avec ou sans le directeur du festival ? – Olivier Py est à la tête d’une structure énorme. Il a un camion, il lui faut du ravitaillement, sinon il ne court pas. Alors, il y a trois mecs en tricycle qui font des trucs et… Lui aussi il peut, mais c’est une question d’organisation. Disons que les scènes d’Avignon étaient plus légères, plus « feu follet » qu’une grosse structure qui doit bouger une lourde machine pour faire quoi que ce soit. Donc, ça a été en accord avec Avignon. Et avec les Nuits de Fourvière, je tiens à le préciser: c’est un festival qui m’accompagne depuis 10 ans maintenant et qui assume les frais de la captation vidéo, ce qui fait que cette lecture est visible partout. Et ça c’est merveilleux Vivre pour écrire, écrire pour vivre “La première des choses, c’est que mon père écrivait. Je le dis souvent : il aurait été charcutier, j’aurai fait de la terrine. Depuis l’âge de 6-7 ans, j’ai vu un monsieur qui restait à la maison, qui tapait sur une machine à écrire, et qui transformait ça en argent pour que l’on puisse manger et s’amuser. Donc ça me semblait un métier idéal. Pour un enfant, voir un monsieur s’installer à sa machine le matin, écrire toute la journée, et même la nuit, et puis l’échanger contre des billets de banque… Eh bien, pour moi, je vivais avec quelqu’un qui faisait de la fausse monnaie, c’était un gangster. Donc j’avais envie de faire ça. Après, dans un premier temps, je ne veux pas écrire : je veux être sur scène. Je veux faire le pitre, faire rire, parce que je fais rire mes copains quand je passe au tableau, j’ai cette vis comica en moi. Je rate brillamment toutes mes études et je veux faire du théâtre très vite. En tous cas être sur scène. Et se dire, là aussi, tu es sur scène, les gens rigolent, ils t’applaudissent, et en plus tu peux gagner de l’argent : c’est quand même intéressant ! Donc, je veux être comédien, et puis très vite j’écris ce que cet acteur qui est sur scène et qui sera moi va dire. Donc je deviens auteur. De voir mon père ça a désacralisé le côté écriture. Et l’enjeu, c’est d’être sur scène. D’être sur le plateau, de me faire remarquer. Parce que je veux faire rire tout le monde. La famille, les voisins… Alors que je suis très timide. Quand les gens rient, c’est comme s’ils m’aimaient. Voilà, je suis dans la recherche de la joie. Et de la connerie la plus monumentale qu’il y a à faire et qui fait rire à avoir mal. Je veux qu’on rie à avoir mal. Et ça, il faut l’organiser. Alors je loue des théâtres à Marseille pour faire la soirée, et il y a des gens qui viennent, je vends des billets. On loue un théâtre, on met des affiches, Valletti va lire des poèmes de Valletti, et puis les gens vont rigoler et puis ça se sait. Et je chante, j’ai un orchestre qui s’appelle les Immondices, avec des copains… J’ai 15-17 ans, et tous les mercredis soir je passe dans un cabaret à Marseille. J’écris des chansons à la con, sur le blues, chanson western, tzigane, chaque fois on prend un thème… On a une trentaine de chansons au répertoire. C’est mon activité. Le lycée, c’est une activité secondaire… Moi, j’avais peur de m’ennuyer. Quand j’étais petit je m’ennuyais et je croyais que les gens connus ne s’ennuyaient pas. Ce qui est une grosse erreur : tu te rends compte très vite que plus tu es connu, plus tu es seul et emmerdé parce qu’il n’y a que les connards qui viennent te voir. Mais quand tu es petit tu crois qu’être connu c’est le paradis. Mais c’est l’enfer. Enfin, l’enfer, j’exagère… Tu peux pas t’assoir à une terrasse de café et regarder les gens passer. Pour en revenir à l’écriture, écrire, pour moi, c’était marquer de l’orale. Presque une partition. Et je me rendais bien compte que ce que j’écrivais était entendable mais pas lisible. C’est-à-dire qu’il fallait que ça rentre par les oreilles, pas par les yeux. Ça a été un long travail, de 69 à 88, j’ai écrit et joué ce que j’écrivais. Parallèlement, je jouais des textes d’autres auteurs, Shakespeare, Marivaux, Beaumarchais, entre autres, mais ce que j’écrivais j’étais le seul à pouvoir le jouer. Jusqu’en 88 où Chantal Morel, à Grenoble, a décidé de mettre en scène une de mes pièces. Et là, je suis devenu auteur. C’est en m’absentant de la scène que je suis devenu auteur. Et il se trouve que ça a été un grand succès, sa mise en scène était très réussie, c’était ma première pièce avec 9 personnages. Un grand moment, et de 88 à 2000, j’ai eu beaucoup de commandes. Parallèlement, j’ai continué à jouer, des solo, des contemporains, des classiques… Donc je jouais et j’écrivais. Et depuis 2000, je ne joue plus, je ne fais qu’écrire. Je me suis débrouillé pour pouvoir vivre sans être obligé de faire de l’alimentaire, ce qui est tout de même la plaie de l’écriture. J’ai le temps, voilà. Je dois faire un jour le Palais des Papes ? J’ai le temps, ça viendra à temps…Faut attendre 10 ans ? Pas de souci… Propos recueillis par Lionel Chiuch . *Toutaristophane, Serge Valletti. Ed. L’Atalante, Bibliothèque de La Chamaille Légende photo : Serge Valletti au Conservatoire de Musique de Marseille, dirigé par Raphaël Imbert, lors des répétitions du concert du Valletti Quintetto qui se tiendra le 1er juillet 2021 aux Nuits de Fourvière, à Lyon. © Richard Patatut

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 20, 2020 4:52 AM
|
Dans la série "Spectacle-culte", Philippe Noisette évoque dans Les Echos une création d'Alain Platel pour l'Opéra de Paris en 2005 - Publié le 19 août 2020 En créant « Wolf », mêlant opéra et danse dans un décor réaliste, le Belge Alain Platel fit chauffer à blanc les ors du palais Garnier, il y a quinze ans. Retour sur ce « spectacle culte », le cinquième de notre série d'août.
Alain Platel délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes.
Créé au festival allemand de la RhurTriennale en mai 2003 « Wolf » arrive à Paris deux ans plus tard. Ce 17 mars 2005 il y a de l'électricité dans l'air à Garnier. Le spectacle est déjà lesté d'une réputation certaine : il prend certains spectateurs à rebrousse-poil tandis que d'autres crient au génie. Alain Platel, orthopédagogue de formation, désormais chef de file du collectif des Ballets C. de la B., délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes.
Dans un décor de centre commercial quasi à l'abandon on brûle les drapeaux des nations, on ose les duos comme des parades amoureuses, on se retrouve dans une communauté de toutes les couleurs. Il y a un message politique, parfois cisaillé par le grotesque des situations. Platel a réuni une équipe singulière avec l'ex-danseuse de l'Opéra de Paris Raphaëlle Delaunay, Serge Aimé Coulibaly ou Franck Chartier. A la baguette de l'orchestre, Sylvain Cambreling.
C'est Gérard Mortier, gantois comme Alain Platel, qui est venu le chercher. Quatre années de patience seront nécessaires pour convaincre le chorégraphe. Une éternité. Entre-temps Mortier a pris la tête de l'Opéra de Paris. On ne sait pas ce qui irritera le plus ce soir-là quelques mélomanes : Mozart détourné ou l'intrusion dans « Wolf » du tube sirupeux de la star Céline Dion « A New Day Has Come » ! Et puis il y a cette meute de 14 chiens accentuant le danger permanent d'une pièce ancrée dans la ville.
Danseur hip-hop en étoile
Platel dira plus tard que, dans son esprit, Gérard Mortier tenait à présenter « Wolf » dans un lieu aussi chargé d'histoire que l'Opéra de Paris. Par contre, les festivaliers d'Avignon ne verront jamais cette œuvre l'été 2003, grève oblige. « Wolf » aurait eu belle allure dans la cour d'honneur du Palais des papes… Ce danseur hip-hop jouant l'étoile du ballet ou ces acteurs sourds-muets imposant la belle langue des signes resteront dans la mémoire du public parisien.
Même si cette création n'est pas sans faiblesse, elle a le mérite d'oser. Le chorégraphe belge retrouvera Mozart le temps d'un « Requiem » bouleversant. Alain Platel ne se voit pas comme un artiste « extravagant ». Mais il reconnaît : « la meute de 'Wolf' c'était quand même quelque chose ! » On ne saura jamais ce que Wolf (gang) Amadeus Mozart en eût pensé…
Wolf, Chorégraphie d'Alain Platel
A l'Opéra de Paris en 2005
Philippe Noisette Légende photo : Alain Platel délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes. (© Victor/ArtComPress via Leemage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 17, 2020 3:56 PM
|
Entretien avec Matéo Cichacki*, directeur du festival de Villerville, propos recueillis par Philippe du Vignal, publié le 13 août 2020
-Alain Desnot qui a créé et dirigé ce festival pendant six ans, a souhaité passer la main et vous a choisi pour lui succéder. Fait exceptionnel, vous êtes nommé directeur à seulement vingt-trois ans…
-C’est étrange mais, j’ai par la force des choses, toujours travaillé comme acteur avec des gens plus âgés que moi. Et sans difficulté. C’est un « petit » festival qui se déroule dans un village mais cela implique comme ailleurs des responsabilités administratives et artistiques. Je demande régulièrement conseil à Alain mais il a choisi cette année de ne pas venir pour qu’il n’y ait pas d’interférences. En raison de la crise sanitaire actuelle, ce sera une édition limitée; j’ai voulu qu’elle ait quand même lieu mais cette fois, sur un seul site: l’ancien garage.
Ce sera sur le plan de la programmation plus facile à gérer pour le jeune directeur que je suis. Et j’ai mis l’accent sur des auteurs contemporains. Restent les contraintes d’ordre sanitaire qui ne sont pas toujours simples à gérer: distanciation physique, mise en place de parcours fléchés avec flacons de gel hydro-alcoolique, billetterie et contrôle des entrées adaptés, réservation par internet avec quand même un petit quota de places à garder. Mais bon, nous n’avons pas de salle de 300 places et Un festival à Villerville c’est une petite manifestation. Le Nouveau Théâtre Populaire près d’Angers, lui, accueille 1.500 personnes par jour pendant dix jours ! Mais question jauge, ce n’est pas nous qui décidons et cela sera réglé au dernier moment. C’est cela le plus inquiétant…
Comme il a fallu en termes budgétaires resserrer les boulons, j’ai décidé de pas faire appel à un traiteur et un cuisinier préparera, avec de nombreux bénévoles, les repas pour les artistes, les techniciens et le personnel d’accueil. Et il y aura une buvette pour le public. Je voudrais que le festival ait une dimension plus ludique et attire davantage de jeunes; l’an prochain, si tout va bien, on mettra en place à leur intention un camping à bas prix.
Toujours dans un souci d’économie, nous avons pu nous faire prêter des logements pour héberger les artistes et négocier des contrats avec des gîtes ruraux. Et l’Hôtel Bellevue, qui nous consent des prix, restera notre partenaire habituel. Ce sont des problèmes d’intendance mais on sait qu’ils sont capitaux dans la bonne gestion d’un festival si l’on veut mettre toutes les chances de son côté. Merci au passage à la municipalité de ce village qui nous soutient. Comme la Région et le Département de Seine-Maritime. La D.R.A.C. ne le peut pas car je n’emploie pas assez de professionnels: ici la directrice technique est la seule rémunérée. Et moi-même, je ne pourrais pas me payer cette année. Et j’ai juste une jeune administratrice qui, elle non plus, n’est pas rémunérée mais juste défrayée.
-Autant dire que vous êtes un peu sur le fil du rasoir… Comment réussissez-vous à faire en sorte que cela puisse quand même fonctionner ?
-Je dois vous avouer que ce n’est pas facile tous les jours, notamment quand il faut cautionner le matériel qu’un grand théâtre nous prête, quand il faut organiser au mieux le transport du dit matériel depuis Paris. Ou quand on dirige toute une équipe de bénévoles… Mais bon, à une quinzaine de jours de la première, tout est dans l’axe et j’ai heureusement avec moi des bénévoles qui sont très motivés…
-Et pour en revenir au programme de cette septième édition hors-normes?
-J’ai essayé dans la mesure du possible de diversifier les choses. Avec des acteurs et metteurs en scène reconnus qui sont déjà venus les années passées à Villerville: ainsi Sylvie Orcier et Patrick Pineau, créeront Black March, une pièce inédite de Claire Barrabès.Théo Askolovitch avec son équipe, met en scène la pièce bien connue de Fausto Paravidino, La Maladie de la famille M. Et Tigran Mekhitarian réalisera un Dom Juan de Molière modernisé. Sacha Ribeiro, avec sa compagnie Courir à la Catastrophe mettra en scène Œuvrer son cri une pièce qu’il a conçue. Et je mettrai en scène Le Monte-Plats d’Harold Pinter. il y aura aussi des lectures de textes contemporains, une performance et deux concerts les vendredi et samedi. Et l’an prochain, je souhaiterais qu’il y ait une majorité de spectacles créés in situ. C’est une des marques de fabrique de ce festival….
Philippe du Vignal
Le festival de Villerville aura lieu du 24 au 26 août.
Réservations à partir du 18 août : par mail (à privilégier) et au 06 71 62 21 57. Et sur place au Garage, 10 rue du Général Leclerc, du 24 au 26 août de 14 h à 19 h et du 27 au 30 août de 10 h à 22 h. * Le nom a été corrigé, par rapport à l'article original

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 17, 2020 4:12 AM
|
PAR AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM dans Toutelaculture.com 14 AOÛT 2020 Sylvain Maurice : « Je ne suis pas inquiet sur le principe du spectacle vivant, je suis inquiet pour l’économie du spectacle vivant »
|
Cet automne, Sylvain Maurice retrouve Vincent Dissez pour Un jour je reviendrai, un montage pertinent de deux textes de Jean-Luc Lagarce. L’occasion de se rencontrer pour parler du confinement, des conséquences du Covid sur le Théâtre de Sartrouville, et bien sûr, de l’avenir. Alors, comment s’est passé le confinement ? A titre personnel, plutôt pas mal, et le théâtre a toujours continué de fonctionner, on ne s’est jamais arrêté. C’est-à-dire, comment avez-vous fonctionné pendant le confinement ? Il y a plusieurs niveaux. Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines est un lieu de création. Il y avait plusieurs problématiques. Il fallait continuer à être en relation avec les artistes, témoigner que malgré tout, l’avenir pourrait s’écrire. Vous avez annulé les spectacles ? Nous avons dû annuler beaucoup de spectacles de la programmation. Notamment Penthésilée qui en était au début de sa vie. L’urgence était de ne pas briser la relation avec le public. Notre territoire comporte des publics très divers dans leurs origines sociologiques et culturelles. Les relations publiques ont vraiment bien travaillé ; nous avons réfléchi avec elles à transformer les dispositifs en présentiel en dispositifs numériques, en « zoomentiel » en quelque sorte ! Et clairement nous avons perdu assez peu de public. Avez-vous des exemples de ces pratiques numériques ? Oui, par exemple les élevés des options théâtre des lycées pouvaient se donner la réplique à distance. Nous n’avons jamais fermé boutique, et même certains ont plus travaillé que d’habitude. Les outils nous ont permis de réaliser des séances plénières où tout le monde était là, ce qui devient une transposition de ce qui était normalement de l’acting, du jeu. Il pouvait y avoir aussi des scènes que l’on jouait en numérique ; alors là c’est autre chose, c’est moins sur le groupe que sur des petits comités, des petites conférences Zoom. Et puis il pouvait y avoir aussi un travail de réalisation. Par exemple faire un solo, le filmer et l’envoyer au pédagogue ou à l’artiste qui dirige l’atelier. Les formats sont finalement assez variés. Mais, il ne faut pas se leurrer, cela ne peut être qu’un moment et qui ne remplacera jamais le vivant. Cela nous a juste permis de garder le lien, de ne pas fermer. Et vous avez pour le coup vraiment « ré-ouvert » le 16 juin, je crois ? Oui, depuis de 16 juin nous avons mis notre nouvelle saison en ligne, nous avons fait pas mal de petits films où je commente toute la saison. Et il y a une bonne réponse du public pour l’instant. Je pensais que vous aviez reçu du public depuis le 16 juin. Nous avons effectivement reçu du public, mais pas sur des spectacles. En revanche, nous allons faire des ateliers dès la mi-août. Avant cela, nous avons reçu les publics pour les conseiller pour les abonnements par exemple. Donc la réouverture de la saison, ce sera avec votre mise en scène de Un jour, je reviendrai, avec Vincent Dissez, qui était immense dans Réparer les vivants. Ce n’est donc pas votre première collaboration avec cet excellent comédien, mais qu’en est-il de Lagarce ? En fait j’ai déjà monté L’Apprentissage il y a une petite dizaine d’années quand j’étais à Besançon à l’école dramatique. C’était Alain Macé qui était un acteur qui avait travaillé avec Jean-Luc Lagarce qui m’avait proposé de le mettre en scène. Depuis Réparer les vivants, Vincent et moi nous voyons régulièrement, on lit des textes. J’avais l’intime conviction qu’il fallait réunir ces deux textes incroyables de Jean-luc Lagarce qui sont L’Apprentissage et Le voyage à La Haye. Et de les concevoir non pas comme un diptyque mais vraiment comme un spectacle qui aurait sa propre unité. Ce sont deux textes que Vincent Dissez connaissait ? Oui, il avait joué dans Le Pays lointain à l’Odéon, mis en scène par Clément Hervieu-Léger. Et il jouait le personnage de A qui est aussi dans L’Apprentissage et qui est plutôt l’assistant, le confident, l’homme de l’ombre qui n’est pas son amant, qui est un personnage avec qui il a des relations plutôt… Je ne vais pas dire d’amitié. Loïc Corbery jouait Lagarce, donc oui c’est une œuvre qu’il connaît bien. Mais là, c’est la première fois qu’il va s’emparer de ces deux textes qui sont à la fois très reliés et très différents. L’Apprentissage est, au départ, une commande d’écriture de Roland Fichet, qui à l’époque officiait à Saint-Brieuc. Il avait passé une commande à toute une génération d’auteurs dont Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana et Lagarce donc, avec la consigne : un récit de naissance. Lagarce parle d’une personne qui sort du coma, qui renaît à la vie et qui apprend à marcher, enfin d’abord à voir, à parler, à marcher, et donc c’est à la fois comme un jeune enfant, voire même un nourrisson, puis quelqu’un qui ferait ses premiers pas, puis ça s’arrête là, à la sortie de l’hôpital. Et le second ? Le deuxième texte s’appelle Le voyage à La Haye. C’est un récit plus factuel. Le premier est écrit un peu avec cette métaphore de la renaissance. A l’occasion d’une tournée à La Haye d’une de ses pièces, Lagarce en profite pour aller à Amsterdam revisiter les lieux de sa grande passion pour G. Mais il est rattrapé par la maladie puisque quand il revient à Paris, il est en train de perdre la vue. D’ailleurs, il en parle dans son journal. Il sait qu’il ne peut plus faire les mêmes choses du fait du Sida, il décide d’écrire des textes autobiographiques. C’est un projet qui est très conscient chez lui. Le voyage à La Haye a été créé par Hervé Pierre, dans une mise en scène de François Berreur, il y a une vingtaine d’années ; d’ailleurs Hervé était magnifique, mais à ma connaissance il n’y a pas eu de nouvelle mise en scène. Ce sont deux textes bouleversants. Et est-ce que cette idée, monter une pièce qui parle d’un coma, est née pendant le confinement? Non, mais ça va raisonner avec le confinement. En fait c’est un projet qu’on a depuis un an. Est-ce un seul en scène ? Oui c’est un seul en scène, il est tout seul, sans musicien. Vous connaissez déjà vos axes de direction ? Oui, on a déjà répété deux semaines. (NDLR : nous sommes alors le 22 juillet 2020). La première est le premier octobre, ça va arriver rapidement. Disons que le travail est très différent que celui sur Réparer les Vivants. L’écriture de Maylis de Kerangal est épique, elle englobe comme ça toute l’humanité, elle est une sorte d’odyssée du cœur, voilà un langage d’une communauté d’êtres humains autour de cette greffe. Là on parle vraiment de l’intime. Vous l’avez pensé quasiment comme une lecture ? Non, il y vraiment un dispositif scénique. Notre travail c’est de trouver la parole la plus simple. Celle qui permet de faire entendre toutes les contradictions du personnage. À la fois, il a envie d’être avec les autres parce que la troupe, le théâtre lui sont chers, même le maintiennent vivant, et puis en même temps, il a envie d’être seul dans une position presque de repli. Cela fait écho avec la dissociation entre le metteur en scène qui a toujours envie d’être avec les autres, qui est un homme ou une femme du collectif, et l’auteur qui est quelqu’un qui est plutôt confronté à la page blanche. Et c’est vraiment cette contradiction là, qui explique le titre : Un jour, je reviendrai qui est le projet qu’énonce Lagarce dans son premier texte et qui est une sorte de fantasme, en tout cas une vision. C’est une phrase qu’il prononce ? C’est une phrase qu’il écrit, ce n’est pas moi qui l’ai inventée, on en a même discuté avec François Berreur, qui gère les droits de Lagarce, et ce titre correspond tout à fait à un moment. Je cite de mémoire : il indique qu’il se prend à rêver qu’un jour il reviendra, plus élégant, et qu’il marchera dans la rue. Comme une espèce de projet, et c’est pas faux puisque c’est Vincent qui l’incarne. Vincent dit souvent – et ça me touche beaucoup – qu’il est un peu le fantôme de Lagarce, comme sa réincarnation au théâtre, qu’il est visité par le fantôme de Lagarce, et je pense qu’il y a vraiment cette idée là, qu’il est un peu revisité par Lagarce. La première partie de votre programmation n’a pas été modifiée. Et bien si, j’ai dû modifier beaucoup. J’ai fait une programmation avec moins de « gros » spectacles. Mais vous avez pensé une saison en deux temps. Alors c’est un peu empirique ; on est un peu comme tout le monde, on essaie d’organiser nos pensées en fonction de l’épidémie. Vous imaginez une première partie avec les mesures barrières puis une seconde avec un retour à la vraie normale. C’est le souhait que je formule, j’espère qu’à partir de janvier on puisse retrouver la « vraie normale ». Mais peut-être que les données me donneront tort. De toute façon, on pourra jouer avec de la distanciation physique et des petites jauges aussi en deuxième partie de saison. Comment ça se passe pour la première partie ? C’est simple : une personne sur trois dans la salle avec les masques. Nous allons accueillir les gens avec toutes les mesures sanitaires. Est-ce que cela fait tomber la jauge ? Nous avons multiplié les levers de rideau, la jauge reste identique si on la pense dans sa globalité. Par soir, c’est en revanche un tiers de la capacité. Mais là où on aurait joué une fois, ou deux fois, on multiplie par deux ou par trois, donc il y a un coût supplémentaire. Bien sûr économiquement ce n’est pas viable sur le long terme. Le théâtre de Sartrouville est un lieu public, un CDN, cela vous permet cette pratique. Oui tout à fait, on peut le faire pendant un certain temps. C’est-à-dire que les budgets 2020, du fait du chômage partiel, vont être équilibrés. En revanche, à partir de 2021 si cela continue, nous allons sombrer. Les scènes subventionnées sont dans une logique économique que le chômage partiel a rendu possible. Sans cela nous serions dans une situation plus que critique. Cela ne pourra pas continuer indéfiniment. Et donc comment avez-vous pensé la saison à l’année ? Vous avez des spectacles jusqu’en juin, par exemple l’Épopée de Johanny Bert. Le CDN est un partenaire constant de Johanny Bert. Nous avions coproduit Elle pas princesse, Lui pas héros qui a été repris au 14, et nous sommes coproducteur de l’Epopée. Concernant la saison, on ne pourra pas programmer plus qu’annoncé. Les budgets sont insuffisants. J’ai davantage privilégié les spectacles avec moins de monde sur scène pour pouvoir jouer plus longtemps. Les grandes formes sont repoussées dans le meilleur des cas. C’est la grande question, si cette crise dure, il faut tout repenser. Il y aura toujours du spectacle vivant, on jouera en plein air, on trouvera des solutions. Je ne suis pas inquiet sur le principe du spectacle vivant, je suis inquiet pour l’économie du spectacle vivant. Visuel : © CDN de Satrouville

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 16, 2020 6:45 PM
|
Propos recueillis parJean-Rémi BARLAND pour le site DestiMed - 11 août 2020
Un homme jouant de la flûte, assis en tailleur au milieu d’une avenue, filmé de dos. Plus loin un autre court à perdre haleine. Des images d’une beauté à couper le souffle. C’est « Cattle » (en français « Bétail ») un court métrage puissant, fort et inquiétant, dérangeant, et magnifique, réalisé en 2019 par Dumas Haddad, un cinéaste anglais qui développe ici une sorte de métaphore quant à notre condition d’êtres humains asservis et pas décideurs de leurs choix.
Celui qui s’enfuit c’est Eliott Lerner, acteur surdoué et au pouvoir d’expression quasi magnétique. « Quand j’ai été contacté par l’assistant de Dumas, je ne savais pas trop ce que j’allais jouer, explique-t-il, je suis parti à l’aventure sans connaître véritablement le thème de ce court-métrage très expérimental car on ne m’avait pas donné le synopsis, et c’est par le retour images que j’ai saisi la force de ce film ». Né le 1er juillet 1990 à Paris, rien ne prédestinait pourtant Eliott Lerner à devenir acteur. Ayant appris le piano dès l’âge de cinq ans au Conservatoire classique de Paris, il découvre le jazz à quinze ans, auprès de pianistes tels que Yaron Herman, et Franck Avitabile. A quinze ans un professeur de français Eric Blaisse lui conseille de faire du théâtre. Mais il n’en fait rien ! Pourtant, trois ans plus tard, le bac en poche, il intègre la formation professionnelle des Cours Simon. « Je me suis dit tant que ça me plaît, je continue ! Il entre ensuite au Conservatoire du 5e arrondissement de Paris, de 2011 à 2014 avec Bruno Wacrenier puis Stéphanie Farison puis la Classe Libre du Cours Florent, où il travaille avec Jean-Pierre Garnier, sur « Les frères Karamazov » pendant cinq mois. « Il se plaçait entre pédagogue et metteur en scène, précise Eliott Lerner, pas en tant que prof regardant un élève. J’ai beaucoup appris avec lui ». Création de la Compagnie Charles Filant Mais l’envie de partage fut si forte que l’acteur créa une compagnie appelée Charles Filant qui développait le concept de jouer dans des lieux publics, dans des cours d’immeuble, à la gare Montparnasse, multipliant les scènes dans des endroits inhabituels. « La Compagnie m’a appris à travailler en groupe, à monter des projets ensemble, en développant l’idée d’autonomie », confie-t-il. Sur un fil… l’idée de vertige Un jour qu’il répétait « Œdipe » de Sénèque avec sa compagnie, il s’est vu marcher sur un fil. « Si je tombe je meurs », se rappelle-t-il. « C’est à cet instant que je me suis dit que je voulais faire du théâtre, marcher sur ce fil, me mettre en jeu, me mettre en risque, me risquer. » Il aurait d’ailleurs pu reprendre à son compte la magnifique chanson d’Anne Sylvestre « Sur un fil » qu’il n’a jamais écoutée. « Je suis le funambule et j’aborde mon fil. (…) Mais je marche, pourtant, je marche lentement. Je ne veux pas penser qu’on me ferait tomber. Pour rien, pour voir, sans méchanceté. Ce n’est pas méchant de souffler, de s’amuser à balancer le fil de ma vie. Le fil de ma vie. » Le fil, frontière entre le monde réel et le monde de tous les possibles On ne saurait mieux dire en parlant d’Eliott Lerner qu’il est un comédien funambule, un acteur exceptionnel de densité, dont le travail passe d’abord par le corps et ensuite par un esprit en éveil qui entre en communion avec le corps. D’une force qui s’impose jusque dans ses silences, inoubliable par sa seule présence, dont chaque apparition est un choc pour celui qui la reçoit, précis dans ses gestes, et dans son positionnement sur scène ou face à la caméra, Eliott Lerner tient beaucoup à cette notion de fil pour un comédien. « Le fil symbolise à mes yeux, un endroit sur lequel je marche et la frontière entre deux mondes : le monde réel et le monde d’à côté ; le monde de tous les possibles ». Et par son parcours d’illustrer sa pensée avec une constance rare. « Iliade » d’Alessandro Baricco mis en scène par Luca Giacomoni créé avec des prisonniers « En 2016, raconte-t-il, je reçois un coup de fil de Luca Giacomoni, un metteur en scène que je ne connais pas et qui me dit : "Je monte Iliade de Baricco en milieu carcéral, ça vous intéresse ?" Immédiatement emballé, je passe l’audition et j’ai le rôle de Ménélas qui est la cause de la guerre de Troie. Nous répétons en prison, et à l’extérieur et dix épisodes d’une heure sont joués au Théâtre Paris-Vilette, en 2017 et 2018. L’intégrale au Théâtre Monfort en 2018. Les prisonniers pouvaient sortir de prison pour jouer et ils y retournaient le soir. C’était incroyable. La mise en scène se voulait très sobre, comme en prison. Pas de décors, pas de lumières, pas de costumes. Des chaises placées en arc de cercle d’où nous racontions cette guerre, et à certains moments nous nous levions pour l’incarner, pour la jouer. Ces mêmes chaises devenaient alors des armes, des corps, des murailles, et pour finir le cheval de Troie. On racontait ici une histoire très ample avec une économie de moyens et l’accompagnement de la magnifique chanteuse iranienne Sara Hamidi. » Amoureux des mots Amoureux des mots, Eliott Lerner accorde une grande place dans son travail à leur signification, à leur force et à l’importance de trouver l’expression juste. « Lors du dixième et dernier épisode, je me suis vu confier le rôle de l’aède, la voix du poète, "la mémoire des gloires humaines". Ce rôle reste à ce jour l’un de ceux qui m’a le plus marqué. » Pas étonnant donc de découvrir que le comédien s’emploie à écrire lui-même, qu’il est un grand lecteur de Dostoïevski, (là encore des romans d’une chute annoncée), et qu’il aime travailler avec des metteurs en scène qui développent des mondes imaginaires. Ainsi Eric Bouvron, avec sa pièce « Marco Polo et l’hirondelle du Khan » dans laquelle Eliott Lerner joua en alternance le rôle titre avec Kamel Isker, un des comédiens fétiches du metteur en scène Jean-Philippe Daguerre. Fort de son succès et de son Molière obtenu en 2016 pour « Les cavaliers » d’après Kessel, Eric Bouvron engagea Eliott Lerner qui se trouva sur la même longueur d’ondes que lui. « Sa façon de mettre en scène m’a particulièrement intéressé , explique le comédien, il était dans l’accompagnement, dans la création et l’imagination d’un monde commun. Ce fut une belle rencontre. » Le fleuve de larmes d’un auteur congolais A la suite de l’Iliade Carine Piazzi contacta Eliott Lerner afin de l’embarquer dans l’aventure de sa mise en scène du texte « J’ai remonté le fleuve pour vous ! » du Congolais Ulrich N’toyo. « D’où je viens ? Congo-Brazzaville. Je te regarde en ce jour ô mon pays bien aimé et mon cœur hurle. Toi, posé sur l’équateur, tu avais tout pour devenir un Eden. Le soleil, l’eau et cette terre qui m’a vu naître… Qu’avons-nous fait de toi ? Qu’avons-nous laissé faire ? Alors que l’Eden est fleuri d’ordures, le Congolais lui boit sa bière chassant d’un geste agacé les moustiques qui le dérangent », dit en substance la pièce qui retrace une partie de la jeunesse d’Ulrich N’toyo. « Il raconte l’histoire d’un jeune qui grandit au Congo-Brazzaville avec l’amour de la langue française, avec des rêves, des espoirs qui vont être anéantis par le chaos de la guerre. Des années de colonisation, un pouvoir aujourd’hui gangrené par la dictature et les bakchichs, des arrestations arbitraires, des artistes appelés à se taire… Comment faire pour panser les blessures ? Passer à autre chose ? », précisent les notes d’intention de la production. Porté par trois comédiens à savoir, Eliott Lerner, Claudia Mongumu, Josué Ndofusu qui incarnent tous le narrateur et les différents personnages : les habitants, les mafieux, les professeurs, la mère, les amis etc, la pièce qui bénéficie de la dramaturgie tout en nuances d’Alice Carré, détaille le contexte historique, et géopolitique précis, et vient dessiner l’évolution de jeunes adultes dans ce pays instable. « Les 3000 » de Hakim Djaziri, la suite de « Désaxé » donné dans le Off d’Avignon 2019 Energie, sensibilité, émotion, présentes ici sur le plateau, sont également les maîtres-mots de ce qui nourrit le quotidien professionnel d’Eliott. Pour preuve sa participation à la pièce « Les 3000 » de Hakim Djaziri (titre en rapport à un quartier de Seine-Saint-Denis), et qui est la suite de l’exceptionnel « Désaxé » qu’il nous fut donné de voir au théâtre du Train Bleu en juillet 2019 dans le cadre du Off d’Avignon. Réflexion sur le phénomène de radicalisation et sur le djihad, le propos de l’auteur, acteur, et metteur en scène secoue les consciences. Eliott Lerner qui n’était pas sur « Désaxé » apportera, à n’en pas douter un souffle neuf à l’univers très riche d’Hakim Djiaziri. « Le théâtre est de l’ordre de l’éphémère » Toujours en mouvement, sans cesse créatif dans sa manière d’appréhender le monde de l’art Eliott Lerner défend l’idée que « le théâtre est de l’ordre de l’éphémère », et aime qu’« il reste gravé dans le corps et le coeur des gens ». Pour preuve ces deux créations de spectacles auxquelles il participera en 2021. Un monologue écrit par Mariette Navarro, intitulé « Impeccable » qui va se jouer en avril 2021 sur la scène nationale de Dunkerque dans une mise en scène de François Rancillac. « Un jeune gars qui vient d’ailleurs, et qui a quitté son chez lui car il trouvait qu’il se renfermait sur lui-même, une écriture imagée, et naïve au sens propre du terme...tout ça me parle » précise Eliott Lerner qui participera aussi à « Saint-Denis, Brazza, Lomé » d’Alice Carré -dramaturge sur « Le fleuve », auteure de « Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre » et « Et le coeur fume encore »- qui propose là une pièce sur les tirailleurs sénégalais. Avec Eric Cantona et Guillaume Gallienne De ses deux expériences télé-cinéma Eliott Lerner se souvient de sa rencontre avec Eric Cantona sur le tournage du téléfilm « Le voyageur » réalisé par Stéphanie Murat. « Eric est un être assez doux, calme, et même si je ne lui ai donné la réplique que sur une seule scène cela restera comme une belle expérience. » Quant à son rôle de Simon dans le film « Maryline » de Guillaume Gallienne il l’évoque avec enthousiasme. « J’y suis allé au culot...Je lui ai envoyé un mail pour tourner dans son film. La réponse est venue alors que je ne l’attendais plus. J’étais très heureux d’être pris et j’ai trouvé en Guillaume Gallienne un directeur d’acteurs très précis ». Une grande connaissance du théâtre avec des propos aussi intelligents que ceux de Laurent Terzieff Impressionnant de culture, Eliott Lerner, un des jeunes acteurs prometteurs de l’Agence Rush, dans laquelle Marie Brand suit son travail avec un soin particulier, possède ce don pas si fréquent chez les comédiens d’avoir une vision d’ensemble du théâtre. On a loué déjà ici la prestance, l’allant, la force presque animale de son jeu, on saluera également son intelligence esthétique qui se reflète dans des propos sur le théâtre et l’art en général dignes de ceux de Laurent Terzieff, acteur et metteur en scène qui sut mettre comme Eliott beaucoup d’oeuvre dans sa vie et de vie dans son œuvre…
Jean-Rémi BARLAND
Eliott Lerner : "se mettre en jeu, se mettre en risque, se risquer". (Photo Cha Gonzalez)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 27, 2020 6:06 AM
|
Par Gaêtane Rohr dans La Dépêche, 23 juillet 2020 Stéphanie Bulteau, 46 ans, a été nommée directrice de CIRCa, le pôle national des arts du cirque à Auch. Elle succède à Marc Fouilland.
Stéphanie Bulteau, directrice de la scène conventionnée Le Séchoir à La Réunion, prend les rennes de CIRCa, le pôle national des arts du cirque Auch Gers Occitanie. Une décision prise par le conseil d'administration de CIRCa où siègent notamment des représentants de la mairie, du Grand Auch, du conseil départemental et de la Région. Une décision validée par le ministère de la Culture. Elle a donc été nommée à l’unanimité par le conseil d’administration de CIRCa et prendra ses fonctions le 15 septembre 2020.
Stéphanie Bulteau, âgée de 46 ans, développera un projet, toujours axé sur la création circassienne, qui accordera une large place aux arts du mouvement au sens large et à l’offre jeune public.
Programmations décentralisées
Elle poursuivra la présence de CIRCa sur le territoire, au plus proche de ses habitants, à travers le développement du festival sur l’ensemble de la ville d’Auch et la mise en place de programmations décentralisées dans le Gers, qui seront accompagnées de résidences et d’actions d’éducation artistique et culturelle hors-les-murs.
Elle poursuivra le travail initié concernant la structuration de la filière professionnelle régionale, notamment en lien avec l’école nationale supérieure du Lido à Toulouse. Très attachée aux valeurs de citoyenneté et de convivialité, elle maintiendra l’ouverture de CIRCa aux pratiques artistiques amateures.
Elle prend la succession de Marc Fouilland, qui, tout au long des 18 années qu’il a passé à la tête de CIRCa, a su faire du Festival du cirque actuel un rendez-vous incontournable pour le secteur des arts du cirque à l’échelle nationale et internationale tout en structurant un projet particulièrement ambitieux, rayonnant bien au-delà du territoire qui l’a accueilli.
Gaetane Rohr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 2020 5:10 AM
|
Par Yonnel Liégeois dans chantiersdeculture.com 24-07-2020 Dans le cadre du festival « Un été solidaire », se joue jusqu’au 29/07 au Théâtre de la Ville-Les Abbesses (75) J’ai trop d’amis ! Dans la mise en scène de David Lescot, l’auteur et artiste associé du lieu. Les états d’âme d’un jeune collégien, entre humour et tendresse. Mains dans les poches et casquette vissée sur le crâne, dans la cour de récréation de son nouvel établissement il fait front ! Il n’en mène pas large, pourtant, celui qui joue au gros dur… Face à lui, le directeur du collège égrène les noms des élèves qui composeront les diverses classes de sixième : se retrouvera-t-il avec sa bande de copains du CM2 ? Las, pas de chance, il est projeté seul dans cette maudite classe de 6ème D, au milieu d’une bande d’irréductibles anonymes conduite par Clarence, le fort en gueule mais nul en thème… Un grand moment de solitude pour le jeune gamin qui va devoir gagner sa place en terre inconnue ! D’autant que les déboires s’accumulent en cette fin de journée de rentrée scolaire : sa petite sœur nouvelle élue en maternelle qui accapare l’attention de ses parents, le complot qui l’a propulsé délégué de classe sans même qu’il soit candidat. Pire encore : pas de chaussures de marque aux pieds, ni de téléphone portable en poche… Il y a vraiment de quoi en perdre ses repères, et le moral. Pendant près d’une heure de spectacle, dans un soliloque subtilement entrecoupé des babillements du plus bel effet de sa sœur et des commentaires pas très éclairés de son voisin de table, le jeune promu dans la cour des grands va capter l’attention du public, non sans humour et tendresse. Un dispositif scénique d’une extrême simplicité, mais très ingénieux avec un coffre de bois qui devient en un tour de main table d’école, chambre ou salon familial, une écriture ciselée au cordeau, au plus près du langage des enfants de ce troisième millénaire… Avec J’ai trop d’amis, sa nouvelle création à la demande d’Emmanuel Demarcy-Mota, le patron des lieux, David Lescot se la joue fort et juste ! D’abord dans sa prise au sérieux des interrogations et doutes à hauteur d’enfant, ensuite par sa maîtrise du jeu qui plonge tout son monde, petits ou grands, jeunes et leurs parents, sans mise au coin ou au piquet, dans l’imaginaire d’un temps révolu pour les uns et à venir pour les autres. Une interprétation fort ludique et inventive des interprètes, toutes féminines même dans les rôles masculins, entre rire et émotion pas une seule once d’ennui jusqu’à ce que la cloche sonne l’heure de la récré ! Yonnel Liégeois La pièce sera reprise, du 4 au 14/11 au Théâtre de la Ville, espace Cardin-Studio
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 28, 2020 7:08 AM
|
Publié par 7 Jours à Clermont le 27 août 2020
En raison de la situation sanitaire, la Ville de Clermont préfère reporter l'inauguration officielle du nouveau théâtre, lieu identitaire de La Comédie de Clermont. La programmation artistique, en revanche, est maintenue. Le premier rendez-vous est fixé au 25 septembre.
L’inauguration officielle du nouveau Théâtre de La Comédie de Clermont devait se dérouler vendredi 4 septembre. En raison du contexte sanitaire, la Ville de Clermont a décidé de repousser cet événement à une date ultérieure, non déterminée. On sait que l’idée initiale était d’organiser une manifestation conviviale et festive pour cette occasion. Il était difficile de la maintenir dans les conditions actuelles.
« Société en chantier » pour démarrer
Le report de l’inauguration ne remet toutefois pas en cause les premiers spectacles prévus dans le nouveau lieu. A commencer par Société en chantier de Stefan Kaegi et du Rimini Protokoll qui lancera la saison de La Comédie de Clermont, le 25 septembre (et jusqu’au 1er octobre). En octobre, le théâtre du boulevard François-Mitterrand accueillera Le lac des cygnes, dans une chorégraphie d’Angelin Preljocaj et recevra le spectacle théâtral de Maud Lefèvre et du Collectif X, Une femme sous influence, inspiré par le film de John Cassavetes. Le mois se terminera avec Wiesenland, l’un des chefs d’œuvre de la chorégraphe Pina Bausch, interprété par les danseurs du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 27, 2020 11:21 AM
|
Propos recueillis par Joëlle Gayot dans Télérama 26/08/2020 Loin de la Comédie-Française, le metteur en scène et comédien se régénère au théâtre de Poche, où il incarne la Mort dans “Le Laboureur de Bohême”. Quelle est la résonance du « Laboureur de Bohême », texte de Johannes von Tepl (daté de 1401) que vous mettez en scène et interprétez, avec notre monde actuel ?
La pièce est écrite après la grande peste de 1380 en Bohême, au cœur d’un monde livré aux révoltes populaires. Elle déploie un dialogue entre la Mort et un laboureur dont l’épouse vient de périr en couches. Au cours de cet échange, le laboureur, peu à peu, se redresse. À la fin, c’est un homme debout. Comme lui, nous traversons une épreuve à laquelle certains de nos proches n’ont pas survécu. Nous tentons de rester debout.
La parole de la Mort est-elle de bon sens ?
Elle est scientifique. Elle affirme que tout est mortel : plantes, arbres, humains. Le laboureur refuse de se laisser piéger par cet argumentaire. C’est là précisément, ce que chaque jour, en vivant, nous faisons. Nous connaissons des deuils, nous sommes fidèles à nos défunts. Mais nous devons vivre.
La Mort dit : « Nous ne sommes ni visible, ni saisissable […]. Nous sommes un événement qui abat tout le monde. » Difficile de ne pas penser au Covid-19 !
C’est très troublant, en effet. Mais Philippe Tesson, directeur du Poche-Montparnasse, m’avait proposé de mettre en scène ce texte bien avant la pandémie. Avec Pauline Devinat, qui signe le spectacle avec moi, nous ne voulons pas illustrer l’actualité. Nous n’avons besoin de rien d’autre que des mots de l’auteur. Le miroir tendu au public est parfait.
Vous interprétez la Mort. Est-elle un homme ?
Elle n’a pas de genre. Elle porte une longue robe, elle est voilée. Elle arborera sans doute un masque d’art primitif et deux masques du créateur suisse Werner Strub. Mais le masque de théâtre n’est pas celui de l’hygiène.
Si vous deviez être masqué pour respecter les contraintes sanitaires, le feriez-vous ?
Oui. Nous, les artistes, avons la chance d’exercer un métier qui nous plaît. Nous sommes dans des circonstances où, justement, nous avons le devoir de rester debout. Ne pas le faire serait attentatoire vis-à-vis des personnes confrontées à de plus grandes difficultés.
“J’ai eu la chance d’être renvoyé de la Comédie-Française avec brutalité” Comment vivez-vous votre passage de la Comédie-Française au Poche-Montparnasse ?
J’en suis très heureux. Ça me rappelle le Théâtre des Marronniers, à Lyon, où j’ai fait mes débuts voici cinquante-cinq ans. Comme le Poche, il était situé au fond d’une impasse.
Que permet la proximité avec le public ?
Elle régénère notre fragilité. Lorsque nous sommes à distance du spectateur, il faut porter la voix. La proximité suppose plus de délicatesse.
La Comédie-Française vous manque-t-elle ?
Absolument pas. J’ai eu la chance d’en être renvoyé avec brutalité, en 2006. J’avais alors 62 ans. Si j’étais resté jusqu’au bout de mon mandat, je serais parti à 65 ans et n’aurais pas recommencé ma vie en fondant une compagnie. Je profite de l’élan de ce coup de pied qui m’a été donné. Ma colère me garde intact. Ce renvoi est un cadeau des dieux du théâtre. Je les en remercie !
Le Laboureur de Bohême, de Johannes von Tepl | À partir du 1er sept. | Du mar. au sam., 21h ; dim., 17h | Théâtre de Poche-Montparnasse, 75, bd du Montparnasse, 6e | 01 45 44 50 21 | theatredepoche-montparnasse.com | 10-20 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 26, 2020 6:23 AM
|
Par Aureliano Tonet et Guillaume Fraissard dans Le Monde du 26 août 2020
Dans un entretien sur France Inter le 26 août, le premier ministre a annoncé le port du masque obligatoire dans les espaces culturels fermés, ainsi qu’une capacité d’accueil réduite de moitié dans les salles en zones « rouges ».
Serait-ce la première défaite de la nouvelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot, nommée le 6 juillet ? Auprès des professionnels du secteur, qu’elle a consultés depuis le 19 août, elle avait promis de se battre pour une mesure-phare, espérée par l’ensemble de la filière : permettre à toutes les petites et moyennes salles de spectacles vivants d’accueillir les spectateurs jusqu’au maximum de leur jauge, sans respecter la règle, aujourd’hui en vigueur, d’un siège inoccupé sur deux. Sur les ondes de France Inter, mercredi 26 août, le premier ministre, Jean Castex, a en partie douché cet espoir : dans les départements classés « rouges », où le virus circule activement, les salles devront se résigner à fonctionner avec une capacité d’accueil réduite de moitié. En revanche, selon nos informations, cette règle n’aura plus cours dans les zones « vertes » ; l’annonce devrait être faite jeudi lors d’une réunion au ministère de la culture, avec des représentants du spectacle vivant.
Lire aussi Jean Castex annonce deux milliards d’euros pour la culture et appelle à la « responsabilité » sur le port du masque
Par ailleurs, le port du masque, aujourd’hui facultatif, sera rendu systématique dans tous les espaces culturels fermés. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes restent interdits, sauf dérogations préfectorales – possibles uniquement dans les départements « verts ».
Conscient des attentes d’un milieu particulièrement frappé par la pandémie, Jean Castex s’est empressé de lui distribuer des signaux autrement positifs : « Le secteur culturel a beaucoup souffert de cette crise, plus que d’autres, a-t-il convenu. Vivre avec le virus, c’est se cultiver avec le virus. » Sur les 100 milliards d’euros du plan d’urgence de relance, qui devrait être présenté le 3 septembre, 2 milliards seront ainsi alloués à la culture – pour rappel, le budget de la Rue de Valois représente entre 0,5 et 1 % des dépenses de l’Etat, en « temps normal ». Cette somme s’ajoute aux 5,9 milliards déjà débloqués depuis le début de l’épidémie pour les secteurs de la culture et des médias.
« Inciter les salles à rouvrir »
Plus spécifiquement, l’Etat ne dédommagera plus les salles qui ont choisi de fermer leurs portes. En revanche, la puissance publique veillera à « compenser l’écart entre les recettes et le point d’équilibre » habituel, promet le premier ministre. Autrement dit, le manque à gagner des salles de spectacles et de cinéma, mais aussi des festivals, sera comblé. Rester à estimer cette différence.
Les professionnels du spectacle vivant assurent ne rentrer dans leurs frais qu’à partir d’un taux de remplissage de 75%
La prochaine bataille que livrera Roselyne Bachelot sera donc une guerre des chiffres : sur quelle base sera calculé le « point d’équilibre » ? Selon leurs syndicats, les professionnels du spectacle vivant assurent ne rentrer dans leurs frais qu’à partir d’un taux de remplissage de 75 %. « La relance n’a de sens que si elle est globale est massive, affirme Stéphane Hillel, directeur général du Théâtre de Paris, qui estime les besoins immédiats pour le théâtre privé à 11 millions d’euros. Si on veut que les gens reviennent dans les salles, il faut que l’offre soit riche et variée, donc il faut inciter les salles à rouvrir. » Les producteurs de festivals de musiques actuelles, où les cachets d’artistes sont souvent plus élevés, avancent de leur côté le chiffre de 95 % de remplissage. Quant aux exploitants de salles de cinéma, ils fixent leur seuil de rentabilité à 4 millions de spectateurs par semaine ; en moyenne, cet été, le box-office hebdomadaire a péniblement franchi le million d’entrées.
Concertations tendues
Interrogé mercredi matin sur France Info, Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT-Spectacle, s’est étonné de ces annonces « avant même les concertations qui auront lieu jeudi ». Il a considéré que la somme de 2 milliards d’euros était d’ores et déjà « insuffisante », rappelant que « les services du ministère de la culture avaient évalué à 3 milliards d’euros le manque à gagner des salles en billetterie ». Quant à la jauge des 5 000 personnes, le syndicaliste considère qu’elle doit être rediscutée avec des spécialistes des milieux médicaux, jugeant « absurde » que l’on impose une distanciation dans les salles alors que ce n’est plus le cas dans les transports en commun.
Les concertations des jours à venir s’annoncent tendues. Jeudi, Jean Castex et Roselyne Bachelot rencontreront plusieurs délégations du spectacle vivant ; vendredi, ils affronteront le milieu du cinéma, à Angoulême. Habituée à ferrailler contre les arbitrages budgétaires du ministère des finances, à Bercy, la Rue de Valois s’est trouvé un nouvel adversaire, de taille : le ministère de la santé, qui a fait plier Matignon sur la question ô combien sensible des jauges à 50 %. Un ministère que connaît bien Mme Bachelot, pour l’avoir coiffé de 2007 à 2010. « Nous allons tout faire pour que les Français reprennent leur vie culturelle le plus normalement possible, en se protégeant… Allez au cinéma, allez au théâtre, vous ne risquez rien ! », a enjoint Jean Castex. Le secteur culturel, lui, risque gros.
Aureliano Tonet et Guillaume Fraissard
Légende photo : Nicolas Demorand et Jean Castex, dans les studios de France Inter, le 26 août à Paris. JULIEN MUGUET POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 24, 2020 1:11 PM
|
Propos recueillis par Catherine Robert - La Terrasse n° 286 Traducteur et poète, André Markowicz anime des ateliers de traduction et de théâtre depuis quinze ans. Tenant d’une pédagogie de la joie, il parle sans langue de bois des paradoxes de son travail avec les lycéens et du sentiment de tragique qui affleure parfois. Surtout, il rappelle l’inutilité, c’est-à-dire la valeur, de l’art en partage.
Tragique
Je fais des ateliers avec des élèves depuis longtemps, à Saint-Denis depuis 2013-2014, alors que Christophe Rauck dirigeait le théâtre Gérard-Philipe ; j’ai continué avec Jean Bellorini et vais continuer avec Julie Deliquet. Je passe une semaine ou deux avec des classes et nous traduisons et lisons ce sur quoi je travaille à ce moment-là. Nous avons ainsi exploré des extraits de Dostoïevski alors que Jean Bellorini mettait en scène Les Frères Karamazov. Je leur donnais le russe mot à mot et je leur disais « traduisez ! ». Ce genre d’aventure est toujours passionnant ! Le niveau de connaissance culturelle est généralement très bas. Dès que je fais une excursion historique et que j’évoque Victor Hugo et Molière, il est fréquent que les élèves en aient entendu parler, mais plus rare que tous s’entendent sur qui précède l’autre ! On note aussi la faiblesse du niveau d’orthographe. La correction orthographique est souvent hasardeuse, un peu comme une montre arrêtée indique l’heure deux fois par jour ! Mais ne caricaturons pas : cela n’est pas vrai pour tous. Là où les élèves sont issus de milieu plus bourgeois, l’orthographe est meilleure, mais le problème demeure d’ampleur, quelle que soit la passion déployée par les professeurs. Il est très cruel de constater la violence qui s’impose et qui fait que certains gosses sont d’évidence condamnés d’avance. Gratuité Mon travail consiste à leur montrer que je ne me moque pas d’eux et que pourtant je ne leur veux rien : je ne veux pas qu’ils changent, je ne veux pas les transformer. Mais je veux qu’ils comprennent – et ils en ressentent l’évidence – que j’aime ce dont je leur parle. Je veux qu’ils comprennent qu’existe quelque chose de radicalement différent d’eux, qui leur est sans doute jusque-là étranger et qui est gratuit et beau. Lors du premier stage que j’avais mené en 2014, j’ai demandé aux élèves si cela les intéressait de lire Rimbaud. Nous avons passé deux semaines avec Mémoire en consacrant trois heures par jour à lire une strophe : c’était absolument bouleversant. Je me souviens aussi d’une autre fois et d’un poème chinois : on découvrait qu’un poète chinois du VIIIème siècle pouvait parler à chacun de nous aujourd’hui, et, en même temps, je voyais qu’ils ne savaient pas conjuguer un verbe. Là est le tragique, lorsqu’on est face à la déshérence. Mais il y a aussi cette extraordinaire découverte de l’immense énergie qu’il y a dans chaque élève et ce moment rare où ils se rendent compte qu’ils peuvent et savent faire un truc gratuit qui, dans la vie pratique, ne leur servira à rien ! Plaisir Je ne le fais pas pour eux ; je le fais pour moi, car, en tant que traducteur, il m’est impossible de traduire tout seul et sans être réinterrogé, pour chaque phrase et chaque réplique, encore et encore. Cela me paraît très important de l’expliquer aux élèves, qui le comprennent parce que c’est vrai. Je fais ça parce que ça m’amuse, sans contraintes de programme ou obligation de résultat, et certaines expériences ont été bouleversantes. Ainsi cette traduction du théâtre russe de 1900 à 1915 quasi inconnue et pourtant incroyablement riche, qui correspond au moment où Stanislavski et Meyerhold affirment leur maîtrise et créent les bases du théâtre moderne. Parmi les œuvres des dramaturges de cette période figure celle d’Alexandre Blok, dont je donnai une première version aux élèves en leur demandant, après chaque proposition de traduction, de trouver quelque chose de mieux. J’ai travaillé avec deux classes de lycéens d’Enghien-les-Bains et de Sarcelles et ceux qui étaient en première sont revenus pour le plaisir l’année suivante tellement ils étaient passionnés. Je me souviens aussi, toujours à Sarcelles, de deux heures passées, en compagnie des élèves et du prof, qui se trouvait être spécialiste de philosophie, à parler de Plotin à propos d’un texte absurdiste de Daniil Harms sur un type qui n’existe pas mais qui boit une bouteille de « spiritueux » sans contenant ! Voilà des moments inoubliables. Ainsi, d’un côté, c’est tragique et de l’autre, c’est extraordinaire ! « Je veux qu’ils comprennent qu’existe quelque chose de radicalement différent d’eux, qui leur est sans doute jusque-là étranger et qui est gratuit et beau. » Inutilité Lorsque je suis invité dans un théâtre, j’habite le lieu. Je peux y donner des conférences, des lectures, des spectacles. Les ateliers font partie de mon travail de traducteur qui ne consiste pas seulement à remplacer un livre par un autre. Pourquoi le faire ? Par devoir social ? Certainement pas ! Je suis hostile à cette conception soviétique des choses. Peut-être y a-t-il des règles morales qui commandent cet acte, mais elles sont privées : on n’en parle pas. Je le fais pour voir naître chez les élèves cette dimension d’une joie qui ne parle pas d’eux mais qu’ils peuvent avoir en eux. Beaucoup d’ateliers sont construits, en pensant mieux les attirer, autour de leur identité. Ils voient arriver des bourgeois qui leur expliquent pourquoi ils sont des prolétaires malheureux. Je me refuse à ce misérabilisme, ferment du racisme. C’est d’ailleurs pour cela que je traduis du chinois avec eux : parce que ça n’a rien à voir avec eux. Enseigner les arts et la culture, c’est justement amener les élèves à fréquenter des choses sans rapport avec la vie quotidienne et qui pourtant, permettent de mieux la supporter. Le but n’est pas de se retrouver soi et encore moins de se servir de ce que l’on découvre. C’est pourquoi la réforme actuelle du lycée qui, quoi qu’elle prétende, parie sur l’utilitaire de telle ou telle option, détruit la culture générale. Réserver par exemple l’enseignement du théâtre à ceux qui se destinent au théâtre est absurde. Cela met à mal la gratuité de la culture. Pire encore, cette réforme est une victoire de l’utilitaire prédéterminant, soit l’inverse de ce qu’offre l’art. Propos recueillis par Catherine Robert Entretien réalisé dans le cadre de la publication du Carnet n°8 de L’Anthropologie pour tous, intitulé Pour une école des arts et de la culture. A paraître en septembre 2020. oLo Collection Site : www.anthropologiepourtous.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2020 6:19 AM
|
Par Laurent Carpentier pour M le magazine du Monde
le 22 août 2020
SÉRIE« Une promenade avec… » (6/7). Chaque samedi, pendant les vacances, « Le Monde » suit les pas d’une ou d’un artiste dans un lieu qui lui est cher. Aujourd’hui, on retrouve le metteur en scène sur une ligne de train désaffectée entre Orange et Carpentras. Sur le vieux pont en charpente métallique qui enjambe la Mède, à la hauteur de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest de Carpentras, autrefois passaient les trains. Depuis 2014, on a enlevé rails et traverses, et transformé la ligne, depuis longtemps abandonnée, en « véloroute » : la Via Venaissia, ainsi baptisée en référence au comtat Venaissin qu’elle sillonne. C’est ici, à 7 h 30 du matin, histoire de profiter du reste de fraîcheur que promettait une nuit zébrée par l’orage, que le metteur en scène Cyril Teste a donné rendez-vous. Parce que c’est ici qu’il a grandi, dans un no man’s land dont il avait fait son terrain de jeux, sa « zone », pour reprendre le terme du film Stalker (1979), d’Andreï Tarkovski, avec lequel il fait la comparaison. « Le théâtre m’a permis d’apporter des réponses sur une forme d’amnésie » « Regardez ce pont : il est totalement tarkovskien... Très vite, enfant, j’ai créé ici mes premières cosmogonies, des histoires d’Indiens. J’étais plus indien que cow-boy », raconte, souriant, le metteur en scène dont la marque de fabrique est ses « performances filmiques » : des pièces de théâtre où la caméra intervient sur le plateau, créant un dialogue du champ et du hors-champ, comme si on assistait en direct au tournage d’un film. Ainsi de Nobody, de Falk Richter, de Festen, d’après le film de Thomas Vinterberg, ou encore, en 2019, d’Opening Night, avec Isabelle Adjani, d’après Cassavetes. « Jusqu’à 16 ans, j’étais le propriétaire de la voie ferrée », dit-il alors que des cyclistes très matinaux nous doublent. On l’imagine, trottant à travers les broussailles odorantes, les genêts en fleur, les mûriers sauvages et le sol tapissé de glands, enfant solitaire accompagné de son chien, Sandy. Une haute futaie, des zones maraîchères. Il a grandi là, à la ferme, sous une triparentalité matriarcale : la grand-mère, la mère, secrétaire médicale, et la tante, laborantine, toutes deux à l’Hôtel-Dieu de Carpentras. Il a 8 ans lorsque son père disparaît des radars. Son grand frère rejoindra rapidement l’armée, spécialiste en propulseurs pour les avions. Lui restera là, à parler aux arbres. « Un métier de la disparition » « Quand tu perds quelqu’un très tôt, tu as un espace vide à l’intérieur de toi. Après, c’est à toi de savoir ce que tu en fais. Au fond, c’est comme une maison. Une pièce vide. Tu peux y mettre ce que tu veux. » On aimerait comprendre, scruter avec lui la part d’ombre que les arbres projettent sur son visage. Il sourit. « J’ai fait la lumière sur ça, pour moi. Mais le temps n’est pas venu pour moi d’en parler. » On voit bien, il sait bien, que le sujet est central, dans ses promenades d’enfant comme dans son travail d’artiste. « Les histoires de famille, il faut les laisser là où elles sont. Tout n’est pas à résoudre. Mais le théâtre m’a permis de réanimer des histoires inconnues, d’apporter des réponses sur une forme d’amnésie. » On se le remémore quelques semaines plus tôt alors qu’on lui rendait visite au Montfort, à Paris, en pleine répétition de La Mouette, expliquant aux acteurs : « On se protège rarement au théâtre. On n’est pas là pour se protéger. Tous ceux qui sont là, dans la salle, sont adeptes de la vulnérabilité. Sinon on n’irait pas au théâtre. » Alors qu’on avance le long d’un champ de melons, il explique : « Je n’ai pas envie d’une Mouette savante. Ce ne sont pas les personnages mais l’auteur que je veux entendre. Anton Tchekhov revient de Sakhaline en se disant : “Comment faire du théâtre après ce que j’ai vécu ?” Forcément tu te projettes. Or, quand tu commences à projeter ta mémoire, tu trouves le présent. Metteur en scène, c’est un métier de la disparition. On ne crée pas, on révèle. » Le père. La parentalité. L’absence… La Mouette est pour Cyril Teste le troisième volet d’un triptyque après Hamlet et Festen. « Trois fois Hamlet…, précise-t-il. De même que Festen est une version contemporaine de la tragédie de Shakespeare, ce n’est pas moi qui le dis, c’est Antoine Vitez, La Mouette en est “une vaste paraphrase”. N’y entend-on pas d’ailleurs Arkadina utiliser jusqu’aux mots mêmes de la reine Gertrude : “Mon fils ! Tu m’as fait voir jusqu’au fond de mon âme, et j’y ai vu de si sanglants ulcères, de si mortels, qu’il n’est point de salut.”» Des signes apaches ou navajo L’enfant qui, dans les années 1980, se promène sur la voie désaffectée de Loriol-du-Comtat n’est pas un écolier mirifique. Il souffre de dyslexie, rate le bac. Un prof de dessin au lycée de Carpentras, peintre avignonnais, Jean-Michel Flourac, le « sauve, dit-il, d’une vie scolaire qui [l]’avait perdu ». Il découvre Jackson Pollock et le « dripping » (« Une méthode d’Indien : on peint au sol avec des bâtons »), Gerhard Richter, Joseph Beuys, Bruce Naumann… La liste est longue, et une chose essentielle lui apparaît : apprendre peut se faire dans le désordre, lire n’est pas nécessairement chronologique. « Deleuze disait : commence par le milieu. Il faut partir de ce qui nous touche. » Il réalise ses premières œuvres, est reçu aux Beaux-arts de Marseille. L’œuvre qu’il présente utilise la vidéo : une projection sur son propre corps. Son titre : Œdipe-roi. Déjà. Si tiraillé qu’il est entre art plastique et spectacle vivant (« Tchekov et Pollock travaillent semblablement, en coulures, en mélanges ») – il choisira finalement de rejoindre l’ERAC, l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes plutôt que les Beaux-Arts –, le principal reste pour lui de suivre cette voie ferrée jusqu’au lointain, jusqu’au plus obscur de ses mystères, comme dans le film de Tarkovski. De toute façon, la voie ramène ici. Chez les mères. « Dans La Mouette, le père est nulle part, c’est le rapport mère-fils qui est intéressant à fouiller. Et la question, importante pour Tchekov, d’être à la fois un père de famille – un homme qui vit –, et un metteur en scène – un homme qui crée pour le monde. » Cyril Teste a 45 ans aujourd’hui et deux jeunes fils, Milo et Marius, pour lesquels il a tatoué sur son corps, à l’emplacement où, bébés, ils posaient leurs têtes, des signes apaches ou navajo dont il garde le secret. « Avec les enfants, tu ne peux pas te dissimuler… Transmettre est fondamental pour moi, explique l’homme qui aime construire avec les étudiants des écoles où il enseigne – à Poitiers, au Fresnoy, à Montpellier où il créa sa première expérience filmique, Park… Il faut aussi savoir s’absenter pour cela. Offrir un espace vide. » Un hyperactif éclectique Il dresse l’oreille. A force de traîner dans ces bosquets, le metteur en scène qui fut comédien chez Catherine Marnas, Bernard Sobel et Olivier Py, a développé une ouïe et une mémoire visuelle particulière. « Enfant, déjà, je savais que les arbres parlaient entre eux, confie-t-il, inquiet qu’on puisse le prendre pour un allumé. Si je n’ai plus l’âge de monter dans les branches, j’ai celui de m’asseoir dans les racines. Le rhizome, c’est quelque chose qui s’agrandit en permanence. En vieillissant, j’inverse les choses. En peinture, on appelle cela la perspective inversée. » Sa compagnie, MXM (pour Monkey Ex Machina) fêtera ses 20 ans en septembre. Au total une trentaine de mises en scènes, sans compter, de façon amusante, en juillet, la présentation digitale de la dernière collection Hermès. Outre La Mouette qui doit être créée cet hiver à Annecy avant de partir en tournée, il prépare déjà un Fidelio pour l’Opéra-Comique en 2021. Derrière la caricature de la balade bucolique, se découvre un hyperactif éclectique qui refuse de séparer nature et technologie, lui dont l’enfance s’est construite entre jeux vidéo et virées champêtres. Pour le confinement, Cyril Teste s’est retrouvé coincé en Bourgogne à la maison Jacques Copeau de Pernand-Vergelesses. Il y a cultivé un potager de 200 mètres carrés : « J’ai laissé le théâtre en jachère et je me suis mis à travailler la terre. Semis, rotation… Ce sont deux métiers qui ont beaucoup en commun. » Il rêve de faire école dans cette transversalité-là, à l’instar du Black Mountain College , en Caroline du Nord – d’où sortirent, de 1933-1957, des artistes comme le peintre Cy Twombly, l’acteur Robert de Niro ou le cinéaste Arthur Penn – ou du Watermill Center de Bob Wilson. « Dans La Mouette, Tréplev, c’est celui que j’étais à 20 ans, Trigorine, celui que je suis à 40. Celui qui voulait changer le monde et celui qui l’observe. On ne construit pas une image, si avant on n’a pas construit son hors-champ », affirme-t-il. C’est peut-être ce que nous sommes en train de faire, là, alors que nous déambulons le long du bois de son grand-père. « Trouver n’est rien, le plus difficile est de s’ajouter à ce qu’on trouve », glisse-t-il en souriant, citant son homonyme, Monsieur Teste, le héros de Paul Valéry. En haut d’un pin, un grillon farceur semble se gausser de nous. Laurent Carpentier Légende photo : Cyril Teste dans l’ancienne gare désaffectée de Loriol-du-Comtat (Vaucluse), le 23 juillet. FRANCE KEYSER/MYOP POUR « LE MONDE » Article réservé à nos abonnés Lire aussiCyril Teste : « On est les petits frères de Thomas Vinterberg » Article réservé à nos abonnés Lire aussiCyril Teste, la génération manga au théâtre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 20, 2020 9:37 AM
|
Par Guillaume Tion dans Libération 20 août 2020 La ministre de Culture a annoncé la fin des règles de distanciation dans les salles de concerts et les théâtres, pour relancer le secteur dont le chiffe d'affaires a fondu. Les syndicats demandent que les aides soient prolongées jusqu'à la fin de l'année. Va-t-on assister au déconfinement du spectacle vivant pour cette rentrée ? La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s’est prononcée pour la fin de la distanciation dans les salles de concert et les théâtres, au moins pour les spectacles «assis». Fini les jauges amputées de moitié et le siège vide entre les spectateurs, lesquels continueront toutefois obligatoirement de porter un masque. La ministre s’est engagée auprès de différents représentants du spectacle vivant, qu’elle a rencontrés mercredi rue de Valois lors d’une série de réunions, à défendre cette idée lors du prochain Conseil de défense, dont la date n’est pas encore fixée. «Motif d’espoir» «Roselyne Bachelot a bien compris notre point de vue, c’est un motif d’espoir : pour nous, la distanciation impose des jauges trop dégradées, nous devons avoir des jauges à 85 %», a rapporté à l’AFP Malika Seguineau, du Prodiss, syndicat des salles de spectacle musical et des festivals. «Nous croyons dans la responsabilité des spectateurs, comme quand ils prennent le métro, le train, l’avion, comme quand ils reprendront le chemin du bureau en septembre», dit-elle. Une revendication qui s’établit aussi par comparaison avec d’autres lieux de spectacles, et notamment par l’incompréhension d’une grande partie du secteur de voir que le parc du Puy-du-Fou avait, par dérogation préfectorale, pu augmenter le week-end dernier la jauge de ses Cinéscénies jusqu’à 9 000 spectateurs, doublant presque le maximum des 5 000 personnes autorisées jusqu’à la fin octobre. L’autorisation leur a été retirée pour ce week-end, mais une demande de clarification du cadre dérogatoire a néanmoins été demandée à Roselyne Bachelot. «Une ministre très concernée» «Nous avions en face de nous une ministre de la Culture très concernée, à notre écoute, avec une vraie envie de défendre le secteur. Elle nous l’a répété en début de rencontre : elle veut sauver le spectacle vivant», a réagi Bertrand Thamin, président du syndicat des théâtres privés, dans le Parisien. Sauver n’est pas trop fort, le secteur a fondu des trois quarts. Selon une étude publiée par le ministère en juillet, «l’impact de la crise du Covid-19 [sur la culture] se traduira par une baisse moyenne de chiffre d’affaires de 25 % en 2020 par rapport à 2019 (de 97 à 74,7 milliards d’euros). L’effet sera le plus important sur le secteur du spectacle vivant (-72 %), du patrimoine (-36 %), des arts visuels (-31 %) et de l’architecture (-28 %)». Avec la précision d’une perte de 4,2 milliards d’euros pour le seul spectacle vivant et un différentiel de -97 % de chiffre d’affaires entre avril et août par rapport à la même période en 2019. Une autre demande appuyée par le Prodiss concerne le déblocage d’une enveloppe de 300 millions d’euros d’aides pour renflouer en trésorerie les entreprises du milieu. «Une boîte sur deux est menacée. Notre secteur est à l’arrêt depuis six mois, or il représente 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 135 000 emplois», insiste Malika Seguineau, dont le syndicat demande aussi des mesures d’accompagnement comme la prolongation des mesures d’activité partielle au moins jusqu’à la fin de l’année. Guillaume Tion Légende photo : La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, au Théâtre national de Strasbourg, le 10 juillet. Photo Patrick Hertzog. AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 20, 2020 5:14 AM
|
Propos recueillis par Christian Jade pour le site de la RTBF. (Belgique), le 17 août 2020 L’autrice, actrice et metteuse en scène Cathy Min Jung a été choisie au mois de juin, parmi 7 candidats pour assumer la direction artistique et générale du Rideau de Bruxelles. Elle prendra ses fonctions au mois de septembre succédant à Michael Delaunoy qui assurera jusqu’en octobre 2020 la direction artistique et générale de sa treizième et dernière saison. Il met en scène "Des Hommes endormis" de Martin Crimp du 22 septembre au 10 octobre. Rencontre avec Cathy Min Jung, une jeune femme bien ancrée dans son époque qu’elle qualifie elle-même de "momentum" : un moment de grand changement, de tension extrême, de protestations multiples, pour l’écologie, pour les droits sociaux, pour le féminisme, contre le racisme. L’artiste Christian Jade : Comment vous définissez-vous comme artiste dans le paysage théâtral belge francophone de la Fédération Wallonie Bruxelles ? Cathy Min Jung : Je suis une femme de 46 ans, autrice, metteuse en scène, comédienne, réalisatrice. J’ai une compagnie de théâtre, "Billie on stage" (parce que fan de Billie Holiday), qui émarge au CAPT. Je pratique une écriture du réel où chaque pièce est le fruit d’un long travail de documentation et d’immersion. A partir de cette matière, je fais travailler l’imaginaire, j’essaie de trouver une réponse théâtrale. C’est le cas de votre autobiographie fictionnalisée, "Les Bonnes intentions" (2012), inspirée en partie de votre expérience d’enfant coréenne adoptée à 3 ans et demi par une famille d’agriculteurs wallons. La fiction et la mise en scène transcendaient ce cas particulier pour le rendre universel. Même principe pour "Sing my life" (2016), votre 2ème spectacle ? J’ai mené une enquête dans le milieu ouvrier mais aussi à travers des livres. Ça partait d’une envie d’explorer les dérèglements du monde de la finance et l’impact concret dans le quotidien d’ouvriers et d’ouvrières lorsque leurusine fermait pour cause de délocalisation. A chaque sujet, j’essaie d’apporter une réponse théâtrale la plus adaptée, donc chaque fois différente. Au fil de l’écriture, la forme se dessine et une dramaturgie s’impose à moi. Votre "Cour des Grands" (2020), interrompue en plein vol par la crise du Corona, ne sera visible qu’en 2021. Aujourd’hui, on est dans un "momentum", un moment de tension extrême, de protestations multiples : pour l’écologie, pour les droits sociaux, pour le féminisme, contre le racisme. Tout crie un désir de changement. En observant l’évolution de mon fils à l’école, j’ai pu rapidement constater que la cour de récré, c’est le Monde ! C’est là qu’on commence à devenir citoyen, à construire nos liens avec les autres, à expérimenter les rapports de pouvoir, les amours, les amitiés, les conflits. Les éducateurs ont un rôle clé dans l’accompagnement de ces futurs citoyens, mais ils sont complètement méprisés, sous-payés, pas valorisés. Dans "La Cour des Grands", j’ai voulu mettre en lumière le rôle de cette profession dans un changement de société. La Cour des Grands sera jouée au Théâtre de la vie du 23 février au 6 mars 2021. Vous renouez avec un théâtre de témoignage social ? Ce qui prime pour moi, c’est l’imaginaire. Je ne veux pas faire du théâtre social, même si l’art est "politique" au sens noble du terme. Mais l’imaginaire transcende le réel. Je m’inspire du réel, mais je ne le reproduis pas tel qu’il est. Christian Jade : Quel est votre rapport historique au Rideau ? Cathy Min Jung : Je suis sensible et à la formidable équipe en place et à la tradition de Claude Etienne, orientée vers le théâtre de texte, l’écriture dramatique. J’ai à la fois un grand respect pour cet héritage et le désir d’y apporter des nuances, l’agrandir. Le Rideau doit davantage s’ancrer dans son territoire, son quartier, l’espace public et revaloriser tout ce qui est mission de service public du théâtre. Vous écrivez qu’il faut élargir le public et représenter la diversité sur scène et dans la salle. Comment allez-vous faire ? On est à un carrefour entre plusieurs communautés, Matonge, la rue Malibran et les Communautés européennes. Je n’ai pas de recette magique et il va falloir chercher. Quant à la diversité, on ne l’invente pas, on ne la construit pas, elle existe, qu’elle soit sociale, ethnique, culturelle… Il faudra mettre en place des évènements festifs fédérateurs qui donnent au plus grand nombre possible l’envie de partager un moment avec d’autres sensibilités. Il est question dans votre projet d’un "collectif associé". Des artistes issus de cette diversité y figurent-ils ? Ma vision "artistes" pour le Rideau a deux axes principaux. D’un côté, il y a les "artistes du cercle mouvant", qui fréquenteront la maison au gré de leurs productions et qui changeront de saison en saison. Par ailleurs, il y a un groupe d’artistes, mais aussi de penseurs, de critiques, de philosophes dont j’ai envie de m’entourer pour discuter une fois par trimestre, avec l’équipe du Rideau et moi-même, des grandes orientations de la maison et questionner le sens même du théâtre dans la société d’aujourd’hui. On peut avoir des noms ? Bien sûr : Nancy Delhalle, Jessica Gazon, David Murgia, Etienne Minungu, Bwanga Pilipili, Laurence Vielle, Ilyas Mettioui, Petra Van Brabandt… J’aimerais impliquer ce "collectif associé" dans des activités de médiation et d’élargissement des publics. J’aimerais par exemple proposer à Laurence Vielle d’aller à la rencontre des habitants du quartier pour recueillir leurs paroles et en tirer un portrait poétique. J’imagine aussi un projet de quartier participatif que je dirigerais pour aller à la rencontre des voisins, pourquoi pas en collaboration avec le CPAS d’Ixelles et qui déboucherait sur un spectacle à part entière. La notion classique d’"artiste associé" n’existe pas dans votre programme ? Je n’ai pas prévu d’"artiste associé " au sens classique mais le "collectif associé" en est la matrice. En son sein, il y a des créatrices et créateurs dont les projets pourront être accompagnés par le Rideau de Bruxelles. Comment retrouver du public dans l’immédiat pour 2020-21 ? Il faut diffuser cette saison 22020-21 imaginée par Michael Delaunoy en ne se focalisant pas uniquement sur le nombre de spectateurs présents. Les artistes doivent continuer à travailler, même si les représentations sont perturbées. On est tous traumatisés, il faut accompagner tout le monde, artistes et public. Les réponses à ces questions doivent se construire avec l’équipe. Comment imprimer votre marque dans la programmation 2021-22 dans le flou actuel ? Il faut mettre en lumière le travail de création, en dehors de la représentation. Comment faire pour faire reconnaître ce travail ? C’est possible, il faut y croire ! J’ai la foi quand même dans le besoin d’imaginaire des artistes et du public ! Tout ça doit se construire avec les artistes. Vous avez été produite par le Théâtre de l’Ancre, le Théâtre de Liège, la Maison de la Culture de Tournai, et vous souhaitez aussi collaborer avec Mars/Mons et toutes les nouvelles directions prochaines du Varia, du Jean Vilar et de Namur. Oui, bien sûr. La crise Covid a ses revers mais elle peut être une contrainte stimulante qui nous oblige à requestionner les processus de production, de représentation, de création. Et moi, je suis dans la construction, toujours, cette contrainte nous oblige à réinventer comment on veut le faire, si on veut le faire et avec qui. "Réinventer " est devenu un mot galvaudé, mais ça peut être réellement stimulant si c’est pensé dans une finalité purement artistique et non dans une optique marchande de rentabilité… "Réinventer" doit être une réponse à cette chape de plomb qui nous est tombée dessus avec la Covid 19. Vous avez aussi un réseau de relations internationales, au Canada notamment. J’aimerais importer à Bruxelles le festival "Jamais lu" créé par Marcelle Dubois à Montréal, à Québec et à Paris. Il est consacré aux nouvelles écritures. Quatre textes " en construction " sont choisis et confiés à un groupe de dix comédien (ne) s qui les interprètent sous la direction de quatre metteurs/euses en scène. C’est le prolongement du RRRR Festival de Michael Delaunoy. Ça se fera en coproduction avec le "Jamais lu" de Montréal. Votre signature, votre "mot de la fin" ? Le Rideau de Bruxelles sera un lieu de création qui privilégie l’approche textuelle, avec un soutien actif aux auteurs et autrices de notre Fédération et une ouverture affirmée aux nouveaux récits. Un lieu qui défend une parole contemporaine polyphonique et pluraliste. Légende photo : Cathy Min Jung - © Beata Szparagowska

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 19, 2020 12:46 PM
|
Par Christophe Levent dans Le Parisien 19 août 2020 La ministre de la Culture a reçu ce mercredi matin les représentants du spectacle vivant. Elle s’est engagée à défendre l’idée de la fin de la distanciation sanitaire dans les concerts et les théâtres lors du prochain Conseil de défense. On avance, on avance… Mercredi matin, les représentants des professions du spectacle avaient rendez-vous avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, pour évoquer l'avenir d'un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. Une réunion dont ils sont sortis avec le sentiment d'avoir été « entendus » et de commencer à voir les lignes bouger, à défaut d'être totalement rassurés… Pendant un peu plus d'une heure, les présidents des syndicats du théâtre privé, des cabarets, des salles de concerts et des festivals ont pu exprimer leurs inquiétudes à quelques semaines de la rentrée et faire valoir leurs revendications. Avec une préoccupation commune : comment faire repartir une activité sinistrée depuis six mois ? Oreille attentive « Nous avions en face de nous une ministre de la Culture très concernée, à notre écoute, avec une vraie envie de défendre le secteur. Elle nous l'a redit en début de rencontre : elle veut sauver le spectacle vivant. Elle souhaite que nous puissions redémarrer vite et elle nous a confié que le président de la République partageait cette volonté. C'était un échange vraiment constructif », estime Bertrand Thamin, président du syndicat des théâtres privés. Même sentiment chez Daniel Stevens, délégué général du syndicat des cabarets. « Nous sommes ressortis plutôt rassurés et avec une impression positive. Même si la ministre était plutôt là pour nous écouter et n'avait aucune annonce officielle à nous faire… » Pas de décisions donc, pas de commentaires non plus du côté du ministère à la sortie, mais une promesse de Roselyne Bachelot, concernant l'une des revendications principales des salles de spectacle : la fin de la distanciation, au moins pour les spectacles « assis », avec masque obligatoire pour tous. « Après nous avoir écoutés, la ministre s'est engagée à défendre cette idée devant le prochain Conseil de défense. Pour nous, c'est le minimum si on veut un redémarrage du secteur et je crois que les spectateurs en seraient plutôt rassurés », affirme Bertrand Thamin. « On voit des concerts sauvages qui s'organisent… » « La ministre a compris que c'était la clé de la reprise de notre activité, constate Pierre Alexandre Vertadier, producteur de concerts (Ninho, Alain Souchon, Christophe Maé…). C'est quelque chose que nous pouvons gérer dans des conditions sanitaires satisfaisantes. De toute façon, il ne faut pas croire que l'on va pouvoir mettre le secteur de la musique sous cloche encore longtemps. On voit des raves, des concerts sauvages qui s'organisent… Mieux vaut que cela soit géré par des professionnels. » Quant à la question des concerts « debout » et des festivals, elle reste un peu plus épineuse. « Je crois que cela fait encore peur à tout le monde… Peut-être que ce n'est pas encore le moment de les faire reprendre. Il ne faut pas être dans le déni de la situation », estime le producteur. « Zéro recettes depuis mars » L'aspect économique a bien sûr aussi été au cœur des discussions. « Pour nous, c'est zéro recettes depuis mars, constate Daniel Stevens. Nous avons expliqué à la ministre qu'il faudrait un plan d'aide estimé à 300 millions pour le secteur ». Dans le théâtre privé, Bertrand Thamin se dit de plus en plus inquiet. « Je commence à avoir beaucoup d'adhérents qui m'expliquent qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Il faut que l'Etat amplifie son aide. Y compris après les réouvertures, le temps que le public revienne… » Là encore, les professionnels du spectacle ont eu le sentiment d'avoir eu une oreille attentive. Mais personne ne s'enflamme. « On a senti la volonté de la ministre. Mais on sait bien qu'elle ne peut pas décider toute seule, constate le président des théâtres privés. Et puis la situation est évolutive. Aujourd'hui, pas grand monde n'a de certitudes, que vous soyez patron de théâtre, médecin ou… ministre. » Légende photo : Roselyne Bachelot s’est entretenue pendant plus d’une heure avec les présidents des syndicats du théâtre privé, des cabarets, des salles de concerts et des festivals. LP/Guillaume Georges

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 17, 2020 7:37 AM
|
Propos recueillis par Jacques Morice et Guillemette Odicino pour Télérama - Publié le 17/08/20
Après avoir joué pour Éric Judor (Problemos, 2017) ou Éric Lartigau (#Je suis là, 2020), la comédienne collabore pour la première fois avec le duo déjanté Delépine/Kervern.
Avec ses sketchs acides, Blanche Gardin s’est imposée comme la reine du stand-up français. Son irrévérence s’épanouit désormais au cinéma, comme dans le prochain film de Benoît Delepine et Gustave Kervern, “Effacer l’historique” en salles le 26 août. Sans tabous, elle nous parle de ses mille et une vies. De son obsession pour la vérité. Et de son autocritique permanente. Suicide, dépression, problèmes sexuels ou intestinaux, psychiatrie ou sodomie, nul tabou ne résiste à Blanche Gardin. À travers ses spectacles, Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche, la jolie et étrange blonde de 43 ans est devenue la reine de l’humour en France. En le faisant grandir d’un coup pour qu’il atteigne l’âge adulte. Sur scène, elle est éminemment drôle en dévoilant des choses très intimes. Qui viennent d’elle et d’une autre, ce personnage qu’elle compose : une poupée rigide, inquiétante, qui cisèle des raccourcis existentiels foudroyants. Le cinéma n’a pas tardé à faire appel à elle. Elle était dans Problemos, d’Éric Judor (2017) et #Je suis là, d’Éric Lartigau (2020). Mais cette fois, elle est au premier plan du formidable Effacer l’historique, de Benoît Delépine et Gustave Kervern (en salles le 26 août), tribulations de trois voisins de lotissement en pleine mouise financière et technologique. Aux côtés de Corinne Masiero et Denis Podalydès, elle s’y montre minable, cuitée, esseulée, mais fichtrement vivante. Une performance riche de vécu ? Oui, à entendre les récits picaresques de cette clown aussi provocatrice que réfléchie, qui semble avoir déjà eu mille vies et une unique obsession : la vérité. S’il fallait effacer votre historique ?
J’effacerais des films porno et mes propres recherches sur Blanche Gardin dans Google ! Je m’en veux de m’accrocher à ce que les gens pensent de moi : c’est à la fois une enflure de l’ego et un manque de confiance en soi. Que notre niveau de popularité puisse nous définir est terrible. De plus, à cause de toutes ces « applis » prétendument ludiques, nous devenons tous malgré nous des instruments de contrôle de tout le monde, des mouchards de l’existence. Nous sommes conditionnés pour prendre des photos comme si notre vie n’existait pas tant qu’elle n’est pas immortalisée sur un écran. Un soir, à Lille, où j’avais pas mal bu après mon spectacle, j’ai détruit fièrement mon smartphone : enfin libérée ! Et j’ai pris un portable à l’ancienne. Avant d’être rattrapée par mon entourage, qui m’en voulait : « Tu nous retardes, tu es moins connectée ! »…
C’est l’un des sujets du film de Gustave Kervern et Benoît Delépine…
La critique du progrès est toujours vue comme réactionnaire ou rabat-joie, alors qu’une critique saine et drôle est possible. Gustave et Benoît y parviennent : leurs personnages refusent de s’adapter et on leur donne raison. La nouveauté n’est pas toujours la panacée : ce n’est pas parce que nous sommes la version la plus récente de l’humanité qu’il s’agit de la meilleure.
Comment s’est passée la rencontre avec eux ?
J’éprouvais depuis longtemps un sentiment de familiarité immense avec leurs films, leurs personnages, leurs acteurs fétiches. Un heureux hasard a voulu qu’ils viennent me voir sur scène. Ils m’ont proposé un rôle dans la foulée. J’étais très intimidée. J’avais peur de foutre en l’air leur film en étant incapable d’incarner un personnage ! Nous avons fait quelques réunions où je leur ai fait des propositions sur le scénario. Comme leur travail est très collaboratif, ils étaient d’accord. Mais je restais paniquée. Le premier jour de tournage, ils sont venus dans ma loge : « Ah, au fait, on ne va pas tourner la scène prévue, mais plutôt commencer par un plan où l’on te voit arriver de dos ; tu te grattes le dos contre un arbre puis tu dévales la pente vers ta maison, un peu bourrée. » D’un coup, j’avais la clef : Marie, mon personnage, est une ourse de lotissement qui a des problèmes avec l’alcool ! On a trempé dès lors dans la même soupe avec Benoît et Gustave, dans cette stratosphère poétique, où ils flottent en permanence. En étant imprévisibles, constamment à contre-courant.
Marie, c’est votre premier vrai rôle ?
Oui, ils m’ont dépucelée ! Jusque-là, j’arrivais dans les films avec mon personnage de Blanche Gardin. Souvent pour un passage rapide, comme dans 20 Ans d’écart, de David Moreau (2013), où j’explose la scène, et je repars, c’est facile et valorisant. Mais Marie n’est pas Blanche. Avec Corinne Masiero et Denis Podalydès, nous avons été nos personnages : trois voisins dans un monde de merde, qui s’entraident comme ils peuvent, sans avoir le temps de s’engager totalement dans une amitié. C’est avant tout un rapport de survie, de solidarité.
“Je refuse d’être militante, car le militantisme exclut la distance et l’humour. Épouser totalement une cause, c’est en épouser aussi les dérives.”
Le film est raccord avec l’actualité des Gilets jaunes. Vous cautionnez leur combat ?
Je suis solidaire de bien des colères. Mais je n’ai pas une vie de Gilet jaune. En revanche, je comprends l’explosion. L’air est devenu irrespirable. D’ailleurs, aujourd’hui, nous portons des masques ! Mais je refuse d’être militante, car le militantisme exclut la distance et l’humour. Épouser totalement une cause, c’est en épouser aussi les dérives.
Dans vos spectacles, vous n’êtes jamais univoque. Cherchez-vous à déconstruire aussi vos propres convictions ?
Cela doit venir d’une pathologie ! Pour laquelle je suis suivie par un psy… J’ai un souci de vérité maladif. Et vain, car personne ne parvient à être totalement honnête. Et puis les bonnes personnes, il faut aussi s’en méfier. Je suis très cliente de l’examen de conscience. Je fais ma propre police quand j’écris mes sketchs, je traque ce qui peut passer pour de la moquerie. Je hais le mépris social.
Quelle est la conviction personnelle la plus solide que vous ayez renversée ?
Le désir d’être mère. J’étais persuadée que j’aurais des enfants, que c’était normal d’être mère. La nature m’a mis un gros stop. Fallait-il que je fasse appel à la science ? La réflexion a été difficile, mais j’ai décidé de ne pas céder à cette notion, malsaine, selon laquelle nos désirs doivent forcément être solutionnés, si besoin par la technique. Aujourd’hui, c’est fait, j’ai déconstruit la maternité.
“La différenciation des rôles me plaît. L’égalité salariale, oui, bien sûr ; en revanche, je ne suis pas contre être en couple avec quelqu’un qui m’en impose.”
Vous semblez ambivalente sur le féminisme…
J’ai besoin d’être une humaine forte. Je résiste à la victimologie. Il y a parfois de la malhonnêteté ou de la simplification à travers certains discours féministes. Les relations hommes-femmes sont plus complexes, souvent de l’ordre de l’alchimie. La différenciation des rôles me plaît. L’égalité salariale, oui, bien sûr ; en revanche, je ne suis pas contre être en couple avec quelqu’un qui m’en impose. Les acquis du féminisme des années 1970 continuent de faire leur effet. De nouvelles filles arrivent, sortent des écoles. Un peu de patience…
Pourquoi avoir refusé d’être décorée dans l’ordre des Arts et des Lettres ?
Je ne voulais rien accepter d’un gouvernement Macron. Une fois élu, le président a promis de manière péremptoire qu’en un an plus personne ne dormirait dans la rue. C’est scandaleux de faire de telles annonces et de ne pas mettre en œuvre ensuite une vraie politique sociale du logement. Tous les jours, on voit des gens dormir par terre dans la pisse de chien. Et on s’est habitué à cette vision d’horreur. C’est atroce.
Vous soutenez activement la Fondation Abbé-Pierre…
J’ai toujours admiré leur travail. Je souscris à leur programme politique « Logement d’abord », qui a été expérimenté avec succès en Finlande, où le sans-abrisme a diminué de 80 %, réduisant par là même le coût financier important qu’il engendre. Une proposition de logement ne doit pas être l’étape ultime de la réinsertion sociale, mais la première. C’est logique : comment demander à un type d’être propre et de se présenter à un boulot s’il dort dans une tente ou un parking ? J’ai fait un Zénith pour reverser les bénéfices à la Fondation et nous avons d’autres projets.
Avant le stand-up, vous étiez en fac de sociologie. Votre sujet de mémoire était surprenant…
Je me suis mise dans la peau d’un flic. Avant la maîtrise, j’avais étudié les toxicos, les concierges portugaises, les sans-abri, les tagueurs. Puis j’ai décidé d’aller voir de l’autre côté, celui de l’ordre. Cela tombait bien car la Police nationale commençait à engager des adjoints de sécurité pour que les policiers ressemblent un peu plus à leurs clients. Sachant qu’entre les gros moustachus avec l’accent du Sud et les petits mecs du 9.3, ce n’était pas la franche entente ! J’ai passé deux mois en internat dans l’Essonne, en plein hiver, avec des gardiens de la paix. Salut au drapeau à 6 heures du mat. Pas beaucoup de filles, pas mal de gouines. J’ai bien rigolé. Même si les cours théoriques se résumaient à apprendre par cœur l’article de loi concernant la légitime défense !
“Je suis partie à Naples prendre des acides et dormir dans la rue avec des punks à chiens pendant neuf mois. Mon père est venu me chercher.”
Et où avez-vous été affectée ?
J’ai fait la circulation au carrefour devant le Sénat, mais comme je suis toute petite, les gens se marraient. J’ai gardé aussi le domicile de Laurent Fabius, armée de ce petit six coups qui datait des années 1960, dangereux, car il explosait facilement. J’ai démissionné ensuite pour revenir à la fac, mais mon père est tombé malade. Je crois que je faisais des études pour lui faire plaisir. Quand il est mort, je les ai arrêtées pour être éducatrice pendant quatre ans, en banlieue parisienne. Avant tout ça, je m’étais aussi lancée dans l’ébénisterie, mais là le machisme ambiant du milieu m’a découragée. Pourtant, j’adorais. J’avais eu envie d’un métier manuel, après ma fugue horrible, à 18 ans.
Horrible ?
Je suis partie à Naples prendre des acides et dormir dans la rue avec des punks à chiens pendant neuf mois. Mon père est venu me chercher. À point nommé : six mois plus tard, mon mec napolitain héroïnomane mourait d’une overdose. C’était le bon gros chaos, cette période.
Les raisons de ce chaos, vous les avez éclaircies ?
J’avais besoin d’être réellement actrice de ce qui m’arrivait, quitte à choisir la perdition. En restant près de ma famille, je n’aurais pas réussi à être totalement libre. Il fallait une grosse rupture. En rentrant de Naples, j’avais des cheveux rouges jusqu’aux fesses et des piercings partout. En socio, je me suis progressivement calmée sur le look rebelle. Mais je faisais encore la fofolle : j’étais maquée avec un peintre, on partait au Mexique, on expérimentait les champignons…
Dans quel milieu avez-vous grandi ?
Intello de gauche, avec un père communiste souvent enfermé dans son bureau à cause de son métier de linguiste et une mère bonne vivante. Tous les ans, ils nous emmenaient avec mon frère et ma sœur dans la R9, pour visiter l’URSS, le Maroc, la Turquie… L’ouverture d’esprit était peu commune, mais le cadre affectif pas si rassurant.
“J’aimais faire marrer depuis l’enfance. C’était un moyen de survie : j’étais la plus petite de la fratrie.”
Quand avez-vous commencé les sketchs ?
Pendant mes études, avec deux copains, mais sans aucune arrière-pensée professionnelle. Lors d’une soirée, j’ai improvisé une fausse émission de cuisine, où je faisais une Périgourdine qui préparait des canards. J’aimais faire marrer depuis l’enfance. C’était un moyen de survie : j’étais la plus petite de la fratrie, nous avions beaucoup de cousins plus âgés. Il fallait que je me fasse accepter par les grands grâce à l’humour et toujours plus de provocation. Mon père n’était pas très client. Ma mère, elle, filmait mes conneries en vidéo.
Comment avez-vous percé ?
Mon pote Ali, qui était en BTS d’audiovisuel, filmait nos sketchs et a commencé à les projeter dans des squats. Les gens riaient. Il a envoyé nos vidéos à droite à gauche. Elles sont tombées entre les mains du producteur Kader Aoun : il nous a branchés avec Karl Zéro qui avait besoin de petits rigolos pour une de ses émissions. Grâce à la chaîne Comédie, on s’est aussi fait les dents. C’est là que j’ai créé le personnage de Marjorie Poulet, une cagole du Sud. Puis Kader a monté le Jamel comedy club.
“Je me suis aperçue que je n’avais pas assez de matière de vie, pas assez de retour réflexif sur mon existence. J’ai quitté la scène pendant cinq ans. Avant de revenir avec mon premier spectacle.” Un souvenir de votre premier passage sur scène ?
La première partie de Tomer Sisley, en 2005. J’étais traumatisée. J’enchaînais des personnages que j’avais d’abord expérimentés devant les clients d’un petit bar kabyle à la gare de l’Est : un petit Portugais de 12 ans, une conseillère d’orientation, un vieux toxico… À la fin, Kader m’a dit : tu es marrante mais ce n’est pas du stand-up ! Il m’a donné des DVD de l’humoriste américain Richard Pryor, que je ne connaissais pas. Une claque. J’ai tout de suite été captivée. Mais rapidement, je me suis aperçue que je n’avais pas assez de matière de vie, pas assez de retour réflexif sur mon existence. J’ai quitté la scène pendant cinq ans. Avant de revenir avec mon premier spectacle.
Dans son adresse au public, le stand-up est-il un exercice d’impudeur ?
Il y a sans doute le fantasme d’être aimée pour ce qu’on est, totalement à nu, maniaco-dépression comprise. Avec mon côté sombre et mes joies extrêmes.
On sent aussi chez vous une certaine misanthropie.
Dont je suis la première à me méfier. Le commerce des humains avec sa mécanique sociale m’est difficile. J’ai l’impression que je ne vais pas arriver à suivre. Dans une fête, par exemple, impossible de faire le job, d’être légère, pourtant j’aimerais y arriver ! Mais je préfère discuter avec Nietzsche dans la montagne. De plus en plus souvent, j’ai besoin de partir marcher, seule, dans la nature.
Vos spectacles regorgent de vérités souvent triviales…
Ce sont des choses vécues, désagréables, miteuses ou organiques, comme avoir peur dans une maison isolée ou faire une coloscopie, que je relativise. Tout ce qu’on cache est forcément drôle à explorer. C’est intéressant de parler de caca ! Nous sommes un amas de chair, c’est notre misère. On a tendance à l’oublier dans notre monde qui déréalise tout.
De là l’interdiction de vos spectacles aux moins de 17 ans ?
Ce que je raconte n’est pas pour les enfants. Je parle à des adultes, point. Ça m’énerverait et me déconcentrerait de voir un gamin dans le public, flanqué d’un parent qui a eu l’irresponsabilité de l’emmener. C’est comme les bars : maintenant qu’on ne peut plus fumer, il y a des gosses partout, c’est agaçant !
“Je ne fais pas semblant d’être pétrifiée, je le suis. Trop timide, incapable de bouger mon corps.”
D’où vient votre jeu de scène si minimaliste ?
J’ai construit ce personnage de Blanche pour me protéger. Mon look avec des robes vintage, c’est la petite fille qui sort du placard. Je ne fais pas semblant d’être pétrifiée, je le suis. Trop timide, incapable de bouger mon corps. Cette rigidité est devenue mon style par défaut. Pareil pour mon débit : il faut que tout soit parfaitement articulé. Cela demande une concentration folle. Si je savonne, tout s’écroule. Je ne peux même pas boire sur scène. La seule fois où j’ai essayé, j’ai renversé l’intégralité du verre d’eau. En général, ce n’est qu’à la centième du spectacle que je suis à peu près satisfaite.
Vous avez récemment enregistré un podcast avec l’humoriste américain Louis C.K. sur les relations à distance. Avant même de le rencontrer, vous déclariez qu’il était l’homme de votre vie.
Dans une vidéo, je l’avais vu en short : il avait la même tache de naissance que moi, à l’intérieur du genou droit ! Je suis partie à New York pour le rencontrer, mais sans succès. Aux César, quand j’ai porté un pin’s à son effigie, on ne se connaissait toujours pas. Puis je l’ai remercié pour son inspiration à la cérémonie des Molières. Il m’a écrit et, après quelques mails échangés, il est venu dîner avec moi à Paris…
En 2017, il a reconnu avoir eu des comportements sexuels répréhensibles : se masturber en présence de comédiennes.
Louis C.K. s’exprime depuis trente-cinq ans sur sa sexualité répréhensible. Par ailleurs, je considère qu’une des définitions du féminisme est la liberté des femmes à disposer de leur cul.
Et le cinéma, envie de continuer ?
En ce moment, j’écris une série où je cherche moins à faire rire qu’à chroniquer l’air du temps. Sinon pas d’aspiration particulière. Cela dépendra de ce qui nourrit le présent. On verra à la prochaine pandémie !
Propos recueillis par Jacques Morice et Guillemette Odicino ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 avril 1977 Naissance à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
2006 Première apparition sur scène dans le Jamel comedy club.
2011 Second rôle dans le film Case départ, de Fabrice Éboué, Thomas Ngijol et Lionel Steketee.
2015 Premier one-woman-show, Il faut que je vous parle !
2017 Deuxième one-woman-show, Je parle toute seule.
2018 Bonne nuit Blanche. Crédit photo : Jean-François Robert pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 16, 2020 7:09 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde
Publié le 14 août 2020
SÉRIE« Théâtres secrets » (5/5). « Le Monde » propose un tour de France des scènes à usage privé. Aujourd’hui, celle de Franck Ciup, qui a imagine sa salle comme un salon de musique pour son Steinway et ses amis. Inauguré en 2006, le Théâtre Saint-Bonnet est devenu le temple des pianistes. Quand on arrive sur le boulevard Clemenceau, à deux pas de la cathédrale, rien ne l’annonce, sinon un écriteau discret sur une façade étroite. Le Théâtre Saint-Bonnet serait-il là ? Oui, c’est bien là, et on n’en doute plus quand arrive Franck Ciup, avec son grand sourire et ses boucles blanches. L’étonnement du visiteur ne surprend pas le maître des lieux. Il en a l’habitude, comme du « Ah oui » stupéfait quand il ouvre la porte : alors apparaît un théâtre à l’italienne avec ses ors et ses dorures, un lustre et des appliques de Murano, des chaises à l’assise rouge et un Steinway sur le plateau, ou plutôt un plateau sous le Steinway, qui occupe toute la place. Car le théâtre est le royaume du piano. C’est pour lui qu’il a été construit. « Il sonnait trop fort dans le salon », explique Franck Ciup. Le salon est dans la maison attenante, une maison de ville avec un jardin aux herbes folles, une piscine sous une verrière, un escalier qui craque, à l’ancienne, et des chambres d’hôte, dont l’une est si vaste qu’elle accueille un billard. Franck Ciup vit là depuis trente ans, avec son épouse Anna. Tous les deux sont des Berruyers d’adoption. Née en Afrique du Nord, elle est arrivée dans la ville du Printemps avec son père, militaire. Né à Clamart (Hauts-de-Seine), il est venu à 5 ans avec ses parents. Un père expert-comptable, une mère dans la confection, et une passion, le piano. « Je l’ai étudié à l’Ecole normale de musique de Paris, dont je suis diplômé, précise-t-il. Mais, comme j’aimais bien être dans les tissus, avec ma mère, j’ai fondé une entreprise, avec ma femme. » Très florissante, l’entreprise de prêt-à-porter : elle s’appelle Col Claudine et a compté jusqu’à une trentaine de boutiques en France. Franck Ciup s’était fixé un objectif : arrêter à 50 ans. Il s’y est tenu, prenant même de l’avance. Il avait 47 ans, quand son épouse et lui ont vendu la société. Jusqu’alors, il avait mené une double vie. « Je me consacrais à l’entreprise jusqu’à 14 heures, puis au piano, comme compositeur et concertiste. J’ai beaucoup voyagé, pour les deux. En voyant d’autres villes que la mienne, je me suis rendu compte à quel point Bourges était équilibrée et belle. » D’où l’ancrage berrichon et la maison où ont grandi sa fille, psychologue, et son fils, ingénieur du son qui travaille avec le chef d’orchestre Teodor Currentzis. Ancienne grange Dès le matin, à l’heure où les hôtes prennent le petit-déjeuner, Franck Ciup se glisse le long de la piscine et ouvre la porte qui donne directement sur la scène de son Steinway D de concert. Le théâtre niche dans une ancienne grange, très haute : « Au XIXe siècle, elle devait faire partie de ce qu’on appelle, à Bourges, les “maisons de colonel”, avec les chevaux en bas, et le foin à l’étage », suppose Franck Ciup, qui s’est passé d’architecte pour les travaux de transformation. Il a imaginé la salle en se souvenant de toutes celles dans lesquelles il avait assisté à des concerts, et en sachant qu’il voulait lui donner les habits d’un théâtre à l’italienne qui ressemblerait à une grande miniature de la Scala : « Et puis, ajoute-t-il, mon épouse et moi avons lu beaucoup de livres. » Franck Ciup : « J’ai appelé un spécialiste, il demandait 80 000 euros. J’ai décidé de m’en passer » Même chose pour l’acoustique : « J’ai appelé un spécialiste, il demandait 80 000 euros. J’ai décidé de m’en passer. De toute façon, la plupart des salles de concert ont une très mauvaise acoustique. Et on fait avec. Je dois dire que j’avais un espoir secret : la salle a la forme très simple d’une boîte à chaussures, comme le Concertgebouw d’Amsterdam et le Gewandhaus de Leipzig, dont l’acoustique compte parmi les meilleures. » Pour l’aménagement et la décoration intérieurs, Franck Ciup a travaillé avec son ami décorateur Jean-Luc Charpagne, lui aussi un passionné de musique « sans qui Saint-Bonnet ne serait pas ce qu’il est ». Du rouge et de l’or, donc, un rideau de scène pourpre taillé dans des chutes du rideau de l’opéra de Monaco, des glaces qui démultiplient sans fin les perspectives latérales et un balcon pas trop pentu – « Je ne voulais pas qu’on ait le vertige, comme dans certaines salles. » Un soin particulier a été apporté au choix des matériaux qui réfléchissent et absorbent le son. Ainsi le parquet a été posé sur lambourdes, par un compagnon de France. Salle privée et publique La scène, qui supporte les 500 kg à 600 kg du Steinway est petite : 4,59 m de large, quand le piano en fait 2,76. Il est entré dans la grange par une porte spécialement conçue, et n’en a plus bougé. C’était en 2006, quand Saint-Bonnet a été achevé, après deux ans de travaux, et 150 000 euros d’investissement. A ses débuts, le théâtre n’avait pas de chaises. Franck Ciup l’imaginait comme un grand salon musical avec des canapés, qu’il prêterait à ses amis musiciens désireux de se roder avant de partir en concert. « Tout était conçu pour eux. Mais mon ami décorateur m’a dit : tu n’as pas le droit de faire venir de grands interprètes sans en faire profiter les habitants de Bourges. » Franck Ciup l’a entendu. Et il ne le regrette pas. La plupart du temps, des pianistes viennent travailler en catimini, ou donner des concerts, eux aussi en toute discrétion. En octobre 2006, il a invité Bertrand Chamayou à donner le premier concert officiel. Le pianiste a choisi un lied de Robert Schumann transcrit par Franz Liszt. « On s’est mis à pleurer, Jean-Luc et moi, au balcon, tellement le son était miraculeux. » Depuis, la salle est à la fois privée et publique. Chaque saison, une dizaine de soirées sont proposées aux Berruyers, qui ont pu assister au dernier concert en France de Vladimir Ashkenazy en juin, ou entendre Ivo Pogorelich l’année dernière. Mais, la plupart du temps, des pianistes viennent travailler en catimini, ou donner des concerts, eux aussi en toute discrétion. Franck Ciup est fier de signaler que « c’est au Saint-Bonnet que Brigitte Engerer a enregistré son disque L’Invitation au voyage, avec le violoncelliste Henri Demarquette [sorti en 2007] ». Il précise aussi qu’il ne reçoit aucune subvention et qu’il n’en veut pas. Seul compte pour lui le bon plaisir d’une salle dont la marraine est la comédienne Marie-Christine Barrault et le roi, un Steinway qui sonnait trop fort dans un salon. Brigitte Salino Bourges (Cher), envoyée spéciale Pour son Théâtre Saint-Bonnet, achevé après deux ans de travaux et 150 000 euros d’investissement, Franck Ciup a fait appel à son ami décorateur Jean-Luc Charpagne. PHILIPPE BRAULT POUR « LE MONDE » « Théâtres secrets » : une série en cinq volets

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 28, 2020 5:34 AM
|
Par Florence Vierron dans Le Figaro - 27 juillet 2020 Installée en Israël depuis une vingtaine d’années, elle avait marqué le théâtre parisien dans les années 1980. Elle s’est éteinte à 61 ans.
Même si elle avait quitté la France depuis une vingtaine d’années, on se souvient de la star qu’elle était en France dans les années 1980. La metteuse en scène de théâtre Saskia Cohen-Tanugi s’est éteinte la semaine dernière, en Israël, où elle vivait. Elle avait 61 ans et a été enterrée à Jérusalem.
Née à Tunis en 1959, passée par le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, où elle eut Antoine Vitez comme professeur, diplômée de l’Université hébraïque de Jérusalem et de la Sorbonne, elle a rapidement été repérée par ses enseignants. Il faut dire qu’elle n’a que 16 ans lorsqu’elle crée son premier spectacle. Passionnée de théâtre et de cinéma, véritable personnage de roman d’aventures, elle joue, en 1983, aux côtés de Sean Connery dans le James Bond Jamais plus jamais. La même année, on la voit dans Le Faucon, de Paul Boujenah. Lors de son passage en Grande-Bretagne, elle en profite pour suivre une formation au théâtre shakespearien et elle sera même correspondante rock de Libération à Londres !
Audacieuse, volubile, insatiable, elle impressionne très vite les grands noms du théâtre. C’est ainsi que René Gonzalez lui confie la mise en scène du Marchand de Venise, de Shakespeare, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, en 1983. L’année suivante, on la verra à Avignon présenter Docteur X Hero ou le dernier client du Ritz, un spectacle de science-fiction.
Toujours en quête de nouveaux territoires d’écriture, de science et de savoir, elle part en 1988 pour la Nouvelle-Calédonie, où elle travaille pendant un an à la préparation du Festival des arts du Pacifique. Mais elle avait la bougeotte. Dès 1989, elle est de retour à Paris, où elle met en scène au Studio des Champs-Élysées Le Banc, du Russe Alexandre Guelman, avec Élisabeth Depardieu et Jean-Michel Dupuis, un de ses grands succès. Sa curiosité l’entraînera ensuite vers un scénario sur l’Afrique contemporaine avec Patrick Grandperret.
Sa route croisera encore quelques stars, comme Kirk Douglas, qui interprète le rôle principal de Veraz, un film de 1991 qu’elle a écrit avec Xavier Castano. Bernardo Bertolucci lui demande de participer à l’écriture de Little Buddha et Diane Kurys fait appel à ses talents pour le scénario des Enfants du siècle.
Mais sa passion va au-delà de l’écriture. De 1995 à 1999, elle est chargée de la programmation artistique du Théâtre 13, à Paris. Puis elle enseigne quelques années à l’école du Théâtre national de Chaillot. En 1997, elle dirige Jean-Michel Dupuis dans L’Orage et la Prière, de Salomon Ibn Gabirol, un spectacle puissant et éclairé. Et en 1999 vient la consécration puisque son adaptation de Mademoiselle Else est nommée quatre fois aux Molières. Isabelle Carré repartira avec le Molière de la meilleure comédienne et Pascale Bordet avec celui des meilleurs costumes.
Puis elle s’installa en Israël, où elle enseignait et où elle a été responsable d’un atelier de théâtre à l’Université hébraïque de Jérusalem. Elle y a aussi dirigé de nombreux spectacles, des ateliers. Et écrit plusieurs œuvres (Caleb et Yoshua, Judith Epstein…). Attirée par des formes de pensée très différentes, elle s’était écartée du milieu théâtral parisien. Elle restera dans les mémoires comme une personnalité unique et lumineuse. Légende photo : Saskia Cohen-Tanugi sur le tournage de Jamais plus jamais, au côté de Sean Connery, en 1983. Crédits : Warner Bros/Kobal/Shutterstock

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 2020 8:46 PM
|
A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste. Ecouter l'entretien (1h58)
Dans le cadre des « Bibliothèques de l’Odéon » – coproduction France Culture (service de la Fiction) et l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste. Il s’agit finalement de s’interroger sur un « art d’hériter » et sur la nature d’une forme de transmission livresque pour des metteurs en scène qui ont choisi de mettre le texte au cœur de leur pratique artistique.
Sur scène, Ivo Van Hove invite Juliette Binoche et Eric Ruf de la Comédie-Française à lire des extraits d’œuvres qui lui sont essentielles : Journal du voleur de Jean Genet, Les identités meurtrières d’Amin Maalouf, Agatha de Marguerite Duras, Foutainhead de Ayn Rand et "Djihad versus McWorld" de Benjamin Barber Il nous dira en quoi certaines de ces œuvres ont façonné son imaginaire et son esthétique, comment il dialogue secrètement avec elles, quelle connaissance intime il en a aujourd’hui et de quelle manière elles ont contribué à constituer son imaginaire et sa pratique de metteur en scène. Ainsi nous composerons un portrait dessiné sur le vif d’Ivo Van Hove, à travers un entretien, des archives et des extraits d’œuvres qu’il a choisis et qui sont lus par des acteurs qui lui sont chers.
Entretien de Ivo Van Hove par Arnaud Laporte
Lectures par Juliette Binoche et Eric Ruf de la Comédie-Française
Réalisation Sophie-Aude Picon
Equipe de réalisation : Benjamin Perru, Emilie Couet, et Léa Racine
Enregistré en public à l’Odéon-Théâtre de l’Europe le 7 novembre 2016
Légende photo Ivo Van Hove en 2020• Crédits : Bruce Glikas - Getty
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...