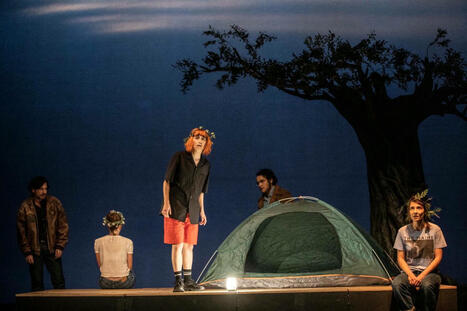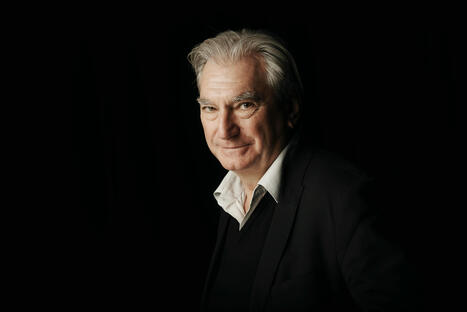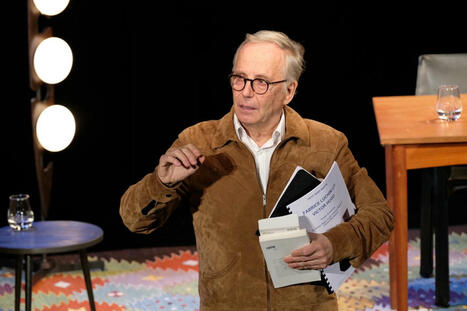Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 30, 2024 3:34 AM
|
Par Clément Ghys dans M le magazine du Monde - 30 nov. 2024 PORTRAIT En dix ans à la tête de la Comédie-Française, l’acteur, metteur en scène et scénographe a profondément transformé l’institution théâtrale. Fin connaisseur de la maison, il a su y apaiser les tensions, et a contribué à la dépoussiérer. A quelques mois de passer le flambeau d’administrateur général, il s’attaque à l’œuvre monument de Paul Claudel, «Le Soulier de satin ».
Lire 'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/11/30/eric-ruf-l-homme-qui-a-insuffle-un-vent-nouveau-a-la-comedie-francaise_6421510_4500055.html
Marina Hands a arrêté de fumer. Elle a également cessé de boire de l’alcool et de manger du sucre. L’actrice met toute son énergie pour préparer un marathon. Mais la course dans laquelle elle s’apprête à se lancer est d’un genre particulier, elle durera plusieurs heures. Sept heures trente exactement, sur la scène de la salle Richelieu de la Comédie-Française, à Paris. A partir du 21 décembre, la 542e sociétaire de l’institution sera Dona Prouhèze, l’héroïne du Soulier de satin, monumentale pièce de Paul Claudel datant de 1929. Des onze heures prévues par le texte intégral, le metteur en scène Eric Ruf en a gardé les deux tiers. L’action, un amour impossible au temps des conquistadors, se déroule sur vingt ans et sur plusieurs continents. Les dialogues évoquent la foi catholique et la recherche de l’absolu, la grandeur de l’art et le poids du péché. Ce sera dur. « Eprouvant, même, précise la comédienne. Il faut adorer le théâtre pour accepter une chose pareille. » Elle sourit : « C’est mon cas. » Avec elle, ils seront une vingtaine, débutants comme vétérans, à interpréter rois d’Espagne, grandes dames de la cour, suivantes, soldats et aventuriers… Tous vêtus par le couturier Christian Lacroix, tous impressionnés par cette œuvre tentaculaire et tous très fiers. Comme Birane Ba, 29 ans, dont la vocation est née quand, collégien en sortie scolaire, il était venu à la Comédie-Française. « Dans une vie d’acteur, on se dit qu’on ne jouera jamais Le Soulier de satin. Là, on atteint le Graal. » Pièce mythique du répertoire La pièce est si longue, si complexe à mettre en scène, qu’elle a rarement été montée. Un bon mot circule à son sujet, tantôt attribué à Jean Cocteau, tantôt à Sacha Guitry. Sortant d’une représentation du Soulier de satin, l’un des deux aurait lancé : « Heureusement qu’il n’y avait pas la paire. » La première a eu lieu dans le Paris occupé, en 1943 à la Comédie-Française, mise en scène par Jean-Louis Barrault, qui reprend la pièce quelques années plus tard, à l’Odéon. En 1987, Antoine Vitez marque les esprits au Festival d’Avignon et Olivier Py propose sa version au Théâtre de la Ville, en 2003. La pièce est un mythe du théâtre hexagonal, la baleine blanche des metteurs en scène. « Ecoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. » Le soir du 21 décembre, l’apostrophe de Claudel aux spectateurs lancera la course. En coulisses, Eric Ruf observera chaque détail. L’administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014 sait que ce Soulier marque une étape dans sa carrière. A 55 ans, l’acteur, metteur en scène et scénographe, sociétaire depuis 1998, vit ses derniers mois à la tête de l’institution. Le 4 août 2025, son mandat arrivant à son terme et la durée totale de sa mission ne pouvant excéder onze ans, il quittera son poste. Après une décennie à tenir le gouvernail de la plus vieille institution théâtrale française, Le Soulier de satin est sa bulle d’air, son bouquet final. Dans son bureau aux murs couverts du trombinoscope de la troupe et où le célèbre portrait de Molière en costume antique semble le surveiller, ses yeux de félin s’animent quand il parle de Claudel. Depuis ses années de jeunesse, quand, débarqué de Belfort, il avait intégré le Cours Florent après des études d’arts appliqués, il a « joué et rejoué, écouté et réécouté cette langue lumineuse et mystique, profonde et drôle ». Claudélien comme d’autres sont shakespeariens, il dit avoir eu l’idée de monter Le Soulier de satin au printemps 2021, alors que l’épidémie de Covid-19 avait fermé les salles. Une lecture intégrale de la pièce par plusieurs comédiens de la Comédie-Française a alors été filmée et diffusée sur YouTube. « Ça aurait pu être l’Odyssée, la Bible, la Torah ou le Coran… » La journaliste Laure Adler, grande connaisseuse du théâtre et admiratrice d’Eric Ruf, se réjouit de voir « ce grand metteur en scène se lancer dans un pari supposément impossible. Il en a les capacités, avec son sens inouï de l’apaisement et de la diplomatie ». Calmer les ego La paix. C’est ce qu’avait promis Eric Ruf en 2014. L’institution est complexe et son fonctionnement unique au monde. La troupe, colonne vertébrale de la Maison de Molière, comporte deux grades, les pensionnaires, aujourd’hui au nombre de 23, et, au-dessus, les sociétaires, actuellement 38. Ce sont ces derniers qui votent pour l’admission des premiers au rang de sociétaires. Les rivalités peuvent être tenaces. A l’administrateur général la charge de veiller au bon fonctionnement, de calmer les ego. Il s’agit aussi d’équilibrer la programmation des 900 représentations annuelles, d’organiser les agendas, d’alterner classiques du répertoire et auteurs contemporains. A cela s’ajoute la supervision des trois salles : Richelieu, place Colette, le Studio-Théâtre, situé dans le Carrousel du Louvre, toutes deux dans le 1er arrondissement parisien, et le Vieux-Colombier, dans le 6e arrondissement… Il faut aussi encadrer les 400 employés de la maison, divisés en plus de 70 métiers, dont beaucoup au sein des ateliers de décors et costumes. Au début des années 2010, la Maison de Molière vit un moment compliqué. Administratrice générale depuis 2006, Muriel Mayette-Holtz (nommée par Jacques Chirac en 2006 et renouvelée par Nicolas Sarkozy en 2011) est contestée par la troupe, qui lui reproche son interventionnisme et ses choix artistiques. Le Français n’a plus la cote dans le paysage du théâtre contemporain, assurent sociétaires et critiques. En 2014, à l’issue d’un pataquès digne d’un vaudeville qui a vu s’opposer les défenseurs de Muriel Mayette-Holtz et plusieurs candidats, le président François Hollande nomme Eric Ruf (sur proposition, comme il se doit, du ministre de la culture, à l’époque Aurélie Filippetti). S’ouvre une décennie de plus grande sérénité et de succès pour la Comédie-Française. L’héritage de Vitez Après vingt-trois ans d’absence, la troupe fait son retour dans la cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon, avec une adaptation du film Les Damnés, de Luchino Visconti, mise en scène par Ivo van Hove en 2016. D’autres grands noms du théâtre contemporain viennent monter des spectacles, comme les Français Julie Deliquet et Christophe Honoré, l’Allemand Thomas Ostermeier, la Brésilienne Christiane Jatahy. Récemment, en arrivant place Colette, Laure Adler a vu Eric Ruf accueillir les spectateurs. « La file d’attente était très longue et il passait de l’un à l’autre pour les rassurer, dire que cela n’allait pas durer. Eux ne le reconnaissaient pas, mais il tenait son poste, comme un artisan. » Le tableau en évoque d’autres, célèbres dans l’histoire du théâtre français : Peter Brook, qui, jusqu’à sa mort, en 2022, déchirait lui-même les tickets à l’entrée des Bouffes du Nord (Paris 10e) ; Ariane Mnouchkine, elle aussi systématiquement présente pour accueillir le public à l’entrée de la Cartoucherie de Vincennes, servant de la soupe après une représentation et remboursant les spectateurs si la pièce avait été mauvaise ; Antoine Vitez, obsédé par l’idée d’un « théâtre élitaire pour tous », écoutant les réactions du public à la sortie de Chaillot. Antoine Vitez… Ce sont ses traces qu’Eric Ruf essaie aujourd’hui de suivre. Mort en 1990 à l’âge de 60 ans, figure majeure du théâtre, connu pour avoir interprété les classiques de manière nouvelle, formé des générations d’acteurs et de metteurs en scène, son nom est encore omniprésent dans les conservatoires comme à la Comédie-Française (dont il a été l’administrateur de 1988 à sa mort). Ruf a monté en 2022 La Vie de Galilée, de Bertolt Brecht, trente-deux ans après Vitez, dans la même salle Richelieu. Et le voici qui dirige Le Soulier de satin, cette même pièce grâce à laquelle Vitez a, en 1987, bouleversé le public du Festival d’Avignon. Le comédien Marcel Bozonnet (administrateur général du Français de 2001 à 2006) revoit encore « les spectateurs, emmitouflés dans des couvertures, et, au lever du jour, les hirondelles qui s’envolent au-dessus des acteurs ». Eric Ruf, qui ne l’a pas vu à l’époque, en parle comme s’il s’agissait d’un épisode mythologique : « Les acteurs s’endormaient en coulisses, à même le sol. Il fallait les enjamber, comme des corps dans un champ de bataille, pour rejoindre les planches de la cour d’honneur. » Il s’inscrit à sa manière dans cette histoire. Pour le rôle de Don Pélage, le mari de Dona Prouhèze, qu’Antoine Vitez lui-même tenait en 1987, il a choisi Didier Sandre, qui, il y a près de quarante ans, était Don Rodrigue, l’amour impossible de Prouhèze. « Ce personnage est celui dont on me parle le plus, il n’a cessé de m’accompagner, confie le comédien au regard intense. Eric me fait un cadeau en m’offrant celui de Pélage, dont je découvre, des années après Antoine, la force. » Le théâtre est aussi fait de ces histoires intimes… La Dona Prouhèze d’Antoine Vitez, Ludmila Mikaël, est ainsi la mère de Marina Hands. « J’avais 12 ans, j’ai le souvenir précis d’être la seule enfant dans le public, raconte cette dernière. C’était vivant et c’était drôle. » Chef de troupe et mentor Comme son modèle autrefois, Eric Ruf fait aussi vivre des acteurs émergents. Ce qu’il était d’ailleurs lui-même à son arrivée dans la troupe, en 1993. « Des jeunes premiers aussi impressionnants, on n’en avait pas eu depuis bien longtemps », sourit Marcel Bozonnet. Aujourd’hui, pour le rôle de Rodrigue, il a choisi Baptiste Chabauty, entré à la Comédie-Française en novembre 2023 en tant que pensionnaire et qui s’apprête à jouer pour la première fois dans la salle Richelieu. « Et pas avec n’importe quel rôle ! C’est beau d’être, à peine arrivé, plongé dans une telle histoire du théâtre », sourit l’acteur à la longue silhouette et aux cheveux blonds décolorés – « Je ne les aurai plus dans Le Soulier, Eric me l’a demandé », précise-t-il.
Avec sa haute taille, son autorité naturelle, Eric Ruf joue à merveille le rôle de chef de troupe qui tente de désamorcer les moments de tension avec une blague. En répétition, ce jour d’octobre dans un sous-sol du théâtre, une expression de Claudel, « reprendre son âme », déstabilise les comédiens. « Je n’y comprends rien, s’amuse Eric Ruf. Est-ce qu’il y a des catholiques dans la salle ? » Surtout, il apprécie d’être un mentor. « Je m’adapte aux acteurs, explique-t-il. Marina, que je connais très bien, est comme un pur-sang pour qui je dois trouver le bon terrain. Avec Baptiste, c’est différent. » Il lui donne des conseils pratiques. « Dis le texte sans y penser, comme si tu récitais une formule mathématique. Deux plus cinq fois quatre plus cent divisé par six… » Baptiste Chabauty s’exécute. Le metteur en scène lui demande d’élever la voix : « Pense au public. Il est là depuis cinq heures, il s’endort. Il faut le réveiller un peu. » Même attention pour Edith Proust, la petite nouvelle de la troupe, entrée en avril. Elle joue la suivante de Dona Prouhèze. La jeune femme est impressionnée. « Mais je suis avec des pros, sourit-elle. Marina, une très grande dame du théâtre, m’emmène. Et Eric me guide. » Quand, au cours d’une scène, elle fait tomber une chaise, le metteur en scène fait une plaisanterie, comme pour la rassurer : « On va la laisser comme ça, on dira que c’est ma scénographie. » Des comédiens « bankables » au cinéma En dix ans, il a fait entrer de nombreux pensionnaires. Sa plus grande fierté est « l’ouverture à la diversité » : « C’est Marcel Bozonnet qui avait lancé cet élan révolutionnaire. Je l’ai suivi. Des acteurs noirs comme Birane Ba, Claïna Clavaron, Séphora Pondi ou Sefa Yeboah sont arrivés. C’est capital de les considérer comme ce qu’ils sont, d’excellents comédiens, et de leur donner des rôles classiques. » Ainsi de Birane Ba, qui s’apprête à jouer plusieurs rôles, dont celui du vice-roi de Naples. Il salive déjà à l’idée de ces moments où, assis en coulisses entre ses scènes, il ne perdra pas une miette des interprétations de ses camarades. Les jeunes assistent, fascinés, à l’aisance de leurs aînés. Ainsi de Serge Bagdassarian, sociétaire haut en couleur. Il répète une scène comique, puis décrit son costume : « Christian Lacroix m’a dessiné une gambas royale. C’est merveilleux. Mon chapeau ? Un Annapurna ! » Eclat de rire général.
Eric Ruf tient à faire de ces répétitions joyeuses le symbole de l’esprit apaisé qu’il a voulu insuffler à la Comédie-Française. Longtemps, la troupe s’est écharpée au sujet des « congés », ces moments accordés par l’administrateur général, au cours desquels pensionnaires et sociétaires allaient jouer dans d’autres théâtres ou dans des films. La direction doit trouver le bon dosage entre des absences à volonté, qui font exister la troupe par le biais de la mention « de la Comédie-Française » dans les génériques, et un agenda plus contraint, nécessaire à un bon fonctionnement. « Quand je suis arrivé, seule une poignée de sociétaires tournait des films. Aujourd’hui, ils sont partout », se réjouit Ruf. Certes, les grands noms (Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Michel Vuillermoz…) brillent, mais d’anciennes jeunes pousses ont réussi à se faire une jolie place : Benjamin Lavernhe, Sébastien Pouderoux… Au point que certains ont même quitté la Comédie-Française pour se consacrer au cinéma, tels Rebecca Marder, en 2021, et Laurent Lafitte, en 2024. Eric Ruf est ravi : « La troupe est bankable pour les directeurs de casting. » Quel successeur pour le « jardinier » Ruf ? Mais c’est une autre audition, très discrète, qui se joue en ce moment. Le Tout-Paris de la culture s’interroge sur le nom de son successeur, qui sera désigné par le locataire de l’Elysée. Le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet, proche du couple présidentiel, assure que « Brigitte et Emmanuel Macron sont des passionnés de théâtre et de la Comédie-Française ». « Ils s’y rendent souvent et le président suit de très près le dossier », dit-il. Selon l’usage, la nouvelle nomination devrait être annoncée peu de temps avant le départ d’Eric Ruf, soit au début de l’été. Dans les couloirs de la Comédie-Française ou à la terrasse du Nemours, café de la place Colette où la troupe a ses habitudes, on se perd en conjectures. L’acteur et metteur en scène Clément Hervieu-Léger, 47 ans, serait candidat et aurait les faveurs de la troupe. D’autres noms, qui ne sont pas issus du Français, circulent. Les questions se multiplient : Emmanuel Macron suivra-t-il, sur ce sujet précis, la proposition de la ministre de la culture, Rachida Dati ? Et écoute-t-il Guillaume Gallienne, l’une des rares personnalités culturelles présentes à son investiture, en mai 2022 ? Ou l’acteur et metteur en scène Christian Hecq, dont il apprécie le travail ? Eric Ruf, de son côté, se dit « prêt à donner son avis » au ministère ou à l’Elysée : « Je pourrais faire mine de ne pas vouloir savoir, mais nous avons la chance d’avoir une maison qui va bien. Autant en profiter pour que le tuilage se déroule correctement. » Il sait qu’à un moment « la tutelle [le ministère et l’Elysée] va me demander mon avis ». A-t-il un candidat en tête ? Il assure que non. Il se souvient de ses propres mots à François Hollande, lors de son entretien de candidature : « Vous avez le choix entre un jardinier et un paysagiste [Eric Ruf, donc, et le metteur en scène Stéphane Braunschweig]. Entre quelqu’un qui n’est peut-être pas révolutionnaire, mais qui connaît très bien le terrain, qui sait comment réagit l’humus, qui a l’historique des lieux, et un autre qui a une magnifique vision d’ensemble, mais qui risque de faire des erreurs avec les plantes. » Le pragmatisme l’avait emporté. L’époque est-elle la même ? Il ne répond pas, mais semble pencher pour qu’un « jardinier » – quelqu’un de la troupe – lui succède. Et donc, Clément Hervieu-Léger. « Par les temps qui courent, assure Eric Huf, Il faut savoir naviguer dans le monde politique, avoir quelques numéros de téléphone. Les montées de sève idéologiques, ce n’est pas nécessaire. » Sans le démentir, Laure Adler précise néanmoins : « C’est formidable que des jeunes metteurs en scène, des gens qui ont une vision nouvelle, candidatent à la Comédie-Française. Cela dit la vitalité de l’institution. » Jean-Marc Dumontet, adepte du « en même temps » macroniste, assure qu’il faut « mêler la tradition et l’audace ». Incertitudes budgétaires et politiques La réalité, elle, est incertaine. En avril, dans le cadre d’une baisse de crédits de 204 millions d’euros pour le ministère de la culture, la Comédie-Française s’est vue amputée d’une enveloppe de 5 millions d’euros, le budget de 24,6 millions d’euros devant être conservé pour l’année 2025. D’autres institutions parisiennes (l’Opéra, le Louvre, les théâtres nationaux de Chaillot et de la Colline, entre autres) ont également été affectées. Eric Ruf connaît « les coups de bambou des décisions budgétaires ». « La très grande déception » de ses mandats, comme il dit lui-même, aura été l’échec de la Cité du théâtre, ambitieuse opération lancée par François Hollande en 2016, visant à réunir sur le site des Ateliers Berthier (Paris 17e), le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, de nouveaux espaces pour le Théâtre national de l’Odéon (déjà présent dans les lieux) et une nouvelle salle pour la Comédie-Française. Le budget ayant explosé et les pouvoirs publics étant terrifiés par des accusations de parisianisme, le projet a été abandonné à l’automne 2023. « Je ne peux que souhaiter au Français d’avoir, enfin, cette nouvelle salle tant attendue. » En deux mandats, Eric Ruf aura vécu deux élections présidentielles, au cours desquelles Marine Le Pen a, à chaque fois, accédé au second tour. Lui-même a, à plusieurs reprises, évoqué la figure de son père, cardiologue à Belfort, homme de haute culture et adhérent du Front national (aujourd’hui Rassemblement national). En mai 2017, dans l’entre-deux-tours, il écrit dans Le Figaro une tribune où il raconte, « pour l’avoir vécu (intimement), ce que donneraient des générations nourries au lait empoisonné du Front national ». Il confie alors : « Mon père était un homme peu aimable, je l’ai aimé, je suis son fils, mais il m’a malheureusement légué une grande part de ses angoisses et de son incapacité au monde. (…) Mon métier, le théâtre, m’a sauvé. » En 2027, son successeur verra-t-il sa tutelle passer à l’extrême droite ? Place Colette, l’angoisse est la même que dans les autres institutions patrimoniales (Le Louvre, l’Opéra…), où l’on craint l’ingérence d’un pouvoir qui les instrumentaliserait et en ferait les modèles d’une culture française étroite et cocardière. Richelieu dans « Les Trois Mousquetaires » La dernière du Soulier de satin aura lieu le 13 avril. Quelques mois plus tard, Eric Ruf quittera Molière et son bureau. Il assure ne pas savoir ce qu’il va faire. Diriger un autre théâtre ? « Aucun ne vaut la Comédie-Française. » Il ne balaie pas l’idée de prendre la tête d’une école, d’une maison d’art lyrique. Devenu sociétaire honoraire au Français, titre prestigieux, il aimerait continuer d’y jouer et d’y faire des scénographies. Il voudrait faire plus de cinéma : l’exposition que lui a apportée son rôle du cardinal de Richelieu dans les deux volets des Trois Mousquetaires (2023), de Martin Bourboulon, n’est pas pour lui déplaire. Sur un mur qui jouxte le bureau de l’administrateur général, une plaque de marbre porte le nom de tous ceux qui ont dirigé la troupe, de Molière à Muriel Mayette-Holtz, Antoine Vitez inclus. Il n’y a plus de place pour aucun nom. Un panneau sera alors installé sur le mur d’en face, avec celui d’Eric Ruf inscrit en lettres dorées. Il sera en bois. « Le marbre, ça fait monument aux morts. Là, c’est une page qui se tourne et une autre qui s’ouvre. » Pour lui comme pour la troupe. Clément Ghys / Le Monde Légende photo : Eric Ruf Photo © BENJAMIN MALAPRIS POUR « M LE MAGAZINE DU MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2024 5:31 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 29 nov. 2024
Le plasticien et metteur en scène, dont la performance « Transfiguration » a fasciné le public du monde entier, à l’exception de la France, sera exceptionnellement à l’affiche du Samovar, à Bagnolet, le 2 décembre.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/29/avec-transfiguration-olivier-de-sagazan-defigure-des-visages_6419695_3246.html
Comment est-ce possible ? Shanghaï en Chine, Belo Horizonte au Brésil, Glasgow en Ecosse, Winnipeg au Canada… La liste des villes visitées par le plasticien et metteur en scène Olivier de Sagazan avec sa performance Transfiguration, créée en 1998, fait le tour du monde. Et plutôt deux fois qu’une. La vidéo sur YouTube de cette sidérante métamorphose mi-chair, mi-boue d’un homme en costard atteint 6,5 millions de vues. Curieusement, un pays semble résister à la fascination : le sien. Très peu de dates en France et une majorité dans des lieux confidentiels, dont le Silencio, à Paris, sur une invitation de David Lynch, et aucune reconnaissance institutionnelle pour cet artiste au geste sauvage. « Sur plus de 400 représentations, il y en a eu à peine une dizaine chez nous, précise Sagazan. Je pense que mon travail échappe au texte et au théâtre chers à la culture française, ainsi qu’au rationalisme à la Descartes qui est le nôtre. L’union du corps et de l’âme dans lequel je crois trouble beaucoup. » Questionner le visage Incroyable mais vrai, une soirée pointe son nez avant la fin de l’année. Lundi 2 décembre, Olivier de Sagazan sera à l’affiche du Samovar, un lieu modeste de quelque 120 places, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). « Il appartient au réseau FLAG, Festival et lieux des arts du geste, qui réunit des programmateurs qui me soutiennent, dont le Théâtre de Châtillon, indique-t-il. Heureusement, je donne de nombreux ateliers à des jeunes. Le paradoxe est qu’on parle souvent de mon travail sans savoir qu’on parle de moi. » Il cite différentes personnalités avec lesquelles il a collaboré, dont Mylène Farmer, le cinéaste Ron Fricke, le styliste Gareth Pugh ou le chorégraphe Wim Vandekeybus. En mode plus doux, il joue auprès du comédien David Wahl, qu’il enveloppe de 50 kilogrammes d’argile et de fleurs dans Nos cœurs en terre. « C’est toujours intéressant pour moi de voir comment Transfiguration se métamorphose au contact d’un texte, de la danse, de la mode, glisse-t-il. Même si c’est en quelque sorte une adaptation de la performance originale. » Vivre et revivre le choc de Transfiguration, sous-titré De la sainte-face à la tête-viande, n’altère pas son impact féroce. La première fois explose sans prévenir pendant le spectacle pour six interprètes intitulé La Messe de l’âne, présenté à la Biennale de la danse de Venise, en 2021. Pas loin d’un film d’horreur ou de science-fiction, mais sans effets spéciaux, cette fable déplie une guirlande de créatures et de monstres dont les museaux de glaise malaxés en direct se font et se défont d’un revers de main. « C’est ce que Beckett appelle l’innommable », souligne Sagazan, également lecteur passionné de Merleau-Ponty, Artaud, Kafka et Renaud Barbaras. Avec seulement de l’argile blanche, de la peinture noire et rouge « comme nos ancêtres dans les grottes », Olivier de Sagazan convoque la forme et l’informe. Il questionne le visage, ce masque, y pénètre, en fouille les orbites, le défigure. Il débusque la bête dans l’homme et inversement, s’amuse en joker balafré ou revisite Eraserhead, de David Lynch. « Je travaille à l’aveugle, décrit-il. Je disparais et me déconnecte du réel dans un état de transe jouissif. Je ne suis plus que dans le toucher, à la fois marionnette et marionnettiste, et je ne sais plus qui transforme qui. Le mouvement alors m’envahit. » Peinture, sculpture et danse ne font plus qu’un « dans ce bain originel, cette relation amoureuse avec l’argile ». Le philosophe Michel Surya nomme « humanimalité » cette performance durant laquelle Olivier de Sagazan devient sa propre œuvre d’art qui semble défier l’idée même de création, de magma. « Il y a cette fascination d’être au monde et de vouloir comprendre d’où vient le vivant apparu il y a quatre milliards d’années, explique Sagazan. C’est terrifiant comment on fait tous comme si de rien n’était, alors qu’on est apparu sur terre sans avoir la moindre explication. » D’où l’objectif de « rendre compte de l’étrangeté même d’être là en réveillant à travers des images fortes et inquiétantes la prise de conscience d’être en vie ». Transfiguration relie les différentes périodes d’Olivier de Sagazan. D’abord biologiste, il enseigne cette matière durant deux ans, de 1984 à 1986, au Cameroun. Juste avant de partir, il tombe sous le choc d’œuvres de Rembrandt. « Je suis resté des heures à contempler les visages qui possèdent une humanité incroyable, se souvient-il. Il y a une douceur et une bonté fantastiques dans leurs traits, tandis que la touche de Rembrandt est épaisse, avec beaucoup de matière et donne l’apparence de la chair véritable. » « Du Bacon en action » De retour d’Afrique, Olivier de Sagazan décide de devenir peintre. « Je devais être instituteur comme ma femme, Gaëlle, qui m’a encouragé à faire ce que je désirais. » C’est un constat d’impuissance devant une de ses sculptures qui le fait chavirer. En juin 1998, dans son atelier à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), il se désespère devant une figure « d’un mutisme terrible ». Il entreprend de se couvrir lui-même d’argile. Il se filme, puis prend sa douche sans regarder le résultat. Jusqu’au jour où l’une de ses cinq filles, Yoko – il est le père de la chanteuse Zaho de Sagazan et de la chorégraphe Leïla Ka –, lui dit qu’elle a vu « un truc bizarre sur la caméra vidéo ». Il jette un œil. « J’ai cru voir du Bacon en action. » Le rapprochement avec le plasticien irlandais, une autre de ses références, claque immédiatement. La sensation d’assister à l’arrachement à soi d’un personnage de Bacon dont le visage est trituré par ses multiples identités est de fait stupéfiante. « Certaines peintures de Bacon m’ont marqué à jamais car elles sont selon moi les représentations les plus efficaces et incroyables de cette tension entre le réel objectif et notre sentiment de solitude intérieure », confie-t-il. Si l’ensevelissement et la disparition ne font pas peur à Olivier de Sagazan, il a tout de même eu un gros frisson lors d’une répétition en août de sa nouvelle pièce, Y a quelqu’un ?. Il s’y enterre sous une tonne d’argile. « Je creuse un trou et je me glisse dedans », raconte-t-il. Sauf que la masse s’est effondrée et a failli l’étouffer. « Heureusement, j’avais gardé la tête à l’extérieur. » De ce glissement de terrain de 200 kilogrammes, il émerge au bout d’une dizaine de minutes. Plus de peur que de mal. L’Homme de boue, comme il se présente dans le film qui lui est consacré réalisé par Alexandre Degardin, veut bien l’être, mais en restant debout. Transfiguration, d’Olivier de Sagazan, le 2 décembre, au Samovar, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ; L’Homme de boue, d’Alexandre Degardin (Fr., 2024, 51 min), diffusé en replay sur France.tv ; Exposition Olivier de Sagazan, jusqu’au 28 février, au Salon Tout-Art, Paris 14e ; « Transfiguration », du 28 janvier au 1er février, au Théâtre et Centre culturel de Namur (Belgique) et exposition « De la sainte-face à la tête-viande », du 16 janvier au 22 février. Rosita Boisseau / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2024 3:49 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 28 nov. 2024 Bruno Geslin adapte le récit du voyage à pied du cinéaste et écrivain allemand entre Munich et Paris, «Sur le chemin des glaces», dans un soliloque exaltant porté par une composition musicale live. Le cinéaste et écrivain Werner Herzog n’est pas seulement à Beaubourg grâce à une rétrospective de ses films les plus rares tournés entre 2010 à 2020. Il n’est pas seulement rivé solitairement à sa table de travail en train d’écrire de futurs chefs-d’œuvre ou d’y songer. Il n’est pas seulement occupé à tacler les journalistes qui osent évoquer sa filmographie et non son œuvre littéraire. Il est aussi au théâtre, du moins l’un de ses récits les plus remarquables, Sur le chemin des glaces, journal d’une marche de 775 kilomètres entre Munich et Paris et en ligne la plus droite possible, pour conjurer le sort : rejoindre une amie, l’historienne et conservatrice à la cinémathèque Lotte Eisner, très malade, afin qu’elle ne meure pas. Elle ne mourra pas, ou seulement dix ans plus tard. Ce voyage, Herzog l’a réellement effectué, avec pour seule arme une boussole et une carte, dormant où il pouvait, sous un Abribus, une «roulotte» servant à entreposer le bois, des granges, coupant les virages pour éviter la «laideur» des routes fréquentées, bénissant sa casquette et maudissant «la Création» pour tant de «neige, neige, pluie-grésil, pluie-grésil». Martelant parfois cette question : «A quoi bon tout ça ?» Le texte envoûte. L’adaptation scénique qu’en propose Bruno Geslin est absolument fidèle en ce qu’elle provoque également un état d’hallucination mentale, d’oubli de soi, de voyage exténuant et existentiel, alors qu’on n’est jamais que sur un siège dans une salle assez confortable et chauffée. Eprouver l’expérience Sur le plateau, le soliloque incarné par Clément Bertani tient de la transe et du voyage intérieur. Quasiment pas d’éléments de décor, mais une musique en live jouée par Guilhem Logerot et Pablo Da Silva, légèrement surélevés. Des pulsations, le rythme d’un cœur qui bat de plus en plus fort, puis des harmonies jusqu’à devenir vocales et chantées. En guise de route, un tapis de marche, de ceux qui transforment les humains en hamsters dans leur roue. Un homme marche. Il marche dans le blizzard, le froid, la neige, les projections vidéo en noir et blanc l’englobent et le frappent tel un paquet de neige. Il marche à pas ininterrompu des journées durant, avec ce but précis et cette croyance irrationnelle que ses pas maintiendront en vie son amie. Ce trajet, Clément Bertani, Bruno Geslin et Guilhem Logerot l’ont fait, entrant dans les traces de Werner Herzog du 23 novembre au 23 décembre 2023. Eux aussi éclusant une trentaine de kilomètres par jour sous des conditions météorologiques diverses et rudes, quoique sans doute différentes. Eprouver l’expérience n’est pas une coquetterie. Elle permet de la rendre tangible au plateau. Werner Herzog avait déjà fait de multiples voyages à pied lorsqu’il entreprit ce périple fin novembre 1974. Alors dans la trentaine, il avait déjà tourné son film le plus connu, Aguirre ou la colère de Dieu avec son ennemi intime Klaus Kinski. Lotte Eisner, à l’époque, on ne la présentait pas : écrivaine, historienne de cinéma, conservatrice à la Cinémathèque française, amie d’Henri Langlois, mais aussi de Brecht et de Kurt Weill. Werner Herzog en était persuadé : si Lotte Eisner mourait, c’est tout le cinéma allemand et peut-être son renouveau – cette décennie 1970 voyant éclore les films de Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder et Volker Schlöndorff – qui disparaîtrait avec elle. Et aujourd’hui ? Quelle marche pour sauver quoi ? Sur le chemin des glaces d’après Werner Herzog mis en scène par Bruno Geslin les 28 et 29 novembre à Malakoff (Hauts-de-Seine), le 30 janvier à Pau, et les 5 et 6 février à Albi, les 26 et 27 mars à Douai (Nord). Suite de la tournée en construction. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Bruno Geslin a choisi un décor réduit pour son adaptation de «Sur le chemin des glaces» de Werner Herzog. ( © Sandy Korzekwa)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2024 5:22 PM
|
Reportage de Joëlle Gayot / Le Monde - 27 nov. 2024 RÉCIT Pour la première fois en soixante ans à la Cartoucherie, la metteuse en scène et directrice du Théâtre du Soleil a accepté d’ouvrir la porte des répétitions à la presse. Immersion dans les coulisses d’« Ici sont les dragons », sa nouvelle création jouée à partir du 27 novembre et inspirée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/27/avec-ici-sont-les-dragons-ariane-mnouchkine-sur-le-pied-de-guerre_6416612_3246.html
En soixante ans de présence à la Cartoucherie du bois de Vincennes, à Paris, jamais la metteuse en scène n’avait ouvert la porte des répétitions à la presse. Cette porte, nous la franchirons semaine après semaine avec d’autres visiteurs : classes de lycéens, amis de passage ou compagnons de route, comme l’autrice Hélène Cixous. Si cette dernière n’a plus écrit de pièces pour la troupe depuis Les Naufragés du fol espoir (2010), elle n’est pas absente pour autant. Conseils ou relectures, elle collabore « en harmonie » aux créations collectives. Fidèles au poste eux aussi, des collégiens venus et revenus en train de Bourgogne, qui, chapeautés par leur professeur de français, ont même dormi dans la place. « Madame Mnouchkine, s’exclame l’un d’eux, même lorsque la répétition est excellente, vous trouvez toujours des problèmes à résoudre. » Cette définition sur mesure du métier de metteur en scène déclenche l’hilarité. Ce mardi 1er octobre, la journée a été fructueuse. L’humeur est bonne. « C’est difficile le théâtre, mais c’est amusant », dit l’artiste avec un sourire. Ruche hyperactive Depuis septembre, par temps froid ou soleil vif, du petit matin jusqu’à la nuit tombante, nous avons donc suivi la fabrication du dernier-né de la troupe du Soleil, Ici sont les dragons. Première Epoque. 1917. La Victoire était entre nos mains. Après six mois d’une intensive préparation collective entamée le 1er avril, ce « grand spectacle populaire inspiré par des faits réels » (dixit le programme) sort du bois pour se montrer au public. Etayée par des événements historiques, portée par une forme puissamment théâtrale, la fresque découle en droite ligne de l’actualité : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. « Comment est-il possible qu’on ait laissé faire ? », s’est demandé Ariane Mnouchkine, bien convaincue que, pour comprendre la nature de l’agression, il fallait scruter de près la naissance des totalitarismes. « Nous aurions pu remonter à l’émergence de l’impérialisme russe, mais février 1917, qui acte la fin d’un monde et le début d’un autre – le nôtre –, s’est imposé. » Elle a donc restreint ses investigations à l’irruption du bolchevisme en Russie et renvoyé à une Seconde Epoque ses incursions vers la seconde guerre mondiale. En 1917, l’Allemagne mène la guerre. A l’ouest contre la France et ses alliés, à l’est contre la Russie que gouverne, pour peu de temps encore, le tsar Nicolas II (il abdique le 15 mars). Hitler est caporal sur le champ de bataille, quant à Lénine, il s’apprête à prendre le pouvoir, à plier la révolution sous sa botte et à tuer dans l’œuf l’utopie de la démocratie. « Pour pouvoir envisager qui est Vladimir Poutine, nous devions comprendre de quel ventre, encore fécond, il sortait », explique Ariane Mnouchkine. Le Théâtre du Soleil est devenu l’antre de ce ventre. Une ruche hyperactive où ressuscitent des protagonistes qui ont réellement existé et dont la mémoire a retenu (ou pas) les noms. Vladimir Ilitch Lénine, Léon Trotski, Alexandre Kerenski, Irakli Tsereteli ou encore Félix Dzerjinski : pour le meilleur ou pour le pire, tous ont pesé sur le cours de l’histoire. Quant aux femmes, « il ne manquerait plus qu’elles ne soient pas là », s’indigne la metteuse en scène, 85 ans, qui a pris soin de ne pas les invisibiliser. Toque sur la tête et col de fourrure, la comédienne Shaghayegh Beheshti promène sa silhouette d’aristocrate déchue et digne dans une rue reconstituée de Petrograd : « Je voulais, en évitant les clichés, être une femme qui incarne la perte d’un monde. Même si elle pense que la Révolution russe est celle de paysans, d’ouvriers et de domestiques analphabètes, elle ne maltraite pas sa bonne pour autant. » Un trio de comédiennes assume une narration poétique de la fable. Elles passent, repassent, hantent les lieux de leurs apparitions prophétiques. Repliée entre les gradins et la scène, derrière une table de régie, Hélène Cinque reprend une partition qu’elle connaît bien, pour l’avoir déjà jouée dans Une chambre en Inde (2016) et L’Ile d’or (2021). Elle est Cornelia, le double fictif de Mnouchkine, la clé qui relie passé et présent. Pratique du circuit court Le Soleil est un paquebot en surchauffe qui transporte à son bord 76 personnes dont les compétences s’articulent avec fluidité. Pas une pensée, un mot, un geste, qui ne converge vers le plateau. De 9 h 15 (heure à laquelle arrivent les équipes pour s’échauffer aux cours de Pilates) jusqu’à 18 h 30 (voire plus tard lorsque approche la date de la première publique), chacun sait ce qu’il a à faire. Veiller à la bonne marche de la maison : c’est la responsabilité du codirecteur, Charles-Henri Bradier. Assister la metteuse en scène : la mission d’Alexandre Zloto. Cuisiner et sonner la cloche lorsque le déjeuner est prêt : celle des chefs cuistots Karim Gougam et Azizullah Hamrah. Déménager, les jours de « chantier », le mobilier inutile qui regagnera l’entrepôt de stockage à Evreux. Repeindre les murs du hall d’accueil pour qu’ils concordent avec la période et le thème traités. Poncer, percer, enduire, souder. De la menuiserie : poussés sur des châssis à roulettes sortent des façades, des palissades, des bunkers enneigés, des guérites, des canapés, des trains et même des encolures de cheval. Concepteur des décors, David Buizard en a construit une dizaine dont certains serviront pour la Seconde Epoque encore en gestation : « Je pars des croquis de Sibylle Pavageau, je dessine les volumes, je bâtis le décor, Eléna Antsiferova le patine avec des couleurs ou des matières. Une fois l’élément validé par Ariane, il repart en peinture. L’atelier est un bel outil qui nous permet de gagner un temps fou. » Au Soleil, la pratique du circuit court démontre, en temps réel, son efficacité. A peine la metteuse en scène regrette-t-elle l’absence d’un réverbère qu’il surgit des coulisses. A peine suggère-t-elle d’agrandir une palissade que celle-ci gagne de l’envergure. Personne ne procrastine, et les problèmes, autant que faire se peut, sont résolus dans le quart d’heure. « Lumières, sous-titres, vidéo, jeu, costumes, textes… Ariane règle tout en même temps. C’est un travail total qui évite les pertes de temps », témoigne Arman Saribekyan. Droit devant son micro sur pied, cet acteur bilingue profère, en russe, des mots que les comédiens en scène (qui restent mutiques de bout en bout, Hélène Cinque excepté) n’ont pas à prononcer. Ils en savent pourtant le contenu sur le bout de leurs doigts. Le spectacle est donné en version originale sous-titrée. Anglais, allemand, français, russe, ukrainien, les paroles qui résonnent sont préenregistrées dans les langues originelles. « Il ne s’agit pas vraiment de play-back, nuance Duccio Bellugi Vannuccini, un pilier historique de la troupe, mais d’un jeu avec nos personnages. Nous travaillons la musicalité. Nous ne sommes pas dans le quotidien. Le corps doit raconter ce que dit la voix, la voix doit dire ce que raconte le texte. » Un exercice de haute voltige que décuple le port des masques (une tradition à laquelle le Soleil ne déroge pas). Marionnettes consentantes, les acteurs sont les hôtes d’altérités qu’ils adoptent au point que les identités se confondent. C’est après bien des tâtonnements et des ajustements que s’épanouissent les personnages. « Les masques sont capricieux. Il faut les observer, les étudier, fraterniser avec eux pour qu’à leur tour ils guident les comédiens. Ils sont nos maîtres », note Arman Saribekyan. Savoir historique Quelques-uns de ces « maîtres » sont conçus par l’équipe de Xevi Ribas. Un commando perché sur une mezzanine à deux pas de la cantine, et qui manie à tour de bras la résine et le silicone. Mais le nec plus ultra des masques (ceux que portent les têtes pensantes de la révolution) surgit des mains d’Erhard Stiefel. Collaborateur du Soleil depuis 1975, le sculpteur suisse n’exerce pas sa créativité au cœur du réacteur. Il opère dans une pièce chaleureuse qui jouxte l’atelier costumes. Le bâtiment, une longue nef blanche, est replié à une centaine de mètres de la maison mère, « et c’est tant mieux, car, là-bas, c’est l’enfer alors qu’ici on travaille au calme ». Les ciseaux de Marie-Hélène Bouvet claquent sous ses doigts habiles. Patrons, découpes et retouches… la couturière improvise avec les moyens du bord. Les uniformes de militaires sont taillés dans de la peau de chameau. La tunique des cosaques ? Des robes de curé customisées par une cape et une toque. « Rien ne se perd, tout se récupère » : telle est la devise des costumières qui gagnent la répétition d’un pas vif pour « savoir ce qu’y dit Ariane » et réagir en conséquence. Autonome, engagée et responsabilisée, l’équipe au grand complet ne se démobilise jamais. Depuis des mois, les comédiens compulsent des ouvrages historiques et affinent leur connaissance de l’année 1917. Les livres s’entassent dans les loges entre miroirs, poudriers et perruques. Ils colonisent la salle d’étude propice aux cogitations communes. Lénine, l’inventeur du totalitarisme russe, de Stéphane Courtois, Pensées intempestives. 1917-1918, de Maxime Gorki, Mémoires de la grande guerre, de Winston Churchill… impossible de citer tous les titres. Et c’est compter sans les annexes documentaires dont regorge la « marmite », un espace de ressources en ligne qu’alimente l’acteur Sébastien Brottet-Michel, rompu, comme ses camarades, à une étourdissante polyvalence des tâches à mener. Les 32 comédiens de la troupe planchent en universitaires et enquêtent en journalistes. Ils ingèrent et digèrent un savoir historique appelé à devenir matière artistique. A eux de transformer la théorie en théâtre et de donner du corps à l’idéologie. A eux d’extirper des pages imprimées la foule d’individus, le flux de propos et le flot d’actions que nécessite la représentation. Dans Ici sont les dragons, pas un propos ne relève de la pure fiction. Discours politiques, courriers intimes, invectives urbaines, tractations de bureau : tout ce qui se proclame sur le plateau a déjà été dit ou écrit à un moment précis de l’histoire. Tout peut donc être sourcé : « La vérité des faits a été trop trahie. Cette histoire est celle d’un mensonge de dimension planétaire dont nous subissons encore les conséquences », affirme Ariane Mnouchkine. « Fabriquer des micropièces » Ce processus de travail a ses règles. Parmi celles-ci : le « concoctage ». Un néologisme cousu main pour désigner un temps d’incubation qui peut prendre des jours ou des semaines. Solitaires ou en bande, les interprètes activent leur imagination. Un œil sur la réalité des faits, l’autre sur les possibles de la représentation, ils échafaudent des séquences de jeu qui étaieront la mise en scène en respectant la trame donnée par Ariane Mnouckhine. Quel personnage étoffer, quelle ligne narrative déployer ? Leaders ou seconds couteaux, paysans ou ouvriers, dialogues ou monologues : leurs idées deviennent des visions, et leurs visions des propositions. Cooptée lors d’un stage, en avril, Elise Salmon, qui a laissé derrière elle une carrière d’orthophoniste pour devenir actrice, explique la méthode : « Nous fabriquons des sortes de micropièces avec amorces de costumes, de lumières et de décors. Dans l’idéal, elles développent un enjeu, des états forts, des relations entre les personnages, une dynamique, une musicalité. Nous travaillons ces propositions entre nous avant de les présenter à Ariane. » C’est Mnouchkine seule qui a le « final cut ». Pas une image n’apparaît au public qu’elle n’ait, au préalable, améliorée et validée. Pas une phrase énoncée qu’elle n’ait supervisée. Tôt le matin et tard le soir, seule devant son ordinateur, elle examine le manuscrit de la pièce, pourchasse ses approximations, affine ses transitions et va jusqu’à traquer les virgules superflues. Début octobre. L’équipe fait face à une impasse. Que s’est-il passé exactement en Russie d’avril à octobre 1917 ? « Cette séquence nous pose des problèmes », témoigne le comédien aguerri Maurice Durozier : « Le déroulé des événements est confus, nous ne savons pas comment les raconter. Nous devons trouver une solution théâtrale pour ne pas perdre le fil de l’histoire. » Invité dans la salle d’étude, l’historien Stéphane Courtois fournit des éclaircissements. Deux heures d’échange à l’issue desquelles une piste semble se dessiner : « Ce fameux trou, conclut Mnouckhine, nous pourrions sans doute l’entreprendre par le biais de témoins français, afin que ce soit eux qui nous guident à travers le labyrinthe de la politique russe. » Substance souterraine Pas le choix, il faut reprendre son bâton de pèlerin. Lire, réfléchir, concocter. Le résultat est là. 17 octobre à 14 heures : neuf propositions sont sur le feu. « Mais c’est Noël », s’exclame, ravie, la cheffe de bande. « Les acteurs ont pensé que c’était leur dernière chance d’avoir une scène », lui répond du tac au tac la régisseuse (et actrice) Aline Borsari. Le fait est : si certains comédiens sont très bien distribués, d’autres n’auront pas cette chance. « On sait qu’on est au service d’une œuvre collective, nos ego doivent être placés au bon endroit », rappelle, fort de sa longue expérience, Vincent Mangado. Le narcissisme n’a pas sa place dans les murs. Engagé au printemps, Jean Schabel avait peaufiné pied à pied une séquence finalement rejetée, car devenue caduque : « J’espérais jouer l’un des concepteurs des fours crématoires. La seconde guerre mondiale n’étant plus au programme, j’ai dû renoncer. Une fois passée la frustration, j’ai compris qu’il me fallait lâcher prise sur mon désir d’être au premier plan. Ici, j’apprends à ne pas focaliser sur moi-même. »
Ces tentatives avortées ne sont pas renvoyées au néant. Qu’elles soient exploitées ou pas dans la Seconde Epoque, elles forment d’ores et déjà la chair d’Ici sont les dragons. Une substance souterraine qui irrigue les muscles et l’esprit de cette première période. « Tout est utile, plaide Ariane Mnouchkine, sauf les scènes au cours desquelles l’acteur succombe au désir de se trouver un rôle plutôt que d’apporter du sens au spectacle. » Ballet millimétré Les propositions s’enchaînent sous son regard intraitable, mais toujours bienveillant. Cinq heures quasi ininterrompues de remarques, de critiques et d’encouragements. Pas une seconde, son exigence ne faiblit : « Je n’écoutais plus, je regardais le réverbère, ce qui n’est pas bon signe », dit-elle en soupirant. L’œil collé à sa caméra, Lucile Cocito filme l’intégralité de ce qui se passe. « Toutes les séances sont chapitrées, numérotées et ordonnées. Les comédiens et Ariane s’en servent pour retravailler les scènes. » Dissimulée derrière un moucharabieh, la musicienne Clémence Fougea improvise. Quelques notes de piano, le grondement d’un orage, le souffle du vent. Cette jeune artiste a pris la relève du compositeur historique Jean-Jacques Lemêtre. De sa cabane à musique, elle a, dit-elle, le « nez rivé sur le plateau. » Hors de question de plaquer une partition qui figerait l’influx nerveux de la scène. « J’écoute les indications d’Ariane. Son ton, le sentiment et les couleurs qui traversent sa parole, tout ce qui vient d’elle m’inspire. » Début novembre. Aussi oppressant qu’insidieux, le tempo s’accélère, la troupe est sur le pied de guerre : « Le compte à rebours a démarré. Nous allons devoir passer des heures à régler les entrées et les sorties, à apprendre à déplacer les décors sans un bruit. » Les bout-à-bout (premières ébauches de représentation) se suivent au pas de charge, bientôt remplacés par des séries de filages durant lesquelles les comédiens jouent le spectacle en intégralité. Les bunkers, les chevaux, les palissades, glissent en souplesse du plateau aux coulisses, où le décor valse, dans le silence ; un ballet millimétré. « Les enfants, ne vous faites pas mal, ne vous énervez pas », implore, maternelle, Ariane Mnouchkine. « Ce toit est sacré. Si vous voulez vous engueuler, allez le faire sur la pelouse. Nos problèmes personnels et nos rages n’ont pas à abîmer notre bien commun. »
20 novembre. Dernière ligne droite avant la première. Malgré les nuits trop courtes, les doutes et l’angoisse, elle garde le cap : « Vilar disait de la répétition qu’elle était l’orgasme de l’esprit. Je tiens avec passion. Je tiens avec plaisir. Il y a dans la troupe ce qu’il faut de jeunesse pour qu’on ait l’énergie et ce qu’il faut d’âge pour qu’on ait la sagesse et la civilité. » Le hall d’accueil est en ordre de marche. Les loges ont rejoint leur habitacle de toujours en dessous des gradins. Chacun, ici, sait ce qu’il a à faire. A commencer par la maîtresse des lieux qui, le 27 novembre, frappera trois coups sur la porte d’entrée, l’ouvrira en grand au public et déchirera les billets. Ainsi le veut la tradition. Loués soient les rituels qui font qu’existe le Théâtre du Soleil. Ici sont les dragons. Première Epoque. 1917. La Victoire était entre nos mains. Une création collective du Théâtre du Soleil, dirigée par Ariane Mnouchkine, en harmonie avec Hélène Cixous. Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e. Du mercredi au vendredi à 19 h 30, le samedi à 15 heures, le dimanche à 13 h 30. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Ariane Mnouchkine, lors des répétitions de sa pièce « Ici sont les dragons », au Théâtre du Soleil, à Paris, le 23 octobre 2024. CHLOE SHARROCK / MYOP POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 26, 2024 8:05 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 26 nov. 2024 Très liée au metteur en scène qui la dirigea à quinze reprises, l’actrice s’était faite rare au théâtre depuis le début des années 2010. Elle est morte le 24 novembre, à 76 ans. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/11/26/la-mort-de-jany-gastaldi-comedienne-emblematique-du-theatre-d-antoine-vitez_6415675_3382.html Née en mai 1948, la comédienne Jany Gastaldi, que le metteur en scène Antoine Vitez a dirigée à quinze reprises de 1971 à 1987, est morte, le 24 novembre, à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer. L’actrice s’était faite rare sur les planches. Depuis 2011 et son rôle de Philaminte dans Les Femmes savantes, de Molière (mise en scène de Marc Paquien), elle n’était plus sollicitée. Quelques enregistrements de fictions pour la radio, une voix off en 2024, dans Palais, un montage de textes proposé par Matthieu Marie, voilà tout. « Pour beaucoup d’entre nous, elle était la Doña Sol d’Hernani et la Doña Musique du Soulier de satin. Deux rôles inoubliables, témoigne Marc Paquien. Mais la nouvelle génération d’artistes, qui ne la connaissait pas, ne l’avait vue ni dans le drame de Victor Hugo [1985] ni dans celui de Paul Claudel [1987], est passée à côté d’elle. » Quel dommage de s’être privé de cette voix singulière au phrasé sensuel et chantant, de ce regard coquin sous la tignasse brune, de ce corps pas bien grand, d’une énergie saisissante, de cette présence intense et offerte ! Saluée en 1990 d’un Prix de la meilleure comédienne décerné par le Syndicat de la critique, Jany Gastaldi ne boudait pourtant pas le théâtre, contemporain ou classique. Dans sa biographie, les noms d’auteurs en disent long sur un appétit de jeu éclectique. Michel Vinaver, Philippe Minyana, Botho Strauss, Jean Genet y côtoient le fin du fin du répertoire : Shakespeare, Beaumarchais, Corneille et aussi Marivaux, travaillé, en 1973, avec Patrice Chéreau, qui la dirige dans La Dispute. « Nature de tragédienne » Dès 1971, dans Le Monde, Bertrand Poirot-Delpech soulignait en quelques lignes serrées l’évidence du talent de l’actrice. La débutante, 23 ans seulement, vient de rallier les plateaux d’Antoine Vitez, qui a été son professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Distribuée dans le rôle d’Hermione (Andromaque, de Racine), elle révèle déjà, selon Bertrand Poirot-Delpech, « une nature de tragédienne, à la fois frêle et tenace, tout en nerfs et déjà très maîtrisée ». Tragédienne, c’est vrai, elle l’était, mais aussi malicieuse, ironique, aimant rire et faire rire. « Il ne faut pas oublier à quel point elle savait être drôle », insiste Marc Paquien. Avec Vitez, le compagnonnage est exemplaire. Elle est de toutes ses aventures. Jany Gastaldi le suit au Festival d’Avignon, où elle arpente trois des quatre pièces de Molière qu’il déroule dans un marathon de légende (Dom Juan, Le Misanthrope, Le Tartuffe, 1978). Plus tard, elle participe à la création (tout aussi iconique) du Soulier de satin (1987). Une traversée de la nuit sous les étoiles de la Cour d’honneur du Palais des papes, qui la voit pour la seule fois de sa vie s’attaquer à la prose de Claudel. A Paris, elle est une figure familière du Théâtre national de Chaillot, que Vitez dirige de 1981 à 1988. Faust, de Goethe, Britannicus, de Racine, Tombeau pour cinq cent mille soldats, de Pierre Guyotat, mais aussi Hamlet, de Shakespeare, Le Prince travesti, de Marivaux, pas une saison sans Gastaldi en scène. Sur les réseaux sociaux, parmi un flot d’hommages émus, les mots du scénographe de Vitez, Yannis Kokkos, ramassent des éclats de souvenirs : « Sa grâce, sa voix, son talent ont enchanté les années Chaillot sous la direction d’Antoine. Vision aérienne de sa descente des escaliers d’Hernani, scène de la folie d’Ophélie dans Hamlet, Doña Musique enchantée, proue inoubliable dans Le Soulier de satin à Avignon, Catherine, la muette déchirante, dans Mère Courage, aux Amandiers, Nina dans le film de René Féret, Fernand, et tant d’autres interprétations inoubliables. » Invitée sur France Inter en 2011, Jany Gastaldi confiait que vivre une vie de comédienne, c’est faire des adieux aux rôles qu’on ne jouera pas. Sa voix s’est tue, mais on peut lire d’elle un superbe et ultime entretien mené par Marion Chénetier-Alev, pour la Revue d’histoire du théâtre. Elle y parle d’elle et de théâtre, et ses propos sont lumineux. Jany Gastaldi en quelques dates Mai 1948 Naissance à Monaco 1971 Première collaboration avec Antoine Vitez dans « Andromaque », de Racine 1973 Comédienne dans « La Dispute », mise en scène de Patrice Chéreau 1987 Dernier rôle sous la direction de Vitez : Dona musique, dans « Le Soulier de Satin » 1990 Prix de la meilleure comédienne du Syndicat de la critique, pour son rôle dans « Phèdre » (mise en scène de Daisy Amias) 24 novembre 2024 Mort
Joëlle Gayot / Le Monde
Légende photo : Jany Gastaldi, dans les studios de l’ORTF, à Paris, en 1971. KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-RAPHO -------------------------------------------------------------------
Commentaire de Mathilde Labardonnie (Facebook)
Troublant comme sous cette neige et avec ce châle, elle (m'ap)parait avoir comme une lointaine ressemblance avec Madeleine Renaud. Impression fugace, un peu balourde. Une Jany Gastaldi inhabituelle. Jamais la même: sa force. Funambule sur le fil de sa voix rien qu'à elle, inimitable, difficile à décrire.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 26, 2024 2:19 AM
|
Arts visuels et de la scène, musique et cinéma : à travers son dispositif, la région Ile-de-France accompagne les artistes émergents locaux. Sept lauréats racontent à «Libération» ce que ce coup de pouce a changé pour eux. Quand Maryse Estier se résout, en 2017, à implanter sa compagnie de théâtre en Ile-de-France, elle a conscience du caractère peu stratégique de sa décision. «Difficile, pour les jeunes artistes, de se démarquer dans une région qui fourmille de propositions culturelles concurrentielles, reconnaît cette comédienne et metteuse en scène qui a grandi et travaillé en Suisse, puis en Belgique. Mais je sortais de l’Académie [formation professionnalisante d’un an proposée par la Comédie-Française, ndlr], je réalisais mon rêve de gosse d’habiter à Paris et je n’avais pas d’autre ancrage territorial en France. Quand m’a été offerte l’opportunité de baser le siège social de ma compagnie dans le Val-de-Marne, j’ai accepté.» En 2019, alors qu’elle travaille à monter l’Aiglon, pièce d’Edmond Rostand largement éclipsée par son Cyrano de Bergerac, elle répond à l’appel à projets lancé par le dispositif FoRTE (Fonds régional pour les talents émergents), financé par la région Ile-de-France. Et décroche une subvention de 40 000 euros, impulsion essentielle à ce projet de grande ampleur. Depuis 2018, FoRTE propose ainsi de soutenir chaque année une promotion d’une quarantaine de jeunes artistes issus des arts visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, de la musique ou encore des arts de la scène. A ses lauréats, «talents émergents» âgés au maximum de 30 ans, le dispositif promet, pendant dix mois, une aide financière (un million d’euros au total), mais également un accompagnement professionnel. Chef d’orchestre formé en musique baroque et joueur de viole de gambe, Valentin Tournet a candidaté à la première édition, après des études au Conservatoire national supérieur de Paris. «J’avais 22 ans, et cette bourse de 25 000 euros m’a permis d’enregistrer mon premier disque, Chefs-d’œuvre oubliés, raconte-t-il. En me permettant de financer un certain nombre de dépenses à la fois artistiques, techniques et promotionnelles, ce coup de pouce a été absolument décisif.» Ce premier enregistrement est suivi d’autres, et, en 2022, Valentin Tournet est nommé dans la catégorie «soliste instrumental» des Victoires de la musique classique. Cet été, l’ensemble instrumental et vocal qu’il dirige, La Chapelle Harmonique, a aussi remporté son premier Diapason d’or, prestigieuse récompense de la musique classique en France. «Une chance inouïe» «Précieuse», «ambitieuse», «généreuse» : les anciens lauréats rivalisent de louanges pour qualifier cette bourse qui a, pour l’écrasante majorité d’entre eux, fait décoller leur carrière. «Peu de structures donnent autant à un seul artiste : en choisissant ce ciblage, FoRTE aide vraiment ceux qui sont sélectionnés», analyse Valentin Tournet. Maryse Estier abonde : «Qu’une compagnie non conventionnée, avec seulement un projet à son actif, reçoive 40 000 euros, c’est une chance inouïe !» La démarche de candidature, qui associe nécessairement un artiste et une structure d’accompagnement, peut être présentée sous forme d’une demande de bourse individuelle ou d’une subvention à la structure : un choix d’options qui permet de s’accorder au mieux aux modalités des différentes disciplines, dont les fonctionnements varient énormément. Ainsi, les postulants en cinéma, milieu habitué des circuits de subvention, entre Centre national du cinéma (CNC) et régions, font généralement la demande au titre d’une structure. C’était en tout cas le choix d’Isis Leterrier l’an dernier. «C’est mon producteur qui m’a conseillé de candidater, car la boîte avait déjà reçu ce genre d’aide, raconte-t-elle. Nous travaillions alors à une série d’animation intitulée Saisons d’oiseaux, et nous avons postulé pour créer l’épisode pilote. L’argent a permis de financer l’installation, le matériel, et la série est désormais en phase de développement final avec France Télévisions.» Beaucoup de postulants ont plutôt eu vent de l’existence de FoRTE par le bouche à oreille ou encore via les réseaux sociaux. L’artiste-compositrice Gabi Hartmann a, par exemple, été renseignée par une amie cinéaste qui lui a précisé que le dispositif concernait aussi les musiciens. La guitariste et chanteuse a déjà un EP à son actif, financé par ses propres moyens, elle souhaite à présent sortir un véritable album. Qu’elle ait investi ses économies dans son travail préliminaire n’est pas un problème pour candidater : FoRTE juge sur projet et ne tient aucunement compte de critères sociaux. La nationalité française n’entre pas non plus en jeu – les étrangers sont même largement encouragés à candidater. C’est ce qu’a fait Odonchimeg Davaadorj, qui a quitté sa Mongolie natale à 17 ans pour la République tchèque, avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris. C’est aussi via les réseaux sociaux qu’elle a entendu parler de cette opportunité de faire acte de candidature et d’être potentiellement choisie. Elle qui souhaite devenir peintre, un rêve jusqu’ici hors de portée faute de fonds, avait alors juste l’âge limite : «Grâce à la bourse, j’ai pu investir dans le matériel adéquat, notamment des grandes toiles de 2 mètres par 1,8, explique-t-elle. Cette expérience a confirmé mon intérêt pour cette technique, que je pratique toujours, dans de plus petits formats que j’arrive maintenant à vendre.» «Aller plus loin» Djabril Boukhenaïssi a appris l’heureuse nouvelle à la rentrée : il figure dans la liste des lauréats de l’édition 2024 pour son projet de gravures sur la guerre d’Algérie, en partenariat avec le musée de l’Histoire de l’immigration. Chaque année, à la fin des dix mois impartis, les productions des créateurs sélectionnés en arts visuels sont présentées aux Réserves du Frac (Fonds régional d’art contemporain), à Romainville (Seine-Saint-Denis) : l’exposition de la promotion 2023, qui débute le 30 novembre, va durer jusqu’au 18 janvier. L’hiver prochain, le travail de cet adepte du pastel y sera donc présenté. Les lauréats des autres disciplines peuvent, quant à eux, dévoiler des extraits de leur travail à l’occasion d’une soirée événement : celle de la sixième promotion a lieu ce 28 novembre à l’Opéra Bastille, à Paris. Ce qui est indispensable pour candidater, c’est un ancrage en territoire francilien : les postulants doivent résider et créer en Île-de-France. Et si certains ne font que passer, d’autres, comme Sébastien Kheroufi, sont là depuis toujours. Ce metteur en scène prometteur a grandi entre une cité des Hauts-de-Seine et un foyer du XXe arrondissement de Paris, à l’écart de toute offre culturelle. Il quitte l’école en classe de quatrième pour bifurquer en BEP, enchaîne «galères et bêtises», et croise la route du théâtre par hasard à l’occasion d’un séjour en Angleterre où il faisait des ménages dans un cinéma et s’y glissait régulièrement pour assister aux séances du matin. «Comme je comprenais mal l’anglais, j’étais surtout attentif au jeu, au décor, à la lumière, raconte-t-il. A mon retour en France, je me suis inscrit à un cours de théâtre municipal : c’est là qu’on m’a convaincu d’aller plus loin.» Il se décide à tenter les concours des écoles nationales «mais seulement parisiennes, pour rester près de ma mère». Ce sera donc l’Esad (Ecole supérieure d’art dramatique), en plein cœur de la capitale, qu’il intègre grâce à sa performance du personnage de Hans dans le texte imposé, tiré de Par les villages, de Peter Handke. «Je ne connaissais rien à l’histoire de Handke, mais je comprenais qu’il parlait de nous, les humiliés, les laissés-pour-compte. Ce texte n’a cessé depuis de m’accompagner.» Et c’est effectivement à nouveau grâce à ce texte qu’il a décroché la bourse FoRTE, accompagné par le Théâtre des Quartiers d’Ivry (Val-de-Marne), le centre Pompidou et L’Azimut de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Dans le cadre du Festival d’automne, une «re-création» de la pièce est prévue en janvier et février : Par les villages est d’ailleurs le dernier spectacle qui se jouera au centre Pompidou avant sa fermeture pour travaux. «Sentiment de légitimité» Développement du réseau, de la visibilité, de la confiance en soi… Pour Sébastien Kheroufi, FoRTE n’est pas qu’une bourse, c’est une validation. «J’ai crié de joie en apprenant la nouvelle, sourit-il. Et pas que pour l’argent : être choisi par un jury spécialisé et pouvoir, à mon tour, intégrer un monde d’exigence artistique m’a donné un immense sentiment de légitimité. Cela a aussi crédibilisé la compagnie tout juste créée, rassuré les partenaires, appuyé nos démarches ultérieures.» Gabi Hartmann témoigne elle aussi d’une grande émotion lors de la soirée de présentation en rencontrant d’autres lauréats dont elle apprécie le travail et auxquels elle se sent désormais reliée. «Que la somme soit octroyée directement à l’artiste donne un sentiment de force inouï, atteste-t-elle. J’ai gagné en assurance, cessé de tergiverser : quand il n’y a qu’un an pour créer un projet, il faut y aller !» La dimension psychologique de ce soutien se révèle donc particulièrement appréciée par de jeunes artistes souvent ébranlés par des conditions de travail éprouvantes, véritables freins à la création. «L’accompagnement, pourtant indispensable, fait encore défaut. Or, c’est souvent quand on a été mal accompagnés qu’on échoue, analyse Sébastien Kheroufi. Et c’est là que FoRTE marque une différence : les interlocuteurs sont présents dès les premières explications administratives et le restent bien après la fin du projet.» Gabi Hartmann salue aussi une structure flexible, qui s’ajuste en fonction des besoins de chacun : «Il n’y a pas de pression, d’attentes ou de comptes à rendre. Un coup de fil pour présenter le fonctionnement et le calendrier, une réunion de lancement et, si on le souhaite, les choses peuvent en rester là.» «La Région est très attentive à ce que les lauréats mènent à bien leurs projets et dans les meilleures conditions. Aussi, nous suivons leur progression tout au long des dix mois d’accompagnement, et après, afin de valoriser leurs œuvres dans le cadre du grand évènement annuel de restitution », complète Elsa Martin, cheffe du service Création-Diffusion de la Région, qui chapeaute le dispositif FoRTE. La diversité des profils et des projets soutenus témoigne surtout d’une vraie volonté d’éclectisme. En arts de la scène, Maryse Estier a obtenu les fonds pour un projet qu’elle décrit comme «hors normes et hors mode» : l’Aiglon de Rostand est une pièce en six actes écrits en alexandrin, qui narre, en quatre heures et cinquante personnages, les dernières années de la vie du fils de Napoléon Ier. En cherchant à la monter, elle s’est heurtée à une «exigence de modernité» qu’elle trouve «omniprésente» dans les structures et festivals dédiés à la jeune création. «En promouvant un théâtre très contemporain et des projets basés sur l’écriture de plateau, ces dispositifs excluent des démarches comme la mienne qui souhaite, au contraire, remettre au goût du jour des textes anciens pour les faire résonner», regrette-t-elle. En lui ouvrant une porte, les jurys FoRTE assument le grand écart entre Napoléon II et Hans, le transfuge de classe de Peter Handke. Comme entre les accents baroques d’une viole de gambe et les rythmes de guitare bossa-nova. Légende photo : Mise en scène de «l’Aiglon» par Maryse Estier. (Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2024 4:42 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 25 nov. 2024 L’actrice Jany Gastaldi s’est éteinte victime d’un cancer. Elle restera comme un astre à part de la planète Vitez. Belle, légère, promenant son corps d’elfe et sa voix céleste dans les plis du théâtre le plus haut.
C’était Jany. Une actrice. Aussi frêle que fascinante, aussi vibrante qu’émouvante. Un corps d’oiseau, une voix d’ange. Elle paraissait... vous étiez envoûté par sa voix douce et cependant timbrée, comme aérienne, propice aux envolées d’ailes. Son corps allait et venait comme en fuite et soudain s’arrêtait, foudroyait. Elle fut longtemps sans âge, adolescente infinie. Des reines d’Antoine Vitez, c’était la plus fragile, la plus imprévisible. Elle associait en elle densité et fragilité, sa voix nous emportait dans d'insaisissables variations, il y avait en elle un filtre comme magique qui mêlait en elle sa voix si aérienne et son corps d’elfe. D’où venait son timbre de voix aux inflexions si particulières ? Elle entrait sur scène et semblait étrangement s’y éveiller. Sa voix venait de loin, bercée d’oubli. Dans les années 70-80, rares sont les spectacles de Vitez où elle n’apparaît pas. Quand Vitez prend la direction de Chaillot et monte la première année Faust,Tombeau pour cinq cents mille soldats de Guyotat et Britannicus , elle est là . Dans Faust elle incarne l’Esprit de la terre, mange des nouilles enveloppées dans du papier journal et invite le docteur Faust (Vitez) à partager son repas. Quand Antoine Vitez met en scène le Soulier de Satin de Claudel il lui confie le rôle de Doňa Musique qui semblait écrit pour elle. Une fois, elle s’égara. Je me souviens, c’était au début des années 80 dans la Cour d’honneur du Palais des papes, un spectacle qui portait bien son titre, Malédiction. Je la regardais, elle semblait obéir à des ordres qu’elle ne comprenait pas, je souffrais pour elle. Alors, le lendemain, dans Libération où j’avais pris en charge la rubrique théâtre quelques années auparavant, j’ai écrit un article sur une pleine page titré « Pour Jany ». Je ne l’avais jamais rencontrée. Je n’osais pas sans doute. Je l’ai croisée ici et là par la suite, je l’ai suivie par ci par là. Dans Les bonnes de Genet par Alain Ollivier elle était Madame.La dernière fois, je crois, c‘était dans Les vagues d’après Virginia Woolf, une aventure répétée dans une cave du côté de la Bastille. Elle avait vieilli sans vieillir. Elle restait Jany Gastaldi, l’unique. L’ange s’en est allée. Adieu Jany. Jean-Pierre Thibaudat dans son blog de Mediapart

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 24, 2024 12:43 PM
|
Par Patrick Sourd dans les Inrocks - 19 nov. 2024 Après “Un Chapeau de paille d’Italie” de Labiche, Alain Françon s’attaque à un autre dramaturge français. Retour au XVIIIe siècle avec ses “Fausses confidences” qui nous passionnent par leur mise en lumière des stratagèmes du théâtre de Marivaux. Jeune veuve intrépide et fortunée, Georgia Scalliet incarne une femme d’une modernité bluffante dans cette aventure où l’amour est malmené. Portant sur l’écriture de Marivaux un regard aussi précis que limpide, Alain Françon revisite avec élégance Les Fausses Confidences, mettant en lumière l’imbroglio sociétal engendré par les inclinations d’une jeune veuve à l’abri du besoin pour son intendant désargenté. Impossible de laisser à l’amour le dernier mot face à une idylle qui frise la mésalliance. Cette situation interroge un XVIIIe siècle où chacun et chacune s’arroge le droit d’y mettre son grain de sel. Ainsi, la belle Araminte (Georgia Scalliet) se retrouve acculée de toutes parts. Pareille à une biche traquée lors d’une chasse à courre, elle subit la pression d’une meute où tous prétendent n’agir que pour son bien. Répartis en deux camps opposés, les tenants du monde bourgeois affrontent la bande formée par les serviteurs. Prenant résolument la tête des opposants aux épousailles, Madame Argante ( Dominique Valadié) freine des quatre fers, s’acharnant à marier sa fille au comte Dorimont (Alexandre Ruby). Menée dans l’ombre par le valet Dubois (Gilles Privat), l’équipe des défenseurs n’est guère plus rassurante, multipliant à plaisir ambiguïtés et manœuvres détournées pour soutenir leur poulain, l’intendant Dorante ( Pierre-François Garel). La naissance d’une icône En refusant de prendre parti pour l’un ou l’autre camp, Alain Françon se contente d’observer la débauche d’intrigues qui se déploie autour d’Araminte, préférant consacrer un travail tout en finesse à la figure de cette héroïne. Il explore les ressorts secrets de la psyché d’une femme qui revendique de vivre sans se soucier du qu’en-dira-t-on. D’un trait léger, il esquisse le portrait d’une femme qui se moque des interdits et de la bienséance, tenant pour négligeables les sombres manigances de ceux qui prétendent la soutenir. Araminte ne se fie qu’à un seul guide : son corps. Sa grâce ? Mettre le cap sur les émotions de son désir pour décider seule de l’avenir. Avec des allures de déesse, gainée dans une robe de soirée à la blancheur immaculée, Georgia Scalliet incarne avec brio cette égérie moderne, qui se révèle peu à peu sans esbroufe jusqu’à devenir une véritable icône de modernité. Comme on extrait une gemme de sa gangue, Alain Françon met à nu une pierre précieuse. Avec une extrême pudeur, il saisit l’instantané de la naissance d’une conscience féministe, rendant hommage à l’émergence d’un esprit libre. Une figure qui, tout en se conjuguant au féminin, devient irrésistiblement bouleversante. Patrick Sourd / Les Inrocks Les Fausses Confidences de Marivaux, mise en scène Alain Françon avec Georgia Scalliet, Pierre-François Garel, Guillaume Lévêque, Dominique Valadié, Séraphin Rousseau, Gilles Privat… Du 23 novembre au 21 décembre, Théâtre Nanterre-Amandiers. En tournée jusqu’au 11 avril 2025.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 24, 2024 10:06 AM
|
Tribune publiée dans Libération - 23 nov. 2024 Alors que la présidente du conseil régional a annoncé une coupe drastique pouvant aller jusqu’à 73 % du budget de fonctionnement de la culture, un collectif d’artistes et de professionnels du secteur dénonce une décision qui s’apparenterait à un plan social de la culture. Nous sommes des artistes, travailleuses et travailleurs dans la culture, liés aux Pays-de-la-Loire. Nous sommes choqué·es par les récentes déclarations de la présidente du conseil régional, madame Christelle Morançais, et terrifié·es par les arbitrages budgétaires qui seraient prévus au vote de l’assemblée régionale du 19 décembre 2024. ll serait donc question d’une coupe drastique allant jusqu’à 73 % du budget de fonctionnement de la culture, interrompant totalement dès 2025 les subventions allouées aux festivals, aux théâtres, aux musées, aux opéras, aux maisons d’auteur·rices, aux centres d’art, aux productions audio-visuelles, aux artistes, mais aussi aux clubs sportifs et aux associations œuvrant pour l’égalité femmes-hommes et la solidarité. C’est un coup porté à la société civile tout entière. Aucune autre région n’a fait de tels choix à l’échelle nationale. Nous avons choisi de vivre dans cette magnifique région et d’y développer nos activités. C’est ce territoire que nous arpentons chaque jour avec nos mots, nos œuvres, nos spectacles, nos concerts, nos images, nos films, parcourant les bibliothèques, les écoles, les collèges, les lycées, les maisons de quartiers, les maisons de retraites, les hôpitaux, les prisons… Et c’est dans ces lieux que nous travaillons. Chaque jour, nous constatons la vitalité culturelle de cette région. Nous savons qu’elle est le fruit de décennies du travail patient de femmes et d’hommes engagé·es qui ont œuvré à la décentralisation culturelle, faisant en sorte que les communes, les départements, les régions et l’Etat s’entendent pour créer des institutions ouvertes à toutes et tous, soutenir les initiatives citoyennes, l’entrepreneuriat culturel et faire vivre le patrimoine. Un virage politique pris sans concertation aucune Ce modèle français, qui repose sur le financement croisé des collectivités et de l’Etat, a produit partout émancipation, désenclavements et partage des savoirs. C’est ce modèle qui a engendré la diversité culturelle et l’attractivité des régions et des villes de France que le monde entier nous envie. Tout cela est aujourd’hui violemment attaqué par la région des Pays-de-la-Loire, qui sous couvert de la cure d’austérité imposée aux collectivités par le gouvernement Barnier, annonce 100 millions d’euros d’économie (quand on lui en demande 40 millions d’euros), dont une bonne partie prise sur la culture, le sport, l’égalité femmes-hommes et les solidarités, arguant que «dans de nombreux domaines, la région n’a plus vocation à intervenir, ou à intervenir autant». Ce virage politique, pris sans concertation aucune et du jour au lendemain, ferait vaciller tout l’écosystème en fragilisant ses grands équilibres. Nous dénonçons ce qui s’apparenterait à un plan social de la culture. Cette décision serait mortifère pour les 150 000 emplois concernés, qu’ils soient permanents ou intermittents, et pour tout un ensemble de professions libérales et de petites entreprises qui gravitent autour du secteur de la culture publique, hautement créateur d’emplois et de richesse économique. Nous dénonçons l’incohérence d’une politique régionale qui dénature par ses choix dangereux ses trois priorités politiques : la jeunesse, l’emploi et la transition écologique. Nous dénonçons une dialectique visant à créer de la division au sein de la société, à désigner les bonnes et les mauvaises manières de produire de la vie artistique et culturelle, alors que c’est la combinaison d’un secteur public de la culture en bonne santé avec des industries culturelles dynamiques qui fait la richesse et la variété du tissu culturel français. Nous demandons, enfin, que les mécanismes démocratiques soient respectés, et que les acteurs et actrices culturel·les soient concerté·es dans la prise d’une décision aussi lourde de conséquences pour l’ensemble des électeur·rices, citoyen·nes, usager·es ligériens et ligériennes. Parmi les signataires : Alain Mabanckou Ecrivain, directeur artistique du festival Atlantide Alice Zeniter Autrice, metteuse en scène Anna Mouglalis Comédienne Christophe Honoré Réalisateur, scénariste, écrivain et metteur en scène Daniel Pennac Ecrivain Dominique A Chanteur, auteur, compositeur Alexis HK Auteur compositeur, chanteur Emily Loizeau Autrice-compositrice-interprète India Hair Comédienne Jean Rouaud Auteur, prix Goncourt 1990 Jeanne Cherhal Chanteuse Jérôme Clément Président du festival Premiers Plans d’Angers, ancien directeur du CNC, ancien président d’Arte, Marielle Macé Ecrivaine et enseignante Henri Texier Contrebassiste de jazz Amala Dianor Chorégraphe Etienne Davodeau Auteur de bande dessinée Marc Caro Réalisateur Vanessa Wagner Pianiste Tanguy Viel Ecrivain, scénariste Xavier Veilhan Plasticien Zaho de Sagazan Autrice, compositrice, interprète Pierrick Sorin Artiste plasticien Patrick Bouchain Architecte Phia Menard Chorégraphe, plasticienne ,Philippe Decouflé Chorégraphe Philippe Katerine Chanteur, auteur, compositeur, acteur Philippe Torreton Comédien, metteur en scène… Retrouvez ici la liste complète des signataires.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2024 12:04 PM
|
Par Caroline Châtelet dans Sceneweb - 22 nov 2024 Au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, Pauline Sales offre une réécriture théâtrale et musicale du mythe de Déméter et Perséphone. Une création travaillant l’univers du conte portée par une troupe à la belle énergie. Si Déméter et Perséphone sont loin d’être les figures mythologiques les plus connues aujourd’hui, le mythe qui leur est lié – narrant l’origine des saisons – est, depuis une bonne quarantaine d’années maintenant, étudié et retraversé par diverses théoriciennes et intellectuelles féministes, notamment américaines – citons la poétesse et essayiste Adrienne Rich, la philosophe et psychanalyste Luce Irigaray, ou encore la militante et théoricienne écoféministe sorcière Starhawk. C’est d’ailleurs à la lecture de cette dernière que Pauline Sales décide de se plonger plus avant dans ce mythe et découvre l’« importance considérable [qu’il a eu] pendant l’Antiquité ». Choisissant d’en proposer une revisitation, l’autrice et metteuse en scène transpose dans un monde aux références contemporaines l’histoire de cette mère et de sa fille qui, toutes deux violées, réinventeront leur vie chacune à leur manière. Ce faisant, elle déploie avec son équipe un univers proche du conte allant volontiers vers la comédie musicale, où la violence du mythe s’efface au profit d’une fable colorée racontant la nécessaire séparation entre mère et fille. Comme dans tout bon conte, il y a un narrateur. En l’occurrence, une narratrice, et c’est du point de vue de Déméter âgée – donc vue de la terre plutôt que de l’Olympe – que cette histoire est portée. Arrivée en scène en fauteuil roulant et installée à jardin auprès d’une partie des musicien.nes – l’autre se trouvant à cour –, Déméter âgée amorce un dialogue avec lesdit.es musicien.nes et offre une plongée dans son histoire et dans celle de sa fille. Déméter, déesse de l’agriculture et protectrice des moissons, fille des Titans Cronos et Rhéa, a (entre autres) deux frères : Zeus, le maître de l’Olympe, et Hadès, le roi des Enfers. Violée par Zeus, elle décide de devenir simple mortelle, et part donner naissance à sa fille et vivre sur Terre – là où, dans nombre d’autres versions du mythe, c’est une fois sa fille enlevée que Déméter quitte l’Olympe. Ce récit chronologique se joue d’abord sur la petite estrade située au centre du plateau – initialement cachée à nos regards par un léger voile blanc –, puis investit progressivement toute la scène. Un éloignement symbolique qui signale la coupure et le passage de la vie de Déméter sur l’Olympe à celle sur Terre, auprès des humains. Dans un vaste mouvement collectif, enchaînant les tableaux comme les rôles avec fluidité, l’équipe de huit artistes au plateau – qu’iels soient musicien.nes, comédien.nes, chanteur.euses – embrasse la vie de Déméter et une partie de celle de Perséphone. Du viol initial subi par la première à son accouchement à peine arrivée sur Terre, de sa vie épanouie, où elle coule des jours heureux, travaillant la terre et rendant le monde fertile, à la tristesse et la colère qui la rongent lorsque sa fille est enlevée et violée par son autre frère Hadès – l’amenant à empêcher les plantes de pousser –, jusqu’à ses retrouvailles avec Perséphone, puis sa mort, les grandes lignes de leur vie sont abordées. La réappropriation propre au mythe, Pauline Sales la réalise, donc, en l’ancrant dans des références très actuelles et en soulignant notamment la volonté des deux femmes de se reconstruire en dépit de ce qu’elles ont subi. Car, entre Déméter et Koré – qui ne prendra le prénom de Perséphone qu’une fois revenue des Enfers –, il y a bien une répétition du même. Une même violence sexuelle, une même domination de la part d’hommes proches d’elles : frère pour Déméter, oncle pour Perséphone. De même, chacune s’invente sa propre existence loin de ce qu’elle a connu. La mise en scène dessine ainsi, dans un dispositif économe – la scénographie étant modestement constituée de petites scènes modulables, de voiles et panneaux mobiles – et à la mise en mouvement ingénieuse et fluide, plusieurs atmosphères. Il y a celles sur Terre, où vivent d’abord Déméter et sa fille, monde joyeux et animé, plein de fêtes et de lumières ; puis les différents espaces aux tonalités plus diverses traversés par Déméter lorsqu’elle tente de retrouver son enfant ; et enfin, les enfers où Hadès embarque Koré-Perséphone. Un univers sombre investi par les morts auxquels la jeune femme s’attache, en les soutenant et en les accompagnant. L’ensemble s’amuse avec un plaisir visible à déplacer l’histoire dans un contexte d’aujourd’hui. Outre quelques allusions superficielles à la politique ou à l’écologie, la situation de Déméter est celle d’une mère solo, sa fin de vie aborde succinctement celle des personnes âgées en Ehpad, et Koré est une ado allant camper avec des amies. Autant de choix qui, comme la langue enlevée traversée de pointes d’humour, tendent à rendre accessible le plus directement possible cette histoire. Quitte à ce que cela soit à quelques moments un brin trop appuyé, comme l’écriture cherchant parfois trop la rime, ou que cela se fasse au détriment d’une plus grande complexité dans les rapports entre les personnages. Ce choix de proximité résonne également avec l’univers de la comédie musicale. Composée par Simon Aeschimann et les quatre musicien.nes au plateau, très joliment interprétée par les artistes, la partition, avec ses références évoquant Jacques Demy ou certaines comédies musicales américaines, participe aussi à l’élaboration d’un univers proche du conte, plus ludique et joyeux que tragique et profond. Le résultat est, donc, une réécriture sacrément séduisante par sa forme rythmée et joyeuse, comme par sa façon de faire du théâtre entre références réalistes et univers stylisé. À cette atmosphère cohérente et maîtrisée, soutenue par une création lumières léchée, l’équipe artistique au plateau n’est pas étrangère. Toutes et tous, qu’iels soient acteur.rices ou musicien.nes, sont dirigé.es dans un même mouvement. Si le spectacle pourrait être resserré, l’élan collectif séduit par sa sincérité. Quant au propos, l’enjeu de celui-ci n’est pas ici de mettre à plat l’ambiguïté des parcours de Déméter et Perséphone, mais bien d’offrir un récit réparateur sur la nécessaire séparation qu’une mère et sa fille doivent réaliser. Pas plus que dans d’autres versions du mythe, la question de la justice n’est posée. Le viol est un état de fait, et chacune fait avec, dans une situation à chaque fois paradoxale : en traçant sa propre route loin de ses origines – la Terre pour Déméter, le retour régulier aux Enfers pour Perséphone –, sans que l’émancipation ne dépasse les assignations de care traditionnellement faites aux femmes – Déméter continuant de nourrir les vivants et Perséphone de prendre soin des morts. Leur liberté, c’est bien dans l’acceptation d’une vie loin de l’autre qu’elles la trouvent. Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr Les Deux Déesses – Déméter et Perséphone, une histoire de mère et fille
Texte et mise en scène Pauline Sales
Avec Mélissa Acchiardi (batterie, percussions), Clémentine Allain, Antoine Courvoisier (clavier), Nicolas Frache (guitare), Aëla Gourvennec (violoncelle), Claude Lastère, Élizabeth Mazev, Anthony Poupard
Musique Mélissa Acchiardi, Simon Aeschimann, Antoine Courvoisier, Nicolas Frache, Aëla Gourvennec
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumière Laurent Schneegans
Son Fred Bühl
Costumes Nathalie Matriciani
Maquillage et coiffures Cécile Kretschmar
Travail chorégraphique Aurélie Mouilhade
Assistanat au son et régie son Jean-François Renet
Régie générale Xavier Libois
Régie plateau Christophe Lourdais
Production Compagnie À l’Envi
Coproduction Les Quinconces L’espal – Scène nationale du Mans ; La Halle aux grains – Scène nationale de Blois ; Théâtre Jacques Carat, Cachan ; L’Estive – Scène nationale de Foix et de l’Ariège ; la C.R.É.A – Coopérative de Résidence pour les Écritures, les Auteurs et les Autrices, Mont Saint-Michel ; Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis ; Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge ; MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale ; Compagnie Atör
Avec le soutien du Fonds SACD / ministère de la Culture Grandes Formes Théâtre et du Fonds SACD / Musique de scène
Résidences Théâtre Jean Lurçat – scène nationale d’Aubusson ; Théâtre Cinéma de Choisy-Le-Roi La compagnie À l’Envi est conventionnée par le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France). Les Deux Déesses est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Durée : 1h50 Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis
du 20 novembre au 1er décembre 2024 Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
le 17 décembre Théâtre Jacques Carat, Cachan
le 19 décembre L’Estive, Scène nationale de Foix et de l’Ariège
le 14 janvier 2025 MC2: Maison de la Culture de Grenoble, Scène nationale
les 5 et 6 février

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2024 3:06 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 20 nov. 2024 L’auteur italien Davide Carnevali et le comédien franco argentin Marcial di Fonzo Bo étaient faits pour se rencontrer. Cela s’est passé discrètement dans un appartement de Buenos Aires. Nom de code « Portrait de l’artiste après sa mort ». Bilan : un spectacle à vif.
Marcial Di Fonzo Bo existe. La preuve, on peut le voir tous les soirs arpentant un appartement sur la scène du théâtre de la Bastille. Oui, mais qui se cache derrière cette identité ? Un artiste qui parle le français comme une vache espagnole ayant copulé avec un taureau argentin ? Un metteur spécialisé dans le Copi non conforme et présentement directeur d’un CDN dans la bonne ville d’Angers célèbre par sa douceur ? N’est-il pas plutôt ou aussi le descendant d’une célèbre famille de comiques portenŏs sommés de devenir sinistres ou de foutre le camp du pays dans les années noires de la dictature argentine ? Ou bien n’est il pas, tout bonnement, un acteur esseulé s’adonnant par désespoir au seul au scène pour n’avoir jamais été sur scène le bel Hamlet ou même le père de ce dernier ? Un peu de ceci, un pointe de cela et un chouia de perlimpinpin a t-on envie de dire en sortant du spectacle Portrait de l‘artiste après sa mort, un pièce de l’auteur italien Davide Carnevali. Notez que le nom de l’auteur, Carnevali, oscille entre la carne et le care, le canevas et le carnaval ce qui ne simplifie pas les choses d’autant que le prétendu Carnevali est peut-être un pseudonyme. Et s’il s’appelait en fait Borgeaisse ? Ce dernier, selon des sources non autorisées, se ferait appeler Carnevali par amour pour sa mère. Quoi qu’il en soit, il se fait un point d’honneur à réécrire sa pièce Portrait de l’artiste après sa mort dans chaque pays où elle se joue. Et il le fait, selon ses dires (aussi fiables qu’une vieille pince à linge au bois défraîchi et jouant au cochon pendu sur son fil) en fonction de son humeur et de celle de l’acteur qui va l’interpréter mais aussi l’incarner en scène, nous laissant croire ou feindre de croire que l’histoire qu’il nous raconte sous le couvert d’un monologue est par-ci vraie, par-là fictive, voire après passage dans la cave à vain, réinventée. Or donc Marcial, mister Bo et l’ami Di Fonzo sont tous en un (et quelques autres) seul en scène. Ça en fait du monde et des pistes, vraiment fausses ou faussement vraies, la littérature argentine adore ça. Et, qui sait, l’italien Carnevali est possiblement le rejeton d’une famille de gens de gauche italiens émigrés à Buenos Aires sous le fascisme italien et revenus précipitamment des décennies plus tard à Milan lorsque les colonels fascistes argentins arrivèrent au pouvoir a Buenos Aires. Difficile à vérifier car le personnage de Carnevali meurt avant la fin de la pièce écrite par son homonyme ou son double. Après enquête et vision du spectacle donné au Théâtre de la Bastille après le Piccolo teatro di Milano, voici ce qu’il en est ou semble en être. Pour commencer le décor : un ensemble pseudo-réaliste associant bureau, coin cuisine, salon et chambre attenante. Les techniciens sont à la bourre, il y a encore plein de trucs à déballer dans des caisses estampillées teatro de Milano, Marcial di Fonzo Bo en profite pour nous parler de sa famille qui serait d’origine italienne. Son grand-père aurait émigré en Argentine comme bon nombre de ses compatriotes. Et puis il en vient à la lettre reçue à son adresse à Caen, ville où, jusqu’à la saison dernière il dirigeait le CDN. La lettre est adressée à Marzial Di Fonzo Bo.. Marzial avec un Z comme zig zag. La lettre mentionne un appartement semblable à celui où évolue sur scène l’acteur Marcial et donc désormais le dénommé Marzial. Les spectateurs observateurs seront conviés un peu plus tard à monter sur scène et à fureter dans l’appartement. Qui a tout d’un vrai appartement –avec meubles, luminaires, etc- et tout d’un décor de théâtre avec faux livres, lumières venant des cintres, etc. . C’est alors qu’Arthur Rimbaud , cet expert en sentiments mêlés nous a chuchoté à l’oreille : « n’oublie pas que je est un autre » La voix d’un poète c’est toujours rassurant. Alors, enfoncé dans mon fauteuil spartiate (tous les fauteuils du Théâtre de la Bastille viennent d’un théâtre de Sparte et son donc particulièrement spartiates), je me suis mis à l’écoute de Radio Bo. C’est comme les grandes sagas de Philippe Colin sur France inter : on y entre comme dans un roman mais c’est la vie. Sur radio Bo l’inverse est aussi probable : tout roman est une vie qui s’ignore. D’ailleurs nous voici partis dans la France de Pétain organisant la chasse aux Juifs et dans l’Argentine des années noires, celle des militaires, faite d’arrestations, de tortures, de nouveaux nés enlevés à leur mère et de vivants pieds et poings liés jetés en pleine mer depuis un avion. Bref, tout commença un certain soir mémorable où l’auteur italien Davide Carnevali vint écouter Marcial à moins que cela ne soit aussi l’inverse : Marcial Di Fonzo Bo découvrant scotché le texte de l’italien un soir d’été à la Chartreuse . Toujours est-il qu’à la fin des fins les deux compères décidèrent de faire cause commune. L’opération s’est reproduite pour l’auteur dans différents pays avec d’autres acteurs. Pour en finir, revenons à cette pièce orgueilleusement titrée Portrait de l’artiste après sa mort. A qui donc appartenait vraiment cet appartement que nous ne quittons d’un bout à l’autre du spectacle? A un musicien juif nommé Schmidt ou au pianiste Lucas Misiti qui aurait pris pour pseudonyme le nom de Jorge Luis Di Fonzo. Allez savoir. Comme le serinait Borges : « l ‘oubli et la mémoire sont tout autant inventifs ». Et l’acteur Martial Di Fonzo Bo est le meilleur guide qui soit pour nous perdre en ravissements dans ce labyrinthe inventé et chroniqué par ce diable de Davide Carnevali. Jean-Pierre Thibaudat Théâtre de la Bastille, jusqu’au 22 nov à 20h, du 22 au 27 à 20h30 ; le samedi 23 à 18h, relâche le jeu et le dim. Traduit de l’italien par Caroline Michel, le texte de Portrait de l’artiste après sa mort sous titré-France 41 Argentine 78 dans cette version pour Marcial Di Fonzo Bo est publié aux Éditions Les solitaires Intempestifs

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2024 11:54 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - publié le 25 avril 2024 À la recherche du grand-père qui lui a donné son nom et que son père a à peine connu, Julia Perazzini mène l’enquête, incarnant tous les personnages de cette épopée familiale. « Dans ton intérieur » parle de la force d’activation des récits lorsque, investis et alimentés, ils délivrent un héritage d’une infinie puissance. L’histoire intime devient alors un espace de projection collectif.
« On m’a raconté que ma grand-mère a coupé les liens avec mon grand-père, quand mon père était enfant. Sans jamais dire pourquoi. Comme si elle l’avait fait disparaitre… et lui, qu’en pense-t-il ? » Blanc sur blanc. Trois grands coffres blancs de tailles inégales occupent seuls l’espace scénique lui-même revêtu d’une moquette blanche lui donnant des allures domestiques. Lorsqu’elle entre en scène, vêtue de noir, Julia Perazzini raconte qu’un soir de spectacle, après la représentation, une femme nommée Estelle est venue lui parler, non pas de la pièce mais de son patronyme, qui fut aussi celui de sa famille même s’il ne l’est plus aujourd’hui, et par extension de son grand-père, Giancarlo. « Je ne connais pas mon grand-père » lance Julia en même temps qu’elle tire d’une première malle, puis des suivantes, une infinité de sacs à mains et autres pochettes qui, une fois déposés au sol occuperont la totalité de la scène. Elle s’adresse à sa grand-mère qui vient de mourir. C’est chez elle que nous sommes, dans son intérieur. Elle y est seule pour la première fois et a accès à tout, absolument tout, et cela parait vertigineux. Elle empoigne maintenant les sacs à mains par trois, quatre, cinq, passe leur lanière sur ses épaules, en est bientôt recouverte, croule littéralement sous leur poids, engloutie, comme si cette confrontation physique aux objets était nécessaire, absolue, avant de finalement les disposer au sol comme les autres. Se saisissant alors d’une perruque aux faux cheveux blancs, une jupe droite, un haut vert – couleur qu’elle porte régulièrement sur scène comme pour conjurer le sort –, un manteau de fourrure et des lunettes immenses, elle devient cette grand-mère que, plus jeune, elle avait appris à vouvoyer. Donner corps à son propre nom Julia Perazzini incarnera ainsi tous les personnages, vivants ou morts, qu’elle croisera au cours de son enquête intime. Pourtant, de tous les protagonistes, la grand-mère s’incarne avec une intensité particulière, une intimité partagée. Sans doute parce qu’elle est le lien biologique avec ce grand-père paternel dont elle ne sait rien, seulement son nom qui est aussi le sien. Se tenant dans un entre-deux, la vieille dame figure le passage, le seuil qui sépare le monde de sa petite-fille de celui des absents. Mais cette gardienne des secrets les a tous emporté dans sa tombe, disparaissant trop tôt, au début de l’investigation. « Au début on avait rien pis après on a eu trop » ne cesse-t-elle de répéter comme pour mieux souligner le changement de statut social de sa famille, de la misère à l’opulence, du moins ce qui lui semblait être l’opulence. Les sacs à main qui recouvrent maintenant la scène en témoignent. Tous sans exception sont des imitations de marques de luxe précise Julia. En retirant ses objets, vêtements et autres biens des malles dans lesquelles ils étaient entreposés, probablement depuis des décennies pour certains, pour les déployer au sol, Julia vide la maison de la défunte, telle une cérémonie qui serait l’indispensable préalable au travail de deuil. Elle les expose, les scrute, tente de les faire parler une dernière fois avant de leur dire adieu. Dans cet intérieur qui fut aussi celui du grand-père disparu, les objets et les secrets précieusement conservés par la grand-mère constituent le point de départ du spectacle et de l’enquête. Grande, élancée, coquette, la grand-mère n’en est pas moins essoufflée, a du mal à se déplacer. « On devient vieux, pauvre et laid » dit-elle, lucide sur son état, sur la précarité de la condition humaine. Elle sait qu’elle est arrivée au bout du chemin, que sa vie est derrière elle. Elle a fait son temps, souhaite partir, mais parait pourtant très heureuse à chaque fois que Julia lui rend visite. Il y a quelque chose d’extrêmement touchant dans cette incarnation, quelque chose de l’ordre de la douceur, d’une immense tendresse, quelque chose de l’ordre d’un manque aussi qui donne à ses apparitions un brin de nostalgie. Drôle, la vieille dame n’en est pas moins bouleversante. De son ancien mari, elle ne dira rien cependant, ou si peu, quelques mots à peine sur leur rencontre. « C’est comme si elle l’avait fait disparaître »dira Julia. « À moins que ce ne soit l’inverse...que ce soit mon grand-père qui ait eu envie de disparaître ». Et de Milan où il est né, à Paris et, comme on l’apprendra plus tard, à la terre béarnaise et ailleurs, l’homme ne se révèle que dans d’infimes fragments de vie souvent énigmatiques. Il semble avoir été littéralement effacé de la mémoire familiale. Ceux qui restent Avec son nouveau seul-en-scène, genre qu’elle affectionne, Julia Perazzini poursuit son introspection troublante et poétique entamée avec « Holes and Hills » en 2016, déambulation étrange dans laquelle la comédienne se laissait traverser par d’autres vies que la sienne en prise avec des questions existentielles [1], et surtout « Le Souper » en 2019, proposition plus saisissante encore où elle invitait son frère ainé à diner, un repas forcément imaginaire puisque celui-ci était mort avant même sa naissance[2]. L’intitulé de la pièce, « Dans ton intérieur », revêt plusieurs réalités. Il renvoie, bien sûr, à l’intimité de l’appartement de la grand-mère, son antre, mais aussi à tous les autres intérieurs des protagonistes qu’elle croise dans sa quête familiale. Par extension, il devient le lieu de l’introspection, l’espace intime, notre jardin secret, ce voyage intérieur propre à chacun qui se reflète ici dans celui de Julia Perazzini. Mais c’est aussi l’incarnation des personnages elle-même. Dans cette enquête personnelle menée pendant plus d’un an, c’est autant elle-même que le grand-père qu’elle cherche. La quête familiale est une quête de soi. La comédienne s’appuie sur la force de la performance pour déplacer les frontières de l’intériorité et ainsi les redéfinir. En évoluant entre les différentes formes d’identité et d’existence qu’elle croise et qui semblent la posséder autant qu’elle les possède tant l’interprétation de chaque personnage sonne juste, Julia devient le réceptacle de tous les membres de cette investigation, connus et inconnus, vivants et morts. Elle est véritablement à l’intérieur d’eux. Chacun des spectacles de la comédienne vient renforcer un peu plus l’importance des jeux de lumières qui occupent une place centrale dans l’œuvre qu’elle construit, volontairement dépourvue de tout décor. Sa première collaboration avec Gildas Goujet est une réussite. Il faut dire que ce dernier a été formé par Philippe Gladieux qui a signé les créations lumière de ses précédents spectacles. La musique est omniprésente. Comme la lumière, elle joue un rôle essentiel. Après s’être essayer à la ventriloquie dans « Le souper », prêtant sa voix à ce frère qu’elle n’a pas connu, elle expérimente ici « le dispositif de l’investigation, entrer ‘dans l’intérieur’ des êtres devient simultanément un outil de recherche artistique et un moyen de connexion, un espace relationnel vibrant qui vient informer l’enquête [3] ». La pièce redonne corps aux absents, vie aux disparus. Elle fait basculer l’histoire personnelle dans un espace de projection collectif pour mieux interroger les récits qui nous constituent, qu’ils soient intimes ou publics. Finalement, cette quête a peu à voir avec la généalogie mais tout avec la force d’activation des récits lorsqu’on prend soin de les déplacer. « Dans ton intérieur » est une bouleversante mise à nu. Espérons que Julia Perazzini poursuive encore longtemps son exploration des identités. Elle a tant à dire de nous. Guillaume Lasserre [1] Guillaume Lasserre, « Julia Perazzini, émetteuse existentielle », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 24 septembre 2018, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/160918/julia-perazzini-emetteuse-existentielle [2] Guillaume Lasserre, « Julia Perazzini, le sens de la vie », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 25 novembre 2021, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/231121/julia-perazzini-le-sens-de-la-vie [3] Julia Perazzini, Note d’intention, Dans ton intérieur, 2024. DANS TON INTÉRIEUR - Conception, écriture, interprétation Julia Perazzini Collaboration artistique, dramaturgie Louis Bonard. Lumières Gildas Goujet. Musique Andreas Lumineau. Hypnose et regard extérieur Anne Lanco Costumes Rachèle Raoult. Fabrication prothèses Jean Ritz
Collaboration à la scénographie Mélissa Rouvinet Régie son David Scrufari. Stagiaire et collaboration Joanika Pages. Administration et production Tutu Production - Véronique Maréchal. Production Cie Devon. Coproduction Arsenic - Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, Théâtre Public de Montreuil - Centre Dramatique National, Théâtre Saint Gervais - Genève. Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie romande, Pro Helvetia, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Leenaards, Fondation Jan Michalski, Migros Vaud. Remerciements Emilie Berry, Simon Guélat, Antoine Héraly, Marie Villemin. Spectacle créé à l'Arsenic à Lausanne 17 avril 2024. Vu à l'Arsenic à Lausanne le 21 avril 2024. Arsenic - Centre d'art scénique contemporain Lausanne, du 17 au 21 avril 2024 ABC CinéCaféThéatre La Chaux-de-Fonds, du 25 au 26 octobre 2024 Théâtre public de Montreuil, du 6 au 23 novembre 2024, avec le Centre culturel suisse on Tour, Théâtre Saint-Gervais Genève, du 22 au 25 janvier 2025,

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2024 8:32 AM
|
Par Kilian Orain dans Télérama - 19 nov. 2024 Trois histoires, trois destins. Avec ce spectacle poétique et sensible, Estelle Savasta mène une réflexion sur la famille, l’identité, l’éducation. À voir au Théâtre des Quartiers d’Ivry jusqu’au 27 novembre, puis en tournée. Un court extrait de musique, puis un autre, et encore un. Une femme cherche à trouver le bon tempo, le morceau approprié. Les invités l’attendent, elle doit faire un discours. Que s’apprête-t-elle à dire ? Noir dans la salle. C’est par cette question que démarre et se conclut D’autres familles que la mienne. Entre-temps, trois destins tissés les uns aux autres par les aléas de la vie se dévoilent à nous. L’autrice-metteuse en scène Estelle Savasta cherche depuis longtemps à traiter du sujet de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Plutôt que d’aborder ce seul sujet, elle a construit un spectacle dont jaillit une réflexion sur la famille, l’éducation, la construction de l’identité. Il y a d’abord Nora (puissante Zoé Fauconnet), jeune femme placée en famille d’accueil qui, à l’aube de ses quatorze ans, doit brutalement changer de foyer sur décision de l’ASE. Au fil de son errance, elle fait, entre autres, la connaissance d’Ariane (émouvante Clémence Boissé), qui deviendra sa meilleure amie. Avant de croiser, des années plus tard, la route de Nino (Matéo Thiollier-Serrano, remarquable acrobate-danseur), qui la contactera pour une tragique raison. Une table et quelques chaises habillent la scène, accueillant des repas de famille, des ateliers danse, des réunions de l’ASE, des cours au collège. En fond, une nappe géante et blanche est accrochée, sur laquelle sont brodées les initiales des personnages. Comme dans une vraie famille ? Aux histoires souvent noires qui sont associées à l’ASE, Estelle Savasta et ses comédiens apportent un peu de lumière. Tissant ainsi une belle et touchante traversée. Kilian Orain / Télérama 1h45. Mise en scène Estelle Savasta. Du 19 au 27 novembre, Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) ; 4-5 décembre, MC2 Grenoble (38) ; puis à Toulouse, Saint-Étienne, Nancy, Bourges, Narbonne… -
Titre D'autres familles que la mienne -
Genre Théâtre -
Auteur Estelle Savasta -
Lieux Théâtre des Quartiers d'Ivry - La Manufacture des Œillets, 1 place Pierre-Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine -
Dates Du 19/11/2024 au 27/11/2024 Légende photo : Sur scène, le décor est sobre : une table et quelques chaises pour accueillir des repas de famille, des ateliers danse, des réunions de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)… Photo Danica Bijeljac
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2024 12:11 PM
|
Théâtre, opéra, danse, humour, cirque, conte, marionnettes : à Paris et en région, les critiques du « Monde » ont sélectionné les représentations à réserver en cette fin d’année.
Par Sandrine Blanchard, Rosita Boisseau, Fabienne Darge, Joëlle Gayot, Cristina Marino et Marie-Aude Roux dans Le Monde, 29 nov. 2024
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/29/vingt-spectacles-a-ne-pas-manquer-en-decembre_6419553_3246.html
Avant le lancement des spectacles de fin d’année, le mois de décembre est riche en propositions dans tous les domaines des arts de la scène. Un Shakespeare dépouillé à Lyon, un Soulier de satin quasi intégral à Paris, un Polifemo étourdissant à Versailles, une Alison Wheeler irrésistible en tournée, une effervescence de rendez-vous pour enfants au Havre… De quoi occuper de belle manière les longues soirées en attendant Noël. THÉÂTRE « Haribo Kimchi », la cuisine théâtrale de Jaha Koo L’artiste sud-coréen Jaha Koo s’était déjà fait remarquer, en 2019, en donnant la vedette de son spectacle Cuckoo à des rice cookers, ces robots ménagers présents dans toutes les cuisines d’Asie du Sud-Est. Avec sa nouvelle création, il transforme le théâtre en pojangmacha, ces gargotes ambulantes typiques des rues sud-coréennes, repère des noctambules de toutes sortes. Le cuiseur à riz figurera une nouvelle fois en bonne place dans ce voyage culinaire, où la nourriture sert de vecteur à une réflexion sur l’assimilation culturelle, symbolisée par le choc entre les bonbons Haribo et le kimchi, une méthode traditionnelle de fermentation des légumes. Ces liens entre alimentation et identité sont par ailleurs l’occasion pour Jaha Koo de poursuivre ses recherches sur des formes hybrides combinant cuisine, écriture documentaire, vidéo, musique et robotique. F. Da. Théâtre de la Bastille, Paris (Festival d’automne), du 9 au 14 décembre. --------------------------- Nicole Garcia dans « Royan », de Marie NDiaye Rencontre au sommet : celle de l’écrivaine Marie NDiaye et de l’actrice Nicole Garcia, dans Royan, créée au Festival d’Avignon en 2021 et reprise au théâtre La Commune d’Aubervilliers. Les ondes souples et félines de l’écriture de Marie Ndiaye saisissent les échos enfouis d’une vie de femme, professeure de français qui a cru se protéger des « effluves âcres du malheur », mais dont la tragédie remonte à la surface à l’occasion du suicide d’une de ses élèves. Nicole Garcia l’incarne magnifiquement, avec une dureté de fauve blessé, cette femme aux abois : son jeu âpre et sauvage, aux arêtes cassantes, n’a pas d’équivalent. F. Da. Théâtre La Commune, Aubervilliers, du 11 au 15 décembre. ---------------------------------------- « Le Songe » dépouillé de Gwenaël Morin Plus de vingt ans déjà que Gwenaël Morin décape l’art théâtral de ses colifichets pour lui redonner une urgence, une intensité, une dimension dionysiaques. Il le prouve une nouvelle fois avec ce Songe librement adapté de la pièce de Shakespeare, qui a fait la joie des nuits avignonnaises lors du Festival 2023. En nettoyant Le Songe d’une nuit d’été de la féerie qui s’y attache, en le jouant avec presque rien et en misant tout sur le jeu de quatre excellents acteurs – Virginie Colemyn, Julian Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaingeon –, le metteur en scène retrouve toute l’acuité de cette comédie sur la folie du désir amoureux. Comme le dit le grand Will, « l’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’imagination ». F. Da. Théâtre des Célestins, Lyon, du 11 au 15 décembre. ---------------------------------------------------- « La Tour de Constance » ou la confusion des sentiments Sur scène, six acteurs issus de l’école du Théâtre national de Bretagne. Trois femmes, trois hommes, que l’auteur-metteur en scène Guillaume Vincent précipite dans une confusion des sentiments, des identités, des désirs et des sens. L’histoire se passe dans un hôtel. Lourds rideaux bleu layette, chaises roses, motifs géométriques de la moquette : de la plonge au ménage, des jeunes gens se croisent, s’aiment, se quittent, pleurent, rient, s’enlacent et se désenlacent. Le décor n’évolue pas. Ce sont les voix et la sensualité d’interprètes remarquablement dirigés qui lui donnent son relief. Tous ces adultes en devenir ne connaîtront pas le même sort. Certains s’épanouissent, tandis que d’autres se perdent. Si cette fiction est douce-amère, c’est parce que, parfois, la vie sait être cruelle. J. Ga. Théâtre national de Bretagne, Rennes, du 12 au 21 décembre. -------------------------------------------------------- « 4211 km », portrait d’un Iran perdu Portrait d’un Iran perdu et pleuré par Aïla Navidi, autrice, metteuse en scène et comédienne d’un spectacle qui se situe à hauteur de l’humain. Sur un plateau au décor minimal, elle déploie une fresque mémorielle. C’est en France que les parents de son héroïne, Yalda Farhadi, ont choisi de s’exiler ; en France que Yalda elle-même a grandi, puis accouché d’une petite fille. Dans cette histoire revisitée par la narratrice, le présent ravive le passé qui, à son tour, éclaire le présent. Les séquences d’hier et d’aujourd’hui s’entremêlent pour raconter le chemin chaotique emprunté par un couple fuyant vers la liberté. Entourée par cinq comédiens, Aïla Navidi donne corps à des personnages livrés à une bataille déchirante entre désir d’émancipation et nostalgie de la terre natale. Ces réminiscences ne vont pas sans bons sentiments. Mais l’artiste sait s’en tenir à un réalisme efficace dans son approche des quotidiens. J. Ga. Studio Marigny, Paris, jusqu’au 31 décembre. --------------------------------------------------- « Le Soulier de satin » dans sa quasi-intégralité Une langue somptueuse qui tutoie le trivial et le sublime, une fresque délirante où la passion aimante les héros Prouhèze et Rodrigue, une épopée qui plie le monde à sa botte, vingt années racontées en quatre journées décisives : lorsque Paul Claudel écrit Le Soulier de satin, il rêve le théâtre en grand. Il le veut magistral et spectaculaire. Il le croit capable de tout. Créée en 1943 à la Comédie-Française par Jean-Louis Barrault, cette pièce démente, qui embarque le spectateur pour une traversée d’heures agitées, aussi baroques que mystiques, aussi concrètes que poétiques, revient se poser salle Richelieu grâce à Eric Ruf. Le metteur en scène, qui quittera en 2025 son siège d’administrateur de la Maison de Molière, veut partir sur un geste fort. Pour la quatrième fois de son existence, Le Soulier sera représenté dans sa quasi-intégralité. J. Ga. Comédie-Française, Paris, du 21 décembre au 13 avril 2025. ------------------------------------------ « Sens dessus dessous », la littérature en état de grâce La précision, l’élégance, la souplesse, une façon bien à lui de sillonner les écritures : André Dussollier est un acteur à part dont la présence au théâtre est toujours un évènement. Le comédien reprend aux Bouffes parisiens un spectacle créé il y a un an et pour lequel il a tout conçu : la scénographie (qui ne manque pas de malice) et le montage des textes. Sens dessus dessous (titre inspiré par Raymond Devos) emmène le public vers les états de grâce de la littérature. Victor Hugo, Charles Baudelaire, Roland Dubillard, Sacha Guitry, bien d’autres plumes encore : les mots des auteurs convoqués accouchent de mondes absurdes, dramatiques, jubilatoires, inquiétants. La vie est une suite de contrastes et Dussollier (qui le sait bien) ne nivelle jamais rien de ce qu’il choisit de faire entendre. Ce qui fait de lui un interprète rare, un peu chat et un peu jaguar. J. Ga. Théâtre des Bouffes parisiens, du 3 au 31 décembre. ---------------------------------------------------------------- OPÉRA Le trépidant « Turc en Italie » de Laurent Pelly Créé en août 1814 à la Scala de Milan, Le Turc en Italie n’a pas connu le fulgurant succès de L’Italienne à Alger, du Barbier de Séville ou de La Cenerentola – l’œuvre n’a été redécouverte que tardivement, à partir des années 1950. C’est pourtant un opéra-bouffe très enlevé, dont l’intrigue et les tours de passe-passe sont à l’origine de situations aussi cocasses que sentimentales. La coquette et volage Fiorilla, femme du pantouflard Don Gerinio, tombe dans les bras d’un beau Turc, Selim, fraîchement débarqué en Italie, qui se propose de s’enfuir avec elle. Mais celui-ci a autrefois été fiancé à une bohémienne, Zaïda, laquelle n’aspire qu’à retrouver son amour. Au centre, un poète en quête d’inspiration. Qui mieux que Laurent Pelly pour expertiser cette comédie au vitriol, les multiples rebonds d’une action menée tambour battant par la verve rossinienne ? Dans des décors inspirés du roman-photo, une distribution internationale réunit la soprano Sara Blanch, la basse Adrian Sâmpetrean et les barytons Florian Sempey et Renato Girolami. M.-A. R. Opéra national de Lyon, Lyon 6e, du 11 au 29 décembre. ----------------------------------------------- Les bouleversants « Dialogues des carmélites » d’Olivier Py Présentés en 2013 au Théâtre des Champs-Elysées, ces Dialogues des carmélites, de Francis Poulenc, atteignaient des sommets dans la mise en scène singulièrement inspirée d’Olivier Py, sans doute l’une de ses plus belles réussites. Le livret, tiré de l’œuvre de Georges Bernanos, relate l’histoire vraie des seize religieuses du carmel de Compiègne guillotinées le 17 juillet 1794 à Paris. Cette longue altercation du doute et de la foi, Olivier Py et le scénographe Pierre-André Weitz l’ont déroulée dans un dénuement ardent et monacal. Privilèges abonné Le Monde événements abonnés Expositions, concerts, rencontres avec la rédaction… Assistez à des événements partout en France ! Réserver des places La direction d’acteur est remarquable, chaque caractère finement ciselé, les rapports entre les femmes minutieusement informés. Certaines des interprètes féminines sont de nouveau présentes, mais dans des rôles différents. Si Véronique Gens conserve le rôle de Madame Lidoine, Patricia Petibon sera ici Mère Marie de l’Incarnation, tandis que Sophie Koch chantera l’incroyable agonie de la prière blasphématoire, Madame de Croissy. Elles seront rejointes par Vannina Santoni (qui fera sa première Blanche de la Force) et Alexandre Duhamel. Au pupitre de cette reprise, l’Américaine Karina Canellakis, à la tête des musiciens Les Siècles. M.-A. R. Théâtre des Champs-Elysées, Paris 8e, du 4 au 12 décembre. ------------------------------------------------- L’étourdissant « Polifemo » de Porpora 1735 : Nicolo Porpora est depuis deux ans en terre londonienne pour tenter de contrecarrer son rival Haendel, alors maître de l’opéra italien, dont il a le monopole. Le cinquième ouvrage du Napolitain pour l’Opera of the Nobility, Polifemo, a de sérieux atouts, dont les célébrissimes castrats Farinelli et Senesino (ce dernier étant passé à l’ennemi en quittant la Royal Academy de Haendel). Le succès, qui réunit autour du cyclope Polyphème les personnages héroïques de la mythologie grecque – le roi d’Ithaque Ulysse, la nymphe Calypso, les amants Acis et Galatée –, est retentissant. Brillamment incarné par des virtuoses qui n’ont rien à envier aux castrats – Franco Fagioli, Paul-Antoine Bénos-Djian –, Julia Lezhneva, Eléonore Pancrazi et José Coca Loza, le chef-d’œuvre nous revient dans une mise en scène de Justin Way, avec les costumes spectaculaires de Christian Lacroix, les danseurs de l’Académie de danse baroque de l’Opéra royal qu’accompagne l’Orchestre de l’Opéra royal, dirigé par le violoniste polonais Stefan Plewniak. M.-A. R. Opéra royal de Versailles (Yvelines), du 4 au 8 décembre. Roberto Alagna dans le dramatique « Fedora » de Giordano « Une femme A adore un homme B. B périt victime d’un meurtre. A soupçonne C d’être l’assassin. Elle s’acharne contre lui, le ruine, le déshonore, le fait condamner à mort. Puis A découvre que C est innocent. » Ainsi Victorien Sardou résumait-il de manière lapidaire la pièce qui servit de livret au chef-d’œuvre de Giordano. Comme son compatriote Puccini dans Tosca, le compositeur s’inspire d’une héroïne de théâtre et des amours tragiques sur fond de pouvoir totalitaire. Vladimir, le fiancé de la princesse Fedora Romanova, est assassiné à Saint-Pétersbourg en 1881 par l’anarchiste Loris Ipanov. Fedora décide alors de poursuivre le meurtrier à Paris, qu’elle dénonce à la police impériale. Mais Loris lui révèle que sa femme était la maîtresse de Vladimir. Les voici unis par un amour né d’une double et commune trahison. Le couple maudit qui fera ses débuts au Grand Théâtre de Genève n’est autre que celui formé par Roberto Alagna et son épouse, la soprano Aleksandra Kurzak. Ils seront en alternance avec les Russes Elena Guseva et Najmiddin Mavlyanov. A la tête de l’Orchestre de la Suisse romande, la baguette d’Antonino Fogliani, tandis que la mise en scène, transposée à l’ère post-glasnost, sera confiée à Arnaud Bernard. M.-A. R. Grand Théâtre de Genève, Genève (Suisse), du 12 au 22 décembre. --------------------------------------------------------- DANSE Le Centre national de la danse fête ses 20 ans à Pantin Le somptueux bâtiment, ancien centre administratif, abritant le Centre national de la danse à Pantin fête le 7 décembre ses 20 ans consacrés à l’art chorégraphique. Conçu par l’architecte Jacques Kalisz, réhabilité par Antoinette Robain et Claire Guieysse, labellisé cette année « architecture contemporaine remarquable », ce lieu, imposant dans son béton sombre, abrite sur cinq niveaux une médiathèque, un espace d’exposition, une salle de projection, quatorze studios… Plaque tournante du spectacle chorégraphique, avec différentes équipes dévolues, entre autres, au soutien à la création, à la formation, à la recherche et au patrimoine, il accueille le 7 décembre une série de spectacles et de performances signés Boris Charmatz, François Chaignaud, Baptiste Cazaux, Soa de Muse… L’exposition Pièces distinguées, qui valorise 250 fonds des archives de la médiathèque, sera également visible. Le cabaret sera aussi de cette fête d’anniversaire, avec la présence toujours génialement magnétique de Monsieur K. R. Bu CND, Pantin, le 7 décembre, de 15 heures à minuit. Evénements gratuits avec réservation obligatoire (spectacles, performances et visites guidées). Carte blanche à Amala Dianor Il est partout. Le danseur et chorégraphe Amala Dianor s’offre un mois de décembre beau comme un cadeau. Du 5 au 19 décembre, la Maison des métallos devient son adresse parisienne avec différents spectacles et ateliers. Au programme : Man Rec, solo autoportrait reflétant ses inspirations hip-hop, contemporaines et sénégalaises dans une écriture riche et fluide ; M&M, duo enlevé entre hip-hop et dance hall interprété par Marion Alzieu et Mwendwa Marchand ; Coquilles, première création pour les tout-petits… Une exposition photographique intitulée Sound of the city, cosignée avec Grégoire Korganow, décline en images le processus de création de sa pièce Dub, entre Los Angeles, Atlanta et Chicago. Et pour compléter ce programme en mode majeur, Dub, qui met en scène onze performeurs spécialistes en voguing, pantsula sud-africain, krump ou waacking, est à l’affiche du 11 au 14 décembre du Théâtre de la Ville, à Paris. R. Bu Maison des métallos, Paris, du 5 au 19 décembre. Et Dub, d’Amala Dianor, Théâtre de la Ville, Paris, du 11 au 14 décembre. « Contre-nature », la passion pour l’envol de Rachid Ouramdane Depuis sa collaboration très réussie avec les artistes experts en portés acrobatiques de la compagnie de cirque XY pour le spectacle Möbius, créé en 2019, le chorégraphe Rachid Ouramdane est tombé sous le charme de cette technique aérienne où la confiance dans l’autre est le ciment d’architectures humaines sublimes. Avec Contre-nature, présenté du 6 au 17 novembre à Chaillot-Théâtre national de la danse à Paris, dont Rachid Ouramdane est le directeur, il poursuit et affine encore sa passion pour l’envol et la chute, l’équilibre et l’instabilité, en insistant sur l’importance de la relation entre les interprètes. Avec dix danseurs-acrobates en scène, tous unis par une énergie de groupe hypnotique, il souligne combien porter son partenaire, le soutenir, le rattraper pour mieux décoller avec lui ou rouler au sol possède une beauté aussi magique qu’émouvante. Sur une musique atmosphérique de Jean-Baptiste Julien, Contre-nature parie sur la douceur de la virtuosité. R. Bu En tournée : le 1er décembre, à Cannes ; le 10 décembre, à La Roche-sur-Yon ; du 17 au 20 décembre, à Annecy ; le 15 janvier 2025, à Dijon. CIRQUE Le collectif Petit Travers dans « Nos matins intérieurs » Lorsque le jonglage se déploie dans un ballet optique, il faut compter avec le talent et la virtuosité du collectif Petit Travers. Fondée en 2004, sous la houlette de Nicolas Mathis et Julien Clément depuis 2011, cette troupe d’excellence réussit à conjuguer impact visuel et artisanat du geste, engagement personnel et jeu collectif, dans une partition savante de jets de balles et de bâtons. Leur spectacle Nos matins intérieurs, à l’affiche jusqu’au 1er décembre de l’Espace Chapiteaux de La Villette, rassemble dix jongleurs d’horizons et de pays différents, accompagnés en direct par le Quatuor Debussy. Dans un décor de cubes gris manipulés à vue par les interprètes, chacun témoigne en paroles de son parcours d’acrobate de cirque, avec ses hauts et ses bas, tout en livrant des numéros tranquillement fabuleux. Ensemble, sur des musiques de Henry Purcell ou du compositeur Marc Mellits, ils font dialoguer le travail et la grâce dans des dégradés et des vagues de balles blanches comme suspendues en l’air ou des compositions géométriques mouvantes. R. Bu Espace Chapiteaux, La Villette, Paris, jusqu’au 1er décembre. Puis en tournée : les 6 et 7 décembre, à Thonon-les-Bains ; les 17 et 18 décembre, à La Rochelle ; le 9 janvier, à Limoges ; le 14 janvier, à Saint-Médard-en-Jalles ; les 16 et 17 janvier, à Boulazac-Isle-Manoire ; du 8 au 14 février, à la Maison de la danse, à Lyon. JEUNE PUBLIC Une éruption de spectacles pour enfants au Volcan La 7e édition du Ad Hoc Festival, du 30 novembre au 7 décembre, vise un double objectif : faire circuler artistes et spectateurs sur l’ensemble du territoire – depuis les communes de quelques centaines d’habitants aux zones périphériques du Havre Seine Métropole, de Rouen, ou même de Deauville et de Fécamp – et promouvoir une création audacieuse et innovante destinée au jeune public. Les 23 spectacles proposés aborderont un large panel de thématiques et mêleront une variété de disciplines allant du théâtre, de la danse et des marionnettes à la musique contemporaine ou baroque, en passant par les DJ, la radio ou même un opérabus itinérant. Deux compagnies proposeront une nouvelle création conçue pour le festival : le collectif La Cohue (Sophie Lebrun et Martin Legros) présentera son premier spectacle jeune public, une adaptation du célèbre Pinocchio, de Carlo Collodi, et Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais (Amélie Poirier) orchestreront un projet baptisé Magnéééétique, en deux parties (Face A et Face B), autour de la K7 audio, alliant danse, musique, clown et théâtre d’objets. C. Mo MARIONNETTES Le théâtre d’ombres persan revisité par Hamid Rahmanian En février 2022, le réalisateur et illustrateur iranien Hamid Rahmanian, né en 1968 à Téhéran et installé aux Etats-Unis depuis les années 1990, avait choisi la France et le Musée du quai Branly-Jacques-Chirac pour la première mondiale de son spectacle Shâhnâmè. Les amours de Bijan et Manijeh (Song of the North). Il est de retour sur les lieux de cette création pour six représentations exceptionnelles, du 5 au 8 décembre. Adapté du Livre des rois, un poème épique écrit au Xe siècle par Ferdowsi (vers 940-1020), texte fondateur de la littérature iranienne, le récit relate les amours contrariées du valeureux chevalier Bijan et de la belle princesse Manijeh, à la voix ensorceleuse, appartenant à des royaumes ennemis, en guerre depuis des siècles. Cet époustouflant feu d’artifice (d’environ une heure et demie) de tableaux colorés, de cavalcades effrénées, de batailles épiques repose sur un astucieux dispositif scénique : les quelque 500 marionnettes et 200 paysages animés, ainsi que la dizaine de comédiens et manipulateurs se trouvent derrière un immense écran placé sur le devant du plateau, seules leurs silhouettes et images sont visibles du public, projetées en ombres chinoises. C. Mo Théâtre Claude-Lévi-Strauss, Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris 7e, du 5 au 8 décembre. THÉÂTRE D’OBJETS Le réjouissant jeu de piste de Pauline Ringeade et Eléonore Auzou-Connes Dans le spectacle Pister les créatures fabuleuses, créé en 2021, la metteuse en scène Pauline Ringeade a adapté sur les planches, avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité, le texte d’une conférence jeune public donnée par le philosophe et naturaliste Baptiste Morizot en 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil. Il y partageait une série de récits de pistage en forêt ou en montagne dans différents pays et continents. Les « créatures fabuleuses » dont il est ici question ne sont ni licornes, ni dragons, ni griffons tout droit sortis de l’imagination fertile d’un écrivain. Il s’agit d’êtres qui vivent non loin de nous, dans les forêts et dans les océans : loups, renards, coyotes, ours, cachalots… même si, la plupart du temps, ils sont invisibles et fuient la présence humaine. Plongée dans un univers sonore constitué de bruits – enregistrés ou créés en direct –, la comédienne Eléonore Auzou-Connes incarne avec fougue une exploratrice un brin casse-cou lancée sur les traces de plusieurs animaux sauvages, dont un « nanoulak », ourson né d’un grizzly et d’une ourse polaire. C. Mo Théâtre Silvia Monfort, Paris 15e, du 10 au 19 décembre. Sandrine Blanchard, Rosita Boisseau, Fabienne Darge, Joëlle Gayot, Cristina Marino et Marie-Aude Roux

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2024 5:13 AM
|
ENTRETIEN - Propos recueillis par Catherine Robert / Artcena - 28 nov. 2024
« Je n’avais pas envie de devenir un notable. » disait Gabriel Monnet pour expliquer sa décision de partir à la retraite à soixante ans, en 1981, en laissant Georges Lavaudant diriger la Maison de la Culture de Grenoble sans lui. Ce dernier suit l’exemple de Gaby, en faisant profiter les créateurs plus jeunes de sa « présence amicale », s’occupant des lumières dans Gaby, mon spectre et participant aux rencontres des 14 et 15 décembre.
Comment avez-vous rencontré Gabriel Monnet ?
Georges Lavaudant : En 1971, nous avions créé, avec Ariel Garcia-Valdès, un spectacle qui s'appelait Joe Pop and Marcus. Nous sommes allés le jouer au Palais de la Méditerranée, à Nice, où Gabriel Monnet dirigeait le Centre Dramatique nouvellement créé. Il est venu nous voir. Nous étions alors installé au Rio, un tout petit théâtre à Grenoble, et nous avons monté Le Roi Lear, avec des copains amateurs. Gaby, qui venait d’être nommé à Grenoble, est revenu nous voir et a trouvé ça très bien ! En 1974, Michel Guy, nommé secrétaire d’Etat à la Culture, a souhaité associer directeurs confirmés et jeunes artistes : Daniel Benoin et Jean Dasté à Saint-Etienne, Bruno Bayen et Maurice Sarrazin à Toulouse et moi avec Gaby à Grenoble. Gaby était d’une générosité splendide. C’est le seul endroit où cette association a vraiment fonctionné : il n’y avait pas de conflits d’égos, d’esthétiques ou de points de vue politique entre nous. Comment dirigeait-on une Maison de la Culture ?
Georges Lavaudant : J’ai dirigé celle de Grenoble à partir de 1981 avec Jacques Blanc. Diriger une Maison de la Culture, c’est compliqué ! Quand j’ai pris la direction de celle de Grenoble, elle avait quinze ans d’existence : elle avait été créée en 1968 pour les Jeux Olympiques, au moment d’un débat, très fort à l’époque, et qui a continué à être sous-jacent, entre l’action culturelle et la création. Les Maisons de la Culture voulaient accueillir un maximum de personnes en danse, poésie et activités annexes relevant de l’action culturelle, contre une politique élitiste, représentée par les metteurs en scène qu’on accusait de défendre des textes abscons avant-gardistes. Pierre Gaudibert avait écrit, dès 1972, Action culturelle, intégration et/ou subversion, et cette question alimentait le débat politique de l’époque, très ardent à Grenoble. La culture, à l’époque, était un sujet de premier intérêt. A l’origine de leur création, Malraux voulait en finir avec le centralisme parisien. L’idée audacieuse, ambitieuse et très noble était que les gens avaient partout droit aux plus grandes œuvres d’art. Cette période et cette ambition étaient celles de Gaby Monnet et de tous ces pionniers qui furent des Sisyphe. N’oublions pas que la Maison de la Culture de Bourges fut inaugurée par De Gaulle et Malraux : c’est dire l’importance magnifique de ce projet ! Diriger une telle maison, c’était donc convaincre ceux qui par peur ou manque de moyens ne veulent pas venir, envoyer des animateurs culturels dans les lycées ou les entreprises, laisser la porte grande ouverte, mais, en même temps, ne pas rabaisser les œuvres et ne pas faire de sondage pour savoir si la programmation était politiquement correcte ou correspondait au sujet de l’année ! Nous tenions à ce que l’art, parfois, échappe à la compréhension, qu’il doit être ébranlement, qu’il peut parfois laisser harassé, exténué, parfois en rage devant ce qu’il représente. Le débat était exagéré, souvent surjoué, mais reconnaissons que cet affrontement était marrant et extrêmement vivant ! A Grenoble et sans doute ailleurs, à Bourges, à Caen, au Havre, à La Rochelle et à Amiens, on discutait vraiment de la place de l’art dans la cité. L’idée paraît sans doute aujourd’hui ridicule, mais on se disait que tout le monde devait fréquenter les lieux de culture, que l’art était une des préoccupations sociales principales. A Grenoble, Hubert Dubedout s’était fait élire à la mairie sur le dossier de l’approvisionnement en eau des logements, surtout ceux des étages supérieurs ; son slogan de campagne était « Grenoble Ville Olympique, c’est bien. De l’eau à nos robinets, c’est mieux ». Mais il n’empêche qu’il a lancé le chantier de la Maison de la Culture : on peut s’occuper des cantines et faire rêver les gens ! C’est le « et » qui est important ! Aujourd’hui, on a l’impression d’avancer sur une seule jambe ! Et si on pouvait se débarrasser de la culture qui coûte un peu trop cher, on le ferait sans doute. Qui était Gabriel Monnet ?
Georges Lavaudant : Un être exceptionnel, qui réunissait des qualités merveilleuses : homme de théâtre, poète, philosophe, marcheur, bouliste, cuisinier, tout à la fois enfant et puits de sagesse. Il irradiait ! Non pas comme un maître, mais comme un camarade, un copain, quelqu’un à qui on pouvait tout dire. Il ne laissait jamais rien tomber, et ne pouvait pas se résoudre à ce que les choses n’aillent pas mieux et que la vie ne soit pas plus belle. Il citait souvent René Char, son poète préféré. Il partageait son immense culture de manière ludique et fraternelle. Il était le contraire d’un gourou. On le retrouvait toujours comme on retrouve un paysage aimé, une femme aimée : on était certain d’en revenir ému et enrichi. Catherine Robert est professeur de philosophie depuis trente ans et journaliste depuis vingt-cinq ans pour Theatreonline, La Terrasse et L'Officiel des spectacles....

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2024 6:59 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 28 nov. 2024 A partir des souvenirs de sa grand-mère maternelle, le comédien a écrit, avec Ben Popincourt, une autofiction pleine de fantaisie qu’il interprète seul sur scène, accompagné par le musicien Ahmed Amine Ben Feguira.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/28/dans-je-ne-suis-pas-arabe-au-theatre-la-reine-blanche-elie-boissiere-plonge-dans-les-meandres-de-la-memoire-familiale_6418037_3246.html
La flamme d’une bougie, un nuage de fumée, la douce mélodie d’un oud, un drap blanc tendu derrière lequel se profile, en ombre chinoise, la silhouette d’un corps qui se contorsionne dans des postures étranges au gré de jeux de lumière… Voilà ce que découvre le public en pénétrant dans la petite salle Marie-Curie, à l’étage du théâtre La Reine blanche, à Paris. La toute jeune compagnie Les Yeux larges, fondée en 2024 par le comédien Elie Boissière, y présente sa première création, Je ne suis pas arabe, jusqu’au 21 décembre. Puis le récit commence dans une maternité, où Elie et Dounia attendent la venue de leur premier enfant, entourés par leurs familles respectives… et par un défilé de plats traditionnels apportés par les uns et les autres. Mais le bébé ne veut pas sortir du ventre de sa mère, et son père se rend compte qu’il manque une personne essentielle : sa grand-mère maternelle, Mahdjouba, qui a changé son prénom pour se faire appeler Magda – elle estime, en effet, qu’elle n’est pas arabe mais française, car, dit-elle, « l’Algérie était française à l’époque ». Tel est le point de départ, réel ou fictif, peu importe, d’un conte plein de fantaisie, de poésie et d’humour qui emprunte à la fois au récit de vie classique et à l’épopée, à l’odyssée homérique. A partir des bribes de souvenirs que cette aïeule lui livre avec réticence, car elle pense qu’il vaut mieux « laisser les morts tranquilles » et ne pas se retourner sur son passé, son petit-fils Elie va s’inventer un voyage rocambolesque dans un Oran fantasmé et fantasmagorique, celui des années 1930-1940, où Mahdjouba est née (en 1942) et a passé le début de son existence, jusque vers ses 8 ans. Personnages excentriques Un peu comme Alice chez Lewis Carroll, le narrateur-acteur croise sur son chemin toute une galerie de personnages excentriques et loufoques : un Italien préoccupé par l’état de santé de ses congénères, un marchand de glaces bonimenteur, une chèvre rasta, un vendeur de sardines tonitruant… Mais il rencontre aussi des personnes bien réelles, issues de son histoire familiale (notamment sa grand-mère, alors petite fille, avec sa propre mère, Fatma Akrour) ou de l’Histoire avec un grand « H », comme l’homme politique Messali Hadj (1898-1974), fondateur du Parti du peuple algérien, figure de l’indépendance, ou le maire d’Oran (de 1934 à 1941), l’abbé Lambert (1900-1979). Elie Boissière parvient à donner vie, souvent avec beaucoup de justesse et d’émotion, à chacun de ces personnages, même si, de temps à autre, il force un peu le trait dans son interprétation, au risque de tomber dans la caricature. Ménageant des moments de pause dans ce récit haletant, il permet au public d’écouter vraiment et de profiter totalement de la musique jouée en direct, sur scène, par le joueur professionnel d’oud, Ahmed Amine Ben Feguira, toujours présent à ses côtés. Le parti pris du comédien – et coauteur, avec Ben Popincourt – de Je ne suis pas arabe de ne pas choisir la voie du récit purement documentaire et pédagogique pour retracer platement et de façon chronologique les différentes étapes de la vie de sa grand-mère se révèle, au bout du compte, judicieux, même si risqué. A trop brouiller les frontières entre réalité et fiction, entre vrai et faux, Elie Boissière égare parfois, en cours de route, le public, qui ne sait plus très bien qui est qui parmi les protagonistes de cette histoire familiale complexe. Si le mystère qui plane sur l’enfance de Mahdjouba à Oran et sur les véritables raisons de son départ pour la France reste finalement entier, ce rêve éveillé que l’on a partagé, une heure durant, en sa compagnie, laisse un agréable souvenir au parfum d’encens et aux notes d’oud. Je ne suis pas arabe, d’Elie Boissière et Ben Popincourt. Mise en scène : Alexis Sequera. Avec Elie Boissière et Ahmed Amine Ben Feguira (oud). La Reine blanche, scène des arts et des sciences, 2 bis, passage Ruelle, Paris 18e. Jusqu’au 21 décembre, les mardis et jeudis à 21 heures, le samedi à 20 heures (relâches le 26 novembre, les 10 et 17 décembre). Cristina Marino / Le Monde Légende photo : Elie Boissière dans « Je ne suis pas arabe », coécrit avec Ben Popincourt, à La Reine blanche, à Paris, en novembre 2024. JULIEN GIAMI

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 26, 2024 8:10 PM
|
Jany Gastaldi : Témoignages en hommage à l'actrice
Publié sur la page Facebook de Samuel Churin , 25 nov. 2024 Cher(e)s ami(e)s, j’ai beaucoup hésité avant d’écrire ce petit mot car je ne veux pas du tout que certain(e)s d’entre vous se sentent visés. Je voulais vous parler de Jany Gastaldi qui vient de nous quitter. Je lis beaucoup d’hommages et elle le mérite tant. Oui Dona Musique, Oui Vitez évidemment. Mais je ne peux m’empêcher de témoigner de sa profonde tristesse et détresse lorsqu’elle s’est sentie abandonnée. Nous sommes en 2003, Avignon vient d’être annulé suite à la grève des actrices et acteurs sur place, un accord réduisant les droits des intermittents du spectacle en était la cause. Les critères d’accès au régime notamment avaient été durcis : pour les artistes 507h en 10,5 mois, pour les techniciens 507h en 10 mois. Jany m’appelle. Je la connaissais pour l’avoir vu jouer mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle était désespérée. Elle n’avait pas ses heures et n’avait plus aucun espoir de les avoir avec ce nouvel accord. Elle qui avait tant travaillé, elle qui était admirée par beaucoup d’entre nous avait été oubliée après la mort de Vitez, elle avait disparu des plateaux. Nous avions pris un thé dans son appartement, avions beaucoup parlé, elle gardait le sourire. Elle avait finalement trouvé des heures d’atelier à donner et nous nous étions débrouillés pour que toutes ces heures soient comptabilisées (encore une règle inepte qui consiste à ne compter qu’une partie des heures de formation données). Voilà simplement ce que je voulais rappeler. Non pas pour dire aux metteurs en scène : « Si vous l’aimiez tant, pourquoi ne l’avez-vous pas engagé ? », pas du tout. Mais pour rappeler que la grande Jany Gastaldi a été oubliée, ce qui n’est pas sans rappeler qu’au cinéma la grande Annie Girardot l’avait été aussi. Je ne sais pas si toutes les femmes et hommes oubliés de notre métier se sentiront moins seuls, mais je tenais à témoigner que j’ai rencontré une Jany très triste de ne plus jamais être appelée. Nous nous sommes peu revus chère jany, mais je garde de toi un souvenir aussi ému que bouleversé. Merci d’avoir tant partagé ton sourire et tes blessures, avec toi le théâtre était bien plus que du théâtre. Samuel Churin ------------------------------ Publié par Manuel Piolat Soleymat (Facebook /25 nov. 2024) Elle était une présence, un regard, une voix. Elle était l'une de nos grandes comédiennes. Jany Gastaldi laisse le monde du théâtre orphelin de sa grâce et de sa singularité. Elle fut l’une des Reines d’Antoine Vitez, avec qui elle fit date dans d'étonnantes interprétations : Catherine (Mère Courage, en 1973), Célimène (Le Misanthrope en 1978), Ophélie (Hamlet en 1983), Doña Sol (Hernani en 1985), Doña Musique (Le Soulier de satin en 1987)… Elle illumina également, parmi tant d’autres créations, La dispute de Marivaux par Patrice Chéreau en 1973, Phèdre de Sénèque par Daisy Amias en 1990, Les Bonnes de Jean Genet par Alain Ollivier en 1998, Petit Eyolf de Henrik Ibsen par Alain Françon en 2002, Les Femmes savantes de Molière par Marc Paquien en 2011, spectacle pour lequel elle monta une dernière fois sur scène. Elle était le charme et l'acuité incarnés. Elle nous manque déjà. ------------------------------ Publié par Jérôme Prigent (Facebook, 26 nov. 2024) « Un artiste c’est un enfant qui a de l’expérience » disait Peter Brook. Jany Gastaldi vient de faire son dernier salut. C’était l’une des reines d’Antoine Vitez. Elle fut Philaminte, Madame (dans Les Bonnes), Doña Musique (Le Soulier de satin)… Sa voix comme un souffle qui estrangeait et magnifiait la langue. ------------------------------ Publié par Michel Strulovici (Facebook, 25 nov. 2024) HOMMAGE A JANY GASTALDI Je me souviens comme si c'était hier de mon reportage, dans les sous-sols du Théâtre Gérard-Philipe de Saint Denis. Cette rencontre avec le théâtre de Sénèque, avec la vitézienne Jany Gastaldi, avec l'inventive Daisy Amias, me transperça. J'eus un peu de mal à le faire inscrire dans les JT d'Antenne 2 , à l'époque, mais nous réussîmes tout de même , après quelques affrontements en conférence de Rédaction. Des JT d'une autre époque. Je me souviens de l'incarnation de Phèdre proposée par cette immense actrice qui vient de disparaitre. Pour ce rôle elle avait obtenu le Prix du Syndicat de la Critique. ------------------------------ Publié par Claire Ruppli (Facebook, 25 nov. 2024) Maintenant c’est JANY GASTALDI qui s’en va… Une comédienne exceptionnelle , un être au-delà du théâtre. J’entends ta voix et tu as été près des anges magnifiques du théâtre . Outre le Soulier de Satin tu as toujours joué au plus que présent avec les anges te faufilant dans l’invisible , et incandescente toujours. Un oiseau rare . Merci , tu m’as permis de m’élever en jeu , et en spectatrice… Extrême tristesse RIP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 26, 2024 7:45 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 25 nov. 2024 Brune au teint clair, silhouette frêle, grand regard fiévreux, elle était ultra sensibilité et intelligence profonde et vive de la poésie, de la littérature. Elle flambait. Mais, avant tout, elle était une voix. Très particulière. Un souffle. Une musique unique. Antoine Vitez, dont elle fut l’élève et avec qui elle aura énormément joué, la désignait comme l’un de ses « reines ». Elle possédait une voix unique, une manière de laisser place au souffle dans le moindre des mots de la langue française. Elle les ouvrait, les mots, les lançait vers le haut. Comment dire ? Elle était musique et, d’ailleurs, son dernier rôle, avec son maître, fut, dans Le Soulier de satin de Paul Claudel, Dona Musique. Les autres « reines » sont Nada Strancar et Dominique Valadié. Jany Gastaldi s’est éteinte hier matin, un dimanche gris de fin d’automne. Elle a été emporté par un cancer cruel. Elle n’était que grâce et intelligence rayonnante de la vie. Réservée dans les relations avec ceux qu’elle ne connaissait pas bien, amie chaleureuse. Elle irradiait la merveilleuse fantaisie d’une éternelle enfant. Mais sans faiblesse d’immaturité. Au contraire. Elle était grave, profonde, mais elle n’aimait pas peser. Poids plume et sérieux de tout l’être. On va encore répéter la formule si jolie de Peter Brook : « un artiste est un enfant expérimenté ». Cela allait idéalement à Jany Gastaldi. On ne refera pas ici tout son parcours. Des légendaires « quatre Molière » de 1977-78, (et au-delà car l’ensemble fut souvent repris), Jany Gastaldi travailla beaucoup, dans les années qui suivirent, avec Antoine Vitez. Mère Courage, Les Miracles, Faust, Electre, Andromaque, Britannicus, Hamlet, Hernani, et enfin le Le Soulier de satin, Jany fut de toutes les aventures. Parmi les autres metteurs en scène avec lesquels Jany Gastaldi a travaillé, il y a Alain Françon de Chambres de Minyana à Petit Eyolf d’Ibsen. On l’a retrouvée avec Christian Schiaretti pour Par dessus bord de Michel Vinaver. Mais pas de metteur en scène, n’était Antoine Vitez, qui tint plus de place dans son parcours, qu’un autre. Toute une génération a voulu Jany dans ses distributions . Citons dans le désordre, Daniel Mesguich, CharlesTordjman, Brigitte Jaques, Allain Ollivier pour qui elle incarna Madame dans Les Bonnes, Henri Ronse, Guy-Pierre Couleau, Sophie Loucachevsky, Jean-Claude Fall, Robert Cantarella, Adel Hakim, Daisy Amias, Jean-Pierre Miquel. Est-ce son dernier rôle au théâtre ? Peut-être. Elle fut une Philaminte acide et drôle dans Les Femmes savantes de Molière dans une mise en scène de Marc Paquien, à la Tempête, en 2012. Jany Gastaldi fut aussi souvent sollicitée par des réalisateurs. Elle avait un visage qui prenait à merveille la lumière, et cette voix de fée qui charmait comme la voix d’une sirène…Elle incarnait des singulières, des êtres à part. De René Féret à Martine Dugowson et au-delà, en passant par Claude Lelouch, elle a beaucoup tourné et on n’oublie pas son joli visage, fin et expressif, son regard sombre et flamboyant. Nous reparlerons d’elle. Ici et là. Ne l’oubliez pas. Armelle Héliot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2024 6:17 PM
|
Par Copélia Mainardi, publié par Libération le 25 nov. 2024 Conjuguant aide financière et accompagnement professionnel, le fonds de soutien francilien aux artistes de moins de 30 ans sélectionne à chacune de ses sessions une quarantaine de créateurs à épauler. Se rapprocher des jeunes créateurs pour, qu’en retour, ils se rapprochent de la région : voilà qui pourrait résumer l’ADN de FoRTE (Fonds régional pour les talents émergents). Le dispositif, qui propose d’aider, à hauteur d’un million d’euros annuel, une quarantaine de lauréats issus des arts visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, de la musique et des arts de la scène, se veut aussi souple que possible dans ses critères d’éligibilité. Certains sont immuables : les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans, créer et résider en Ile-de-France, et être accompagnés par une structure professionnelle. D’autres le sont moins. En théorie, il faut ainsi être diplômé ou avoir «suivi une formation qualifiante» dans l’une des disciplines, «mais, en pratique, on peut être éligible en sortant d’une simple formation Afdas [Assurance formation des activités du spectacle], car ce qui compte, c’est le projet présenté», précise Benoit Solès, conseiller régional francilien et membre de la présidence du jury. Ce projet n’a d’ailleurs pas forcément vocation à être le premier : le dispositif cible les artistes «émergents», mais nombreux sont les lauréats qui ont déjà une ou deux réalisations à leur actif. Deux types de soutien Sur une durée de dix mois, FoRTE s’attache à apporter deux types de soutien. Le premier sous forme d’une aide financière, qui peut être perçue via une bourse individuelle ou à travers une subvention touchée par la structure d’accompagnement. La bourse est plafonnée à 25 000 euros (soit l’équivalent de 2 500 euros mensuels) et généralement touchée en deux fois : au lancement du projet, puis à la fin de la création. La subvention, quant à elle, peut atteindre 50 000 euros : «Un budget qui comprend la rémunération de l’artiste», précise François Demas, conseiller culture de la région. Le choix du type d’aide se fait au cas par cas, pour coller au plus près des besoins de chaque dossier. Le second soutien est un accompagnement à travers des conseils, de la mise à disposition de matériel et de lieux et de la mise en relation des artistes. Lui-même comédien, Benoit Solès connaît bien les difficultés du milieu : «Le manque de salles de répétition, l’absence d’aide à la diffusion, la difficulté de décrocher un premier coup de pouce… C’est pour pallier ces carences que le dispositif FoRTE a été créé». Durant tout le temps de leur création (et même après), les lauréats peuvent ainsi se tourner vers différents responsables, comme Alpar Ok, chef de projet Jeune création de la région. Et ce, aussi bien pour obtenir des détails pratiques et techniques (sur les conventions, par exemple) que pour poser des questions relatives à leur projet. La région Ile-de-France affiche la volonté d’avoir «sanctuarisé et fortement augmenté son budget culture, estimé à 103 millions d’euros en 2024», décrit François Demas, conseiller culture à la région. Concentrant 50 % des artistes français, l’Ile-de-France est particulièrement riche en offre culturelle, mais celle-ci reste inégalement répartie sur le territoire francilien. La région espère donc que FoRTE gagnera en visibilité, pour «inclure de plus en plus d’artistes issus de catégories sociales sans accès immédiat à la culture», explique-t-il. Pour l’instant, le nombre de candidats est assez stable : autour de 300 chaque année depuis la mise en place du dispositif en 2018. Et deux phases de sélection La sélection des lauréats se déroule en deux phases : un écrémage par les services de la région, qui s’assurent que les dossiers correspondent aux critères d’éligibilité, puis l’examen des dossiers par les quatre jurys – un par discipline. Chacun d’eux est composé d’un conseiller de la région membre de la présidence du jury et de quatre autres profils spécialisés, renouvelés à chaque édition. En 2023, on retrouvait ainsi l’actrice Elsa Zylberstein dans le jury cinéma, tandis que le comédien Nicolas Bouchaud siégeait aux côtés de la danseuse étoile Alice Renavand en arts de la scène. Le peintre Philippe Cognée, qui se prononçait sur les arts visuels, a beaucoup apprécié l’expérience, même s’il regrette que la sélection ne soit que sur dossier. «Quand on est face aux candidats, on ressent quelque chose en plus, qui échappe au travail écrit, justifie-t-il. Mais j’ai trouvé les dossiers exigeants et variés, même s’ils étaient nombreux à proposer quelque chose d’assez ouvertement politique, une tendance en vogue.» Parfois, la région fait aussi appel à d’anciens lauréats : l’an dernier, Valentin Tournet et Gabrielle Hartmann ont tous deux été sollicités pour faire partie du jury musique. «La plupart des candidats avaient pour projet de sortir un disque, mais les styles étaient très éclectiques, et cette diversité devait se retrouver dans nos choix», relate Valentin Tournet. Sa consœur abonde : «C’est l’originalité qui séduit, surtout. Des projets atypiques ont parfois raflé la mise au détriment d’autres plus aboutis.» Car il y a des cases et des cadres, mais aussi des coups de cœur. Copélia Mainardi / Libération Légende photo Les lauréats de la promotion de 2021 du Fonds régional pour les talents émergents. (Hugues-Marie DUCLOS/Hugues-Marie DUCLOS)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2024 9:34 AM
|
Propos recueillis par Sandrine Blanchard pour Le Monde, publé le 25 nov. 2024 Celui qui dirigeait, depuis 2019, la première organisation d’employeurs du spectacle vivant subventionné dénonce, dans un entretien au « Monde », le gel du budget du ministère prévu et les attaques des politiques contre les aides au secteur.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/25/nicolas-dubourg-president-demissionnaire-du-syndeac-le-service-public-de-la-culture-est-dans-une-situation-extremement-critique_6412659_3246.html
A la tête du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) depuis 2019, Nicolas Dubourg, directeur du Théâtre La Vignette-Université Paul-Valéry, à Montpellier, présidera sa dernière assemblée générale syndicale, lundi 25 novembre. Il vient d’annoncer sa démission « afin d’éviter tout conflit d’intérêts », alors qu’il s’est porté candidat à la direction d’un lieu culturel. Le nom de son successeur sera connu lundi 9 décembre. Première organisation d’employeurs du spectacle vivant subventionné, ce syndicat compte plus de 500 adhérents (lieux et compagnies) représentant plus de 15 000 salariés. Il s’inquiète du gel du budget du ministère de la culture et des attaques récentes portées par des politiques contre les subventions au secteur culturel. Dans le projet de loi de finances pour 2025, le budget de la culture a été préservé et devrait être reconduit au même niveau que celui de 2024. Est-ce finalement une bonne nouvelle ? Un budget de statu quo signifie que nous n’aurons pas la revalorisation de 100 millions d’euros que nous avions demandée pour le service public de la culture. Par ailleurs, nous risquons de subir de nombreuses coupes de la part des conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles, villes, à qui l’Etat retire 5 milliards d’euros dans le PLF 2025. Or, 70 % des financements de la culture sont issus de ces collectivités territoriales. Donc, non, ce n’est pas une bonne nouvelle. Sous prétexte que la dette a explosé et que le déficit n’est plus maîtrisé, le budget global 2025 va accélérer le démantèlement des services publics. Tout se passe comme si on avait laissé une situation économique déraper pour justifier des choix politiques qui auraient été proprement insupportables auparavant. Comment qualifieriez-vous la situation actuelle du service public de la culture ? Nous sommes dans une situation extrêmement critique. S’il ne se passe rien, si les projets de budget ne sont pas amendés, on peut s’attendre à ce que, en 2025, des artistes cessent leur activité, des personnels permanents d’institutions publiques soient licenciés et que le nombre de créations et de représentations proposées au public accuse une baisse drastique. En Pays de la Loire, en réponse à ceux qui s’inquiètent d’une baisse du budget de la culture, la présidente de région, Christelle Morançais, a répondu sur X : « Quelle est la pérennité d’un système qui, pour exister, est à ce point dépendant de l’argent public ? N’est-ce pas la preuve que notre modèle culturel doit d’urgence se réinventer ? » Serait-on à un moment de bascule sur la question de l’engagement des collectivités locales ? Elle fait tomber le masque. Quand les débats sont simplifiés à outrance de manière ultradémagogique, comme ça a été le cas lors de la campagne présidentielle américaine, et qu’en plus ils sont relayés par certains médias, il est facile aujourd’hui de créer des cibles. Si on interrogeait les Français, ils seraient certainement très peu nombreux à demander le démantèlement des services publics. Quand on dit que ça coûte trop cher, qu’est-ce que ça veut dire ? Que ceux qui paient des impôts, par exemple, ne souhaitent plus contribuer à l’intérêt général ? On renvoie alors à la question du marché : ceux qui veulent accéder aux services de santé, à l’école ou à la culture n’ont qu’à se le payer. Seulement, quand vous allez au théâtre dans des pays où il n’y a pas de service public de la culture, la place ne coûte pas entre 10 et 20 euros, mais entre 80 et 150 euros. La présidente de la région Pays de la Loire considère que la culture subventionnée serait « le monopole intouchable d’associations très politisées qui vivent d’argent public ». Selon elle, vous êtes tous des « militants » de gauche… Il faudrait rappeler à cette présidente de région qu’il y a, en France, la loi relative à la liberté de création, qui prévoit notamment la liberté de programmation et de diffusion. On a réussi à créer en France un système qui libère les artistes non seulement des influences politiques, mais aussi des influences du marché, et protège la liberté d’expression. Par exemple, dans le spectacle vivant, les financements croisés permettent qu’un artiste ou un théâtre ne soit pas soumis uniquement à l’influence d’un maire ou d’un ministre. En France, on a un cinéma indépendant, un théâtre de création indépendant, etc. La question n’est pas de savoir si les artistes sont d’accord ou pas avec elle. La question est de savoir si elle est contente de vivre dans un pays où les citoyens ont une liberté d’expression, ou pas. C’est tout. La culture a peu de poids dans le débat politique, elle n’est jamais un sujet de campagne électorale… On a actuellement une attaque ciblée. Tous ceux qui considèrent que la liberté d’expression dont on jouit alimente une idéologie qui leur est défavorable s’intéressent de très près à la culture. L’extrême droite et la droite libérale ont parfaitement compris qu’on était dans une guerre culturelle. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que la droite républicaine, la gauche démocrate ou la gauche radicale et écologiste ne disent rien sur le sujet. Des ultralibéraux comme la présidente de région des Pays de la Loire, il y en a toujours eu en France. Ce qui est troublant, c’est qu’elle n’est pas spécialement contestée par les siens. La droite républicaine qui défend un modèle français de service public ne se fait pas entendre pour remettre en cause ce qu’elle dit. Le débat culturel est d’abord un débat sur le vocabulaire. Il y a des mots qui ont été volés, instrumentalisés par nos adversaires. Par exemple, la démocratisation. Auparavant, cela avait un sens très social, c’était donner accès à la culture à des personnes dont le capital économique était faible et dont les barrières symboliques et sociales étaient importantes. Aujourd’hui, la démocratisation à la manière d’un Laurent Wauquiez [président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes] correspond, en gros, à donner la priorité à une culture gauloise, traditionaliste, populiste. La démocratisation est un mot qui est devenu très ambigu lorsque des ministres ou des maires vous disent : « Votre salle est élitiste » ou « Ce n’est pas assez populaire, pas assez mainstream ce que vous proposez. » Mais n’y a-t-il pas une part d’échec depuis quarante ans dans la démocratisation ? En juin, dans une tribune remarquée, dans « Libération », Ariane Mnouchkine écrivait à propos du monde culturel subventionné : « Une partie de nos concitoyens en ont marre de nous : marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. (…) Nous, gens de gauche, nous, gens de culture, on a lâché le peuple. » Comment Ariane Mnouchkine peut-elle s’arroger le droit de dire : « Nous, les artistes de gauche » ? Pour fréquenter de très nombreux artistes, je peux vous affirmer que les nuances politiques dans notre secteur sont très importantes. Qui que ce soit, y compris Ariane Mnouchkine, ne fait pas la synthèse idéologique de notre secteur. Chaque jour, des compagnies et des artistes travaillent dans des quartiers populaires, en zone rurale, en prison, ou auprès de personnes en situation de détresse psychiatrique. Que réclament-ils ? Des moyens. Nous n’avons pas failli, nous sommes prêts à en faire mille fois plus, mais, quand on propose des ateliers à l’école, à l’université, des interventions à l’hôpital ou en prison, les portes se ferment parce qu’on nous répond qu’il n’y a plus de budget. On vit dans un pays où il y a dix mille personnes qui pensent que Paris est le centre du monde. C’est ça le problème aujourd’hui. A voir le monde avec des mauvaises lunettes, on a du mal à l’observer. Il n’y a pas que le Festival d’automne à Paris et le Festival d’Avignon l’été. Ailleurs, la démocratisation est à l’œuvre. Des gens très variés, des jeunes, dont les parents n’ont pas fait des études supérieures, et ne sont peut-être jamais venus au théâtre, composent le public. Mais l’essentiel des financements publics pour la culture est concentré sur Paris. A un niveau délirant. Quatre théâtres nationaux sur cinq sont à Paris, l’essentiel des centres dramatiques nationaux et des scènes nationales est concentré dans la banlieue parisienne, et une majorité des compagnies et des moyens de création sont en Ile-de-France. Le spectacle vivant représente à peine 1 % des réservations sur le Pass culture. Rachida Dati souhaite réformer la part individuelle du Pass et propose, notamment, de réserver une partie de la somme attribuée aux jeunes au spectacle vivant. Cela vous satisfait-il ? La part individuelle du Pass culture ne relève pas d’une politique culturelle mais d’une politique économique, à travers laquelle l’Etat, par, pourrait-on dire, une distorsion de marché, soutient des entreprises à but lucratif. Quand on fait une politique qui finance la demande plutôt que de financer l’offre, il ne faut pas s’étonner que ceux qui vont avoir la capacité de communiquer, de faire de la publicité de manière massive, ce n’est pas le secteur public, mais privé. L’an dernier, nous avons collecté des données pour voir combien de billets avaient été vendus dans le réseau public par le biais du Pass : l’équivalent de moins de 20 000 euros sur l’ensemble de la France. C’est ridicule. Ce qui nous permettrait d’avoir plus de jeunes dans nos salles, ce n’est pas le Pass culture. Ce serait d’avoir des médiateurs, un travail de relais avec des associations, des programmes de pratiques artistiques, bref, du personnel et des compétences, mais certainement pas une application de géolocalisation. Donc, selon vous, ce projet de réforme ne changera rien ? Depuis le début, nous demandons l’abrogation de ce dispositif. Plutôt que de mettre un quota de 15 % ou 20 % pour le spectacle vivant, nous préférerions que soit annoncée une diminution de la part individuelle pour refinancer les lieux. Le Pass culture coûte 250 millions d’euros par an. Prenons 100 millions sur cette enveloppe et utilisons-les pour financer le secteur que la ministre appelle à fréquenter. La Cour des comptes, le Sénat, tout le monde critique le Pass culture. La seule raison pour laquelle il va encore vivre quelque temps en étant amendé à la marge pour limiter les dégâts, c’est parce qu’il s’agit d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron en 2017. Pour créer ce dispositif, le ministère a été capable de récupérer 250 millions d’euros. Alors prenons cet argent pour faire de vraies politiques publiques de la culture, pour refinancer enfin un secteur qui ne l’a pas été depuis vingt ans et remettre tout le monde à flot. Le Pass n’est pas la bonne politique, mais c’est le bon budget. Sandrine Blanchard / LE MONDE Légende photo : Nicolas Dubourg, à Paris, le 20 novembre 2024. SOPHIE LERON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 24, 2024 11:29 AM
|
Par Marie-José Sirach dans L'Humanité - 24 nov. 2024 Marcial Di Fonzo Bo revient en Argentine sur les traces d’un musicien disparu au temps de la dictature. Un récit captivant de Davide Carnevali. D’abord, le titre. Énigmatique, intrigant. Portrait de l’artiste après sa mort. Seul sur scène, dans un décor en construction, une sorte de studio tout ce qu’il y a de plus simple, Marcial Di Fonzo Bo regarde les techniciens s’affairer. Au-dessus de lui, un écran sur lequel s’affiche le plan de Palermo, l’un des quartiers les plus en vogue de la capitale argentine. Sur un tableau accroché à une cloison, on peut lire : Argentine, 1978. Un jour, Marcial reçoit une lettre en provenance du ministerio de Justicia y Derechos humanos, avenida Sarmiento 329, Buenos Aires, Argentine. Son prénom est mal orthographié, Marzial, un z à la place du c. Mais l’adresse est bonne. Le courrier évoque la réaffectation d’un appartement sis Avenida Luis Maria Campero 726, à Buenos Aires, dont Marcial aurait hérité d’un oncle, un certain Jorge Luis Di Fonzo. Marcial n’a jamais entendu parler d’un tel oncle. Plusieurs failles spatio-temporelles Avec Davide Carnevali, l’auteur de la pièce, ils décident de se rendre à Buenos Aires pour tenter de comprendre l’affaire. Pour Marcial, argentin de naissance, français d’adoption, c’est un retour au pays natal dans des conditions étranges. Quant à Davide Carnevali, il tombe malade à peine arrivé et ne sortira pas de l’appartement, plutôt glauque, qu’ils ont loué sur Airbnb. Marcial, seul sur scène, nous conte cette histoire. On est tout ouïe. Le récit va s’articuler autour d’un Argentin, un certain Luca Misiti, compositeur, pianiste, disparu sans laisser de traces le 25 juin 1978, le jour de la finale de la Coupe du monde que remporta l’Argentine face aux Pays-Bas. Où l’on découvre avec Marcial que Misiti fut le dernier occupant de l’appartement de l’oncle Di Fonzo. L’appartement est resté en l’état : vieille radio posée sur le plan de travail de la cuisine, fauteuil, table basse et son cendrier en cristal, tapis. Seul le piano, dont on devine l’emplacement, n’est plus là. Enfin, pas tout le temps là. L’histoire de Misiti va faire écho à celle de Schmidt, sans la lettre d (dont le musicien argentin avait retrouvé les partitions), un pianiste juif allemand lui aussi porté disparu alors qu’il s’apprêtait à fuir la France de Vichy. Le récit vertigineux auquel nous convie Marcial Di Fonzo Bo se déploie sur plusieurs échelles spatio-temporelles, dans une superposition où passé et présent s’entrecroisent sans que jamais le spectateur ne perde le fil d’Ariane de cette intrigue. Cette histoire fait même ici un détour par la bataille d’Alger, les méthodes employées par quelques officiers français ayant inspiré leurs « homologues » argentins. Dans l’appartement de Misiti, aucune trace du vieil oncle de Marcial. C’est comme si personne n’avait habité là depuis ce 25 juin 1978. Marcial imagine la scène. Et nous avec. Une vieille Ford rouge aux vitres enfumées. Un flic en civil, visage caché par des lunettes noires. Les cris de détresse de Misiti se confondent avec les cris de joie des supporters argentins. La Ford démarre, direction l’Esma, l’École de mécanique de la marine, qui fut un centre de torture. C’est de là que décollaient les avions pour jeter les corps des prisonniers au-dessus de l’océan. Entre réalité et fiction Tous les indices concordent pour enrichir le récit. Et pourtant, où est la vérité dans cette histoire ? Toute ressemblance avec des personnages ayant existé est voulue, assumée, revendiquée. On est à la fois troublé par ce récit où fiction et réalité ne cessent de se renvoyer la balle. Y a-t-il eu jamais un Misiti ou un Di Fonzo habitant Avenida Luis Maria Campero, 726, Buenos Aires. Le spectateur se prend au jeu. Portrait de l’artiste après sa mort tient de la contre-enquête et d’une course-poursuite contre l’oubli, celui qui efface de nos mémoires l’Histoire. Combien de Misiti ou de Schmidt sont-ils tombés dans les limbes de l’Histoire ? Les spectateurs sont pris à témoin. Mieux, ils sont totalement immergés dans ce qui se joue sous leurs yeux. Le piano semble le seul témoin de la scène d’enlèvement. Les notes jaillissent de l’instrument sans que personne n’en joue. Les fantômes des disparus hantent cet appartement. Un appartement témoin soudain transformé en musée et que les spectateurs, invités à monter sur le plateau, vont alors visiter. En 2023, l’Esma est devenue musée de la Mémoire de l’Argentine. Le texte de Davide Carnevali est créé pour être adapté à tous les pays en fonction des acteurs qui l’interprètent. Le théâtre soudain, ici, prend tout son sens : il ne parle pas au nom d’une personne en particulier mais de tous ceux qui sont passés entre les mains de la dictature, pour qu’ils ne soient pas morts pour rien. Portrait de l’artiste après sa mort (France 41-Argentine 78), jusqu’au 27 novembre, au Théâtre de la Bastille, Paris, 11e. Rens. : theatre-bastille.com Tournée : les 15 et 16 janvier 2025 au CDN de Montluçon ; du 20 au 22 février 2025 au Théâtre de Liège, Belgique, et du 26 avril au 7 mai 2025 au Quai-CDN d’Angers. Le texte est publié aux Solitaires intempestifs. Légende photo : Le récit s’articule autour d’un Argentin, un certain Luca Misiti, compositeur, pianiste, disparu sans laisser de traces le 25 juin 1978.
Photo © Victor Tonelli

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2024 12:27 PM
|
Rencontre avec l’acteur et metteur en scène, qui convoque les fantômes de la dictature dans «Portait de l’artiste après sa mort» au théâtre de la Bastille et observe depuis la France, entre colère et inquiétude, la présidence de Javier Milei. «Je m’appelle Marcial Di Fonzo Bo ; je suis acteur, metteur en scène et directeur du Quai, Centre dramatique national d’Angers. Je suis né à Buenos Aires le 19 décembre 1968…» Ça commence comme ça : seul en scène au théâtre de la Bastille à Paris, Marcial Di Fonzo Bo décline son identité devenue texte pour la pièce Portrait de l’artiste après sa mort de Davide Carnevali. Le reste se joue dans une histoire à tiroirs à la Borges, retour sur les années de dictature en Argentine, les enlèvements, les desaparecidos, avec cette idée que le théâtre peut mener l’enquête, faire parler les fantômes, au moins leur donner une identité. Bien sûr que ce que raconte Marcial ne lui appartient pas, quand bien même il est dans le texte comme dans la vie «Argentin mais Français d’adoption […] arrivé à Paris à la fin des années 80». Carnevali s’appuie sur les codes du théâtre documentaire pour mieux les détourner, créer des effets de réel qui embarquent même les spectateurs invités à monter sur scène, entrer dans le décor, à ne plus savoir ce qui est vrai. «Car il y a une vérité historique, celle de la dictature, qu’on enterre aujourd’hui sous des tonnes de mensonges», embraye immédiatement Marcial Di Fonzo Bo, rencontré dans un café parisien, qui, plutôt que de parler de lui, fonce sur la situation de son pays d’origine, l’Argentine de Javier Milei, élu président il y a un an. «Un monstre de fiction inventé par le capitalisme ultraviolent, un Joker avec mèches folles et tronçonneuse, tout y est, un type délirant qui communique avec son chien mort, censé lui donner des ordres depuis l’au-delà.» «Une société qui explose à tous les niveaux» Bienvenue dans l’ère de l’ultrafiction au service d’un programme concret : destruction définitive de l’Etat, discours négationniste de la vice-présidente, fille de militaire, qui fait des selfies avec les tortionnaires en prison et raconte qu’il y aurait moins de 3 000 disparus pendant la dictature alors qu’on estime qu’ils étaient plus de 30 000, enrage Di Fonzo Bo. «Ce type est en train de vendre son pays à des entreprises étrangères qui auront le droit de puiser le pétrole argentin sans employer la population locale, le dollar va remplacer la monnaie nationale… Ça produit une société qui explose à tous les niveaux : mes sœurs restées en Argentine appartiennent à des camps totalement opposés et les voisins commentent nos origines italiennes, ça, je ne l’avais jamais vu.» Marcial Di Fonzo Bo reprend son souffle, la colère ne retombe pas, cette colère qui l’anime depuis son adolescence sous la dictature militaire, à grandir et traîner dans la rue, les bars homos. Mais à l’époque, la colère était joyeuse «dans un mouvement de contestation génial qui passait par la scène rock. J’y ai appris qu’on pouvait dire une chose tout en faisant croire qu’on en disait une autre ; j’ai choisi de le faire au théâtre». Marcial a 18 ans, il commence le Conservatoire, et puis c’est l’exil, comme son oncle et sa tante Facundo et Marucha Bo, comédiens de la bande des Argentins de Paris, celle d’Alfredo Arias ou de Copi, l’avaient fait à la fin des années 60. Il lui faut deux ans pour apprendre le français, avant d’intégrer l’école du Théâtre national de Bretagne de Rennes à 22 ans. L’élève va vite, surdoué. Le conteur extraordinaire au phrasé envoûtant – il hypnotise chaque soir les spectateurs du théâtre de la Bastille – se révèle metteur en scène inventif au sein du Collectif des Lucioles. On est en 1994, il vient de rencontrer Claude Régy, enchaîne avec Matthias Langhoff et devient ce héros baroque du théâtre des années 90, installé trente ans plus tard à la direction du Quai, Centre dramatique national d’Angers, en successeur de Thomas Jolly. «Aujourd’hui j’ai 55 ans et je suis très inquiet sur l’avenir des jeunes qui choisissent le théâtre, ici en France, plus encore en Argentine. Comment vont-ils résister ? Javier Milei a braqué la presse qu’il a rachetée, puis les artistes en coupant toutes les subventions. Maintenant il s’attaque aux universités, donc à la jeunesse. Mais il y a des signes qui me rassurent. En octobre dernier, pour la deuxième fois, des milliers d’étudiants étaient dans la rue. La prochaine fois, il faut espérer qu’ils vont tout casser.» Portrait de l’artiste après sa mort de Davide Carnevali au théâtre de la Bastille (75011), du 25 au 27 novembre. Puis en tournée à Montluçon, Liège, Angers. Reprise de Dolorosa de Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo du 24 au 28 février au Quai CDN Angers-Pays de la Loire puis au théâtre du Rond-Point, à Paris ; et au TNB à Rennes. Légende photo : Marcial Di Fonzo Bo décline son identité devenue texte pour la pièce «Portrait de l’artiste après sa mort» de Davide Carnevali. (Victor Tonelli/Victor Tonelli)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2024 11:44 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 12 nov. 2024 Cécile Garcia Fogel en a eu l’idée et se met en scène avec une partenaire épatante, Flore Lefebvre des Noëttes. Elles nous rappellent la merveilleuse indépendance de la dessinatrice en jouant « Poussez-vous, les mecs ! »
N’étaient quelques chansons, tous les mots, ici, sont d’une femme exceptionnelle, morte bien trop tôt, en 2020, il y a un peu plus de quatre ans. Elle était née en 1940, à Nantes. Elle était une artiste reconnue, maîtresse de l’observation de son époque. Elle aurait pu être peintre, et elle a laissé de très beaux portraits de ceux qu’elle aimait. Sa famille, ses amis. Claire Bretécher fut une pionnière. Une des rares artistes femmes ayant su œuvrer dans un domaine dominé alors par les hommes, clôturé par les hommes. Elle y eut pourtant de grands amis, tel René Pétillon, son frère, son confident, son ami. Elle travailla un moment avec René Goscinny, mais il y avait entre eux une paroi générationnelle. Elle traversa bien des univers et aura dessiné pour tous les titres connus alors, les journaux de BD, plutôt destinés à la jeunesse, ou encore la presse « féminine », avant de s’émanciper. Les générations d’aujourd’hui ont accès à de nombreux albums, les plus anciens ne peuvent avoir oublié les dessins publiés par Le Nouvel Observateur. Il y a tout cela dans le spectacle offert au Lucernaire par Cécile Garcia-Fogel et Flore Lefebvre des Noëttes. Il y a la brune, Cécile Garcia Fogel, qui a déjà, parfois, mis en scène des spectacles, la blonde, Flore Lefebvre des Noëttes, qui a souvent écrit, et notamment des textes autobiographiques, qu’elle a portés elle-même sur un plateau. Elles ont en partage un talent éblouissant. Cécile Garcia Fogel a été du côté des interviews. D’ailleurs le titre, « Poussez-vous, les mecs ! », vient d’un texte inscrit sur un tee-shirt que la belle Claire Bretécher portait, bien en vue, alors qu’elle était filmée pour un entretien télévisé. Les deux comédiennes vont et viennent. Elles déplacent elles-mêmes les éléments de décor, d’un canapé à des draps de bain pour plage. Ce qui est très malin dans ce spectacle c’est qu’elles sont bien au-delà de toute psychologie, de toute intention de faire rire à toute force. Comme l’était Claire Bretécher elle-même : son humour était sec, sans complaisance et ses dessins le prouvent à l’envi. Brune, piquante, souveraine, ironique, battante, Cécile Garcia Fogel est merveilleuse, Blonde, volontairement protectrice, mais ne craignant aucun excès et parfois maussade, Flore Lefebvre des Noëttes, est irrésistible, dans une manie à donner des conseils et un voile de crainte. Il ne s’agit pas ici d’un « spectacle » drôle à toute force. Les deux interprètes ont réussi à transcrire sur un plateau la manière très originale de Claire Bretécher, si belle et bouleversante, si intelligente et joyeuse ! L’humour de Claire Bretécher est très particulier. Elle voit. Elle comprend les absurdités, les mensonges, d’un petit monde. Celui qu’elle préfère épingler est celui d’une gauche années 70-90 si contente d’elle qu’elle en perd toute pertinence. Le spectacle est d’autant plus jubilatoire qu’il surgit aujourd’hui, dans un monde brouillon, brouillé, et qui craint toute critique. « Poussez-vous, les mecs ! », mais vous, les filles, faites bien gaffe à vos faiblesses et complaisances. Ici, une chose est certaine : le plaisir du théâtre ! Avec une belle équipe de scénographie, Luna Rauck, de lumières, Olivier Odiou, de voix off, Eric Challier et David Houry, de son, Laurent Hernieux, et le violoncelle de Louis Albertosi. Armelle Héliot Lucernaire, à 21h00 du mardi au samedi, à 17h30 le dimanche. Durée : 1h00. Tél : 01 45 44 57 34. Jusqu’au 5 janvier 2025. www.lucernaire.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2024 12:03 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 19 nov. 2024 Au Théâtre de l’Atelier, à Paris, le comédien chaloupe entre tragique et comique dans ses lectures de l’écrivain et poète, truffées d’intermèdes personnels.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/19/victor-hugo-par-fabrice-luchini-une-deferlante-d-emotions-et-de-mots_6403529_3246.html Que Fabrice Luchini soit un phénomène, c’est une évidence. Qu’il soit surtout un exceptionnel comédien est l’autre certitude devant laquelle s’incline le public du Théâtre de l’Atelier, à Paris, où se joue le dernier spectacle de l’artiste (qui le reprendra, à partir du 19 janvier 2025, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, toujours à Paris). Presque deux heures d’une déferlante de sensations, d’émotions et de mots où il n’est question que de Victor Hugo. Hugo encensé par Baudelaire et salué par Péguy. Hugo à qui l’acteur se garde bien d’édifier une statue de marbre mortuaire (ce n’est pas son genre), mais qu’il fait se dresser, aujourd’hui, vibrant, sensuel, humain. Plus nécessaire à nos vies que jamais. S’il ne fallait d’ailleurs retenir qu’une fulgurance de cette ardente représentation, ce serait la nécessité impérieuse des noces entre la poésie et l’humanité. Un cliché ? Oui, mais qui est ici décapé : sans poésie, l’humanité est pauvre en paroles, sans l’humanité, la poésie n’a pas grand-chose à dire. Comment l’acteur opère-t-il ce tour de force ? Dans les premières pages du Soulier de satin (1929), un Annoncier se présente qui avertit chacun : « Ecoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C’est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c’est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant et c’est ce que vous ne trouvez pas amusant qui est le plus drôle. » Paul Claudel n’est pas convoqué sur le plateau, mais Fabrice Luchini aurait pu le citer en préambule programmatique. Pas seulement parce que le public cesse de tousser à l’instant où il l’en conjure, dans une de ses adresses effrontées dont il a le secret. Mais aussi parce qu’il fait naître, dans la salle, un sentiment océanique. Lui appelle ça la fraternité : « Vous êtes 600 à être présents chaque soir, je n’ai jamais vécu cela », s’enthousiasme le comédien. Une impalpable communion Le fait est : une impalpable communion se noue autour de la littérature menée par Hugo vers des hauteurs stratosphériques et que l’acteur sait mettre en scène avec un art consommé du suspense, de l’attente et des montées en puissance. Moins cabot qu’à l’ordinaire, parfois même solennel, et presque douloureux lorsque résonne la Pastorale de Beethoven (« ce sourd qui avait une âme entendait l’infini »), il froisse et défroisse son manuscrit, met ses lunettes, les enlève, agace de sa main droite sa manche gauche, fixe le public d’un œil enfantin mais roué de séducteur patenté. Son visage est plastique. Sa voix vagabonde en confidences ou en invectives. Il feint de bredouiller, avant de dire les vers en droite ligne. Il reste longtemps debout adossé à une table de bois, s’assoit sur la chaise et puis sur le fauteuil. Trois ou quatre déplacements dans l’espace, pas plus. Il se laisse regarder. Il se laisse écouter. Alors on tend l’oreille, happé par le fil d’une narration qui démarre par la mort et s’achèvera par une naissance. Mort de la cinéaste Sophie Fillières (à qui l’acteur rend hommage et qui devait filmer la représentation), mort de Léopoldine, fille chérie dont Hugo apprendra la noyade en lisant la presse dans une brasserie à Rochefort. Naissance enfin, et en clôture du spectacle, d’Israël, dans ce qui est, affirme Luchini, le chef-d’œuvre hugolien : Booz endormi (1859). Un poème où le génie l’emporte sur le talent, car le talent, explique-t-il au cours d’un mémorable aparté, n’est rien d’autre que le savoir-faire. Remarquable performance Et lui, en a-t-il du génie, alors qu’il chaloupe, sans jamais chavirer, du tragique au comique (le récit des séances de spiritisme de Victor Hugo sur l’île de Jersey est un moment d’anthologie à hurler de rire) et distille, chez le spectateur, une envie forcenée de beauté et d’intelligence mêlées. Grâce à cet interprète hors norme, l’art cesse d’être un Everest inatteignable réservé à quelques lettrés. L’acteur se donne en exemple et l’homme ouvre la voie. Comment en est-il arrivé à Hugo ? En passant par Charles Péguy. Comment est-il parvenu à Péguy ? En marchant dans Paris deux heures chaque matin jusqu’à une librairie de Saint-Germain-des-Prés. Pourquoi arpentait-il la capitale ? Pour vaincre ses insomnies. Luchini n’imbrique pas son ego aux mots des poètes pour satisfaire une pulsion narcissique. Mais parce qu’en surgissant de la sorte (lui, sa bronchite, ses névroses et sa psychanalyse) entre un courrier sublime de Baudelaire, une étude pointue de Péguy, des poèmes ou des extraits de La Légende des siècles, de Choses vues ou des Contemplations, il expédie par-dessus bord les complexes de ses spectateurs. Sa représentation est une maïeutique. Cette remarquable performance exige un fin dosage entre expérience et intuition. Ne pas chanter Hugo, ne pas saturer la profération d’effets inutiles, rester à l’équerre des phrases, respecter le « lyrisme de la banalité » et danser avec grâce au-dessus du volcan des pensées. Pour parvenir à cet équilibre et à cette justesse, le talent est un prérequis et l’humilité, un sésame. Après quarante ans de présence dans les théâtres de France et de Navarre, Fabrice Luchini, aujourd’hui, pactise avec le génie. « Fabrice Luchini lit Victor Hugo. Textes, poèmes et Victor Hugo vu par Charles Péguy et Charles Baudelaire ». Théâtre de l’Atelier, Paris 18e, jusqu’au 19 décembre. Puis au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Paris 10e, du 19 janvier au 17 février 2025. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : « Fabrice Luchini lit Victor Hugo », au Théâtre du petit Saint-Martin, à Paris, en décembre 2023. STÉPHANIE GUERTIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 20, 2024 8:51 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 20 nov. 2024 Dans « Skinless », le plasticien et metteur en scène a travaillé à partir de déchets pour plonger le spectateur dans une expérience immersive qui, de manière inattendue, parle d’amour.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/20/festival-d-automne-theo-mercier-un-pirate-dans-le-spectacle-vivant_6404170_3246.html
Peau après peau, mue après mue, Théo Mercier se déplace. Il mute, et fait bouger les lignes. A 40 ans, le cliché du « petit prince des arts plastiques » lui colle encore à la peau. Mais, ces dernières années, c’est en tant que metteur en scène qu’il a trouvé une deuxième reconnaissance. Metteur en scène de quoi, au juste ? Ses spectacles, de Radio Vinci Park à Outremonde en passant par Affordable Solution for Better Living, ne relèvent ni du théâtre, ni de la danse, ni même de la performance, mot fourre-tout servant dorénavant à ranger les inclassables de la création contemporaine. Skinless, qu’il présente à La Villette dans le cadre du Festival d’automne, poursuit cette échappée hors des cases manufacturées comme des étagères Ikea, qui étaient les héroïnes d’un de ses spectacles. Quoi alors ? Est-ce si important ? « Je cherche justement un endroit “entre”, pose d’emblée Théo Mercier dans ce qu’il appelle son « arbre à chats » de Belleville, à Paris, espace plein de coins et de recoins. Des endroits qui viennent pirater nos habitudes de fabrication, de regard, de consommation de la culture. Au départ, je n’avais pas forcément envie d’être artiste. Je savais que l’objet m’intéressait, et j’ai fait une école de design industriel. Dans ce domaine, on ne crée pas des objets pour eux-mêmes, mais pour qu’ils aient une relation à l’individu. Il y a un usage, et dans cet usage, il y a une chorégraphie. Un corps fantôme rôde au travers du dessin d’une table ou d’une tasse. Après, quand j’ai commencé ma pratique de la sculpture, je me suis toujours intéressé à l’aura des choses, à la partie vivante de l’inanimé, sa vibration, son fantôme aussi au loin. Très vite mon travail a commencé à jouer le mouvement, à vouloir s’émanciper de son statut d’inanimé. J’ai travaillé beaucoup autour de cette sorte de chorégraphie à faire par le regard, de danse fantôme des choses. » Le passage de l’« inanimé » (mot impropre pour lui) à l’animé s’est fait insensiblement, d’autant plus que Théo Mercier est depuis vingt ans un spectateur assidu de tout ce que la scène contemporaine offre de plus stimulant. « Cette scène-là m’a toujours plus intéressé que celle des arts plastiques, avoue-t-il. Des créateurs comme Gisèle Vienne, Phia Ménard, Philippe Quesne, Jan Martens, François Chaignaud, avec qui j’ai créé Radio Vinci Park, et par-dessus tout Romeo Castellucci, ont eu un rôle fondamental. Ce sont des artistes qui proposent des expériences sensorielles et temporelles particulières, des créateurs de mondes. Ils m’ont magnétisé. J’ai eu l’envie de réunir la force respective de ces temples et de ces rituels que sont le musée et le théâtre, de venir créer du déplacement dans ces deux endroits, et de mélanger la magie blanche de l’un et la magie noire de l’autre. » Les coups d’essai ont été des coups de maître, pour le designer sculpteur plasticien qui n’a jamais suivi aucune formation théâtrale ou chorégraphique. De Radio Vinci Park, rituel érotique et machinique, à Affordable Solution for Better Living, où la fameuse étagère Ikea Kallax, produit d’ameublement le plus vendu dans le monde, prenait peu à peu le pouvoir sur le performeur qui la montait en direct tous les soirs. Mais c’est avec Outremonde, magnifique méditation sur les ruines et le temps, spectacle déambulation en trois volets créés à la Collection Lambert en Avignon, à Zurich et à la Conciergerie à Paris (entre 2021 et 2023), que Théo Mercier a vraiment trouvé son endroit « entre » les mondes des arts plastiques et du spectacle vivant, un endroit unique dans le paysage d’aujourd’hui, où les catégories s’abolissent. Et c’est ce qu’il poursuit avec Skinless, où l’écologie est au cœur du processus de création, sans être pourtant le sujet de la pièce. « Outremonde a été un projet très important pour moi, et pour la compagnie de spectacle et le studio d’art que je dirige parallèlement : c’est le projet où je suis vraiment arrivé à mélanger mes deux savoir-faire, la sculpture et la mise en scène. Que faire après ? Je pars toujours de la matière, je ne suis pas un artiste minimal. Mais il est devenu évident que cette matière, je veux l’emprunter au monde et la lui rendre, et non la piller et la jeter. Et je veux pouvoir la trouver sur place, sur tous les lieux de diffusion du spectacle. C’est ce que nous avons fait avec le sable, qui était la matière-sujet d’Outremonde. En me demandant comment concevoir un spectacle qui puisse tourner sans déplacer de scénographie ni d’objets, en m’interrogeant sur la matière que l’on trouve partout dans le monde, je suis tombé sur les déchets, passionnants à bien d’autres égards. » Les déchets ? Eh bien oui. Ils sont la « matière-sujet » de Skinless : cent tonnes d’ordures non organiques, issues du recyclage effectué dans les poubelles jaunes, sourcées localement, compressées, et qui forment un ring sur lequel évoluent trois performeurs. « Les spectateurs sont debout autour de cette scène, et sont en contact direct avec la matière, précise Théo Mercier. Les déchets ne sont pas lavés, juste compressés, et même s’ils ne sont pas organiques, ils sentent mauvais et sont envahis d’insectes. C’est vraiment du spectacle vivant ! Je voulais que toute la sensualité et le poids du réel soient là. » La question des ruines Les ordures ont pourtant mené Théo Mercier à l’amour, dans un mouvement qui pourrait rappeler le cinéaste Rainer Werner Fassbinder, un artiste qu’il ne cite pas mais auquel on ne peut s’empêcher de penser à son propos, dans sa manière d’aller déterrer une forme de romantisme et de beauté dans la crasse de la vie. « Skinless est une histoire d’amour, de séparation et de métamorphose. Ce qui m’intéresse avec ces rebuts, c’est de dire que ce sont nos peaux, nos mues. Ce que nous avons laissé, ce que nous avons fait de nos vies d’avant, de nos festins, de nos scènes d’amour. On se retrouve sur un tas de peaux mortes, et qu’en faire ? C’est une sorte de jardin d’Eden inversé. Qu’est-ce qu’on fait de ce monde abîmé ? Qu’est-ce qui peut en naître ? La dimension contestataire et subversive des restes m’intéresse : c’est l’endroit du sale, de l’interdit, de l’obscurité, qui a ce potentiel de mise en désordre du monde. Et donc de renaissance, de mouvement vital. » Les déchets, ce sont aussi des ruines − moins nobles que celles qu’on identifie habituellement, ce qui correspond à notre temps d’aujourd’hui −, motif qui est au cœur de l’œuvre multiforme de Théo Mercier. L’artiste est d’ailleurs un grand lecteur d’un livre important, Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, d’Anna Tsing, aussi bien que des travaux des philosophes Emanuele Coccia et Donna Haraway. « La question de la ruine, elle a été là depuis le début dans mon travail, confirme Théo Mercier. Sans doute est-ce une vision romantique du monde. La ruine est un endroit du passé et du présent en même temps. Elle rejoint celui du fantôme, de la part manquante. Ces zones manquantes, d’ombre, de trouble, ce sont les leviers que j’utilise pour raconter le monde. Cette manière d’investir une forme d’archéologie et ces machines à créer de la fiction que sont le musée ou le théâtre, c’est une façon d’inverser un système de valeurs : créer un monde renversé, c’est peut-être faire un premier pas vers le nouveau. Il n’y a aucune dimension apocalyptique dans mon travail, au contraire. » « Skinless », à La Villette, du 21 novembre au 8 décembre. Cet article fait partie d’un dossier réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Festival d’automne à Paris. Fabienne Darge / LE MONDE Légende photo : L’artiste plasticien et metteur en scène Théo Mercier, le 2 décembre 2022. LOBATO
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...