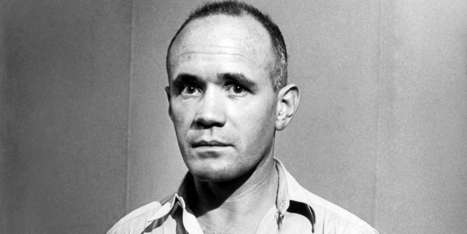Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 13, 2020 6:11 PM
|
Par Grégoire Biseau dans M le magazine du Monde 10/10/2020 Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Mais à l’heure de l’apéro, l’acteur doublement césarisé se prépare à faire son entrée sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Alors, va pour un café à 14 heures. C’était perdu d’avance. On ne prend pas un apéro, à l’heure de l’apéro, avec un acteur de théâtre. Ce tocsin du lâcher-prise, qui sonne aux alentours de 19 heures, est totalement contre-indiqué par les metteurs en scène. A cette heure-ci, un acteur de théâtre n’est là pour personne. Il se prépare à monter sur scène. Et généralement, cela suffit amplement à sa peine. Swann Arlaud, qui joue tous les soirs depuis le mercredi 30 septembre, nous a donc donné rendez-vous à 14 heures, dans un café-restaurant du 11e arrondissement de Paris. Il habite le quartier. Ici, il a ses habitudes. Il y vient souvent prendre un pot, lire des scénarios. La décoration est au diapason d’une gauche gentiment alter mais pas militante, décontractée, un poil branchée mais conviviale. Dehors, il pleut comme dans un film de Claude Sautet. 14 heures, c’est l’heure de rien. Sauf peut-être du café. D’ailleurs, il ne sait pas très bien quoi répondre à la serveuse qui vient prendre sa commande. Il précise que si cela avait été un vrai apéro, il aurait pris une bière. Direct. Sans hésiter. Il commande donc un café. Puis très vite se ravise : « Ça te dérange si je mange un peu ? Parce que, là, je suis un peu décalé. » (Oui, Swann Arlaud tutoie son interlocuteur, sans même lui demander son avis.) Enfant de la balle A la vraie heure de l’apéro, donc, Swann Arlaud est au Théâtre du Rond-Point et se prépare à devenir un jeune combattant, dans un Beyrouth imaginaire, ravagé par des guerres intestines. Il joue un monologue, Exécuteur 14, un texte, à la fois râpeux, tranchant et poétique, d’Adel Hakim. Il arrive vers 18 heures, deux heures et demie avant les trois coups et fume une clope, croque une pomme, marche sur le plateau, face aux gradins vides de la salle. Comme pour domestiquer la chose. Il dit que le trac n’arrive que plus tard, une grosse demi-heure avant le noir complet. Lui qui n’a que deux pièces à son compteur dit aussi qu’il « progresse », qu’il a « gagné trois heures en dix ans ». En 2010, lors de sa première expérience théâtrale, déjà au Théâtre du Rond-Point et déjà mise en scène par sa maman, Tatiana Vialle, il arrivait vers 14 heures. « Je ne pouvais rien faire d’autre de ma journée, j’étais totalement angoissé. » Aujourd’hui, l’acteur, doublement césarisé (meilleur acteur pour Petit Paysan, d’Hubert Charuel, et meilleur second rôle pour Grâce à Dieu, le film de François Ozon), s’autorise une facétie que beaucoup de comédiens assimileraient à un supplice chinois. Caché dans les coulisses, il aime regarder la salle se remplir lentement, épier les spectateurs en train de s’installer, défaire leur manteau, se parler à voix basse… Il ajoute que le masque a au moins cet avantage qu’il lui permet de ne pas reconnaître les personnes qu’il connaît. « J’aime bien ce côté tapi dans l’ombre. » Ce projet est une vieille histoire. Il y a quatre ans environ, sa mère, longtemps directrice de casting et aujourd’hui metteuse en scène, lui exprime le souhait de monter une nouvelle pièce avec lui. Il part alors chercher dans sa bibliothèque le texte d’Adel Hakim, qu’il avait soigneusement conservé, et dont il avait refait la couverture pendant ses études aux Beaux-Arts de Strasbourg. C’était ça ou rien. C’était surtout évident, pour tous les deux. Quand il avait 15 ans, sa mère l’avait emmené à une représentation du texte, alors interprété par l’acteur Jean-Quentin Châtelain. Ce fut pour lui une déflagration. Un choc émotionnel, dont il a gardé encore toutes les vibrations. Mais lui, l’enfant de la balle (son beau-père est l’ancien chef-opérateur et réalisateur Bruno Nuyten, son grand-père, l’acteur Max Vialle, et son grand-père par alliance, Jean Carmet), qui n’a jamais vraiment voulu embrasser ce métier d’acteur, n’avait jamais pensé monter ce texte, jusqu’à ce jour. « Les larmes, elles viennent du travail : à force de faire les choses, de les répéter, il y a une mémoire sensible, physique… comme si le corps comprenait la force des mots. » On lui fait remarquer que ce compagnonnage artistique avec sa maman est plutôt original… Il répond du tac au tac, comme s’il avait attendu la question depuis le début. « Non, Nicole Garcia travaille, par exemple, souvent avec son fils Frédéric Bélier Garcia. En fait, je crois assez à l’entreprise familiale. Ça nous fait gagner un temps fou dans le travail. Elle sait jusqu’où elle peut m’emmener, et ce qu’elle ne peut pas me demander. Et puis, on peut tout se dire. Un jour je peux lui balancer : “bon alors là, c’est bon, tu m’as trop parlé, tu me saoules”. Ce que je ne pourrais pas faire avec un autre metteur en scène. » On insiste : « Ce lien mère-fils n’est pas trop encombrant dans le travail d’acteur ? » Il sourit : « Je ne comprends pas la question. Je suis le fils de ma mère. Mais nos rapports sont très équilibrés. Ce projet, il existe grâce à elle, mais aussi grâce à moi. On travaille vraiment ensemble, ce qui me permet de me mêler un peu de tout, y compris de la mise en scène. Et puis, il y a beaucoup de pudeur dans notre relation, il n’y a pas de lien qui vient interférer là-dedans. » Un blanc s’installe. On s’apprête à rebondir, quand il nous attrape le regard. « Le seul grand inconvénient de cette relation, c’est qu’il faut toujours que je répète la même chose aux journalistes. » Il le dit sans une once d’agressivité. Nous, évidemment, on entend très distinctement : « Bon, c’est bon, là, on passe à autre chose, ça devient un peu chiant, ces questions sur ma mère. » Le temps de reprendre nos esprits, on se demande s’il faut obtempérer ou relancer ? On sent bien qu’un silence est en train de prendre ses aises. Pour se donner une petite prestance, on saisit notre tasse à café, pour s’apercevoir qu’elle est vide. On se dit alors qu’il ne faudra pas oublier, à ce moment du récit, de faire un paragraphe. Une gueule bénie des dieux On a donc choisi de bifurquer. Et de reprendre la parole. « Le jour de la première, j’ai été fasciné par la vitesse à laquelle vous sont montées les larmes aux yeux. » Il enchaîne : « Je ne sais pas pleurer. Au cinéma, il y a des acteurs qui pleurent, comme quand on appuie sur un bouton. Ce n’est pas du tout mon cas. Sur cette scène, initialement, il n’était pas prévu que je pleure, je trouvais ça un peu trop évident, et puis c’est venu naturellement ». Mais ça vient d’où, des larmes d’acteur ? « En ce qui me concerne, elles viennent du travail : à force de faire les choses, de les répéter, il y a une mémoire sensible, émotive, physique… comme si le corps se souvenait et comprenait la force des mots. Je pense que n’importe quel acteur qui répète des dizaines de fois “La personne que j’aime est morte”, eh bien, il se met à chialer. Il faut juste prendre le temps de prononcer distinctement les mots, et ça vient. Aujourd’hui, mon problème, c’est plutôt ne pas me faire submerger. A la générale, je me suis fait avoir, je me suis laissé déborder, ça a été épouvantable. Tout cela manquait de pudeur. » « J’ai tiré une croix définitive sur la représentativité de la classe politique. En fait, ces gens ne nous représentent pas du tout. » A le regarder parler, on se dit que ce garçon de 39 ans a une gueule bénie des dieux. Douce et anguleuse, coupée à la serpe et percée de deux yeux bleus, à la fois enfantins et inquiétants. Incroyablement juvénile, Swann Arlaud pourrait encore jouer un garçon de 18 ans, jeune premier chez Marivaux ou toxico dans un film de Jacques Audiard. Tout à la fois, ville et campagne. On lui demande s’il se sent parisien. « Non. Même si j’y habite avec mon fils de 4 ans, je rêve de partir. J’ai grandi dans les Yvelines près de Rambouillet, j’ai besoin du contact de la nature, de la forêt, des rivières. » Le confinement a servi de déclic. « Naïvement, j’ai pensé que nos gouvernants auraient compris qu’il était temps de ralentir la cadence, de ne plus courir après toujours plus de croissance. Mais j’ai vite déchanté. Et là, j’ai tiré une croix définitive sur la représentativité de la classe politique. En fait, ces gens ne nous représentent pas du tout. » Le flot puissant s’est arrêté net. D’un coup, comme stoppé par une digue. Lui qui a signé dans Libération une pétition de soutien aux « gilets jaunes » reprend son souffle : « Ça peut paraître naïf mais j’ai cet idéal de vouloir construire, dans un collectif, quelque chose qui ressemble à un autre monde. Je m’en voudrais de ne pas avoir essayé. » Grégoire Biseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 12, 2020 6:53 PM
|
Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte sur France Culture 12 octobre 2020 Lien pour écouter l'émission (55 mn) Son spectacle "La Brèche" poursuit sa tournée en France après une étape au Centquatre à Paris. L’occasion de s’engouffrer dans la fabrique artistique du metteur en scène Tommy Milliot au micro d'Arnaud Laporte. De l'université à l'Académie Son appétence pour les mots lui vient dès l’enfance et se confirme lorsqu’il découvre le théâtre à onze ans lors d’une sortie avec son professeur de français. Une vocation est née, il la consolide par de multiples formations en mise en scène et dramaturgie. A Nanterre, il suit l’atelier sur l’écriture de Marguerite Duras proposé par le metteur en scène et directeur du théâtre de Lorient Éric Vigner. C’est une révélation, il devient son assistant pour son grand projet l’Académie qui consiste à réunir sept jeunes acteurs durant trois ans pour réaliser plusieurs créations au sein du CDN. Une trilogie est fondée avec La place royale de Corneille, Guantánamo d’après Franck Smith et La Faculté de Christophe Honoré, qui part en tournée dans toute la France. Au cours de cette aventure, Tommy Milliot monte pour la première fois sur les planches et expérimente le jeu. Plus tard, c’est encore une rencontre fortuite, avec Hubert Colas, qui le propulse davantage dans la sphère théâtrale. Celui-ci l’invite à participer au festival Actoral et le soutient en 2014 pour la fondation de sa compagnie : Man Haast. Avec cette dernière, Tommy Milliot se met au service des dramaturgies contemporaines. Une œuvre au service des écritures du présent Entouré d’un noyau de collaborateurs fidèles (Sarah Cillaire à la dramaturgie, Sarah Marcotte à la lumière, Adrien Kanter au son, Matthieu Heydon à l’assistanat à la mise en scène), Tommy Milliot explore les écritures du présent, notamment étrangères et méconnues.Sa première pièce, qui s’intitule Lotissement, est une adaptation minimaliste de Frédéric Vossier qui a reçu le prix du jury Impatience en 2016. Il réalise ensuite Que je t’aime, une performance créée avec Sarah Cillaire où il transpose le mythe de Phèdre dans une salle de sport, puis met en scène En héritage de l’autrice suisse Marie Fouquet. Tommy Milliot réalise ensuite un voyage en Norvège pour rencontrer Frederik Brattberg dont il adapte Winterreise au Festival Actoral en 2017. Il y explore la thématique de la parentalité. En 2019, le metteur en scène présente La Brèche au Festival d’Avignon qu’il adapte d’un texte de l’autrice états-unienne Naomi Wallace. Récemment, Tommy Milliot a mis en scène Massacre, un huis-clos écrit par l’autrice catalane Lluïsa Cunillé, sur invitation de la Comédie Française. Son actualité : La Brèche, mis en scène et scénographié par Tommy Milliot, texte de Naomi Wallace traduit par Dominique Hollier, avec Lena Garrel, Matthias Hejnar, Roméo Mariani, Dylan Maréchal, Aude Rouanet, Edouard Sibé et Alexandre Schorderet. La Brèche sera en tournée : - Du 24 au 26 septembre 2020 à Actoral, Marseille
- Du 7 au 17 octobre 2020 au Centquatre, Paris
- Les 17 et 18 novembre 2020 au Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
- Les 26 et 27 novembre 2020 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Belgique
- Du 16 au 18 mars 2021 à la Comédie de Reims.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 11, 2020 8:14 PM
|
Comment reconstruire sur les ruines ?
Par Léna Martinelli dans Les Trois Coups - 9 octobre 2020
Depuis longtemps déjà, les corps des acrobates défient la gravité. Mais aujourd’hui, certains circassiens rivalisent d’inventivité pour traiter de la chute ou de l’instabilité comme métaphores de l’effondrement. Figure majeure du cirque contemporain, Mathurin Bolze compose justement une chorégraphie sur trampolines au-dessus d’un monde en ruines. Comme d’habitude, un spectacle de haute tenue et à la portée universelle. D’abord, lui et ses complices évoluent dans un espace chaotique composé de déchets recyclés. Ils se terrent. Malgré l’insécurité et une sensation d’urgence, ils ne semblent pas s’inquiéter, en dépit des alertes. La vie suit son cours, tant bien que mal, jusqu’à la catastrophe ultime. Après ce cataclysme, le petit groupe trouve alors un refuge précaire sur des plateaux d’où leur parviennent les images du désastre : la terre est dévastée. Mais, de la table rase, émerge à nouveau la vie. Animée par le désir de liberté, la joyeuse bande s’organise. Le trampoline comme agrès et langage Depuis toujours, Mathurin Bolze creuse les questions de gravité et de suspension grâce au trampoline, sa discipline. Ainsi, dans Fenêtres, le rebond apparaissait comme un moyen d’échapper au carcan social et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Dans ces Hauts Plateaux, les personnages paraissent comme éjectés d’un système déglingué, rejetés d’une planète saturée. Mais le rebond, moyen de s’extraire de la chute, traduit aussi l’idée de sursaut. Comment survivre sans s’élever ? Pour la première fois, Mathurin Bolze agence deux trampolines (un petit et un grand, tantôt horizontal, tantôt incliné). Ce terrain de jeu est propice à d’infinies variations, de la panique à la farandole, car les inquiétantes glissades finissent souvent par de ludiques rebonds. Que de prouesses ! Mais l’intérêt va bien au-delà de la seule performance. Trampolineurs, contorsionnistes, acrobates font œuvre commune pour transmettre, de façon poétique, les valeurs du cirque : prises de risque et complicité, travail de troupe et solidarité… Le tout porté par un souffle épique. Scénographie judicieuse Les variations sont d’autant plus palpitantes qu’elles se déploient en trois dimensions, dans un espace ingénieusement conçu en volume. Les plateformes suspendues créent à la fois du mouvement et de l’immobilité. Mathurin Bolze avait déjà magnifiquement exploité cet agrès, dans Du goudron et des plumes. Il ajoute des échelles, tantôt portes sans issue, tantôt passage aléatoire. L’une d’entre elle, très longue et amovible, ne mène effectivement nulle part. Image parlante sur notre actuelle quête de sens. Pourtant, ce spectacle n’est pas résolument sombre. Matérialisées par les déchets, les ruines permettent de penser des continuités de l’humain. Plusieurs lectures ont nourri le travail, parmi lesquelles la Supplication, de Svetlana Alexievich, un essai consacré à la catastrophe de Tchernobyl, et le Champignon de la fin du monde, où l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing réfléchit sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, à partir de l’étude du Matsutaké, un champignon qui pousse au Japon dans les lieux contaminés par l’homme. Mathurin Bolze s’est alors demandé dans quelle mesure nous sommes comparables à ces végétaux si particuliers, ces dignes représentants du règne fongique. Il s’en est inspiré pour étudier notre rapport au temps, devant l’imminence de la catastrophe, et la capacité de renouveler notre énergie. « Il faut faire confiance au corps circassien pour être résistant dans l’exercice de sa puissance : il raconte quelque chose de la lutte contre la gravité ou les gravités, du monde et des lois physiques. Ainsi, voit-on des ruines, mais aussi un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités », écrit-il. Pulsions de vie et échappatoires Le spectacle regorge de vitalité. Dans la fange, la vie grouille. Puis les nuisances rechargent les corps, galvanisent le groupe. Après les échappées solitaires, les portés fondateurs. Si des questions graves sont abordées, c’est non sans une certaine légèreté. Quelques séquences sont même très drôles. Surtout, les acrobates se jouent de l’apesanteur dans des envolées poétiques et acrobatiques de toute beauté, notamment dans la dernière partie, avec ces élégantes ombres chinoises qui tranchent par rapport à l’esthétique trash du début. Ce passage au noir et blanc pourrait faire référence au philosophe Pierre Rabhi qui prône un retour Vers la sobriété heureuse. Outre la qualité du travail circassien et dramaturgique, saluons donc aussi l’aspect plastique qui contribue à faire de ce spectacle un moyen formidable de sensibiliser le plus grand nombre aux défis qui nous attendent, dont la réhabilitation du collectif, autrement dit le « vivre ensemble ». D’ailleurs, le public de ce soir-là, largement composé de jeunes qui ont applaudi à tout rompre, atteste de sa bonne réception. C’est vrai, comme on était bien ensemble ! ¶ Léna Martinelli Les Hauts Plateaux, de Mathurin Bolze Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi Avec : Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze Dramaturgie : Samuel Vittoz Scénographie : Goury Création sonore : Camel Zekri et Jérôme Fèvre Création lumière : Hervé Gary Création vidéo : Wilfrid Haberey Costumes : Fabrice Ilia Leroy Construction des décors par les ateliers de la MC93 Bobigny Ingénierie scénique : Arte Oh Benoit Probst Durée : 1 h 15 Conseillé à partir de 13 ans MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis • Salle Oleg Efremov • 9, bd Lénine • 93000 Bobigny
Du 2 au 10 octobre 2020 Tournée ici Photo

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 11, 2020 9:07 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 10 octobre 2020 A trente-six ans, il demeure un artiste inventif et rigoureux. La reprise de « La Brèche » de Naomi Wallace au 104 donne un éclat certain à ses talents.
Se faire connaître, dans le monde du théâtre, ne va pas de soi. C’est long. Par-delà le talent, il faut des relais. Né en 1984 dans le Nord, Tommy Milliot possède une personnalité très forte et un sens des textes, de l’espace et du groupe qui sont rares, aujourd’hui, dans les générations du renouvellement. La force de l’adhésion du public, aînés comme jeunes collégiens et lycéens, conduits par leurs professeurs dont on ne soulignera jamais assez le rôle déterminant –ce le fut pour Thomas Milliot- est une éclatante récompense pour le metteur en scène, son équipe artistique (lumière, son, scénographie) et ses comédiens. Le soir où nous avons vu le spectacle, de très grands garçons, des adolescents de 16 ans sans doute, avouaient : « J’ai pleuré… » Tommy Milliot s’appuie sur l’excellente traduction de Dominique Hollier de la pièce de l’Américaine contemporaine Naomi Wallace (entrée au répertoire de la Comédie-Française avec Une puce, épargnez-la ! dans une mise en scène de Anne-Laure Liégeois, sous l’Administration de Muriel Mayette. C’est dans le Kentucky, où elle est née en 1960, que la dramaturge situe l’action de The McAlpine Spillway, traduit en française par La Brèche. Deux périodes, 77, à peine sorti de la guerre du Vietnam, et quelques années plus tard. Quatorze années. Beaucoup, à ces âges-là… Scénographie stricte, lumières, effets. C’est très beau en plus. Un espace strict, minimal, des lumières très finement pensées, costumes, etc…tout est idéal. Saluons cette équipe d’excellence, et, évidemment les comédiens. Deux équipes si l’on peut dire. Mais tous jeunes et très bien armés : voix, présence des corps, mouvements, justesse des regards, malgré les pénombres on ressent ces regards, manières de s’exprimer. Ce sont : Lena Garrel et Aude Rouanet, Jude 77 puis 91, Dylan Maréchal, Acton qui est celui qui disparaît, le petit frère de Jude, Roméo Mariani et Matthias Hejnar, Hoke 77 puis 91, Edouard Sibé et Alexandre Schorderet, Frayne 77 et 91. Cela parle de l’Amérique, mais cela parle du monde, de la société, aujourd’hui. Tommy Milliot donne son ampleur universelle à la fable. N’épiloguons pas : le plaisir est aussi dans le développement, les suspens, la succession des séquences, autrefois, maintenant, de 77 à 91. C’est l’un des meilleurs spectacles à voir en ce moment à Paris CentQuatre, jusqu’au 17 novembre. A 20h30. Durée : 1h50. Tél : 01 53 35 50 00. Une tournée suit : Aix/Bois de l’Aune les 17 et 18 novembre, Charleroi les 26 et 27 novembre, Comédie de Reims du 16 au 18 mars 2021. Légende photo : Solitude et silence. Crédit : Christophe Raynaud De Lage. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 10, 2020 6:56 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 9 octobre 2020 A travers « Familie » pour Milo Rau et « _jeanne_dark_ » pour Marion Siéfert, deux artistes qui ne sont pas de la même génération portent chacun un regard aigu sur l’adolescence. Via la vidéo pour lui, via Instagram pour elle. Et sur une scène de théâtre pour elle comme pour lui. Le 27 septembre 2007, à Coulogne, village près de Calais, dans leur pavillon rue des Frênes, un père, une mère et leurs deux enfants qui ne sont plus des enfants mais de jeunes adultes sont retrouvés morts, pendus. Ensemble, côte à côte, à la même poutre de la véranda. Un suicide collectif. Une lettre a été laissée qui se termine par ces mots : « On a trop déconné, pardon. » Une autre lettre demande à ce que l’on s’occupe du chien, un caniche. Le père, pré-retraité (cadre dans la chimie) avait peu avant quitté la troupe de théâtre amateur à laquelle il appartenait. Les voisins ont décrit « madame Demeester » comme effacée et un peu dépressive. C’était aussi le cas du père (à qui on avait prescrit des médicaments) et du fils, Olivier, 30 ans, qui n’arrivait pas à faire décoller l’entreprise de transport qu’il venait de créer et qui se résumait à un camion. Le fils était revenu vivre chez ses parents. La fille, Angélique, 27 ans, avait un copain mais elle avait du mal à décoller de la maison. Le 27 septembre, elle avait quitté plus tôt que prévu son travail dans une entreprise de nettoyage, prétextant des maux de ventre. Ni les voisins, ni la police, ni la justice ne perceront le mystère de ce suicide familial. L’affaire sera classée. De Coulogne à Gent Après Five Easy Pieces (sur l’affaire Ducroux, interprétée par des enfants en âge d’être des victimes), après La Reprise (un jeune Arabe homosexuel massacré par ceux qui l’ont pris en voiture, lire ici), Milo Rau, directeur du NTGent, cherchait une suite à ces crimes contemporains. Il voulait une famille. Il a choisi ce fait divers des « pendus de Coulogne », comme titrait la presse régionale pour son mystère : une famille « banale » qui n’était pas surendettée, qui ne se déchirait pas. Selon le manifeste du NTGent que Milo Rau a écrit en arrivant à la direction du théâtre (lire ici), la distribution de ses spectacles doit comporter au moins deux acteurs non professionnels. Ann Miller est une comédienne de la troupe du théâtre de Gent, son mari Filip Peteers est un acteur belge connu du petit écran et du cinéma. Ils ont deux enfants, deux filles, âgées de 14 et 15 ans, Louisa et Léonce Peeters et deux chiens. Milo Rau propose au couple de jouer Familie avec leurs deux enfants et les deux chiens. La famille en discute et accepte. Milo Rau les emmène à Coulogne, ils voient le pavillon aux volets fermés des Demeester (aujourd’hui racheté par un pompier, apprendra-t-on au générique final), c’est le seul lien direct. Tout le reste est… quoi ? Mi-reproduction, mi-fiction ? « Il n’y a pas de fiction, dit Milo Rau. Il s’agit d’un montage de différents éléments, mais tout est vrai dans ce que les acteurs racontent sur leur propre vie. » Laquelle est loin de celles des parents et surtout des « enfants » du fait divers. Ceux de Coulogne étaient de jeunes adultes, ceux de Gent sont des adolescentes. Et là, tout se déplace. Le journal de Léonce Le mystère que cerne le spectacle, c’est celui de l’adolescence et secondairement celui de la famille. La protagoniste, la seule à s’installer au premier plan dans l’espace vide ou plutôt neutre du théâtre devant le décor très réaliste de la maison familiale (salle de bain, salle à manger, chambre des filles, etc.), c’est la fille aînée, Léonce. On le sent, on le pressent, le metteur en scène, l’artiste Milo Rau a été fasciné par tout ce qu’elle recèle, charrie, par l’opacité douce de son visage. Assise sur une chaise, elle regarde une caméra qui la filme, elle s’adresse à nous, son visage (qui plus est, photogénique) est projeté au-dessus sur un grand écran (où défilent les surtitres du texte dit en flamand). Elle nous regarde. Elle tient son journal intime ouvert sur la table, elle nous fait part des idées de suicide qui l’ont traversée. Elle devient le pivot du spectacle. Pour l’issue finale, c’est elle qui choisira les vêtements que porteront chaque membre de la famille. Nombreux sans doute sont les spectateurs qui ont connu ces moments de l’adolescence où l’idée de suicide passe par la tête, ne serait-ce qu’un instant. Ils se projettent dans ce visage, dialoguent intimement avec lui. Tous ces moments de confession sont captivants, troublants et d’autant plus que le visage de l’adolescente se garde de toute expression, tout comme sa voix, étale et douce. Le cinéma offre ses services au théâtre. Milo Rau, autant cinéaste que metteur en scène, sait jouer des castagnettes. Comme, avec raison, il n’a surtout pas voulu expliquer l’inexplicable, il se garde bien d’ouvrir des pistes qui pourraient en tenir lieu. Ce qui le conduit à des scènes volontairement fades, tel ce repas de famille interminable qui s’avérera être le dernier (personne n’a très faim), préparé (en temps réel) par le père qui a été cuisinier avant de devenir comédien. Le théâtre, ses rythmes endiablés et son cortège d’effet est à la peine, il piaffe en coulisse. Il aura tout de même le dernier mot : les pendus reviennent saluer. La « _ jeanne_dark_ » d’Orléans Tapez adolescence sur Internet et tôt ou tard vous tomberez sur cette citation d’une certaine Myriam Alison : « L’adolescence commence le jour où, lorsqu’il suit un western à la télévision, un enfant préfère voir le cowboy embrasser l’héroïne plutôt que le cheval. » La citation est plaisante mais datée. Quel ado, fille ou garçon, regarde encore un western à la télé ? Et même regarde la télé ? Dans Familie de Milo Rau, l’adolescente qui est au centre de son spectacle vit dans un village et préfère regarder des vidéos familiales ou écrire son journal. Dans _jeanne_ dark_ de Marion Siéfert, l’héroïne vit en ville ou en banlieue urbaine, elle a choisi ce nom pour circuler sur les réseaux sociaux et, pour une fois seule dans la maison familiale, se filme sur Instagram. C’est à Orléans, la ville de son adolescence, que l’on avait vu Deux ou trois choses que je sais de vous, le premier spectacle de Marion Siéfert qui tournait autour des pages Facebook des spectateurs présents dans la salle (lire ici). Après deux autres spectacles passionnants, Le grand sommeil (lire ici) et Du Sale ! (lire ici), Marion Siéfert retourne en pensée dans cette ville où la pucelle est reine pour son nouveau spectacle _jeanne_dark_. Jeanne est une adolescente d’aujourd’hui dans laquelle Siéfert projette son adolescence d’hier, une époque, récente mais somme toute lointaine, où Instagram n’avait pas déferlé dans le monde des ados. Comme elle, et comme Jeanne d’Arc, son héroïne a été élevée dans la religion catholique. Comme la paysanne devenue guerrière et comme l’était Marion Siéfert à son âge, son héroïne est vierge. Mais son cul, ses seins, ses lèvres, son nez et ses cheveux préoccupent beaucoup jeanne dark, tout comme ce qu’on dit sur elle, sa réputation. Profitant d’un moment béni car « super rare » où sa mère est à une réunion catho, son père « à l’étranger pour son boulot », son frère et sa sœur en vacances chez la grand-mère, seule donc à la maison, elle se lance, téléphone en main, dans un live Instagram. Extrait : « Voilà. En fait c’est que... voilà... comment dire... depuis la rentrée, ça se passe pas très bien au lycée… J’ai pas trop d’amis. Quand y a un truc, je suis jamais invitée... Bref. C’est chiant. Et en plus... depuis quelques temps... y a des gens qu’ont commencé à se foutre de ma gueule. Au lycée et aussi sur Insta. Ça a commencé parce qu’ils ont vu que sur Instagram je m’appelle jeanne dark... et y a une meuf de ma classe qui a répété à tout le monde que je suis vierge. Et voilà... donc ils disent que je suis coincée. Je suis coincée. Et comme je suis coincée, faut me décoincer, et pour me décoincer bah... faut me dépuceler. Ils m’appellent « cul tendu ». Et ils s’amusent à faire des trucs... genre ils vont me prendre en photo, sans que je m’en rende compte, et après poster la photo de moi trop moche sur Insta et commenter : «#jeannelapucelle » Ils disent que je pue la vierge. Que ma chatte c’est un cimetière. Qu’il faut que je me fasse défoncer le cul une bonne fois pour toutes pour que je me détende. Qu’ils vont me faire couiner. Que des trucs comme ça. Tout le temps tout le temps tout le temps. Au début j’étais en mode : c’est pas grave - je me tais - je n’entends pas ces gens. Ils ne rentrent pas dans mon cerveau. C’est pas grave. Je ne dis rien. Ils sont débiles. Ça va passer. » Théâtre et Instragram Le texte, Marion Siéfert l’a écrit au fil des répétitions avec la phénoménale actrice et danseuse Helena De Laurens (créditée au générique comme « collaboration artistique, chorégraphie et performance »). Elles se retrouvent après Le grand sommeil où Helena interprétait un double rôle d’enfant et d’adulte. Dans une très juste scénographie de Nadia Lauro disant à la fois l’enfermement et déployant la liberté qui s’y installe en vase clos , toute la place est laissée au dialogue entre le personnage et le téléphone qu’elle tient en main ou fixe sur un trépied ou tient au bout d’une perche à selfie. Entre le jeu, la posture et la confession, dans une ambivalence à la fois joueuse et sincère, Jeanne, - sans jamais nous regarder puisque son seul interlocuteur c’est son téléphone, à la fois miroir, double, sparring partner - nous fait partager l’instabilité chronique de ce qu’elle vit entre deux âges, son corps intranquille, ses envies, ses complexes et Dieu dans tout ça. Jeanne n‘a de cesse que de masquer son image qu’elle exhibe cependant, en la déformant, en la tordant, en la maquillant. Bref, en jouant tout en se jouant. Le dispositif est double voire triple. Dans la salle, les spectateurs voient l’actrice évoluer sur l’espace blanc. Sur les côté des captures d’écrans égrènent les messages de ceux qui suivent le spectacle sur Instagram et commentent. Il arrive à l’actrice d’intégrer dans son jeu certains commentaires. « Je veux que le spectateurs puissent expérimenter au théâtre cette présence particulière, de quelqu’un absorbé dans sa propre image. Et inversement, que le spectateurs d’Instagram vivent un type de spectacle, à ma connaissance inédit : une continuité d’1h30 en direct, conçue spécialement pour Instagram« dit Marion Siéfert. Pari doublement réussi. D’autant que , par des respirations musicales des plus variées, elle aère le huis-clos et laisse Helena de Laurens déployer son corps dans une étonnante chorégraphie le plus souvent au sol. Seule voix off, celle de la mère au retour de sa réunion catho : « qu’est-ce que tu fais ! Ouvre ! ». Familie au Théâtre de Nanterre-Amandiers, les 9 et 10 octobre à 20h _jeanne_dark_ au théâtre de la commune d’Aubervilliers, mer et jeu 19h30, ven 20h30, sam 18h, dim 16h jusqu’au 18 oct. Les deux spectacles sont présentés dans le cadre du Festival d’automne. Légende photo : Scène de " _Jeanne_dark_" © Matthieu Bareyre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 8, 2020 7:36 AM
|
Par Joëlle Gayot / Télérama le 8 octobre 2020 Autorisés par dérogation à ne pas porter de masque, les acteurs et chanteurs sont très exposés au virus lorsqu’ils sont sur scène. Plusieurs institutions, comme l’Opéra de Rouen ou l’Opéra-Comique, ont déjà dû annuler des représentations en raison d’infection au virus au sein de l’équipe. Doublures, protocoles de détection rapides, distanciation entre artistes… Chaque maison tente de s’adapter. Répétitions interrompues, représentations reportées voire annulées : il suffit d’un acteur contaminé par le Covid, ou soupçonné de l’être, pour que s’arrête la marche du spectacle vivant et que se creusent ses déficits. Maillons faibles d’un secteur pourtant sécurisé par les mesures sanitaires, le comédien et le chanteur sont les portes d’entrée au vent mauvais de l’épidémie. La raison ? Ils ne portent pas de masque sur la scène, une dérogation validée par décret gouvernemental le 28 août 2020. L’autorisation a été saluée avec soulagement, personne n’imaginant qu’un spectacle digne de ce nom se déroule avec masques. Mais le retour de manivelle ne s’est pas fait attendre. Sans tissu pour se protéger et protéger les autres, les interprètes sont frappés d’anathème. Celui-ci porte un nom : cas Covid. Cas Covid au Théâtre de la Colline, où une mise en quarantaine a suspendu les répétitions de Mes frères, et différé la date de la première. Cas avérés à l’Opéra de Rouen, dont la saison n’a pu s’ouvrir avec Tannhauser, de Wagner. Cas Covid à l’Opéra-Comique, où, deux heures avant le lever de rideau, on annonçait l’annulation du Bourgeois gentilhomme. Double cas Covid à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, où l’Iphigénie de Racine n’a dû son salut qu’à son metteur en scène, Stéphane Braunschweig, venu en personne et le texte à la main, pallier la défection de deux comédiens. L’artiste avait prévu une double distribution. Si un acteur tombait malade, son alter ego prenait le relais. Peine perdue : ses deux Achille ont été diagnostiqués positifs au virus. Au manque de chance, s’ajoute l’évidence : doubler les troupes ne sert à rien. Dans ce combat inégal face à un ennemi ingérable, il faut organiser des protocoles de détection rapide qui paralysent a minima les spectacles. Le Théâtre de la Colline a conclu un accord avec un laboratoire. Le secrétaire général, Arnaud Antolinos, s’en explique : « Nous avons négocié trente places pour les tests le vendredi matin. Les acteurs qui ne font pas la queue ont les résultats rapidement. » Personne ne peut contraindre l’interprète à se faire détecter. « Ils sont responsables », concède Benoît Lavigne, directeur général du Lucernaire, « mais s’ils présentent des symptômes, on leur demande de vérifier. » Dans ce théâtre privé, la bronchite d’une actrice a entraîné l’annulation d’une soirée. Son partenaire de jeu préférait ne pas prendre de risque. Résultat du test ? Négatif. Benoît Lavigne s’estime heureux, la réponse est tombée rapidement. Mais il s’inquiète : « Ce phénomène va se répéter. Que fera-t-on si les délais sont trop longs ? Est-ce qu’on joue malgré tout en mettant peut-être l’autre en danger ou est-ce qu’on arrête tout selon le principe de précaution ? » “Il aurait fallu identifier les corps de métier ayant besoin de tests ultrarapides pour exercer leur profession.” Julie Deliquet, directrice du théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis Tout le monde n’a pas, comme Frédéric Biessy, directeur de la Scala, le numéro de portable d’un médecin ami, ce qui lui permet, au moindre doute, de passer par un « filon rapide ». Au royaume de la débrouille, l’égalité est un leurre, d’autant plus qu’un marché parallèle se déploie sans vergogne, certains laboratoires exploitant au prix fort l’urgence des situations. Conséquence : plus on paie cher, plus vite on passe. En Seine-Saint-Denis, on trépigne. Sept jours de patience avant d’être testé, l’attente est incompatible avec le tempo quotidien du spectacle. Au Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis, Julie Deliquet s’étonne : « Il aurait fallu identifier les corps de métier ayant besoin de tests ultrarapides pour exercer leur profession. » L’acteur, sans qui le théâtre n’est plus, doit être reconnu en tant que sujet prioritaire. Au ministère de la Culture de monter au créneau pour l’imposer et éviter ainsi au spectacle vivant de trop longues éclipses qui se traduisent, faute de recettes, par de fâcheuses pertes d’argent. En attendant, chacun se prend en main. À Paris, le Festival d’automne limite les déplacements en transport en commun pour les troupes venues de l’étranger et privilégie des hébergements à proximité des théâtres. Pour Pierre Gendronneau, directeur de production, « l’enjeu est de s’adapter à tout prix. » Car tout vaut mieux que l’annulation. Ce parti pris suppose des aménagements. Et des concessions des artistes contraints de négocier avec leurs exigences. Coupes de scènes, lectures improvisées ou réductions des durées. « Nous voyons arriver de l’international des spectacles qui ont, d’ores et déjà, intégré la distanciation des acteurs au plateau », constate Pierre Gendronneau. Pendant le temps de la pandémie, artistes et publics auront à prendre soin les uns des autres. Ce qui implique un effort partagé : côté plateau, des esthétiques qui s’adaptent au principe de réalité. Coté gradins, un public plus que jamais bienveillant. Joëlle Gayot / Télérama Légende photo : Pierric Plathier et Suzanne Aubert dans Iphigénie, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Suite à un double cas de Covid, le metteur en scène, Stéphane Braunschweig, a dû venir sur scène en personne, le texte à la main. Photo : Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2020 7:02 PM
|
Article de Geneviève Charras dans son blog, le 7 octobre 2020 Le Père, de Stéphanie Chaillou, mise en scène Julien Gosselin, avec Laurent Sauvage.
"Le Père est la version scénique du roman L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou. Un homme revient sur ses rêves de jeunesse : acheter une ferme, cultiver la terre, élever du bétail, se marier, avoir des enfants. Ce paysan va se heurter à la transformation profonde du monde qu’il connaît, avec l’application de la politique agricole commune. En 1977, à 30 ans, surendetté, il fait faillite. Quel regard porte-t-il sur son histoire ? Julien Gosselin, habitué à mettre en scène de grandes fresques comme 2666 ou Joueurs, Mao II, Les Noms, livre ici, avec l’acteur Laurent Sauvage, un spectacle intime où le destin d’un homme est bouleversé par un contexte économique qui le dépasse. Face au regard de la société sur ce qu’est un échec ou une réussite, comment se réapproprier sa vie ?" C'est dans le noir que surgit une voix qui conte la vie d'un homme , amoureux de l'existence , heureux de tout et de rien , qui ose vivre ses rêves...Mais tout s'effondre peu à peu, la torpeur gagne le ton de la voix, la silhouette du comédien apparait peu à peu de ce brouillard obscur. Vrombissement et musique accompagnent ce destin voué à l'échec, ce "fermier" déchu, désemparé, démantibulé comme ses terres confisquées par des huissiers, vautours et rapaces banquiers, hommes d'affaires sans faim de vie. Le "père" de famille qui défaille, dépérit, désolé, méprisé, abandonné. Et quand la scène se soulève avec ses néons lumineux, comme une boite qui s'ouvre, bouche béante et lumineuse, de néons clignotants allumée, c'est le drame de la prise d'otage. Un homme seul sur le carré d'une pelouse de jeu, cerné, traqué, acculé à la défaite: sans but, sans filet sans surface de réparation où rebondir.... Comme dans une serre qui ne sert plus à rien: le jeu du comédien, sa voix sont émouvants, touchants et la simplicité du texte, émis dans la semi-obscurité, concentre l'attention sur le sens d'une vie finie, défunte, désolante... Stéphanie Chaillou a publié trois ouvrages de poésie aux Éditions Isabelle Sauvage. Son premier roman, L’Homme incertain, a paru en 2015 chez Alma Éditeur. Elle a depuis publié, chez le même éditeur, Alice ou le choix des armes (2016) et, aux Éditions Noir sur Blanc, Le Bruit du monde (2018) et Un jour d’été que rien ne distinguait (2020). Elle est également autrice d’une pièce de théâtre, Ringo, écrite en 2019. Publié par Geneviève Charras Crédit photo : © Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2020 9:20 AM
|
Article de Clara Laurent dans son blog Hapax - Mai 2017 Qui a peur de Virginia Woolf ? C’est ce qu’Alain Françon nous révèle dans sa mise en scène de la célèbre pièce d’Edward Albee le mardi 16 mai au Théâtre Princesse Grace. Aux côtés de Dominique Valadier dans le rôle de l’épouse, Wladimir Yordanoff, Molière 2016. Portrait d’un comédien…monégasque. Ce visage vous est immédiatement familier ? Mais oui, c’est le mari de Catherine Frot dans Un air de famille, le succès de Jaoui-Bacri de 1996 ! Comédien prolifique, Wladimir Yordanoff épanouit son talent depuis plus de trente ans sous la direction des plus grands au théâtre et au cinéma, sans oublier le petit écran : Nina Companeez l’emploie en effet dès 1979 dans ses Dames de la côte. Quand on le rencontre au mois d’avril 2017, Wladimir Yordanoff n’est pas avare de son temps, heureux de revenir sur ce riche parcours et d’évoquer ses attaches monégasques. Une enfance monégasque Le petit Wladimir nait en 1954 à Chatou, dans un milieu de musiciens classiques: « Mon père, Luben, a fui la Bulgarie en 1946. Au Conservatoire de Paris, il a rencontré ma mère, cantatrice, qui avait quitté elle aussi la Bulgarie. » Luben Yordanoff est bientôt appelé à Monaco comme violon solo de l’Orchestre Philharmonique. La famille Yordanoff est alors naturalisée monégasque par le prince. Wladimir se souvient avec nostalgie de son enfance dans la principauté : « A l’école primaire de Saint-Charles, j’ai joué le Petit Poucet sur scène… Plus tard, on se promenait avec les copains dans le jardin d’une maison abandonnée — la Villa Sauber ! » L’adolescent effectue ses études secondaires au Lycée Albert 1er. Le célèbre chef d’orchestre Charles Munch sollicite bientôt le violoniste pour entrer comme violon solo dans l’Orchestre de Paris qu’il vient de créer. La famille revient alors en région parisienne : « J’avais quatorze ans, je me suis senti déraciné de Monaco ! Plus de copains, fini la plage et le beau temps ! Mon seul rayon de soleil, c’était la littérature. Et puis, le ciné-club dont je m’occupais au lycée à Saint-Germain-en-Laye. » L’adolescent découvre alors le cinéma d’auteur, Kurosawa, Bergman… Devenir comédien Bon élève, Wladimir est orienté vers des études de médecine. Il faut dire qu’il est très attiré par la psychiatrie et la psychanalyse : « Je rêvais d’une médecine au secours des gens… » Mais le rêve se heurte à l’ambiance de la fac de médecine, « à cette bourgeoisie pompidolienne » qui l’exaspère. Depuis quelques temps, le jeune homme prend des cours de théâtre. Il passe le concours du Conservatoire national : « J’ai passé le premier tour. Puis on m’a dit au deuxième qu’en tant que Monégasque, je pourrais me contenter d’être auditeur libre.» En fait, cela ne change pas grand chose : après 68 ce statut permet de recevoir les cours des meilleurs enseignants : « Louis Seigner me semblait pépère, très IVe République. J’ai préféré suivre l’enseignement d’Antoine Vitez et de Pierre Debauche. L’improvisation, la liberté. » Une actrice repère le jeune Wladimir et lui propose d’intégrer la troupe d’un Américain, Stuart Seide : « On jouait à la Cartoucherie de Vincennes. Shakespeare, Molière, Calderon… Mais au bout d’un moment, je me suis révolté contre le travail contraignant de la troupe. » C’est toujours ce désir de liberté qui guide le jeune comédien lorsqu’il rejette l’idée d’entrer à la Comédie française. Cinéma vs théâtre Wladimir Yordanoff entre par la grande porte dans le 7e art grâce à Andrzej Wajda qui lui donne en 1983 le rôle du chef des gardes dans son Danton. L’acteur enchaîne chez Margarethe von Trotta (L’Amie), puis chez Robert Altman où il incarne Paul Gauguin dans Vincent et Théo en 1990 : « Ça n’a pourtant pas impressionné les réalisateurs français. Non, le vrai démarrage de ma carrière au cinéma, je le dois à Un air de famille.» Le comédien avait déjà joué pour les plus grands metteurs en scène du théâtre public (Patrice Chéreau, Roger Planchon, Bernard Sobel…), lorsqu’il rejoint la pièce de Jaoui et Bacri en 1994. Quitter le théâtre subventionné pour le privé, ce n’est pas simple en France: « Je me suis fait traiter de traître ! » Lorsque Cédric Klapisch adapte deux ans après la pièce au cinéma, Yordanoff est ravi de reprendre son rôle aux côtés de Catherine Frot. Suivra Le Goût des autres réalisé par Agnès Jaoui, autre gros succès public, puis d’autres films populaires, souvent des comédies, parfois des drames, comme Polisse de Maïwenn en 2011. Pourquoi ne voit-on plus l’acteur au cinéma depuis trois ans ? « C’est parce que je suis accaparé par le théâtre. On me propose des rôles dans des pièces pour lesquelles je ne peux pas dire non, que ce soit Le Temps et la chambre de Botho Strauss, ou la création d’une pièce de Peter Handke… » Dans Qui a peur de Virginia Woolf ? (D.R.) Qui a peur de Virginia Woolf ? Wladimir Yordanoff aime renouveler les collaborations, comme avec le metteur en scène Alain Françon. « Je cherchais une pièce à jouer avec Dominique Valadié, la femme de Françon. C’est moi qui ai proposé Qui a peur de Virginia Woolf ? » La pièce d’Edward Albee a été particulièrement popularisée par l’adaptation au cinéma avec Richard Burton et Elisabeth Taylor, dans laquelle les deux monstres sacrés se déchirent dans une suite de crises paroxystiques mémorables. Pour Yordanoff, « le texte d’Albee évite de se poser des questions psychologiques idiotes : on ne se demande pas pourquoi ? mais pour quoi ? Alain Françon (Molière du metteur en scène 2016) a choisi d’abandonner tout geste naturaliste et de faire évoluer les personnages dans un espace rouge sang qui évoque un ring de boxe, mais pris comme un art noble, à l’instar de la danse. » La pièce d’E. Albee a été analysée par l’école de psychologie de Palo Alto comme un pur exemple du schéma du « double bind » (l’injonction paradoxale). Selon Wladimir Yordanoff, « les époux de cette pièce jouent un protocole qui régit leur relation. Il faut que les acteurs s’aiment pour jouer ce texte, car les personnages se disent des horreurs, se provoquent sexuellement. A sa création en France en 1964, Madeleine Robinson et Raymond Gérome avaient chacun leurs avocats dans la salle pour compter les coups ! » On se souvient comment les choses avaient mal tourné en 1996 entre Niels Arestrup et Myriam Boyer… Pas de risque en revanche entre Dominique Valadier et Wladimir Yordanoff. Ils réfléchissent tous deux à la poursuite de leur collaboration avec Le Malade imaginaire : « J’ai toujours vu cette pièce jouée sur le ton de la comédie, alors que pour moi, Argan est un vrai fou. » Espérons que nous puissions prochainement découvrir sur les planches cette version singulière du classique de Molière... Clara Laurent (mai 2017, D.R.)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 6, 2020 7:13 AM
|
Par Gilles Costaz dans Webthéâtre 5 octobre 2020 Le ciel et la terre Claudel va à la messe et nous en parle. Rien de très engageant, si l’on résume ainsi ce texte de 1917 ! Notre grand poète catholique se rendait souvent aux saints offices. Mais chez lui, sous les grandes orgues, il faut chercher la blessure, ce qui fait qu’il est à la fois dans l’orgueil du poète et dans la profonde humilité du croyant. Telle est l’une des mises en clarté qui anime Didier Sandre quand il prend le parti, audacieux, difficile, de porter ce texte,La Messe là-bas à la scène, en solo, c’est-à-dire dans une forme de solitude offerte au public. En 1917, Claudel est ambassadeur à Rio de Janeiro, il a la hantise de la guerre qui se passe en Europe et, au moment précis où il écrit, des tourments intimes ne cessent de l’assaillir. Il n’a pu oublier sa liaison adultérine avec celle qui inspira Partage de midi, ni l’enfant qui en est né et dont il ne s’est pas préoccupé. Il vit avec sa fascination de Rimbaud et veut se persuader que ce poète sauvage a été touché par le foi chrétienne. Il est à Rio mais il se sent dans la nature de ses origines où poussent le blé d’or et les églises aux flèches droites comme le blé.
Sa pensée tourne en colimaçon. Claudel s’incline devant la cérémonie de la messe où il se rend et cherche à structurer son texte selon les moments de la cérémonie (les termes de la liturgie s’inscrivent au-dessus de l’acteur : offertoire, consécration…). Mais la pensée se rompt, change de hantise, rebondit, va de lui-même aux autre et des autres à lui-même. Les remords surgissent. Dans le dédale du cerveau cognent le besoin de revenir à l’éblouissement que procura Rimbaud , l’insoluble tristesse de la guerre figurée par le départ des maris qui quittent femme et enfants consciencieusement, le goût de la moquerie à l’égard de qui est trop bourgeois et trop orthodoxe… Plus brûlante que tout, peut-être, est la sensation que la mort est là, et donc l’heure de vérité face à Dieu, l’instant où l’on parle « d’homme à homme » au créateur et où l’on est un chrétien que si l’on s’est dépouillé de tout, si notre présence est une absence…
Cette richesse folle, vertigineuse du texte, cet effroi qui bouscule le plain-chant, cette quête douloureuse d’une paix qu’il faut arracher au forceps et qu’une fois obtenue il faut partager, on ne les aurait pas sans doute pas ressenties de façon si absolue si Didier Sandre ne nous les dévoilait dans leur double cheminement, évident et souterrain, oraculaire et mystérieux. En veste de smoking noir (porté sur un maillot noir) mais les pieds nus, il est entre la terre et le ciel. Il est l’homme du monde qui a renoncé au monde. Pour changer d’altitude, il se contente d’empiler un tabouret sur un autre (c’est ainsi qu’il peut jouer Dieu répondant à Claudel ! Mais aussi être le Claudel qui entre dans sa méditation). Sur le plateau, se dressent aussi trois modestes paravents, que la lumière vient éclairer de façon symbolique. Didier Sandre n’est pas ici dans une interprétation strictement littéraire ou dans le parcours habile d’une brillante prosodie. Il va et vient dans les avancées et les reculs d’un orage intime et pénètre lentement, par élans, dans la sphère de la spiritualité. Pour le spectateur, peu importe la foi. L’instant théâtral sculpté et prodigué par cet interprète qui noue et dénoue les versets comme personne se déroule à une altitude tout à fait inhabituelle.
La Messe là-bas de Paul Claudel, conception et interprétation de Didier Sandre, lumières de Bertrand Couderc, conception musicale d’Othman Louati, collaboration artistique d’Eric Ruf.
Studio-Théâtre, Comédie-Française, galerie du Carrousel du Louvre, tél. : 01 44 58 15 15, jusqu’au 11 octobre (dans le cadre du cycle Singulis).
Photo Brigitte Enguérand.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 6:48 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération 6 octobre 2020
Magnifiquement porté par Helena de Laurens, le seul-en-scène de Marion Siéfert est diffusé en live sur Instagram, les commentaires s’affichant sur la scène.
Le spectacle capte les relations d’une lycéenne (Helena de Laurens) avec son compte Instagram. Photo Marion Siéfert
En sortant du théâtre, on dit à chaque passant d’y entrer. Ce qui est stupide puisque Jeanne Dark, la dernière création de Marion Siéfert avec la magique Helena de Laurens, est déjà complet, malgré le Covid, malgré la pluie, jusqu’au dernier jour. Mais pas si absurde, car l’une des spécificités du dispositif imaginé par Marion Siéfert est qu’on peut également suivre la pièce sur Instagram, et c’est même une expérience à ne pas rater. Encore un spectacle participatif ? Et qui plus est, où l’on nous fait croire qu’un écran de téléphone peut se substituer à l’incarnation sur un plateau ? Pas de panique. Si Marion Siéfert inclut dans sa dramaturgie un usage d’Instagram et une réflexion en acte sur sa place chez ses utilisateurs, notamment adolescents, ceux qui regardent ce seul-en-scène via l’application n’auront ni la même fonction ni le même point de vue que les spectateurs dans la salle.
Cocon
Ces derniers auront la chance de pouvoir scruter les métamorphoses de la performeuse, actrice, danseuse Helena de Laurens en Jeanne, 16 ans, sur le plateau, tout en regardant son live diffusé sur deux écrans verticaux placés à chaque bout de la scène et les commentaires qu’ils suscitent. Personne ne peut savoir à l’avance qui sera au rendez-vous sur Instagram ni le nombre d’abonnés - plus de cent le jour de la première, des personnes inconnues de l’actrice et de la metteure en scène pour la très grande majorité. Impossible de savoir non plus comment vont réagir ces abonnés dont les commentaires en direct influent sur la perception des spectateurs, mais que l’actrice qui se filme ne voit pas. Helena-Jeanne entre en scène, c’est-à-dire dans sa chambre entièrement blanche, entièrement vide, cocon glacial, studio de photo, ou chambre d’hôpital, selon ce qu’on projette sur l’impeccable scénographie de Nadia Lauro. De la comédienne, qui mime à merveille la lenteur empruntée de la lycéenne de retour chez elle, croulant sous son sac à dos, on ne voit d’abord que sa silhouette dessinée comme en ligne claire par son slim et son pull moulant coloré, ainsi que par sa masse de cheveux qui dissimule l’entièreté de son visage. Cependant, de dévoilement, de mise à nu, il ne sera question que de ça, au point qu’au fur et à mesure de la représentation, le monologue incessant de Jeanne, cette parole qu’elle adresse à son smartphone, paraît lui retourner la peau, la transformer en écorchée. Ce doit être cela, ce qu’on appelle «incarner le verbe». Et le paradoxe est évidemment que ce soit un outil numérique qui rende visible cette incarnation, sur lequel on suit, captivé, le moindre oscillement de ses traits, la puissance expressive faramineuse de l’actrice décuplée par les gros plans de son visage, tandis que sur le plateau, son corps se déploie, s’exaspère, se tend de la pointe de ses cheveux jusqu’au bout de ses doigts flexibles. La comédienne et son personnage partagent une même particularité : elles ne peuvent s’empêcher de prendre les expressions de ceux auxquels elles pensent, rendant ce seul-en-scène infiniment peuplé. Est-ce Helena de Laurens qui vampirise son personnage ou l’inverse ? La frontière s’estompe et la performance de l’actrice rappelle celle, jamais oubliée, de Zouc, qui en un quart de seconde, était capable de passer du nouveau-né à l’octogénaire.
Bise
Les sensations cartographiées sont celles de tout adolescent, capturées dans un carcan biographique singulier : une famille catho chaleureuse moralement irréprochable, une mère, femme au foyer, qui l’aime «tellement qu’elle imagine toujours le pire» en pensant à elle, une sœur et des frères qui ne lui laissent pas une minute de répit puisqu’elle est l’aînée, l’exigence de la perfection scolaire qui l’assaille et «la messe, la messe, la messe» le dimanche alors que chaque temps vacant de la semaine est colmaté. «Rentrer, rentrer, rentrer, c’est ma vie. Je ne peux jamais sortir.» Et puis il y a l’intrusion de sa mère dans sa chambre vide, dans ses pensées, partout où elle est. Et puis il y a son père qui demande qu’elle lui fasse la bise le matin. Parents qui acceptent que leur fille soit sur les réseaux sociaux à condition de voir ce qu’elle poste. Jeanne Dark vit à Orléans, à côté du cimetière, telle Jeanne d’Arc. Et bien sûr, les railleries sur les réseaux sociaux et l’angoisse de la jeune fille qui ausculte son corps, provoquant une forte émotion chez les scolaires dans la salle, portent sur la virginité pour la vie.
Native d’Orléans, 30 ans et des poussières, Marion Siéfert dit que l’audace des deux interprètes de son spectacle précédent - Janice Bieleu et la rappeuse Laetitia Kerfa dans Du sale ! - lui a donné à son tour le courage et l’envie de s’atteler à une partie de sa vie qu’elle taisait jusqu’alors, dont elle avait un peu honte. Avec Helena de Laurens, il leur a fallu une bonne année pour accomplir ce spectacle à double focale, et qui bouleverse aussi par son temps : le présent impérieux, redoublé par le live. Il a fallu très peu d’années à l’autrice, metteure en scène et performeuse pour se révéler comme une incroyable inventrice de forme. Mais ce qui frappe est que ses recherches formelles sont toujours au service de l’émotion la plus franche. Déjà, dans son premier spectacle, Deux ou Trois Choses que je sais de vous, elle était une extraterrestre (pas si loin de Jeanne d’Arc), qui tendait un miroir au public, en délivrant à chaque spectateur des bribes de sa vie, à travers les traces qu’on laisse sur Internet. Et elle tremblait comme une feuille, en les touchant un à un. Sa deuxième création, le Grand Sommeil, était indissociable de son interprète, déjà Helena de Laurens, fantastique enfant de 10 ans dans son corps d’adulte.
Anne Diatkine
Jeanne Dark de Marion Siéfert Théâtre de la Commune, Aubervilliers (93). Jusqu’au 18 octobre. Dans le cadre du Festival d’automne à Paris. Et en tournée.
Instagram: @jeanne_dark_
Légende photo : Le spectacle capte les relations d’une lycéenne (Helena de Laurens) avec son compte Instagram. Photo Marion Siéfert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 5:29 PM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 4 octobre 2020 Les Zébrures d’automne 2020, trente-septième édition des Francophonies du Limousin, des écritures à la scène
Malgré les restrictions sanitaires, le festival bat son plein. En marge des salles de spectacle, ont eu lieu plusieurs projections de film, des remises de prix, des concerts… Et une grande exposition qui nous fait revivre les riches heures de ce festival à la belle Bibliothèque francophone du centre-ville. Inaugurée en 1998, elle est labellisée Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale et Pôle Associé à la Bibliothèque Nationale de France dans le domaine du théâtre et de la poésie francophone. Avec un fonds de 40.000 volumes, une discothèque, une vidéothèque, une artothèque et un espace multimédias. Et avec aussi un équipement à la hauteur de cette architecture aérée. Toute en granit et en verre avec un atrium construit autour d’une grande mosaïque gallo-romaine.
Le conservateur de la bibliothèque et le directeur des Francophonies ont imaginé un parcours à partir de différentes thématiques. On se promène d’un espace à l’autre et dans de petites cabanes, des vitrines, ou le long des murs, on retrouve des auteurs et metteurs en scène familiers, des photos de spectacles qui ont fait date, des livres, affiches et articles de presse montrant le festival dans tous ses états. Et il en a vu passer des artistes, depuis sa création par Pierre Debauche en 1984 ! Il a accompagné les premiers pas en Europe du travail d’un bon nombre d’entre eux, évoqué dans l’espace Premiers cris comme Robert Lepage en 1986, Werewere Liking en 1988, Wajdi Mouawad deux ans plus tard ou Salia Sanou en 2002…
En regard du module Conscience du réel, des documents attestent combien le théâtre, ici, est ancré dans l’actualité avec des pièces comme Rwanda 94 de Jacques Delcuvellerie, créée il y a vingt ans ; les conflits syriens sont vus par Catherine Boskowitz et Fadwa Suleiman (2012) ; la violence faite au femmes racontée aux enfants par Michel-Marc Bouchard dans L’Histoire de l’oie. Mais comme le rappelle la rubrique État de fête, le spectacle est aussi dans les rues, avec des propositions participatives comme In C de Terry Riley en 2000 ou Rituels vagabonds de la chorégraphe Josiane Antourel, l’an passé. Sans oublier les nombreux concerts, rencontres, célébrations dans le quartier général où public et artistes se rassemblent après les représentations: autrefois le Grand Chapiteau et le Zèbre, aujourd’hui la Caserne Marceau.
Silences et Bruits réalisation de Clément Delpérié et Véronique Framery
Ces courts-métrages sont l’aboutissement d’une aventure au long cours avec quatre-vingt élèves de deux collèges des quartiers populaires de Limoges. Ils ont, de la sixième à la quatrième, suivi un atelier d’écriture avec l’auteur Jean-Luc Raharimanana sur le thème : Se voir grandir, se voir changer. Sous l’égide du festival, cet atelier a été conçu après les attentats de Charlie-Hebdo en 2015, à des fins d’action culturelle dans les écoles. Et de ces textes, est sorti un spectacle collectif… Puis une exposition de photos. Ce film entend garder la trace de ces moments privilégiés qui ont marqué les adolescents. Les images, accompagnées d’extraits de leurs textes, ont été captées dans leur environnement : couloirs, classes et cour du collège ou dans les champs et la forêt…
Rien d’anecdotique dans ces plans-séquences souvent muets évoquant la solitude des adolescents qui s’interrogent sur le sens de l’existence. En opposition à des moments où ils s’ébattent en liberté… L’esthétique singulière de cette réalisation, l’étrangeté des mots souvent en voix off, sont en décalage avec le vérisme de l’objectif. « J’en ai fait un objet artistique qui m’appartient » dit le réalisateur : en effet, il ne s’agit pas d’un reportage mais d’un portrait collectif et subjectif de cette jeunesse qui cherche sa place dans le monde. «Nous serons des guerriers et quand la tristesse nous prendra, nous serons à nouveau des enfants »: cette phrase empruntée à Jean-Luc Lagarce, revient comme un leitmotiv. « Dans le monde, il y a la guerre, dans la guerre, il y a du monde», disent-ils encore… Sorti de son contexte, Silences et Bruits rend compte de la mélancolie qui étreint la génération Je suis Charlie.
Les prix
Le Prix S.A.C.D. à été remis à Andrise Pierre pour Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus. L’auteure vient de Port-au-Prince et enseigne aujourd’hui la littérature haïtienne à l’Université Paris XVlll. Yol, à la veille de son mariage avec un Blanc, rend visite à sa tante pour lui emprunter sa robe de mariée. Mais elle découvre que ce dont elle rêvait, est «un assemblage de lambeaux rapiécés», à l’image d’une vie désastreuse. Si « les tantes sont nos pères absents », elles témoignent ici de la condition des femmes dans son pays natal…
Quant au Prix R.F.I., il revient à La Cargaison de Souleymane Bah. Cette cargaison de morts que personne ne veut accueillir, prend la parole : fes femmes, jeunes, vieux, enfants, jusqu’à la balle qui a frappé ces victimes, le corbillard, cimetière vont parler, croisant leurs mots en un chœur polyphonique. L’auteur guinéen a écrit cette pièce en hommage aux manifestants de son pays, victimes de la répression. « Je veux dédier ce prix aux jeunes guerriers qui, chez moi, se battent pour la liberté et la démocratie. Et à travers eux, à tous ceux qui luttent et disent : NON. »
Chef du principal parti d’opposition, Soleymane Bah a été condamné par contumace à Conakry en 2016 et vit maintenant en exil en France. Il nous faut entendre cette rumeur grondante, véhiculée par ses mots: « Nous sommes les destins fractionnés, les immolés de la République, écrasés sous les bottes des appétits antagoniques. » « Nous dansons la danse des corbillards crépusculaires, jusqu’à ce que la mort soit morte. »
Mireille Davidovici
37 Rayures Zèbre, jusqu’au 9 janvier, Bibliothèque francophone multimédias de Limoges, 2 place Aimé Césaire, Limoges (Haute-Vienne). T. : 05 55 45 96 00.
Les Zébrures d’automne/ Les Francophonies, des écritures à la scène, ont eu lieu du 23 septembre au 3 octobre. 11 avenue du Général de Gaulle, Limoges. T. 05 55 33 33 67
Légende photo : exposition « 37 Rayures zèbre » © Christophe Péan

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 7:49 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde Publié le 5 octobre 2020 « _jeanne_dark_ », de Marion Siéfert, avec Helena de Laurens, orchestre avec réussite l’hybridation entre le théâtre et le réseau social, très populaire chez les jeunes.
C’est un des spectacles qui va le plus faire parler de lui, en cet automne théâtral, et au-delà. Pas seulement parce qu’il est d’une justesse rare, en même temps que totalement réjouissant, pour aborder cette période si particulière et douloureuse qu’est l’adolescence. Mais aussi parce que _jeanne_dark_, que signe la jeune autrice et metteuse en scène Marion Siéfert, est la première pièce de théâtre à procéder à une hybridation avec le réseau social Instagram. _jeanne_dark_, c’est donc à la fois le titre du spectacle, et le compte Instagram sur lequel les spectateurs virtuels peuvent se connecter pour voir la représentation sur leur téléphone, et envoyer leurs commentaires en direct, lesquels commentaires s’affichent sur le plateau. Et _jeanne_dark_, c’est aussi le pseudo Instagram que s’est choisi l’héroïne de la pièce, Jeanne, une adolescente de 16 ans issue d’une famille catholique, qui vit dans la banlieue pavillonnaire d’Orléans. Depuis plusieurs mois, Jeanne subit les railleries de ses camarades, parce qu’elle est encore vierge. Un soir, elle s’enferme dans sa chambre, et décide de prendre la parole en direct sur Instagram. D’abord hésitante et honteuse, sa confession va prendre la tournure d’une vaste opération cathartique de libération et de reconquête, avec toutes les possibilités offertes par le réseau social pour se mettre en scène, se masquer et se démasquer, se travestir et se mettre à nu. Mise en scène de soi Effréné, débridé et terriblement drôle, c’est tout un théâtre qui est ainsi convoqué, qu’il s’agisse de celui d’une famille catholique – le personnage de la mère de l’héroïne, qui n’apparaît qu’à travers les SMS qu’elle envoie à sa fille, est particulièrement savoureux – ou de celui, intime, de cette période de l’adolescence où l’on cherche son identité, où l’on se sent moche, seul et mal aimé. Ce qui a changé, aujourd’hui, par rapport aux générations précédentes, c’est évidemment la mise en scène de soi que permettent les réseaux sociaux. Mettre en scène la mise en scène, la mettre en abîme, la démultiplier, voilà un joli défi que relèvent avec virtuosité Marion Siéfert et sa fabuleuse actrice-performeuse Helena de Laurens. La voilà qui déboule sur le plateau, ado plus vraie que nature en jean, blouson vert et sac à dos, le visage noyé sous ses longs cheveux noirs. Elle ouvre son téléphone, se connecte sur Instagram, et c’est parti pour un crescendo théâtral qui verra Jeanne exprimer ses fantasmes, ses désirs et ses pulsions les plus « dark » – ceux d’une adolescente ordinaire, somme toute –, face au miroir de son téléphone. La caméra a remplacé le stylo avec lequel les jeunes filles écrivaient leur journal intime, dans un autre temps. Effet de réel saisissant En tant que spectateur, on assiste à la fois à la performance sur le plateau, à la vidéo que tourne Jeanne en direct, utilisant les filtres et artifices divers permettant de trafiquer et transformer son image, et aux commentaires des instagrammeurs branchés sur la représentation, qui jouent eux-mêmes une sorte de jeu, puisqu’ils parlent au personnage de Jeanne comme le feraient ses amis dans la fiction. Le soir où nous avons vu le spectacle, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), où il a été créé avant d’arriver au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Jeanne a été fortement encouragée dans son entreprise de libération, à coups de « #jeanneyesyoucan » ou de « #envoielestousaubûcher ». Helena de Laurens inaugure une nouvelle forme de jeu, téléphone en main pendant toute la représentation, une nouvelle forme de corps hybridé L’effet de réel est saisissant, un réel dorénavant fortement tramé avec le virtuel, et que le théâtre, art de la présence concrète, à la fois ingère, intègre et interroge. Helena de Laurens inaugure ainsi une nouvelle forme de jeu, téléphone en main pendant toute la représentation, une nouvelle forme de corps hybridé. Elle jongle avec une vivacité et une présence incroyables avec ces deux niveaux, celui de l’image et celui du plateau, et semble apte à toutes les métamorphoses. Ainsi se réfléchissent le miroir du théâtre et celui du smartphone, de manière assez vertigineuse, sous des dehors on ne peut plus ludiques. Marion Siéfert ne cache pas être partie de sa propre jeunesse orléanaise dans les années 2000 pour écrire cette fiction. Elle fait observer, de manière passionnante, que « quant au corps, Instagram ne fait que prolonger le rapport totalement obsessionnel que le catholicisme entretient à l’image : dans les peintures religieuses, comme sur Instagram, il faut éveiller le désir sans jamais montrer un téton ou un sexe. Il faut respecter des interdits et des règles de pudeur tout en amenant le spectateur à adorer l’image et ce qu’elle représente. L’histoire de l’art religieux est habitée par cette tension : représenter le divin dans des corps, voiler et dévoiler, éveiller les sens pour encourager la piété. Avec Instagram, on se retrouve face à une forme mutante de l’image religieuse ». Et avec Marion Siéfert, face à une forme mutante et néanmoins très théâtrale de théâtre. Voir le teaser vidéo _jeanne_dark_, de et par Marion Siéfert. Avec Helena de Laurens. La Commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Jusqu’au 18 octobre, Festival d’automne. De 10 € à 21 €. Puis en tournée jusqu’à fin mai 2021. Et sur le compte Instagram _jeanne_dark_. Fabienne Darge(Villeneuve-d’Ascq (Nord), envoyée spéciale) Légende photo : Helena de Laurens (Jeanne) dans le spectacle de Marion Siéfert, « _jeanne_dark_ ». MARION SIÉFERT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 2, 2020 9:54 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello le 2 octobre 2020 La Loi de la gravité, texte d’Olivier Sylvestre (Editons Hamac, Québec), mise en scène de Cécile Backès, dès 11 ans.
Cécile Backès, metteure en scène et directrice de la Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France, crée La loi de la gravité de l’auteur québécois Olivier Sylvestre.
La question du genre se pose parfois à l’adolescence de façon très cruelle, une occasion scénique rêvée d’interroger et de mettre en question tous les préjugés.
« Fred (Frédéric) – D’abord, qu’est-ce que t’es ?
Dom (Dominique) – ça dépend des jours.
Un cactus, un oiseau.
Je veux pouvoir changer quand ça me tente, être l’un pis l’autre en même temps, ni l’un ni l’autre quand ça me tente plus pis m’habiller comme je veux. »
Cécile Backès, attentive aux écritures significatives qu’elle met en scène – Marguerite Duras, Annie Ernaux…-, a été interpelée par la langue québécoise et musicale d’Olivier Sylvestre et par la jeunesse de ses jeunes gens contemporains.
Dans les années 2020, on évoque d’emblée le « profil » de chacun sur les réseaux sociaux, à distinguer d’une « vraie vie » dans sa life, soit une dualité des données, métaphorique de l’intériorité des deux adolescents en souffrance – trouble expressif de l’ambiguïté de la fille/garçon ou du garçon/fille, justesse d’un regard instable.
Douze courtes séquences font apparaître Dom et Fred, deux jeunes élèves scolarisés qui traînent dans une zone indéterminée, Presque- La-Ville.
L’une préfère sécher les cours d’abord, alors que le second serait plus assidu.
Chacun des deux hésite sur son genre, explore les jeux à jouer pour être fille ou garçon, et laisse paraître son malaise, ses doutes et incertitudes. Et s’il ne fallait pas obligatoirement choisir entre les deux pour chercher finalement le non-binaire ? Etre l’un et l’autre à la fois, ou bien l’un puis l’autre, ce sera selon l’humeur du moment.
L’auteur évoque la non-binarité comme l’un des derniers tabous, à travers une histoire d’amitié, de complicité et de confidences qui aident à tenir debout et à oser affronter le monde ensemble et non plus seul, à marcher vers lui, précise Cécile Backès. On n’accepte tout simplement pas que quelqu’un soit « entre les deux ».
La Loi de la gravité propose un théâtre où ce qui est énoncé devient possible, du moment qu’on le profère. Par le récit, le dialogue ou la voix intérieure.
Tenter de passer le pont qui relie la Presque-Ville à La Grande Ville, un vrai projet.
Les deux acteurs – Marion Verstraeten qui joue Dom et Ulysse Bosshard Fred – correspondent exactement à la justesse de cette confusion de genre assumée.
Autant l’une paraît décidée, porteuse d’une belle colère rebelle éloquente, autant l’autre semble disposer d’une conscience de soi et des autres plus intériorisée.
Or, tout cela n’est que fantômes et fantasmes, l’un et l’autre éprouvent une même difficulté à communiquer avec leurs semblables, qui ne se ressentent pas différents.
Autour d’eux, dans un espace situé à la lisière de Presque-La-Ville et de la Grande Ville, les oiseaux tournent et le vent se lève, selon une nature intensément présente.
A chaque fois que Dom fait un pas, il lui semble que La Ville s’éloigne. Pourtant, elle a rencontré une autre élève, sans lendemain. Quant à Fred dont la mère est décédée, il souffre, et consent parfois à ce que Dom le maquille. Il a mal à l’âme : il faut qu’il « décrisse » : la langue québécoise est savoureuse.
Est reconnaissable la voix universelle de qui se pose la question du genre et des stéréotypes concernant le genre, ainsi le dernier roman de Camille Laurens, Fille.
Aussi Fred fait-il ce commentaire douloureux et clairvoyant sur ses sensations :
« Tous les jours… y a un comédien qui prend possession de mon corps, il est là, il est tout le temps là, c’est un gars qui joue au gars, qui essaie d’être plus grand, plus fort, plus viril, qui aime tout ce que les gars aiment, qui se prend une voix grave… »
La mise en scène de Cécile Backès est joyeuse et lumineuse au possible, apte à détecter dans sa direction d’acteurs la force propre à ces figures juvéniles joliment peintes, pleines à la fois de niaque et de réserve, de quant à soi et d’ouverture.
Le jeu de Marion Verstraeten pour Dom est inénarrable tant le rôle lui colle à la peau, vive et imprévisible, tant du côté de la haine ou de la hargne que de l’émotion celée.
Quant à Fred qu’incarne Ulysse Bosshard, il représente la face solaire de ce couple improbable, si on estime que Dom en est la face ténébreuse et mystérieuse : l’un et l’autre tissent entre eux une toile solide de correspondance éthique et esthétique.
Justesse, précaution et attention, ils multiplient les égards mutuels et réciproques.
Leur salle de bal est plutôt bien agencée dans la scénographie de Marc Lainé et Anouk Maugein, un échafaudage à un étage – une sorte de coursive dominant les eaux avec ses barrières de métal qui simulent le parapet du fameux pont à franchir.
Des escaliers des deux côtés, des parois ou volets qui ouvrent et ferment l’espace, telles des fenêtres d’immeubles avec ses centres d’achat, ses cinémas. Des espaces muraux peints, tagués et colorés, propres à nos espaces urbains d’aujourd’hui.
Les interprètes n’en finissent pas de monter et descendre, de se poser à peine sur un chemin de cailloux de Petits Poucets enfantins, dessinant une courbe mouvante.
Au bas du pont, entre ses piles, en alternance le musicien Arnaud Biscay ou la musicienne Héloïse Devilly qui dispense ses bruits d’ambiance – cris des oiseaux, souffle du vent, feuillages en mouvement et bruits incertains d’une nuit insaisissable.
Le musicien ou la musicienne n’hésite pas à monter sur l’entrée du pont quand les protagonistes descendent du panorama pour se rapprocher en bas de leur douleur.
Et la liberté qu’ils portent en eux rappelle les droits mis enfin au jour des Premières Nations et Inuit, comprenant au Québec cinquante communautés autochtones, des figures métaphoriques, emplumées et magnifiques de l’entre-deux de tous les temps.
Un joyaux scénique scintillant d’éclats noirs mélancoliques et de lumières joyeuses.
Véronique Hotte
Le Palace – Comédie de Béthune – CDN des Hauts-de-France, du 1er jusqu’au 9 octobre à 20h, et aussi le 9 octobre à 14h30 et le 10 octobre à 18h30. Reprise du 24 au 27 novembre à 20h, le 27 novembre à 14h30. Tél : 03 21 63 29 19.
Théâtre de Sartrouville – CDN Yvelines, du 17 au 20 novembre. Comédie de Saint-Etienne – CDN, du 1erau 3 décembre. Scènes du Golfe, Théâtres Arradon-Vannes, les 17 et 18 décembre.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 13, 2020 2:31 AM
|
Par Le Figaro avec AFP 12 octobre 2020 DISPARITION - L'auteur et scénariste, spécialiste du vaudeville, récompensé deux fois aux Molières est décédé lundi à Paris des suites d'une longue maladie.
Éric Assous, auteur et scénariste de nombreuses pièces de théâtre et de films dont Les Montagnes russes avec Alain Delon et Bernard Tapie, est décédé lundi à Paris à 64 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé à l'AFP le producteur et metteur en scène Philippe Hersen, ami de la famille.
Récompensé par deux Molières de l'auteur francophone en 2010 et 2015 pour les pièces L'Illusion conjugale et On ne se mentira jamais, Éric Assous avait également été consacré en 2014 par le Grand prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique. «Éric Assous était un auteur prolifique et talentueux. Nous avons monté plusieurs pièces avec Alain Delon et Bernard Tapie. C'était un auteur et dialoguiste d'exception, spécialiste de la vie de couple», a dit Philippe Hersen qui lui avait confié aussi l'adaptation pour Bernard Tapie de la pièce Oscar de Pierre Mondy, portée à l'écran en 1967, avec Louis de Funès. Éric Assous qui a été également l'auteur de dizaines de pièces radiophoniques pour France Inter, a signé aussi des scénarios pour des séries télévisées dont Nestor Burma. Il avait réalisé plusieurs films dont Les Gens en maillots de bain ne sont pas (forcément) superficiels (2001) et Sexes très opposés (2002). Au théâtre, il a signé aussi de nombreuses pièces de boulevard dont Les Belles-sœurs (2007) dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, Secret de famille (2008) avec Michel Sardou, Une Journée ordinaire (2011) avec Alain Delon et sa fille Anouchka, Nos Femmes (2013) dans une mise en scène de Richard Berry avec Daniel Auteuil et Inavouable (2018) avec Michel Leeb. «Le vaudeville, c'est un art extrêmement difficile. Ce sont des équations mathématiques à mettre en œuvre. À la fois de la littérature, des mathématiques et de l'observation», expliquait Éric Assous au Figaro en 2018. Avant d'ajouter : «L'humour, il vient d'une situation et de la qualité des dialogues. C'est pour ça que la pièce radiophonique, nue, sans comédien, ni décor, fonctionne à merveille! J'ai appris mon métier en écrivant pour la radio. Au début de ma carrière, on m'a dit en lisant mes textes: «Les gens ne parlent pas comme ça». Il fallait enlever ce vernis littéraire et rechercher le réalisme. «Faire brillant», ce n'est pas être brillant, c'est une façon de se cacher.» Pour le cinéma, il a été le scénariste notamment d'Un Adultère (2018) de Philippe Harel, Deux jours à tuer (2008) de Jean Becker et Une Hirondelle a fait le printemps (2001) de Christian Carion. Légende photo :Éric Assous avait également été consacré en 2014 par le Grand prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Fred DUFOUR / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 12, 2020 8:02 AM
|
Par F.B. pour la Provence - 12 octobre 2020
PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
Sa création aurait du être un des temps forts du 74e Festival d'Avignon, en juillet dernier, dans la cour d'honneur du palais des papes. Trois mois plus tard, le spectacle de Jean Bellorini, "Le jeu des ombres", sera enfin joué sur scène, lors du mini-festival "Une semaine d'art en Avignon", initié par Olivier Py. Du 23 au 30 octobre, c'est à la FabricA que prendra forme ce spectacle total, autour des mots de Valère Novarina et de la musique baroque de Claudio Monteverdi. Il s'agira du retour de Jean Bellorini quatre ans après sa version des "Frères Karamazov" à la carrière de Boulbon. Il y a quelques jours, à la FabricA, le metteur en scène est venu présenter aux fidèles spectateurs du Festival In ce projet très attendu. Mots choisis.
La génèse d'un spectacle
"Olivier (Py, directeur du Festival d'Avignon ndlr) m'a proposé de faire un spectacle dans la cour d'honneur du palais des papes. J'ai alors demandé à Valère (Novarina) d'écrire à propos du mythe d'Orphée. Je savais que j'avais envie que ce soit un auteur vivant, je voulais rendre hommage au théâtre et je désirais un grand mythe, avec de la musique. Valère m'a livré un premier texte en janvier, et on a commencé à répéter fin mai. P.O.L publiera le texte en même temps que le spectacle sera créé à Avignon. Mais il sera très différent du texte de la pièce, parce que Valère (Novarina) écrit tout le temps, jusqu'au bout, et aussi parce que la pièce est un concentré subjectif de l'oeuvre. Il nous a laissé libres d'aller piocher avec les acteurs, des passages de ce que nous voulions dire aujourd'hui, en résonance avec le chant et l'opéra".
Le théâtre et lui
"Le théâtre que j'aime, c'est le celui du sensible, des sens, de la musique et qui dépasse toute conception intellectuelle ou intelligente. Ici, les acteurs sont comme des âmes errantes, qui se trouvent dans les dessous des dessous, accueillent les nouveaux morts, et accueillent un petit Orphée qui viendrait chercher son Eurydice(...) Est-ce qu'un acteur naît en scène ou est-ce qu'il meurt en scène quand il apparait?"
Orphée et lui
"C'est l'opéra qui a défini le genre, l'oeuvre-matrice, la plus belle déclaration d'amour à la musique comme art universel et suprême. L'art qui fédère, qui soulève le coeur des artistes et des spectateurs".
Valère Novarina et lui
"Il représente la poésie à l'état brut. Il me fait un bien fou. Depuis toujours, il est l'auteur qui revendique que la parole n'est pas une nécessité de communication, mais un acte de partage pour être au-delà de la compréhension. Il y a une rythmique, un flot, un engagement, des sonorités, une langue mystérieuse, qui nous échappe tout le temps. Ici, c'est clairement un dialogue avec le ciel et, en même temps, on est proche du cirque, d'une chanson de rue, d'une volonté de chanter tout ce qu'on a dans le coeur. Ce qui me touche particulièrement en ce moment, c'est cette dimension, cette conscience de l'extraordinaire. Tout d'un coup, un acteur entre, et juste sa présence, la vibration d'un mot, suffisent".
"Le jeu des ombres" du 23 au 30 octobre (sauf le 25) à 20h30 à la FabricA, Avignon; 15 € ; https://festival-avignon.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 11, 2020 1:44 PM
|
Par Gaspard Delhemmes dans M le magazine du Monde - 9 octobre 2020 RÉCIT C’est un trésor littéraire que Roland Dumas a longtemps gardé pour lui : trois mallettes contenant des manuscrits inédits de l’écrivain, dont il fut l’avocat et l’ami. Il les a remises à l’Institut mémoires de l’édition contemporaine, près de Caen, qui les expose à la fin du mois d’octobre.
En ce début d’avril 1986, Jean Genet sait qu’il n’a plus que quelques jours à vivre. L’écrivain de 75 ans, malade d’un cancer auquel il succombera le 14 du même mois, se rend quai de Bourbon, à Paris, sur l’île Saint-Louis, au domicile de son avocat. Il s’engouffre dans un entresol tapissé d’œuvres d’art, où sculpta jadis Camille Claudel, et pose sur le bureau deux valises, l’une en cuir noir, l’autre en Skaï marron. Roland Dumas, qui, quelques jours plus tôt, était membre du gouvernement de Laurent Fabius balayé par les législatives, entend ce « petit bonhomme chauve au nez cassé » lui lancer : « Roland, voici tout mon travail en cours, faites-en ce que vous voudrez ! » A cette date, l’auteur des Bonnes (1947) et du Journal du voleur (1949) n’a rien publié depuis vingt-cinq ans. Il vient de jeter ses dernières forces dans l’écriture d’Un captif amoureux, son dernier livre, qui paraîtra après sa mort. « Quand j’ai ouvert les valises pour la première fois, j’ai été émerveillé par le désordre d’une incroyable richesse, un peu comme une caverne d’Ali Baba », Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC Trente-quatre ans plus tard, dans le même entresol de l’île Saint-Louis, Roland Dumas nous reçoit dans la touffeur du mois d’août. C’est une employée de maison à l’accent slave qui ouvre la porte et procède aux ablutions hydroalcooliques. A 98 ans, Dumas peine à marcher, mais l’œil frise en confettis quand il évoque son « ami Jean », autrefois emprisonné pour vol et magouilleur impénitent. « Si vous saviez combien d’affaires mal cuites et recuites j’ai plaidées pour lui, sourit-il. Jean est arrivé ici un soir, une gueule terrible, on ne s’est plus quittés pendant vingt ans. Il y avait des problèmes partout dans ses contrats, un fouillis juridique inouï, il s’était fait avoir, j’ai dû remettre de l’ordre. Parfois, j’aidais ses amis en difficulté. Pendant les audiences, il me griffonnait des petits mots comme : “Le juge d’instruction est un salaud, il faut le compromettre” ! » Scénario pour David Bowie De ce compagnonnage, Dumas, conteur hors pair, a gardé mille anecdotes. Et un trésor : ces deux valises, ainsi qu’un petit cartable noir, qu’il s’est enfin décidé à partager. En novembre 2019, il a cédé les malles à l’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine) qui les expose à la fin du mois d’octobre près de Caen. De quoi mettre en émoi les admirateurs de Genet. On ne parle pas de quelques brouillons retrouvés au fond d’une vieille commode, mais du produit de quatorze ans d’écriture. « Quand j’ai ouvert les valises pour la première fois, j’ai été émerveillé par le désordre d’une incroyable richesse, un peu comme une caverne d’Ali Baba », se souvient Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC et responsable du fonds Genet. Au milieu des nombreux brouillons, chemises, notes, cahiers, tracts, enveloppe, affiches, carnet de vaccination, manuscrits en vrac, plusieurs textes inédits : l’esquisse d’une suite du Captif amoureux, ainsi qu’un étrange scénario écrit à la demande de David Bowie. L’existence des malles n’était connue que de quelques rares universitaires, qui osaient à peine y croire. Ouvrir ces valises, c’est entrer pour la première fois dans l’atelier d’un écrivain nomade. Et mesurer, à travers cette profusion de notes, l’incroyable créativité du « dernier Genet ». Pour comprendre l’importance de cette découverte, il faut revenir au début des années 1960. Quand Genet, en bisbille avec le producteur d’Un chant d’amour, son premier et unique film (réalisé en 1950 et sorti en 1975), rencontre Roland Dumas, il n’est plus cet auteur prolifique qui écrivit cinq romans entre 32 et 36 ans. A plus de 50 ans, il a des dents gâtées et une inspiration en berne. Une vie entre la France, la Grèce et le Maroc. Il aime Abdallah Bentaga, un acrobate marocain à la beauté féline, de près de trente ans son cadet. Avec lui, Genet joue les mentors, lui paie ses leçons de funambulisme et lui invente même des numéros d’équilibriste. Le texte Le Funambule (1957) lui est dédié, avec ce conseil tristement prémonitoire : « J’ajoute pourtant que tu dois risquer une mort physique définitive. La dramaturgie du Cirque l’exige… Le danger a sa raison : il obligera tes muscles à réussir une parfaite exactitude… et cette exactitude sera la beauté de ta danse… » Une complicité inattendue Dumas, lui, n’est pas encore le « Talleyrand » de François Mitterrand mais un avocat prisé de l’intelligentsia. Il défend les intérêts du psychanalyste Jacques Lacan et des peintres Marc Chagall et Pablo Picasso : il a organisé le rapatriement en Espagne de son chef-d’œuvre Guernica. Genet dit qu’il a choisi Roland Dumas pour son « accent méridional » et parce qu’il « ne pontifie pas comme ses collègues parisiens ». Ils ont aussi une amie en commun, Paule Thévenin, l’éditrice d’Antonin Artaud. Entre l’homme à femmes, prince de l’establishment, et le poète des déshérités, grand séducteur homosexuel, une complicité inattendue s’installe. Ils ont en commun l’amour de l’art, du monde arabe et une même passion de la transgression. Genet connaît sans doute le mot préféré des socialistes d’alors : « François Mitterrand a deux amis avocats. Robert Badinter pour le droit, Roland Dumas pour le tordu. » Genet a tenté d’écrire un scénario à partir de son premier roman. La commande vient de David Bowie, qui rêve de jouer Divine, le héros travesti de « Notre-Dame-des-Fleurs ». D’avocat, Dumas devient confident. En mars 1960, Abdallah tombe de son fil et se brise le genou. Quelques années plus tard, en 1964, craignant d’être délaissé par son mentor, le funambule se tranche les veines. Genet est au désespoir. Souvenirs d’une soirée au coin du feu, où l’avocat tente de consoler son client et l’encourage à poursuivre son œuvre. Réponse de Genet : « Non, Roland, je ne veux plus rien faire. D’ailleurs, j’ai déchiré tous mes manuscrits ! Il faut qu’une mort serve à quelque chose. » Comme pour expier le décès d’Abdallah, « Saint Genet », comme le surnomma Jean-Paul Sartre, qui lui consacra une colossale étude, fait vœu de silence. Il ne veut même plus toucher un stylo. C’est la « bouche cousue » qu’il évoquera, plus tard, dans Un captif amoureux. Une nuit de mai 1967, à Domodossola, ville frontière d’Italie, Genet, qui a rédigé un testament une semaine plus tôt, absorbe une forte dose de Nembutal, un barbiturique. Il sombre dans le coma et échappe de justesse à la mort. Légende photo : Jean Genet au côté d’Elbert Howard, alias « Big Man », militant américain des droits civiques et cofondateur du Black Panther Party (en haut), le 1er mai 1970, à New Haven, dans le Connecticut. A la fin des années 1970 a été publiée une brochure (au centre) réunissant l’ensemble des textes de l’écrivain pour l’hebdomadaire du BPP. Parmi les curiosités trouvées dans les valises, le portrait de Jean Genet réalisé vers 1975 par Jacky Maglia, un de ses anciens compagnons (en bas). Collage Camille Durand/M Le magazine du Monde à partir de photos de Michael Quemener/IMEC et David Fenton/Getty Images Le fracas du monde le sort peu à peu de sa torpeur, quitte à flirter parfois avec l’antisémitisme. Après Mai 68, Genet découvre que sa révolte intérieure peut se nouer avec une insurrection politique. Lui, l’écrivain sans domicile fixe, embrasse la cause des Palestiniens, ce peuple sans terre. Il se passionne aussi pour le combat des Noirs américains. « Un jour, il est arrivé chez moi avec un Noir de 2 mètres, se souvient Roland Dumas. Il m’a dit : “Roland, je vous remets ce monsieur.” » L’homme en question n’est autre que le porte-parole du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, accusé du meurtre de deux policiers et menacé d’extradition. « Je lui ai trouvé une planque et j’ai mouillé François Mitterrand, qui a accepté de poser une question à l’Assemblée. » La littérature comme seule possession La littérature a disparu des conversations de l’auteur, mais pas de ses rêves. Les valises en témoigneront. L’écriture est revenue phrase après phrase. Genet commence par écrire sur des emballages de morceau de sucre, des factures d’hôtel ou la couverture d’un bloc-notes. Petit à petit, ces notes convergent pour former un grand texte dédié aux Palestiniens, dont les malles conserveront la trace. Entre deux essais sur le jazz, le Japon ou son enfance, Genet écrit aussi des scénarios. Et notamment l’adaptation de son premier roman, Notre-Dame-des-Fleurs (1943). La commande vient de David Bowie. La star est fan de « Our lady of flowers » et rêve de jouer Divine, le travesti héros du roman. Dans sa biographie de Jean Genet, le romancier Edmund White raconte l’étonnante rencontre entre les deux hommes. Bowie donne rendez-vous à Genet dans un restaurant londonien. L’écrivain aperçoit une jolie femme seule à sa table et lui lance : « Mr. Bowie, I presume. » Le chanteur s’était visiblement préparé pour ce rôle. Mais le projet est abandonné faute de financement. « Genet a toujours été frustré dans son désir de cinéma : il avait des exigences telles qu’il échouait à passer de l’écriture du script à la réalisation. » Marguerite Vappereau, historienne du cinéma Personne n’a su que ce scénario avait réellement été écrit jusqu’à l’ouverture des valises. « On a souvent dit que Genet écrivait des scénarios pour des raisons alimentaires, explique l’historienne du cinéma Marguerite Vappereau, l’une des rares personnes à avoir travaillé sur le contenu des malles. En réalité, il a plutôt toujours été frustré dans son désir de cinéma : il avait des exigences telles qu’il échouait à passer de l’écriture du script à la réalisation. » Ces valises, Genet ne s’en sépare jamais. Elles sont toujours avec lui, des hôtels de gare miteux qu’il fréquente au camp de réfugiés palestiniens de Chatila, à Beyrouth, des ghettos noirs des Etats-Unis à la petite maison aux volets bleus qu’il a fait construire pour son dernier amour à Larache, au Maroc. Ses pièces, jouées partout dans le monde, l’ont rendu riche. Mais il préfère redistribuer son argent aux hommes de sa vie. Lui ne possède rien de plus que ses valises, un exemplaire des Illuminations, de Rimbaud, un blouson et une écharpe qu’il laisse flotter sur son épaule comme un lycéen. Le mythe du « dernier Genet » A la fin des années 1970, Genet découvre qu’il a un cancer de la gorge. Son ami Alexandre Romanès l’emmène à l’hôpital pour ses séances de radiothérapie. Il le revoit aujourd’hui, les doigts jaunis, tirant sur ses Gitanes jusque dans la salle d’attente. « J’allais chercher ses boîtes de Nembutal à la pharmacie, il fabriquait de fausses ordonnances au nom d’Alexandre de Nerval ou Alexandre Baudelaire, ça l’amusait beaucoup », raconte le cofondateur du cirque tzigane Romanès. Au début des années 1980, la maladie empire. L’auteur comprend qu’il n’en a plus pour longtemps et travaille sans relâche sur Un Captif amoureux. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1986, il tombe dans la salle de bains de sa chambre d’hôtel, près de la place d’Italie, à Paris. Au matin, un de ses anciens compagnons, Jacky Maglia, ex-pilote de course devenu dessinateur après un accident, le découvre inanimé. Roland Dumas le rejoint pour reconnaître le corps de Jean Genet à la morgue. Il revoit encore Maglia, tournant autour du cadavre, ressassant : « Pas de doute, ce sont bien ses pieds ! » Dumas, qui vient de quitter le Quai d’Orsay, organise le transfert de la dépouille au Maroc. « Le roi m’a fait dire qu’il voulait organiser une cérémonie grandiose avec la fanfare militaire et des intellectuels marocains. J’ai répondu : “N’organisez rien s’il vous plaît, facilitez tout.” » L’enterrement a finalement lieu avec quelques proches dans le cimetière de Larache. La vie posthume de l’écrivain peut commencer. Un mois après sa mort, Gallimard publie Un Captif amoureux, dont les épreuves corrigées se trouvaient sur sa table de chevet. L’héritage est partagé entre trois légataires, anciens compagnons de Jean Genet, dont Jacky Maglia, qui est l’exécuteur testamentaire. Les valises, léguées à Dumas, plongent dans un long sommeil. Spécialiste de Genet, Albert Dichy en entend parler au début des années 1990, alors qu’il travaille à un documentaire sur l’écrivain. Quand, début 2000, Albert Dichy est invité par Roland Dumas à ouvrir les malles, une chose le frappe : « Les valises obligent à reconsidérer le mythe d’un “dernier Genet” silencieux, légende qu’il a lui-même savamment entretenue. Leur contenu raconte la lutte entre un écrivain qui ne veut plus écrire et l’écriture qui le submerge. » Parmi les nombreux documents présents dans les valises, le brouillon d’une lettre de Jean Genet adressée, en 1976, à un juge pour dénoncer le contrat qui le liait à son premier éditeur (à droite) et une note sur la révolution, rédigée sur l’enveloppe d’un grand hôtel de Madrid en 1977 (à gauche). Collage Camille Durand/M Le magazine du Monde à partir de photos de Michael Quemener/IMEC Sur un bout de journal, Genet écrit : « Je suis toujours du côté du plus fort. » Et sur une couverture de papier à lettres : « Il n’y a pas d’autre virilité que celle-ci : la trace noire sur la nation blanche. » A travers ces textes, Genet tente de comprendre ses engagements politiques en les reliant à sa propre trajectoire de délinquant et de vagabond. « Pour ce qui semble être la suite du Captif amoureux, Genet avait l’idée d’écrire un livre avec une disposition typographique proche de celle du Talmud et avait demandé pour cela des essais au graphiste Robert Massin, détaille Albert Dichy. On trouve dans les valises les traces de ce rêve littéraire inachevé. » Pouvoir talismanique Dès leur première rencontre, Albert Dichy propose à Roland Dumas d’accueillir les valises à l’IMEC, association qui abrite le premier fonds Genet. Mais Dumas renâcle. Il pense pouvoir éditer lui-même ces textes. Les années passent. Redevenu avocat après avoir présidé le Conseil constitutionnel, Dumas se retrouve empêtré dans l’affaire Elf, pour laquelle il sera relaxé en 2003. Il faut attendre 2019 pour qu’il consente à se séparer de ces valises. A plus de 90 ans, l’avocat condamné pour « complicité d’abus de confiance » dans le cadre de la succession du sculpteur Alberto Giacometti se peaufine une image de mécène. Un document de cinq pages, que nous avons pu consulter, consigne le « don manuel de Maître Roland Dumas à l’IMEC ». Le contenu des valises y est retranscrit avec un luxe de détails, du « certificat de vaccination avant son séjour au Proche-Orient » (octobre 1970) aux « papiers à en-tête de l’hôtel New Hamra à Beyrouth ». « Nous avons fait les choses bien », nous a prévenu d’emblée Roland Dumas, pressé de dissiper tout soupçon. A la question de savoir pourquoi il a attendu si longtemps, l’avocat joue les candides : il n’est pas un spécialiste de l’édition, il a beaucoup consulté pour trouver la solution « la plus sûre et la plus intéressante ». Les archives d’écrivain sont parfois investies de pouvoir talismanique. Comme si l’immortalité des manuscrits pouvait gagner leur possesseur. Roland Dumas soupire longuement. « Je lisais parfois ses manuscrits, le soir, seul chez moi ; ça me faisait penser à Jean », souffle-t-il, une ombre de mélancolie dans la voix. Jamais de plan, que des réécritures L’exploitation des malles dépend aujourd’hui de Jacky Maglia, qui s’est toujours montré réticent par le passé. Et pour cause : Genet, de son vivant, a toujours rechigné à voir son œuvre rééditée. En plus de l’exposition à l’IMEC, un Cahier de l’Herne regroupant certains des textes de la valise doit paraître au printemps 2021. Les deux scénarios, Divine et La Nuit venue, pourraient être bientôt édités, si Maglia donne son accord. Le reste des manuscrits occupera longtemps les chercheurs. Il permet de mieux cerner le processus de création de Genet – jamais de plan, uniquement des réécritures en intégralité du même texte. « Les valises montrent aussi que Genet n’avait pas renoncé à une vie posthume à travers l’écriture. » Eric Marty, professeur de littérature Un mystère demeure. Pourquoi Genet, qui ne se comportait jamais en homme de lettres et n’a conservé aucune de ses archives, a-t-il souhaité transmettre ses valises ? Voulait-il faire plaisir à son ami Roland Dumas ? Espérait-il reprendre ses brouillons s’il guérissait de son cancer ? Ou voulait-il tout simplement que ses derniers travaux finissent par être publiés ? « Les valises disent deux choses contradictoires sur Genet : elles symbolisent l’absolue liberté d’un homme sans foyer et sans frontières, mais elles montrent aussi que, derrière ce nomadisme, il n’avait pas renoncé à une vie posthume à travers l’écriture », estime Eric Marty, professeur de littérature française contemporaine à l’université Paris-VII. Comme une façon, aussi, d’installer sa légende de poète vagabond. Parmi les curiosités qu’abritent les valises : des dessins au crayon de Jacky Maglia. Sur l’un d’entre eux, Genet est allongé dans son lit, comme s’il se reposait de sa maladie. C’est en réalité surtout dans cette position qu’il avait l’habitude d’écrire. S’il n’a plus les manuscrits de Genet à lire le soir, Roland Dumas peut se consoler avec un autre dessin qui représente l’écrivain : un portrait au crayon signé Giacometti. L’écrivain avait posé longuement pour son ami sculpteur. En ce moment, l’œuvre est prêtée à un musée, mais, d’habitude, elle est installée au-dessus du bureau de l’avocat. Comme si son « ami Jean » n’avait jamais quitté l’entresol de l’île Saint-Louis. ------------------------ « Les valises de Jean Genet », exposition à l’IMEC, abbaye d’Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados). Du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021. Gaspard Dhellemmes Légende photo : Jean Genet photographié par Brassaï en 1950 à l’Hôtel Rubens, Paris. ESTATE BRASSAI SUCCESSION

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 10, 2020 7:20 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, le 10 octobre 2020 Sous le titre « Un jour, je reviendrai », Sylvain Maurice réunit deux textes de Jean-Luc Lagarce, « L’Apprentissage » et « Voyage à La Haye ». Tout l’esprit de l’écrivain est là. On sera bref car rien ne sert de faire l’esprit fort devant ces textes déchirants et innervés de son humour ravageur : L’Apprentissage et Voyage à La Haye donnent la mesure de l’art singulier de Jean-Luc Lagarce. Son style, le régime de sa phrase, ces reprises, ces répétions qui affinent l’expression en se rapprochant de la juste expression. Comme les battements d’un cœur. Roland Fichet avait passé commande à Jean-Luc Lagarce. Il rêvait du récit d’une naissance. L’écrivain a choisi sa renaissance. Sa sortie d’un coma. Réapprendre la vie, reprendre main sur sa vie. Ce dont on peut se souvenir. Le Voyage à la Haye, avec ce qu’il y a de mélancolie et de férocité, lorsqu’il décrit le petit monde qui reçoit un des spectacles de sa compagnie, donne l’image très fraîche d’un si jeune homme encore, qui sait que son chemin se clôt. Dans un espace découpé de formes franches par des lumières très finement animées, espace imaginé par Sylvain Maurice lui-même avec André Neri et changeant selon ces lumières signées de Rodolphe Martin, Sylvain Brunet étant à la régie, Vincent Dissez interprète les deux textes comme des partitions précises, précieuses. Son, et régie son par Cyrille Lebourgeois, ajoutent à la beauté simple et saisissante de ce moment. L’essentiel repose sur le comédien que l’on sait capable d’illuminer des registres très différents. Depuis Didier-Georges Gabily et le groupe Tchang, depuis le conservatoire, on sait les qualités puissantes mais discrètement exprimées, de Vincent Dissez. Ici, il y a de la pudeur. Une juste distance avec l’auteur fauché par le sida en 1995 et qui continue de nous parler au plus près. Sylvain Maurice, dont on admire depuis toujours le travail, signe ici une perfection de théâtre qui touchera les adolescents comme leurs aînés. C’est très beau. Comme inspiré par une intime imprégnation pour celui qui dirigea le CDN de Besançon-Franche-Comté de 2003 à 2011, une maison qu’aurait pu longuement habiter Jean-Luc Lagarce… Théâtre de Sartrouville, jusqu’au 23 octobre. Durée : 1h30. Renseignements sur les horaires et réservations au 01 30 86 77 79. Site : theatre-sartrouville.com Textes publiés par Les Solitaires intempestifs. En tournée les 2 et 3 décembre au Théâtre de Lorient-CDN. Légende photo :Un découpage graphique et une présence simple, sans autre arme que le jeu. Photographie de Christophe Raynaud De Lage. Sartrouville.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 8, 2020 7:51 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 8 oct. 2020 Ton Père d’après le roman de Christophe Honoré, adaptation et mise en scène de Thomas Quillardet – Festival d’Automne à Paris. Spectacle à partir de 15 ans.
Ton Père (Mercure de France 2017, Gallimard Folio, 2019) est l’autoportrait romancé de Christophe Honoré, auteur de romans et de livres pour la jeunesse, metteur en scène de théâtre et d’opéra, et cinéaste contemporain, fort salué dans tous ces arts. A la fois, père et gay, la double identité de l’artiste trahirait, selon certains, l’hétérosexualité et l’homosexualité. Après les temps de violence de la Manif pour tous (LMPT 2012) et ses actions d’opposition à la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe – dit le mariage pour tous – en France. Et depuis la promulgation de la loi en mai 2013, les revendications du collectif vont de l’opposition au mariage homosexuel, à l’homoparentalité – adoption PMA, GPA – à la défense de la famille et au rejet de l’enseignement des études de genre, les « théories du genre ». Tout cela semble appartenir à un passé récent mais révolu. Depuis, en 2020, l’eau a heureusement coulé sous les ponts ; en 2017, l’auteur de Ton Père redéfinissait sa place à travers son propre parcours intime et professionnel. Le narrateur rappelle être allé à la Manif Pour Tous, sa fille sur les épaules. Il fait le récit de ses jours passés avec celle-ci quand elle a douze ans, dont il a la garde alternée. Il a fallu de l’assurance, admet-il, et un esprit de liberté à la femme qui a consenti à devenir parent avec lui. Sur son « oui » à elle, ils ont tous deux construit une histoire sincère, exempte de tout artifice et de toute hypocrisie : « Nous n’étions pas amants, ni amoureux, nous étions amis, et ce projet que nous nous sommes offert, nous avons chacun œuvré pour qu’il se présente de la manière la plus modeste, la moins fanfaronne, la plus simple possible ». Aussi ne comprend-il pas les attaques homophobes, tel un billet indiquant une contrepèterie douteuse : Guerre et paix, à interpréter comme Gay et père… Un récit d’épanchements et de réflexions, doublé d’une enquête avec dénouement. Dans la belle mise en scène – impression de soleil radieux – de Thomas Quillardet, un dimanche matin, alors que le protagoniste s’attarde, endormi sous sa couette, et que sa fille est partie acheter des pains au chocolat, tout commence avec la découverte à son retour d’un billet anonyme sur la porte d’entrée : « Gay et père ». Cette violente mise à l’index initie une enquête personnelle méthodique, et le narrateur, installé sur le premier rang d’un des quatre côtés de la scénographie quadri-frontale et apurée de Lisa Navarro, s’adresse librement, selon les codes du théâtre, aux spectateurs attentifs et intéressés, les prenant à témoin, raisonnant, cherchant à questionner avec eux l’absurdité de cette situation inouïe et cruelle de rejet et de haine, en convoquant sa propre enfance et ses souvenirs familiaux. Sous les lumières de Lauriane Duvignaud, Thomas Blanchard, l’œil vif, heureux d’en découdre, se lève et marche, observateur des scènes jouées sur le plateau et acteur. Il est narrateur et protagoniste, bénéficiant d’une distance appréciée avec humour. La scène est comparable à un terrain de jeux d’intérieur, une moquette claire comme un tapis moelleux d’enfant qui aurait été agrandi à la mesure des cinq jeunes gens. A la sortie de l’école, il rencontre la mère de la copine de sa fille, qui invite celle-ci à un goûter : il ne sait quels sont les sentiments de cette mère ni son jugement. La blonde Claire Catherine, mère assumée, est juste, s’obligeant à rire sans se livrer. Est convoquée sur le plateau la figure de la sœur, interprétée par Morgane El Ayoubi, décidée et déterminée, quant à ses convictions raisonneuses, prenant à témoin la mère malade, et rendant coupable ce frère qui veut tant l’impossible. Le père est mort et l’adolescent a souffert de ce regard méprisant originel. Néanmoins, il rend visite au défunt au cimetière, assis perpendiculairement à la tombe horizontale : « Avant qu’il meure, jamais je n’aurais pu imaginer qu’il était capable d’aimer un fils homosexuel. Son effacement perpétuel m’a permis d’oublier l’enfant douteux que j’avais été à ses yeux ». L’auteur vit sa prime jeunesse en Bretagne intérieure avant de rejoindre plus tard Rennes pour ses études universitaires de lettres et de cinéma. Il cite avec le sourire le lotissement des Espaces Verts à Rostrenen où il vivait alors, et le lycée de Carhaix, et les instants collectifs de la vie d’élève à la même humeur quotidienne, entre ennui et énergie joyeuse, partagés avec un quatuor d’élèves – garçons et filles. Il n’oublie pas sa route personnelle, conviviale et festive, arpentée avec ses amis, quand on boit trop de « perroquets » ou qu’on passe la nuit dehors sous la lune, les étoiles, les cris des oiseaux et les lampes-torches mobiles dans l’herbe humide. La scène est particulièrement savoureuse, les jeunes gens errent dans le noir au milieu des bruits nocturnes et des tressaillements des petites bêtes, pouffant de rire, excités et goûtant à toutes les aventures nouvelles entre eux, quelles qu’elles soient. Le public éprouve, avec les personnages, cette situation de campement improvisé. Temps mémorable de la découverte de soi – désir, filles, garçons, plaisir et drague. Quelle « folie » de vouloir pousser un jour jusqu’à la mer avec ses amis, dans la voiture d’une copine, et se retrouver seul dans un bar, en train d’écrire, au bord de la mer, avant de faire du stop pour rentrer, conduit par un drôle de type sur le qui-vive. Cyril Metzger dans le rôle est parfait, à la fois sérieux et comique, équivoque. Quant à Etienne Toqué, il joue l’ami, le camarade, toujours présent, au bon moment. Les acteurs sont habillés par Marie La Rocca de couleurs vives et printanières, des tenues d’éternels jeunes gens à la fraîcheur réjouie, pantalons, t-shirts et blousons, dégaines et chevelures libres, ce qui confère à ce chœur une gaieté acidulée. Reviennent en mémoire, entre autres, les souvenirs parisiens, avec la découverte de la danse contemporaine de Dominique Bagouet, une seconde naissance, après des débuts espiègles et sensuels où le fils se rêvait à la fois père et artiste homosexuel. Le spectacle repose sur une atmosphère de lumière radieuse, non seulement du fait du rêve accompli du narrateur, mais aussi grâce à l’engouement des interprètes, à la fois retenus et effervescents. Offrant leur passion d’être et de jouer au public, ils ravivent d’autant les bonheurs et les amertumes d’une jeunesse souriante et grave. Véronique Hotte La Comédie – CDN de Reims, à L’Atelier à Reims, jusqu’au 14 octobre 2020, du mardi au samedi à 20h, samedi à 18h, relâches les 10, 11 et 12 octobre. Tél : 03 26 48 49 10. Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, les 12 et 13 novembre. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, Le Monfort Théâtre – 75015 Paris, du 18 au 28 Novembre. Théâtre Firmin Gémier / La Piscine à Châtenay-Malabry, les 1 et 2 Décembre. Théâtre de Chelles, le 4 Décembre. L’Avant Seine / Théâtre de Colombes, le 8 Décembre. Théâtre du Fil de l’eau / Salle Jacques Brel à Pantin, le 19 Janvier…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2020 7:23 PM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog, 7 octobre 2020 Là par la compagnie Baro d’evel Inscrire un spectacle sur le blanc immaculé d’un décor, comme sur une page vierge on écrit à l’encre noire: Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias nous parlent de là, de ce vide à remplir. Premier volet du diptyque Là sur la falaise, Là est un prélude à Falaise, notre coup de cœur la saison dernière (voir Le Théâtre du Blog). Mêlant danse, acrobatie et musique, il préfigure cette épopée vertigineuse où se rencontraient huit humains, un cheval et des pigeons au pied de hautes et sombres murailles, truffées de failles. Comme dans Falaise, on assiste au surgissement intempestif des corps, littéralement enfantés par la paroi. Premières fissures, premières traces sur les trois hauts murs de l’enceinte où va évoluer le duo, bientôt rejoint par un corbeau-pie impertinent, apprivoisé mais libre comme l’air. D’abord seul, Blaï Mateu Trias, en costume noir étriqué et chemise blanche, tente quelques mots dans un micro, seul élément de décor. Mais l’oiseau perturbateur l’interrompt de ses cris, puis vient lui voler son texte. Cet univers étrange accouche alors, par voie pariétale, d’une inconnue qui ne sait que chanter ou émettre des borborygmes…Camille Decourtye joue autant de la voix que de son corps, en réponse à l’élégance empruntée de son partenaire, pour autant excellent acrobate. Faire spectacle de la rencontre de deux genres, du noir et du blanc, de deux styles, deux solitudes, tel est l’enjeu… D’abord inarticulée, la pièce trouve son langage dans l’espace et se laisse le temps d’advenir, reprenant, par bribes, les improvisations qui l’ont constituée… Une histoire s’élabore devant nous sur le plateau. Avec ses hésitations, ses interrogations. Drôle et touchante. Un premier pas-de-deux acrobatique mais harmonieux réunit le long corps raide de l’homme et les rondeurs flexibles de la femme. Mais la communication s’interrompt. Élans brisés, réitérés, ruptures puis retrouvailles constituent une gestuelle à la fois brute et poétique. Dans ce vide, tout est possible et le moindre bruit résonne. Les moindres mouvements comptent : impulsifs, saccadés, ceux du spasme ou du cri… Mais jamais tragiques : le clown pointe chez l’un comme chez l’autre. Entre sens et non-sens, les artistes cherchent à occuper l’espace et le temps, et les marquer de leur présence… Comme le clame le lamento de l’opéra baroque Didon et Énée d’Henry Purcell entonné avec humour par Blaï Mateu Trias : «No trouble, no trouble in thy breast; remember me, remember me, but ah! forget my fate. » (En ton cœur, ne te soucie pas, ne te soucie pas ; Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, mais oh ! Oublie mon triste sort !) Et l’oiseau qui s’envole, retourne se percher et défie les humains avec cet appel à l’apesanteur. Perchés eux aussi, en haut du mur, il leur faudra vaincre la gravité à leur façon et redescendre sur terre… Pour danser. Que faisons-nous là, devant vous ? Et qu’est-ce qui fait l’artiste? Et comment habiter l’éphémère de la scène et du monde? En réponse, leur passage se lit en noir sur le blanc du décor: lézardes béantes laissées par leur arrivée au forceps, traces charbonneuses de leurs glissades sur les murs, points et longs traits rageurs de coups portés par le micro. Preuves qu’ils ont été là. Et le public les a longuement applaudis . Mireille Davidovici Spectacle vu le 2 octobre, Théâtre 71, 3 place du 11 novembre, Malakoff (Hauts-de-Seine) T. : 01 55 48 91 00 Du 7 au 10 octobre Romaeuropa, Rome (Italie) ; les 15 et 16 octobre Trio…S, Inzinzac-Lochrist (Morbihan).
Les 5 et 6 novembre, Charleroi-Danse (Belgique) et du 17 au 20 novembre, Piccolo Teatro, Milan (Italie).
Les 4 et 5 décembre La Kasern, Bâle (Suisse) et du 9 au 19 décembre, Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) .
Les 14 et 15 janvier, L’Empreinte, Tulle (Corrèze).
Les 17 et 18 février, Le Zef, Biennale internationale des arts du cirque, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Du 2 au 4 mars, Comédie de Valence, (Drôme) ; les 26 et 27 mars, La Brèche, festival Spring, Cherbourg (Contentin) et les 31 mars et 1er avril, Le Prato, Lille (Nord).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2020 9:53 AM
|
Publié par Le Figaro avec AFP le 7 octobre 2020 Voir sur le site du Figaro (avec les photos, captures d'écran Twitter et liens vidéo qui illustrent l'hommage) DISPARITION - Célèbre pour son interprétation de Philippe dans Un air de famille, mis en scène en 1994 par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, l'acteur s'était distingué sur grand écran dans L'Auberge espagnole ou plus récemment dans J'accuse de Roman Polanski. Il a été emporté par une «maladie fulgurante». Le comédien Wladimir Yordanoff, grand acteur de théâtre et second rôle populaire au cinéma, inoubliable Philippe dans Un air de famille, sur les planches et à l'écran, est mort mardi à l'âge de 66 ans, a annoncé Aartis, son agence artistique. Il «est décédé aujourd'hui en Normandie des suites de maladie fulgurante», est-il précisé. En un demi-siècle de carrière au théâtre, cet acteur, fils du violoniste bulgare Luben Yordanoff, a été dirigé par les plus grands metteurs en scène, dont Patrice Chéreau (Hamlet, 1988) et Alain Françon. Formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique dans la classe de Pierre Debauche et d'Antoine Vitez, il a collaboré à plusieurs reprises avec le metteur en scène Alain Françon. C'est sous sa direction, dans Qui a peur de Virginia Woolf ?, qu'il remporte en 2016 le Molière du meilleur comédien d'un spectacle privé. En 1994, il campait Philippe, un cadre supérieur qui fait la fierté de sa mère, dans Un air de famille, la pièce à succès d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, puis dans l'adaptation cinématographique de Cédric Klapisch (1996), réalisateur qu'il retrouvera dans L'Auberge espagnole (2002). En 2000, il joue dans un autre film d'Agnès Jaoui, Le Goût des autres. S'il occupe rarement le premier rôle, dans les films au cinéma, son visage est connu de tous, tant sa carrière cinématographique l'a mené dans des films populaires (Trois zéros de Fabien Onteniente, 2002) ou plus exigeants (J'accuse de Roman Polanski, 2019, où il incarne le général Auguste Mercier). Son dernier film est OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire réalisé par Nicolas Bedos et dont la sortie est prévue le 3 février 2021. «Tu auras donné tes dernières bouffées de talent au personnage de Lessignac dans OSS. Beaucoup de gens t'aimeront encore», a écrit le réalisateur de 41 ans sur Instagram pour rendre hommage à l'acteur. Jean Dujardin, qui campe le rôle d'OSS 117, lui a également dit «au revoir». À VOIR AUSSI - L'acteur Wladimir Yordanoff jouait le général Auguste Mercier dans «J'accuse» de Roman Polanski : Lien vidéo J'ACCUSE [VF] [Bande annonce] Bande annonce Légende photo : Wladimir Yordanoff apparaîtra à l'écran à partir du 3 février 2021 dans le prochain film des aventures d'OSS 117, réalisé par Nicolas Bedos. Vincent Dargent/ABACA.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2020 7:42 AM
|
C’est une voix. Celle d’un homme, aujourd’hui âgé, qui se souvient de sa vie que les autres, à un moment de bascule, ont qualifié de « ratée ». C’est un homme qui prend la parole pour nous dire la vie que fut la sienne et celle de sa femme et de leurs enfants. « Je ne me souviens plus de mes rêves », commence-t-il. Il avait rêvé devenir riche, avoir une vie heureuse, « Je croyais que c’était suffisant », ça, être heureux. Et puis, avant même la fin de la première page de L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou, on sait que cela n’a pas été ça : « je n’ai jamais compris ce qui s’est passé. Pourquoi ça a mal tourné. »
L’homme et la faillite
L’homme qui nous parle – oui, il nous parle car c’est une voix que porte l’écriture oralisée de l’auteur – avait vécu enfant dans une ferme, fait du foot avec les potes. Adulte, il s’était comme naturellement marié, les enfants étaient venus comme ça aussi, et il avait assouvi son rêve : avoir sa propre ferme. « A l’époque, je pensais que les choses étaient simples. Je pensais que vivre était simple. » Mais rien n‘est simple quand on a une ferme modeste, la fragilité des choses fait qu’on est à la merci de tout : une météo calamiteuse, un virus, un accident de tracteur. Et c’est ce qui est arrivé. L’argent manque, on emprunte aux banques, c’est l’engrenage. L’homme ne veut pas y croire, il s’entête mais un jour l’huissier apporte les papiers à signer, la faillite est déclarée. Tout s’écroule.
« J’étais K.O. Complètement sonné. » L’échec, l’humiliation, la colère, la honte rongent l’homme, au dedans de lui. Il a des envies de meurtre, mais il les ravale. Il ne dit rien. « Je n’ai jamais pu parlé de ça. Avec personne. J’avais trop honte, je crois. Et aussi. Avec qui ? Avec qui aurais-je pu en parler ? » Pas même à ses enfants, figés dans l’enfance. Plus tard, il répondra à leurs questions en biaisant.
Son échec le met au ban du monde dans lequel il vit. « Parce que j’avais échoué, ma vie ne m’appartenait plus. » Et il y a les autres, les voisins, les anciens copains de foot qui le regardent comme un pestiféré. « J’ai encaissé le coup, tous les coups ». Il sait ce que veut dire ne plus « avoir d’horizon », il comprend ces agriculteurs qui se suicident.
Alors un jour, il part. Avec femme et enfants. Les années passent. Il vieillit, commence à voir son passé autrement. « J’ai changé. La vie que j’ai eue m’a fait changer. Et je suis moins certain d’avoir raté ma vie. J’ai fait faillite certes. J’ai eu une vie difficile, c’est vrai. Mas je ne sais pas si quelqu’un peut dire que j’ai raté ma vie. » Telle est la courbe du livre L’Homme incertain et du spectacle Le Père qui en est issu, en plusieurs mouvements ou creusements, de la négation à l’affirmation.
Laurent Sauvage au bout de la nuit
C‘est une voix. Celle d’un acteur. Laurent Sauvage. Un de nos meilleurs acteurs, un de ceux qui accompagnent notre vie de spectateur. La voix de Laurent Sauvage et son corps qui en est comme la traduction physique. Une voix voilée de vie, une voix qui porte en elle son vécu, ses insomnies. Longtemps dans Le Père, on entend la voix de Laurent Sauvage sans voir l’acteur. Il est là présent, par sa voix. Une voix qui vient de la nuit du théâtre, la nuit d’une vie. Cette voix, elle extirpe une vie de son puits, seau après seau. La déverse. L’agencement simple, les phrases jamais bien longues de Stéphanie Chaillou portent la parole de l’homme. L’acteur Laurent Sauvage leur offre son timbre lesté des balafres du temps, de tous ces rôles qu’il a emmenés au bout de leur nuit. Il ne joue pas l’homme, il le porte en lui. Il partage sa tristesse, il veut l’épauler à relever la tête, toucher ensemble au cœur de cette parole prise enfin et qu’il ne faut plus lâcher. Se taire, ce serait l’échec, encore une fois. Alors il apparaît. L’acteur, l’homme. Au loin. A peine, infime comme dans un spectacle de Claude Régy. Il s’approche de nous doucement, jambes un peu écartées comme souvent les paysans. Une jambe, puis l’autre. Tout autour la lumière tremble, lui aussi peut-être. La voix gagne en amplitude, monte, la musique en fait autant. Intensité maximum. Emotion absolue.
C’est une voix. Celle de Julien Gosselin. On ne l’entend pas mais elle est partout. Un jour, le metteur en scène tombe sur un extrait de L’Homme incertain alors intitulé Le Père, un titre qu’il conservera pour le spectacle. Un extrait publié dans la revue If que publie Hubert Colas. La revue traîne là sur une table. Il l’ouvre au hasard ou peut-être est-ce titre qui l’attire, Le Père. Il lit quelques lignes et l’émotion le submerge. Le spectacle est là en germe dans cette émotion première. Qu’est-ce qui fait qu’une écriture tout de suite nous submerge ? Cette langue, ce ton, ce monde, c’est comme s’il les reconnaissait. Quelques mois plus tard, quand on lui envoie tout le texte, il décide tout de suite d’en faire quelque chose. Et de faire cette chose avec Laurent Sauvage, lui et personne d’autre. Un homme qui parle, un acteur seul en scène. D’autres en seraient restés là. Un acteur, une chaise, une toile de fond peut-être et un plein-feux. Julien Gosselin a une autre approche du théâtre, plus généreuse et plus ambitieuse à la fois. Pour lui, tout spectacle doit être l’agencement d’une forme-monde que le spectacle (acteurs, espace son, lumière, etc.) déploie et accomplit jusqu’à son épuisement, sa clôture. Et c’est ce qui fait que ses spectacles nous pénètrent le cœur, le ciboulot et la peau. Aucun clin d’œil adressé au public mais, impalpable, un tutoiement secret avec chaque spectateur. Chacun le sien.
Autre exemple. Dans le livre, à la fin de chacune des courtes séquences, à la parole du père succède celle des enfants, ce sont de brèves comptines fabriquées avec leurs mots, des boîtes à souvenirs. Dans le spectacle, ces mots sont projetés sur un écran, un à un, comme si, à cloche-pied, ils jouaient à la marelle.
Une fraternité d’écriture
Pour Le Père, l’intelligence de Gosselin consiste à mettre en scène ensemble la solitude de l’acteur et celle de l’homme, l’une rejaillissant sur l’autre. Et d’inscrire l’acteur-homme dans un dispositif, en osmose avec le mouvement du texte de Chaillou, lequel partant de la disparition sociale de l’homme par sa négation conduit à son apparition, son identité d’être humain, cette voix qui se décide sur le tard à parler. « Jusqu’à ce jour, j’ai tout tu », dit l’homme. L’arme des mots. « Sortir de ma vie au point de la nommer », dit-il. Laurent Sauvage a lu le texte ; il a dit oui, alors la machine, le circus et la bande Gosselin - c’est tout un - se sont mis en route. Gosselin et Nicolas Joubert à la la scénographie et aux lumières, Guillaume Bachelé à la création musicale, Julien Feryn à la création sonore, Pierre Martin à la création vidéo. Des compagnons de route de Gosselin et de sa compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur, depuis plusieurs spectacles (la création initiale du Père date de 2015).
C’est une voix. Celle singulière de Stéphanie Chaillou. Pour autre preuve, un autre livre, son plus récent, Le Bruit du monde paru en février 2018 (L’Homme incertain a été publié en novembre 2014). C’est encore une vie que raconte Stéphanie Chaillou, mais cette fois à la troisième personne du singulier. La vie de Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, née le 18 juillet 1964 « dans une famille pauvre ». Pas de misérabilisme, pas de ton compassionnel, mais une fraternité d’écriture. L’histoire d’une femme incertaine, si l’on veut. Une vie qui rate une marche sur l’escalier de l’ascension sociale, étant partie dans la vie avec un lourd handicap nullement physique. Une vie marquée par la pauvreté, la honte, le sentiment d’injustice, l’envie de vengeance, la supercherie de l’égalité des chances.
Ceci : « La honte qui entoure l’enfance de Marilène ne s’accroche à rien de précis. Elle prend la forme d’un éloignement. D’un rabais. Une atténuation diffuse. Pour Marilène, tout est loin. Entaché de distance. La joie. La vie. Tout est comme enfermé dans une impossibilité à éclater, à exister. » Elle essaiera de faire comme si. Bonne élève elle entre en classe prépa, mais le mot « classe » est trop fort. Elle devient institutrice, se marie avec le premier venu. Elle ne supporte pas les enfants ni, le soir venu, le mari vissé à sa télé. Elle quitte l’enseignement et le mari. « Elle se sent désencombrée. » On est en 1990. Cinq ans plus tard, elle cesse de se taire, comme l’homme incertain. Il parle, elle écrit. « Marilène n’a plus besoin de se venger, elle écrit. »
En exergue de ce dernier livre, Stéphanie Chaillou cite une phrase de Jacques Rancière. Des mots cernant ce qui me semble être le geste fondateur de l’écriture de Chaillou. Une phrase que ferait bien de punaiser dans son bureau le Président de la République pour lui rappeler les paroles de pauvres entendues cinq heures durant dans les locaux d’ATD Quart Monde : « Le premier remède à la “misère du monde”, c’est la mise au jour de la richesse dont elle est porteuse. Car le mal intellectuel premier n’est pas l’ignorance, mais le mépris. C’est le mépris qui fait l’ignorant et non le manque de science. Et le mépris ne se guérit par aucune science mais seulement par le parti pris de son opposé, la considération. » Stéphanie Chaillou, une écriture de la considération.
Le Père, mar, mer, jeu 19h30 (sf jeu 20 14h30), ven 20h30, sam 18h30, dim 15h30, relâche le lundi et le dim 23, jusqu’au 29 sept à la MC93 dans le cadre du Festival d’automne. Puis les 22 et 23 nov au CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy.
L’Homme incertain, éditions Alma, 168 p., 16€. Le Bruit du monde, éditions Notab/lia, Noir sur Blanc, 168 p., 14€.
Un autre livre de Stéphanie Chaillou, Alice ou Le Bruit des armes (Editions Alma), fera l’objet d’une lecture par Olivier Martinaud le 8 octobre à Actoral et le 18 octobre à la MC93 (hors les murs à Montreuil) et par Sarah Jane Sauvegrain et Olivier Martinaud du 28 nov au 8 déc à la Scène Thélème.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 6, 2020 6:04 AM
|
Publié par Simon Abkarian dans Sceneweb le 6 octobre 2020
Le comédien et metteur en scène Simon Abkarian, d’origine arménienne prend la plume pour s’exprimer sur le conflit armé qui oppose depuis plusieurs jours, arméniens et azerbaïdjanais dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh. Il confirme son souhait de vouloir créer une festival de théâtre international à Erevan, la capitale de l’Arménie. Simon Abkarian qui a reçu en juin, trois Molières pour Électre des bas-fonds, reprend à partir du 16 octobre au Théâtre de Paris, Le dernier jour du jeûne.
Il y a six mois de cela, avec quelques amis liés au monde des arts et du cinéma, je rencontrai à Paris le ministre de la culture et des sports d’Arménie. La discussion était détendue, studieuse, constructive et amicale. Nous exposions chacun et chacune nos projets entre la France et l’Arménie. L’un parlait de transmission des savoirs, d’autres des moyens d’inventer des modes de production commune. Quand à moi je décidais de faire part au ministre de mon désir de créer un festival de théâtre international à Erevan. Je devais me rendre en Arménie en juillet pour visiter des lieux, mais la pandémie en décida autrement.
Je me souviens d’avoir dit au ministre que mon approche n’était nullement sentimentale mais concrète et pragmatique.
Depuis neuf jours l’Azerbaïdjan avec l’aide de l’armée Turque a déclenché une attaque généralisée sur l’Artsakh et l’Arménie. L’Europe et d’autres pays appellent au calme, quand Monsieur Erdogan clame haut et fort qu’il se tient aux côtés de son petit frère Azéri, qu’il lui viendra en aide à tout moment et par tous les moyens.
Pourquoi ? Par amour de l’autre qui parle la même langue?
Oui, mais pas seulement, aussi par reflexe…génocidaire.
Cette rhétorique raciste, cette équation mortifère « Turkye über alles » est profondément ancrée dans la classe politique turque.
Depuis les temps obscurs, son héroïsme s’est confondu à l’inhumaine cruauté.
Et son patriotisme s’est mué en un nationalisme fascisant.
Comme tout paranoïaque, monsieur Erdogan pense le monde en terme de menaces et de soumission, de vainqueurs et de vaincus, de traîtres et de fidèles.
Et fidèle à son obsession panturque, il envoie à Bakou des avions, des drones et toutes sortes de missiles et…des djihadistes Syriens, Lybiens. Ceux là même qui ont tué en France et en Europe. Ceux là même qui, équipés par Ankara, ont chassé les kurdes de Kobané et de Afrin. Mais pourquoi Ilam Aliev, comme son père trente ans plus tôt, a-t-il besoin d’engager des combattants étrangers ?
La motivation sur le champ de bataille est la clef, n’importe quel expert en matière de stratégie guerrière vous le dira. La motivation des Arméniens est simple : la survie sans conditions aucune. Aliev lui, tout comme Erdogan, est motivé par sa survie politique, rien de plus. Pour ces deux multimillionnaires, cette guerre n’est pas seulement une question identitaire Turco-Turque. C’est un leurre, un écran de fumée sensé occulter la crise économique que traversent leurs pays respectifs. Mais le sang versé quel qu’il soit, retombera sur leurs têtes.
Bien sûr, Erdogan dément être l’instigateur de cette guerre.
Le déni est une arme majeure dans l’histoire de la diplomatie turque.
Mais l’homme fort d’Ankara fait plus fort que ses prédécesseurs, il nie le crime à venir avant même de l’avoir commis. « La Turquie sera aux cotés de ses frères Azéris »
Ça veut dire : « On va finir le travail de 1915. »
Il est dans la logique criminelle de ses pères.
Et lorsqu’il est pris la main dans le sac ou plutôt sur le manche, outragé, blessé dans son honneur si ottoman, tel un mauvais acteur, il se cabre sur le théâtre du monde et réfute, récuse l’évidence même.
Les preuves de son forfait sont pourtant indélébiles.
En Syrie, en Lybie, à Chypre, en Grèce et maintenant en Artsakh et de nouveau en Arménie.
Nombreuses sont les scènes de crimes (de masses) qui jalonnent l’histoire de son pays.
L’orgueil démesuré d’Erdogan ignore la raison, il ne comprend que la force.
Et lorsque la France s’interpose, il recule.
Pourquoi ? Parce que sa témérité s’affirme sur les plus faibles que lui.
Mais nous, peuple antique et millénaire, nous ne sommes pas faibles et qu’importe où nous nous trouvons, en Arménie ou en diaspora, nous soutiendrons de toutes nos forces, de tout nos bras Artsakh la courageuse qui depuis la nuit des temps et sans interruption maintient sa présence dans son antique berceau. Les pierres, sculptées ou pas, vous le diront.
Là bas comme en Arménie les maisons sont ouvertes aux voyageurs.
Et quand trop nombreux il faudrait les nourrir, les portes se couchent, se transforment en table. C’est l’hospitalité qui est la couronne de notre peuple.
C’est elle qui fait de nous une civilisation.
Staline offre l’Artsakh, la fleur de notre patrie, aux tatars et l’histoire s’arrêterait là ?
Non, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes nos fleuves, nos rivières, nos plaines, nos forêts et nos montagnes et voulons vivre en paix.
Et vous amis de l’occident, ouvrez vos livres et remontez le cours de la grande histoire, depuis l’Antiquité « Arménie » est sur toutes les cartes et dans de nombreux récits.
L’Azerbaïdjan s’y est glissé de force en 1918, même la boisson Coca-cola est plus vielle que lui.
C’est la guerre ! Ainsi en a décidé l’homme d’Ankara, l’émir du djihad islamique.
Et la langue maternelle de Nazim Hikmet, devenue nationale, se lasse de s’entendre mentir. Les Magna-dictateurs n’en sont pas à un mensonge près.
Ils persistent et s’enlisent dans un charabia aux accents fascisants.
L’orateur s’adresse au cœur, l’usurpateur harangue les peurs.
C’est la guerre, oui, et de l’autre côté des cimes le monde vaque aux affaires du monde.
Au lieu de leurs amours, nos enfants embrassent les armes.
Ils ont vingt ans mais leurs yeux en racontent mille.
Aussi ils ne veulent pas de l’exil plus redoutable encore que la guerre tueuse d’hommes.
Ils n’iront pas marcher dans les déserts de Der Zor.
Leurs cadavres ne seront pas la proie des charognards.
Oui, c’est la guerre. Ainsi l’on décidé les frères Turcs.
Où se cachait-elle toute cette haine, messieurs?
Il était tant qu’elle sorte et que le monde vous voit tels que vous êtes vraiment.
Des monstres pétris de haine et de rancœur.
Des affairistes avides qui ne savent pas partager.
Certes vos familles détiennent des fortunes
Mais ce sont vos peuples qui vous pendront.
Car si la guerre à une vertu, c’est sa force de révélation.
Malgré vos armes dernier cri, malgré vos vociférations aux accents religieux, malgré vos
Djihadistes à 2000 dollars le mois et leurs cachetons à courage, vous ne gagnerez pas.
Car vous avez déjà perdu.
Emmenez vos morts et partez, la terre des Arméniens c’est le pays du savoir, le pays du miel et de la rose.
Vous ne sauriez quoi en faire.
Ici les femmes sont des reines porteuses de joie.
Et les filles n’ont aucun certificat à soumettre à aucun homme.
Ici la musique et le vin sont des remèdes incontournables.
Ici on peux prier à l’endroit, à l’envers ; on peux croire ou ne pas croire, personne ne viendra dire quoi que ce soit. Parce que notre pays à nous ce n’est pas un pays, c’est un carrefour. Et vous savez qui s’y croise ? L’humanité toute entière. Nous ici depuis des siècles nous pratiquons l’extase, même dans l’âpreté du combat. C’est en dansant que nous vous affronterons. Alors si vous pensez nous égorger comme des agneaux en un
tour de main, sachez que nous avons grandi sous le ventre des lionnes.
Mais sachez surtout que nous n’oublions pas 1915, que nous avons appris.
Oui, nous savons désormais que le monde vaque aux affaires du monde, que “rien” ne viendra l’en détourner. Et si ce “rien” daignait nous regarder, il le ferait toujours trop
tard. Les consciences de ce monde sont toujours en retard d’un massacre.
Elles trouvent toujours les mots justes et éloquents pour dire leur retard qui n’en était pas un. Où que nous vivions, nous les Arméniens, nous savons cela. Aussi nous nous battons pour l’avenir de nos enfants avec en mémoire nos morts qui refusent de mourir une deuxième fois.
PS : bientôt, avec mes amis, j’irai en Arménie, comme promis, créer un festival de théâtre international. Simon Abkarian le 6 octobre 20

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 5:41 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 3 octobre 2020 Avec Le Côté de Guermantes, le cinéaste, écrivain et metteur en scène, transcrit audacieusement l’encre de La Recherche, s’appuyant sur une troupe brillante. “My Lady d’Arbanville, why do you sleep so still?
I’ll wake you tomorrow
And you will be my fill, yes, you will be my fill My Lady d’Arbanville, why does it grieve me so?
But your heart seems so silent
Why do you breathe so low, why do you breathe so low”… C’est par cette chanson de Cat Stevens que débute la représentation du spectacle le plus attendu de la saison, Le Côté de Guermantes. La Comédie-Française s’installe pour plusieurs mois au Théâtre Marigny. On pénètre dans la salle où le grand plateau est occupé par un décor superbe, élégant, bien dans l’esprit somptueux d’un salon de l’époque de Marcel Proust, mais vide. Un sol de marbre noir et blanc, un espace fait pour la danse et pour les bousculades mondaines… Alban Ho Van et Ariane Bromberger signent cette scénographie que Christophe Honoré déchire en ouvrant la porte du fond du plateau, celle qui donne sur les jardins, la pluie, la fraîcheur de la nuit parisienne. Dominique Bruguière, de son art tout en nuances, éclaire l’ensemble. Il faut veiller – ce n’est pas elle ! – à l’un des lampadaires extérieurs qui, lorsque s’ouvre cette porte du fond, éblouit tant, que l’on ne voit plus les visages… My Lady d’Arbanville…Cela date de quand ? C’est lointain et beau comme la mélancolie. Il a écrit quand, Yusuf Islam…C’était le nom qu’il s’était choisi…Il y a bien cinquante ans…Mais cette chanson a les vertus que cherche Christophe Honoré : il veut nous charmer, et il nous charme. C’est un ensorceleur. Elle est interprétée par le blond Stéphane Varupenne qui s’accompagne à la guitare. Il est Marcel. Le jeune Marcel qui rêve d’approcher Oriane de Guermantes. Depuis peu, sa famille s’est installée dans un appartement de l’hôtel de cette très grande famille, et il est taraudé par ce dont il a tant entendu parler du temps des promenades…lorsque l’on allait « du côté de Guermantes ». On entendra aussi, entre autres, Nights in white satin des Moody blues…Une chanson de la fin des années 60, écrite et composée par un jeune homme blond qui aurait pu jouer Marcel, Justin Hayward…Il n’y a pas que cette époque, dans Le Côté de Guermantes On ne donne ces exemples que pour donner une idée au plus large cercle des futurs spectateurs ! Christophe Honoré, avec beaucoup de modestie –et de prudence sans doute- ne dit pas « adaptation », il dit « livret ». Comme pour une comédie musicale. On chante, mais on danse aussi en des processions enjouées réglées par Marlène Saldana. Il prend du champ, pour se protéger des éventuelles accusations d’infidélité, mais aussi, justement, pour trouver une fidélité. A la manière dont Chantal Ackerman et son co-scénariste Eric de Kuyper avaient transposé La Prisonnière pour La Captive, il y a vingt ans. Jean-Yves Tadié, le scrupuleux connaisseur, participe à l’élaboration du copieux dossier de presse (on n’a pas eu le temps de le lire) mais c’est une caution ! On est sous le charme, oui, et ému. A Marigny, on est au cœur même du jardin où se baladait le jeune Marcel, à deux pas de l’Hôtel des Guermantes. On voit entrer les « personnages » comme autant de fantômes qui nous seraient visibles… Disons, l’utilisation très sophistiqués des micros –Christophe Honoré dit qu’il n’aime pas la sonorisation, mais les micros artificieux sont de sacrés soutiens pour l’écoute, soyons simples ! – peut déstabiliser une partie des spectateurs. Un clin d’œil, aussi, au film déjà tourné l’été dernier, dans ce décor même… Il ne faut pas abdiquer toute connaissance si l’on fréquente son Proust et qu’on l’aime… Et si l’on ne connaît pas du tout, et on a le droit, il faut se laisser aller au bonheur du jeu. A l’engagement de chacun de la quinzaine de comédiens de la troupe, plus les jeunes de l’Académie. Pas de vidéo, mais une séquence déchirante, la mort de la grand-mère de Marcel, incarnée par Claude Mathieu, hallucinante dans l’agonie de cette femme qu’aime tant le narrateur. Une mort en direct (sauf que la séquence est filmée, et que la comédienne n’a pas à se mettre dans cet état terrible chaque soir), une mort qui fait écho à celle annoncée dans la scène finale avec l’apparition de Charles Swann, Loïc Corbery, émacié, comme creusé de l’intérieur, Swann qui va disparaître face au sensible Marcel : Stéphane Varupenne, en scène et sollicité deux heures trente durant. Conclusion terrible portée par deux virtuoses. En amoureux des acteurs, Christophe Honoré a offert à chacun quelques plans rapprochés. Sensuelle et avide, la Rachel de Rebecca Marder est marquante, mais l’est tout autant le plus discret Bloch de Yoann Gasiorowski, excellent, très fin, profond sans effet, intériorisé, comme le très bien tendu père de Marcel par Eric Génovèse qui joue aussi Legrandin. On pourrait citer chacun. Ils échappent à la tentation du « numéro ». Julie Sicard passe de la fidèle Françoise à l’électrique Comtesse d’Arpajon, avec art. Dominique Blanc est la Marquise de Villeparisis, taraudée par son âge mais si heureuse de mener les rondes. Florence Viala est la fée de ce petit monde, la Princesse de Parme, déliée et légèrement fatigante…Anne Kessler, maman minuscule et vibrionnante, est comme toujours idéale. Et drôle. Car Christophe Honoré transfigure l’humour du narrateur, le regard tendre mais parfois acerbe de Marcel Proust, en piques contre ce petit monde qui s’étourdit et laisse sourdre son antisémitisme bourgeois. Gilles David est Norpois, avec son autorité, Laurent Lafitte, très présent (forcément) Basin de Guermantes, a ce qu’il faut de l’assurance sans corset d’un héritier de longue famille. Il est épatant et glisse sans crainte Basin jusqu’à la sottise de chaussures rouges…On voit là qu’Oriane, à sa façon, est ligotée. Elle prend une très grande place dans le spectacle. C’est Elsa Lepoivre, brillante dans ce rôle de femme qui s’étourdit de ses bavardages, de sa méchanceté, une Célimène 1900, mais qui n’a déjà plus la jeunesse de l’héroïne de référence. Et Marcel est atrocement déçu, et on le comprend… Robert de Saint-Loup, figure essentielle, est dessiné avec profondeur et sensibilité par Sébastien Pouderoux, qui lui aussi connaît la musique ! Il est formidable Pouderoux, comme toujours. Serge Bagdassarian se délecte de sa partition de Charlus et de la scène, cocasse, des sièges. On atteint ici le cœur de la représentation dans l’écho qu’elle cherche à donner de l’écriture et de l’esprit de Marcel Proust, l’écrivain. On rit et on pleure. On est dans la vitalité, le tourbillon mondain et la mortifère angoisse d’être au monde. Vous l’aurez compris : il faut se soumettre. Accepter les décisions très personnelles de Christophe Honoré qui nous offre « son » Proust, son cher Marcel. Comédie Française au Théâtre Marigny, jusqu’au 15 novembre. Durée : 2h30 sans entracte. Texte du « Livret » et compléments documentaires publiés par L’Avant-scène théâtre (14€). Tél : 01 44 58 15 15 www.comedie-francaise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 5:17 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 5 oct. 2020 Le Festival d’automne consacre un portrait en huit spectacles à l’Encyclopédie de la parole de Joris Lacoste et de ses diseurs. Une formidable aventure que cette collecte de paroles à travers la France et le monde qui nous ravit depuis plus de dix ans. Un trésor de paroles qui nous parviennent enrichies par le geste même de leur restitution-interprétation en solo ou en commando. Je ne sais pas si Joris Lacoste est un taiseux ou un causeur, c’est assurément un homme qui ne manque pas d’oreilles. Il les laisse traîner partout, de jour comme de nuit, à la ville, à la campagne, dans les rues, les école, les logis, les forêts, les réseaux sociaux, la télé, les aéroports, les bistrots, les cuisines, partout où l’être humain, doué de parole, se manifeste. Mais s’il est à l’écoute des paroles du monde, ce n’est pas en solitaire, c’est un être collectif. Il a su s’entourer d’aficionados frénétiques et avides, dit autrement (car tout est dans le dire) : il a su contaminer et entraîner dans son sillage une pléiade d’acteurs, d’actrices, accros et véloces, une superwoman du dire, l’historique Emmanuelle Lafon, la nouvelle et phénoménale Ghita Serraj, mais aussi de non-professionnels, et encore de musiciens, de chanteurs, de chefs d’orchestres et, last but not least, d’une pléiade de récolteurs de paroles, et pas seulement en français, en moult langues. Tu parles d’un parlement Joris Lacoste et son équipe récoltent les paroles comme d’autres des pommes de terre. On ne peut vivre sans les unes ni sans les autres. A cette différence près qu’entre une ratte du Touquet et une Belle de Fontenay, il n’y a que la forme, la texture et le goût qui varient tandis que chaque parole enregistrée est unique au monde et toutes sont goûteuses. L’encyclopédie de la parole, cette fabuleuse banque de données, constitue une phénoménale collecte qui ne cesse de s’enrichir chaque année et où chaque spectacle puise. A la différence du vin ou du blé, il n’y a pas de mauvaises récoltes, toutes les paroles son top. Toute parole est bonne à dire et à entendre, nous disent, nous redisent, nous serinent, nous chantent, nous mugissent, nous hurlent, nous éructent Lacoste et les siens, car toute parole recèle une part de créativité verbale, elle vaut donc d’être enregistrée. Mais elle atteint une densité disons artistique, et à tout le moins ludique, dès lors qu’elle est épinglée comme un papillon, et par là même érigée au rang d’objet de collection et que, cerise magnifique sur ce gâteau nourrissant, elle est confiée à la bouche et au corps d’un diseur, exactement un porte-parole, qui nous la restitue, non telle qu’elle a été enregistrée mais en décalage horaire et corporel, passée par le filtre de son organe vocal, et dans un lieu autre que celui de son élocution primitive mais commun à toutes les paroles choisies : la scène. Cela fait dix ans que cela dure et on ne s’en lasse pas. Et c’est une formidable opportunité que nous offre cette année le Festival d’automne et les théâtres associés en offrant à Lacoste et à son word’s band, un portrait qui se décline en huit propositions rassemblant onze ans de labeur et de bonheur. Au commencement était Le Parlement. C’était en 2009, Emmanuelle Lafon, seule en scène devant un micro, usant à peine de ses mains et des positions de son visage, d’un ton ni neutre ni marqué, coupant court à toute théâtralité manifeste, passait d’un locuteur à l’autre à toute vitesse, une centaine de paroles. Enchaînant par exemple : les consignes données dans l’avion au moment de l’atterrissage / les paroles du coach lors d’une séance de gymnastique collective / un coup de fil de la banque vous demandant de rappeler de toute urgence avant de clôturer votre compte / l’extrait d’un discours rocailleux de Jacques Duclos / un slogan publicitaire dont j’ai oublié la marque / la litanie de l’émission « Questions pour un champion » (« je suis... ») / le coup de fil d’un type lâché par son amour et paumé dans une rupture et qui n’en finit pas de rompre / le discours d’un prédicateur religieux / la saillie d’un politicien anti-Hollande / un commentaire sportif du tiercé… (noté lors d’une représentation vue en 2012). C’était vertigineux. Ce spectacle fut comme le manifeste, l’acte fondateur de ce qui allait suivre. Emmanuelle Lafon allait le reprendre des années durant, un tube, elle le reprend – le verbe est inexact car le matériau change au fil du temps – prochainement dans le cadre du portrait au Théâtre de la Bastille. Série de suites Devait suivre une forme chorale avec une vingtaine de diseurs (Emmanuelle Lafon était du nombre) : Suite n°1, spectacle recréé aujourd’hui sous le titre Suite n°1 (Redux). On retrouve une bonne partie des acteurs de la création : Ese Brume, Geoffrey Carey, Delphine Hecquet, Vladimir Kudryavtsev, Nuno Lucas, Marine Sylf. Avec en renfort quatorze étudiants du CFA d’Asnières. Et sous la direction musicale de Nicolas Rollet, dos au public. Tout commence par un murmure de mots qui nous arrivent aux oreilles dans le va-et-vient orchestré d’un brouhaha, puis apparaissent les premières paroles en langue étrangère (anglais d’abord, mais aussi italien, allemand, espagnol, etc.). Les diseurs font bloc en chœur ou reviennent par petits groupes, de brefs solos parfois vite emportés par le reste du groupe. Le soir de la première à Gennevilliers vendredi dernier, le public a salué en applaudissant et en libérant des cris-paroles de joie, il a eu le dernier mot. Suite n°2 est une sorte de Parlement à cinq têtes et dans une multitude de langues (bien que l’anglais soit dominant) portées par Thomas Gonzalez, Vladimir Kudryavstev, Emmanuelle Lafon, Nuno Lucas et Barbara Matijević. La composition et la mise en scène sont comme toujours signées Joris Lacoste. C’est avec ce spectacle qu’adviennent la collaboration avec le musicien Pierre-Yves Massé et la collaboration artistique d’Elise Simonet. Le spectacle créé au Kunstenfestivaldesarts en 2015 était venu à Gennevilliers, déjà dans le cadre du Festival d’automne (lire ici), il revient au Centre Pompidou. Créé en 2017 au Théâtre Garonne de Toulouse, Suite n°3 Europe réunit Denis Chouillet (piano), Bianca Ianzzuzzi (soprano) et Laurent Deleuil (baryton). Le spectacle chante toutes les langues de l’Europe mais bien loin des discours officiels : chant en polonais d’une petite fille aux relents nationalistes, prêche d’un prête orthodoxe de Chypre aux accents anti-juifs, entraîneur de foot italien insultant ses joueurs, star de la télé de Porto s’en prenant à une mendiante à laquelle elle vient de faire l’aumône… (lire ici). Chaque texte est dit dans sa langue et traduit en sous-titres. Implacable et saisissant. Le spectacle Suite n°3 revient avec les mêmes interprètes mais sans sa précision « Europe » dans le titre, au Théâtre de Montreuil. Blablabla et jukebox de paroles Cette même année 2017 était créé blablabla composé par Joris Lacoste, mis en scène par Emmanuelle Lafon avec en alternance Armelle Dousset et Anna Carlier. L’actrice est assise en lotus et tient entre ses mains une tablette lumineuse. Elle appuie sur une case, hop : on entend la voix d’un enregistrement et sa propre voix vient se superposer. Beaucoup de situations quotidiennes : repas, cour d’école, salle de sports, télé, jeux vidéos... C’est un spectacle excitant et jouissif que les parents gagnent à voir avec leurs enfants (en principe à partir de 7 ans), ou ces derniers avec leurs enseignants. Un spectacle que le ministre de l’Education nationale au lieu de se préoccuper des tenues vestimentaires des élèves devrait proposer à toutes les écoles de France (lire ici). Il sera visible dans trois théâtres de banlieue et au Théâtre 14. Cette année, Suite n°4 a été créé au Théâtre national de Strasbourg le 25 septembre. Si, comme moi, vous ne l’avez pas vu ce soir-là, il sera en novembre à l’affiche de la MC93. Autre nouveau butin d’une récolte, L’Encyclopédiste sera créé, également en novembre, au Centre Pompidou avant d’aller à Chelles. Finissons ce périple aux paroles-pépites par un petit bijou qui vient d’être créé au T2G, Jukebox, dernière mise en scène en date de Joris Lacoste. Derrière un micro ou assise sur une chaise ou debout, orchestrant sa voix avec son corps et d’abord ses mains en accord avec les variations de sa bouche, Ghita Serraj enchaîne les paroles d’une façon aléatoire dictée par le public. J’explique. Dans un premier temps, Elise Simonet a coordonné la collecte de paroles auprès des habitants de Gennevilliers. Cela va d’une discussion dans un jardin partagé à une prise de parole d’un syndicaliste, d’une scène de tombola aux mots d’une influenceuse sur YouTube, d’un vendeur sur un marché à une vidéo live sur Instagram, d’un discours lors d’un pot de départ à la retraite à la récitation d’un poème par une petite fille. La liste des quarante-cinq morceaux de ce jukebox de paroles est donnée à l’entrée de la salle à chaque spectateur. Tour à tour, chacun lance à haute voix le titre de ce qu’il a envie d’entendre et Ghita Serraj s’y colle. Goulûment. Avec une confondante liberté et une jubilation légère masquant le travail intense de gymnastique de la mémoire des mots et de leur traduction gestuelle et vocale. A peine sorti, on a envie d’y retourner. Tout est à voir, à découvrir ou à revoir. Vous pouvez me croire. Sur parole, il va sans dire. Mais cela va encore mieux en le disant. C’est dit. Parlement, Théâtre de la Bastille, du 8 au 14 oct, lun au sam 19h ;
Suite n°1(redux) s’est donné du 2 au 4 oct au T2G ;
Suite n°2, Centre Pompidou du 5 au 8 nov, jeu, ven, sam 20h3O, dim 17h ;
Suite n°3, Nouveau théâtre de Montreuil, du 15 au 18 déc, mar 20h, mer, jeu et ven 21h ;
Suite n°4, MC93 Bobigny, du 19 au 22 nov, jeu et ven 20, sam 18h, dim 16h ;
blablabla, Théâtre 95 le sam 17 oct 19h30 ; Théâtre 14 du 10 au 21 nov mar au ven19h, sam 16h ; Pantin, Théâtre du fil de l’eau le mer 25 nov à 15h et le sam 28 nov à 18h ; Lavoir Numérique de Gentilly le sam 30 janv à 16h30 ;
Jukebox, les représentations au théâtre de Gennevilliers sont terminées mais le spectacle sera en itinérance dans la ville en décembre et janvier ; MC93, le spectacle sera en itinérance du 10 au 14 nov puis du 30 nov au 5 déc ; maison de la musique de Nanterre, villa des Tourelles le ven 20 nov à 19h et et sam 21 nov à 18h ; Malakoff, fabrique des arts, les jeu 26 et vend 27 nov 20h, sam 28 à 18h. L’Encyclopédiste, Centre Pompidou du 5 au 8 nov, Théâtre de Chelles le 19 janv. Légende photo : Scène de Suite N°1 (rdux) © Ctibor Bachraty

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 5, 2020 7:27 AM
|
Par Caroline Châtelet dans Sceneweb, le 5 octobre 2020
Avec Familie, Milo Rau se saisit d’un fait divers et livre une mise en scène plus habile que profonde.
Il y a des spectacles qui ne peuvent laisser indifférent. Par leur sujet, comme par leur forme. Dans cette catégorie, l’on pourrait avancer que le metteur en scène suisse Milo Rau excelle. D’abord, car en explorant dans son travail la question de la violence et du mal dans le monde contemporain, Rau se saisit le plus souvent d’histoires vraies ayant marqué notre société : génocide des Tutsi au Rwanda avec Hate Radio (2011) ; affaire Dutroux avec Five Easy Pieces (2016) ; meurtre homophobe à Liège avec La Reprise. histoire(s) du théâtre (I) (2018). Qu’il s’agisse d’épisodes historiques ou de faits divers, Milo Rau ausculte l’horreur dans ce qu’elle a de plus tragique ou triviale.
Avec Familie, créé en janvier 2020 au NTGent, le théâtre de Gand qu’il dirige depuis 2018, le metteur en scène se saisit d’un drame aussi sordide qu’énigmatique : soit la découverte en 2007 à Coulogne, petite ville française située à proximité de Calais, de quatre membres d’une même famille pendus dans leur véranda. Les parents Demeester et leurs deux enfants n’ont laissé pour tout message qu’une laconique phrase « On a trop déconné, pardon… ». Si l’affaire a été classée, le mystère reste entier sur leurs motivations.
Clôturant avec Familie sa trilogie européenne, qui retrace « l’histoire de la violence en Europe du point de vue de citoyens européens lambdas » (entamée avec Five Easy Pieces et La Reprise), Milo Rau décide de réunir sur scène une vraie famille : les comédiens flamands An Miller et Filip Peeters, couple dans la vie, avec leurs deux adolescentes Leonce Peeters et Louisa Peeters. Ce choix atypique répond à l’un des dix points énoncés dans le Manifeste de Gand (« Au moins deux des acteurs sur scène ne peuvent pas être des acteurs professionnels »), profession de foi théorique dans laquelle Rau défend sa conception du théâtre. Mais il participe, également, du trouble et de l’adhésion suscitée par le spectacle, l’identification et l’empathie face à une vraie famille étant amplifiée.
Lorsque les spectateurs prennent place dans la salle, ils découvrent à l’avant-scène, devant le rideau fermé, une table sur laquelle se trouve un grand carnet et une lampe de bureau ; deux chaises ; et une caméra sur le côté ; tandis que des chants d’oiseaux résonnent au lointain. Évoquant un dispositif d’interview, cet espace ne sera investi que par l’aînée des filles. Un choix justifié par le fait que c’est elle qui prendra en charge le récit de leur histoire, et qui orchestrera le destin familial. D’ailleurs, jamais personne ne viendra s’asseoir en face d’elle, preuve que cette place nous échoit à nous, spectateurs.
Quand Familie débute, le rideau s’ouvre sur une maison aux briques rouges et aux parois vitrées, surmontée d’un grand écran. Tandis que les briques évoquent le Nord-Pas-de-Calais, les vitres, en mettant à vue toutes les pièces de la maison, font des spectateurs des entomologistes en puissance, scrutant les déplacements. Nous allons assister à une reconstitution des derniers instants de la famille, relayés par la vidéo surplombant la scène. Ces moments – préparation du dîner, repas, rangement – extrêmement prosaïques s’étirent en longueurs, et sont ponctués parfois de confidences intimes en voix-off ou dites face au public. Ils alternent également avec d’autres séquences racontant la genèse du projet, les échanges au sein de la famille Peeters-Miller sur celui-ci, ainsi que le travail d’enquête mené autour des Demeester.
Narré, donc, par l’aînée – et accompagné de traces vidéos de leur voyage jusqu’à la maison de Coulogne – ce récit étoffe le geste de reconstitution. Car comme le raconte l’adolescente, elle-même aurait eu quelques mois auparavant des pensées suicidaires – expliquant sa position de meneuse dans le suicide familial. Par ces aveux, le spectacle (voire, le théâtre) devient ici un geste de réparation, la manière d’empêcher de commettre l’irréparable en le jouant. Advient ainsi ici une autre vérité, celle de la scène, peut-être la seule qui vaille. Et si rien ne garantit la véracité de cette histoire, le dispositif réaliste et la présence d’une vraie famille encouragent à apporter du crédit à celle-ci. En apportant un surcroît de tragique, cette confidence rapproche également les deux familles. Difficile de démêler l’enquête du témoignage, la fiction documentaire de la représentation du réel, la reconstitution d’une soirée chez les Demeester ou la simple mise en jeu d’une autre, habituelle, chez les Peeters-Miller. Hélas, ces moments de trouble – jouent-ils eux-mêmes ou les Demeester ? À qui appartiennent ces paroles ? – n’empêchent pas les scènes interminables.
Si l’on comprend qu’il s’agit pour Milo Rau de donner à voir une ultime soirée dans sa banale platitude, ainsi que la trivialité d’instants précédant la mort, l’ensemble de la reconstitution se révèle bien faible, bancale, voire, carrément indigente par les évocations appuyées (sorte de phrases clin d’œil) de l’ultime geste à venir. Car ce geste ultime, donc, va venir. Et rien ne nous en sera épargné. C’est, d’ailleurs, également en cela que les spectacles de Milo Rau ne laissent jamais indifférents : tout est donné à voir, dans les moindres détails. En l’occurrence, la pendaison s’éternisera plusieurs dizaines de secondes.
Face à l’ensemble naît, au-delà de l’émotion, le sentiment étrange de ne pas avoir eu le choix, de se trouver face à un spectacle qui ne peut pas ne pas émouvoir profondément. Explicable par le propos initial ; par la présence d’une vraie famille ; par l’exposition de tous les instants du drame ; ainsi que par l’aveu terrible de l’aînée, cette sensation trouve sa source, également, dans la maîtrise formelle. Outre la scénographie et la création lumière soignées, les comédiens impeccables, le recours à des procédés scéniques (récurrents chez Milo Rau) favorisent notre immersion dans le récit et notre identification avec les personnages : vidéo en direct offrant des gros plans sur les visages, chapitrage et générique introductif et final soutenant la narration, musiques émotionnellement puissantes (qu’il s’agisse de Leonard Cohen, ou de Tristes apprêts de l’opéra Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau).
Spectacle éminemment efficace et habile, Familie serait alors trop volontariste en regard de son propos comme de l’épaisseur de celui-ci. Si cette manière de Rau d’opposer à l’énigme du geste des Demeester la représentation par le menu du drame se révèle peut-être une manière de vouloir contrer, combler son énigme, elle n’y suffit pas. Et la cavalerie d’artifices requis comme l’exposition scrupuleuse du suicide étouffent le spectacle en imposant leur charge compassionnelle.
Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr
Familie Conception et mise en scène Milo Rau Texte Milo Rau et les interprètes Avec An Miller
Filip Peeters
Leonce Peeters
Louisa Peeters Recherche et dramaturgie Carmen Hornbostel Costumes Anton Lukas
Louisa Peeters
Künstlerhaus Mousonturm, Festival de l’Europe de Rome
cette production a été réalisée avec le soutien de L’abri fiscal belge
Durée: 1h30
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national dans le cadre du Festival d’Automne
3 au 10 Octobre 2020
Complet
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...