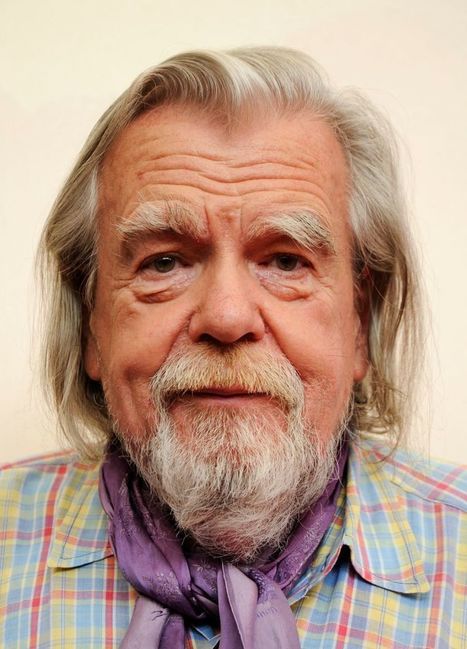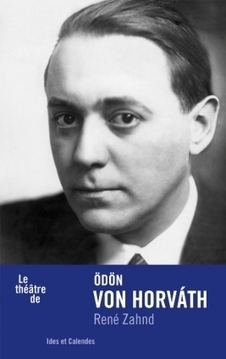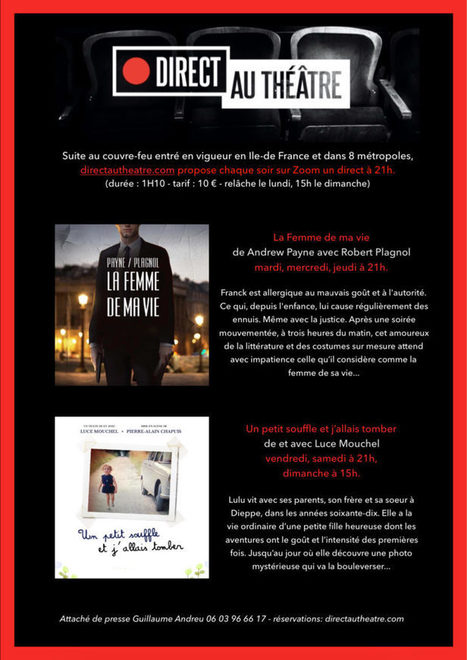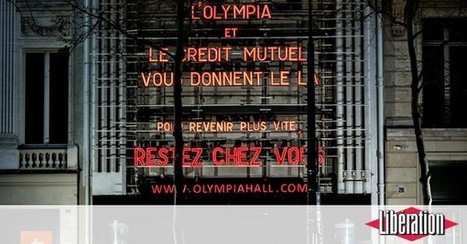Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 23, 2020 4:29 PM
|
par Fabienne Darge dans Le Monde 23/10/2020 La Norvégienne présente, à la Semaine d’art en Avignon, son théâtre de marionnettes adapté du chef-d’œuvre d’Herman Melville. Une grande Norvégienne au regard doux et rêveur part à la chasse à la baleine. Avec ses armes : ses marionnettes et son théâtre multisensoriel. Yngvild Aspeli est la découverte artistique de la Semaine d’art en Avignon, où elle présente rien de moins qu’une adaptation de Moby Dick, le titanesque roman d’Herman Melville, insondable comme la mer elle-même. L’immensité ne semble pas faire peur à Yngvild Aspeli, née il y a 37 ans au milieu des montagnes norvégiennes. Le petit village est entouré de forêts, enveloppé de neige la moitié de l’année, et la maison remplie de livres, notamment les albums pour enfants qu’écrit le père d’Yngvild. « Le goût de la littérature et de la poésie m’a été donné d’emblée », note-t-elle. « Théâtre à la croisée des arts » Entre cette enfance magique et sa vie d’aujourd’hui, celle d’une marionnettiste et metteuse en scène dont on commence à beaucoup parler, il y a une jeune femme qui est partie seule à Paris, à 19 ans, pour entrer à l’Ecole internationale de théâtre Jacques-Lecoq, un endroit où l’on apprend le théâtre par le corps et l’image plus que par les mots. Yngvild Aspeli faisait du théâtre depuis toujours, mettant en scène ses camarades d’école, un théâtre où elle fabriquait tout elle-même, comme elle le raconte au moins autant avec les mains, qui dansent dans l’air quand elle parle, qu’avec les mots. Chez Lecoq, elle a creusé son désir de « créer un théâtre à la croisée des arts » et d’« utiliser les outils visuels de manière dramaturgique ». La marionnette est arrivée comme une évidence, et elle a alors intégré l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, dont elle est sortie en 2008 en créant sa compagnie, Plexus polaire. « Dès le début, j’ai voulu par le théâtre parler de ce qu’on ne dit pas, ce qu’on ne montre pas, de l’invisible, l’inexplicable, dit-elle. Je m’intéresse aux histoires qui ne sont pas racontées, et à ce qu’elles révèlent d’une société. » L’inquiétante étrangeté de la marionnette s’est conjuguée chez elle à une recherche sur le son, la vidéo, la lumière et la scénographie. « Ce qui m’obsède, c’est la manière dont une histoire peut devenir une expérience physique, sensorielle, précise-t-elle. Il y a des choses que l’on peut comprendre par le ventre, par le cœur, et pas seulement par le cerveau. Le théâtre est un espace où tout ce qui est inexprimable peut être vécu, et pas expliqué. » Yngvild Aspeli : « Je m’intéresse aux histoires qui ne sont pas racontées, et à ce qu’elles révèlent d’une société » Dès son premier spectacle, Signaux, créé en 2008, son univers était là. Elle l’a rêvé d’après un recueil de nouvelles de l’auteur norvégien Bjarte Breiteig, intitulé Douleurs fantômes, un titre qui pourrait résumer toute la recherche de cette exploratrice de l’âme humaine dans ses recoins les plus secrets et les plus troubles. Dans Cendres, créé en 2014 et inspiré par le récit d’un autre écrivain norvégien, Gaute Heivoll, elle partait sur les traces d’un jeune pyromane. Dans Chambre noire, créé en 2017, et qui est toujours en tournée, elle a adapté le formidable roman que la Suédoise Sara Stridsberg a consacré à la féministe Valerie Solanas, prisonnière de son image de « femme qui a tiré sur Andy Warhol ». Yngvild Aspeli s’interroge d’elle-même, elle qui vit en France depuis quinze ans, sur ce goût des artistes nordiques pour l’invisible, les créatures imaginaires, les présences absentes. « Sans doute est-ce lié à la nuit, qui chez nous règne une bonne partie de l’année, observe-t-elle, songeuse. Dans le noir, on s’imagine que l’on n’est pas seul, et on imagine des créatures d’autres mondes, des “sous-le-monde” », comme on les appelle chez nous… Mais oui, je suis assez occupée par les fantômes de toutes sortes », dit-elle avec un rire léger, et ce regard qui sans cesse se perd vers des horizons lointains. « Affronter le monstre » Moby Dick, sans doute, rôdait depuis longtemps dans les parages, quand elle a décidé qu’elle était prête à s’attaquer au chef-d’œuvre de Melville, à « affronter le monstre ». « C’est bien un monstre, inépuisable, que ce livre qui est aussi complexe que son sujet principal, la mer, médite-t-elle. La mer et l’humain s’y superposent, en une infinité de profondeurs inconnaissables. Le livre est si poétique et si concret, il arrive à rendre ses questionnements existentiels tellement vivants… » Le grand-père d’Yngvild Aspeli était marin, il avait une femme nue tatouée sur le bras, sa petite-fille se souvient de sa maison, remplie de souvenirs de ses voyages. « Il y avait un bébé alligator empaillé, des petites tasses chinoises, un éléphant sculpté en bois indien… La mer était une ouverture vers le reste du monde. » Elle-même a passé des semaines à Stamsund, une des îles Lofoten, où elle était en création quand la Norvège a décidé de confiner sa population. Elle sait que Moby Dick est un défi à la représentation : la mer, la baleine, le bateau, la folie d’Achab… La capitaine Aspeli affronte l’aventure avec un certain nombre d’atouts : son talent dramaturgique, ses marionnettes à taille humaine, qu’elle sculpte elle-même pour leur donner l’expression recherchée, le travail sur l’image sophistiquée de son vidéaste, David Lejard-Ruffet, la musique portée par Ane Marthe Sorlien Holen, forte personnalité à la Björk… « Il faut faire un voyage à la mesure de celui du capitaine Achab, il faut plonger… », conclut Yngvild Aspeli, une grande fille qui n’a pas peur de regarder le monstre en face. Moby Dick, d’après Herman Melville. Mise en scène : Yngvild Aspeli. Semaine d’art en Avignon, du 27 au 31 octobre à 16 heures, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. festival-avignon.com. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) Légende photo : « Moby Dick », par la compagnie Plexus polaire. CHRISTOPHE LOISEAU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2020 7:59 PM
|
Par Jean-Marc Lalanne dans Les Inrocks - 20/10/2020 Laure Calamy et Nicolas Maury ont tourné pour la première fois ensemble sur le plateau de Dix pour cent, dont on découvre aujourd’hui la saison 4. Au moment où se termine la série, c'est une forme d'accomplissement qui se fait jour : avec le succès populaire d'Antoinette dans les Cévennes pour la première, avec un premier long métrage très réussi, Garçon chiffon, pour le second. Quand on les a vu·es pour la première fois, il·elles partageaient une même serre. Une cage de verre en longueur dans les bureaux de l’agence ASK, jouxtant les bureaux de leurs responsables respectifs. C’était il y a cinq ans, lors de la première saison de Dix pour cent. Noémie et Hervé étaient assistant·es d’agents : une assistante plus que dévouée pour la première, un assistant plus fantasque que rigoureux pour le second. Deux purs personnages de comédie respectant tous les critères du théâtre classique : hiérarchiquement subalternes (tels des valets), insatisfait·es dans leur vie amoureuse et sexuelle (elle est amoureuse de son patron mais il ne veut pas quitter sa femme, il est homosexuel et n’arrive pas à fixer une relation), condamné·es à tout vivre sur le mode de la bouffonnerie (là où les scènes d’introspection graves et bluesy sont réservées aux personnages plus centraux, telle Andréa). Dans la saison 4 de Dix pour cent, Noémie n’est plus assistante mais chargée de développement. Elle partage le bureau de son amant et ancien patron Mathias, lequel a quitté son épouse pour vivre avec elle. Hervé n’est plus assistant mais agent junior, avant d’être engagé comme comédien par la cinéaste Valérie Donzelli. Le trajet commun d’Hervé et Noémie, c’est l’histoire d’une triple ascension : celle, dans la fiction, de leurs personnages, gravissant de saison en saison de nombreux échelons ; mais aussi celle du statut de leur personnage à l'intérieur de la série, glissant progressivement de la place de simple faire-valoir comique à celle de personnage de premier plan ; et enfin, celle des comédien·nes qui interprètent Noémie et Hervé, Laure Calamy et Nicolas Maury, qui, à l’heure où France Télévision déflore cette quatrième saison, ont vu leur position se modifier considérablement sur le planisphère du cinéma d’auteur français. Des premiers rôles Laure Calamy emporte avec elle le plus gros succès d’art et essai de la rentrée, Antoinette dans les Cévennes, véritable phénomène au box-office, qui, dans un contexte de désertion des salles, caracole à plus de 600 000 entrées France à ce jour (et pourrait bien approcher du million). Nicolas Maury, lui, vient de signer son premier long métrage de cinéaste, le très inspiré Garçon chiffon, (auto ?)portrait d’un comédien en crise qui reprend pied après un détour par ses cicatrices d’enfance. >> Lire aussi : Laure Calamy explose dans “Antoinette dans les Cévennes” On ne sait pas encore si Garçon chiffon connaîtra comme Antoinette dans les Cévennes un large succès public, mais le film marque en tout cas une naissance : celle d’un cinéaste extrêmement doué, affirmant par les moyens de la mise en scène de cinéma un univers poétique aussi précieux que celui que l’acteur Nicolas Maury a longtemps transporté dans des films signés par d’autres. Créatrice de Dix pour cent (elle quitte la série après la troisième saison), Fanny Herrero se souvient du moment où sa Noémie et son Hervé ont pris corps. “Je ne les connaissais pas avant que la directrice de casting de Dix pour cent ne les propose. Laure a tout de suite été une évidence. Elle me semblait pouvoir excéder largement le simple archétype de la secrétaire. On sent qu'elle a du vécu. Et j'adore son physique. Il raconte plein de choses, à la fois une puissante sensualité et en même temps la conscience d'exister en dehors de la norme. Elle fonctionnait très bien avec Thibault de Montalembert, qui a un côté très bourgeois, alors qu'elle renvoie au contraire quelque chose de plus populaire. Concernant Nicolas, ça a été moins évident au premier abord. J’imaginais le personnage moins maniéré. Mais lorsque je l'ai vu jouer, j'ai compris qu'il dépassait complètement le cliché de l'homosexuel affecté en y amenant une fantaisie et une étrangeté géniales. Il arrive à faire en sorte que tout ce qu'il fait soit surprenant. De seconds rôles, ils sont devenus au fil des saisons des premiers rôles. Mais en vérité, dès la fin de la première saison, nous savions que nous allions leur donner de plus en plus de place. Une de mes scènes préférées de toute la série est d'ailleurs probablement celle où, à la fin de la saison 2, Hervé décide de ne pas aller à Cannes pour tenir compagnie à Noémie, qui est privée de festival. Ils regardent la cérémonie et finissent par danser ensemble devant l'ordinateur.” Ce progressif recentrement des deux personnages au cœur du récit a évidemment considérablement accru la notoriété de l’une et de l’autre. Laure Calamy en convient : “Oui, bien sûr, cette série a changé ma vie. Si, depuis cinq ans, je tourne à un rythme soutenu, c’est sans doute en partie grâce à Dix pour cent. On me propose des rôles plus importants parce que je suis plus identifiée. Tout à coup, on se dit que je peux toucher le grand public. Mais j'ajouterais quand même que, Nicolas comme moi, nous existions dans le cinéma d’auteur avant Dix pour cent. Depuis plusieurs années déjà, je m'étais sentie vraiment regardée par certains cinéastes. Je dirais que ce sont deux parcours qui se sont aidés l’un l’autre.” En effet, l’apport est totalement réversible. Si Dix pour cent a donné un indéniable coup d’accélérateur à leur carrière, l’intelligence de la série a été aussi de se laisser traverser par des vibrations issues du plus exigeant et original cinéma d’auteur contemporain, dont Laure Calamy et Nicolas Maury étaient déjà des égéries. Sans elle et lui, sans leur fantaisie instable, leur grâce trublionne et l’originalité des univers artistiques dont il·elles sont porteur·euses, la série perdrait ce rapport intime au cinéma qui en fait le prix (et ne tient pas seulement à la façon dont elle accueille en majesté ses guests prestigieux·euses). Le sentiment de renaître au monde Quels sont ces univers dont les deux comédien·nes sont porteur·euses ? Il y a d'abord une troublante proximité de parcours. Tous·tes deux viennent de province : une petite ville près d’Orléans pour Laure, une petite ville dans le Limousin pour Nicolas. Tous·tes deux se sont installé·es à Paris pour faire du théâtre. Tous·tes deux ont été admis au très prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Tous·tes deux ont éprouvé ce sentiment de renaître au monde en montant sur une scène. “C’est au Conservatoire que j’ai appris à explorer des choses que je ne connaissais pas de moi. Dans le même temps, je faisais mon apprentissage de spectatrice” Laure Calamy “Oui, clairement, pour moi, le théâtre a été une seconde naissance, raconte Laure. Quand j’étais enfant, un ami de mon père, le comédien Jean-Paul Dubois, passait régulièrement à la maison. Il nous racontait ses tournées de théâtre et ça me faisait très envie. Mais j’étais très en timidité avec ça. J’ai pris des cours de théâtre, puis fait la rue Blanche. J’ai commencé à éprouver cette émotion particulière que constitue le fait de monter sur une scène. Mais c’est au Conservatoire que j’ai appris à explorer des choses que je ne connaissais pas de moi. Dans le même temps, je faisais mon apprentissage de spectatrice. J’allais voir beaucoup de spectacles, certains me bouleversaient : La Servante d’Olivier Py, Le Sacre du printemps de Pina Bausch, découvert dans la Cour d’honneur d’Avignon… Le monde ne cessait de s’ouvrir. J’apprenais en voyant les spectacles de Pina Bausch comment chaque danseur arrivait à créer une fiction particulière, seconde, à l’intérieur de celle de la pièce.” Olivier Py, dont elle a tant admiré La Servante, la repère dès le Conservatoire et lui propose d'intégrer l'atelier de jeunes comédien·nes que le Conservatoire lui confie. Il écrit pour ses élèves un spectacle : Au monde comme n’y étant pas (2001). “Au Conservatoire, j’ai joué beaucoup de belles-mères méchantes dans des Feydeau. Mais Olivier a eu justement envie de me proposer des emplois de tragédienne. Il me disait que ce qui était intéressant chez moi, c’est que j’étais entre Feydeau et Andromaque.” Ils se retrouveront plus tard sur deux autres spectacles. C’est aussi en se découvrant une aptitude à déclencher le rire que Nicolas Maury naît à la scène. “A l’âge de 10 ans, j’étais en classe verte pendant les vacances et il fallait préparer un spectacle. J’ai joué sur scène un sketch des Inconnus, celui où on répète en boucle 'Stéphanie de Monaco'. Et là j’ai vu face à moi trois cents personnes éclater de rire. Dans la vie, je n’étais pas un garçon qui faisait rire les autres, j’étais plutôt très en retrait. Mais, tout à coup, sur scène, je sentais un appel d’air.” Ce n’est que l’année suivante, à 11 ans, que le petit garçon se formule qu’il veut devenir comédien. “C’était également l’année où mes parents se sont séparés. J’ai eu l’instinct que ce serait par ce chemin que je pourrais retisser un monde qui par ailleurs venait de tomber en lambeaux.” “Nicolas ne se satisfait jamais d’une seule proposition de jeu, doit vraiment explorer dans tous les recoins une scène avant de fixer quelque chose” Guillaume Vincent Après le lycée, il entre au conservatoire à Bordeaux. Pas encore vingtenaire, il obtient un petit rôle dans Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau en 1998. “Je n’avais pas énormément de choses à jouer, mais j'étais présent dans beaucoup de scènes. Je suis resté dix-sept jours sur le plateau, que j’ai passés à tout observer avec voracité, à m’imprégner de chaque moment. C’était une expérience sidérante de me retrouver entouré de si grands acteurs. Mais plus encore que Jean-Louis Trintignant, c’était Valeria Bruni-Tedeschi que je ne pouvais pas quitter des yeux. Car j’avais été ensemencé par Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel.” Après Bordeaux, Nicolas intègre le conservatoire de Paris, où il s’installe à l’âge de 22 ans. A peine est-il sorti du Conservatoire qu'un jeune metteur en scène le remarque : Guillaume Vincent. Il met en scène le comédien dans plusieurs textes de Lagarce (Nous, les héros en 2006, Histoire d’amour en 2007), avant de lui confier le rôle de Moritz, l’adolescent suicidaire de L’Eveil du printemps de Frank Wedekind – un rôle clé dans la carrière du comédien, sur lequel il revient largement dans son premier long métrage de réalisateur, Garçon chiffon. Guillaume Vincent, qui a dirigé Nicolas Maury dans une demi-douzaine de spectacles, jusqu’au très beau La nuit tombe, présenté à Avignon en 2012, se souvient de leur collaboration fertile : “J’étais impressionné par sa force de travail. Nicolas est tout le temps en train de chercher. Il ne se satisfait jamais d’une seule proposition de jeu, doit vraiment explorer dans tous les recoins une scène avant de fixer quelque chose. C’est très inspirant.” >> Lire aussi : “Dix pour cent” : que vaut vraiment la saison 4 ? Une place dans ce cinéma d'auteur français C’est donc d’abord au théâtre que Laure Calamy et Nicolas Maury imposent leur présence inédite et troublante. Pour Laure, le cinéma tarde un peu à se signaler. “Pendant des années, j’ai eu le sentiment d’être une mauvaise herbe pour le cinéma. Je faisais un casting tous les deux ans, généralement pour des petits rôles. Et les premières propositions sont venues de cinéastes qui m’avaient vue au théâtre.” C’est Vincent Macaigne qui lui permet de faire un passage remarqué de l’un à l’autre. Sur scène, il fait d’elle la Gertrude d’une adaptation tonitruante d’Hamlet en 2011, Au moins j’aurai laissé un beau cadavre. Aspergée de sang, vociférante, la comédienne laisse libre cours à son inspiration la plus tempétueuse. La même année, le metteur en scène fait ses premières armes de réalisateur de cinéma avec un moyen métrage et introduit la comédienne entre deux personnages de frères se déchirant pour une histoire d’héritage (Ce qu’il restera de nous, 2011). Dans la foulée, un jeune metteur en scène, Guillaume Brac, propose à la comédienne d’incarner une mère en vacances avec sa fille adolescente dans son moyen métrage, Un monde sans femmes (2012). Une nouvelle histoire de trio, où la mère et la fille se partagent les faveurs amoureuses d’un jeune homme maladroit interprété justement par Vincent Macaigne. Le film obtient un beau succès critique et un certain écho public. Brac, Macaigne : Laure Calamy semble se trouver une famille dans le jeune cinéma français des années 2010. Dans les années qui suivent, on la retrouve dans des seconds rôles toujours plus marquants, déployant avec de plus en plus d'aisance son inspiration farfelue : avocate puis sœur de Virginie Efira chez Justine Triet (Victoria, 2016, Sibyl, 2019), naturopathe-magicienne exerçant dans la forêt chez Guiraudie (Rester vertical, 2016), à nouveau mère d’une adolescente dans une ville balnéaire dans le premier film remarqué de Léa Mysius (Ava, 2017, qui lui vaut sa première nomination aux César dans la catégorie second rôle féminin). Dans Les Rencontres d’après minuit, il est l’hôtesse déchaînée d’une partouze mélancolique en tenue de soubrette Dans le même temps, Nicolas Maury s’aménage aussi une place dans ce cinéma d'auteur français en plein renouveau du début des années 2010 (sanctuarisé par une célèbre couverture des Cahiers du cinéma, "Demain ils feront le cinéma français", novembre 2010) . Il est un prof de français peu autoritaire dans Les Beaux Gosses de Riad Satouf (2009), puis le cousin de Léa Seydoux et Anaïs Demoustier dans le premier film de Rebecca Zlotowski (Belle Epine, 2010). Mikael Buch lui donne son premier premier rôle dans la comédie queer Let My People Go !, où le comédien est étourdissant de fantaisie drolatique (notamment dans un playback extravagant sur Where Is My Man ? d’Eartha Kitt). Enfin, Yann Gonzalez lui donne à cinq ans d’intervalle deux rôles extrêmement marquants : dans Les Rencontres d’après minuit (2013), il est l’hôtesse déchaînée d’une partouze mélancolique en tenue de soubrette (on pense bien sûr au travestissement idoine du fameux auteur argentin seventies Copi). Puis dans Un couteau dans le cœur (2018), il est un hardeur de porno gay au service de Vanessa Paradis (son idole d’enfance, à laquelle il rend un émouvant hommage dans Garçon chiffon, en playback sur Marilyn et John). Deux talents monstres “Je n’ai jamais été de ceux à qui on fait immédiatement une place royale, confie sans amertume Nicolas. Je n’ai pas enchaîné les tournages. Je n’ai jamais fait partie de ces comédiens à qui on offre tout, tout de suite. Je ne m’en plains pas d’ailleurs. Je me suis senti accueilli dans certains films par certains cinéastes qui m’avaient vraiment choisi." Bertrand Mandico, un des cinéastes à l’univers poétique le plus transgressif de sa génération, a par exemple choisi Nicolas pour le clip d’une chanson de Calypso Valois, Apprivoisé. Le comédien y interprète un étonnant oiseau de proie qui affole un dîner mondain en accomplissant des prodiges avant d’égorger tous·tes les invité·es à grands coups de griffes. Quand on l’interroge sur le jeu de Laure Calamy, Vincent Macaigne parle de sa “fureur magnifique” et conclut en disant : “Laure a un monstre en elle.” Dans Garçon chiffon, le personnage principal décrit ainsi l'amour toxique qui l'unit à son compagnon : “Plus je l'aime et plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.” Cette capacité à faire sourdre un monstre intime tapi en soi, c’est peut-être le lien le plus fondamental entre les deux comédien·nes. Nicolas confirme : “C’est un mot qui a une étymologie magnifique, 'monstre'. Ça désigne ce qui est montré. Avec Laure, nous avons en commun d’aimer montrer tout ce qui peut nous traverser entre la fiente et le lyrisme. D’ailleurs, Laure m’a offert le livre de Gérard Depardieu intitulé Monstre.” Laure enchaîne en disant qu’en voyant Nicolas dans son costume lors du shooting pour Les Inrockuptibles, elle a pensé au Joker du film de Todd Phillips. “Il serait formidable dans ce rôle à la fois monstrueux et si humain, qui fait peur et dans lequel tout le monde peut se reconnaîre.” Puis elle ajoute que tous les deux pourraient tenir le rôle. “On s’est souvent plu à s’imaginer Macbeth et Lady Macbeth, mais je nous verrais bien aussi jouer une paire de jokers.” Ils éclatent de rire. “On s’était croisés quelques fois dans la vie grâce à des amis communs, mais on s’est vraiment connus sur le plateau de Dix pour cent. On s’est immédiatement trouvé un imaginaire et un endroit de jeu communs” Laure Calamy En dépit des diverses résonances de leurs itinéraires, Laure et Nicolas n’avaient jamais tourné ensemble avant la première saison de Dix pour cent. La rencontre a été foudroyante. “On s’était croisés quelques fois dans la vie grâce à des amis communs, mais on s’est vraiment connus sur le plateau de Dix pour cent. On s’est immédiatement trouvé un imaginaire et un endroit de jeu communs. Au début, nous étions présents dans beaucoup de scènes, mais sans avoir beaucoup de choses à faire. On développait ensemble des délires, qu’on injectait ensuite dans les scènes.” Nicolas complète : “C’était une relation assez exclusive, et même un peu excluante pour les autres. Je pense que ce lien que nous avons noué a déterminé ensuite l’évolution des personnages d’Hervé et Noémie, leur amitié véritablement fusionnelle. Au départ, leur relation n’était pas du tout écrite comme ça.” “Mais quel travail !” En jouant avec Laure, Nicolas raconte qu’il a très vite eu envie de la filmer. Il présente alors un projet à l’Université d’été internationale de cinéma Emergence, qui permet à de jeunes cinéastes, sur concours, de mettre en œuvre une scène de leur scénario. Il fait incarner à la comédienne une réalisatrice en crise, au bord de la démence, hurlant sur son assistant souffre-douleur et mettant en péril le film qu’elle prépare. “La séquence a été assez vue, a beaucoup plu. J’ai senti qu’avec Nicolas il n’y avait pas de limite. On pouvait s’entraîner très loin l’un l’autre.” La scène a été retournée pour Garçon chiffon trois ans plus tard et en constitue l'un des pics, dans sa façon de libérer une puissance comique inouïe à partir d’affects d’anxiété profondément inquiétants. Pour Laure, il a toujours été évident que Nicolas deviendrait à court terme cinéaste. “Quand on tournait des scènes ensemble sur Dix pour cent, je sentais que son regard était celui d’un réalisateur.” Yann Gonzalez confirme avoir toujours perçu le comédien comme un cinéaste en puissance. "D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé un moyen métrage qu'il avait réalisé après le tournage des Rencontres d'après minuit, intitulé Virginie ou la capitale. C'était un film très étonnant, imposant un climat inquiétant et étrange, marqué par le cinéma de genre.” En effet, le désir de mise en scène vient de loin et le cheminement a été long. “Le scénario de Garçon chiffon, je l’ai écrit il y a longtemps, l’été 2012. C’était lié à une relation amoureuse douloureuse, un homme que j'avais le sentiment d'aimer mal. Le film a été long à monter. Il a été tourné avec moins d’un million d’euros. J'ai l'impression de l'avoir arraché. Encore une fois, je ne suis pas de ceux à qui on ouvre une voie royale. Quand on me dit : ‘Mais quelle chance !’, j’ai plutôt envie de répondre : ‘Mais quel travail !” >> Lire aussi : Dans les coulisses de “Dix pour cent”, fictions et réalité Répondant à la question de savoir si son travail avec les cinéastes qui l’ont dirigé a pu lui servir de boussole, il évoque un des premiers réalisateurs à l’avoir filmé, Philippe Garrel, en 2005, dans Les Amants réguliers. “Philippe m’a dit un jour : ‘Attention, je vais filmer tes pensées.' C’est une des phrases les plus éclairantes qu’on m’ait dites sur la mise en scène de cinéma. Je pense vraiment que la caméra a accès à la pensée. C’est la plus grande beauté du cinéma.” Lorsqu’on leur demande une dernière fois de tenter d’étreindre ce qui les rend si proches et a cimenté ce lien si complice qui les unit, il·elles réfléchissent, échangent des regards de gêne amusée. Et puis Nicolas se lance : “Je crois qu’en fait Laure et moi sommes des égocentriques qui ne s’aiment pas. Quand on nous convoque, on est contents d’être là, on pense même que nous sommes la personne parfaite pour être là et, en même temps, on se déteste !” Qu’importe puisque le cercle de ceux et celles qui les aiment ne cesse de s’élargir. Garçon chiffon de et avec Nicolas Maury, avec Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo Christine et Laure Calamy (Fr., 2020, 1h49). En salle le 28 octobre Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Laverhne, Olivia Cote (Fr., 2020, 1h35) Dix pour cent saison 4 sur France 2 du 21 octobre au 4 novembre et sur france.tv La Flamme, série créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galland et Florent Bernard, avec entre autres Laure Calamy, en cours de diffusion sur Canal+ Photo : Nicolas Maury et Laure Calamy © Jules Faure pour Les Inrockuptibles

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2020 5:39 PM
|
Par Jean Couturier / Théâtre du blog 21 octobre 2020 La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? Performance conçue par Jean-Christophe Meurisse. Avant le couvre-feu, les acteurs de plusieurs générations de la compagnie des Chiens de Navarre et des invités exceptionnels se réunissent pendant une heure afin de jouer ou lire, dans la plus totale improvisation, une pièce, différente à chaque séance. Dans une société malade de multiples troubles qui la détruisent peu à peu, l’irrévérence n’est plus de mise et cette parole libre, sur le plateau des Bouffes du Nord, fait du bien. L’humour permet toutes les audaces. Six comédiens à la table, munis de micros, feuilles blanches, gel hydro-alcoolique et masques chirurgicaux. Derrière eux, une dizaine d’autres attendent leur tour de parole, devant des malles et des costumes de scène qui... ne seront jamais utilisés. Ce spectacle rappelle les exercices d’improvisation que beaucoup ont connus lors des cours d’art dramatique. Ces petits-enfants du Théâtre de l’Unité d’Hervée de Lafond et Jacques Livchine sourient de leurs délires et nous avec. Cette pièce, qui change de style au fur et à mesure des improvisations, aime se moquer du théâtre lui-même. Soit de son enseignement : « Je comptais faire du théâtre, pas me faire violer ». Soit de ses thèmes de prédilection comme les pièces de Tchekhov : «Il pleut à la fenêtre » ; « Une chèvre s’est suicidée » ; « Piotr tu me dois cinq roubles. »« J’aimerais tellement aller à Moscou. ». Les artistes s’adaptent aussi à la réalité politique : «Je me méfie des gens du Sud, tout ce que vous pouvez dire, avec votre accent, ne vous permet pas d’être légitime. » Parfois l’actualité les rattrape et on entend : « Je suis la liberté d’expression, je vais prendre la parole et on me décapite. » Pendant une heure, cette forme d’irrévérence salutaire incite une fois de plus à retourner au théâtre. Jean Couturier Jusqu’au 24 octobre, Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd de la Chapelle Paris (X ème). T. 01 46 07 34 50.. -------------------------------------- Autre critique, signée Denis Sanglard parue dans le blog « Un fauteuil pour l''orchestre»
Un peu embarrassé là, votre chroniqueur. Dernier opus Des chiens de Navarre, plus enragés que jamais, La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? ressemble à s’y méprendre et comme deux gouttes de gel Hydroalcoolique à cet hilarant et caustique exercice de style qui était Regarde le Lustre et Articule soit une lecture de pièce qui n’existe pas, improvisation plus que foutraque, pages blanches tournée avec application et texte ânonné comme si… Bref on reprend la chose à l’identique à ceci près que la meute de nos chiens est augmentée. Il y a là les anciens et les nouveaux. On ne s’en plaindra pas, bien au contraire. Curieux de voir comment les uns et les autres vont s’amalgamer. Et comme annoncé, un invité surprise, ce soir-là c’était, échappé des Chiche-Capon, Frédéric Blin qui s’y collait, quelque peu dépassé par les événements mais cœur vaillant et ne rechignant pas à la tâche. Improvisation donc, pas plus de six autour de la table (tiens donc ! comme à la maison.) et se passant le relais de grés ou de force, en douceur ou avec chausse-trappes. Improvisation donc où il est question de pintades atteintes d’un mal mystérieux, de notre éminente confrère Fabienne Pascaud, du professeur Raoult, de conseil municipal, de conseil des ministres, de bergers et de moutons, d’homosexualité, d’immigration, de la Covid et de ce foutu couvre-feu arbitraire, et j’en passe… D’ailleurs à 20 heures pétantes surgit Jean-Christophe Meurisse sifflant sans ménagement la fin de la récréation. Retour brutal à la réalité.
Or donc ceci étant une reprise augmentée (on peut dire ça), autocitons-nous, reprenons ce que nous écrivions le 25 février 2014, ce qui nous évitera de se répéter.
« La pièce se fabrique sous nos yeux. C’est parfois franchement drôle, parfois laborieux, c’est du n’importe quoi. Le n’importe quoi c’est un peu leur marque de fabrique, cette explosion joyeuse et transgressive de la théâtralité et de ses codes. Oui, mais là ça coince un chouïa. L’impression confuse que l’exercice atteint ici ses limites. Peut-être parce que nous savons à quoi nous attendre et qu’évidemment la surenchère guette. Les chiens de Navarre sont sur le fil du rasoir, ça dérape souvent mais quelque chose ne fonctionne plus, ne fonctionne pas. Le niveau reste bas, les sujets patinent, aucun envol. Pas d’explosion. On le sait, l’improvisation ne s’improvise pas. Si Une Raclette et Nous avons les machines participent de l’improvisation – et là c’est du nanan – ces deux créations n’en sont que le fruit maturé. On peut objecter ici de la fragilité de l’exercice brut de coffre avec tous les défauts inhérents à ce genre de performance.
À moins, à moins que tout ceci ne soit foutrement organisé et que bernés nous soyons. On ne sait jamais avec les Chiens de Navarre… Donc reprenons à l’envers le raisonnement du méchant critique, on se dit alors que tout ça n’est que le carnaval grotesque des cuisines théâtrales, de la fabrication d’un évènement. L’envers possible d’Une Raclette. En somme une parodie orchestrée de main de maître. C’est bien ça le problème avec Les Chiens de Navarre, on ne sait jamais si c’est du lard ou du cochon. La position du spectateur s’en trouve quelque peu agitée qui louvoie entre plusieurs positions dont celle de regarder le lustre et de laisser articuler ceux dont c’est sans doute le métier. Et que dire de celle du chroniqueur, de position, qui essaie tant bien que mal de saisir quelque chose au vol pour se raccrocher un tant soit peu à cette non-représentation avant d’écrire son désarroi, son impuissance devant un tel machiavélisme… ou ce foutage de gueule. »
Mais ça c’était avant. Parce qu’au regard de cette nouvelle et aléatoire création et des précédentes modérons grave notre propos. Et restons sur le second chapitre de cet article. Battons méchamment notre coulpe. Il ne s’agit plus ici des cuisines de leur métier mais comme à leur habitude de chiens fous d’un regard mordant sur le monde. Les chiens de Navarre montrent les crocs et happent au mollet, ne lâchent pas leur proie qu’ils déchiquettent jusqu’à l’os. Le rire énorme qui secoue la salle fait trembler avec bonheur la bienséance. Le monde, la société, rien n’échappe à leur regard aiguisé de Basilic. Même dans cet exercice périlleux de l’improvisation ce qui est avant tout célébré c’est cette liberté absolue de dire que le théâtre permet, quelle que soit la forme. Et de ça, avec leur foutu talent, indéniable, ils n’en démordent pas. Au vu de notre actualité désespérante, à l’heure des politiques incompréhensibles qui jettent la culture avec l’eau du bain sanitaire, des obscurantismes nauséabonds qui tuent la liberté d’expression, ça fait un bien fou !
La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? performance conçue par Jean-Christophe Meurisse
Avec les Chiens de Navarre et chaque soir des invités exceptionnels.
Du vendredi 16 au samedi 24 octobre à 19 h
Matinée les samedi et dimanche à 16 h
Durée 1 heure
Crédit photo : © Ph. Lebruman

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 20, 2020 3:47 PM
|
Par Françoise Sabatier-Morel dans Télérama Sortir Grand Paris le 20/10/2020
Une petite fille joue à s’inventer une maison. Avec la force de l’imagination, quelques bouts de bois et des petites maisons de papier, elle délimite la porte d'entrée, les pièces, la fenêtre qui donne sur un pré avec des moutons. L’enfant, bientôt remplacée par une vieille femme qui s’étonne que le temps soit passé si vite, réapparaît, et toutes deux entrent dans un dialogue, qui s’interrompt, reprend, au rythme d’une alternance de noir et de lumière. Une présence magique passe sur scène, intervient parfois, patiente… Dans cette pièce de Philippe Dorin, auteur contemporain de théâtre jeunesse, impossible d’enfermer les personnages dans un seul rôle, une seule histoire (l’enfant n’est peut-être qu’un souvenir, un rêve…). Toute la poésie du texte réside dans cette multiplicité de sens, dans cette ouverture aux possibles. Cette poésie émeut, étonne, et c'est avec habileté et délicatesse que le metteur en scène Julien Duval réussit à la garder intacte.
Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)
Auteur : Philippe Dorin
Interprète : France Darry, Carlos Martins, Juliette Nougaret et Camille Ruffié
Metteur en Scène : Julien Duval
Lieux et dates
Théâtre Paris-Villette
de 10 € à 16 €
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
infos
Du 21 au 22 octobre 2020 14h30
Samedi 24 octobre 2020 19h00
Du 28 au 29 octobre 2020 14h30
Vendredi 30 octobre 2020 19h00
Dimanche 1 novembre 2020 15h30

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 19, 2020 8:13 PM
|
Le Monde avec AFP Publié le 19/10/2020 Apprécié particulièrement pour ses prestations avec Andrzej Wajda ou au Théâtre national de Chaillot à Paris, Wojciech Pszoniak est mort lundi à l’âge de 78 ans.
Grand homme de cinéma et de théâtre polonais et français, Wojciech Pszoniak, apprécié particulièrement pour ses prestations avec Andrzej Wajda ou au Théâtre national de Chaillot à Paris, est mort lundi 19 octobre d’un cancer généralisé, a annoncé un proche ami de la famille de l’acteur.
« Wojciech Pszoniak est décédé aujourd’hui, à 6 h 08 du matin, à l’âge de 78 ans. Un des plus grands, un des géants du film et du cinéma polonais de l’après-guerre », a écrit sur le site du journal catholique Wiez le père Andrzej Luter, qui accompagné l’artiste jusqu’aux dernières heures de sa vie.
Né le 2 mai 1942 à Lviv (aujourd’hui en Ukraine), il a mené une carrière très riche en films et en spectacles, tous d’une grande diversité. Il s’est éteint à Varsovie, selon les médias polonais.
Insallé en France depuis les années 1980
Sous la houlette d’Andrzej Wajda, il a interprété Robespierre dans Danton, le Juif Moryc Welt dans la série La Terre de la grande promesse, ou encore le rôle éponyme de Korczak. Il a également collaboré avec Volker Schlöndorff ainsi qu’avec Peter Handke, et ce aux côtés de Gérard Depardieu, de Michel Piccoli ou de Michel Aumont.
Dans les années 1980, il avait fui le régime du général Wojciech Jaruzelski pour s’installer en France. Il s’y était vu remettre, en 2008, les insignes d’officier de l’ordre national du Mérite. Légende photo : Wojciech Pszoniak en 1990 dans « Korczak », d’Andrzej Wajda. BBC / ERATO FILMS / ERBOGRAPH CO / REGINA ZIEGLER FILMPRODUC / Ronald Grant Archive/The Ronald Grant Archive / Photononstop / BBC / ERATO FILMS / ERBOGRAPH CO / REGINA ZIEGLER FILMPRODUC / Ronald Grant Archive/The Ronald Grant Archive / Photononstop Ses grands rôles au théâtre en France : 2007 La Locandiera de Carlo Goldoni mise en scène Philippe Mentha 2001 La Boutique au coin de la rue d'après Miklós László… mise en scène Jean-Jacques Zilbermann 1998 L'Atelier de Jean-Claude Grumberg mise en scène Gildas Bourdet 1994 Marchands de caoutchouc de Hanoch Levin mise en scène Jacques Nichet 1992 Ubu roi d’Alfred Jarry mise en scène Roland Topor 1983 Par les villages de Peter Handke mise en scène Claude Régy 1980 Ils ont déjà occupé la villa voisine de Stanislaw Ignacy Witkiewicz mise en scène Andrzej Wajda 1978 Les gens déraisonnables sont en voie de disparition d'après Peter Handke mise en scène Claude Régy

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 18, 2020 6:27 PM
|
Montage par Jean-Pierre Jourdain, à partir des archives des enregistrements radiophoniques de Michael Lonsdale. Diffusé sur France Culture sur le programme des Fictions le 18 octobre 2020 Lien pour écouter l'émission en ligne (2h) Suite à la disparition de Michael Lonsdale (21/09/2020) nous avons voulu partager avec vous ces 2 heures durant lesquelles nous retrouvons Michael Lonsdale et des auteurs, Duras, Ionesco, Beckett, Aperghis, Césaire… autant d’auteurs, d’inventeurs, avec lesquels il dit avoir été le plus heureux à la radio. Dans les années 50 je me suis présenté à la Maison de la radio pour passer un examen, mais j’ai été refusé parce qu’il fallait lire des classiques, des alexandrins qui m’enquiquinaient… La seconde fois, de même… Si bien que j’ai tiré une croix sur la radio. Ils sont venus me chercher 10 ans plus tard, au début des années 60, après m’avoir vu jouer au théâtre. Alors je me suis pris de passion pour les pièces radiophoniques : j’en ai fait des dizaines, des centaines.
Michael Lonsdale Ainsi s’exprime le grand comédien de théâtre et de cinéma. Durant deux heures nous reviendrons sur ses plus significatifs et symboliques enregistrements pour la radio en réécoutant, en sa compagnie, des extraits que sa mémoire voudra bien prolonger, amplifier : Duras, Ionesco, Beckett, Aperghis, Césaire… autant d’auteurs, d’inventeurs, avec lesquels Michael Lonsdale dit avoir été le plus heureux : «Ils m’ont permis de laisser apparaître l’inconnu qui se promène en moi. Quelque chose peut alors surgir du plus profond et qui n’est pas intellectuel, qui n’est pas pensé». Son métier d’acteur, qu’il vit comme un acte de transmission, de passeur, lui permet de rester enfant, de continuer à jouer.
Jean-Pierre Jourdain Entretien avec l'acteur et choix d'archives INA par Jean-Pierre Jourdain. Choix des archives INA par Jean-Pierre Jourdain Réalisation Véronique Vila Conseillère littéraire Caroline Ouazana Equipe de réalisation Pierre Mine, Cédric Chatelus Photo : Michael Lonsdale (en 2012)• Crédits : ullstein bild - Getty

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 19, 2020 6:30 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog 17 octobre 2020
Fine et blonde, allure d’éternelle jeunesse, comédienne remarquable, elle nous raconte sa vie en confidences et chansons, très bien accompagnée.
C’est un moment musical rare et chaleureux, extrêmement touchant et rigoureux. On a vu ce spectacle cet été et il n’a été repris qu’il y a quelques jours, simplement le samedi et le dimanche. Depuis est tombé le couperet du couvre-feu, les horaires ont donc été modifiés pour les dernières représentations. Vincent Leterme, piano, Laurent Valero, violoniste, deux musiciens excellents, véritables partenaires, soutiennent la mise en scène, précise, fluide, utilisant tout l’espace de ce lieu qui va bien à l’esprit cabaret, au récital. Une mise en scène signée Olivier Cruveiller, comédien dont on loue depuis longtemps le talent ondoyant. Elle peut être gavroche, mais aussi la vamp des récitals, qui s’allonge sur le piano. Photo DR. Natalie Akoun est une interprète que l’on a très souvent applaudie au théâtre dans des registres très différents. Des personnalités de théâtre très différentes l’ont dirigée. Elle-même s’est mise à l’écriture : Les Madones, Une histoire de clés, La Femme aux sandales d’été. A chaque fois, des chansons, mais prises dans le fil dramaturgique. « Chanter au théâtre, dit-elle, c’est continuer sa pensée quand on ne trouve pas les mots ou quand on n’a plus forcément conscience de ce que l’on ressent. Comme une boîte noire au fond de sa tête » dit-elle. Le fil de Mon âge d’or, que l’on pourrait prendre pour un clin d’œil décalé à Ariane Mnouchkine, est celui de l’autobiographie. Ses parents l’ont initiée au théâtre et ce chemin est souvent passé par la Cartoucherie. Natalie Akoun et Olivier Cruveiller ont joué à –et ils s’y sont même mariés… Mais cet Age d’or est aussi celui de Léo Ferré…. Sur le fil de la mémoire, des perles précieuses : les chansons qui l’ont marquée et qu’elle interprète de sa jolie voix, très bien placée lorsqu’elle parle, très juste, mélodieuse et nuancée lorsqu’elle chante. Ce qui est très intéressant c’est qu’elle n’imite jamais, elle ne reprend pas les manières des chanteurs qui ont fait connaître ces textes, ces airs. Elle a forgé, pour chaque chanson, sa propre manière. Elle glisse de Trois petites notes de musique –Delerue/Colpi en 61- à L’Age d’or de Léo Ferré. Il y a aussi, très important, Saltimbanque de Maxime Le Forestier, puisque « saltimbanque » c’est le métier dont rêvait la petite fille. Boris Vian, Renaud, Barbara, Rezvani, Gréco, Béart, Louis Amade et Bécaud (La Ballade des baladins, évidemment), Roda-Gil et Julien Clerc, Moustaki, on ne vous dévoilera pas ici tous les titres. On aurait bien ajouté une chanson de Pierre Mac Orlan, mais cela, c’est par goût personnel, ou encore des textes d’Aragon…mais c’est une question de génération. Ce récital est une pépite d’émotions chatoyantes, une manière merveilleuse d’être plongé dans la musique, la poésie, l’esprit. Natalie Akoun est une fée, une fragile silhouette mais qui possède une force de jeune déesse et un irrésistible charme. Les Rendez-vous d’ailleurs, 109 rue des Haies, 75020 Paris (Métro Maraîchers). Téléphone : 01 40 09 15 57. Vendredi et samedi à 18h30 et, normalement, ensuite, reprise le 4 décembre à 21h00, jusqu’en janvier, chaque vendredi et samedi, 21h00. Puis au Théâtre de l’Epée de Bois du jeudi au dimanche, du 28 janvier à février.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 17, 2020 7:36 PM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 16/10/2020 Croquis de voyage #2 par les élèves de l’École du Nord de Lille Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Maxime confirmée par les premiers Croquis de voyage vus à l’automne 2017 (voir Le Théâtre du Blog). On se souvient encore, parmi d’autres, de la prose de Mathias Zachar descendu en train, en bateau, en stop, de la source à l’embouchure du Danube… Des expériences inoubliables aux dires des anciens élèves venus voir les travaux de la sixième promotion. « C'est peut-être cela, le pari du voyage? disait François Maspero. Au-delà des émerveillements ou des angoisses de l'inconnu, retrouver le sentiment d'être de la même famille. Parfois ça rate. Parfois même, ça tourne mal. Mais le pari vaut d'être fait, non ?» Marquée par les récits de l’écrivain-voyageur, Balkan-Transit ou Les passagers du Roissy-Express, Cécile Garcia Fogel actrice et enseignante à l’Ecole du Nord avait proposé aux élèves de la promotion 5 ( 2015-2018) de partir seuls sur les chemins de l’Europe. Pour cette deuxième édition, les règles étaient les mêmes : départ fin août de la gare de Lille, téléphone mobile et ordinateur débranchés pour une immersion totale dans l’inconnu. En poche, un petit pécule : de quoi manger, se loger et voyager pendant un mois. Chacun(e) a dû faire, en fonction de sa destination, un budget prévisionnel et s’y tenir. Cette fois, la plupart des jeunes est restée à l’intérieur de l’Hexagone. Moins exotique peut-être mais fructueux en rencontres, comme en témoignent les petites formes présentées à la maison Folie Moulins. En amont, Jean-Pierre Thibaudat, homme de théâtre et grand voyageur, parrain de l’expédition, les a aidés à affiner leurs objectifs, puis, au retour, à peaufiner leurs pièces. Il dit être très peu intervenu, si ce n’est : « raccourcir un texte, supprimer des passages superflus, resserrer les boulons, c’est tout. Et pour certains c’était déjà bouclé.» Pour la mise en scène, Cécile Garcia-Fogel, qui connaît bien ses élèves et leurs projets, a été un précieux œil extérieur : «Je les ai aidés à préciser leurs intentions de départ. A circonscrire leur sujet, en évitant les généralités. A rechercher des choses moins sexy mais plus vraies. Au retour, je leur ai donné quelques conseils pour leurs textes et leurs réalisations, sans jamais rien leur imposer. » Reste qu’après un mois de solitude absolue, écrire, répéter et présenter son Croquis de voyage, en dix jours a été, pour ces dix-huit jeunes, un pari difficile mais largement gagné. L’ancienne brasserie en briques rouges est en effervescence. De la cour aux Petits et Grands Germoirs et à la Petite Cuve, par des escaliers métalliques, le public est invité au voyage…D’une salle à l’autre, il faut garder ses distances et s’asseoir loin les uns des autres. Jauge réduite oblige, chaque pièce a dû être jouée de quatre à six fois… Soit un marathon de trois jours. « En route, le mieux c’est de se perdre, lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises, et c’est alors, mais alors seulement, que le voyage commence », écrivait Nicolas Bouvier. C’est vrai pour Et tu ne diras rien de Pierre-Thomas Jourdan. Parti à la rencontre de marins au long cours, le comédien s’arrête dans la maison d’un vieil homme en fin de vie. Impressionné par le personnage et la situation, il écrit une partition remarquable. En scène, il incarne sobrement un vieillard attablé qui ressasse ses souvenirs, devant un frère de dix ans son ainé qui lui sert la soupe « avec lenteur », en silence. Le cadet commente méticuleusement, avec force précision, la photo des noces d’or d’une tante, le 16 mai 1994, sur laquelle figure ses parents, son frère, et lui enfant : « Josiane notre tante au centre de la photo et moi toujours habillé de cette veste verte et de ce sourire déjà malade… » Le frère encaisse, muet les rabâchages et les sarcasmes du moribond… La vie de ce des deux êtres, en attente de la mort, semble s’être figée dans ce monologue glaçant. Suzanne de Baecque, avec Cluster, opère une plongée dans les coulisses du concours Miss Poitou-Charentes. Elle s’y est elle-même présentée, et a vécu la violence de cette course à l’écharpe. Elle est ainsi entrée en contact avec plusieurs aspirantes : des filles très seules mais qui se sont confiées à elle. Devant nous, Suzanne devient Laureline, au mot près : une langue d’aujourd’hui, de là-bas, vitaminée au globish : «Je suis pas une fille de groupe, tu vois. Mais, meuf, la vie elle est courte, alors, profite ! …Go, go, go !… » La comédienne a su trouver la bonne distance pour faire exister, sans la caricaturer, cette jeune femme très « girly », fan des séries Gossip Girl et Pretty Little Liars… Une prestation émouvante qui donne voix à l’une de ces personnes qu’on n’entend jamais, confinées dans ces « territoires perdus de la République » pour citer le titre du livre d’Emmanuel Brenner. Oscar Lesage, avec Dear Nanni, raconte l’histoire d’une obsession : rencontrer le cinéaste Nanni Moretti pour lui dédier une chanson de sa composition. Il est à Rome, à Venise… Il bombarde le réalisateur de mails, rencontre des personnes influentes qui peuvent le mettre en relation avec lui, soudoie Pietro Moretti, le fils de son idole… Micro en main, il nous donne un aperçu de son talent de parolier et chanteur ; il a aussi un don pour passer du français à l’anglais et à l’italien… L’acharnement finit par payer : il rencontrera Nanni Moretti et nous aurons bien ri de son voyage… Tout aussi rocambolesque : L’Exil d’Hortensius d’Antoine Heuillet. Le pédant Hortensius quitte les pages de La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux et débarque dans la Creuse en août 2020. « J’ai cent-quatre-vingt seize ans et je suis perdu dans ce monde qui n’est pas le mien. » dit-il; en habit d’époque, il cite Sénèque en toute occasion. Il aura tôt fait d’entrer en contact avec une famille de chasseurs qui l’entraînent à tuer un sanglier « Mon index avait décidé de faire de moi un meurtrier ». Repéré par des journalistes, il alimente la chronique de La Montagne et le voici promu citoyen d’honneur de la ville de Guéret… L’acteur a en quelque sorte trouvé la vérité de son personnage dans l’imprévu. Louis Albertosi avec Veiller sur le sommeil des villes, marche sur les traces de l’ange Daniel dans Les Ailes du désir de Wim Wenders. Il parcourt des cités « à demi-mortes, dépeuplées » de Calais à Dunkerque en passant par Saint-Omer, fait une brillante chronique de « ces cités palimpsestes grands territoires qu’on déconstruit et sur les ruines desquels on reconstruit. » Entre polémique et mélancolie, il s’en prend aux jeux de mots foireux en « hair » aux enseignes d’improbables salons de coiffures. Pour connaître sa ville, dit-il, il faudrait « inventer la vie des détritus que l’on croise »… Il fustige aussi les mesures sanitaires, comme les gestes barrière : « Sauver l’humanité c’est s’en tenir à l’écart ! » Annuler la fête de l’andouillette d’Arras, est pour lui le symbole de ces liens qu’on coupe entre nous… Il y a du mensonge : cette apparence de reprise n’est qu’une parodie et il conclut: « J’espère que cette parodie n’était qu’une hibernation et j’attends notre printemps sauveur. » Un périple en forme de prophétie où Daniel, l’ange de la communication, devient une sorte de lanceur d’alerte… Sept jours d’Adèle Choubard résume, en sept temps, son ascension quotidienne d’un terril à Loos-en-Gohelle le plus haut d’Europe. Vingt-six fois, Adèle a gravi les cent-quatre-vingt six mètres de ce monticule qui marque le paysage de son enfance. Et de jour en jour, lui revient l’image de son père, récemment disparu et les glaces qu’elle partageait avec lui au bord de la mer du Nord. Avec humour et tendresse, elle dédie son exploit sportif aux hommes du plat pays chanté par Jacques Brel, qui, grâce à leur dur labeur, ont édifié de leurs mains cette colline de terre noire. Un émouvant hommage… Avec Confessions au silence, Rebecca Tetens raconte sa quête du silence sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais le bruit est partout, à commencer par ses pas qui martèlent lourdement la scène. «Quand je suis avec ta cousine, la solitude, j’ai l’impression de te trouver un peu, silence », dit-elle. Pourtant, elle prend plaisir à écouter d’autres marcheurs et à faire un bout de route avec eux. Et quand ils se quittent et que son équipée prend fin, elle éprouve peut-être ce silence inaccessible et qu’elle ne cherchait plus… Mathilde Auneveux a installé sa voiture dans la cour de la Folie-Moulins. Entre deux croquis, elle propose aux spectateurs des intermèdes musicaux. Perchée sur le capot, elle chante des titres de sa composition. Des romances piquantes ou un slam aux paroles douces-amères : « And if you want my soul/Ask for it, I’ll send it by mail ». Un style affirmé et une voix prometteuse. Si l’on entre dans la voiture qui l’a amenée d’un point à un autre du territoire, on trouve pêle-mêle les traces de son voyage : interviews, lettres, musiques… Dans le même esprit, le croquis de voyage de Paola Valentin se décline en une installation : bric-à-brac de photos, enregistrements audio, dessins et messages gribouillés, qu’elle a amassés en traversant les villages dans un camion aménagé pour le camping. Elle expose ainsi les portraits de Georges, Marie, Damien et les autres : rencontres éphémères mais qui lui ont confié leurs histoires et leurs souvenirs… Devant quitter la maison Folie-Moulins à mi-parcours, nous n’aurons pas vu les travaux de Maxime Crescini, Orlène Dabadie, Simon Decobert Joachim Fossi, Nicolas Girard Micheletti, Solène Petit, Constance de Saint-Rémy, Noham Selcer, Nine d’Urse… Mais la plupart des croquis que nous avons découverts, ont un point commun : la rencontre souvent intime avec d’autres mondes, aux périphéries de l’Hexagone, aux confins de « l’Archipel français » selon les mots de Jérôme Fourquet. Les habitants de ces territoires ruraux ou périurbains constituent 60 % de la population mais restent sous-représentés dans la sphère publique… Laureline dit dans Cluster : « Quand t’es Miss, t’as beaucoup de voix ». C’est pour sortir de l’anonymat et mettre sa voix au service d’une cause, qu’elle espère remporter le concours… Avec l’aide du scénographe Christos Konstantellos, les jeunes artistes ont donné corps et vie à ces voix. Chacun(e) à sa manière et selon sa personnalité a su traduire en théâtre son expérience personnelle. Et certaines de ces formes brèves pourraient aboutir à un spectacle… Pour Christophe Rauck, directeur de l’École et du Théâtre du Nord qu’il va bientôt quitter pour le Centre Dramatique National de Nanterre-Amandiers, cette démarche fait partie de l’apprentissage du théâtre : «Imposer dans ce cursus un voyage en troisième année, ce n’est pas de l’exotisme. Le voyage, c’est difficile. Ça demande du courage, une certaine connaissance de soi, de l’inventivité, une curiosité. Ce n’est pas fuir, c’est tirer une ligne de fuite pour regarder autrement » En attendant, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice recrutera en mars prochain la septième promotion, soit douze élèves-comédiens et quatre élèves-auteurs. Inscriptions au concours: du 2 novembre au 14 février. Mireille Davidovici Présentation publique des travaux d’élèves du 9 au 11 octobre, à la maison Folie Moulins, Lille (Nord).
Prochaines présentations: les 20 et 21 novembre avec Toujours la Tempête de Peter Handke, mise en scène d’Alain Françon. En janvier : tournée régionale de Marivaux en balade Ecole du Nord, adresse provisoire : 7 rue du Sec Arembault, Lille (Nord). T. 03 20 00 72 64 Légende photo : Oscar Lesage, élève-comédien de l'école du Nord Photo © Simon Gosselin-

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 16, 2020 11:12 AM
|
Propos recueillis par Jérémie Couston, Joëlle Gayot et Jean-Baptiste Roch dans Télérama 16/10/2020 Concerts déprogrammés, sorties de films reportées, climat anxiogène… Interrogés par “Télérama”, les trois artistes commentent l’annonce des restrictions horaires décrétées par le gouvernement et l’impact qu’elles auront sur les salles de spectacles et de cinéma. Suzane : “Le live, c’est vital pour moi !” « Moralement, ces annonces sont difficiles à encaisser. C’est un peu les montagnes russes. Après cinq dates cet été, j’ai entamé début octobre une tournée de vingt-cinq concerts, et j’avais la sensation de retrouver un semblant de vie normale. Les concerts avec les masques, les gens assis et espacés : ça ressemble à la série Black Mirror, mais au moins, pendant une heure dix, tout le monde oublie le contexte ! Ces annonces relancent l’incertitude : que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent ? Les restrictions vont-elles s’étendre ? Pour l’heure, sur ma tournée, cinq concerts sont directement touchés, dont un au Trianon prévu à Paris début novembre. On va s’adapter : a priori, tous auront lieu, il faudra juste jouer plus tôt. Mais ce couvre-feu nous replonge dans le flou. J’espère sincèrement que ces mesures vont permettre d’atténuer la flambée de l’épidémie. Pour ma part, je n’ai pas modifié ma scénographie en fonction des conditions sanitaires, ni réduit la voilure : mon concert est tel que nous l’avions pensé en résidence, en février dernier, avec énormément de visuels. De ce point de vue, c’est un vrai plaisir de voir les choses se concrétiser. En ce début d’automne, je me sens enfin redémarrer. J’ai été très active dès le déconfinement, notamment en sortant un morceau avec Grand Corps Malade, mais le spectacle vivant me manquait terriblement. Le live, c’est ma came, c’est par lui que je suis arrivée, je n’ai pas émergé comme d’autres sur TikTok ! C’est vital pour moi. Ces derniers mois, il a fallu exister quasi exclusivement à travers les réseaux sociaux, mais ce n’est pas mon but dans la vie. Ce que je veux, c’est jouer sur scène, l’essence de ma musique, c’est ça. La période est morose, mais il faut continuer à se battre. » Vincent Macaigne : “C’est l’éducation par la fessée. Le couvre-feu doit être le dernier recours” « Je suis sous le choc. D’un côté, on nous dit que les conditions sanitaires sont bonnes dans les lieux culturels, d’un autre, on impose un couvre-feu. Si les salles de cinéma et les théâtres sont sécurisés, il devrait y avoir une dérogation. La semaine dernière, je suis allé voir l’Iphigénie de Stéphane Braunschweig à l’Odéon : le public était parfaitement discipliné, les gestes barrières respectés. Avec une place de théâtre ou un ticket de cinéma dans la poche, on devrait pouvoir rentrer chez soi après 21 heures. Le gouvernement est en train d’assassiner un secteur. Les films risquent d’être annulés les uns après les autres. Aucun distributeur ne prendra le risque de sortir un film sans la séance de 20 heures, la plus importante en termes de fréquentation. “Une fois encore, le gouvernement nous infantilise, il nous supprime nos jouets d’une semaine à l’autre, sans explication, sans concertation.” La culture permet aux gens de se rassembler, de croire en la réalité d’une société. En particulier dans les grandes villes où les appartements sont trop petits et où la population vit beaucoup dehors. S’il n’y a plus de proposition culturelle, ni bars ni restaurants, la vie en ville devient absurde. Les gens vont péter les plombs. Et je ne prends pas la maladie à la légère. Mon frère est médecin ; j’ai des amis de 30 ans en parfaite santé qui ont attrapé le virus et en gardent des séquelles. J’adore aller au restaurant et boire des verres dans les bars, et j’ai pu constater qu’il y avait un relâchement sur les gestes barrières. Hier, je suis allé me faire tester [résultat négatif, ndlr] et dans la file d’attente du laboratoire, une dame, qui trouvait que je laissais trop d’espace entre moi et le patient devant, m’a doublé. Ne pas respecter les distances physiques avec des personnes toutes potentiellement malades… Nous ne sommes pas encore capables de vivre ensemble. Mais il faut de la pédagogie, pas de la répression. On doit tous apprendre à vivre autrement. Une fois encore, le gouvernement nous infantilise, il nous supprime nos jouets d’une semaine à l’autre, sans explication, sans concertation. C’est l’éducation par la fessée. Le couvre-feu doit être le dernier recours. Peut-être fallait-il que Macron n’aille pas faire du jet-ski cet été pour mieux préparer le pays à cette deuxième vague… » Couvre-feu : comment les salles de spectacle s’adaptent aux restrictions horaires 10 minutes à lire Denis Podalydès : “J’aimerais que nous sortions de la rhétorique de la survie” « J’avoue avoir été soulagé en écoutant Emmanuel Macron car je m’attendais à un reconfinement. Même si je sais que changer les horaires des spectacles ne sera pas simple lorsqu’ils sont longs. Nous devons obtenir une dérogation ! L’impact de la crise a déjà eu lieu sur le théâtre. On ne peut plus imaginer la mise en scène de textes fleuves (comme La Servante, d’Olivier Py, qui durait vingt-quatre heures). Peut-être sommes-nous en train de prendre la mesure d’un âge d’or révolu. Moi qui me refuse au déclinisme, je n’arrive pas à jouer les Cassandre. Tout est toujours en transformation et les mutations des représentations ne datent pas du Covid. Ma génération pensait que sa culture, nourrie de Corneille ou Racine, était immuable. Or cette culture s’est métamorphosée. Racine n’est plus un passage obligé pour les jeunes compagnies qui veulent s’asseoir dans le paysage. J’ignore si c’est pour un bien ou pour un mal, je note juste l’évolution. Sur les tournages, je me promène au milieu de personnes masquées alors que moi, je ne le suis pas. Ça me plonge dans une sorte d’abstraction, comme si ma condition d’acteur m’extrayait et me mettait à part. “Nous manquons d’esprits clairvoyants qui nous aident à percevoir ce qui se passe actuellement.” Nous vivons une période de bouleversements. Il y a toujours quelque chose d’exaltant dans ces déplacements de structures, lorsque nos perceptions sont chamboulées. Ce vacillement peut rendre fou de colère ou de désespoir. Mais passer son temps à regretter ce qui a été et qui n’est plus empêche de voir ce qui va apparaître. Ce n’est plus comme avant, se lamentent certains. Mais de toute façon, rien n’est jamais comme avant. Nous manquons d’esprits clairvoyants qui nous aident à percevoir, de manière fine, ce qui se passe actuellement. Nous manquons de nuances, il n’y a qu’à voir, à cet égard, ce qui se déploie sur les réseaux sociaux. Ce que j’aimerais, c’est que l’art me rende cette période, qu’il me la réinvente, qu’un livre, un spectacle me fasse comprendre ce que je vis. Alors j’y verrais plus clair. J’aimerais que nous sortions de la rhétorique de la survie. La survie, ce n’est pas la vie. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 15, 2020 7:30 PM
|
Par Olivier Joyard dans Les Inrocks - 12/10/20
Il était l'une des révélations de 120 Battements par minute en 2017. Aujourd'hui, Arnaud Valois illumine la série Moloch aux côtés de Marine Vacth et le premier long métrage de Nicolas Maury, Garçon chiffon. Rencontre avec un acteur lucide sur son travail et son parcours.
Dans les premières scènes de Moloch, le contraste est saisissant entre le jeune homme que nous connaissions dans 120 Battements par minute il y a trois ans, un militant d’Act Up amoureux et endeuillé, et le flic qui arrive sur une scène de crime après une étrange affaire de combustion spontanée. Mais dans son jeu, Arnaud Valois ne semble pas perturbé par cet effet d’étrangeté. Bientôt, il forme avec Marine Vacth (qui joue une jeune journaliste) le couple le plus désirable que l’on puisse imaginer dans une série française. Ce déplacement naturel des attentes lui ressemble. Mais comment l’expliquer ? “Après le film de Robin Campillo, je m’attendais à recevoir énormément de scénarios dans la même veine, explique-t-il. En fait, j’ai suscité des projections complètement différentes chez les cinéastes : un pompier, un militaire, un vétérinaire et donc, ici, un flic dans un récit fantastique. On me dit que la façon dont j’incarne les personnages laisse ouvertes beaucoup de perspectives. Pourquoi pas ! Mais, évidemment, je ne joue pas en me disant que je vais laisser ouvertes des perspectives !” (rires) Arnaud Valois ne semble jamais dépassé par le désir qu’il inspire. Il s’en accommode comme d’une donnée parmi d’autres, dont il est inutile de chercher l’origine. Il se montre plus prolixe quand il exprime son propre désir. Sa partenaire dans Moloch l’a stupéfait. “Pendant les lectures du scénario avant le tournage, je ne pouvais pas m’arrêter de regarder Marine.” “C’est très impressionnant. Je ne parle pas forcément de sa beauté, mais vraiment du magnétisme qui se dégage d’elle. Quasiment toutes mes scènes sont en duo avec elle et nous avons pu faire fructifier le contraste entre nous. On ne travaille pas de la même façon. Marine est d’abord instinctive sur le moment, moi je suis davantage dans la réflexion et le travail en amont.” Un jeune premier vingtenaire Créateur et réalisateur de Moloch, Arnaud Malherbe confirme la méthode Valois. “Ce grand écart avec Marine Vacth m’a passionné. Même pour un rôle moins important en termes de présence à l’écran, Arnaud arrive en ayant pris trois pages de notes, tout le scénario est annoté, il s’est imaginé le background du mec qu’il incarne. Dans le chaos de la préparation d’une série, c’est bien d’avoir quelqu’un qui ne vient pas en touriste. En même temps, Arnaud a eu le désir enfantin de jouer un flic. Il m’a dit qu’il en rêvait, ça m’a fait rire. Il veut devenir de plus en plus acteur, même s’il l’est déjà : ne pas être seulement ce qu’il est ou ce qu’il peut donner malgré lui, mais s’emparer d’un projet de personnage et le travailler. Se dire qu’il peut tout faire.” >> >> Lire aussi : “120 Battements par minute” : un choc émotionnel, l'un des plus beaux films de l'année L’intéressé n’exprime pas encore cette ambition (“Je pense que je ne suis pas capable de tout jouer, et je ne me fais pas de bile à ce propos"), mais la problématique a du sens au regard de son parcours. Il a été un jeune premier vingtenaire dans Selon Charlie (2006) de Nicole Garcia, puis dans La Fille du RER (2009) d’André Téchiné notamment, avant de sortir du métier d’acteur par lassitude et manque de sollicitations. On a retrouvé Arnaud Valois en Thaïlande, où il a suivi une formation de masseur thaï, avant d’ouvrir un cabinet de sophrologie à Paris – il a été récemment un lecteur attentif de Yoga d’Emmanuel Carrère, qui l’a passionné. “Si j’avais continué à être comédien de ma vingtaine à mes 36 ans aujourd’hui, je serais un acteur différent. Mais il y a eu ce break énorme de sept ans où j’ai travaillé sur les autres, sur moi, sur comment aller bien. J’imagine que cela ressort dans ma façon d’interpréter des personnages et d’être avec les gens sur un plateau. De cette période, j’ai conservé tous les outils que je connais (sophrologie, méditation) pour me les appliquer à moi-même. Pour sortir de la bulle d’un tournage et pour y entrer, c’est vraiment intéressant. “Je connais ma chance d’avoir ces boussoles pour mieux vivre les hauts et bas du métier, les variations d’émotions et de sensations qui impactent la tête et le corps. La vie n’est pas un plateau de cinéma. Je comprends très bien mes camarades qui ont envie d’y passer tout leur temps, puisqu’on peut y trouver un plaisir extrême, mais j’avoue que je prends plus de plaisir dans les énergies un peu plus neutres.” “Cela m’a paru impossible après un hiatus de sept ans de faire semblant” Clairement, Arnaud Valois peut arpenter avec joie d’autres territoires que ceux du cinéma ou de la télévision, ce qui rend son désir d’autant plus fort. “120 Battements par minute a tout bouleversé, dans le bon sens du terme. Pendant la tournée promo qui a duré des mois, je me suis demandé si j’allais tourner à nouveau, parce que la vie que je m’étais créée me satisfaisait énormément. Mais j’ai compris que j’aurais été idiot de ne pas saisir tout ce qui se passait. Quand on ne voudra plus de moi, ou quand je n’aurai plus envie, je repartirai ailleurs sans regrets.” Un tel niveau de tranquillité intérieure, voilà peut-être ce qui a guidé le comédien dans son choix d’évoquer publiquement son homosexualité – lors de la tournée internationale ayant suivi 120 Battements par minute –, ce qu’aucun acteur français de sa notoriété n’a fait. Il s’affiche ce mois-ci sur la couverture du magazine Têtu avec ce titre : “Fier, haut et fort.” “Pourquoi j’en ai parlé ? Cela m’a paru impossible après un hiatus de sept ans de revenir et de faire semblant. Je n’ai aucun jugement à porter sur les autres, mais on m’a posé la question et j’y ai répondu sincèrement. Je ne pouvais pas faire autrement, moi en tant qu’Arnaud. La question de ce qui me paraît juste ou non est la seule qui vaille. “Quand je reçois des scénarios, par contre, je ne me base pas sur l’orientation sexuelle du personnage. L’affirmation de qui je suis n’a rien changé à mon moi d’acteur. Je ne l’ai pas vécu comme quelque chose dont j’aurais dû me délivrer. Simplement, je suis revenu au cinéma avec un film dont les personnages, au risque de leur vie, revendiquaient tout. Je l’ai donc fait, à ma hauteur. Soyons clairs : je ne prends pas de risques en tant que comédien. Je vis dans un monde ouvert et fluide où je me sens à ma place.” Le résultat de cette fluidité, c’est qu’Arnaud Valois passe cet automne d’un personnage de flic amoureux d’une journaliste torturée (Moloch) à celui d’un trentenaire qui tape dans l’œil d’une lycéenne (16 Printemps de Suzanne Lindon, en salle le 9 décembre), ou encore d’un vétérinaire en couple avec son compagnon très jaloux dans Garçon chiffon de Nicolas Maury, l’une des sensations de la fin d’année (à lire dans notre prochain numéro). Bien plus qu’une beauté saisissante Dans ce beau film, la masculinité à la fois classique et légèrement hors norme d’Arnaud Valois fait de lui bien plus qu’une beauté saisissante. “Je joue souvent des hommes en couple, c’est vrai, comme si j’étais une épaule sur laquelle se reposer. Si les gens savaient… (rires) Dans la vraie vie, généralement, c’est plutôt moi qui ai besoin d’une épaule." Le film de Nicolas Maury a été pour lui une expérience intensive et joyeuse" et l’occasion d’une découverte. >> Lire aussi : Rencontre avec Nicolas Maury : “Je suis trop freak pour devenir l’acteur du moment” “Nicolas m’a choisi après un seul essai, en une seule prise. J’ai eu la sensation d’être vraiment regardé. Mais quand j’ai vu le film terminé, j’ai compris quel degré de cinéaste il avait atteint, ses plans, ses références, cette mélodie qu’il arrive à mettre en place. Pour moi, un cinéaste se reconnaît au fait que tu rentres dans une espèce de transe en voyant un film, qu’elle soit très joyeuse ou très angoissante. Avec Nicolas, tu passes par tous ces états.” Incarner une époque de la façon la moins volontariste qui soit n’est pas donné à tout le monde. Celui qui joue aussi actuellement dans le spectacle pour enfants Le Vilain Petit Canard, sur une musique d’Etienne Daho, traverse sa période d’intense actualité avec un flegme bienveillant, pas forcément dupe. Tout en ayant le talent de se trouver au bon endroit au bon moment, il est capable de rester légèrement en retrait, sans se formaliser. Il sait aussi que les séries et surtout le cinéma français se trouvent à un tournant, qu’il appelle de ses vœux. A propos des César, Valois estime que "les choses vont revenir sur le bon chemin car nous avons maintenant une super présidente, l’ancienne patronne d’Arte, Véronique Cayla”, avant d’embrayer calmement sur l’importance de ne plus regarder en arrière. “C’est une excellente chose que l’on agisse pour la place des femmes et la diversité dans tous ses aspects – je déteste le mot ‘minorités’. C’est important que le cinéma et son industrie puissent ressembler à quelque chose de plus paritaire et inclusif, à l’image de la société.” “Ce qui s’est passé, la vague MeToo, je la trouve nécessaire, bien que la déferlante arrive à retardement en France. Je pense qu’il faut ouvrir la parole. Parfois, les revendications sont extrêmes, mais sans revendications extrêmes, on n’avance pas. Avec des robinets d’eau tiède, on n’y arrivera pas. Nous avons besoin de figures qui prennent la parole de façon assez radicale.” Quand il prononce ces mots, on pense évidemment à sa partenaire de 120 Battements par minute, Adèle Haenel, comme si le hasard des rôles et des projets n’en était jamais vraiment un. “J’ai été solidaire de l’action d’Adèle Haenel pendant les César, c’était sa façon de l’exprimer, et personne ne peut avoir de jugement là-dessus. Je ne peux que dire bravo. Aller jusqu’au bout de soi de cette manière, c’est remarquable.” Moloch d’Arnaud Malherbe les 22 et 29 octobre sur Arte, du 15 octobre au 27 novembre sur arte.tv Garçon chiffon de Nicolas Maury en salle le 28 octobre Le Vilain Petit Canard spectacle musical, les 21 et 22 octobre, Philharmonie de Paris Légende photo : A Paris, en octobre © Jules Faure pour Les Inrockuptibles

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 15, 2020 10:29 AM
|
Par Cédric Pietralunga dans le Monde du 15 octobre 15h00 Concrètement, les séances auraient toujours l’obligation d’être terminées à 21 heures, mais les spectateurs auraient ensuite le temps de regagner leur domicile. La mesure est réclamée par tous les professionnels de la culture. Selon nos informations, le gouvernement envisage d’aménager le couvre-feu pour les salles de cinéma, de théâtre ou de spectacle, qui se disent effondrées depuis les nouvelles annonces d’Emmanuel Macron et dénoncent une mise à mort de leur secteur. Alerté par certains de ses proches, le chef de l’Etat plaiderait notamment pour cet assouplissement. « Il faut qu’on l’étudie », a répondu le premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse, jeudi après-midi. « La décision est en débat », confirme son entourage. Concrètement, si cet assouplissement est adopté, les séances auraient toujours l’obligation d’être terminées à 21 heures, mais les spectateurs auraient ensuite le temps de regagner leur domicile. Une modification destinée à donner davantage de souplesse aux professionnels et à leur permettre de maintenir une activité en soirée. « Le billet électronique, où l’heure de la séance sera inscrite, peut servir de justificatif. Il suffirait aux spectateurs de le présenter en cas de contrôle », assure une source au sein de l’exécutif. Cet aménagement est au centre des revendications des professionnels du spectacle, qui estiment qu’un couvre-feu obligeant les gens à être rentrés chez eux à 21 heures condamne de facto toutes les séances ou représentations en soirée. « Les séances en soirée représentent 40 % à 50 % de la fréquentation des salles de cinéma en France, il faut qu’on puisse au moins en sauver une si on veut assurer une exposition suffisante des films et inciter les distributeurs à maintenir les sorties », plaide Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Couvre-feu : le monde de la culture à nouveau sous le choc Nouvelles mesures de compensation financière Décidée à sauver « quoi qu’il en coûte » le secteur de la culture depuis son arrivée rue de Valois, Roselyne Bachelot devait recevoir les professionnels jeudi après-midi, pour les assurer de la mobilisation du gouvernement. Outre le maintien du chômage partiel à 100 % pour les employeurs et des exonérations de charges sociales, la ministre de la culture devait leur annoncer de nouvelles mesures de compensation financière, à la fois pour les salles qui décident de fermer, mais aussi pour celles qui tentent de rester ouvertes, en prenant en charge le manque à gagner provoqué par le couvre-feu. « La ministre défend toujours la position qui préserve au mieux l’activité, défend l’entourage de Mme Bachelot. Il y a une grosse demande assez uniforme des acteurs qui disent qu’ils peuvent sauver les meubles si 21 heures est l’heure de sortie du spectacle et pas d’arrivée au domicile. (…) La ministre va relayer cette demande très forte et convergente du secteur. » Cédric Pietralunga

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 14, 2020 7:50 PM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans son blog l'Oeil d'Olivier 14 octobre 2020 Seul sur la scène de la petite salle du Théâtre de Sartrouville Yvelines CDN, Vincent Dissez se glisse avec fièvre et intensité dans les mots de Jean-Luc Lagarce. Dirigé avec précision et justesse par Sylvain Maurice, le comédien donne le meilleur de lui-même et ressuscite, le temps d’un spectacle, l’esprit du dramaturge français mort trop tôt du sida en 1995. Une scène nue, un immense écran lumineux en arrière-plan, pas besoin de plus pour donner vie aux textes plus ou moins autobiographiques de Jean Luc Lagarce. Sylvain Maurice ne s’y trompe pas. En artiste ciseleur, il sculpte le jeu de son comédien fétiche Vincent Dissez, le met à nu, habillé par les magnifiques lumières de Rodolphe Martin et laisse les mots du dramaturge attrapés, envoûtés. Deux récits autobiographiques La langue de Lagarce est singulière, belle. Elle est faite de répétitions, de redites, de reprises. Entre introspections et confessions, le dramaturge se raconte tout en faisant le portrait de ses congénères. Humain, il parle de ses faiblesses, de ses défauts, de ses envies, de ses doutes. Qu’il sorte du coma et doit réapprendre à vivre, comme dans L’apprentissage, ou qu’il s’épuise dans un voyage aux Pays-Bas pour suivre en tournée ses comédiens, comme dans Voyage à La Haye, l’auteur ne cherche pas à se donner le beau rôle, bien au contraire. Ce n’est pas son but. Son écriture est celle de l’urgence, de la nécessité de tout dire avant qu’il ne soit trop tard, qu’il ait oublié ou qu’il ne puisse plus le faire. Un autoportrait cinématographique Malade, ses jours étant comptés, Lagarce parle de son amour pour le théâtre, de ses angoisses, de ses peurs. Que la toile de fond soit un hôpital, où les rues d’Amsterdam ou de La Haye, sa vie défile à toute vitesse. En adaptant ces deux textes courts, Sylvain Maurice a, tout de suite, vu le potentiel cinématographique de cette prose. Jouant des travellings, des gros plans, des zooms arrières, il s’attache avec épure à souligner la puissance poétique des récits, leurs forces troublantes, leurs puissances sensibles, humaines. Un comédien en état de grâce Clairs obscurs, pénombre, halos incandescents, carrés lumineux aux multiples couleurs, servent d’écrin à Vincent Dissez. Torse nu, ou vêtu d’un tee-shirt, il ne fait plus qu’un avec l’auteur. Il s’approprie sa personnalité, son caractère. Il emprunte ses pensées, ses errances. Tout en retenue, en finesse pudique, il fait retentir la férocité, la causticité mâtinée de mélancolie de la plume « lagarcienne ». C’est terriblement intense, passionnément émouvant. Avec une simplicité parfaitement maîtrisée et hautement précise, Sylvain Maurice et son comédien font entendre à nouveau l’auteur du Pays lointain et laisse entrevoir l’homme derrière l’artiste. Avec délicatesse et ingéniosité, Un jour, je reviendrai frappe net et juste. Olivier Frégaville-Gratian d’ Amore ------------------------------------- Un jour, je reviendrai d’après L’Apprentissage et du Voyage à La Haye, deux récits autobiographiques de Jean-Luc Lagarce
Théâtre de Sartrouville Yvelines CDN
Place Jacques-Brel – BP 93
78505 Sartrouville cedex mise en scène de Sylvain Maurice assisté de Béatrice Vincent
avec Vincent Dissez
scénographie ce Sylvain Maurice en collaboration avec André Neri
costumes de Marie La Rocca
lumière de Rodolphe Martin
son et régie son deCyrille Lebourgeois
régie générale d’André Neri
régie lumière de Sylvain Brunat Crédit photos © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 14, 2020 7:05 PM
|
Par Sylvain Merle dans le Parisien - 14/10/2020 À l’annonce, attendue et redoutée, de l’instauration d’un couvre-feu à 21 heures pendant six semaines, les théâtres parisiens oscillent entre colère et abattement. Et cherchent déjà des solutions. « On va avoir du mal à s'en remettre cette fois. On commençait à peine à reprendre notre envol et on nous coupe dans notre élan, c'est l'effet double lame mal venu », réagit vertement ce mercredi soir Bertrand Thamin, président du Syndicat national du théâtre privé (SNDTP). « Tout ça est quand même géré à la petite semaine, c'est assez décourageant, je suis assez atterré ce soir. On nous a fait la danse du ventre il y a un mois et demi pour qu'on rouvre et voilà… », lâche celui qui est aussi directeur du théâtre du Montparnasse. « On espérait qu'on nous laisse jusqu'à lundi, mais non, là on a 48 heures pour se retourner, c'est très court », poursuit-il. Le spectacle à l'affiche de sa grande salle, « Marie des Poules », va passer de 20h30 à 19 heures dès samedi. « Demain mes caissiers vont téléphoner toute la journée pour proposer aux spectateurs de venir à 19 heures, mais la pièce dure 1h25, ceux qui habitent loin ne viendront pas, prévoit-il. On va perdre 50 à 60 % de nos spectateurs, déjà qu'on était en jauge dégradée ». Au Petit Montparnasse, il a deux spectacles. Et il ne sait pas encore ce qu'il fera. « Etudier comment on va enchaîner les deux pièces » C'est d'ailleurs un peu l'inconnu pour beaucoup. Et l'on cherche des solutions. Au Tristan Bernard, Pascal Guillaume va tenter de doubler ces matinées les samedis et dimanches pour « Affaires sensibles » avec Fabrice Drouelle et « Virginie Hocq- Ou presque », ses deux spectacles actuellement à l'affiche. « On va faire des essais demain pour voir en combien de temps on démonte le décor de Virginie Hocq et étudier comment on va enchaîner les deux pièces », explique-t-il. Il va tenter, aussi, de passer l'adaptation à la scène de l'émission de France Inter à 18h30 le mardi. « Certaines salles le font avec succès, le Rond-Point ou Le Lucernaire, souligne-t-il. On va tenter, si ça prend, on continuera ». Également producteur du « Dernier jour du jeûne », de Simon Abkarian, qui débute ce vendredi au théâtre de Paris, Pascal Guillaume va devoir se restreindre aux seules matinées du week-end vu la longueur du spectacle, plus de deux heures. « A ma connaissance, il n'y a aucun cluster dans un théâtre » Devant la situation, les salles sont condamnées à tenter, à tester. Ou à fermer et faire le dos rond, encore une fois. « Je pense que ceux qui peuvent vont essayer d'avancer leur lever de rideau à 19 heures, même s'ils perdent des spectateurs, c'est mieux que de rester fermé », reprend Bertrand Thamin. Et de souligner combien toutes les salles se sont montrées « particulièrement vertueuses » depuis leur réouverture en s'auto-appliquant des protocoles stricts. « A ma connaissance, il n'y a aucun cluster dans un théâtre, insiste-t-il. Le président a salué la bonne conduite des salles et voilà… C'est un peu l'enclume pour écraser une mouche ce qu'ils sont en train de faire ». Conscient des conséquences d'un tel couvre-feu, le chef de l'Etat a annoncé « l'amélioration de l'accompagnement économique » des secteurs impactés. « Mais, on n'a même pas eu le temps encore de mettre en place le dispositif de compensation de la billetterie, il faudra leur expliquer que la lourdeur administrative ne peut aller avec la gestion d'une telle crise », déplore encore Bertrand Thamin. Et de poursuivre, acide, « j'attends de voir comment les annonces du château vont être traitées par les ministères, ils n'ont plus un centime ». Une réunion est prévue ce jeudi au ministère de la Culture.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 23, 2020 2:20 PM
|
Propos recueillis par Rosita Boisseau et Guillaume Fraissard pour Le Monde 23/10/2020 Le directeur du Festival se réjouit, dans un entretien au « Monde », de l’impatience du public à venir découvrir les sept spectacles programmés du 23 au 31 octobre. Après l’annulation du Festival d’Avignon, en avril, Olivier Py, metteur en scène et directeur de la manifestation, a réussi à construire une exceptionnelle Semaine d’art en Avignon, avec sept spectacles programmés entre vendredi 23 et samedi 31 octobre. Lire le focus : Une Semaine d’art en Avignon à la Toussaint La ministre de la culture Roselyne Bachelot a annoncé de nouvelles aides financières pour le spectacle vivant, secteur sinistré. Quelle est l’importance de cette Semaine d’art dans le contexte actuel ? Elle est d’abord un signe pour la ville d’Avignon déjà sinistrée. C’est la cinquième ville la plus pauvre de France et l’annulation de la manifestation a été un coup terrible avec une perte estimée à 100 millions d’euros. Le festival n’a, quant à lui, pas de soucis financiers. Nous avons reçu nos subventions 2020. Les billets à la vente sont partis très vite, et on n’en aura sûrement pas assez. On sent une envie très forte du public de revenir dans les salles. Il sera plus local que pendant le mois de juillet où seulement 35 % des spectateurs sont de la région, mais ce lien est précieux à conserver. Lire le compte-rendu : 115 millions d’euros pour soutenir le spectacle vivant et le cinéma confrontés aux conséquences du couvre-feu A Avignon, la Semaine d’art est très attendue par les équipes, les artistes et la ville. A ceci près que nous suivons les normes et n’aurons que 5 000 places au lieu de 10 000 et c’est très dommageable. Mes seules inquiétudes sont la mise en place de nouvelles contraintes sanitaires ou que des artistes aient le Covid-19, qu’ils soient tenus d’annuler. Pour quelles raisons avez-vous choisi pour ce rendez-vous exceptionnel le titre de Semaine d’art, nom de la première semaine imaginée, en 1947, à Avignon, dans le cadre de laquelle Jean Vilar fut programmé, et que va devenir le festival que l’on connaît ? Ce titre est venu impulsivement. Ce n’est d’ailleurs pas tellement moi, mais mes collaborateurs qui s’en sont emparés avec évidence. En 1947, cette Semaine d’art en Avignon avait d’ailleurs lieu en automne et était pluridisciplinaire. Je suis revenu à la source en quelque sorte, et aussi à Jean Vilar, qui est mon maître à penser. Il n’a jamais commis d’erreur politique. Même en 1968, il ne nie pas la légitimité du mouvement des artistes et refusera de mettre en scène un opéra commandé par de Gaulle. A chaque fois que le festival est attaqué, j’ai une phrase de lui qui me vient. En ce moment, ce serait par exemple : « Donnez-nous un autre monde et je vous donnerai un autre théâtre. » Le théâtre n’est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde, il ne peut pas raccommoder la fracture sociale, mais il peut en être un peu le remède. Lire la tribune d’Olivier Py : « La culture n’est pas un luxe mais un devoir impérieux » Comment avez-vous bâti cette programmation resserrée avec seulement sept spectacles ? Annuler quarante-sept spectacles en avril, c’est douloureux. On a pu en sauver sept, à l’affiche dans une quinzaine de salles, et en reporter une dizaine sur l’édition 2021. J’étais très fier d’ouvrir la manifestation avec de la danse dans la Cour d’honneur. C’est un deuil de ne pas avoir pu le faire. Pour le reste, ç’a été un Rubik’s Cube. Certains spectacles n’ont pas été répétés ni créés ; les artistes n’étaient pas toujours libres. Lire le portrait : La marionnettiste Yngvild Aspeli à l’assaut de la baleine de « Moby Dick » En ce qui concerne l’élaboration de l’édition 2021, tenez-vous compte de la crise sanitaire dans vos projections ? Le Festival 2021 est construit et fini. Nous travaillons évidemment sur l’éventualité de devoir jouer devant des demi-jauges. On aurait du mal, la ville comme les artistes, à se remettre d’une seconde annulation. Certaines compagnies sont presque en situation de banqueroute et, pour les aider, nous avons décidé d’augmenter les moyens de production pour les spectacles. Nous avons reçu l’intégralité de nos subventions 2020 pour un festival qui n’a pas eu lieu. Notre budget aurait dû être de 14 millions d’euros en 2020, et il est en définitive de 9,4 millions après une perte d’exploitation – billetterie, mécénat, tournées – de 4,6 millions, suite à l’annulation : cela avec une équipe de trente-trois permanents. Nous avons payé tout le monde, artistes, intermittents et saisonniers, ainsi que les compagnies qui ne pouvaient pas être reprogrammées. Une partie de nos mécènes continue à nous soutenir. Lire le récit : Comment le Festival d’Avignon fait face aux conséquences de l’annulation Est-ce que la crise sanitaire influence les artistes dans leur création ? Avez-vous pu voir et constaté des changements et des nouveautés, dus au Covid-19, dans les spectacles ? J’aimerais vous dire oui ! J’aimerais qu’il y ait une victoire de l’art et de la poésie sur la fatalité, mais je n’en ai pas l’impression. La réalité est tout de même très dure. On a quand même expérimenté des choses cet été, comme, par exemple, les cent événements du programme audiovisuel Un rêve d’Avignon, en partenariat avec les chaînes de l’audiovisuel public, France Télévisions, Arte, France Culture et RFI. On a décidé, pour la Semaine d’art, d’un tarif unique et solidaire à 15 euros : nous n’avons pas un public de riches. En novembre, nous distribuerons deux mille billets gratuits pour que les jeunes puissent assister, à La Fabrica, au spectacle Le Joueur de flûte, de Joachim Latarjet, qui aurait dû être présenté cet été également. Ce ne sont que quelques exemples pour contrecarrer la fatalité. Votre contrat à la tête du Festival d’Avignon va-t-il être prolongé jusqu’en 2022 ? C’est le souhait de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Il y a d’ailleurs beaucoup d’autres directeurs d’établissement qui sont dans le même cas que moi. En ce qui me concerne, il faut attendre le conseil d’administration qui se réunit début décembre. Il s’agit d’envisager ma succession, d’y travailler pour qu’elle soit bien faite, que la passation de pouvoir se fasse en douceur, compte tenu des difficultés de la fonction. Que la nouvelle présidente du conseil d’administration soit Françoise Nyssen, ex-ministre de la culture, est une bonne chose, car c’est elle qui devra assumer cette passation. Lire l’entretien avec Roselyne Bachelot : « L’Etat n’abandonnera personne » Quel bilan tirez-vous des états généraux des festivals qui ont eu lieu les 2 et 3 octobre, à Avignon, à l’initiative de Roselyne Bachelot, et dont vous attendiez beaucoup ? J’ai été très heureux de ce qui s’est passé pendant ces deux jours. Ces états généraux sont pour moi comme le troisième acte de la décentralisation que j’appelle de tous mes vœux. Après la seconde guerre mondiale, le Festival d’Avignon a été le premier à inviter la décentralisation dans la Cour d’honneur du Palais des papes. Il faut rappeler l’importance d’un service public de la culture et celle des festivals sur les territoires. La décentralisation se réinvente elle aussi avec des manifestations comme celle du Nouveau Théâtre populaire, dans le Maine-et-Loire. Lire le compte-rendu : A Avignon, Roselyne Bachelot annonce cinq millions supplémentaires pour les festivals Les festivals sont un moteur économique, mais ils ont aussi un rôle social en créant du lien. Cet aspect est inspirant. Je suis très attaché au travail que nous menons, par exemple dans les collèges et les lycées, mais aussi en milieu carcéral. Quant au budget supplémentaire de 5 millions pour les festivals, il faut le souligner, car ce n’est pas souvent qu’un plan de relance de cet ordre se fasse. L’augmentation de 5 % du budget de la culture est exceptionnelle quand on est resté si longtemps au chiffre de 1 % du budget de l’Etat. Quant au nombre des festivals, qui serait de 5 000 en France, non, il n’y en a pas trop. La France reste une exception culturelle. Avez-vous continué à écrire pendant cette période difficile ? Au début, j’ai été tétanisé. Je ne pouvais rien faire, ni lire ni écrire. Mon énergie spirituelle était totalement prise par l’annulation. Ensuite, j’ai travaillé sur un scénario pour un film sur la mort de Molière. Retour au père fondateur dont j’ai relu toutes les pièces et aussi des biographies. Le Covid-19 et la mort au théâtre étaient aussi présents. Pour la première fois, j’ai eu beaucoup de temps. Au lieu d’écrire pendant mes trajets en train ou les vingt minutes de coupure pendant les répétitions, j’ai pu profiter de ce temps, et cela a été une expérience très bénéfique pour moi. Je ne veux pas avoir l’air indécent, mais j’ai pu lire et écrire. J’ai commencé de nouvelles pièces de théâtre, mais, pour l’an prochain, je finirai ma mise en scène d’Hamlet, sur laquelle je travaille depuis trois ans et qui est une grosse production avec des élèves de l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes et Marseille. La culture a été contrainte de se réinventer. Comment voyez-vous votre avenir après Avignon et quel rôle aimeriez-vous endosser ? La culture et le théâtre populaire se sont toujours réinventés ! Personnellement, j’ai plein d’idées pour l’avenir. Je ne sais pas du tout si j’aurai envie de diriger une maison après Avignon, mais je n’ai pas peur de l’avenir, car j’ai un très beau passé. Légende photo : Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, au cloître Saint-Louis, à Avignon, le 16 octobre. OLIVIER METZGER / MODDS POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2020 5:53 PM
|
Présentation par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 20 octobre 2020
Ödön von Horvath par René Zahnd, Editions Ides et Calendes, Collection Le Théâtre de ****, environ 128 pages, 10 €.
Aux éditions Ides et Calendes – Lausanne, Suisse -, Le Théâtre de **** est une collection de référence consacrée aux auteurs de théâtre. Les directeurs de la collection, Hélène Mauler et René Zahnd, proposent une série d’ouvrages servant d’introduction intelligente à la vie et à l’oeuvre d’un auteur de théâtre, une bibliothèque idéale pour les amateurs et professionnels de théâtre. Plus d’une quinzaine d’auteurs, d’Eschyle à Vinaver, sont parus, dont Büchner, Pasolini, Tchekhov, Beckett, Césaire, Duras, Maeterlinck et Synge…
Cet automne 2020, paraissent quatre grands auteurs incontournables – Henrik Ibsen, Luigi Pirandello, Max Frisch et Ödön von Horvath, celui-ci faisant l’objet de ce présent article.
René Zahnd est l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre, les plus récentes publiées chez Actes Sud – Papiers. Son travail de traducteur, mené le plus souvent en collaboration avec Hélène Mauler, a débouché sur une trentaine de titres (Brecht, Dürrenmatt, Dorst, Mayenburg…) C’est dans ce cadre qu’il s’est passionné pour Ödön von Horvath, donnant de nouvelles versions françaises de cinq de ses pièces, parues chez L’Arche Editeur.
Ce livre, l’un des rares en français consacrés à cet auteur majeur, aborde les grandeurs et les secrets d’une oeuvre qui ne cesse de résonner dans le monde d’aujourd’hui, abandonnant derrière elle « la petite musique d’une fascinante mélancolie ».
Un fils de son temps
Le 1er juin 1938, une tempête s’abat sur Paris, Ödön von Horvath, âgé de 37 ans, est tué sur les Champs-Elysées par une branche cassée. il sortait d’un cinéma, après avoir vu Blanche -Neige et les sept nains de Walt Disney. Sa fin tragique reflète les textes qui nous interrogent, des titres de profession de foi poétique : Casimir et Caroline, Légendes de la forêt viennoise, Foi, amour, espérance, Don Juan revient de la guerre, Nuit italienne…
Enfant de la Mitteleuropa, attaché à sa langue allemande comme à une patrie, Horvath assiste avec stupeur à la montée des nationalismes et des extrémismes : le dialogue est l’essence de l’humanité. A travers l’écriture et le théâtre en particulier, l’écrivain témoigne des injustices, des scandales, des lâchetés, mais aussi des beautés existantes.
Son oeuvre singulière est faite de fulgurances poétiques, d’ambiances et de mouvements, de lumières et de couleurs. Développant un art du fragment et de la fresque dramatique, il dessine le destin d’êtres, de femmes en particulier, saisis dans les convulsions d’une société déboussolée, celle de l’Europe qui vacille au bord de tous les abîmes.
Selon cette excellente biographie et étude menée par René Zahnd sur l’oeuvre de Ödön von Horvath, inscrite en pleine République de Weimar, l’écrivain hongrois germanophone suscite un intérêt qui dure, inépuisable, non seulement à travers les thèmes qu’il aborde, le chômage, l’inflation, la prostitution, le suicide, la fracture sociale, la lâcheté, l’hypocrisie, la montée des extrémismes, l’impact des lois et de la justice sur la vie des gens, l’absurdité de certaines hiérarchies – des sujets qui résonnent dans notre actualité.
Mais l’auteur s’impose encore à travers une écriture qui traverse le temps, nourrie d’un humour mordant, une poésie imprégnée de mélancolie, une recherche sur le langage, une habileté diabolique à jouer avec les genres et les codes, des innovations dans le découpage dramaturgique, une aptitude à restituer une galerie de personnages.
Au contraire de son glorieux contemporain, Bertolt Brecht, et de son approche dialectique, Horvath opte pour une attitude empirique et intuitive.
Tout commence dans la Mitteleuropa, qui est bien davantage qu’une « Europe centrale » aux contours mal définis. Pour les historiens, cette appellation recouvre les territoires occupés par l’Empire autre-hongrois, rayé des cartes en novembre 1918. Un univers où les peuples s’entremêlent, un kaléidoscope de cultures et d’influences, un lent carrousel ethnique où les langues se fertilisent les unes les autres, à tel point que l’imaginaire collectif pare ce monde de mille qualités rares. Le rêve d’une Europe des Lumières, l’aboutissement d’une société cosmopolite, un mélange détonant d’intellectualisme et d’hédonisme. L’enchantement de l’évocation de Vienne 1900 balaie jusqu’au souvenir du naufrage de violence dans lequel la ville sombre dès les premiers jours de l’Anschluss.
A cette époque, poètes, écrivains, artistes, penseurs et observateurs prennent conscience de la richesse et du potentiel d’un territoire qui s’est développé hors de tout contrôle : la ville. Chef-lieu des chansonniers et des cabarets, ville d’une folle activité nocturne, Berlin dont l’univers coloré est peint par Otto Dix ou Georges Grosz, est aussi le siège de l’UFA
, le plus grand cinéma de l’entre-deux-guerres, où travaillent notamment Lubitsch, Lang, Pabst et Murnau, sans compter les journaux édités, les salles de concert et de théâtre.
Deux figures de la modernité s’épanouissent à Berlin, Max Reinhardt et Erwin Piscator, celui-ci étant un pionnier du théâtre politique. Berlin est une capitale de l’art dramatique, le théâtre s’intéresse au mouvement de la « Nouvelle Objectivité », et nombreuses sont les pièces qui traitent des questions sociales, politiques, économiques et morales.
Von Horvath choisit de s’installer à Berlin pour « fuir la tranquillité et s’attacher au devenir d’une nouvelle conscience sociale ». La relation de l’être à la multitude est un thème récurrent de son oeuvre, la négation de l’individu étant le signe des dictatures.
Dans Sladek ou l’armée noire (1928), le protagoniste est un soldat de son temps, des années 1923, entre Woyzeck de Büchner et le Chveïk de Hasek, un représentant de la « classe 1902 », pubère à la Grande Epoque, pendant la crise et l’inflation – un type sans traditions, un déraciné auquel manquent de solides fondements et qui devient le prototype du suiveur. Sans être véritablement un meurtrier, il commet un meurtre.
1929 est une date charnière pour la République de Weimar : la première échéance du paiement des réparations de guerre, fixée au 1er septembre 1928, puis le krach de Wall Street, marquant la fin de l’embellie de quelques années pour l’Allemagne. La crise économique provoque une montée fulgurante du chômage, qui passe de 1,3 million de personnes en 1928 à plus de 6 millions en 1932, soit près de 30% de la population active.
Klaus Mann écrit : « L’amertume du chômeur ne résulte pas tant du désespoir dû à la baisse de son niveau de vie – même si c’est ce dont il prend le plus tôt conscience – que de la souffrance bien plus profonde et légitime de ne plus pouvoir participer. Tout se déroule sans lui, au-dessus de sa tête, dans l’indifférence la plus cruelle. Voilà ce qu’il trouve insupportable. »
Et l’écrivain de conclure : « Et lui qui par nature n’est ni bon ni mauvais pourrait devenir terrible et tout casser si on lui demandait de rester encore longtemps assis là, les bras croisés. Il est très difficile de savoir si, à l’origine, il était plus proche de faire le mal que le bien. Ce qui est sûr, c’est qu’à la longue, il aimera mieux faire le mal que ne rien faire… »(Contre la barbarie, 1925-1948, Phébus, 2009).
Le regard du peuple sur le monde
Une tradition autrichienne privilégie le Volksstück, la « pièce populaire », s’adressant non seulement au peuple mais le représentant sur scène, un divertissement pur et simple.
Et au tout début des années 1930, von Horvath définit ainsi trois de ses pièces majeures – Nuit italienne, Légendes de la forêt viennoise et Casimir et Caroline. La quatrième – Foi amour espérance s’accompagne de la mention « Petite danse de mort ». Des pièces populaires du terroir, au meilleur sens du terme – questions et préoccupations du peuple.
Or, la notion de « peuple » – ni catégorie ethnique ni catégorie nationale – exige des précisions quand elle tente, hier comme aujourd’hui, de cerner une catégorie sociale. Ce « peuple », historiquement constitué d’artisans, d’ouvriers, de paysans, de travailleurs divers, a évolué au fur et à mesure des changements politiques. Pour le dramaturge, l’Allemagne et les autres Etats européens se composent à 90% de petits-bourgeois accomplis ou refoulés : les petits-bourgeois sont la classe la plus représentative du temps.
Dans son « Mode d’emploi », l’auteur évoque chez le petit-bourgeois la mise en place d’un « jargon cultivé » mal assimilé qui traduit un désir d’intégration et d’ascension sociale – jargon marxiste, politique, psychanalytique, banal, plein de clichés. Soit l’incapacité à développer son propre discours, soumis au plus fort, croit-on, et bientôt aux totalitarisme.
L’auteur renvoie dos à dos la molle démission des Républicains et le délire fasciste.
Légendes de la forêt viennoise voit ses couples se défaire pour se reformer, une comédie mordante et caustique. La pièce – une satire contre la petite-bourgeoisie en général, incapable de rire d’elle-même, fait scandale en Allemagne, de façon moindre en Autriche.
En exergue : « Rien ne donne autant le sentiment de l’infini que la bêtise humaine. »
Pour décor, la rue viennoise, un quartier quotidien – boucherie, magasin de magie, tabac : la rue est un spectacle en soi. Le grand sujet de la pièce, dans une société vivante et foisonnante, est le sort réservé à la femme quand le pouvoir appartient aux hommes. Marianne, prisonnière d’une éducation patriarcale, a voulu se libérer mais elle finira sa vie dans le mariage, « la mort la plus lente qui soit ».
Casimir et Caroline prend pour cadre un autre espace référentiel de la culture populaire, l’Oktoberfest de Munich, une tradition née en 1918, appelée en France la Fête de la Bière. Casimir fait partie des 10 millions de chômeurs de l’année 1932.
Au départ, Casimir aime Caroline qui aime sans doute Casimir. Mais une fois à la fête, ils ne parviennent pas à se libérer. Les deux sont sans travail et lui considère cette situation comme une tare rédhibitoire – la perte de son emploi marque la fin de leur liaison, croit-il.
La pièce à l’audace structurelle se compose de 177 séquences, le dramaturge use de la technique cinématographique du découpage – des scènes très courtes et rapides, parfois.
L’auteur alterne le focus accordé à des scènes simultanées – marques de la modernité.
L’Oktoberfest est l’exutoire de toutes les frustrations, le peuple s’y évade à bon compte.
A cette fête foraine, on voit des monstres dont un présentateur se charge de faire l’article, servant d’intermédiaire entre le public du théâtre forain et la représentation des phénomènes – intermédiaire entre le public venu voir la pièce et la scène du théâtre forain.
La quatrième pièce marquante de ce début des années 30, Foi amour espérance (allusion à l’Epître aux Corinthiens de saint Paul) permet à Horvath l’exploration de nouvelles ressources structurelles : l’histoire qui débute au printemps et s’achève à l’automne – ellipses, résonances d’un tableau à l’autre, construction, progression et évocation.
La pièce montre la justice ou plutôt l’injustice des disparités sociales, « le combat gigantesque entre l’individu et la société, cette éternelle tuerie qui ne saurait déboucher sur aucune paix – au mieux, un individu savoure ici ou là pendant quelques instants l’illusion du cessez-le-feu ». Du monde impitoyable, les plus vulnérables ne se sortent pas.
Le 30 janvier 1933, est nommé au poste de Chancelier le chef du groupe parlementaire le plus puissant, Adolf Hitler. Tout était planifié depuis des années pour cette prise de pouvoir – coup d’état, révolution. Les événements se précipitent, le 27 février 1933, le Reichstag est incendié. L’attentat fournit au nouveau pouvoir un prétexte pour suspendre les libertés individuelles, donnant à la répression contre les partis de gauche une apparence légale. En mars, est créé le ministère de l’Information et de la Propagande, englobant le domaine culturel, confié à Joseph Goebbels.
Pour Hitler, et depuis 1924, le théâtre fait partie « des symptômes de déclin d’un monde en train de lentement pourrir ». Après 1933, face à la montée de l’intolérance et à la violence étatique, c’est par milliers que des personnalités qui consacrent leur existence à l’art, à la poésie, à la pensée sont jetées sur les routes de l’exil, contraints ou par choix.
Pour Horvath s’ouvre une période délicate – perte de repères et changements fréquents de domicile, épisodes dépressifs. Rétif à toute forme d’engagement collectif, il refuse de participer à toute publication parlant politique. Comme Stefan Zweig, il choisit le repli.
Il revient à Berlin pour retrouver son statut d’auteur en vue, hostile pourtant au régime national-socialiste, à son idéologie et à sa vision du monde. Les deux pièces les plus abouties durant cette période datent de 1936 et ont pour point commun de s’inspirer de mythes littéraires, Figaro et Don Juan, Figaro divorce et Don Juan revient de guerre.
La première pièce, créée en 1937 à Prague dans une version très édulcorée, se développe autour des deux thèmes principaux de l’émigration et la révolution.
Le traumatisme de l’exil – problèmes quotidiens et blessures profondes – est évoqué; et la dégradation personnelle, le désordre mental à tous points de vue que provoque le fait d’être jeté sur les routes. Le thème de l’émigration est plus clair que celui de révolution. S’agit-il de 1789 ou bien toute révolution dont on peut se réclamer, comme le Führer lui-même appelait la prise de pouvoir par le nationalisme ? A cette confusion des révolutions s’ajoute la fait que Figaro, malin et bon prince, prône la grande réconciliation.
Le désenchantement
Entre 1934 et 1936, Horvath termine Don Juan revient de guerre, pièce jouée à Vienne en 1952. Meurtri par la guerre, hanté par un amour idéalisé, accablé par le remords, l’homme aux mille conquêtes n’est plus que l’ombre de lui-même, un spectre qui rôde dans une réalité de ruines et de désolation – un homme pour trente-cinq personnages féminins.
Dans un monde où les hommes sont devenus rares, fauchés par le bourbier de la Grande Guerre ou par l’épidémie de grippe espagnole, les femmes sont obligées de prendre en charge la société civile. Une telle situation favorise l’émancipation et, ici, les femmes ne sont plus seulement des « demoiselles », victimes des mécanismes du patriarcat marchand, ou des « petites-bourgeoises » qui se reposent sur les lauriers de leur mariage.
On croise des actrices, des prostituées, des artisanes d’art, des religieuses, des lesbiennes, des mondaines, une militante communiste, des adolescentes, des enfants…
Dans ce gynécée, le héros représente en quelque sorte le mâle déchu. Le troisième acte de la pièce s’achève en forme de conte, intitulé « Le bonhomme de neige ».
L’engrenage conduit à la perte de Don Juan, accusé de viol par une jeune fille, poursuivi comme un criminel et achevant son voyage tout seul, peu à peu recouvert de flocons sur la tombe de sa fiancée – la fin du roman Un Fils de notre temps, de la même période.
S’impose la relation entre le froid extérieur et le froid intérieur, due à la faute commise par Don Juan avant la guerre et son impossible réparation – comparaison du destin d’un héros épuisé et de celui d’une Allemagne exsangue, rongée par la culpabilité. La société est menacée de mourir de froid, sans pouvoir ne rien sauver, et glisse sans vie vers le néant.
La pièce reflète les années 20/30, entre espoir et pragmatisme, ascension des fascismes et des progrès sociaux. Un glissement s’est produit d’un cynisme initial à un final teinté de mélancolie, d’un contexte de barbarie à une échappée poétique – démission ou désarroi.
Véronique Hotte / Hottello
La véritable patrie reste l’esprit, attiré aussi par les sciences occultes et le surnaturel.
Les pièces maîtresses de Horvath révèlent une pertinence aigüe et une force poétique, admirées par Rainer Werner Fassbinder, Christa Wolf, Thomas Bernhard, Heiner Müller.
Dans les années 1960 et 1970, les grands théâtres institutionnels s’emparent de l’oeuvre.
Légendes de la forêt viennoise a été produite au Schauspiellhaus de Zurich dans la mise en scène de Michel Kehlmann en 1964 et à la Schaubühne de Berlin dans une mise en scène de Klaus Michael Grüber en 1972, avec Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe… et au Burgtheater de Vienne dans une mise en scène de Otto Shenk, en 1974.
Peter Handke écrit, dans un texte qui désaxe totalement la pensée théâtrale occidentale : « Les pièces de Brecht proposent une simplicité et un ordre qui n’existent pas. Pour ma part, je préfère Ödön von Horvath, son désordre et sa sentimentalité dépourvue de maniérisme. Les égarements de ses personnages me font peur : il pointe avec bien plus d’acuité la méchanceté, la détresse, le désarroi d’une certaine société. Et j’aime ses phrases folles, signes des sauts et des contradictions de la conscience. Il n’y a guère que chez Tchekhov ou chez Shakespeare que l’on en trouve de semblables. » (J’habite une tour d’ivoire, Christian Bourgois, 1992 – édition allemande,1972).
En 1967 paraît chez Gallimard un volume de trois pièces traduites par Renée Saurel, puis Hans Schwarzinger se fait le promoteur de l’oeuvre de Horvath, en dirigeant un Théâtre complet en six volumes à L’Arche. Les spectacles se succèdent à Paris, en province, en Suisse, dans des mises en scène orchestrées par Yvon Davis, Jacques Nichet, André Engel, Laurent Pelly, Jean-Louis Hourdin, Alain Françon, Jean-Paul Wenzel, Emmanuel Demarcy-Mota, Jacques Osinski, Christophe Rauck, Yan Dacosta, Guy-Pierre Couleau…
La comédie humaine que l’auteur envisageait d’écrire à la fin de sa vie, raconte René Zahnd, il l’a réalisée dans son corpus dramatique. Les voix et les présences qui peuplent ses pièces dénoncent, avec une politesse désespérée, le sort réservé aux femmes.
Elles se moquent des tics de langage et de tous ceux qui relaient les idées toutes faites, elles s’insurgent contre le poids des conventions. Elles élèvent le petit-bourgeois au rang d’archétype du genre humain. Elles font de l’ironie une forme de poésie et du désarroi une forme d’élégance, transformant les fêtes populaires en laboratoires des pulsions enfouies.
Tout un programme que l’ouvrage de René Zahnd révèle avec acuité et belle passion.
Ödön von Horvath par René Zahnd, Editions Ides et Calendes, Collection Le Théâtre de ****, environ 128 pages, 10 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 21, 2020 5:02 PM
|
Par Christophe Mey, France Bleu Besançon, France Bleu - 21 octobre 2020 Le tribunal judiciaire de Besançon a condamné ce mercredi le metteur en scène et professeur de théâtre bisontin Guillaume Dujardin à 2 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis. Il était poursuivi pour agressions sexuelles, chantage sexuel et harcèlement sexuel sur d'anciens étudiants et étudiantes. Quatre ans de prison, dont deux ans assortis d'un sursis probatoire, c'est la peine prononcée ce mercredi par le tribunal judiciaire de Besançon à l'encontre de l'homme de théâtre bisontin Guillaume Dujardin. Le metteur en scène, fondateur du festival de Caves à Besançon, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles, harcèlement sexuel et chantage sexuel sur des étudiants. Des faits commis entre 2014 et 2017 alors qu'il était professeur de théâtre à l'université de Franche-Comté. Neuf anciennes étudiantes et un ancien étudiant s'étaient portés partie civile lors du procès le 7 octobre dernier au cours duquel le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux avait requis cette même peine de 4 ans de prison dont deux ans ferme, il a donc été suivi par le tribunal à un détail près : Guillaume Dujardin a été relaxé des accusations concernant l'une des jeunes femmes. Il devra indemniser les 9 autres victimes, pour des sommes allant de 5.000 à 15.000 euros chacune, il a également l'obligation de se soigner, l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, et son nom sera inscrit au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes). Un jugement historique pour l'avocate des parties civiles L'avocate des parties civiles, Maître Anne Lassalle, salue un jugement historique pour le monde du théâtre: "c'est la première fois en France qu'un professeur de théâtre est reconnu coupable devant dix parties civiles et j'espère que la décision sera suivie par d'autres juridictions, d'ailleurs des dossiers sortent" note Maître Lassalle, "je pense qu'aujourd'hui c'est le début d'une réelle réflexion que le théâtre doit mener sur son enseignement". Le metteur en scène, qui n'était pas présent à l'audience, a désormais 10 jours pour faire appel du jugement s'il le souhaite, son avocat, Maître Mikaël Le Denmat, s'est refusé à tout commentaire. Si Guillaume Dujardin ne fait pas appel, il sera prochainement convoqué par la justice pour être écroué. Légende photo : L'avocate des victimes Me Anne Lassalle et le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux à la sortie de l'audience. © Radio France - Christophe Mey

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 20, 2020 3:31 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, le 20/10/2010 Le comédien Robert Plagnol avait réagi dès le moment du confinement, au printemps dernier. La merveilleuse Luce Mouchel propose elle aussi du théâtre à déguster en direct.
Pas plus compliqué que cela, en apparence. Jouer et se filmer, faire de son appartement un espace scénographié.
Voici l’affiche/communiqué de presse. Toutes les informations sont là !
Evidemment, cela suppose un travail fin et délié. On n’a pas encore pu voir Luce Mouchel qui est non seulement une interprète fine, audacieuse et qui écrit très bien. Mais on a vu dès ses débuts en direct, Robert Plagnol. Et franchement, c’est bluffant car on suit vraiment l’interprète avec passion. Il y a du suspens dans son adaptation d’Andrew Payne de « La Femme de ma vie » et l’on passe un excellent moment de théâtre, seul ou entre amis.
Dès que l’on aura eu le bon créneau pour découvrir Luce Mouchel et son texte « Un petit souffle et j’allais tomber », on vous en parlera d’une manière plus précise. Mais il n’y a pas à hésiter !
https://www.directautheatre.com/spectacles

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 18, 2020 7:50 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 16/10/2020
Avant la retraite de Thomas Bernhard, traduction de Claude Porcell ( L’Arche Editeur, 1987), mise en scène d’Alain Françon.
Le biographe Hans Höller, auteur de Thomas Bernhard – une vie (L’Arche Editeur, 1994) résume ainsi l’argument de la pièce mise en scène par Alain Françon.
Avant la retraite. Une comédie de l’âme allemande (1979), une pièce satirique, se conclut sur une petite fête familiale, célébrée tous les ans pour l’anniversaire d’Himmler. Autour de la table, deux sœurs – Vera et Clara – et leur frère Rudolf Höller, président de tribunal en République fédérale d’Allemagne, ancien officier nazi reconverti qui s’apprête à prendre sa retraite au terme d’une carrière exemplaire au service du droit et de la justice. Vera éprouve amour et haine pour ce drôle de frère. La pièce se déroule le 7 octobre, jour de la naissance de Himmler, auquel notre héros voue une admiration sans faille. Tout est prêt, l’uniforme, les accessoires, le repas. Or, le bonheur – retour à un passé douteux – ne peut être complet puisque Clara, la sœur paralysée observe les deux autres crûment, sans nulle complaisance. « Rudolf déjà légèrement ivre, en uniforme complet d’Obersturmbannführer SS avec casquette, revolver au ceinturon et bottes à tiges noires, à la table (…) Tous les trois mangent et boivent du champagne allemand ». Au milieu de ce retour orgiaque d’un passé récent dans le plus actuel des présents : « tout va dans notre sens/ il n’y en a plus pour très longtemps/ et finalement nous avons aussi une foule d’autres/ politiciens de premier plan/ qui ont été national -socialistes » – le juge en uniforme de SS s’effondre, totalement ivre : il porte les mains à la poitrine et tombe la tête sur la table ». Profitera-t-il de sa retraite ? La pièce fait par ailleurs allusion à la « retraite » forcée du ministre-président du land de Bade-Wurtemberg, Karl Filbinger, dont on avait découvert l’activité de juge dans la marine sous le nazisme. Sa carrière politique était terminée : celui qui avait fait en sorte que Claus Peymann quitte la direction du théâtre de Stuttgart en le traitant de « sympathisant du terrorisme », est démasqué comme complice des crimes nazis, il dut partir lui-même avant le metteur en scène qu’il avait conspué. Dans la pièce de Thomas Bernhard, Vera a caché son frère dix ans avant qu’il ne puisse revenir à l’air libre sans qu’on ne l’importune pour son passé… « oublié ». Avant la retraite fait allusion à ce rêve de restauration d’un ordre menacé, dans un prétendu état d’exception qui justifie tous les moyens – le frère et la sœur complices ne cessent de répéter que dignitaires et puissants, sommités politiques et militaires, anciens dignitaires nazis ne pensent qu’à « se débarrasser de l’étranger et du juif ». Des inepties insoutenables qu’ils s’échangent entre eux, sourds au monde. Soit la danse macabre d’une restauration rêvée d’ex-puissances démises. Le juge ne cesse d’attaquer la démocratie et de la nommer « terroriste » : les bombes américaines ont malheureusement détruit une école, à la fin de la guerre – dégâts collatéraux qui ont handicapé la benjamine, rivée à vie à son fauteur roulant. Clara est de gauche et engagée contre les convictions réactionnaires et iniques du frère et de la sœur aînés, qui vivent aussi, dans leur folie, une relation incestueuse. La pièce est d’un humour ravageur, donnant à entendre l’inouï et l’infâme, les points de vue les plus bas et irraisonnés, formulés contre le peuple et les étrangers, un discours abject qui résonne encore aujourd’hui de ses relents d’extrême-droite. La prétendue bonne conscience est dévoilée et mise en lumière, sans tabous ni censure, au cours d’un repas familial dans une salle à manger dont les volets et les rideaux sont tirés afin de pouvoir cacher l’inavouable infamie des hommes injustes. Le monde est une scène de théâtre où l’on répète continuellement la même pièce, sans résolution finale – comédie ou tragédie, selon Alain Françon qui cite l’auteur. Toujours est-il que Catherine Hiégel qui ouvre la bal est somptueuse de précision scénique, déclamant, faisant sonner et résonner les paroles odieuses de son frère et d’elle-même qui les répète, à l’aveugle, les ressasse, les contourne, les reprend à vif. Tandis qu’elle parlemente sans fin, expose et commente sa foi politique et morale, elle s’occupe dans la grande salle de séjour – décor majestueux, à présent désuet et décrépit de Jacques Gabel, sous les lumières Joël Hourbeigt. Une femme d’intérieur n’en finissant pas d’épousseter les meubles et de repasser convulsivement la robe sans pli de dignitaire de la Justice, l’habit de son frère, ou proposant un café à sa sœur qu’elle craint et qu’elle sait moqueuse et ironique, quant à son raisonnement. André Marcon, tranquille et déterminé, joue son rôle excellemment, vaniteux, satisfait de ses titres et de sa gloire passée, nostalgique, regrettant que ce temps soit révolu. Noémie Lvovsky – Clara – se tait et pourtant elle est fort expressive, quand elle entend les sottises énoncées par le duo infâme qui lui reproche son mépris. Une partition nette et cristalline à la musique étrangement inquiétante et menaçante. Véronique Hotte Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 bd Saint-Martin 75010 Paris, nouveaux horaires, le vendredi à 18h, le samedi à 17h, dimanche à 16h. Tél : 01 42 08 00 32. Crédit photo : Jean-Louis Fernandez. © Simon Gosselin-

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 19, 2020 6:54 PM
|
Par Jérôme Skalski dans L'Humanité - 19/10/2020 L’écrivain et dramaturge s’est éteint ce week-end à Concepcion, au Chili, à l’âge de 66 ans. Homme engagé, au singulier comme au pluriel, il avait animé des dizaines d’ateliers de création, afin que ceux à qui on ne donne jamais la parole prennent la plume et s’expriment.
« Mon ami, mon camarade, écrivain et dramaturge Ricardo Montserrat avec qui j’ai tant fait et tant échangé est décédé (…) d’un arrêt cardiaque à Concepcion au Chili, où il était parti vivre depuis trois ans », écrit Babouse dans l’hommage que rend le journaliste et dessinateur à celui qui, souligne-t-il, « était de ceux qui redonnent un peu de foi en cette vacharde putassière Humanité. » Né en 1954 à Saint-Brieuc de parents antifascistes espagnols catalans exilés en Bretagne, Ricardo Montserrat Galindo se rend au Chili en pleine dictature pour, en tant que professeur de langue à l’Alliance française de Concepcion, s’engager par le théâtre et l’écriture contre le régime de Pinochet. De Lorient à Roubaix, avec les chômeurs De retour en France au début des années 1990, il poursuit son engagement par la littérature, le théâtre et le cinéma, avec des œuvres abordant aussi bien le thème de la mémoire politique et historique que celui des résistances sociales. Animateur d’ateliers d’écriture tels ceux qui formèrent la base de la série des Aventures de Nour et Norbert, portée par Colères du présent, il signera une vingtaine d’autres romans écrits en collaboration, dont Zone mortuaire, rédigé avec quatorze chômeurs du quartier Kervenanec de Lorient, qui sera publié en 1997 dans la collection « Série noire », ainsi que Ne crie pas, coécrit avec des salariés privés d’emploi de Roubaix et paru dans la même collection en 2000, qui servira de base au scénario de Sauve-moi, film réalisé par Christian Vincent la même année. « Je suis revenu en France en 1990, après avoir vécu une dictature politique au Chili. Je me suis aperçu que l’on parlait aux chômeurs français de la même manière que la dictature parlait à ses opposants, qu’elle nommait les “antisociaux” : “Taisez-vous, laissez-nous agir, attendez, tout ira bientôt mieux.” Ils étaient considérés comme totalement hors jeu, quasiment morts », expliquait-il à l’Humanité au lendemain de son expérience roubaisienne, le 20 novembre 1999. Un « accoucheur de mots qui permettait aux gens de se raconter » « Ricardo a accompagné Colères du présent pendant plusieurs années, notamment sur le volet “éducation populaire” de l’association », explique François Annicke : « Sous son chapeau et de sa petite voix souriante, il savait emmener un groupe dans une aventure d’écriture collective et susciter l’envie d’écrire chez ceux à qui on ne donne que rarement la parole. Se qualifiant lui-même de maïeuticien, d’accoucheur de mots, il permettait aux gens de se raconter et d’imaginer des histoires communes. » « La collection qu’il a créée avec Colères du présent et les éditions Baleine, Nour et Norbert, a laissé des traces chez de nombreuses personnes qui parlent encore de ce lien fort et original que Ricardo savait nouer avec elles », souligne le coordinateur de Colères du présent. « Tu vas pouvoir retrouver tous ceux qui t’ont manqué si fort même quand ils étaient vivants », écrit pour sa part Reynaldo Montserrat Galindo en hommage à son frère disparu : « Sûr que tu vas leur tendre la main là où leur enfance et leurs rêves se sont cassés, dans les Pyrénées. Va, mon frère, chante avec Neruda et Jara, tu avais déjà rejoint leur pays… et puis Durruti et les écrivains des Brigades internationales, et Blum et Anaïs Nin, et Alfred Jarry. » Vivant à Saint-Malo non loin de Saint-Cast, dormant « tout au fond du brouillard », et de Cancale, où René Vautier passa ses derniers moments, Ricardo Montserrat était retourné au Chili depuis trois ans. Il avait 66 ans.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 18, 2020 5:55 PM
|
Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte dans Affaires culturelles, sur France Culture - 13 octobre 2020 Sur les planches du Théâtre Marigny dans la pièce "Du Côté de Guermantes", Florence Viala se confie au micro d’Arnaud Laporte sur son métier de comédienne, de son processus de création à ses imaginaires. Ecouter l'émission en ligne (55 mn) Le salon mondain de Guermantes s’invite du côté du Théâtre Marigny. Sur la scène, occupée par la Comédie Française, le réalisateur et metteur en scène Christophe Honoré s’attelle au deuxième opus de "La Recherche du temps perdu" de Marcel Proust : "Du côté de Guermantes". Dans un décor belle époque où les liens se sont et se défont et où les conversations vont bon train, on retrouve la comédienne Florence Viala, cinq-cents troisième sociétaire de la Comédie Française, sous les traits de la Princesse de Parme. Vers la Comédie Française Le théâtre est d’abord une affaire familiale. Après avoir suivi les tournées de son père comédien, Florence Viala en fait une affaire personnelle et prend pour ce faire des cours de théâtre au Centre Dramatique National de Bourgogne à Dijon. Elle y découvre la méthode Lecoq qui l’a durablement marqué. D'un seul coup, j'avais la possibilité de parler, de ressentir mais sans que ce soit mes mots à moi. A l'époque, c'était simple. C'était l'école Lecoq donc on travaillait beaucoup sur les animaux, sur les personnages, sur le clown. J'étais un petit peu cachée, mais ça me permettait de faire des choses extravagantes, moi qui étais une petite fille très sage. Roger Planchon, en quête d’une Amélie pour la pièce de Feydeau, la remarque alors qu’elle est au Conservatoire de Paris et l’engage sur le projet de la Comédie Française. Occupe toi d’amélie la propulse, elle rejoint officiellement la Comédie française en 1994 et devient sociétaire en 2000. Là-bas, elle fait des rencontres déterminantes et collabore avec des artistes tels que Jean Paul Roussillon, Thierry Hancisse, Robert Wilson, Alain Françon, Lukas Helmeb, Anatoli Vassilliev et Lilo Baur plus récemment. On a toujours un moment où on veut partir. Ça arrive pratiquement à tout le monde. Au bout de dix ans, on en a marre. On se sent piégé et coincé. Et puis, il suffit d'un spectacle qu'on vous propose et ça redémarre. Les planches comme terrain de jeu Florence Viala rejouera maintes fois dans des pièces de Feydeau qu'elle affectionne particulièrement. Elle interprète notamment Lucienne dans Le Dindon monté par Lukas Hemleb (2003), Lucette dans Un fil à la patte de Jérôme Deschamps (2011), ou encore Marcelle dans L’Hotel libre échange d’Isabelle Nanty (2017). Elle a également animé un atelier sur le dramaturge pour les élèves des cours Florent à propos duquel elle nous en dis plus ... Lesjeunes en général ont une image de Feydeau très vieillotte, pas du tout contemporaine, une image passée d'un théâtre pas très intéressant et puis d'un petit ronron, d'une voix qu'on prend, et qu'on réutilise. Je leur dis que non, ce sont de vraies personnes. Commencez par ce qu'il y a écrit, par la ponctuation. Il faut travailler le texte comme n'importe quel texte. Et puis ensuite, on est sur la situation: Qu'est ce qui se passe? Quel est le rapport? N'allez pas dans une musique. Maintenant, une fois que vous avez trouvé la base juste, vous montez tous les curseurs. Et ça y est, Feydeau arrive, mais il faut partir quelque chose d'une situation véritable et de personnes véritables. Entre toutes ses autres pièces, qui sont nombreuses, on a notamment pu la remarquer dans le personnage de Flaminia dans La double inconstance de Marivaux (2015), dans le rôle de Mirandolina dans La Locandiera (2018), ou encore en nounou meurtrière dans Chanson douce adapté par Pauline Bayle (2019). En plus de la reconnaissance du public, Florence Viala a été nommée trois fois aux Molières. Elle s’illustre également devant la caméra, pour la télévision comme le cinéma. Je suis fascinée par la machine humaine. Son actualité : « Le côté de Guermantes » d'après Marcel Proust. Adaptation et mise en scène Christophe Honoré. Nouvelle production, au Théâtre Marigny à Paris du 30 septembre au 15 novembre. Avec Claude Mathieu, Anne Kessler, Éric Génovèse, Florence Viala, Elsa Lepoivre, Julie Sicard, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian, Gilles David, Stéphane Varupenne, Sébastien Pouderoux, Laurent Lafitte, Rebecca Marder, Dominique Blanc, Yoann Gasiorowski. Sons diffusés pendant l'émission : - Jacques Lecoq évoque l’ouverture de son école, au micro de François Billetdoux, sur France Culture, le 6 novembre 1966.
- Entretien de Florence Viala par Catherine Ceylac dans le JT de France 2, le 11 septembre 1994.
- Roger Planchon au micro de Ludovic Dunod dans "Pièces détachées", sur France Inter le 25 décembre 1994.
- Valérie Dréville au micro d'Arnaud Laporte dans l'émission "Tout Arrive", sur France Culture le 23 avril 2007.
- Extrait du film “César et Rosalie” de Claude Sautet, 1972.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 17, 2020 7:12 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan le 17/10/2020 Au Studio-théâtre de la Comédie-Française, le Sociétaire Christian Gonon fait vibrer les mots, on ne peut plus actuels, de Jack Ralite, pour qui le théâtre était « le bêchage incessant du terrain humain ». Cher Jack Ralite, On s’apprête à fêter, le 12 novembre prochain, le troisième anniversaire de ta disparition. Enfin « fêter », le verbe est bien mal choisi car le temps, ces jours-ci, n’est plus à la fête. Et puis « disparition » le mot est lui aussi mal choisi, car te revoilà. En pleine forme, incisif et persuasif, combattant. Ta parole sonne sur la scène enfouie du Théâtre studio de la Comédie-Française et cela fait du bien aux guibolles et aux neurones. On sort de là rasséréné. Tu as beau être mort, la parole est plus vivante, plus actuelle, que jamais. L’acteur Christian Gonon, Sociétaire de la Maison de Molière, donne à entendre un livre, La Pensée, la Poésie et le Politique, un dialogue entre toi et Karelle Ménine. Et pas seulement. C'est tout ton être qui vibre sur la scène accompagné par les grondements du métro au-dessus de nous êtes semble-t-il,, comme si le Studio-théâtre s'apparentait à une cache retrouvée de la Résistance. Ce PPP du titre résume ta vie, même si trois autres lettres, PCF ont joué un rôle crucial dans ton parcours puisque tu a adhéré « au Parti » en 1947 (tu avais 20 ans), sans jamais en démissionner. J’aurai aimé parler de cela avec toi, moi « le fils d’un exclu du Parti », mais je n’ai jamais osé, même ce jour où je t’ai vu pour la dernière fois en tête à tête, dans un petit restaurant qui t’était cher, près de la mairie d’Aubervilliers, ville dont tu avais été maire (de 1984 à 2003), ville que tu as marqué à jamais. Ce jour là, comme les autres jours, tu avais trop le souci de parler du présent, du théâtre, de citer Octavio Paz et de pester contre les frilosités du ministère de la culture, pour revenir sur ta vie, sur l’évolution du Parti. Et Christian Gonon procède de la sorte : il parle de toi au présent. Il ne raconte pas ta vie mais tes actes de paroles qui sont des actes d’amour et de foi en l’être humain à commencer par les poètes et les artistes. Tu attaques tout de suite, dans le vif. Le ministère de la culture ? Il a « renoncé à être le grand intercesseur entre les artistes et les citoyens. Il répond de moins en moins quand on sonne à sa porte, occupé qu’il est, en duo avec l’Élysée, à nommer, dénommer, renommer, dans tous les domaines. Il a perdu son pouvoir d’illuminer. » Combien de fois tes mots nous ont illuminés! Je me souviens de ces moments au Verger Urbain V (lieu magique devenu un anodin lieu de passage) où tes interventions galvanisaient les festivaliers avignonnais. Et chacun repartait vaillant, avec, dans l’oreille et sur les lèvres, des mots de René Char ou Saint John Perse donnés en partage. Jusqu’au bout – les derniers temps avec une canne - tu auras été un spectateur avide, curieux. La plupart des hommes politiques viennent au théâtre pour se faire voir, toi tu venais voir des aventures artistiques et tu ne manquais pas ensuite, sans micros et sans caméras, d’aller discuter dans les loges avec les artistes. Tu n’étais pas un communicant mais un militant, un allié, un partisan. Christian Gonon, en se glissant dans tes mots, nous rappelle ta passion pour Robespierre, pour Victor Hugo et d’abord pour un poète que tu as côtoyé, Aragon. Mais aussi Baudelaire, Prévert, Gracq et tant d’autres. Ou tes complicités avec « les deux V du théâtre français », Jean Vilar et Antoine Vitez, que tu as rassemblées dans un autre livre (Complicités avec Jean Vilar, Antoine Vitez, éditions Tirésias ). Tu n’auras jamais été Ministre de la culture en titre mais tu le fus en actes, au quotidien, à travers l’aventure des États généraux de la culture , au fil de tes discours et de tes lettres, de tes interventions au Sénat et ailleurs. Tu fus vent debout contre un Président de la République, Nicolas Sarkozy – tu le traites de «décivilisateur » - qui voulait faire des artistes des employés qui répondent à la demande et non des « inventeurs d’avenir ». Tout au long de la soirée (belle idée de Gonon), tu commences une lettre aux différents Présidents de la République qui se sont succédé et finalement tu t’adresses au dernier, celui qui était en poste lorsque ta parole s’est tue, et qui est toujours aux affaires. Tandis qu’ils défilent sur un écran et que Gonon les dit, tes mots vivent et vibrent comme si tu les avais griffonnés à l’instant, en ces jours sombres où les théâtres et les lieux de culture sont malmenés,. Crise ou Covid, même blabla : « On a l’impression que beaucoup d’hommes et de femmes des métiers artistiques sont traités comme s’ils étaient en trop dans la société. On nous répond "C’est la crise". La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n’est pas un luxe, dont en période de disette il faudrait se débarrasser, la culture c’est l’avenir, le redressement, l’instrument de l’émancipation. C’est aussi le meilleur antidote à tous les racismes, antisémitismes, communautarismes et autres pensées régressives sur l’ homme. Mais la politique actuelle est marquée par l’idée de "donner au capital humain un traitement économique". Il y a une exacerbation d’une allégeance dévorante à l’argent. Elle CHIFFRE obsessionnellement, COMPTE autoritairement, alors que les artistes et écrivains DÉCHIFFRENT et CONTENT. Ne tolérons plus que l’esprit des affaires l’emporte sur les affaires de l’esprit . » Studio-théâtre de la Comédie-Française, 18:30 (durée 1h10) jusqu’au 31 octobre. Le livre La pensée, la Poésie et le Politique (dialogue avec Jack Ralite) de Karelle Ménine et Jack Ralite est publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs. Légende photo : Scène de "La Pensée, la Poésie, la Politique (dialogue avec Jack Ralite)" © Christophe Raynaud de Lage, coll. CF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 16, 2020 4:41 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 15 oct. 2020 Dans « L’Aventure invisible », l’artiste suédois met en présence trois êtres qui vivent autrement que les communs des mortels : le premier avec le visage d’un autre, la seconde sans mémoire et sans passé propres, la-le troisième, ni homo ni trans, dans un entre-deux, à la fois homme et femme. « Je est un autre », disait, vivait et prophétisait Arthur Rimbaud. Je n’est pas seulement un autre mais plusieurs autres, nous raconte L’Aventure invisible, nouvelle aventure du metteur en scène suédois Marcus Lindeen. C'est déjà ce que racontait, à sa manière, sa précédente mise en scène Wild Minds autour des troubles de la rêverie compulsive d’êtres qui, une partie de leur vie, vivent dans des rêves éveillés, côtoient des alter ego qui n’existent pas mais dont ils façonnent la vie imaginaire. L’Aventure invisible retrouve le dispositif de Wild Minds (version française créée en 2017 au CDN de Caen dans le cadre du festival Les Boréales, reprise brièvement au Théâtre de Gennevilliers) : le public (restreint) est assis sur quelques gradins circulaires. Au premier rang de ce lieu clos sur lui-même, les performeurs parlent, se parlent, se regardent et par trois fois échangeront leurs places. Chacun des trois est muni d’oreillettes qui balancent le texte enregistré d’un témoignage ou du texte mis au point par Marcus Lindeen et la collaboratrice et traductrice Marianne Ségol-Samoy. Le texte est dit, via la reprise de cette écoute, dans un débit calme, jamais ostentatoire, donnant une étrange impression de présence à la fois intense et flottante. Ancien journaliste, Marcus Lindeen aime les faits, les expériences humaines singulières, et aime les raconter (voir son film The Raft sorti en 2019). Devenu metteur en scène, il aime le montage, le dialogue et donc aime que ces histoires se croisent, se répondent, s’interrogent mutuellement. Et cela, non avec les personnes qui en sont le sujet, mais avec des acteurs professionnels ou pas, des performeurs qui en tiennent lieu. Rien donc à voir avec le théâtre documentaire et ses tranches de vie à pleurer. Aidé par l’intelligence du dispositif en gradins circulaires où performeurs et spectateurs partagent le même espace, Marcus Lindeen ne cherche pas à nous émouvoir mais à nous entraîner dans ses explorations, à nous faire partager ses fascinations pour ces cas où l’individu vacille, et le questionnement identitaire qui s’ensuit. Il y parvient, degré après degré, et, de fait, c’est fascinant. C. (Jérôme) a quarante-cinq ans. Mais son visage, hormis ses yeux, est celui de son donneur, un homme de vingt ans. Avant sa maladie, son visage était celui d’un « monstre », nous dit-il, et c’est ainsi qu’on le regardait. Aujourd’hui, avec son nouveau visage, il passe inaperçu ; « personne ne me remarque », « je suis devenu invisible ». Avant d’en arriver là et d’en parler avec un certain apaisement, ce fut un long combat. Ce Français est le premier homme au monde à avoir reçu deux greffes totales du visage (la première a été suivie d’un rejet, il a frôlé la mort ; la seconde tient), un exploit du chirurgien plastique Laurent Lantiéri. Mais comment vit-on avec le visage d’un autre ? D’un autre bien plus jeune ? A. raconte un cauchemar où son visage est celui d’un mort, il dit se sentir aujourd’hui comme un « être flottant ». Le chirurgien, lui, se souvient qu’après le dernier geste de l’opération déclenchant la circulation du sang, il a eu l’impression de « regarder un mort revenir à la vie ». B. (Jill) était une neuroanatomiste, autrement dit : elle étudiait « le cerveau des personnes mortes ». Et puis un jour, en 2002, à 37 ans, elle a été victime d’un AVC. Toute la partie gauche de son cerveau (centre de la logique, du langage et du temps) a été bousillée, elle s’est trouvée sans mémoire, sans passé, donc sans souvenirs et sans identité. « Celle qui était en moi est morte », dit celle qui, aujourd’hui, en partie grâce à sa mère, a pu s’en sortir. « La langue est revenue directement pas les souvenirs. » A. est liée à ce qui est, en partie, à l’origine du projet : l’artiste surréaliste Claude Cahun dont Marcus Lindeen trouve les photographies « fascinantes, très queer et mystérieuses ». Le titre L’Aventure invisible vient de l’un de ses écrits. A. est une artiste qui comme Claude Cahun n’était pas à l’aise avec son seul sexe. Elle était femme, elle s’est fait retirer la poitrine mais ne veut pas « devenir homme pour autant ». Claude (prénom qui vaut pour les deux sexes) Cahun était née Lucy Schwov, et la personne qui partageait sa vie, de Suzanne est devenue Marcel. Avec Marcel ou seule, Claude a réalisé des tas de photos durant leur vie commune qui s’est achevée sur l’île de Jersey. Des photos, des autoportraits de Claude en particulier, jamais exposées du vivant de l’artiste et retrouvées miraculeusement. Elles ont vite suscité un grand intérêt, jusqu’à une exposition au Jeu de Paume en 2011 accompagnée d’un catalogue coédité chez Hazan. A. n’a pas voulu s’identifier à Claude mais la retrouver : « Je la fais revivre à travers ma pratique. Et alors son esprit revient et elle existe à nouveau. » Le résultat (la mise en scène réitérée des photos) comptant moins que « le processus ». A. nous montre cette photo où les yeux de Claude sont obstrués par des capuchons d’objectifs photographiques et se souvient de ses mots qu’elle s’approprie : « s’aveugler pour mieux voir ». Les trois performeurs sont impeccables. C. est interprété par Tom Menanteau, un jeune comédien, élève du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. B. par Claron McFadden, une chanteuse américaine soprano. A. par Franky Gogo, chanteuse de rock et batteuse (pour Bertrand Belin et beaucoup d’autres), elle était en concert à la Boule Noire ce 14 octobre. Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d’automne, jeu et ven 19h et 21h, sam et dim 16h et 18h, jusqu’au 17 octobre. Du 3 au 6 nov à Caen dans le cadre des Boréales.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 15, 2020 6:15 PM
|
Par Didier Péron , Gilles Renault , Guillaume Tion , Ève Beauvallet et Sandra Onana — Libération 15 octobre 2020 à 20:21
L’annonce de Macron a été un coup dur pour les théâtres, cinés et autres lieux de spectacles, qui font leurs principaux bénéfices en soirée. Certains vont tenter de s’adapter, encore, d’autres vont être contraints de fermer s’ils n’ont pas de dérogation.
L’annonce du couvre-feu crée un nouveau vent de panique dans le monde de la culture, qui tentait péniblement de se reconstruire après l’arrêt brutal de toutes ses activités pendant le confinement, avec la fermeture unilatérale des salles, l’annulation à la pelle des festivals, des salons, le détricotage vertigineux de tout un écosystème professionnel étroitement lié à la vitalité sociale du pays. Tout le monde à la maison à 9 heures du soir, une soupe et au lit, c’est évidemment décréter que les spectacles de théâtre, de danse, de stand-up, les concerts et les deux séances de cinéma de la soirée n’ont plus lieu d’être, quand bien même aucun cluster n’a été identifié dans les structures culturelles. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a évoqué «la terrible épreuve» endurée par la profession. Elle consultait jeudi les représentants syndicaux du spectacle vivant et du cinéma afin de discuter des «mesures indispensables» à prendre pour traverser cette nouvelle période de black-out, dont de nouvelles compensations financières de soutien. La réunion en visioconférence avec des interlocuteurs aux problématiques très diverses semble avoir été quelque peu cacophonique. Parmi les revendications exprimées, faire en sorte que le chômage partiel, pensé jusqu’au 31 décembre, puisse s’étendre à 2021, et que l’argent du fonds de solidarité arrive le plus vite possible, pour qu’il soit versé aux entreprises qui en ont le plus besoin. «Qui va vouloir sortir un film ?» La Fédération nationale des cinémas français, qui représente la quasi-totalité des 6 000 salles du territoire, a publié jeudi un communiqué vindicatif contre «une décision aux conséquences extrêmement graves pour la filière» : «Avec une fréquentation déjà réduite de 50 % à 70 % depuis de nombreux mois, les cinémas vont devoir se passer de ces séances qui représentent plus de la moitié de leur public.» Didier Tarizzo, exploitant du multiplexe des Trois Palmes ainsi que du Bonneveine, en périphérie de Marseille, confirme ce sentiment de coup de grâce : «Il faut comprendre que c’est une catastrophe pour l’ensemble des cinémas, même ceux qui se trouvent dans les villes non touchées par le couvre-feu. Qui va vouloir sortir un film sur le marché des six prochaines semaines ? Personne. Je pense et crains que d’ici à la fin des vacances scolaires, les salles doivent fermer de nouveau. Cette mesure signe notre mort.» Première à retirer son produit de la vitrine, la boîte indépendante ARP, qui a annoncé le report de la sortie du Peninsula de Sang-ho Yeon (Dernier train pour Busan) qui devait être distribué sur 500 copies mercredi prochain. «La décision du 21 heures est incompréhensible, s’énerve Michèle Halberstadt, copatronne d’ARP, il fallait sauver la séance de 20 heures au moins pour que ça ait un sens économiquement de continuer.» Distributrice de Drunk, sorti cette semaine, Carol Scotta veut croire encore que les négociations autour du maintien de cette séance du soir (celle qui réalise le plus d’entrées en semaine) peuvent aboutir, car elles sont le nerf de la guerre : «On ne peut pas s’amuser à décaler les films tous les quinze jours. Il faut trouver des méthodes durables, soutenables pour la profession et souhaitables pour les gens, qui vont devenir fous.» Le Premier ministre, Jean Castex, alerté sur la question dérogatoire, a laissé la porte entrouverte lors de sa conférence de presse. Que 21 heures soit un horaire de sortie de cinéma ou de spectacle avec billet électronique faisant foi pourrait calmer les angoisses générales. «Jouer quatre fois le week-end» Côté théâtre, la sidération passée après l’annonce de mercredi soir, les responsables de salles n’ont eu d’autres choix que d’envisager dans la panique une parade viable alors même que l’essentiel de leur activité est calé sur le début de soirée et la sortie de bureau. Le mot d’ordre est quand même de ne pas diffuser trop de déprime pour ne pas décourager le public le plus motivé. Ainsi, le Festival d’automne, mini-saison de théâtre, danse et musique francilienne qui compte 28 spectacles dans 25 lieux d’Ile-de-France pour un total de 120 représentations prévues sur les six semaines de couvre-feu, doit réviser une bonne partie de sa programmation. Emmanuel Demarcy-Mota, son directeur, également à la tête du Théâtre de la Ville, veut rester positif et agile face à la crise : «Personne ne viendrait par exemple sur des représentations le matin ? interroge-t-il. Et pourquoi pas les 65 ans et plus [on enregistre une perte de 45 % de ce public, ndlr] ? Et pourquoi pas les scolaires, si les chefs d’établissements et le ministère de l’Education acceptent de dialoguer avec nous sur ce point ?» Il a passé une nuit quasi blanche faite de réunions par visioconférence avec ses 41 partenaires franciliens. Et a eu aussi une discussion collective avec d’autres directeurs de salles franciliennes et la mairie de Paris pour accorder les violons : tentons d’avancer les représentations à 18 h 30, de multiplier les représentations le week-end en accord avec les syndicats, investissons ce désert de Gobi théâtral qu’est la période des vacances de la Toussaint (où la quasi-totalité des théâtres ferment). Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaires de plusieurs salles privées parisiennes, proche de Macron, était le soir même de l’annonce remonté à bloc : «On va se battre. On n’a pas le choix. Mon énergie est décuplée. On programmera des pièces à 19 heures, on va jouer quatre fois le week-end. Il va y avoir des embouteillages, c’est sûr, mais il est hors de question que la flamme s’éteigne.» Francesca Poloniato, directrice de la scène nationale le ZEF à Marseille, cherche, elle, des solutions à son échelle mais avoue sa lassitude : «On essaie de décaler les spectacles, mais j’en ai marre de construire et de redéconstruire. Ne pas pouvoir se projeter sur une saison, c’est dur psychologiquement.» Tourneur et producteur de spectacles (à la tête de la société Astérios et des salles parisiennes des Bouffes du Nord, de la Maroquinerie et de l’Athénée), Olivier Poubelle, s’il veut lui aussi rester «combatif», ne cache pas lui aussi un vrai début d’épuisement : «Chacun essaie de sauver des miettes, mais tout cela ne raconte plus rien de ce qu’est notre métier et de la place qu’occupent la musique et les spectacles dans la vie des gens. Je ne jette la pierre à personne face à ce problème sanitaire qui nous dépasse. Mais j’insiste aussi sur le fait que je déplore avant tout le préjudice psychologique, plus que financier. C’est quand même la quatrième fois qu’on se dit "demain, on rase gratis" et là, on commence à comprendre que les festivals de l’été 2021 sont déjà fragilisés. Que devient notre histoire ? Notre projet ? On perd pied…» «Chance inouïe» Le directeur du théâtre privé parisien la Scala, Frédéric Biessy, veut tempérer l’impression de ruine et rappelle la «chance inouïe» du secteur culturel français en regard de la situation anglo-saxonne, entre autres. «J’ai des amis directeurs de salle à New York et à Londres qui ont dû mettre la clé sous la porte. En France, je ne connais pas un seul théâtre privé qui ait dû fermer». De son côté, Frédérique Magal, directrice de Point Ephémère à Paris, à la fois salle de concert, club, bar-resto et lieu d’exposition, se dit paradoxalement soulagée d’une mesure qui met un terme à une situation qu’elle jugeait de plus en plus intenable : «Depuis le début de la crise, notre lieu n’a jamais pu fonctionner normalement. Et la salle va encore rester inactive pendant six mois, un an, voire plus. Aussi l’annonce n’est-elle pas un coup de massue, juste le nouvel épisode en date d’une situation désastreuse qui nous oblige à questionner le rôle, la vocation et l’agencement d’un lieu culturel, festif. Nous avons essayé ces derniers temps d’exister, vaille que vaille, mais sur un modèle extrêmement altéré, dégradé.» Président du Prodiss, syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété, Olivier Darbois jette sur la séquence un regard où se mêle «un sentiment de déception, de tristesse et de colère» : «Des petits pas ont été effectués depuis la rentrée, insuffisants pour que le domaine du spectacle vivant parvienne à redresser la barre, mais synonymes d’espoir, et nous voilà à nouveau scalpés. Les décisions sont-elles fondées pour lutter efficacement contre le Covid ? Je n’en sais rien, ça n’est pas mon métier d’y répondre. Ce que j’affirme en revanche, c’est qu’il nous faut une aide à la hauteur du sacrifice. Roselyne Bachelot est à l’écoute, comme l’Etat dans son ensemble. Elle a été jusqu’à présent pertinente et réactive. Maintenant, une fois admise la nécessité absolue d’une aide prolongée, il nous faudra des actions très concrètes et significatives.» Didier Péron , Gilles Renault , Guillaume Tion , Ève Beauvallet , Sandra Onana Légende photo : A Paris, le 30 mars. Photo Frédéric Stucin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 15, 2020 8:40 AM
|
par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 15/10/2020 Comme un coup de tonnerre, l’annonce de l'instauration d'un couvre-feu dans toute l'Ile-de-France ainsi que dans huit métropoles par Emmanuel Macron, le 14 octobre, met à nouveau un coup d’arrêt au spectacle vivant. Premières réactions. Comme un coup de tonnerre, l’annonce de l'instauration d'un couvre-feu dans toute l'Ile-de-France ainsi que dans huit métropoles par Emmanuel Macron, le 14 octobre, met à nouveau un coup d’arrêt au spectacle vivant. Premières réactions. “Une injustice folle”, pour Jean-Christophe Meurisse des Chiens de Navarre, “la super claque” pour l’acteur Samuel Churin, membre de la coordination des intermittents et des précaires. Le couvre-feu de 21h à 6h décrété mercredi 14 octobre par le Président Macron dans toute l'Ile-de-France mais aussi dans huit métropoles (Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne), met à mal un secteur qui se relève à peine du long confinement vécu pendant un semestre. Et se révèle incompréhensible puisque le ministère de la Culture l’assure haut et fort : aucun cluster n’a été découvert dans les théâtres depuis la rentrée. Et pour cause, comme pour les restaurants, les gens sont prévenus des cas contacts quand il y en a. Ce qui est loin d’être le cas quand on s’entasse dans le métro, le RER ou le train. Dans le communiqué envoyé ce 15 octobre au matin par le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot le réaffirme : “Je tiens par ailleurs à saluer l’engagement et la responsabilité des professionnels pour assurer la sécurité du public dans les salles de spectacles et de cinéma, grâce à des protocoles sanitaires stricts, scrupuleusement respectés par les spectateurs.” Si bien qu’on se demande quels vont bien pouvoir être “les dispositifs d’accompagnement indispensables aux secteurs du spectacle vivant et du cinéma, particulièrement affectés par le couvre-feu” sur lesquels elle va travailler avec les organisations représentatives dès ce jeudi 15 octobre. Le choix de cibler certains secteurs économiques pour en préserver d’autres relève de la responsabilité du gouvernement. Mais devra-t-il en rendre compte ? “Je suis estomaqué car il faudra quand même qu’on nous prouve, preuves scientifiques à l’appui, que des clusters se créent au théâtre, assène Jean-Christophe Meurisse. Ce couvre-feu n’a aucune légitimité. On ne nous demande que de bosser ? Alors, résistons, allons bosser le matin puis quittons le travail à 16 h pour aller au cinéma ou au restaurant puis au théâtre.” “C’est une situation kafkaïenne” L’exception française reste de mise, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi décider d’un couvre-feu à 21 h plutôt qu’à 23 h, comme en Allemagne ? “Je n’en peux plus de cette politique réactive, ne décolère pas Samuel Churin. Ce qui est sûr, c’est que pour blesser très fortement, voire mortellement, le spectacle vivant, il n’y a pas mieux. L’Allemagne, la Suède ou la Suisse procèdent autrement. J’ai joué récemment en Suisse et ils sont atterrés de la façon dont le Covid est géré en France. Diriger, c’est prévoir et cette deuxième vague était attendue. Je suis en lien avec le collectif Inter-Urgences, qui réunit des aides-soignant·es, des infirmier·es et des médecins et ils sont en rage. Lorsque Roselyne Bachelot était ministre de la santé, elle a privatisé l’hôpital et depuis, le nombre de lits ne cesse de baisser, les soignants travaillent à flux tendu. C’est cette ligne rouge du nombre maximum de patients qu’on peut accueillir qui provoque le couvre-feu. Le collectif pensait qu’Olivier Véran allait multiplier par deux le nombre de lits possibles en prévision de la deuxième vague de Covid. Rien n’a été fait. C’est une situation kafkaïenne.” Si ce couvre-feu qui s’attaque à la vie culturelle et sociale de plusieurs villes du pays a tout l'air d’un cautère sur une jambe de bois, plusieurs théâtres réagissent au quart de tour. “Avec le directeur des Bouffes du Nord, à Paris, on a décidé hier soir d’avancer les représentations de notre performance, La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ?, qui doit commencer le 16 octobre à 19h au lieu de 20h30”, annonce Jean-Christophe Meurisse. Le spectacle durant une heure, le public pourra le voir et rentrer à temps chez lui. Le site des Bouffes du Nord alerte dès ce jeudi de ce changement d’horaire. Au théâtre de la Colline (Paris) aussi, où se joue Mes Frères de Pascal Rambert mis en scène par Arthur Nauzyciel jusqu’à la fin de la semaine prochaine, la décision d’avancer la représentation à 17h est en train de s’organiser. “On a appris la nouvelle juste avant de jouer hier soir, c’est tellement triste, nous dit Arthur Nauzyciel. Les représentations sont un peu étranges, on est à la fois sur le plateau et un peu ailleurs, absorbés par nos interrogations sur ce qu’on va vivre les jours prochains. C’est quand même incroyable que ça ne pose pas de problème de forcer les gens à travailler la journée et de nous enlever tout ce qui nous permet de nous échapper, la culture, le fait de retrouver ses amis. Surtout, ce n’est pas lisible pour nous puisque les théâtres sont les lieux les plus sûrs. On joue déjà devant des demi-jauges ! On nous met à genoux mais on ne lâchera rien. On veut jouer, coûte que coûte, et soutenir tous ceux qui font en sorte que le spectacle reste vivant.” Contacté mercredi 14 octobre au soir, Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du festival d’Automne (avec 50 spectacles programmés) à Paris et du théâtre de la Ville s’apprête à discuter avec les “40 lieux partenaires en Ile-de-France pour discuter de la circulation des publics en soutien avec l’éducation et la santé comme priorité. Pour le théâtre de la Ville, nous sommes à peu près calés avec des représentations à 18h-18h30 qui se terminent à 20h. Evidemment, décaler le couvre-feu à 22h aurait facilité les choses. Comme beaucoup de directeurs de théâtre me téléphonent depuis l’annonce de Macron en demandant des dérogations, je vais préparer une réunion avec tous ceux qui le souhaitent pour échanger et faire des propositions concrètes pour faire un texte commun.” A suivre… Légende photo : “La Peste c'est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ?" de Jean-Christophe Meurisse (Philippe Lebruman)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 14, 2020 7:23 PM
|
Par Françoise Dargent, Léna Lutaud, Thierry Hillériteau et Nathalie Simon dans Le Figaro - 14/10/2020 Producteurs, patrons de cinéma ou de théâtre. Tous dénoncent cette décision sanitaire prévue pour quatre semaines, criant même au scandale ou à l'injustice. D'autant plus qu'ils disent avoir respecté scrupuleusement le protocole sanitaire et assuré la sécurité des spectateurs. Sans attendre la réunion qui sera organisée demain au ministère de la Culture demain par Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la création artistique, la plupart des directeurs de théâtre affichaient hier soir leur abattement. Pour Jean-Marc Dumontet, la mesure de couvre-feu est injuste pour les théâtres. « Je l'ai annoncé à 300 spectateurs venus voir l'humoriste Florent Peyre que je viens de faire entrer en scène», s'insurge Loïc Bonnet directeur d'un théâtre à Rouen et président de l'association des Théâtres Privés en Régions. On a depuis le début respecté le protocole sanitaire, on a toujours respecté à la lettre ce que le gouvernement a demandé, je ne comprends pas ce qu'il veut. Des directeurs de théâtres vont péter les plombs. Qu'allons-nous faire, nous sommes aidés seulement jusqu'à fin mai. Macron est en train de tuer les salles de spectacle. » En temps normal, une pièce débute à 20h30 ou 21 heures. L'une des solutions sera d'avancer l'horaire des représentations. Loïc Bonnet table sur 19 heures. Au théâtre Hébertot où certaines représentations commencent à 19h, Francis Lombrail, le directeur s'interroge : « C'est un drame, on essaiera de les programmer à 18h30, mais ça va décourager le public. Déjà avec la jauge covid qui permet d'accueillir 340 personnes au lieu de 626 ! Ce qui nous tue, ce sont les loyers très élevés voire prohibitifs. Au Théâtre Hébertot, le loyer est de 200.000 euros par mois. On est obligé de proposer des places à des prix modiques. Si l'État ne nous aide pas et ne prévoit pas une loi sur les loyers on ne peut pas tenir. » « Il n'y a pas un seul cluster dans les théâtres, on s'est démené pour respecter des protocoles sanitaires, on n'est pas récompensé (...). Gouverner c'est prévoir ! Là, on court à la catastrophe. » » Bertrand Thamin, président du Syndicat National des Théâtres Privés Même constat amer chez Bertrand Thamin, président du Syndicat National des Théâtres Privés : « Il n'y a pas un seul cluster dans les théâtres, on s'est démené pour respecter des protocoles sanitaires, on n'est pas récompensé. On nous a demandé de rouvrir, on a fait des dépenses de productions et de publicités et moins d'un mois après, ils referment de nouveau les salles. Gouverner c'est prévoir ! Là, on court à la catastrophe.» Dès la fin l'allocution présidentielle, ces professionnels se mettaient pourtant en ordre de bataille. « La Philharmonie de Paris maintiendra ses activités les six prochaines semaines, annonce son directeur Laurent Bayle au Figaro. Nous allons étudier la possibilité d'avancer tous les concerts que nous pourrons à 19 heures au lieu de 20h30, avec pour ambition que les spectateurs soient sortis à 20h20 ou 20h30 au plus tard, ou bien de les déplacer sur le week-end lorsque cela sera possible. Nous sommes conscients que ce ne sera pas confortable pour le public, mais l'hypothèse de faire venir le public à 18h30 ne me paraît pas réaliste », dit-il. Mêmes mesures à l'auditorium de Radio France, qui va retravailler sa programmation dès demain pour avancer les concerts à 19 heures et faire en sorte que le public soit sorti à 20h15. Se pose toutefois la question du Ring de Wagner, le cycle fleuve d'opéra qui devait être en donné en concert à l'Opera de Paris du 23 au 29 novembre, et repris à Radio France le 30 novembre. « Nous allons étudier dès demain les possibilités pour maintenir ce cycle, qui devait être un symbole fort de la reprise du lyrique dans la capitale », explique Michel Orier, directeur de la musique à Radio France. « Il faut repartir au charbon pour parler de 2021 car il n'y aura pas de reprises des spectacles avant le premier trimestre 2021 et sans doute même l'été 2021... » Olivier Darbois, producteur de concerts chez Corida et président du syndicat du Prodiss À l'arrêt depuis le mois de mars, les responsables de grosses salles ont réagi aux aussi à ces annonces qui affectent désormais même les salles de moins de 1000 places. «Pour toutes les autres salles moyenne, grandes, géantes et les spectacles qui vont avec, cela ne va rien changer puisque nous sommes à l'arrêt total depuis mars , rappelle Olivier Darbois, producteur de concerts chez Corida et président du syndicat du Prodiss. Contrairement aux restaurants qui ont fermé de façon ponctuelle et qui pourront travailler jusqu'à 21 heures, nous sommes totalement à l'arrêt depuis maintenant huit mois. Le plan de relance qui nous avait permis cet été d'obtenir 220 millions d'euros, nous avait donné un peu d'espoir mais là nous sommes de nouveau dans l'inconnu. Il faut repartir au charbon pour parler de 2021 car il n'y aura pas de reprises des spectacles avant le premier trimestre 2021 et sans doute même l'été 2021 ». Pour les cinémas également, les conséquences d'un couvre-feu dans les villes concernées s'avèrent catastrophiques. Les cinémas perdent leurs deux séances du soir. Un signal du gouvernement «très mauvais» selon eux. Jocelyn Bouyssy, dirigeant du circuit CGR, second groupe de cinémas en France se dit «abasourdi». «Si le couvre-feu avait été mis à 22 heures, nos cinémas, les théâtres et les salles de spectacle des multiplexes pouvaient continuer à recevoir du public. On avançait les films longs à 19 heures et le tour était joué. À 21h30, tout le monde était rentré puisqu'en France, les spectateurs habitent à maximum 20 minutes», estime-t-il. Avant d'ajouter : «Je suis d'autant plus fâché qu'il n'y a eu aucun foyer de contamination dans un cinéma et ce dans le monde entier. Même le président l'a reconnu : ''les cinémas sont un lieu très sûr''.» « À une heure près, les cinémas et les films étaient sauvés. La décision du gouvernement est incompréhensible. C'est un véritable scandale » Jean Labadie, producteur, patron du Pacte Le producteur Jean Labadie, patron du Pacte, ne décolère pas non plus. « La décision du gouvernement est incompréhensible. Il fusille ainsi les deux séances du soir. Je crains que les cinémas dans les grandes villes ne puissent survivre en ne travaillant que l'après-midi. Pour les films familiaux comme Trolls 2 et Calamity Jane ça ira. Mais pour les films que le public adulte va voir le soir comme Drunk de Tomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen et les films qu'on va voir entre copains pour rire ensemble comme 30 jours Max de Tarek Boudali, c'est une catastrophe. Qui va vouloir se presser d'aller au cinéma en sortant plus tôt du travail ?», peste-t-il. Et de craindre que toutes les sorties programmées soient à nouveau bousculées. « Que vont décider les producteurs et distributeurs des gros films français attendus cet automne hiver : Aline de Valérie Lemercier, de Kaamelott d'Alexandre Astier, d'Adieu les cons d'Albert Dupontel, de Mandibules de Quentin Dupieux ? Que va-t-il se passer pour ADN de Maïwenn prévu le 28 octobre ? Le milieu du cinéma va dès demain passer son temps en réunion de crise. Faut-il déplacer les sorties au premier trimestre 2021? Le virus sera peut-être encore là. À une heure près, les cinémas et les films étaient sauvés. La décision du gouvernement est incompréhensible. C'est un véritable scandale.»
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...