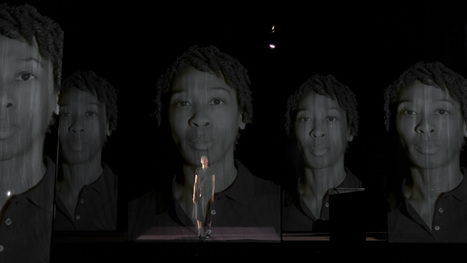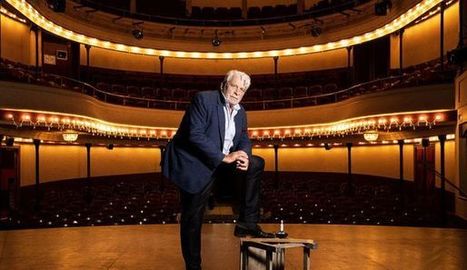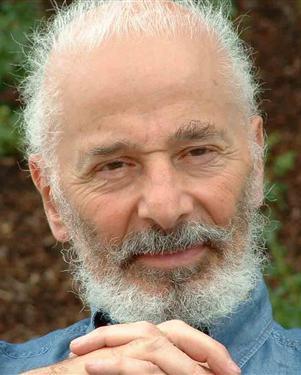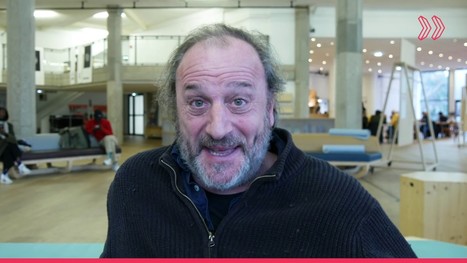Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 1, 2020 7:16 AM
|
Par Joshka Schidlow dans son blog Allegro Théâtre 01/10/2020 Séduite par la lecture de La loi de la gravité du jeune auteur dramatique québecois Olivier Sevestre, Cécile Backès en a tiré un spectacle qui émerveille. Dom et Fred ont quatorze ans et sont en proie a un tumulte intérieur dont ils parlent dès leur première rencontre.Dom est une fille qui sèche les cours qui la font, dit-elle, vomir. Son nouvel ami se remet mal de la mort de sa mère. Leur complicité leur permet de se tenir à flot et les pousse à tenter ,pour ce qui est de leurs objets de désir, d'y voir plus clair. Eprise d'une fille de son âge qui semble lui rendre la pareille, Dom nage dans le bonheur. Pour un temps. Fred, est lui, tenté d'en finir, de rejoindre sa chère disparue. Les deux jeunes tendrons vont, à l'intiative de Dom, faire un bout de route ensemble. Si on ne peut guère résister à la fraîcheur qui émane de ce spectacle c'est qu'il cerne avec une infinie délicatesse les troubles de l'identité propre à l'adolescence. Cécile Backes fait, comme à son habitude, preuve d'une impressionnante intelligence scénique. Elle a trouvé en Marion Verstraeten et Ulysse Bosshard des interprètes rêvés.Le spectacle est tout du long soutenu par la batterie d'Arnaud Biscay (en alternance avec Héloïse Divilly). Le scénographe Marc Lainé a, pour sa part, conçu un ingénieux décor dont n'a de cesse de jouer l'artisane accomplie qu'est la metteuse en scène. On ajoutera qu'avec ses tournures inusitées la verve langagière de l'auteur canadien est pur délice. Jusqu'au 10 octobre Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France tél 03 21 63 29 19 Du 17 au 20 novembre Théâtre de Sartrouville - CDN Yvelines, Du 24 au 27 novembre Comédie de Béthune, du 1er au 3 décembre Comédie de Saint-Etienne, les 17 et 18 décembre Scènes du Golfe. Théâtres Aradon-Vannes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 28, 2020 7:34 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 28/09/20 Dans « X », pièce du jeune Anglais Alistair McDowall que l’on découvre, les cinq acteurs et actrices du collectif OS’O, avec la complicité de Vanassay Khamphommala, nous entraînent sur une planète lointaine pour mieux nous parler de près.
Ils sont cinq astronautes. Deux femmes, Gilda (la capitaine, première mission) et Mattie ; trois hommes, Clark, Ray et Cole ; tous scientifiques. Ils vivent enfermés dans l’habitacle de leur base de recherches sur l’hyper lointaine planète Pluton. Ils ont quitté la terre depuis longtemps. Par leur système de communication en parfait état de marche, ils envoient des messages vers la Terre qui les reçoit. Mais ne répond pas. Un dernier message leur a dit qu’on allait venir les chercher car eux ne peuvent pas décoller. Depuis, rien. L’attente, l’interminable attente dans le huis-clos de l’habitacle sur une planète faite de cailloux et de glace. Par une grande fenêtre, ils ont vu sur la nuit : infinie.
Compagnonnages
Ils sont cinq bêtes de théâtre. Deux femmes : Roxane Brumachon (Mattie) et Bess Davies (Gilda), et trois hommes : Mathieu Ehrhard (Clark), Baptiste Girard (Ray) et Tom Linton (Cole). Anciens élèves de la première promotion de l’école de Bordeaux (l’une de nos écoles nationales), à la sortie, ils ont créé le collectif OS’O (d’après « on s’organise »). Un collectif d’acteurs qui, pour chaque spectacle, fait ou pas appel à un metteur en scène, un ou plusieurs auteurs. Avec Timon-Titus (spectacle sur la dette à partir de Shakespeare et David Graeber), ils ont gagné le Prix Impatience. Leur spectacle suivant, Pavillon noir (sur le piratage informatique, les flibustiers d’hier et du net), a été écrit par le collectif d’auteurs et d’autrices Traverse. A chaque fois, avec une présence très active du groupe des cinq.
Pour leur nouveau spectacle, X, une pièce du jeune Anglais Alistair McDowall, la mise en scène est signée collectivement. La traduction, la dramaturgie et la direction d’acteurs ont été confiées à Vanasay Khamphommala . A chaque fois, les dés sont donc lancés différemment avec comme ligne conductrice commune le jeu des cinq pour des pièces qui traversent, frontalement et de biais, le monde d’aujourd’hui. Fait rare et notoire, les spectacles cités ci-dessus ainsi que leur adaptation de L’Assommoir (leur premier spectacle) et Mon prof est un troll de Dennis Kelly (un spectacle jeune public), forment un répertoire actif, puisque tous ces spectacles continuent de se jouer.
C’est la première fois que l’on peut voir en traduction française une pièce d’Alistair McDowall, un auteur anglais qui n’en est pas à ses débuts. Sa pièce X a été montée en 2016 au Royal Court Theatre et une autre de ses pièces Pomona a connu une longue carrière jusqu’à être jouée au National Theatre de Londres. L’Arche devrait prochainement publier X et, espérons-le, d’autres pièces de cet auteur intrigant. En créant X au Quartz de Brest, le collectif OS’O achève en beauté leur compagnonnage de plusieurs années avec cette Scène nationale. Pour les prochaines années, les cinq sont collectivement artistes associés au Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine et au CentQuatre.
Le chant des oiseaux
Etonnant et troublant de voir X aujourd’hui, cette chronique des affres d’un confinement sur une autre planète, après ce que nous venons de vivre et ce qui nous menace à nouveau. Comme un miroir déformé tel qu’il en existe parfois dans les fêtes foraines et comme une loupe grossissante comme en possèdent ceux qui aiment regarder les étoiles, le huis-clos des cinq scientifiques, confinés dans ce monde extrême et paumé, exacerbe tout. A commencer par les rapports humains. Il chavire le temps, la mémoire et même l’identité. Il bouscule les certitudes, pique au vif les postures, vrille les rapports de force entre les sexes, fragilise les hiérarchies et creuse les solitudes. La nourriture, les jeux de société sont des trompe-temps de ces êtres qui ont été volontaires pour travailler « hors monde », craignent d’avoir été abandonnés et se demandent même si la vie existe encore sur terre.
Avec raison, Alistair McDowall bouscule la chronologie qui, la déliquescence du temps aidant, perd son sens. Quel temps ? Quelle durée ? On ne sait. La date du dernier contact avec la terre passe, en quelques répliques, de trois semaines à dix-huit mois. Enfin l’horloge, en principe calée sur le temps universel, comme le reste, déraille. Ils recherchent un algorithme dont X serait l’inconnu. Pour l’heure, c’est une lettre majuscule maculée de sang sur une vitre, comme un signe à la croisée des chemins
La Terre qu’ils ont laissée est un globe dévasté dont les habitants se sont regroupés sur une parcelle surpeuplée. L’Amérique du Sud a disparu de la carte, les arbres et les oiseaux aussi. La catastrophe écologique est derrière eux. Ils se souviennent avec émotion du dernier arbre qu’ils ont vu, enfants. Ils ont enregistrés les chants des oiseaux ; c’est tout ce qui leur reste. De la nature moribonde ne restent que des enregistrements. « D’abord, les arbres ont arrêté de chanter. Après, ils ont arrêté de respirer. Les couleurs sont parties. Et puis la lumière. Et puis plus rien », dit Ray disant appartenir à « la dernière génération qui a vécu parmi les vivants » et se souvient du temps où « la viande était faite avec des vrais animaux ». Ce à quoi Clark répond : « Tu me déprimes. » Mattie, elle, fait « tourner les platines » et se « nasturbe » (Le N de Nasa tenant lieu de m). De son côté, Gilda dit aimer s’asseoir et « les lumières éteintes, je regarde par la fenêtre et je, en quelque sorte, je me laisse un peu partir ». Cole est à la fois le plus pervers et le plus terre à terre – si l’on peut dire.
Cinq sur cinq
Alors on ne les quitte pas, ces êtres qui s’épaulent en se déchirant, en se contaminant les uns les autres, les souvenirs ou une réplique de l’un.e finissant par appartenir à un.e autre, le temps n’en finit pas de faire du yoyo dans une déchronologie brumeuse prompte à entraîner le spectateur dans sa spirale. On ne doit pas trop chercher à comprendre l’incompréhensible, mais on se raccroche volontiers à l’humanité forcément tourmentée des personnages, à déborder de tendresse pour ces individus à la faiblesse mise à nu, pour ce groupe qui va s’effilochant et qui, sans bouger de l’habitacle, n’en finit pas de dériver. Ils meurent l’un après l’autre (on met les corps dans le congélo), reviennent comme une bouffée du passé ou une hallucination. Cette petite fille ? Cette apparition derrière la vitre ? Qui voit ça ? Des yeux ouverts ou fermés ? Rêve ou mirage ? Le langage lui-même n’en finit pas de se décomposer.
Ni simple fable écologique, ni encore moins nouvelle relevant de la science-fiction, c’est une belle pièce qui, après coup, fait soudainement penser à La Cerisaie de Tchekhov. Le même plaidoyer pour la nature, le même enfermement, la même appétence de l’auteur pour les humains. Alistair McDowall dit que ses influences seraient plutôt à aller chercher du côté de Beckett – ce que l’on comprend : en commun, une même dépression du langage – et Sarah Kane, ce qui est moins évident.
C’est presque la fin. Gilda dit à Mattie que sa mère était « le dernier des arbres » et elle se souvient : « Les gens venaient de partout pour la voir. Pour l’écouter parler du passé.. Et tout le monde écoutait, écoutait, et pleurait, pleurait. » Et ainsi jusqu’à ce que les couleurs et les lumières s’éteignent et que ses feuilles tombent en poussière. « Alors avec son tout dernier souffle, elle m’a portée jusqu’ici. /Loin de tout ce qui restait./Elle m’a envoyé ici avec tous ses souvenirs. » Alors, la très belle musique et les sons de Martin Hennart livrent leurs derniers accords avant que les lumières envoûtantes de Jérémie Papin ne s’éteignent sur la subtile scénographie d’Hélène Jourdan. Quelle équipe !
Au Quartz de Brest jusqu’au 29 sept. Du 3 au 14 nov au TN de Bordeaux. Le 17 nov au Gallia théâtre de Saintes. Le 8 déc au Théâtre du cloître à Bellac. Le 11 déc au Théâtre de Châtillon. Du 12 au 21 janv au Centquatre. Puis en avril à Aubusson le 8, Saint-Brieuc les 13 et 14. En mai à Saint-André de Cubuzac le 4, Bruges le 6 et Toulouse, Théâtredelacité, du 25 au 29 Légende photo : Scène de "X" © Denis Lejeune

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 27, 2020 5:28 PM
|
Entretien radiophonique avec Arnaud Laporte pour France Culture diffusion le 27 septembre 2020, première diffusion le 30 juillet 2020 ÉCOUTER L'ENTRETIEN (59 MIN)
À retrouver dans l'émission
LES MASTERCLASSES par Arnaud Laporte
Avignon 2020 | Le dramaturge libanais Wajdi Mouawad nous livre ses influences, les écrits qui l'ont marqué et les résonances que trouve chez lui le théâtre antique. Dans le cadre d'un "week-end spécial Liban", sur France Culture, du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020, nous vous invitons à retrouver cette Masterclasse de Wadji Mouawad au micro d'Arnaud Laporte. Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968. Il est comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi plasticien et cinéaste. Après avoir passé une partie de son enfance et de son adolescence en France, il part pour le Canada en 1983. Il sort diplômé de l'Ecole Nationale d'Art Dramatique en 1991. Après avoir fondé différentes troupes et dirigé différents théâtres, il est nommé en 2016 directeur du Théâtre National de la Colline. Au micro d'Arnaud Laporte, Wajdi Mouawad revient sur ses inspirations, son travail mais aussi sur sa vocation, lui qui est l'un des dramaturges francophones les plus talentueux de sa génération. Il a écrit, joué et mis en scène sa première pièce de théâtre lorsqu'il avait 11 ans, peut-être un signe avant-coureur de sa vocation : Je crois à la vocation, mais pas au départ. Je crois à la vocation plus tard. Je crois à la vocation lorsqu'elle est un choix, véritablement. Je crois à la décision de la vocation. À ce moment-là, elle devient une chose vraiment puissante et immense. Wajdi Mouawad Un texte qui a déterminé quelque chose de très concret chez moi, c'est un texte de Jan Patocka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire (1975). Il pose la question : qu'est-ce qui peut solidariser deux personnes qui se tirent dessus ? C'est la solidarité des ébranlés qui les relie. Cela nous englobe tous. Wajdi Mouawad Cette phrase-là, je l'ai lue alors qu'en 1994 il y avait les massacres au Rwanda. Avec une classe de théâtre, j'étais en train de faire un spectacle. On était au Canada, que j'avais formulé comme "monstrueusement en paix", c'est à dire une paix qu'il faudrait questionner. La question était : mais que faisons nous là ? Les journaux nous disaient : 40 000 morts à la machette. On arrivait pas à comprendre. On s'est dit : ils se trompent. Wajdi Mouawad Il y a une ligne, une éthique qui se joint au geste de la création et qui devient une véritable vocation. Wajdi Mouawad Les auteurs grecs et particulièrement Sophocle ont aussi beaucoup influencé le travail de Wajdi Mouawad : Je me rends compte que Sophocle a un rapport aux hommes, au monde et à soi digne d'un humaniste. Il dit : "l'enchantement est terminé, mais on peut quand même suivre les lois de l'enchantement". Les sept tragédies de Sophocle reposent toujours sur un moment de révélation. Le héros qui est mis en place est toujours un personnage de pouvoir, que ce soit Créon, Oedipe ou Electre, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. [...] Il les amène jusqu'à un moment de démesure très grand et au moment où ils atteignent l'acmé de la démesure, il les lâche. Et là, c'est la chute. [...] Le fait qu'il ne veut pas prendre position entre les dieux et les hommes, [...] C'est peut-être quelque chose qui peut me ramener à la guerre civile libanaise et la manière dont la génération qui est la mienne l'a vécue. C'est à dire, enfant, le désir d'une réconciliation qui était impossible, qui n'arrivait pas, parce qu'on avait pas du tout les moyens de la faire. Wajdi Mouawad Masterclasse de Wajdi Mouawad par Arnaud Laporte, réalisée par Clotilde Pivin. Avec la collaboration d'Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Pour aller plus loin Rediffusion du 30.07.2019 Légende photo : Wajdi Mouawad• Crédits : Pedro Ruiz - Getty

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 27, 2020 7:19 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde 26 septembre 2020 De nombreux établissements publics offrent des événements en accès libre, afin d’aider les spectateurs à retrouver le chemin des salles, malgré la pandémie. « J’aimerais que ça dure toute l’année ! », s’emballe Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, à Paris (8e). Après six mois d’abstinence, son rendez-vous de rentrée Le Rond-Point dans le jardin, du 8 au 27 septembre, ouvre pour la première fois sa saison en plein air avec des événements gratuits rassemblant une cinquantaine de stars du spectacle vivant. Samedi 19 septembre, dès 17 heures, le public faisait la queue pour la lecture de Pierre Arditi, prévue à 18 h 30. « C’est un tel plaisir de revoir enfin des pièces, s’enthousiasment Claire et Christelle. Sans compter que ça se passe dehors et que c’est libre d’accès. » Si soixante spectateurs peuvent s’asseoir dans la petite enceinte située derrière le théâtre, les badauds s’agglutinent autour. « On a 200 personnes par jour en moyenne, précise Ribes. On est tellement heureux ! On retrouve une forme de catharsis qui fait du bien ! » Le même jour, le Théâtre national de Chaillot à Paris (16e) entamait son week-end de performances gratuites. « Revenir au théâtre dans une situation générale dégradée oblige à trouver des idées, commente Didier Deschamps, le directeur. La gratuité est plus facile pour attirer les gens et leur montrer que la vie reprend dans les salles aussi. » Dès 19 h 30, l’atmosphère grimpe pour le battle orchestré par le chorégraphe hip-hop Ousmane Sy : 700 personnes plongent dans le groove sous l’œil vigilant des ouvreurs, qui n’ont laissé personne tomber le masque. « Vital d’être solidaire » Gratuit ! Le mot claque. Dans le contexte de la pandémie, la reprise dans les théâtres après six mois de parenthèse est une aventure acrobatique quotidienne. Faire revenir le public pour les uns, avoir envie de s’enfermer masqués dans les salles pour les autres, est le challenge. Quitte à bouleverser le fonctionnement, la gratuité devient un levier. « A période anormale, dispositifs inhabituels, affirme Emmanuel Demarcy-Mota, aux manettes du Théâtre de la Ville et du Festival d’automne, à Paris. Nous traversons une époque difficile, c’est le moment ou jamais de changer nos habitudes. » Dans la foulée de la réouverture libre d’accès du Théâtre de la Ville, à Paris (4e), lundi 22 juin, le lancement du Festival d’automne, les 5 et 6 septembre, était gratuit avec une ribambelle de propositions théâtre et musique. « Parallèlement au fait de retrouver les spectateurs, il m’a paru vital d’être solidaire des jeunes artistes isolés qui n’ont pas travaillé depuis des mois, poursuit le metteur en scène. L’application rapide de cette solidarité est, entre autres, la gratuité : c’est une façon de dire que tout n’est pas question d’argent, surtout en ce moment, et que nous devons être capables de nous réunir à nouveau. » Bascule sociétale et économique, la pandémie a soulevé un besoin urgent de retrouver du sens, de nouvelles valeurs pour une communauté explosée. « La Maison est inclusive et solidaire », lit-on sur le site de la Maison de la danse de Lyon (8e). « Le spectateur n’est pas qu’une Carte bleue », insiste Dominique Hervieu, sa directrice, qui programme des performances gratuites jusqu’au 28 octobre. « La solidarité est double, effectivement : pour les danseurs et pour le public qui flippe en zone rouge, ce qui est compréhensible, car l’incertitude est énorme, constate-t-elle. Il m’a semblé important de montrer que les institutions culturelles sont attentives à la précarité des gens, dont beaucoup ont perdu du pouvoir d’achat. Nous avons un rôle social à jouer que nous avons peut-être oublié. Lorsque j’ai imaginé ce début de saison gratuit, je me suis revue à 20 ans, et je me suis dit qu’il fallait danser en plongeant artistes et spectateurs dans un sas de douceur, pour retrouver le chemin de la salle en toute confiance. » Dégâts collatéraux positifs à une crise catastrophique ? « Le Covid-19 nous oblige à questionner le spectacle vivant, dont nous nous sommes passés pendant six mois il faut quand même le dire, lance, non sans provocation, Olivier Michel, directeur de la péniche La Pop (Paris 19e). La gratuité, à laquelle nous nous sommes habitués à travers les nombreuses propositions de spectacles sur Internet, permet de revenir à la notion de bien commun, de don, aussi, sans contrepartie, et ça me semble vraiment une très bonne chose. » Aide de mécènes L’argent est néanmoins le nerf de la guerre de ces opérations. Alors que la pandémie a entraîné la chute de la billetterie, souvent un apport massif pour équilibrer les financements d’un certain nombre de théâtres – la Maison de la danse par exemple fonctionne avec 60 % de recettes propres sur 6 millions d’euros de budget global –, choisir la gratuité oblige à trouver des stratégies économiques pour payer les artistes. « On a doublé la fréquentation. Même si ce n’était pas encore formidable, ça nous a soulagés », réagit Stéphane Boitel (Théâtre Garonne, à Toulouse) Les crédits exceptionnels alloués par le ministère de la culture pour « l’été culturel et apprenant » ont été moteurs pour de nombreux événements. Dominique Hervieu, elle, a mis dans l’escarcelle trois budgets sanctuarisés : celui des coproductions, celui des ateliers d’éducation artistique et celui des frais de résidences. Emmanuel Demarcy-Mota a obtenu, pour les nombreuses performances gratuites de l’édition spéciale du Festival d’automne, une aide exceptionnelle de mécènes. Au Théâtre Garonne, à Toulouse, on a coupé la poire en deux. Après avoir constaté début septembre que les billets ne se vendaient pas, l’équipe a lancé l’opération « un ticket acheté, un offert ». En une semaine, les ventes ont augmenté nettement pour les productions à l’affiche du 16 au 19 septembre. « On a doublé la fréquentation. Même si ce n’était pas encore formidable, ça nous a soulagés, réagit Stéphane Boitel, codirecteur artistique. Les gens se sont retrouvés dans la salle, et ils ont vu qu’ils n’étaient pas seuls. C’est aussi une façon de dire que cette reprise inhabituelle mérite une forme de courtoisie. Et ça devrait leur donner envie de revenir. » En payant pour deux, cette fois. « Car la gratuité, dans le système marchand aujourd’hui, peut difficilement être un modèle économique », conclut Stéphane Boitel. Un avis partagé par Didier Deschamps : « Elle ne peut pas devenir la règle. On n’a pas les moyens financiers pour le faire et elle entraîne aussi souvent une dévalorisation des propositions artistiques. » « Des années de travail » Ce bémol est souvent évoqué. « C’est comme la psychanalyse, blague Jean-Michel Ribes. Il faut payer pour que ça marche. » « Le théâtre public est généralement contre la gratuité, qui serait synonyme de fête à Neuneu, déclare Patrick Ranchain, directeur du Théâtre du Bois de l’Aune, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui fonctionne entièrement sur la gratuité. La gratuité est une affaire complexe, dont la construction économique et citoyenne prend des années de travail. » « La question de la gratuité, qui permet une diversité du public, doit être prise à bras-le-corps par le politique », assure Patrick Ranchain (Bois de l’Aune) L’aventure du Bois de l’Aune, situé dans un quartier prioritaire d’Aix-en-Provence, commence en 2012. Sur une demande de l’adjointe au maire, déléguée à la culture, Sophie Joissains, Patrick Ranchain planche sur un lieu gratuit. « Ça a créé une tension immédiate chez moi, car j’étais habitué comme tout le monde à compter sur les recettes pour équilibrer le fonctionnement d’un théâtre », se souvient-il. Huit ans après, la salle affiche régulièrement complet avec 1,5 million d’euros de subvention, dont 450 000 euros destinés à la présentation de trente spectacles, pour une équipe de neuf personnes. « Pour qu’elle devienne effective, la question de la gratuité, qui permet une diversité du public, doit être prise à bras-le-corps par le politique », assure Patrick Ranchain. La lutte ne fait que commencer. Prochainement devrait se réunir, sous la houlette d’Emmanuel Demarcy-Mota, une quinzaine de théâtres de Paris et d’Ile-de-France pour trouver les moyens de la gratuité des spectacles jusqu’à l’âge de 14 ans. Festival d’automne, événements gratuits en Ile-de-France, jusqu’au 16 janvier : La Fabrique, de Boris Charmatz, les 26 et 27 septembre, au CND de Pantin ; Jukeboxe, d’Elise Simonet et Joris Lacoste, du 2 au 4 octobre, au T2G de Gennevilliers. Théâtre national de Chaillot, Paris 16e. Répétitions publiques gratuites, jusqu’au 9 octobre. Tél. : 01-53-65-30-00. « Automne de la danse », rendez-vous gratuits, jusqu’au 28 octobre. Maison de la danse, Lyon 8e. Tél. : 04-72-78-18-00. Bois de l’Aune, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Tél. : 04-88-71-74-80. Rosita Boisseau Légende photo : Le Collectif Ès, en sortie de résidence, à la Maison de la danse de Lyon, le 12 septembre. ROMAIN TISSOT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 7:22 PM
|
Par Mathieu Macheret dans Le Monde le 21 septembre 2020 Le comédien, qui a brillé aussi bien au théâtre qu’au cinéma, notamment chez Buñuel, Duras, Welles, Costa-Gavras ou Beauvois, est mort lundi à l’âge de 89 ans.
Comédien excentrique et sophistiqué dont le maintien britannique lui permettait tous les dérapages possibles, Michael Lonsdale, mort le 21 septembre à Paris, à l’âge de 89 ans, a offert au cinéma français de ces cinquante dernières années l’une de ses présences les plus fascinantes et insaisissables. On se souvient de sa haute silhouette légèrement voûtée, plantée comme un point d’interrogation, de son visage aux bajoues plongeantes, mais surtout, peut-être, de sa voix sinueuse et grésillante, infiniment souple et capable de voler en éclats tonitruants. Cette labilité corporelle et émotionnelle est précisément ce qui l’autorisait à passer d’un rôle à l’autre en restant exactement lui-même, comme tous les grands acteurs. Habitué à ces seconds rôles marquants qui volent la vedette aux premiers par leur force drolatique dans les films de Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras, François Truffaut ou Orson Welles, il fut surtout un homme de théâtre chevronné et assidu, ayant joué sous la direction de Claude Régy, Peter Brook ou Jean-Marie Serreau. Il est né le 24 mai 1931, dans le 16e arrondissement de Paris, d’une passion intempestive de sa mère, une Française d’ascendance bourgeoise, pour un officier de l’armée britannique, ami de son mari. L’enfant, qui tirera son bilinguisme de sa double nationalité, grandit sur l’île de Jersey, où ses parents tiennent un hôtel, puis quelques années à Londres, avant d’arriver, en 1939, au Maroc, où son père prend un emploi de représentant en engrais chimiques. Ce dernier, soupçonné de traîtrise, est fait prisonnier par les autorités vichystes, après la destruction de la flotte française par les Britanniques lors de l’attaque de Mers el-Kébir, en Algérie, du 3 au 6 juillet 1940. Il ne sera libéré que deux ans plus tard, en novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord : revenu à la maison, il n’est plus que l’ombre de lui-même. L’acteur confiera s’être inspiré de son apathie pour incarner le personnage du vice-consul, dans India Song, de Marguerite Duras. Choc avec Strindberg C’est dans le sillage de cette libération que, à Casablanca, le jeune Michael Lonsdale découvre le cinéma, grâce aux films américains projetés dans les casernes pour les GI’s. Il voit les films de Howard Hawks, John Ford, George Cukor, qui lui font éprouver pour la première fois le désir de devenir comédien. En 1947, il revient en France seul avec sa mère, désormais séparée de son second mari. Ils s’installent d’abord à Meudon, dans une maison où l’adolescent s’initie à la musique et à la littérature, à travers les ouvrages de Sacha Guitry, Mark Twain et Gustave Flaubert. Ils reçoivent régulièrement la visite d’un oncle, l’écrivain Marcel Arland, pilier de la NRF et Prix Goncourt (1929), qui présente son jeune neveu à tout le petit milieu de la littérature. Lui et sa mère emménagent définitivement à Paris, dans un grand appartement que leur laisse son grand-père. Le jeune Lonsdale tourne alors autour des écoles de théâtre, mais n’ose en franchir le seuil. C’est en voyant La Sonate des spectres, d’August Strindberg, mis en scène par Roger Blin, qu’il reçoit un choc et décide de se lancer. Au début des années 1950, il intègre le cours de Tania Balachova, au Studio des Champs-Elysées, « professeure de génie » dont il dira qu’elle était « capable de révéler à ses élèves une dimension d’eux-mêmes totalement insoupçonnée », mais aussi qu’elle « travaillait les comédiens comme un matador, jusqu’à ce qu’ils succombent. » Double orientation Il reçoit une seconde révélation en 1955, celle du théâtre de Bertold Brecht, devant Le Cercle de craie caucasien joué au Théâtre des Nations par le Berliner Ensemble. Il passe alors une audition auprès de Raymond Rouleau, metteur en scène de boulevard, en même temps qu’il rejoint la troupe de Laurent Terzieff, portée vers des aventures théâtrales novatrices. Il joue Chers zoiseaux, de Jean Anouilh, avec le premier, et L’Echange, de Paul Claudel, avec le second. On reconnaît ici la double orientation qui présidera à toute la carrière de Michael Lonsdale : complice irréductible des avant-gardes et des auteurs contemporains, il semble s’être fait connaître du grand public par ricochets – notamment pour son apparition dans Hibernatus (1969), au côté de Louis de Funès, et son rôle de méchant, Sir Hugo Drax, dans le volet Moonraker (1979) de la saga James Bond. Au théâtre, il devient le compagnon de route du metteur en scène Claude Régy, maître du silence et de la suspension, sous la direction duquel il jouera 18 pièces, interprétant les textes de Marguerite Duras, Peter Handke ou Luigi Pirandello. Avec un autre dramaturge, Jean-Marie Serreau, il travaille au défrichage scénique des textes d’Eugène Ionesco et de Samuel Beckett, encore fraîchement accueillis en ce mitan des années 1960. Sa rencontre avec Beckett est déterminante : en 1966, l’écrivain supervise en personne une mise en scène de Comédie, où Lonsdale se retrouve aux côtés de Delphine Seyrig et Eléonore Hirt. Il restera fidèle à Beckett tout au long de sa carrière, portant lui-même sur scène certaines de ses pièces, telles que Dis Joe, L’Impromptu d’Ohio, Berceuse et Catastrophe. Autre rencontre déterminante, celle de Marguerite Duras qui assiste aux répétitions de L’Amante anglaise, mise en scène par Claude Régy en 1968. Duras se souviendra du comédien et l’invitera à jouer dans trois de ses films : Détruire, dit-elle (1969), son tout premier long-métrage, où l’acteur joue Stein, personnage récurrent de son œuvre, Jaune le soleil (1971) et, surtout, l’inoubliable India Song (1975). Michael Lonsdale y incarne un vice-consul languissant, dont la silhouette fantomatique se traîne dolemment à travers les salons et courts de tennis d’une propriété abandonnée. Sur la bande-son, audacieusement désynchronisée de l’image, il pousse de terribles hurlements d’amour et de désespoir (précédemment enregistrés lors d’une représentation radiophonique du texte en 1974). Dérision magistrale Son premier grand rôle au cinéma avait eu lieu quelques années auparavant, dans Snobs (1961), de Jean-Pierre Mocky, où il jouait déjà avec une dérision magistrale de cette affectation guindée qui lui semblait si naturelle. Mais le film fut interdit pendant deux ans pour outrage à l’armée et à l’Eglise. La suite de la carrière cinématographique de Michael Lonsdale est majoritairement faite de seconds rôles et d’apparitions ponctuelles, à chaque fois si puissamment drolatiques ou étranges, qu’ils en viennent souvent à voler la vedette. « J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage », déclarait Michael Lonsdale Dans Le Procès (1962), d’Orson Welles, d’après Kafka, il pousse une harangue inquiétante, dans un anglais parfait, sous la défroque d’un prêtre. Dans Baisers volés (1968), de François Truffaut, il interprète un marchand de chaussures comme un petit commerçant étriqué et hautain. Dans Le Fantôme de la liberté (1974), de Luis Buñuel, il incarne un chapelier sadomaso, qui se fait fouetter les fesses devant une assemblée outragée. Il faut évidemment ajouter à tout cela sa participation à des expériences de cinéma hors du commun, comme les douze heures du ciné feuilleton Out 1 (1970) de Jacques Rivette, où il se livre à de longues séances d’improvisation théâtrale en roue libre, ou encore au magnifique cycle des « Quatre Saisons », de Marcel Hanoun, où il incarne le double du cinéaste à l’écran. Le jeu de Michael Lonsdale se caractérise à chaque fois par une forme de distance envers le personnage, dans laquelle peuvent aussi bien se loger l’ironie que la réflexivité. L’acteur est capable de passer de l’onctuosité la plus suintante à une forme de dureté brute, voire à d’impressionnants coups de colère. Il sera également voyeur des toilettes publiques chez Jean Eustache (Une sale histoire, 1977), érotomane patenté chez Alain Robbe-Grillet (Glissements progressifs du plaisir, 1973) et collaborateur vichyste chez Costa-Gavras (Section spéciale, 1975). L’un des rares films où il occupe le premier rôle est une merveille méconnue tournée pour la télévision : Bartleby (1976) de Maurice Ronet, d’après Herman Melville, où il joue un notaire troublé par l’un de ses employés qui se refuse à tout. Dans les dernières années de sa carrière, on l’avait retrouvé en sublime patriarche prostré, dans Gebo et l’ombre (2012), du Portugais Manoel de Oliveira, ou en double de fiction du cinéaste Eric Rohmer, dans Maestro (2014), de Léa Fazer. La foi chrétienne Une part plus secrète de sa filmographie concerne les rôles ecclésiastiques qu’il a ponctuellement interprétés au fil des années, fondés sur son aisance à incarner l’obséquiosité, le dédain, la dissimulation ou plus simplement l’aménité. Michael Lonsdale a joué un abbé bibliophile dans Le Nom de la rose (1986), de Jean-Jacques Annaud, d’après Umberto Eco, le cardinal Barberini, dans Galileo (1974), de Joseph Losey, et surtout le frère Luc Dochier, dans Des hommes et des dieux (2010), de Xavier Beauvois, sur l’assassinat des moines de Tibéhirine. Un rôle qui lui vaudra la reconnaissance ainsi que le César du meilleur acteur de second rôle. Il raconte toutefois avoir refusé de jouer un évêque de Rome dans Amen. (2002), de Costa-Gavras, pour son parti pris « anti-papiste ». Derrière ces choix et ces refus pouvait se lire en filigrane l’adhésion de Michael Lonsdale à une foi chrétienne dont il ne s’est jamais caché, et qui ne l’a surtout jamais empêché d’accepter des rôles transgressifs ou anticléricaux. Il confiait à ce sujet : « Certaines personnes, dans le métier, se sont détournées de moi parce que le seul mot de “religion” leur donne des boutons… La peur d’être rejeté, de ne plus travailler, en a muselé plus d’un, et loin de moi l’idée de les juger ! » Cette foi assumée fut peut-être moins une marque d’anachronisme que d’anticonformisme suprême, de la part d’un artiste qui est toujours resté « à part » et ne s’est jamais vraiment fondu dans le milieu artistique. Situation d’isolement qu’il évoquait lui-même en ces termes : « Ah, cette grande famille des acteurs… Je m’y sens parfois si décalé, n’ayant pas du tout l’esprit blagueur, pas le moindre goût pour la grosse farce, au point de me sentir parfois très mal à l’aise. J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage. » Michael Lonsdale restera pour toujours ce comédien extraterrestre, cet acteur venu d’ailleurs qui semblait incarner une certaine condition humaine tout en posant un regard extérieur sur elle, comme s’il ne lui appartenait pas vraiment. Et sans doute faut-il voir là le véritable secret de son génie. Michael Lonsdale en dates 24 mai 1931 Naissance à Paris 1966 Interprète de la pièce « Comédie » de Samuel Beckett 1968 Interprète de la pièce « L’Amante anglaise » de Marguerite Duras 1975 Acteur dans le film « India Song » de Marguerite Duras 1979 « Moonraker » de Lewis Gilbert 1986 « Le Nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud 2010 « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois 2012 « Gebo et l’ombre » de Manoel de Oliveira 21 septembre 2020 Mort à Paris Mathieu Macheret Légende photo : L’acteur Michael Lonsdale, en 2008 à Paris. OLIVIER ROLLER / DIVERGENCE --------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Christophe Henning dans La Croix Publié le 21/09/2020 Mort de Michael Lonsdale, comédien à l’inépuisable générosité Michael Lonsdale est mort lundi 21 septembre à l’âge de 89 ans. Acteur aux 130 films et comédien à la longue carrière, il a toujours témoigné d’une foi profonde. Michael Lonsdale, photographié le 20 octobre 2011 à Paris. ERIC GARAULT/PASCO Monstre sacré du cinéma, il était devenu une icône. Après une longue carrière, il reste la figure d’un sage ou d’un grand-père, à qui on peut se confier, tout comme il apparaît dans le film Des hommes et des dieux, quand une jeune Algérienne demande à Frère Luc ce qu’est aimer. Michael Lonsdale est né à Paris de la rencontre de sa mère avec un officier britannique. Il a vécu une partie de son enfance au Maroc, pendant la guerre, avant de s’installer avec sa mère dans un appartement familial, face aux Invalides, où il vécut jusqu’à sa mort, ce lundi 21 septembre. François Truffaut y a tourné en son temps une scène de Baisers volés (1968). Entré en théâtre comme en religion, Lonsdale a joué des rôles d’une incroyable diversité. Après-guerre, le monde des arts est en ébullition : Lonsdale le timide fréquente Beckett, Marguerite Duras, Madeleine Renaud… En suivant les cours de Tania Balachova, ce vrai timide dans un corps trop grand apprend le métier : « J’ai mis du temps, mais j’ai fini par libérer toute mon énergie jusqu’à casser une chaise ! J’en étais effrayé moi-même. » Dirigé au cinéma par les plus grands, on le retrouve aussi bien avec François Truffaut qu’avec Jean-Pierre Mocky, dans James Bond ou Le Mystère de la chambre jaune. Une voix à nulle autre pareille Les années passant, sa silhouette s’impose, le pas lent, la barbe fournie et les sourcils broussailleux, les cheveux balayés en arrière… Un regard, et une voix, à nulle autre pareille, grave et douce, jouant aussi bien des intonations que du silence. Plus de cent trente rôles au cinéma et une profonde vie intérieure, intime. Le théâtre est sa maison, l’Église, là où est son cœur. Baptisé à 22 ans, il n’a jamais caché sa foi, qui devient contagieuse à force de lectures et de méditations. « Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d’autre », lui avait dit, très jeune, un père dominicain, qui avait perçu cette singularité du comédien. Sainte Thérèse de Lisieux et tant d’autres bouleversent l’artiste courtisé par le Tout-Paris. Dans les années 1980, frappé par une série de décès, il plonge dans la dépression. C’est lors d’une célébration de la communauté de l’Emmanuel, dans sa paroisse Saint François-Xavier à Paris, qu’il reprend pied : « Cela m’est apparu très clairement : ce qui allait me sortir de mon chagrin, ce qui me rendrait le goût de vivre, était là. La vie fraternelle, la prière et la louange : Jésus venait à ma rencontre. J’étais fou de joie. » L’émotion de Frère Luc « Le métier de comédien est un travail de passeur : je dois m’efforcer de transmettre la beauté, je fais entendre les mots d’un autre », confiait-il encore. Au soir de sa vie, interpréter Frère Luc de Tibhirine dans le film de Xavier Beauvois fut une grande émotion. « Mais ni le film, ni l’existence édifiante de frère Luc ne doivent nous faire oublier que c’est le Christ le premier qui a donné sa vie pour nous. Jésus s’est laissé humilier, bafouer. Nous ne sommes que ses disciples. » Témoin du Christ et artiste à part entière, il a déclamé de grands textes, écrit nombre de livres de prière et de méditation, sans oublier une carrière de plasticien, peu connue, et qui lui tenait particulièrement à cœur : « La beauté est un des noms de Dieu », soufflait-il. Si c’est un grand comédien qui s’en va, c’est aussi un accompagnateur, un accoucheur, qui ne savait pas refuser les multiples sollicitations qui engorgeaient son répondeur téléphonique, souvent saturé. Il inscrivait à l’occasion plusieurs rendez-vous sur une même page, au risque de faire faux bond, preuve d’une inépuisable générosité, qui se manifestait par une écoute bienveillante accordée aux plus grands comme aux passants de la rue. De santé fragile, ce roc a tenu, jusqu’au bout. Lonsdale est mort à 89 ans. Et connaît aujourd’hui l’envers du décor : « J’aimerais partir en paix. Je voudrais mourir en Dieu. Ce qui fonde ma confiance face à la mort, c’est Jésus : mon ami m’a dit que la mort était vaincue, qu’elle n’avait pas le dernier mot. Pourquoi se soucier de ce qui est entre les mains de Dieu ? » ______________________________________________ Repères 1931 : naissance à Paris, d’une mère française et d’un père britannique 1946 : rencontre le metteur en scène Roger Blin et décide de faire du théâtre. Il s’inscrit à l’école de Tania Balachova. 1955 : premier rôle au théâtre avec Raymond Rouleau dans Pour le meilleur et pour le pire. 1956 : début au cinéma dans C’est arrivé à Aden de Michel Boisrond 1961 : Snobs ! de Jean-Pierre Mocky. Ensemble, jusqu’au Renard Jaune en 2013, ils tourneront sept longs-métrages. 1962 : Le procès d’Orson Welles 1967 : La mariée était en noir, de François Truffaut ; Baisers Volés l’année suivante. 1968 : L’amante anglaise de Marguerite Duras, au théâtre, sous la direction de Claude Régy. 1974 : Le Fantôme de la liberté de Luis Bunuel 1975 : India Song, de Marguerite Duras 1986 : Le nom de la Rose, de Jean-Jacques Annaud 1993 : Les vestiges du jour, de James Ivory. 2010 : Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois. César du meilleur acteur dans un second rôle. 2020 : Mort à Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 6:51 PM
|
Par Armelle HÉLIOT dans son blog - 26 septembre 2020
Stéphane Braunschweig signe la mise en scène de la tragédie de Racine dans une scénographie marquée par la distanciation. Cela donne une sévérité certaine à la représentation portée par un ensemble de comédiens sensibles répartis en formations changeantes. Si l’on en croit les photographies du livret de salle remis aux spectateurs des Ateliers Berthier, il n’y a pas seulement deux comédiens en alternance pour chaque rôle dans ce travail, mais une combinaison très changeante, mouvante comme l’est discrètement la mer immense qui sert de double toile de fond à la représentation d’Iphigénie. L’entrée dans l’immense espace impressionne. Un podium central recouvert de noir, comme l’ensemble de cette halle. Avec simplement deux chaises. De chaque côté, sur le sol, sont installées les mêmes chaises, blanches, deux par deux. Les murs, à l’arrière de chaque ensemble de sièges, portent d’immenses écrans sur lesquels seront continûment diffusées des images de la mer, la mer à l’infini et le ciel parfois déchiré du vol d’un oiseau. L’une des extrémités de l’estrade centrale s’ouvre sur les corridors de la salle, l’autre est fermée par une paroi et une porte. Une fontaine à eau flanque l’un des côtés. Stéphane Braunschweig l’explique, il a commencé à travailler avec les comédiens au printemps dernier et a pensé cet espace, cette scénographie qu’il signe, dans la perspective de la pandémie et de la distanciation. Curieusement, la mort hante le lieu, évoquant les froids et monumentaux funérariums de certains pays. Mais Iphigénie ne peut s’inscrire autrement que dans un monde que hante la mort. Mort à venir, et mort du monde même puisque les vents sont tombés et aucun souffle ne semble vouloir jamais reprendre. Le dispositif impose aux protagonistes un éloignement certain, mais parfois les personnages se retrouvent, se rapprochent, s’agrippent les uns aux autres et alors, il faut l’avouer, l’émotion touche plus. Un léger défaut affecte la sonorisation : cela peut se corriger. Mais le soir où nous avons vu Iphigénie, le si talentueux Claude Duparfait, Agamemnon, donnait le sentiment de faire exploser les syllabes, effet dommageable et amendable, qui s’est d’ailleurs estompé au fil du jeu. La blonde et délicieuse Cécile Coustillac, jolie personne de la troupe informelle de Stéphane Braunschweig, possède la lumière, la candeur, la grâce, la voix superbe d’une idéale Iphigénie. Elle connaît d’ailleurs l’œuvre pour l’avoir fréquentée il y a des années. Mais, attention, le podium ne pardonne rien et on voit trop cette merveilleuse jeune fille parler en tendant l’index pour appuyer ses propos. C’est tellement difficile d’être debout sur ce plateau, un pantalon et un petit chemisier, comme si elle revenait de la plage, regardée de tous les côtés en légère contre plongée. Ils ont du cran, tous ces interprètes, qui n’ont aucun appui, n’étaient parfois quelques chaises sur lesquelles ils s’asseyent. Mais ils ont la langue, ils ont Racine, ils servent un chef-d’oeuvre. Peu monté. On n’oublie pas une bouleversante Iphigénie, à la Comédie-Française, il y a trente ans, par Yannis Kokkos, avec Valérie Dréville dans le rôle-titre. On oublie une version laborieuse, il y a quelques étés. La pièce est difficile. De l’intime aux manoeuvres politiques, de l’amour aux nécessités de la guerre, Racine plonge au plus profond des atermoiements des êtres. Le mythe, la grande histoire, mais l’humanité aussi, palpitent en une oeuvre construite magistralement et audacieuse. Rien d’encalminé, ici. Sauf les navires. Claude Duparfait, comédien d’exception, laisse sourdre les flottements du grand Agamemnon, jusqu’à sa lâcheté. Mais il laisse apparaître aussi le débat, la déchirure. D’une manière de se mouvoir, de ployer, d’avoir des fêlures dans la voix : « Vous y serez ma fille », répond-il à Iphigénie, lorsqu’elle demande si son « heureuse famille », sera présente lors du sacrifice que doit accomplir Calchas. Achille, ce soir-là, était joué, parfaitement, par un Pierric Plathier vulnérable, perturbé par ce qu’il devine des menaces. Face à eux, Ulysse, Sharif Andoura, Ulysse sans état d’âme, au début. Pas le choix. Pas de question à se poser. Mais il acceptera le dénouement… Arcas, Thierry Paret, tient parfaitement sa partition, comme le font Astrid Bayiha, Doris, Aegine, Clémentine Vignais, Eurybate, Glenn Marausse. Anne Cantineau est une Clytemnestre fermement dessinée, avec ce qu’il faut d’autorité au personnage, sans amoindrir la passion maternelle. Brune et dorée, d’essence tragique est l’Eriphile de Chloé Réjon, aussi séduisante que déterminée. Théâtre de l’Odéon aux Ateliers Berthier, du mardi au samedi à 20h00, le dimanche à 15h00. Relâches les 27 septembre, 11, 25, 31 octobre et 1er novembre. Durée : 2h15 sans entracte. Tél : 01 44 85 40 40 www.theatre-odeon.eu Légende photo : Cécile Coustillac, Iphigénie, Pierric Plathier, Achille. Photographie de Simon Gosselin. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 25, 2020 10:14 AM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 24/09/20
Comme un clin d’œil à la trop longue fermeture des théâtres, Christophe Honoré ouvre la saison de la Comédie-Française avec Le Côté de Guermantes, tome central d'A la recherche du temps perdu de Proust.
“Bien sûr qu’il est ridicule de prétendre adapter Proust, au théâtre comme au cinéma”, écrit Christophe Honoré aux acteur·trices de la Comédie-Française en mai 2019. Soyons plus sentimentaux, plus scrupuleux. Je ne vous propose pas une adaptation mais une séance de nécromancie.” Cette feuille de route liminaire à la création du Côté de Guermantes, tome central d'A la recherche du temps perdu, s’avère aujourd’hui doublement emblématique de l’aventure engagée avec la troupe du Français.
D’abord, la Comédie-Française étant en travaux pour plusieurs mois, parce qu’elle se joue au Théâtre Marigny, situé au cœur des jardins des Champs-Elysées où se déroule une partie des faits rapportés par Marcel, le narrateur – et non des moindres : la mort de sa grand-mère. Ensuite, parce que la création devait avoir lieu en avril dernier mais, après quatre semaines de répétition, tout s’arrêta pour cause de confinement.
Pour Christophe Honoré, Proust s’est naturellement imposé lorsqu'Eric Ruf lui a proposé une création au Français. “Depuis Plaire, aimer et courir vite, Proust m’accompagne dans beaucoup de créations, que ce soit le spectacle Les Idoles ou le film Chambre 212. C’est une lecture qui m’a souvent aidé, soutenu, voire stimulé dans Chambre 212, sur cette idée d’un passé recomposé, retrouvé. Je me suis dit que c’était quelque chose que je n’oserais jamais faire au cinéma, à raison ; alors, à tort, pourquoi ne pas essayer de le faire au théâtre ?”
“N’ayez pas peur de sortir un peu de vos partitions”
Depuis trois semaines, le travail a repris là où il s’était arrêté en mars, “au moment où on commençait à comprendre ce qu’on allait faire”. Lorsqu’on se rend à une répétition à dix jours de la première, l’ambiance est pourtant détendue. Pas de panique à l’horizon. Juste une équipe au travail, comédien·nes masqué·es sur le plateau, écoutant les indications données par Christophe Honoré avant de reprendre la scène où Rachel (Rebecca Marder) et Saint-Loup (Sébastien Pouderoux) se disputent en présence de Marcel (Stéphane Varupenne).
A la précision de la chorégraphie gestuelle mise en place doit s’accorder la liberté d’être dans le ressenti, enjoint Christophe Honoré aux acteur·trices : “N’ayez pas peur de sortir un peu de vos partitions.” Sur le sol en damier noir et blanc du décor, le hall d’un hôtel particulier parisien, Rachel se tient nue, debout dans une vasque, pendant que son amie lui verse de l’eau pour la laver. Au micro, Saint-Loup chante Léo Ferré, Ton style. En fond de scène, un double paravent constitué de bandes verticales de miroirs ne reflète que des brisures d’images.
Comme une allégorie de l’entreprise menée par Proust tout au long de La Recherche, titanesque dans son désir de reconstitution impossible d’un passé révolu, collection hétéroclite de personnages, de lieux, de paroles et d’atmosphères que la mémoire réagence. A l’image de l’adaptation réalisée par Christophe Honoré : “J’ai travaillé d’une manière scénaristique en choisissant les moments que j’avais envie de garder, plutôt que d’essayer de condenser plusieurs moments en un seul. Je me suis appuyé sur les personnages pour diviser le livret en huit chapitres, qui portent chacun le nom d’un personnage.”
Les affaires politiques de l’époque, l’amour et la mort
Chacun d’eux cristallise les enjeux du Côté de Guermantes, cette comédie sociale explorant les classes sociales dépeintes par Proust, les affaires politiques de l’époque, celle de Dreyfus en tête, l’amour et la mort, ce legs littéraire qui hante le XXe siècle et coïncide avec l’idée que Christophe Honoré se fait du théâtre : “J’ai beaucoup convoqué les fantômes au théâtre, dans Nouveau Roman ou Les Idoles. Dans un sens, ces personnages sont des fantômes pour Proust. J’ai l’impression que le théâtre est le bon lieu pour communiquer avec eux et essayer de leur redonner une possibilité d’être là pendant l’instant de la représentation avant de disparaître à nouveau."
Du théâtre au cinéma, il n’y avait qu’un pas à franchir. Alors, du temps perdu que fut le confinement pour le théâtre, Christophe Honoré aura gardé des traces en tournant dix jours fin juin “un film absolument improvisé, sans scénario, d’une troupe empêchée de travailler à qui on annonce qu’elle ne va pas jouer. Il essaye de rendre compte de cette troupe au travail, de la période et de Proust.” L’image fantôme d’une recherche en cours.
Le Côté de Guermantes d’après Marcel Proust, mise en scène Christophe Honoré, avec la troupe de la Comédie-Française. Jusqu'au 15 novembre, Théâtre Marigny, Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 23, 2020 7:27 PM
|
Entretien avec Juliette Gréco par Véronique Mortaigne : Télérama, juillet 2020, re-publié en hommage ce 23 septembre
Nous l’avions rencontrée dans son lumineux paradis méditerranéen de Ramatuelle, parmi les pins et les fleurs, la mer en contrebas. Devant nous, la chanteuse cultivait ses souvenirs et semait ses secrets. Son AVC, la mort de sa fille unique et son éloignement de la scène n’avait pas eu raison de sa force vitale… Relisez le récit de notre dernière rencontre avec Juliette Gréco, en juillet dernier.
Il fait un temps magnifique. Juliette Gréco, 93 ans, trois fois veuve des comédiens Philippe Lemaire et Michel Piccoli et du compositeur Gérard Jouannest, a choisi de poursuivre sa vie dans la « fulgurante beauté » des hauteurs de Ramatuelle. Hiératique, droite, elle est cependant prisonnière d’un corps qui l’a lâchée au soir du 12 mars 2016. Alors foudroyée par un AVC, la chanteuse iconique avait perdu l’usage de la parole. Pire malheur pouvait-il atteindre cette amoureuse des textes, de la diction, du chant ? Oui, il y a eu pire, dit-elle en ce lumineux jour d’été. Il y a eu la mort la même année de sa fille unique, Laurence, scripte de cinéma, emportée par un cancer à 62 ans, bouleversant l’ordre des choses. L’enfant a disparu, alors que Juliette, la mère, n’en avait toujours pas fini avec ses désirs de gamine têtue. D’ailleurs, Gréco a si bien lutté qu’elle reparle. Différemment, sans les phrases fleuries d’ironie auxquelles la mutine nous avait habitués. Elle livre des mots dépouillés comme on décoche des flèches. Et l’âge imposant la remarque, oui, elle a toute sa tête. Bref, elle est « vivante », dit-elle de cette voix inchangée, prompte à l’emphase pour les mots d’importance. “Le silence des oiseaux” Le corps est un carcan. Juliette, la muse de Saint-Germain-des-Prés, la vagabonde aux pieds nus de la plage de Pampelone, l’interprète audacieuse de Sartre, Vian, Gainsbourg, Brel ou Ferré, est allongée sur le canapé de la grande salle cernée de pins, la mer en bas, des buissons de fleurs et un calme olympien. Elle nous dit, énigmatique : « C’est le silence des oiseaux. La vie m’a donné une fille et me l’a reprise. » La main fait une circonvolution aérienne. Ah ! ces mains ! Longues, fines, inspirées. Sur scène, elles volaient, formaient des papillons, des fleurs, distribuant des bons points à la poésie autant qu’elles faisaient barrage à la laideur et au vulgaire. C’était Gréco. Dans sa longue robe noire, qui avantageait ses formes. Mais elle s’en foutait parce que les lumières se portaient en priorité sur ses mains de fée-sorcière. “Je suis un espoir. (...) Un espoir de sauver la vérité. La musique ne ment pas.” Juliette Gréco, affaiblie, a ajouté au noir (le gilet) du noir et blanc (la robe). Le tout élégamment assorti à la jeune chienne chihuahua qu’elle a nommée Rosebud. « Elle est drôle, et elle en sait long ! Rosebud, c’est la luge de Kane », objet central du désir dans le Citizen Kane d’Orson Welles. « Je suis un espoir. » Silence. Un espoir de quoi ? Silence. Et puis : « Un espoir de sauver la vérité. La musique ne ment pas. Rosebud ne ment pas. » « Ça tourne », dit Juliette, la main voletant au-dessus du visage. La tête lui tourne, sans doute. Ou bien serait-ce la terre, les étoiles ? Ou encore la roue de la chance, celle qui a mené son amie si chérie Françoise Sagan vers les tables de casino ? Sagan, dont la présence imprègne Ramatuelle, ses collines et ses plages, son indiscipline hédoniste, aujourd’hui faussées par l’argent-roi. Gréco a tout gardé, gravé dans ce corps empêché : Françoise, le danseur Jacques Chazot, l’écrivain Bernard Frank, Brigitte Bardot, qui s’empilaient dans sa Mini Moke pour aller s’enfiler des omelettes au Café de l’Ormeau, sur la place. Juliette Gréco parle au présent, jamais au passé. Si elle a de la colère, « ce n’est pas contre la vie ». Parce que « Laurence est formidable », qu’elle l’a faite avec un « type magnifique », l’acteur Philippe Lemaire, et qu’en ces jours de juin où nous lui parlons sur les hauteurs de l’Escalet, sa petite-fille, Julie, ponce une table sur la terrasse, prend la main de « Mamie » en riant et représente « la troisième génération de femmes fortes ». Julie, sa petite-fille Julie vit dans le Finistère, se baigne tous les jours dans la Manche glaciale, a parcouru près de 10 000 kilomètres à vélo en Afrique de l’Ouest, puis a monté une société de traiteur dont la crise du Covid-19 a eu raison. Mais elle a d’autres projets. D’abord, elle ne veut plus qu’on tienne sa grand-mère pour morte. Ça l’énerve, « puisque c’est faux ». Le Théâtre du Châtelet a ainsi inauguré une salle Juliette-Gréco fin 2019, après rénovation. En oubliant de l’inviter. Le sang de Julie n’a fait qu’un tour. « Je suis vivante », insiste Juliette Gréco, posture de madone, cheveux tirés en arrière. Parce que vous êtes forte ? « Non, répond celle que la Gestapo avait relâchée vu son jeune âge alors que sa mère et sa sœur, entrées dans la Résistance, partaient pour le camp de Ravensbrück. Cela a sans doute à voir avec la force, mais ce n’est pas tout. Je suis résistante, j’ai un sale caractère, ce qui est une qualité. La maladie est injuste. » “Je n’ai jamais renoncé, je me bats, je sais très bien dire non, je l’ai dit toute ma vie.” Après l’AVC et la mort de Laurence, la série noire a continué. En mai 2018, son compagnon de vie et accompagnateur depuis près de quatre décennies, Gérard Jouannest, a lâché prise. Et voici Gréco alitée, citant, le doigt levé au ciel, la chanson de « Brel et Jouannest », qu’elle a si souvent interprétée : J’arrive. « J’arrive, j’arrive/Ce n’est même pas toi qui es en avance/C’est déjà moi qui suis en retard/J’arrive, bien sûr, j’arrive/N’ai-je jamais rien fait d’autre qu’arriver ? » En scène, au Printemps de Bourges en 2015, alors qu’elle inaugurait son ultime tournée, intitulée « Merci », Juliette Gréco, 88 ans à ce moment-là, avait eu un coup de chaud. Épuisée, elle avait achevé J’arrive avant de s’enfuir en coulisses. Ce fut poignant. « On arrive tous, plus ou moins bien. Je n’ai jamais renoncé, je me bats, je sais très bien dire non, je l’ai dit toute ma vie et quand c’est non, c’est non », ajoutant, tout miel : « Mais quand c’est oui, c’est oui. » “Je suis noire et blanche. Comme une partition.” Rosebud mordille une peluche, dans ce salon où il y a beaucoup de peluches — celles que le public amoureux jetait sur scène. Des automates, aussi, « parce qu’ils sont construits avec intelligence et humour ». Et des pliages japonais, des origamis magnifiques, arbres, oiseaux, cirque miniature, régulièrement expédiés par Keiko Nakamura, sa productrice japonaise depuis 1979, toujours fidèle. Juliette Gréco a une passion pour la papeterie. Il y a dans son bureau des photos privées de Michel Piccoli, onze ans de mariage (1966-1977), faisant le fou sur un voilier. Une lithographie de Miles Davis (trois semaines de passion torride en 1949 et des rechutes). Et une collection de petits papiers. « J’adore le papier, on peut y écrire ce que l’on veut, c’est un espace libre. Au Japon, les couleurs des papiers sont superbes. Tranchantes, noir c’est noir, blanc c’est blanc, et le rouge dit ce qu’il a à dire. » De quelle couleur êtes-vous aujourd’hui ? « Je suis noire et blanche. Comme une partition. » “Chanter, c’est la totale, il y a le corps, l’instinct, la tête.” Il y a une question évidente, difficile, qu’il faut poser : comment vivre sans chanter ? « Cela me manque terriblement. Ma raison de vivre, c’est chanter ! Chanter, c’est la totale, il y a le corps, l’instinct, la tête. Cela a toujours été une affaire entre moi et moi. Je travaille beaucoup en silence. Je répète à l’intérieur, j’essaie de servir l’auteur, d’être compréhensible. Il faut être une servante convenable. » Si elle pouvait, où irait-elle chanter demain ? « N’importe où, là où il y a des gens. » Des gens, collés, agglutinés, en communion. Quand elle est fatiguée, somnolente, affaiblie, Juliette Gréco écoute la radio, France Inter, sous un casque. Elle n’a pas perdu le fil de l’histoire. Le Covid est parvenu à interdire l’un des fondamentaux de la vie : le contact humain. « Ne plus s’embrasser, ne plus s’étreindre est cruel. » La main se lève, floue. La suppression des concerts est « terrible », et « nous n’avons ni Malraux ni Lang » pour affirmer la primauté des arts. Se protéger est peut-être nécessaire, mais vivre, tellement plus. Oui, elle a entendu les rumeurs du soutien au comité Adama Traoré, avec ces milliers de jeunes réunis malgré l’interdiction de manifester. « Merveilleux. » Sa vie a été émaillée de compagnonnages « fastueux », des guerriers comme le parolier et dialoguiste Étienne Roda-Gil, « un soldat qui cherchait la justice comme moi. Brel qui combattait la connerie, la lâcheté, “raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques” » — elle cite la chanson Ces gens-là. Il appartenait à cette catégorie d’hommes si particulière, « excessivement féminins mais qui avaient peur des femmes : Ferré, Brassens, Ferrat… Et puis, tous ces mecs fragiles », comme MC Solaar, Abd al Malik ou Benjamin Biolay, qui lui a composé des chansons, « un type tellement talentueux, délicat et courageux. Des êtres humains ». Qu’est-ce qu’un être humain ? « Quelqu’un qui donne, et ça, c’est sûrement difficile. » Sourire malin et doigt d’honneur « L’extrême droite ne me fait pas peur, elle me dégoûte. » Julie a fini de passer du vernis marin sur la table poncée. Elle arrive, bille en tête : « Mamie, tu as vu ces policiers qui ont tatoué sur leurs bras des aigles nazis à côté de la croix de Lorraine ? On fait quoi ? » Juliette, mutique, fait le geste du ciseau d’une main droite assurée. Traduction de la petite-fille, habituée de ce nouveau langage corporel : « On leur coupe les c… » « Vous voyez, elle a une tension de jeune fille, elle n’a plus de tachycardie depuis qu’elle a arrêté ses tournées marathons. » Ah ! l’œil noir de l’artiste ! Ah ! le demi-sourire malin ! Et la conclusion ! Un doigt d’honneur adressé à l’héritière, hilare. « Nous formons une fine équipe », sourit la grand-mère, qui connaît son état et à qui on ne la fait pas. Rosebud gratte le bras du reporter, les yeux ronds, genre « madame est fatiguée ». On se tait. Le temps s’étire. Les repas sont une épreuve. L’appétit ne lui vient pas. Même en mangeant. Normal pour son âge, dit-on, comme on le dirait d’une adolescente rebelle. L’entretien se joue en pointillé. Avez-vous peur de la mort ? « Oh ! non. » Vous n’avez peur de rien ? « Ah ! si, terriblement. » De quoi ? « De ne pas être aimée. J’ai peur de cela depuis toute petite et ça continue. » Véronique Mortaigne Légende photo : Juliette Gréco en 1972, à Paris, au sortir de la douche. Irmeli Jung, photographe : “Elle était d’accord pour que je la photographie ainsi. Elle m’a souvent dit que c’était la photo d’elle qu’elle préférait.”
© Irmeli Jung / Agence VU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 21, 2020 5:07 AM
|
Reportage de France 2 diffusé le 20 septembre 2020 Voir la vidéo de France 2 La crise sanitaire a durement touché le secteur des grands théâtres, notamment privés. Ils entament désormais leur reprise sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup d’espoir et d’énergie du côté des comédiens et des directeurs de salles. Illustration au Théâtre Antoine, à Paris.
Le comédien François Berléand fait son retour, ému, au théâtre Antoine, à Paris. Il y retrouve son metteur en scène et son partenaire, François-Xavier Demaison. Leur spectacle est de ceux qui, d’ordinaire, attirent les foules et remplissent les caisses. Après des mois de fermeture, la directrice du théâtre a tout prévu pour respecter les mesures sanitaires : gel hydroalcoolique et distanciation physique avec marqueurs au sol.
Une trésorerie au plus bas
Dans les coulisses aussi, on s’affaire avec soulagement, même si chômage partiel et année blanche pour les intermittents ont aidé à passer le cap. Tous sont impatients de reprendre, d’autant plus que la trésorerie est partout à sec. Les salles ne pourront être remplies qu’aux trois-quarts. Pas forcément rentable, mais elles n’ont pas le choix. La plupart des théâtres privés rouvriront d’ici au mois de novembre, mais les castings ont, eux, déjà repris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 5:47 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 20-09-2020 Noire d’après Noire – La Vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne, adaptation et mise en scène de Stéphane Foenkinos.
Noire ou le récit d’un combat qui dure encore contre la violence raciste et l’arbitraire.
Publié soixante ans après les faits en 1955, le roman biographique Noire (Grasset, 2015) a fait de son auteure la lauréate du prix Simone Veil, revenant sur une époque contemporaine où, bien après l’abolition de l’esclavage, la personne noire est considérée avec indifférence méprisante, davantage encore quand elle est femme.
La voix s’adresse aux spectateurs d’abord plongés dans le noir, à l’orée du spectacle mis en scène par Stéphane Foenkinos qui convoque sur le plateau l’auteure du roman éponyme, Tania de Montaigne, interprète pudique d’un personnage à l’honneur qu’elle vouvoie, s’adressant d’une part, à la fois à Claudette Colvin, figure d’héroïne peu connue œuvrant à l’émancipation des Noirs, et au public, d’autre part.
« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes un noir, un noir de l’Alabama dans les années cinquante. Vous voici en Alabama, capitale : Montgomery… »
Grâce à la vidéo de Pierre-Alain Giraud qui diffuse nombre de documents d’archives – paysages urbains et paysages ruraux de la Cotton Belt, et plus tard, des scènes de meetings avec Martin Luther King, des manifestations avec Rosa Parks, et les concerts de Nina Simone et Myriam Makeba, et d’autres voix encore, celles de Billie Holiday, le spectateur voyage d’un continent à l’autre, de l’Est américain au Sud.
Le public a l’impression de survoler les terres de coton et d’esclavage, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l’Alabama pour échouer à Montgomery :
« Regardez-vous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l’âme de Claudette Colvin, jeune fille de quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu’être noir ne donne aucun droit mais beaucoup de devoirs… »
Puis, survient sur la scène Tania de Montaigne, silhouette élégante et assurée, qui poursuit son récit en interpelant le public, l’autre, le sommant de juger par lui-même.
Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager blanc. Malgré les injonctions menaçantes, elle reste assise. Confrontée au conducteur du bus puis à deux policiers agressifs et violents, elle est jetée en prison mais n’en décide pas moins de plaider non coupable et d’attaquer la ville.
Avant elle, personne n’avait osé une telle opposition à l’ordre inique établi, emblème d’une lutte collective pour la fin de la ségrégation raciale ; prend forme ici et là le mouvement historique de libération et d’émancipation d’un joug moral arbitraire.
Montgomery est une ville légendaire où se croisent le révérend Martin Luther King, pasteur de vingt-six ans, et Rosa Parks, couturière quarantenaire, pas encore dite la Mère du mouvement des droits civiques et icône de la lutte contre la ségrégation.
Noire est l’histoire de cette modeste lycéenne de quinze ans, âgée aujourd’hui de 81 ans, jamais placée sous les feux des projecteurs, travaillant depuis longtemps à ce qu’on l’oublie. Peu après les faits, Claudette eut un enfant, dût quitter la ville pour y revenir plus tard : d’autres soucis, moraux, sociaux et économiques, l’accaparèrent.
Tania de Montaigne, souriante et conciliante, a la grâce de la sincérité dans ce récit qu’elle adresse au public, confiante en sa capacité à raisonner et à réfléchir, loin de toute haine, sans amertume ni ressentiment face à un monde si absurde et décalé.
Véronique Hotte
Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, du 15 au 26 septembre à 20h, relâche les 20 et 21 septembre. Tél : 01 44 95 98 21.
Share this:

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 12:25 PM
|
Par AFP, publié dans L'Express - 19 septembre 2020
Paris - Il remonte sur scène pour jouer un vieil acteur confronté à un théâtre désert, au moment où les salles sont toujours à moitié vides. Mais pour Jacques Weber, la crise sanitaire est une occasion de repenser le théâtre.
"Le problème n'est pas le masque. Il faut arrêter de dire +c'est horrible+. La question est +qu'est ce qu'on fait?+. Il faut agir!", déclare à l'AFP le comédien de 71 ans à la longue carrière, dont l'un des rôles les plus marquants sur les planches fut Cyrano de Bergerac.
"Je sais que je suis privilégié et qu'il y a des gens dans ce métier beaucoup plus précaires que moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais j'ai le devoir comme d'autres de réfléchir à des façons de faire autrement le théâtre", ajoute-t-il.
Il joue à partir de mardi dans "Crise de nerfs: trois farces" d'Anton Tchekhov au Théâtre de l'Atelier à Paris, mis en scène par un spécialiste de l'écrivain russe, l'Allemand Peter Stein. La pièce, prévue au printemps, avait été reportée à cause du confinement.
Coïncidence, la première courte pièce, "Le chant du cygne", raconte l'histoire d'un vieil acteur se réveillant après un temps d'ivresse dans un théâtre vide, un texte où Tchekhov s'interroge sur le théâtre et sa fragilité.
"Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si on joue bien ou mal. C'est (plutôt de s'interroger sur) la place du théâtre dans le monde. Avec l'épidémie, il est grand temps qu'on se pose cette question, différente de celle de la carrière", affirme l'acteur. "On ne peut pas se satisfaire d'avoir seulement 1% de la population qui va au théâtre, on ne peut pas rester muet devant le fait que les gens préfèrent de plus en plus la retransmission à l'art du direct, au jeu".
- Paris-Beyrouth -
Pourquoi ne pas tenter des expériences hors les murs, "dans les espaces verts, les lieux patrimoniaux, les lieux atypiques", pour que le public n'aille pas toujours "dans les mêmes salles", suggère-t-il.
Jacques Weber cite par exemple une pièce jouée par Audrey Bonnet sur les quais de Seine, où les spectateurs portaient un casque pour écouter le dialogue de manière "intime", à laquelle il a assisté à la fin de l'été.
Avec la crise sanitaire, le théâtre et les arts ont été considérés "comme un luxe", constate-t-il. Mais il rappelle que si la scène ne change pas le monde, elle amène la réflexion. Et dans sa longue histoire, "le théâtre a toujours surmonté les épreuves", même si cette épidémie et ses incertitudes entament durement la situation financière de nombreux théâtres.
Signe de la fragilité de la reprise, le Théâtre de la Colline a annoncé vendredi la suspension des répétitions de la nouvelle création du dramaturge Pascal Rambert, "Mes frères", après qu'un membre de l'équipe artistique a été testé positif au Covid-19.
Outre sa rentrée théâtrale, Jacques Weber publie un ouvrage autobiographique intitulé "Paris-Beyrouth" qui relate son expérience lors du tournage d'un film en pleine guerre civile du Liban, dans les années 80. Il a alors 33 ans et va à Beyrouth pour un film, poussé par la réalisatrice Jocelyne Saab, après avoir été lâché par sa voix en jouant Cyrano.
"Je voulais sortir de cet enfer et paradis qu'était Cyrano...Je suis tombé sur une ville totalement détruite et totalement charmeuse, un pays si doux et si follement abîmé", dit-il.
Un livre qui parait quelques semaines après l'explosion au 4 août au port de Beyrouth qui a fait près de 200 morts et des dégâts considérables. "Effroyable", murmure le comédien, qui avoue être "extrêmement gêné" par ce hasard de calendrier: la sortie --prévue de longue date-- d'un livre relatant "une histoire avant tout personnelle" et la situation tragique de tout un pays et de ses habitants.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 8:07 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde le 19 septembre 2020
REPORTAGE - A Paris, comédiens, directeurs de salles et spectateurs composent avec les nouvelles règles de distanciation. C’est leur première sortie théâtrale depuis cinq mois. Masques en tissu bien calés sur le visage, Chris et Zina veulent « reprendre autant que possible leur vie d’avant et retrouver le plaisir des soirées au spectacle ». Ces deux amies quinquagénaires patientent, avec une légère appréhension, devant le théâtre du Petit-Saint-Martin, à Paris. « J’espère qu’ils ont bien aménagé la salle pour qu’on ne soit pas collés et qu’ils ont fait le nécessaire pour l’aération », insiste Zina. La capitale a beau être en zone rouge Covid-19, il y a foule, ce samedi 12 septembre, pour découvrir la nouvelle création de Camille Chamoux, Le Temps de vivre. Dans la salle, toutes les consignes sont rappelées par l’ouvreur : « Eteignez vos portables, gardez votre masque, respectez le siège d’écart entre les groupes de spectateurs, bref, aidez-nous. » Une heure et demie plus tard, effacées les appréhensions, envolé le virus ! Chris et Zina sortent avec le sourire : « On était concentrées sur la comédienne. Comme le spectacle est vraiment bien, on en a oublié qu’on portait un masque, c’est comme s’il était devenu une paire de lunettes ! » Dans ce théâtre de 200 places, la « jauge Covid » (qui impose un siège vide entre chaque couple ou groupe de spectateurs) peut monter jusqu’à 140 : « Cela fait quand même de très belles salles », se réjouit Camille Chamoux. La comédienne humoriste n’a pas hésité à lancer sa création malgré les mesures sanitaires : « Le spectacle était prêt, le pire aurait été d’attendre. Rien ne m’aurait fait annuler ces dates. Contrairement à un film dont on peut décaler la sortie, le spectacle vivant, c’est un souffle et c’est maintenant que j’avais ce souffle pour porter ce seule-en-scène ». Et d’ajouter, enthousiaste : : « Il y a une fièvre magique qui circule entre public et artistes. » « Retrouver l’émotion du vivant » A fréquenter pendant une semaine les théâtres parisiens, on se dit que le spectacle vivant n’est pas mort. Et qu’après une si longue période de fermeture, on assiste, comme le résume joliment Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, « à la rencontre de deux désirs : le désir de jouer des comédiens et celui, pour le public, de retrouver l’émotion du vivant ». Sophie Vonlanthen a les yeux qui brillent lorsqu’elle se remémore la soirée du 27 août. Ce jour-là, le théâtre contemporain de la Manufacture des Abesses, qu’elle dirige, a rouvert ses portes. « Ce fut bouleversant et galvanisant. Il y avait urgence à jouer, car les artistes étaient pris d’un doute existentiel. Le public était là, comme dans un élan de solidarité. » Dimanche 13 septembre, devant l’entrée de ce théâtre montmartrois, Swan Demarsan se dit « abasourdi par cette envie partagée ». Cette rentrée si particulière « est à la fois formidable et terrible », estime le metteur en scène de Désordres, une création sur les affres du couple de Yamina Hadjaoui. Le port du masque obligatoire pour les spectateurs modifie-t-il le rapport avec le public ? « Ça ne change rien. Tout le monde a envie que ça se passe bien et cela emporte tout », assure Sophie Vonlanthen. « J’étais préoccupée par le fait de savoir comment les gens allaient vivre le théâtre masqué, temporise la comédienne Oriane Blin, à l’affiche de Désordres. Finalement, je ressens du soutien. » Son partenaire, Boris Khalvadjian, poursuit : « Le masque n’a pas mis de frontière supplémentaire, les gens ont une grande capacité d’adaptation. » La comédienne et humoriste Camille Chamoux, elle, juge la situation « très étrange. Je ne vois plus les visages qui sourient, les rires sont plus étouffés, mais je sens le corps des spectateurs penchés vers l’avant et une très belle qualité d’écoute ». La troupe du Cercle des illusionnistes est moins catégorique : « Le masque étouffe les réactions, elles nous parviennent beaucoup moins. » Pourtant, mercredi 9 septembre, au théâtre du Splendid, les applaudissements sont nourris pour cette pièce à succès d’Alexis Michalik. Avant la séance, le message de l’ouvreuse est comme un cri du cœur : « Gardez vos masques pendant la représentation, c’est la seule solution pour qu’on puisse travailler, et nous avons très envie de travailler et de rester ouvert ! » Oriane Blin : « J’étais préoccupée par le fait de savoir comment les gens allaient vivre le théâtre masqués. Finalement, je ressens du soutien » Devant le Théâtre du Marais, Jean-Michel et Ghislaine sourient : « On brave le Covid ! » Ce couple de Provençaux n’était pas venu à Paris depuis cet hiver. « Comme à chacune de nos virées dans la capitale, on sort au théâtre. On garde nos habitudes malgré le virus pour que les artistes puissent continuer à travailler », explique Jean-Michel, heureux de découvrir, jeudi 10 septembre, le nouveau spectacle de Pierre Palmade, Assume, bordel !, en duo avec Benjamin Gauthier. Derrière eux, Eric, Natacha et Claude évoquent leur « plaisir de retrouver des comédiens sur scène ». Le masque ? Peu importe. « De toute façon, je l’ai depuis ce matin au boulot, alors une heure de plus ou de moins… », relativise Eric. « Si c’est la condition pour continuer à vivre, alors ok pour le masque », renchérit Claude. Gel hydroalcoolique à la main, Hervé Compan, directeur du Théâtre du Marais, accueille et place les spectateurs. Une cinquantaine de personnes s’installent dans cette salle de 90 places. « On a rouvert dès le 5 août, on était parmi les premiers et je suis assez surpris par la fréquentation », se réjouit le directeur. De son côté, Bruno Moynot, cogérant du Splendid, confie : « J’ai décidé d’être optimiste. On a passé les attentats, les “gilets jaunes”, les grèves des transports, on a toujours réussi à rebondir. Si on maintient des jauges variant de 125 en semaine à 250 le samedi - le maximum qu’on puisse atteindre dans notre salle de 350 places - on passera le cap », espère-t-il. Il a joué la prudence, en reprenant une pièce à notoriété : « Du Michalik, ça rassure. » Mais, s’inquiète-t-il, « peut-être profite-t-on du fait que tous les théâtres n’ont pas encore redémarré ». De grandes salles, comme le Théâtre de Paris, la Porte-Saint-Martin ou l’Edouard-VII ont en effet préféré décaler leur réouverture. « On verra dans un mois » En ce début de saison, « les gens qui viennent sont des habitués du théâtre », reconnaît Sophie Vonlanthen. Pour les lieux qui reprogramment les spectacles interrompus à cause du confinement, une partie du public vient, suite à des reports de réservations. « 75 % des spectateurs n’ont pas demandé de remboursement, souligne Jean-Michel Ribes. Signe, selon lui, « qu’un lien existe, qu’on n’a pas été abandonné par le public ». « On verra dans un mois », avance, prudent, Hervé Compan, au Théâtre du Marais. Mercredi 16 septembre, la grande salle Renaud-Barrault du Rond-Point (900 places) a fait sa rentrée avec Mon dîner avec Winston, d’Hervé le Tellier. Ce seul en scène, brillamment mis en scène et interprété par Gilles Cohen, n’avait pu être joué que quatre soirs dans la petite salle avant que le confinement mette fin à l’aventure. « Quel bonheur de pouvoir revenir, j’en avais ras-le-bol des écrans à la maison. J’ai fait une overdose de télé », lâche Annick, une spectatrice habituée du lieu. Craignant un éventuel durcissement des mesures sanitaires, qui obligeraient à nouveau la fermeture des salles, elle ne s’est pas réabonnée. Bon nombre de directeurs le constatent : les réservations démarrent doucement et une majorité de spectateurs achètent leurs places au dernier moment. « Pourtant, on se sent plus en sécurité dans un théâtre que dans un dîner entre cousins ! », pointe une attachée de presse. Quant à l’obligation de distanciation physique, elle nécessite un « gros travail d’organisation des salles », relève Jean Robert-Charrier, directeur de la Porte-Saint-Martin, et plonge les théâtres dans un équilibre économique très précaire. Les spectateurs doivent laisser un siège de chaque côté pour respecter les gestes barrières, au théâtre du Rond-Point, à Paris, le 16 septembre. « Sans les mesures d’urgence, prêts garantis par l’Etat et chômage partiel, on serait morts », témoigne Hervé Compan. « On a bouffé nos réserves, les jauges Covid permettent juste de payer les frais et les comédiens, et de ne pas s’enfoncer davantage », complète Bruno Moynot. Les artistes eux, croisent les doigts pour que cette rentrée ne soit pas interrompue par de nouvelles mesures de restriction de jauge et s’inquiètent de tous les projets de création reportés. Comme le résume Charline Paul, l’une des comédiennes du Cercle des illusionnistes : « L’instabilité est inhérente à notre métier, mais là, c’est vraiment au jour le jour. » Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 17, 2020 7:36 PM
|
par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 16 sept. 2020 Dans des dispositions du public semblables, suite aux règles imposées par la distanciation due au virus, deux spectacles opposés interrogent le réel. Multinationale pour « Bananas (and Kings) », futurs sans logis pour « La Trêve ». A plus ou moins bonne distance.
Naguère, la fameuse distanciation brevetée Brecht (marque déposée) se contentait de tapiner sur scène : l’acteur ou l’actrice ne devait pas faire corps avec son personnage, mais devait lui tenir compagnie, le prendre par la main, l’emmener au parc ou au café, boire des coups en sa compagnie. Le spectateur, dans son fauteuil, comptait les points et mettait le tout en musique si le metteur en scène (ce mange-tout des temps modernes) ne saturait pas trop l’horizon. A la fin, on applaudissait ou on huait, ensemble, tous ensemble.
Quel comédien, ce théâtre !
Le virus a mis fin à cette situation à laquelle on avait fini par s’habituer quoiqu’elle fût, heureusement, propice à des remous contestataires. Désormais, nouvel habit de la distanciation : c’est le spectateur qui est isolé des autres humains, au mieux deux en un, par un fauteuil au vide abyssal. Qui plus est, il doit s’avancer masqué, autrement dit : le voici d’entrée de jeu à distance. Bien vite se crée un gouffre, la scène semble s’éloigner. L’ensemble des spectateurs ne forme plus un tout – ce que l’on nommait naguère un public – mais un non-groupe disparate et troué, veiné de courants d’air contradictoires et parfois tapissé de méfiance (le premier qui tousse est illico presto un suspect, merde je ne suis pas venu là pour l’attraper, cette saloperie). Loin de faire masse avec ses camarades spectateurs, l’individu masqué s’ancre dans sa solitude jusqu’à se dédoubler, derrière son masque distançant le regard : il se regarde regarder vers une scène où s’agitent à distance des hurluberlus non masqués, des déviants, des hérétiques. Il envie leur audace, leur liberté, il les maudit. Il voudrait être à leur place, ou à tout le moins faire corps avec eux. Il en oublie la pièce en cours. Et pour les binoclards (j’en suis), c’est pire, le masque n’épongeant pas l’air que dégagent la bouche et les narines, tout se nimbe d’une brume épaisse sans que les techniciens du théâtre n’aient à actionner des appareils à fumée. Au secours, Bertolt !
Et pourtant, étrangement, sur scène, domaine privilégié des non masqués, c’est comme avant. On prend les mêmes pots et on y touille les mêmes soupes. Quel comédien, ce théâtre ! C’est qu’il a le cuir dur, l’animal ! Il a de la ressource, le fieffé !
Tenez, prenez Bananas (and kings) qui ouvre ce valeureux petit théâtre privé qu’est La reine blanche, bien moins bien loti que les gros théâtres privés qui sont pourtant les premiers à jouer les éplorés par les temps covidiens qui courent. Le plan de salle a été un casse-tête, là comme ailleurs, pour « respecter la distanciation » impérative en milieu fermé. Après les saluts, on s’attarderait bien mais pas question, on est prié de sortir rang par rang comme à l’armée, de ne pas traîner dans le hall comme dans les églises pendant l’office, ni de stationner au bar d’ailleurs fermé, et donc le pot de première supprimé. Bref : le spectacle étant ingurgité comme une potion si possible magique, on est prié de déguerpir.
Sous son titre fruitier et english, le spectacle dissimule une histoire au long cours (elle commence à la fin du XIXe siècle) celle de la United Fruit company qui, plus tard, changera son nom en Chiquita Brands pour se refaire en vain une virginité car la barque est lourde de coups bas et tordus, d’argent sale, de tripatouillages financiers en tous genres, de foire aux pesticides, d’exploitation des peuples et tribus d’Amérique latine, de financement de terroristes d’extrême droite, de complicité avec la CIA pour couper la chique aux démocraties naissantes. Et tout cela pour nous faire manger des bananes (un tiers de la production mondiale).
Après Un démocrate (sur les manipulations de masse) il y a deux ans, Julie Timmerman signe là sa deuxième pièce pour sa compagnie Idomecanic théâtre qui, en dix ans, s’est déjà frottée à Walzer, Orwell, Michelet et Ibsen. C’est foisonnant, trop parfois, ici et là inutilement caricatural pour mieux souligner l’ignominie. Deux actrices, l’autrice et Anne Cressent, et deux acteurs, Mathieu Desfemmes et Jean-Baptiste Verquin, se partagent vigoureusement plus de quarante rôles, le spectateur masqué s’y perd un peu mais le rythme ne faiblit pas dans un décor astucieux signé Charlotte Villermet.
La tour hivernale
On retrouve le même dispositif côté spectateurs dans la petite salle du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers pour La Trêve, quinzième « pièce d’actualité » de l’établissement, et seconde du genre pour Olivier Coulon-Jablonka après 81 avenue Victor Hugo. Ce dernier s’est entouré de la dramaturge Alice Carré et de la cinéaste Sima Khatami. Les trois cosignent le spectacle se revendiquant du « théâtre documentaire » qui met en scène, comme le premier, des habitants d’Aubervilliers.
Après les sans-papiers de 81 avenue Victor Hugo, voici des mal-logés, anciens ou futurs sans-logis. Tous ont trouvé refuge au fort d’Aubervilliers dans une tour anciennement vouée à la gendarmerie et qui, depuis 2005, sert à l’hébergement d’urgence. La plupart, français et étrangers, avec ou sans papiers, sont arrivés via le 115 (quand, miraculeusement, quelqu’un a décroché) ou le CHU (Centre d’hébergement d’urgence) et se sont arrangés pour y rester. Mais, tôt ou tard, ils devront partir : le terrain, qui appartient à l’Etat, entre dans le cadre du Grand Paris et les tours vont être rasées. Où iront-ils ? A cette question posée au Préfet par Olivier Coulon-Jablonka via l’un des habitants et filmée par Sima Khatami, aucune réponse n’est donnée. C’est sur cette non-réponse que s’achève La Trêve (hivernale).
Le spectacle fait alterner des séquences filmées et des « témoignages » d’habitants sur le plateau. C’est une alternance meurtrière. Autant les séquences filmées aux abords de la tour ou dans un lieu collectif (jamais dans les logis précaires des uns et des autres) sont passionnantes, surprenantes, pétries d’écoute, de complicité (entre Coulon-Jablonka et ses interlocuteurs), mettant en scène sans filtre des personnes attachantes, autant, par contraste, les « témoignages » sur scène semblent artificiels, empruntés. Car chacun dit un texte appris, fruit d’entretiens avec l’équipe. « Suite à ces entretiens, nous avons composé plusieurs monologues et nous avons commencé à réfléchir avec certains d’entre eux à la possibilité de leur présence sur scène », explique Olivier Coulon-Jablonka. Mais personne n’est à la bonne place. Ni eux, ni nous. Question de distanciation ?
Bananas (and kings), Théâtre de la Reine blanche jusqu’au 1er nov.
Tournée : le 3 nov, Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, puis dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin le 13 nov au CC Elsa Triolet d’Orly, le 20 nov à la Grande Dîmière de Fresnes et le 11 déc à l’espace André Malraux du Kremlin Bicêtre. L’an prochain à Charenton-le-Pont, Cambrai, Lésigny, Les Ulis, Saint-Michel-sur-Orge, Orléans, et Saint-Genis-Pouilly.
La Trêve, Théâtre de la Commune d’Aubervilliers jusqu’au 25 sept, les mar, mer et jeu 19h30, ven 20h30, sam 18h, dim 16h.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 30, 2020 6:50 PM
|
Par Emilie Darlier-Bournat dans Artistik Rezo (juin 2016)
Livre : Humeurs variables, de Simon Eine
Editions Riveneuve
Elégant et leste, Simon Eine est de ceux, quand ils parviennent à un âge qui commence par huit, dont on dit plutôt qu’ils ont quatre fois vingt ans. Interprétant Colin et le Chef de troupe dans George Dandin et La jalousie du barbouillé, il vient une fois de plus d’exceller au Vieux-Colombier.
Simon Eine entre à la Comédie-Française en 1960, cueilli immédiatement à sa sortie du Conservatoire National avec trois Prix en poche. A l’époque, quand on est ainsi repéré et placé dans la troupe la plus brillante, il n’est pas question de refuser. Pour Simon Eine qui a alors 24 ans, c’est un parcours superbe qui commence et des décennies plus tard, sa reconnaissance envers cette prestigieuse maison est immense.
Il y enchaine les rôles phares du répertoire, Alceste du Misanthrope, Albin dans Polyeucte, Antiochus dans Bérénice, travaille les plus illustres auteurs, Molière, Shakespeare, Corneille, Hugo, est dirigé par Roussillon, Dux, Boutté, Françon, et la liste serait si longue qu’il n’est pas question de la dresser, d’autant plus qu’elle se diversifie richement du côté des contemporains et se poursuit encore.
On le retrouve chez Copi, Duras, Grumberg, Jon Fosse, et des metteurs en scène tels que Ribes, Mesguich, Lavelli, David Géry font appel à lui. C’est dire que ce comédien, sociétaire honoraire au Français depuis 2004 et qui a également considérablement travaillé à l’extérieur de la célèbre troupe, a une palette haute en couleurs. Venant de terminer les représentations au Vieux Colombier sous la direction d’Hervé Pierre, il s’apprête à rejoindre Nice où il réside désormais.
Entre le Sud et Paris, de nouvelles aventures se dessinent et outre le théâtre, c’est la littérature qui fait son actualité avec la sortie le 7 juillet d’un recueil de Nouvelles intitulé Humeurs variables aux Editions Riveneuve. Depuis toujours, l’écriture et le goût de la littérature accompagnent Simon Eine, son premier livre de
souvenirs Des étoiles plein les poches étant sorti en 2012.
C’est que parallèlement au parcours modèle, il y a chez Simon Eine une étincelle hors normes, constante et juvénile, une vivacité et un entrain toujours sur le qui-vive, une force et une fragilité mêlées qui en font un comédien à part, dont la personnalité est plus libre et plus marquée que celle d’une certaine nouvelle génération au parcours tout tracé d’enfant souvent gâté.
Né en 1936 dans un milieu modeste d’immigrés polonais, Simon Eine a connu une enfance dominée par l’exode et l’obligation de se cacher. Durant ces années de guerre qui l’éloignent de ses parents, -tragiquement et définitivement de sa mère-, la lecture le sauve. Autodidacte, il ne cesse ensuite de découvrir fébrilement des textes, chapardant Le Cid sur un marché de Nice et recevant un véritable choc quand il se jette dans Cyrano de Bergerac après en avoir vu l’adaptation cinématographique avec José Ferrer. « Ensuite, je ne pouvais plus m’arrêter… », lance-t-il aujourd’hui avec un enthousiasme intact. Et effectivement, il n’a jamais arrêté.
Adolescent, quand il donne la réplique à un copain, c’est lui qu’on vient chercher ; d’élève comédien au TNP il passe à l’école de la Rue Blanche et l’ascension commence. Il rêve alors de rejoindre Vilar, ses convictions politiques l’entrainent vers les expériences théâtrales audacieuses. C’est une forte et noble tête, il n’est pas du genre à plier sous les coups du destin, au contraire, il en sort avec une vaillance dont il habille délicatement son indélébile fêlure.
Il vend l’Huma, il se passionne pour les utopies populaires, où l’art et l’engagement se marient. Son père étant tailleur, Simon Eine se souvient d’une période acharnée durant laquelle il travaille le matin sur la machine Singer familiale et l’après-midi il se laisse éblouir par Charles Dullin qui le forme à son « métier d’artisan du spectacle », comme il aime à le dire. « Cette machine à coudre a maintenant rejoint le 6e étage de la Comédie- Française, offerte par mes soins aux Ateliers de la maison après la mort de mon père en 81». A travers ce geste symbolique, s’expriment toute la générosité de Simon Eine, la volonté, la fidélité et conjointement le désir d’aller de l’avant.
La profondeur de jeu de ce comédien s’appuie à n’en point douter sur de vraies connaissances des facéties et des folies humaines, autant que des authentiques tragédies. Il y a toujours en Simon Eine un charme romantique qui se pare de prestance : cette combinaison subtile d’émotions autant que de caractère, a fait de lui un magnifique, touchant et imposant comédien dont peut s’enorgueillir la Comédie-Française et que l’on souhaite retrouver ici ou ailleurs.
Emilie Darlier-Bournat

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 25, 2020 4:23 PM
|
Par Cassandre Leray, dessins Cyril Pedrosa — 24 septembre 2020 à 20:01
«Libération» a recueilli les témoignages d’anciens apprentis comédiens à Rennes qui dénoncent les méthodes de leur professeur, toujours en poste, décrites comme abusives et violentes. Malgré une procédure disciplinaire, celui-ci conteste toute faute pédagogique. «J’ai pensé à arrêter le théâtre. J’allais en cours la boule au ventre, je comptais les jours avant la fin de l’année.» Jade (1) a 17 ans. Depuis qu’elle a quitté le conservatoire de Rennes (Ille-et-Vilaine), en juin 2019, elle tente de laisser derrière elle les souvenirs de la formation théâtrale qu’elle y suivait. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, Jade et ses 13 camarades de cycle d’orientation professionnelle (COP) de théâtre affirment avoir enduré pendant plusieurs mois des violences physiques et psychologiques de la part de leur professeur. Des blessures provoquées par des exercices, des «hurlements», des «humiliations»… Avec le recul, ces apprentis comédiens parlent de «harcèlement moral», d’un climat de «terreur». Surtout, ils accusent leur professeur, V. (2). d’avoir agressé sexuellement deux élèves, dont Jade, alors âgée de 16 ans. Agissements que celui-ci conteste fermement à Libération par l’entremise de son avocat. Deux membres de la promo ont quitté les cours avant la fin de l’année. Sur les 14 élèves, un seul s’est réinscrit au conservatoire. Malgré les nombreuses alertes des apprentis comédiens adressées à la direction du conservatoire et un signalement au procureur de la République, leur professeur enseignera à nouveau en COP au conservatoire de Rennes en cette rentrée 2020. Libération a pourtant recueilli une vingtaine de témoignages d’anciens élèves et collègues qui, dans un contexte pédagogique où une large autonomie est laissée à l’enseignant, accablent les méthodes de V., décrites comme violentes et abusives. «Acharnement» En septembre 2018, V. est désigné comme professeur de COP à Rennes. Ce quadra présente un profil et une expérience a priori intéressants : diplômé d’Etat en enseignement théâtral, il a été professeur dans les conservatoires de Dijon (Côte-d’Or) et Quimper (Finistère). Une dizaine d’années auparavant, il a déjà donné des cours à Rennes. Metteur en scène et comédien au CV modeste, il est alors aussi président de l’Association nationale des professeurs d’art dramatique - fonctions qu’il quittera en janvier 2020. Une réputation controversée le précède pourtant. «D’anciens élèves nous avaient prévenus qu’il était agressif… Un prof nous avait dit de faire attention à nous», se remémore Chloé, 23 ans. Mais cela n’inquiète pas outre-mesure la promo 2018-2019, dont la jeune femme fait partie, qui s’apprête à passer la majorité de sa vingtaine d’heures de cours hebdomadaires avec V. Les 14 élèves ont entre 16 et 26 ans et rêvent tous depuis des années de mettre le théâtre au centre de leur vie. Juliette, 21 ans, se rappelle avoir été «prête à tout pour rentrer en COP». Etre admis n’est pas donné à tout le monde : un entretien, plusieurs journées de stage, une audition devant un jury… Il n’est pas rare d’essuyer plusieurs refus avant de trouver une place dans cette formation qui prépare les élèves aux concours d’entrée d’établissements très prestigieux, tel le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Les élèves de V. déchantent dès les premiers cours en septembre. Tous dépeignent un professeur qui les effraie tant qu’ils n’osent pas lui répondre. «Il sème la terreur, se souvient Sarah, 20 ans, il nous hurle dessus si on ne fait pas ce qu’il veut. Il parle à deux centimètres de notre visage en levant le doigt. Quelqu’un qui lui sort par les yeux, il l’humilie en disant devant tout le monde qu’il ne sera jamais acteur. Il aimait nous voir pleurer, trimer…» Deux mois seulement après le début des cours, un des étudiants quitte le conservatoire après avoir été régulièrement ciblé par V., au point que des élèves évoquent «un acharnement». Dans la lettre collective adressée au procureur de la République un an plus tard, la promo dénoncera une «violence sans égale» à son égard et parle «d’humiliation publique». Les comédiens redoutent aussi les «échauffements» imposés par V. Pendant une demi-heure, ou même dans certains cas plus d’une heure, ils doivent courir sur scène pieds nus, parfois jusqu’au sang, sauter sans s’arrêter… Lors d’un autre exercice, la classe a pour consigne de s’allonger sur le dos et de se déplacer uniquement à l’aide du bassin, en se frottant au sol. «Certains avaient des croûtes sur le coccyx. Et à force de le refaire, elles s’arrachaient et saignaient. On finissait avec des bleus, mais V. s’en fichait», lâche Romain, 23 ans. «Cette façon de faire ne concerne pas que V. : certains profs persistent à penser que la brutalité est nécessaire car être acteur est un métier difficile, ou que s’immiscer dans la vie personnelle des élèves fait partie du processus», déplore un enseignant et ancien collègue. Pour lui, ces abus sont souvent provoqués par le fait qu’il n’y a «pas de règles pour enseigner le théâtre». Concrètement, les professeurs sont libres d’envisager leurs cours comme ils le souhaitent et de choisir les exercices et méthodes auxquels ils ont recours. Une absence de contours clairs du cadre pédagogique qui peut s’avérer propice à des dérives. «Sous prétexte d’être des artistes, certains s’autorisent tout, souligne le même professeur. Ce sont ces gens que l’on retrouve parfois dans les conservatoires. A la sortie des écoles, on récupère des élèves tétanisés de monter sur scène.» Longtemps, les apprentis comédiens du COP de Rennes s’autopersuadent que le comportement de V. est «peut-être normal.» «C’est du théâtre», admet Corentin, 20 ans. Jusqu’au point de non-retour, en novembre. Depuis plusieurs semaines, V. a axé le travail sur Titus Andronicus, de Shakespeare. Le texte raconte la sanglante vengeance de Tamora, reine des Goths, contre le général romain Titus qui a tué un de ses trois fils. Acte II, scène 3 : les deux fils de Tamora la rejoignent sur scène avec la fille de Titus, Lavinia, et son fiancé, qu’ils tuent. Ils sortent de scène en emportant Lavinia et la violent avant de lui couper les mains et la langue pour l’empêcher de les dénoncer. «Salie» Le 21 novembre, les comédiens à qui ce passage a été assigné répètent en costumes devant V. et le reste de la classe. Sur le plateau, Juliette dans le rôle de Lavinia, habillée d’une robe kaki soyeuse et d’un trench beige. A ses côtés, Jade, qui joue son fiancé, et Sarah dans le personnage de Tamora. Les deux agresseurs sont interprétés par Charles et Romain, tout de noir vêtus, cheveux plaqués en arrière. Les consignes de V. se font de plus en plus brutales : «Il demandait aux gars de vraiment me violenter. J’avais tellement mal que je m’étais acheté des genouillères», rembobine Juliette. Charles : «V. trouvait qu’on était trop passifs. Il est donc monté sur le plateau pour nous montrer comment faire», sans prévenir les deux jeunes femmes qui se trouvent allongées sur le plateau. D’abord, V. fonce sur Juliette. «Je n’ai pas vu V. venir, et il s’est allongé sur moi, il m’a bloqué les poignets au sol. Il m’écrasait de tout son corps, plaqué contre moi. Je sentais son odeur, sa respiration, sa tête dans mon cou… Il a fini par me lâcher. Il ne voyait pas que c’était Juliette qui pleurait, et pas Lavinia.» Ensuite, V. se tourne vers Jade. «J’étais allongée sur le dos car je faisais le cadavre, je ne l’ai pas vu arriver. Il était debout et il a attrapé mes jambes pour simuler une pénétration. Il s’est tellement collé à moi que je sentais son sexe. Ensuite, il a lâché mes jambes puis m’a attrapé les épaules pour rapprocher mon visage de son pénis. Là, il a mimé une fellation en faisant des mouvements de va-et-vient», détaille la comédienne, alors âgée de 16 ans. Silence dans la salle. Dans le texte, le viol que subit le personnage de Juliette n’a pas lieu sur scène et n’est que mentionné dans les dialogues. Et rien dans l’œuvre n’indique la moindre atteinte sexuelle sur son fiancé Bassianus, le personnage interprété par Jade. «Quand V. a vu la tête de tout le monde, il a dit : "C’est ça, Shakespeare !"» reprend la jeune fille. Les répétitions s’enchaînent malgré tout. «Je pleurais tout le temps parce que j’avais peur et que je me sentais salie», confie Juliette. Charles ne supporte pas plus la situation : «Quand il a fallu que je fasse à Jade ce que V. lui avait fait, c’était horrible. Je lui ai chuchoté à l’oreille que j’étais désolé.» Cauchemars Quelques semaines plus tard, V. se trouve à nouveau sur le plateau pour montrer aux comédiens ce qu’il attend d’eux. Juliette relate : «J’étais debout. V. s’est mis derrière moi. Il m’a pris les bras, les a bloqués dans mon dos. Il a commencé à descendre une main sur mes hanches, mes cuisses, mon ventre en me disant des choses salaces qui n’étaient pas dans le texte.» A plusieurs reprises durant la répétition, il répète les mêmes gestes. Clémence, 26 ans, y assiste depuis la salle : «Je ne pouvais plus regarder, je me suis levée et je suis sortie pleurer. A la fin du cours, avec l’accord de Juliette, j’ai dit à V. que ce n’était pas normal.» Le professeur ne remontera plus sur scène. «Mais c’était déjà beaucoup trop tard», souffle Juliette. Pendant les vacances de Noël, plus personne ne veut revenir en cours. Pour Romain, le stress est tel qu’il vomit chaque matin. Jade, elle, fait des cauchemars «dans lesquels V. [la] viole». Anaïs craque et quitte le conservatoire en janvier. Mais les 12 élèves restants s’accrochent. Ils exposent leur mal-être à V. lors d’une réunion le 14 janvier 2019 qui aboutit à l’arrêt du travail sur Titus Andronicus. Mais «après la confrontation, ses efforts ont duré deux jours et c’est reparti de plus belle», selon Romain. Le 1er avril, c’en est trop. Ils alertent le secrétariat de direction. Deux groupes d’élèves sont reçus les jours suivants par le directeur du conservatoire, Maxime Leschiera, à qui ils font état de leur indignation. A la rentrée des vacances de printemps, V. n’est plus là, remplacé par un prof issu d’un autre cycle. Interrogé par Libération, Maxime Leschiera explique avoir constaté la «persistance» de «difficultés relationnelles» et ainsi «pris la décision de permuter les groupes et les enseignants par mesure de précaution et pour assurer aux élèves un contexte de travail apaisé». «Ce n’était pas régler le problème, mais le déplacer ! martèle a posteriori Chloé. Ça montrait bien que le directeur ne nous prenait pas au sérieux.» Maxime Leschiera avait pourtant été auditionné le 13 mars 2019 par le Sénat au sujet de la répression des infractions sexuelles sur mineurs, en tant que président de Conservatoires de France, une association de directeurs d’établissements d’enseignement artistique. A cette occasion, il avait déclaré : «Il faut éviter de prendre des mesures injustifiées si l’adulte n’est coupable de rien, et prendre au sérieux la rumeur dans les cas où il s’avère qu’elle est fondée.» A Libé, il assure qu’après sa rencontre avec les élèves au printemps, «aucun autre fait les concernant n’a été porté à la connaissance de la direction du conservatoire jusqu’à la réception du courrier du 1er octobre 2019. A aucun moment, les faits graves dénoncés n’avaient jusque-là été portés à notre connaissance». Plusieurs élèves se souviennent pourtant lui avoir, dès avril, tout relaté des aspects les plus choquants du travail sur Titus Andronicus. «Sur ses gardes» Au fil des semaines, les comédiens comprennent que V. redeviendra bien leur professeur à la rentrée 2019. Sur les 14 élèves de la promo, 13 décident donc de quitter le conservatoire de Rennes. Une partie d’entre eux parvient à trouver une autre formation. Mais pour certains, dont Juliette, la seule issue est l’arrêt total du théâtre : «Je ne sais même pas si j’arriverai à remonter sur un plateau un jour», admet la jeune femme, qui rêvait d’être comédienne depuis le lycée. Jade, qui a changé de conservatoire, est d’abord restée «sur [ses] gardes tout le temps» : «J’avais très peur. Mais j’ai vu que c’était un endroit bienveillant, et ça m’a fait du bien de voir qu’il est possible d’apprendre le théâtre autrement.» Un sentiment d’injustice ne quitte pas les élèves de la promo. En juin 2019, une partie des étudiants veut déposer une plainte collective. «Pour qu’il y ait une trace de ce qui s’était passé», justifie Jade. La police leur conseille d’écrire directement au procureur. Alors qu’ils rassemblent leurs témoignages, les rumeurs de ce qu’a subi la promo parviennent aux oreilles d’autres comédiens. Le 4 juillet, une quinzaine d’autres anciens élèves de V. écrivent à Maxime Leschiera. Ils dénoncent le recours à «la violence, à l’humiliation, à la menace et à des attitudes déplacées et tendancieuses» du professeur dont ils ont suivi les cours au même conservatoire une décennie plus tôt. Ils réclament une procédure disciplinaire à son encontre. Dans sa réponse quelques semaines plus tard, le directeur écrit que l’établissement travaille «à la préparation de l’année scolaire prochaine afin que les difficultés rencontrées l’année dernière ne se reproduisent pas. Nous serons évidemment extrêmement vigilants sur ce point». «Manque de vigilance» Dans les différents conservatoires où il est passé, V. a marqué de nombreux autres élèves par ses méthodes. Lucie, qui l’a eu comme enseignant à Rennes entre 2009 et 2011, se souvient de «crises de nerfs arbitraires qui faisaient régner une ambiance de terreur. Il pouvait lancer du mobilier à travers la salle. Il avait balancé un bouquin dans la tronche d’un élève. On avait entre 15 et 18 ans !» Des parents d’élèves avaient pris rendez-vous avec le directeur de l’époque pour signaler la situation : «On n’a pas attaqué bille en tête V., mais on a dit que dans ce que nous rapportaient nos enfants il y avait une forme de violence psychique et des exercices physiques démesurés», relate Amélie, la mère d’une ancienne élève. Avant son retour à Rennes, V. enseigne au conservatoire de Dijon entre 2016 et 2018. Camille, 23 ans aujourd’hui, se souvient de ce jour où il est venu sur scène pour simuler une levrette sur elle : «Il a mis ses mains sur mes hanches et a mimé une sorte de mouvement. C’est fou comme c’est violent quand quelqu’un qui ne te demande pas touche ton corps.» Des gestes confirmés à Libération par un autre témoin de la scène. Blanche, qui était de la même promotion, fond en larmes en racontant qu’elle ne supportait plus les «réflexions humiliantes» et les exercices physiques épuisants de V. : «Je pleurais matins et soirs, ça m’a créé des troubles de l’alimentation, je vomissais de stress. J’ai fait une tentative de suicide. J’avais honte d’exister.» Le prédécesseur de V. en COP à Rennes, qui a enseigné dans cette classe pendant quatorze ans avant de prendre sa retraite, n’avait pas compris le choix de son successeur : «Pour avoir travaillé avec lui, il a une façon de diriger intrusive qui peut être dérangeante, voire violente. Je pense qu’il y a eu un manque de vigilance. Cela pose question sur les processus de recrutement.» Le 1er octobre 2019, les comédiens de la promotion 2018-2019 du COP de Rennes jouent leur dernière carte : tous, à l’exception d’un élève, signent une lettre de 17 pages accompagnée d’une annexe de 14 pages qui recense les témoignages issus de promotions plus anciennes et d’autres établissements. Outre les humiliations, l’agressivité verbale et des accusations de violences physiques, ils y compilent des «remarques franchement inconvenantes, car personnelles, portant sur [eux], pas sur les personnages [qu’ils jouaient], telles que "j’avoue en tant qu’homme que ce que tu fais là, ça ne laisse pas indifférent", "c’est fou, même comme ça elle est jolie" , "ta scène, c’était chaud, c’était caliente", à l’adresse d’un garçon : "Montre un peu plus que t’es excité, regarde, elle a des jambes magnifiques"». Entre autres. La missive est adressée au procureur de la République de Rennes, au conservatoire, à la direction régionale des affaires culturelles (Drac) et à la mairie. Malgré la description de faits pouvant relever de l’agression sexuelle, le parquet ne retient qu’un signalement pour harcèlement moral. Questionné par Libération sur cette décision, le procureur ne donnera pas suite. Une enquête est confiée à la sûreté départementale de Rennes le 21 octobre et plusieurs personnes sont auditionnées, dont le directeur du conservatoire et V. Sur les dix élèves de la promotion 2018-2019 interrogés par Libération, deux seulement affirment avoir été entendus. Le 22 juin 2020, la procédure est classée sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée». Blâme De son côté, la ville de Rennes commandite une enquête administrative à BLV, un cabinet privé de consulting en ressources humaines. Cette fois, une seule élève déclare avoir été interrogée. Ni Jade ni Juliette n’ont été contactées. V. est suspendu provisoirement par la ville puis cantonné à des fonctions ne comportant pas d’enseignement direct avec les élèves, avec l’injonction par son employeur de «remettre radicalement en question sa posture professionnelle et pédagogique». Le lien sera rétabli progressivement avec les élèves de la promotion en cours, mais «toujours en binôme avec un autre professeur», selon la municipalité. Le rapport restitué à la ville de Rennes le 17 décembre 2019 aboutira le 9 mars à un blâme de l’enseignant pour manquement «à ses obligations professionnelles de savoir être». Selon la mairie, l’enquête n’a «pas permis de mettre en évidence des éléments de preuve formelle permettant d’établir la faute grave. Et ce d’autant plus que les élèves ont refusé de produire des témoignages individuels et ont souhaité rester anonymes». Pourtant tous étaient explicitement identifiés dans la lettre à l’origine de la procédure. V. n’a répondu aux sollicitations de Libération que par la voix de son avocat. Selon ce dernier, l’enseignant conteste «le principe même d’une sanction» et a déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif. Il dément en outre «avec la plus grande fermeté avoir commis quelque infraction pénale que ce soit» dans l’exercice de sa profession. Du côté de la Drac, on souligne que le conservatoire, bien que sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture, relève de la responsabilité de la ville de Rennes. Parmi les institutions destinataires du courrier dénonçant l’attitude du professeur, seul le conservatoire est resté mutique. En janvier 2020, Maxime Leschiera a pris la direction du conservatoire de Bordeaux, remplacé par Hélène Sanglier. Les anciens étudiants affirment n’avoir plus jamais reçu de signe de la direction, tandis que la municipalité fait état de «réunions bilans» au début de l’été avec les élèves actuels, puis les enseignants, ayant «permis d’attester d’un déroulement satisfaisant des cours et d’une sérénité quant à la prochaine rentrée», avec la mise en place de mesure de sensibilisation et de prévention sur les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. C’est par des amis restés au conservatoire que les anciens élèves de 2018-2019 ont appris que V. sera à nouveau professeur de COP au conservatoire de Rennes lors de la rentrée, lundi. A la mairie, on a toutefois spécifié à Libération que la nouvelle promotion «aura plusieurs professeurs […]. Les élèves ne seront pas seuls avec V.». (1) Les prénoms des élèves ont tous été modifiés. (2) L’initiale du professeur a été changée. Cassandre Leray dessins Cyril Pedrosa ------------------------------ Enseignement du théâtre : le flou artistique La liberté pédagogique laissée à l’enseignant, souvent enrichissante, peut ouvrir la porte à des abus dans un milieu où les élèves sont «habitués à la violence» pour progresser. «Dans les écoles de théâtre, quand il y a de vrais problèmes, tout le monde ferme les yeux», soupire Sonia (1). Depuis plus de dix ans, elle enseigne dans un conservatoire. En France, un peu plus de 200 établissements forment les passionnés d’art dramatique à devenir comédiens. Les professeurs peuvent être acteurs, metteurs en scène, expérimentés ou débutants dans l’enseignement… En fonction de leur parcours, tous ont leur méthode : «On rencontre des gens, on retient des exercices qu’on réutilise par la suite dans nos cours…» décrit Damien, prof en conservatoire. Une liberté d’approche qui peut être enrichissante, à condition de respecter des «règles du jeu. L’élève n’est pas une marionnette entre nos mains», dit Sonia. Des «règles» qui demeurent toutefois tacites. «Brèches» Bien qu’il ne soit pas obligatoire pour enseigner, il existe un diplôme d’Etat de professeur de théâtre, visant à former des «artistes-pédagogues». Il s’obtient soit en validation d’acquis d’expériences, soit via une formation. Formation qui n’existe que depuis 2016 (alors que le diplôme, lui, a été créé en 2006) dispensée à ce jour dans trois établissements. Parmi eux, l’Ecole supérieure d’art dramatique de Paris. Comme l’explique Carole Bergen, responsable des études, quatre cents heures de cours théoriques et pratiques sont données, notamment «pour voir quels sont les devoirs d’un professeur : ne pas imposer, ne pas se poser en maître mais en guide». Pour autant, un tel diplôme ne met pas «à l’abri de toute dérive», concède-t-elle. «Etre prof dans ces écoles donne une liberté qu’on ne trouve nulle part ailleurs : il y a ce plaisir de former, mais aussi de déformer», estime Petra Van Brabandt, philosophe et membre d’EngagementArts, mouvement belge contre le sexisme dans les arts. Elle étudie notamment l’enseignement dans les écoles de théâtre. Selon elle, les «abus» fréquents sont en partie liés au fait que «la souffrance est une valeur très ancrée dans le théâtre et la danse, qui vient d’une tradition pédagogique plutôt ancienne, du XIXe siècle. Il y a cette conviction que quand on souffre, on s’élève artistiquement». Un problème accentué par le fait que de nombreux élèves ont été «habitués à la violence» au cours de leur formation, sans possibilité de «questionner ou interroger. La liberté de l’art est absolue. Il y a aussi la notion de génie artistique, de charisme : même quand il va dans la transgression, c’est perçu comme une transgression qui nous guide vers quelque chose. On ne le contredit pas». Cette façon de faire, Damien en a lui aussi été témoin au cours de sa carrière. Adepte d’une pédagogie «bienveillante, sans chercher à faire mal aux élèves», il constate que bon nombre d’enseignants ne sont pas dans ce même état d’esprit : «Il y en a pour qui, pour être au plus près de la vérité, il faut réellement faire mal. Et ça peut laisser des séquelles.» Selon Petra Van Brabandt, «les remarques personnelles n’ont rien à voir avec la pédagogie du théâtre. C’est une façon, souvent, de se permettre des intrusions dans la vie privée des étudiants. Ça tourne autour de leur sexualité, leur orientation sexuelle, leur passé, leur personnalité». Des sujets qui peuvent rendre les élèves particulièrement «vulnérables», selon Sonia : «On peut vite arriver à des situations d’abus car on travaille sur des choses sensibles, sur les sentiments. Une personne mal intentionnée trouve facilement les brèches pour s’engouffrer.» Autre problème fondamental pour la philosophe : l’émiettement de la notion de consentement. «La nudité, le toucher, faire sur scène des choses expérimentales… La pratique est plutôt de persuader, forcer et ridiculiser ceux qui ne veulent pas faire ce qui est attendu par leur prof.» De son côté, Damien l’admet, il n’est pas étonnant que «des comédiennes soient traumatisées face à des profs ou metteurs en scène qui ne peuvent pas s’empêcher de monter sur le plateau pour montrer. Il faut vérifier que la personne est consentante, prévenir et demander d’abord». S’il parle des «comédiennes», c’est que les femmes sont les premières victimes de ces méthodes, comme l’explique Petra Van Brabandt : «Les corps des femmes sont présentés comme des objets. Par exemple, les femmes passent beaucoup plus de temps horizontalement sur scène que les hommes. C’est une comparaison simpliste mais ça dit des choses.» «Non-réponse» Depuis deux ans, le ministère de la Culture a engagé un «gros travail sur la prévention des inégalités, avec un accent sur la responsabilité des établissements d’enseignement», souligne Agnès Saal, haute fonctionnaire à l’égalité, la diversité et la prévention des discriminations. En novembre 2017, il a été demandé aux 99 écoles supérieures de la culture relevant du ministère de se doter d’une «charte égalité», composée entre autres d’un volet sur les violences sexistes et sexuelles. Cette demande concerne 12 écoles publiques nationales de théâtre. Par la suite, une formation a été mise en place à l’automne 2019 pour tous les agents travaillant dans ces établissements, ainsi que les élèves qui le souhaitent. Les conservatoires, bien plus nombreux, sont quant à eux gérés par les collectivités territoriales. Ils ne bénéficient donc pas de la mise en place de ces mesures. «Le ministère a une tutelle pédagogique seulement, et pas fonctionnelle. Là, on dépend vraiment de la volonté d’agir des collectivités. S’il y a un problème dans un établissement territorial, on n’a pas la capacité, ne serait-ce que juridique, d’agir», précise Agnès Saal. Il existe bien un schéma d’orientation pédagogique concernant l’enseignement initial du théâtre, mais le document publié en 2005 n’évoque à aucun moment la question des violences. D’après Sonia, la principale question à soulever est celle des recrutements. «Si un professeur a des plaintes d’élèves dans son dossier, ça ne devrait pas passer inaperçu.» Et d’ajouter : «Ce n’est pas normal que les élèves qui témoignent ne se sentent pas écoutés. Si le prof est déplacé, c’est une non-réponse absolue. Il faut des enquêtes et des procédures administratives.» Pour Petra Van Brabandt, une chose est sûre : «Ce n’est pas la responsabilité des élèves, des opprimés, de changer les choses. C’est celle des écoles et des professeurs.» (1) Certains prénoms ont été modifiés. Cassandre Leray

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 27, 2020 5:06 PM
|
Par Solenn de Royer dans Le Monde le 27 sept. 2020
Je ne serais pas arrivée là si… « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, la chef d’orchestre, fondatrice du chœur Accentus, évoque son éducation, la spiritualité et la vertu consolatrice de la musique.
Laurence Equilbey est l’une des rares femmes chefs d’orchestre. Cette musicienne de 58 ans a créé Accentus, qui a relancé la tradition du chœur de chambre en France, en 1992. Elle est en résidence à La Seine musicale, sur l’île Seguin (Boulogne-Billancourt) avec son ensemble Insula Orchestra, fondé en 2012. Elle milite pour une meilleure représentation des femmes dans la culture. Je ne serais pas arrivée là si… Si je n’avais pas passé mon enfance en Forêt-Noire, en Allemagne. Entre 3 et 9 ans. Cette sorte de nostalgie romantique, qui constitue la musicienne que je suis, je l’ai d’abord ressentie là-bas, dans cette atmosphère imprégnée de musique mais aussi environnée d’une nature puissante, enivrante. Mon père était officier, ma mère, kiné. Très mélomanes tous les deux. Haendel, Beethoven… emplissaient notre maison, à Fribourg. Mes parents chantaient, aussi. La chef de chœur était assez âgée et quand la musique s’emballait, elle se mettait à loucher, ça me fascinait. En rentrant en France, je me suis mise au piano. Plus tard, en pension, à la Légion d’honneur de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), j’ai pratiqué aussi la flûte, la guitare et le chant. Il n’y a que cela qui me faisait vibrer. La musique était pour moi un moyen de supporter la dureté de cet univers. La dureté ? Pour peu qu’on soit sensible, c’était très raide. Au collège, nous étions 300 filles, dans des dortoirs de 70, il n’y avait aucune intimité, jamais. Nous devions marcher en rang. Mais dans cette éducation stricte, la musique était valorisée. Le soir, la surveillante me laissait partir à ma leçon de piano, je traversais le parc, seule enfin, c’était grisant. Jamais je n’aurais fait autant de musique sans cette pension, mes parents n’avaient pas des moyens infinis. Vous avez eu une adolescence difficile ? Je crois. J’étais très grande et mal dans ma peau. A 12 ans, j’avais quasiment ma taille adulte. Je n’étais pas à l’aise dans ce corps, il me faisait peur. Je me sentais un peu comme un monstre. Je me recroquevillais, me cachais dans des gros pulls. Un garçon manqué. A la Légion d’honneur, j’étais bonne élève mais une « bad girl ». Je répondais. J’allais fumer dans le parc. Je lisais des livres que le censeur avait refusé de signer. Je jouais de la guitare pour tout le dortoir. L’intendante dissertait sur l’équité et puis soupirait : « Quel dommage que vous soyez aussi turbulente… » J’ai toujours détesté le rang. Vous détestez aussi qu’on vous demande si vous avez des enfants. « Cette question devrait être interdite », avez-vous dit un jour. Parce que j’ai essayé d’en avoir et n’aime pas me rappeler ces épisodes douloureux, c’est tout. Il est vrai que je trouve cette question déplacée. Cela met en jeu des choses trop intimes. De façon générale, je suis mal à l’aise quand on privilégie les liens du sang. Les grands rassemblements familiaux ne me fascinent pas. Ce sont souvent des réunions pour de mauvaises raisons. La musique sacrée fait partie de votre répertoire. Quel rapport entretenez-vous avec le sacré, la transcendance ? Avez-vous la foi ? Mes parents sont catholiques, très croyants. Il n’était pas question de ne pas aller à la messe. J’ai gardé la foi un temps et puis je l’ai perdue. Je ne voulais pas m’enfermer dans une seule explication du monde. Etudiante, j’ai commencé à douter. Mais la spiritualité m’intéresse toujours beaucoup, l’ésotérisme aussi, la science des nombres, la cabale… J’aime la littérature sacrée et musicale, j’y suis à l’aise, je comprends cette émotion, je comprends Bach. J’aime aussi les secrets de vie qui se trouvent dans les psaumes. Mais je ne crois plus en la résurrection. J’aurais préféré garder la foi. Lorsque je l’ai perdue, beaucoup de choses se sont effondrées. Pourquoi êtes-vous partie à Vienne à 22 ans ? Pour étudier la direction. Je n’y connaissais personne, avec le sentiment d’être loin : il n’y avait pas Internet et le téléphone coûtait cher. Je n’oublierai jamais cette sensation de liberté. Et puis à Vienne, la musique est partout. Tous les compositeurs des XVIIIe et XIXe siècles sont passés par là ou presque. On allait écouter des concerts au Musikverein, on passait par les coulisses, le portier pensait que nous étions musiciens. J’étais inscrite au conservatoire mais il fallait que je gagne ma vie car je n’avais pas un sou. J’ai chanté dans un chœur, j’étais payée en liquide avant les concerts. C’est aussi à Vienne que j’ai rencontré le chef d’orchestre « baroqueux » Nikolaus Harnoncourt, un maître absolu. Il m’a appris à chercher la clé de résonance d’une œuvre avec notre époque. Si on ne la trouve pas, disait-il, il ne faut pas la jouer. Pourquoi avoir choisi de devenir chef d’orchestre ? A la Sorbonne, où j’étudiais la musicologie, j’ai eu l’occasion de diriger. J’ai senti pour la première fois la musique dans mes bras. Comme un fluide invisible, une matière que vous gouvernez, vous pouvez en faire n’importe quoi, lui donner de l’élan, un phrasé… Les danseurs ont la même sensation, je crois. Ce corps, que je n’assumais pas quand j’étais adolescente, tout à coup je l’acceptais. Un plaisir physique inouï ! Et puis, j’aime l’étude. J’ai une grande résistance au travail. C’est nécessaire quand on veut devenir chef d’orchestre. Il s’agit tout de même d’une vie austère. Austère ? Il faut beaucoup étudier, analyser les partitions, les apprendre. C’est très technique, cérébral. C’est un peu votre vie qui passe dans toutes ces heures « à la table ». J’adore ça, mais ce sont des sacrifices. Il faut avoir une discipline de vie, comme les danseurs. Je souffre de ne pas assez voyager. Sans compter qu’avec ce Covid, et ces frontières plus ou moins fermées, j’ai l’impression d’habiter chez Marine Le Pen ! On ne peut plus jouer ni en Angleterre ni en Allemagne… j’étouffe ! La musique vous fait-elle pleurer ? Quand vous êtes chef, vous devez être en contrôle, vous ne pouvez pas vous laisser aller complètement à l’émotion. Mais parfois, c’est bouleversant. Il y a des choses tellement tristes qui peuvent se dire en musique… Vous êtes dans l’indicible, l’incommunicable. La musique peut faire mal. Une œuvre de Schubert, Nuit et rêves, m’a fait pleurer, une fois. Au milieu, il y a un moment où l’espoir revient, un majeur qui arrive soudain, vous ne vous y attendez pas, et ensuite ça se referme. C’est très Schubert : il vous amène au bord du précipice, puis il vous en retire, au dernier moment. La première fois que j’ai entendu l’interprétation d’Ian Bostridge, j’étais chez moi, j’ai pleuré. Un jour, à la Philharmonie de Paris, vous avez dit que la musique est consolatrice… Ce soir-là, une amie venait de perdre sa fille dans un tremblement de terre au Népal. A la veillée, nous avions mis le Stabat Mater, de Dvorak. La mort a besoin d’un berceau. La musique peut beaucoup aider et cette œuvre en particulier, car Dvorak, lui aussi, a perdu un fils de 8 ans, Otokar, qu’il adorait. II y a plusieurs passages dans cette œuvre qui crient à l’intérieur et d’autres plus doux, comme pour vous aider à accepter. Dans les requiem, c’est pareil, on alterne des moments très durs et d’autres, comme le Recordare, « Souviens-toi de qui j’ai été », qui tout d’un coup peuvent consoler. On a besoin des deux devant un deuil, crier sa colère et en même temps être consolé. Comment envisagez-vous la mort ? La mort me fait horriblement peur. J’ai peur d’avoir froid, peur de ne plus être, peur d’être dans cette boîte. Je ne suis pas du tout sereine avec la mort. Mais l’abstraction me sauve. J’adore l’art contemporain, l’innovation. Un tableau me calme. Vous dites que les œuvres sombres et tragiques sont proches de vous, ce sont celles que vous préférez interpréter… Oui, il y a plus d’enjeu dramaturgique, plus d’adrénaline aussi. Parfois c’est dur, âpre. Mais dans cette incantation douloureuse, je me sens dans mon élément. J’ai toujours été plus proche de Bach, Schuman, Beethoven ou Haendel, que de Rossini ou Offenbach. Dans Mozart, il y a un peu les deux. Cette année, j’ai fait un disque, Magic Mozart, très joyeux. Nous étions sur la légèreté, l’humour, l’amour. J’ai adoré faire ce disque ! Vous avez un tempérament mélancolique ? Je préfère le mot gravité. C’est relié à la Forêt-Noire, sans doute. Le Fernweh germanique, je le comprends très bien. Fern c’est « loin », weh c’est « douleur ». La nostalgie des préromantiques allemands. J’adore le préromantisme, le romantisme aussi, parce qu’on y trouve l’amour de la grandeur, la démesure, la transcendance, la folie aussi. Je suis hantée par l’inquiétude, l’impatience… Je cours après le temps, avec toujours deux ou trois projets devant. Je veux construire, bâtir, faire des choses, et je suis pressée. Est-ce parce que la vie, sa finitude, me paraît parfois aberrante ? Je ne sais pas. Que ressentez-vous sur le podium ? De la joie. Les musiciens donnent, je reçois, et je fais la synthèse de toutes ces émotions. Il y a aussi un intense plaisir sensoriel et physique. En play-back, je n’y arrive pas. Mais quand je suis sur le podium ou dans la fosse, j’ai l’impression que le son est matière. Une matière que j’ai entre les mains. C’est inouï ! C’est aussi une position de pouvoir. Quel rapport entretenez-vous avec le pouvoir, l’autorité ? J’ai connu de nombreuses embûches. Recréer une technique de chœur en France, avec Accentus, fonder une école, Insula Orchestra à La Seine musicale, c’était du vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quand vous avez un peu de pouvoir, ça fait gagner du temps. J’aime faire ce que je veux sans trop qu’on m’embête. J’aime aussi le succès. Et j’aime le courage. Artistiquement, j’ai reçu ma première fiche de paye à 34 ans ! Avant, il a fallu me débrouiller. Après, j’ai eu la chance d’être beaucoup aidée et soutenue. La vie, aujourd’hui, est plus facile. Mais je n’oublierai jamais ce que disait Harnoncourt : « Si on est content, c’est que le but n’était pas assez haut. » Recherchez-vous la perfection ? J’ai le goût de la perfection mais sans être obnubilée par la technique. C’est lié à la couleur, à l’exactitude de l’intonation, des balances. J’aime l’alchimie entre la précision et l’inspiration. J’ai besoin d’une organisation d’horloge autour de moi. On a une telle sensation de vertige parfois, quand on est dans une œuvre, qu’il faut que ce soit hypercarré autour. On a besoin d’être protégé. Un vertige ? Manier un chef-d’œuvre, c’est vertigineux. Quand j’analyse une œuvre, je fais des Lego pour la mettre en 3D. C’est comme si j’entrais ensuite dans un vieux château, il y a la porte d’entrée mais je sais qu’il y a aussi des portes dérobées et des lucarnes, un peu plus loin, qui nous emmènent ailleurs… Il faut connaître les formes. Ça peut faire peur, il y a des recoins, des lignes de fuite où vous êtes perdu… C’est impressionnant. Vous êtes devenue chef d’orchestre à une époque où il n’y avait pas de femmes dans ce métier… Avez-vous connu des obstacles ? Rétrospectivement beaucoup, je ne m’en rendais pas forcément compte. Ça a commencé dans mon propre couple. Je vivais avec un chef d’orchestre qui ne supportait pas que je le sois aussi. Je me rappelle aussi de la stupeur d’un orchestre polonais quand je suis arrivée sur le podium. Ils avaient cru que Laurence, c’était un garçon. Ils ont tombé la mâchoire, littéralement. Au début, je tremblais. J’avais peur de ne pas être à la hauteur, ne pas entendre une faute, faire le mauvais geste. Quand vous découvrez ce mastodonte qu’est l’orchestre, ces 120 musiciens devant vous, il faut être sûr de soi. J’ai passé mon temps à entendre ou à sentir que le podium n’était pas ma place. Il a fallu travailler l’estime de soi, beaucoup. Il n’y a que 4 % de femmes chefs d’orchestre programmées ! Je milite avec d’autres pour promouvoir la place des femmes dans la culture. Et ça avance un peu ! Où se situe votre fragilité ? Ma fragilité… c’est ma vie elle-même. Les circonstances ont fait que je n’ai pas réussi à trouver une forme d’équilibre, une philosophie de vie. Je me laisse trop souvent gagner par l’inquiétude. Ce n’est pas toujours simple. Même si c’est nourricier aussi, ça m’incite à construire, j’ai ce désir d’élévation permanente, ne pas être dans le quotidien. Pensez-vous à la postérité ? On se donne tant de mal… on aimerait tous laisser une trace, c’est évident. J’accorde aussi beaucoup de prix à la transmission et à la jeunesse. Ce que j’ai appris, j’ai envie de le partager. Je reste persuadée qu’une œuvre peut inspirer la société, modifier le cours d’une vie. Concerts : Schumann, Mendelssohn, le 27 septembre ; Magic Mozart… concert spectaculaire !, le 15 novembre (1 CD Erato, 14,84 €), Neuvième symphonie, de Beethoven, les 3 et 4 décembre, à La Seine musicale Retrouvez tous les entretiens de la série « Je ne serais pas arrivé là si… » de La Matinale ici. Solenn de Royer

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 7:24 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 24 septembre 2020 Seul en scène, accompagné tout du long, d’une création vidéo, il incarne le narrateur d’un texte de Mohamed Rouabhi, mis en scène par Sylvie Orcier.
Ne mentons pas : on serait bien en peine de circonscrire exactement le propos et l’action du texte de Mohamed Rouabhi adapté par Sylvie Orcier qui signe la mise en scène et par Patrick Pineau qui joue.
Un homme seul. Un isolé. Un paumé qui s’adresse à un chien que l’on ne verra vraiment qu’à la fin, en image.
Un type qui souffre, tel Job. Mais pas d’imprécations contre un Dieu cruel, ici. Juste un homme qui condenserait tout ce que la noire littérature du XXème siècle nous a donné à comprendre.
On est seul, on est embarqué. Mais comme Rouabhi est un conteur, il nous a concocté une fable : un avion s’est écrasé non loin du refuge de celui qui nous parle. Un président et tout son staff. Tous morts. L’homme récupère sa valise. Il y a dedans un téléphone. Il va pouvoir, depuis le lieu reculé de sa solitude extrême, s’adresser au monde.
N’en disons pas plus. Saluons l’art éblouissant du comédien. Patrick Pineau est impressionnant et bouleversant.
La direction, le déploiement de vidéo par Ludovic Lang, de son par François Terradot, de lumière par Christian Pineau, de musique par Jean-Philippe François, l’orchestration de tout cela par Sylvie Orcier, tout concourt à donner à ce moment bref d’une heure dix/quinze, une puissance profonde.
A voir vite. A Bobigny puis en tournée.
Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin, de Mohamed Rouabhi
MC93, Nouvelle salle, jusqu’au 3 octobre. Tél : 01 41 60 72 72.
reservation@mc93.com
Site : www.mc93.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 7:11 PM
|
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte, "Affaires culturelles" sur France Culture - Le 24 septembre 2020 Ecouter l'émission (55 mn)
Mohamed Rouabhi, auteur dramatique, comédien et metteur en scène français, est au micro d'Arnaud Laporte. Le texte qu’il signe pour la pièce "Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin joué" est l’occasion de retracer avec lui son parcours, son imaginaire et son processus créatif.
C’est un monologue, écrit sur mesure pour son complice Patrick Pineau, qui l’amène à venir dialoguer au micro d’Arnaud Laporte. Mohamed Rouabhi renouvelle sa collaboration avec le comédien dans Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin mis en scène par Sylvie Orcier. Un spectacle à la fois insolite et poétique qui fait une étape au théâtre MC93 du 23 septembre au 3 octobre avant de partir en tournée dans toute la France.
Avec Patrick, on s'est beaucoup concertés. On a essayé d'extraire une espèce de nectar, des choses essentielles pour comprendre l'histoire. Il est au milieu de la nature, une nature qui n'est plus une nature hostile mais qui est une nature en train de mourir. Lui qui s'est retiré pendant des années, il décide finalement de faire quelque chose. L’occasion se présente : Il va faire quelque chose pour l'humanité. Un ermite s’est être retiré de ce monde, sauf qu'il lui reste une chose qui est essentielle et qui se retrouve dans beaucoup de mes textes : c’est la radio. La radio, c'est le vecteur de toutes les révolutions et de toutes les évolutions.
De quoi est fait l’imaginaire de l’artiste, d’où vient sa vocation, qu’elles sont ses inspirations et ses méthodes de travail, tentative d'approche du processus de création de Mohamed Rouabhi...
L’émergence d’une vocation
Marqué par les récits de captivité de sa mère, ex-militante FLN, et de son père, ouvrier métallurgiste qui combattit dans l’Armée Française pendant la Seconde Guerre Mondiale au sein des Bataillons Indigènes, Mohamed Rouabhi est aujourd’hui un artiste engagé. Né en 1965, le futur artiste exerce d’abord différents métiers sur les chantiers puis se découvre un intérêt pour la poésie.
Il y avait le métro et ce métro faisait beaucoup de bruit. Il était insalubre, il y avait énormément de gens. On était debout. Et moi, je lisais énormément. Je lisais pour aller entre chez moi et le boulot. Je lisais tout le temps, debout, en marchant, et c'est comme ça que j'ai pris le goût. Le travail m'a fait aimer la poésie, la littérature.
Le théâtre c'est le livre, c'est l'écrit et c'est ça qui me plaisait. J'étais amoureux des livres, de la poésie. Que ça soit Rostand, Racine, Koltès... On commence par là. J'avais déjà une relation particulière avec le livre. Donc tout naturellement, je suis arrivé au théâtre.
Se rêvant meilleur orateur, Rouabhi cherche à parfaire sa diction et entre pour ce faire au conservatoire municipal de Drancy puis est admis à la Rue Blanche (ENSATT) en 1985 où il travaille avec Marcel Bozonnet, Stuart Seide et Brigitte Jaques. Il. A peine sorti de l’école, il remplace au pied levé un comédien d’une troupe palestinienne invitée par le Théâtre du Soleil.
Quand on a commencé au début après la rue Blanche, ce n'est pas qu'on avait envie de tout casser, mais on avait envie d'inventer un nouveau répertoire, de parler d'aujourd'hui. Mes premiers textes étaient sur le monde ouvrier. C'est des choses qu'on connaissait. C'est le côté populaire et le côté qu'on aimait au théâtre et qu'on avait envie de défendre et de montrer. C'était ces écritures nouvelles et tout ça, ça manquait beaucoup. Il faut aller contre une espèce de mode, même si j'aimais bien évidemment les spectacles de Chéreau, de Grüber, etc. Ce n'est pas se mettre en concurrence avec ça, mais c'est à un moment donné, aujourd'hui, ici et maintenant, comment faire du théâtre? À qui? Pour quoi faire? C'est toujours les questions posées auxquelles on essaie de répondre, on avait vingt-cinq balais et c'est ce qu'on essayait de faire.
Un artiste acharné
Touche à tout, Rouabhi créé avec Claire Lasne la compagnie « Les Acharnés » en 1991 qui produira Les Acharnés, Les Fragments de Kaposi, Ma petite Vie de Rien du Tout, Jeremy Fisher, ou encore Les nouveaux Bâtisseurs. L’auteur dramatique s’est fait remarquer avec Malcom X en 2000 qu’il met en scène, puis Requiem opus 61 et Soigne ton droit. Il joue également dès l’âge de vingt ans dans de nombreux spectacles montés par Claire Lasne, Patrick Pineau, Jean-Christophe Baüly, Arnaud Des Pallières, Marcel Bozonnet, Anne Torrès et bien d’autres. On peut notamment relever Providence Café en 2003, l’année où il reçoit le Prix SACD Nouveau Talent Théâtre.
Je suis quelqu'un d'assez éclectique, c'est à dire je fais du théâtre, mais aussi j'aime beaucoup faire des voix pour les documentaires, pour France Culture, tout ça. J'aime cette diversité des choses. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a vraiment des textes. Il y a des rencontres avec l'histoire avec un grand H, mais aussi avec notre quotidien, notre vie. Tous les jours, il y a le temps de la réflexion qui est important. Il faut laisser un peu macérer. Dès fois, on se plante, on va dans un endroit pour faire marche arrière. Le temps était un luxe pour nous dont je voulais user pour pouvoir améliorer l'écriture. Prendre le temps aussi de voir des gens et puis d'essayer de fomenter des projets avec eux.
Un artiste conteur
L’artiste convoque les histoires individuelles, l’Histoire de France mais aussi internationale sous le prisme de la question coloniale, la problématique relative à la représentation de la banlieue ou encore les textes d’activistes noirs. Ces différentes thématiques sont parfois mises en dialogue avec des archives et documents dans ses pièces. Rouabhi créé également des pièces de théâtre pour le jeune public et anime de nombreux ateliers d’écriture en milieu carcéral et scolaire en France et à l’étranger, notamment à Ramallah et à Bethléem.
On fait du théâtre pour des gens. Ça parait bête mais on travaille pour un public. Et moi, j'écris pour des acteurs. C'est très particulier. On a un rapport continuel, c'est un fil qui ne doit pas se briser. Sans ça, ça n'a pas de sens. On n'écrit pas du théâtre pour que ça soit lu, on écrit du théâtre pour que ça soit joué. Cette littérature, elle doit prendre corps, être vivante, bouger.
Son actualité : Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin, texte de Mohamed Rouabhi, mis en scène par Sylvie Orcier, du 23 septembre au 3 octobre à la MC93
En tournée : le 12 septembre au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Châtenay-Malabry ; le 13 novembre au Théâtre Le Scénograph à Saint-Céré; le 19 novembre au Théâtre Le Canal à Redon, du 25 au 27 mars au Théâtre-Sénart à Lieusaint.
Présentation : Depuis une trentaine d’années, Jean-Noël Moulin vit reclus dans les bois seul avec son chien. Une nuit, il apprend par les ondes que l’avion qui transportait le « Président » a percuté la montagne...
Sons diffusés pendant l'émission :
Mahmoud Darwich qui lit un de ses poèmes, extrait d’un documentaire de Simone Bitton et Elias Sanbar (1997).
Allocution de Bertrand Lamber, marche sur le LARZAC organisée par les Paysans-Travailleurs (25 et 26 août 1973). Mis en ligne sur Soundclound par Mohamed Rouabhi.
Archive d'un entretien entre Jean-Pierre Elkabach et Maurice Papon en octobre 1991, diffusé sur la Cinq.
Charles Mingus, « Non sectarian blues », album : Dave Brubeck : « Summit Sessions » (1971).
Générique de l’émission : Succession, Season 1 (HBO Original Series Soundtrack) de Nicholas Britel.
Mohamed Rouabhi• Crédits : © Guillaume Durieux

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 9:43 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde publié le 15 septembre 2020 Au Théâtre de l’Atelier à Paris, Peter Stein met en scène Jacques Weber dans trois courtes pièces de l’auteur russe. Des cheveux hirsutes, une barbe folle, un regard égaré : sur l’affiche du Théâtre de l’Atelier à Paris, le visage de Jacques Weber est à peine reconnaissable. On pourrait penser qu’il joue Lear. Il joue Svetlovidov, un vieil acteur citant Lear, dans une pièce de Tchekhov, Le Chant du cygne, qui est présentée avec Les Méfaits du tabac et Une demande en mariage, sous le titre de « Crise de nerfs ». C’est un plaisir de voir réunies ces trois pièces dans une soirée qui scelle l’entente entre un acteur et un metteur en scène d’exception, Jacques Weber et Peter Stein. Depuis leur première rencontre, à l’occasion du Prix Martin, d’Eugène Labiche, à l’Odéon, en 2013, ils ont abordé Beckett, avec La Dernière Bande, en 2016, et Molière, avec Tartuffe, en 2018. Mais jamais ils ne se sont aussi bien accordés. Lire l’entretien (en 2005) : Peter Stein : "J'ai toujours dû me battre contre" Peter Stein a vécu vingt ans en compagnie d’Anton Tchekhov. Il a monté ses grandes pièces, il est revenu plusieurs fois à certaines d’entre elles, telle La Cerisaie, et laissé des souvenirs inoubliables, comme celui des Trois sœurs, avec la scène de la toupie dont parlent encore ceux qui l’ont vue, à Nanterre-Amandiers, en 1988. Dans Mon Tchekhov (Actes Sud-Papiers, 2002), le metteur en scène allemand, né en 1937, témoigne de l’attachement, artistique et humain, qui le lie à l’auteur russe. Avec le temps, Peter Stein a eu envie d’aller vers les « petites » pièces de Tchekhov. Pour lui, elles contiennent en germe les chefs-d’œuvre, et elles offrent une liberté de ton dont il fait son miel dans Crise de nerfs. Morceaux de bravoure Un vieil acteur qui s’est endormi dans un théâtre (Le Chant du cygne). Un pseudo-conférencier tétanisé par sa femme (Les Méfaits du tabac). Un propriétaire terrien, sa fille et leur voisin qui se disputent bêtement (La Demande en mariage). Les personnages de ces pièces sont loin d’être des héros. Ils ont leur lot de faiblesse, de lâcheté, de bêtise et de bizarrerie. Mais Tchekhov observe avec l’humanité teintée de cet humour fataliste qui lui est propre, et nous les rend proches. Jacques Weber, qui aborde Tchekhov pour la première fois, passe d’un rôle à l’autre en grand acteur aguerri : c’est un colosse sensible, un intempestif discret Si le vieil acteur s’est endormi, c’est parce qu’il avait trop bu après la représentation. Il se retrouve seul dans le théâtre avec le souffleur, qui tente de le convaincre de rentrer chez lui. Il ne veut pas. Personne ne l’attend, il est vieux, et il regarde la fosse en se disant qu’elle a englouti sa vie et son talent. A cet homme, ce pauvre Lear du théâtre, en bout de course, Jacques Weber donne une puissance dévastée, à l’image de sa forte stature ployant sous un visage au teint crayeux. Dans Les Méfaits du tabac, il se redresse, mais comme un âne battu. Fini la tignasse et l’air hagard de Svetlovidov, le vieil acteur. Jacques Weber endosse le rôle de Nioukhine avec des cheveux teintés et des favoris. Il est censé donner une conférence sur le tabac mais, très vite, il bifurque sur son épouse qui le traite comme un moins que rien. Jacques Weber s’en donne à cœur joie. Puis le voilà sans fard, chaussé de bottes et élégamment vêtu, en père d’une Natalia dont le voisin, Lomov, vient demander la main. Jacques Weber s’efface alors devant les deux jeunes comédiens, Loïc Mobihan et Manon Combes, à qui reviennent les morceaux de bravoure. Ces morceaux de bravoure reposent sur l’expression d’une nervosité qui atteint les personnages des trois pièces et se manifeste de diverses manières – crise d’asthme, jambe qui tremble, gémissements, logorrhée, bafouillement… La mise en scène de Peter Stein pointe ce côté farcesque qui met en branle l’incontrôlable, et donne un fameux grain à moudre aux comédiens. Encore faut-il maîtriser cet équilibre instable dans le jeu. Jacques Weber, qui aborde Tchekhov pour la première fois, passe d’un rôle à l’autre en grand acteur aguerri : c’est un colosse sensible, un intempestif discret. Il y a une grande beauté, et une belle élégance dans sa façon d’accompagner Loïc Mobihan et Manon Combes, une comédienne éclatante qui provoque l’hilarité dans la salle. Car, plus le temps passe, plus l’on rit, dans cette Crise de nerfs. Ce n’est pas le moindre mérite de la soirée. Surtout en ce moment. Crise de nerfs (trois pièces d’Anton Tchekhov), mise en scène de Peter Stein. Avec Jacques Weber, Manon Combes et Loïc Mobihan (1 h 35). Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, Paris 18e, Tél. : 01-46-06-49-24. Du mardi au samedi à 21 heures, le dimanche à 17 heures. De 25 € à 43 €. Le spectacle, prévu jusqu’au début janvier 2021, fait relâche à certaines dates, et se joue en province (voir les villes et les dates sur Theatre-atelier.com). Brigitte Salino Légende photo : Jacques Weber dans « Crise de nerfs », une soirée avec trois courtes pièces de Tchekhov, mise en scène par Peter Stein. Le 18 septembre 2020, au Théâtre de l’Atelier, à Paris. MARIA-LETIZIA PIANTONI

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 23, 2020 7:49 PM
|
par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 23 sept. 2020 De nouveaux élus municipaux entendent orienter les choix des théâtres de leur cité
De Lorient à Lunéville, maires et adjoints à la culture veulent intervenir dans le choix des spectacles des théâtres de leur ville à la programmation qualifiée d’« élitaire ». Vous avez dit « populaire » ? Comme c’est populiste.
Rien de commun, semble-t-il, entre Lorient, chef-lieu du Morbihan, et Lunéville, sous-préfecture de Meurthe et Moselle. Rien de commun entre, d’un côté le gros EEPC (établissement public de coopération culturelle) qui réunit le théâtre de Lorient et le Cendre dramatique national et, de l’autre, le Théâtre de la Méridienne, petite scène conventionnée « pour les écritures scéniques croisées » de Lunéville. Sauf qu’aux dernières élections municipales, ces deux villes ont changé de têtes, des nouveaux maires et adjoint.e.s à la Culture qui, avant, piaffaient dans l’opposition. Et ont été élus avec une courte avance. Fabrice Loher (UDI), nouveau maire de Lorient, et son adjointe à la Culture Aurélie Martorell d’un coté, et de l’autre, à Lunéville, Madame le maire Catherine Paillard (Républicains et divers droites, ancienne première adjointe) et son adjointe à la Culture et au Patrimoine, Virginie Genot.
A Lunéville comme à Alfortville (lire ici), la programmation de la nouvelle saison du Théâtre de la Méridienne a été arrêtée au 31 décembre en attendant le résultat d’un audit visant à « prendre connaissance de ce qui peut le mieux correspondre aux attentes des Lunévillois.es ». Ce qui nous vaut un double éditorial dans la plaquette qui se limite donc à un début de saison et ne présage rien de bon pour la suite tant une saison se prépare en partie à l’avance. Un éditorial signé Virginie Genot qui est aussi la présidente du conseil d’administration du Théâtre de la Méridienne, conseil largement remanié par Madame le nouveau maire : « Depuis que je suis adjointe à la Culture, écrit-elle, nombreux sont les Lunévillois qui m’interrogent sur la programmation théâtrale et qui me demandent si elle va changer. » Le second édito est signé par Yohann Mehay, directeur du théâtre de la Méridienne en poste depuis plus de six ans et qui écrit devoir faire face à une « double réalité : d’un côté, “l’imprévisible contexte sanitaire” et de l’autre, « les “prochaines décisions municipales” tout aussi imprévisibles ». La ville finance le théâtre à hauteur de 80 %.
Le Théâtre de la Méridienne affiche un enviable taux de fréquentation de 80 %. Et il faut ajouter à la programmation les activités, moins visibles mais précieuses, menées auprès des écoles, des quartiers, la mise en place de projets participatifs, etc. Tout cela a bien dû contenter bon nombre de Lunévillois, lesquels se sont d’ailleurs manifestés lors de la présentation de saison en scandant le slogan : « Nous voulons une saison pour de bon », rapporte L’Est républicain. Va-t-on vers une municipalisation du Théâtre de la Méridienne ? L’éviction ou la mise en retrait de son directeur au bilan pourtant bon ? La nomination d’une personne façonnant une programmation laissant davantage de place au théâtre privé et aux artistes « vus à la télé » ?
Comme il est loin, le temps où en prenant la direction du Théâtre national de Chaillot, Antoine Vitez disait vouloir faire du « théâtre élitaire pour tous ». Ce qu’il fit dès la première année en mettant scène deux classiques (de façon nullement « classique »), Hamlet et Faust, et Tombeau pour cinq cent mille soldats de Pierre Guyotat. Elitaire (sous-entendu : « pour quelques-uns »). Le mot « élitaire » et sa cohorte de fantasmes font la navette entre Lunéville et Lorient.
Après six mois de fermeture, le CDN de Lorient a rouvert avec la compagnie Baro d’Evel en extérieur, spectacle accompagné d’impromptus dans les quartiers Frébault et à Kervénance. Un beau succès public. Elitaires, les danseurs et circassiens du Baro d’Evel ? Populaires, assurément, mais sans doute pas dans le sens où l’entendent le maire et son adjointe à la Culture disant vouloir « diversifier la programmation du Grand Théâtre pour tout public » et avoir une « ouverture » vers des spectacles « plus populaires ». Ça veut dire quoi ? Des Bigard par pelletées ? Du théâtre de boulevard ? Des artistes estampillés « vus de la télé » ? Des spectacles en breton ?
La convention qui relie la ville à l’EPCC est arrivée à échéance. La ville l’a prolongée jusqu’à la fin de l’année (décidément), le temps de discuter. Rodolphe Dana, artiste-directeur, et Frédérique Payn, directrice adjointe chargée de la programmation, rencontreront le maire et son adjointe à la Culture le 14 octobre. La prochaine création de l’équipe artistique aura lieu, elle, le 4 novembre. Une adaptation de la formidable nouvelle d’Hermann Melville Bartleby. Populaire ou élitaire, Melville ? Popélitaire, peut-être? Que dit Bartleby ? « Je préférerais ne pas. »
Et, personnellement, je préférerais ne pas devoir écrire des papiers de la sorte. D’autant que les clivages politiques ne sont plus un filtre éclairant. Alfortville (PS) et Lunéville (divers droites), c’est tout comme. Ou encore ceci : qui a dit, parlant du directeur d’un festival qui se déroule dans sa ville : « Je n’ai pas à m’immiscer dans sa ligne politique » ? Louis Aliot, politicard finaud, le nouveau maire (RN) de Perpignan à propos du directeur de Visa pour l’image, lequel avait dit qu’il s’en irait si Aliot était élu. Pas toujours simple, la vie de ceux qui dirigent un établissement culturel, par les temps qui courent... Jean-Pierre Thibaudat

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 21, 2020 5:59 PM
|
Par Véronique Hotte dans Théâtre du blog - 21 septembre 2020 Les Pièces manquantes (puzzle théâtral), création collective, mise en scène d’Adrien Béal
Le spectacle a été créé à partir du puzzle inventé à L’Atelier du Plateau en juin/juillet 2019, au Féria, Festival à débordement dans le XIX ème arrondissement de Paris. Avec ses fidèles Pierre Devérines, Boutaïna El Fekkak, Adèle Jayle, Julie Lesgages, Etienne Parc et Cyril Texier, ce metteur en scène inspiré et son Théâtre Déplié qu’accompagne une fanfare de jeunes amateurs issue du Conservatoire de cet arrondissement, inventent un puzzle théâtral, avec récits et musiques…
Pour les soirées uniques de Pièces manquantes, le spectacle repart à zéro, avec, à chaque fois, le défi toujours d’aller plus loin pour semer, en vingt-huit soirées singulières, les termes complémentaires d’une enquête réordonnée. Dans la perspective et la distance, le collectif joue de multiples éléments que notre logique doit assembler pour reconstituer la réalité des faits. Selon Adrien Béal, meneur de jeu, chaque soirée est composée de certaines de ces pièces, écrites ou improvisées, avec un titre, des spécificités, invariants et imprévus. Le public compose avec les plans et les manques de ce soir-là différemment dans le puzzle avec des pièces supplémentaires de puzzle et partage avec les acteurs l’expérience d’une remise en jeu.
Soit telle la toile mythique de Pénélope, un ouvrage grandement élaboré, jamais terminé et qui doit sans cesse être repris. Pour essayer de voir à travers tel motif ou telle pièce l’ensemble du tableau sur le métier, il faut aller et venir, circuler sur le plateau en tri-frontal et si possible, recoller les morceaux. Le geste interroge le cheminement spatial, que ce soit celui de notre pensée ou celui des acteurs en entraînant derrière eux la pensée vagabonde du public allant et venant ici et là, amorçant des départs et faisant retour, comme si l’imagination cheminait encore à l’intérieur d’une fresque.
La représentation du 20 septembre Comment vivent les autres commence par l’évocation d’une disparition : celle d’une ado sans problème et encore enfant, selon sa belle-mère, même si on apprend peu à peu qu’elle soutirait de l’argent à son père pour les moindres menus travaux domestiques accomplis. Les parents sont bientôt confrontés à d’autres dont la situation est similaire : leurs jumeaux de quinze ans, un garçon et une fille, ne sont pas rentrés chez eux. Mêmes interrogations, mêmes angoisses et mêmes craintes de disparition ou d’enlèvement, avant que ne se dessine grâce à des messages, l’éventualité d’un geste individuel pour rompre les ponts avec leurs père et mère.
Les quatre premiers parents sont rejoints par un cinquième qui élève sa fille seule, et la mère du premier adolescent évoqué, soit six adultes en proie à un malaise et plongés dans une attente glaçante, ont le cœur serré et l’âme en perdition. Les acteurs aguerris, jouant de l’art énigmatique de l’attente, entre silences installés et verbe bégayant ou éloquent, sont saisis de mouvements de culpabilité et de remise en question de soi, proches d’un public ému qui partage leur inquiétude. Puis, le récit bifurquera sur une évocation du premier père qui, fumeur régulier, s’installe dans le noir, à la fenêtre de son appartement pour saisir la vie des autres. L’idée de puzzle avec ses pièces manquantes s’impose à l’attention du public : Cyril Texier décrit ainsi l’appartement d’en face avec ses pièces agencées. Une mise en abyme, une métaphore du spectacle lui-même en son entier, puisqu’il imagine la vie des autres, selon un calcul de probabilités auquel s’essaie le locuteur. On pense à Georges Perec qui traite de son projet La Vie mode d’emploi dans Espèces d’espaces : « J’imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée… de telle sorte que, du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade, soient instantanément et simultanément visibles. »
Des personnages se dessinent à partir de la fiction proposée: un couple battrait de l’aile et dormirait dans des pièces séparées, à moins qu’un frère et une sœur n’aient ici chacun leur chambre. Puis est évoquée dans ce même appartement une scène de réunion après la disparition d’un être cher. Puis, on apprend la «libération» d’un jeune couple vivant dans l’appartement parental, peu après les décès successifs du père et de la mère. Le couple initial ? Le narrateur évoque en guise de dénouement, le baiser réconciliant les jeunes gens.Ruse, piège et illusion suivent les lois du hasard et de la préméditation. Le public est le créateur, au même titre que l’acteur, de sa propre fiction intérieure. La fanfare des instruments à vent d’une jeune génération arrive pour jouer aux quatre coins de la salle, représentant, de fait, les adolescents énigmatiques disparus. Puis réunis sur le plateau, ils sont dirigés par leur professeur de musique, qui, amoureuse d’un élève, hésite entre la vie et la mort. Et dans une scène étrange, ses parents viendront reconnaître le corps…
Un spectacle de théâtre complice et de grande proximité entre comédiens et spectateurs généreux. On attend avec impatience que ce collectif s’épanouisse dans une œuvre achevée… à moins qu’il ne veuille nous instiller le manque et la frustration comme seul point de repère.
Véronique Hotte
Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, route du Champ de Manœuvre, jusqu’au 18 octobre. T.: 01 43 28 36 36

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 6:06 PM
|
Par Fabienne Arvers dans les Inrocks le 11 septembre 2020 En dirigeant l'écrivain dans Qui a tué mon père, Thomas Ostermeier éclaire le texte dans ses soubassements les plus profonds : l’enfance perdue et retrouvée. C’est comme une trilogie, montée dans l’urgence d’une confrontation avec le réel, passée au filtre de l’autobiographie pour en pointer, à travers son aspect individuel, sa dimension collective, sa portée symbolique et politique. Après avoir porté au plateau Retour à Reims de Didier Eribon en 2019 et Histoire de la violence d’Edouard Louis en janvier 2020, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier est de retour à Paris pour la création de Qui a tué mon père, le dernier texte d’Edouard Louis, paru en 2018. A cette différence près que, cette fois-ci, l’auteur incarne sur le plateau son propre récit. Une mise en abyme comme seul le théâtre en a le secret, où l’acteur interprétant le personnage qui se tient devant nous en est également l’auteur et le dramaturge. On découvre un acteur au “talent fou”, nous dit Thomas Ostermeier De l’écrivain, le plateau nous montre sa table de travail et son ordinateur. S’y trouve aussi un fauteuil, placé dos au public, recouvert d’une couverture. La place du père, le lieu de son absence aussi, à qui s’adresse le fils dans son livre et qui est non seulement le sujet du récit mais aussi l’objet de la dénonciation à laquelle se livre l’auteur : “Qu’est-ce que c’est d’avoir un corps détruit par la politique ? Avoir un certain corps, dans le monde social, c’est être exposé à une destruction prématurée”, constate Edouard Louis. Plus énigmatiques, trônent encore des micros et de drôles d’accessoires qui prendront vie, bientôt. En arrière-plan, des images défilent sur un écran, comme le reflet du paysage mental d’où surgissent les souvenirs d’enfance d’Edouard Louis. Routes plongées dans le brouillard, maisons de briques ternes, champs nus aux buissons rabougris ou des photos de famille qui éclairent le voyage intérieur auquel se livre l’acteur sur le plateau. A la logique du livre répond celle du théâtre. >> A lire aussi : Edouard Louis : “Chaque personne qui insultait un Gilet jaune insultait mon père” Alors, Edouard Louis s’en donne à cœur joie pour entrecouper son récit de séquences où il danse et chante en play-back, se travestit d’une perruque blonde et d’une minijupe et se déhanche allègrement, retrouvant les hits de son enfance, de Barbie Girl d’Aqua à (Hit Me) Baby, One More Time de Britney Spears, ou My Heart Will Go On de Céline Dion. A ces moments-là, des couleurs éclaboussent le noir et blanc des images projetées sur l’écran et irradient le plateau. On y découvre aussi un acteur au “talent fou”, nous dit Thomas Ostermeier. Passeur d'émotions On en revient alors à la genèse du projet. Edouard Louis avait proposé au metteur en scène de monter son texte. Mais Thomas Ostermeier ne trouvait pas, dans sa troupe, le bon acteur : “Finalement, j’ai pensé que la meilleure idée, ce serait de le faire avec Edouard lui-même. Je me souviens très bien : j’ai encore la vidéo de la première mondiale de Retour à Reims à Manchester. Edouard, Geoffroy de Lagasnerie et Didier Eribon sont venus et, après le spectacle, Edouard est monté sur scène et il a joué le rôle de Nina Hoss (rires). Pour moi, le plus important, c’est le fait qu’il interprète son histoire. On revient aux sources du théâtre.” >> A lire aussi : “Retour à Reims”, l'adaptation scénique inventive de Thomas Ostermeier Pour Edouard Louis, le théâtre offre une opportunité unique : “Tout le monde sait ce que je raconte dans le livre. La question devient presque plus esthétique que politique : comment trouver une forme pour confronter les gens à ce qu’ils savent déjà mais qu’ils ne veulent pas voir ? De ce point de vue-là, le théâtre est pour moi encore plus fort que l’écrit à travers la présence des gens dans la salle.” Il y fait aussi l’apprentissage de l’art de l’acteur, passeur d’une émotion destinée au public : “Quand on a commencé à travailler, j’avais tendance à pousser et à montrer mes émotions dans le jeu. Mais Thomas me disait toujours : ‘ Laisse-nous la ressentir. Ne nous l’impose pas. Si tu nous le racontes simplement, l’émotion viendra de nous. C’est le réel qui est insupportable, émouvant de tristesse, de colère et de beauté.” Emouvante aussi est l’incroyable énergie dont fait preuve Edouard Louis, ce moteur du désir que l’enfant a dû réprimer et qu’il exprime, en la décuplant, pour se rapprocher de son père et que la honte, jusqu’alors, empêchait. Au final, le spectacle s’avère le portrait croisé d’un père et de son fils dont le metteur en scène a tissé les ressemblances. Un contrepoint politique fort à une relation entachée par l’idéologie masculine, par le travail et par des réformes politiques assassines. Qui a tué mon père d’Edouard Louis, mise en scène Thomas Ostermeier. Jusqu'au 26 septembre, théâtre des Abbesses, Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 3:59 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 19 septembre 2020
Après « Un démocrate », consacré à celui qui pensa la propagande, l’auteure, metteuse en scène et comédienne s’intéresse, avec « Bananas (and kings) », à la fortune que la culture du fruit en Amérique Latine offrit à quelques cyniques, dévastant populations indiennes et paysages.
Elle possède de l’audace et une maîtrise de l’art du théâtre qui sont bien réconfortantes en une période où la faiblesse des propositions est frappante. Julie Timmerman est une artiste remarquable. Elle a été comédienne en herbe, elle est devenue une femme de tête qui n’a jamais abdiqué une sensibilité extrême. Après Un démocrate –un livre complété d’un dossier très intéressant vient de paraître- Julie Timmerman poursuit son questionnement, par le théâtre même, d’épopées qui se sont dessinées grâce aux injonctions d’un monde capitalistique et sans états d’âme. Avec Bananas (and kings) , elle réussit, dans le même style, une plongée hallucinante dans le monde qu’elle évoquait rapidement dans Un démocrate. Elle y évoquait des faits qui sont la conclusion de Bananas, son dénouement, presque. Guatemala 1954 : un coup d’Etat est ourdi par la CIA et la très puissante United Fruit Company. Ce qui est très aigu dans le travail de Julie Timmerman, c’est qu’elle nous apprend, sans leçon rigide, comment les multinationales ont pu commencer à grignoter le pouvoir des Etats, dans l’unique pensée de leur profit financier. On ne vous résumera pas ici les faits et moins encore la manière dont l’auteure et metteuse en scène conduit son récit. Elle le développe avec intelligence et efficacité, sans jamais amoindrir le charme consubstantiel au théâtre. Avec quatre comédiens –elle évidemment et aussi Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, en s’appuyant sur une équipe artistique et technique de premier plan (décor, lumière, son, vidéo, musique, costumes), elle nous captive. Quatre pour quarante-trois personnages. Du XIXème siècle aux années soixante, on voit grandir une société tentaculaire et toxique, la United Fruit Company. On la vit détruire les Indiens, les réduire, les ruiner, les exploiter, les déposséder, pour pratiquer l’ultra culture de la banane et agir sur tous les rouages des pays utiles à ce déploiement arasant. Des pouvoirs de la communication, de la propagande, dans Un démocrate, à celui des atroces connivences dans Bananas, Julie Timmerman, mine de rien, écrit des pièces fortes, puissantes. Disons-le, en cette très morose rentrée qui offre une cascade de gentils essais d’un intérêt plus que faible, Bananas est un véritable morceau de théâtre, palpitant et enthousiasmant. Pas le temps aujourd’hui d’analyser les passages d’un mouvement à l’autre, d’un personnage à l’autre –Julie aime les personnages de garçons !- , pas le temps de louer dramaturge et collaborateur artistique. On y reviendra, Un seul mot : allez-y ! Du théâtre exigeant, élitaire pour tous, comme on le dit, reprenant Antoine Vitez. Allez-y et nous y reviendrons… Théâtre de la Reine Blanche, du mercredi au samedi à 21h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h50 sans entracte. Jusqu’au 1er novembre. Tél : 01 40 05 06 96. Lisez l’ouvrage consacré à la pièce précédente « Un démocrate », ou le parcours d’Edward Bernays, « petit prince de la propagande ». C&F éditions –Caen master édition. 18€. reservation@scenesblanches.com https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/bananas-and-kings Légende photo : Les Indiens, tous les Indiens en un personnage, femme-fantôme qui témoigne des faits. DR Photo de Pascal Gély.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 12:04 PM
|
Par Guillaume Tion dans Libération- 10 septembre 2020 L’Encyclopédie de la parole a tiré de son corpus d’enregistrements de phrases quotidiennes plusieurs spectacles musicaux, joués au Festival d’automne. Rencontre avec ces experts du langage en plein débat sur l’éventualité d’ajouter à leurs références un poème en arabe égyptien ou un prof bulgare en train de péter les plombs. La parole a une encyclopédie. Fréquemment s’y glissent de nouvelles entrées : des documents enregistrés comme des sons officiels, des ambiances de villes prises à la volée, des dialogues au sein d’un couple… Du facteur qui taille le bout de gras en délivrant un recommandé à un ado qui joue à Fortnite, tous font partie d’un vaste corpus mis en ligne, mais aussi mis en scène et en musique, par l’Encyclopédie de la parole, la compagnie fondée par Joris Lacoste, qui associe comédiens, musiciens et chercheurs de la langue, «même si nous n’avons rien de scientifique». Comment sont sélectionnés ces documents ? Définis ? Classés ? Certainement pas en fonction de ce qui est dit, mais de comment c’est dit : avec quelle musicalité, quelle cadence, s’exprime donc le commentateur sportif brésilien ou Françoise Sagan en pleine conférence ? La question a fait naître une tripotée de spectacles depuis une grosse décennie, des mises en voix incongrues et passionnantes que nous aurons le plaisir de voir ou revoir au Festival d’automne à Paris, mini-saison francilienne qui consacre cette année une grande rétrospective à ces obsédés des façons de parler. En attendant, nous voici dans le hall des Laboratoires d’Aubervilliers, à l’endroit même où l’équipe de Joris Lacoste avait commencé en 2007 à consigner ses premiers documents sonores. Aujourd’hui s’organise une «ruche». Durant cet événement quasi historique, qui se produit une à deux fois par an, les piliers de la compagnie et quelques invités écoutent des sons et les jugent dignes ou non de rejoindre le bon millier de références déjà accessibles sur leur site. «L’intégration suit trois étapes, explique Lacoste, une bouteille de limonade allemande Bionade à la main. Les accepter ou non ? Sous quelle entrée ? Avec quelle durée, quelle coupe, quel titre ?» A l’extérieur des Labos, deux poules se baladent et passent parfois une tête dans le théâtre. Autour de Lacoste, parmi les apiculteurs du langage, Nicolas Rollet, universitaire, maître de conférences en analyse conversationnelle, «enseigne la sociologie interactionniste, la façon dont on peut analyser les interactions sociales avec de la vidéo». Nicolas a développé un goût pour la parole ordinaire et enregistre des sons depuis ses 7 ans. Membre fondateur, présent aux premières ruches, il n’a plus participé depuis près de dix ans. En face, Frédéric Danos, auteur, acteur, performeur, cuisinier à ses heures, souriant, l’œil facétieux, accompagne aussi le projet depuis ses débuts et présente au Festival d’automne le seul en scène l’Encyclopédiste. Elise Simonet, elle, arrivée en 2012 par un atelier choral, est devenue collaboratrice artistique sur toutes les Suites, ces pièces qui recomposent sur scène, avec acteurs et chef de chœur, de grandes symphonies de paroles ordinaires. Passée par un cursus mise en scène et scénographie à l’université, elle a travaillé sur l’enregistrement des rêves, allant jusqu’à débarquer chez les dormeurs avec un micro à 6 heures du matin. Des invités complètent la réunion, dont Anna Carlier et Ghita Serraj, comédiennes, la première sur la pièce Blablabla, la seconde sur la série des Jukebox (lire ci-contre). La frontière de l’emphase La session s’étale de 10 heures à 17 heures. Une unique règle les guide : les encyclopédistes se fichent donc du fond. A l’image des juges de la Cour de cassation, seule la forme les intéresse : le phrasé, l’intonation, la mélodie de la parole ont leur priorité. Prenons ce document sonore, un des candidats du jour. Visiblement, l’enregistrement de ce type au bord de la crise cardiaque qui appelle sans cesse le Samu, lequel s’en balance, ça ne les intéresse pas : «Moi, ça me met mal à l’aise, j’ai pas envie d’écouter ça», s’énerve Frédéric ; «Pourrait-on revenir aux sujets qui sont les nôtres ? Formellement, il n’y a rien qui soit à ce point remarquable», note Elise. Le document sera classé «double fond». Viré. Pour définir la forme de la parole, l’équipe a élaboré un système de références qui lui permet de typer chaque son, ce qu’ils appellent les «entrées» : choralités, compression, saturation, répétitions, sympathies, série… la liste compte 20 descripteurs dont les plus fréquents sont la projection (s’adresser à un locuteur absent, type message sur un répondeur), la répétition («réitération d’une locution, d’un mot, voire d’une syllabe»), les cadences («opération par laquelle la parole tend à organiser ses accents toniques selon un patron régulier») ou encore l’emphase, une caractéristique qui va bien, par exemple, au commentateur de match de foot brésilien mais qui, ce jour-là, pose quelques problèmes. Début de polémique «Nous passons à un poème en arabe égyptien qui est tiré d’une émission de télé, apparemment une émission littéraire.» Après une écoute religieuse du poème, dont la diction bondissante et on ne peut plus cadencée fait secouer les têtes en rythme, rappelant les scansions des poésies occidentales et les carrures des octosyllabes ou des alexandrins, l’affaire dérape. Anna, la comédienne, entend, dans certains «a», comme un accent très prononcé et propose de classer le document à la fois dans l’entrée «cadences» mais également dans «emphase». «Pourquoi pas, mais ce ne serait pas une emphase dramatique car le poème est léger», analyse Nicolas. Cette description audacieuse modifierait la façon traditionnelle de considérer l’emphase : on imagine Sarah Bernhardt et on tombe sur une poétesse rigolote. «Oui, mais précisément : si c’est gai, est-ce emphatique ?» se demande Frédéric, assez prompt à soulever des points de détail que les autres aimeraient survoler. Dilemme. «Comparons en écoutant une récitation emphatique en chinois», propose Joris, qui a effectivement dans son ordi une «récitation emphatique en chinois». «Des amis chinois m’ont expliqué que le locuteur exagérait absolument tout.» Bon. Après avoir décortiqué l’emphase en chinois, retour à la possible emphase en arabe égyptien qui, à l’oreille, n’a rien à voir. Nicolas a soudain un doute : «Surjouer le côté sautillant comme elle le fait apporte-t-il une emphase, en réalité ?» Rapportons-nous à la définition de l’emphase telle que consignée dans leur charte : «Phénomène par lequel une parole s’exhibe, s’écoute, s’expose, se donne en représentation.» Frédéric, jamais en retard, pointe : «A ce moment-là, dès qu’il y a théâtre il y a emphase.» Début de polémique. Si le théâtre produit nécessairement de l’emphase, alors vérifions-le. Avec Romain Duris dans le Bourgeois gentilhomme. Oui, Joris Lacoste a aussi cela dans son ordi. «Dans la définition, on dit que le locuteur s’écoute. Moi, je ne trouve pas vraiment que Duris s’écoute», analyse Joris. La différence entre l’emphase et l’interprétation tiendrait au fait de savoir, en faisant de l’emphase, qu’on fait de l’emphase. Joie saine et positive Où est donc la frontière de l’emphase, quels sont ses contours ? Retour à la notice. Rien de plus éclairant. Alors on écoute du Frédéric Mitterrand, grand emphatique devant l’éternel, dans un son où il ne l’est pas vraiment et qui se trouve toujours dans l’ordi de Joris. «C’est de l’emphase retenue, ça ne compte pas», entend-on. Silence. «Ecoutez, finit Nicolas. Moi, j’aime bien que ce soit classé dans emphase. C’est mon dernier mot. Si vous n’êtes pas d’accord, je propose qu’on vote.» Les autres haussent les épaules. «Mais non, si tu veux emphase, classe-le à emphase. Pas de problème.» A moins que ça n’ait changé depuis, ce son est classé à «cadences», «mélodie», «emphase». Une mini-révolution. Ces discussions pour le bien de la cause tournent parfois en rond. L’amour de la contradiction. Exemple, à propos du son d’un homme parlant lentement dans la nuit, à voix basse monocorde : «C’est timbré, mais par détimbrage», sourit Frédéric. «Donc tous les chuchotements deviennent du timbre pour toi !» s’offusque Elise. «Le fait que ce ne soit pas timbré est précisément une forme de timbre», constate Joris. «C’est vous deux qui êtes timbrés», conclut Elise. Et l’on sent sous ces dialogues des sous-textes vieux d’une décennie rejaillissant au bout de fleurets mouchetés, autant qu’une joie saine et positive de se prendre la tronche sur des sujets passionnants concernant la sémiologie. Mais aussi sur le port du masque. Faut-il le garder pour la photo qui ouvre ces pages ? Quelle est notre distanciation ? Trente minutes de débats brillants ont opposé, avant le début de la «ruche», une représentation naturaliste du monde du travail dans Libé et le nécessaire souci d’une mise en scène éloquente par sa synthèse. Dans ce temple de la parole, tout est prétexte à générer des flots de discussion. Tempérés d’une seconde à l’autre par des tunnels d’écoute silencieuse. Ont été élus, ce jour-là, par les tympans experts de nos apiculteurs, un son du Youtubeur Francis CG («Merci de nous avoir infligé ça…»), le prêche antidarwinien d’un Colombien de 6 ans (entrée «timbre» et «saturation»), un critique d’art berlusconiste qui s’emporte dans un amphi («Boah, c’est un Italien qui crie quoi», «C’est très fasciste quand même !»), une prof de statistiques qui pète les plombs en Bulgarie («De l’emphase ? Non, car c’est aussi une mise en scène de soi-même, là elle n’est pas consciente»), le retour de Gary, le vagabond des cimes («Dommage, c’est trop court»). On s’est éclipsé avant un son chuchoté en coréen, mais juste après l’entrée du premier son datant de 2020, un discours de la reine Elizabeth. «Validé.» Guillaume Tion Photo Iorgis Matyassy L’Encyclopédie de la parole Au Festival d’automne (Paris) Suite n°1 du 2 au 4 octobre Jukebox du 2 octobre au 28 novembre Parlement du 8 au 14 octobre blablabla du 17 octobre au 30 janvier L’encyclopédiste du 5 novembre au 19 janvier Suite n°2 du 5 au 8 novembre Suite n°4 du 19 au 22 novembre Suite n°3 du 15 au 18 décembre Légende photo : Les artistes de l’Encyclopédie de la parole au travail, le 14 septembre, aux Laboratoires d’Aubervilliers. Photo Iorgis Matyassy pour Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2020 7:51 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 18 sept. 2020 Onéguine d’après Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine, traduction André Markowicz, mise en scène de Jean Bellorini, réalisation sonore Sébastien Trouvé.
Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine, composé entre 1821 et 1831, est un roman en vers, un classique de la littérature russe, aux accents romantiques exacerbés, sentis par des âmes aux prises avec l’amour, la solitude, le mal-être.
Goût aussi de la poésie, de la vie mondaine et de la fréquentation des âmes bien nées.
De son côté, l’enjeu de Jean Bellorini, directeur engagé du Théâtre Gérard Philippe – CDN de Saint-Denis – et metteur en scène inscrit dans ce geste déterminé et loyal de transmettre au plus grand nombre les œuvres universelles de la littérature – afin qu’elles soient « populaires », au sens vrai du terme -, crée son bel Onéguine.
Et pour que les spectateurs goûtent au mieux les voix entêtantes d’une poésie trop souvent confidentielle, il les invite à porter un casque sonorisé, assis sur des gradins, dans un dispositif bi-frontal déplaçable dans les lieux publics, lycées, gymnases…
Tout se passe sous les yeux du public et lui est raconté en direct – les strophes versifiées marquées de mélancolie douce et de détachement léger. Cinq acteurs content l’histoire, incarnant l’auteur qui commente, et ses personnages – Clément Durand, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, Mélodie-Amy Wallet.
Ce sont les servants d’une cérémonie ludique, vêtus de sombre, avec pour décor, deux tables, des chaises, des bocaux d’airelles, des bouteilles et des chandeliers.
La réalisation sonore est enregistrée et arrangée par Sébastien Trouvé, à partir de l’opéra de Tchaïkovski, une scénographie où acteurs et public portent un casque.
Dans l’oreille du spectateur, se glissent au début de la représentation, le vent, les cloches, le bal, les danseurs sur le parquet, les pas dans la neige, les sons de la vie, les feux d’artifice qui éclatent dans une nuit éclairée d’étoiles, le trot des chevaux.
Autant de bruits qui participent de la sensation d’être vivant au monde, tout en suivant l’histoire contée, ses mouvements et les retours de l’auteur sur sa création.
Les signes auditifs sont convoqués, et l’imaginaire s’éveille à la fois à la poésie des mots et des vers d’un côté, et aux bruits fugitifs et récurrents du monde, de l’autre.
Le metteur en scène voit dans ce principe audio un acte de résistance à l’image :
« ce que l’on voit vraiment, c’est ce que l’on ne voit pas, c’est ce que l’on a en soi. »
André Markowicz s’est penché avec tact et patience sur la musique de cette langue russe – rimes et sonorité fidèles à la langue de Pouchkine -, une manière allègre de comptine versifiée et chantée sur l’ennui, la tristesse, l’amour déçu et la vie ratée.
A la fois, insolence et douceur sur les thèmes de la solitude et du tragique existentiel.
« Mais il est triste de se dire/ Qu’en vain jeunesse fut donnée, /Qu’on l’a trahie comme on respire, / Et que c’est nous qu’elle a bernés, / Que nos désirs les plus sincères, / Nos rêves les plus téméraires, / Se sont fanés, se sont pourris, … »
Les comédiens bienheureux déclament ou bien susurrent dans l’oreille du spectateur, lui parlent au plus près, lui soufflent pensées et sentiments – ceux des personnages, de l’auteur et du spectateur auditeur, au plus près de l’intimité.
Onéguine est un jeune homme de la bonne société, gâté par la vie et qui s’ennuie.
Le dandy pétersbourgeois s’ennuie et fuit le monde, s’adonnant à la lecture : il ne s’ennuie pas moins, gagné par le Spleen. L’auteur le rencontre et se lie d’amitié.
C’est lui qui conte la vie d’Onéguine aux spectateurs qui voient les différents personnages s’incarner devant lui, distribués entre les différents comédiens.
Demeurant à la campagne depuis qu’il a hérité d’un oncle, Onéguine s’ennuie jusqu’au jour où il rencontre Lenski, un jeune poète amoureux d’Olga.
Au cours d’une visite chez la belle, Onéguine rencontre sa sœur, Tatiana, demoiselle simple, vraie et naturelle, qui tombe sous le charme du Pétersbourgeois. Elle lui écrit, il lui répond qu’il ne peut l’aimer, trop enclin à entretenir sa posture de « désabusé ».
De fil en aiguille, Onéguine en viendra à tuer Lenski dans un duel que son ami a exigé après qu’il l’ait vu danser avec Olga, par désœuvrement et calcul. Le poète est mort, et Onéguine errera dans la solitude jusqu’à la fin du roman puisqu’il tombe amoureux de Tatiana à Moscou, devenue dame, et que celle-ci le rejette à son tour.
La femme est plus forte, restée fidèle à elle-même, aux campagnes et aux forêts.
L’homme ne s’est pas départi de sa posture condescendante qui le blesse plutôt.
Les acteurs sont excellents d’impertinence et d’ironie facétieuse, se moquant de qui veut se moquer, racontant et incarnant de jeunes gens joyeux et tristes, à la fois.
Ils n’hésitent pas à se passer le micro, à l’écoute intime de leurs partenaires, vifs et attentifs, tournant autour de la belle Tatiana, silencieuse, jouant à son piano. Et le public voit la boue de l’automne, les pluies fortes et la brume qui s’étend sur le pays.
Un spectacle subtil, fait de connivence souriante entre une œuvre majeure, ses passeurs sur la scène de théâtre et ses récepteurs – vision et audition – dans la salle.
Véronique Hotte
TGP – Théâtre Gérard Philipe, CDN Saint-Denis, 59 boulevard Jules Guesde 93200 – Saint-Denis, du 16 septembre au 27 septembre 2020, du lundi au samedi à 20h30, dimanche à 16h, relâche mardi. Tél : 01 48 13 70 00
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...