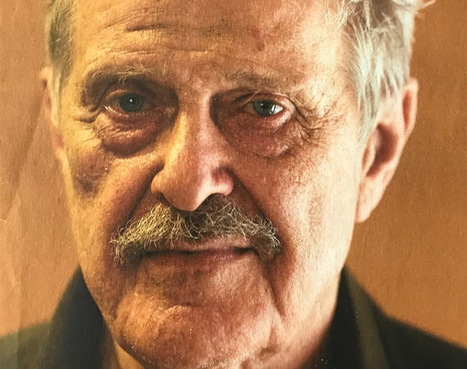Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2020 7:51 PM
|
Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires culturelles" sur France Culture, le 2 novembre 2020 Christian Benedetti, metteur en scène, scénographe mais aussi directeur du Théâtre-Studio à Alfortville, est au micro d'Arnaud Laporte. L’occasion de retracer avec lui son parcours, son imaginaire et son processus créatif.
ECOUTER L'EMISSION (1h)
Tchekhov, un amour de jeunesse
C’est au Conservatoire national supérieur d’art dramatique que Christian Benedetti découvre Tchekhov. Dès 1980, il propose une mise en scène de La Mouette en 1980 qui reçoit l’enthousiasme de son professeur et maître à penser, Antoine Vitez. Le jeune metteur en scène tente alors de monter tout Tchekhov mais en vain, le projet reste à l’état de gestation. Metteur en scène aujourd’hui aguerri, il s’est depuis aventuré du côté des auteurs contemporains. Toutefois, en prise à des doutes quant aux projets à mener, Christian Benedetti demande alors conseil à Edward Bond : « Go back home » lui répond-il. Prenant sa réponse au sens figuré et au sérieux, le metteur en scène retourne à son premier amour : Tchekhov. Le succès de sa reprise de La Mouette l’encourage à rêver de nouveau son projet d’étudiant : monter l’intégrale. Quarante acteurs ont depuis participé au projet qui a débuté en 2011, dont l’Athénée donne l’« intégrale en état futur d’achèvement ».
Tous azimuts
Le parcours de Christian Benedetti est marqué par un lien prégnant avec l’Europe de l’Est que l’artiste a notamment sillonné au gré de séjours d’études. A Moscou, il travaille avec Oleg Tabakov et Anatoli Vassiliev. Au Théâtre Katona de Budapest et à Prague, il collabore avec Otomar Krejča, acteur et metteur en scène, mais aussi dissident tchécoslovaque qui a grandement marqué sa vision de l’acteur. Benedetti a non seulement donné des cours aux Académies de Bucarest et de Sofia, mais fit aussi découvrir au public français de nombreux auteurs slaves. Fort de ces expériences, le metteur en scène ouvre en 1997 le Théâtre-Studio d’Alfortville et y œuvre en tant que bénévole, vivant de son salaire d’enseignant au conservatoire de Marseille où il est retourné pour transmettre. Il décide de s’investir en proposant des auteurs vivants qu’il associe à son espace de création: Edward Bond (Sauvés, 1997 ; Mardi, 1998 ; Onze débardeurs, 2001, Existence, 2002, Les Enfants, 2003 qu’il remonte en 2005 avec des jeunes incarcérés à Fresnes), Biljana Srbljanović, auteure dramatique serbe (Supermarché, 2003 ; La Trilogie de Belgrade, 2004 ; Amérique, suite, 2004) ou encore Gianina Cărbunariu, auteure dramatique roumaine (Stop the Tempo, 2005 ; Kebab, 2007 ; Avant-hier/Après-demain, 2009 ; La Guerre est finie, qu’est-ce qu’on fait ?, 2010). Il monte également plusieurs fois Sarah Kane, Blasted comme 4.48 Psychose.
Sur la scène politique
Motivé viscéralement par la vocation politique du théâtre – son projet de Théâtre-Studio Alfortville en est un des meilleurs exemples, et ayant été tout au long de sa carrière un revendicateur attentif aux nouvelles politiques du Ministère de la culture, Benedetti a également investi la scène politique du côté de la France Insoumise. Son engagement est aujourd’hui renforcé par l’augmentation de la censure des artistes. En témoigne sa prise de parti pour son homologue Árpád Schilling mis récemment sur la liste noire d’Orban en Hongrie.
Son actualité : Spectacles : « Tchekhov - 137 évanouissements », intégrale, prévu du 7 au 28 novembre au Théâtre de l’Athénée à Paris, textes d'Anton Tchekhov, mise en scène et scénographie Christian Benedetti. ANNULE - PROCHAINES DATES DE CREATION A VENIR
Légende photo : Christian Benedetti• Crédits : Alex Mesni

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 1, 2020 5:38 PM
|
Le billet de François Morel sur le site de France Inter - 30 octobre 2020 Je me souviens, le premier confinement, je ne l’avais pas mal pris. Il avait fait beau, on mangeait dehors. Je dinais à heure fixe, ça me changeait. Je réussissais à perdre du poids. J’écrivais. J’ai travaillé mais de manière différente. J’ai regardé des séries. Et puis surtout, j’ai profité de mes proches. Ce fut une parenthèse pas désagréable. Tous les soirs à 20h, comme tout le monde, j’applaudissais le personnel hospitalier. Je me disais que ce n’était pas si mal un pays qui, plutôt que son économie, privilégiait notamment la vie de ses vieux.
Le deuxième confinement, j’ai moins aimé. D’abord, plutôt que vers le printemps, on allait vers l’hiver. On était un peu démoralisé. On se demandait combien de temps ça allait durer, s’ils allaient bientôt réussir à trouver un vaccin. Le soir, à 20h, on n’applaudissait personne. C’est pas quand on met les radiateurs qu’on va ouvrir les fenêtres en grand.
Le troisième confinement, c’est là que la vente des chiens a explosé. C’était encore le meilleur moyen de justifier les promenades en ville. Ceux qui n’avaient pas les moyens de s’acheter un chien s’achetaient juste une laisse. Quand ils croisaient des gendarmes, ils se mettaient à courir la laisse à la main en criant Sultan ! Sultan ! Reviens ! Reviens Sultan, reviens !
Le quatrième confinement, c’était l’anniversaire de la mort de Samuel Paty. Certains ont eu l’idée, (ça partait d’une bonne intention), d’applaudir tous les soirs à 20H les professeurs des écoles, des collèges, des lycées. Ça a fait des polémiques. Certains ont pensé que ça pouvait passer pour une provocation.
Le cinquième confinement, je ne m’en souviens plus trop. Je crois que j’ai commencé à boire le premier jour et je suis resté torché pendant les six semaines. Je buvais. Parfois, je vomissais pour faire de la place. Puis je rebuvais…
C’est surtout à partir du sixième confinement que j’ai repris du poids.
Je me souviens que entre le septième et le huitième confinement, je ne suis même pas sorti de chez moi, j’avais perdu l’habitude.
Pendant le neuvième confinement, en ouvrant la fenêtre, j’ai le voisin d’en face qui travaille dans le BTP qui m’a crié « Vu votre nouvelle silhouette, vous devriez peut-être faire élargir vos portes au cas où vous auriez envie de ressortir de chez vous entre les deux prochains confinements. « De quoi je m’occupe ? » j’ai répondu en refermant la fenêtre.
Le dix-septième confinement, je me souviens, on a regardé plein de films, des vieux trucs, des comédies sentimentales. Les enfants étaient quand même étonnés, ils ne comprenaient pas quand ça finissait bien, pourquoi le monsieur et la dame, se sentaient obligés de se frotter la bouche l’une contre l’autre, parfois même de sortir la langue en guise de contentement ? « C’est dégueulasse, ils disaient, c’est pas hygiénique et puis ça sert à rien… »
On ne leur répondait pas trop, on avait peur de passer pour des parias, on avait de la nostalgie…
Voilà. J’arrive bientôt à mon vingt-troisième confinement. D’une certaine manière, ça passe vite la vie confinée quand on est dans la torpeur.
Pour les jeunes, on est des dinosaures. Ils nous demandent « Mais avant quand ça n’existait pas les confinements, qu’est-ce que vous pouviez bien faire toute la journée à traîner dehors ? Et pourquoi vous étiez obligés d’être en présentiel pour prendre un apéro avec des potes alors qu’avec Zoom c’est tellement plus pratique ?»
On fait comme si on n’entend pas.
On attend la nuit pour pouvoir faire des rêves de baisers, de poignées de mains, d'étreintes, de terrasses, de cinémas, de théâtres. Nos rêves d’aujourd’hui, c’était le quotidien d’hier.
François Morel dans son billet sur France Inter Ecouter la chronique sur le site d'Inter

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 1, 2020 8:40 AM
|
Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama
Publié le 30/10/20
Et si les théâtres restaient fermés jusqu’en janvier ? Pour le directeur du Théâtre National de Strasbourg (TNS), Stanislas Nordey, le monde du spectacle vivant est plus que jamais à cran mais n’a d’autre choix que de composer avec l’incertitude du reconfinement, à ses yeux justifié. Il se défend d’être trop complaisant vis-à-vis du gouvernement et s’exprime sur la suite de son parcours. Stanislas Nordey doit à nouveau tout chambouler de la programmation du Théâtre National de Strasbourg qu’il dirige depuis 2014. Nous l’avions déjà interrogé à l’occasion du premier confinement. Acteur et metteur en scène, il dirige l’un des six théâtres nationaux que compte l’Hexagone – le seul situé en région, dans une ville durement touchée lors de la première vague de Covid-19. Comment envisage-t-il cette deuxième période de fermeture ? Il revient sur ces huit mois de gestion de crise, par un gouvernement « qui fait ce qu’il peut », en cette période qu’il juge « grave ». Il est aussi à mi-chemin de son deuxième mandat et nous avons profité de cet entretien, réalisé ce vendredi matin 30 octobre par téléphone, pour l’interroger sur son avenir d’artiste. Comment vivez-vous ce deuxième confinement ?
Avec une certaine philosophie. Car au moment où cet arrêt nous a saisis, nous préparions une soirée en hommage à Samuel Paty, dans un geste de communion avec les enseignants de Strasbourg avec qui nous travaillons régulièrement. Croiser les questions de l’éducation avec celle de l’art et de la tolérance a toujours été au cœur de la mission du TNS. Me remettre de cette atteinte à la liberté d’enseigner m’est difficile. Car le TNS abrite lui aussi une école… Les lieux de culte sont également visés comme à Nice. Alors, face à la barbarie de ces derniers jours, cette fermeture brutale de nos salles liée à la deuxième vague de la pandémie m’a paru curieusement moins insupportable. Tuer au nom d’un dieu est atroce, et semble hélas un paramètre constant au cours des âges. Aujourd’hui, on tue au nom de l’islam, hier au nom de la chrétienté (Inquisition, croisades, conquistadors). Le théâtre peut répondre à cette violence en continuant inlassablement à prôner la parole (dissensuelle) des poètes et à la porter haut.
Quelles mesures avez-vous prises pour continuer à faire vivre le TNS ?
On a tiré les leçons du premier confinement et les équipes sont prêtes à s’organiser tout de suite en télétravail quand c’est possible. On sentait venir cette décision depuis quelques jours. Mais le changement primordial par rapport au mois de mars est de pouvoir continuer à ouvrir l’école, en travaillant avec les étudiants par petits groupes, selon des règles strictes pour les travaux pratiques. Les cours théoriques, eux, se font en ligne.
Et de pouvoir continuer à répéter avec les équipes artistiques ! On va devenir des spécialistes des spectacles congelés. On avait déjà fait cela à la sortie du confinement en mai avec Berlin mon garçon de Marie NDiaye, on continue avec le Mithridate de Racine mis en scène par Éric Vigner, où j’interprète le rôle-titre. Les spectacles que l’on devait accueillir sont d’ailleurs en répétition ailleurs en France, comme la mise en scène de La Septième de Tristan Garcia, par Marie-Christine Soma, à la MC 93 de Bobigny. On continue de travailler, de mobiliser les comédiens… Mais on recueille déjà toutes les infos sur leur disponibilités s’il y a des reports. Les spectacles de la saison 2019/2020 ont été reportés sur 2021/2022. On est obligé d’envisager déjà des bascules sur 2022/2023… Et de dégager du temps pour prévoir des reprises immédiates à partir du mois de janvier.
“On se prépare à plusieurs scénarios, comme d’habitude.” Reprendre en janvier, pas avant ?
On se prépare à plusieurs scénarios, comme d’habitude. Soit une reprise le 2 décembre avec un couvre-feu dur (19 heures). Soit, oui, une reprise en janvier seulement. Il faut s’y attendre et s’y préparer. Je pense que les théâtres ne seront sans doute pas les premiers à déconfiner. Le président a annoncé quatre semaines a minima, on sait bien ce que cela peut signifier. Ce matin, à Strasbourg, il y avait beaucoup de gens dans la rue et je ne suis pas sûr que la contamination décélère suffisamment avant janvier. Avec ces reports sans fin, comment les compagnies indépendantes vont-elles s’en sortir ?
On essaie d’atténuer tout ce qui peut l’être. Le paiement des prestations annulées d’abord, comme au printemps. Ensuite, on anticipe certains règlements pour aider la trésorerie des compagnies. On discute au cas par cas et on recase en priorité dans la programmation les plus fragiles. Depuis le début de cette crise, on a toujours protégé les plus précaires.
“Roselyne Bachelot est la ministre de la Culture la moins mauvaise en ces temps de crise.” Vous êtes d’accord avec cette décision de fermer les théâtres, alors qu’ils ont été, en majorité, exemplaires dans la conduite de la sécurité sanitaire, qu’ils n’ont pas été des clusters ? N’est-ce pas injuste ?
C’est un crève-cœur de fermer, certes, car le public depuis le début de la saison a répondu à l’appel (c’était quand même une inquiétude) et nos jauges Covid, à 70 %, ont été remplies. Même sur des propositions pas si faciles d’accès, comme les deux créations de Joris Lacoste et de Séverine Chavrier. Les spectateurs nous l’ont dit : ils étaient impatients de revenir au théâtre.
Pour autant, les théâtres sont bien « des lieux recevant du public ». Et si nous étions les seuls à ne pas fermer, il y aurait une contradiction dans les termes. Je peux donc entendre, que dans une situation anxiogène, nous soyons fermés comme les autres. D’autant plus que nous nous sentons accompagnés par Roselyne Bachelot. Elle est la ministre de la Culture la moins mauvaise en ces temps de crise. Elle a un poids médiatique, donc politique au sein du gouvernement. Même si elle n’est pas écoutée sur tout (elle s’est battue en vain pour l’assouplissement de l’heure du couvre-feu pour les spectateurs). Je fais partie de ceux qui ne remettent pas en cause la stratégie sanitaire du gouvernement : il fait ce qu’il peut et je ne suis pas sûr que les Républicains ou la France Insoumise auraient fait mieux.
Le président de la République, dans son allocution solennelle de mercredi dernier, n’a pas eu un mot pour la culture…
Il aurait dû, c’est dommage. Après, si dans les couloirs du ministère de la Culture, les choses avancent, je n’en fais pas un fromage.
La conférence qui a invité une dizaine d’artistes à s’exprimer à l’Élysée en mai dernier, à laquelle vous avez participé, n’a-t-elle pas été mise en scène de manière spectaculaire ? Ne vous êtes-vous pas senti instrumentalisé par la communication présidentielle ?
Nous ne savions pas que la dernière partie était diffusée en direct. Nous pensions que c’était à huis clos. Instrumentalisé ? Je n’en sais rien. Nous avions signé une tribune sévère pour défendre les droits des intermittents, nous allions à cette conférence avec l’objectif que ce soit gravé dans le marbre. Ce qui a été le cas. Heureusement, nous n’étions pas sur la photo. Néanmoins, nous avons regretté une telle médiatisation et l’avons dit. Emmanuel Macron avait promis de nous re-convoquer en juin et en juillet, il l’a fait en septembre. Cette fois, ce match retour a eu lieu sans caméra. Nous y avons fait le point par branches et sommes entrés dans le détail. Par exemple, j’ai tiré la sonnette d’alarme sur la paupérisation des étudiants en écoles d’art. À celle du TNS, la demande de bourse a été multipliée par dix. Et le problème a été traité par le ministère de la Culture. On nous avait assuré alors que les théâtres ne refermeraient pas…
“Quand on prend position, on s’expose à des volées en retour… Pourtant, je ne suis pas macroniste pour un sou.” Le milieu – parfois dur – vous soupçonne d’être, par stratégie personnelle, trop mesuré à l’égard du pouvoir ?
Toutes les interventions que nous avons faites, nous les artistes convoqués à ces conférences du président, nous ne les avons pas faites pour notre pomme ! Mais pour défendre les plus précaires. Et si moi, acteur du théâtre public, on me demandait de parler en faveur du théâtre privé en train de se battre pour sa survie, je le ferais aussi. Quand on prend position, on s’expose toujours à des volées en retour… Et pourtant, je ne suis pas macroniste pour un sou. Dans cette situation de crise, grave et multiple, il faut garder de la mesure. L’opportunisme de certains politiques est écœurante. Il y a une différence entre l’expression publique et les propos tenus dans la sphère privée et je ne souhaite pas fragiliser le gouvernement en ce moment. Je défends l’idée d’unité nationale. Franck Riester et Roselyne Bachelot se sont battus, chacun à leur manière. Pourquoi ne pas le reconnaître ? Sur d’autres aspects de la politique du gouvernement, j’exprimerais sans doute des idées moins favorables.
Des millions d’euros annoncés en faveur du spectacle vivant, qu’avez reçu, vous au TNS ?
On a répondu à l’appel de « l’été culturel et apprenant », en montant « La traversée de l’été du TNS » en juillet et en août. En faisant des propositions dans la rue, en allant dans des lieux où nous n’allions pas, en nous rendant dans les Ehpad. Preuve des capacités du théâtre à créer du lien quoiqu’il arrive. Nous avons reçu 250 000 euros du ministère pour une opération qui en a coûté 328 000. Le reste a été financé par nos ressources propres. 2020 verra sans doute le TNS accuser une perte de 600 000 euros, dont 450 000 sont liés au premier confinement et à la réduction des jauges, selon nos estimations de septembre. Le budget global de 12 millions d’euros tient quand même avec 20% de ressources propres et celles-ci nous font défaut. Le ministère de la Culture en est conscient.
“Parmi les théâtres nationaux, seul celui de La Colline me ferait envie si Wajdi Mouawad ne fait pas de deuxième mandat.” On parle de vous pour succéder à Olivier Py au Festival d’Avignon …
Trois mandats de suite sont possibles à la tête du Théâtre National de Strasbourg (cinq ans + deux fois trois ans). J’ai toujours pensé que les deux premiers mandats seraient suffisants pour moi. Rester trop longtemps à la tête d’une institution n’est bon pour personne : ni pour l’équipe, ni pour les artistes, ni pour le public qui a besoin d’un renouvellement des esthétiques. Toutefois, si le TNS s’avérait traverser une période difficile, je resterais même si je ne le souhaite pas.
La suite ? Plusieurs options sont ouvertes dont celle de retourner en compagnie, de redevenir nomade, qui est la manière la plus joyeuse de faire du théâtre. Candidater à une autre institution – sachant que l’obtenir n’est jamais un dû ? Cela relèvera pour moi d’un choix profond. Parmi les théâtres nationaux, seul celui de La Colline, dont l’enjeu est la création contemporaine me ferait envie si Wajdi Mouawad ne fait pas de deuxième mandat. Mais pas l’Odéon-Théâtre de l’Europe, ni la Comédie-Française. Quand au Festival d’Avignon ? J’ai toujours pensé, qu’un artiste à la tête d’Avignon, dans la tradition vilarienne, c’était bien. Cela a aussi des inconvénients. Est-ce que l’artiste qui dirige n’est pas pris en otage pour sa propre création ? Bref, tout ça pour vous dire – sans langue de bois, promis – que je ne sais pas ce que je vais faire…
Légende photo : Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg (TNS), le 12 janvier 2019. (c) Jean-Francois Robert pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2020 5:59 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 30 octobre 2020 Une Semaine d’Art en Avignon – Une Cérémonie, texte et mise en scène Raoul Collectif, avec Julien Courroye, Romain David, Clément Demaria, Jérôme de Falloise, Anne-Marie Loop, David Murgia, Philippe Orivel, Benoît Piret, Jean-Baptiste Szézot.
Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot se réunissent autour d’une sensibilité artistique et politique commune, appréhendée lors de leurs études à l’ESACT (Ecole Supérieure d’Acteurs du Conservatoire royal de Liège. Ils fondent un collectif qu’ils baptisent Raoul – un clin d’oeil au situationniste belge Raoul Vaneigem et s’engagent dans la voie utopique, lente, mais fertile de la création collective. A la fois metteurs en scène, auteurs et acteurs, ils co-créent leurs spectacles, usant toutes les dimensions de la création – écriture, jeu, mise en scène, musique et scénographie. De cette dynamique – sorte de laboratoire pratique de démocratie -, de la friction de leurs cinq tempéraments se dégage une énergie particulière, perceptible sur le plateau, une alternance de forme chorale et d’éruptions de singularités, une tension réjouissante, tant dans le propos que dans la forme, entre rigueur et chaos, gravité et fantaisie. Après Le Signal du promeneur (2012) et Rumeur et petits jours (2015), Une Cérémonie est leur troisième spectacle, vu à la Semaine d’Art en Avignon, dès le 28 octobre 2020. « Nous sommes des Quichotte lorsque nous partons nous battre avec des armes usées et poussiéreuses contre le capital, contre la finance, contre la bêtise et les profits, contre le patriarcat et la fascination du pouvoir, contre les esprits étriqués, les discours dominants. En ce qui nous concerne, ces armes sont le théâtre, la parole, les mots, les corps, les voix, la musique, l’ivresse poétique. Et l’intelligence collective. » La scénographie de Juul Dekker ne passe pas inaperçue : jetées en pleine lumière, des chaises de jardin vert bouteille sont éparpillées sur le plateau, plus ou moins rangées ; un capharnaüm indescriptible que jonchent ces obstacles modestes et quotidiens sur lesquels il va bien falloir grimper, au risque même d’une perte d’équilibre, pour non seulement tirer sur la petite corde manipulant les ailes grandiloquentes d’un drôle d’oiseau préhistorique, qui semble voler en déployant ses ailes, mais pour encore faire sa harangue sur le monde, depuis ce piédestal, dire ce qu’on pense et qui pèse sur le moral. Sont laissés également à la contemplation du public les instruments de musique – piano, violoncelle, guitare…- dont le bois scintille sous les lumières, non loin d’un bar plutôt sympathique, trônant dans le lointain – bouteilles entrechoquées, petits verres d’alcool fort servis pour les différents toasts que l’on porte à la vie et aux petits arrangements imposés. Les interprètes investissent la scène en descendant du haut des gradins de la salle. Des hommes seulement, semble-t-il, jusqu’à ce qu’apparaisse, plus tardive, Anne-Marie Loop. Celle-ci reste le plus souvent observatrice et spectatrice de ses camarades de jeu en folie, jusqu’à ce qu’elle incarne la grande figure féminine de résistance, l’insoumise Antigone. Le groupe festif se retrouve pour une célébration : ils sont endimanchés, vêtus d’une chemise blanche et d’une veste sombre. L’un des interprètes, le facétieux David Murgia, dialogue avec son habit de cérémonie qu’il n’enfile pas, un compagnon-effigie auquel il parle avec précaution, dansant en duo – un beau théâtre d’objet. Soit une image de soi et de son double, dont on ne se libère pas, aliéné sans cesse par l’impossibilité à choisir. Il déclamera vaillamment – pudeur et réserve – un poème magnifique de Gonzalo Arongo Les masques des comédiens sont splendides, en bois et végétaux, ils imposent leur force. Romain David est un peu le maître de cérémonie, guettant la manière dont les événements suivent leur cours, jouant de la trompette, chantant et exposant ses vues sur notre présent, entre volonté d’en découdre et prise de conscience de l’impuissance à agir. Benoît Piret fait part de ses vues, discourant, jetant un discours fiévreux à la face de tous, soucieux d’engagement politique et social, une réflexion sur le dérèglement du monde. Quant à Jérôme de Falloise, il semble un peu en retrait, regard critique aigu et subversif, avant de mieux revenir, au centre de la scène, en imposant sa présence intense, d’abord à travers sa métamorphose en chouette onirique de matière végétale – feuilles, branches, roseaux – aux yeux éloquents, dont le silence attire les regards : la chouette réapparaîtra. Pour un vrai moment de théâtre dans le théâtre, le comédien interprète aussi le Centaure précieux à notre imaginaire antique, puissant, récalcitrant, tapant du pied, le regard têtu, incarnant avec superbe le poitrail de l’homme-animal et ses pattes-avant, tandis que Jean-Baptiste Szézot en est le corps, la croupe et les pattes-arrière – un spectacle réjouissant. Celui-ci auparavant aura fait son numéro de cabotin avec brio, se mettant en colère d’abord verbalement, puis, dans la durée, insultant physiquement les autres, n’hésitant à vouloir les agresser, retenu à temps par ses camarades compréhensifs et bon enfants. Philippe Orivel, à l’accordéon, ou en courtisan de roi complaisant – humour et ironie -, est toujours là, à propos. Avec les deux autres musiciens, Julien Courroye et Clément Demaria, il forme un trio efficace et bien balancé, entre rock, jazz et acoustique. Le rendez-vous scénique a bien eu lieu, et ceci, grâce au sentiment moqueur d’incertitude affichée du collectif Raoul, sa détermination politique, conviviale et approximative, le flux ambiant et réconfortant de ses images mythiques et oniriques récurrentes – preuve d’un souci esthétique -, et la reconnaissance spontanée de l’impasse de temps insaisissables,. Véronique Hotte Une Semaine d’Art en Avignon – Salle Benoît XII. Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine, du 13 au 15 novembre. La Maison de la Culture, Tournai, les 17 et 18 novembre.Théâtre de la Bastille, Paris, du 26 novembre au 19 décembre. Nebia, Bienne, le 4 mars 2021.Théâtre Le Rayon Vert, Saint-Valéry-en-Caux, le 9 mars. Théâtre de Châtillon, les 18 et 19 mars.Théâtre de Namur, du 24 au 27 mars.Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon, du 30 mars au 2 avril. Le Manège, Maubeuge, le 8 avril. Centre dramatique national d’Orléans, du 14 au 16 avril. Mars – Mons Arts de la Scène, du 4 au 6 mai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2020 11:34 AM
|
Propos recueillis par Thierry Jallet pour le site Wanderer, 30 octobre 2020 Entretien réalisé à Avignon, le dimanche 25 octobre 2020
Avignon est au ralenti en ce dimanche matin d’octobre. L’été est loin, l’actualité reste assez paralysante, le couvre-feu tout juste entré en vigueur accentue cette impression. Pour autant, la Semaine d’Art vient de débuter et Jean Bellorini nous rejoint dans un café, près des remparts. Après avoir dirigé le théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, il est le directeur du Théâtre National Populaire à Villeurbanne, depuis le mois de janvier 2020. S’il se trouve dans la Cité des Papes, c’est pour présenter à la FabricA, Le Jeu des Ombres qu’il a mis en scène sur un texte de Valère Novarina et qui devait ouvrir l’édition 2020 du Festival en juillet, annulée en raison du contexte sanitaire. Nous étions dans la salle la veille et revenons plus précisément sur ce spectacle dans l’article qui lui est consacré sur Wanderersite. L’homme pourtant discret s’anime au fil des mots. Son regard est intense, sa voix vibrante. Il parle de cette maison dont il a pris la tête dans un contexte si particulièrement contraignant, de la place essentielle de la musique dans ses créations, dans sa vie. Il parle aussi bien sûr, de cette nouvelle création présentée toute la semaine à la FabricA et au TNP en janvier 2021, de ses projets et de sa passion pour l’art théâtral. Entretien.
À propos du "Jeu des ombres"
Thierry Jallet :
Vous créez Le Jeu des Ombres à la FabricA, à l’occasion de cette Semaine d’Art en Avignon, l’horaire étant avancé mais maintenu malgré l’installation du couvre-feu. C’est la deuxième fois que vous venez à Avignon avec un spectacle, après Karamazov en 2016. Est-ce un rendez-vous important pour présenter votre travail au public ?
Jean Bellorini Il est vrai que la Cour d’honneur [du Palais des Papes] est particulièrement emblématique et mythique. C’est toujours un endroit symbolique du Festival. Il est effectivement important pour moi que cette présentation se fasse à Avignon car j’arrive en même temps au Théâtre National Populaire. Je trouvais que cela avait beaucoup de sens, je disais qu’on allait pouvoir fêter les cent ans du TNP à Avignon aussi, que tout cela coïncidait parfaitement. C’est bien entendu une déception au regard de ce qu’il s’est finalement passé. Je reconnais cependant qu’il y a des situations pires que la nôtre. TJ Vous voici donc avec Le Jeu des Ombres dont vous avez commandé le texte à Valère Novarina. Alors que vous vous intéressiez à la tragédie familiale avec Karamazov, vous réactivez ici le mythe orphique qui semble également figurer un hommage à l’art théâtral… C’est ce que j’avais justement envie de dire dans la Cour d’honneur : je voulais mettre le théâtre au centre car, en définitive, quand on fait des spectacles, on ne fait que parler de théâtre. Et lui-même parle de la vie. Ma première envie était tout de même de célébrer ici les noces du théâtre et de la musique. Entremêler ces deux arts est ce qui m’importe depuis toujours. Pour la Cour d’honneur, je pensais donc à cela et à un grand mythe universel – on a toujours besoin de se raccrocher à de grandes histoires. Je souhaitais enfin passer commande du texte à un grand poète contemporain. Et tout cela réuni me semblait signifiant à la fois pour cette participation au Festival mais aussi pour le TNP. TJ A travers cette création, n’interrogez-vous pas en définitive ce qu’est « être acteur » ? JB C’est en effet une interrogation que je poursuis depuis mes débuts. J’ai d’ailleurs commencé en étudiant l’art de l’acteur, même si j’ai tout de suite su que je préférais être de l’autre côté, celui d’où l’on regarde. Quand on est metteur en scène, on a toutefois besoin d’éprouver cet art « de l’intérieur ». Une des grandes questions – dont parle précisément la langue de Valère Novarina– est de savoir, si on pouvait ouvrir le crâne d’un acteur, ce qu’il se trouve à l’intérieur de lui tandis qu’il joue. Que s’y passe-t-il de mécanique, de chimique, d’organique ? Au fil de mon parcours, alors que j’étais beaucoup en recherche dans le cadre de mon travail avec des jeunes, je me suis toujours demandé pourquoi on parle au théâtre. Et tout cela résonne très fort avec l’œuvre de Valère Novarina. Se demander également si on apparaît ou si on disparaît quand on entre en scène. Se demander si c’est une renaissance ou bien si c’est une mort de soi pour laisser apparaître l’autre. Toutes ces interrogations me fascinent et me portent. Le théâtre est-il fondé sur un manque, sur une projection ? Je le crois, en effet : le théâtre apparaît réellement dans un imaginaire partagé entre les spectateurs et les acteurs. Il naît d’une rencontre entre le public et une œuvre plus ou moins compréhensible. Et à ce propos, ce qui me paraît important ici est que Le Jeu des Ombres est une œuvre peu claire, trouble. TJ Le choix de travailler avec Valère Novarina se justifie ainsi à cet égard… JB Absolument. J’aime infiniment la langue qu’il utilise. Celle d’un grand poète du XXIème siècle – le plus grand pour moi. En 2003, Valère avait vu l’un de mes premiers spectacles, mis en scène avec Marie Ballet sur un de ses textes : L’opérette imaginaire. Nous l’avons ensuite joué jusqu’en 2007. Arriver au TNP, monter un spectacle pour le Festival d’Avignon avec un autre de ses textes, tout cela représente pour moi une façon de boucler une boucle, avant de recommencer avec un autre cycle. Et au milieu de ce cycle cohérent qui s’achève et où Novarina est encore très présent, il y a Rabelais. Les Paroles gelées sont justement un hommage direct à son œuvre. La question de la parole, de sa puissance, de sa polyphonie, de sa réduction qui découle de la réduction de la pensée m’intéresse vraiment. Valère nous rappelle sans cesse que la langue doit être riche et que c’est cette richesse qui permet à la pensée de grandir. C’est pourquoi Le Jeu des Ombres compte beaucoup pour moi : c’est précisément ce que je souhaite faire au théâtre. TJ Vous avez en partie signé la scénographie. Tout semble lié et on perçoit une grande homogénéité du spectacle dans le fond comme dans sa forme plastique et visuelle... JB (Rires) C’est compliqué parce que j’ai l’impression d’être un peu totalitaire en étant aussi scénographe. Pourtant, je peux vraiment dire que ce spectacle est une création collective qui est né des acteurs. Tout y est intimement lié : de la musique au texte, à l’espace, à l’image, à la lumière. Il est vrai que j’ai justement l’habitude de créer la lumière, et si je ne le faisais pas, j’aurais l’impression de ne pas mettre en scène. Tout ce qui se passe avant est par contre, partagé et collectif. Bien sûr, je suis présent, j’impulse, je suis même au piano de temps en temps. En fait, je dirige un peu comme un chef d’orchestre, c’est-à-dire beaucoup plus à l’oreille qu’à l’intelligence. En répétition, il faut être davantage dans l’hypersensibilité, se rendre poreux à toutes les impressions qu’on reçoit. Je me sens plus musicien à ce moment précis du travail. Certes, j’ai déjà pensé l’espace mais tout peut être bouleversé. Je ne dépends de personne qui pourrait venir m’opposer qu’on l’avait décidé autrement auparavant et qu’il ne faut rien changer. Ce qui se passe au cours des répétitions relève du présent et se trouve lié à l’immédiateté du travail. C’est au moment de créer les lumières que je deviens peut-être un peu plus dirigiste. Je sais alors pourquoi je demande quelque chose de précis à un acteur. Avant cette étape, je ne suis jamais sûr d’avoir raison. TJ Qu’est-ce qui a guidé vos choix scénographiques pour Le Jeu des ombres justement ? JB C’est un hommage au théâtre et c’était pensé pour la Cour d’honneur au départ. Pour ce mur. Pour ce grand plateau. Pour ce mur humain du public face à la scène. Quand le Festival a été annulé pour juillet, on aurait pu tout modifier, construire d’autres décors… J’ai voulu au contraire garder le projet tel quel, sans le moindre changement. J’ai vraiment souhaité conserver le fantôme de cet espace de la Cour d’honneur. Il s’agit d’un des fantômes importants du spectacle qui ranime tous les fantômes du théâtre et par là même, tous ceux de la vie que chacun peut y voir. En effet, nous sommes tous faits de nos morts, de ceux qui nous ont aimés, de ceux qui nous aiment. Ici, on remet au centre tous ceux-là. "De la musique avant toute chose" TJ La musique fait partie intégrante de votre dernière création. Elle semble être une composante dramaturgique toujours privilégiée, n’est-ce pas ? JB Oui, et elle intervient toujours au tout début des répétitions. Je considère les acteurs et les musiciens au même endroit. Tous sont porteurs de sens et de musicalité à la fois. Ils sont, nous sommes tous au service d’un même propos, d’un même projet poétique, d’une même partition théâtrale finalement. J’aime l’idée que chacun n’a pas son couloir propre même si on peut être soliste à un moment ou à un autre. Nous avons tous notre base commune et continue. Ici, c’est tous ensemble que nous avons « cuisiné » l’écriture de Valère en dialogue avec la musique de Monteverdi. TJ Ce rapport à la musique vous suit toujours… JB Toujours. Et même quand il n’y a pas de musique, il reste toujours la musique intérieure, le battement de cœur du spectacle. TJ « De la musique avant toute chose » ? JB Je crois, oui. Et peut-être encore plus en ce moment. C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert la saison au TNP avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton notamment, avec qui nous avions déjà organisé des ateliers à Saint-Denis. Aujourd’hui, on ne sait plus mettre les mots, exprimer clairement ce que l’on pense. En tant qu’artiste, j’ai souvent envie de me taire. Tout le monde a son avis, tout a la même valeur et on finit par en dire trop. Non seulement la musique soigne mais elle ouvre également l’espace qui tout d’un coup, permet à la langue d’apparaître et à partir de laquelle peut naître la pensée. Cette pensée étonnante obtient ainsi la possibilité de se renouveler, de se démultiplier. TJ Dans Le Jeu des ombres, vous convoquez le mythe d’Orphée que vous placez de cette manière au commencement de votre parcours au TNP. Orphée, c’est aussi une figure de la transgression, de l’ultime prise de risque. Celui qui fait le choix de la vie dans sa plénitude, comme vous le dites en substance. Faut-il y voir de votre part, une méditation sur notre présent ? JB Lorsque j’ai imaginé ce projet il y a bientôt deux ans, il résonnait plus comme une façon de célébrer une forme de désobéissance. Oui, il se retourne parce qu’il a envie de vivre complètement. Et il perd Eurydice pour l’éternité mais il l’aura en lui pour toujours. Il y a bien une résonance avec le présent même si le spectacle ne se réduit pas à ce propos-là. Pour moi, Orphée n’est pas un impulsif et ne désobéit aveuglément : il opère un choix après avoir longuement réfléchi. L'arrivée au TNP et les projets TJ Vous êtes arrivé à la tête du TNP en janvier 2020. Cette prise de fonction n’a certainement pas été simple pour vous… Et elle ne l’est toujours pas. Cependant, elle nous permet d’aller plus vite sur un certain nombre de points, de nous rencontrer différemment avec l’équipe en place et de renouveler tout, tous ensemble. Comme si nous redémarrions collectivement une autre histoire au même moment. Je ne cache pas que cette période est longue, que cela devient difficile à tenir dans le temps. Le moral n’est pas toujours au beau fixe. Cela me préoccupe car je considère que diriger un théâtre, c’est s’occuper vraiment des gens qui le font. Un directeur de théâtre artiste est empreint du lieu dans lequel il va créer, des gens qui y œuvrent. Pendant les six premiers mois, il m’a été difficile de ne pas pouvoir m’attacher à voir ce qui fonctionnait, tant j’étais absorbé ailleurs. On prendra donc plus de temps pour arriver à ce que je souhaite mais je suis content des relations que nous avons tous nouées, dans ce temps de crise. Concernant le public, je considère que je ne le connais pas encore suffisamment, que je ne l’ai pas assez rencontré même si nous avons tenté plusieurs choses comme des ateliers au mois de juin lorsque nous répétitions Le Jeu des ombres. C’est difficile dans un lieu comme le Théâtre National Populaire, avec ce qu’il véhicule d’imaginaire sur un vaste public, d’être obligé de proposer un théâtre intimiste pour des formats corona-compatibles. Nous allons là, à l’inverse du projet même de ce lieu. TJ Votre première saison est riche néanmoins, comme Wanderer l’a souligné pour sa présentation en juin. Comment l’avez-vous pensée ? JB Elle s’inscrit dans la continuité du projet avec lequel je suis arrivé au TNP. Elle est marquée par des fidélités à des artistes que j’ai connus à Saint-Denis par exemple, et dont je sais l’engagement personnel sur le territoire. Pouvoir m’appuyer sur eux à l’endroit de la création comme à l’endroit de la transmission va assurément m’aider. Cela permettra aussi au TNP d’être un théâtre de service public, qui revendique le théâtre d’art et sa raison d’être. Il s’agit alors de réunir dans la salle le plus grand nombre, une assemblée théâtrale, une assemblée de solitudes qui ne se ressemblent pas. Et de se demander ce qu’il convient de présenter pour que cela résonne différemment pour chacun. Cette interrogation m’a guidé pour choisir des œuvres lisibles à tous les niveaux et portées par des artistes qui accompagnent la transmission de leurs œuvres. Comme Margaux Eskenazi, jeune metteure en scène qui construit souvent ses spectacles à travers la rencontre avec des citoyens ; Lilo Baur qui mène souvent des ateliers et qui a travaillé à l’ENSATT l’an passé ; Thierry Thieû Niang que j’aime beaucoup et qui sait transmettre lui aussi son art à tous, à ceux qui sont en difficulté en particulier ; Sonia Wieder-Atherton qui a construit toutes ses odyssées à travers la rencontre des publics. Je crois fermement que la création est liée à la rencontre avec le monde. Par conséquent, je me suis appuyé sur des artistes avec qui nous partageons cette conviction. Mon projet avec la Troupe éphémère que je poursuis, s’inscrit également dans cette démarche. Il y aura une authentique création présentée au cœur de la saison, au Grand-théâtre, avec ses trente-quatre comédiens amateurs. Les cent ans du TNP seront fêtés notamment grâce à ce projet en cours qui sera un hommage à Firmin Gémier à partir de ses textes. Concernant le centenaire, le fait d’accueillir Georges Lavaudant et son Roi Lear, le fait que Christian Schiaretti puisse également créer son spectacle Jeanne en ce moment [L’entretien a été réalisé avant l’annonce du confinement le 28 octobre], je peux dire que toute la saison se décline autour de cet anniversaire. J’aimerais beaucoup continuer à développer un partenariat avec la Maison Jean Vilar à Avignon, qui est en train de créer une exposition au TNP à partir des notes de Jean Vilar. Je souhaite aussi nouer le plus de collaborations possible avec les lieux les plus près de la région comme avec d’autres plus éloignés. Si je devais résumer mon projet, je dirais effectivement que c’est celui d’un théâtre à la fois le plus proche et le plus lointain avec des artistes comme par exemple, les actrices brésiliennes qui viendront à la fin de la saison, accompagnées par Ariane Mnouchkine. TJ Pour finir, quels sont vos projets, vos espérances ? JB J’ai toujours du mal à me projeter avant que les choses ne parviennent à éclore. C’est ce qui est en train de se passer avec Le Jeu des ombres avec Valère : le spectacle arrive, enfin ! Bien sûr, il y aura ma prochaine création avec la Troupe éphémère au mois d’avril. J’ai également un projet à l’étranger pour donner au TNP la possibilité de collaborer avec des institutions internationales : pour fêter l’anniversaire de Molière, je vais mettre en scène un Tartuffe, à Naples, en 2022, en italien. Il sera créé au Teatro Stabile di Napoli avant de venir tout de suite après au TNP. Voici les deux projets concrets que j’ai en tête pour le moment. Je pense proposer aussi une création avec des acteurs français mais il est encore un peu tôt pour en parler. Nous avons besoin de grands spectacles, joyeux, qui nous donnent de l’énergie. Ma plus grande espérance aujourd’hui est que le théâtre continue à exister, que nous puissions continuer à accueillir au TNP les artistes comme très prochainement Joël Pommerat avec le magnifique Ça ira (1) Fin de Louis [L’entretien a été réalisé avant l’annonce du confinement le 28 octobre]. Vous savez, au fond, le théâtre populaire tel que je le rêve pour les cent ans à venir, ce n’est qu’avec des spectacles comme Ça ira. Ce serait un théâtre citoyen, un théâtre conscient du monde. Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel, nous avons décidé de ne rien annuler en remontant les horaires. Nous allons profiter de ce moment inédit pour trouver aussi une nouvelle manière de faire pour accueillir des gens qui n’allaient pas au théâtre auparavant. Cela ne fera que confirmer la nécessité de l’art, et du théâtre particulièrement. Le Jeu des ombres, création du 23 au 30 octobre 2020 à la FabricA, dans le cadre de la Semaine d’art, Festival d’Avignon ; du 6 au 22 novembre 2020 aux Gémeaux – scène nationale de Sceaux ; du 6 au 8 janvier 2021, au Quai – CDN d’Angers Pays de la Loire ; du 14 au 19 janvier 2021, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne ; les 5 et 6 février 2021, au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence ; du 10 au 13 février 2021, à La Criée – Théâtre national de Marseille ; du 17 au 19 février 2021 à Anthéa-Antipolis Théâtre d’Antibes ; du 24 au 26 février 2021 à la Scène nationale du Sud-Aquitain à Bayonne ; du 23 Au 26 mars 2021, au ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse Occitanie ; le 6 avril 2021, à l’Opéra de Massy ; du 14 au 16 avril 2021, au Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France ; les 21 et 22 avril 2021, au Théâtre de Caen ; du 18 au 20 mai 2021, à la MC2 de Grenoble ; les 27 et 28 mai 2021, au Liberté – Scène nationale de Toulon. Onéguine d’après Pouchkine, création au TGP de Saint-Denis en mars-avril 2019, du 1er au 3 décembre 2020, au Théâtre de l’Archipel – Scène nationale de Perpignan ; les 14 et 15 janvier 2021, au Théâtre de la Coupe d’or – Scène conventionnée de Rochefort ; du 18 au 22 janvier 2021, à la Coursive – Scène nationale de La Rochelle ; du 23 février au 3 avril 2021, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. La création de la Troupe éphémère, au Théâtre National Populaire, Grand Théâtre – salle Roger Planchon, les 27 et 28 avril 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2020 11:34 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde 28 octobre 2020 A Avignon, le comédien Yoshi Oïda et la danseuse Kaori Ito revisitent magnifiquement un nô moderne de Yukio Mishima. D’un coup, les nuages ont disparu, le ciel est devenu bleu et le soleil caresse les façades d’Avignon. Il est bientôt 11 heures du matin, ce lundi 26 octobre, et les spectateurs entrent dans la Chapelle des Pénitents-Blancs où Le Tambour de soie se donne pour la dernière fois, dans le cadre de la Semaine d’art, avant de partir pour Paris. Une heure plus tard, les spectateurs sortent de la salle comme on émerge d’un songe. La ville n’en est que plus belle, Avignon respire cette douceur que l’on ressent quand s’allient au théâtre la beauté et la poésie. Ces sentiments, nous les devons à deux Japonais qui ont choisi de vivre en France : la danseuse Kaori Ito et le comédien Yoshi Oïda. Elle a 40 ans, lui 87, ils sont amis, et ils ont eu envie de jouer ensemble un des cinq nô modernes de Yukio Mishima (1925-1970), qui fut un ami de Yoshi Oïda. Comme la chaîne d’amitiés qui nous vaut le spectacle, ce nô de Mishima, Le Tambour de soie, s’inscrit dans une chaîne d’histoires nées d’une même trame : un vieil homme tombe amoureux d’une jeune femme, qui lui donne un tambour et lui dit : « Si vous arrivez à le faire sonner, je suis à vous. » Le fantôme et la beauté Mais le tambour, recouvert de soie, ne sonne pas. Ce qui se passe ensuite varie selon les nô, les auteurs, les époques. Mais, toujours, rôde le fantôme du temps, qui rogne ou aiguise les ailes du désir. A ce fantôme, Kaori Ito et Yoshi Oïda donnent les couleurs d’un oiseau de paradis d’aujourd’hui : ils invitent les spectateurs à rêver, dans la nuit, d’un théâtre où un vieil homme vient nettoyer le plateau. Il porte un imperméable, il a les cheveux blancs, il est frêle et beau comme un roseau. Peut-être est-ce un revenant, qui hante la jeune femme brune que l’on voit bientôt arriver. Vêtue de rouge, c’est une beauté aux cheveux noir de jais, et au corps délié. A l’avant du plateau, le tambour repose sur un tabouret. Il a la forme d’un sablier. Sur le côté, d’autres tambours qui, eux, sonnent : ce sont certains des instruments avec lesquels Makoto Yabuki va jouer. Complice de Kaori Ito et Yoshi Oïda, ce musicien est la voix de ces corps qui ne parlent pas, ou si peu, mais disent tout. Ils sont là, à deux âges de la vie qui les séparent mais liés par deux arts et reliés par la transmission qu’ils portent à son acmé. Lui, splendide compagnon des spectacles de Peter Brook, c’est « l’acteur invisible » (du nom d’un de ses livres, publié chez Actes Sud en 1995), au sens où la grâce l’est. Elle, c’est une flamme, la danse dans tous ses états. Leur rencontre est magnifique : ils sont au-delà de l’âge et du temps. A la fin, la jeune fille dit au vieil homme : « Si tu avais frappé le tambour encore une fois, j’aurais pu l’entendre. » Brigitte Salino(Avignon, envoyée spéciale)
Le Tambour de soie, un nô moderne. Espace Cardin, 1, avenue Gabriel, Paris 8e. Tél. : 01-42-74-22-77. Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, à 19 heures ; samedi 31 octobre, à 15 heures et 19 heures ; dimanche 1er novembre à 15 heures. De 10 € à 22 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Les 17 et 18 décembre à la Maison de la culture d’Amiens (Somme). (Annulation à partir du 30 octobre pour cause de confinement)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2020 6:20 PM
|
Sur la page de l'émission de Marie Richeux "Par les temps qui courent" sur France Culture le 28/10/2020 Pour la sortie de son film "Garçon chiffon", en salles ce jour, le comédien et réalisateur Nicolas Maury vient discuter avec nous du premier long métrage qu’il réalise, ainsi que de ses influences littéraires et de leur rôle dans son métier d'acteur.
Ecouter l'émission en ligne (44 mn) Dans Garçon chiffon son premier film en tant que réalisateur, Nicolas Maury incarne le personnage de Jérémy, trentenaire, de retour dans sa région natale, le Limousin. Auprès de sa mère (interprétée par Nathalie Baye) il prend du recul sur sa vie parisienne, sa carrière de comédien et sa vie amoureuse. Extraits de l'entretien Ce film est un geste personnel, et il n’a d’autobiographique que le fait de le faire dans ma vie. Si, un jour, j’écris une autobiographie, j’y mettrai le fait que j’ai fait ce film : c’est ça qui est autobiographique. D’ailleurs, je suis d’abord acteur, et j’ai l’impression de me révéler beaucoup plus en jouant Marivaux, Sarah Kane ou Guillaume Vincent, et en cela, de me rapprocher de ma maison fondamentale. Nicolas Maury Ce qui a motivé l’écriture de Garçon chiffon, ce n’était pas de se dessiner soi-même, mais de poser très franchement, presque politiquement, un héros que je n’avais pas vu au cinéma. Il se trouve que je donne le bâton pour me faire caresser dans cette histoire, avec les questions qu’on me pose : est-ce vous, ou non, est-ce un miroir déformant, reformant, reconstituant ? Mais, je l’ai fait pour vraiment établir un nouveau symptôme, à savoir, comment être un chiffon dans une société qui nous oblige à avancer si droit, si fort, si haut. Parfois, être un chiffon est un état d’où on peut, peut-être, renaître. En fait, ce qui m’a motivé, c’est une réflexion sur la personna, plutôt que sur le personnage, et dans ce film, il y a un acte à la fois très conscient et très inconscient. Nicolas Maury Mon personnage Jérémy, le garçon chiffon, tend une perche : dans cette société, où il est de bon ton d’être une personne différente dans chacun des espaces de la société, que ce soit, au boulot, dans la sphère amoureuse ou amicale, chez son psy, lui, il est la même personne tout le temps. Etre la même personne tout le temps, quand on est acteur de cinéma ou de théâtre, c’est très difficile, et c’est vrai, que parfois, on peut se sentir complètement dépeuplé et intranquille, mais cette intranquillité, c’est mon chemin. Nicolas Maury Dans son autobiographie "Parure d’emprunt", la romancière américaine Paula Fox a regardé sa vie non par dates, mais par lieux, et cette autobiographie est, peut-être, l’une des références les plus assumées de "Garçon chiffon". Regarder sa vie par paysages, en abolissant le feuilleté du temps, et se dire que ce sont les lieux qui nous parlent et peuvent témoigner de nous. Nicolas Maury Parler de soi, en faisant état des livres qu’on a lus, c’est ce qu’il y a de plus beau, c’est comme faire état de pénétration ultime : il y a les amants, les amis, mais il y a les livres qui nous habitent. Imaginez le bonheur d’être un acteur, et dans le métro, se faire tout seul, des Italiennes de Marivaux : c’est l’un des plus beaux trésors. Nicolas Maury . Archives François Truffaut, émission Les après-midi de France Culture, France Culture, 1975 Marguerite Duras, émission Nuits magnétiques, France Culture, 1980 Nathalie Baye, émission Le cinéma des cinéastes, France Culture, 1981 Référence musicale Jane Birkin, Ballade de Johnny Jane Légende photo : Nicolas Maury, Cannes, octobre 2020 • Crédits : JOEL SAGET - AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2020 6:16 AM
|
Par Cassandre Leray dans Libération - 28 octobre 2020 L'ancien professeur de théâtre à l'université de Besançon Guillaume Dujardin a été reconnu coupable en première instance le 21 octobre. Pour «Libération», les victimes reviennent sur leur histoire et le procès. «On a été entendus. Maintenant, quand je parle, la honte n’est plus sur moi. Elle est sur lui», affirme Anaïs (1). Depuis la fin du procès contre son ancien professeur de théâtre, la comédienne de 24 ans se sent «apaisée». Mercredi 21 octobre, Guillaume Dujardin a été reconnu coupable de chantage sexuel sur neuf anciens élèves, et d’agressions sexuelles sur deux d’entre elles. Il a toutefois été relaxé pour les accusations d’agression sexuelle d’une de ses anciennes étudiantes. Au cours de ce procès, les jeunes comédiens ont dénoncé les méthodes de travail de Guillaume Dujardin, décrites comme «violentes» et constamment orientées vers «la nudité ou le sexe». Des faits commis entre 2014 et 2017, alors qu’il donnait cours au sein du Deust (Diplôme d’étude universitaire spécialité théâtre) de l’université de Franche-Comté, à Besançon. Contacté par Libération, l’avocat du professeur déclare que son client «conteste être coupable des infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles le tribunal correctionnel de Besançon l’a condamné», sans préciser s’il compte faire appel. Guillaume Dujardin a été condamné à quatre ans de prison, dont deux fermes, et devra verser des dommages et intérêts aux victimes allant de 5 000 à 15 000 euros. Par ailleurs, son nom sera inscrit au Fijais (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes). Il a également interdiction d’entrer en contact avec les victimes, et obligation de se soigner. «A la sortie de ce verdict, c’était un soulagement. Même si ça va être très long de se réparer, c’est un nouveau départ», confie Lucie, 27 ans. Une trentaine de témoignages Le premier signalement a eu lieu il y a près de trois ans. Le 7 décembre 2017, l’université reçoit une lettre anonyme. Noir sur blanc, une mère d’élève alerte, avec son mari, sur les agissements de Guillaume Dujardin. Dans ces lignes, ils évoquent notamment le fait que le metteur en scène est accusé de demander à certaines jeunes femmes de se dénuder lors de répétitions chez lui. «Un prof m’a appelée pour me demander si c’était vrai. J’ai dit que oui. Là, il m’a demandé de recueillir d’autres témoignages anonymes. Et c’est comme ça que tout a commencé», rembobine Emma, de la promo 2012-2014 du Deust. A lire aussi Enseignement du théâtre : le flou artistique En voyant les témoignages s’accumuler, Anaïs comprend qu’elle n’est «pas seule» : «Quand j’ai lu ce qu’avaient écrit les autres filles, je me suis effondrée. Je suis allée porter plainte le 16 février 2018.» A sa suite, une trentaine d’autres personnes se rendent au commissariat pour témoigner. En tout, 10 plaintes sont retenues, venant d’élèves des promotions allant de 2010-2012 à 2014-2016. Celle de Clément en fait partie : «C’est là qu’ont commencé les trois plus longues années de ma vie, en attendant le procès. Avec Anaïs, on s’appelait tous les jours pour en parler.» Pendant tout ce temps, il ne se passe pas un jour sans que le souvenir des cours avec Guillaume Dujardin ne s’immisce dans l’esprit du jeune homme : «Avec un camarade, on avait eu pour consigne de violenter et déshabiller une étudiante sur scène, jusqu’à ce qu’elle se retrouve torse nu…» Une autre plaignante, Héloïse : «J’ai dû simuler un viol sur une de mes camarades, je devais mettre ma main dans sa culotte sur les consignes de Guillaume. J’étais en train de violenter mon amie, c’était glaçant. En plus, cette scène ne se prêtait pas à ça…» «Il disait que c’était pour me faire progresser» Pour Anaïs, le temps qui s’écoule entre sa plainte et le procès est ponctué de séjours en hôpital psychiatrique et de comportements autodestructeurs allant jusqu’aux tentatives de suicide, à quatre reprises. «Je me détestais, je pensais tout le temps à ce qui s’était passé», souffle la jeune femme, qui a étudié au sein du Deust entre 2014 et 2016. Comme plusieurs autres plaignantes, elle raconte avoir été invitée à des «cours particuliers» de théâtre au domicile de Guillaume Dujardin, et avoir reçu pour consigne de se dénuder : «Il disait que c’était pour me faire progresser, qu’il faudrait que je n’ai plus aucune limite…» explique Anaïs. Eva, de la même promotion : «Je lui faisais confiance, il nous a tellement mis en tête que la nudité nous ferait progresser, qu’on devait passer par là pour être une super actrice. Mais ça ne suffisait jamais. J’ai dû me masturber plusieurs fois devant lui, nue, alors que je n’en avais pas envie.» Au cours de ces répétitions, Eva et Anaïs accusent le professeur d’avoir été encore plus loin, raison pour laquelle elles ont déposé plainte pour «agression sexuelle» : «Je jouais nue, debout sur son radiateur. Lui était derrière moi, et j’ai senti ses mains qui touchaient mes fesses. Je me suis retournée, je ne voulais pas qu’il me touche. Là, j’ai vu son visage au niveau de mon sexe, et il a commencé à m’embrasser juste au-dessus des poils. Je lui ai dit stop. J’ai eu peur de lui pour la première fois», se remémore Eva. A lire aussi«Paye ton rôle» : un compte Instagram pour dénoncer les abus dans les écoles de théâtre A son tour, Anaïs raconte ce qu’elle a vécu lors de ces «cours particuliers» : «Un jour, il m’a proposé de me masser car il me trouvait trop tendue. J’étais allongée sur le ventre, en culotte, sur son lit. Il m’a massé les épaules, les jambes, les fesses, et là, il est allé vers mon entrejambe et m’a masturbée. Je suis restée figée. J’étais là, et en même temps j’étais absente.» Au fil des répétitions, «ça allait de plus en plus loin» : «On travaillait ma scène puis il me faisait aller dans sa chambre. Il utilisait ses doigts et sa langue. Si je disais stop, il me parlait pendant des heures pour me convaincre que si, c’était ce que je voulais. Il me disait que j’avais trop de morale, qu’il fallait que je sois prête à tout pour le théâtre sinon je ne serais jamais une grande comédienne. Ça a duré un an.» Un procès «historique» Le 7 octobre 2020, l’attente prend fin. Il est 8h30 du matin et le groupe de plaignants se rejoint à quelques mètres de l’entrée du tribunal judiciaire de Besançon. Ensemble, ils entrent dans la salle dans laquelle se tient le procès de Guillaume Dujardin. «Il y avait 150 personnes, dont des élèves qui ont voulu porter plainte mais pour qui c’était prescrit. C’était très fort», décrit Héloïse. Après les douze heures d’audience, reste une dernière attente. Celle du verdict. Le 21 octobre, Lucie est là pour l’entendre, comme une «libération» : «Cette peine, elle est symbolique. On a été écoutés et reconnus.» A lire aussiRécits d’humiliations, harcèlement, agressions sexuelles… Scènes cruelles au conservatoire de Rennes Surtout, les plaignants espèrent que cette décision sera un exemple pour d’autres comédiennes et comédiens victimes de situations similaires. «Je pense que c’est vraiment historique dans l’enseignement théâtral. Des histoires comme ça, il y en a plein d’autres, et ça n’a jamais abouti», note Me Anne Lassalle, l’avocate des victimes. Héloïse, plus déterminée que jamais, conclut : «Le théâtre ne doit plus s’enseigner par la violence. J’espère que ce verdict pourra donner de la force aux victimes dans d’autres écoles. Voilà à quoi doit ressembler un procès des années 2020.» Cassandre Leray (1) Les prénoms des élèves ont été modifiés. Légende photo : Le metteur en scène Guillaume Dujardin à la barre du tribunal correctionnel de Besançon, le 7 octobre. Photo Ludovic Laude. MAX PPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2020 6:53 PM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore pour le magazine en ligne L'Oeil d'Olivier 27/10/2020 Loin du château de Grignan, où il aurait dû être créé cet été, Fracasse de Jean-Christophe Hembert est né en cette fin octobre à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Encore en rodage, ce spectacle de cape et d’épée, adaptation rock du roman éponyme de Théophile Gauthier, ne manque ni de souffle, ni de verve. Loin du château de Grignan, où il aurait dû être créé cet été, Fracasse de Jean-Christophe Hembert est né en cette fin octobre à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Encore en rodage, ce spectacle de cape et d’épée, adaptation rock du roman éponyme de Théophile Gauthier, ne manque ni de souffle, ni de verve. L’orage gronde dans la grande salle de l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Des éclairs zèbrent l’obscurité laissant entrevoir les vestiges d’un château qui fut en son temps imposant, superbe. De vieux rideaux déchirés volent dans les airs. L’ambiance est lugubre, le maître de maison, un certain baron de Sigognac (Thomas Cousseau), vieille et belle noblesse, n’a plus, à son grand dam, les moyens d’entretenir la gloire de ses ancêtres. Tout l’argent a été dilapidé en alcool par sa parentèle. Une renaissance par le théâtre Bègue, limite autiste, le gentilhomme se cache des autres hommes. Il n’a plus d’illustre, que son nom et la fierté qui s’y accole comme un gant. Poussé vertement par son maître d’armes, il n’a d’autres choix que de quitter le berceau de sa famille pour se rendre à Paris et sillonner les routes de France avec la célèbre et extraordinaire troupe de maître Hérode (François Caron). La belle et vertueuse Isabelle (Aurélia Dury), comédienne émérite et joyau glamour de la compagnie, dont il tombe jalousement amoureux, a quelque peu aiguillonné son désir de grand air et d’aventures. Entre honneur et amour, entre peur de décevoir ses aïeux et accepté son destin de saltimbanque, le chemin du Baron pour devenir le Capitaine Fracasse est parsemé d’embûches, de duels et de belles rencontres. Une adaptation pop rock Le réalisateur de Kaamelott n’y va pas par quatre chemins pour dépoussiérer le dernier romain de Théophile Gautier. Privilégiant les clairs obscurs, magnifiquement imaginés par Seymour Laval, il invite à une ronde folle, rythmée par des sons pops rocks. Usant de praticables mobiles, qui, tour à tour, se métamorphosent en roulotte, en porte d’un château en ruine, en scène de théâtre ou en loge de comédiens, qui ne sont pas sans rappeler, ceux de la très puissante mise en scène de Castorf, présentée il y a trois ans à Avignon, Jean-Christophe Hembert joue sur les jeux décalés, les anachronismes verbaux et musicaux, les traits d’humour pour donner un souffle à cette épopée romanesque. Toutefois, encore en rodage, l’ effet escompté n’est pas encore tout à fait au rendez-vous. Un duo de choc Grâce à une mise en scène menée rondement, malgré quelques flottements, quelques scènes superflues qui au fil des représentations devraient s’ajuster, les comédiens se laissent porter, emporter dans un tourbillon d’intrigues amoureuses. Si Caroline Cons est détonante en marquise, Loïc Varraut épatant en jeune premier certes beau mais incapable de charmer le beau sexe faute de verve, C’est le duo David Alaya et Bruno Bayeux qui emporte la mise. Le premier excelle en narrateur tonitruant porté sur la dive bouteille, le second brille en duc ombrageux et possessif. Malheureusement la partition est plus complexe pour l’étonnant Thomas Cousseau, qui a la lourde tâche d’interpréter Fracasse. Le choix assumé par Jean-Christophe Hembert de faire du personnage un sorte d’autiste bègue qui trouve grâce à un masque une belle faconde n’aide pas. La transition entre les deux états est encore trop abrupte. De beaux tableaux Les décors tournantsde Fanny Gamet, de Jean-Christophe Hembert et de Seymour Laval – le prodigieux créateur des lumières – , les costumes baroques? et punks? de Mina Ly et les perruques et masques de l’extraordinaire Cécile Kretschmar sont des points forts de ce Fracasse, qui ne demande qu’à divertir petits et grands, jusqu’à enfin conquérir la magnifique demeure de la fille de Madame Sévigné, le château de Grignan, cet été. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Chalon-sur-Saône Fracasse d’après Théophile Gautier
Création à l’Espace des Arts le 23 octobre 2020
5 bis avenue Nicéphore Niépce
71102 Chalon-sur-Saône
Durée 2h20 environ
Tournée
Les 6 et 7 novembre 2020 au Théâtre de Grasse
Du 14 au 17 novembre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand
Le 24 novembre 2020 au Théâtre de l’Olivier, Istres
Les 1er et 2 décembre 2020 au Liberté, Toulon
Le 4 décembre 2020 au Forum, Fréjus
Du 8 au 12 décembre 2020 au Théâtre du Gymnase, Marseille
Du 15 au 31 décembre 2020 aux Célestins, Théâtre de Lyon
Les 19 et 20 janvier 2020 La Comète, Châlons-en-Champagne
Le 2 février 2020 au Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
Du 4 au 6 février 2021 Théâtre Sénart
Du 9 au 13 février 2021 au Théâtre de Caen
Du 17 au 19 février 2021 au Volcan, Le Havre
Le 2 mars 2021 à la MA Scène nationale, Montbéliard
Le 4 mars 2021 à l’Équilibre, Fribourg
Le 13 avril au 2 mai 2021 au Théâtre de Carouge
Les 6 et 7 mai 2021 au Théâtre Jean Vilar de Suresnes Mise en scène de Jean-Christophe Hembert assité de Sarah Chovelon
Adaptation de Jean-Christophe Hembert et Loïc Varraut
Collaboration artistique Aurélia Dury, Loïc Varraut
Avec David Ayala, Bruno Bayeux, François Caron, Jean-Alexandre Blanchet, Jacques Chambon, Caroline Cons, Thomas Cousseau, Aurélia Dury, Eddy Letexier, Véronique Sacri, Loïc Varraut
Décor de Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert et Seymour Laval
Costume de Mina L
Accessoires de Fanny Gamet
Maquillages, coiffures, masques de Cécile Kretschmar
Lumières de Seymour Laval
Musique et création son de Clément Mirguet Légende photo : Fracasse, mise en scène Jean-Christophe Hembert,© Simon Gosselin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 26, 2020 7:53 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 25 octobre 2020
Kaori Ito et Yoshi Oïda, Etienne Minoungou et Simon Winse, Israël Galvan et Nino De Elche, trois occasions d’éprouver la grandeur au théâtre.
Parce que le couperet du couvre-feu a obligé les organisateurs de la Semaine d’art en Avignon à avancer les spectacles de trois heures, on n’a pas pu voir, encore, Le Tambour de soie, un nô moderne de Yukio Mishima. Un drame découvert dans une mise en scène de Maurice Béjart qui s’appuyait alors sur la belle traduction de Marguerite Yourcenar, au Théâtre du Rond-Point, il y a bien des années. On a pris date pour le 1er novembre, au Théâtre de la Ville où va être présenté le spectacle. Mais, évidemment, l’alliance artistique et spirituelle de ces deux artistes rares que sont la danseuse Kaori Ito et le comédien Yoshi Oïda, personnalité essentielle du parcours de Peter Brook, et écrivain singulier, est promesse d’excellence. Pour cette représentation ils sont accompagnés de Makoto Yabuki et c’est Jean-Claude Carrière qui a rédigé le texte. On en reparlera. Mais les spectateurs ont été charmés. A la Collection Lambert, on peut découvrir l’imagination enlevée des élèves des « villas » de rêve que sont la Casa de Velazquez à Madrid, la Villa Kujoyama à Kyoto, la Villa Médicis qui abrite l’Académie de France à Rome. « Viva Villa ! » est un parcours espiègle avec quelques œuvres puissantes. Mais peuvent-elles rivaliser avec les pièces de la collection permanente ? Pas sûr. C’est ici, dans la très agréable salle ouverte dans les dessous des Hôtels de Caumont et de Montfaucon, qui abritent la collection d’Yvon Lambert, que l’on a pu applaudir le serein et lumineux Etienne Minoungou, dilaté comme un soleil, avec son regard si profond, émerveillé, offert, et son heureuse et solaire présence. Accompagné de l’extraordinaire musicien Simon Winse, qui chante d’une voix unique, qui vous ouvre et vous comble, il dit le texte de Felwine Sarr, Discours aux Nations africaines. Magnifique plongée dans laquelle, avec une précision fascinante, nous entraînent ces deux interprètes, unis et différents, uniques et disant le pluriel de l’Afrique. Magistral sans démonstration, dans la retenue, la modestie, ce discours, tel qu’il nous est délivré, nous bouleverse. Ici, ce qui touche le plus est la sincérité. Troisième duo, voici Mellizo Doble qui exalte la complicité du chanteur, guitariste, compositeur Nino de Elche et du danseur et chorégraphe Israël Galvan. La voix exceptionnelle de Francisco Contreras Molina, vrai nom de Nino de Elche, sa puissance, sa maîtrise, ses connaissances et sa virtuosité sont saisissantes. On est empoté par cette voix, ce récit. Tout commence sous le soleil d’une corrida et c’est un soleil de plomb qui pèse sur le mort de Dominguin…A la fin, Séville est célébrée, torride et déchirante. L’art de Nino de Elche est grand. Disons-le, il est dommage que les paroles ne soient pas traduites car, même si l’on connaît la langue, on peut avoir du mal à suivre et c’est dommage. Même si, ici, c’est la complicité des deux artistes qui fait la chair du propos. Israël Galvan, avec ses chaussures blanches et noires, son costume à poche surprise, sa morgue joyeuse, son insolence, est époustouflant dans la performance –comme son ami chanteur qui tient sans boire une goutte d’eau, très longtemps. Dans l’énergie, l’humour vache, l’insolence gamine, et la beauté, la virtuosité, la violence toujours renouvelée de l’expression, il est vraiment étonnant. C’est comme un grand coup de vent sur le plateau, un grand coup de vent sur la ville et cette « semaine d’art » formidable. Le Tambour de soie, du 24 au 26 octobre à 11h00. Chapelle des Pénitents blancs. Durée : 1h00. Reprise au Théâtre de la Ville-Espace Pierre-Cardin, puis au 104. Traces, du 23 au 27 octobre à 14h00. Salle de la Collection Lambert. Durée : 1h00. Mellizo Doble, Théâtre Benoît XII, les 24 et 25 octobre. Durée : 1h15. Reprises en tournée internationale.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 6:09 PM
|
Sur la page de "Barbatruc" l'émission de Dorothée Barba, sur France Inter 25/10/2020 Ecouter l'émission en ligne (1h)
Je ne suis pas sereine. C’est bien la première fois, depuis qu’existe cette jeune émission. J’ai la trouille, parce que nous allons parler d’un conte qui convoque chez moi des souvenirs vivaces. Ma petite sœur réclamait sans cesse qu’on lui raconte. Et je ne comprenais pas cette fascination. Je me souviens très bien que ça m’inquiétait, même : je trouvais ça tordu, cette envie d’entendre encore et encore la clé, la porte, et les corps sans vie baignant dans le sang. Barbe Bleue est au programme de Barbatruc, cette semaine.
Je me replonge dans cette histoire atroce et je réalise seulement aujourd’hui – comment ne l’avais-je pas remarqué ? – le rôle de la sœur. La sœur Anne, la fameuse, celle qui ne voit rien venir. Si Barbe Bleue me faisait si peur, c’est peut-être que je me sentais impuissante, que je m’inquiétais pour ma petite sœur ! Peut-être pour les femmes en général ? Tout cela serait-il affaire de sororité ? Voilà qui mérite de couper les poils de barbe en quatre, avec deux invitées.
Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la pensée féministe. Elle est l'autrice, entre autres, de La suite de l’Histoire – Actrices, créatrices (Seuil) et Féminisme et philosophie (Folio). Geneviève Fraisse est l’invitée de la revue trimestrielle Théâtre Public - été 2020. Lisa Guez est metteuse en scène de théâtre. Son spectacle Les femmes de Barbe Bleue, avec Juste avant la Compagnie, a été annulé à Avignon cette année. Il devrait être présenté le 15 décembre 2020 à l'Espace 1789 à Saint Ouen et au 104 à Paris à partir du 29 janvier 2021. La pièce a reçu deux prix au festival Impatience 2019. Le texte est édité à la Librairie Théâtrale. Reportage : Caroline Pomès a tendu son micro à des enfants et ados dans les rues de Bordeaux. Lecture : Mehdi Kerouani de la compagnie El Duende lit des extraits du conte de Charles Perrault. Cette version a été choisie dans le livre Les Contes de Perrault illustrés par l'art brut (éditions Diane de Selliers). Programmation musicale : - Billie EILISH My future
- DRAKE Hotline bling
Barbe Bleue, même pas peur ! © Getty / duncan1890

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 5:24 PM
|
Par Laurent Carpentier dans Le Monde , le 25/10/2020 Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. A Saint-Germain-des-Prés, le patron du Festival de Cannes dévoile ses plans pour une flamboyante édition 2021 et peste contre le couvre-feu imposé à la culture. Il est arrivé, engoncé dans son manteau, avec un air renfrogné. Café de Flore, haut lieu de Saint-Germain-des-Prés, pas très loin de chez lui. « J’ai failli vous appeler, ce matin, pour remettre. Avec le couvre-feu et tout ça. Et puis je me suis dit que j’allais vous dire tout le mal que je pense de votre traitement du cinéma dans Le Monde. Ça m’a donné du cœur au ventre. » Pierre Lescure (75 ans, président du Festival de Cannes, premier directeur de Canal+, père des « Enfants du rock » sur France 2, chroniqueur encore aujourd’hui pour l’émission « C à vous » sur France 5, un demi-siècle dans la culture…) n’a pas sa langue dans la poche, ni le mot « diplomatie » tatoué sur le front : « Si vous étiez cons, je n’en dirais pas un mot. Mais des mecs d’une telle intelligence qui en font un usage aussi désespérant, qui ne me donnent jamais envie de voir un film ! Même quand vous aimez, vous coupez la chique… » « Je suis né avec “Le Monde” » Il se marre. Ça sauve un peu. Et puis, de parler, ça va mieux. « Vous comprenez, c’est le journal que je lis depuis toujours. Je suis né avec Le Monde. » Ça pourrait être glauque, c’est bizarrement joyeux. Nous, on est venu pour parler de Cannes, de comment le Festival a traversé cette annus horribilis, pour, finalement, la semaine du 27 au 29 octobre, y présenter une version ultra-light, histoire de « rallumer la lumière » : « Quelques invités, une petite délégation et une montée des marches, symbolique mais quand même, pour que Cannes ait un peu une émotion. » En projection, la sélection des courts-métrages, celle de la Cinéfondation et de quatre films de la compétition qui n’a pas eu lieu : Un triomphe, d’Emmanuel Courcol, Les Deux Alfred, de Bruno Podalydès, Asa ga kuru (True Mothers), de Naomi Kawase, et Beginning (Au commencement), de la Géorgienne Dea Kulumbegashvili. A dire vrai, ceux-là et d’autres, on les a déjà vus. Sous l’appellation « Sélectionné au Festival de Cannes », Thierry Frémeaux, directeur et sélectionneur du Festival, et Pierre Lescure, président, ont en effet, depuis six mois, « promené » (comprendre « accompagné », mais le terme est joli) « leur » sélection d’une cinquantaine de films à Venise, Angoulême, Deauville, Saint-Sébastien, ou encore, la semaine dernière, au Festival Lumière à Lyon. Faute de pouvoir se tenir, Cannes a protégé sa marque. « Comme pour une année normale » « Quand le confinement démarre au début du mois de mars, le comité de sélection est en plein boulot, avec 2 000 films qui lui ont été proposés. Jusqu’au bout, on espère que le Festival va se tenir comme prévu en mai. A la mi-avril, on comprend que le doute est trop important, qu’il y aurait trop d’absents, d’étrangers qui renonceraient, que ça ne va pas être possible. On espère reporter à juin. Mais déjà on se dit : quoi qu’il se passe, faisons la sélection et on verra l’usage qu’on en fait. Donc, Thierry et son orchestre finalisent leurs choix comme pour une année normale. Sauf qu’ils en sélectionnent plus que d’habitude. Mi-juin – quand on prend la décision d’annuler le Festival –, on en annonce 52, une dizaine de plus qu’en temps normal. » Pierre Lescure s’est mis en jambes, a tombé le manteau, pioché dans les chips et ne rechigne pas maintenant à raconter, dans le désordre et avec faconde. On se dit que le ring est sans doute pour lui un terrain de jeu nécessaire. « Le label a été bénéfique pour tout le monde. Prenez Antoinette dans les Cévennes, extra ce film, pas une petite comédie du Massif central, mais le fait que l’on dise qu’on l’a sélectionné a attiré le regard dessus. » « De toute façon, je ne sais pas m’arrêter. Comme mon père, rédacteur en chef à “L’Humanité” : il est mort en bossant… » Ça s’appelle s’accrocher aux branches ? (Sur un ring, il faut renvoyer un peu les coups sinon l’adversaire s’ennuie). Et question s’accrocher, on lui rappelle sa réélection à la présidence du festival – pas gagnée, non ? – en début d’année. Esquive tranquille du briscard : « Il fallait qu’on se mette d’accord sur la manière dont je passerais le flambeau. En fait, il y a eu un flou artistique avant mon élection, parce que j’ai un peu hésité à me représenter. Alors, un certain nombre de candidatures, de désirs de me succéder, sont apparus. Finalement, je fais l’année prochaine et puis, on va travailler à trouver une candidate – qu’on n’a pas pour l’instant, mais on n’est pas aux pièces – que j’accompagnerai… Cela me plaît bien comme ça. » Et après ? « Après ? Mais j’ai plein d’autres choses. De toute façon, je ne sais pas m’arrêter. Comme mon père, rédacteur en chef à L’Humanité : il est mort en bossant… » Pierre Lescure manie la langue verte du gamin de banlieue grandi à Choisy-le-Roi avec sa mère et ses grands-parents communistes, et l’assurance du journaliste devenu patron de programme, puis patron de chaîne, membre de conseils d’administration… On est passé au tutoiement. Le rapport Hadopi, la S-VoD, Canal+, ses années Universal à Los Angeles, Deneuve, dont il fut le compagnon, la vague #metoo (« Sans grosse secousse, tu ne bougeras pas le confort bourgeois des mecs. Je connais un conseil d’administration dont les statuts imposent d’arriver à la parité pour payer les jetons de présence, je peux te dire que les mecs, ils se magnent, là »)… On parcourt les trente dernières années avec un guide assermenté du PAF, comme on disait autrefois, pendant que l’auteur de ces lignes s’embourbe dans des transitions qui n’en sont pas. « On va dire que l’apéro, on a chargé ! », s’amuse-t-il en sifflant un Coca. En 2021, embouteillage de films Le tabac de la rue de Fleurus où il voulait initialement nous retrouver était fermé, mesures sanitaires oblige. Ici, ça dégorge de touristes flirtant avec les fantômes d’Huysmans, d’Apollinaire ou de Beauvoir. Derrière la caisse, la gentille matrone qui surplombe la salle râlote : « C’est un mot fort, tout de même, couvre-feu… » « Il ne suffit pas de dire : “Ah ! La culture ! C’est essentiel !” Non, la culture c’est bandant. Ça doit provoquer du désir. » On s’est retrouvé à l’étage avec Lescure. « Je fais partie, dit-il, de ces gens qui pensaient que Bachelot allait obtenir cet Ausweis qu’eût été un ticket de cinéma ou de théâtre pour rentrer chez soi après la séance du soir. Le gouvernement a refusé de faire une exception… Putain, la culture, ce n’est pas juste un loisir ! Je suis né avec le TNP. Mon grand-père était aux chemins de fer, ma grand-mère dans l’enseignement, ma mère était secrétaire dans une banque mais ils étaient tous au cinéma tout le temps. Et je ne parle pas des livres. Donc, quand M. Castex dit “je suis sûr qu’ils vont s’adapter”, je dis non, tu dois traiter ça po-li-ti-que-ment. Il y avait une chance qu’avec ce ticket en forme d’autorisation, des gens qui ne vont pas souvent au spectacle soient justement incités à y aller, parce que cela aurait été une fenêtre de vie sociale au milieu des contraintes sanitaires… Il ne suffit pas de dire : “Ah ! La culture ! C’est essentiel !” Non, la culture c’est bandant. Ça doit provoquer du désir. » Il reprend son souffle. Se marre. Tape dans ses mains. Il est seul sur le ring. Double salto arrière. Cannes, 2021, l’annonce d’un embouteillage de films. Ça peut être « brillant et luxuriant » (ce sont ses mots), un embouteillage. « Les tournages reprennent et un paquet de films importants ont été reportés : le Paul Verhoeven, le Wes Anderson… Alors, on a déjà pris les dispositions pour que, quoi qu’il advienne, le Festival se tienne… en mai, je l’espère, mais s’il faut décaler, on trouvera les créneaux. » Il raccroche les gants. Manteau. Masque. Rire sous le masque. « Euh, essayez de ne pas me fâcher avec tout le monde quand même. » Laurent Carpentier Lire aussi Pierre Lescure, enfant de « L’Huma » et du rock Légende photo : Pierre Lescure au Café de Flore, le 17 octobre. Rudy Waks POUR "LE MONDE"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 5:07 PM
|
Par Christine Friedel dans Théâtre du blog 25/10/2020 Oblomov de Nicolas Kerszenbaum, d’après le roman d’Ivan Gontcharov, mise en scène de Robin Renucci - Production des Tréteaux de France Aboulie, apathie et manque de désir, sinon celui de se réfugier sur un tas d’oreillers et peluches : ce mal du siècle serait-il celui du nôtre, en ces temps incertains ? Comme dans une interminable adolescence ? Pour le héros, si l’on peut dire, tout se révèle une montagne à escalader. Gérer sa propriété, pour commencer ? Mais plutôt dormir. L’argent tombe, de moins en moins ? On verra plus tard... Cette image de l’aristocrate ruiné hante la littérature russe du XIX ème siècle. Honnête, mais sans projet ni autorité, vaguement « progressiste », il ne fait pas un geste, bercé, en éternel enfant, par un vieux serviteur dévoué qu’il oublie de payer. Oblomov est le cousin du Gaev de La Cerisaie et d’André, le frère des Trois sœurs… Ce roman foisonnant, à la fois réaliste, satirique et philosophique fait vivre tout un monde… Nicolas Kerszenbaum a radicalement élagué le texte pour en faire surgir une pièce très structurée, d’une pureté presque classique et resserrée autour du champion de la sieste et de la légende de l’enfant au brochet qui, pour avoir été bon une fois, reçoit en récompense tout ce qu’il désire. Sous l’amicale pression de son ami Stoltz (« fier » en allemand), Oblomov finit par quitter son divan. Il rencontre Olga, une délicieuse jeune fille à la voix d’ange. Ils tombent amoureux : pour lui, une piqûre de vie et un éveil enchanté à un avenir possible. Pour elle, la jouissance d’avoir trouvé dans son art, une âme sœur et sans doute aussi d’avoir réveillé un cœur endormi (le Prince au bois dormant ? ) Mais, mais… La vie à deux n’est pas si confortable, les projets s’embourbent dans la procrastination. Oblomov s’aperçoit qu’il ne cherchait pas une compagne mais une nounou… Qu’il trouve dans la cuisine et non dans les exaltations musicales… L’auteur de la pièce décrit la courbe ascendante et descendante d’un amour mais parle aussi vraiment de la peur de vivre, de la peur du risque. Comme Ivan Gontacharov, il ne condamne pas ses personnages mais est sans indulgence pour l’égoïsme d’Oblomov, l’honnête homme qui finit par vivre avec sa servante pour être sûr d’être servi. Du reste, il n’est pas ingrat. Mais Olga, aveuglée par le fantasme de l’amour souverain qu’elle aurait enflammé ? Mais Stoltz, qui récupère la dite Olga et met leur vie au carré, en bon Allemand? Il a un regard sur eux compréhensif et navré : chacun fait ce qu’il peut… Quant aux serviteurs, « ceux d’en bas », ils n’ont pas le loisir d’être égoïstes ! Et pourtant on les aime tous et cela, on le doit aux comédiens. Une scène particulièrement touchante, dans son économie : celle où l’escargot sorti par force de sa coquille (Xavier Gallais), découvre le coup de foudre et il le bafouille à la jeune femme dont la voix l’a traversé (Pauline Cheviller). Une autre scène où modestement, la servante (Emmanuelle Bertrand) donne à Olga l’enfant qu’elle a eu de Monsieur, pour qu’il ait une vie meilleure. Mère porteuse de l’amitié et de l’amour… Valéry Forestier et Gérard Chabanier, tous deux comédiens formateurs à l’ARIA*, sont avec délicatesse, le vieux serviteur et l’ami qui soutiennent le vacillant Oblomov… La scénographie de Samuel Poncet fonctionne bien: une chambre ouverte ou fermée, un écran pour visions idylliques et écrin de l’inertie du héros, occupe, on pourrait presque dire encombre, le centre de la scène, comme cet Oblomov qui ne sait pas quoi faire de lui-même. Le metteur en scène n’a pas cherché particulièrement à faire russe : c’est dit et cela suffit. Il ne développe pas non plus une psychologie démonstrative : les comédiens jouent les situations, avec leurs pièges et contradictions. L’émotion affleure et l’on rit, comme chaque fois que le théâtre nous offre un moment de vérité humaine. Mais on se demande pourquoi l’excellente violoncelliste Emmanuelle Bernard quitte son instrument pour incarner la servante, avec un jeu discret et avec ce que la sincérité apporte de profondeur… Côté cour, comme il se doit. Olga, elle, évolue plutôt côté jardin mais aussi face public. Bien sûr, les contraintes économiques jouent. Mais cette double présence sur le plateau contient aussi un message secret : et si Oblomov avait été touché par une autre musique, celle -métaphorique- de la servante ? Et si sa vie n’était pas aussi ratée qu’il le croit ? Au point de se laisser mourir: et cela clôt toute inquiétude. On s’aperçoit que rien n’est simple et qu’on n’est pas dans un conte de fées. On n’attribuera pas forcément ces rêveries sur l’art secret d’une prolétaire aux intentions du metteur en scène mais merci à lui de nous en avoir donné l’occasion. C’est aussi le travail du spectateur d’ouvrir les failles qui se dessinent dans cet Oblomov sensible, et généreux en ce qu’il ne laisse aucune place à l’ironie mais tout à l’humour et à la tendresse. Bref, on ne repart pas les mains vides… Christine Friedel Spectacle vu aux Tréteaux de France en tournée à Compiègne (Oise).
Le 14 novembre, salle des fêtes, Verneuil-sur-Avre (Eure) ; le 24 novembre, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan (Var), les 27 et 28 novembre, Scène Nationale de Châteauvallon (Var). Le 9 décembre, Théâtre de l’Union, Limoges (Haute-Vienne). Le 2 février, Espace culturel des Corbières, Lézignan (Aude). *A.R.I.A.: Association des Rencontres Internationales Artistiques. Les vingt-troisièmes rencontres auront lieu du 18 juillet au 14 août prochains. Cette association d’éducation populaire fondée en 1998 par Robin Renucci en Corse propose des formations et stages de théâtre se concluant par des représentations en plein air dans plusieurs lieux du patrimoine.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 2, 2020 2:10 PM
|
Il faudra faire des choix sur ce que l’on veut porter demain » (Nicolas Royer, Espace des Arts)
Publié dans NewsTank le 30/10/2020 « Lors du premier confinement, nous avions reporté le plus possible les spectacles annulés sur la saison 2020-2021, qui est, de fait, très dense dans beaucoup de théâtres. (…) En novembre, nous n’avons pas encore pris nos engagements pour la saison 2021-2022. Deux possibilités s’offrent à nous : fait-on une nouvelle saison avec de nouveaux projets ou, a contrario, repoussons-nous les spectacles de cet automne à la saison prochaine ? Nous ne pourrons pas faire les deux, relancer la machine et reporter. Nous n‘aurons ni les espaces ni le public pour tout accueillir », indique Nicolas Royer, directeur de l’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), à News Tank le 30/10/2020.
« Il faudra que notre profession s’interroge au niveau de ses instances : Syndeac, qui représente beaucoup de compagnies avec lesquelles nous devrons échanger, Scènes nationales, CDN. Notre profession doit être unie. Il faudra faire des choix sur ce que l’on veut porter demain, et les assumer », ajoute Nicolas Royer qui répond aux questions de News Tank. Annulation de la 1re édition du festival TransDanses La Scène nationale devait organiser, du 10 au 23/11/2020, la première édition de TransDanses, festival dédié à la danse et aux arts du mouvement dans leur relation avec la musique, notamment électronique. Sept spectacles, dont deux créations, ainsi que la projection d’un documentaire étaient programmés. L’Espace des Arts devait accueillir, du 10 au 23/11/2020, la première édition du festival TransDanses. Un reconfinement national ayant été annoncé par le Président de la République, ce nouveau temps fort ne peut plus se tenir. Envisagez-vous de reporter les spectacles prévus, ainsi que ceux qui étaient programmés dans la saison en novembre ? C’est une vraie question. Lors du premier confinement, nous étions dans la sidération, la torpeur. Le sentiment n’est pas le même aujourd’hui. Depuis le printemps, nous avons été extrêmement volontaristes et avons enclenché des projets futurs avec les artistes avec des situations très différentes d’une discipline à l’autre : - La danse, déjà très fragile avant le début de la crise sanitaire, a du mal à se remettre en mouvement.
- Le cirque, qui est un secteur très international, souffre des restrictions en termes de mobilité et connaît par conséquence une certaine « crise de création » avec très peu de nouveaux projets.
- La musique est, elle, dans une situation catastrophique. Les musiques actuelles étaient jusqu’à présent encore quasiment à l’arrêt en raison de l’interdiction de la jauge debout. Un petit segment avait réussi à s’organiser en proposant des concerts assis avec jauge réduite mais la musique, dans son ensemble, est un secteur lourdement touché.
« Dans le théâtre, nous nous sommes retrouvés face à une sur-offre de projets » À l’inverse dans le théâtre, nous nous sommes retrouvés face à une sur-offre de projets. Les artistes confinés ont nourri plein de rêves pendant cette période d’arrêt. Nous nous devions de les accompagner dans ces nouveaux projets. En mars, nous avions reporté le plus possible les spectacles annulés sur la saison 2020-2021, qui est, de fait, très dense dans beaucoup de théâtres. À l’Espace des Arts, la période janvier-juin 2021 compte un volume de spectacles quasiment deux fois plus important que ce que nous proposons normalement. Avec le flux important de projets reportés et nouveaux, la problématique va être de savoir comment donner de la visibilité à tous ses spectacles. Nous ne pourrons pas reproduire la mécanique mise en œuvre après le premier confinement. En novembre, nous n’avons pas encore pris nos engagements pour la saison 2021-2022. Deux possibilités s’offrent à nous : fait-on une nouvelle saison avec de nouveaux projets ou, a contrario, repoussons-nous les spectacles de cet automne à la saison prochaine ? On ne pourra pas faire les deux, relancer la machine et reporter. Nous n‘aurons ni les espaces ni le public pour tout accueillir. « Nous n‘aurons ni les espaces ni le public pour tout accueillir » C’est une réponse collective qu’il nous faudra donner. Il serait terrible que chacun fasse les choses dans son coin. Notre profession devra s’interroger au niveau de ses instances : Syndeac, lequel représente beaucoup de compagnies avec lesquelles nous devrons échanger, Scènes nationales, CDN. Notre profession doit être unie. Il faudra faire des choix sur ce que l’on veut porter demain et les assumer. C’est un changement fondamental. Le nouvel épisode qui s’ouvre nous permet au moins d’ouvrir et d’accueillir les équipes artistiques et de leur permettre de travailler. Symboliquement, c’est important que le Gouvernement prenne cette position. Cela change beaucoup de choses. L’art est toujours un combat et nous avons là peut-être gagné une bataille. Elle n’est en tous les cas pas à minimiser. Pendant le premier confinement, les théâtres, salles de spectacles et équipes artistiques ont imaginé des projets, souvent via le numérique, pour garder le contact avec le public. Allez-vous réitérer cela cet automne ? Nous n’avons jamais perdu le lien avec le public. Dès le mois de mai 2020, nous avons tourné dans tous les EHPAD de Saône-et-Loire avec le spectacle « Cabaret sous balcon » créé par Léna Bréban. Nous avons aussi organisé, en lien avec le conservatoire du Grand Chalon et L’Abattoir - Cnarep, un été culturel pour les jeunes avec des ateliers de pratiques artistiques et de rencontres avec des artistes. « Faire circuler le projet numérique I-Dance dans les collèges et lycées du département pendant ce reconfinement » La situation est très difficile pour la jeunesse et il nous faut l’accompagner. C’est pourquoi, je réfléchis à un dispositif extérieur qu’on pourrait lancer autour du projet numérique I-Dance de l’artiste Pierre Giner et développé par Bonlieu Scène nationale, que nous devions accueillir dans le cadre de TransDanses. I-Dance consiste pour les utilisateurs à se créer un avatar, puis, via une appli, à le faire danser sur des chorégraphies d’artistes reconnus. L’idée serait de faire circuler I-Dance dans les collèges et lycées du département qui resteront ouverts pendant ce reconfinement. Monter un festival dédié à la danse alors que cette discipline a déjà été très fragilisée par la crise constituait un soutien fort. Pourquoi ce choix d’accompagner la danse ? Historiquement, l’Espace des Arts porte une attention particulière à la danse. Avant d’obtenir le label Scène nationale, il était « Plateau pour la danse ». Un festival de danse contemporaine, Instances, existait déjà depuis longtemps. Il me semblait important d’aller plus loin en considérant la danse au-delà de la seule « catégorie » danse contemporaine. D’une part, celle-ci est arrivée à maturité et, d’autre part, les artistes ont complètement intégré l’hybridation des disciplines dans leurs créations : le cirque, le théâtre, le hip-hop, les arts numériques… À l’image, notamment, de ce que fait le collectif (La)Horde qui devait présenter son spectacle « Room With A View » avec Rone. Le festival TransDanses est porté par la volonté de donner de la visibilité aux arts du mouvement dans leur diversité. La danse a donc son festival mais est aussi très présente dans la programmation à l’année. Dans le projet que je porte, je souhaite également créer un espace dédié aux danseurs de hip-hop et lancer un grand plan de formation pour les accompagner à l’échelle de la Région Bourgogne Franche-Comté. Vous avez pris vos fonctions en janvier 2020. Comment avez-vous appréhendé ce nouveau rôle de directeur-programmateur dans ce contexte ? Lorsque j’ai écrit mon projet pour la Scène nationale, j’avais beaucoup requestionné ce rôle de directeur-programmateur. La programmation est bien sûr importante mais je la conçois comme une « compétence » partagée. C’est pour cette raison que j’ai créé un comité de programmation qui réunit sept personnes. Je me positionne davantage comme un « directeur-animateur » ou créateur d’une dynamique globale en prise avec le territoire, et dont la programmation est un axe. Cela suppose de remettre la maison au cœur de la ville, de la repositionner dans un lien plus fort avec les habitants, les élus. C’est un aspect important du projet que je porte et qui détermine tout ce que nous développons : la création d’un bar avec un prestataire extérieur au sein de notre lieu, la création de l’espace dédié au hip-hop ou encore la création d’une classe aménagée à l’Espace des Arts. Cette classe accueillera sur une semaine des élèves auprès desquels interviendront régulièrement les artistes Pauline Bureau, Léna Bréban, Olivier Letellier et Antoine Prud’homme, autour de la question de l’oralité. Des axes de votre projet ont-ils évolué au regard de la crise que nous traversons ? « Être en capacité de jouer pour tous et pour chacun » Évidemment. Jamais lorsque j’ai été nommé, je n’aurais pu imaginer que nous allions jouer tout l’été. Ce que je retiens surtout de cela c’est l’importance d’être en capacité de jouer pour tous et pour chacun. J’avais peut-être intuitivement intégré cela dans mon projet mais je ne l’avais pas réellement pensé, n’en avais pas perçu totalement tous les enjeux, les limites. Au regard de la crise sanitaire, politique et de libertés que nous traversons, ce « jouer pour tous, jouer pour chacun » est sans doute à intégrer encore plus fortement dans nos actions. Face à l’obscurantisme latent de nos sociétés, nos endroits sont absolument nécessaires. Nous avons une responsabilité collective à faire en sorte que l’art, et la culture en général, reste très prégnant sur nos territoires.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 1, 2020 4:20 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération 1er novembre 2020 Jeudi dernier à Nantes, le metteur en scène et l’historien ont donné leur performance érudite et drôle autour de ces objets de bazar, point de départ à des métaphores sur le bon goût et les mondes tenus sous cloche.
Le gouvernement vient de le rappeler sans détours : il y a ce qui est vital et ce qui ne l’est pas, les commerces de première nécessité, et puis les autres. Parmi les choses qui ne servent visiblement à rien, il y a par exemple ce petit objet qu’on ne trouve pas dans les supermarchés, mais parfois encore dans cette micro-échoppe venue du passé, au bout du rayon de l’inutile et du vain, derrière l’étagère du dérisoire, en penchant bien la tête vers le bas. Vous l’aviez oubliée mais elle est toujours là, endormie, il faut la secouer pour qu’elle reprenne vie. C’est un jouet ? Pas tout à fait. C’est un monde sous cloche, un paysage en suspension, un concentré d’artifice et de factice, c’est une boule à neige. Certains fous y consacrent leur vie.
Collectionneurs. Jeudi soir, alors que les gens se préparaient en panique au reconfinement et qu’un nouvel attentat terroriste à Nice tordaient les boyaux du pays, on ne savait plus si c’était vraiment l’urgence, de parcourir des kilomètres pour assister à la première et à l’ultime représentation de Boule à neige, spectacle du metteur en scène Mohamed El Khatib et de l’historien Patrick Boucheron, donné au Grand T à Nantes. Eux non plus, d’ailleurs, ne savaient plus si leur produit était vraiment de première nécessité. «On a failli pas venir, lance El Khatib à la centaine de spectateurs réunis en cercle autour de lui. J’avais pas très envie. Et on savait pas si vous alliez venir non plus.» Mais tout le monde est bien là pourtant, face à ce curieux petit théâtre anatomique, un espace en clin d’œil aux cabinets de curiosité sans doute, ce luxe bourgeois du XIXe siècle où la boule neigeuse serait née. Est-on bien sûr de l’origine, pour commencer ? Nous voici alors plongés au cœur du travail d’enquête de l’historien, ce très affable et plaisantin Patrick Boucheron, chargé de confronter les documents sous l’œil amusé de son copain El Khatib, histoire de nous montrer en passant comment s’élabore un récit scientifique et où peut s’introduire la fiction. Le terrain est inattendu mais aussi très riche, notamment en témoignages vidéo des plus grands collectionneurs internationaux (un fonds de 20 000 boules pour celui de Los Angeles) spéculant sur les origines exactes de la boule à neige (Nevers ou Nuremberg ?) ou appréciant la qualité de suspension des flocons (inégalée chez les artisans allemands). Un terrain riche, encore, en anecdotes pêchées par les deux auteurs sur le contenu de la «boule zéro» (la tour Eiffel sans doute), les guerres fratricides entre fabricants français, ou les crises géopolitiques (boycott des boules à neige chinoises après qu’elles ont été remplies d’eaux polluées du port de Hongkong). Un terrain riche, surtout, en énigmes irrésolues, au rang desquelles : mais putain à quoi sert ce truc ? Qui a pu avoir l’idée de faire fabriquer des boules à neige à l’effigie de votre journal Libération – comme celle qu’on aperçoit sur le plateau ? Cet objet dénigré est-il réellement, comme l’écrivait le célèbre chionosphérophile (oui oui) Walter Benjamin, une «conjuration enfantine contre la méchanceté du monde» ? A t-il le pouvoir de retenir les désastres ? Faut-il considérer ses collectionneurs comme des névrosés accumulateurs ou des précieux gardiens du temple ? Eux-mêmes n’ont jamais tranché.
Brûlot. En ce dernier soir de fête, une mécanique simple et puissante s’enclenche vite, celle des métaphores. Car c’est de boules à neige qu’on est venu nous parler mais aussi de la scène du théâtre bien évidemment, et de la culture plus largement. Celle, par exemple, qui nous questionne sur le bon et le mauvais goût, le noble et le refoulé, la construction de la valeur et du coût. El Khatib a tissé le spectacle, explique-t-il, après avoir découvert la collection de boules à neige d’Yvette, supportrice du RC Lens qu’il a rencontrée sur un précédent projet, moins réussi que celui-ci, Stadium. Il a voulu faire, dit-il, «l’archéologie de sa tendresse». Les thèmes qui lui sont chers, à lui, ce bourdieusien sardonique, sont comme grossis à la loupe, à mesure que Boule à neige se transforme en plaidoyer pour les passions populaires, ou plus exactement en un brûlot contre ces élégants qui prétendent défendre les prolétaires tout en méprisant ce qui les émeut. Tout est drôle ici, de cette drôlerie qui fait la patte d’El Khatib, cet artiste qu’on aime pour sa façon de tenir délicatement dans une main le ridicule et la tendresse, ou de jouer de soudains écarts d’échelles entre le pathos et le grotesque. Des jeux d’échelles, c’est au fond ce que propose ce petit monde portatif au coin de la cheminée. Et c’est aussi ce que visent l’artiste et l’historien : passer les vies minuscules au miroir grossissant, émettre un doute sur ce qui est vain ou important, renverser la donne entre l’infiniment petit et le démesurément grand. Boule à neige de Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron Probables dates futures : du 15 au 29 décembre, Grande Halle de la Villette, 75019. Dans le cadre du Festival d’automne à Paris. Ève Beauvallet Envoyée spéciale à Nantes Légende photo : Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib, en plein éloge de l’inutile. Photo Yohanne Lamoulère. Tendance Floue

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2020 6:05 PM
|
Sur la page des Fictions de France Culture, diffusé le 31 octobre 2020
Septembre 1940. Joseph Bridet se rêve en héros des Forces libres et tente de jouer la comédie auprès des autorités de Vichy. Et le voici pris au piège, inexorablement.
Ecouter la fiction (58 mn)
Joseph Bridet a été démobilisé après l'armistice de juin 1940 et s'est réfugié, aux côtés de sa femme Yolande, en zone libre, à Lyon. Idéaliste, il se rêve en héros des Forces libres. Il se rend alors à Vichy où il tente de jouer la comédie auprès des autorités du régime, en clamant un peu trop imprudemment sa fidélité au Maréchal, dans l'espoir d'obtenir une mission en Afrique du Nord qui lui permettrait de rejoindre l'Angleterre… Mais le tempérament indécis et les maladresses de Bridet finiront par se retourner contre lui et le perdre…
Écrit sous l'occupation allemande mais publié en avril 1945, quelques mois avant sa mort, ce roman de Bove n'eut aucun succès. En cet immédiat après-guerre, alors que le pays juge ses traîtres et révère ses libérateurs, comment accepter un roman construit autour d'un « héros » sans envergure et aussi négatif ? Le style de Bove, d'une grande subtilité, agit ici à la perfection : des dialogues courts et ciselés, un sens étonnant du détail, un décor vide, anxiogène, une écriture « blanche » - qui annonce Camus et Modiano, et nous voici pris au piège, inexorablement, de ce roman trouble et réaliste, l'un des rares écrit sur les premiers temps de Vichy et de l'Occupation.
Adaptation : Stéphane Bonnefoi
Réalisation : Cédric Aussir
Conseillère littéraire Caroline Ouazana
Avec Jean-Claude Dauphin, Pascal Collin, Constance Dollé, Pierre Baux, Patrice Bornand, Clément Morinière , Antoine Doignon, Dominique Daguier, Antoine Basler , Jean-Paul Bordes , Antonin Meyer, Yoann Piquet, Régis Royer, Cyrille Labbé, Dominique Parent, Jean O’Cottrell , Thierry Bosc, Léo Reynaud , Antoine Libguinou , Eric Challier , Antoine Joly, Olivier Chauvel , Pierre-Marie Schneider, Laurent Claret , Alain Lahaye , Nathalie Cerda , Bastien Bouillon , Jean-Gilles Barbier , Gabriel Dufay, Thierry Launey, André Osinsky, Raphaël Magnabosco, Yves Heck
Bruitages : Sophie Bissantz
Musique originale : Manuel Peskine
Alto : Maud Gastinel
Flûte : Gwladys Marceau
Ondes Martenot : Nathalie Forget
Piano, célesta : Manuel Peskine
Pris de son, montage, mixage : Bruno Mourlan, Bastien Varigault
Assistante à la réalisation : Cécile Laffon
Emmanuel Bobovnikoff est né le 20 avril 1898 à Paris, d'un père russe aux revenus incertains et d'une mère domestique. Dès l'âge de 14 ans, Emmanuel décide de se consacrer à l'écriture. Et s'il occupe quelques boulots (taxi, manœuvre, garçon de café, fait-diversier…), c'est toujours dans l'idée de nourrir ses écrits. En 1924, il publie grâce à Colette Mes amis chez Ferenczi. C'est un succès et il rencontre à Paris un Rilke admiratif. Bove enchaîne : Armand, Bécon-les-Bruyères, Un soir chez Blutel… Démobilisé en juillet 40, il espère gagner Londres via l'Afrique du Nord et refuse de publier dans la France occupée. Il réside en 1942 à Alger où il écrit Le piège. L'ouvrage ne sera publié qu'après la libération, deux mois avant sa mort le 13 juillet 1945. Oubliée durant des décennies, l'œuvre d'Emmanuel Bove connaît un nouvel engouement en France, mais aussi en Allemagne grâce à Peter Handke et Wim Wenders.
Le piège d’Emmanuel Bove est publié aux éditions de la Table Ronde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2020 12:16 PM
|
Par Thierry Jallet dans le site Wanderer - le 28 octobre 2020 La Semaine d’Art en Avignon débute malgré toutes les contraintes horaires imposées. En cette fin d’après-midi, les spectateurs s’installent dans la salle de la FabricA, suivant l’ordre d’accès imposé. À cet instant, on ressent tout de même cette fébrilité qui règne en d’autres circonstances, lors du Festival en été, devant ce vaste plateau ouvert, laissant apparaître les cintres. Plusieurs portiques avec des rideaux de plastique rouge entourent l’espace de la scène. L’ensemble est éclairé par des servantes sur pied, alignées avec soin tout autour du plateau. Au centre, un piano. D’autres se trouvent à l’avant-scène, côté jardin comme côté cour. Ceux-là sont endommagés, en pièces, dans un empilement hétéroclite. Au fond, à jardin, deux rangées de fauteuils tournés vers le côté cour – comme dans un lieu de culte pour une célébration ou bien comme au spectacle. Huit comédiens sont déjà là, assis et semblent attendre, regardent de temps à autre en direction le public dans un premier effet d’étrangeté qui absorbe, tel un fragment de miroir lointain, réfléchissant la salle.
Les notes de trompette si reconnaissables par les festivaliers retentissent. Après quelques recommandations d’usage, les projecteurs latéraux s’allument, le spectacle commence. D’autres comédiens entrent rapidement à cour et se placent face aux autres. Les tenues conçues par Macha Makéïeff et Claudine Crauland sont bigarrées, la plupart des couleurs chaudes s’inscrivent en harmonie avec la lumière. Le musicien Anthony Caillet joue de l’euphonium. Sur le lointain, on lit « Le premier instant dure toujours ». Une femme se lève et s’avance vers le public. Elle lit tandis que tous la regardent. Hélène Patarot lit avec une certaine gravité Les Métamorphoses, le texte d’Ovide qui relate le mythe d’Orphée. La comédienne prête sa voix au Demi-dieu. Comme lui, elle est sur cette ligne invisible entre un monde et l’autre, entre la terre et les Enfers, entre l’univers des hommes et celui des Dieux. Entre l’espace théâtral et l’espace dramatique où finalement se tient toujours le comédien au théâtre. Le propos sensible et poétique se déploie. Les différents éléments qui composent le spectacle semblent fusionner dans une articulation très esthétique. Les voix retentissent, les mots de Valère Novarina s’énoncent, la musique s’élèvent, les images apparaissent harmonieusement. La Personne morte – Karyll Elgrichi tout en grâce au fil des scènes – se trouve ensuite à l’avant-scène et dans une activité évoquant à la fois l’utilisation des matriochkas russes et le bonneteau, elle agite, mélange, empile des boîtes les unes dans les autres, dont elle révèle qu’elles contiennent les cendres de ses ascendants, de ses descendants. Alors qu’une trappe s’ouvre vers les dessous – endroit limbesque du théâtre, plein de mystère et d’inconnu pour le spectateur – elle jette les boîtes à l’intérieur. Et les frontières du réel se déplacent. Jean Bellorini rappelle que, comme la Personne morte, chacun est constitué de ses morts, de ces vies passées qui ont précédé la sienne. Et chacun constitue également ceux qui lui succèderont, après sa propre disparition. Mais comment échapper à cette fin, « à la poubelle, dans la nuit » ? Comment repousser définitivement cet instant fatidique où tout s’arrête ? On croit percevoir ici les accents du désespoir devant l’inéluctable. Orphée malgré lui, un peu plus loin, provoque malgré tout l’hilarité du public : « Ceux qui ont tagué La mort est nulle au bord du canal de l’Ourcq, ont bien fait » Interprété par la jeune et prometteuse Liza Alegria Ndikita, l’Ambulancier Charon s’interroge : « Quand serons-nous au plus près de la vie sur cette île de bois ? », ce qui n’est pas sans rappeler une fois encore la réflexion, le travail du comédien sur les planches. Pour Jean Bellorini et Valère Novarina, c’est également le tourment d’Orphée dans sa remontée vers la surface. Orphée malgré lui qui retrouve Eurydice aux Royaume des Morts, qui retrouve sa parole magique, perdue avec sa bien-aimée. Orphée malgré lui qui affirme « je respecte beaucoup le réel mais je n’y ai jamais cru ». Orphée enfin qui prend résolument le parti de vivre pleinement en se retournant, en acceptant le risque de perdre une deuxième et dernière fois celle qu’il aime. Et elle disparaît. C’est la vie aussi, pourrait-on en conclure ici. Une autre figure hante le plateau : Flipote, sorte d’avatar décadent de la déesse des Enfers, « une espèce de Perséphone » comme elle le précise, interprétée par Anke Engelsmann, comédienne allemande passée par le Berliner Ensemble, sensible et si troublante par moments, notamment dans ses morceaux chantés. Elle décrit le monde de la nuit noire et infernale puis présente au public dans une séquence presque brechtienne, tous les personnages comme autant de fantômes damnés, toutes les « ombres » du Jeu des ombres. Nous sommes soumis à un mouvement oscillatoire permanent entre la dévastation infernale – rappelons la scénographie des pianos brisés, mais aussi les lumières rougeoyantes derrière les rideaux de plastique, le maquillage morbide des comédiens – et le mouvement vital qui ne cesse de jaillir partout. On oscille aussi entre le drame et le réel de la représentation. Les limites deviennent floues, les frontières s’estompent – d’ailleurs, comment croire pleinement au réel dans ces conditions ? – tout s’opacifie au rythme de la langue incantatoire et mystérieuse du poète Novarina. L’équilibre du spectacle tient aussi à la musique si délicatement présente. Jean Bellorini dit d’ailleurs qu’il situe les musiciens et les acteurs au même endroit comme toutes ses mises en scène ne cessent de le souligner. Anthony Caillet, Clément Griffault, Barbara Le Liepvre et Benoît Prisset habitent l’espace avec les comédiens et leur pratique instrumentale entre complètement dans sa composition, au même titre que le ballet des corps – harmonieusement pensé par Thierry Thieû Niang, que les lumières – somptueuses servantes ! – et les mots du texte. Toutes les voix chantées du jazz à la variété, en particulier celles du comédien Ulrich Verdoni et de la mezzo-soprano Aliénor Félx qui reprend des airs de L’Orfeo baroque de Monteverdi adaptés par Sébastien Trouvé, rappellent l’origine de l’enchantement que provoquait Orphée avec sa voix et sa lyre. Un pouvoir extraordinaire, celui de la poésie. Ces voix mélodieuses se font également l’écho de cette tension vers la vie éternelle. Elles glissent sur les corps qui tournoient, qui dansent. Elles emplissent l’espace du théâtre dans lequel elles résonnent. Elles s’impriment sur le panneau tendu au lointain. Elles sont une des manifestations du sentiment amoureux. De l’art. De la vie, en somme. Orphée dans Le Jeu des ombres, devient un personnage choral. Les comédiens tantôt se rassemblent – au cours de très beaux moments à l’avant-scène tous derrière une servante ou bien en ligne où ils sont vêtus de blanc ; tantôt ils sont solistes d’une partition dont les fragments s’enchaînent les uns aux autres, au fil des scènes. La mort « est hors du temps, elle n’a rien à dire » nous lance l’Ambulancier Charon. Cette figure orphique collective qui évolue sur scène semble justement conjurer le mauvais sort qui condamne au silence et à la mort inéluctable. Comme un acte d’insoumission, au moins le temps du spectacle. Pour ne pas rejoindre « sous terre, les dévissés de la vie » et rester obstinément en éveil.En effet, c’est à une célébration pleine de d’allégresse et de fureur que nous nous sentons conviés. Elle se termine sur une lente énumération proférée par le formidable François Deblock et Karyll Elgrichi – comme un temps retrouvé proustien. Et cette même énumération s’achève, elle, par le mot « Eurydice ». C’est bien sa parole perdue qu’Orphée semble retrouver ici finalement. Comme un dernier jaillissement de vie, un dernier souvenir de la femme aimée qu’il garde en lui vivante pour toujours. Le spectacle soulève et emporte dans une articulation élégante de tout ce qui le constitue : sa dimension plastique pensée par Jean Bellorini, Véronique Chazal et Luc Muscillo, la place essentielle qu’occupe la musique et le chant, la langue sibylline et audacieuse de Valère Novarina sans oublier l’engagement tout à fait remarquable des comédiens – avec une mention particulière pour Marc Plas dans un morceau de bravoure exceptionnel au début de l’acte IV où il égrène sans faillir, une longue série de citations sur Dieu. Voilà donc du beau théâtre qui invite à la méditation alors qu’on quitte la salle et qu’on entend encore résonner en soi les mots d’Orphée malgré lui. « Souffle ! respire ! prie ! chante ! inverse tout, passe par-dessus ! » Crédits photo : © Pascal Victor Cet article a été écrit par Thierry Jallet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2020 5:57 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 29/10/2020 Le président de la République a laissé entendre par son silence, son « oubli » de la culture, que cette dernière n’est pas une nécessité, une source de connaissance, de réflexion, de beauté, un baume, un supplément d’âme, mais une distraction dont on peut se passer. Que les travailleurs qui la font vivre, ne comptent pas. Inventaire du cimetière théâtral de novembre. Dans les quatre semaines qui viennent, je ne verrai donc pas Gwenaël Morin traquer l ‘infini d’Andromaque, je n’entendrai pas la prisonnière se lamenter à propos de son fils, le seul bien qui lui reste et d’Hector et de Troie, dire « j’allais seigneur, pleurer un moment avec lui:/ Je ne l’ai point encore embrassé au jourd’hui ». Je ne serai pas à Strasbourg pour la première de Mithridate du même Jean Racine et voir vaciller le coeur et le trône de ce « roi de Pont et de quantités d’autres royaumes » dans la mise en scène d’Eric Vigner où Stanislas Nordey est , le temps d’un spectacle, le père de Thomas Jolly. Je ne verrai pas non plus au Maillon la première de Bandes en retrouvant Camille Dagen après son mémorable Durée d’exposition. Je n’irai pas à Nantes entendre le babil de Sébastien Barrier et le voir commencer une phrase qu’il mettra une bonne demie heure à finir en nous parlant, utopique programme , de Ceux qui vont mieux, c’est le titre. Je n’irai pas à Lorient voir comment Rodolphe Dana et Katja Hunsinger se sont aventurés dans Bartleby, ce texte retors de Melville. Ce n’est pas que je préfère ne pas. C’est que je ne peux pas, confinement oblige. Je n’irai pas à Aubervilliers entendre Maxime Kurvers me parler du jeu et de l’art de l’acteur, je ne verrai pas à l’Echangeur de Bagnolet l’acteur Yann Collette dire et faire entendre Les enfants éblouis, un texte de Yann Allégret, je n’irai pas au Théâtre 14 découvrir Antis une pièce de Perrine Gérard, autrice que je ne connais pas dans une mise en scène de Julie Guichard dont je connais un peu le travail. Je n’irai pas à Lyon voir une nouvelle mise en scène de Ivres la belle pièce du russe de Ivan Viripaev dont j’avais vu naguère Moscou le premier travail alors qu’il arrivait d’Irkoutsk. Je n’irai pas à la Piscine de Chatenay-Malabry, voir Les couleurs de l’air, le nouveau travail d’Igor Mendjisky. Je ne verrai pas à Sceaux Le jeu des ombres la nouvelle pièce de Valère Novarina, une commande de Jean Bellorini (oui, une commande, ils ne sont pas légion les théâtres et les metteurs en scène qui commandent des pièces à des auteurs). Je n‘entendrais donc pas le Pangolin dire : « Alors l’homme fit l’homme de sa tanière sortir - et il alla chanter la suite loin de son cadavre : ‘homme je te le dis et re-te-lere-de-te-le dis : Fidèle animal domestique, ne va jamais chercher ailleurs la Raison que dans ta chair vivante ». Non, je ne verrai pas, n’entendrai rien de tout cela. Je n’irai pas à Toulouse voir comment la chilienne Millary Lobos Garcia a interprété La réunification des deux Corées de Joël Pommerat, ni à Valence renouer avec Comédie de Beckett par l’Italienne Silvia Costa. Je ne pourrai pas me plonger dans Abysses de Davide Enia que met en scène la nouvelle directrice du CDN de Thionville, Alexandra Tobelaim. Ni compter les 137 évanouissements qui traversent le théâtre de Tchekhov, un marathon mis en scène par Christian Benedetti au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet. Je n’irai pas à Besançon assister à Molière par les acteurs du tg STAN devenus, au fil du temps, comme des amis anonymes. Non, je ne verrai pas à l’Odéon la suite du tête à tête entre Fedor Dostoïevski et Sylvain Creuzevault autour des Frères Karamazov où j’aurais eu la joie de retrouver les actrices et les acteurs du Grand inquisiteur. Et je ne verrai pas non plus au théâtre de la Tempête le nouveau spectacle d’ Elise Chatauret A la vie ! (quel titre !); ni comment s’est débrouillé Pascal Kirsch au Théâtre des Quartiers d’Ivry pour adapter Solaris du polonais Stanislas Lem et tenir en respect le film éponyme de Tarkovski. Non, hélas, non, Je n’irai au théâtre de Nanterre Amandiers voir Das weinen (Das Wâhnen) de Christoph Marthaler, un spectacle que je ne verrai probablement jamais. Au sortir du métro à Bobigny, je ne prendrai pas le chemin de l’avenue Lénine pour découvrir Mauvaise de Sébastien Derrey. Je n’irai pas à Valenciennes camper devant Les forteresses de Gurshad Shaheman où il donne la parole à ses tantes et à sa mère. Je n’irai pas non plus à Toulouse le 25 novembre pour la première d’Antigones, un spectacle de Nathalie Nauzes d’après le roman de Henri Bauchau, ni le 26 à la première du nouvel opus du Raoul collectif au théâtre de la Bastille , mon coeur n’aura donc pas à balancer avec Catarina et la beauté de tuer des fascistes de Tiago Rodrigues qui débute, - devait débuter - ce même soir au Théâtre des Bouffes du Nord mais que je verrai peut-être en décembre si.... Non, rien, rien de rien, je ne verrai rien ce mois-ci de ces espérées merveilles. Novembre est, chaque année, le mois le plus chargé de la rentrée théâtrale, on se plaint habituellement, trop c’est trop, mais trop de propositions valent mieux que rien du tout. Tout avait pourtant était fait dans les règles imposées par la saloperie et ceux qui sont censées la juguler : des masques en veux-tu en voilà encore , des demi-salles distancées , des spectacles à 18h , au plus tard à 19h, des offres multipliées le weekend. Balayé tout cela. Sans discussions, sans concertation, sans même y songer, sans que la culture soit un instant à l’ordre du jour. Et ce n’est pas la ministre de la culture qui a changé la donne en faisant médiocrement de la figuration ce mercredi parmi les ministres qui se sont succédé autour du Premier d’entre eux, délégué au service après -vente. Peanuts la culture, aux chiottes les artistes. Hamlet nous avait prévenus : « Economie ! Économie ! Économie ! »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 29, 2020 4:57 AM
|
Par Aureliano Tonet, Marie-Aude Roux, Stéphane Davet, Nicole Vulser, Rosita Boisseau, Brigitte Salino, Laurent Carpentier, Clarisse Fabre, Sandrine Blanchard et Fabienne Darge dans Le Monde - Publié le 29 octobre 2020
Pour le monde de la culture, le choc du reconfinement
Entre fatalisme, colère, peur de l’avenir et envie d’y croire, les artistes et acteurs du monde culturel affrontent une nouvelle période de salles vides.
Rideau. Comme au mois de mars, lors du premier confinement, les salles de concerts, les musées, les théâtres, les bibliothèques et les cinémas vont à nouveau fermer leurs portes à partir du vendredi 30 octobre suite aux annonces d’Emmanuel Macron pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Après une reprise, très partielle et avec des jauges réduites depuis l’été, c’est un nouveau coup dur pour un secteur culturel déjà passablement fragilisé par les reports de tournées, les annulations de festivals et récemment par le couvre-feu. Témoignages. « J’ai le sentiment de vivre un jour sans fin » Nora Hamzawi, comédienne et humoriste Nora Hamzawi aurait dû jouer son nouveau spectacle aux Folies-Bergère en avril. Le premier confinement a mis fin à l’aventure. « Nous avions décalé les dates en octobre au Casino de Paris. Mais l’obligation de réduire la jauge pour respecter la distanciation physique nous a obligés à redécaler la programmation en février 2021. Pourra-t-on jouer à cette période-là ? J’ai le sentiment de vivre un jour sans fin », témoigne la comédienne et humoriste, qui excelle dans l’observation des névroses de sa génération. Depuis la mi-mars, elle n’a été sur scène que cinq soirs à Paris et trois soirs en tournée, alors qu’elle avait quinze dates par mois prévues à son planning. « Zone verte, zone rouge, changement d’horaire à cause du couvre-feu, j’ai tout expérimenté dans ce chaos sanitaire », témoigne cette trentenaire en pleine ascension ces dernières années, grâce au succès de son one-woman-show et à sa prestation remarquée dans le film Doubles vies, d’Olivier Assayas. Depuis la mi-octobre, après sept mois d’arrêt, Nora Hamzawi est remontée quelques fois sur scène au théâtre parisien Le République : « J’ai vécu une communion très forte avec le public. On ressent à quel point nous étions tous en manque de réel et de relation. Il faut s’interroger sur ce que serait une société sans tout cela… » L’annonce du couvre-feu à 21 heures l’a mise « très en colère. Les incohérences, les demi-mesures m’agacent. Les salles de spectacle ont un protocole sanitaire strict, contrôlable et respecté par les spectateurs », insiste-t-elle. Quant au soutien financier promis par le gouvernement au secteur culturel, la comédienne a du mal à y voir clair. Coproductrice de son spectacle, elle a créé une petite société et n’a pas le statut d’intermittente. « Je suis un peu comme une auto-entrepreneuse. Pour l’heure, je n’ai reçu aucune aide. » Malgré tout, Nora Hamzawi dit « garder le moral. Je ne suis pas la plus à plaindre. Mais on ne peut plus rien anticiper, tout n’est que spéculation. Si ça trouve, on ne pourra pas rejouer avant l’automne prochain… » Sandrine Blanchard « J’espère qu’on sera tous aidés de la même manière » Firmin Gruss, directeur de la compagnie Alexis Gruss La voix est nette ; le ton, vigoureux. Rien ne semble devoir entamer le moral de Firmin Gruss, directeur de la compagnie Alexis Gruss. « On est bien obligé de rester positif, affirme-t-il. On ne peut pas faire autrement que travailler lorsqu’on a cinquante chevaux qui nous imposent leur rythme et qu’il faut nourrir et une équipe de quatre-vingts personnes avec nous. » De retour à Paris, comme tous les ans depuis plus de quarante ans pour la saison hivernale, la troupe familiale a planté sa toile de 3 000 places dans le bois de Boulogne. En haut de l’affiche, une nouvelle production intitulée Les Folies Gruss, avec laquelle l’enseigne équestre bien connue compte attirer les spectateurs. Sauf que depuis le 17 octobre, jour de lancement de ce nouveau spectacle ambitieux, les obstacles s’accumulent. Les premières ont été annulées à cause de l’interdiction d’ouvrir faite aux chapiteaux. « On a été mis au même rang que les bars, les restaurants, alors que le chapiteau est un lieu de spectacle, s’agace Firmin Gruss. Les pouvoirs publics ont du mal à comprendre ce qu’est un chapiteau mais heureusement, l’interdiction a été levée. Nous avons tout de même pu jouer, enfin, le 24 octobre. » Dans un contexte, évidemment, pas optimal, compte tenu des mesures sanitaires. « Sur les 3 000 billets, nous ne pouvons en vendre que 1 000, poursuit-il. Par ailleurs, alors que, d’habitude, les spectateurs se projettent et achètent leurs tickets pour Noël et le 31 décembre, là, ils font des réservations de dernière minute. Mais on a appris à s’adapter aux tempêtes, aux attentats, aux “gilets jaunes”, aux grèves… On a démarré avec 400 personnes et nous en sommes, mardi 27 octobre, à 250. » Les chiffres tombent et font mal. Le retour au confinement, Firmin Gruss avait du mal à l’envisager. « On ne peut en vouloir à personne, ajoute-t-il. Ce qui est rassurant, c’est de voir comment la ministre de la culture Roselyne Bachelot se bat. Et on est tous dans le même bateau : les théâtres, les opéras, les chapiteaux… J’espère seulement qu’on sera tous aidés de la même manière. En tout cas, s’il y a une chose que nous ne perdrons pas pendant cette période, quoiqu’il arrive, c’est notre travail qui définit notre liberté. » Rosita Boisseau « Un confinement total, c’est la mort ! » Laurence de Magalhaes, codirectrice du Monfort Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel semblent inséparables, à la ville comme au théâtre Le Monfort, qu’ils codirigent depuis 2008. Mais là, Stéphane préfère ne pas parler. Tout cela lui pèse. « Ce n’est pas facile, explique Laurence, cette situation met tout le monde sous tension, dans un état de fatigue, de stress, même les plus résistants, les plus forts. » Pourtant, la voltige, Stéphane Ricordel connaît. Autrefois, du haut des trapèzes de la compagnie Les Arts Sauts, il rattrapait ses camarades qui s’élançaient dans les airs. « On a eu une année compliquée entre les grèves, les “gilets jaunes”, et enfin le confinement. Un trou de 300 000 euros de billetterie. Pour nous, c’est énorme. Or, depuis la réouverture en septembre, on était sur une bonne dynamique. Comme un acte militant, on a vu le public revenir, et malgré nos jauges limitées à un tiers de salle, on a fait un 100 % sur tous les spectacles, avec des listes d’attente chaque soir. On repartait sur une belle pente. » Voilà qu’on annonce le couvre-feu à 21 heures. Le théâtre s’adapte. Ils modifient les horaires pour jouer plus tôt. « Et là encore, les gens ont suivi, ils se sont reportés… Il fallait absolument rester ouvert, quoi qu’il arrive, pour les artistes d’une part, qui ont besoin de jouer. Pour le public ensuite, qui a soif de culture. Il n’y a aucune raison, aujourd’hui, de fermer nos théâtres. Aucun cluster n’est venu de là. » Aussi, alors qu’on attendait les annonces du gouvernement avec inquiétude, l’idée même d’un couvre-feu à 19 heures et d’un confinement le week-end, hypothèse d’abord évoquée, ne les empêchait pas de continuer à vouloir imaginer la suite. « Il ne faut pas lâcher, affirmaient-ils. On continue. Jusqu’au moment où on pourra plus… », se disant prêts, en concertation avec les artistes, à présenter des spectacles en journée, « à l’heure du repas peut-être, au lieu d’aller déjeuner, on pourrait aller voir un spectacle », misant qu’avec le télétravail, les gens puissent adapter leurs horaires. « Je ne sais pas si le public aurait suivi, mais au moins on l’aurait tenté », confie Laurence de Magalhaes. Appelés une nouvelle fois à se réinventer, voilà leur imaginaire dans le mur : « Un confinement total, c’est la mort ! La dernière fois, on ne savait pas ce que c’était, ça nous est tombé dessus. Du coup, il y avait un côté expérimental, mais là, on sait. Il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux. Je ne crois pas que cette fois-ci, on va s’envoyer de petites blagues sur les réseaux… Ça va être horrible. » Laurent Carpentier « On a tenu uniquement grâce au chômage partiel » Jean Robert-Charrier, directeur du Théâtre de la Porte-Saint-Martin « Quel enfer ! », s’exclame Jean Robert-Charrier. Le jeune directeur du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, reclus dans sa maison de Bourgogne après avoir attrapé le Covid-19, envisage la perspective d’un nouveau confinement avec « beaucoup d’angoisse » pour la survie de son établissement, haut lieu du théâtre privé parisien auquel il a redonné un lustre artistique certain depuis qu’il en a pris la direction, en 2010. « On est déjà restés fermés sept mois, du 12 mars au 8 octobre, sept mois pendant lesquels on a joué aux équilibristes avec la trésorerie qui nous restait, à savoir 1 million d’euros encaissés grâce aux réservations pour La Carpe et le Lapin, le spectacle qu’on devait jouer au printemps, explique-t-il. Cette trésorerie a été mangée au fur et à mesure que l’on remboursait les spectateurs. On a tenu uniquement grâce au chômage partiel. » Malgré un contexte déjà difficile, Jean Robert-Charrier a fait le pari de rouvrir, en octobre, avec une création exigeante : Avant la retraite, de Thomas Bernhard, mis en scène par Alain Françon avec Catherine Hiegel, Noémie Lvovsky et André Marcon. Malgré un succès unanime sur le plan critique et un excellent bouche-à-oreille, le spectacle a mis du temps à trouver son public, avant de subir un nouveau couperet avec l’instauration du couvre-feu, le 16 octobre. Comme ses confrères, Jean Robert-Charrier s’est adapté, et a alors décidé de jouer trois représentations par semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche, qui ont eu lieu devant un public « peu nombreux mais enthousiaste », remarque-t-il. Une solution qui lui permettait d’être tout juste à l’équilibre sur le plan financier. Avec l’instauration d’un nouveau confinement, il entre dans le rouge, sans autre perspective immédiate que de « négocier le découvert bancaire du théâtre ». Le directeur reconnaît le « volontarisme » de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, mais, précise-t-il, « si je sais que l’on est éligible aux aides sur la jauge Covid et au fonds d’urgence pour les théâtres, je n’ai reçu aucune information sur le montant de cette aide ni sur la date à laquelle je vais pouvoir la toucher ». Il sait aussi que le Théâtre de la Porte-Saint-Martin sera soutenu par le groupe Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière, qui en est le propriétaire. Mais, précise-t-il, « Fimalac n’est pas un mécène. Les aides, il faudra les rembourser ». « La programmation de la suite de la saison est un véritable cauchemar, conclut-il. J’aurai très peu de moyens pour rebondir avec une création début 2021, et je ne veux pas recourir à une comédie racoleuse pour remplir le théâtre. Les conséquences d’un nouveau confinement seront incalculables sur tous les plans, économique, artistique, moral et psychologique. » Fabienne Darge « L’impression d’être dans un mauvais jeu de télé-réalité » Izïa Higelin, chanteuse et comédienne « Annuler deux tournées en moins d’un an, je dois battre des records ! », plaisante avec amertume Izïa Higelin. Le 16 mars, Emmanuel Macron annonçait le premier confinement quelques jours avant un Olympia que l’auteure-compositrice-interprète et actrice devait donner à guichets fermés, en amont d’une longue suite de soixante concerts. Mardi 27 octobre, veille de l’intervention du président de la République annonçant un reconfinement, la fille de Jacques Higelin devine qu’elle doit faire une croix sur la vingtaine de concerts qu’elle et son tourneur, Uni-T Production, avaient réussi à reprogrammer à partir du 28 novembre. « J’ai peut-être été naïve, mais je ne pouvais pas ne pas y croire, insiste la tout juste trentenaire. J’ai vu plusieurs spectacles ces dernières semaines et cela se passait toujours bien. On sentait que le public avait un désir irrépressible de retrouvailles avec les artistes. » Dans la foulée d’un quatrième album, Citadelle, sorti le 10 octobre 2019, Izïa devait être l’une des chanteuses françaises les plus actives de 2020, avec, notamment, une impressionnante série de festivals d’été. « Pour moi qui ai peu de passages radio, les concerts, en particulier les festivals, sont mon principal outil de promotion, un moyen unique d’aller chercher les gens et de leur faire connaître mon album », constate la bête de scène aux trois Victoires de la musique et un César (meilleur espoir féminin pour Mauvaise fille, en 2013). « J’ai l’impression d’avoir été fauchée en pleine prise d’élan. » Elle avait baptisé « Le Retour » la tournée qu’elle croyait pouvoir redémarrer cet automne, avec une équipe réduite – quatre musiciens et quatre techniciens, au lieu des quinze personnes prévues à l’origine – s’adaptant à un public masqué et des salles assises en jauge restreinte, « offrant toutes les garanties sanitaires ». Les répétitions devaient débuter le 10 novembre. « J’ai l’impression d’être dans un mauvais jeu de télé-réalité où des pièges seraient semés continuellement devant les candidats », s’attriste-t-elle en s’inquiétant de l’avenir des équipes techniques. Difficile aujourd’hui d’échapper à la déprime, même si tous les festivals qui l’avaient programmée l’été dernier l’ont remise à l’affiche de leur prochaine édition. « J’apprends à ne plus rien attendre. J’ai peur qu’une dynamique soit cassée », s’inquiète celle qui reconnaît avoir beaucoup de mal à écrire de nouvelles chansons. « Je devais jouer une pièce de théâtre en février 2021 dont les répétitions devaient commencer en janvier. Comment ne pas douter ? » Stéphane Davet « On tiendra » Laura Koeppel, co-directrice du cinéma Le Vincennes La salle de cinéma est sans doute le lieu qui symbolise le mieux la période de turbulences que nous traversons, estime Laura Koeppel, codirectrice avec Nicolas Métayer du cinéma d’art et d’essai Le Vincennes, situé dans la commune du même nom (Val-de-Marne). « On a connu le confinement, la réouverture des salles, le couvre-feu. A chaque fois, les gens étaient tiraillés entre deux attitudes opposées : s’isoler, ou faire front ensemble. Cette tension, c’est ce qui se passe depuis toujours dans la salle de cinéma : on est seuls devant l’écran, et en même temps on vit une expérience collective ». Née en 1968, Laura Koeppel connaît tous les métiers de l’exploitation : projectionniste de formation, elle fut ouvreuse en 1992, puis directrice de cinémas, enfin animatrice de ciné-club depuis 2002, tous les lundis soirs au « Vincennes ». « Je suis une furieuse », dit-elle, pour évoquer son parcours et son amour de la salle. Il faut que le « Vincennes » soit « à la hauteur » des exigences de Simon Simsi (1938-2018), l’exploitant et distributeur qui avait racheté le cinéma en 2002, et lui a « fait confiance » à ses débuts. « On ne lâchera rien sur notre mission : le cinéma est un lieu où les spectateurs rencontrent des œuvres dans les meilleures conditions possibles », insiste-t-elle. Pendant le confinement, elle postait sur le site du « Vincennes » des vignettes « ciné-confinées », soit des extraits de films qui lui semblaient évocateurs de la période. « Si je suis enfermée chez moi ou que Paris est vide, j’ai des images de films qui me reviennent », dit-elle. Pour sa réouverture, le 22 juin, le cinéma et ses quatre salles se sont refaits une santé : « On a encore amélioré la qualité de projection, on a fait faire un audit sur le renouvellement de l’air, etc. S’occuper d’un cinéma, c’est articuler la cinéphilie avec des préoccupations très terre-à-terre ». 2019 fut la meilleure année pour le Vincennes, avec 183 000 spectateurs. L’année 2020 aura été chaotique, avec trois mois de fermeture : fin octobre, le nombre d’entrées s’établit à 63 000. « On tiendra » dit-elle. Clarisse Fabre « Je m’inquiète surtout pour les jeunes » Karine Deshayes, chanteuse lyrique Trois Victoires de la Musique classique, une discographie dodue et un parcours exemplaire depuis plus deux décennies : à 48 ans, la mezzo-soprano Karine Deshayes s’est imposée sur les grandes scènes internationales. Comme ses collègues, la Française a cessé de chanter avec le premier confinement, tandis que son planning s’allégeait de quatre productions d’opéra. Seuls les récitals en plein air et les concerts de musique de chambre – notamment en duo avec Delphine Haidan, sa partenaire dans l’album Deux mezzos sinon rien, paru chez Klarthe – ont repris avec le déconfinement. « De ce point de vue, je me sens privilégiée par rapport à d’autres qui n’ont malheureusement recommencé à chanter que depuis peu », déclare Karine Deshayes. La fin de l’été et le début de saison laissaient espérer une reprise générale, plébiscitée par le public, malgré les gestes barrières et les mesures de distanciation. La chanteuse n’oubliera jamais les larmes qui lui sont venues pendant le long tonnerre d’applaudissements qui a accueilli son récital du 27 juin à l’Opéra de Bordeaux en compagnie du pianiste Antoine Palloc. « Comme je l’ai déjà dit, souligne la mezzo, je continue à me sentir beaucoup plus en sécurité sur une scène lyrique que dans les transports – métro, train et avion. » Plus que l’absence de spectacle vivant, Karine Deshayes craint les effets délétères de ce second confinement qui fragilisera encore plus les personnes les plus précaires. « Pour tenir le coup, il faut un but, et nous, les artistes confirmés, avons des projets jusqu’en 2024, admet-elle. Alors je m’inquiète surtout pour les jeunes. On doit sauver des vies, mais j’ai peur que des gens meurent de faim. » Et de citer certains qui ont déjà dû revendre leur maison ou leur instrument quand d’autres retournaient vivre chez leurs parents. Si la mezzo salue les aides mises en place par l’Etat en direction de la culture, elle pressent que rien ne sera plus comme avant. C’est pourquoi, elle prêche pour la mise en place d’un système de troupe, à l’instar de celui qu’elle a connu, débutante, au Studio de l’Opéra de Lyon, qui lui a permis de se lancer dans la carrière avec moult garde-fous. Marie-Aude Roux « C’est difficile, mais on essaye de faire face » Tiphaine Raffier, autrice et metteuse en scène Pour Tiphaine Raffier, 2020 s’annonçait comme une grande année : à 35 ans, elle était invitée à présenter deux spectacles, Dans le nom et France-fantôme, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, en avril-mai. Puis, en juillet, elle devait créer, au festival d’Avignon, sa nouvelle pièce, La Réponse des hommes. Les représentations de l’Odéon ont été annulées, et la création d’Avignon a été reportée à la mi-novembre, au Théâtre national de la Criée, à Marseille. Tout était en place quand la nouvelle du couvre-feu est tombée. « Il a fallu s’adapter, le théâtre a réagi très vite, explique Tiphaine Raffier. Par chance, on devait jouer le week-end, du 13 au 15, à 20 heures les vendredis et samedis, et à 16 heures le dimanche. Comme le spectacle est long, trois heures vingt, on a décalé les deux premières représentations à 16 heures. » « Aujourd’hui, je ne sais pas quand et où aura lieu la première de La Réponse des hommes », poursuit l’autrice et metteuse en scène qui a fait ses débuts comme comédienne, dans la compagnie de Julien Gosselin, avant de créer sa compagnie, La Femme coupée en deux. Très vite, son talent a été reconnu, et sa nouvelle création, coproduite par une quinzaine de structures, était appelée à une belle tournée en France, jusqu’en avril 2021. « C’est difficile, parce que les théâtres doivent sans cesse répondre à de nouvelles mesures gouvernementales. Et financièrement, ils seront bientôt à sec. Au printemps, ils ont payé les représentations annulées. Pourront-ils continuer à le faire ? Est-ce que les mesures de soutien au spectacle vivant seront reconduites ? » Autant de questions en suspens. Et il y en a une que Tiphaine Raffier met de côté : la sienne. « Mes états d’âme d’autrice-metteuse en scène ne sont pas intéressants. Et j’ai la chance de diriger une compagnie. Je suis en contact avec les directeurs de théâtre, on essaye de faire face, de trouver des solutions. Les comédiens n’ont pas cette chance. Ils attendent qu’on leur dise de jouer ou non. Ils attendent aussi que des directives soient prises pour prolonger leurs droits. C’est crucial. » Brigitte Salino « J’ai appris à apprécier les temps morts » Vincent Mougel, musicien de scène et de studio « J’ai trouvé l’interrupteur pour allumer toutes les lumières de la ville. » Ainsi chantait Vincent Mougel, de sa voix véloce et veloutée, sur Tonight (2017), le tube disco du groupe napolitain Fitness Forever. Le spectre du black-out n’effraie plus ce multi-instrumentiste de 39 ans, qui épaule de nombreux artistes, en studio comme à la scène : Juliette Armanet, Herman Dune, Halo Maud… En mars, passée la « panique » initiale, il a vécu le confinement comme une « libération » : « Avant, les temps morts me stressaient, je cherchais à optimiser à tout prix mon agenda ; ce printemps, j’ai appris à les apprécier. J’ai compris à quel point ils sont nécessaires à la création. » Sur la cinquantaine de concerts qu’il aurait dû donner depuis mars, aux côtés des Innocents, This is the Kit ou Ricky Hollywood, seule une petite dizaine a pu être assurée, dans des configurations réduites. Ce Lorrain installé à Paris en a profité pour bichonner ses deux filles, et raviver sa carrière solo, menée sous le pseudonyme Kidsaredead : « Avec mon ami musicien Flóp, on s’est lancé le défi d’écrire une chanson par jour ; il en a pondu 150, moi, une belle dizaine, ce qui est déjà énorme pour un procrastineur comme moi ‒ en français qui plus est, un vieux fantasme. » Assuré de toucher ses indemnités jusqu’en août 2021, au titre de l’intermittence du spectacle, il est conscient de ne pas « être à plaindre » par rapport aux musiciens des pays où ce régime n’existe pas. En 2021, il avait prévu de repartir sur les routes avec Mathieu Boogaerts et le spectacle musical de Sonia Bester Ah ! Felix (n’est pas le bon titre)… Sera-ce possible ? En attendant, ce fan de Prince cumule les cachets, dans l’espoir de renouveler son statut dans les meilleures conditions, l’été prochain. Piges pour une agence spécialisée dans l’illustration musicale, design sonore pour un musée alsacien… Le reconfinement sera aussi l’occasion de caresser de nouvelles lunes : pourquoi ne pas se lancer dans de l’animation en crèche, voire dans l’accordage de piano ? « Au printemps dernier, j’ai apprécié la suspension de la nouveauté perpétuelle, à laquelle on est surexposé dans les grandes villes. J’ai réalisé, aussi, à quel point le silence manque dans ma vie. » Aux plages de silence que Vincent Mougel s’apprête à traverser cet automne succéderont, gageons-le, de doux airs de musique. Aureliano Tonet « Si on achète juste des pâtes et du beurre, on va devenir fou » Philippe Touron, libraire à Paris « Les librairies doivent être considérées comme des magasins essentiels », affirme Philippe Touron, directeur du Divan et responsable des trois autres librairies parisiennes du groupe Gallimard – la Librairie de Paris, la Librairie Gallimard et Delamain, actuellement en travaux. « Il ne faut absolument pas les fermer, en cas de reconfinement », dit-il. Mais Emmanuel Macron en a pour l’instant décidé autrement.. « Il n’y a pas de commune mesure entre l’activité normale d’une librairie et du “click and collect” ou des expéditions qui ne représentent qu’un pis-aller, guère plus de 10 % de l’activité », explique-t-il. Seule exception dans le paysage culturel français ravagé par la pandémie, les librairies vendent bien depuis le déconfinement (+12 % en moyenne entre le 11 mai et fin septembre, selon le Syndicat de la librairie française). « La fréquentation est soutenue, le panier moyen en hausse de 10 %, et cette dynamique bénéficie à toute la chaîne du livre », assure Philippe Touron. D’où l’importance de ne pas casser cette reprise. « Les librairies sont des lieux de respiration, une soupape dans une rue commerçante. Le livre constitue une vraie valeur refuge. Si, pendant le confinement, on achète juste des pâtes et du beurre et que l’on rentre chez soi, on va devenir fou, il faut garder des nourritures pour l’esprit, affirme Philippe Touron. Une librairie peut permettre de rendre plus supportable cette période difficile. » D’autant plus, selon lui, « que toutes les mesures sanitaires y sont scrupuleusement respectées ». La concurrence d’Amazon et des hypermarchés ne faiblira pas, en cas de confinement. « Notre seul modèle économique viable, c’est de laisser le public entrer et choisir ses livres », plaide-t-il. Le directeur du Divan rappelle qu’en novembre et décembre, la période cruciale de Noël, les ventes triplent par rapport à l’activité habituelle. La raison pour laquelle il souhaite ardemment être entendu pour rester ouvert, « au même titre qu’un magasin d’alimentation ». Il dévore lui-même trois livres à la fois. Une consolation pendant ses insomnies. Nicole Vulser Aureliano Tonet, Marie-Aude Roux, Stéphane Davet, Nicole Vulser, Rosita Boisseau, Brigitte Salino, Laurent Carpentier, Clarisse Fabre, Sandrine Blanchard et Fabienne Darge Liens : Lire « Un apéro avec… » Nora Hamzawi (en 2019) : « Rien ne m’angoisse plus que quelqu’un qui va toujours bien » Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Rêve de gosse » ou déclic post-confinement, le métier de libraire suscite toujours plus de vocations Lire aussi Un plan de 230 millions d’euros pour « soutenir les librairies indépendantes » et accompagner « la diversité éditoriale » de l’édition Article réservé à nos abonnés Lire aussi Covid-19 : « On ne peut pas faire de théâtre avec des masques et des gants » Lire le portrait (en 2015) : Au Monfort, deux saltimbanques s’enracinent Lire le portrait (dans « M » en 2017) : Jean Robert-Charrier, le théâtre sans frontières Lire aussi Karine Deshayes, ou l'été d'une mezzo surdouée Article réservé à nos abonnés Lire aussi Ludovic Tézier : « Si l’on n’y prend garde, le virus aura la peau du spectacle vivant, et particulièrement de l’art lyrique »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 28, 2020 9:57 AM
|
Sur la page de l'émission de Marie Richeux "Par les temps qui courent" sur France Culture 27 octobre 2020
Le spectacle " _jeanne_dark_ " part en tournée dans toute la France et c’est l’occasion pour nous de rencontrer la metteuse en scène du spectacle, Marion Siefert. Lien pour l'écoute en ligne (44 mn) Interprété par Helena de Laurens, ce spectacle met en scène Jeanne, une jeune adolescente orléanaise. Grâce aux réjouissances d’Instagram (filtres, interactions…) – Jeanne devient _jeanne_dark_. Elle est seule dans sa chambre mais sous le regard de toute une communauté d’internautes qui commentent en direct, avec plus ou moins de tendresse, ce qu’elle nous montre et les personnages qu’elle incarne. Extraits de l'entretien Quand je crée, je suis très attentive à ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, à ce qui se passe autour de moi, et à ce que cela provoque en moi. Et pour _jeanne_dark_, il y a eu comme un appel. J’ai lu plein de biographies, vu tous les films qui lui ont été consacré, mais l’appel que j’ai ressenti, c’est un appel vers une période très précise de ma vie, et l’envie de parler de quelque chose dont j’avais, jusqu’à, lors honte. Pour moi, le théâtre c’est le lieu où on peut combattre sa honte et l’exposer. C’est également un endroit où on peut se réinventer, et je pense que c’est ce que raconte la pièce : Instagram permet à mon personnage de construire un cadre dans lequel elle peut se transformer, se réinventer, et échapper à un regard, que les autres lui renvoie, et qui ne lui convient pas. Marion Siéfert Pour trouver la forme de la pièce, ça m’a pris beaucoup de temps, car tant que je n’avais pas sa forme, je ne pouvais pas écrire, parce qu’en fait, je n’avais pas l’adresse. Ça ne m’intéressait pas d’avoir un récit de ce qui s’était réellement passé : je voulais exagérer les choses, car Jeanne D’arc c’est quand même un mythe et je voulais en être à la hauteur, et il a fallu donner beaucoup plus d’ampleur aux émotions. Marion Siéfert Je voulais surtout que ça se passe aujourd’hui et que ça puisse parler à la jeunesse. Je voulais qu’on vive la crise avec mon personnage. Je suis toujours intéressée par amener au théâtre, ce qui en est exclu, ce que les gens considèrent comme n’étant pas du théâtre, et Instagram en fait partie. C’est un endroit très ambivalent, qui pose plein de questions différentes, qu’elles soient éthiques, esthétiques ou moral, et du coup, c’est passionnant d’y travailler. (…) Instagram permet d’ouvrir mon théâtre, je ne veux pas que mon théâtre soit fermé, qu’on y voit toujours les mêmes spectateurs, avec les mêmes connivences esthétiques. J’aime quand il y a tout qui débarque, et pour moi, le théâtre est un endroit, qui permet à la société entière se regarder ensemble. Marion Siéfert Pour voir le spectacle sur Instagram : _jeanne_dark- _jeanne_dark_ a été programmé dans le cadre du festival d’automne à Paris et part dans une tournée dont voici les dates : * du 2 au 18 octobre > La Commune Aubervilliers / Festival d’Automne * le 12 novembre 2020 › L'Empreinte - Scène nationale (Brive-Tulle) * du 18 au 19 novembre 2020 › Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon (Lyon) * du 24 au 25 novembre 2020 › Théâtre d'Arles (Arles) * du 16 au 17 décembre 2020 › Espaces Pluriels - scène conventionnée de Pau (Pau) * du 05 au 07 janvier 2021 › Théâtre Sorano (Toulouse) * du 14 au 15 janvier 2021 › Le Tandem, Scène nationale Arras Douai (Douai) * du 21 au 22 janvier 2021 › Festival Parallèle (Marseille) * du 11 au 12 février 2021 › CNDC d'Angers (Angers) * du 18 au 26 mars 2021 › Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National de Rennes (Rennes) * du 30 mars au 01 avril 2021 › Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne (relâche le 11) (Strasbourg) * du 08 au 12 avril 2021 › Théâtre de Gennevilliers, CDN (Gennevilliers) * du 18 au 21 mai 2021 › Théâtre Olympia - CDN (Tours) * du 26 au 28 mai 2021 › CDN d'Orléans (Orléans) Archives Simone et Hélène de Beauvoir, émission "Nuits magnétiques", France Culture, 1979 André Gunthert, émission "La suite dans les idées", France Culture, 2015 Extraits _jeanne_dark_ de Marion Siéfert avec Helena de Laurens Référence musicale R’may, Leur dire Prise de son Fabien Capel Légende photo : Helena de Laurens, dans _jeanne_dark_ de Marion Siéfert• Crédits : Matthieu Bareyre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2020 8:11 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama - Sortir le 23 octobre 2020 “La Peste c’est Camus, mais la grippe est-ce Pagnol ?” Le dernier spectacle des rois de l’impro surfe sur le vide, ce qui rend la représentation encore plus électrique et prenante.
Ce soir nous sommes réunis pour jouer une pièce qui n’a jamais existé… » Ainsi s’adresse à la salle comble et frémissante des Bouffes du Nord Jean-Christophe Meurisse, chef de meute des Chiens de Navarre. La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? va bientôt commencer. Capable de s’adapter à tous les virus, la bande dadaïste a toujours eu le génie des titres à l’humour vache et potache. Au bout d’une petite heure, Meurisse surgira une dernière fois du public, pour siffler la fin de partie, stopper l’improvisation collective des quinze comédiens de sa troupe ; comme il a lancé tout au long du spectacle des musiques chics ou popu histoire de ponctuer leurs délires instantanés et leurs transgressions jubilantes mais éphémères. Hélas La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? s’achèvera le dimanche 24 octobre au soir à 20 heures, juste avant le couvre-feu. Peu de chances que vous trouviez encore des places… Liberté et insolence Pourquoi les spectateurs – à l’unisson de ses blagues insensées – aiment-ils donc tant cette bande mal élevée réunie en 2005 ? Parce qu’elle est libre, qu’elle dérange, donne le goût de cette liberté et de cette insolence chères à l’esprit français de toute éternité. Parce qu’elle a l’audace et le courage de rire de tout, malgré tout. Parce qu’elle manie l’humour comme une arme de résistance et de combat. Parce qu’elle fait du bien, surtout, aère, donne des ailes à nos habitudes étriquées, nos pensées paralysées, nos fatigues existentielles toujours recommencées. Depuis quinze ans, on sort comme rajeuni de ces fiestas adolescentes aux décors et costumes de rien, aux perruques et maquillages bricolés, avec de l’hémoglobine ou de la nourriture à foison parfois sur les tables en Formica de la France d’avant, moquée avec une violence tendre. Même le Christ est parfois ici râleur compagnon de route, bougonnant sur sa croix… D’Une raclette (2008) à Tout le monde ne peut pas être orphelin (2019) – qu’ils reprendront d’ailleurs aux Bouffes du Nord à partir du 11 juin 2021 –, les Chiens de Navarre s’en prennent à la famille, au couple, à la religion, aux conditions de travail et à la vie sociale hexagonale dans ses injustices et ses inégalités, à la politique dans ses lâchetés et hypocrisies, aux extrémismes. Avec une inébranlable envie d’en découdre. Avec une rage qui déssille le regard et rend chacun plus lucide et vif. Qui délivre. Mais tout en amusant. De l’art de ne pas se prendre au sérieux, ni de délivrer de message prétentieux. En roue libre Ainsi quelques-uns sont-ils juste attablés dans La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? tandis que leurs partenaires attendent en demi-cercle derrière eux de venir les remplacer, un à un, au cours de l’improvisation générale. Du pas grand-chose, du presque rien. Le spectacle surfe incroyablement sur le vide. Et ça, aussi, rend la représentation électrique et prenante, comme si le public participait par ses réactions mêmes à la poursuite de l’impro, à ses directions, selon ce qu’il manifeste de rires, d’étonnements, d’émotions. Les Chiens de Navarre nous avaient déjà fait le coup de l’impro collective assumée au Théâtre du Rond-Point, en 2014, avec Regarde le lustre et articule, d’après une citation de Louis Jouvet. Et l’exercice en roue libre marchait déjà à merveille, donnant non seulement au public la sensation d’assister à la confection d’une écriture scénique en direct, mais aussi un étonnant sentiment de partage, même risqué. Car les Chiens de Navarre n’ont peur de rien. Surtout pas d’affronter les tragédies de l’actualité. « Je suis la liberté d’expression mais on m’a décapitée », affirme ainsi calmement, au détour d’une de ses répliques créées au vol, Céline Fuhrer, interprète ravageuse dans sa distance toujours si élégante. Discret hommage à Samuel Paty au milieu des associations d’idées surréalistes et des collisions d’inconscient sulfureuses et sauvages… Ne pas avoir peur de dire et de penser, c’est ce à quoi invite la meute canine indressable. Huit au départ, ils sont quinze aujourd’hui à tordre le réel avec leur rosserie rebelle et débridée. Autant de petites bombes – parfois juste des pétards mouillés… – que Jean-Christophe Meurisse refuse de contrôler. À l’espace de liberté rendu à l’imaginaire du public répond celui de la troupe. C’est cet espace de liberté commun, cet immense chantier et terrain vague à habiter ensemble à la bonne franquette que nous sommes venus chercher. Bonne nouvelle, cette semaine Jean-Christophe Meurisse, quatre ans après Apnée, se lance dans son deuxième film. Toujours improvisé… À voir
La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ?, de Jean-Christophe Meurisse. Jusqu’au 24 octobre, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 10e. À 19h, le 24 séance supplémentaire à 16h.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2020 6:32 PM
|
Publié par Stéphane Capron dans Sceneweb le 27 octobre 2020 Le comédien Fred Ulysse est mort à l’âge de 86 ans. Toujours sur les planches depuis le milieu des années 50, il devait être dirigé l’année prochaine par Arnaud Meunier dans Tout mon amour de Laurent Mauvignier.
Formé aux cours André Bauer, Pierre Valde et Tania Balachova, Fred Ulysse débute sa carrière en 1956 au Centre dramatique de l’Ouest, il joue sous la direction d’Hubert Gignoux dans Noë d’André Obey.. Claude Régy le met en scène en 1965 dans L’Accusateur public de Fritz Hochwälder au Théâtre des Mathurins. A la télévision, il est le père de Jacquou le Croquant dans la série de Stellio Lorenzi. En 2007, au Festival d’Avignon, il participe à l’aventure des Feuillets d’Hypnos de René Char dans la Cour d’honneur sous la direction de Frédéric Fisbach. Il travaille sous la direction de Luc Bondy à l’Odéon dans Tartuffe et Ivanov. Il devait partager l’affiche l’année prochaine de Tout mon amour de Laurent Mauvignier dans la mise en scène d’Arnaud Meunier avec Anne Brochet, Romain Fauroux, Ambre Febvre, Philippe Torreton.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 8:12 PM
|
Par Yann Gaudin dans son blog de Mediapart "Pôle Emploi : le droit de savoir" 25/10/2020 On le sait davantage encore depuis l'annulation des festivals d'été et les milliards d'euros perdus pour l'économie française : les professionnels du spectacle sont essentiels à l'activité du pays, ils sont un patrimoine vivant de compétences, un patrimoine très précieux pour les territoires, pour le bien-être, pour la productivité et pour la production économique en général. Mais ce patrimoine est en danger. Pour les intermittents du spectacle, les mesures de confinement, de couvre-feu et les restrictions en matière de rassemblements ont réduit les chances de travailler à une portion congrue. Et il serait aussi inutile qu'irresponsable de les inviter à jeter leurs compétences à la poubelle pour aller exercer un autre métier puisque l'ensemble du marché du travail est sinistré, à quoi bon déshabiller Paul pour habiller Françoise quand les deux sont déjà presque à poil... C'est là que vient en renfort la solidarité nationale, comme pour les restaurateurs et autres travailleurs empêchés de travailler. Fin juillet 2020, le Gouvernement a donc décidé de maintenir l'indemnisation des intermittents du spectacle jusqu'à fin août 2021 : c'est la fameuse année blanche. Mais cette mesure ne rend pas la situation confortable : beaucoup d'intermittent·es doivent actuellement se contenter de leurs seules allocations chômage qui, dès lors, ne sont plus un complément aux revenus d'activité mais quasiment leur unique revenu de subsistance. Sans compter la diminution de ressources liée à la perte d'indemnités de congés spectacles faute de contrats. Et cette mesure ne rend pas la situation rassurante : l'échéance du 31 août 2021, c'est à ce jour dans 10 mois et la deuxième vague de Covid ne présage pas de reprise des spectacles d'ici là. Or pour bénéficier d'une éventuelle réadmission à partir du 1er septembre 2021, il y a un préalable à ne pas oublier : il faudra nécessairement avoir eu au moins une fin de contrat dans les 12 derniers mois (article 7 du règlement d'assurance chômage en vigueur). Le gouffre de la fin de droits se rapproche donc à grands pas... Et pour celles & ceux qui auront les conditions d'une réadmission au 1er septembre, il y a une autre perspective très inquiétante : l'engorgement inédit lié à un nombre phénoménal de demandes de réexamens début septembre 2021, ce qui pourrait provoquer des retards considérables d'indemnisation si Pôle emploi ne met pas en œuvre un plan d'actions adéquat. Heureusement il existe quand même plusieurs dispositions de secours, à la fois dans les règles ordinaires de l'assurance chômage et dans les règles exceptionnelles du décret de l'année blanche. Et elles ne sont pas toutes explicitées par Pôle emploi...
► Le réexamen (anticipé ou ordinaire)
D'ici le 31 août 2021 vous aurez ou vous avez déjà peut-être en réserve au moins 507 heures d'intermittence sur 12 mois, ou 549 heures sur 13 mois, ou 591 heures sur 14 mois, etc. (allongement de la période d'affiliation : paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X ; l'allongement à hauteur des 3 mois de confinement n'est plus possible pour les bénéficiaires de l'année blanche) Dans ce cas vous pouvez toujours demander un réexamen, de manière anticipée ou à votre date anniversaire "ordinaire", ce qui vous permettrait notamment d'éviter le risque d'engorgement mentionné plus haut. Mais est-ce bien judicieux d'ouvrir de nouveaux droits avant le 1er septembre 2021 ? C'est la fin de contrat retenue pour la réadmission qui déterminera votre nouvelle date anniversaire (paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X). Par exemple si vous demandiez un réexamen avec une fin de contrat en octobre 2020, vos nouveaux droits se termineraient en octobre 2021 donc juste quelques semaines après l'échéance du 31 août 2021. Et vous auriez de nouvelles franchises à l'occasion de la réadmission, voire un nouveau délai d'attente de 7 jours, donc pour que ce soit financièrement valable il faudrait que la réadmission vous apporte un bien meilleur taux d'indemnisation pour compenser la pénalité des nouvelles franchises. On trouve sur internet des simulateurs gratuits pour faire une évaluation de l'intérêt financier d'une réadmission pendant l'année blanche, par contre toujours pas de simulateurs du côté de Pôle emploi pour les intermittents du spectacle...
L'idéal en matière de réexamen dans les mois qui viennent, pour sécuriser la durée de votre future indemnisation, c'est d'attendre l'été 2021 et d'avoir une fin de contrat la plus proche possible du 31 août 2021. Evidemment c'est un pari, car si vous n'avez aucun contrat à l'été 2021 vous risquez alors d'être concerné·e par la disposition qui suit.
► L'allongement exceptionnel de la période d'affiliation Comme vu plus haut, en temps normal il est possible pour Pôle emploi de rechercher davantage que 507 heures sur une période plus longue que 12 mois dans le cadre d'un réexamen.
Pour un réexamen post-année blanche, à partir du 1er septembre 2021, le décret de juillet 2020 prévoit que Pôle emploi pourra rechercher 507 heures aussi loin qu'il le faudra dans le temps avant votre dernière fin de contrat (dans la limite toutefois du dernier contrat qui avait servi à ouvrir vos anciens droits), mais dans ce cas seules 507 heures seront retenues ! (paragraphe II du décret) Sauf à avoir eu des contrats très bien rémunérés pour ces 507 heures, vous serez alors très probablement indemnisé·e au montant journalier brut minimum de 38€ pour un technicien ou 44€ pour un artiste. Comme votre nouvelle date anniversaire sera déterminée par la date de dernière fin de contrat, votre nouvelle indemnisation à partir du 1er septembre 2021 sera peut-être très courte. Par exemple si votre dernière fin de contrat remonte au 31 décembre 2020, vous ne seriez alors indemnisé·e que du 1er septembre au 31 décembre 2021, soit seulement 4 mois de nouveaux droits ! Un délai très court pour cumuler à nouveau 507 heures afin de bénéficier d'une nouvelle réadmission... Et la réadmission entraînera de nouvelles franchises, or si à la fin de ces nouveaux droits vous n'avez pas soldé toutes vos franchises, vous devrez rembourser à Pôle emploi le reliquat restant selon le principe du trop-perçu. (paragraphe 2 de l'article 23 des annexes VIII et X).
Donc là encore, pour une nouvelle indemnisation la plus longue possible, l'idéal est d'avoir une fin de contrat à l'été 2021 et au plus près du 31 août 2021. Or si aucun vaccin ni traitement contre la Covid n'a été trouvé d'ici là, cet hypothétique contrat très salutaire devient alors... un contrat en or ! ► La clause de rattrapage Si dans votre parcours professionnel vous avez cumulé 5 ouvertures de droits à l'intermittence et qu'au 1er septembre 2021 vous n'avez pas cumulé 507 heures mais au moins 338 heures, là aussi sur une période potentiellement rallongée autant qu'il le faudra à titre exceptionnel, vous pourrez bénéficier d'un nouveau prolongement temporaire de maximum 6 mois de vos droits. (alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X). ► Les allocations de solidarité Si vous n'avez pas non plus les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage mais que vous avez bien une fin de contrat au régime intermittent dans les 12 mois précédant votre demande de réexamen à partir du 1er septembre 2021, vous aurez très probablement le droit soit à l'Allocation de Professionnalisation et de Solidarité (APS) ou à l'Allocation de Fin de Droits (AFD) car, exceptionnellement, Pôle emploi recherchera 507 heures d'intermittence aussi loin qu'il le faudra dans le temps et y compris en assimilant des heures qui avaient déjà servi à ouvrir vos anciens droits ! Voici la notice concernant ces allocations. ► La clause de sauvegarde Si vous avez eu quelques contrats au régime général et quelques contrats au régime intermittent sur une période de 24 mois (36 mois pour les plus de 53 ans) avant le 1er septembre 2021 et qu'en tout ça représente les conditions minimum pour une ouverture de droits au régime général (actuellement 610 heures minimum), vous pourrez alors ouvrir des droits au régime général pour quelques mois (actuellement 4 mois) à un montant journalier d'environ 30€. (paragraphe 4 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage). A ce propos, n'ayez pas d'inquiétude de basculer au régime général si vous avez eu quelques contrats hors spectacle. D'abord parce qu'il n'y aura pas de réexamen automatique après le 31 août 2021, le réexamen se fera uniquement si vous le demandez à Pôle emploi, donc si vous craignez une ouverture de droits au régime général vous pourrez vérifier votre situation avant de demander un réexamen. Mais surtout il y a toujours la règle de l'activité habituelle (paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage), si vous avez les conditions pour ouvrir de nouveaux droits au régime intermittent alors peu importe vos contrats au régime général. ► Le maintien des droits jusqu'à la retraite à taux plein Vous avez atteint l'âge de 62 ans avant l'échéance du 31 août 2021 ? Alors vous pouvez peut-être souffler en bénéficiant du maintien de votre indemnisation jusqu'à pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut toutefois réunir plusieurs conditions. (paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X) ► L'aide de fin de droits Si jamais au 1er septembre 2021 vous n'aviez aucune fin de contrat dans les 12 derniers mois et que vous ne pouvez ainsi bénéficier d'aucune nouvelle indemnisation, sous conditions de ressources de votre foyer vous serez alors probablement concerné·e par le RSA mais vous pourrez également percevoir un versement unique de 324€ au titre de l'aide de fin de droits. ► Le bonus des périodes de formation et des contrats d'enseignement Si vous avez suivi une formation avant le 1er septembre 2021 et que vous vous étiez désinscrit·e de Pôle emploi le temps de cette formation, vous pourrez bénéficier de l'assimilation des heures de formation (dans la limite de 338 heures) pour la recherche des 507 heures d'intermittence. (paragraphe 1 de l'article 3 des annexes VIII et X) Il faudra toutefois qu'il y ait eu au moins une fin de contrat au régime intermittent après la dernière formation. Si dans votre parcours professionnel vous avez cumulé au moins 5 ouvertures de droits à l'intermittence, vous pouvez potentiellement bénéficier d'aides financières pour votre formation dans le cadre du Fonds de Professionnalisation et de Solidarité. En mai 2020 l'AFDAS avait annoncé un assouplissement exceptionnel des conditions d'obtention d'un financement de formation mais ces mesures ont pris fin dès août 2020. Si vous avez eu des contrats d'enseignement technique ou artistique avant le 1er septembre 2021, le décret de l'année blanche prévoit un renforcement de l'assimilation de ces heures de contrats pour la recherche des 507 heures : jusqu'à 140 heures d'enseignement (170 heures pour les plus de 50 ans) pourront être exceptionnellement assimilées. (paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du décret) Quid des primo et néo accédants ? En matière d'indemnisation, la seule disposition exceptionnelle pour celles & ceux qui n'avaient pas encore ouvert de droits à l'intermittence au 1er mars 2020 est la prise en compte des 3 mois de confinement (de mars à mai 2020) pour l'allongement de la période d'affiliation, autrement dit la recherche des 507 heures se fait dans ce cas sur 15 mois au lieu de 12. Sur les 2 ou 3 dernières années, vous avez peut-être aussi cumulé suffisamment d'heures d'intermittence pour bénéficier d'une ouverture de droits au régime général au titre de la clause de sauvegarde comme il est expliqué dans cet article du blog. Des fonds de soutien ont aussi été créés pour apporter un petit subside à celles & ceux qui n'avaient pas pu ouvrir des droits à temps. Il y a notamment le FUSSAT et l'aide mise en place par Audiens et Netflix. En conclusion Comme on l'a vu, pour sécuriser les mois qui suivront le 1er septembre 2021, un contrat à l'été 2021 pourrait bien représenter un contrat en or mais gare à la bidouille, le Service Prévention des Fraudes (SPF) de Pôle emploi sera probablement très attentif aux contrats sur cette période... Nous aborderons d'ailleurs prochainement sur ce blog les méthodes parfois très douteuses employées par des agents de Pôle emploi services dans le cadre d'un contrôle. En attendant, il n'est pas utile de surcharger Pôle emploi services de mails ou d'appels téléphoniques pour savoir si de nouvelles dispositions vont être prises pour l'après 31 août 2021 puisque c'est le Gouvernement qui décidera d'éventuelles nouvelles mesures et dans ce cas elles seront aussitôt présentées sur le site de Pôle emploi dédié aux professionnels du spectacle. Mais comme une nouvelle année blanche représenterait plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires non-compensés par des cotisations en forte baisse, on peut imaginer que le Gouvernement attendra le dernier moment avant de se prononcer en fonction de l'évolution du contexte sanitaire...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 5:40 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde du 24 octobre 2020
Ecrit par Valère Novarina et mis en scène par Jean Bellorini, « Le Jeu des ombres » a ouvert avec grâce la Semaine d’art en Avignon ce vendredi 23 octobre.
Qu’elle fut étrange, cette soirée d’ouverture de la Semaine d’art en Avignon, vendredi 23 octobre. Avignon en octobre, sans ce soleil du midi qui découpe le monde en contours nets, sans le plein air, sans la Cour d’honneur du Palais des papes, Avignon en automne, sous une pluie fine et sous couvre-feu. Mais Avignon quand même, le théâtre retrouvé : les trompettes de Maurice Jarre ont bien retenti avant que ne commence le très beau spectacle signé par Jean Bellorini, ce Jeu des ombres au titre évocateur, qui fut applaudi longuement et avec ferveur, à l’issue de la représentation.
A l’origine, Le Jeu des ombres devait faire l’ouverture du festival, début juillet, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, un festival qu’Olivier Py, son directeur, avait voulu placer sous le signe d’Eros et Thanatos – dieux de l’amour et de la mort –, bien avant que l’on entende parler d’un nouveau virus mortel. La mort et l’amour baignent ce spectacle inspiré par le mythe d’Orphée et Eurydice et dont Jean Bellorini a commandé le texte à Valère Novarina, notre plus grand poète dramatique vivant. Pour Novarina, « la plus profonde des substances, la plus miroitante, la plus précieuse des étoffes, la très vivante matière dont nous sommes tissés, ce n’est ni la lymphe, ni les nerfs de nos muscles, ni le plasma de nos cellules, ni les fibres, ni l’eau ou le sang de nos organes, mais le langage. La langue est notre autre chair vraie ». Et chez lui, ce langage semble lui-même un organisme vivant en perpétuelle effervescence, recomposition, arborescence, prolifération, recréation. Spectacle captivant Autant dire que c’est une relecture très libre du mythe que livre l’auteur. L’histoire d’Orphée allant chercher Eurydice aux enfers, pour la perdre à nouveau, est une nouvelle occasion de mâcher la chair de la langue, de pétrir et repétrir la glaise des mystères de la vie et de la mort, de la création et du néant. Cette partition poétique, Jean Bellorini l’entrelace avec des extraits de L’Orfeo, de Monteverdi, chantés en direct sur la scène, qui recentrent en douceur ce Jeu des ombres vers le voyage d’Orphée et Eurydice. Le drame est dans le langage, dans la musique, dans la manière dont le spectacle lui-même fait opérer l’art et la poésie comme principes de vie face à la mort Cet alliage, auquel s’ajoutent des chansons populaires ou foraines, aurait pu donner un spectacle bancal. Et pourtant, on se laisse captiver, sans se poser trop de questions, par la grâce de la poésie scénique, de l’atmosphère qui se crée sur le plateau. Un plateau qui est comme une bouche d’ombres, le noir sous-sol des enfers qu’éclairent des dizaines de servantes, ces lampes sur pied qui veillent, la nuit, sur les théâtres déserts. Un plateau plongé dans la nuit que traverse un rail de feu – image splendide –, flammes des enfers ou de la création, tandis qu’Orphée chante son amour perdu, par la voix divine du jeune chanteur Ulrich Verdoni. Bien sûr il ne faut pas chercher ici de personnages et de dialogues au sens classique du terme, et d’histoire à raconter. Le drame est dans le langage, dans la musique, dans la manière dont le spectacle lui-même fait opérer l’art et la poésie comme principes de vie face à la mort, sans jamais forcer sur le message, qui pourrait être lourdement appuyé dans le contexte actuel. Ce qui est mis en acte, sur le plateau, c’est la création d’un monde par la parole, une parole magnifiée par la musique, la lumière, le mouvement – le chorégraphe Thierry Thieû Niang collabore à la mise en scène. « Fermer les paupières du monde » Il est, ce drame, dans la « chair parlante » qu’est l’homme, qui crée le monde en le nommant, fragment par fragment, couleur par couleur, lieu, créature, brindille ou caillou. Une « chair parlante » dont la représentation exacte est le comédien de théâtre. Et ces comédiens, ici, sont merveilleux, ils arrivent à rendre extraordinairement vivante et concrète cette langue de Valère Novarina. François Deblock et Karyll Elgrichi caressent avec un charme fou leurs figures d’Orphée et Eurydice, ils dansent avec la mort, elle avec sa robe de mariée, lui avec son costume dessiné à même la peau comme un squelette. « J’irai tracer au compas la limite qui est invisible entre naître et n’être pas », dit-il. « Je vais fermer les paupières du monde », dit-elle. Les morceaux de bravoure langagiers ne manquent pas, comme celui, étourdissant, qui voit l’acteur Marc Plas énumérer une flopée de conceptions de Dieu, de saint Augustin à Antonin Artaud en passant par Serge Gainsbourg ou Hubert-Félix Thiéfaine. Valère Novarina glisse la sienne, au passage : « Dieu est la quatrième personne du singulier. » Ivresse de la perte En contrepoint, Aliénor Feix chante, merveilleuse elle aussi, cette musique céleste de Monteverdi. Où est le monde des morts, où est celui des vivants ? Quel est ce monde où les vivants ne sont que des ombres ? Le spectacle de Jean Bellorini se rapproche doucement de nos rivages actuels. Alors qu’il s’achemine vers la fin de son poème dramatique, Valère Novarina se lance dans de longues listes d’herbes, d’arbres, d’animaux, où apparaît notamment un pangolin, qui était venu se glisser dans son texte bien avant que cet étrange animal écailleux ne s’invite dans l’actualité. Mais cette ivresse accumulative du langage, alors, semble avoir changé de nature, comme si elle était devenue une ivresse de la perte. La parole de ce mangeur « de la chair de l’arbre qui fait parler » qu’est Novarina n’est plus là pour créer le monde, ou se délecter de sa richesse inépuisable, mais pour faire revivre ce qui n’est plus, ou risque de ne plus être. « La mort n’a rien à dire », affirme, à un moment, un de ces forains de la métaphysique. Tout est dit ? Peut-être pas, puisqu’on est encore là pour le dire. « Le Jeu des ombres », de Valère Novarina (Editions P.O.L, 272 pages, 17 euros). Mise en scène : Jean Bellorini. Semaine d’art en Avignon, La FabricA, jusqu’au 30 octobre, à 17 h 30. Tarif unique 15 euros. Puis tournée jusqu’à fin mai 2021, notamment : du 7 au 22 novembre au Théâtre Les Gémeaux de Sceaux, et du 14 au 29 janvier 2021 au TNP de Villeurbanne. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) Légende photo : Karyll Elgrichi lors de la répétition générale du « Jeu des ombres », jeudi 22 octobre, à La Fabrica, à Avignon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 25, 2020 5:15 PM
|
Par Bruno Tackels sur la page des Fictions de France Culture feuilleton créé en 2006, rediffusé à l'occasion de la Semaine d'art en Avignon en octobre 2020 Ecouter l'émission en ligne (2h) Ce théâtre que je fais, il cherche à s’inscrire dans l’histoire sociale, tout simplement. Et si sur cet immense terrain où se déroulent les querelles du monde ma place est misérable, c’est à cette place et à cette place seule que je tiens" Jean Vilar, créateur du Festival d'Avignon en 1947. La 74 ème édition du Festival d’Avignon a été réduite à néant comme l’écrit son directeur Olivier Py à cause de l’épidémie de covid. Désireux de sauver au moins symboliquement ce qui pouvait l’être de la programmation de juillet 2020, le directeur du Festival a souhaité revenir à l’origine, à cette semaine d’art qui fonda au cœur de l’automne 1947 le Festival. Cette semaine d’art était une idée de poète comme dit Bruno Tackels, l’idée d’un metteur en scène Jean Vilar, d’un poète, René Char et d’un collectionneur d’art, Christian Zervos. Car tout a commencé à Avignon par une exposition d’art contemporain réunissant les plus grands artistes de l’époque, de Chagall à Picasso, Klee, Kandinsky, Léger, Matisse … et par une provocation. A l’invitation de Zervos d’accompagner cette exposition par la reprise d’un spectacle, Jean Vilar répondit par la proposition de trois créations montées en quelques jours. Et ainsi est né le désir d’Avignon chez "le patron" , Jean Vilar , qui réussit à convaincre les élus de lui offrir la cour du palais des papes et y installer des chaises pour les spectateurs et un plateau pour les acteurs. A l’occasion de la semaine d’art réimaginée par Olivier Py, du 23 au 31 octobre, nous avons souhaité vous raconter l’histoire du Festival d’Avignon et vous proposer en nouvelle diffusion , le feuilleton d’Avignon, une histoire sonore composée par Bruno Tackels et Jacques Taroni en 2006, à partir de lectures, d' archives, et de courtes interview. Voix historiques et voix contemporaines se côtoient pour raconter 60 ans de festival. Composé à l’origine de 20 épisodes, nous arrêterons ce soir l’histoire de la nuit avignonnaise à 1968, année charnière dans l’histoire du Festival, cruelle pour Jean Vilar et nous commencerons donc au tout début, à l’automne 1947. Car comme l’écrit Roland Barthes : C’est donc d’Avignon - l’hiver que tout a germé : de rien, de la pierre, du silence d’un arbre. Ce qu’Avignon a donné à Vilar, ce n’est pas un lieu privilégié, un site prestigieux, suant de spiritualité. Heureusement non : c’est un lieu simple, froid, naturel, disponible, au point que l’homme, et le surgissement du spectacle hors d’une matière sans voix et sans complicité. Avignon a été la voix naturelle du théâtre populaire, parce que Avignon est un lieu sans mensonge où tout est remis entre les mains de l’homme. Il n’est que de passer la tête, un jour d’hiver, par la grosse porte de bois qui ferme la cour du festival, pour saisir qu’au théâtre aussi les hommes sont seuls et qu’ils peuvent tout. Réalisation : Jacques Taroni Avec Jacques Bonnaffé, Hugues Quester, Jean-Marc Hébert, Agnès Sourdillon, Jean-François Sivadier, Georges Wilson, Michaël Lonsdale, Denis Podalydès, Bruno Sermonne, Dominique Reymond, Bérangère Bonvoisin, Anne Alvaro, Genevière Page, Nicolas Bouchot, Georges Wilson, Michel Galabru, Samuel Perche, Valérie Lang Equipe de réalisation Philippe Bredin, Elise Leu, Alexandra Malka, Noélly Pellegrin Merci à Alain Trutat, Laure Adler, Colette Fellous, Lucien Attoun, Alain Veinstein pour les extraits de leurs émissions Merci à la Maison Jean Vilar pour son aide pour la recherche des archives. Légende photo : Jean Vilar, créateur du festival d'Avignon, en 1967• Crédits : Keystone-France - Getty
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...

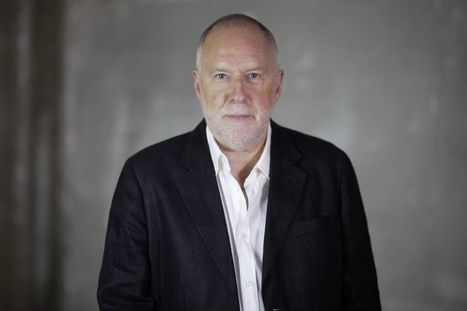


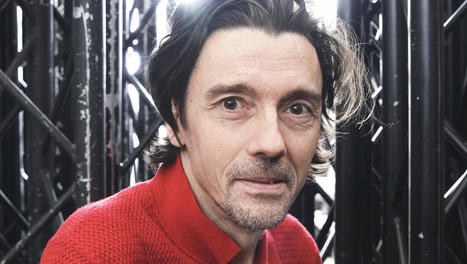

![Jean Bellorini : « Le théâtre populaire tel que je le rêve pour les cent ans à venir […] serait un théâtre citoyen, un théâtre conscient du monde. » | Revue de presse théâtre | Scoop.it](https://img.scoop.it/SlPNvMo8v2lp0JPoLe7NADl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)