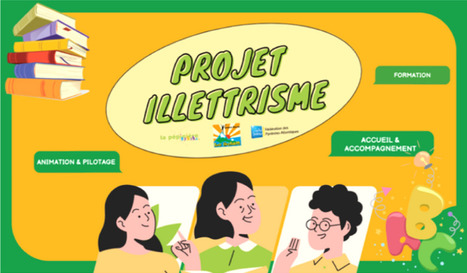Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Cap Métiers NA
July 10, 2024 6:35 AM
|
Une école pour l'environnement
Léa Ternot est directrice de L’Ecole de la Rénovation Energétique, créée à Bordeaux afin de proposer de nouveaux parcours pour accompagner et réussir la massification de la rénovation énergétique. Sa mise en place a été financée par le Fonds Régional pour l’Innovation en Formation. Quelle est l’origine de votre école ? Notre création il y a trois ans répondait à un double constat. Le premier c’est le manque de compétences opérationnelles dans la rénovation énergétique des bâtiments. Des entreprises nous faisaient part de besoins très importants qu’elles n'arrivaient pas à combler. Le second, c’est le nombre croissant de personnes qui souhaitaient se reconvertir, faire un métier qui ait du sens et un impact positif sur l’environnement, notamment depuis la crise sanitaire. A la croisée de ces deux constats, notre école a été créée pour mettre en lien les besoins des entreprises et les personnes qui cherchent à évoluer dans ce secteur. Pour démarrer nous sommes allés à la rencontre des entreprises pour connaître les compétences qu’elles recherchaient. Nous avons construit les parcours, cherché des financements auprès des acteurs qui interviennent sur la formation des demandeurs d’emploi (les Régions, les Opco, France Travail). L’équipe a grandi petit à petit et est aujourd’hui constituée de six personnes, réparties sur trois sites : Bordeaux, Biarritz et Rennes. Que signifie votre sigle ? Initialement, éRE était le sigle pour Ecole de la Rénovation Energétique. Depuis nos activités se sont développées et vont au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments, puisque nous formons de manière plus large à la stratégie bas carbone. Notre sigle représente donc aujourd’hui nos trois branches de formation : Executive, Reconversion, Evolution. Quelles sont vos 3 branches ? La reconversion est notre branche « historique. » Nous formons à la fois des chefs de projet en rénovation énergétique, destinés à piloter et accompagner l’ensemble d’un projet de rénovation dans la durée, et nous formons des « compagnons en rénovation énergétique spécialisés en enveloppe du bâtiment », c’est-à-dire des ouvriers qui interviennent sur les chantiers (isolation thermique par l’extérieur, par l’intérieur, étanchéité, menuiserie). La deuxième branche, « executive », est dédiée aux décideurs dans le bâtiment et consiste à les former à la stratégie bas carbone en 8 ateliers d’une durée de 5 heures chacun. Ces ateliers permettent de maîtriser les principaux enjeux du bâtiment bas carbone, d’être acteur de cette nécessaire transition dans leur métier au quotidien, mais aussi de porter la démarche au sein de leur structure pour impulser le changement. Enfin, concernant la branche « évolution », la plus récente, l’objectif est de former des salariés, des collaborateurs, qui souhaitent évoluer au sein de leur structure et pour cela acquérir de nouvelles compétences. Nous répondons ici à des besoins spécifiques des structures et construisons des parcours sur mesure pour s’adapter à leurs enjeux. En synthèse, notre offre permet de former trois publics, ceux qui souhaitent retrouver un emploi dans le secteur, ceux qui souhaitent impulser une démarche au sein de leur structure, et ceux dont les métiers évoluent au regard des nouveaux enjeux du secteur et qui doivent donc acquérir de nouvelles compétences. Pour la partie reconversion, l’école a déjà formé 230 personnes, 170 chefs et 60 compagnons, sur nos trois campus. Sur les pacours « executive », nous avons formé 110 décideurs à Bordeaux, Biarritz et Rennes et déployons ce parcours en 2024 dans de nouvelles villes (Paris, Toulouse, La Rochelle). Enfin, 46 personnes ont suivi nos parcours « évolution ». En quoi consiste un parcours de reconversion ? Nos parcours reconversion durent deux mois et demi. Cette durée courte est importante car elle permet à nos stagiaires de faire le pari de la reconversion. Ce format concentré est aussi important pour les structures « employeurs » qui ont des besoins de recrutement à court terme. Nous les associons au processus de recrutement des stagiaires et elles peuvent ainsi se projeter avec un candidat dans les mois qui suivent. Tous nos formateurs sont des professionnels du secteur. Cela constitue une garantie que nos contenus de formation soient toujours en adéquation avec les besoins réels en compétences des employeurs. C’est aussi une garantie de la bonne employabilité de nos stagiaires, puisque certains formateurs sont par ailleurs des recruteurs et embauchent donc certains candidats directement à l’issue de nos parcours. Quel est le profil de vos stagiaires « reconversion » ? Sur ces parcours nos stagiaires ont par définition déjà une expérience professionnelle derrière eux. S’agissant des compagnons, nous n’avons pas de prérequis scolaires, ils ont simplement une appétence et souvent une première expérience dans le secteur, mais surtout de la motivation et de l’envie de s’engager dans ce domaine. Les chefs de projet ont le Bac (ou équivalent) et au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le bâtiment ou en tant que pilote de projet. Ils peuvent venir de divers secteurs parfois éloignés du monde du bâtiment (commerce, marketing, santé, administration, …). Dans les promotions de chefs de projet, on parvient à avoir un équilibre femmes / hommes dans les profils, c’est plus difficile chez les compagnons. Les entreprises sont encore pour certaines largement en pénurie de recrutement, donc il y a un enjeu aujourd’hui à aller chercher de nouveaux publics et de diversifier les profils. Comment procédez-vous pour vous faire connaître ? Par nature, nous sommes dans une démarche partenariale avec les formateurs et les entreprises : les acteurs professionnels sont pour éRE des formateurs, des recruteurs, des lieux de visite, des lieux d’immersion, des membres de nos jurys, des intervenants. Nous sommes en lien constant avec eux et cela contribue à la création, à la consolidation et à l’animation de notre réseau. Par ailleurs, les entreprises que nous avons mobilisées progressivement ont embauché nos stagiaires, qui eux-mêmes sont devenus des recruteurs, etc. Ce réseau d’alumni est très riche et contribue au développement de notre activité. Nous sommes aussi en lien, évidemment, avec l’ensemble des fédérations professionnelles du secteur, et des institutionnels qui interviennent en particulier sur la formation des demandeurs d’emploi. Comment vous adressez-vous à vos publics en reconversion ? On insiste beaucoup sur la transversalité. Pour nous, c'est très important. Premièrement nous leur proposons une approche technique globale, performante et qualitative du bâtiment, des enjeux qu’il représente sur le plan énergétique, des interactions entre les différents corps de métier. Deuxièmement, au-delà des compétences techniques nous formons aussi nos stagiaires à des compétences transversales de type posture professionnelle, communication, parce que nous souhaitons qu'ils aient des profils solides pour intégrer une équipe, savoir gérer un conflit, savoir bien communiquer, savoir bien se présenter, etc. Où vont vos stagiaires après leur formation « reconversion » ? Puisque les profils en entrée sont très différents, les profils en sortie sont aussi extrêmement diversifiés. Ce qui est intéressant pour eux, c'est que cela leur ouvre une multitude de voies possibles. Les chefs de projet en particulier peuvent aller travailler à l’issue dans des structures variées, comme des entreprises de travaux, des bureaux d'études, des gestionnaires de patrimoine public ou privé, des structures dédiées à l'amélioration de l'habitat et à la précarité énergétique, des plateformes publiques dédiées à la rénovation énergétique, etc. Dans quel métier évoluent les chefs de projet ensuite ? Le poste classique, c'est le chef de projet en rénovation énergétique qui a de nombreuses appellations différentes. S’ils ont un profil orienté vers le conseil, ils seront conseillers en rénovation ou conseiller en précarité énergétique. S’ils ont une vision davantage commerciale, ils pourront devenir chargés d'affaires en rénovation énergétique ou responsable commercial. S'ils ont plus un parcours chantier, ils vont pouvoir évoluer vers le métier de coordinateur de travaux ou conducteurs de travaux. En bureau d'études, ils peuvent être chargés d'études bâtiment ou chargés d'études thermiques. 20% de nos stagiaires chefs de projet s’installent en indépendant ou fondent leur structure. Quel que soit leur situation à l’issue de la formation, nous les accompagnons jusqu’au bout, et nous restons en lien avec eux ensuite, ils savent qu’ils peuvent faire appel à nous en cas de besoin. Avez-vous rencontré quelques surprises ? Je dirais la diversité des profils qui viennent d’horizons très variés. Nous n’avions pas anticipé une telle variété, c'est plutôt un point très positif pour la dynamique de groupe. Autre aspect positif, auquel on ne s’attendait pas forcément, c’est la grande reconnaissance des stagiaires. Nous en avons beaucoup qui reviennent nous voir après leur formation, ils ont un sentiment d'appartenance assez fort. Selon vous, que faudrait-il améliorer ou faire évoluer ? Par rapport aux enjeux de massification du secteur, obtenir un financement pour se former est encore un processus assez long et complexe pour un stagiaire. Si demain une entreprise a besoin de dix personnes, on ne sait pas lui répondre rapidement. Il y a un certain décalage entre les besoins exprimés et la vitesse à laquelle on peut répondre. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
June 27, 2024 7:30 AM
|
Véronique Bales est directrice du centre régional de formation professionnelle de Croix-Rouge Compétence Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2020, Croix rouge Compétence a mis en place à Bègles et à Limoges une prépa apprentissage pour les métiers du secteur médical et médico-social. Pouvez-vous nous présenter Croix-Rouge Compétence ? Croix-Rouge Compétence est la filière formation de la Croix-Rouge française. Elle gère 157 instituts de formation répartis sur 60 sites. Elle représente le seul réseau intégré d’organismes de formation sanitaire et sociale en France présent sur l’ensemble du territoire national. Elle est spécialisée dans les domaines du sanitaire, du social, de la santé et sécurité au travail. Elle prépare à 30 métiers et accompagne les professionnels dans leur montée en compétences. Elle propose également des programmes de pré-qualification pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi dans l’acquisition des savoirs et compétences de base. Notre expertise dans le champ de la formation sanitaire et sociale nous permet d’accompagner les professionnels du secteur dans leur montée en compétence, notamment dans le champ de la prévention. Nous accompagnons les entreprises à répondre aux exigences qui sont les leurs.
Globalement, notre ambition est de garantir l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement de carrière par des formations d’excellence adressées aux jeunes, aux salariés, aux demandeurs d’emploi et à toute personne éligible à la formation professionnelle, tout au long de leur vie.
Comment êtes -vous organisés en Nouvelle-Aquitaine ? Nous avons une organisation en régions, avec des filières « apprendre un métier », un CFA, et le segment « montée en compétences. » Nous proposons ainsi une offre de formations dans les métiers du secteur sanitaire, médical et médico-social qui permet de se former tout au long de la vie. En Nouvelle-Aquitaine nous avons une filière avec des formations de secrétaire médical, médico-social, d'aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, d'ambulancier, de brancardier, d’auxiliaire ambulancier, d’infirmier, de coordonnateur de parcours et de soin et de masseur kinésithérapeute, de santé et sécurité au travail et des formations continues. Nous avons également une filière pré-qualifiante, avec une offre de formation relevant du dispositif 100% inclusion avec le PIC, et des préparations opérationnelles à l'emploi (POEC). Notre CFA Croix-Rouge est présent en Nouvelle-Aquitaine sur les territoires de Bègles, Cognac, Angoulême, Brive, Limoges, Poitiers et Pau. Pour répondre aux besoins du territoire, nous menons des études en lien avec les employeurs et les opérateurs de l'emploi. Cela nous permet de travailler le maillage territorial et de répondre aux attentes. Comment avez-vous mis en place une prépa apprentissage ? Notre première action, c’était sur un PIC auquel avait répondu le CFA de l'hospitalisation privée. Ils nous ont délégué la partie pédagogique que nous avons déployée pendant 4 ans sur le territoire de Bègles, pour préparer les jeunes à entrer dans leur formation de secrétaire médical et médico-social. Ensuite, nous avons répondu à un deuxième appel à projet avec notre propre CFA Croix-Rouge Compétence à Limoges, une prépa apprentissage pour les métiers du secteur médical et médico-social. C’était un tronc commun qui permettait aux jeunes de rentrer dans des cursus d'aide-soignant, d'accompagnant éducatif et social, de secrétaire-médical, et même d’auxiliaire de puériculture. Combien d’apprenants avez-vous accueillis ? Pour la prépa apprentissage secrétaire médical, les deux premières années, nous avons eu des groupes de 30 personnes. Les deux dernières années, ce nombre a progressivement baissé, jusqu’à une quinzaine d’apprenants. Les pré-requis ont été modifiés lors du renouvellement de l’AAP. Initialement, ils étaient de 80% de niveau 4 et 20% de niveau infra bac, mais par la suite la proportion s’est inversée avec 80% d’infra bac et 20% de niveau Bac. Pour la prépa apprentissage de Limoges, en 2022 et 2023, nous avons accompagné un groupe de 15 personnes. Les apprenants bénéficiaient de 260 heures de cours en institut et un stage de 140 heures, alors que pour celle préparant aux métiers du secteur médical et médico-social, les apprenants suivaient 210 heures de cours en institut et 70 h de stage. Pourquoi vous positionner sur un tel dispositif ? Un des objectifs de Croix-Rouge Compétence est d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est dans notre ADN. Le deuxième objectif est de répondre aux besoins des recrutements du secteur médical et médico-social. Les actions d’insertion et pré qualification répondent à ces objectifs, tout en proposant des formations du secteur médical et médico-social en apprentissage. Ces parcours permettent alors de sécuriser le projet professionnel des apprenants et participent à limiter le taux d’abandon. Ces dispositifs de préapprentissage permettent à la fois de travailler les compétences socle, les savoir-être, la découverte des métiers et de valider le projet professionnel du jeune. Quels ont été les apports de ce dispositif ? Ce dispositif a permis de répondre aux problématiques de posture professionnelle et de difficultés en expression écrite et en bureautique. La prépa apprentissage a ouvert la possibilité de travailler sur les savoirs de base, les codes professionnels, le respect des consignes, les caractéristiques de l’environnement professionnel. Des animateurs en théâtre ont accompagné les apprenants dans l’acquisition de la posture professionnelle, la gestion du stress, la confiance en soi et la dynamique d’équipe. Quelle est la place consacrée aux stages ? Nos équipes accompagnaient l’apprenant dans ses démarches de recherche de stage, de mise en relation avec les employeurs et de validation du projet professionnel. Elles ont tout mis en œuvre pour s’adapter aux besoins des apprenants et aux contraintes des structures. Le stage a permis aux apprenants de participer, sous la supervision d’un tuteur, à de véritables activités. Par exemple, pour la prépa apprentissage aux métiers du secteur médical et médico-social, aux activités de soins et de confort, à la prise de repas, à la découverte du travail en équipe et à la transmission des consignes. A quel moment considérez-vous qu’un jeune soit prêt à entrer en contrat d'apprentissage ? Tout au long de la prépa apprentissage, les conseillères en formation en appui des équipes pédagogiques accompagnent les apprenants jusqu’à la signature du contrat en alternance. Nous travaillons avec eux leur projet et la levée des freins périphériques si nécessaire. Notre offre de sécurisation de parcours (cellule écoute et soutien, référence handicap, réussite aux apprentissage) a permis de répondre à la levée de ces freins. Avez-vous rencontré des difficultés particulières lors de la mise en place ? Nos équipes ont surtout dû s’adapter, pour chaque groupe déployé, aux besoins des apprenants et au contexte du territoire. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
June 13, 2024 8:21 AM
|
Adapter la formation aux besoins, la solution AFEST
D’un côté, des entreprises qui cherchent des soudeurs compétents pour répondre aux demandes de clients de plus en plus exigeants. De l’autre, des demandeurs d’emploi souvent très peu qualifiés. A Bressuire (Deux-Sèvres), compte tenu de cet écart, le Greta s’est interrogé en 2022 sur les raisons qui faisaient que, pour ce métier particulier, la formation initiale et la formation par apprentissage n’arrivaient pas à couvrir les besoins de recrutement. Nathalie Baron, conseillère en formation continue à l’agence de Thouars, constatait également que les entreprises étaient circonspectes sur les solutions habituellement proposées. « J’entendais, quelquefois, de leur part que les référentiels de formation sont parfois trop théoriques, normatifs et ne reflètent pas les compétences pratiques et opérationnelles requises par les entreprises et qu’elles recherchaient des formations plus succinctes et directement applicables. Je me suis dit qu’il fallait qu’on aille au plus près des attentes. Que pouvions nous proposer qui soit différent ? » La réponse apportée était de collaborer différemment avec les entreprises et avec les partenaires du service public de l'emploi, de travailler ensemble sur un projet qui consiste, à terme, à recruter des personnes qualifiées qui correspondent aux besoins du territoire. Par ailleurs, l’enjeu était de trouver un moyen de « désacraliser » l’entrée en formation pour attirer un public qui a souvent connu un parcours scolaire difficile. « J’avais déjà entendu parler de l’AFEST. Pour avoir échangé avec des collègues, cela paraissait une modalité compliquée à mettre en œuvre, qui demandait du temps, des compétences spécifiques en ingénierie de formation et surtout un engagement de toutes les parties prenantes. Un jour, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? » A l’époque, le Greta travaillait avec le Pôle Métal 2S, un cluster de la métallurgie du bocage bressuirais regroupant une trentaine d’entreprises et différents partenaires institutionnels. Les réunions plénières de l’association constituaient une occasion idéale pour présenter le projet AFEST avant de déposer un dossier de financement en réponse à l’appel à projets régional. AFEST et apprentissage « Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des entreprises locales et leur expliquer l’intérêt de la démarche, elles ne voyaient pas la différence avec l’apprentissage, qui lui aussi se déroule en partie dans un environnement de travail réel et vise à développer des compétences professionnelles directement applicables au poste de travail. Nous avons réussi à en mobiliser trois, ainsi que des formateurs internes susceptibles de s'impliquer dans le projet. J’ai aussi travaillé avec un formateur, lui-même certifié AFEST, qui venait du monde de l’industrie. Avec la chargée de mission du Pôle Métal 2S, nous formions une véritable équipe projet. » Nathalie Baron était persuadée que la modalité AFEST serait en mesure de garantir aux entreprises une formation correspondant véritablement à leurs besoins. Particulièrement parce qu’il s’agissait d’en déterminer tous les éléments avec elles, d’élaborer un référentiel d'activité adapté aux spécificités de leurs métiers. Pratiquement parlant, l’objectif du projet était simplement d’être capable de souder. Le référentiel a donc été intitulé « souder à plat ». Volontairement il n’était pas question de certification, l’objectif principal étaient de renforcer les compétences opérationnelles plutôt que d’obtenir une reconnaissance formelle. Il s’agissait aussi de ne pas mettre trop de pression aux formateurs en interne qui pourraient craindre de ne pas être à la hauteur des attentes, ainsi qu’aux apprenants. Puisque les apprenants devaient être capables de réaliser des soudures simples, à plat, le parcours ne devait pas dépasser 400 heures, avec 30% en centre, le reste en entreprise. Pour une formation certifiante, c’est plus du double. « Nous sommes partis d'une page blanche. Avec les dirigeants et les formateurs, nous avons déterminé quelles étaient les prérequis, les compétences à acquérir, par exemple d'être capable de mettre en service et d'entretenir un poste à souder, etc. » Un référentiel avec un socle commun a été élaboré, reflétant les besoins et les exigences partagés par l’ensemble des partenaires impliqués. Par la suite, chaque entreprise a conçu son propre référentiel d’activité, adapté à ses besoins et à ses exigences particulières. « Au préalable, nous avions mobilisé les cinq formateurs internes pendant 21 heures, afin de les former à la méthodologie pédagogique et à la conception d’un parcours de formation sur mesure ». Le recrutement des stagiaires a commencé par des réunions d’information collectives pour leur présenter le dispositif, leur expliquer les modalités. Il s’agissait aussi d’impliquer les candidats dès le départ en leur demandant ce qui pourrait les attirer en comparaison d’une formation classique. Le processus de recrutement des candidats a été orienté vers l’identification des demandeurs d’emploi peu qualifiés, qui pouvaient avoir connu des difficultés scolaires mais ayant un potentiel d’apprentissage à la modalité AFEST. Ils ont ensuite été sélectionnés en fonction de leur motivation, de leur intérêt pour le métier de soudeur et de leur aptitude à suivre ce programme en situation de travail. Beaucoup de candidats ont décliné la proposition en raison de freins à la mobilité. Finalement, un groupe de cinq personnes, dont une femme, a été recruté pour une entrée en formation au printemps 2023. En cours de route, une personne a quitté la formation car elle n’arrivait pas à gérer ses problématiques personnelles. Elle a tout de même pu avancer grâce à cette expérience, mais qui ne s’est pas traduite en emploi. Les autres stagiaires sont allés au bout de leur parcours, tous ont été recrutés, dont un dans l'entreprise qui l’avait formé. L'apport de la réflexivité L’expérience AFEST a changé le regard sur la formation et a fait émerger de nouvelles modalités de collaboration entre le Greta, le lycée professionnel, les entreprises et le service public de l’emploi. Cette expérience a modifié les pratiques des formateurs qui conçoivent maintenant des contenus de formation plus contextualisés, adaptés aux besoins réels et immédiats de l’entreprise et directement applicables. De plus, la pratique de la réflexivité a trouvé sa place dans l’apprentissage d’aujourd'hui en favorisant la remise en question, l'ajustement et l'amélioration constante des pratiques pédagogiques. Ce qui a eu pour effet de rendre les stagiaires encore plus acteurs de leur formation, plus impliqués. Une réflexion est en cours pour lancer une deuxième session, centrée sur la même thématique, à savoir « le soudage à plat » en conservant une approche pragmatique, adaptée aux besoins des entreprises et sans contrainte de certification formelle. Cela permettrait de renforcer les compétences et la compréhension de cette modalité pédagogique. « Si nous répondons à un nouvel appel à projet, il serait bénéfique d’avoir une entreprise déjà engagée dans cette action antérieure, cela peut être facilitant pour entraîner les autres. Nous serons également exigeants sur le choix des formateurs internes. Le formateur interne doit pouvoir sortir de la production pour se consacrer à la formation et ainsi respecter le planning d’apprentissage défini. Il est essentiel de choisir des personnes capables de prendre du recul et d’adopter une réflexion approfondie conforme aux attentes de la modalité AFEST » Autre piste d’amélioration, les évaluations en cours de formation, elles étaient complexes à mettre en œuvre par les formateurs internes malgré la simplicité volontaire des outils déployés, il faut aussi développer des outils pour simplifier le suivi des acquis des apprenants en entreprise. « Par ailleurs, concernant le recrutement, il est crucial d’établir des partenariats plus étroits avec les entreprises. Et comme nous avons maintenant des repères sur tous les aspects administratifs, techniques et financiers, nous pourrons nous consacrer principalement sur l’aspect de l’ingénierie pédagogique ».

|
Scooped by
Cap Métiers NA
May 31, 2024 2:58 AM
|
La mobilité dans toutes ses dimensions
Avant il y avait Ateliers Méca Deux Sèvres, une plateforme mobilité qui fonctionnait essentiellement autour d’un garage social. Fin 2023, Ateliers Méca est devenu Soligo 79. « Depuis plusieurs années, nous avons développé toute une gamme de services, » explique Juliette Leroy, directrice. « Notre idée était de modifier notre nom en enlevant le terme « mécanique » afin de mieux promouvoir la notion de plateforme mobilité dont l’objectif est de lever les freins à la mobilité pour faciliter l'accès à l'emploi ou à la formation. Son principe est de regrouper en un même lieu tout un panel de solutions pour parvenir à lever ces freins. » L’organisme niortais est un précurseur dans le domaine de la mobilité. Il emploie un chargé de mission dont la fonction est de coordonner toutes les plateformes mobilité du territoire créées au fil des années, certaines avec l’accompagnement d’Atelier Méca. Aujourd’hui Soligo 79 comporte toujours un garage solidaire qui s’occupe de l'entretien et la réparation toutes marques. Sa vocation est double. D’abord proposer des tarifs adaptés aux clients en difficulté financière, orientés sur prescription des partenaires sociaux. Ensuite, d’être un chantier d’insertion qui emploie une dizaine de salariés, encadrés par des professionnels. Les salariés en insertion peuvent y apprendre les métiers de la mécanique s’ils le souhaitent, ou être accompagnés vers un autre emploi qui leur correspond. La structure a également développé, depuis deux ans, la collecte et la réparation de vélos. Son principe est de récupérer les cycles en partance pour la benne, et de les remettre en état avant de les revendre avec un tarif solidaire et un tarif tout public. Si cette activité reste encore un peu à la marge, elle fait déjà pleinement partie des solutions de mobilité proposées. « Nous sommes là pour conseiller les personnes, pour rendre un service et pas pour vendre un service. Il n’est jamais question de vente forcée, mais plutôt de tout faire pour limiter les coûts. Les mécaniciens font le tour du véhicule, établissent les priorités, échelonnent les réparations pour que ce ne soit pas trop coûteux. » La mobilité, ça s'apprend Autre activité de Soligo, le conseil à l'achat de véhicules d'occasion. Certaines personnes se présentent au garage avec des véhicules trop endommagés. Plutôt que d’envisager de très grosses réparations, elles sont alors orientées vers un projet d'achat de véhicule adapté à leurs besoins. C’est tout un accompagnement pédagogique qui leur est proposé, un véritable diagnostic au cours duquel on leur parle du véritable budget que représente un véhicule, des pistes de financement et de micro-crédit adaptées à leur situation. L’association entend également lutter contre les fraudes à l'achat de véhicules d'occasion. Aujourd’hui, trop de publics précaires acquièrent des véhicules trafiqués, sans contrôle technique, dans lesquels ils engloutissent leurs économies. Soligo fait également de la location de véhicules, toujours destinée aux personnes rencontrant des difficultés dans leurs démarches de recherche d'emploi. Voiture, scooter, ou encore vélo à assistance électrique, la location inclut l’assurance ainsi qu’un volet pédagogique de prise en main du véhicule. Seule condition pour bénéficier d’une voiture, entrer une formation, avoir un contrat de travail ou une promesse de contrat. « Sur la location on est sur du temporaire. Nous sommes obligés de restreindre, parce que nous n’avons pas assez de véhicules pour tout le monde. Pendant les 3 à 6 mois de la location, on accompagne la personne sur le service conseil en mobilité pour que, à l’issue, elle ne se retrouve pas sans solution. Aucune obligation, mais on insiste vraiment sur cet accompagnement. » Le parc de Soligo est constitué de 26 véhicules, il inclut depuis quelque temps 6 voitures sans permis. Ils ont été achetés à petit prix à des garages ou à des particuliers, remis en état par les salariés en insertion. « Nous faisons partie du réseau Agil'ess. On répond aussi régulièrement à des appels à projets de fondations. En ce qui concerne les dons on travaille avec une autre association reconnue d'intérêt général qui s'appelle la PRAM, plateforme régionale d'accès à la mobilité. Elle compte 5 garages solidaires sur le territoire de l’ex Poitou-Charentes. Son rôle est de collecter des véhicules auprès de particuliers ou de grands comptes, de les faire remettre en état par les garages solidaires adhérents de l'association et de les revendre à bas prix à nos bénéficiaires. Mais ces voitures n’ont pas vocation à être louées. » « Nous avons aussi une auto-école sociale. Comme nous ne disposons pas de l'agrément auto-école, nous travaillons avec un prestataire, l'automobile club des Deux-Sèvres. Son principe est d’accompagner les personnes jusqu'au l’obtention du permis. Elles en ont besoin parce que c'est un examen, avec un code difficile à comprendre. Le vocabulaire utilisé, ses nuances, ne sont pas évidents pour tout le monde. » Côté public, l’association a connu une forte augmentation du nombre de jeunes de moins de 26 ans. 90% des bénéficiaires ont un niveau d'étude infra bac, le plus souvent CAP-BEP. Selon une étude menée par le réseau Agil’ess, près de 80% des bénéficiaires des plateformes mobilité sont dans des situations professionnelles qualifiée de précaires, des emplois temporaires, en horaires décalés, etc. Ils sont 80% à déclarer que le manque de mobilité est le frein principal à leur insertion et la cause de leur précarité professionnelle. Cela est confirmé par des chiffres nationaux puisque qu’un Français sur 3, un sur 2 en situation de précarité, a déjà refusé une offre d'emploi faute de solution de mobilité pour s'y rendre. Cause et conséquence L’absence de mobilité et les difficultés d’insertion sont clairement liées, particulièrement pour ceux qui habitent en dehors des grandes agglomérations, des zones peu ou pas desservies. Le vélo, le covoiturage, les transports collectifs, ne sont pas des solutions adaptées pour la plupart de ces personnes, notamment à cause des contraintes horaires. En réalité, aujourd'hui la plupart des Français ne peuvent pas se passer de voiture. Sauf les résidents des territoires urbains, qui disposent de solutions assez faciles d’accès, comme le vélo à assistance électrique ou le scooter électrique, solutions peu onéreuses et écologiques que la ville de Niort a développé avec son service Tanlib. « C'est là qu’intervient notre conseil en mobilité, qui connaît cependant des limites. Par exemple, le vélo reste peu utilisé. Notre impression c'est que la voiture reste un marqueur social. Pour nos publics en difficulté, réussir à posséder une voiture, c'est passer un cap. C’est très dur de faire évoluer les mentalités. » Les entreprises partagent le constat selon lequel il est difficile de recruter en raison du manque de mobilité des gens, et que le covoiturage n’est pas une réponse durable. Pour autant, elles sont difficiles à mobiliser. Une des solutions qui leur est proposés consiste à mettre des véhicules à disposition des salariés les premiers mois de leur intégration, le temps qu’ils trouvent d'autres moyens de se déplacer. Cette approche somme toute assez simple, serait susceptible de sécuriser les emplois et d’attirer un public plus large. Mais elle repose sur la volonté des employeurs. Depuis deux ans, l’association mène une expérimentation qui consiste à intégrer le conseil en mobilité au sein des formations d’Assistant De Vie aux Familles (ADVF) en partenariat avec l’AFPA. Encore trop de personnes formées à ce métier en tension ne sont pas employables parce qu'elles ne disposent pas de moyens de mobilité. Avec cette action, elles bénéficient de séances d’information collective, d’entretiens individuels en tout au long de leur parcours de formation professionnelle, afin de leur trouver des solutions adaptées. La démarche est reconnue par les employeurs qui sont plus enclins à recruter lorsqu’ils savent que le problème de mobilité est temporaire et que cette question est réellement prise en compte. Pour le futur, Soligo 79 voudrait également ouvrir une vélo-école, dans le but de convaincre les personnes de recourir à ce mode simple, écologique et économique. « Je pense qu’on ne fait pas assez d'actions autour du vélo. Beaucoup de gens pourraient l’utiliser, mais ne savent pas en faire. Si on les accompagne, qu’on leur apprend, ils s'y mettront volontiers. » Aujourd’hui, la priorité de l’association est de maintenir son éventail de services. Elle veut également développer sa flotte de véhicules en location, passer à une trentaine, pour répondre à des besoins urgents. En l’état elle ne peut pas répondre à toutes les demandes. Une loi récente autorise désormais les structures à récupérer les véhicules peu polluants éligibles à la prime à la conversion, pour en faire bénéficier les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Les modalités exactes ne sont pas encore connues, mais elles ouvrent des perspectives intéressantes.

|
Scooped by
Cap Métiers NA
May 16, 2024 8:45 AM
|
Promouvoir les droits culturels de chacun
Le pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui accompagne depuis 13 ans le développement de projets artistiques et culturels en lien avec les milieux de santé (hôpitaux, structures médico sociales, etc.). Capucine de Decker est la responsable réseau et accompagnement de cette structure qui participe à la politique publique « culture et santé », portée en Nouvelle-Aquitaine par la DRAC, l’ARS et la Région. Son projet « Soyons Cap », financé par l’appel à projets régional « mobilisation vers la formation », en fait partie. Qu’est exactement le pôle culture et santé ? C’est une équipe de 4 personnes basée à Bordeaux, qui intervient sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons trois grands axes d’action. Le premier est un pôle ressources. Nous proposons des rendez-vous conseils gratuits à toute personne qui veut développer un projet ou qui rencontre des difficultés à le développer. En complément, nous organisons des réunions d'informations collective sur les territoires, qu'on appelle les « déjeunettes », pour que les artistes, soignants et éducateurs par exemple se rencontrent et apprennent à se connaître. Nous avons aussi une newsletter mensuelle et une cartographie régionale des projets. Notre deuxième axe, c’est la formation et l’accompagnement. Nous sommes OF et nous avons actuellement 6 formations à notre catalogue, dont 2 formations phares autour de la conception et la conduite d’un projet de coopération. Les autres sont plus thématiques, comme la place du corps dans la relation d’aide, une formation qui est portée par une artiste chorégraphe danseuse et psychomotricienne. Nous sommes de plus en plus appelés pour proposer des prestations sur mesure, par exemple pour une structure comme un Ehpad qui souhaite écrire une politique culturelle dans son projet d'établissement. Notre troisième grand axe, c'est un laboratoire d'idées. Notre équipe, ou parfois des groupes de sociétaires, portent des projets de recherche et d'innovation sur la question des personnes isolées à domicile ou sur le respect des droits culturels des personnes par exemple. Dans ce cadre, il arrive qu’on réponde à des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets. C’est comme ça que nous avons imaginé le projet Soyons Cap, sur la place des artistes dans un parcours de remobilisation. Dans quel esprit travaillez-vous ? Nos projets s’inscrivent dans la ligne du respect des droits culturels de chacun. Nous sommes persuadés que les hôpitaux et les structures médico-sociales sont des espaces de la cité qui doivent être ouverts sur le monde. Et que chacun, qu’il soit en parcours de soin, en accompagnement, professionnel de santé ou artiste soit reconnu dans son individualité culturelle. Chacune de nos activités nourrit l'autre, c'est à dire que le laboratoire va venir soit développer quelque chose du côté de la formation, soit apporter de la ressource. Pourquoi avoir choisi de fonder une SCIC ? Nos trois partenaires publics ont décidé, il y a de ça plus de 10 ans, qu’il manquait une structure qui valorise les projets de coopération culture et santé, en formant autant les professionnels de santé que les professionnels de l'art et de la culture. C’est pour cela que la forme SCIC a été choisie, parce que c'est le format juridique le plus adapté afin de réunir autour de la même table des partenaires publics, des Epahd, des hôpitaux, des opérateurs culturels, des compagnies artistiques, etc. La relation entre les domaines de la culture et de la santé n’apparaît pas comme une évidence. Qu’en est-il ? Pendant mes 11 années en tant qu’infirmière, je n'avais jamais entendu parler de ces projets. Si on me parlait de culture à l'hôpital, je voyais des clowns, ou le joueur d'accordéon, qui passent une fois par mois dans les Ehpad. Mettre autour de la table tous ces gens, ça peut paraître étrange. Et expliquer ce qu’est notre SCIC c'est toujours complexe. On est sur deux cultures très différentes, ces deux milieux n’ont pas toujours les mêmes mots pour dire les choses. Pourtant, les mondes de la culture et de la santé peuvent se rencontrer à plein d'endroits, il y a des projets d'animation, d’éducation, et d'art thérapie et les projets de coopération. Ces projets de coopération culture et santé ont la particularité d’être co-construits entre une équipe artistique et une équipe de soins, parfois d'administration, d'une structure de santé. Mais ce n’est pas de l'art thérapie, qui est très spécifique. Comment abordez-vous les choses ? On ne marie personne, on ne va jamais dire à une structure de monter un projet avec untel ou untel. C’est eux qui vont décider. En revanche, on leur fait savoir que ce sont des projets qui bousculent tout le monde, donc les partenaires doivent entretenir une relation un peu solide au départ. On fait de la mise en relation entre artistes et structures de santé qui ont toutes des chargés d'actions culturelles. Notre rôle est de donner des conseils, proposer des contacts, créer les conditions de rencontre, par exemple avec les déjeunettes. Comment avez-vous élaboré Soyons Cap ? Nous avons d'abord fait partie pendant deux ans d'un projet européen porté par Croix rouge compétence Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelait « Change of view », dont l’idée était de créer des outils pour aider les professionnels à changer de regard sur les personnes qu’ils accompagnaient, avec tout un référentiel sur l’empowerment. Pour le dire très vite, nous avons monté une méthodologie « Clichés » autour du pouvoir d'agir. « Change of view » avait permis de développer une belle dynamique, de nombreux échanges, un vrai enrichissement pour chacun. On a voulu poursuivre sur cette lancée et nous avons écrit Soyons Cap avec Croix Rouge compétence Nouvelle-Aquitaine. Nous avons dû apprendre à connaître les réseaux de l'accompagnement, les Cap emploi, missions locales, Pôle emploi, les maisons départementales des solidarités et autres associations qui œuvrent dans ces accompagnements pour prendre le temps de leur présenter notre projet. Nous n’avions pas la prétention de ramener les gens à l'emploi en deux mois. Nos objectifs étaient de permette aux personnes de reprendre confiance en eux, de sortir de chez soi, de rentrer à nouveau en contact avec d’autres personnes, d’avoir la capacité de savoir un peu plus qui je suis, qui je ne suis pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. A quoi ressemble un parcours ? Après les informations collectives et les entretiens individuels, nous formons des groupes d’une dizaine de personnes. Initialement, nous avons mis en place trois parcours, à Bègles, Angoulême et Limoges. Plus récemment en Gironde, dans le Médoc, à la Réole et Saint-André de Cubzac, qui vient de se terminer. Aucun prérequis d’âge ou de territoire n’est demandé. Aucun prérequis artistique non plus, il n'est pas question d’en faire des artistes. On leur demande surtout de s'engager à suivre tout le parcours et à venir trois jours par semaine, ce qui n’est pas rien. Nous les accueillons toujours au même endroit, dans un lieu réconfortant, où ils vont rencontrer les artistes qui vont les aider à reprendre confiance, se recentrer sur qui ils sont pour mieux appréhender le monde de la formation et de l’emploi. Pour notre part, nous animons des journées en binôme avec Croix Rouge compétence, autour du pouvoir d’agir, sachant que nous sommes également garants du bon déroulement du parcours, de la sécurité, et du fait que tous les participants s’y sentent bien. Nous avons aussi des rencontres professionnelles, avec des réseaux locaux, des professionnels que l’on connait. C’est important pour les jeunes, ils s’imaginent souvent que pour aller vers un métier, il n’y a qu’un chemin, alors qu’en fait ils sont tous différents. Quel est le bilan que vous dressez ? Chacun a vécu cette expérience différemment. Chez une très grande partie des personnes, c'est venu bouger des choses. Certaines sont entrées en formation, d’autres se sont inscrites pour le permis de conduire, ou sont devenues bénévoles parce qu'elles avaient envie de garder cette dynamique de sortir de chez elles, etc. En deux mois, nous avons vu de vraies transformations, y compris physiques. Avez-vous rencontré des surprises ? Ce qui m’a souvent surpris, c’est la rapidité avec laquelle les participants se constituent en groupe. Nous commençons chaque parcours par une journée d’immersion pendant laquelle nous leur présentons les lieux, le planning, les horaires, on évoque des questions pratiques comme le covoiturage. On apprend à se connaître avec des jeux d’intelligence collective. On les revoit généralement une semaine après, et à chaque fois, je suis surprise de la dynamique qui s’est mise en place entre eux. Souvent ils ont monté un groupe WhatsApp, ils échangent des choses, ils s’accompagnent en voiture, etc. On sent ce besoin de rencontrer d’autres personnes, certes très différentes, mais qui vivent les mêmes difficultés. Les participants sont heureux de voir un des leurs réussir à chanter, chacun devient inspirant pour l’autre. La diversité d'âge et de parcours de vie apporte une vraie richesse, sur laquelle on s’appuie. Selon vous, que faudrait-il ajuster ? Nous n’avons pas tout fait parfaitement, mais à chaque session on s’est adapté. On a réduit la durée de 3 à 2 mois, on s’est vite rendu compte que c’était suffisant pour qu’ils lâchent prise, et que ça ne constitue pas un engagement trop long. On a multiplié les contacts avec les structures de l’insertion (ML, EMI, etc.) très en amont. Se montrer, expliquer notre action, c’est un point clé. Toujours présenter, montrer les réalisations des groupes, les témoignages d’anciens participants. Nous avons aussi abandonné notre idée initiale de leur faire créer chacun un CV revisité, qui parlerait d’eux différemment sous la forme d’un support multimédia, un jeu de plateau, une affiche… Nous avons arrêté parce que certaines personnes se retrouvaient avec une pression énorme, en stress total sur la finalisation de l’objet dont ils ne se serviraient pas forcément en entretien. Finalement, la formule qu’on a trouvée, différentes approches artistiques couplées à des journées autour du pouvoir d’agir, c’est la formule la plus intéressante. Nous avons voulu la modéliser, pour que si un opérateur culturel ou plusieurs acteurs d'un territoire de l'insertion culturelle veulent porter un parcours Soyons cap, ils soient en capacité de le faire de manière autonome. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
April 10, 2024 12:12 PM
|
Redonner le pouvoir d'oser
L’APEJ-APP Cognac Ouest Charente et Saintes propose, entre autres, des accompagnements à l’orientation, à la reprise d’activité des demandeurs d’emploi et à la reconversion professionnelle. Son projet « Inter’actions » s’adresse à un public souhaitant reprendre confiance en lui pour se projeter dans un avenir positif. Après une mise en place à Saintes en 2023, il doit débuter courant avril sur le territoire de Cognac. "Inter’actions" est financé par l'appel à projets régional "mobilisation vers la formation" et à venir par le FSE régional ainsi qu’un co-financement conseil départemental de la Charente. D’où vient l’idée d’Inter’actions ? Inter’actions vient de notre envie de changer notre manière traditionnelle d’accompagner les publics, sortir des standards, ne plus mener des actions cadrées, avec une date de début, une date de fin, le même programme pour tout le monde. Cette approche fonctionne de moins en moins, les publics en difficulté ont écumé nombre de dispositifs avec toujours le même process. Ils n’ont plus envie ou plus confiance. Même si on peut noter quelques bons résultats, les publics sont de plus en plus de réfractaires à ces accompagnements stéréotypés. Donc il fallait imaginer une autre approche. Quel était l’état de vos réflexions ? Depuis plusieurs mois déjà, nous rencontrons de moins en moins les usagers dans un bureau en face à face ou dans une salle où tout le monde fait la même chose. Depuis le dispositif individualisé de positionnement à l'emploi (DIPE), nous avions déjà réfléchi avec les acteurs locaux, à une approche plus contextualisée et autant que possible hors les murs pour se rapprocher du terrain. Les mises en situation des bénéficiaires permettent qu’ils deviennent acteurs de leur parcours. Lorsque l'appel à projet est sorti, forcément ça nous a parlé. Nous étions déjà dans une dynamique de déploiement et d’innovation avec les acteurs du territoire. Nous avions pleins d'idées pour développer des projets qui permettaient de travailler hors les murs, de permettre aux bénéficiaires de se remettre en action et de pouvoir leur faire conscientiser leurs capacités et compétences. Nous avons débuté sur Saintes, parce que nous étions déjà sur l'accompagnement des jeunes en rupture. Notre partenariat local fonctionnait bien, on s'est appuyé dessus pour rédiger notre dossier. Est-ce que vous aviez déterminé un public particulier ? À l’origine, nous voulions cibler tous les publics éloignés de l'emploi. Mais on avait une idée derrière la tête, essayer de capter des personnes non-inscrites, qui ne bénéficient plus d’aucun accompagnement. Un public tellement éloigné de l'emploi qu’il n’y pense même plus. Je crois que, pour l’essentiel, nous avons réussi à capter ces personnes. Nous avons aussi eu des publics de Pôle emploi mais plutôt ceux qui étaient au chômage depuis un grand nombre d’années. Quelle approche avez-vous choisie ? Nous avons repris les grands principes du DIPE et du Cléa, qui consistent à mettre les gens en situation professionnelle et reconnaître leurs compétences. Nous avons poussé plus loin ces constats pour travailler à faire reconnaitre aux personnes leurs capacités et compétences et avons permis, par l’obtention de badges, de valoriser ces atouts. Nous avons proposé cette démarche au service des projets et actions formation en intégrant de la pratique réflexive. Nous avons levé les cadres, les obligations et les calendriers figés (un rendez-vous par semaine) par les commandes des financeurs (trois mois d’accompagnement). Nous nous sommes appuyés sur le relais des ateliers partenariaux. Ainsi, nous levons toutes les barrières en redonnant aux usagers le pouvoir d’oser. Notre idée était de démontrer que nos repères ne sont pas leurs repères, que nos envies ne sont pas les leurs et que nos idées ne leur correspondent pas. Nous avons fait le pari de les écouter et de prendre en considération leur attentes et envies dans le respect de leurs capacités. Qu’entendez-vous par travailler autrement ? Travailler autrement, ça veut dire par exemple ne pas parler emploi, ne pas parler formation, ne pas parler d’obligations, parce qu'il y a des publics à qui cela fait peur. Ça veut dire essayer de capter des publics qui ne croient plus en rien et qui ne sont plus dans le système France Travail, mission locale ou autre. Nous avons un rôle à jouer pour leur permettre de retrouver confiance en eux, d’oser et de se reconnaitre des compétences. Nous avons enclenché une nouvelle dynamique pour leur permettre de se projeter dans un futur où ils auront une place. C’est la genèse de notre réflexion. D’un côté il y a plein d'entreprises qui cherchent du personnel, de l’autre des gens qui n'ont plus confiance et qui ne veulent plus y aller. On s'est dit qu’on allait leur faire confiance et construire avec eux leurs parcours en respectant le rythme et les besoins des uns et des autres. Comment s’est faite la mise en œuvre de votre action ? Nous avons effectué un travail de repérage avec les associations locales. Nous sommes allés sur leur terrain, rencontrer les usagers au jardin public ou à la collecte des Restos du cœur. Certains n’avaient pas envie de venir nous voir, mais petit à petit, nous avons pu, avec le concours des acteurs des associations, les convaincre de nous faire confiance. Notre approche sans obligation nous a permis de partir de leurs envies, de leurs centres d’intérêt, mais également, en écoutant leurs craintes et leurs inquiétudes, de les mobiliser pour nous rencontrer et pour participer à des projets et activités en interne, ou dans les ateliers de nos partenaires associatifs. Cet accompagnement hors les murs et sans contrainte, basé sur le volontariat a permis de leur redonner envie et de prendre conscience de toutes les compétences qu’ils pouvaient déployer dans leurs actions au quotidien, activités quotidiennes qu’ils n’identifient pas spontanément comme intéressantes comme cuisiner, s’occuper de leurs enfants, bricoler, aider leurs voisins. Par exemple, ils ont mis en place des petits ateliers comme la cuisine placard, ils ont pu fabriquer un nichoir, un cadre, … Ils sont progressivement devenus acteurs, ont repris confiance. Avec cette reprise de confiance, ils se sont organisés en petits groupes et ont émis le souhait de pouvoir aider les autres, être utiles. Cela consistait en quoi ? Ils ont alors réfléchi à un projet qui faisait sens pour l’ensemble des bénéficiaires du groupe. Ils ont choisi de s’occuper de la collecte des jouets pour Noël. Ils ont alors contacté les structures et les partenaires locaux, ils sont allés à leur rencontre pour collecter des jouets puis les nettoyer, les trier. Sans s'en rendre compte, ils ont monté une vraie entreprise. Ils ont fait un véritable travail, dans lequel ils se sont totalement investis. Par la pratique réflexive, ils ont pris conscience qu’ils avaient développé des compétences transposables dans la vie professionnelle. Ils ont compris qu’ils avaient déployé des capacités et que celles-ci pouvaient être transférées vers des activités professionnelles, avec pour certains des besoins de formations complémentaires. C’est alors que tous se sont projetés dans un avenir professionnel, alors que certains cumulaient dix ans d'inactivité. À quel moment une personne est-elle prête à passer à une étape suivante ? C’est au moment où la personne prend conscience qu’elle a des compétences, qu'elle a la capacité d’aller plus loin et qu’elle retrouve du sens à agir, qu’elle se projette dans un emploi ou une formation. Nous avons accompagné ces temps collectifs par des temps individuels permettant de lever les freins pour lui permettre de sauter le pas vers un emploi ou une formation. Une fois que la personne a retrouvé sa place dans la société, elle est en capacité de réaliser ses démarches et retrouver de l’autonomie. Les résultats parlent, entre les retours en formation continue, les entrées en SIAE et dispositifs de droits communs comme Amorce de parcours, et la validation de la certification CLEA et de badges numériques, les bénéficiaires ont retrouvé l’envie d’aller de l’avant. En complément de nos actions, nous avons également visité l’AFPA et des CFA, demandé l’intervention de l’Espace Régional d'Information de Proximité (ERIP) et de professionnels pour ouvrir les horizons. Tout cela est facile quand les personnes sont prêtes. En même temps, nous faisons attention à ce qu’elles ne se sentent pas tellement bien chez nous, qu’elles seraient tentées de s’installer. Notre volonté est toujours que nous soyons juste un tremplin au service de leur avenir. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
March 28, 2024 5:10 AM
|
Le Rocher de Palmer est une salle de spectacle située à Cenon. Elle est labellisée Scène de Musiques Actuelles (SMAC) et développe des actions sur la métropole Bordelaise. Parmi elles, le projet OPUS, financé par l’appel à projets régional « Mobilisation vers la formation » et soutenu par le Fonds Social Européen. François Friquet, responsable des dispositifs d’accompagnement, est chargé de son suivi En quoi consiste Opus ? C’est d’abord le prolongement d’un dispositif existant. Voilà 10 ans que nous développons une action qui s'appelle « le forum du rocher », deux sessions par an de formations gratuites de 2 mois, avec des intervenants professionnels, sur la découverte des outils numériques, la photo, la vidéo, le graphisme, le web. Pour nous c’est un prétexte pour remettre des personnes sur des rails, leur montrer qu’autour des métiers artistiques, il y en a plein d’autres qui gravitent. Le forum s’adresse à des jeunes ou moins jeunes, prioritairement des habitants des quartiers prioritaires de la ville puisque le rocher de Palmer est situé dans un QPV. Notre idée était de revenir aux fondamentaux, de partir des choses que nous savons faire, c’est-à-dire utiliser la musique, plus particulièrement le hip hop, comme outil de médiation et de rencontre de personnes qu'on ne croise pas par d'autres biais. C’est comme ça que le projet Opus est né. En parallèle de la formation, nous avons un espace de coworking ouvert aux habitants du quartier qui peuvent venir y travailler, quel que soit leur projet. Pas forcément développer une activité artistique ou culturelle, mais chercher un emploi, discuter avec d’autres gens, bénéficier gratuitement de formations courtes qu'on leur propose. Dans quels termes le présentez-vous ? Le pitch d'Opus, que nous avons voulu rendre le plus clair possible, c'est « identifier et mobiliser des jeunes par la culture hip-hop et les outils de communication numérique, dans le but de les accompagner vers l'emploi la formation et leurs projets professionnels. » Il se découpe en 5 étapes : identification, mobilisation, orientation, formation et accompagnement. Comment avez-vous pensé l’action ? C’est surtout une action de remobilisation. Avant même la mobilisation, il y a une étape de rencontre avec les publics. Nous avons pris le parti de travailler dès le démarrage avec un artiste reconnu qui s'appelle DJ Vex. On l'implique dans toutes les dimensions du projet, le repérage, la formation, le volet insertion. Il est un peu notre porte d'entrée. Concrètement, en pied d'immeuble, c’est lui qui crée la connexion avec les jeunes, c'est vraiment un point important. On ne tient pas de discours particulier. On se présente aux jeunes, on prend contact, on les invite à venir au Rocher, on crée un lien de confiance. Dans un premier temps, on est surtout dans l'écoute. La formation, c’est l’étape d’après. L’idée n'est pas de dire aux jeunes que l’on croise qu’ils seront tous des futurs artistes. Pour nous, c'est un prétexte pour leur montrer qu’il y a plein de métiers autour du secteur culturel et artistique et pour tirer des fils, voir quelles sont leurs autres compétences, leurs autres envies. Quel est le déroulement de la formation ? Depuis maintenant deux ans, nous proposons deux sessions annuelles. Leur durée est de deux mois, à raison de cinq jours par semaine de 35 heures. Pour nous, c’est un travail constant de leur faire respecter des horaires, leur apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole et donner leur avis en public. On leur parle aussi de l'intérêt de s'inscrire à la mission locale et à France Travail, même s’ils ne cherchent pas de boulot. En fonction de leur situation, on leur dit qu’ils peuvent faire une formation, un service civique ou un stage. On veut leur montrer le champ des possibles, qu'ils ne connaissent pas forcément. Les jeunes sortent avec un certificat de compétences, Ils ont un carnet pédagogique qui cible bien les objectifs de chaque module. Vous n’êtes pas un acteur « naturel » de l’insertion, comment avez-vous procédé ? Au démarrage il y a 10 ans, ce n’était pas évident de se connecter avec les missions locales, Pôle emploi, qui ne nous repéraient pas forcément comme un lieu ressource ou un opérateur de formation et d’accompagnement. Au bout de 4 ou 5 ans, grâce à ces prescripteurs, on touchait effectivement des personnes en décrochage issues des quartiers. Mais on n’accrochait pas celles qui ne sont pas, ou plus, dans les missions locales, voire ne sont plus dans les centres sociaux non plus, parce que ça ne colle pas pour plein de raisons. Quel est le rôle de vos partenaires ? Ils nous aident dans la phase d’identification, qui peut être très chronophage. Notre but ce n’est pas de faire à leur place le travail des structures de proximité, les associations, le centre social, qui sont actifs dans les quartiers. On est plutôt co-organisateur. Une des autres clés, c'est le temps long. Les choses mettent du temps à se faire. De plus, il nous faut essayer d'éviter, dans la mesure du possible, de faire du quantitatif et d'être dans un temps plus individuel. On ne peut pas accompagner 40 personnes à la fois, c'est impossible. Cependant, on peut en accompagner 40 ou 50 sur l'année si on prend le temps et qu'on s’adapte au rythme de chacun. Selon vous, que faudrait-il améliorer dans le rapport avec ces publics ? Avec dix années d'expérience, on commence à être un peu plus aguerris sur ces questions d'accompagnement. Aujourd’hui, on est acteur culturel, mais aussi un acteur social et un acteur de l'insertion. Pour nous, le levier c’est de faire évoluer les compétences transverses. L’approche culturelle et artistique a toute sa place pour apporter des solutions. Notre approche, c’est de se dire comment, depuis notre place, nous pouvons contribuer à ce que des personnes soient accompagnées, aient suffisamment confiance en elles pour valoriser et développer leurs compétences. Je crois que c'est ça qui est le plus important dans notre projet, peu importe que l’on passe par la musique, le théâtre, l’insertion ou la formation. * * * * * Le projet Opus a essaimé à d’autres lieux en Nouvelle-Aquitaine, le caféMusic' à Mont-de-Marsan et l’Ampli à Billère, près de Pau. Le plus récent est la Sirène, L’Espace Musiques Actuelles de l’Agglomération de La Rochelle dont Sandrine Brenans est la médiatrice culturelle. A la Sirène, nous avons officiellement démarré le projet opus le 1er décembre 2023, sur les 3 QPV et les zones rurales à revitaliser de l’agglomération rochelaise. Avec la même approche que celle du Rocher de Palmer, c’est-à-dire un repérage en pied d'immeuble, une phase d'identification, de mobilisation etc. L’année dernière, le plus gros travail a été de tisser un réseau. Le jour du lancement, une cinquantaine de partenaires étaient présents, des acteurs publics, culturels, sociaux. C’était l’occasion de leur dire que sans eux, nous étions incapables de monter ce projet. Je pense que ce discours leur a plu, ça se fait en belle énergie, en toute confiance, chacun restant dans son rôle. On s’est rendu compte que les acteurs locaux sont vraiment dans l'attente qu'on propose des actions, qu'on les soutienne sur le montage de projets. Sur les QPV, certains nous soutiennent et ont envie de faire des choses, peut être en essayant de croiser les 3 quartiers. Avec les jeunes, nous essayons de comprendre où ils en sont, quelles sont leurs compétences, pourquoi ça a bloqué dans leur vie, dans leur parcours scolaire, dans leur vie professionnelle, puisque certains ont déjà eu quelques expériences. La question c'est vraiment comment peut-on les aider, avec de la formation ou un accompagnement ? Ceux qui veulent s'orienter dans la musique, on peut leur faire rencontrer des gens. L’idée c'est qu'ils puissent continuer à nous contacter, de disposer ici d’un lieu où ils peuvent trouver des ressources. La volonté de la direction était aussi d'accueillir des « open mics » (ou scènes ouvertes) à la Sirène pour que les jeunes prennent l'habitude de rencontrer le lieu. Puis d’en organiser dans les quartiers. On en a organisé un avec le soutien du Rocher de Palmer et de DJ Vex, qui nous font profiter de leurs retours d'expérience. Nous avons aussi des ateliers d’une semaine où une dizaine de jeunes travaillent sur un clip, de la vidéo, du traitement photo, un site web, etc. Ils rencontrent tous les midis une personne de l’organisme de formation Insup qui vient parler avec eux d'insertion et de formation. Ensuite, des stagiaires de l'équipe partent en formation numérique au rocher de Palmer pendant deux mois. Notre projet à terme, c’est d’avoir notre propre cycle, peut-être en 2025. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
March 14, 2024 5:21 AM
|
De l'insertion dans les métiers des services à la personne
Form’Aqui est un centre de formation basé à Bruges depuis 2017, dont Julien Castang est le directeur. Il intervient dans le champ des métiers des services à la personne. Il a été financé par le Fonds Régional d’Innovation dans la Formation (FRIF) pour son projet baptisé « valoriser et pérenniser les actions pour l'emploi dans le service à la personne par le maintien de la dynamique partenariale ». D’où vient votre projet ? Depuis plusieurs années, nous faisons partie d’un groupe de travail sur les métiers des services à la personne et de l'aide à domicile, notamment composé des prescripteurs et de quelques employeurs, sur un territoire qui inclut les communes du nord de Bordeaux jusqu'à Mérignac. Dans ce cadre, nous avons été sollicités pour monter des chantiers formation insertion (CFI), qu’on a baptisé « trouver sa voie dans un métier local et solidaire », pour les publics éloignés de ces emplois et/ou bénéficiaires du RSA. Les deux premiers ont été concluants, et pour le 3e, nous avions un objectif un peu plus ambitieux, faire pareil en moins de temps. Nous voulions aussi intégrer beaucoup plus de numérique. Il fallait qu'on change un peu les habitudes, que l’on prépare un nouveau planning, un nouveau déroulé, en impliquant les prescripteurs en amont et les employeurs pendant, et après, l'action de formation. C’est à ce moment-là que la Région Nouvelle-Aquitaine nous a parlé du FRIF. Vos actions concernaient des métiers en particulier ? Les chantiers portaient sur le titre professionnel d'assistant de vie aux familles (ADVF), avec un programme adapté à un public très éloigné de l'emploi, confronté à des freins périphériques. C’était un ADVF classique avec une très forte proximité et un accompagnement socioprofessionnel en tripartite, avec le référent et le financeur. Ce qui avait plu à notre groupe de travail c'est que mon équipe issue du terrain est en CDI, donc stable. Ce qui fait qu’un stagiaire a le même responsable, le même référent, le même accompagnant du début à la fin. Pour nous, en termes de gestion et de communication c’est aussi bien plus facile d’être dans une équipe stable. Sur la 3e action, on est parti sur un temps plus court, 470 heures au lieu de 760. L'idée c'était de diminuer la partie technique pour y rajouter beaucoup de mobilité, de théâtre, toutes ces actions qui permettent de reprendre confiance en soi. Puisque les stagiaires ne faisaient pas l’ensemble du titre, les employeurs étaient inquiets de leur niveau de compétence sur le terrain. De leur côté, les prescripteurs ne comprenaient pas s’il s’agissait d’une action de remobilisation, ou de pré qualification. On a eu besoin de recréer une dynamique, de leur présenter le projet et de les convaincre. C’est ce que le FRIF a permis. Vous avez fixé des prérequis pour les stagiaires ? Pas de prérequis sauf un casier vierge, la capacité de travailler, etc. Il faut juste que la personne ait envie. On lui présente les modalités, et si elle accepte, on lui fait confiance. Ensuite c'est à elle de montrer qu’on ne s’est pas trompé. Si elle ne maîtrise pas le français à l'écrit ou à l'oral, je la fais évaluer par mon collègue du FLE qui me signale ce dont elle aurait besoin. Ce n’est pas au public d’avoir la capacité de faire une formation, c'est à l’organisme de lui rendre accessible. La seule chose que le public doit faire, c'est de suivre la formation et passer l'examen. Pour le reste c'est à nous de lui faciliter la vie, de le préparer à réussir l’entrée en emploi. Le titre pro est facile à travailler, il est bien cloisonné, on peut décider de ne viser qu’un CCP, ou la moitié d'un. Donc on est sur ce besoin qui va au-delà du titre. L'idée c'est de mobiliser le public par des actions de remobilisation. Et là, ça fonctionne. Comment avez-vous commencé l’action ? On a débuté en janvier 2023 avec 6 stagiaires, l’objectif étant d’en accueillir 15 en tout. Nous avons découpé le contenu en modules, avec des fils rouges qui peuvent être, par exemple, le théâtre ou une action spécifique sur la mobilité. Sur ce titre pro, j’ai 7 entrées possibles. C’était un pari financier en ce sens qu’il ne faut pas craindre de mobiliser beaucoup au début, les formateurs, les salles, même quand on n’a pas le compte de stagiaires. Qu’il y en ait 5 ou 15, c’est finalement presque le même coût. Même s’ils ne sont que 5 au début, ils ont droit à leur entrée et à la même qualité que s’ils sont 15. Nous sommes en entrées sorties permanentes, un formateur supplémentaire assure la rentrée pendant que les autres sont en cours. Puis on crée le lien entre les nouveaux et les anciens, en utilisant le théâtre par exemple. Les sorties c'est pareil, il suffit juste d'accompagner et de suivre sachant que nous visons soit l'emploi, soit la poursuite de parcours. Quelle organisation avez-vous choisie pour ce public ? C’est la partie la plus facile. On s’adapte. S’ils ne peuvent pas être là à 09h00, on commence à 09h30. S’ils doivent aller chercher leurs enfants à l’école à 16h30, on termine à 16h00. Nous ne faisons pas cours le mercredi. Sur les CFI on faisait 09h30-16h30 par exemple. En plus la journée commence avec un petit déjeuner, un moment sympathique. Le plus difficile c'est vraiment l'employeur derrière, parce que lui va avoir besoin de les faire travailler en soirée, avant 9 h, le week-end, etc. La vraie plus-value de nos actions de formation sur ces publics n'est pas de les faire venir, ça on sait faire. C'est vraiment de les accompagner à l'emploi. Pendant le temps de formation, on travaille avec la personne pour qu'elle puisse s'organiser, parce que se libérer du temps est souvent une question d'organisation. Comment abordez-vous la question des freins périphériques ? Pour la mobilité, nous avons créé notre auto-école sociale et solidaire « Mobincub », en partie financée par nos actions de formation, avec 2 moniteurs sensibilisés au public demandeur d’emploi, FLE, etc. Nous avons des taux de réussite excellents. Le stagiaire ne paye parfois rien du tout car Mobincub possède la certification Qualiopi, donc il peut utiliser son CPF quand il en a. Il y a aussi le problème de la garde d'enfant, pour lequel nous sommes en train de mettre en place une solution avec un de nos partenaires. Le centre participera financièrement pour permettre aux stagiaires de venir en formation ou d’aller travailler. Autre frein, celui des repas. Depuis 4 ans maintenant nous offrons le petit déjeuner, et on constate que certains n’ont pas de quoi déjeuner. Nous sommes trop petits pour avoir une cantine, donc nous venons de créer une autre entreprise, de livraison de plats. Ainsi nous pouvons proposer des repas sains et équilibrés à 12€, avec 3€ à la charge du stagiaire. Enfin, nous avons une accompagnatrice socioprofessionnelle à temps plein à Form’aqui permettant de suivre les personnes, en lien avec les prescripteurs, dont le besoin est identifié en amont ou durant la formation. C’est un vrai plus, Delphine Kra est notre ASP dédiée à cette mission. Quel est le rôle des employeurs ? Tous les employeurs avec qui nous travaillons ont signé une charte avec Form’Aqui, dans laquelle ils s’engagent à accueillir des personnes même s’ils ne peuvent peut-être pas travailler le weekend ou le soir. Pour que ça marche, il faut les accompagner et les former. Mais aussi leur ouvrir le centre et leur donner la possibilité d’utiliser l’outil RH que nous sommes finalement. Chaque semaine, j'ai 2 ou 3 employeurs qui viennent ici parce qu’ils ont besoin de rencontrer le groupe. Il faut recréer ce lien là avec le public, avec leur manager… Nous, les employeurs et moi-même, regrettons qu’ailleurs la plupart du temps sur ces actions là les employeurs ne soient pas suffisamment associés. C’est quand même eux qui signent le contrat de travail à la fin. Notre réseau compte un peu plus de 110 structures employeurs. C’est ce qui fait notre force, nous sommes connectés à l'emploi, je ne pense pas qu'on puisse avoir faux. Vous leur demandez de s’engager sur quoi ? Nous attendons d’eux qu’ils s’engagent pour de bon, pas de faire des promesses. Les formatrices et formateurs sont préparés à diagnostiquer le bon employeur pour le bon stagiaire, et à créer entre eux un lien de confiance dès la formation. C’est par exemple important qu’il y ait un véritable tutorat. Je leur demande aussi qu’ils s'engagent à rencontrer le groupe pendant les cours, parce qu'en fait nous constatons que les stagiaires ont une représentation un peu déformée, idéalisée, des employeurs. C’est important de pouvoir démystifier ça, par la présence, par l'accompagnement. Parce qu’au bout, il y a tout de même un être humain qui s’engage dans une nouvelle aventure, ce n’est pas anodin. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
February 29, 2024 8:46 AM
|
Entreposage en mode virtuel
Quelle est l’innovation que vous avez expérimentée en Nouvelle-Aquitaine ? Le projet a démarré initialement fin 2021, et son développement a pris environ 2 ans avec des équipes d'ingénierie pédagogique et des experts-métiers. Nous en sommes à la 3e phase, celle du déploiement national. En Nouvelle-Aquitaine, l’idée était d’expérimenter progressivement avec nos apprentis la création d’un environnement logistique en réalité virtuelle sur les 14 sites AFTRAL de la Région. Ce nouvel outil se destine aux formations logistiques accessibles en apprentissage mais nous avons la volonté de le déployer aussi pour nos publics en formation continue, notamment inscrits sur les parcours PRF et/ou HSP. Ce projet s’inscrit dans le champ de la transformation et de l'hybridation des formations. Nous disposons déjà de simulateurs pour les métiers de la conduite (voir article…). Nous voulions ouvrir le champ de l’innovation pédagogique à destination de nos apprenants en logistique, en intégrant de la réalité virtuelle sur des modules travaillés à partir des référentiels des titres professionnels. Nos équipes ont ainsi répertorié l'ensemble des champs de compétences transversaux et plus particulièrement ceux concernant la sécurité. En quoi consiste l’outil ? Le dispositif de réalité virtuelle développé permet à plusieurs personnes, chacune avec un casque, d’interagir dans une halle logistique modélisée à partir d’un site d'une entreprise du territoire. Généralement, dans nos centres AFTRAL, ces espaces font 500 à 1000 m². Ici, nous pouvons avoir 7 à 8 000 m² de terrain de jeu, nous sommes immergés totalement dans une entreprise logistique que l’on peut visualiser. Les métiers de la logistique sont associés à environnements très contraints, par la sécurité, le matériel, parfois pour des raisons de place tout simplement. Donc il nous faut trouver des solutions et l’expérience virtuelle en fait partie. En plus cela désengorge les plateaux techniques dans nos centres. C’est vraiment un outil pédagogique utilisé en présentiel qui vient compléter les outils de nos équipes de formateurs. Nous avons besoin d’être à proximité des apprentis pour ancrer les savoirs et travailler les situations qu'ils n’ont pas encore rencontrées en entreprise. Par exemple, un apprenant en bac pro logistique qui n'est pas encore allé en entreprise, cela lui permet de vraiment s'immerger dans un hall logistique avant de se confronter à la réalité. Quels sont les métiers concernés ? Le préparateur de commande, l'agent magasinier, le cariste, pour les niveaux infra bac, et le bac pro logistique. Nous sommes vraiment partis de l'identification des compétences de ces formations et nous sommes allés chercher la prise en compte de la sécurité pour l'utilisation des chariots, comment on prépare et emballe des commandes, le stockage et le déstockage, le réapprovisionnement et l’inventaire. C’est un outil techniquement accessible, et il nous permet d’aborder les premiers niveaux de compétences des référentiels concernés. Comment sont abordées les compétences ? A partir de ces compétences, l'équipe d'ingénierie a identifié dix scénarios, qui incluent la découverte de l’entreprise, les différentes opérations et les flux logistiques. Les scénarios sont déployés au fur et à mesure du parcours pour chaque typologie de compétence. Nous sommes vraiment dans un serious game, qui utilise tous les codes du gaming. Les utilisateurs se testent, se chronomètrent, s'orientent dans les espaces. Nous insistons beaucoup sur l’aspect sécurité, sur le contrôle et l’utilisation d’un chariot élévateur, les indicateurs de sécurité. Nous pouvons aussi intégrer des anomalies comme un marquage qui n'a pas été fait. L’utilisateur ne peut pas rentrer dans la halle virtuelle sans avoir mis ses équipements de sécurité, c’est vraiment une simulation. L’outil apporte quoi de nouveau ? La nouveauté sur cet outil, c'est que nous voulions aller chercher la coactivité. Aujourd’hui, sur un plateau technique logistique AFTRAL, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas faire évoluer en même temps des chauffeurs, des préparateurs de commandes, des agents magasiniers et des caristes. Le dispositif permet de les faire travailler ensemble, leur montrer les répercussions que peut avoir une action sur celles des autres dans l'environnement professionnel. Avec les scénarios, les formateurs ont la possibilité de déclencher des aléas, des incidents, qu’il faut résoudre à 2 ou 3 dans le même espace virtuel. Combien d’heures les apprenants passent-ils sur le simulateur ? En fonction des organisations, c’est de l’ordre de 4 à 5 heures sur l'ensemble d’un parcours, ce qui représente environ 30 minutes par séance. L’utilisateur vit une situation avec le casque, puis va débriefer avec le formateur et le groupe. Nous l'utilisons vraiment en complément du reste de la formation. C’est un outil qui permet de prendre le temps, de revenir sur des situations professionnelles particulières, de vérifier l’acquisition des compétences, de les approfondir, ce qui n’est pas toujours possible directement sur les plateaux techniques. Mettre ses équipements de protection individuelle, se diriger dans la halle, organiser sa tournée avec son chariot. Tout cela, ce sont des gestes professionnels qui prennent du temps. Et qui prennent du temps aussi dans la réalité. Quelle est selon vous la juste place de la simulation dans un processus d’apprentissage ? Pour nous, l'immersif n'est pas un gadget. Nous vérifions à chaque fois qu’il apporte un plus à nos apprenants, quels qu'ils soient. Cela doit les aider à ancrer les savoirs parce qu’ils vont pouvoir répéter les exercices. Aujourd’hui, nous n’apprenons plus de la même manière. Les personnes qui viennent dans nos centres, ont besoin de se tester, elles ont besoin d'acquérir des gestes métiers en situation, ce que nous pouvons faire sur nos plateaux techniques de mise en situation. En plus du savoir livré par le formateur, ils viennent chercher de la pratique. Mais pour les raisons évoquées précédemment, contraintes d’espace ou de sécurité, nos plateaux ne sont pas disponibles en permanence. Grâce à la halle logistique virtuelle, les apprenants vont pouvoir mettre encore plus en pratique. Cet outil en réalité virtuelle, vient compléter nos pratiques pédagogiques et devient indispensable pour nos apprenants, à la fois pour accompagner leur montée en compétence, et augmenter leur engagement en formation. Cela fait partie des méthodes que nous essayons de déployer au maximum. Quels sont les effets sur les apprenants ? Nous avons constaté que les apprenants sont plus motivés parce qu’ils vivent une expérience avec des interactions différentes pendant leur formation. Ils partagent leurs idées, l'organisation de la session, etc. Avec ce dispositif, nous pouvons plus facilement adapter et individualiser les parcours. Un jeune qui rencontre des difficultés dans la spatialisation va pouvoir répéter un scénario. Nous pouvons aussi travailler sur les soft skills comme la gestion du temps avec les flux logistiques, la résolution de problèmes comme les retards, des produits manquants, la prise de décision immédiate, la gestion du stress… Qu’en pensent les formateurs ? Je pense qu'il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer au niveau de l'approche pédagogique. Même si à AFTRAL, nous sommes plutôt reconnus sur la partie immersive, il y a toujours une phase d’appropriation à mener avec nos équipes pédagogiques. Certains formateurs étaient réticents au départ, notamment sur la performance de l'outil ou sa prise en main technique. Aujourd'hui, ils l’utilisent au quotidien en complément de leurs supports de cours « classiques », dans chacun de nos sites en Nouvelle-Aquitaine. Et ils en sont vraiment très satisfaits. Pour le moment, je pense qu'il y a encore des disparités de pratique. C'est aujourd'hui le rôle des équipes d'ingénierie de guider les formateurs dans la prise en main de ces outils. C’était important qu’Evol’Job, un cabinet bordelais de conception d’ingénierie pédagogique, accompagne les équipes et leur explique comment elles peuvent intégrer de l’immersif dans leur formation. La pédagogie immersive devient incontournable pour AFTRAL, c'est vraiment une transformation dans la construction de nos parcours pédagogiques. Cela nous donne la possibilité d’intégrer des méthodes qui permettent d'engager autrement les jeunes, de les motiver différemment et puis, au-delà, d’améliorer leur projection dans un environnement professionnel en perpétuel évolution. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
February 15, 2024 8:14 AM
|
A l'écoute des situations d'illettrisme
Le centre social « Lo Solan » de Mourenx propose depuis des années des modules de formation de base à destination des publics Français Langue Etrangère (FLE) ou en situation d’illettrisme. Après s’être doté d’un « bus numérique » pour porter son offre de services sur l’ensemble de son territoire (voir notre article https://sco.lt/7eJR1U), « Lo Solan » a mis en place l’action « Tendre l’O.RE.ILLE », financée par l'appel à projets régional « innover contre l'illettrisme ». En quoi consiste « Tendre l’O.RE.ILLE »? Avec « Tendre l’O.RE.ILLE », notre but était surtout de capter et de mieux accompagner les publics en situation d'illettrisme, souvent invisibles, de les rendre plus autonomes. Il fait suite à un premier projet «#inclusion numérique mobilisation et programme Lo Solan» de 2021, avec notre bus numérique qui existe toujours. À l’époque nous avions pu compter sur l'implication et la forte mobilisation de nos partenaires, auxquels nous avions notamment proposé des journées de sensibilisation au repérage des personnes en situation d’illettrisme. Quel bilan avez-vous tiré de votre première action ? Lors du premier appel à projets, en tant qu’organisme de formation, nous avons accueilli des personnes sur le parcours 1 de l’HSP (Habilitation de Service Public) sur l’illettrisme et l’illectronisme. Et on s'est rendu compte que certains partenaires pouvaient faire des amalgames entre le FLE et l’illettrisme et par conséquent avaient besoin d’être formés pour mieux repérer les publics en situation d’illettrisme. Nous avions une dizaine de personnes sur l'année, ce qui était très peu alors qu’on se doute bien que sur notre territoire, il y a de nombreuses personnes en situation d’illettrisme qui passent au travers des mailles du filet. Qui sont vos partenaires ? Le centre social de la Pépinière à Pau a répondu aux mêmes appels à projet. Nous avons mis en évidence des actions communes, notamment autour de la formation des acteurs, puisqu'on a proposé des formations similaires auprès des professionnels, des partenaires, conseillers en insertion professionnelle, sous forme d’actions de sensibilisation et des échanges de pratiques. Cela nous a permis d'intervenir sur un territoire élargi et de façon concertée entre les deux territoires. On a également mis en place des séances destinées aux bénévoles, parce qu'il y en a beaucoup qui interviennent auprès des publics en proposant de l'accompagnement individualisé. « Tendre l’O.RE.ILLE » est un projet de formation ou un projet d'accompagnement ? C’est surtout un projet d'animation du réseau auprès de tous les acteurs, de formation et de sensibilisation des partenaires, ainsi que de repérage et d’accompagnement des publics en situation d’illettrisme. Le but est de maintenir une dynamique partenariale et une animation de réseau pour que la thématique de l’illettrisme reste toujours attrayante. C'est pour ça que, pour ce projet, nous avons voulu partir de la base constituée avec les acteurs socioprofessionnels, Pôle emploi, le PLIE, la mission locale, le Département des Pyrénées-Atlantiques avec le SDSEI « Pays des Gaves », les acteurs du monde associatif et du social, tout le réseau France services, les conseillers numériques avec la Fibre 64, ainsi que la fédération départementale des centres sociaux. Bien entendu, il y a également un accompagnement individuel de réapprentissage qui se réalise avec des bénévoles, le repérage des publics et la mise en place d'actions innovantes en matière de formation (accès aux droits, renforcement des compétences professionnelles en lien avec le numérique…). Quel type de parcours suit une personne avec « Tendre l’O.RE.ILLE » ? Les actions de formation première marche nécessite de travailler en amont avec les structures partenaires et les publics repérés. Concernant la personne, on la prévient, on travaille avec elle sur le fait qu’elle peut être accompagnée. Pour cela, nous avons mis en place un groupe de bénévoles qui a été formé et sensibilisé à l'illettrisme, en partenariat avec le Centre Ressources Illettrisme Analphabétisme Nouvelle-Aquitaine (CRIA-NA). C’est le CRIA-NA qui a assuré cette sensibilisation en lien avec nous, qui dispense la formation et opère les échanges de pratiques avec les partenaires. Ainsi les personnes sont accueillies et accompagnées en individuel ; tout leur parcours s’établit au contact des bénévoles qui apportent une écoute différente et proche des situations vécues. Donc, dès le départ, on met en place ce principe, on voit comment ça fonctionne et ça évolue vraiment avec la personne et son accompagnateur. Et finalement on leur propose d’entrer dans un groupe, mais pour cela, il faut nécessairement du temps. Quel rôle jouent exactement ces bénévoles ? La particularité des personnes en situation d’illettrisme, c'est qu'elles ont quasi toutes été en situation d'échec scolaire et ont eu un rapport douloureux avec l’école. Repartir dans un dispositif classique, avec un tableau où suivre des cours est souvent impossible pour elles. Donc on leur propose de commencer par rencontrer un(e) bénévole avec qui elles peuvent parler des sujets qui les intéressent. Le fait d’installer une relation de confiance permet d’engager un travail avec elles. C’est un préalable nécessaire. Progressivement, il y a un lien affectif qui se crée. On fait plusieurs mois d’accompagnement en individuel, et on peut leur proposer ensuite, pour les valoriser, de les associer à une autre personne pour lui expliquer comment elles ont démarré, leur donner des astuces, etc. Sur l’aspect repérage avez-vous mis en place des actions particulières ? Les personnes en situation d'illettrisme, c'est un public particulier qui a été scolarisé en France jusqu'à l'âge de 16 ans. Il n’est pas évident pour des professionnels, qui ne sont pas formés à l'illettrisme, de se dire qu'une personne qui a été scolarisée, qui peut même avoir un CAP BEP, qui a souvent son permis de conduire, a des difficultés avec la lecture et l'écriture. Surtout que les personnes en situation d'illettrisme développent beaucoup d'autres compétences à côté et savent masquer leurs difficultés. Donc l'idée c'est de les aborder par des biais indirects, des thèmes comme la santé, l'accès aux droits, des voies de contournement pour essayer de recréer une relation. La culture numérique est un très bon support, c'est moins compliqué de dire qu’on a du mal à se servir de l’informatique que d’avouer qu’on ne sait pas lire. Donc on se sert beaucoup du numérique pour repérer et accompagner les publics. On sait aussi qu’il y a un travail à effectuer pour optimiser des passerelles entre nos structures, SIAE, organismes de formation, centres sociaux. Nous pouvons nous appuyer sur les outils du CRIA et nous construisons aussi des outils spécifiques. Par exemple, nos collègues conseillers France services disposent de petits indicateurs autour des pièces administratives qui leur permettent de détecter les situations d’illettrisme dans les différents publics qu’elles accueillent au quotidien. Que considérez-vous comme une sortie positive ? À partir du moment où l’on a répondu à la demande d’une personne, à son projet de départ, par exemple d'arriver à être plus à l'aise avec l'écriture, d'arriver à lire le journal, de trouver un emploi, c’est pour nous très positif… Sur l’HSP socle de compétences, nous avons des objectifs et il faut un nombre minimum de stagiaires pour engager des sessions. Mais sur le projet illettrisme, ça ne fonctionne pas comme ça, même si nous devons renseigner des données quantitatives et qualitatives. Pour donner un ordre d'idée, la première année où nous avons répondu sur le parcours 1, on a reçu 7 personnes sur l’année. 3 ans après, et le déploiement de « Tendre l’O.RE.ILLE », nous en sommes à 24 personnes, dont 18 qui sur l’HSP et 4 qui sont suivies par des bénévoles. Pour avoir ces résultats, c'est un travail de longue haleine. Selon vous, que faudrait-il améliorer ? Nous pensons qu’aujourd’hui, les professionnels font bien mieux la différence entre une personne en situation d'illettrisme et une personne FLE même si certains partenaires sont encore dans la confusion des publics. Les prescripteurs orientent mieux, connaissent mieux les caractéristiques de ce public, son isolement, et la honte que certaines personnes ressentent par rapport à leur situation, ainsi que leurs stratégies de contournement. Cela dit, il est important de poursuivre la formation des acteurs et des bénévoles, ça reste un travail qui s’établit sur du long terme. Si l’on veut continuer à agir de façon efficace pour ce public, il faut poursuivre notre effort de sensibilisation et de formation des acteurs. Et puis trouver les moyens de répercuter cette dynamique sur les zones blanches du département. Dans nos perspectives de travail, il y a également le développement de notre réseau. La lutte contre l’illettrisme ne peut pas rester le souci de spécialistes, cela doit être l'affaire de tous. L’offre de dispositifs et de formations adaptés est conséquente et nécessaire, mais ce que l'on constate sur l'ensemble des territoires, c’est que toutes les personnes concernées ne s'en saisissent pas forcément. L’enjeu reste la mise en adéquation entre l'offre et les besoins. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
February 1, 2024 7:28 AM
|
La prévention spécialisée au service de l'insertion professionnelle
L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Vienne (ADSEA 86) intervient dans le champ de la protection de l’enfance et dans celui de l’insertion sociale et professionnelle. Son pôle Prévention, dont Emmanuel Delestre est directeur, anime depuis 2020 une action baptisée "De l’oisiveté de la rue au travail », lauréate du PIC Repérer et Mobiliser les Publics Invisibles (RMPI). Comment avez-vous créé « De l’oisiveté de la rue au travail » ? C'est en 2019 que nous avons entamé un travail avec la mission locale de Châtellerault et de Poitiers. Nous avons commencé à monter un dossier ensemble, avant que l’Association Régionale des Missions Locales ne dépose son propre projet. De notre côté, nous avons présenté le nôtre, puisqu’il n'était pas interdit de partir seul. Et nous avons été retenus. Notre proposition était de travailler à partir des quartiers pour accrocher et remobiliser les jeunes, en renforçant la prévention spécialisée sur les territoires de Poitiers, de Châtellerault et d’Angoulême. Quel est le profil de votre public ? Dans ces villes, les éducateurs de prévention spécialisée sont implantés sur tous les quartiers prioritaires. Ils s’adressent aux 16-25 ans. Avec le PIC, le public est celui des 16-29 ans, sans formation, sans emploi, sans stage (les NEET) sortis des radars. Etant donné que nous étions déjà en lien avec des publics sur ces territoires, disposer d’un poste de plus nous permettait d'aller plus loin et de mettre un focus sur ce public en rupture. Quel était votre objectif de départ ? Notre parti pris était de nous appuyer sur notre dispositif existant. Nous ne voulions pas créer un poste spécifique PIC qui aurait rencontré l’incompréhension des jeunes et risquait de dénaturer l’action des éducateurs déjà en place. Concrètement, nous voulions éviter de faire une distinction entre ces professionnels. Les jeunes sont extrêmement prudents vis-à-vis de l'adulte et en défiance par rapport aux institutions. Je pense qu’ils n’auraient pas compris pourquoi un troisième éducateur arrivait avec une mission différente. Donc nous avons constitué une équipe de 3 éducateurs en leur demandant d’élargir leur champ d’intervention jusqu’à 29 ans. Quelle est votre approche ? Les jeunes en rupture, les décrocheurs en voie de marginalisation, les gens qui ont connu une succession d'échecs, sont dans une forme de rejet des intervenants. L'idée de monter un groupe, par exemple, c'est déjà toute une affaire. Pour arriver à les remobiliser, il faut créer un lien de confiance. Et pour ça, il faut avoir des éducateurs en poste sur ces quartiers. Le nouvel intervenant PIC a pu s’appuyer sur ce lien de confiance ce qui lui a fait gagner plusieurs mois représentant une forte plus-value. Notre action passe ensuite par des petits riens, par les centres d’intérêt des jeunes afin de les amener là où on veut. On parle de leur quotidien, de leurs difficultés, c'est vraiment un art de l'ordinaire. C'est un travail qui prend énormément de temps. Pour ça, nous disposons de quelques outils. Quels sont ces outils ? En premier lieu, nous avons les chantiers éducatifs, qui sont un très bon support de remobilisation. Dans ce cadre, on propose un travail aux jeunes, qui va d'une demi-journée à plusieurs jours. Nous travaillons en partenariat avec des associations intermédiaires, la SATE 86 à Poitiers, Action Emploi à Châtellerault ou AISD’EMPLOI à Angoulême, qui se chargent d’éditer les contrats à durée déterminée d’usage, des déclarations URSSAF et de verser le salaire aux jeunes. L’encadrement est assuré par les éducateurs de la prévention spécialisée qui travaillant aux côtés des jeunes. C'est un dispositif que nous avons beaucoup utilisé dans le cadre du PIC. Petit à petit, en fonction de ce qu'ils nous disent de leurs difficultés, de ce qu'ils veulent faire, on les éprouve à partir du chantier éducatif qu’on peut ouvrir à partir de 16 ans. Nous avons aussi eu recours à « Explore l'Europe » à Angoulême, un dispositif qui permet à des groupes de monter un projet pour faire un séjour dans un pays de l’UEE. Quand on fait des projets européens avec les jeunes, ils passent physiquement des frontières géographiques mais aussi psychologiquement par le fait de s’ouvrir sur le monde et d’autres cultures, favorisant l’altérité. Pour finir, ils bénéficient également des accompagnements des missions locales, ou d’autres structures en fonction de leurs problématiques. Selon vous, quels effets ont les chantiers éducatifs ? Avant de rejoindre un chantier, il faut que l’éducateur sente que le jeune est prêt, ne serait-ce que pour y travailler une demi-journée. Avant ça, il faut souvent qu’il refasse ses papiers, son cv, sa carte vitale, avoir un RIB pour se faire payer, etc. Avec ces éléments, on peut voir si le jeune est déjà dans une dynamique de remobilisation. Une fois qu'il est inscrit à l'association intermédiaire, encore faut-il qu’il vienne. Pour que ça marche, il y a tout le lien de confiance à créer entre lui et l'éducateur, ça prend de nombreuses semaines. L'avantage des éducateurs qui étaient déjà sur le terrain c'est que parfois ils ont vécu des séjours ou des sorties avec ces jeunes, ce qui leur a permis d’en repérer certains en amont. Le chantier éducatif est aussi un bon outil pour ceux qui vivent des parcours extrêmement chaotiques, y compris avec de la prison. Au démarrage, vous étiez-vous fixé un objectif en nombre de jeunes accompagnés ? Un peu moins de 300 sur 4 ans. Fin 2023, on en était à environ 140 jeunes. Nous avions misé sur 110 la première année, mais comme l’action a commencé début 2020, nous ne sommes arrivés qu’à la moitié. Compte tenu de la situation sanitaire, les sorties à la journée, les activités en petits groupes, tout cela a été très compliqué. Nous avons gardé des liens avec eux pendant toute cette période. C'est un suivi souvent sur des mois parce qu'ils partent de loin, et il y a un travail à faire sur leurs papiers, leur vie quotidienne, leur remobilisation, etc. Tout cela est très chronophage. Nous avions mal anticipé ce côté chronophage. En fait, pour travailler auprès des invisibles, 4 ans c'est court. Il faut créer un lien avec eux, il ne suffit pas de leur proposer un dispositif. Cela prend des semaines, des mois, il faut arriver à se faire accepter sur le territoire. C’est l’avantage de la prévention spécialisée, elle évite d’être trop intrusif. Vous savez quand un parcours commence, mais en moyenne combien de temps dure-t-il ? C'est un peu le système des tamis. Le premier, ce sont les maisons de quartier, l’éducation nationale, etc. Nous sommes le deuxième tamis, avec un maillage un peu plus serré. Il y a toute une partie des jeunes que l'on connaît vers 11-12 ans, plus on intervient tôt, plus on arrive à agir sur leurs problématiques. Et puis le troisième tamis, ce sont tous les jeunes qui sont passés à travers. C'est ceux-là qui vont demander le plus de temps de mobilisation, pour les amener à faire des démarches un peu autonomes, par exemple appeler un médecin, s’inscrire pour passer leur permis de conduire, trouver les ressources pour le financer. A un moment donné les choses s'enclenchent, permis, santé, prendre plus soin de soi. Petit à petit, ces jeunes s’autonomisent et reprennent leur place dans le jeu social. Mais les parcours peuvent durer 10 ans. Certains jeunes passent par la case prison, et quand ils sortent, ils reviennent nous voir pour participer à un chantier par exemple. C'est très aléatoire. Mais il y a toute la partie où on va devoir le soutenir, le tirer, et cette dernière est très chronophage. Vous semblez insister sur l’importance du temps dans le cadre de vos actions, qu’en est-il ? On ne mesure pas assez le temps nécessaire pour accompagner ces jeunes. En matière de dispositifs tout existe aujourd’hui. Le vrai problème, ce sont les marches qu'il faut gravir pour que les jeunes se sentent suffisamment autonomes, qu’ils aient envie de progresser. C'est notre métier d’effectuer ce travail. Le principe de « l’aller vers » est un peu galvaudé en ce moment. Mais aller vers des gens n'est déjà pas simple, aller vers des jeunes en rupture, ça demande un vrai savoir-faire pour être accepté. Selon moi, le métier est devenu plus difficile avec la dématérialisation, la situation des jeunes qui est plus compliquée sur le plan administratif. Et puis il y a des diminutions de moyens partout. Le métier est devenu plus dur aussi au niveau éthique et personnel, on se fatigue plus vite. Je suis content que nous arrivions à garder les éducateurs. Nous connaissons des problèmes de recrutement comme tout le secteur social et médico-social, problème d’attractivité des métiers, même si nous sommes pour le moment encore quelque peu épargnés. Le milieu ouvert attire toujours, mais nous arrivons à la limite. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
January 18, 2024 8:34 AM
|
Le CPA Lathus est un Centre de Plein Air et de formations situé à Lathus-Saint-Rémy (Sud Vienne). Parmi ses nombreuses activités, il propose le dispositif « Osez, lancez-vous », dont Alice Polo est la coordinatrice. « Osez, lancez-vous » a été retenu fin 2022 par l’appel à projets régional « Mobilisation vers la formation. » Pouvez-vous nous présenter votre action ? « Osez, lancez-vous » est le prolongement de l’action « dynamisons les résignés ruraux » (voir notre article du 25 novembre 2021 https://sco.lt/7eJR1U), qui était déjà une aide pour sortir de l'isolement et aller vers l'emploi, destinée à des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique avant d'intégrer un emploi. On a souhaité garder le même cap en faisant des améliorations sur certains axes, notamment la mobilité et la santé, pour que ça corresponde au mieux au public espéré. Nous avons aussi souhaité faire plus d’accompagnements individuels. Pour Osez lancez-vous, on est sur une logique progressive. Comme les personnes avaient du mal à reprendre un rythme très important dès le début de l’action, on est parti sur le principe de 5 semaines à 2 jours de présence, puis 5 semaines à 3 jours, enfin 5 semaines à 4 jours. Quel est son objet ? Pendant environ 3 mois, l’idée est d'appréhender et d’explorer les acteurs du territoire, dans les domaines de la santé, de la mobilité, du travail. C’est aussi créer des projets comme intégrer une association (par exemple un club de couture, de sport…), ou se lancer dans une formation, voire rejoindre un chantier d'insertion pour ceux qui sont prêts à reprendre petit à petit une activité. Le tout est fait de manière très progressive, pour avoir le temps de réaliser ces projets. Et surtout l’équipe vise l’individualisation de chaque parcours. Quel est votre public ? Le public très large, de 16 à 67 ans. Ce sont des personnes très isolées et très éloignées de l'emploi et de la formation, notamment à cause du Covid. On a aussi un public qui a connu des traumatismes importants (violences conjugales, harcèlement, etc.) ou qui souffrent de certaines phobies sociales, la peur de foule, des troubles psychologiques, et qui n'arrivent pas à vivre en collectif. Avec les réformes des retraites, des personnes ont besoin d’échanger ou de travailler encore quelques semestres, ne serait-ce que pour toucher une retraite convenable. À partir de 16 ans, on touche des décrocheurs qui ne peuvent pas, ou ne veulent absolument pas, retourner dans le système scolaire. Nous essayons de leur redonner l'envie de se réinsérer professionnellement et socialement. Géographiquement, ce sont des personnes de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG). Comment trouvez-vous vos participants ? Des personnes candidatent sur notre chantier d’insertion pour travailler, mais lors du premier entretien nous constatons qu’elles ne sont pas encore prêtes, donc nous leur proposons ce dispositif. Nous avons également nos partenaires (la mission locale Centre et Sud Vienne, Pôle Emploi de Montmorillon, Le Centre d’Information et d’Orientation), qui nous orientent des personnes pour les positionner sur l’action. Et le bouche-à-oreille fonctionne bien. Mais la plupart du temps c’est notre service qui trouve les personnes, par la pratique de ces différentes activités, des ateliers sur les savoirs de base par exemple. Comment vous leur présentez l’action ? La première question c'est, de quoi avez-vous envie ? Puis quels sont vos besoins ? Le plus souvent la réponse est la suivante : je veux retrouver une vie sociale, une vie professionnelle. Je leur décris le dispositif, leur explique que tout sera basé sur leurs besoins. Ça donne une projection positive de la suite. Mais je n’utilise pas de discours type. Tenir le même discours pour toutes les personnes ça aurait moins d'effet parce que les traumatismes, les causes d'isolement, les vécus ne sont pas les mêmes. En tout cas j’écoute, et après j’adapte mon discours. Comment sont vos groupes ? On aurait aimé accueillir 16 personnes sur nos deux sessions, on est un peu en deçà de ce qu'on avait visé. On a une grande mixité en âge. Ça favorise énormément les échanges et les partages d’expériences. Du coup, les savoir-faire et les expériences de chacun sont valorisés. C’est très important qu'ils s'écoutent sans se juger. Les plus âgés sont poussés à apporter leur expérience aux plus jeunes, et inversement on attend d’un jeune de 18 ans qu’il aide les plus âgés à utiliser les réseaux sociaux par exemple. Quelle est globalement votre approche ? On met un point d’honneur à ce que ça ne soit pas scolaire, parce que c’est souvent ça qui fait peur. On essaie de ne pas rester enfermés dans une salle. Nous proposons des activités variées, motivantes et enrichissantes. Les bénéficiaires pratiquent des activités sportives comme l’escalade (pour vaincre des peurs et apporter de l’aide à l’autre) ou d’aller visiter un musée. En fait, sans s’en rendre compte, les personnes reprennent confiance en eux et travaillent sur leur employabilité. Elles vont s’apercevoir qu’elles sont capables de réaliser telle ou telle chose, d’échanger avec la personne qui leur a organisé la visite, de poser des questions, de s’intéresser. Le premier module de 5 semaines est basée sur la découverte du groupe, sur les prémices des différents projets individuels et collectifs et sur la confiance en soi principalement. Pour le deuxième, on va plutôt être sur des activités d'expression c'est-à-dire oser parler et écrire, et sur les visites nécessaires, (par exemple à l’AFPA ou dans d’autres organismes de formation). Le dernier module est consacré aux immersions parce que les personnes sont un peu plus capables d'appeler ou de démarcher elles-mêmes. On organise différentes visites, à la CCVG, à la Maison Départementale des Solidarités, au CCAS, au tribunal, dans des associations socio-culturelles comme les MJC… Tout simplement pour leur faire découvrir ce qui les entoure. À quel moment commencez-vous à parler de projet professionnel ? On n'a aucun tabou, on en parle dès le début. Mais le mot professionnel fait peur, c'est certain. On est très transparent en leur disant que l'objectif de ce dispositif c'est d’abord de faire naître un projet, qu'il soit professionnel ou pas. L’idée c'est de dédramatiser, d'expliquer qu’on peut avoir plusieurs projets professionnels dans une vie, qu’on peut en changer. On l’aborde sous l’angle des appétences, des goûts de chaque personne. Est-ce que j'aime les animaux ? Est-ce que j'aime travailler avec mes mains ? Faire de la peinture ou plutôt du bois ? En fait, on cherche à dégager un projet par le biais des envies des gens, sans qu’ils s’en rendent vraiment compte. Que se passe-t-il à la fin des 4 mois ? Notre objectif, c'est que la personne sorte en emploi, en formation ou qu’elle ait réalisé un des objectifs qu’elle s’était fixée. On ne veut pas se focaliser sur l’emploi ou la formation, parce qu'une personne peut simplement avoir comme but de reprendre une vie sociale, ça c’est aussi une sortie positive. Parfois, on a des sorties négatives, avec aucun objectif réalisé et des abandons. Dans ce cas, on essaye de maintenir quand même un contact assez régulier par téléphone, on réoriente vers un autre partenaire. On essaie en tout cas de ne pas les laisser seuls dans la nature. C’est la personne qui est actrice de sa vie. Pour la suite, que faudrait-il améliorer selon vous ? Nous rencontrons des difficultés à mobiliser des personnes qui auraient pourtant besoin de cet accompagnement. Il faudrait arriver à mettre tous les acteurs locaux ensemble pour aller les chercher, donc je dirais une mobilisation territoriale plus importante. On s’est amélioré, je pense qu'une fois qu'on aura réalisé les deux sessions (la dernière se termine en mars), on pourra faire un bilan un peu plus précis de ce qui a marché ou pas en fonction des types de personnalités et des activités proposées. Pour nous, la thématique principale reste la reprise de confiance. C'est vraiment notre ligne de conduite et ce qu'on a envie de produire sur le territoire, tout en sachant qu'on a déjà au sein du CPA Lathus des actions très thématiques, notamment nos formations en animation. Avec « Osez, lancez-vous », on avait envie de cette ouverture qui laisse place à plein de possibilités. On y met ce qui nous semble pertinent pour les individus, c'est un choix de notre association d’éducation populaire. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
December 21, 2023 9:41 AM
|
La coopérative des coopains
KPA LA Rochelle est une association qui fait partie du réseau national KPA-Cité. Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans à construire leur avenir par l'exploration entrepreneuriale et l’entrepreneuriat collectif. C’est dans le cadre d’un consortium que le réseau KPA-Cité a répondu à l'appel à projet du PIC 100% inclusion. Présentez-nous KPA La Rochelle. KPA La Rochelle c’est une association qui porte différents parcours. Le parcours la Fusée, un parcours destiné aux porteurs de tous types de projets, qui est comme une pré incubation. Pendant quelques semaines, les participants se retrouvent chaque mercredi soir pour faire avancer leur projet. Nous avons aussi le parcours Osmose, de janvier à juin, qui est une formation de 6 mois pendant laquelle des jeunes de 16 à 25 ans vont apprendre à gérer une entreprise, à faire des devis, des factures et réalisent des prestations. Pendant cette période, ils font également des stages en entreprise, et travaillent sur leur projet de vie au CFA de Lagord, pour mieux se découvrir. Plus récemment, RestoKoop, ouvert en septembre, qui est co porté par Horizon habitat jeunes et par l'URHAJ. L'idée c'est que 5 jeunes participent, pendant 6 mois, à tous les aspects de la gestion d’un restaurant. Ils n’ont pas forcément vocation à devenir cuisinier, l’activité leur permet surtout d’acquérir certaines compétences, un rythme, des horaires, une posture professionnelle et une plus grande confiance. Et puis la coopérative « Les Coopains à bord » issue du programme Kpa-cité qui est le parcours qui a donné naissance à l’association il y a 5 ans, et par lequel nous avons répondu à l’appel à projet du PIC 100 % inclusion. En quoi consiste Les Coopains à Bord ? Les Coopains à bord est une coopérative jeunesse de services. Le programme vient du Canada. Son principe est de regrouper des jeunes pendant les vacances d’été, afin qu’ils proposent des services aux habitants des quartiers. Ils apprennent à gérer ensemble une entreprise coopérative et à proposer des prestations rémunérées. Après une première expérience menée ici, les jeunes et les accompagnateurs se sont dit que ce serait une bonne idée de continuer toute l'année. C’est comme ça qu’est née la coopérative les Coopains à Bord. La particularité de KPA La Rochelle, c'est que nous nous adressons aux 16-25 ans, principalement des jeunes déscolarisés des quartiers prioritaires. Alors qu’ailleurs dans le réseau KPA-cité, notamment à Lille, c’est plutôt pour un public adulte. Soit ils sont déjà inscrits à la mission locale, soit nous faisons en sorte qu’ils les soient. Pour participer, ils signent un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise (CAPE) porté par l’association KPA La Rochelle. Comment trouvez-vous les jeunes ? Nous mobilisons tous nos partenaires, et nous allons à la rencontre des jeunes sur le territoire. On organise plusieurs réunions d'informations pour les jeunes, qui peuvent s’engager sur la base du volontariat. Nos partenaires connaissent le programme et nous les informons régulièrement. De toute façon, rien ne peut se faire sans les partenaires. Nous accueillons une douzaine de candidats par groupe. En tout cas on a la capacité d’en accompagner une douzaine en même temps. Après, au cours de l’année, on en accompagne beaucoup plus. Aux Coopains à bord, ils viennent le mercredi après-midi donc ça permet aux jeunes scolarisés d’être là, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires. A quoi les jeunes s’engagent-ils ? À tout moment les jeunes peuvent rejoindre la coopérative Les Coopains à Bord. L'idée c'est qu'ils viennent découvrir si elle correspond à leurs besoins. Ensuite on leur demande de prendre un véritable investissement, on veut leur inculquer cette notion d'engagement. Quand un jeune décide que c’est le bon moment, on signe un CAPE d’une durée de 2 mois à un an, renouvelable. C'est aussi une façon pour que les jeunes se sentent impliqués dans un projet. Nous on souhaite qu'ils s'engagent de 6 mois à un an, mais on ne les garde pas à tout prix. Comment trouvez-vous vos clients ? L'association a 5 ans d'existence maintenant, nous avons beaucoup de clients fidèles qui nous connaissent. Je pense notamment à la ville, à la SCIC TEO, aux Francofolies avec qui nous avons un partenariat depuis longtemps. Il y a toujours un moment dans l'année où nous menons plusieurs de démarchages, ça aussi c'est un apprentissage pour les jeunes. Les groupes évoluent, ils ont des capacités, des envies, des appétences différentes. Si on identifie que, par exemple, dans le groupe il y a beaucoup de d'intérêt pour l'audiovisuel, peut être que nous allons va prendre un temps pour aller démarcher des clients dans ce secteur. De quel type sont vos prestations ? Les prestations proposées par les Coopains sont multiservices. Notre objectif c'est que les jeunes découvrent des activités différentes, avec des entreprises et des partenaires différents. C’est pour eux une façon de mieux se connaître, découvrirent ce qu'ils aiment faire. On veut conserver cette ouverture, donc on ne se spécialise pas. Aux Francofolies par exemple c'était l'accueil et l’orientation des flux des publics, de la distribution de goodies, du ramassage des gobelets pour les mettre dans les bons bacs à tri, etc. A la guinguette du Gabut, c'était l’installation et la désinstallation du site, des tables des chaises, le tri des poubelles. On ne s’interdit pas d'intervenir dans des domaines très différents. Il y en a plein que nous n’avons pas encore exploré. Par exemple les vêtements de seconde main. J'ai récemment rencontré une entrepreneuse qui travaille dans ce domaine-là, et qui aurait peut-être des besoins ponctuels pour du tri. A voir si peut intéresser les jeunes. En pratique, ça se passe comment ? Le mercredi après-midi, il y a un temps collectif. Ensemble, les Coopains prennent connaissance des courriels reçus, regardent s'il y a des demandes de prestation. Ils vérifient qu’il y a tous les détails nécessaires pour répondre, dates, horaires, nature de la demande, etc. Sinon, on appelle le client. Ensuite ils décident d’y aller ou pas. Si tout est calé, ils envoient un devis et organisent la prestation. Ce ne sont pas forcément les mêmes qui contactent le client, établissent le devis, font la prestation ou préparent les factures. Ça dépend des disponibilités et des envies des uns et des autres. L’important c’est qu’ils soient tous au courant, qu’ils aient tous la même information. Potentiellement toutes les personnes qui ont participé à la réunion du mercredi peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre sur la même prestation. Quel est le rôle des accompagnateurs ? Nous faisons le lien dans le sens où on s'assure auprès du client qu'il a bien compris le cadre d'intervention, le public qui va venir. Evidemment on s’assure que les jeunes soient en sécurité, pas que physiquement, mais aussi dans le sens du cadre dans lequel ils vont évoluer, pour qu'ils se sentent en assurance et en autonomie. C’est nous qui définissons ce cadre, surtout quand il y a des mineurs. Notre règle, c’est que les jeunes n’agissent pas seuls. Ils sont toujours au minimum en binôme. C’est important pour la prise de confiance. Parfois les clients ont besoin de plusieurs personnes, la prestation dépend du besoin et de la demande. Vous effectuez un suivi après la sortie de l’action ? C’est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place. Pour l’instant nous préparons la sortie des jeunes, c’est très important. On les aide à prendre conscience des compétences qu'ils ont acquises, avec des temps d'entretien individuel, des ateliers CV, etc. Et surtout, comme nous sommes très ancrés dans un maillage local, nous sommes en lien avec les conseillers de la mission locale, pour essayer de s’assurer qu’il y aura une suite pour eux. En revanche il n’y a pas de suivi à 6 mois. On a pour projet de créer une communauté des anciens, parce qu'il y a une vraie fierté d'appartenance et beaucoup de liens qui se créent entre les différents parcours. En général, au-delà d'un an, on sent qu'ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre. Les derniers mois de leur présence, ils peuvent jouer le rôle des plus anciens qui vont former les nouveaux arrivants. C'est intéressant en termes de transmission entre eux. Et puis souvent au bout d'un an, ils partent vers d'autres horizons, nous souhaitons que ce soit un tremplin vers de nouveaux projets. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/
|

|
Scooped by
Cap Métiers NA
July 4, 2024 5:45 AM
|
Faire mieux connaître les services à la personne pour attirer un nouveau public
La plupart des CIAS et des CCAS sont confrontés à des problèmes de recrutement de personnels dans les services à la personne. Le territoire des Landes ne fait pas exception. Soucieux de les aider à résoudre ce déficit de main-d’œuvre, le pôle action sociale et insertion du conseil départemental s’est emparé du sujet en 2023, dans le but de trouver une solution susceptible de former de futurs professionnels aux problématiques et postures liées à la profession. Afin de monter ce projet « Prep’emploi », répondant aux besoins des structures et des potentiels apprenants, le Département a sollicité la MFR de Castelnau-Chalosse, près de Dax. « Il fallait que la formation se fasse aussi proche que possible du domicile des stagiaires, » précise Laure Rigodanzo, assistante de direction. « Donc nous avons cherché un lieu central par rapport à la domiciliation des stagiaires positionnés en formation. Nous avons alors demandé à nos collègues de la MFR de Pontonx-sur-l’Adour d'accueillir la formation que nous avons élaborée en lien avec nos financeurs*." Si la MFR de Castelnau a été choisie, c’est en raison de son expérience dans le champ des métiers de service à la personne, elle qui propose notamment une formation d’Assistant De Vie aux Familles (ADVF). Le Conseil départemental connaissait ce savoir-faire. Il a assorti sa demande d’un certain nombre d’exigences pédagogiques qu’il estimait nécessaires pour former au mieux un public de demandeurs d’emploi aptes à être employés par les centres sociaux. « Nous avons pensé Prep’emploi en droite ligne de ce que l’on fait d'habitude sur les formations de services à la personne, pour des publics avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Ce qui a changé c'est que nous l’avons faite hors les murs et avec la collaboration étroite du conseil départemental qui s’est beaucoup investi. » Le rôle des centres sociaux Les centres sociaux ont été partie prenante du dispositif dès le départ. Ils se sont engagés, en premier lieu, à formuler clairement leurs besoins, puis à désigner des tuteurs parmi leurs salariés, qui ont été formés par le centre de gestion afin d’être en mesure d’accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions. Les structures s’engageaient également, si l’immersion se passait bien, à leur proposer un CDD d’une durée de 3 à 12 mois, au lieu d’1 mois comme c’est le cas habituellement pour une première embauche. Des réunions d’information collective ont été organisées, pour lesquelles France travail a mobilisé des demandeurs d'emploi intéressés par les métiers du service à la personne. Des bénéficiaires du RSA ont également été invités à y assister. Le Conseil départemental et la MFR présentaient la formation, son contenu et ses modalités. Ensuite, chaque CIAS décrivait sa structure, ses pratiques et son fonctionnement, le nombre de ses salariés, son planning de roulement, les indemnités diverses, tout un ensemble d’informations concrètes sur l’exercice du métier. « Ce que nous avons remarqué dans les informations collectives c'est que les personnes ne savent pas toujours précisément ce que recouvrent ces postes. Elles ont des préjugés, beaucoup d’images fausses. Ces réunions ne servent pas qu’à trouver des candidats, mais aussi à les informer de la réalité de terrain. » C’était également l’occasion de faire connaître les tâches effectuées par les professionnels et celles qui ne sont pas de leur responsabilité, de parler de leur niveau de polyvalence et d’autonomie. Et surtout préciser leur périmètre d’intervention, puisque certains actes de nature médicale ne relèvent pas des aides à domicile. Autre dimension essentielle, la communication avec les bénéficiaires et les aidants, ainsi qu’au sein des services avec les autres salariés du médical ou du paramédical qui interviennent chez le bénéficiaire. Lors des échanges avec les participants, certains sujets ont été évoqués, comme la place des hommes dans ces métiers, confirmant le fait que, dans l'imaginaire collectif, il s’agit plutôt d’une activité féminine. La plupart des questions portaient sur le salaire, les déplacements, les périmètres d'intervention, etc. Les CIAS présents répondaient à toutes les questions, sans en éluder aucune, en s’efforçant de donner une image juste des métiers. Ils ont pu expliquer ce qu’ils avaient mis en place en matière de revalorisations de salaire, des prises en charge liées à la mobilité. Intervenir à domicile, cela veut bien sûr dire se déplacer. Un problème pris en compte par les structures qui s’organisent en secteurs géographiques, et établissent les itinéraires les plus raisonnables possibles. « Je pense qu'on accepte mieux certaines contraintes du métier quand on sait pourquoi on le fait. Il est vrai que c’est contraignant de faire de la route, de travailler certains week-ends et parfois en soirée, mais nous insistons sur le fait que c’est pour s’occuper de personnes qui ont besoin que l’on passe chez elles. Mettre en évidence cette dimension, ça compte dans notre démarche. » Les réunions d’information collective étaient suivies d’entretiens de recrutement menés par les CIAS, en binôme avec le Département ou avec la MFR. La formation elle-même s’est déroulée en deux sessions, de novembre 2023 à juin 2024, pour des groupes d’une douzaine de stagiaires. Chaque session durait 10 semaines, incluant 120 heures d'immersion en fin de stage et 50 heures d’accompagnement individualisé consacrées à la levée des freins liés à la mobilité ou à la garde d’enfant, ainsi que des ateliers de sophrologie. « Les freins à la mobilité c'est un grand sujet. Mais je ne crois pas qu'il n’y ait que cette question à prendre en compte dans le service à la personne, particulièrement pour la profession d'aide à domicile. » Lever les freins La MFR de Castelnau n’a pas rencontré de difficultés particulières à mener le dispositif, en raison de son expérience en matière de formation en service à la personne et de sa connaissance des publics éloignés de l'emploi. Les candidats ont été suffisamment nombreux, même si pour certains les freins étaient trop importants et ne leur permettaient pas d’entrer en formation et de la suivre jusqu’au bout dans de bonnes conditions. Dans ces cas-là, le Conseil départemental reprenait la main avec d'autres services pour essayer de lever ces freins, par exemple avec une indemnité pour frais de déplacement. « Nous avons commencé chaque fois avec 10 ou 11 stagiaires. Nous avons eu des arrêts en début de session, en raison de problèmes financiers ou personnels. Parfois aussi parce que la personne prenait conscience qu’elle ne pourrait pas passer au-delà de l’aide à la toilette. Pour certains, rentrer dans l'intimité des personnes est difficile, leur rapport au corps constituait un obstacle infranchissable… » La Prep’emploi n’est pas certifiante. Cependant, pendant leurs parcours, les stagiaires suivaient la formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique – Sanitaire et Social Accompagnement à La Mobilité (PRAP 2S) et celle de Sauveteur Secouriste du Travaille SST, deux certifications incluses dans leur programme. La formation a été pensée pour que sa durée permette l’acquisition des apports théoriques nécessaires et que l'immersion dans les structures soit suffisante pour que les stagiaires intègrent pleinement un poste. « Peut-être que des personnes auraient besoin de plus, mais je pense que notre formule était la bonne et qu’elle a eu le mérite de bien les préparer. Je pense aussi que le PRAP 2S et le SST sont des choses rassurantes pour les employeurs qui, par ailleurs, connaissent bien les stagiaires puisqu’ils passent plusieurs mois avec eux. Donc c'est un temps efficace. » A l’issue des deux sessions, quatorze stagiaires ont reçu une proposition de CDD dans les structures où ils ont effectué leur stage. Si certains ont préféré se réorienter, chacun a pu trouver du positif dans l’expérience. * Prep’emploi a été financé par le conseil départemental des Landes, la DREETS et par l’appel à projets « initiatives territoriales pour l’emploi » de la Région Nouvelle-Aquitaine.

|
Scooped by
Cap Métiers NA
June 20, 2024 4:10 AM
|
BLIK, former des techniciens à distance
Marion Delas est directrice de l’ASsociation pour la FOrmation et le perfectionnement professionnel des Pays de l’Adour (ASFO ADOUR), un organisme de formation qui comprend trois sites en Nouvelle-Aquitaine (Saint-Paul-Lès-Dax, Mont-de-Marsan, Ustaritz). L’ASFO Adour développe depuis l’année dernière une plateforme d’apprentissage aux métiers de la maintenance industrielle. Ce projet, baptisé BLIK, est co-financé par le Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation. Que signifie BLIK ? BLIK veut dire “Blended Learning for Industrial Knowledge.” Son principe est de proposer des modules d’apprentissage 100% à distance en maintenance industrielle. Son côté novateur, raison pour laquelle nous avons déposé le dossier dans le cadre du FRIF pour le volet innovation pédagogique, c'était d’amener du distanciel sur un métier technique. Quelle est son origine ? Il vient du constat d’un manque d'attractivité des offres d'emploi dans tout ce qui est maintenance industrielle. C’est un secteur qui a de forts besoins de recrutement, mais peu de candidats, sans doute en raison d'une image vieillotte, pas moderne, avec de fortes contraintes etc. Notre but était de redonner de l'attrait à ces métiers en qualifiant et en formant notamment des demandeurs d'emploi. Nous avons mené une enquête en 2020 auprès d'une cinquantaine d'industriels en Nouvelle-Aquitaine, sur leurs attentes en matière de formation. Ils nous ont souvent répondu qu’ils trouvaient rarement des candidats formés et opérationnels intéressés par ces métiers. Le secteur est très tendu et les bons techniciens de maintenance sont démarchés directement dans les entreprises. Le constat était clair, des offres d’emploi non pourvues, des candidats peu intéressés par le domaine. Notre réponse, travailler sur l’attractivité du métier en proposant un parcours de formation attractif, en lien avec les attentes des apprenants d’aujourd’hui, sans oublier les besoins techniques des entreprises. Comment avez-vous abordé ce problème ? Nous avons cherché à imaginer une solution d'apprentissage à distance, chose qui n’existait pas du tout dans le domaine de la maintenance. Sachant que, généralement, les stagiaires apprennent en faisant, en manipulant les pupitres de commande dans nos ateliers. Notre idée était de basculer tout cela en virtuel, d’acquérir des bibliothèques d'éléments 3D spécifiques aux marques de machines utilisées. Nous avons créé une plateforme d'apprentissage à distance qui permet à l'apprenant de rentrer en formation à son rythme. Nous avons également pris en compte les attentes des formateurs qui avaient du mal à partager leurs données de manière sécurisée, puisque tout était fait sur papier. Avec la plateforme, ils peuvent déposer leurs cours et leurs TP, faire leurs corrections, donner du contenu ressource, et communiquer avec les apprenants. Autre dimension, c'est que nous n'avons pas acheté une formation ou un module sur étagère, selon la formule usitée dans la formation à distance. C’est un de nos formateurs expérimentés qui a construit les modules, qui a élaboré les quiz. Maintenant, il dispose de retours d’expérience utiles, il sait où les gens peuvent rencontrer des difficultés, il a construit les modules en s’appuyant sur les besoins des entreprises et les attendus techniques. Quelles sont les modalités pratiques pour l’apprenant ? Avant d’entamer un parcours, l’utilisateur passe des tests de pré-positionnement et, en fonction des résultats, entre à une étape différente du parcours. Chaque module (automatismes, pneumatique, etc.) est calibré pour un nombre d’heures donné, mais comme chacun peut apprendre à son rythme, certains la compléteront en 20 heures, d’autres en 60 heures Le parcours se débloque au fur et à mesure. A chaque fin de module, il doit répondre à un quizz pour valider sa compétence afin de pouvoir passer à l’étape suivante. Tout au long de la formation, il dispose d’une petite icône d'aide qui lui permet de contacter le formateur qui répond pendant les horaires classiques de formation. Quelles ont été vos premières conclusions ? Au départ, nous avions pensé que notre dispositif serait tout en e-learning. C’est à dire d’ouvrir un accès à une personne, et la laisser tout gérer seule. Nous avons constaté que ça ne convenait pas, c’est pourquoi nous avons ajouté une classe virtuelle d’une heure, au début du parcours, pour sensibiliser l’apprenant, lui montrer comment marche l'outil, lui expliquer la progression pédagogique attendue. Une classe virtuelle au début, une assistance formateur tout au long du parcours et une classe virtuelle à la fin. C’est le principe du « blended learning ». Notre idée est d’appliquer le principe d’entrée sortie permanente, parce que la classe virtuelle de départ et de fin est individualisée. On ne peut pas faire une classe virtuelle en réunissant tous les apprenants, parce qu’on a quand même besoin de savoir qui on a en face. Pour éviter les décrochages, il faut que l’on puisse évaluer à quel moment du parcours, selon nous, il pourrait y avoir blocage, ou à quel moment du parcours une personne pourrait s'ennuyer parce qu'elle trouve ça trop facile. Quelle est la spécificité de la maintenance par rapport à un autre métier technique ? Le service maintenance, c'est un peu les pompiers de l'entreprise. Quand on fait appel à eux, c’est qu’il y a eu un arrêt de la chaîne, un plantage, un problème impactant pour toute une équipe. Toute ou partie de l'usine dépend de leur intervention. Tout l’enjeu de ces métiers, c’est de faire en sorte que le feu ne parte pas, qu’il y ait toujours quelque chose à faire, mais rien dans l’urgence. Le problème, c’est que le préventif, dans une vision immédiate, coûte de l’argent sans en rapporter. Le préventif est pourtant la solution qui permet d’éviter l’arrêt. La dernière des spécificités de ce métier est la pression et le travail en équipe. Le service maintenance doit assurer la continuité de la production en s’appuyant sur le service entretien, électricité, etc. On pourrait penser que les métiers sont plus valorisés que les autres métiers industriels. Qu’en-est-il ? Dans leur ensemble, les métiers de l’industrie attirent peu, malgré de réels efforts pour les rendre visibles et attractifs (salon, forum, casques immersifs, visite d’entreprises…). La maintenance a besoin des meilleurs, c’est encore plus difficile de les trouver. Les entreprises sont parfois dans l’urgence et cherche parfois le collaborateur « idéal » pour pallier un besoin urgent. La tension est très forte, les exigences aussi. Et les demandeurs d’emploi ? Historiquement, l’ASFO Adour est plus tournée vers l'entreprise, la montée en compétences des salariés, que vers les demandeurs d'emploi. Toutefois, nos trois centres de formation en accueillent pour accompagner les reconversions, la montée en compétences et répondre aux besoins des employeurs sur les métiers en tension. Notre grande force consiste à créer des sessions en mixant les publics, les demandeurs d’emploi sont intégrés dans des sessions avec des salariés. Les échanges sont riches, le partage d’expérience et de bons plans emploi aussi. Cette mixité est possible car nous limitons la taille de nos groupes à 6 personnes en maintenance. C’est assez atypique dans la formation. Tout au long du développement du projet, nous avons travaillé en comité de pilotage avec la référente technologie et digitalisation de Pôle emploi, un expert en informatique et le délégué territorial formation emploi des Landes. Ensemble, nous avons rédigé un cahier des charges pour créer ce projet. Pour être tout à fait sincère, ces modules s’adressent à des personnes qui connaissent l’industrie et qui ont déjà des bases. Un parcours à distance demande une autonomie et une aisance qu’un novice n’aura pas. Le public visé est celui d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi qui a besoin d’un complément sur la partie pneumatique ou la partie automatisme de telle ou telle marque. Quel est l’avenir de BLIK ? Avec cette formation, nous n’avons pas l’ambition de faire des techniciens en maintenance en quelques modules, alors que pour décrocher le Titre Professionnel technicien supérieur de maintenance, un bac +2, il faut compter un parcours de 10 mois. En revanche, nous pouvons répondre à une demande de l'industriel qui a besoin d’un complément de compétence pour un candidat à l'emploi, ou à un salarié pour une remise à niveau ou une évolution professionnelle. Nous sommes engagés dans une démarche de commercialisation et de promotion du produit. Nous l’avions présenté en novembre pendant le salon So pro à La Rochelle. Nous avons ouvert des parcours pour quelques entreprises, les apprenants testent le parcours et nous font des retours très précieux. Dès la rentrée, nous allons déployer cette offre grâce à une communication digitale, mais aussi sur les nombreux forums et salons. Notre souhait est que ce projet permette aux entreprises de trouver des alternatives aux formations en présentiel, de permettre aux salariés et demandeurs d’emploi de monter en compétences, à leurs rythmes, sur des thématiques ciblées. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
June 6, 2024 5:58 AM
|
A Limoges, l'Association Loisirs et Intégration Sociale (ALIS) intervient entre autres dans le domaine social et du français langue étrangère. Plus récemment, elle a engagé des actions de lutte contre l'illettrisme, sous la forme d'un espace collectif de traitement des difficultés, financé l'AAP régional Innover contre l'illettrisme. Mame Codou Fall, coordinatrice du Pôle Inclusion et Insertion du Centre Social Entre Deux est chargée de son suivi. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Notre association ALIS, pour Association Loisirs et Intégration Sociale, existe depuis 1996. Elle chapeaute trois établissements, le Centre Social Entre Deux, dans le quartier prioritaire des Coutures, et le centre social Aristide Briand dans le quartier du même nom, qui inclut un foyer de vie en accueil de jour pour des adultes porteurs de handicap. Nous avons également un Etablissement d'Accueil Non Médicalisé (EANM). Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place une action sur l’illettrisme ? L'action sur les difficultés liées à l'illettrisme est prise en charge dans le Centre Social Entre Deux, qui a son agrément depuis 2017. Sa particularité par rapport aux autres établissements, c'est qu'il comprend un secteur intégration insertion qui est très axé sur l'accompagnement social des personnes précaires, dans la recherche d'emploi, dans l'apprentissage du français pour les primo-arrivants, dans la mise en œuvre d'un parcours d'intégration au travers d’espaces collectifs. Depuis des années, nous avons constaté que beaucoup de personnes sollicitaient nos agents d’accueil pour les aider à lire un courrier, remplir un document ou un chèque. Le même constat a été fait dans les espaces collectifs (jardin, projet journal de quartier, Espace Familles). Notre projet est venu aussi des constatations des professionnels dans ces différents espaces. C’était un nouveau domaine pour vous ? Avant, nous n’intervenions pas dans le domaine de l'illettrisme. En revanche, voilà plusieurs années que l'on travaille sur le français langue étrangère avec une pédagogie de type Montessori qui s'appelle la pédagogie Gattegno. C’est une méthode phonétique basée sur des couleurs, chaque carré de couleur représente un son en français et l’accès à la langue passe d’abord par l’oral. Les participants apprennent les sons en français à travers ces couleurs. Ensuite, elles sont traduites dans un nouveau tableau qui met en place les graphies, on l’appelle le FIDEL. Ça marche très bien pour le français langue étrangère. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette pédagogie pour le traitement de l’illettrisme ? Nous avons testé les outils la première fois en 2018 dans notre foyer d'accueil, avec des personnes porteuses de handicap, des adultes qui ne sont pas allés à l'école. Quand on a vu l'appel à projets régional, on s'est dit que c’était le moment de répondre aux besoins qui ont été identifiés au sein de l’association. Nous avons constitué nos premiers groupes fin 2022. Avez-vous eu besoin de nouvelles compétences ? Nous avons suivi des formations pour la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme. On avait déjà la pédagogie Gattegno, mais on ne s’est pas arrêtés là. En 2023 et cette année, on a profité de l'accompagnement du CRIA avec des offres de formation sur comment repérer les personnes, comment utiliser les outils disponibles. Depuis que notre projet a été retenu, on a aussi reçu des demandes de bénévolat, notamment d'anciennes institutrices qui veulent participer et donner du temps sur l'illettrisme, parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender que le public non francophone. On est en train de traiter ces propositions, mais nous n’avons pas encore de bénévoles parce que c'est toute une gestion, il faut les former, prendre le temps de faire les choses comme il faut. Vous connaissiez un peu ce public particulier ? Nous savions que c’est un public qui n'est pas facile à repérer et à mobiliser. Les personnes utilisent beaucoup de mécanismes d'évitement, elles sont réticentes à montrer qu’elles ne savent ni lire ni écrire. On ne peut pas les aborder de la même manière que le public FLE qui, lui, est en demande d’aide. Les structures spécialisées dans l’illettrisme sont confrontées aussi à ce problème de repérage, elles disent que le meilleur moyen de les repérer c'est de sensibiliser les gens qui rencontrent ces publics de manière quotidienne. Quelle a été votre approche ? On est partis des espaces inclusifs du centre social et des professionnels en qui les personnes ont confiance, qu’elles voient régulièrement. Dans le cadre de ce projet nous avons voulu profiter de cette confiance pour en quelque sorte s'immiscer tout doucement dans la vie des personnes, essayer de les amener à participer à des ateliers. Nous avons aussi sollicité les associations qui sont sur les différents quartiers pour trouver des personnes ressource, qui pourraient nous signaler des publics, nous inviter à participer à des événements comme les fêtes de quartier, afin de nous faire connaître. Notre ligne de conduite c'est de se déplacer, d’aller vers les personnes, de ne pas trop bousculer leur emploi du temps. On essaie de faire en sorte de s'insérer pour ne pas trop multiplier les freins et de partir de leurs centres d’intérêt. Votre projet consistait à créer un espace collectif ? Notre idée était celle d’un espace de traitement des difficultés liées à l'illettrisme, en trois temps. En premier lieu, le repérage via les espaces inclusifs dans les centres sociaux, et par le biais d’événements. Deuxième étape, c'était de mettre en place une phase de confiance avec les publics. Et la troisième étape, passer au diagnostic à 360 degrés, qui ne se limite pas au niveau de français, mais qui aborde aussi les conditions de vie de la personne, ses motivations pour apprendre à lire et à écrire, son emploi du temps. C’est de voir comment, au travers de sa situation sociale, on peut l'aider au mieux. On parle de traitement collectif mais on sait que pour les publics en situation d'illettrisme, il n’en faut pas trop. Nous avons constitué des groupes de trois personnes au maximum qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ça peut être des actifs, des personnes en insertion qui travaillent, mais qui ont des lacunes au niveau de l'écrit, des personnes âgées qui voudraient apprendre à lire et à écrire pour correspondre avec leurs proches. Ou encore des groupes d’adolescents à la limite du décrochage, des personnes porteuses de handicap. Nos groupes peuvent être mixtes en termes d’âge et de genre. Comment avez-vous procédé en pratique ? Dès le départ nous avons évalué que ce projet pouvait accueillir 50 bénéficiaires sur une année, par groupes de de trois. On commence par des entretiens de diagnostic, puis on établit des créneaux pour commencer l'accompagnement. Tout le sens de la pédagogie que nous utilisons consiste à se caler sur le rythme de l'apprenant, et en fonction de ses disponibilités. Donc il n’y a pas de programme type. On va vraiment s'atteler déjà à mettre en place les apprentissages, voir comment le groupe fonctionne. Tant que les personnes ont besoin d'accompagnement, on continue avec elles. On essaie de faire minimum deux séances par semaine, jusqu'à trois fois. Chaque séance peut durer jusqu'à trois heures. Mais pour que les participants repartent avec quelque chose, il ne faut pas qu’elles durent trop longtemps. On est vraiment dans le ludique, dans la manipulation, les jeux de rôle, les cartes, l’utilisation de logiciels. On n’est pas du tout dans un cahier un stylo, la méthode classique d'apprentissage. Il faut que la personne garde sa concentration et qu'elle trouve toujours plaisir à le faire. Il faut surtout éviter de les mettre dans une ambiance d’école, qui les plonge directement dans leurs souvenirs d'échec scolaire Quels résultats avez-vous relevé ? Nous avons constaté que le tableau des sons est très efficace avec les personnes en situation d'illettrisme. C'est beaucoup plus facile pour elles parce qu’elles connaissent les sons en français, et elles passent tout de suite au lien entre le son et la couleur. On peut assez vite aborder la graphie. La méthode est adaptée à ce public, parce qu’elle est ludique et que les outils sont pensés pour que les utilisateurs expérimentent, qu'ils soient acteurs de leur apprentissage. Ce qui a été plus difficile pour moi en tant que formatrice FLE, c’est la mobilisation du public. Je savais que ça allait être difficile. Même avec des gens qui étaient en demande, parfois j’ai dû annuler cinq ou six fois des rendez-vous. J’ai vite compris que je devais être arrangeante au niveau de l'emploi du temps, enlever les freins, beaucoup anticiper. Cet article est publié pour le compte de "La Place", la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine : https://pro.cap-metiers.fr/politiques-publiques/la-place-nouvelle-aquitaine/

|
Scooped by
Cap Métiers NA
May 23, 2024 9:36 AM
|
Les compétences avant le handicap
En 2021, APF France handicap Gironde (anciennement Association des Paralysés de France) constatait que certaines personnes en situation de handicap, même formées, n'avaient pas accès à l'emploi. Et surtout avaient renoncé à une vie professionnelle du fait de la difficulté rencontrée à trouver des postes adaptés à leur situation. Face à cette forme d'injustice, l’association a imaginé « Boostons les talents », un programme d’un mois à destination de publics avec tous types de handicap. Financé à l’origine par AG2R La Mondiale, il a été porté sur fonds propres par l’association pendant un an, puis par le FSE. Autre observation, aucun des acteurs intervenant dans le champ du handicap ne proposait alors d’actions collectives adaptées à son public. Cap emploi ou l’AGEFIPH animaient des ateliers autour des techniques de recherche d'emploi, comment faire un CV, comment utiliser les sites en ligne. Des apports très techniques. « Mais notre intervention ne se situe pas là, » explique Laurie Lebran, conseillère en insertion. « Nous sommes persuadés que c'est le collectif qui fait la force de notre dispositif, au-delà des handicaps, au-delà des projets professionnels et des générations. Ce qui est important, c'est que tous les participants soient en recherche d'emploi. C'est ça qui les réunit, c'est le point d'ancrage. » Dans ses grandes lignes, « Boostons les talents » agit sur la confiance en soi, pousse les personnes à reprendre confiance dans leurs compétences. L’idée n'est pas d'en acquérir de nouvelles, mais plutôt de retrouver celles qu'on pensait avoir perdu. Le dispositif est venu en quelques sorte combler un trou dans la raquette, puisque les autres acteurs ne proposaient pas d'action collective autour de la confiance en soi, adaptée au handicap. La volonté comme prérequis Du côté des publics, deux prérequis. Avoir une RQTH ou un justificatif de handicap comme une carte mobilité inclusion ou une affection de longue durée. Et être en recherche d'emploi, ou plutôt avoir la volonté d'intégrer le marché du travail ou de la formation, de retrouver une certaine dynamique. « C’est aussi de se remettre dans un parcours puisque le public est composé de personnes qui sont en fracture de parcours. Il faut qu’il y ait une volonté à trouver, à aller vers. » Aujourd'hui, le dispositif accueille des personnes entre 18 et 55 ans, potentiellement plus. Deux groupes principaux se distinguent. D’abord les 18 à 25 ans, sans expérience professionnelle, qui ont quitté l'école prématurément, généralement peu diplômés, ou qui le sont mais rencontrent des difficultés à trouver un emploi du fait de leur handicap. Ensuite, les plus de 45 ans, eux aussi peu diplômés, ou qui ont « acquis » un handicap au cours de leur vie et doivent entamer une reconversion professionnelle. Quel que soit leur niveau de formation, ils ne peuvent pas passer facilement d'un emploi à un autre. Les groupes accueillent une majorité de femmes, peut-être parce qu’elles ont moins de réticences à aborder la question de la confiance en soi. Initialement, le public comportait surtout des jeunes porteurs d’un handicap moteur. Mais ce n’est plus le cas. « Nos sessions collectives accueillent entre 8 et 12 personnes, en moyenne seules deux d’entre elles ont des problématiques moteurs, des personnes en fauteuil comme hémiplégiques par exemple. En revanche, nous avons maintenant une forte proportion de personnes en situation de handicap psychique, avec ou sans troubles cognitifs associés. Le Covid a pu jouer un rôle, mais ce sont les environnements familiaux compliqués, le rapport à l’école, à l’emploi, qui expliquent plus les ruptures de parcours et les rechutes. La crise sanitaire n’a pas été la cause des troubles puisque le handicap était déjà présent. » Les participants arrivent quasiment exclusivement sur prescription du service public de l’emploi, principalement les missions locales. Les autres viennent par le milieu associatif, d'autres structures du handicap qui généralement ont un volet accompagnement vers l'emploi mais pas de volet collectif, comme la fédération APAJH, l’ADAPEI ou Clubhouse France. « Nous sommes en lien avec l'ensemble des référents handicap des missions locales, qui diffusent bien l’information, y compris en interne. Chaque conseiller peut s'en saisir comme il le souhaite. Nous faisons aussi des informations collectives directement auprès des jeunes. Paradoxalement, on travaille plutôt à la marge avec France Travail et Cap emploi. La raison c'est qu'ils sont difficiles d'accès pour nous, étant donné que nous avons un petit dispositif qui accueille très peu de personnes. » Les candidats sont reçus en entretien individuel pour s’assurer de leur adhésion au projet. Et vérifier que leur profil corresponde, afin de ne pas créer de déception, car certains peuvent croire qu’il s’agit d’un dispositif d’orientation professionnelle. On leur explique qu’il s’agit bien de remobilisation. « C'est important qu'il n’y ait pas de confusion. Il est arrivé que nous ayons des personnes qui n'avaient pas de projet professionnel défini et qui étaient très perdues. Elles se sont retrouvées en difficulté sur l'exercice du CV parce que, comment faire un CV si on n'a aucune idée de ce pourquoi on le fait ? Globalement, les termes que nous utilisons pour notre promotion résonnent beaucoup chez les publics qui nous sont adressés. Donc parfois le travail est déjà fait avant l’entretien. Je leur parle motivation, mobilisation et généralement la personne adhère parce que c’est la réalité qu’elle vit. » Le programme s’étale sur 3 semaines, avec des dates définies par avance afin que les intervenants extérieurs calent leur venue en fonction du calendrier. C’est également plus simple pour les participants, qui peuvent ainsi se rendre disponibles. Le déroulement de chaque période est toujours le même, elle commence par un atelier de lancement et se termine par un atelier bilan. Lors de ces 3 semaines, les intervenants se succèdent sur quatre champs différents. Tout d'abord des ateliers théâtre, pour travailler la prise de parole en public, le regard de l'autre sur soi, plus généralement l'expression orale. Ensuite des ateliers de socio-esthétique avec l'institut bordelais Princ’ESS, une structure de l'IAE, sur la posture professionnelle, la présentation, ainsi que la colorimétrie, qui consiste à trouver la couleur dans laquelle la personne se sent en confiance pour se présenter devant l'autre. Avec l'association Activ’Action sont abordées la capacité des personnes à rebondir à la suite d’un échec, et la valorisation des compétences. Enfin, la « Cravate Solidaire » anime des ateliers « pitch », un atelier CV et le parcours « coup de pouce », qui concerne les aspects un peu plus techniques du retour à l’emploi. Recruter une compétence, pas un handicap « Notre idée, c'est également d’informer les participants sur leurs droits, sur le fait qu’ils ne sont pas obligés de mentionner leur handicap sur leur CV, qu’ils ont le droit de ne pas en parler lors d’un entretien d'embauche. On leur apprend à parler de leur handicap, sachant que les personnes ont souvent tendance à tenir un long discours sur leur situation, mais pas du tout sur leurs compétences. Ce qui pose problème, puisqu'on ne recrute pas un handicap, mais justement des compétences. D’autant que nous savons qu’il peut y avoir de l’appréhension du côté des recruteurs. C’est important d’apprendre à utiliser les bons mots, ne pas trop en dire, sans pour autant tout cacher. C’est tout l'enjeu de cet atelier. » Avec trois sessions par an, « Boostons les talents » a accompagné une douzaine de groupes depuis son lancement. Le dispositif a connu quelques modifications, par exemple en mettant plus l’accent sur les techniques de recherche d’emploi, à la demande des participants lors des ateliers bilans. La sophrologie, qui faisait initialement partie du programme, a été abandonnée après qu’une personne a connu un épisode de compensation, heureusement sans gravité. « La bonne surprise que nous avons eue, ce sont les séances photo. Aujourd’hui elles sont intégrées au parcours Coup de pouce de la Cravate Solidaire. Cette activité fait beaucoup de bien aux participants, notamment quand on les met en scène dans des mises en situation professionnelle, par exemple en tenue de peintre entouré de ses pinceaux et pots de peinture. Se voir de cette façon leur apporte beaucoup. Cela peut sembler anodin, mais c’est le genre de petites choses qui participent à transformer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Et ça résume bien notre objectif. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
April 18, 2024 9:13 AM
|
Vent en poupe pour les métiers du nautisme
Sylphe est un voilier mythique des années 60. Ce monocoque habitable de croisière de 6,5 mètres, conçu par l'architecte naval Michel Dufour, a été construit par le chantier du même nom, à La Rochelle, jusqu’au début des années 70. Aujourd’hui, son prototype original, le numéro « 0 », est accueilli dans les murs du lycée polyvalent du Pays d'Aunis à Surgères (Charente-Maritime). Il joue désormais le rôle d’ambassadeur du programme « Embarquez dans la Filière Nautique » (EDFN). Ce programme est porté par Fountaine Pajot qui a constitué un consortium1 afin de répondre à l’appel à projet Ingénierie de Formation Professionnelle et d’offres d’Accompagnement Innovantes (IFPAI) soutenu par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du plan d’investissement d’avenir « France 2030 » opéré par la Caisse des Dépôts. Il a l’ambition de toucher tous les profils, jeunes ou adultes en reconversion, afin d’identifier et d’attirer des publics nouveaux qui constitueront les futurs salariés. Il entend également fidéliser et faire progresser ces publics et les salariés en poste. EDFN comprend 12 actions, réparties pour moitié en actions « amont », pour l’autre moitié en actions « aval ». En amont, tout ce qui relève de la sensibilisation aux métiers et au repérage des publics éloignés de l’emploi. Pour Patricia Meignen, cheffe de projet IFPAI chez Fountaine Pajot, la présence du Sylphe dans un organisme de formation relève typiquement de ce champ-là. « L’objectif de faire venir le bateau ici, c'est vraiment de sensibiliser aux métiers du nautisme, de montrer qu’ils incluent par exemple des menuisiers et des menuisiers agenceurs. Ensuite, nous avons la volonté d’accompagner les gens vers les formations et, en fonction des intérêts de chacun, de les orienter, de leur proposer un environnement adapté et de lever les freins à l'emploi. » Au chapitre des actions « aval », on trouve l’intégration des stagiaires dans l’entreprise, le développement des compétences managériales, la formation des formateurs internes, le renforcement de la polyvalence (ou de la polycompétence) et des mobilités transversales des salariés. Ces actions n’ont pas été pensées selon une logique chronologique, elles ont toutes été engagées de front. Certaines sont complémentaires et s’alimentent entre elles. L'importance de la formation « Je vois les choses par le prisme de l'entreprise et de sa responsabilité sociétale » précise Franck Bonot, DRH de Dufour Yachts. « Son développement économiquement ne peut pas faire abstraction de l'environnement, de son bassin d’emploi. Et la formation tout au long de la vie est essentielle au développement. Les établissements de formation et les entreprises ne doivent rester en silo, il faut les décloisonner, pour faire en sorte que les apprenants ne soient pas trop éloignés des réalités des entreprises. » Pour la Communauté de Communes Aunis Sud, le projet s’inscrit naturellement dans le prolongement de ses compétences en matière de développement économique et d’emploi. Son président Jean Gorioux estime que « les pistes de travail ne sont pas spécifiques au nautisme, mais elles s'intègrent complètement au sujet du repérage des publics en recherche d'emploi. Les questions de mobilité, de logement relèvent aussi de nos compétences. Elles sont au cœur de la problématique de notre territoire, qui est dynamique mais qui malgré tout connaît des problèmes d'emploi de longue date, même si la situation s’améliore. Les objectifs affichés rentrent complètement dans notre projet de territoire et les moyens qu'on a mis en place. » En Aunis Sud, la priorité porte sur les demandeurs d’emploi de très longue durée, qui ont déjà fréquenté les structures d’insertion. Avant même de travailler le projet professionnel ou la formation, il s’agit déjà de les remobiliser et de leur redonner de la confiance. Dans cet esprit, des démarches ont été engagées avec les structures d'insertion pour créer des passerelles avec les entreprises, et outiller les conseillers. La présence du Greta comme organisme de formation au sein du consortium présente l’avantage d’associer l’éducation nationale au projet, et de s’adresser à la fois aux jeunes et aux adultes en formation. Il permet également d’impliquer le rectorat dans le but de mettre en place des actions de découverte des métiers auprès des collégiens. Même logique en ce qui concerne les établissements comme le lycée polyvalent de Surgères, qui voit dans ce projet la possibilité de toucher les trois types de public qu'il accueille, à savoir les jeunes en formation initiale, les apprentis dans le cadre de son UFA, membre du CFA académique, et les adultes en formation continue. « L’Éducation nationale nous demande d’adapter nos formations aux besoins économiques du territoire, » ajoute Vincent Rulié, proviseur. « Nous apportons notre pierre à l’édifice et, en retour, nous bénéficions de l'expertise des entreprises pour développer notre offre afin qu’elle soit plus en adéquation avec leurs besoins. On s'appuie sur des référentiels existants mais, en l'occurrence, il va peut-être falloir les écrire ou les inventer » Aujourd’hui, les diplômes et titres sont utilisés partiellement avec quelques « écarts », en ne gardant que le contenu pédagogique qui correspond aux besoins de l'entreprise. Des certifications plus adaptées, préparées par la Fédération des Industries Nautiques, sont en cours de validation par France compétences. Pour Frank Bonot, « il ne faut pas être dans une logique propriétaire. Les salariés n'appartiennent pas aux entreprises, notre rôle est de monter les gens en compétences. A nous d'être mieux disant dans les conditions d'emploi, d'être beaucoup plus attractif. Ça peut bénéficier aux autres acteurs du secteur, voire à d’autres secteurs. La logique n'est pas que dans un sens, on peut aussi récupérer des personnes qui ont acquis des compétences dans d’autres activités. » Dans cet esprit, le groupe Fountaine Pajot2 a créé un organisme de formation interne « l’Institut des Talents Nautiques » afin d’accompagner la montée en compétence des salariés et de fidéliser les nouveaux entrants. Attirer vers le nautisme Aujourd’hui, l’industrie du nautisme est méconnue ou ne bénéficie pas forcément d’une bonne image. Pour remédier à ce déficit d’attractivité, les pistes envisagées sont diverses : travailler sur la « marque employeur », améliorer les conditions d'accueil des stagiaires et des salariés dans les entreprises, faire découvrir les métiers par l’intermédiaire d’un certain nombre de relais, au premier rang desquels les prescripteurs. Mais aussi les parents, qui ont besoin d’être rassurés sur les débouchés des formations. Pour casser les idées préconçues, les partenaires s’accordent à penser qu’il faut donner à voir, proposer des visites d’ateliers, des journées portes ouvertes, exposer les techniques modernes de fabrication et les produits finis que sont les bateaux. Montrer que les accastilleurs, opérateurs techniques, menuisiers, contribuent à créer des produits de prestige. Pour ce qui concerne le repérage des publics, les partenaires vont élaborer des fiches par métier, présentant les compétences, les aptitudes nécessaires, l'offre de formation initiale et continue. Ils vont également concevoir des ateliers de découverte métiers mobiles. « L’idée est que nous choisissions quelques villes sur le territoire de la CDC Aunis Sud afin d’aller vers les publics. A partir de septembre, nous prévoyons de nous déplacer avec quelques outils, des supports techniques manipulables et numériques. Notre but est de donner envie aux jeunes et aux adultes d’en savoir plus, de venir visiter les entreprises, puis éventuellement de se projeter vers une formation et un emploi. » Au-delà des membres du consortium « Embarquez dans la filière nautique », ce projet permet une synergie avec l’ensemble des acteurs du territoire : Structures de l'Insertion par l'Activité Économique, France Travail, Rectorat, lycées, Comités Locaux École Entreprise, associations 3, etc. Les premiers résultats sont perceptibles au travers des relations engagées autour des projets créant, une nouvelle façon de travailler ensemble qui produit déjà des effets sur les prescripteurs dont les perceptions de l'entreprise et du milieu du nautisme en général ont évolué. L’appel à projet IFPAI est le catalyseur d’une véritable synergie entre toutes les parties prenantes, les acteurs économiques, les opérateurs de l'emploi. Il permet de créer des rencontres, une meilleure coordination, la mise en commun de moyens. Selon Patricia Meignen, « il y a une prise de conscience que le système qui a prévalu jusqu'ici a atteint ses limites. Le terreau était là, ainsi que les volontés et les constats partagés. Mais sans l’appel à projets, je pense qu'on n’aurait pas avancé aussi rapidement. » 1 Le consortium est composé des constructeurs Fountaine Pajot et Dufour Yachts, des équipementiers APPEP et Pochon, du Greta Poitou-Charentes, de la communauté de communes Aunis Sud, et de la Fédération des Industries Nautiques (FIN). 2 Le groupe Fountaine Pajot est notamment composé des chantiers Fountaine Pajot et Dufour Yachts 3 Ocean peak, Fondation Fier de nos Quartiers

|
Scooped by
Cap Métiers NA
April 4, 2024 7:27 AM
|
Après Angoulême, Cognac, Rochefort, le dispositif 100 chances 100 emplois est développé à La Rochelle depuis la fin 2023. Cette action est financée par le conseil départemental de la Charente Maritime et l’Etat. Deux sessions ont déjà eu lieu l’année dernière, quatre autres ont été programmées pour 2024. Le programme est porté par une association nationale du même nom. Elle s’associe aux missions locales un peu partout en France, en tant que structures spécialistes de l'accompagnement des jeunes. « Avant cela, nous avions mis en place du parrainage simple, » précise Juliette Foussal de Belerd, chargée de relation entreprise de la mission locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis. « Il fallait le redynamiser, lui donner une autre envergure. Nous faisions de l'individuel, alors que nous sommes là sur une approche de groupe. Finalement, c’est une nouvelle forme de parrainage. Les entreprises sont toujours prêtes à venir en soutien, on sent qu’il y a une envie de participer, d’aider des jeunes ou des moins jeunes. Le principe de l’action reprend donc dans ses grandes lignes celui du parrainage, c’est-à-dire s'appuyer sur des entreprises qui apportent leur regard, leur expertise, la dimension professionnelle et de connaissance des métiers. Pour Martine Touron, chargée de projet "Emploi" leur implication dépasse la logique de ressources humaines. « On sent que les entreprises ont envie de s’impliquer en ayant un rôle auprès des jeunes, ce n’est pas seulement lié à leur politique en matière de responsabilité sociale. Les jeunes changent, les entreprises changent, les besoins aussi. Notre rôle à la mission locale, c'est d’être à l'écoute de tous et de rebondir. » Le rôle des entreprises Le projet 100 chances s’est mis en place assez rapidement, puisqu’il s’intégrait naturellement dans la dimension de relations entreprises de la mission locale. « En juin 2023, nous avons eu un petit déjeuner avec quelques employeurs pour trouver nos deux copilotes, l’agence d’emploi CRIT et la société Foundever. En septembre, nouvelle rencontre avec une cinquantaine d'employeurs de tous secteurs et de partenaires, afin de leur présenter le dispositif, en présence de la responsable régionale de 100 chances 100 emplois. Notre message était que nous avions besoin d'eux pour que ça fonctionne dans l'intérêt des jeunes. » Pour les inciter à s’engager, plusieurs arguments sont présentés aux entreprises, comme sourcer leurs employés de demain, développer leur marque employeur, apporter leur contribution au développement économique et social du bassin d'emploi rochelais. La société évolue, les employeurs également, puisque les recruteurs d’aujourd’hui n’ont pas exactement la même vision des choses que leurs ainés. « On constate que le regard a changé vis-à-vis des jeunes, même s’il peut subsister quelques a priori. Je pense qu’il y a aussi une curiosité, une envie de rencontre. Quand on fait venir une trentaine d'entreprises, on voit aussi qu'elles échangent entre elles. C’est peut-être en partie un effet post Covid. » Avant chaque session, une réunion d’information collective est organisée, au cours de laquelle le fonctionnement du dispositif est présenté aux jeunes intéressés. Les candidats sont ensuite reçus individuellement, afin d’évaluer leur motivation. Aucun prérequis particulier, il faut cependant qu’ils aient un projet professionnel en tête, et la capacité de tenir toute une semaine, de 8 à 18 heures au sein d'un groupe d’une dizaine de personnes, pour pratiquer des exercices de développement personnel. De leur part, il s’agit d’un véritable engagement. L’action consiste d’abord en une semaine de coaching, encadrée par un partenaire extérieur, en l’occurrence Adecco training, qui effectue principalement des tests de développement personnel. La coach travaille avec chaque jeune pour débloquer certains freins et le préparer à se présenter individuellement devant des professionnels. Le jeudi après-midi, une vingtaine d’employeurs se déplacent pour proposer des simulations d’entretiens aux jeunes auxquels ils délivrent de nombreux conseils. Les jeunes prennent la parole Le vendredi matin, la coach livre ses conclusions, sur le déroulement de la semaine, comment elle a été vécue par chaque jeune, son projet professionnel, ses freins, ses atouts. Toutes ces informations sont restituées dans des livrets distribués aux acteurs économiques. Le mardi marque la fin de la session où les entreprises assistent au « pitch » final des jeunes, c’est l’occasion d’échanger sur leur projet professionnel. « Les présentations sont suivies d’un cocktail, au cours duquel les jeunes et les employeurs s’échangent leur carte de visite, ont des entretiens informels, abordent tout type de sujets. La finalité c'est de faire bouger des choses, de rassembler. Les jeunes ont besoin d'une écoute. Et surtout de réseaux professionnels pour s'insérer. Cette expérience leur permet de faire des rencontres qu’ils n’auraient pas eues autrement » La plus-value du dispositif réside dans le fait que, pendant une semaine, les participants travaillent ensemble en groupe d’une dizaine de personnes, plutôt qu’en accompagnement individuel. Autre intérêt majeur, celui de rassembler au même endroit une quarantaine d'acteurs économiques pour trouver des solutions au contact des jeunes qu’ils rencontrent. L’exercice final de présentation est un véritable travail, qui mobilise toute leur énergie. « Prendre le micro pour parler devant un parterre d'entreprise n’a rien d’évident. Certains se révèlent à ce moment-là, ils ressentent une grande satisfaction d'avoir réussi à le faire. Surtout si on compare leur attitude lors des entretiens que nous avons eus avec eux avant. Nos collègues qui les accompagnent sont très épatées par les résultats. Certains vont s'en emparer, continuer dans cette voie, d'autres non. Ça peut aussi faire sens des mois après. » « L'idée c'est bien évidemment qu'il y ait un maximum de jeunes qui partent avec une solution, une formation, un emploi, une immersion, un départ à l’étranger, etc. On continue à les accompagner. Il arrive qu’ils changent de projet professionnel grâce à leurs échanges avec les professionnels qui leur ont montré d'autres pistes. » Le dispositif est trop récent à La Rochelle pour en faire déjà l’évaluation. Mais c’est un succès au regard de la participation des entreprises, qui va se poursuivre par l’entremise d’un partenariat avec le club d’entreprises de La Rochelle. Le pitch final se fera au sein d'une entreprise adhérente du club. « Nous sommes vraiment au cœur du système économique. Ça réaffirme le travail mené par la mission locale. C’est une satisfaction pour nous. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
March 21, 2024 6:42 AM
|
De la valorisation en insertion
L’entreprise d’insertion Asmaco, pour ASsociation MAtériaux COnfluent, est née en 2022 d’une rencontre fortuite, un déjeuner au cours duquel est évoqué un problème rencontré par un grand distributeur, Cdiscount. Il concernait leurs produits refusés à la livraison, retournés après avoir été déballés, ou dont l’emballage était endommagé. Seule solution à l’époque, revendre la marchandise à vils prix à des soldeurs. Mais l’entreprise avait la conviction qu’il était possible de pousser bien plus loin le niveau de valorisation, et que ces produits avaient plus de valeur que ce qui en était tiré. Pour Thomas Pinet, directeur général du Groupement d’Insertion du Confluent (GIC), c’était l’occasion de proposer une nouvelle approche à l’entreprise. « Nous les avons rencontrés pendant une journée pour évoquer le projet. A l’issue, nous avons décidé de tenter l’expérience. Deux mois plus tard, nous avions le local, le premier salarié, la demande d'agrément était faite pour avoir le conventionnement en tant qu’entreprise d'insertion. Et puis c'était parti. C'est un peu notre raison d'être dans l'Insertion par l’Activité Economique, de créer des modèles alternatifs, et de répondre à des sujets que l'économie classique ne sait pas traiter. » « L’entreprise ne connaissait pas l’IAE, notre discours a été simple : retenez ce qu'on fait, que vous trouvez bien, pas besoin que vous deveniez des pros de l'IAE pour qu'on puisse travailler ensemble. En plus de ça, la seule chose qui nous intéresse, c'est de créer de l'emploi non délocalisable, en insertion. Vous avez un problème, nous avons la capacité de vous proposer un modèle un peu innovant et structurant, faites-nous confiance et on aura quelque chose de plus vertueux demain. » Le GIC a choisi de créer une nouvelle association à part entière, intégrée au groupement. Activité principale d’Asmaco, recevoir des meubles neufs, jamais montés, si besoins retapés au sein d’un véritable atelier de menuiserie entièrement équipé. Tous les types de meubles peuvent être pris en main, du gros dressing d'angle à la chaise, en passant par le lit, le canapé, la commode ou la table. En moyenne, 90% des produits sont ainsi valorisés, bien au-dessus des 60% initialement évalués pour équilibrer le budget prévisionnel demandé par la DDEETS. Contrôle qualité Choix a été fait, dans un premier temps, de monter tous les meubles reçus, afin d’apprendre à repérer ce qui fonctionne ou pas, d’être capable de contrôler l’état d’un carton. « Aujourd’hui, nous avons deux schémas de fonctionnement. D’abord, nous vérifions si le produit est complet. S’il n'a aucun défaut, on ne le monte pas. Mais à partir du moment où il manque de la visserie, qu’il a un coin cassé, là on va l’assembler, reprendre ce qui est nécessaire. Aujourd’hui, nous sommes plutôt à 70% des meubles montés. » Pour ce faire, Asmaco a intégré des compétences nouvelles, en la personne d’une encadrante technique menuiserie, en capacité de retaper les meubles. Pour organiser le flux sortant, la solution le Bon coin s’est avérée la plus efficace. Les meubles sont pris en photo, les annonces mises en ligne par une personne en insertion chargée de les actualiser régulièrement. Grâce à ce process, tous les produits partent en moins de 30 jours. Les ventes se font en direct à l’atelier, sur le site d'Aiguillon (Lot-et-Garonne). Pas d'expédition, afin d’éviter d’avoir à gérer des problèmes de logistique. Le prix des meubles est inférieur de 30% à ceux affichés sur le site de Cdiscount. Les bénéficiaires du RSA, les primo arrivants, les personnes en situation de violences conjugales, les salariés des structures d'insertion du département, ont droit à 20% de remise additionnels. Asmaco maîtrise désormais les flux entrants et les flux sortants. Sa priorité actuelle est de trouver un volume conséquent de marchandises à valoriser, afin de poursuivre son développement. « Notre partenaire était prêt à nous accompagner étape par étape, sur une expérimentation de 12 à 18 mois. Il nous a vraiment accordé du temps. Pendant plus d'un an, ils nous ont livré gratuitement les produits pour que l’on construise le modèle, qu’on le teste, que l’on consolide aussi nos apports financiers avant d'aller un peu plus loin. Nous avons pu choisir le rythme et la nature des livraisons. Aujourd’hui, nous avons la capacité d’absorber 40 produits par semaine. Si nous voulons aller au-delà, il faudra sans doute embaucher et nous agrandir. Mais nous avons encore un peu de marge là-dessus. » La structure compte 3 personnes, qui ont toutes suivi les formations Caces et sauveteur secouriste du travail. Une réflexion est en cours sur l’intérêt de leur faire suivre également la formation d’agent valoriste proposée par le Cluster Economie circulaire et valorisation des matériaux recyclables à Damazan. « C’est le tronc commun sur lequel on peut ajouter des formations individuelles, en fonction des projets professionnels de chacun, plutôt autour des métiers de la logistique. Mais si certains sont bons sur la partie menuiserie, pourquoi pas basculer sur des formations de menuisier si cela peut répondre à des besoins. » Respecter l'esprit IAE Thomas Pinet estime que pour que le modèle réussisse, il faut qu’il atteigne un volume d’activité suffisant. Mais pas trop pour que la structure ne soit pas confrontée à un dilemme, qu’elle n’ait pas à faire un choix entre les produits à valoriser et ceux qui seront jetés à la benne. « Nous devons respecter nos indicateurs : les 90% de valorisation, pas d'ouverture le samedi, pas d'horaire de magasin, pas d’expédition. Ce sont eux eux qui garantissent qu'on n'est pas sur le secteur marchand et concurrentiel. C’est notre raison d'être, ce qui fait que nous ne sommes pas une structure comme les autres, qui pratique vraiment l'insertion sociale, sans chercher la rentabilité. » A terme le modèle économique reposera sur l’achat de produits plutôt que sur la récupération. C’est déjà en partie le cas aujourd’hui. « Pour moi la garantie que le modèle perdure, c’est d'aller chercher le flux entrant, parce qu’on a constaté que tout se vendait. Pour la suite, nous allons essayer de développer notre modèle avec d'autres acteurs pour essayer de récupérer et revaloriser tout ce qui peut l’être. Nous avons eu des premiers échanges avec Conforama, pour diversifier nos partenaires, ne pas dépendre que d’un seul. Il y a aussi beaucoup d’appels à projets sur le réemploi, comme la mobilité il y a 10 ans. Mais je pense qu'il ne faut pas dépasser les 20% de financement public. » Asmaco envisage que son exemple soit dupliqué un peu partout en France. Mais elle n’a pas vocation à s’occuper elle-même de cet essaimage. Elle peut en revanche identifier des acteurs qui auront la capacité de le faire. Elle ouvre d’ailleurs ses portes à d’autres structures qui viennent passer une ou deux journées sur place pour en savoir plus sur le fonctionnement et repartir avec des pistes de travail. « Ce n'est pas notre rôle d’installer des Asmaco partout dans l’Hexagone. Je ne connais pas les autres territoires, je n’ai pas d’ancrage sur place, je ne sais pas qui fait quoi. Arriver de nulle part alors qu’il y a peut-être déjà des gens qui ont déjà la même activité, ça n’a ni queue ni tête. Les structures qui sont venues nous voir de Marseille ou de Rouen, des structures d'insertion également, ont été contactées par Cdiscount, toutes avec le projet de s’inspirer de notre expérience et de l’adapter à leurs réalités locales. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
March 7, 2024 9:50 AM
|
L’E2C Limousin ouvre ses portes
Depuis une quinzaine d'années, en plus de ses activités de formation classiques, le CFPPA Les Vaseix-Bellac développe une filière insertion et cordonne des actions sur l'accompagnement au projet professionnel et à la remise à niveau. Dans le cadre d'une analyse des dispositifs existants, le centre avait constaté qu'il n'existait pas d’Ecole de la 2e Chance (E2C) en Limousin. Alors que, pour Annie Demay, responsable développement, le concept correspondait exactement aux valeurs du centre. « Nous avons l’expérience de dispositifs comme Socle de Compétences, Amorce de parcours, PAIR (Intégration Professionnelle des Réfugiés)… et on a créé une formation appelée Equilibre, qui aide les personnes à reprendre confiance en elles, en utilisant des pédagogies innovantes comme l'équimédiation, une conseillère en image, une sophrologue, une psychologue, etc. » L’E2C est donc apparue comme une suite logique du travail engagé en réponse aux besoins du territoire, de disposer d’un service de proximité pour accompagner les demandeurs d'emploi vers la formation qualifiante ou l’emploi. La réflexion initiale s’est poursuivie avec le réseau national des E2C, des visites de plusieurs autres écoles en (Châtellerault, Nevers) pour échanger et s’inspirer de leurs expériences. Ce travail préparatoire s’est concrétisé à l’occasion d’un appel à manifestation d'intérêt lancé au printemps 2023*, donnant lieu à la création de la nouvelle école. Il s’agit d’une entité juridique à part, qui bénéficiera de l'ensemble des supports et des centres techniques du CFPPA. Deux sites sont prévus, un en Haute-Vienne au Vaseix, l’autre en Creuse à La Souterraine où l’école sera située dans les locaux de la maison de l'emploi de la formation, qui accueille déjà tous les acteurs locaux. « Nous avons une roseraie, un atelier maraîchage, une forêt domaniale dans laquelle les jeunes vont pouvoir faire du sport, un centre équestre pour faire de l'équimédiation, un pôle économie sociale et familial pour travailler, par exemple, sur des notions mathématiques par le biais de recettes de cuisine. Avec notre théâtre de verdure nous pourrons non seulement faire du théâtre, mais aussi des cours de français en extérieur. On est vraiment dans un cadre verdoyant aux portes de Limoges, une bulle à part dans laquelle on va permettre aux jeunes de se reconstruire. Nous avons beaucoup réfléchi aux façons de leur proposer quelque chose de différent du système scolaire dans lequel ils ont vécu. » Des conditions idéales pour tous « Nous avons l'expérience de l’insertion, de l’apprentissage, de la formation pour adultes. Nous connaissons bien les publics, notamment les différentes formes de handicaps, les troubles dys (dyslexie, dyspraxie, les difficultés de concentration, etc. » Le centre a aménagé chaque lieu pour qu'il ne ressemble pas à une salle de cours, en allant jusqu’à faire réaliser, par un chantier d'insertion, des meubles à l’allure « domestique », afin de mettre à l’aise les apprenants. Ils sont complétés par un matériel propre à faciliter la concentration. Pour lancer l’activité, les premières entrées se sont faites en groupe début mars. Les intégrations suivantes s’effectueront petit à petit en entrées sorties permanentes, pour un objectif d’une centaine de jeunes en 2024. Le parcours moyen dure 7 à 8 mois, 4 mois pour les plus courts. Mais certains jeunes pourront être accompagnés jusqu’à 18 mois. La première étape est un mois d’intégration, suivi par le parcours de formation proprement dit. Lors de cette intégration, les jeunes découvrent une diversité d'ateliers, et sont positionnés en fonction de leurs envies et de leur projet professionnel, aidés en cela par une conseillère en insertion sociale et professionnelle, à temps complet sur le dispositif. Ils pourront ainsi bénéficier d’un parcours à la carte. Le programme prévoit 30 heures par semaine, à l’exception du mardi après-midi consacré aux démarches administratives, et du vendredi matin afin que les prescripteurs viennent rencontrer les jeunes et faire un suivi avec eux. Pour mettre à jour leur dossiers, ils sont en autonomie, mais le centre leur donne des consignes de travail sur leur recherche de stage, les bilans de santé, les démarches CAF et France travail, etc. « Avec notre équipe pédagogique nous avons construit et planifié un ensemble d'ateliers, par exemple de remise à niveau en français, en mathématiques, de travail en collectif, des objectifs personnels. » Les stages en entreprise représentent 40% de l’ensemble. La pédagogie repose beaucoup sur les expériences et les compétences acquises lors de ces périodes. La Ligue de l'enseignement s’occupera du sport et de la partie laïcité, et des intervenants extérieurs viendront animer des ateliers dans différents domaines : des chefs d'entreprise pour la création d'entreprise, une conseillère en image, un kinésiologue, des bilans de santé avec le CRESLI (Centre Régional d'Examens de Santé du Limousin), un atelier graphe pour aborder la dimension culturelle mais aussi scientifique (recherches, application de la peinture, etc.). Rien n’est figé, en fonction des besoins, de nouveaux ateliers peuvent être créés et leur contenu modifié à tout moment. Reprendre confiance en soi L’E2C du Vaseix s’adresse aux publics des quartiers prioritaires, des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les bénéficiaires du RSA ou RQTH), qui ont totalement perdu confiance en eux, soit en raison de problèmes scolaires, de problèmes relationnels ou familiaux. La majorité d’entre eux ne devraient pas connaître de problèmes de mobilité, puisque le centre est à proximité du réseau de transport en commun de Limoges. Le site de La Souterraine, en centre-ville est lui aussi facilement accessible. « On aimerait pouvoir rendre le service disponible à tous les jeunes qui habitent en territoire rural, mais pour l'instant ça ne sera pas le cas. » « Nous organisons des informations collectives, ou on se déplace dans les quartiers pour présenter le dispositif. C’est à ce moment que l’on vérifie si les jeunes adhèrent ou pas. En général, leur conseiller leur en a déjà parlé, mais ils peuvent avoir besoin d’informations complémentaires. Ensuite, on fait un entretien individuel avec un responsable de formation et une secrétaire administrative pour passer en revue leur situation, lister les premiers freins à l'intégration en formation. C'est un public très volatil, si on ne les intègre pas dans les 72 heures, ils sont perdus. » Pour l’instant, les garçons sont majoritaires. Mais le centre ambitionne d’atteindre la parité. « On sait que les filles ont les mêmes besoins, mais ont tendance à les cacher. Elles intègrent moins les dispositifs, elles essaient de se débrouiller seules. Il va falloir faire attention à communiquer spécifiquement pour le public féminin. Il faut aller vers elles, plus que vers les garçons, dans les associations sportives et culturelles qu’elles fréquentent, utiliser les réseaux sociaux, et sensibiliser les prescripteurs. » « Ce que nous voulons pour l'école c'est travailler main dans la main avec nos partenaires, que le jeune ne soit pas baladé d'un dispositif ou d'une structure à l'autre. Nous proposons le fil rouge et le prescripteur peut l'accompagner tout au long de de la formation. Notre objectif, c'est d'être un maximum sur l'individualisation. Nous ferons des projets collectifs mais il n’y aura pas d'entrée date à date. » L’E2C des Vaseix n’est pas encore labellisée. Pour obtenir cette reconnaissance, elle doit d’abord faire ses preuves, notamment en accueillant une cinquantaine d’apprenants. Un audit de labellisation interviendra en avril, à l’issue duquel elle disposera d’un logo personnalisé et pourra afficher officiellement son appartenance au réseau national. * Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, FSE, Département de la Creuse, Communauté Urbaine de Limoges Métropole, Communauté de Communes du Pays Sostranien, Communauté d’agglomération du Grand Guéret.

|
Scooped by
Cap Métiers NA
February 22, 2024 5:49 AM
|
Mécanique au féminin, l'outil AFEST
EVOLPRO est un laboratoire d’innovation sociale pas comme les autres, ne serait-ce que parce qu’il ne se positionne pas dans le champ concurrentiel. Son crédo est le développement du pouvoir d'agir, l'éducation populaire, l’accès de tous aux dispositifs de droit commun. « Notre cœur d'activité, c'est d'accompagner les professionnels, tous les acteurs dont l'activité a un impact sur d'autres, » précise Olivier Chabot, secrétaire général d’EVOLPRO. « Parmi eux, il y a les structures d'insertion, les organismes de formation, les métiers du conseil et de l'accompagnement, les métiers du sport, le métier du soin, les syndicalistes, les ressources humaines. » C’est dans ce cadre que l’organisme a été contacté en 2023 par une structure d’insertion, Apreva 47, qui envisageait de mettre en place une Action de Formation en Situation de Travail (AFEST) au sein d’un de ses garages solidaires. Avec dans l’idée de développer la mixité, d’accueillir des femmes dans un milieu très masculin, celui de la mécanique. La réponse d’EVOLPRO, architecte de cette action, s’est faite à plusieurs niveaux. D’abord sur le principe de démontrer que tout est possible avec un accompagnement de qualité. Et puisque le garage solidaire est situé en QPV, l’action s’adresse à des femmes issues de ces quartiers. Ce sera l’occasion de sensibiliser le garage à la question de la neutralité de genre. De plus, comme le métier évolue avec les enjeux de transition énergétique, ce sujet sera également pris en compte. « Notre plus-value, elle est là-dessus. Cette vision holistique des choses, très large. On ne s’enferme pas dans une catégorie, dans une case comme c’est trop souvent le cas. » Parier sur un potentiel EVOLPRO travaille étroitement avec le GPV rive droite dans le cadre de la cité de l'emploi, à Bassens, Cenon, Floirac et Lormont où est situé le garage. Aller chercher des femmes issues des QPV pour les accompagner dans une structure d'insertion, c’est une façon de démontrer le potentiel des habitants et des habitantes de ces territoires. « On ne peut pas réduire les gens à des catégories et à des cases liées aux politiques de la ville. On ne nie pas les difficultés, au contraire. On a affaire à des personnes qui ont des parcours singuliers, qu’il faut prendre en compte à partir de leur potentialité. » La formation baptisée « Femmes et mécanique » se déroulera entre début mars et début juillet. Elle mobilisera un groupe d’une dizaine de femmes qui rencontrent des obstacles en matière de mobilité et de garde d’enfants. Leur profil, être demandeuse d'emploi de longue durée issues des QPV de la métropole de Bordeaux, savoir s’exprimer et comprendre oralement le français, idéalement être titulaire du permis B, ne pas avoir de contre-indication médicale liées aux métiers de la mécanique, être disponible, volontaire et capable de s’engager dans une action collective. Le système sera adapté à leurs besoins et contraintes. « Nous ne sommes pas des consultants, ce qui nous intéresse c'est vraiment de faire bouger les choses. Il faut expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de penser le monde. On s'est beaucoup intéressé aux tiers lieux, qui défendent une façon de travailler autrement. Nous, on défend une façon d'accompagner autrement, pour démontrer que d'autres modèles sont possibles. C’est pour ça que nous menons tous nos projets en partenariat, on essaie d'aller chercher des structures qui partagent nos valeurs, ce qui ne se résume pas à gagner de l'argent. » La mise en place d’une AFEST réclame une ingénierie pédagogique très structurée. Son principal intérêt étant de faciliter des parcours, notamment pour des personnes éloignées de l'emploi à qui la formation peut faire peur. EVOLPRO aurait pu s'en tenir à simplement appliquer le référentiel de mécanicien polyvalent, mais il a décidé d’y intégrer la certification Cléa. « Il existe un enjeu autour de la lutte contre l'illettrisme, et dans la reprise de confiance en soi. Avec Cléa c’est l’assurance de sortir de l’action avec au moins un diplôme, d’identifier certaines difficultés comme la maitrise du français, le travail en équipe, la posture d'apprendre à apprendre, etc. C'est redonner de l'espoir et se projeter dans l’avenir. » « De manière globale, nous n’avons pas une vision adéquationniste de la formation. Les compétences ne sont pas juste un verre vide à remplir. Nous privilégions plutôt l’image du silex sur un fétu de paille. Je fais partir un feu, et après je souffle dessus. On commence par faire des étincelles, l'accompagnement consiste ensuite à entretenir ces feux. » L’accompagnement concerne également les hommes qui travaillent déjà dans le garage, qui n’ont pas forcément l'habitude de côtoyer des femmes dans leur quotidien professionnel. Travailler sur la mixité dans un métier traditionnellement masculin est un chantier en soi, qui nécessite un acte volontariste. EVOLPRO a fait appel au CIDFF Gironde pour animer des ateliers de sensibilisation. De plus, lorsqu’il s’agit de convaincre un public de partir en formation, on multiplie les difficultés. « Le fait de découvrir un métier en l’apprenant dans une situation de travail, d’évoluer au quotidien dans un environnement de travail, optimise les chances de réussite. En même temps, ça permet de dédramatiser, de démystifier tout l'aspect formation. L’AFEST peut être sécurisante et facilitante justement parce qu’elle ne se déroule pas dans un organisme de formation. » Un programme adapté Le programme « Femmes et mécanique » dure 14 semaines, à l’exception du mercredi. Il comprend une phase de découverte des métiers et l’apprentissage des compétences techniques nécessaires pour réaliser toutes les actions de préparation d’un véhicule, diagnostiquer une panne, être capable de communiquer en situation professionnelle auprès des fournisseurs, etc. S'agissant de Cléa, les sessions, animées par l’organisme Retravailler Sud-Ouest, seront délocalisées dans un organisme de formation, afin d’habituer progressivement les participantes à entrer dans un cadre de formation plus classique. « Pour nous l’insertion, c’est vraiment accéder au droit commun, mais pas de force. Il y a deux façons de faire rentrer un cube dans un trou rond, soit on gomme les coins du cube et on en fait une boule, soit on agrandit le trou. Ce que nous voulons c’est arriver petit à petit à ce que la formation s'adapte aux besoins des gens. Nous travaillons beaucoup sur la notion d'appétence, qu’il nous semble importante à valoriser. Mais on ne veut pas se limiter à la projection vers un métier, on veut ouvrir les possibles. Quelqu’un qui vient faire cette formation peut reprendre confiance, retrouver de l’espoir en l’avenir personnel et professionnel, valoriser des compétences sur son CV, etc. » A l’issue de la formation, les participantes pourront envisager de continuer sur un parcours d'insertion, de formation, ou un emploi dans les métiers où les connaissances et compétences en mécanique peuvent être un plus, comme le transport ou la livraison. Plus largement, l’objectif est de leur donner les moyens de reprendre leur vie en main. « Au-delà du modèle économique, nous voulons absolument démarrer l’action. Même s'il n’y avait que 2 ou 3 candidates, si ça répond à des appétences, que ça permet de redonner de l'espoir, il faut y aller. Notre ambition est de changer le monde. Mais on sait qu'on ne va pas le changer comme ça, que ça peut faire peur. Il faut s'autoriser à être utopique, sans être arrogant. On est plus nombreux qu’on le croit à partager cette approche mais, souvent, le système impose aux opérateurs de faire les choses chacun de leur côté. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
February 8, 2024 8:54 AM
|
L’AFEST comme solution de recrutement pour le secteur médico-social
Le Groupement d'Employeurs Médico-social de la Creuse (GEMS 23) existe depuis 2016. Il compte aujourd’hui une cinquantaine de salariés et plus de 25 structures adhérentes représentant une soixantaine d'établissements de tailles diverses. Son cœur de métier est la mise à disposition d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’aides-soignants, de surveillants de nuit, d’agents de nettoyage, dans le cadre de remplacements prévisibles ou d’urgence. En 2023, cela représente 66 000 heures de mise à disposition, environ 50 équivalents temps plein par mois. Dans le cadre de ses différentes actions, dont la formation, le groupement fait face à des problématiques de repérage et de recrutement que connait l’ensemble du secteur médico-social. Ces difficultés ont été le point de départ d’une réflexion sur la recherche de dispositifs permettant de répondre à ces besoins. L’AFEST ((Action de Formation En Situation de Travail) faisait partie des hypothèses. D’autant qu’elle pouvait potentiellement apporter une réponse à la question du déficit de personnes diplômées ou certifiées pour alimenter les écoles. De ce fait, le GEMS a présenté un dossier à l’appel à projets régional sur l’AFEST, qui a été retenu fin 2022. « L’AFEST nous plaisait de par sa proportion 70% en entreprise, 30% en actions de formation, » explique Fabien Devillechabrolle, chargé de développement. « Cet équilibre est intéressant pour les profils que nous visons, essentiellement des demandeurs d'emploi, que nous voulons amener vers un bloc de compétences assez large. » En l’occurrence, le bloc de compétences est celui de maîtresse de maison, qui permet d’inclure différents profils pour aller vers une certification, ou vers des métiers comme agent de nettoyage ou surveillant de nuit. Capter les futurs salariés Parmi d’autres dispositifs, l’AFEST a été retenue en raison du fait qu’elle permet de « capter » des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi, de les rendre employables. Et le cas échéant de les emmener vers des formations certifiées et diplômantes, comme celles d’AES ou d’aide-soignant. Pour Nathalie Lefebvre, coordonnatrice du GEMS, « il fallait trouver un système qui nous permette de trouver des capitaux pour les former. Les autres dispositifs n’offrent pas cette possibilité d'aller immédiatement dans l'entreprise pour prendre la mesure des différentes tâches à réaliser. Ainsi qu’un apport théorique adapté aux publics dont beaucoup ne sont pas du métier, pas formés, et que nous pourrons amener au métier petit à petit, avec un accompagnement en doublon pour réapprendre le rythme du travail. Puis pour les mettre à disposition dans les établissements. » Tous les CV réunis doivent être validés par la Région afin de vérifier leur compatibilité avec les critères d'éligibilité de l'action (niveau de formation infra bac, zone de revitalisation rurale ou QPV, éventuellement demandeurs d'emploi). Aucun prérequis sur l'origine sociale et socioprofessionnelle, contrairement aux établissements qui ont des exigences d'efficacité immédiate. « Sur le principe, nous recevons tout le monde, même des gens qui peuvent être extrêmement loin de nos apprenants habituels, ce qui permet d'ouvrir l’action à des profils inattendus. » Les candidats se présentent parfois sur prescription, mais le groupement a effectué son propre repérage en participant à des événementiels, des salons organisés par ses partenaires. « Pour la détection des candidats nous fonctionnons assez différemment des collègues organismes de formation qui recrutent uniquement pour l’AFEST. Après avis de la Région, nous validons avec les candidats s'ils veulent suivre la formation. » Parmi les personnes rencontrées, beaucoup ne savent rien du secteur, sont en reconversion ou cherchent à travailler, quel que soit l’emploi. De plus, le métier de maîtresse de maison est très peu connu. « Nous leur expliquons que ce métier se situe à la frontière entre l'entretien et l'éducatif, qu’il fait partie de l'équipe éducative de façon pleine et entière. Souvent ils sont intéressés. Autant surveillant de nuit ou accompagnant éducatif et social, ils ont une petite idée, autant maitresse de maison est pour eux une vraie découverte. » Le déroulé pédagogique a été élaboré avec le CFA de la CCI de la Creuse. Il comporte plusieurs grandes phases en commençant par la prise en compte du contexte d'intervention, la présentation des établissements, des agents de service à domicile, de différents métiers, les types de handicaps, leurs causes et leurs effets possibles, le développement psychomoteur, etc. Suivent notamment la qualité et la sécurité du cadre de vie, ou encore l’élaboration de son identité professionnelle. Les enseignements théoriques alternent avec les périodes en entreprise, au sein des structures adhérentes du groupement. Pousser à la découverte des métiers Les structures d’accueil ont toutes signé une lettre d’engagement avant le dépôt du projet. Elles doivent disposer d’un référent AFEST et d’une personne compétente pour accompagner au plus près les stagiaires. La volonté du groupement est que chacun d’entre eux essaie au moins deux environnements professionnels. « Nous restons vigilants quant à la capacité de la personne à s’adapter à la structure, en tenant compte de leurs goûts, leurs appétences, leurs compétences. L’idée est d’éviter de perdre des gens s’ils n’arrivent pas à s’y adapter, parce que parfois ça ne fonctionne pas. Certains iront plus facilement vers le soin, d’autres vers l’éducatif. Cela dit, nous tenons vraiment à leur faire essayer des structures sur lesquelles ils n’ont pas envie d'aller au départ, pour les aider à sortir des représentations parfois faussées. » A l’issue de la formation, en cas de réussite, les stagiaires obtiennent la certification de maître/maîtresse de maison et peuvent idéalement évoluer dans toutes les structures. Si les besoins sont plutôt sur des postes d'aide-soignante ou d’AES, ils peuvent être intégrés en tant que « faisant fonction », l'idée étant vraiment de les amener à ce qu’ils poursuivent leur formation et qu’ils travaillent en Creuse. Avec la première promotion AFEST qui a commencé en janvier pour un groupe de 8 apprenants, 2024 est une année d’expérimentation. A terme, l'objectif est de mettre en place un pôle territorial de coopérations économique au niveau départemental, une organisation qui permettra de coordonner et répondre à des appels à projets de grande ampleur. Ses adhérents, le GEMS, le GIEQ en cours de création, les tiers lieux, la communauté 360 en Creuse, les instances institutionnelles, disposeraient d’un outil pour faciliter les échanges, mutualiser les services, et déployer plus facilement des actions de la filière médico-sociale à l’échelle du département. « Concrètement, nous pourrons par exemple répondre à une AFEST de façon beaucoup plus importante, afin de la déployer dans plusieurs types de structures. C'est l'une des voies qui permettront peut-être de coordonner et de faciliter tout ce qui fonctionne déjà dans le territoire. On s'aperçoit qu'il y a pléthore de dispositifs, que chacun travaille à sa façon, à son rythme, réalise parfois des actions exceptionnelles, mais dans son propre établissement ou dans sa propre association, sans forcément partager, échanger et déployer chez les autres ce qui fonctionne. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
January 25, 2024 8:17 AM
|
L’Institut National du Cycle et du Motocycle (INCM) est un organisme de formation de branche, spécialisé dans les métiers du deux-roues, moto, vélo et mobilité électrique. Depuis une trentaine d'années, sa mission principale est d'accompagner les entreprises en répondant à leurs besoins en recrutement, par le biais de formations en alternance, de la formation de demandeurs d'emploi ou de personnes en reconversion. Son siège et site principal est situé au Bourget. L’INCM mène également des actions de promotion des métiers et des filières de formation. « Après la crise COVID, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des besoins exprimés sur le territoire national pour permettre le développement de la mobilité décarbonée. Tant sur la partie vente que la partie réparation entretien maintenance et location de vélo » explique Sabrina Kockenpoo, directrice. « Nous orientons notre stratégie en fonction de ce que les professionnels en activité ressentent sur le terrain et nous font remonter. » Depuis 2019, l’organisme ouvre progressivement des antennes dans différentes régions, à commencer par l’Occitanie avec une implantation à Beauzelle, transférée depuis à Toulouse. « On s'est rapidement rendu compte que la formation vélo doit être au cœur de la ville pour être pertinente, aussi bien pour les stagiaires que pour les entreprises. » Ont suivi les antennes de Lyon, Nantes et, fin 2022, La Rochelle. En Nouvelle-Aquitaine, une offre de formation existait à Bordeaux, mais trop éloignée pour répondre aux besoins du bassin de La Rochelle, la ville motrice en matière de développement du vélo depuis des années, notamment sur les flottes de deux-roues en libre-service. Partir des besoins des entreprises Chaque implantation est précédée d’un travail d’étude mené localement pour connaître le besoin des entreprises et s'assurer qu’il est bien réel. La Rochelle et les villes limitrophes comptent une soixantaine d'entreprises de location, d'entretien, de maintenance et de réparation vélo, qui ne disposaient pas de l'offre de formation nécessaire. « Nous avons travaillé avec le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lagord qui a un grand projet de développement de pôle automobile. Nous avons ouvert en novembre 2022 une antenne à échelle humaine, un local de 175 m2 situé à proximité du port de plaisance, de l’université et de la vie étudiante. » Objectif de la nouvelle structure, proposer des formations en entretien et maintenance réparation cycle. Sa caractéristique est d’être modulable pour permettre de dispenser des formations longues ou de plus courte durée, pour un public demandeur d'emploi ou en reconversion professionnelle qui a besoin de se former rapidement pour s'insérer. Sont également proposés des modules de 2 ou 3 jours destinés aux professionnels qui souhaitent se spécialiser dans telle ou telle compétence. « On est plutôt sur de la dentelle, notre objectif n'est pas d'inonder le marché parce que ça n'aurait pas de sens mais d’accompagner les entreprises dans le maintien et développement des compétences. L'aspect commercial est important, mais ce n’est pas la première demande sur le bassin, il s’agit essentiellement de réparation, en tous cas pour le moment. » Un formateur est présent en permanence, c’est le référent de l’INCM La Rochelle. Il est soutenu par les équipes administratives, éducatives et pédagogiques de l’IDF. Et un collègue, qui n’est pas toujours le même, est envoyé depuis Le Bourget quand il y a 2 groupes à accompagner. « Il y a quelques années la formation vélo était liée à la moto. Les personnes se formaient en CAP ou en Bac avec une dominante moto, et quelques heures dédiées au vélo. Auparavant les besoins étaient assez confidentiels, néanmoins les entreprises de la branche des services d'automobiles et de la mobilité avaient tout de même un besoin. C’est pour ça que plusieurs certifications de branche ont été créées par l’ANFA qui répondent aux exigences des entreprises et qui intègrent les évolutions technologiques (VAE, connectivité, …), le service client et l’organisation atelier » Les publics visés sont assez hétérogènes. Des jeunes sortant de classe de 3e, ainsi que des plus âgés qui ont déjà cherché une orientation et qui reviennent à un métier technique, des demandeurs d'emploi ou des adultes en reconversion professionnelle. Tous passent la même certification mécanicien cycle, mais avec des modalités différentes, soit en 12 mois pour un contrat en alternance, soit pendant 3 mois et demi de manière continue avec un stage en entreprise de 2 à 3 semaines. A l’issue de la formation, nombreux sont ceux qui ont des projets de création ou de reprise d'entreprise. Le centre de La Rochelle peut prendre en charge deux groupes de 12 apprenants de manière simultanée, avec chaque année une session en alternance, et deux sessions demandeurs d'emploi et reconversion professionnelle. « L’objectif de la formation est d’accompagner les apprenants à intervenir sur une diversité de vélos qu’ils soient, musculaires, à assistance électrique, des VTC ou VTT, du vélo de ville, etc. Ils sont essentiellement préparés lors de leur formation au montage, préparation et l'assemblage d'un vélo et l’organisation et après-vente en atelier. » Nouvelles technologies, nouvelles compétences « Il est indispensable de disposer de la compétence technique pour intervenir, réparer et entretenir un vélo. Ils sont confrontés à différents matériaux, différentes technologies comme le changement de vitesse par Bluetooth par exemple, toutes ces nouvelles options qui sont plutôt attractives pour le cycliste nécessitent des connaissances très fines et une approche client adaptée et différente. Il est indispensable que le futur mécanicien cycles permette au client de circuler également en toute sécurité. » Aujourd’hui les besoins sont réels, parce que les activités liées à la maintenance sur un vélo sont plus en plus complexes. En conséquence, il faut disposer des compétences adaptées aux matériels disponibles sur le marché. Mais le secteur connaît un tassement au niveau de la production et des ventes, après un engouement certain observé à la sortie de la crise sanitaire. Sur le secteur de La Rochelle, le caractère saisonnier de l’activité est assez poussé. Les loueurs sont nombreux, une spécificité que l’on retrouve sur la côte Ouest et la façade atlantique. Ces loueurs ont des besoins qui se renouvellent chaque année, l’activité est beaucoup plus réduite entre novembre et mars, ce qui n’est pas le cas sauf dans des villes qui connaissent un véritable dynamique autour du vélo, comme Lyon, Lille ou Paris. Autre modalité d’intervention pour l’INCM, celle d'atelier éphémère. Une formation autour du vélo nécessite un certain nombre d'équipements, mais l’ensemble peut prendre place dans une salle classique, il n’y a aucune nécessité qu’il s’agisse d’un atelier spécialisé. Autrement dit, un espace d’une centaine de m2 est suffisant. « Nous arrivons en début de semaine avec l'ensemble du matériel, on installe six postes de travail, ce qui nous permet d'avoir une douzaine de stagiaires. Et on démonte tout à l’issue. Ce fonctionnement offre une souplesse certaine, de pouvoir aller là où le besoin est présent, sans forcément ouvrir une antenne. » Le formateur entretient des contacts réguliers avec les entreprises par le biais d'une campagne téléphonique en début de formation, puis par des visites en entreprise au cours du cursus. Le rôle des entreprises est de former, mais elles participent également directement à l’évaluation et à l’accompagnement des apprenants, notamment lors de la période de stage. Sur la Nouvelle-Aquitaine, la volonté est de proposer une offre de formation raisonnable et adaptée à la demande des entreprises du Vélo. « Notre stratégie est différente de celle de l’Ile-de-France où il y a un besoin très développé. Sur La Rochelle, on adapte notre offre à la demande. Aujourd’hui sur le vélo, 80% des candidats qui obtiennent leur certification sont en emploi à l'issue de la formation, mais pas forcément dans leur entreprise formatrice. L’autre particularité de ce public, c’est qu’il est assez volatile. L’INCM accompagne également les entreprises à proposer des actions de fidélisation de leurs collaborateurs. »

|
Scooped by
Cap Métiers NA
January 11, 2024 8:48 AM
|
La Forge, transformer ses acquis en compétences
« En 2019, j’étais adjointe de direction à la mission locale de Bordeaux » explique Marylène Costa. « Et je constatais que nous avions des actions pour lesquelles on avait beaucoup de mal à mobiliser des jeunes. A un moment, il faut admettre que quelque chose ne fonctionne pas. Et qu’il faut sûrement chercher de notre côté, que ça ne peut pas simplement être le manque de motivation des gens qui n’auraient pas envie de travailler. » Certains citoyens ne poussent pas la porte de la mission locale ou de Pôle emploi. Plus généralement, nombreuses sont les personnes qui ne recourent pas au droit public auquel elles ont pourtant droit. Autre constatation, plus on s’approche des quartiers populaires, plus ces phénomènes grandissent. Taux de chômage élevé, déscolarisation, précarité des femmes au travail, dont beaucoup sont prises dans des schémas monoparentaux. « Avec Yolande Panneels, du cabinet Axe et Cible, on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas informées, qui n'adhéraient pas du tout aux dispositifs, qui refusaient complètement le fait, par exemple, de bénéficier du RSA et de se faire contrôler par un système qu’elles ne connaissaient pas. Nous avons alors travaillé ensemble à un un projet que l’on a présenté à la Région Nouvelle-Aquitaine. En fait, une page blanche avec 3 idées fortes, que nous avons essayé de défendre en partant du principe que ce document devait être écrit par les bénéficiaires eux-mêmes. » Première intention, l'idée d'être présent sur les territoires, de faire du « aller vers », d’intervenir sans trop avoir la volonté de vendre un produit d'insertion. Deuxième principe, inviter les personnes à participer à un collectif pour fabriquer un projet ensemble. « On leur disait, on prend votre besoin comme il est, ici et maintenant, on ne le tord pas, on ne le transforme pas. On a décidé d'accompagner les personnes comme elles le souhaitent, soit en individuel, soit en collectif, ou encore dans un café, sans se donner de limites quant aux modalités. » Troisième intention, travailler au développement des compétences de chacun en s’appuyant sur les notions d'entraide et de pair-aidance. S'appuyer sur les pairs « La pair-aidance, je suis allée la chercher du côté de la santé mentale, parce qu’aujourd’hui ça n'existe pas dans l'insertion professionnelle telle qu’elle est. J’ai voulu voir si ça pouvait marcher sur du vécu expérientiel, comment réparer des personnes en insertion. On y arrive aujourd'hui parce qu'on a une multi culturalité dans les projets. Et que nous utilisons l’outil de l’âge, un senior qui va presque accompagner un jeune, ça se fait un peu naturellement. Mais c'était véritablement ambitieux de se reposer sur le pouvoir d'agir et la pair-aidance. » En pratique, le projet était de créer une association ou une entreprise solidaire basée sur un collectif, une sorte de tiers-lieu vivant, sans idée de refaire une structure de service public. Son but, recueillir le besoin, l'accompagner et le ramener vers le droit commun si nécessaire. Son démarrage remonte à début 2021, avec le recrutement de deux médiateurs développeurs. De mars à octobre, la nouvelle équipe a déambulé au sein des 21 quartiers politiques de la ville situés en Gironde. Elle est partie à la rencontre des habitants, des partenaires potentiels, des associations, etc. En fonction de l’accueil reçu, parfois des coups de cœur, elle a établi une cartographie des quartiers sur lesquels elle voulait intervenir. « Pour attirer les gens et leur proposer de nous rencontrer, on utilisait des brise-glace, comme un goûter en bas d'immeuble, un jeu de cartes, ou encore une invitation à participer à un atelier cuisine. On partait d'une proposition qui n’avait rien à voir avec le besoin d’emploi formation. Nous voulions d’abord échanger avec les personnes, leur demander comment elles trouvaient leur quartier, si elles avaient envie de changer. » Pour choisir ses territoires d’action, l’équipe se donnait comme principal critère le besoin les habitants, sans jamais chercher à forcer sa présence. Si leur réponse, ou celle des acteurs locaux, était qu’ils n’avaient besoin de rien, elle n’insistait pas. Parfois les acteurs se sont dit partants pour tester quelque chose ensemble. « À ce moment-là, nous n’avions pas de communication, on voulait rester nous-mêmes un peu invisibles, parce que nous voulions en quelque sorte rester à égalité avec les personnes rencontrées. Nous sommes restés là où on se sentait bien. Maintenant il y a des gens qui nous appellent depuis Coutras, Sainte-Foy-la-Grande, Villenave-d’Ornon, parce qu’un besoin s'est fait sentir. » La Forge a été créée officiellement en septembre 2021 par un consortium coordonné par Axe et Cible*. Elle a ensuite pris ses quartiers au sein de la résidence Habitats Jeunes Le Levain à Bordeaux. Sa première action a été de constituer un collectif en sollicitant les 10 missions locales de la Gironde pour trouver de jeunes ambassadeurs qui iraient faire sa promotion. « Au départ, on a constitué un premier collectif d’une quinzaine de jeunes issus de mission locale, de service civique et de formation professionnelle « amorce de parcours. » Deux ans plus tard, certaines d’entre eux sont encore avec nous dans le collectif, à tricoter le programme. La logique du pair à pair c'était vraiment notre idée de départ, un jeune parle avec un jeune. » Le collectif avant tout Aujourd’hui, la Forge des compétences se présente toujours comme un collectif ouvert à tous, à partir de 16 ans. Elle propose un programme d’ateliers « animés pas toutes et tous » autour de l’écoute, de la cuisine, de l’image, du sport. Sa différence fondamentale avec d'autres accompagnants sociaux, c'est son accueil et le libre arbitre. Plutôt qu’un accueil classique, avec des questions, un diagnostic, tout un processus parfois un peu lourd, chaque personne est invitée à venir quand elle veut, à son rythme, pour donner autant qu’elle reçoit, dans l’entraide et le respect mutuel. Porte d’entrée idéale, tous les jeudis après-midi se tient la « fabrique à solutions », sorte d’outil révélateur des potentiels, qui fonctionne sur la base de l’intelligence collective. « La notion de communauté, de collectif, de démocratie participative est très importante pour la transmission. Même si nous n’oublions pas de prendre en considération l’individu à l’intérieur du collectif. Il y a aussi la question du « non-sachant » qui peut se résumer ainsi : finalement qui suis-je pour penser à la place de l'autre ? Nous travaillons beaucoup la question de la représentation, ma vérité n'est pas la même que la tienne. » Ce sont les premiers « forgeronnes et forgerons » qui ont baptisé eux-mêmes leur collectif, une forge où se fabriquent des compétences au regard du vécu expérientiel de chacun. Car chaque participant, à partir de ses expériences, de son parcours, peut y transformer ses acquis en compétences s’il le veut, les « forger », que ce soit un savoir, un savoir-être, un « soft skill ». « Ces compétences sont reconnues au fur et à mesure, donc on travaille sur une cartographie des compétences des personnes. À partir de questions simples, en quoi es-tu compétent ? Si on part du principe que tu es très fort en quelque chose, ce serait quoi ? Quel super héros serais-tu ? A partir de cette cartographie, le prétexte est d’aller vers l'emploi ou la formation qui correspond le mieux. » « Depuis le début, nous avons beaucoup évolué dans nos postures. Je crois qu'on a gagné en humilité, parce que le public est là, on est avec lui, on fait partie de ce public. Pour la suite, l'idée avec Axe et Cible, que j’ai rejoint en juin 2023 en tant que responsable de développement, c’est que la forge devienne une entreprise d'économie sociale et solidaire. J'aime bien travailler avec les bénéficiaires aussi sur leur emploi au sein de l’ESS. Mon modèle prochain pour 2024-25, c’est une réponse à appel à projet sur le Contrat Engagement Jeunes - Jeunes en Rupture (CEJ-JR), pour travailler sur des territoires sinistrés. » * La "Forge des Compétences" est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine (AAP « Mobilisation vers la formation ») et par le PIC 100% Inclusion (La Fabrique de remobilisation). Porté par le cabinet Axe-Et-Cible, le consortium rassemble la mission locale de Bordeaux, Habitats Jeunes Le Levain, le Pôle Territorial de Coopération Jeunesse de Bordeaux Nord, AKSIS et AFEC. Et pour la recherche action, Marie-Hélène Doublet, maitre de conférences associée, université de Tours et Nathalie Mondain, professeur agrégée, université d'Ottawa.
|




 Your new post is loading...
Your new post is loading...