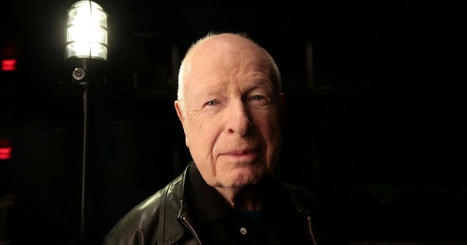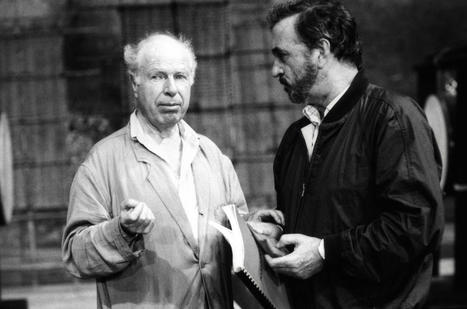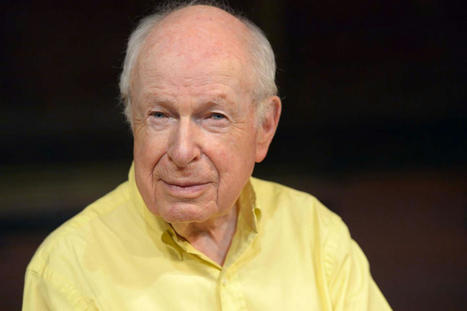Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 6:42 AM
|
Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires culturelles" sur le site de France Culture 3 juillet 2022 Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. Ecouter l'entretien radiophonique sur le site de France Culture (56 mn) Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. avec : Peter Brook (Metteur en scène et réalisateur). Avec quatre-vingt-quinze printemps à son compteur, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook est assurément le doyen du théâtre moderne dont il est un protagoniste essentiel. Ancien directeur des Bouffes du Nord, il a également marqué la discipline pour son approche multiculturelle et sa quête du théâtre dans son plus simple appareil. L’explorateur n’a toutefois cessé de revenir à Shakespeare tout au long de son parcours, de ses débuts à la Royal Shakespeare Company à la parution aujourd’hui du texte de sa pièce Tempest Project, d’après Shakespeare, aux éditions Actes Sud (cocréé avec Marie-Hélène Estienne). L’occasion de revenir, en sa présence et au micro d’Arnaud Laporte, sur le parcours hors normes de Peter Brook pour en savoir plus sur ses sources d’inspirations et son processus créatif… L'artisan d'un théâtre multiculturel De Londres à Paris, en passant par l’Amérique Latine, les Etats-Unis et l’Afrique, Peter Brook n’a cessé de prendre le monde pour terrain de jeu. Dès ses débuts en tant que collaborateur avec le Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon puis directeur de production au Covent Garden de Londres, le metteur en scène jette les conventions du théâtre, le bon goût et le savoir-vivre, et propose des formes différentes, des récits inédits. Peter Brook : "Je travaille dans le West End et tout le monde, les acteurs, les critiques, pensaient que le théâtre anglais c'était le meilleur théâtre du monde. Moi, j'ai trouvé ça très bien, mais il y a une phrase de Shakespeare qui contient tout : "There is a world elsewhere". Il y a un monde ailleurs et pour moi, il faut y aller soi-même pour voir, pour découvrir, pour choisir, pour filtrer." 27 janvier 2022Écouter plus tard 1h 00 F in des années soixante, Peter Brook pose les valises dans un théâtre désaffecté derrière la Gare du Nord à Paris que lui a déniché Micheline Rozan, son agente et complice de toujours. Avant d’en faire le Théâtre des Bouffes du Nord que l’on connaît, il est d’abord le quartier général du Centre international de recherche théâtrale qu’il fonde en 1971. Avec une troupe multi-ethnique, Peter Brook écume le monde durant trois années, de l’Iran à l’Amérique du Sud, en passant surtout par l’Afrique où il découvre alors un territoire digne d’intérêt théâtral dont il va beaucoup apprendre, autant en matière de jeu d’acteur que de répertoire. Peter Brook : "Très tôt, j'étais horrifié parce que je ne pouvais pas comprendre le racisme, comment ça se faisait que pendant les vingt premières années de ma vie en Angleterre, je n'avais jamais vu sur scène un acteur noir. Là-dessus, je vais voir pour moi même en Afrique et à chaque instant, c'est une révélation." Peter Brook : "Les frontières, c'est utile jusqu'à un certain point, mais ça crée l'hostilité, la division. C'est pour ça que j'ai énormément voyagé quand j'étais très jeune. Non seulement pour le plaisir de voyager, mais pour cet esprit de recherche. Et chaque fois, à chaque voyage, je découvre quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné dans la petite vie de Londres." De retour à Paris, Peter Brook dirige le Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’en 2010. Il y déploie un théâtre pour tous, la jeunesse comme les classes populaires, toujours au service de la diversité. Pas à pas, la ruine devient un phare en matière d’expérimentation théâtrale. Shakespeare y côtoie le théâtre sud-africain. Les Bouffes du Nord furent la maison de grands acteurs et actrices et l’écrin de nombreuses œuvres de Peter Brook parmi lesquelles on peut citer le Mahabharata, une épopée sanskrite de la mythologie hindoue dont l’adaptation de Brook a marqué l’Histoire. Peter Brook : "La base de l'expérience théâtrale c'est une expérience vivante au moment même et partagée" La quête du dépouillement Peter Brook est à bien des égards l’un des artisans pionniers de la modernité théâtrale. On lui doit notamment le concept d’espace vide qu’il introduit en 1968 dans son livre du même nom. Exit le décorum, l’artifice, place aux comédiens et à leur jeu : l’austérité se fait la condition de l’invention. Au naturalisme, il préfère désormais le minimum requis pour que le théâtre advienne. Peter Brook : "On a besoin de très peu pour toucher l'imagination et quand j'allais très jeune voir des spectacles immenses et compliqués, c'était pour moi moins convaincant que ce que je pouvais faire avec mon petit théâtre chez moi, avec de très simples moyens." Peter Brook : "J'ai appris de mon père qui adorait les citations « un rien et c'est déjà trop »" Engagé dans une quête de dépouillement le plus extrême, le metteur en scène épure de plus en plus son geste. Dans Why ?, sa dernière pièce en date présentée aux Bouffes, Peter Brook s’interroge sur le sens de son art et sur la nécessité du théâtre. Comme souvent, la spiritualité y est au centre. Peter Brook : "Pour moi, la seule chose qui est vraie et qui était dans toutes mes mises en scène de cinéma et de théâtre, c'est l'immédiat. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que ça touche ou pas ?" Son actualité : Le texte de sa pièce Tempest Project (d’après Shakespeare) a paru aux éditions Actes Sud (co-créé avec Marie-Hélène Estienne). Sons diffusés pendant l'émission : - Extrait de son film “Moderato cantabile”, réalisé en 1960, d’après le livre de Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo.
- “Gracias a la vida” par Violeta Parra (1966)
- Sonate pour violon piano en la majeur (1886) de César Franck, 2ème mouvement (Allegro). Interprètes : Augustin Dumay & Maria Joao Pires.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 4:55 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 3 juillet 2022 Le metteur en scène à la carrière immense marquée par Shakespeare, théoricien d’une écriture scénique sans artifice, réduite à la quintessence du texte et quasiment sans décor, est mort à 97 ans. Sur scène, il y avait de moins en moins d’éléments. Seulement quelques tapis, parfois des coussins et des cadres pour signifier le dehors et le dedans et leur réversibilité. Cette raréfaction suffisait à Peter Brook pour nous faire voyager partout dans le monde, lui qui fut le premier, à l’orée des années 1960, à jeter les oripeaux du théâtre occidental du bon goût et du savoir-dire pour se lancer à la recherche de récits alors complètement inconnus, tel le Mahabharata, l’épopée sanskrite de la mythologie hindoue qu’il fit découvrir en neuf heures à Avignon en 1985, après une bonne dizaine d’années d’investigation. Peter Brook vient de mourir à 97 ans et avec lui, c’est une mémoire de plusieurs continents théâtraux qui s’ensevelit ou s’écroule, tant il avait fait de la recherche de toutes les formes scéniques existantes la matière même de son œuvre. La curiosité de Peter Brook n’avait aucune limite et pas plus d’interdit. Elle ne se nourrissait d’aucun goût pour l’exotisme mais d’un émerveillement inlassable de la diversité contenue dans ce mot : théâtre. Elle le poussait à se passionner autant pour le tazieh iranien que pour la danse chhau en Inde, en passant par la tradition yoruba de la possession au Nigéria, ou les théâtres afghan, japonais, balinais. Elle nécessitait des voyages de plusieurs mois avec sa troupe constituée d’acteurs du monde entier. Mais elle l’avait poussé aussi à visiter plusieurs hôpitaux psychiatriques (à Paris, notamment à la Salpêtrière, mais aussi à Miami) pour concevoir les histoires tragiques et réelles de L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, d’après le best-seller du neurologue Oliver Sacks. Sans oublier de forer le répertoire – une enlevée et sobre Cerisaie qui fit date avec Natasha Parry et Michel Piccoli en 1981, un Oh les beaux jours de Beckett, toujours avec Natasha Parry, son épouse adorée, en 1995, et tant d’autres, avec une prédilection pour le monument Shakespeare qui l’accompagna et le questionna toute sa vie et avec lequel il commença sa carrière (mais le mot lui allait si mal) si jeune, à Stratford, auprès de la Royal Shakespeare company. Peter Brook le disait : «Il y a d’un côté le théâtre, de l’autre Shakespeare.» Shakespeare dont il a fait redécouvrir de nombreuses pièces peu ou jamais jouées en France sur un mode toujours plus aérien et épuré, trois bambous suffisant pour signifier la Tempête. Pièce qu’il remonta inlassablement, sous une forme toujours plus minimaliste, une esquisse, comme s’il s’agissait d’en saisir son essence, et dont on avait pu suivre la recherche avec des apprentis acteur de l’école Jacques Lecoq. Mais dans Shakespeare pour Brook, il y avait par dessus tout Hamlet, qu’il a monté souvent sans jamais, disait-il, épuiser le mystère de la simplicité du «to be or not to be» et de la permanence de la fascination qu’exercent ces quelques mots partout dans le monde. Un art du dépouillement tenant de la prestidigitation Pourquoi devient-on metteur en scène ou dramaturge ? Pourquoi choisit-on le théâtre, un art qui, dans les années d’immédiat après-guerre, était communément «rasoir» comme il le qualifiait dans son œuvre phare, l’Espace vide ? (1) Peter Brook ira même plus loin en assurant que toute mise en scène porte en elle les germes de son autodestruction. Qu’elle est établie pour être reproduite soir après soir mais que, «du jour où elle est fixée, quelque chose d’invisible commence à mourir» et que tout metteur en scène se bat sur du sable pour vaincre cette mort annoncée. Selon lui, aucun spectacle, aussi prodigieux soit-il, n’y échappait et ne pouvait être rejoué à l’identique à une décennie d’intervalle. A 93 ans, donc, Peter Brook disait à Libération ignorer encore pourquoi il était devenu metteur en scène. «Le destin», concédait-il. Et l’on remarquait que son ouverture à toutes les formes scéniques, d’où qu’elles proviennent, avait pour corollaire une remise en question constante des limites du théâtre. En témoignait sa pièce testamentaire, Why ? co-écrite et co-mise en scène avec sa complice de trente ans Marie-Hélène Estienne. Dedans, il s’interrogeait encore une fois sur les fondements de l’art dramatique et les raisons d’y consacrer sa vie. Peter Brook s’y prenait simplement, sans jamais que les questions essentielles s’habillent d’une tournure théorique. Il s’interrogeait sur le sens de son art comme un tout jeune metteur en scène à l’orée d’une vie professionnelle. Et il cherchait des réponses en revisitant les traces laissées par les plus grands dramaturges, Stanislavski et Meyerhold – fusillé sous ordre de Staline – comme, quelques décennies auparavant, il avait sondé les mystères d’Edward Gordon Craig, Brecht, ou Artaud, dans un autre spectacle au nom hamlétien, Qui est là ? Une fois de plus, son art du dépouillement tenait de la prestidigitation. On était bien en peine de saisir comment les acteurs parvenaient à montrer de multiples vies, lieux, ou temporalités sur le plateau vide du théâtre des Bouffes du Nord. Un regard transperçant, une douceur susceptible d’effrayer : il faut croire que l’attention aux autres et une gentillesse qu’on n’aurait tort d’associer à de la mièvrerie gardent l’esprit en alerte. Quand on avait rencontré Peter Brook dans les hauteurs d’un immeuble au centre de Paris, la ville où il vivait depuis les années 1960, sa sagacité rigoureuse et sa prévenance interdisaient qu’on esquive ses questions, qu’il posait en fixant son interlocuteur de ses yeux bleus. On ne pouvait pas mentir à Peter Brook, éluder, lui répondre à côté et ce fut une expérience surprenante d’être soumise à la question par un homme de 93 ans. A moins que le secret de sa longévité ne réside dans son don pour le bonheur ? Car Peter Brook avait une particularité rarissime et frappante lorsqu’on plonge dans son autobiographie Oublier le temps, parue en français en 2003 : il fut un artiste heureux. Aussi bien son enfance que sa vie se déroulèrent dans la joie. Et contrairement à beaucoup de ses collègues, il ignora les affres de la création, les cris, les rapports de force, pariant plutôt que la puissance de ses acteurs et collaborateurs serait décuplée s’ils étaient mis en confiance par un climat «serein», l’épithète est de lui. Il est significatif que Peter Brook n’éprouva jamais le besoin d’être un gourou et d’exercer un pouvoir sur ses collaborateurs et ses acteurs. Et que chaque rencontre artistique se doubla d’une amitié pérenne. Peter Brook n’a pas eu son Philippe Caubère (ancien acteur d’Ariane Mnouchkine) pour se moquer de ses travers, et il semble bien que lorsqu’un acteur ou une actrice quitte la troupe, ce soit sans amertume ni blessure d’un côté ou de l’autre. Il semble faire partie de ces rares personnes qui ne suscitent ni la médisance, ni la rumeur. Et si des différends adviennent, leur tournure n’est pas celle du règlement de compte. La cave d’un magasin de chaussons Peter Brook est né à Londres le 21 mars 1925 dans le quartier de Chiswick, de parents juifs lituaniens immigrés, un père ingénieur et une mère scientifique. Leur nom fut anglicisé à partir de Bryck, qui devint un temps Brouck, avant qu’un préposé à l’état civil ne tranche définitivement l’affaire. Lui et son frère grandissent dans une atmosphère familiale qu’il décrit comme idyllique même si ses parents ne s’entendent pas. «Nous étions encouragés, mon frère et moi, à croire que la vie était une corne d’abondance et notre maison une terre de profusion, où tout pouvait, à tout moment, nous être procuré. L’illusion, non sans danger, contribua a créer en nous et pour toujours un sentiment de sécurité intérieure.» Jeune adulte, cette sécurité intérieure se double de la croyance, certes un peu «périlleuse», qu’une «main du destin» le sauvera de tous les mauvais pas et qu’il ne doit donc avoir peur de rien. Ses notices biographiques indiquent – sans pour autant que l’anecdote soit inscrite dans ses mémoires – qu’il effectua sa première mise en scène d’Hamlet dans son petit théâtre de marionnettes quand il avait cinq ans. Pour autant, la première passion du jeune Peter ne fut pas le théâtre, mais le cinéma ou plus spécifiquement un projecteur à la séduction irrésistible, rouge et brillant comme une trottinette, qu’il contemplait dans la vitrine d’un magasin de jouets. Finalement, un après-midi, il assiste dans une librairie à une représentation dans un théâtre miniature pas plus grand qu’une maquette. Cette première expérience théâtrale demeure, affirme-t-il plus de quatre-vingts ans plus tard dans son autobiographie, «non seulement la plus vivante, mais la plus réelle», réelle signifiant sans doute que le mirage fonctionne à plein. Quand il pénètre, jeune adolescent, dans un vrai théâtre, c’est moins ce qui se passe sur scène qui le captive que les portes, les coulisses et l’étrangeté des acteurs s’évanouissant dans un hors-champ inatteignable. Un appareil de projection, des disparitions inexplicables : c’est bien la machination et le fonctionnement de l’illusion qui attirent le futur metteur en scène dès son plus jeune âge. Peter Brook ne fut pas un bon élève, et à seize ans, avant de réintégrer un parcours classique, il effectue un stage dans un labo dans l’espoir de devenir cinéaste. A peu près au même moment, il réquisitionne la cave d’un magasin de chaussons de danse, pour organiser sa première mise en scène. Le spectacle – une pièce élisabéthaine sanglante – en resta au stade des répétitions, mais le jeune Brook déclara un peu partout, jusqu’à y croire lui-même, que les représentations avaient été un triomphe. Après un passage par Oxford, il monte, en pleine guerre, la Machine infernale, pièce qu’il entraîne en tournée. Le jeune homme échafaudait encore d’autres projets théâtraux quand des bombes réduisirent à néant la maison de ses parents. Peter Brook débarrasse la scène de son rideau rouge, et monte, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un «Roi Lear» affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Après-guerre, expliquait Peter Brook, le terrain était vierge, il y avait peu de metteurs en scène, du moins en Angleterre. Dès lors, rien ne lui résiste et ce qui l’étonne, c’est plutôt lorsqu’il rencontre des obstacles. Le roi Jean, Peines d’amour perdues, Roméo et Juliette : Shakespeare l’aimante et, de Stratford à Londres, les salles les plus prestigieuses le recherchent. A 23 ans seulement, il est chargé de monter l’opéra Boris Godounov à Covent Garden. La salle est pleine à craquer, mais la scène aussi, et l’armée de figurants peine à se déplacer. Chaque geste pèse des tonnes. Est-ce après ce qu’il estime être un désastre qu’il théorise que le théâtre n’a besoin de rien, que d’«un espace, un espace vide» ? A cette époque, et les années qui suivirent, Brook enchaîne les spectacles dont les répétitions ne durent que trois semaines, il est le plus jeune metteur en scène au monde, et dit-il, il devient «un phénomène de foire», se produisant de Londres à New York. Il a brûlé les étapes, n’a jamais été assistant, n’a pas de maître, son statut est sans précédent, mais plutôt que de lui monter à la tête, il lui permet, écrit-il rétrospectivement, de mépriser les fruits du succès et «les récompenses sans intérêt véritable». Sans intérêt véritable : c’est aussi ce qu’il éprouve lorsqu’il se rend dans les salles de spectacles d’Angleterre au début des années 1950. Anti-intellectualisme, théâtre moribond, ennui fracassant : les grands acteurs ironisent, refusent de réfléchir à leur art. On n’utilise pas l’expression de théâtre de boulevard car c’est l’ensemble du théâtre londonien qui est alors boulevardier, empesé dans du velours rouge et emprisonné dans les conventions. Peter Brook ne renonce pas, mais il a l’intuition qu’un autre théâtre que celui qui assomme les foules et vide leur porte-monnaie est possible. Comment s’y soustraire et que faut-il soustraire ? ll lui faudra encore quelques années, pour débarrasser la scène de son rideau rouge, et monter, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un Roi Lear affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Ce n’est pas un style, c’est une raison d’être et un problème : comment essorer les pièces de tout superflu pour en montrer la quintessence ? Cette absence d’artifice s’accompagnera ensuite parfois d’une élimination progressive de personnages. Carmen, Hamlet, la Flûte enchantée : autant d’œuvres dont Brook tentera d’extraire la note absolue, les quelques éléments premiers. Le miracle derrière la palissade Déjà, lorsqu’il accepte de codiriger la Royal Shakespeare Company, c’est à condition d’y créer un groupe de recherche sur l’histoire des conventions théâtrales et du métier d’acteur. Peter Brook réalise que tout ce qui sépare les acteurs du public dans les théâtres à l’italienne – l’épais rideau, les places les plus chères près de la scène – n’avait pas trait dans le théâtre élisabéthain où, à l’inverse, le public le plus populaire était debout au plus près du plateau. En 1970, ce groupe de recherche est accueilli dans un Paris alors en effervescence, et devient le Centre international de recherche théâtrale, chargé d’explorer non seulement toutes les formes théâtrales mais aussi les langues et les sons, en confrontant le japonais, le bambara, l’anglais, le portugais, le persan et même le français. Les comédiens sont de toutes nationalités. Le projet est d’éprouver la langue dans sa matérialité, de faire glisser les sons, de saisir la façon dont ils imprègnent le sens, et modulent aussi bien la gestuelle que la pensée. Sont aussi étudiées des langues anciennes ou disparues telles l’avestique, le zoroastrien, le grec ancien… Le poète Ted Hughes va jusqu’à inventer une nouvelle langue nommée «orghast», dont la signification des mots se transmet par la forme et la sonorité. Cette nouvelle langue est utilisée pour des créations jouées dans des endroits inattendus – un supermarché – ou expérimentaux – le festival des arts de Chiraz en Iran – mais aussi sur des places de villages en France, en Afrique ou en Amérique Latine. A la même époque, une rencontre capitale a lieu, avec Jean-Claude Carrière, alors scénariste attitré de Luis Buñuel (entre autres). L’écrivain demande à se glisser dans la troupe en tant qu’observateur et Peter Brook l’y autorise à condition qu’il soit un participant à part entière. Leur collaboration durera jusqu’à la mort de l’écrivain, en février 2021. Dans son dernier livre, Du bout des lèvres, Peter Brook évoque leur amitié immédiate faite d’une compréhension «instantanée» et d’une même hantise du langage «fleuri» au détriment de la clarté, surtout lorsqu’il s’agit de traduire Shakespeare. C’est également au début des années 1970 que Peter Brook ressent le besoin d’avoir un lieu à lui et se lance, avec son administratrice Micheline Rozan, à la recherche d’un théâtre. Au fil de promenades, ils tombent d’abord en arrêt sur un bâtiment du XVIIIe siècle abandonné et dissimulé au cœur de Paris où une supplique est restée gravée sur la porte d’entrée : «On demande poliment aux spectateurs de laisser leur épée à l’entrée.» Mais c’est finalement, à la Chapelle, dans le nord de la capitale, derrière une palissade, que le miracle a lieu : voici une friche pleine de décombres en déshérence depuis plus de vingt ans. Les murs sont noircis, le sol est bourré d’ordures en tout genre et Peter Brook éprouve le sentiment d’être dans le lieu idéal. «Trois années de voyages et d’expériences nous avaient appris – à la dure – ce qu’est un bon espace, et ce qu’est un mauvais espace… Nous remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous frayâmes un chemin à travers un tunnel poussiéreux, pour soudain nous redresser et découvrir, délabrées, carbonisées, ruinées par la pluie, grêlées, et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle : les Bouffes du Nord. Nous prîmes deux décisions : l’une, de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne rien effacer des marques qu’une centaine d’années de vie lui avaient laissées ; l’autre, de ressusciter l’endroit aussi vite que possible. On nous prévint que c’était impossible, un fonctionnaire du ministère nous dit que cela prendrait deux ans pour obtenir l’argent et les permis. Micheline refusa leur logique, accepta le défi.» Finalement la salle qui devait devenir le port d’attache de Peter Brook pendant presque cinquante ans rouvrit le 15 octobre 1974. François Marthouret incarnait Timon d’Athènes. Une pièce méconnue de Shakespeare. Et quarante-huit ans plus tard, en avril dernier, c’est sur cette même scène à la magie intacte, qu’il enchantait le public, par quelques représentations de Tempest project, co-mis en scène par Marie-Hélène Estienne. Un «projet» évidemment, le mot tourné vers l’avenir lui sied. Et encore une fois Shakespeare. (1) Une œuvre où il démontrait que si le théâtre assassinait par l’ennui si souvent son public, c’est qu’il usait de formes mortes, n’ayant plus aucun sens, revenant comme des zombies. (2) Editions Odile Jacob, 2018. Légende photo : Peter Brook (à gauche) et Jean-Claude Carrière, aux Bouffes du Nord, discutant de l'adaptation du «Mahabharata» au début des années 1980. (Julio Donoso/Sygma. Getty Images)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 5:30 AM
|
Cet été, le maître du vaudeville investit les places des villages du Nord Vaucluse Saisie par les premières contractions, Léonie défoule ses douleurs et sa mauvaise humeur sur Toudoux, son époux. Auprès de la future mère se succèdent Madame puis Monsieur de Champrinet. Sous le regard de Clémence, soubrette imperturbable, les parents de Léonie réitèrent leur dédain à l’égard d’un gendre roturier. Arrive enfin Madame Virtuel, sage femme autoritaire, limite militaire… . Après Les Vilains, farce de Ruzzante, montée l’an dernier, Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse choisit le roi du vaudeville pour sa tournée estivale. Co-directeur du CDDV avec Frédéric Richaud (Mr de Champrinet), Gilbert Barba met en scène son premier Feydeau dans le respect de la lettre, la mécanique mais aussi de l'époque : salon bourgeois, costumes fin XIXème, ici d’une rare élégance. Concentré sur un acte, Léonie est en avance fustige le mépris de classe et l’obsession des bonnes réputations. L’injustice, la bêtise soutendent les caprices des unes et les bassesses des autres. Mais toujours pour le meilleur et pour le rire. La sarabande est emmenée par la troupe du CDDV, dont Sarah Nedjoum vitupérante Léonie, Elsa Kmiec immarcescible Clémence et Benjamin Kerautret qui dote Toudoux du burlesque indispensable. Sans oublier Gilbert Barba mémorable Madame Virtuel. Interview de Gilbert Barba et Frédéric Richaud à l’issue de la première sur la place de Saint Roman de Malegarde. Léonie est en avance ou le mal joli : Ven. 17 juin – 21h place de l’église Notre Dame de Val Romigier Mornas Ven. 24 juin – 21h devant l’Espace Peyrolles – Colonzelle Ven. 1er juillet – 21h place sous le Barry – Buisson Sam. 02 juillet – 21h boulodrome – Montségur-sur-Lauzon Lun. 04 juillet – 21h place Humbert II – Visan Mar. 05 juillet – 21h place du village – Richerenches Mer. 06 juillet – 21h ancienne cours de l’école Jules Ferry – Lapalud Jeu. 07 juillet – 21h Ferme Saint-Agricol – Savoillans Ven. 08 juillet – 21h théâtre de verdure – Mollans-sur-Ouvèze Sam. 09 juillet – 21h salle des fêtes – Réauville Vendredi 22 juillet 21H30, Place Colonguin Grillon (dans le cadre des Nuits Théâtrales de l’Enclave).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 6:45 PM
|
Une sélection de spectacles à voir dans le Off d'Avignon
Comme c'est une sélection, elle est nécessairement incomplète; elle comporte des oublis qui ne sont rien d'autre que des oublis, et elle comporte une part évidente de subjectivité.... *** : veut simplement dire que j'ai vu le spectacle et que je le recommande particulièrement. Mais les autres spectacles mentionnés ici, que je n'ai pas encore pu voir, méritent sans aucun doute d'être vus (A.N.) Classés par horaire des représentations 9h 9H40 La Manufacture : ALABAMA SONG d’après Gilles Leroy, mise en scène Guillaume Barbot*** https://www.youtube.com/watch?v=NedCP38QO8A&ab_channel=LeTangram http://www.critiquetheatreclau.com/2022/01/alabama-song-texte-gilles-leroy-adaptation-et-mise-en-scene-guillaume-barbot.html 10 h 10h Théâtre du Train Bleu : SEUIL, de Marilyn Mattei mise en scène Pierre Cuq *** https://sceneweb.fr/pierre-cuq-seuil-de-marilyn-mattei/ https://www.loeildolivier.fr/2022/04/etre-un-homme-entrer-dans-le-clan/ 10h20 Petit Louvre : UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE de M. Duras, par Anne Consigny https://www.journal-laterrasse.fr/un-barrage-contre-le-pacifique-de-marguerite-duras-mise-en-scene-anne-consigny/ https://theatre-petit-louvre.fr/avignon/un-barrage-contre-le-pacifique/ 10h25 La Manufacture : TOGETHER, de Dennis Kelly mise en scène Arnaud Anckaert (jours pairs) http://www.zef-bureau.fr/together-creation/ https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/together-s30669/ 10h25 La Manufacture : SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? De Robert Alan Evans, mise en scène Arnaud Anckaert (jours impairs) https://www.legrandt.fr/programme/spectacle/si-je-te-mens-tu-maimes https://www.journal-laterrasse.fr/si-je-te-mens-tu-maimes-et-together-deux-pieces-britanniques-mises-en-scene-par-arnaud-anckaert/ 10h30 au 11 : L’ART DE PERDRE Alice Zeniter Mise en scène Sabrina Kouroughli https://www.journal-laterrasse.fr/sabrina-kouroughli-porte-a-la-scene-lart-de-perdre-dalice-zeniter/ https://vimeo.com/503385448 11h 11h la Reine Blanche : L’AUTRE FILLE d’après Annie Ernaux avec Marianne Basler https://www.journal-laterrasse.fr/lautre-fille-dannie-ernaux-mise-en-scene-de-marianne-basler-et-jean-philippe-puymartin/ https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/l-autre-fille 11h La Scala Provence : JE NE SUIS PLUS INQUIET de et par Scali Delpeyrat *** https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2021-2022/theatre/je-ne-suis-plus-inquiet-1 https://www.journal-laterrasse.fr/scali-delpeyrat-interroge-les-fondements-dune-vocation-dune-personnalite-avec-je-ne-suis-plus-inquiet/ 11h Th. Des Halles : CHASSER LES FANTÔMES Hakim Bah M.e.s. Antoine Oppenheim (lun-jeu-sam) https://www.foudart-blog.com/post/chasser-les-fantomes https://www.theatredeshalles.com/pieces/chasser-les-fantomes-2 11h25 La Condition des Soies : UN DÉMOCRATE Texte et mise en scène Julie Timmermann *** https://www.journal-laterrasse.fr/un-democrate-de-julie-timmerman-2 https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/democrate-de-julie-timmerman/ 11h30 Th des Halles (spectacle au Conservatoire 1 rue Gal Leclerc) : L’OCCUPATION d’Annie Ernaux M.e.s. Pierre Pradinas avec Romane Bohringer https://sortiralons.fr/loccupation-2/ https://www.theatredeshalles.com/pieces/loccupation-2/
11h55 La Manufacture : TIME TO TELL par Martin Palisse et David Gauchard*** https://www.telerama.fr/sortir/time-to-tell-la-creativite-du-jonglage-face-a-la-maladie-6859559.php https://www.journal-laterrasse.fr/time-to-tell-de-david-gauchard-et-martin-palisse/ 12 h 12h15 Théâtre du Train Bleu : ODYSSEES 2020, mise en scène Noémie Rosenblatt, textes de Baptiste Amann, Yann Verburgh et Mariette Navarro https://bureaudesfilles.com/noemie-rosenblat-cie-du-rouhault/spectacles/odyssees-2020/ 13 h 13h30 « le 11 » : LA FÊTE DES ROSES de H. von Kleist, m.e.s. Sylvain Maurice avec Norah Krief https://www.journal-laterrasse.fr/la-fete-des-roses-dapres-dapres-heinrich-von-kleist-mise-en-scene-sylvain-maurice/ 14 h 14h30 Train Bleu : INSULINE ET MAGNOLIA de et par Stanislas Roquette *** https://hottellotheatre.wordpress.com/2022/06/09/insuline-et-magnolia-texte-et-interpretation-stanislas-roquette/ https://www.journal-laterrasse.fr/insuline-et-magnolia-seul-en-scene-plein-delan-dhumour-et-de-tendresse-de-stanislas-roquette/ 14h Th des Halles : ANGELA DAVIS – De Faustine Noguès mise en scène Paul Desveaux avec Astrid Bahiya *** https://sceneweb.fr/astrid-bayiha-dans-angela-davis-une-histoire-des-etats-unis-de-faustine-nogues/ 14h Théâtre de L’Oulle : BANANAS (AND KINGS) Texte et mise en scène Julie Timmermann *** https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/bananas-and-kings-du-regime-de-bananes-a-la-republique-bananiere-la-nouvelle-piece-de-julie-timmerman_4103615.html 14h05 « 11 » : PORTRAIT DE RAOUL de Ph. Minyana m.e.s Marcial di Fonzo Bo, avec Raoul Fernandez *** http://rebelle.blogspirit.com/archive/2019/05/23/le-portrait-de-raoul-3138297.html 14h25 La Factory : CA NE MARCHERA JAMAIS, mise en scène Nicolas Ramond https://www.journal-laterrasse.fr/ca-marchera-jamais-nicolas-ramond-se-tourne-vers-ceux-qui-se-plantent/ https://lestroiscoups.fr/ca-marchera-jamais-de-nicolas-ramond-theatre-de-lelysee-a-lyon/ 14h25 la Reine Blanche : CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉS, Texte, mise en scène et jeu Yvain Juillard *** https://www.journal-laterrasse.fr/cerebrum-le-faiseur-de-realites-conference-spectacle-dyvain-juillard/ 15 h 15h Au coin de la lune : NOTRE PETIT CABARET de et par Béatrice Agenin et Emilie Rochereau https://hottellotheatre.wordpress.com/2022/06/21/notre-petit-cabaret-spectacle-musical-par-beatrice-agenin-et-emilie-bouchereau/ 15h35 La Manufacture : AUTOPORTRAIT A MA GRAND-MÈRE de et par Patricia Allio https://sceneweb.fr/autoportrait-a-ma-grand-mere-de-patricia-allio/ 16 h 16h00 Th des Halles : FIN DE PARTIE . Samuel Beckett / J. Osinski avec Frédéric Leidgens et Denis Lavant https://www.journal-laterrasse.fr/jacques-osinki-veut-dire-la-longue-marche-du-temps-avec-fin-de-partie-de-beckett/ 16h Présence Pasteur : PLOUTOS ou L’ARGENT DIEU, d’après Aristophane Adaptation Olivier Cruveiller, mise en scène Philippe Lanton https://www.journal-laterrasse.fr/philippe-lanton-met-en-scene-ploutos-largent-dieu-adapte-dapres-aristophane-par-olivier-cruveiller-un-spectacle-pour-faire-penser/ 16h25 au « 11 » : ULYSSE DE TAOURIRT spectacle musical de et avec Abdel Sefsaf https://hottellotheatre.wordpress.com/2021/01/29/ulysse-de-taourirt-ecriture-et-mise-en-scene-de-abdelwaheb-sefsaf-collaboration-a-la-mise-en-scene-et-a-la-dramaturgie-de-marion-guerrero-musique-aligator/ https://sceneweb.fr/ulysse-de-taourirt-dabdelwaheb-sefsaf/ 17 h 17h05 le 11 : JANIS (d’après Janis Joplin), mise en scène Nora Granovsky https://www.journal-laterrasse.fr/janis-de-nora-granovsky-un-portrait-de-janis-joplin-au-dela-des-stereotypes-accoles-a-son-personnage/ https://www.youtube.com/watch?v=8OsardOcSZA&ab_channel=Th%C3%A9%C3%A2treMoli%C3%A8reS%C3%A8tesc%C3https://www.journal-laterrasse.fr/janis-de-nora-granovsky-un-portrait-de-janis-joplin-au-dela-des-stereotypes-accoles-a-son-personnage/%A8nenationale https://bvzk.fr/janis/ 19 h 19h30 La Manufacture : HERMANN de Gilles Granouillet, m. e .s. François Rancillac *** https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/hermann-de-gilles-granouillet-mise-en-beaute-par-francois-rancillac/ 19h35 La Manufacture : LES POSSEDES D’ILLFURTH de Lionel Lingelser et Yann Verburgh, par Lionel Lingelser*** https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/critiques/les-possedes-dillfurth-de-yann-verburgh-en-collaboration-avec-lionel-lingelser# 20 h 20h30 le « 11 » : LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT ? De et par Amine Adjina, Métie Navajo et Gustave Akakpo https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-et-unitaire/ https://www.webtheatre.fr/La-diversite-est-elle-de-Amine-Adjina-Gustave-Akakpo-et-Metie-Navajo 20h40 le "11" ET ME VOICI SOUDAIN ROI D'UN PAYS QUELCONQUE d'après Fernando Pessoa, mise en scène Guillaume Clayssen, avec Aurélia Arto *** https://www.journal-laterrasse.fr/guillaume-clayssen-met-en-scene-et-me-voici-soudain-roi-dun-pays-quelconque-dapres-fernando-pessoa 21 h 21h Du 19 au 30 juillet Chêne Noir : FRAGMENTS, textes d’Hannah Arendt, par Bérangère Warluzel, mise en scène Charles Berling https://www.journal-laterrasse.fr/fragments-de-hannah-arendt-un-excellent-spectacle-mis-en-scene-par-charles-berling/ 21h20 La Manufacture : J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE CA FAIT D’ÊTRE LIBRE, de et par Chloé Lacan https://sco.lt/6jtAgK https://www.youtube.com/watch?v=S0L1mMbho48&ab_channel=Chlo%C3%A9Lacan EXPOSITIONS A voir : Exposition Jean Vilar à la Maison Jean-Vilar Exposition « Photographier le théâtre » Maison Jean-Vilar https://maisonjeanvilar.org/festival-avignon-2022/ Collection Lambert en Avignon : Bienvenue dans le désert du réel https://collectionlambert.com/expositions/en-cours/ Note : *** Vu et particulièrement recommandé. Une sélection proposée par Alain Neddam (30.06.2022)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2022 6:38 PM
|
Par Annabelle Martella dans Libération - 1er juillet 2022 Critiquée pour sa surproduction et des conditions de travail parfois violentes, la manifestation alternative, qui se déroule du 7 au 30 juillet, est tiraillée jusqu’à son sommet entre deux visions du théâtre en apparence irréconciliables. Si le «off» d’Avignon, foire théâtrale tentaculaire donnée en parallèle du festival «in», était un animal, ce serait un blob. Une créature vorace de film d’horreur, à la forme indéterminée, qui grossit à vitesse exponentielle et qu’aucune forme de pandémie et de quarantaine ne suffit à calmer. Dans les années 70, seule une quarantaine de spectacles se produisaient dans ce off, créé sous l’impulsion de l’artiste avignonnais André Benedetto en rébellion contre «l’institution» que représentait alors le festival de Jean Vilar. Cette année, entre le 7 et le 30 juillet, pas moins de 1 570 spectacles se joueront quasi tous les jours dans la petite cité papale en parallèle à la programmation officielle. Sur ce nombre, 1 183 sont présentés pour la première fois au off. Et autant craignent d’être mort-nés, invisibles dans cet immense marché dérégulé que certains artistes surnomment – c’est tout dire – un «cimetière de compagnies», mais dans lequel ces dernières continuent d’investir massivement dans l’espoir de repartir avec des dates de tournée et de se rembourser. Le festival officiel se fonde sur une logique de programmation – triant sur le volet ses artistes, grosses locomotives internationales qui bénéficient de conditions de travail idoines et d’un relais presse conséquent. Le off, lui, non subventionné et historiquement sans direction, transforme chaque mois de juillet une multitude de locaux de la ville en petits théâtres de fortune louant, pour la plupart, des créneaux horaires au millier de compagnies qui y affluent. Aujourd’hui, rapporte Harold David, coprésident de l’association qui coiffe l’événement – Avignon festival et compagnies (AF & C) –, cet événement populaire attire «trois fois plus de spectateurs que le in, délivre sept fois plus de billets et rapporte plus de 50 millions d’euros au territoire». Il est aussi devenu le concentré infernal des problèmes de tout un secteur. Comme le dénonçait cette année un rapport de la Cour des comptes, les spectacles pullulent, stimulés par des aides publiques centrées sur le renouvellement de la création, sans que leur diffusion ne suive toujours. Plus grand marché du monde Les tables rondes organisées pendant les multiples confinements ont eu beau appeler à «renverser un système à bout de souffle», aucune ne sera parvenue à freiner l’appétit du monstre : l’offre pléthorique de pièces, one man shows et numéros de cirque en tous genres atteint les mêmes sommets qu’en 2019. Les locations de salles (puisque les artistes, dans le off, paient pour jouer) continuent à se négocier autour de 100 euros le siège. Les prix des logements, eux, auraient considérablement augmenté pour cette nouvelle édition, à entendre Emilie Audren, directrice de la Manufacture, salle très repérée pour sa programmation : «Les programmateurs qui s’y prennent au dernier moment sont obligés de se loger à vingt kilomètres d’Avignon ou de payer des chambres d’hôtel à 300 euros la nuit.» Résumé du tableau : «Des théâtres au confort et à la qualité de service variables, prisonniers d’un modèle économique reposant sur la location de créneaux horaires aux compagnies, une population locale laissée de côté, des logements loués à prix d’or, des compagnies sortant de l’aventure exsangues», énuméraient, en mars 2021, Irène Jacob, Agnès Jaoui ou Jean-Michel Ribes dans une tribune publiée dans le Monde appelant à «réinventer» la manifestation. Un an et demi plus tard, rien n’a changé dans le plus grand marché théâtral du monde. Toute tentative de régulation de cette foire populaire reste donc au point mort. La faute, entre autres, à une guerre aux allures fratricides à la présidence d’Avignon festival et compagnies. Cette association, sans pouvoir coercitif, rassemble depuis 2006 tous les acteurs du off, pour coordonner l’événement. Ainsi représente-t-elle plus de 130 théâtres, aux modèles économiques et intérêts parfois antagonistes. Coexistent ici des lieux à la programmation exigeante mais au prix de location onéreux, des grosses franchises parisiennes (théâtre des Béliers, le Palace, ouvert, lui, toute l’année etc.), des cinémas qui enchaînent comédies et one man shows à un rythme industriel, des lieux endettés tenus par des compagnies, des garages sans gradins ni ouvreur etc. Quelques-uns ouvrent à l’année et perçoivent pour certains des subventions. Mais la majorité fait son chiffre sur les trois semaines du festival et ne se sentait visiblement pas toujours représentée par l’ex-président d’AF & C, Sébastien Benedetto, fils du fondateur du off et directeur du théâtre des Carmes, lieu permanent qui reçoit des aides de l’Etat. Comme son prédécesseur, Pierre Beffeyte, en poste durant le début de la crise sanitaire, Benedetto entendait en effet «assainir» la foire en limitant le nombre de créneaux horaires, en encourageant aussi ces «coréalisations» qui permettent de répartir les risques financiers entre artistes et théâtres. Certains adhérents, cependant, l’accusaient de ne prêcher que pour sa paroisse : «Les anciens présidents prenaient leurs décisions sans nous concerter suffisamment et répondaient à toutes les injonctions du ministère, comme si on était sous tutelle, alors que le off ne reçoit presque aucune aide publique, dénonce la Fédération des théâtres indépendants d’Avignon (Ftia), à la tête de la rébellion. Benedetto voulait faire du off un lieu de sélection pour aller vers une plus grande qualité artistique, selon leurs critères, et stigmatisait les théâtres qu’il jugeait uniquement commerciaux.» Ancestral déchirement Cette guerre, qui semble rejouer de manière manichéenne l’ancestral déchirement entre théâtre public et privé, s’est enflammée pendant le Covid. Lors de l’annulation du off en 2020, les théâtres que le ministère de la Culture jugeait «peu vertueux», par exemple ceux qui tardaient à rembourser aux compagnies les acomptes qu’elles avaient versés, se sont vus exclus des aides d’Etat. A raison selon Benedetto : «C’était pour protéger les compagnies.» A tort selon ses détracteurs, qui expliquent que certains établissements ne disposaient pas d’une trésorerie suffisante. Quand Sébastien Benedetto est réélu en décembre, la tension monte encore d’un cran : certains adhérents (directeurs de salle ou compagnies) ne purent pas voter, Benedetto les ayant suspendus de l’asso en raison «d’insultes». L’affaire atterrit devant les tribunaux qui, en février 2022, donnent raison aux plaignants, annulant l’élection de Benedetto en raison «d’irrégularité ayant eu une incidence sur l’orientation des votes». Les nouvelles élections d’avril firent monter ces voix dissidentes. Et la direction revint à un binôme : un représentant des théâtres avignonnais, Harold David (directeur de plusieurs salles et président de la Ftia), un des artisans de la rébellion contre l’ancienne présidence, et un représentant des compagnies, Laurent Domingos, metteur en scène et président des Etats généraux du festival off d’Avignon (Egoff) créés en 2020, un événement qui visait à instaurer des logiques plus vertueuses. Cette nouvelle présidence a des idées pour améliorer l’animal sans brider sa liberté. Par exemple, accoler des labels aux théâtres repérés pour leurs «bonnes pratiques» (équipements corrects pour l’accueil des compagnies, conditions de travail, etc.). Mais aussi transformer Avignon en grande fabrique théâtrale pour transformer des salles habituellement ouvertes trois semaines l’an en «lieux de résidence pour les compagnies», précisent les codirecteurs : «Les théâtres recevraient ainsi des aides publiques qui leur permettraient de ne pas se reposer uniquement sur le festival et de changer de modèle économique. Pendant leurs résidences, les artistes pourraient faire un travail à destination du public, pour attirer une nouvelle population.» Très bien. Seulement, pour changer ainsi de modèle économique, il faut la bénédiction des tutelles. Sébastien Benedetto, l’ancien président destitué, peste : «Cette nouvelle présidence tire pour rester dans le monde d’avant. Les tutelles ne peuvent pas donner de l’argent à des gens qui ont un discours de théâtre privé…» Méfiance au ministère Qu’il se rassure, c’est avec méfiance qu’au ministère de la Culture, la déléguée théâtre à la direction générale de la création artistique (DGCA), Sophie Zeller, juge la capacité des nouveaux à nettoyer ces écuries d’Augias. Celle-ci a même échangé des courriers «vifs», précise-t-elle, avec l’actuel coprésident Harold David au sujet des aides publiques versées aux théâtres du off pendant la crise sanitaire. Elle déclare : «Nous allons rencontrer la nouvelle présidence, mais s’il n’y a pas un réel souhait de réguler le off, il n’y aura pas de soutien d’Etat. Les théâtres à Avignon sont tous rentables et tant qu’ils laisseront les compagnies prendre tous les risques, le ministère n’aura aucune raison de les soutenir.» Les nouveaux présidents de AF & C se défendent d’une telle philosophie et disent tenter de faire converger les intérêts, tout en rappelant que le off d’Avignon «est un immense marché et non un festival in bis». «En excluant certains théâtres, l’ancienne présidence a créé d’énormes blocages qui ont empêché des réformes de se faire. Nous, nous voulons remettre de l’horizontalité et de la concertation, explique Laurent Domingos. De même, il ne faut pas opposer compagnies et théâtres. Les lieux ont des réalités économiques différentes, doivent payer leurs murs, leurs charges sur toute l’année etc.» N’en déplaise aux tutelles et aux soutiens de la ligne Benedetto, ce discours d’apaisement semble pour l’instant bien reçu par différents adhérents, et pas uniquement par les tenants d’une vision commerciale de l’événement. La Manufacture, théâtre à la programmation qualitative communément appelée dans le jargon du milieu le «in du off», ne voit pas l’arrivée de cette nouvelle présidence d’un mauvais œil. Tout comme l’Adami (société de services aux artistes-interprètes) ou des Actrices et acteurs de France associés, association qui veille aux droits des comédiens. Reste à voir, si ce duo plus libéral parviendra à convaincre les théâtres de faire évoluer leur modèle économique, et si le ministère suivra. Le chaos dans la gouvernance va déjà priver cette année des artistes de la seule aide mise en place par le off, le fonds de soutien à la professionnalisation, dont le budget a considérablement baissé, faute, selon les dires de la nouvelle présidence, d’avoir pu déposer à temps les demandes de financement. Annabelle Martella / Libération du 1er juillet 2022 Illustration : Dessin de Fanny Michaelis

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2022 7:38 AM
|
par Eva Tapiero dans Libération - publié le 29 juin 2022 L’autrice et metteuse en scène, chercheuse en «matrimoine», s’attache à faire revivre les œuvres des premières dramaturges. C’est dans les archives de la Comédie-Française, plus précisément dans les registres de comptes de La Grange, comédien de la troupe de Molière, qu’Aurore Evain découvre un mot qui va la suivre toute sa vie : «autrice». Nous sommes en 1998, elle est alors étudiante en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. A l’époque, personne n’emploie le terme. Pour la metteuse en scène, c’est le début d’une prise de conscience : celle de l’invisibilisation historique des femmes de théâtre. Celles qui jouent. Celles qui écrivent. Quinze ans plus tard, elle intègre le Mouvement HF, une association qui travaille sur les inégalités de genre dans l’art et la culture. Elle propose de lancer les Journées du matrimoine, dont la première édition sera organisée en 2015. La même année, elle monte le Favori de Mme de Villedieu. Les pièces de femmes de l’Ancien Régime n’avaient quasiment aucune place dans les programmations, et pour cause, peu savaient même qu’elles existaient. Il fallait donc compter sur des soutiens précieux et un soupçon de malice pour les monter. «Le Favori avait été joué par Molière devant le roi et il avait écrit un prologue, c’était plus facile de légitimer le choix», se souvient la dramaturge, chercheuse et comédienne. Au parc des Beaumonts, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), où l’on se retrouve pour la photo, l’air est orageux et fait voltiger ses fins cheveux. Elle les remet maladroitement derrière ses oreilles. Prendre la pose, ce n’est pas son truc. Aurore Evain a débuté sa carrière d’autrice avec sa première pièce, Femmes d’attente, mise en scène par Stéphane Druet. Elle a, alors, 26 ans. Ce petit succès ne plaît pas à tout le monde. La violence de certaines critiquent la touchent profondément. Elle se sent mise à l’écart et renonce au monde créatif pour se consacrer à la recherche de «ses mères de théâtre». Elle s’attaque d’abord aux premières comédiennes et publie l’Apparition des actrices professionnelles en Europe. Elle continue à tirer le fil et plonge dans les travaux des premières femmes dramaturges. C’est là qu’elle découvre le terme d’autrice. Pour la préparation d’un séminaire en 2004, elle décide de remonter jusqu’à l’origine du mot et de son usage. Après un mois de travail de fourmi à la bibliothèque, elle met en lumière la première occurrence du terme au IVe siècle chez le grammairien Servius. Sa prise de parole est saluée. «Nom de dieu, on a un mot, on a une histoire, on nous a caché ça», lui lance Carole Thibaut, aujourd’hui directrice du Centre dramatique national de Montluçon. Si Aurore Evain goûte la provocation, ce n’est pas naturel. Enfant autonome, elle est élevée de façon libre par sa mère, coloriste textile dans le Sentier. Cette dernière n’était pas féministe. «Il y a toujours une petite fille en moi qui a l’impression de soulever un tabou et ne devrait pas le faire.» Résultat, l’artiste est tout en ambivalence. Côté pile, la rigueur et la vivacité d’esprit, côté face, l’hypersensibilité. Quand elle nous répond, les larmes lui brouillent la vision par intermittence. Elles apparaissent dès qu’elle parle des victoires de femmes, présentes ou passées, de leurs existences, de leurs traces qu’elle contribue à rendre indélébiles. «Quand je vois comment nous sommes biberonnés à Jean de La Fontaine ou aux contes de Perrault, Grimm, Andersen alors que les premières conteuses sont des femmes. Marie de France était fabuliste 400 ans avant La Fontaine…» Son rêve de liberté et d’émancipation commence dès le collège. Le pouvoir des professeurs sur leurs élèves, les notes, les horaires stricts, lui sont insupportables. Elle se sent restreinte, corsetée. Elle n’attend qu’une chose : passer le bac pour faire du théâtre. Est-ce un hasard si son premier souvenir de planches est celui d’un emprisonnement et du coût de la liberté ? Les yeux de l’enfant se souviennent des costumes flamboyants de l’Oiseau de feu de Stravinsky, la sensibilité de la petite fille aura peut-être gardé la puissance du sentiment d’iniquité. Après dix ans de recherches entre maîtrise, DEA, doctorat non finalisé et explorations personnelles, elle revient au théâtre par la porte de l’enseignement au conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Ses choix féministes sont raillés, mais elle s’accroche et abandonne ce sentiment d’imposture qui ne la laissait pas en paix. «C’est à ces femmes avant moi que je le dois. La recherche a été une matière de création, j’étais chercheuse en matrimoine et en légitimité, j’y ai puisé de la force.» En 2014, elle copublie le fruit de son travail : le premier tome d’une anthologie du théâtre de femmes de l’Ancien Régime qui en compte désormais cinq. Cette année-là, la transmission de ce matrimoine devient aussi un enjeu personnel avec la naissance de sa fille. Comme elle s’ennuie vite, les projets doivent s’enchaîner. Dernière question subversive en date : «Et si Shakespeare était une femme ?». Quand elle tombe sur l’essai de Robin P. Williams Did a Woman Write Shakespeare ? elle avoue, en riant : «Même moi, je trouvais ça too much!» Qu’à cela ne tienne, elle n’en est pas à sa première bousculade de l’ordre établi. Besogneuse, elle se met à la traduction de l’essai pendant le confinement. Sa pièce Mary Sidney, alias Shakespeare, voit le jour en 2020. A bientôt 50 ans, Aurore Evain vit de son métier seulement depuis quelques années, après avoir enchaîné les petits boulots dont assistante de rédaction à Télérama. Dans Un lieu à soi, Virginia Woolf raconte que si le dramaturge anglais avait eu une sœur aussi douée que lui, elle aurait été empêchée de créer, puisque les conditions réservées aux femmes rendaient cette réalisation impossible. C’est contre cette histoire violente d’un échec annoncé qu’Aurore Evain se révolte, tout en admirant l’écrivaine. Sa voix s’éraille. «Un siècle plus tard, je lui réponds : “Si. La sœur de Shakespeare aurait pu exister et peut-être même que c’est Shakespeare elle-même”.» Elle a envie d’y croire. Ce que ça change ? «Le génie théâtral peut enfin se décliner au féminin. Il n’y a pas de certitude, mais c’est devenu vraisemblable qu’une femme de cette époque ait pu écrire les œuvres de Shakespeare. Et ça, c’est énorme !» Un article d’Hélène Cixous paru dans le Monde en 1977, l’a marquée. Cette dernière y raconte pourquoi elle ne va plus au théâtre : «Pour ne pas assister à mon enterrement…» C’est ce qu’Aurore Evain veut changer : «Quand on va au théâtre, je veux qu’on assiste à notre renaissance.» 1972 Naissance à Créteil. 1998 Représentation de sa première pièce de théâtre : Femmes d’attente. Découverte du mot «autrice». 2013 Proposition de lancer des Journées du matrimoine. Légende photo ;Aurore Evain, à Montreuil, le 10 mai 2022. (Camille McOuat/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2022 8:49 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 29 juin 2022
Julie Deliquet a imaginé la vie collective que mène l’auteur, acteur et chef de troupe, sans réussir à la rendre aussi passionnante que les pièces qu’il a écrites.
Qui n’a jamais eu envie de s’inviter chez Molière ? D’entrer dans les secrets de fabrication d’une œuvre qui, en France, fait partie d’un substrat commun ? On en sait finalement peu sur la vie de notre grand auteur national, notamment parce qu’il n’a pas laissé, à sa mort, d’écrits personnels. Acteur, auteur, chef de troupe, grand ordonnateur des plaisirs du roi, Molière, sans doute, vivait sa vie à cent à l’heure, sans avoir le temps de la consigner. Julie Deliquet tente le pari d’entrer dans cette intimité, pour la dernière création de la saison Molière programmée par la Comédie-Française depuis janvier. Avec Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, elle saisit l’auteur et sa troupe à un moment-clé de leur histoire. On est au printemps 1663, Molière vient de triompher avec L’Ecole des femmes. Ce succès déchaîne une cabale, à laquelle l’auteur réplique avec La Critique de l’Ecole des femmes, qui lui permet de délivrer une profession de foi pour la comédie, et avec L’Impromptu de Versailles, dans lequel il se montre lui-même dirigeant une répétition. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique La metteuse en scène les a imaginés, tous, dans la vie collective qu’ils mèneraient dans un appartement sur deux étages au décor bohème et chaleureux. Autour du chef de troupe, il y a là Madeleine Béjart et sa fille, Armande, qui vient d’épouser Molière, Mlle du Parc et Mlle de Brie, actrices, ainsi que les comédiens Brécourt, du Croisy et La Grange qui, plus tard, deviendront les premiers sociétaires de la Comédie-Française. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique. On y retrouve le sens de l’atmosphère qui est celui de Julie Deliquet, notamment dans les scènes de groupe à la douceur toute tchékhovienne, éclairées à la bougie, où s’estompent les frontières entre la fiction et le réel. Le spectacle est plaisant et non dénué de charme, comme toujours chez cette metteuse en scène qui elle aussi porte haut le théâtre de troupe. Malgré toutes ces belles qualités, Jean-Baptiste, Madeleine, etc. trouve rapidement sa limite : la vie de Molière, telle qu’elle est représentée ici, ne parvient pas à être aussi intéressante que ses pièces. Acteurs merveilleux de fraîcheur Et cela même alors que les acteurs réunis ici sont magnifiques, au sommet de leur talent. A commencer par Clément Bresson, qui est un Molière flamboyant, un peu extrême et totalement crédible. Le voir jouer Molière lui-même en train de jouer est un de ces vertiges pirandelliens dont on se souviendra. Autour de lui, toutes et tous sont merveilleux de fraîcheur, de vie et de transparence de jeu : Florence Viala (Madeleine), Adeline d’Hermy (Armande), Elsa Lepoivre (Mlle Du Parc), Pauline Clément (Mlle De Brie), Serge Bagdassarian (Du Croisy), Hervé Pierre (Brécourt) et Sébastien Pouderoux (La Grange). Et pourtant, on ne retrouve pas totalement ici la magie, l’alchimie particulière qui s’étaient créées entre Julie Deliquet et la troupe du Français pour Fanny et Alexandre, en 2019. La raison en est simple : dans ce spectacle sur l’auteur Molière, ce qui manque, c’est justement un auteur. Ainsi se clôt la saison Molière de la Comédie-Française : sur un bilan en demi-teinte. La volonté de redonner un coup de jeune au patron était louable, pour ne pas dire salutaire, mais la plupart des spectacles créés dans ce cadre depuis janvier n’ont pas réellement convaincu, à commencer par le Tartuffe pour le moins racoleur signé par Ivo van Hove. Pour retrouver Jean-Baptiste Poquelin en sa vie ordinaire et extraordinaire, on recommande, encore et encore, la biographie que lui a consacrée Georges Forestier (Molière, Gallimard). L’historien y décape un certain nombre de clichés recouvrant le monument national, et son statut dans une société où les comédiens étaient des réprouvés, mais où il a su se faire une place tout à côté du Roi-Soleil. « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres », d’après Molière. Mise en scène : Julie Deliquet. Comédie-Française, salle Richelieu, à 14 heures ou 20 h 30 en alternance, jusqu’au 25 juillet. De 5 € à 42 €. www.comedie-francaise.fr Fabienne Darge Légende photo : Guillaume Marcoureau (Hervé Pierre), Armande Béjart (Adeline d’Hermy), Mlle Du Parc (Elsa Lepoivre) et Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (Clément Bresson) dans « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres... », de Molière, à la Comédie-Française, salle Richelieu, le 8 juin 2022. BRIGITTE ENGUERAND

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2022 1:44 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 21 juin 2022 Dans la demeure de Paul Claudel, les célèbres « rencontres » fêtent leur cinquantième anniversaire. Directeur artistique, impliqué de toutes ses fibres depuis de nombreuses années, Christian Schiaretti maintient, avec, entre autres, Marie-Victoire Nantet, une programmation de haute qualité. C’est en 1972 que Renée Nantet, fille de Paul Claudel, et Jacqueline Veinstein, créèrent, avec le soutien de Jean-Louis Barrault, entre autres, les « Rencontres de Brangues ». Brangues, ou la paix des poètes. Photo DR. Dans ce château à taille humaine, entre Lyon et Grenoble –pour dire vite à ceux qui ne connaîtraient pas le Dauphiné- Paul Claudel a vécu d’heureux moments. Il repose dans le jardin, un espace à la japonaise, sobre, il incite à la méditation. Christian Schiaretti, artiste de la poésie, qu’il choisisse des textes, mette en scène, dirigeant avec acuité et tendresse des interprètes de générations et d’horizons différents, s’est très tôt impliqué dans la vie, la survie des Rencontres de Brangues. Renée Nantet lui faisait toute confiance et admirait la fluidité de ses analyses et le caractère aigu de son intelligence, son goût de la transmission. Renée Nantet s’est éteinte en janvier 2021, dans sa 104ème année. Sa fille Marie-Victoire Nantet a su poursuivre ce grand travail que suppose la tenue des rencontres. Longtemps, on a rêvé que le lieu entre dans le cercle des « centres culturels ». Christian Schiaretti y pense toujours et dans le texte de présentation, il écrit notamment : « Rencontres, ce mot dit tout. Espérance aussi que l’on y perçoive comme la silhouette, l’ombre portée du grand Centre Culturel de Rencontres à venir. Centre culturel installé dans le domaine et offrant l’année durant les fruits de son activité. Lieu de transmission, de formation, de création, d’un intérêt local et national, grands poètes vivants et élèves des établissements d’à-côté, grands interprètes et public spontané, chacun à l’école de la langue, de sa discipline et de son plaisir, de ses secrets et de l’espoir certain qu’elle constitue. » Mais signalons une création de Christian Schiaretti qui propose, avec Francine Bergé, esprit rétif, immense interprète, dès le jeudi 23 juin à 18h00 à la Maison Ravier, à Morestel, un dialogue saisi sur le vif et intitulé : « Comment j’ai dirigé une actrice notoire en la suivant ». Il s’agit, précise-t-il, de la « chronique impromptue des tribulations d’une actrice et d’un metteur en metteur en scène aux prises avec la prosodie de Paul Claudel. Le spectateur entre dans la coulisse, souvent drôle, de l’élaboration théâtrale. » On peut en rire, l’élaboration orageuse ayant donné un spectacle mémorable. Tout commence avec l’un des habitués des « Rencontres », Jean-Pierre Siméon, une variation à partir de l’Electre de Sophocle. Avec Francine Bergé, Louise Chevillotte, Juliette Gharbi, Julien Gauthier, Kenza Laala, Julien Thiphaine. A voir vendredi 24. A découvrir sur le site. Une nouvelle création de la Jeanne de Péguy, la présence de poètes chinois, de Lydie Dattas, d’Antoine Gallimard et de nombreuses autres personnalités. Et il y a même du théâtre pour les très jeunes ! Et un peu de Molière, évidemment. Réservations par la billetterie → https://rencontres-brangues.fr Ou encore : Offices du tourisme de Crémieu et de Morestel. Et, sur place, au château le jour des représentations. Journées principales, vendredi 24 juin 2022, samedi 25 et dimanche 26 juin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2022 7:41 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 25 juin 2022 Ambiance joyeuse et belle tchatche, vendredi 24 juin, pour la finale de la 12e édition du Trophée d’impro Culture & Diversité.
« Pour venir là, il a fallu partir de loin » : les paroles introductives entonnées, vendredi 24 juin, par le groupe de musique Oliv’et ses Noyaux, sur la scène de la Comédie-Française, résument bien la soirée si particulière qui a électrisé la maison de Molière. Pour la première fois, l’improvisation théâtrale a eu les honneurs de la salle Richelieu. « On vit un moment historique », a résumé Mélanie Lemoine, maîtresse de cérémonie de la finale nationale du Trophée d’impro Culture & Diversité. Pour sa douzième édition, ce rendez-vous s’est tenu sous les ors et les pampilles de cette institution théâtrale. « Il aura fallu beaucoup de temps et d’énergie pour faire se rencontrer ces deux mondes », a reconnu la comédienne. Sur scène, le cérémonial des matchs d’impro est respecté à la lettre : une patinoire en guise d’aire de jeu ; douze collégiens improvisateurs en herbe vêtus de maillots de hockey et accompagnés de leur coach ; un arbitre (Nour el Yakinn Louiz) en tenue noir et blanc, qui édicte les thèmes de chaque impro, siffle les fautes éventuelles et comptabilise, avec ses deux assistants, les votes du public ; des musiciens qui chauffent la salle et comblent les temps de concertation. Nanka, Slimane, Assetou, Emma, Léo, Yousstoine, Daniel, etc., enchaînent six improvisations de durées imposées, en forme mixte (les équipes peuvent jouer ensemble) ou comparée (les équipes se succèdent) et sur des sujets variés : « Pois chiches, harissa et olives noires », « Un blaireau sur la départementale », « Cachez ce vin que je ne saurais voir » à la manière de Molière, etc. La Comédie-Française n’a jamais vu ni entendu ça. Millésime d’exception La salle est joyeuse. Deux mondes et plusieurs générations s’y côtoient. D’un côté, des dizaines de collégiens issus des onze équipes régionales d’impro venues de toute la France avec leurs coachs et professeurs. Pendant la journée, ils ont participé au tournoi pour déterminer les deux équipes finalistes. Habitués des matchs, ils mettent l’ambiance. De l’autre, des invités plus âgés, novices de ce type de spectacle, certains un peu désorientés, mais se prêtant au jeu de brandir le petit carton remis en début de séance pour élire les meilleures prestations. Des officiels sont aux premières loges, parmi lesquels deux ministres de la culture – Jack Lang et Rima Abdul Malak, la toute nouvelle locataire de la Rue de Valois –, la première dame Brigitte Macron et l’entrepreneur milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, créateur de la Fondation Culture & Diversité pour favoriser l’accès à la culture des jeunes issus de milieux modestes. C’est grâce à sa rencontre, en 2010, avec Jamel Debbouze – qui doit tout à l’impro – que le Trophée est né et s’est développé sous la direction artistique d’Alain Degois, surnommé « Papy » et découvreur de l’humoriste. A édition exceptionnelle, déroulé exceptionnel. Au match des collégiens, remporté par l’équipe Ile-de-France-Normandie, a succédé un étonnant « match de gala », réunissant quelques collégiens et des comédiens professionnels, dont Serge Bagdassarian et Séphora Pondi, de la Comédie-Française, ainsi que Jamel Debbouze. Aucun n’a joué la vedette, tous ont respecté l’esprit d’équipe et se sont amusés. Il fallait voir l’improbable duo Serge Begdassarian et Jamel Debbouze improviser en chantant sur l’air de We Will Rock You, de Queen. « Cette turbulence nous fait un bien fou. Tout ça, c’est grâce à Papy Degois. Si Molière était là, il trouverait que cette journée est la plus fidèle à son art et à son geste », a défendu Eric Ruf, l’administrateur de la Comédie-Française, à l’issue de la représentation. Alors que Marc Ladreit de Lacharrière déroulait les remerciements et les chiffres du Trophée d’impro depuis sa création (133 collèges partenaires, 6 500 jeunes), Jamel Debbouze semblait encore étonné d’avoir pu fouler cette scène prestigieuse. « Grâce à cette discipline, j’ai pu m’exprimer et avoir le sentiment d’être digne », a rappelé l’humoriste, avant de lancer : « Liberté, égalité, improvisez ! » Au milieu des collégiens réunis pour la photo souvenir se sont glissés, au premier rang, Brigitte Macron et Rima Abdul Malak. L’impro bientôt intégrée à l’option théâtre dans les établissements scolaires ? Sandrine Blanchard Légende photo : La finale du Trophée d’impro Culture & Diversité en présence de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture et de Brigitte Macron à la Comédie-Française, le 24 juin 2022. THOMAS RAFFOUX

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 21, 2022 5:32 PM
|
Par Philippe Noisette dans Les Echos - 20 juin 2022 Dès les premiers instants, la signature Pina souligne ce « Barbe-Bleue » : scènes rejouées, chaîne humaine, opposition des sexes. Créé en 1977 à Wuppertal, fief de la chorégraphe, ce spectacle à l'instar de son « Café Müller » impose alors la grammaire gestuelle de l'Allemande. Après une série d'opéras dansés comme « Orphée et Eurydice » ou le légendaire « Sacre du printemps », Pina Bausch s'affranchit d'une narration possible et offre au regard ces morceaux de vie. Si on entend bien l'oeuvre de Béla Bartòk, elle est comme disséquée, souvent interrompue - au grand dam des ayants droit du compositeur à l'époque de la création.
Pourtant la créatrice respecte la partition, véritable ossature de ce ballet vertigineux, à défaut de son livret. Dans une salle comme traversée par les vents, au plateau de feuilles mortes, un couple émerge, puis toute la compagnie, des danseurs qui n'ont pas connu Pina. On se tourne autour, se renifle presque dans une esquisse de séduction. Bien vite la violence affleure jusqu'à cette course tête la première contre les murs. Les solistes paraissent se cogner à leur propre vie, qui est aussi la nôtre.
Miroir
Bausch dresse un portrait d'ensemble hérissé de caresses et de domination, de fuites en avant et de pas de deux. Les femmes, en robe longue, sont souveraines, les hommes, en costume ou slip de velours coloré, parfois ridicules. On s'accroche aux parois, un pied dans le vide, on s'affaisse sur un oreiller moelleux pour amortir la chute. La chorégraphe ne juge pas, elle tend un miroir à son époque bouleversée par les révolutions sexuelles et féministes. « Je ne crois pas que dans mes pièces il y ait des moments où l'on puisse dire : 'Elle a voulu ceci ou cela' », nous confia un jour Pina Bausch. Pourtant voir « Barbe-Bleue » en 2022, c'est inévitablement adopter un autre point de vue. La force de cette création en surprendra plus d'un, surtout les jeunes dans le public.
Enfin, cette production est un bulletin de santé du Tanztheater Wuppertal au moment où le Français Boris Charmatz en prend la direction artistique. Les interprètes ici réunis ont une technique irréprochable. Ils deviendront, qui sait, de vraies personnalités de scène. Une danseuse, Tsai-Chin Yu, dans le rôle de Judith (en alternance avec Silvia Farias Heredia et Tsai-Wei Tien) a déjà tout d'une grande. « Barbe-Bleue » (en écoutant un enregistrement sur bande magnétique de l'opéra de Béla Bartòk « Le Château de Barbe-Bleue », son titre complet) conjugue à sa manière, magistrale, le passé au présent.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2022 2:49 PM
|
Par Armelle Héliot dans Marianne - 18 juin 2022
Il y eut plusieurs Trintignant : le très populaire, le très discret ; le comédien à la voix douce, mais aussi l'acteur capable de dureté, d'ambiguïté. Il y eut surtout, au cœur de son art et de son immense culture, un amour considérable pour le théâtre – qui le lui rendait bien.
Il n’avait jamais oublié ce soir de décembre, où, à Marseille, il avait assisté à une représentation de L’Avare de Molière dans la mise en scène de Charles Dullin. L’interprétation du directeur de l’Atelier le marque à jamais. Le jeune étudiant en droit de la fac d’Aix-en-Provence rêve alors de devenir réalisateur. De « faire du ciné », ainsi qu’il le dira toute sa vie. Jean-Louis Trintignant a été initié aux grands textes par sa mère. « Elle adorait les tragédies classiques et récitait de grands rôles, Phèdre, Agrippine. Elle aimait Racine, mais aussi Corneille. Et puis elle m’emmenait aux arènes de Nîmes, voir des spectacles. On jouait Mireille tous les ans, et cela m’enchantait ! Ce fut mon premier contact avec le théâtre. Inoubliable ! » COMPLEXÉ PAR SON ACCENT DU SUD En 1950, alors qu’il découvre la bohème de l’après-guerre à Paris, comme toute sa génération il s’inscrit au cours de Tania Balachova, noue d’indéfectibles amitiés, rencontre sa première femme, Colette Dacheville, qui deviendra Stéphane Audran. Il est timide, complexé par son accent du sud. Il travaille à l’effacer. Il restera toujours dans sa voix, cette voix sourde, envoûtante, qui a fait son charme sa vie durant, un voile subtil qui dit ses origines. À LIRE AUSSI : Paradoxal, touchant, ambigu : immense acteur, Jean-Louis Trintignant n'est plus Il décroche ses premiers rôles. « Nous n’étions pas nombreux sur le marché. On savait que dans tel ou tel théâtre, on pouvait passer des auditions. On partageait une chambre de bonne. On faisait des petits boulots, aux Halles, notamment. Et lorsque l’on voulait être réconforté et manger correctement, on était accueilli chez les parents de Claude Berri. » Premier rôle vraiment professionnel dans À chacun selon sa faim (justement !) de l’oublié Jean Mogin, dans une mise en scène de Raymond Hermantier qui le dirige également dans Marie Stuart de Schiller. Son copain Robert Hossein a écrit Responsabilité limitée que monte Jean-Pierre Grenier. Trintignant est de l’aventure et demeurera proche de la compagnie Grenier-Hussenot. UNE PRÉSENCE SINGULIÈRE Dans ces premières années cinquante-soixante, il partage la scène avec ses pairs, sous le regard des grands metteurs en scène d’alors : René Dupuy pour Le Héros et le soldat de George Bernard Shaw, Sacha Pitoëff pour Andréa ou la fiancée du matin d’Hugo Claus. On est en 1955. Cette même saison il joue Jacques ou la Soumission d’Eugène Ionesco et retrouve ses chères arènes de Nîmes pour La Tragédie des Albigeois de Maurice Clavel et Jacques Panijel, grand spectacle réglé par Raymond Hermantier. Dès ce moment, Jean-Louis Trintignant est un comédien repéré. Sa sensibilité, sa présence singulière, lui offrent de beaux rôles. Jean Meyer le dirige dans L’Ombre de Julien Green. C’est en 1956, époque de ses premiers films, dont, bien sûr Et Dieu créa la femme, et du service militaire. Une parenthèse de trois années réamorcée avec Pierre Valde pour La Cathédrale de René Aubert, Le Prince de papier de Jean Davray, par Jacques Charon. Vieux-Colombier, Fontaine, Œuvre, Huchette, Hébertot, Mathurins : Trintrin, ainsi que l’appelait sa fille Marie, avait des souvenirs dans toutes les salles de Paris. À LIRE AUSSI : Jean-Louis Trintignant, l'élégance d'aimer En 1960, puis en 1971, il joue le rôle-titre d’Hamlet. Le Prince de Danemark devient une obsession. Maurice Jacquemont ne cesse de le faire travailler. Dix années durant, il répète, ressasse, corrige, cherche. Il n’est pas content de lui. Jamais il ne le sera. Son ami pour la vie, Antoine Bourseiller, le dirige dans La Ménagerie de verre de Tennessee Williams. Un univers qu’il apprécie pour sa complexité, pour les souffrances des personnages. Il ne déteste ni la joie, ni l’humour. Mais la gravité sied à son caractère pudique, secret. DU SUCCÈS À LA PISCINE... En 1962, il est engagé par Jean Vilar pour jouer dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux. Dans la cour d’honneur du Palais des papes, avec sa jupette à l’antique, Pâris séduit ! Judith Magre, qui était Cassandre, se souvient encore en riant des succès du jeune prince troyen auprès des filles, à la piscine ! Plus léger, et bien accordé à ses humeurs, il crée la pièce de Françoise Sagan, Bonheur, impair et passe, sous la direction de Claude Régy avant de s’interrompre pour longtemps, n’était la reprise d’Hamlet en 1971. Il attend 1985 pour revenir sur les planches, convaincu par le fin Bernard Murat, qui le met face à Nicole Garcia dans Deux sur la balançoire de William Gibson et joue aussi l’étrange Chasse au cafard de Janusz Glowacki avec Andréas Voutsinas.
Plus tard, il participera par deux fois à Art de Yasmina Reza et apportera son étonnante personnalité aux pièces de Samuel Benchetrit. Comédie sur un quai de gare, avec Marie, en 2002, puis après la mort tragique de sa fille, la cocasse Moins deux, avec son ami Roger Dumas. Un discours de Pinter à Limoux, et Jules Renard avec Jean-Michel Ribes sont d’autres jalons sublimes.
DES CASSETTES AUDIO ÉCHANGÉES AVEC MARIE Il consacre l’essentiel aux poètes et à la musique. D’extraordinaires moments partagés avec Marie, pour Alcools et Poèmes à Lou d’Apollinaire. Dans les années heureuses, le père et la fille correspondaient en échangeant les cassettes qu’ils enregistraient. C’est par la poésie qu’il trouve le courage de reprendre le cours de sa vie, lui qui disait : « Le pire est advenu, je ne crains plus rien. » Jacques Prévert, Boris Vian, Robert Desnos sont ses frères. Accompagné de musiciens et compositeurs, Daniel Mille, accordéoniste, Grégoire Korniluk, violoncelliste, parfois épaulé d’autres violonistes et violoncellistes, il renouvelle sans cesse sa manière de dire, d’éclairer les textes. Une précision magistrale et simple. Le 11 décembre 2018, le public de la Porte Saint-Martin chante pour lui : c’est son anniversaire. L’été dernier, à Châteauvallon, une dernière fois, il avait donné le récital Mille/Piazzolla. Un adieu de poète : ayant hérité du diabète maternel, il avait peu à peu perdu la vue. Mais, avec le soutien sans faille de Mariane, son épouse, il continuait d’apprendre par cœur, par le cœur, de nouveaux textes… Armelle Héliot pour Marianne

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2022 6:04 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 18 juin 2022 Crédit photo : Stéphanie Jasmin.
Sur la scène, une femme fait entendre au public la voix de sa conscience – la part intime d’elle-même irréductible aux décennies qui passent, comme aux allées et venues existentielles. La figure féminine, interprétée avec intensité par l’élégante Julie Le Breton, est plutôt jeune; or, à l’orée de la représentation, la voix semble chevrotante, marquée par l’âge : « J’ai cent ans », dit-elle. Elle rétrogradera à ses soixante-dix ans, puis cinquante ans, dix ans, quatre-vingts ans, etc… L’autrice Stéphanie Jasmin - et la narratrice à travers elle - croirait entendre la voix de sa grand-mère, celle « d’une femme désirante, celle qui est restée intacte à l’intérieur d’elle-même, hors du temps qui passe », parole qui met au jour le désir profond inaccompli de pouvoir écrire elle-même. La parole déferlante, empressée et bousculée - belle prose poétique - incarne le mouvement des marées, le passage de l’ombre à la lumière, du jour à la nuit, le souffle de la vie, selon l’ordonnance de dix mouvements déclamatoires, des diktats intériorisés par l’obéissance et la soumission féminines à l’ordre masculin du monde, lieu d’où elle trouve pourtant sa liberté. L’invitation du spectateur à entendre Les Dix Commandements de Dorothy Dix, chroniqueuse américaine livrant ses conseils de bonheur - vie conjugale, professionnelle et éducation des enfants - dans le New York Journal, lu avidement par l’autrice, dramaturge et scénographe québécoise Stéphanie Jasmin, encline à sonder les âmes féminines.
Or, la journaliste propose aux femmes des années 1930-1940 un nouveau modèle de bonheur typiquement américain.
« 1- Décider d’être heureux. 2 - Tirez le meilleur de votre situation. 3- Ne vous prenez pas trop au sérieux. 4 - Ne prenez pas les autres trop au sérieux. 5 - Ne vous inquiétez pas. 6 - Ne nourrissez pas de rancunes et d’inimitiés. 7 - Restez en mouvement. 8 - Ne revenez pas sur le passé. 9 -Faites quelque chose pour quelqu’un de moins chanceux que vous. 10 - Restez occupée. » Le bonheur ne tiendrait qu’à soi et pour l’entretenir, foin de la tristesse et de la déprime : en échange, accueil à bras ouverts de l’optimisme et de la valorisation de l’activité et la productivité.
La dictature du bonheur consisterait même à ravaler ses larmes pour « rester toujours belle ». L’actrice égrène les trois étapes de ses soins de visage - crème, lotion tonique et baume de jour, et le soir, baume de nuit. Rester aimable, bienveillante et souriante, c’est à peine si la narratrice consent à éprouver ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses deux sœurs moins chanceuses et d’un frère suicidé. C’est grâce aux enseignement de la journaliste que la narratrice a trouvé la force d’élever ses sept enfants, de vivre dans l’ombre du mari, confinée dans les tâches domestiques - un paravent derrière lequel elle a pu éprouver en même temps sa propre vérité et sa reconnaissance - art et littérature. Souffrances, humiliations, frustrations, tout est transcendé « plus haut » et près de soi, et le désir d’écrire comme ultime manière de parler authentiquement, derrière les sourires de circonstance. La mer - images de bord maritime de la Côte Est américaine - est présente dans la vidéo des trois murs du plateau séparés de rideaux noirs fermés. Avec ses plages immenses et les vagues vivaces qui vont et viennent, et la perspective, depuis cette même baie foulée par la narratrice, de la côte élevée, solitaire et silencieuse, pourtant habitée d’immeubles et de roue immense de fête foraine. La contemplation est magnétique de ce paysage sublime à la fois élémentaire et grandiose dans ses changements de lumières, de temps et d’espaces où le public se trouve rivé et enserré. Lui-même est pris dans ce sentiment de la vie qui respire au gré des images et de la parole proférée. De l’enfance chez des religieuses austères, la narratrice passe à sa condition de mère de famille de milieu aisé, puis aux regrets récurrents de ne jamais être allée au bout de son désir d’écrire. Une performance d’actrice, emportée par le flux précipité d’une bourrasque de paroles fracassées. Les dix commandements de Dorothy Dix, texte (édit. Somme Toute, Montréal), vidéo et scénographie Stéphanie Jasmin, mise en scène de Denis Marleau. Avec Julie Le Breton. Lumières Etienne Boucher, musique Denis Gougeon, costumes Linda Brunelle. Du 7 au 26 juin 2022, du mercredi au samedi à 20h, dimanche à 16h, à La Colline - Théâtre National, 15 rue Malte-Brun 75020 - Paris. Tél : 01 44 62 52 52.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 17, 2022 6:52 PM
|
Jean-Louis Trintignant est mort, un homme et une voix s’en vont
Par Jacques Morice dans Télérama - 17 juin 2022 Le timide acteur au sourire tantôt ravageur, tantôt carnassier, est mort ce vendredi à 91 ans. Après avoir reçu un César pour “Amour” de Michael Haneke, il s’est surtout consacré au théâtre et à la poésie, souvent seul en scène, sa voix pour seule compagnie. Le silence et puis sa voix. Qui tinte, se fait clairement entendre, mais sans bruit, comme si elle prolongeait le silence. Cette caresse vibrante, c’est peut-être ce qu’on aimait le plus chez Jean-Louis Trintignant, qui vient de s’éteindre à l’âge de 91 ans. Un séducteur irrésistible, qui a tenu dans ses bras les plus belles actrices du cinéma français (Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Romy Schneider, Anouk Aimée…), tout en étant l’exact opposé du chasseur – malicieux, il se voyait plutôt comme « une victime des femmes ». À l’écran, le timide audacieux pouvait déconcerter. Était-ce un amoureux transi ou un tueur ? À sa voix s’ajoutait une autre arme fatale : son sourire. Une rangée de dents éclatantes, qu’il dégainait à point nommé. Signe d’enchantement ou rictus carnassier, c’est selon. Dans les années 1960 et 1970, il est une star de premier plan. Moins bankable que Delon et Belmondo, et pour cause. Comme ce dernier, Trintignant vient du théâtre, mais lui n’en a pas retenu le panache. Au contraire. Tel Beckett, il a cherché à (se) soustraire, visant le moins d’effets possibles. Intérioriser le jeu, c’était son style. Né en 1930 dans une famille bourgeoise de Pont-Saint-Esprit, dans cette région du Gard à laquelle il est resté attaché toute sa vie, le jeune Jean-Louis a grandi auprès d’un père responsable, cumulant les garanties de moralité – industriel, résistant et maire (SFIO) –, et d’une mère nettement plus fantasque, qui aurait rêvé d’être tragédienne. Et à qui l’on doit cette étrange toquade : elle habille Jean-Louis en fille jusqu’à ses… 7 ans. Il aurait pu lui en tenir rigueur, mais non. « Ça ne me rendait pas malheureux, dira-t-il plus tard. J’ai vécu la condition d’une femme.
Sa rencontre avec le vrai théâtre date de 1949, à Aix-en-Provence, où il découvre le mythique Charles Dullin, malade héroïque, à la veille de mourir, dans sa toute dernière représentation de L’Avare. Révélation : le vague étudiant en droit vient de trouver sa vocation. Il monte à Paris, y suit le cours monté par Dullin puis celui de Tania Balachova, la prêtresse du théâtre moderne. À l’époque, Trintignant a son accent méridional et s’avère totalement inhibé. Il lutte avec sa timidité maladive, pas si rare chez les grands acteurs. À force de s’obstiner, le métier rentre. Il est assez petit, fluet, un peu raide, mais a un atout de poids : un minois de jeune premier. Il plaît d’ailleurs à une jeune femme elle aussi ravissante, Stéphane Audran, avec qui il se marie vite. Le cinéma ? Trop vulgaire pour ce comédien en herbe qui rêve de grands textes. C’est pourtant Et Dieu… créa la femme(1956), de Roger Vadim, qui le révèle de manière retentissante. Lui et surtout Bardot, sa partenaire de jeu. La moue boudeuse de celle-ci, son sex-appeal, son insolente liberté, c’est ce qui sauve toujours le film, bien naïf par ailleurs. Trintignant, très jouvenceau, y peine à convaincre en mari piqué au vif. L’ironie, c’est qu’une passion naît hors de l’écran : Bardot (alors mariée à Vadim) et Trintignant tombent réellement amoureux, faisant les choux gras de la presse à sensation. Un long service militaire et le poids écrasant du star-système auront raison de cette liaison. Après ce moment de gloire prématurée, et à ses yeux futile, l’acteur décide de se forger une réputation plus solide, en s’attaquant à Hamlet, qu’il interprète avec brio. Dans la foulée, il travaille avec Jean Vilar, Antoine Bourseiller, Claude Régy. Mais cela ne dure pas. « On court après le cinéma, par vanité, pour le prestige. Par cupidité aussi : on y gagne huit fois plus que sur les planches ! » avouait-il. Va pour le cinéma, alors. Le commercial comme le plus singulier. C’est un trait de sa carrière : il a souvent donné la sensation d’être à la fois au centre du paysage cinématographique et ailleurs, un peu décalé. Un peu dandy. Abonné à la fois au cinéma de Claude Lelouch (six films avec lui) et à celui d’Alain Robbe-Grillet (quatre films), le pape du Nouveau Roman et auteur de fantasmagories ludiques, à l’érotisme SM sophistiqué. En 1962, dans Le Combat dans l’île (1962), Alain Cavalier le brosse en extrémiste de l’OAS responsable d’un attentat. Un rôle d’exalté froid, qui rappelle celui du Conformiste(1970), de Bertolucci. Où il est impressionnant d’ambiguïté, en fasciste ambitieux et frustré, hanté par la haine de soi, la culpabilité, la tentation double d’obéir et de se singulariser. Dans ce grand film, l’un de ses meilleurs, il distille à merveille violence morbide et beauté. Avec Anouk Aimée, un couple fiévreux à l’écran C’était après que sa douceur de gendre idéal lui ait un peu trop collé à la peau. Voyez Le Fanfaron (1962), où il n’a plus vraiment l’âge d’être un étudiant. Et pourtant, il y est impeccable de gentillesse introvertie à côté de l’exubérant Vittorio Gassman. Ce road-movie ensoleillé qui file à toute allure compte parmi ses choix judicieux, lui qui a su faire carrière en Italie, en tournant là-bas avec des grands. Dino Risi, Bernardo Bertolucci, mais aussi Valerio Zurlini (Été violent, Le Désert des Tartares), Luigi Comencini (La Femme du dimanche),Ettore Scola (La Terrasse, Passion d’amour, La Nuit de Varennes). Dans ce chapitre transalpin, deux pépites témoignent de son penchant aventureux : En cinquième vitesse, giallo pop et sexy, limite expérimental, de Tinto Brass. Et surtout, Le Grand Silence (1968), de Sergio Corbucci, western spaghetti funèbre et enneigé où, le regard triste, il campe un pistolero justicier en restant muet (son nom est Silence). En France, trois films lui ont assuré la gloire. D’abord Un homme et une femme(1966), de Claude Lelouch, tourbillon d’images aussi cruel que romantique, associé à jamais aux planches de Deauville et au « chabadabada » de Francis Lai, où Anouk Aimée et lui, tous deux veufs, forment un couple fiévreux. Z, ensuite, de Costa-Gavras, grâce auquel il décroche un prix d’interprétation à Cannes en 1969. Dans ce réquisitoire efficace contre la dictature des colonels en Grèce, il est le petit juge effacé derrière ses lunettes fumées, qu’on croit sans carrure, mais qui finit par inculper un à un les hauts gradés. Enfin, le must : Ma nuit chez Maud (1969),marivaudage voluptueux de chasteté, où désir et morale s’affrontent dans la chambre de cette chère Maud (Françoise Fabian), libre-penseuse et belle parleuse qui le galantise. Le comédien a hésité avant d’accepter ce rôle d’ingénieur catholique indécis, vertueux mais troublé, qui s’enroule dans une couverture comme une squaw honteuse. Le film, au budget très modeste, n’a pas non plus été simple à tourner, en raison de la personnalité un brin doctrinaire d’Éric Rohmer, qui avait tendance à embrouiller les comédiens en les bombardant de consignes tout en exigeant le respect du script à la virgule près. Des années après, Trintignant a raconté comment il avait fini un jour par acheter des boules Quies pour dire oui à tout et mieux se concentrer. Outre-Atlantique, il y a eu quelques rendez-vous volontairement manqués, Hollywood ne l’ayant jamais vraiment tenté. Il a ainsi refusé de jouer dans Apocalypse Now, de Coppola, et Rencontre du troisième type, de Spielberg. Il pouvait être espiègle. Cela nous avait frappé, lors d’un entretien avec lui en 2012. Il refusait l’esprit de sérieux et avait gardé une certaine innocence. Il aimait le jeu. Dans sa jeunesse, il s’était distingué au poker, gagnant souvent. « Le poker est un jeu de méchanceté, où l’on s’en prend au plus faible. C’est un raccourci saisissant de la vie », disait-il, lui qui n’hésitait point à se qualifier d’« égoïste » – « Les gens m’intéressent, mais au bout de deux jours, je ne veux plus les voir. » Volontiers solitaire, traçant sa ligne de fuite. À l’image de sa pratique assidue de la natation (médaillé plusieurs fois dans sa jeunesse), puis de la course automobile où, sans être un grand champion comme son oncle, Maurice, il a malgré tout remporté quelques compétitions. Il a failli en mourir une fois, aux Vingt-Quatre Heures du Mans, en 1981. Sur la ligne droite des Hunaudières, à 325 kilomètres à l’heure, le pneu arrière qui explose : le bolide se déporte, cogne six fois le rail de sécurité. Il s’en sort sans une égratignure. Un miracle. C’est sur les circuits qu’il a rencontré Mariane Hoepfner, championne de rallye, devenue sa dernière épouse, succédant à Nadine Trintignant, laquelle l’a dirigé à cinq reprises. Après le poker et le sport automobile, il y a le vin. Autre passion, qui l’a amené à acheter des vignes et à produire un côtes-du-rhône, le Rouge Garance (en hommage à Arletty). L’ivresse, les paradis artificiels aussi (il a touché à tout, y compris l’héroïne), il en parlait volontiers, lui qui a connu de grands bonheurs et de grands malheurs – la perte de Pauline, sa seconde fille, à l’âge de dix mois, puis celle de Marie, en 2003, cognée à mort par Bertrand Cantat. Il y avait chez lui autant de soleil que de noirceur suicidaire. Sensibles dans les deux films qu’il a réalisés, méconnus, oubliés à tort, car vraiment originaux. Une journée bien remplie (1972), road-movie brindezingue en side-car d’un fils de boulanger avec sa maman, où Jacques Dufilho déroute en ange exterminateur. Et Le Maître-Nageur (1979), pastiche d’On achève bien les chevaux, où un minable chanteur (Guy Marchand) se fait engager par un milliardaire tyrannique en fauteuil roulant pour organiser un marathon en piscine, avec à la clé le legs de sa fortune. Une comédie féroce et dérangeante sur l’argent dominateur. Retour aux planches, son “vrai métier” Las, Trintignant n’a pas poursuivi dans la mise en scène, faute d’avoir rencontré le succès. Reste que la subtile perversité de ses deux films se retrouve dans bon nombre de ses rôles, même si l’on pointe encore de la douceur dans l’homme de l’exode fragilisé (Le Train, où il tombe amoureux de Romy Schneider) ou le faux-coupable cocasse coincé à la cave (Vivement dimanche !). Ennemi public numéro un (Flic Story, sa grande confrontation avec Delon), mari exquis mais assassin (Eaux profondes),président de la République hautain et machiavélique (Le Bon Plaisir) ou haut dignitaire robotique (Bunker Palace Hotel),il s’impose de plus en plus, au fil des ans, en misanthrope ou cynique implacable, le corps sec, le visage creusé. À partir des années 1990, il se fait rare mais ne manque pas trois grands cinéastes : Krzysztof Kieslowski (Trois Couleurs : rouge),Jacques Audiard (Regarde les hommes tomber), Patrice Chéreau (Ceux qui m’aiment prendront le train).
Et puis est venu le moment où il s’est détaché du cinéma. Il a fait le mémorable Amour – il fallait quelqu’un d’aussi persuasif et talentueux que Michael Haneke pour qu’il accepte de tourner encore. Un film où il est terriblement émouvant, sans jamais être larmoyant, pour lequel il décroche un César. Mais ce qui le maintient en vie, c’est surtout d’être sur scène. Il a toujours pensé que le théâtre était son vrai métier, qu’il avait délaissé après l’échec cuisant en 1971 d’un second Hamlet mis en scène par Maurice Jacquemont. Il y revient grâce à la poésie. Après avoir mis à l’honneur les magnifiques Poèmes à Lou, de Guillaume Apollinaire, en compagnie de sa fille, Marie, il célèbre Jules Renard. Puis il tourne un peu partout en France et même au Québec en disant trois poètes libertaires, Jacques Prévert (sa première lecture foudroyante, à 14 ans), Boris Vian et Robert Desnos. Seul, parfois accompagné par la musique d’Astor Piazzolla et Daniel Mille, il se révèle un récitant extraordinaire, son timbre de voix épousant à nu la profondeur des mots. Avec un ménagement extrême de la sobriété, sa signature de politesse. Jacques Morice / Télérama Légende photo : Jean-Louis Trintignant, à New York, février 1970. Photo Jack Robinson / Getty Images
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 5:20 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 3 juillet 2022 Installé en France depuis 1974, l’artiste a marqué l’une des pages les plus importantes de l’aventure théâtrale. Il laisse des spectacles uniques montés dans son Théâtre des Bouffes du Nord, comme « Le Songe d’une nuit d’été », « Le Mahabharata » ou « La Tempête ». Il est mort samedi à l’âge de 97 ans.
Comme les chats, il semblait avoir eu (au moins) neuf vies. Mais Peter Brook est définitivement passé de l’autre côté, du côté de cet invisible, dont il n’avait eu de cesse de vouloir s’approcher, encore et encore. Le metteur en scène britannique, installé en France depuis 1974, est mort samedi 2 juillet à Paris, à l’âge de 97 ans, a appris Le Monde dimanche. Avec lui s’éteint une des aventures théâtrales les plus importantes de la deuxième partie du XXe siècle, qui a fait du théâtre un fabuleux instrument d’exploration de l’humain, dans toutes ses dimensions, au fil de spectacles légendaires : Le Songe d’une nuit d’été, La Tempête, La Tragédie de Carmen, Le Mahabharata, La Cerisaie, L’Homme qui…, jusqu’à cette merveilleuse Flûte enchantée créée par le maître en 2010 en son Théâtre des Bouffes du Nord, jusqu’à ce Battlefield qui, à l’automne 2015, le vit offrir une quintessence pure et lumineuse de son théâtre et de sa recherche. Cette esthétique du divers, cette éthique de la curiosité avaient été trempées d’emblée dans l’histoire de sa famille. Peter Brook naît à Londres, le 21 mars 1925, de parents émigrés juifs originaires de cette Lettonie qui faisait alors partie de l’Empire russe. Son père, Simon, jeune révolté appartenant au parti menchevik, avait dû s’exiler en 1907, accompagné de sa très jeune femme, Ida. Le couple fait ses études à Paris et à Liège, avant de fuir la Belgique pour l’Angleterre en 1914, avec l’arrivée de l’armée allemande. Le nom russe de la famille, qui se prononçait Bryck, a été déformé en Brouck dans sa transcription par l’administration française, avant de devenir Brook à l’arrivée en Angleterre. Peter Brook confiait invariablement, quand on l’asticotait sur ce sujet, n’avoir aucun lien réel avec ses origines juives. En revanche, la culture russe était encore fortement présente dans sa famille, et restera, tout au long de sa vie, inscrite de manière très intime, comme une clé essentielle de compréhension de cet homme à la fois formidablement ouvert et totalement énigmatique. Ce lien avec la Russie fut ainsi au cœur de sa rencontre, en 1950, avec son épouse, l’actrice Natasha Parry (1930-2015), elle aussi d’origine russe : Peter Brook avait été frappé, notamment, par le fait qu’elle s’appelait comme l’héroïne de Guerre et Paix, de Tolstoï… Le couple nommera d’ailleurs leur fille Irina, en hommage à la plus jeune des héroïnes des Trois Sœurs, de Tchekhov – Irina Brook (née en 1962) est elle aussi metteuse en scène et dirige le Théâtre national de Nice de 2014 à 2019. Une carrière fulgurante Passionné de photo et de cinéma, le jeune homme, qui déteste une institution scolaire britannique traditionaliste et xénophobe, aimerait devenir réalisateur, dans cette grise Angleterre de la fin de la guerre et de l’après-guerre. Mais le milieu du cinéma lui paraît inaccessible. Alors il se tourne vers le théâtre, à Oxford, où il étudie la littérature russe. La carrière du jeune ambitieux est fulgurante : première mise en scène professionnelle à 21 ans, en 1946, avec Peines d’amour perdues, de Shakespeare, l’auteur-continent qu’il ne cessera d’arpenter tout au long de sa vie, et qui structurera toute sa réflexion sur le théâtre. A 22 ans, il signe avec Roméo et Juliette son premier spectacle dans le temple shakespearien de Stratford-upon-Avon. A 23 ans, il est nommé directeur de production à l’Opéra royal de Covent Garden. Il en est renvoyé quelques mois plus tard, après avoir par trop bousculé les habitudes de cette vénérable institution, et provoqué un beau scandale avec sa mise en scène de Salomé, de Richard Strauss, dans les décors surréalistes de Salvador Dali. Surnommé l’enfant terrible, Peter Brook aurait pu continuer ainsi, en jeune homme brillant travaillant sans états d’âme à la fois dans l’institution et dans le théâtre commercial. Mais, à partir du milieu des années 1950, son rapport au théâtre commence à changer insensiblement, ouvrant cette longue période de novation qui va faire de lui une des figures essentielles du renouvellement théâtral de la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de sa réflexion sur le « théâtre mortel », ayant perdu tout son sens. D’abord, il se décentre – déjà… –, en travaillant à New York, au Metropolitan Opera, et à Paris, où il met en scène La Chatte sur un toit brûlant, de Tennessee Williams, Vu du pont, d’Arthur Miller et, en 1960, Le Balcon, de Jean Genet, qui n’a pas encore été créé en France. Mais c’est surtout sa mise en scène stylisée de Titus Andronicus, en 1955, pour la Royal Shakespeare Company, qui fait date dans l’histoire du théâtre, en imposant une vision nouvelle de Shakespeare, et en posant la première pierre de ce dépouillement raffiné qui va devenir l’essence de son art. Théorie de l’espace vide Au début des années 1960, Brook, nourri des écrits des pionniers de la modernité théâtrale – le Russe Meyerhold, l’Anglais Gordon Craig et, surtout, le Français Antonin Artaud et son théâtre de la cruauté –, stimulé par l’effervescence tous azimuts de ces années-là, notamment les recherches du Living Theatre et celles du Polonais Jerzy Grotowski, rompt définitivement avec le théâtre officiel. Il s’attaque à la folie, aux camps de la mort, à la guerre du Vietnam, avec Marat-Sade et L’Instruction, de Peter Weiss, et US, une création collective. « J’étais saturé de cette imagerie que j’avais tellement aimée, et je sentais de plus en plus qu’au cœur du théâtre, il y a une seule chose, qui est l’être humain, et donc l’acteur », nous expliquait Peter Brook dans un entretien réalisé en novembre 2010. « J’ai commencé à m’intéresser au développement intérieur, aux techniques basées sur les mouvements du corps, la respiration, pour arriver à faire sortir de la personne tout son potentiel. » « Si on veut parler de l’être humain, on ne peut pas le réduire à l’être humain blanc et bourgeois de nos sociétés » Cette recherche est formalisée, en 1968, par un ouvrage théorique devenu un classique, L’Espace vide, qui s’ouvre par ces lignes célèbres : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé. » « J’avais très envie, aussi, de casser la rampe, ce quatrième mur invisible qui, au théâtre, coupe la scène et la salle, ajoutait Peter Brook en novembre 2010. Dans le théâtre classique, la structure des salles est une structure bourgeoise, qui conditionne le contenu. En parallèle, j’éprouvais la nécessité, expérimentée en 1968 grâce à Jean-Louis Barrault, d’avoir un atelier international. Si on veut parler de l’être humain, on ne peut pas le réduire à l’être humain blanc et bourgeois de nos sociétés. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés Jean-Claude Carrière, scénariste et écrivain, est mort à l’âge de 89 ans En 1970, Brook crée son dernier spectacle dans le cadre de la scène officielle anglaise, avec ce Songe d’une nuit d’été qui, lui aussi, fait date, en perchant les comédiens sur des trapèzes, dans un espace vide d’une blancheur immaculée. Mais surtout, il crée son Centre international de recherche théâtrale (CIRT), composé d’acteurs venus des quatre coins de la planète, dont certains, comme le Britannique Bruce Myers et le Japonais Yoshi Oïda, resteront jusqu’au bout des fidèles. Pendant trois ans, ils joueront un peu partout, en France, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, et surtout là où le théâtre ne va pas : dans des foyers d’immigrés en banlieue et des bidonvilles à Paris, dans les ruines de Persépolis en Iran, au fin fond du Sahara et sur des places de villages au Mali ou au Nigeria, chez les Chicanos à la frontière mexicaine et dans une réserve indienne, dans les rues du Bronx ou de Brooklyn, à l’hôpital Sainte-Anne à Paris ou en entreprise à Jouy-en-Josas (Yvelines), dans des garages, des salles de cinéma à l’abandon… L’aventure des Bouffes du Nord Pendant ces trois ans, Peter Brook a avancé dans sa réflexion sur ce qu’est un espace théâtral partagé : comment se crée le lien avec le spectateur ? Comment éviter la coupure entre le lieu clos du théâtre et le dehors, la vie, la vraie vie ? En 1974, la redécouverte miraculeuse du Théâtre des Bouffes du Nord, qui tombait en ruine, dans le quartier populaire de La Chapelle, à Paris (10e), lui offre l’occasion de synthétiser toutes ses recherches. « Les Bouffes sont vraiment l’espace caméléon dont je rêvais, propre à stimuler et libérer l’imagination du spectateur, un espace où un partage est possible » Ce sera le début d’une aventure exceptionnelle, notamment pour les spectateurs français qui l’ont suivie passionnément. Une aventure qui s’est poursuivie jusqu’à l’hiver 2010, quand Peter Brook a mis en scène Une flûte enchantée, « sa » Flûte, d’après l’opéra de Mozart, et a confié les clés de « son » théâtre à Olivier Poubelle et Olivier Mantéi, un duo d’administrateurs venus du monde de la musique. Et qui s’est encore prolongée, puisque les nouveaux patrons ont accueilli ensuite toutes les créations du maître. Peter Brook avait trouvé dans ce lieu magique que sont les Bouffes du Nord tout ce dont il rêvait, comme il nous le racontait dans un entretien en 2004 : un théâtre installé dans un quartier populaire et cosmopolite, porteur d’une histoire, d’une mémoire inscrites sur ses murs comme sur une peau, et « doté de proportions extraordinaires, uniques en Europe, dont nous avons découvert plus tard qu’elles étaient les mêmes que celles du Théâtre de la Rose de Shakespeare ». Lire aussi Article réservé à nos abonnés Les Bouffes du Nord, l’espace vide idéal « Ne dirait-on pas à la fois une cour, une mosquée, une maison ? », demandait Peter Brook avec fierté en faisant faire le tour du propriétaire. « Les Bouffes sont vraiment l’espace caméléon dont je rêvais, à la fois intérieur et extérieur, propre à stimuler et libérer l’imagination du spectateur, un espace où un partage est possible, ainsi que la concentration qu’exige le théâtre. Car le théâtre n’est rien d’autre qu’une expérience humaine plus concentrée que celles que nous avons coutume de vivre dans la vraie vie. » La recherche de cette « expérience humaine plus concentrée » va donner lieu à toute une série de spectacles inoubliables, dans cet espace unique dont Peter Brook et la codirectrice du théâtre, Micheline Rozan (1928-2018), femme de tête qui l’accompagne depuis les années 1950, ont su garder la « beauté des ruines », avec ses murs craquelés, couleur rouge de Pompéi, symboles de l’éphémère qui par essence définit le théâtre. Tout englober de l’expérience humaine En octobre 1974, pour l’ouverture, ce sera Timon d’Athènes – Shakespeare, of course –, avec François Marthouret, Maurice Bénichou, Bruce Myers… Puis il y aura Les Iks, d’après l’histoire, étudiée par l’anthropologue Colin Turnbull, d’une tribu africaine passée sans transition de l’âge de fer au XXe siècle ; La Conférence des oiseaux, inspirée par le poète persan du XIIe siècle Farid Al-Din Attar ; La Cerisaie, un Tchekhov intime, avec Michel Piccoli ; La Tragédie de Carmen, emmenée par l’irrésistible Hélène Delavault, avec laquelle Brook renouvelle totalement le théâtre musical ; Le Mahabharata, d’après le grand récit mythique indien, sans doute son spectacle emblématique, s’il fallait n’en choisir qu’un, créé dans une carrière de pierre, au Festival d’Avignon. « L’être humain est le seul ésotérisme qui mérite d’être déchiffré » Et puis encore La Tempête – Shakespeare toujours… –, avec le comédien malien Sotigui Kouyaté (1936-2010), autre acteur fétiche, dans le rôle du magicien Prospero ; L’Homme qui, inspiré par les recherches du neurologue Oliver Sacks ; The Island, Le Costume et Sizwe Banzi est mort, pièces issues des townships sud-africaines ; Hamlet, avec le comédien anglais d’origine jamaïcaine Adrian Lester ; Tierno Bokar, d’après Amadou Hampaté Ba, La Mort de Krishna, d’après Vyasa, et Le Grand Inquisiteur, d’après Dostoïevski, trois réflexions sur la religion et la tolérance… Le récapitulatif donne le vertige, et la mesure d’un homme qui semble avoir voulu tout englober de l’expérience humaine, y compris dans ses dimensions ésotérique ou mystique. L’influence fondamentale d’un théâtre élisabéthain – « Shakespeare est à l’origine de tout », disait-il – à la fois comique et tragique, politique et frivole, brut et sacré, se joignait chez lui à des recherches plus mystérieuses, notamment le travail effectué pendant des années avec des disciples du maître spirituel Georges Gurdjieff (1866-1949), personnage sur lequel il a réalisé son film Rencontre avec des hommes remarquables, en 1979. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Théâtre : Peter Brook, l’épure au bord du vide Peter Brook, pourtant, détestait qu’on le prenne pour un gourou, et qu’on lui demande quel était le lien entre sa connaissance – et sa pratique – des philosophies orientales, son goût pour l’ésotérisme et son travail avec les acteurs. Dans son loft lumineux de la Bastille, à Paris, vaste espace vide principalement meublé de tapis et de livres – d’art, d’anthropologie, de philosophie… –, son œil bleu laser se posait sur vous avec encore plus d’intensité que d’habitude, et il vous répondait que « l’être humain est le seul ésotérisme qui mérite d’être déchiffré ». Ce qui était encore une pirouette de chat, cet animal magique entre tous, puisque cet « ésotérisme » humain demande bien des clés et des techniques pour être décrypté. Le metteur en scène a fait du théâtre le lieu par excellence de cette pluralité d’approches. Mais avec l’homme Peter Brook, le mystère ne faisait que s’approfondir, au fur et à mesure qu’on le connaissait davantage. Peter Brook en quelques dates 21 mars 1925 Naissance à Londres 1946 « Peines d’amour perdues », première mise en scène professionnelle 1970 « Le Songe d’une nuit d’été », avec la Royal Shakespeare Company ; création du Centre international de recherche théâtrale (CIRT) 1974 Installation à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord 1985 « Le Mahabharata » 2010 « Une flûte enchantée », d’après Mozart 2015 « Battlefield » 2018 « The Prisoner » 2022 Mort à 97 ans Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : Peter Brook dans son Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, en août 2015. BERTRAND GUAY/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 8:31 PM
|
Sur le site de l'émission Affaires culturelles, d'Arnaud Laporte, sur France Culture Le metteur en scène présentera pour la première fois dans son intégralité "Le Nid de Cendres", un spectacle épique et fantastique d'une durée de treize heures.
Ecouter l'entretien (5 mn)
En recomposant à l'occasion du 76e Festival d'Avignon où il sera présenté à partir du 9 juillet à La FabricA pour la première fois dans son intégralité son spectacle Le Nid de Cendres (sept pièces en tout, réarrangées pour une durée totale de treize heures heures), le metteur en scène Simon Falguières s'inscrit dans la fameuse tradition des spectacles fleuves du festival pour proposer un récit épique tendu entre le monde du rêve et la réalité.
Un projet de troupe, un projet au long cours, aussi, démarré il y a sept ans au Cours Florent où Simon Falguières s'est formé.
Au micro d'Arnaud Laporte, il revient sur cette épopée
Présentation du spectacle : Enfant de la balle, Simon Falguières a déjà une longue expérience de la mise en scène et de l’écriture à son actif. Il relève un défi dont seuls quelques intrépides rêvent encore : le spectacle fleuve. Soit treize heures de théâtre interprétées par dix-sept comédiens aux soixante personnages et deux cents costumes ! À la fois conte merveilleux et épopée fantastique, son Nid de Cendres est constitué de sept pièces qui se succèdent dans un suspens qui maintient les spectateurs en alerte. Une aventure riche en péripéties qui entraîne le public dans deux mondes en péril, celui des rêves – le royaume de la princesse Anne – et celui de la réalité, qui a pour héros le comédien Gabriel. Et si au début du spectacle, ils ignorent leurs existences réciproques, bientôt guidés par une force surnaturelle, ils vont tout faire pour se rejoindre et peut-être ainsi sauver leurs mondes en les unissant…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 8:25 PM
|
Par Sylvia Zappi dans Libération - 1er juillet 2022 Reportage dans les coulisses de la création de Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan jouée par une troupe d’amatrices de la ville de Seine-Saint-Denis, avant les représentations du 1er au 3 juillet.
Sur la scène, un cratère plein d’eau, une rampe électrique qui pend et des projecteurs qui jonchent le sol. Une sirène d’alarme retentit. Est-ce la guerre ? Une ville à l’abandon ? Un groupe de femmes vêtues d’un poncho de pluie force une porte et se précipite dans la pénombre, leurs lampes torches balayant la salle. Une dizaine d’enfants terrorisées entrent à leur tour, accompagnées de leur professeure de danse. Plus tard, ce sont des adolescentes trempées après une baignade à la base de loisirs qui surgissent, hagardes. Trente fillettes, jeunes filles et femmes vont trouver refuge dans cet antre délabré que constitue un vieux théâtre à l’abandon. Ce mercredi 29 juin, au Théâtre Gérard-Philipe (TGP) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), c’est soir de répétition avant la générale et les trois soirées où va se jouer Fille(s) de, la nouvelle pièce de Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan. Durant une heure et demie, une trentaine d’adultes ou en devenir vont se raconter, tisser des liens, se reconnaître, malgré les différences d’âge : sur scène comme dans leur quotidien, des femmes dans un monde masculin, filles de mères aussi, certaines déracinées de leur propre histoire. Les deux metteuses en scène cadrent le jeu, reprennent une tirade. La troupe concentrée, en dépit de la journée de travail ou d’école, écoute et reprend. Entre petites et grandes, la complicité est visible. Projet expérimental La pièce est d’abord le fruit de la rencontre de ces trois groupes constitués pour un projet expérimental. Dans la vraie vie, enfants comme adultes sont d’abord des habitantes de Saint-Denis, banlieue populaire du nord de l’Ile-de-France. La directrice du TGP voulait recruter des amatrices issues du tissu associatif ou des maisons de quartier : « L’idée était d’être entre femmes – parce que le féminin induit un travail sur l’émancipation –, en laissant chacune partir de son histoire », explique Julie Deliquet. Des heures d’improvisation, d’écriture en groupe générationnel, de répétitions et, au final, un texte touchant et vivant réécrit par Leïla Anis. Dans ce récit de femmes mues par une envie d’être vivantes, on reconnaît les intonations de Debout les femmes ! (2021), le documentaire de François Ruffin (député LFI) et Gilles Perret. Ou encore des témoignages du film A la vie (2021), d’Aude Pépin. Chacune raconte son quotidien de labeur – les passages sur le sort des soignantes dans un hôpital à bout de souffle sont particulièrement criants de vérité –, ses défaites et ses petites victoires sur la vie. L’émotion est là, très présente quand Merbouha, la lingère, casquette à l’envers sur la tête, raconte la première femme aimée et la folle douceur éprouvée ; ou quand la jeune Soumaya décrit les sévices que, toute son enfance, sa mère lui a fait subir, avant qu’elle ne décide de s’enfuir. Derrière ces histoires, on sent les vécus de certaines jeunes actrices, et cela sonne juste. On assiste peu à peu, avec ce texte, tel un puzzle qui se met en place, à un croisement d’émotions, de peurs et de désirs s’exprimant face à l’inconnu des plus jeunes quand les plus vieilles consolent et encouragent. Mais, peu à peu, l’espoir surgit et s’installe dans cette sororité improvisée. Comme quand cette mère dit les mots de soutien que Soumaya n’a jamais entendus : « Je te promets d’être là si tu tombes, si tu te sens tomber et que tu as besoin que je te donne la main, si tu as besoin que je te regarde avancer sans dire un mot. » La mise en scène de ces moments de résilience est tout en épure. Le jeu de lumières colorées ou tamisées caresse les costumes – blouse blanche des infirmières, volants des petites danseuses ou serviette des adolescentes. Le résultat est plutôt bluffant pour une troupe amatrice. « Fille(s) de », création mise en scène par Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan, écriture collective avec la collaboration de Leïla Anis. Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules-Guesde, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Du 1er au 3 juillet. Tarif 7 euros. Tgp.theatregerardphilipe.com Sylvia Zappi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 6:27 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 2 juillet 2022
La 56e édition, du 7 au 30 juillet, après deux années perturbées par le Covid-19, cherche à renouer avec le public.
Le Festival « off » d’Avignon renoue avec son gigantisme. Trente-trois mille levers de rideau, 1 570 spectacles, 6 000 artistes, 138 lieux, les chiffres de cette 56e édition, qui se déroulera du 7 au 30 juillet, tordent le cou à deux années perturbées par le Covid-19. Annulé en 2020, organisé en mode dégradé sous contraintes sanitaires en 2021, ce plus grand rassemblement théâtral, en marge du « in », attire cet été plus de mille compagnies. Pour elles, le « off » agit comme un aimant, un rendez-vous sans équivalent pour montrer leurs créations et espérer une indispensable diffusion. Car professionnels et directeurs de lieux venus de toute la France viennent y faire leur marché. « 25 % de la programmation nationale est issue du “off” », rappelle Harold David, le nouveau coprésident, au côté de Laurent Domingos, de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C). Ce binôme – le premier est codirecteur de trois salles avignonnaises (l’Atypik, l’Archipel et Le Rouge Gorge), le second est comédien, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Minuit44 – a été élu mi-avril, en remplacement de Sébastien Benedetto, dans une ambiance délétère. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Sébastien Benedetto, le « off » d’Avignon en héritage La crise sanitaire n’a pas seulement perturbé le festival mais aussi déclenché une guerre de clans et d’ego au sein d’AF&C, association qui accompagne et supervise le « off », notamment en éditant le catalogue des spectacles proposés. Huissier, assignation au tribunal pour non-respect des statuts, « le conseil d’administration a vécu six mois de cauchemar », témoigne Véronique Boutonnet, de la compagnie Les Ames Libres, et entraîné des démissions. Vaste marché Cette guerre intestine a plusieurs origines. D’abord le fonds d’urgence octroyé, à l’été 2020, par le ministère de la culture au « off » d’Avignon, pour atténuer les conséquences de son annulation. Dénonçant l’absence de concertation de l’AF&C et les critères d’attribution des aides (seuls 49 lieux ont pu en bénéficier), des dizaines de salles avignonnaises non permanentes se sont regroupées au sein d’une nouvelle Fédération des théâtres indépendants d’Avignon (FTIA), coprésidée par Harold David. Les nouveaux présidents d’AF&C, Harold David et Laurent Domingos, ne remettent pas en cause les chantiers lancés avant eux Ensuite, la volonté affichée de Sébastien Benedetto et de son équipe de proposer un festival « plus apaisé et plus raisonnable », notamment en limitant le nombre de créneaux horaires par salle, a fini de cristalliser les oppositions sur la manière de contrôler ce vaste marché du spectacle vivant. « Réguler le festival, rééquilibrer les risques financiers entre lieux et compagnies, c’était une manière d’assurer l’avenir », défend Sébastien Benedetto. Les nouveaux présidents d’AF&C jurent désormais que « la discorde ne portait pas vraiment sur les choix mais sur un problème de gouvernance trop verticale ». Sur le fond, Harold David et Laurent Domingos ne remettent pas en cause les chantiers lancés avant eux. Il est toujours question de professionnaliser davantage le festival, d’inciter à l’élaboration d’un « label » de bonnes pratiques pour les salles et les compagnies, et de développer l’accueil d’artistes en résidence afin que de nombreux théâtres ne restent pas fermés onze mois sur douze. « Si des dizaines de compagnies étaient accueillies à l’année, le visage d’Avignon, en devenant une fabrique d’art vivant, changerait hors saison. Cela permettrait aussi de travailler sur les publics du territoire », considère Harold David. Baisse de la fréquentation Pour l’heure, l’enjeu de cette 56e édition est justement de renouer avec le public, après une baisse de la fréquentation en 2021. Avant le Covid-19, le « off » attirait près de 300 000 festivaliers, enregistrait environ un million d’entrées (pour une jauge de 3,5 millions de places) et assurait quelque 50 millions de retombées économiques. Mais les études montrent que le public vieillit et peine à se renouveler. Peut-être a-t-il du mal à se retrouver face à une offre pléthorique ? Il y a vingt ans, ce festival accueillait 500 spectacles. Cet été, sur les 1 570 à l’affiche, plus de 1 000 sont des créations. Si les pièces de théâtre restent largement majoritaires (912 propositions), la catégorie « humour/café-théâtre » arrive en deuxième position (253), suivie par le « jeune public » (180) et les « spectacles musicaux » (150). Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Avignon, 1982, le festival « off » devient un marché Parmi les nouveautés de cet « off » 2022, l’ouverture de La Scala Provence (pendant de La Scala Paris), en lieu et place du Pandora, confirme l’intérêt des producteurs parisiens pour la scène avignonnaise. Dotée de quatre salles – dont une de 600 places, un record dans le « off » –, La Scala Provence proposera 31 spectacles pluridisciplinaires du matin au soir et deviendra, hors festival, une scène permanente accueillant des créations et des résidences d’artistes. « 2022 doit être l’année de la fête et de la liberté retrouvée », espère Laurent Domingos. La traditionnelle parade, défilé des compagnies en musique et en costumes, renaîtra mercredi 6 juillet, en espérant que le contexte de reprise épidémique ne vienne pas perturber ce retour tant attendu à la normale. Festival « off » d’Avignon, 56e édition, du 7 au 30 juillet. Sandrine Blanchard Légende photo : Pour l’édition 2022 du « off », sur les 1 570 spectacle à l’affiche, plus de 1 000 sont des créations. Ici, une représentation sur l’esplanade devant le Palais des papes à Avignon, en juillet 2021. THOMAS O’BRIEN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2022 9:30 AM
|
Par Le Figaro avec AFP Publié le 30 juin 2022 Le réalisateur et metteur en scène russe avait fait du Centre Gogol, à Moscou, un haut lieu de l'avant-garde. Dans un message posté sur compte Telegram, il déplore la nomination d'un nouveau directeur en phase avec le Kremlin. Le réalisateur et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, opposé à l'offensive en Ukraine, s'est insurgé contre le changement de direction de son ancien théâtre, qu'il avait transformé en épicentre de l'avant-garde. Entre 2012 et 2021, Kirill Serebrennikov, désormais en exil à l'étranger, a été le directeur artistique du Centre Gogol à Moscou, un théâtre municipal, où il a mis en scène des pièces osées mêlant critique sociale et de la religion, sexualité, des thèmes peu en phase avec la ligne conservatrice du Kremlin. À LIRE AUSSI Kirill Serebrennikov en ouverture du Festival d'Avignon mais toujours interdit de sortie de Russie L'année dernière, il avait dû quitter son poste, son contrat n'ayant pas été renouvelé. Quelques mois auparavant, il avait été condamné dans une affaire controversée de détournement de fonds. Mercredi soir, le département de la Culture de la ville de Moscou a indiqué qu'un nouveau directeur artistique, Anton Iakovlev, avait été nommé au Centre Gogol et que l'établissement allait retrouver son ancien nom : le Théâtre dramatique Nikolaï Gogol. Immédiatement, Kirill Serebrennikov a dénoncé le «meurtre» d'un lieu qu'il avait complètement métamorphosé et dont la plupart des spectacles étaient joués à guichets fermés. Pour lui, ce changement est lié au conflit en Ukraine. «Ils ont décidé de fermer le théâtre. Pour sa prise de position, pour son honnêteté. Pour avoir essayé d'être libre. Pour le fait que, depuis tous ces mois que dure la guerre, les acteurs, qui protestent contre la guerre, ne font plus de salut mais terminent chaque spectacle sur l'image d'une colombe», a affirmé l'artiste. «D'un point de vue artistique, ce n'est pas seulement un acte malveillant. C'est un meurtre. Un nouveau meurtre ordinaire», a-t-il conclu, dans un message publié sur son compte Telegram.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2022 4:51 PM
|
Par Nathalie Simon - Le Figaro - Mars 2020 CRITIQUE - Au Théâtre de Belleville , Chloé Lacan se raconte en musique à travers sa passion pour la chanteuse de jazz américaine. Auteur et chanteuse, Chloé Lacan se raconte et relate son parcours à travers sa passion pour Nina Simone, disparue en 2003. «Tout nous sépare, l’époque, le pays et la couleur de peau. Et pourtant, au départ, il y a deux petites filles», explique-t-elle. Et la même envie de devenir artiste, de se libérer des carcans de l’éducation et des préjugés. «Birds Flying High You Know How I Feel», chante la chanteuse de jazz américaine, pianiste prodige dès l’âge de 5 ans et qui rêve d’être la «première concertiste classique noire en Amérique». Tandis que sa fan se souvient de la première fois où elle a entendu son timbre de voix si particulier. De son enfance à elle, des chants liturgiques qui résonnait dans l’église quand elle accompagnait sa grand-mère à la messe. De la «fille», puis de la «femme parfaite» qu’elle voulait ardemment être pour ses parents désunis. «Longtemps, j’ai fait ce qu’il fallait pour plaire à ma mère, pour garder mon père», confie Chloé Lacan. Née Eunice Kathleen Waymon en 1933 à Tryon, descendante d’esclaves, la future Nina Simone luttera pour les droits civiques. Chloé Lacan, elle, bataille pour s’émanciper du désir des autres. S’imposer, imposer ses différences, s’écouter elle. Entre la légende afro-américaine et la Française qui a des origines algériennes, le point commun, c’est le combat pour la liberté. Sans oublier le talent, l’énergie vitale et une colère qui les fait avancer. Un plateau dépouillé Aux côtés de Chloé Lacan, aussi à l’aise avec un accordéon qu’avec un ukulélé, Nicolas Cloche, formidable interprète et multi-instrumentiste touche-à-tout l’accompagne. En osmose, le duo offre un hommage rythm and blues et jazzy à Nina Simone. Conquis, ailleurs, le spectateur bat la mesure, fredonne. En chœur avec les deux artistes dirigés par Nelson-Rafaell Madel, acteur et ancien assistant à la mise en scène de Claude Buchvald. Ce dernier a opté pour un plateau dépouillé où ne figurent que les instruments de musique. «Do I Move You?» («Est-ce que je te donne envie de bouger?»), demandait Nina Simone au public. Ajoutant: «Tu as plutôt intérêt à répondre “oui”!» Oui, répond-on aujourd’hui et sans se forcer. A Avignon off La Manufacture - 21h

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2022 10:52 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 23 juin 2022 Exilés en France, le metteur en scène Ukrainien Vlad Troitskyi et les actrices-chanteuses -musiciennes des Dakh Daughters présentent une déchirante « Danse macabre ». Et la SACD met à l’honneur deux artistes ukrainiens : le cinéaste Oleg Sentsov et Vlad Troitskyi. Portrait – souvenir du créateur, entre autres, du théâtre Dakh. Lundi dernier, Vlad Troitskyi, l’air ébouriffé comme à son habitude, était dans le jardin de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), pour la remise annuelle des prix. Cette année, la société des auteurs avait décidé d’honorer l’Ukraine en accordant deux grand prix européens, l’un à Oleg Sentsov et l’autre à Vlad Troitskyi. Quelques jours auparavant, Vlad Troitskyi avait présenté Danse macabre sur la scène du théâtre de l’Odéon-Berthier, avec les Dakh daughters (Natacha Charpe, Natalaia Hanlanevych, Rusiana Khazipova, Solomia Melnyk, Anna & Nikitina) et, son épouse, Tetiana Troitska. Tous sont en exil à Vire, en Normandie, depuis mars dernier, accueillis par la directrice du CDN Lucie Berelowitsch (qui avait signé une Antigone avec les Dakh daughters) et logés avec l’aide de la municipalité. Je me souviens. J’avais rencontré Vlad Troitskyi pour la première fois à Kiev en 2009 lors de la troisième édition du Gogol fest, Dix jours durant le Gogolfest occupait l’Arsenal de Kiev désaffecté et comme abandonné. Probablement l’une des plus grandes friches du monde s’étendant sur plus de 60 000 m2. Une foule énorme, jeune. Un service d’ordre quasi invisible. Des expos de peintures et de photos où l’amateur côtoyait le professionnel et où l’humour était souvent de rigueur, des projections de films, des spectacles dans des halls aux imposantes colonnes de pierre, des installations, des concerts de rock ou de fado, des débats à n’en plus finir. Cette cohabitation inédite des arts, cette atmosphère de fête, c’était le rêve de Vlad Troitskyi. Je m’attendais à voir un type nerveux, affairé, voire un maigrelet à lunettes comme son quasi homonyme. Rien de tel. Je découvrais un homme flegmatique comme sorti d’une longue sieste, les yeux embués de sommeil et de rêveries, les cheveux follement en bataille, un visage plutôt rond. Un homme calme, incroyablement calme au milieu de cette foule qu’il semblait apaiser par sa présence tranquille. Il ressemblait plus à un SDF ou à un poète qu’à un manager. Mais derrière le look bigarré veillait le manager. Entouré d’une fine équipe, celle du théâtre Dakh qu’il dirigeait en avait fondé quelques années auparavant, Troitskyi et ses acteurs, dix jours durant, ont fait une fête de ce festival portant le nom de l’écrivain le plus cher au cœur des ukrainiens. Kiev n’avait jamais connu une manifestation artistique aussi ample et aussi libre, à mille lieues des cérémonies officielles encore très soviétiques à l'époque, à mille lieues aussi des opérations marketing de firmes ou de milliardaires. Le grand art de Troitskyi, hier comme aujourd’hui, est de savoir naviguer entre les gouttes et avec tact. Des riches sponsors, il en avait trouvé pour ce festival, mais comme lui, ils se faisaient discrets. Troitskyi est un fédérateur hors pair. Diable d’homme ! Comme beaucoup de futurs artistes nés en Union soviétique, il avait fait des études scientifiques. Et non des moindres : l’école polytechnique. Au sortir des études supérieures, ses travaux de physiciens lui valent d’être remarqué par des revues américaines. Au moment de l’éclatement de l’Union soviétique, il investit ses connaissances scientifiques et sa clairvoyance dans le business. Fortune faite, pour assouvir pleinement a passion, il entre comme élève dans la grande école de théâtre moscovite, le GITIS. De retour au pays, après quelques aventures, en 1994 Vlad Troïtskyi fonde à Kiev le Centre d’art contemporain Dakh (toit), une sorte d’hôtel des arts où l’on fait de la musique, du théâtre et où on y expose. L’esprit du futur Gogolfest qu’il créera dix ans plus tard, est déjà là. Cette année-là, alors qu’il signe ses premiers spectacles, il crée au sein du Dakh le groupe de musique DakhaBraha, catalogué comme « ethno-chaos », un qualificatif qui résume bien la musique du groupe (aujourd'hui connu dans le monde entier et actuellement en tournée aux Etats-Unis). Très vite aussi, Troitskyi crée une école de théâtre alternative où des professeurs formés à Moscou dans le sillage d’Anatoli Efros et d’Anatoli Vassiliev viennent former les jeunes acteurs ukrainiens, loin des professeurs de l’école officielle de Kiev le plus souvent fossilisés dans des dogmes soviétiques. A l’exception d’un seul, un vieux monsieur respecté, l’auteur, pédagogue et metteur en scène ukrainien Vladimir Oglobline qui, avant de mourir en nonagénaire en 1995 aura eu le temps de transmettre son savoir à Vlad et aux jeunes actrices et acteurs du théâtre Dakh. Pour financer et animer toutes ces activités, Vlad Troitskyi s’est rapidement éloigné du business tout en gardant des parts dans des affaires qui lui offrent alors des revenus substantiels avec lesquels il paie ses acteurs et finance ses spectacles. Car cette aventure, fondatrice du nouveau théâtre ukrainien, n’est aucunement subventionnée. L’utopiste en lui fait la paire avec l’entrepreneur, le businessman avec l’artiste, le pragmatiste avec le rêveur. Un homme fort en paradoxes. Et il en va de même pour l’éventail de ses spectacles. Dans l’une des vastes salles de l’Arsenal, j’avais pu voir La mort de Gogol . Le public était installé sur un gradin devant une imposante lande de terre noire et au-delà un bassin de quelques centimètres d’eau sur plus de 50 mètres de long où les acteurs évoluaient, leurs voix modulant leur réverbération tandis que le groupe DakhaBraha, installé sur le côté, les accompagnait de ses stridences et de son lamento obsédant. Un spectacle magnifique qui nous transportait dans l’Ukraine des tréfonds. J'en verrai d'autres l'année suivante, très différents² Au théâtre Dakh aménagé au pied d’un immeuble à deux pas du terminus d’une des lignes du métro qui desservent Kiev, les dimensions sont stout à fait à l opposé de la scénographie gigantesque vue à l’Arsenal: on passe à une scène de 6 mètres sur 6. Sur le plateau, à travers des spectacles comme son Prologue à Lear ou des nouvelles paysannes de Pirandello, Vlad Troitskyi déploie les circonvolutions d’un même univers qu’il nomme « mystique Ukraine » . Un petit théâtre unique en Ukraine Et qui aura tenu en haleine ses spectateurs à de 1999 jusqu'à ces derniers mois. En fait, rien ne ressemblait mieux à Vlad Troïstkyi que son théâtre fait de bric et de broc qu’il a dû abandonner. malgré lui, à l’heure de l’exil. Mais conjurons les temps, et parlons au présent du théâtre Dakh. On y entre par une porte en bois comme en possède beaucoup d’immeubles datant des années soviétiques. Derrière la porte, un étroit couloir long de deux ou trois mètres. Au fond à gauche un petit rebord qui tient lieu de caisse, à droite en retrait un petit vestiaire où déposer son manteau en hiver et emmailloter ses chaussures dans des chaussons en plastique bleu pour ne pas maculer le sol des paquets de neige qui colle aux souliers. On pénètre alors dans un foyer-capharnaüm meublé de chaises et de canapés dépareillés, d’un piano droit, et entassés pêle-mêle sur des étagères des masques, des instruments (cuivres, tambourins, etc.) et puis aussi des chaises suspendues au plafond. Sous l’apparent fouillis, un rangement très organisé. Dans un recoin, un bar où une jolie fille vous propose du vin chaud au clou de girofle. Une atmosphère chaleureuse à l’image de ce que dégage Vlad. Au son d’une sonnette agitée à bout de bras, on se dirige vers le fond. C’est là qu’est la salle de théâtre, grande comme une salle de classe, une soixantaine de places en se serrant bien. Le spectacle commence et là on se rend compte que la jeune femme de la caisse, le gars du vestiaire et la jolie fille du bar sont aussi des comédiennes ,des comédiens. Une fois le spectacle fini, ils deviennent machinistes, débarrassent le plateau. Comme Vlad, ils sont tranquillement hyper actifs et possèdent plus d’une corde à leur arc. La preuve : de ce groupe allait naître les Dakh daughters. On connaît la suite : leur venue en France au festival Passages, au Théâtre Monfort, au Théâtre Vidy-Lausanne, au Printemps des comédiens et ailleurs. Jusqu’à ce que la guerre en Ukraine les contraigne à l’exil pour exercer leur art. Quand Vlad et ses actrices-musiciennes-chanteuses reverront leur cher Dakh théâtre ? Leur toit ? Leur pays ? Mêlant légendes et récits de scènes de guerre, de viols, Danse macabre porte bien son nom. La musique, les voix et les chants déchirants accompagnent la douleur. Pour tout décor : les valises de l’exil en attendant qu’elles soient celles du retour. Danse macabre, après la création au Mans à l’Espal avec la Fonderie, Paris et Poitiers, le spectacle sera le 25 juin à l’espace Malraux de Chambéry, le 29 juin au Théâtre de Pully avec le théâtre de Vidy-Lausanne, le 4 juillet au Théâtre National de Strasbourg, le 5 juil let au théâtre de la ville de Luxembourg, le 21 juillet à la fondation Cartier dans le cadre des Soirées nomades, les 26 et 27 sept au festival de Tbilissi (Géorgie), le 9 oct au CDN de Vire-Normandie. Jean-Pierre Thibaudat / Balagan

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2022 10:17 AM
|
par Ève Beauvallet dans Libération - publié le 26 juin 2022 Après la condamnation du chorégraphe à dix-huit mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une de ses danseuses, la compagnie Troubleyn s’est vue retirer ses subventions. Une décision inévitable, mais qui intervient dans un contexte extrêmement tendu pour la culture flamande, soumise par le gouvernement à des pressions budgétaires effarantes. Le 29 avril, Jan Fabre, chorégraphe et plasticien flamand de renommée internationale, était condamné à dix-huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Anvers pour agression sexuelle contre l’une des danseuses de sa compagnie Troubleyn, et pour violences ou humiliations à l’égard de cinq autres. Depuis l’émergence du mouvement #MeToo, cette condamnation d’un artiste pour des faits de violences sexuelles ou morales dans le cadre du travail est à notre connaissance la première à advenir dans le milieu du spectacle vivant. La précision n’est pas anodine. Car dans le cas du théâtre ou de la danse en particulier se pose inévitablement, dans la foulée du procès, la question de la mort programmée des œuvres (la fameuse «cancel culture», comme les polémistes l’appellent). En effet, si le spectateur peut toujours choisir de revoir ou non, en conscience, les films de Woody Allen, de Roman Polanski, ceux produits par Harvey Weinstein – ceux, en somme, d’hommes impliqués dans des scandales de violences sexuelles – il ne verra probablement plus les spectacles créés par Jan Fabre depuis trente ans, lesquels étaient pourtant considérés avant que le scandale n’éclate comme des jalons incontournables de l’histoire de la scène. Poubelle ? Avis défavorable Pour que ce répertoire continue à exister, il aurait fallu d’une part que des danseurs acceptent de remonter sur scène, que des directeurs de théâtre tiennent à programmer une œuvre entachée par la signature de l’artiste (quand bien même Jan Fabre n’accompagne plus les tournées des danseurs depuis longtemps). Il aurait fallu, surtout, que cette compagnie employant une quarantaine d’employés fixes et de nombreux intermittents survive financièrement au jugement. Fin mars, la commission d’évaluation chargée d’examiner les dossiers de demandes de subventions dans le secteur culturel flamand avait rendu un avis défavorable pour la compagnie Troubleyn. Comme attendu, le cabinet du ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), responsable de la culture, a confirmé ce vendredi que la structure de Jan Fabre ne percevrait pas d’argent public pour la période 2023-2027. Voilà donc qui devrait intéresser les historiens et sociologues de l’art et donner une autre stature aux archives vidéo. Contexte de stress maximal Sur le dossier Fabre, la décision gouvernementale semble évidemment légitime. Elle intervient néanmoins dans un contexte de stress maximal pour le milieu de la culture flamand, soumis à des pressions budgétaires alarmantes qui ne sont pas sans rappeler le carnage opéré en France notamment par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. En avril, rappelait la RTBF, le secteur culturel flamand avait lancé une campagne sous le hashtag #ambitieuzerdandit («plus ambitieux que cela») pour demander au gouvernement régional d’investir davantage de moyens dans la culture, à l’heure où un organisme sur quatre était menacé de perdre ses subsides. Ces organismes en question sont bien connus en France pour avoir produit, soutenu, accompagné cette fameuse «nouvelle vague» flamande enviée de la part le monde. Des artistes de la stature de Jan Lauwers – qui avait conquis le festival d’Avignon avec son blockbuster la Chambre d’Isabella en 2004 – étaient dans le viseur d’un «comité d’experts», mais aussi la célèbre Toneelhuis d’Anvers dirigée par le metteur en scène très souvent diffusé en France Guy Cassiers, ou encore l’ensemble de musique contemporaine Ictus. Finalement, le gouvernement a repêché neuf de ces organisations dont la Toneelhuis, laquelle se dit «soulagée, malgré les avis négatifs, de recevoir 2,6 millions de subventions. Avec ce montant, la Toneelhuis peut garantir son fonctionnement, mais cela nécessite une révision approfondie des plans et des budgets proposés. Nous allons nous y atteler dès demain». Eve Beauvallet / Libération Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" Légende photo : Répétition générale du spectacle «The Power of Theatrical Madness» par la compagnie Troubleyn, au Burgtheater de Vienne le 17 juillet 2012. (Herwig Prammer/REUTERS)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 21, 2022 6:55 PM
|
Par Lilia Blaise (Tunis, correspondance)
Publié le 19 juin 2022 dans Le Monde Ecrite et mise en scène par la jeune dramaturge Essia Jaibi, l’œuvre se base sur des faits divers et les témoignages de victimes des brutalités policières et sociales. Percutant.
Neuf représentations à guichets fermés et des standing ovations pour les comédiens. La pièce de théâtre Flagranti, restée à l’affiche à Tunis jusqu’à début juin, a su conquérir son public en abordant un sujet encore tabou dans le pays. Sur un scénario aux airs de thriller et inspiré de faits réels, la troupe s’est employée à décortiquer les affres subies par la communauté LGBT en Tunisie. L’article 230 du Code pénal tunisien, dénoncé par de nombreuses associations de défense des droits humains, condamne « l’homosexualité » et la rend passible de trois ans d’emprisonnement pour les personnes prises en flagrant délit, qui donne son nom au titre de la pièce. Les arrestations peuvent même donner lieu à un test anal forcé, une pratique qualifiée de « torture » par les Nations unies. En 2019, 120 procès pour homosexualité ont été traités par la justice tunisienne. Pour la dramaturge Essia Jaibi, âgée de 33 ans, il fallait à tout prix dénoncer cette situation juridique. « La lutte pour les droits LGBT existe depuis dix ans, mais il n’y a pas eu beaucoup d’avancées. Nous voulions donc aller vers une autre forme d’expression », indique-t-elle. « Sujet accessible à tous » La pièce est le fruit d’une collaboration avec Mawjoudin We Exist, une association de lutte pour l’égalité des droits LGBT. « Nous avons écrit les dialogues à plusieurs car je voulais qu’il y ait des voix différentes et c’est moi qui me suis occupée de la mise en scène et de l’écriture », raconte Essia Jaibi. Elle s’est efforcée, dit-elle, de rester la « plus didactique possible pour aborder un tel sujet qu’il faut pouvoir rendre accessible à tous ». Pour son texte, la metteuse en scène s’est basée sur plusieurs faits divers, entretiens et rapports documentés réalisés par l’association Mawjoudin. L’histoire finale est celle d’une bande d’amis dont la vie se retrouve bouleversée après avoir voulu signaler à la police la disparition d’un de leurs camarades. Deux d’entre eux sont placés en garde à vue quand les enquêteurs découvrent leur orientation sexuelle à l’occasion d’un interrogatoire musclé. Lire aussi : Dans « Le Prix du cinquième jour », Khaoula Hosni réinvente les codes de l’intrigue sentimentale La pièce n’élude aucun sujet et livre des éclairages sur la loi et la définition de termes propres à la communauté LGBT, en intégrant des intermèdes audiovisuels. « Beaucoup de gens sont conscients de ce que vit cette communauté mais pas forcément dans les détails. Par exemple, beaucoup parlent du test anal sans savoir de quoi il s’agit réellement », explique Essia Jaibi, qui a voulu utiliser les ressorts esthétiques du théâtre pour « décrire avec le plus de fidélité possible une réalité ». Certaines scènes peuvent choquer dans un pays encore conservateur sur les questions de sexualité. « Mais il vaut mieux aller droit au but que de continuer à utiliser le symbolisme qui a prévalu dans le théâtre tunisien pour contourner la censure sous la dictature », tranche Karam, membre de Mawjoudin, qui prône « l’artivisme », le changement des mentalités par l’entremise d’un art engagé. « Avant le Covid, nous avions pu faire des festivals de films queer en Tunisie. Aujourd’hui, nous voulons provoquer un vrai débat, car le théâtre permet un contact direct entre la scène et le citoyen », poursuit-il. Un débat qui n’a pourtant pas vraiment eu lieu faute d’une médiatisation suffisante. « Nous avons été interviewés par des radios qui s’intéressent à ces problématiques, mais il n’y a pas eu de couverture dans les médias nationaux grand public », déplore Karam. « Encourager l’empathie » La pièce a cependant drainé de nombreux jeunes, déjà avertis ou membres de la communauté LGBT, mais aussi des Tunisiens plus âgés qui ont accompagné leurs enfants. Tels Adnene Sellami, chef d’entreprise, et sa femme Emna, tous deux la soixantaine, qui ont rejoint leur fille par curiosité. « C’est vraiment important de voir que des jeunes peuvent oser parler librement de ces problématiques, insiste Adnene. On n’aurait pas pu assister à ce genre de pièce il y a quelques années. » « Le sujet fait mal car je ne savais pas qu’il y avait autant de violences subies par cette communauté. On met enfin des images sur des choses dont on avait seulement entendu parler », renchérit Emna. Myriam, étudiante en marketing de 23 ans, est venue grâce au bouche-à-oreille. Cette militante LGBT se dit « très émue » : « D’habitude je suis des performances culturelles via les réseaux sociaux sur la communauté LGBT mais à l’étranger. Cela fait du bien de voir une pièce en arabe et qui parle vraiment de notre quotidien en Tunisie. » Pour Karam, il s’agit aussi de changer la perception et la représentation de l’homosexualité chez les Tunisiens : « Il y a des personnages efféminés ou homosexuels dans les feuilletons tunisiens, même ceux diffusés au moment du ramadan, mais c’est très caricatural. Ils sont toujours pris en pitié ou tournés en dérision et ne représentent pas réellement le point de vue de la communauté. » Il affirme avoir vu de nombreux spectateurs touchés par la pièce et se réjouit que très peu soient partis au milieu. « C’est ce que nous voulions, encourager le débat mais aussi l’empathie », dit Karam. Comme Essia, il espère que le spectacle va circuler dans les régions pendant l’été, à travers les festivals. « Encore faut-il qu’on nous laisse réellement le montrer et organiser des discussions en marge de la scène, relève-t-il. Comme la plupart des programmateurs de festivals sont étatiques, on ne sait pas encore si ce sera possible. La censure a différentes formes. » Lilia Blaise (Tunis, correspondance) Légende photo : Les acteurs tunisiens Mohamed Ouerghi et Hamadi Bejaoui dans la pièce « Flagranti », écrite et mise en scène par Essia Jaibi, à Tunis le 16 mai 2022. FETHI BELAID / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 20, 2022 4:31 AM
|
Par Gilles Renault dans Libération - 19 juin 2022 Très réussi, le nouveau spectacle de Marc Lainé oscille entre le drame familial et l’intrigue d’espionnage impliquant une vedette yéyé. Pour qui fréquente l’univers du prolifique Marc Lainé, la nouvelle histoire démarre là où la précédente s’était arrêtée (alors qu’en réalité, l’écriture a suivi l’ordre inverse de celui où l’on découvre les deux spectacles, la pandémie ayant juste chamboulé la chronologie). L’échelle, en revanche, est tout autre. Passionné de son propre aveu par les voyages, l’auteur, metteur en scène et scénographe, qui a eu sa période américaine, s’en tient désormais (du moins, jusqu’à nouvel ordre) au continent européen, qu’avec lui, on parcourt en train, moyen de transport propice au vague à l’âme. Ainsi, en était-il du modeste et séduisant Nos Paysages mineurs qui disséquait l’éclosion puis la flétrissure d’un couple, au fil de trajets Paris-province, à la fois interprétés sur scène et filmés en live. Pièce montée Le plateau et l’écran, mais aussi la musique et ce désir d’enchâsser la trame narrative dans un contexte socio-historique documenté : tous les éléments du puzzle Lainé (déjà étalés en 2015 dans Vanishing Point, qui sillonnait le grand nord canadien) sont à nouveau mixés. Mais cette fois au format «superproduction», dans Nosztalgia Express, un «divertissement» select qui, avec une crânerie tâchant de faire fi du pédantisme, prend l’aspect d’une pièce montée, autour d’une intrigue… montée de toute pièce. Ou comment, entre une France bigarrée à la veille de basculer dans le charivari revendicatif de Mai 68, et une Hongrie secouée en 1956 par l’invasion des troupes soviétiques venues mettre au pas une nation désireuse de s’émanciper (un ancrage fortuit qui fait tilt, par exemple au détour de tel couplet : «Les bombes russes auront raison/ De votre grande révolution»), un jeune homme, devenu vedette yéyé en panne d’inspiration, part à Budapest à la recherche d’une mère qui, sans la moindre explication, l’avait abandonné, enfant, sur un quai de gare à Reims. Chef de chantier Ainsi compacté, l’imbroglio, dont on pressent qu’il peut tenir l’auditoire en haleine, ne dit pourtant pas tout ce qui bouillonne dans la tête du directeur (depuis 2020) de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche. Un chef de chantier qui, tant qu’à y aller franco, entreprend de juxtaposer les époques (le récit couvrant une trentaine d’années) et les registres, dans un maëlstrom qui engloutit géopolitique, drame familial et intrigue d’espionnage. Le tout, flambé au pastiche et parsemé de chansons à contre-courant (cf. ces inflexions parfois intimistes évoquant l’univers d’un Alex Beaupain) qui, à intervalles réguliers, cèdent, non sans caractère, à la tentation de la comédie musicale. Ce qui, deux heures quarante profuses plus tard, laisse à l’évidence un rien pantelant, animé que l’on est par le désir de ne pas égratigner un projet aussi singulier, vaillamment joué – jusqu’à l’outrance, assumée –, chanté, scénographié et éclairé, cependant qu’objectivement surdimensionné. «Nosztalgia Express», de Marc Lainé, Théâtre de la Ville, les Abbesses, 75018, theatredelaville-paris.com, 01 42 74 22 77, jusqu’au 23 juin. Légende photo : «Nosztalgia Express», un projet singulier, vaillamment joué, chanté, scénographié et éclairé. (Christophe Raynaud De Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2022 6:36 PM
|
par ARMELLE HÉLIOT dans son blog - 15 juin 2022
Avec la compagnie qu’il a fondée, Le Royal Velours, il recompose en un feuilleton de six épisodes, l’actualité française depuis septembre 2016. Des croquis, des analyses, de la férocité, une joyeuse énergie et un sens profond du théâtre et de ses possibilités. Le point numéro 1 du contrat qu’Hugues Duchêne propose aux spectateurs de son feuilleton politique sur la France est ainsi formulé : « Je m’en vais mais l’Etat demeure est une pièce de théâtre dont l’histoire débute en septembre 2016 et se termine à la date du jour où le spectacle est joué devant les spectateurs. » Un contrat strictement observé si l’on en croit les derniers épisodes de ce long fleuve non tranquille. L’épisode 6 est pour l’essentiel consacré à cette année d’élection présidentielle, avec en particulier, un gros plan sur le parcours du candidat Zemmour. On imagine donc Hugues Duchêne et ses comédiens très impliqués, au travail actuellement, pour ajouter les scènes de l’anéantissement du phénomène, lors du premier tour des élections législatives, à Cogolin ! Nous serons conduits à reparler de ce travail au long cours entamé il y a pas mal de temps et dont on avait aperçu le dessein au Train Bleu d’Avignon il y a cinq ans et, un peu plus tard, en décembre 2019, dans le cadre d’Impatience au 104. Trois filles –mais qui jouent aussi les hommes, à commencer justement par Zemmour ou Jean-Michel Ribes- cinq garçons dont le « patron », le chef de troupe, le capitaine qui fracasse tout, Hugues Duchêne. Saluons Vanessa Bile-Audouard, Juliette Damy, Marianna Granci, Théo Comby-Lemaître, Robin Goupil (en alternance avec Gabriel Tur), Laurent Robert, Gabriel Tur. Et puis leurs camarades assistants à la mise en scène, Victor Guillemot, Pierre Martin, vidéaste. Une bonne bande, pas de doute. Cela va vite, c’est féroce. Peu d’éléments de décor, et du jeu. Du jus ! La forme est évidemment contraignante : il faut aller rapidement, avoir des points de vue, les assumer, tout en étant assez impartial. Disons-le, plus on est près du présent, plus Je m’en vais mais l’Etat demeure nous paraît pertinent. On déguste les piques, la manière de mettre en scène, littéralement, les événements. La jeunesse de cette troupe lui donne même le droit d’être hâtive et de formuler des « vérités » à l’emporte-pièce, si l’on peut dire, qui nous font rire, même lorsque l’on n’est pas d’accord ! Un spectacle qui bouscule et réveille, et qui est, en même temps, une célébration sincère et amoureuse du théâtre. Ils sont passés par l’Académie de la Comédie-Française. Ils ont déjà du métier. Mais nulle arrogance dérangeante. Ils se prennent pour un groupe doué, et ils ont raison. Hugues Duchêne aime faire de l’immersion. Être pris pour qui il n’est pas. En l’occurrence, pour s’en tenir à ses derniers exploits, se rapprocher, comme un vrai-faux photographe de presse, du pouvoir et pénétrer des cercles très surveillés. Il aime séduire. Gare à se laisser séduire ! Avec sa haute silhouette, il domine facilement des petits mondes des adorateurs de Macron ou de Zemmour ! Les comédiens excellent à passer d’une humeur à l’autre, d’un costume à l’autre, d’une composition à l’autre. Ils ont du talent. Mais Hugues Duchêne, au cœur de cette deuxième partie, épisode 5, impose une personnalité forte, très plastique, très originale. C’est lui, en fait, de par sa seule et haute ambition, qui donne son sens et sa profonde légitimité à cette mise en œuvre d’un théâtre qui s’adresse à tous et accomplit sa belle mission : éclairer et divertir. Théâtre 13-Glacière, jusqu’au 26 juin. Du mardi au vendredi à 20h00. Chaque épisode dure environ 1h10. Mardi et jeudi, première partie (1, 2, 3), mercredis et vendredis, deuxième partie (4,5,6). En intégrale les samedis et dimanches à partir de 15h00. Durée : 8h00 entractes compris. Tél : 01 45 88 16 30. www.theatre13.com Autres dates : 2 juillet, Festival Malaze, Annecy (74) 27 août, Festival Pampas, Sainte-Foix-la-Grande (33)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2022 4:55 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 17 juin 2022 En dépit de sa voix de velours et de sa présence unique, le comédien, mort vendredi à 91 ans, n’aura réussi son grand rendez-vous avec la scène qu’au soir de sa vie, avec la forme des récitals. Il commence comme un enfant resté seul : « J’entends mon cœur qui bat, c’est maman qui m’appelle. » Jean-Louis Trintignant sait qu’il n’en a plus pour longtemps quand il choisit de dire ces mots de Jules Laforgue (1860-1887), le 28 janvier 2018, à Radio France. Ce soir-là, l’acteur fait un enregistrement public, dont le CD (paru en juin 2018) restera comme son testament. Daniel Mille est à l’accordéon, Grégoire Korniluk au violoncelle, Diego Imbert à la contrebasse, ils jouent des musiques d’Astor Piazzolla, et Jean-Louis Trintignant les écoute comme il écoute battre son cœur au rythme des poètes libertaires qu’il aime, Boris Vian, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire… Lire aussi Jean-Louis Trintignant, l’acteur qui voulait rester clandestin, est mort D’Aujourd’hui je me suis promené, de Robert Desnos, à Je voudrais pas crever, de Boris Vian, en passant par Mon ptit Lou adoré, de Guillaume Apollinaire, et Cher frère blanc, de Léopold Sédar Senghor, c’est un cœur vivant, à gauche, amoureux et revenu de tout qui nous parle, de cette voix magnifique dont le temps n’a pas altéré l’élégante mélancolie. Une voix qui se souvient, qui va et vient entre hier et aujourd’hui, dans l’instant frémissant du très grand âge. Chaque jour, Jean-Louis Trintignant disait qu’il allait mourir et, chaque jour, il semblait trouver une lueur de bonheur, comme dans celle de faire connaître un poème de son petit-fils Paul Cluzet, Je dors à l’ouest, que l’on entend dans l’ultime CD. S’oublier en s’exposant Lire aussi Jean-Louis Trintignant : « Le vin et la poésie sont toujours liés » L’acteur vivait la vieillesse comme une expérience contemplative, et il aimait s’oublier en s’exposant devant des spectateurs, au théâtre, à qui il disait « merci d’être venus », comme s’il s’excusait d’être là pour dire ses poèmes préférés. Il y aurait eu une coquetterie dans cette attitude si Jean-Louis Trintignant n’avait pas tout connu, et s’il ne lui était pas resté un fond de la timidité qui le tétanisait quand il apprenait le métier, dans sa jeunesse. C’était à Paris, dans l’immédiat après-guerre. Et c’était arrivé d’une manière banale : un jeune homme suit mollement des cours de droit, en province. Un comédien passe dans la ville, il va le voir. Et lâche le droit, parce qu’il a compris que sa voie était sur scène. Ainsi fit Jean-Louis Trintignant, à Aix-en-Provence, après que Charles Dullin (1885-1949) y eut joué L’Avare. Il monta dans la capitale, apprit, se trouva mauvais. Mais il avait une présence que les metteurs en scène ont aussitôt repérée. Dès 1950, Jean-Louis Trintignant s’aguerrit dans les petites salles de la rive gauche où s’invente le théâtre d’art. Il est encore « un débutant » quand Le Monde le remarque dans une pièce de Robert Hossein, Responsabilité limitée, en 1954. Six ans plus tard, c’est le grand saut : Maurice Jacquemont (1910-2004) choisit l’acteur pour être Hamlet dans la traduction de Shakespeare par Jacques Copeau. Du prince du Danemark, Jean-Louis Trintignant fait, selon le journaliste et académicien Bertrand Poirot-Delpech, « un gamin bourru maladif qui aurait juré d’inquiéter ses parents ». En 1971, Maurice Jacquemont remettra Hamlet sur le métier, toujours avec Jean-Louis Trintignant qui, cette fois, montrera « une retenue fraternelle ». Dans les deux cas, l’entreprise s’avère périlleuse, et la réussite incertaine. Un charme absolu Le succès n’est pas non plus au rendez-vous quand Jean Vilar (1912-1971) met en scène La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Giraudoux, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon, en 1962. Trop datée de l’avant-guerre, la pièce passe mal, malgré la présence de Jean Vilar, de Judith Magre et de Jean-Louis Trintignant. Ce dernier n’aura pas réussi son grand rendez-vous avec le théâtre, dans sa carrière. Est-ce parce qu’il n’a jamais appartenu à une troupe ou qu’il a trop peu travaillé avec de grands metteurs en scène ? Ou tout simplement parce que le cinéma a pris le dessus, même s’il le trouvait beaucoup moins intéressant que le théâtre ? Une pièce de Tennessee Williams, La Ménagerie de verre, en 1961 ; une autre de Françoise Sagan, Bonheur, impair et passe, en 1964… Puis vingt ans s’écoulent avant que Trintignant ne renoue avec la scène, dans un boulevard mièvre, Deux sur la balançoire, de William Gibson. En 1996, il joue dans Art, de Yasmina Reza, et en 2001 dans Comédie sur un quai de gare, de Samuel Benchetrit, l’ancien compagnon de Marie Trintignant. Unis sur le plateau comme ils le sont dans la vie, Jean-Louis Trintignant et sa fille dégagent un charme absolu. En 1994, ils s’étaient retrouvés pour la première fois sur scène, pour une lecture de Roland Dubillard (1923-2011), à Avignon. Puis ils firent, en 1999, un récital Apollinaire. « Mon ptit Lou adoré, je voudrais mourir un jour que tu m’aimes », disait l’acteur. C’est ainsi, avec sa voix berçant les jours et les nuits des poètes, que Jean-Louis Trintignant aura donné le meilleur de lui-même. En 2005, deux ans après la mort de Marie, il a créé une autre pièce de Samuel Benchetrit, Moins 2, dans laquelle il jouait un vieil homme enfui de l’hôpital. Cette année-là, il a retrouvé la Cour d’honneur du Palais des papes d’Avignon pour le récital Poèmes à Lou, déjà avec Daniel Mille et Grégoire Korniluk. Et il a triomphé. Mais il a refusé de revenir à Avignon, où il était invité en 2011, parce que Bertrand Cantat, le meurtrier de sa fille, était lui aussi invité à se produire dans un spectacle de Wajdi Mouawad. Lire aussi Jean-Louis Trintignant annule sa participation à Avignon en raison de la présence de Bertrand Cantat Dans les années qui ont suivi, Jean-Louis Trintignant est apparu, de récital en récital, tel un Lear sur la lande, privé de sa Cordélia mais continuant, sans se départir du mystère d’un homme et d’un acteur qui comme nul autre pouvait dire : « Beau temps mauvais temps ; qui pourrait se vanter d’en avoir vécu autant ? » Brigitte Salino Légende photo : Avec sa fille, Marie Trintignant, au Théâtre de l’Atelier, en 1999 VICTOR/ARTCOMPRESS/LEEMAGE
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...