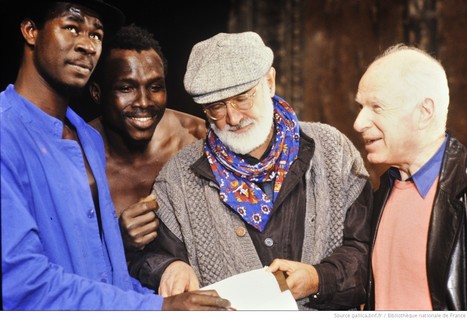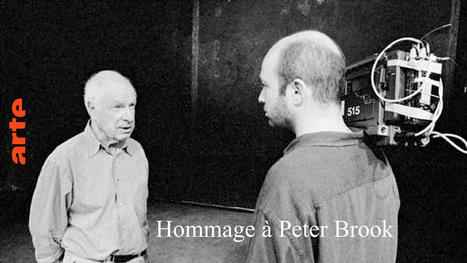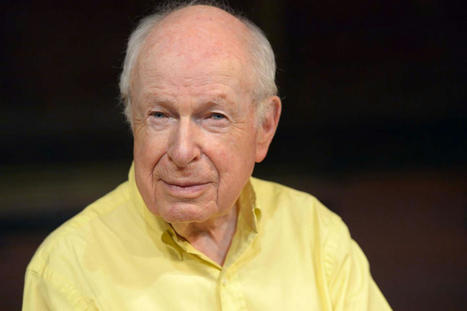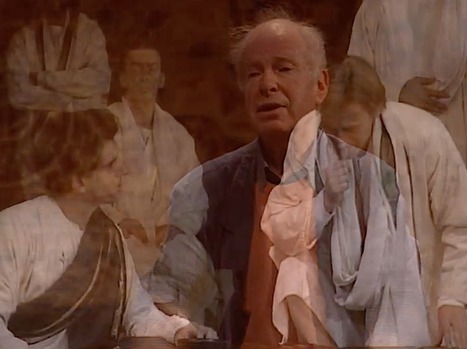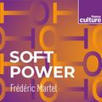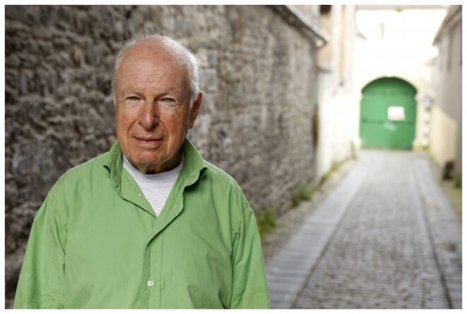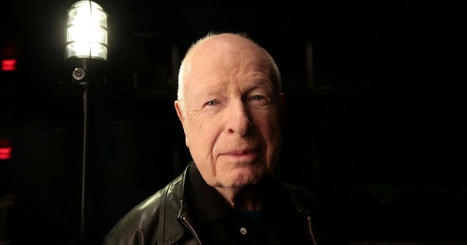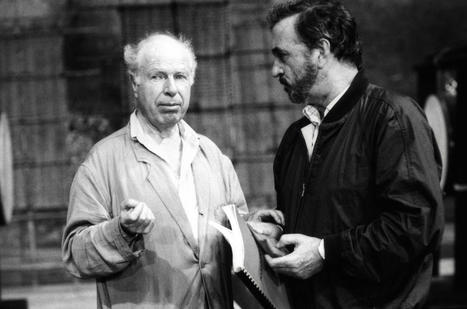Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 9, 2022 6:20 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - 9 juillet 2022 Seule en scène, la comédienne Astrid Bayiha campe magistralement la militante du mouvement des droits civiques, membre du Black Panther Party et professeure de philosophie, et retrace, à travers son parcours, une histoire récente des États-Unis. Paul Desveaux met en scène le texte de Faustine Noguès dont la rage poétique répond à la puissance incantatoire de la musique de Blade MC Alimbaye.
C’est par une scène filmée diffusée sur un grand écran disposé côté cour que commence la pièce. Un journaliste interroge Angela Davis sur son passé de militante afro-américaine, au moment où elle est membre des Black Panthers et figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées des États-Unis par le Federal Bureau of Investigation (FBI). Très vite, les commentaires du journaliste se font accusateurs, lui reprochant notamment de n’avoir pas soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump. L’homme se révèle pétri de préjugés. L’expression d’une misogynie de bon aloi, caustique, ponctuée de tentatives de bons mots qui ne le sont pas, dévoile une condescendance, celle du mâle blanc de la bourgeoisie étasunienne. « We have to talk about liberating minds as well as liberating society[1] ». Angela Davis, après avoir fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie, quitte le studio et l’écran pour rejoindre seule la scène. « Je vais vous parler des meurtres. Je vais vous parler de mes meurtres » Face aux spectateurs, elle raconte son histoire, détaille son parcours et les circonstances qui ont fait sa renommée. Derrière elle défilent des images qui appartiennent à l’histoire : les émeutes de Watts, les visages des quatre fillettes tuées en 1963 dans l’attentat raciste de l’église de la 16è rue à Birmingham, Alabama, les iconiques poings levés, gantés de cuir noir, de Tommie Smith et John Carlos sur le podium du 200 m des jeux Olympiques de Mexico en 1968. Sa propre histoire la dépasse pour incarner en creux une histoire des Etats-Unis, le négatif ou l’autre face de celle, officielle, écrite par les tenants du pouvoir. Angela Davis est née à Birmingham en 1944. Ses parents sont enseignants et communistes. La capitale de l’Alabama est alors l’une des villes les plus ségréguées du pays. Elle grandit dans le quartier de Dynamite Hill qui doit son nom aux nombreux attentats qui y ont été perpétrés contre la population noire. À partir de 1962, elle entame de brillantes études supérieures à l’Université de Brandeis dans le Massachussets – elle est l’une de trois étudiantes noires – puis en Europe, à la Sorbonne et à Francfort, fréquentant James Baldwin, Herbert Marcuse et Theodor W Adorno. Elle se forge une pensée dans laquelle la conscience des discriminations subies se teinte de communisme et de marxisme. Rentrée aux États-Unis, elle obtient son doctorat en philosophie en 1969 et devient, la même année, professeur à l’Université de Californie Los Angeles (UCLA) tout en affirmant son appartenance au Parti communiste américain et au Black Panthers Party. En raison de son activisme, elle est surveillée par le FBI et, très vite, renvoyée de UCLA. « Ma vie répond à l’équation suivante : Je suis femme. Je suis noire. Je suis communiste. On m’arrête pour kidnapping. Pour meurtre. Pour conspiration. Le procureur demande à mon égard une triple peine de mort[2] » résume-t-elle sur scène. Arrêtée le 13 octobre 1970 à New York par le FBI après deux mois de cavale, elle passera seize mois derrière les barreaux avant d’être libérée en février 1972 grâce à un formidable élan de solidarité mondial, avant d’être reconnue non coupable de tous les chefs d’accusation pesant contre elle lors de son procès qui a lieu quatre mois plus tard. « Faire la révolution. C’est un acte ingrat » En entremêlant le récit d’une vie et la parole politique, les extraits des discours d’Angela Davis aux archives vidéo et au texte de Faustine Noguès, Paul Desveaux met en scène un spectacle qui prend des allures de conférence politico-poétique baignant dans une ambiance sonore 70’s/ 80’s. La grande force de la pièce tient dans ses variations de tempo qui lui confèrent son intensité. Le récit conté est aussi slamé. Parler et chanter se cofondent lorsque le verbe et la note s’unissent. Les changements de rythme constants traduisent l’urgence d’une époque qui, soixante ans plus tard, n’a jamais été aussi actuelle. Le rap se veut ici le vecteur de l’union de la parole militante et de l’espace scénique en traduisant la violence de la pensée et des actes en une poétique rageuse de l’engagement. De retour de Reims, Blade MC Alimbaye signe la musique de la pièce comme un genre politique, un uppercut, un coup de poing. Ainsi, les émeutes de Watts de 1965 se racontent-elles dans la colère d’un slam qui répond à la répression massive de la police américaine dans un pays où le racisme antinoirs est systémique. L’épisode dramatique marque le début du Black Power. Désormais, subir n’est plus une option. Les mots « Burn Baby burn », répétés inlassablement, deviennent un leitmotiv musical, une antienne de la lutte. Paul Desveaux, pour qui l’art a été un « outil de conscientisation », a la volonté de porter à la scène le destin et la pensée d’Angela Davis dont il ne comprend que trop bien la discrimination : « Je pense que si j’avais porté le nom de mon père biologique, je n’aurais sans doute pas pu monter les textes de Nathalie Sarraute dans les années 90 et faire ce parcours dans le théâtre public. Car dans l’esprit commun de cette fin de XXème siècle, il y avait une forme d’inadéquation entre un nom de famille comme Kahlouche et un livre comme ‘L’Usage de la parole’. Cette fois-ci comme dans mon parcours de metteur en scène, j’ai été sauvé par mon nom[3] ». Prenant soin de ne pas installer trop de fiction autour du personnage, il instaure un dialogue direct entre la comédienne et le public. Seule en scène pour la première fois, ayant pour uniques accessoires une loop station qui lui permet d’enregistrer des boucles musicales en direct, et un micro, Astrid Bayiha incarne avec brio la philosophe activiste. Comédienne, autrice, metteuse en scène, chanteuse, la jeune femme avait « un terrain propice pour accueillir cette forme rythmique[4] ». Femme orchestre passant du récit au slam et au chant, générant les images et la musique, « initiatrice de la poétique du spectacle comme elle a été la conceptrice de ses propres idées[5] », elle porte telle une chamane à la voix incantatoire le spectacle à son point d’incandescence. « En tant que femme noire, il y a des choses que je comprends de par mon parcours, mon histoire » explique Astrid Bayiha. « Les blessures qu’elle a subies sont présentes mais elles ne sont pas mises en avant. Elles font partie de son engagement. Angela Davis porte avant tout un message d’espoir et laisse entrevoir la possibilité d’un avenir lumineux ». Pour nourrir son texte, Faustine Noguès prend comme point de départ l’autobiographie qu’Angela Davis décide de publier en 1974, sous l’impulsion de Toni Morrison, dans le but avoué de partager ses idées avec le plus grand nombre. Le récit donne la mesure de son engagement et offre une vision de l’activisme au quotidien. Il commence avec l’évènement fondateur qu’est son arrestation à New York en 1970. Noguès choisit de déconstruire le rapport à l’idole pour revenir sur sa pensée politique. Pour l’autrice, le rap vient palier les limites du discours parlé : « Il est là quand il est nécessaire de véhiculer des choses plus profondes, quand on s’attaque au corps » « Je ne crois pas à un théâtre militant mais à un théâtre politique par essence dès lors qu’il s’adresse à la cité[6] » écrit Paul Desveaux dans sa note d’intention. « Il n’a pas le pouvoir de soulever les foules mais il peut changer, par petites touches, quelques êtres et quelques esprits ». Angela Davis utilise sa propre vie et sa pensée théorique pour aborder, en dépassant la simple lutte contre le racisme, l’étendue des dominations. Opposée à une séparation de la société blanche que prônent certaines associations afro-américaines, elle milite pour inscrire la lutte des Noirs dans le mouvement international ouvrier et appelle à renverser les fondations racistes du capitalisme, clef de la libération des peuples opprimés. La majeure partie du travail d'Angela Davis est toujours pertinente et urgente aujourd’hui. C’est parce qu’elle les subissait toutes en même temps qu’elle est devenue très tôt une figure internationale de la lutte contre toutes les formes de domination, bien avant que Kimberlé Crenshaw ne théorise la notion d’intersectionnalité[7]. « Peut-être que la particularité d’Angela Davis est d’avoir véritablement pensé le réel » écrit Paul Desveaux. Elle n’a en tout cas toujours pas déposé les armes, s’intéressant au rôle des mouvements sociaux, à l’évolution des mouvements féministes. Faire la révolution est décidemment un acte ingrat. [1] « Nous devons parler d’esprits en libération autant que de société en libération », Il s’agit de l'une des citations les plus célèbres d’Angela Davis qui a toujours été catégorique sur le fait non seulement de plaider en faveur d'un changement de politique au sein du système, mais aussi de nous encourager à voir différemment et à regarder en dehors du système. Tout ce qui nous constitue a été conditionné et socialisé par une société raciste, de sorte que même une politique parfaite n'effacerait pas l'oppression. [2] Les citations de la pièce sont extraites de Faustine Noguès, Angela Davis : Une histoire des États-Unis, Lansman Éditeur, 2022. [3] Paul Desveaux, « Réflexions personnelles », Note d’intention, SD. [4] Astrid Bayiha, citée dans Maryse Bunel, « Angela Davis, une vie de combats », Relikto, 6 novembre 2021, https://www.relikto.com/2021/11/06/angela-davis-une-vie-de-combats/ Consulté le 2 juillet 2022. 5 Paul Desveaux, op.cit. [6] Paul Desveaux, op. cit. [7] Kimberle Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, (« Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire de la doctrine de l’anti-discrimination, de la théorie féministe et de la politique anti-raciste »), University of Chicago, 1989, 31p. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf ANGELA DAVIS. UNE HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS Texte Faustine Noguès sur une idée originale de Véronique Felenbok et Paul Desveaux. Mise en scène Paul Desveaux. Avec Astrid Bayiha. Musique, direction musicale et coaching chansons Blade AliMBaye, lumière Laurent Schneegans, images Jérémie Levy, assistanat à la mise en scène Ada Harb, régie générale Johan Allanic ou Nil Elftouh. Texte publié chez Lansman Éditeur. Une production l’héliotrope coproduction L’éclat / Pont Audemer, L’étincelle / Rouen, Théâtre Le Passage / Fécamp avec la participation artistique du Studio|ESCA. Spectacle créé à l'Étincelle - Théâtre(s) de la ville de Rouen le 22 février 2022, vu au Théâtre de Paris-Villette le 4 juin 2022. Du 7 au 30 juillet 2022, relâche les mercredis 13, 20 et 27 juillet. Théâtre des Halles - Scène d'Avignon
4, rue Noël Biret
84 000 Avignon Légende photo : Angela Davis. Une histoire des États-Unis de Faustine Noguès mis en scène par Paul Desveaux © Jérémie Levy

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 9, 2022 1:50 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération - 9 juillet 2022 Le trentenaire utopiste a écrit et mis en scène l’une des pièces les plus attendues du Festival, «le Nid de cendres». Une épopée féerique de treize heures fait se rencontrer deux mondes disjoints. Simon Falguières dit que pendant longtemps, il n’arrivait pas à écrire des textes «un peu longs», alors même qu’il ne désirait que ça, concevoir une pièce de «théâtre fleuve» qui permette aux spectateurs de s’abstraire du monde, pour plonger, quand tout se passe bien, dans un autre pays, le temps d’un instant, délicieux, de treize heures. Simon Falguières a une allure passe-muraille, un tee-shirt gris, des jeans anthracite, des cheveux on ne peut plus châtains, un teint pâle, une barbe de quelques jours. Il cultive l’imperceptibilité comme d’autres la singularité, et si vous ne le connaissez pas, aucune inquiétude, la notoriété est toujours relative, surtout lorsque c’est le cadet de nos soucis et des siens. Il est jeune, à peine 34 ans, et c’est donc lui qui a écrit l’une des pièces les plus attendues de cette édition du Festival d’Avignon : le Nid de cendres, épopée féerique en sept parties qu’on ne se risquera pas à résumer. «La durée créé une autre théâtralité» Bien sûr, Simon Falguières n’est pas le premier à se lancer dans de très longs formats. Mais tout de même, treize heures d’une pièce écrite par un metteur en scène qui n’oublie pas de jouer dans son spectacle, de balayer le plateau ou de changer les ampoules lorsqu’il a cinq minutes, c’est rarissime ; même à Avignon qui a forgé sa légende à travers une série de spectacles au long cours, marathons théâtraux peut-être plus encore pour le public, immobile sur son siège, que pour les acteurs qui peuvent s’échauffer physiquement et peut-être aussi s’assoupir en coulisse. «La durée crée une autre théâtralité. Elle permet à chaque spectateur de rencontrer son voisin, de vivre une expérience émotionnelle avec lui. Je suis bien persuadé que la longueur est populaire, elle ouvre sur une structure en feuilleton, sur des personnages récurrents auxquels on s’attache», explique-t-il. Simon Falguières ne nous contredit pas lorsqu’on affirme tout autant qu’il est très âgé. D’une part parce qu’il eut plusieurs vies de théâtre, en grandissant en partie dans le CDN d’Evreux que son père, Jacques Falguières, dirigea pendant plus d’un quart de siècle, puis dès ses 18 ans, en écrivant et jouant ses propres pièces, plutôt «austères», assure-t-il, dans des squats à Paris et à Aubervilliers. D’autre part, parce qu’il offre la curieuse sensation de puiser ses forces et son esthétique dans la mémoire de spectacles qu’il n’a pas pu connaître – et nous non plus –, celle des premiers Mnouchkine par exemple, à l’orée des années 70. D’où vient la drôle d’impression de remonter le temps, lorsqu’on entre dans la salle de répétition du CDN de Rouen, où 17 jeunes et excellents comédiens répètent quelques chapitres du Nid de cendres ? Est-elle due à l’absence de vidéos, de micros HDMI, et autres prouesses technologiques ? Pas essentiellement. C’est l’effet de troupe qui frappe le visiteur et le renvoie à une époque révolue et magnifiée. Sur le plateau, il y a donc une reine malade, des princes et princesses, comme dans un conte d’enfant. Mais aussi un couple de classe moyenne, une visite aux urgences, le quotidien comme il brûle. Ou encore du théâtre dans le théâtre, une «harangueuse» en velours rouge, vestige d’un rideau de scène. «En tant que spectateur, je n’ai aucune chapelle, nous dira plus tard Simon Falguières. Mais comme auteur et metteur en scène, je fais ce dont je suis capable, et défends un type de théâtre qui place les acteurs, la fable et l’histoire au cœur de la représentation.» Il ne pratique pas l’écriture de plateau. Autrement dit, l’entièreté de cette longue pièce a été écrite avant les répétitions. Epopée rêveuse Utopie est le mot qui lui sied le mieux. Une utopie qui prendrait la forme d’une rencontre qui dure, «un peu miraculeuse», avec la majorité des comédiens qui forment aujourd’hui la compagnie K, lorsque Simon Falguières est pris à la classe libre sur concours du cours Florent et qu’un enseignant, Jean-Pierre Garnier, lui propose de diriger le tout dernier stage de la formation. De là naît, il y a sept ans, une toute première et brève mouture de l’épopée rêveuse, qu’ils jouèrent ensuite deux étés de suite sur un plateau de bois dans un jardin en Charente. Magie des premières fois lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée : «On ne pouvait plus s’arrêter.» Autre utopie, sur le point de devenir concrète, portée par l’envie de «réinventer sa vie» : le metteur en scène a des étoiles dans les yeux lorsqu’il évoque l’aventure du moulin de l’Hydre où il campe avec six autres coacheteurs dans un espace gigantesque constitué d’une usine, d’un moulin et d’une maison, au cœur d’une vallée, près de Vire en Normandie. Durant cinq ans, ils ont foré la France à la recherche du lieu susceptible de matérialiser leur rêve et être transformé de toutes pièces en théâtre, mais aussi en café alternatif, refuge, lieu de résidences, tout en y cohabitant. Les sept – des techniciens, des acteurs – ont donc lancé des chantiers participatifs, refait eux-mêmes la toiture, et dès cet été des résidences seront proposées à des troupes émergentes de Flers. Une manière, à l’instar de Sylvain Creuzevault qui lui aussi a investi avec son équipe d’anciens abattoirs devenus un théâtre à Eymoutier, de réinventer et renouveler en profondeur la décentralisation. Ce serait la troisième utopie portée par Simon Falguières, et assurément, pas la dernière. Anne Diatkine / Libération Le Nid de cendres, de et mis en scène par Simon Falguières, du 9 au 16 juillet à la FabricA, Avignon. Légende photo : Sur le plateau, il y a une reine malade, des princes et princesses, comme dans un conte d’enfant. (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2022 9:32 AM
|
Par Fabienne Darge pour Le Monde - 8 juillet 2022 Au travers de cette nouvelle méconnue de Tchekhov, le metteur en scène russe perd cependant parfois un peu son public en cours de route. « Stop the war » : l’injonction s’est inscrite en lettres gigantesques sur fond rouge sang, sur la muraille du Palais des papes, au terme de la représentation du Moine noir, en cette soirée d’ouverture du Festival d’Avignon, jeudi 7 juillet. Et l’on ne sait si le public s’est levé pour saluer cet appel, le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov ou son spectacle, d’une indéniable force théâtrale. Tout cela ensemble, sans doute. Il n’est pourtant pas question ici de l’invasion qui ravage l’Ukraine mais d’une autre guerre, d’un autre pacte faustien. D’une autre crise, d’un autre chaos, plus intimes, plus existentiels. Kirill Serebrennikov, 52 ans, désormais exilé à Berlin après avoir été poursuivi par la justice sous des prétextes fallacieux et assigné à résidence pendant deux ans, entre dans le saint des saints d’Avignon avec Tchekhov, mais un Tchekhov bien particulier. Ce Tchekhov-là, qui se rapproche de Dostoïevski, c’est celui du Moine noir, une des nouvelles les moins connues du maître en France, mais qui, en Russie, fait partie de l’imaginaire collectif. L’histoire est celle d’Andreï Kovrine, un intellectuel surmené et déprimé, qui part se reposer à la campagne chez son ami Pessotski, qui l’a en partie élevé, et sa fille Tania. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Kirill Serebrennikov, les zones d’ombre d’un créateur russe en pleine lumière Pessotski est à la tête d’un domaine magnifique, un paradis d’arbres fruitiers et de fleurs, et la métaphore jardinière est au cœur de la nouvelle et de la crise que traverse Kovrine. Car, à peine arrivé à la campagne, l’homme est l’objet d’étranges hallucinations : un moine noir lui apparaît, surgi de vieilles légendes, qui lui tient ce genre de propos : « Etre libre, c’est être l’élu, servir la vérité, chercher la vérité, être de ceux qui rendront l’humanité meilleure (…). La liberté n’est peut-être qu’une illusion, mais n’est-il pas préférable de vivre d’une grande illusion ? Pousser librement dans le vent, comme une haute tige, plutôt que de se multiplier comme des arbustes résistants au froid. » Les arbustes résistants symbolisant ici la médiocrité d’une vie ordinaire et simple, normée comme des arbres que l’on taille et tuteure pour leur donner une forme, opposée à l’appel d’une vie plus élevée, plus exaltante et plus dangereuse, en un conflit existentiel qui traverse toute l’œuvre de Tchekhov. Conflit qui va mener Kovrine sur les rivages de la folie. Un maelström graphique Cette nouvelle d’une vingtaine de pages, Kirill Serebrennikov la déploie sur un spectacle de deux heures trente, en un geste de mise en scène ample et puissant, qui creuse le point de vue de chacun des personnages. Sur le grand plateau de la cour d’honneur, où soufflait un mistral bien accordé avec le chaos, sont installées trois petites cahutes ressemblant à des serres, qui vont se recomposer en différents espaces au fil de la représentation. La première partie appartient à Pessotski, à sa vie enracinée dans son domaine, qui le constitue jusque dans ses fibres les plus profondes. La deuxième à Tania, sa fille, qui se marie avec Kovrine pour son malheur – une vie de femme sacrifiée sur l’autel des rêves d’un homme. La troisième à Kovrine lui-même, dans son obsession de courir plus vite que la médiocrité qui le rattrape, quitte à se faire aspirer par un gouffre. A chaque étape, Kirill Serebrennikov diffracte un peu plus la narration. En éclatant les rôles entre plusieurs acteurs, en doublant leur présence sur le plateau par leur image filmée en direct (avec des téléphones), en creusant les interrogations ouvertes par Tchekhov, il offre un fascinant voyage, dans les trois premières parties de son spectacle. Un voyage où les images s’impriment sur la rétine, celle d’une mariée au long voile blanc et vaporeux comme un mirage, celles de ces tableaux de groupes avec ouvriers brechtiens, et toutes ces images qui renvoient aux avant-gardes russes des années 1920. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le comédien Philipp Avdeev au Festival d’Avignon : « J’avais envie d’aller vers l’inconnu » Peu à peu, la dimension cosmique s’approfondit, le tourbillon dans lequel apparaît le moine noir se matérialise – si l’on peut dire – en une autre vision superbe : un maelström graphique qui donne l’impression d’aspirer et de faire palpiter la muraille de la cour d’honneur. La quatrième partie du spectacle est celle du moine noir, qui jusque-là était resté hors champ, traité pour ce qu’il était : un fruit du psychisme perturbé de Kovrine. Avec le risque que les délires hallucinatoires imaginés par Tchekhov ne contaminent Kirill Serebrennikov, qui perd alors un peu son spectacle et ses spectateurs. Un geste de mise en scène ample et puissant, qui creuse le point de vue de chacun des personnages La musique de Jekabs Nimanis et la danse prennent le dessus sur le théâtre. Le Moine noir s’engage sur le chemin d’une cérémonie qui, certes, là encore, a une vraie force spectaculaire, mais dont on ne sait plus trop ce qu’elle veut dire, à quelle mystique elle s’accroche. C’est d’autant plus dommage que, jusque-là, la soirée avait été portée par des acteurs remarquables, qui viennent de l’ensemble du Thalia Theater de Hambourg, où le spectacle a été créé, et de la troupe qu’avait formée Kirill Serebrennikov en son Gogol Center de Moscou. C’est grâce à eux, les deux Katia de Viktoria Mirochnichenko et de Gabriela Maria Schmeide, les trois Andrei de Mirco Kreibich, Odin Biron et, plus encore, de Filipp Avdeev, un talent éclatant, que la représentation est aussi intense, fiévreuse et qu’elle attrape, malgré les réserves que l’on peut exprimer. De film en spectacle, à travers les figures d’artistes de son pays, Viktor Tsoï, Noureev, Tchaïkovski, Tchekhov, bientôt Tarkovski, c’est bien l’histoire de son pays que Kirill Serebrennikov sonde encore et encore, dans sa folie, son rapport complexe à la terre, à la liberté, au divin, à la souffrance et au sacrifice. Le Moine noir, d’après Anton Tchekhov (Actes Sud-Papiers, avec la nouvelle originale traduite par Gabriel Arout, et l’adaptation théâtrale de Serebrennikov). Mise en scène : Kirill Serebrennikov. Festival d’Avignon, cour d’honneur du Palais des papes, à 22 heures, jusqu’au 15 juillet. De 10 à 40 €. festival-avignon.com Fabienne Darge (Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale) pour Le Monde Légende photo : « Le Moine noir », d’après Anton Tchekhov, mise en scène de Kirill Serebrennikov, au Festival d’Avignon, jusqu’au 15 juillet 2022. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2022 12:10 PM
|
par Patricia Huon, correspondante à Johannesburg pour Libération - 7 juillet 2022 Avec la compagnie sud-africaine, Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor ont dessiné deux volets de «Via Injabulo», rencontre pleine d’espoir d’une jeunesse post-apartheid. Des pieds frappent la scène, en rythme, dans un tourbillon effréné. Le mouvement d’un autre corps se fait plus planant, presque doux. «Allez, on reprend», interrompt Amala Dianor. Le mois dernier, le chorégraphe était à Johannesburg pour préparer une nouvelle création, avec la compagnie de danse sud-africaine Via Katlehong, qui porte haut le flambeau de la «pantsula», danse populaire ultra virtuose des townships. En préparation de sa tournée européenne cet été, celle-ci a mis en place une collaboration avec deux grands noms de la danse contemporaine issus des «streetdances» : l’étoile montante de la nouvelle scène portugaise Marco da Silva Ferreira, et le Franco-Sénégalais Amala Dianor. Avec huit danseurs et danseuses sud-africains, ils ont dessiné les deux volets de Via Injabulo – «joie» en zoulou. Avec eux, Marco da Silva Ferreira a élaboré Førm Inførms, qui transpose sur la scène ce que des corps désarticulés traînent de souffrance du passé, alors que l’énergie des jeunes danseurs les porte et les fait vivre. De son côté, Amala Dianor explore l’âme et les codes des rues d’Afrique du Sud à travers le patrimoine des danses populaires, dans Emaphakathini, ce qui signifie «entre-deux» en zoulou. Danses traditionnelles Via Katlehong a été créée en 1992, dans le township de Katlehong, un quartier déshérité, au sud-est de Johannesburg, dont la compagnie tire son nom. L’apartheid vient alors d’être aboli, l’Afrique du Sud prépare sa transition et les premières élections multiraciales. «C’était une période difficile, l’ancien gouvernement attisait les tensions entre les communautés, entre ceux qui supportaient le Congrès national africain de Nelson Mandela, et ceux qui soutenaient le Parti Inkatha de la liberté. Les jeunes étaient très affectés par cette violence, raconte Buru Mohlabane, 39 ans, codirecteur de Via Katlehong. A l’époque, je me souviens avoir régulièrement vu des corps, au bord de la route, sur le chemin de l’école.» A la criminalité, à l’ennui, au manque de perspectives, à la drogue, des jeunes décident de substituer la danse, et de partager leur passion. «Tout ce que nous avons vécu a laissé un traumatisme, et nous n’avions pas accès à des psychologues, dit Buru. La danse a été pour moi une manière de faire sortir les énergies négatives, d’oublier mes problèmes, de retrouver l’espoir.» Dans un centre communautaire, ils apprennent les bases des danses traditionnelles, et de la pantsula, une danse urbaine qui, comme le hip-hop américain, trouve ses origines dans les rues des ghettos noirs. La culture qui la caractérise est née dans les années 50, à Sophiatown, un quartier bohème, rebelle et multiracial de Johannesburg, rasé ensuite par le régime raciste pour faire de la place à des résidences réservées aux blancs. Jeu de jambes précis Les adeptes de la pantsula (un mot zoulou qui signifie «se dandiner comme un canard») défient leur condition matérielle par leur audace vestimentaire : gants blancs, pantalons à pinces et sapes griffées. Avec leur jeu de jambes précis et extrêmement rapide, et leurs postures qui se rapprochent parfois du mime, les danseurs prennent la rue comme scène improvisée. Le martellement des pieds caractéristique s’inspire de celui du «gumboot», une autre danse qui se pratique généralement avec des bottes en caoutchouc, qui deviennent un instrument du rythme de percussion. Celle-ci trouve ses origines dans les mines sud-africaines. Sous l’apartheid, les mineurs noirs ont élaboré ce mode de communication non-verbal, par lequel ils exprimaient tant la joie, que la tristesse ou, souvent, la frustration… Elle a pris par la suite un aspect revendicatif et est devenue un outil de protestation. «La danse est un langage universel. Cela permet de soulager le cœur, dit Thato Qofela, 34 ans, petit brillant dans chaque oreille, dent en or et veste de training bleue. J’ai commencé à danser dans la cour de la maison. J’avais 8 ou 9 ans, j’imitais mon frère. Et j’ai réalisé que cela me rendait heureux.» Depuis son apparition, la pantsula a évolué, modelée pour refléter les préoccupations de ceux qui la pratiquent. Hybride des multiples influences artistiques qui ont traversé l’Afrique du Sud, elle intègre tant les danses traditionnelles tswana, zulu ou sotho, que des gestes saccadés, voire acrobatiques, inspirés du breakdance. Fini les costumes chics, les chaussures cirées, les chapeaux à larges bords. Les danseurs portent désormais des salopettes et des baskets Converse, un bob coloré vissé sur la tête. Pour les faire vibrer et virevolter, la musique marabi, mélange de jazz et de rythmes afro, a cédé la place à la house et au kwaito. Elle est devenue un mode de vie et prend, pour certains, une dimension plus politique, engagée, une forme de contre-culture, un art populaire, qui s’impose comme une résistance. Dans des ruelles défoncées, sur un terrain vague, ou au milieu d’un carrefour, ces danseurs au look caractéristique, qui sifflent et frappent des pieds et des mains, captent l’attention des passants et des automobilistes. La pantsula reste longtemps perçue comme une danse de voyou, de «bad boys» qui, pour séduire les filles, s’affrontent dans des compétitions de rue, où le style et la popularité comptent autant que les mouvements. Il faudra du temps pour que cette forme d’expression, snobée par les professionnels, gagne ses lauriers d’art de la scène, tandis que les vidéos sur YouTube ou TikTok contribuent à sa visibilité. Parcours atypique «Lors des premières sélections auxquelles nous avons été invités, cela commençait toujours par une annonce : “Les danseurs professionnels, mettez-vous de ce côté, les danseurs de pantsula, de l’autre.” Depuis, les choses ont changé, mais il y a toujours un énorme manque de moyens, dit Thato, qui se souvient de répétitions annulées juste parce qu’il manquait à certains l’argent du transport. Beaucoup de groupes ont disparu à cause de ça.» Autodidacte issu du hip-hop, Amala Dianor, peut s’identifier. En 2000, à 24 ans, il intègre le Centre national de danse contemporaine d’Angers, qu’il a été le premier artiste de street dance à fréquenter. Il y a été initié à différents genres, dont la danse contemporaine et le ballet néoclassique, qu’il intègre désormais dans ses créations. Riche d’un parcours atypique, il veut «encourager les différences» et dit aimer «décoder les styles», se jouer des barrières arbitraires. «J’ai envie de partager l’expérience que j’ai acquise avec cette jeunesse», dit-il. Mais plutôt que de considérer les danseurs comme des instruments qui suivraient ses instructions pour construire une partition qu’il aurait lui-même imaginée, son approche laisse une place aux individualités dans l’espace scénique, tout en accordant les corps les uns aux autres. «Je voudrais qu’ils s’expriment sans se concentrer sur le public, qu’ils fassent d’abord ressortir ce qu’ils ressentent. Mais ce n’est pas facile de sortir des codes auxquels ils sont habitués. C’est notamment là-dessus que nous travaillons», dit-il. Le spectacle devient une introspection, les personnalités peuvent se révéler. Avec les directeurs de Via Katlehong et les danseurs, Amala Dianor découvre Johannesburg, et le township dont ils sont originaires, à la recherche des images et des sensations qui feront la matière première de sa chorégraphie. Il s’inspire de leurs histoires et les relie à celle de leur pays. Lors de ses pérégrinations, il remarque les divisions raciales et économiques qui persistent et «l’obsession de la sécurité, les barrières électriques et les murs présents partout». Mais ce n’est pas ça qu’il a envie de montrer. «Il y a une énergie, une envie de faire la fête, de se rassembler, d’échanger, c’est une des premières choses qui m’a frappé, dit-il. C’est très spontané et c’est omniprésent.» Une forme de thérapie pour une société traumatisée, dont les blessures restent profondes. Vie quotidienne Sur scène, les danseurs sont dans un club, ou peut-être juste dans la rue, un DJ joue, une glacière est posée par terre. L’atmosphère colle à l’esprit de la pantsula, qui reprend des gestes de la vie quotidienne, tels que celui des joueurs de dés ou les signes de la main pour héler un taxi, et les transforme en une chorégraphie à la fois théâtralisée et réaliste. Parmi les huit danseurs, plusieurs ont été auditionnés et recrutés en dehors de la compagnie Via Katlehong et associés à cette création, afin de mieux mêler les talents individuels. «Je cherche des concepts intéressants, de nouvelles perspectives. Et je suis très curieuse de voir comment le public européen va accueillir cette représentation, dit Julia Zenzie Burnham, 31 ans, qui a débuté par le ballet, puis la danse moderne, avant de travailler avec le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma. Pour moi, l’entre-deux consiste à tracer un trait d’union entre la vie que nous menons, et notre passé, nos racines, d’où nous venons.» Avec la pandémie de Covid-19, les danseurs de Via Katlehong n’ont pas donné de représentation publique depuis 2019. Une période difficile pour beaucoup d’entre eux. «L’industrie du spectacle a beaucoup souffert. Toutes nos tournées et spectacles ont été annulés, dit Buru Mohlabane. Des danseurs n’ont rien gagné pendant deux ans. Et nous n’avons reçu aucune aide du gouvernement. Ce retour sur scène est une vraie joie pour nous.» Via Injabulo est une rencontre pleine d’espoir et d’énergie. C’est aussi l’expression d’une jeunesse post-apartheid, à la fois exaltée, vibrante, en colère, qui n’hésite plus à libérer les mémoires douloureuses et à rêver d’un meilleur avenir. Légende photo : Les danseurs de Via Katlehong à l'extérieur du théâtre où ils répètent, à Germiston, le 26 avril. (Lindokuhle Sobekwa/Magnum Photos pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2022 5:16 PM
|
Cinq idées de spectacles à voir au Festival, parmi les 1570 du off et les 46 du in. par SERVICE CULTURE de Libération publié le 6 juillet 2022 à 20h06 «La liberté, est-ce l’embarras du choix ?» La question, façon sujet de philo, bourdonne telle une petite voix, tandis qu’on élit, de manière assez arbitraire avouons-le, 5 spectacles, parmi les 1 570 du off et les 46 du in. «Our daily Performance» de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic Comment tomber sans se faire mal quand on a plus de 65 ans ? Comment faire une chanson rap à partir d’un sonnet de Shakespeare ? Solo pour une interprète et un MacBook conçu par un duo de chorégraphes loufoques, Our Daily Performance détourne les tutoriels YouTube où les auteurs de vidéos sont des musiciens amateurs, des passionnés de fitness ou des spécialistes en self-défense. Du 8 au 26 juillet à 14 h 15 au Train bleu, off. Trois spectacles écrits et joués par Geoffrey Rouge-Carrassat Il y a un an, dans cette même salle, on découvrait Dépôt de bilan, le dernier volet d’un triptyque porté entièrement par Geoffrey Rouge-Carrassat, où l’acteur-écrivain saisissait le vide qui étreint et la surchauffe au travail à travers une impressionnante logorrhée. Chance, cette année, c’est l’entièreté du triptyque qu’on peut voir. Conseil de classe, Roi du silence : deux autres monologues, performance d’un acteur hors norme à la puissance de jeu inoubliable et inquiétante. Triptyque Conseil de classe, Roi du silence, Dépôt de bilan. Au théâtre de la Reine Blanche, du 7 au 25 juillet, off. Sélection suisse du 8 au 25 juillet 2022 Dans le off d’Avignon et parmi le flot incessant des harangues, la sélection suisse est aussi précieuse que les cailloux du Petit Poucet. Au milieu du dédale, on s’accroche aux balises posées par Laurence Pérez, la directrice artistique andalouse de la sélection helvète, qui présente cette année sa dernière édition et n’a pas son pareil pour dénicher des pépites. Entre le Grand écart de Ryan Khoshoo, au train Bleu du 9 au 25 juillet, la Matrue, adieux à la ferme, de Coline Bardin, ou Fantasia de Ruth Childs, et la dizaine d’autres, on choisit de ne pas choisir. Dans différentes salles du Off, se renseigner sur le site. Avignon off. «Futur proche» de Jan Martens Sa précédente pièce, carton du festival d’Avignon 2021, était un space opéra abstrait riche d’une multitude d’influences chorégraphique et qui semblait balayer avec humour et fantaisie un siècle d’histoire de la danse. Vu l’impact, on brûle de découvrir la façon dont le jeune chorégraphe flamand postpop travaillera avec quinze danseurs d’un des plus grands ballets académiques, le Ballet Royal de Flandre. Du 19 au 24 juillet, à la cour d’honneur du palais des Papes, in. «A ne pas rater» par La vaste entreprise Comment résister à cette proposition qui nous assure que cette fois, on est à la bonne place, on n’est pas en train de rater quelque chose de mieux ? Ou comment triturer les méninges de chaque spectateur, en lui rappelant tout ce qu’il rate, lorsqu’il choisit un spectacle au détriment de tous les autres. Une réflexion scénique sur notre relation aux lieux et aux temps, de moins en moins exclusifs, par les concepteurs de l’Origine du monde 46 × 55. A la Manufacture (Patinoire) du 7 au 26 juillet, off. Légende photo : On brûle de découvrir la façon dont le jeune chorégraphe flamand postpop travaillera avec quinze danseurs d’un des grands ballets académiques, le Ballet Royal de Flandre. (Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2022 9:13 AM
|
Eve Beauvallet dans Libération - 5 juillet 2022 L’ancien directeur du théâtre des Amandiers prendra la tête du labo atypique dès juillet 2022, pour remplacer Marie-Thérèse Allier, morte il y a quelques mois. Cette dernière l’avait désigné comme son héritier esthétique. Il avait claqué la porte du théâtre des Amandiers de manière fracassante en 2019, dégoûté des relations épouvantables qui s’étaient noués entre l’historique institution qu’il dirigeait et le maire PCF de Nanterre, Patrick Jarry. Après deux ans de cavalcade en compagnie indépendante, voici le metteur en scène laborantin Philippe Quesne est nommé, à compter de juillet 2022, à la direction d’une structure culturelle emblématique, qu’on appellera moins «structure» d’ailleurs que «labo», «maison» ou «zone à défendre» : la Ménagerie de verre. Ce repaire underground du XIe arrondissement parisien où naquirent 70 à 90 % de ce que le paysage chorégraphique et théâtral contemporain peut compter d’excitant, s’est retrouvé subitement orphelin le 26 mars, jour du décès, à 91 ans et quasi sur scène, de son éminente et tonitruante fondatrice Marie-Thérèse Allier. Refuge privilégié Cette productrice passionnée avait déniché en 1983 une ancienne imprimerie qu’elle transforma en refuge pour artistes laborantins comme il n’en existe aujourd’hui plus vraiment d’autres. C’est là-bas que les Chiens de Navarre firent leurs débuts en amoncelant dans le garage des tonnes de terre et un bordel en diable sur lequel ils haranguaient Fabienne Pascaud (directrice de Télérama) masqués en monstres. C’est là que dans un mi-sommeil, on vit surgir dans un nuage de fumée Jeanne Balibar dorlotant un dindon dans un spectacle du dandiesque Yves-Noël Genod. Là que débutèrent les Christian Rizzo ou Rachid Ouramdane, aujourd’hui respectivement directeur du Centre chorégraphique de Montpellier et du Théâtre national de Chaillot. Là que des monstres déjà sacrés comme Claude Régy purent entamer un virage plus radical. A l’instar du Théâtre de la Bastille, son voisin de quartier plus institutionnel et refuge privilégié des «collectifs» de théâtre (TG Stan, puis l’Avantage du doute ou Raoul collectif), la Ménagerie de verre fit émerger, des années 1990 à 2020, une autre vision et une nouvelle génération des arts de la scène. Les deux voisins changent donc de main au même moment après plus de trente ans de direction engagée et controversée. Le nom de la future direction du Théâtre de la Bastille devrait tomber à l’automne. Marie-Thérèse Allier, elle, locataire de son espace de la rue Léchevin, avait pris soin de son leg de manière plutôt singulière. L’ancienne danseuse de ballet shootée aux arts expérimentaux ne disposant pas de descendance importante, elle tenait à ce que sa fortune personnelle (dont ses parts de la Ménagerie de verre) puisse alimenter un fonds de dotation destiné à préserver l’héritage esthétique de son labo d’une part et, de l’autre, à soutenir des projets artistiques indépendants de la Ménagerie. Présidé par l’ancienne directrice de l’Office national de diffusion artistique Pascale Henrot depuis la mort de Marie-Thérèse Allier, le fonds fut créé en 2011. Il nommera en octobre un ou une future gérante des espaces et annonce donc ce mardi le nom de Philippe Quesne à la direction artistique (à temps partiel), selon les vœux de Marie-Thérèse Allier qui en avait fait son héritier esthétique. «Ça a toujours été très clair dans la bouche de Marie-Thérèse Allier», précise Pascale Henrot. La ville de Paris, la région Ile-de-France et le ministère de la Culture ont confirmé leur soutien futur à la Ménagerie de verre – doté aujourd’hui d’un budget de 780 000 euros – si le cœur du projet est respecté. Inventeurs plus que continuateurs Tel est bien le vœu de Philippe Quesne qui énumère à Libé ce qu’il doit à cette directrice adorée et redoutable. «En 2003, j’avais fait ce truc avec des copains, un spectacle, la Démangeaison des ailes, montré à Dijon. J’ai été l’exemple de ce qui arrive quand une personne comme elle, avec son flair et son enthousiasme, ouvre des portes. Elle n’aurait pas été là, je ne sais pas si j’aurais pu faire ce métier.» Il compte, dit-il, rester fidèle à l’esprit de ce lieu «très accessible pour les artistes» à l’importance plus symbolique que budgétaire. Il se dit admiratif de «la grande spontanéité avec laquelle elle prêtait des studios, sans paperasse, tant aux jeunes qui débutent qu’aux plus confirmés qui veulent encore chercher». Quand Philippe Quesne se cogna à la direction du «château fort» de Nanterre, Marie-Thérèse était dans les gradins. Là-bas, dans une des plus grosses institutions théâtrales, il rendait vivante et visible cette famille d’artistes proches de l’esprit Ménagerie : celle des inventeurs, plus que des continuateurs. A son départ des Amandiers, on s’inquiétait que ses poulains se retrouvent à la rue, à l’heure où les directions des théâtres de la décentralisation s’uniformisent toutes vers un courant esthétique plus tradi (Pauline Bayle, Maëlle Poésy…). On espère donc les revoir dans le plus familier de leur logis à partir de début 2023. La fin de saison 2022, qui compte une grande exposition autour des derniers films de Jean-Luc Godard, avait, elle, été finalisée par Marie-Thérèse Allier. Légende photo : Philippe Quesne en novembre 2014. (Thomas Samson/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2022 12:08 PM
|
Article de Marie-Céline Nivière pour le site du SNSM - 4 juillet 2022 Voir l'article dans son site d'origine, avec de très nombreuses illustrations (photos de spectacles, documents) « C’est un rôle étrange que celui de mettre en scène. »
Né à Londres en 1925, de parents immigrés Lituaniens, il découvre très tôt que le cinéma et le théâtre semblent « faits pour nous aider à nous échapper vers un ailleurs ». A l’âge de 5 ans, il signe avec ses marionnettes sa première mise en scène, « Hamlet ». Mais sa préférence va au cinéma. Il considère, alors, le théâtre « comme un prédécesseur ennuyeux et moribond du cinéma ».
En 1942, étudiant à Oxford, il désire s’inscrire dans une des associations théâtrales de l’université. Mais il ne peut pas, car ces clubs sont le monopole des 3e année, or il n’est qu’en 1ère année. Profitant des vacances, il monte avec des amis « La tragique histoire du docteur Faust ». Il a 17 ans. Il est fasciné par les lumières, le son, les couleurs et les costumes. En parallèle, il monte un club de cinéma pour pouvoir tourner un film avec ses mêmes amis, « A sentimental journey ». Contre la promesse de ne plus faire de théâtre et de cinéma, il évite d’être renvoyé d’Oxford. Après son diplôme, étant de santé fragile, il est réformé et échappe à la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Peter se met, alors, à chercher du travail. Son rêve étant toujours le cinéma, il se fait embaucher dans une société de film publicitaire où il écrit des scénarios. Il arrive à convaincre ses employeurs de lui donner un film à tourner. Mais celui-ci est bien trop « artistique » pour de la publicité, il est renvoyé aux scénarios. Il démarche des producteurs de cinéma pour réaliser des films. Il est jeune, sans expérience, on le remercie à chaque fois. Dépité, Brook se tourne, avec « condescendance » vers le théâtre qu’il juge toujours comme étant « une contrée démodée » du cinéma. A ce moment-là de sa vie, le théâtre n’est « ni ceci ni cela » mais juste une expérience. N’ayant peur de rien, le jeune homme décide d’attaquer tout de suite le haut de l’échelle et frappe à la porte du Old Vic. Evidemment, le directeur lui dit de revenir le voir plus tard, lorsqu’il aura monté des spectacles ailleurs. Brook s’adresse alors à tous les théâtres de la banlieue londonienne et finit par en trouver un qui l’accepte. Il monte « La machine infernale » de Cocteau. Puis, grâce à une actrice renommée, Mary Grew, il met en scène un spectacle dans le cadre du théâtre aux armées. Un vieil ami de la comédienne le recommande à Sir Barry Jackson, pionner du « véritable théâtre dramatique de l’entre-deux-guerres ». Celui-ci lui commande, en 1945, la mise en scène de la pièce de George Bernard Shaw, « Man and Superman ». Il se fait remarquer par un producteur de Londres qui lui propose de mettre en scène « L’invitation au Château » de Jean Anouilh. Lorsque Sir Barry prend en charge le festival de Stratford, il demande à Peter Brook de mettre en scène « Peines d’amour perdues » de Shakespeare, qu’il réalise en s’inspirant des tableaux de Watteau. Peter Brook découvre que le théâtre de Shakespeare est mal en point, car joué éternellement dans une certaine tradition. Il commence alors à réfléchir sur l’idée d’un « théâtre mort » (le théâtre bourgeois). Il sait qu’il existe un nouveau courant du théâtre, influencé par l’héritage de Copeau et Craig. L’année suivante, 1947, il met en scène « Roméo et Juliette ». Il se démarque du style convenu des mises en scène shakespeariennes. Brook en restituant à la pièce la violence, la passion, les haines héréditaires en fait autre chose qu’une bluette sentimentale. Comme, le préconisaient les metteurs en scène du Cartel pour les classiques, il fait une relecture de la pièce. A ses débuts, Peter Brook suit son désir de fabriquer des images en mouvement. Toujours ce sentiment que le cinéma est plus important. La scène est pour lui, « un écran de cinéma, en relief où la lumière, la musique et les effets sonores sont plus importants que le jeu des acteurs ». A cette époque, il croit au théâtre à l’italienne, à l’importance du cadre.
« Le théâtre de la fin des années 1940 a connu des moments glorieux : c’était en France, le théâtre de Jouvet et de Christian Bérard, de Jean-Louis Barrault. […] C’était un théâtre de tissus chatoyant, de mots extravagants, d’idées folles, de machineries ingénieuses – un théâtre de la légèreté, du mystère et de la surprise. C’était le théâtre d’une Europe défaite, qui tentait de faire revivre le souvenir d’une grâce perdue ».
Peter Brook est alors considéré comme « l’enfant terrible » du théâtre. N’arrivant toujours pas à faire de cinéma, il décide de se tourner vers l’opéra. Et bien sûr, comme il l’a fait pour le théâtre, il vise haut : Covent Garden. A 22 ans, il devient directeur de production de la Royal Opera House. C’est-à-dire metteur en scène « en résidence ». Son objectif est de propulser cette institution qu’il considère comme démodée dans le monde actuel. Il sait que les influences d’Appia et de Craig peuvent prendre forme à l’Opéra et qu’il faut en finir avec les toiles peintes. Tout cela ne se fait pas sans douleur. Après quelques succès, il monte « Salomé » dans des décors et des costumes de Dali. Devant se battre contre tout le monde à Covent Garden, il accepte de faire des concessions. Le résultat est mauvais et le spectacle est hué. Il est renvoyé.
Il n’en a pas délaissé pour autant le théâtre. Entre des pièces de Shakespeare et d’auteurs contemporains, il monte à Londres, entre 1946 et 1955, des auteurs français comme Jean-Paul Sartre (« Huis clos », « La putain respectueuse »), Anouilh (« Colombe », « L’alouette ») et Roussin (« La petite hutte »).
En 1951, il sort d’Angleterre pour la première fois avec « La mort d’un commis voyageur » d’Arthur Miller, qu’il monte au Théâtre National de Belgique, à Bruxelles. Il épouse la belle et talentueuse comédienne Natasha Parry, avec qui il a deux enfants, Irina et Simon. Il rencontre Bertolt Brecht à Berlin. Brook a appris sur le tas. Jusqu’alors, ce sont ses sentiments et ses intuitions qui lui servent de guide. Il se trouve loin de toute approche théorique sur le théâtre. S’il n’est pas tout à fait en accord avec la distanciation brechtienne, il est fasciné par l’homme et la richesse de son travail de metteur en scène. Lorsqu’il voit « Mère courage », il est séduit car cela ouvre une voie nouvelle au jeu de l’acteur. Brook prend conscience que le théâtre n’est pas seulement fait d’images. Il a 26 ans. En 1953, il se rend à New York pour mettre en scène « Faust » de Gounod au Metropolitan Opera. L’année suivante, il y monte une pièce de Truman Capote et tourne, pour la télévision, « Le Roi Lear » avec Orson Welles. A cette période de sa vie, désirant développer « une certaine compréhension de la création », il met en place ce qu’il nomme « un système de rotation », entre les classiques, l’opéra, le boulevard, la comédie musicale, la télévision, le cinéma (« L’opéra des gueux »). C’est à cette époque qu’il entreprend ses premiers grands voyages, il part en Afghanistan. Il apprend à chaque fois quelque chose. Mais c’est sa mise en scène de « Titus Andronicus » de Shakespeare, avec Laurence Olivier et Vivien Leigh, qui lui offre la reconnaissance internationale. Il arrive avec la pièce à Paris dans le cadre du festival du Théâtre des Nations, en 1957. La première à faire appel à ce jeune metteur en scène, au parcours déjà bien rempli, est Simone Berriau, directrice du Théâtre Antoine. Brook est étonné de découvrir le paysage théâtral parisien de ces années 1950, où chaque théâtre a sa propre identité, son public. Les producteurs n’ont pas encore la main mise sur la production qui reste du ressort des directeurs de théâtre. Sa première mise en scène parisienne est, en 1956, « La chatte sur un toit brûlant » de Tennessee Williams, avec Jeanne Moreau et Paul Guers. En 1958, toujours au théâtre Antoine, il monte « Vue du pont » d’Arthur Miller, dans une adaptation de Marcel Aymé, avec Raf Valone et Evelyne Dandry. Il fait la connaissance de Micheline Rozan, alors agent de Miller. Il réalise son premier grand film, « Moderato cantabile » d’après le roman de Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo. Il a la conviction que le théâtre doit s’affranchir des conventions classiques et naturalistes. C’est dans cet esprit qu’il choisit, en 1960, « Le Balcon » de Jean Genet. Simon Berriau craignant les remous que la pièce risque de créer, refuse de la produire dans son théâtre. C’est Marie Bell qui prend le risque au théâtre du Gymnase. La distribution est composée d’une trentaine de personnages. Brook mélange acteurs professionnels, Marie Bell, Roger Blin, Jean Babilée, René Clermont, Jacques Dacqmine, Loleh Bellon, William Sabatier, entre autres, avec des comédiens amateurs et des artistes venus de divers horizons, cirque, chant, danse. La pièce fait scandale. n 1962, il monte à Stratford avec la Royal Shakespeare Company, « Le Roi Lear ». Cette mise en scène marque un changement dans sa perception du théâtre. Il renonce au décor, adopte « l’espace vide » dans lequel doit se développer l’imagination du public.
« Si on laisse la pièce s’exprimer toute seule, on peut très bien ne pas entendre du tout. Si l’on veut que la pièce soit entendue, alors il faut savoir la faire chanter ». En 1963, Françoise Spira, qui a quitté le T.N.P. de Jean Vilar, vient de prendre la direction de l’Athénée, avec sa compagnie le Théâtre Vivant. Elle demande à Peter Brook de mettre en scène « La danse du sergent Musgrave » de John Arden, avec Jean-Baptiste Thierrée, Pierre Trabard, Laurent Terzieff. La même année, toujours à l’Athénée, Françoise Spira met à l’affiche « Le vicaire » de Rolf Hochhuth, avec Michel Piccoli, Antoine Bourseiller, dans une adaptation de Jorge Semprun, la mise en scène est de François Darbon. Brook signe l’adaptation scénique de cette pièce qui normalement dure huit heures. La pièce soulève l’indignation de la presse et du public. En Angleterre, il propose aux anglais réticents, « La visite de la vieille dame » de Dürrenmatt, pièce que les Américains acceptent mieux. Brook prend en compte que la culture de chacun ne permet pas là même appréhension d’une œuvre. Il est en accord avec Meyerhold pour qui les spectateurs jouent un rôle important au théâtre : « le public ce quatrième créateur ».
« Si nous avons la conviction qu’un moment de la vie vient d’être pleinement et complètement vécu sur scène, c’est parce que diverses forces émanant du public et de l’acteur ont convergé sur un point donné au même moment. »
A ce moment-là de sa vie Brook pense abandonner le théâtre. Il effectue des voyages, et pour les financer, accepte une série de conférences qui forment la base de son livre « L’espace vide ». Lui qui ne se considère pas théoricien, avouant ne rien connaître aux théories théâtrales, réalise un ouvrage remarquable. Il s’attelle surtout au tournage du film « Sa majesté des mouches ».
En 1964, il s’inscrit au Syndicat National des Metteurs en Scène. Grand partisan du statut d'auteur des metteurs en scène, il est un adhérent fidèle du syndicat. Lorsqu’il parle du metteur en scène comme un guide tenant le gouvernail, il n’est pas si éloigné de Dullin, un des fondateurs du syndicat.
« On se trompe souvent sur le travail du metteur en scène. On pense qu’il est un architecte d’intérieur qui peut faire quelque chose avec n’importe quelle pièce pourvu qu’on lui donne suffisamment d’argent et d’objets à mettre dedans. Cela ne se passe pas comme ça. La moitié de la tâche du metteur en scène consiste à maintenir la bonne direction. Là, le metteur en scène – le director – devient un guide, il tient le gouvernail, il doit avoir étudié les cartes et savoir s’il se dirige vers le nord ou vers le sud ». C’est à cette période que s’opère un véritable changement dans sa perception et sa manière de concevoir le théâtre. Peter Hall, qui a fondé la Royal Shakespeare Company en 1960, à Stratford, lui demande de le rejoindre. Brook accepte à la seule condition de « disposer d’une unité de recherche indépendante ». Il forme un groupe à qui il donne le nom de « Théâtre de la cruauté », en hommage à Artaud. Il aime chez ce dernier « l’intensité brûlante de ses positions dans le contexte de théâtre « plan-plan » de son époque ». Le groupe s’intéresse aux mots, aux sons. Cette recherche l’amène à rencontrer Grotowski qu’il admire énormément, parce qu’il a exploré la nature du jeu. Sa première investigation est de répondre à cette question : Qu’est-ce qu’il reste lorsqu’on enlève les mots ? Il désire « savoir si l’invisible peut-être rendu visible par la présence de l’exécutant ». Le travail de recherche est basé sur des exercices et des improvisations. Ils montent la pièce de Peter Weiss, « Marat-Sade ». Nous sommes en pleine guerre du Vietnam. Brook et certains de ces compagnons du « Théâtre de la cruauté » souhaitent parler de leur époque mais sans passer par un auteur. Ils présentent en 1966, « US », une pièce qui repose sur le travail d’improvisation de la troupe. A partir de cette création, Brook se démarque du théâtre traditionnel.
« Durant la représentation d’une pièce de théâtre s’établit une relation entre l’acteur, la pièce et le public. Pendant les répétitions, cette relation s’établit entre l’acteur, la pièce et le metteur en scène ».
En 1968, Jean-Louis Barrault l’invite, dans le cadre du Théâtre des Nations, à monter « La tempête ». Brook propose plutôt de réunir dans un atelier des acteurs et metteurs en scène de différentes cultures. Pour faire plaisir à Barrault, il choisit d’étudier les diverses manières d’aborder les œuvres de Shakespeare en partant de « La Tempête ». Il rencontre « l’irremplaçable » Yoshi Oida. Cette expérience lui donne un avant-goût d’un travail avec des acteurs de plusieurs cultures différentes. Le groupe répète au Mobilier National, dans la galerie musée de la Manufacture des Gobelins. Les événements de Mai 1968 font que l’atelier doit se déplacer à Londres. Ils y présentent un spectacle de théâtre expérimental autour de « La tempête » qui laisse perplexe le public anglais. En 1970, arrive le spectacle qui bouleverse tout et permet à Peter Brook de passer dans la voie d’un théâtre novateur débarrassé des traditions. C’est « Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. Cette pièce est à l’époque peu appréciée car considérée comme artificielle par les uns et destinée aux enfants par les autres. Peter Brook en découvrant à Paris le Cirque de Pékin, a été ébloui par les performances des acrobates chinois. Il pense à eux pour sa mise en scène, car, pour représenter l’univers féerique du « Songe », il faut quelque chose d’aérien, un mélange entre le théâtre et le cirque. Il demande aux comédiens de la Royal Shakespeare de faire de véritables prouesses, jouant suspendus. Le spectacle connaît un succès immense. Il s’installe à Paris, où avec l’aide de Micheline Rozan, il décide d'explorer le théâtre à travers une nouvelle structure. Il met en place le C.I.R.T. (Centre International de Recherches théâtrales), qui devient après tout simplement le Centre de Création. Ils trouvent les fonds nécessaires auprès de fondations internationales. Brook se réinstalle à la Manufacture des Gobelins. Il accueille des acteurs venus de partout. Ce premier groupe est composé par Bruce Myers, Yoshi Oida, François Marthouret, Natasha Parry, Michèle Collison, Miriam Goldschmidt, Claude Confortès… Ils sont rejoints par l’auteur, Jean-Claude Carrière qui prend part aux exercices. L’idée est de désapprendre pour mieux reconstruire. « Cela oblige l’acteur à prendre du recul avec sa propre culture ». Ils travaillent sur les langues anciennes, les sons, le corps. Pour Brook, le groupe est primordial. Il recherche chez l’acteur « le cœur et le courage ». Il s’efforce de développer « chez l’être qui joue cette capacité d’intensifier ses émotions, de les dilater, tout en aidant à s’ouvrir ». Chaque jour est réglé par des séries d’exercices et d’improvisation. Les exercices permettent de se libérer et surtout de développer « le rythme, l’écoute, la cadence, la tonalité, la réflexion collective ou la conscience critique ». L’acteur chez Brook ne joue pas le personnage, il joue avec.
« Le but de l’improvisation et des exercices est toujours le même : rejeter les conventions usées du théâtre ».
Comme les spectateurs sont « les éléments indissociables du processus théâtral ». Ils présentent leurs improvisations dans les écoles (Brook apprécie la spontanéité de l’enfance qui en fait un juge implacable), les hôpitaux, les foyers d’immigrés. De 1970 à 1973, il emmène ce groupe métissé en un long voyage, qui passe par l’Iran, l’Afrique, où l’actrice Helen Mirren les rejoint, l’Amérique, celle des minorités. Ils vont ainsi à la « rencontre des gens qui n’ont pas la possibilité de voir chez eux une tournée théâtrale ». Ils présentent la première version de « La conférence des oiseaux ». Le spectacle n’est donné qu’une fois, mais il commence au début de la soirée pour se terminer au petit matin.
« Le théâtre c’est la vie mais condensée ». En 1971, grâce à Micheline Rozan, Peter Brook découvre son lieu, celui de tous les possibles, « un espace caméléon » : les Bouffes du Nord. Il fait de ce théâtre, à l’origine à l’italienne, un théâtre élisabéthain. Il met en place l’espace vide, en faisant avancer l’aire de jeu, devenue circulaire, vers le public qui l’entoure. Il ouvre la scène à la verticale en lui retirant le cadre, obtenant ainsi une hauteur de plafond qui aère et libère le regard. Le mur du fond est laissé vide, mettant en relief les silhouettes des acteurs. Pas de scène, mais un sol, sur lequel bien souvent, est jeté un tapis qui condense et délimite l’espace de jeu. Il en fait un lieu modulable « partiellement » selon les exigences du spectacle. A l’orchestre, des bancs inconfortables sur lesquels les spectateurs sont très proches les uns des autres et non séparés comme dans les salles de spectacle ordinaire.
« Le théâtre repose sur une caractéristique humaine particulière, le besoin d’avoir une relation nouvelle et profonde avec ses congénères ». Grâce à Micheline Rozan, devenue sa collaboratrice, qui sait où trouver de l’aide, et même si les Bouffes sont soutenus par le Ministère de la Culture, Brook peut garder son indépendance. Les subventions lui permettent de proposer des prix abordables. Son objectif est de rendre le théâtre accessible à tous. Il ouvre les Bouffes avec « Timon d’Athènes » de Shakespeare, une pièce jugée alors « secondaire ». Il demande à Jean-Claude Carrière d'en faire une version française, dans un langage contemporain. Il est important pour lui de repenser les adaptations.
« Les adaptations portent toujours la marque de l’époque à laquelle elles ont été écrites, tout comme les spectacles que rien ne destine à durer ». La pièce rencontre un grand succès. Peter Brook obtient le Prix du Brigadier. Depuis le début de sa carrière, c’est grâce à Shakespeare que Brook, comme Gordon Craig, a trouvé un nouveau style de théâtre. Après « Timon », Brook présente « Les Iks » d'après Colin Turnbull, puis « Ubu aux Bouffes » d’après Alfred Jarry. Il revient à Shakespeare avec « Mesure pour mesure ». Puis il s’attache aux grands textes épiques, comme « La conférence des oiseaux », d’après un poème persan du XIIe siècle, et la farce africaine « L’os » de Birago Diop. Par les jeux de masques, de marionnettes et de la farce, il réunit ce qu’il nomme le « théâtre sacré » au « théâtre brut ». Pour les spectacles suivants, sans sa troupe, il s’attaque pour la première fois à Tchekhov avec « La Cerisaie », interprétée par Michel Piccoli, Natasha Parry, Niels Arestrup, Catherine Frot… Brook casse les codes de la « langueur » et rend à « l’âme slave » sa légèreté. C’est un triomphe. Puis Brook propose « La tragédie de Carmen », prouvant ainsi que l’Opéra n’est pas un art figé dans les traditions et qu’il peut faire alliance avec le théâtre. Il fait une dernière incursion dans le théâtre privé, au Théâtre Montparnasse, en cosignant avec Maurice Benichou la mise en scène de la pièce de François Billetdoux, « Tchin-Tchin » avec Marcello Mastroianni et Natasha Parry. Chaque mise en scène de Peter Brook marque les esprits. Les plus mémorables sont évidemment, « Le Mahâbhârata », spectacle fleuve qu’il crée dans la carrière Boulbon pour le festival d’Avignon, et « La tempête », travail magnifique aux couleurs de l’Afrique et du mystique. Avec « L’homme qui » d’après le livre d’Oliver Sacks, Brook se concentre sur un théâtre plus austère. Ensuite, passant de Beckett à Can Themba (« Le costume »), en faisant un détour par Mozart, revenant régulièrement à Shakespeare, tout ce que Peter Brook aborde trouve écho auprès du public. Et pourtant il ne le ménage pas, ne le conforte pas dans les habitudes. Car Brook se renouvelle sans cesse, observant autour de lui les mutations du monde. S’il revient au cinéma c’est pour filmer le théâtre : « La persécution et l’assassinat de Jean-Paul Marat… » d’après la pièce « Marat-Sade », « La tragédie de Carmen », « Le Mahâbhârata », « La tragédie de Hamlet ». Un film fait l’exception à la règle, « Rencontres avec des hommes remarquables » d'après l'œuvre éponyme de Georges Gurdjieff dont la pensée a influencé une grande partie de sa recherche spirituelle. En 2010, Peter Brook et Micheline Rozan ont quitté la direction des Bouffes du Nord, reprise par Olivier Mantei et Olivier Poubelle. Sa dernière création « The Prisoner », en collaboration avec Marie-Hélène Estienne, a été jouée au printemps 2018 aux Bouffes du Nord. Peter Brook a incontestablement marqué l’histoire du théâtre et de la mise en scène. « Dans le théâtre ce qui est au centre, c’est l’humain ».
Marie-Céline Nivière
Sources :
« Oubliez le temps », Peter Brook (Seuil)
« Point de suspension, 44 ans d’exploration théâtrale 1946-1990 », Peter Brook (Seuil).
« Du bout des lèvres » de Peter Brook (Odile Jacob).
« Peter Brook, de Timon d’Athènes à la Tempête » de Georges Banu (Flammarion).
« Peter Brook », texte de Georges Banu (Encyclopédie universalis).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2022 11:02 AM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 3 juillet 2022 Après 80 ans de carrière, le grand metteur en scène britannique est mort à l'âge de 97 ans. Pratiquant un théâtre « monde » épuré, passant de Shakespeare aux fresques indiennes ou aux contes africains, Peter Brook a approché au plus près le mystère de l'art dramatique. Son fantôme hantera longtemps sa maison, Les Bouffes du Nord. Devant les Bouffe du Nord, en cette nuit de juillet, un marchand de fleurs à la sauvette aurait laissé tomber une rose. Ce serait le plus bel hommage involontaire qu'un passant aurait pu faire au grand homme de théâtre décédé le 2 juillet 2022 à 97 ans. Dans leur belle simplicité, ses murs patinés et sans âge lui ressemblaient tellement. Cette salle du nord de Paris, il l'avait investie dès le début des années 1970 et il continua à l'habiter jusqu'au bout même s'il n'en était plus le gestionnaire. Il lui avait imposé sa marque tout en douceur : l'art de créer le plein d'émotions dans un « espace vide ». Qu'il monte Shakespeare son grand maître, des fresques comme « Le Mahâbhârata », des contes ou Beckett, Peter Brook ne s'embarrassait pas de décors. Quatre bâtons lui suffisaient pour représenter une maison, une souche et quelques brindilles pour évoquer une forêt… Le magicien transformait ses acteurs en roi et reine en les parant d'un simple tissu écarlate. Un balancement du corps de plus en plus insistant évoquait une tempête. Et puis il y avait ce sol nu, magistralement éclairé, comme animé d'une force tellurique. Mer ou désert, rue ou place de village… En le foulant, ses personnages semblaient faire renaître le monde. Il faut du temps pour parvenir à l'épure. Les amateurs de théâtre d'aujourd'hui, du sénior à l'adolescent, connaissent bien son travail depuis son installation à Paris. Mais l'homme, fils d'immigrés lituaniens juifs, a commencé très tôt à faire du théâtre. Ses premières mises en scène à Londres datent du début des années 1940. Il n'a même pas 20 ans. Si on fait la somme aujourd'hui de ses créations et recréations, on en dénombre plus de 90, soit à peu près autant que son âge. Brook fait d'emblée feu de tout bois. Shakespeare reste son fil rouge, magnifiquement traduit en français par Jean-Claude Carrière, son indéfectible compagnon de route. Mais il s'attaque aussi à Marlowe, Shaw et à Beckett, puis au répertoire américain (Tennessee Williams, Arthur Miller), russe (Tchekhov, Dostoïevski) nordique (Ibsen) et aussi bien sûr français. Dans son prisme, les modernes, avec un goût certain pour l'éclectisme : André Roussin, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Jean Genet… Du cinéma en parallèle Le metteur en scène s'ouvre d'emblée aux autres disciplines : dès la fin des années 1940, il met en scène des opéras à Covent Garden. Il mène parallèlement une carrière, humble mais non négligeable, de cinéaste avec en tout une dizaine de films : « Sentimental Journey » (1944), « Moderato Cantabile » (1959), « Sa Majesté des mouches » (1963), « Le Mahâbharâta » (1989), « La Tragédie d'Hamlet » (2002… Tous ou presque sont liés à son travail d'homme de théâtre. Ce n'est qu'en 1962, lorsqu'il crée « Le Roi Lear » à la Royal Shakespeare Company à Londres, que Peter Brook décide d'abandonner les oripeaux du théâtre traditionnel, de supprimer les décors et de mettre en œuvre sa théorie de l'espace vide. Au plateau nu s'ajoute une nouvelle façon de mettre en scène, s'appuyant sur l'impro, la recherche permanente du jeu juste, un rapport nouveau avec le public. Brook vise un théâtre total, inspiré du théâtre de la cruauté d'Antonin Arthaud. Mais sa « révolution » ne s'arrête pas là. Le Britannique décide d'étendre son terrain de jeu. Peu à peu, il s'impose comme le héraut d'un « théâtre monde ». Cela passe par des voyages (Iran, Afrique, Amérique du nord) et bien sûr par des rencontres. En 1971, alors qu'il s'est installé à Paris, il crée le Centre international de recherche théâtrale, ouvert à des acteurs du monde entier. A l'instar d'Ariane Mnouchkine, il fait appel à des distributions métissées, où aux côtés de Français ou de Britanniques comme Maurice Bénichou ou Kathryn Hunter… figurent des Indiens ou des Africains. Parmi eux, Bakary Sangaré, ancien élève de l'Institut des arts de Bamako, remarqué dans « Le Mahâbhârata » puis dans « La Tempête », rejoindra la Comédie-Française en 2002. De la maison de Brook à la maison de Molière, il n'y a qu'un pas… Metteur en scène conteur Plus les spectacles de Brook s'épurent, plus l'osmose entre la tradition occidentale et les cultures du reste du monde s'approfondit. Brook est faiseur de théâtre sans frontière, tout à la fois metteur en scène, conteur, griot. Le merveilleux se niche dans les détails d'un petit geste, d'un regard… et dans ces silences chargés de mille sens. Le maître baladeur peut nous plonger dans la tragédie de Carmen, mise à nu, raccourcie et portée par les seules notes d'un piano, puis la fois d'après nous propulser dans les townships d'Afrique du Sud. La même humanité inonde la scène. Et submerge le public. Artiste de l'indicible et de l'invisible, Brook n'a eu aucun mal à abattre ce quatrième mur qui sépare le spectateur de l'acteur. Depuis les années 2010, où le duo formé par Olivier Mantei et Olivier Poubelle avaient repris les manettes des Bouffes du Nord, Peter Brook, aidé de sa complice Marie-Hélène Estienne, s'était voué à des projets plus modestes ou plus courts, n'hésitant pas à « refaire » certaines de ses créations (comme « Fragments » de Beckett) ou à rajouter un bref chapitre au Mahâbhârata ». Il était au rendez-vous quasiment chaque année. Ces derniers temps, ses spectacles ressemblaient de plus en plus à des leçons de théâtre en forme de testament lumineux. Son ultime création à l'affiche des Bouffes en avril dernier fut « The Tempest Project ». Peter Brook s'emparait une nouvelle fois de l'œuvre flamboyante du grand Will pour en célébrer la plus belle flamme, celle de la liberté. Philippe Chevilley / Les Echos

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2022 9:16 AM
|
par Pierre Desorgues pour Tv5monde
Peter Brook un géant, inspiré par l'Afrique, qui a changé à jamais la face du théâtre
Peter Brook est mort à l'âge de 97 ans. Il était avec Constantin Stanislavski le metteur en scène le plus influent du XXe siècle et à qui l'on doit le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il fut l'un des premiers grands metteurs en scène à s’adresser à l'Afrique en adaptant des écrivains africains comme Birago Diop et des auteurs sud-africains noirs censurés par le régime d'apartheid. Le maître de théâtre, né en Grande-Bretagne mais qui a mené une grande partie de sa carrière en France, à la tête de son théâtre parisien Les Bouffes du Nord, avait réinventé l'art de la mise en scène en privilégiant des formes épurées au lieu des décors traditionnels.
(RE)voir : Peter Brook l'Africain Première mise en scène à 17 ans Né à Londres le 21 mars 1925, ce fils d'immigrés lituaniens juifs signe sa première mise en scène à 17 ans. S'il rêve de cinéma, il se dirige rapidement vers le théâtre. A 20 ans, diplômé d'Oxford, il est déjà metteur en scène professionnel et, deux ans plus tard, ses productions à Stratford-upon-Avon, ville natale de Shakespeare, déchaînent les passions. A 30, il dirige déjà de gros succès à Broadway. Pour la Royal Shakespeare Company (RSC), il met en scène de nombreux textes du "Barde", qui est pour lui "le filtre par lequel passe l'expérience de la vie". Une grande partie de sa carrière menée en France
C'est dans les années 60, après des dizaines de succès, dont de nombreuses pièces de Shakespeare, et après avoir dirigé les plus grands - de Laurence Olivier à Orson Welles entame sa période expérimentale.
Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Peter Brook Il crée avec la Royal Shakespeare Company un "Roi Lear" dépouillé (1962) et surtout sa surprenante production de "Songe d'une nuit d'été" (1970) dans un gymnase en forme de cube blanc: c'est la théorie de "l'espace vide" qui marquera définitivement le théâtre contemporain. Parue pour la première fois sous forme d'ouvrage en 1968, elle laisse libre cours à l'imagination du public et est considérée comme une "bible" pour les amoureux du théâtre avant-gardiste. "Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène" est une de ses célèbres phrases.
"Le visionnaire, le provocateur, le prophète, le filou et l'ami avec les yeux les plus bleus que j'aie jamais vus, a quitté la maison", a tweeté dimanche son compatriote metteur en scène et acteur Simon McBurney. Son "Marat/Sade" fascine Londres et New York et lui vaut un Tony Award en 1966.
Au début des années 70, il s'installe en France où il fonde le "Centre international de recherche théâtrale", au Théâtre des Bouffes du Nord. Il monte des pièces monumentales nourries d'exotisme, avec des acteurs de différentes cultures, et tournera dans le monde entier, souvent dans des lieux inédits: des villages africains jusqu'aux rues du Bronx en passant par la banlieue parisienne.
Sa pièce la plus connue est "Le Mahabharata", épopée de neuf heures de la mythologie hindoue (1985), qu'il présentera pour la première fois au festival d'Avignon et qui sera adaptée au cinéma en 1989. Dans les années 90, lorsqu'il triomphe au Royaume-Uni avec "Oh les beaux jours", de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme "le meilleur metteur en scène que Londres n'a pas". Peter Brook et l'Afrique
Dans le théâtre de Peter Brook apparaît une présence constante : le continent africain. Cette relation privilégiée passe par de nombreux voyages et des mises en scène d’ambiance africaine et une longue collaboration avec des acteurs africains.
"Peter Brook est le premier metteur en scène à s'adresser à l'Afrique. L'Afrique était alors rarement considérée comme un territoire d’intérêt théâtral" Rosaria Ruffini, spécialiste du Théâtre de Peter Brook "Dans sa recherche de régénération, Brook se détache des tendances théâtrales de l’époque et entreprend un parcours tout à fait original : il est le premier metteur en scène à s’adresser à l’Afrique, tandis que la plupart des artistes de théâtre se tournaient plutôt vers l’Orient", souligne ainsi l'universitaire Rosaria Ruffini auteur d'un article "Les Afrique du théâtre de Peter Brook".
"L’Afrique était alors rarement considérée comme un territoire d’intérêt théâtral. Victime de catégories et de modèles culturaux coloniaux, le continent est une inconnue qui suscite souvent suspicion et perplexité", écrit encore l'universitaire spécialiste du théâtre de Peter Brook.
Il met alors en scène de grands intellectuels et écrivains africains. Dans L’Os la troupe donne vie à un village sénégalais. L’Os est une farce brève et légère qui marque le premier pas du metteur en scène britannique dans la dramaturgie africaine. Son spectacle est une adaptation de la pièce de l’écrivain et intellectuel sénégalais Birago Diop.
Birago Diop (1913-1989) est un écrivain et poète sénégalais connu connu notamment pour ses rapports avec la négritude et la mise par écrit de contes traditionnels de la littérature orale africaine. Il adapte également des auteurs sud-africains noirs dès les années 80 en plein apartheid. Le comédien burkinabé et malien Sotigui Kouyaté (1936-2010), un de ses acteurs favoris
"Ses mises en scène tirées des textes sud-africains : Woza Albert ! (1989), The Island (1999), Le Costume (1999), Sizwe Banzi est mort (2006) dessinent un véritable « cycle sud-africain » à l’intérieur de son répertoire. Ces quatre mises en scène se basent sur les textes de dramaturges sud-africains qui œuvraient pendant l’apartheid en condition de clandestinité et censure, lorsque toute forme d’art était interdite aux Noirs", souligne ainsi Rosaria Ruffini dans "Les Afrique du théâtre de Peter Brook".
Sotigui Kouyaté (1936-2010), comédien, metteur en scène malien et bukinabé est un de ses acteurs favoris. Sotigui Kouyaté joue ainsi dans l'adaptation du Mahabharata sur scène en 1985. Il joue dans la Tempête (1990), Le Costume (2000), La Tragédie d'Hamlet (2003). Sotigui Kouyaté obtiendra au festival du film de Berlin l'Ours d'argent 2009 du meilleur acteur dans "London river" du Franco-Algérien Rachid Bouchareb ne manquant pas de mettre en avant sa relation de travail avec Peter Brook dans le succès de sa carrière.
Premier pensionnaire africain de la Comédie Française (entré en 2002) Bakary Sangaré né en 1961 et formé l’Institut national des arts de Bamako a également travaillé régulièrement avec Peter Brook. Il a joué entre autres dans Woza Albert ! adaptation d’après le texte de l'écrivain sud-africain Barney Simon.
Peter Brook a été un des premiers à introduire de la diversité, et ça n'a pas été une petite révolution, dans un théâtre qui était essentiellement blanc.
Olivier Py, directeur du festival d'Avignon. Peter Brook, a été un des premiers à donner sa chance aux acteurs africains et noirs. Peter Brook après une aventure de plus de 35 ans aux Bouffes du Nord, Peter Brook quitte la direction du théâtre en 2010, à 85 ans, tout en continuant d'y monter des mises en scène, jusqu'à récemment. "Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d'une infinie tristesse", a réagi sur Twitter la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak, estimant qu'avec lui "la scène s'est épurée jusqu'à l'intensité la plus vive".En 2019, il rend hommage dans "Why?" à Meyerhold, grande figure russe du théâtre et victime des purges staliniennes, rappelant une de ses citations: "Le théâtre est une arme dangereuse".Il a toujours refusé de faire du théâtre engagé, préférant un théâtre qui invite à la réflexion ou à la spiritualité, que ce soit avec des pièces shakespeariennes ou des adaptations comme Carmen. "Certains journalistes viennent me demander: 'Alors, vous pensez pouvoir changer le monde?'. Cela me fait rire. Je n'ai jamais eu cette prétention, c'est ridicule", confiait en 2018 à l'AFP celui qui avait été ébranlé trois ans plus tôt par le décès de son épouse, la comédienne Natasha Parry.
Outre sa fidèle collaboratrice Marie-Hélène Estienne, il laisse derrière lui deux enfants, le réalisateur Simon Brook et la metteure en scène de théâtre Irina Brook
Pierre Desorgues / TV5 Monde * Légende photo : en 1989, Woza Albert ! mars 1989, les acteurs Bakary Sangare, Mamadou Dioume, l'écrivai Barney Simon et Peter Brook. Photo : Daniel Cande Peter Brook, né en Grande-Bretagne en 1925, a mené une grande partie de sa carrière en France notament à la tête du théâtre parisien Les Bouffes du Nord qu'il a dirigé durant plus de 35 ans. C'est là que l'acteur camerounais Emil Abossolo-Mbo y a fait sa connaissance. Il garde un souvenir "pleinement vivant" du metteur en scène "qui était un être humain plein de bienveillance. Quoi qu'il pouvait dire, le plus important était de faire passer de l'amour et de la douceur".

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 3:12 PM
|
Brook par Brook - Portrait intime Un documentaire
Peter Brook est décédé le 2 juillet à l'âge de 96 ans. Qui mieux que Simon, son fils, pouvait capter ce regard plein de tendresse et d’humilité, ce sourire insaisissable, ce discours simple et passionné ? Peter Brook se livre ici à un interlocuteur privilégié qui l’accompagne tout au long du film et dévoile une part de son intimité d’artiste et d’homme.
Réalisation : Simon Brook
Auteur.e : Fabienne Pascaud
Pays : France Année : 2001
Voir la vidéo sur le site d'ARTE (1h10)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 5:20 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 3 juillet 2022 Installé en France depuis 1974, l’artiste a marqué l’une des pages les plus importantes de l’aventure théâtrale. Il laisse des spectacles uniques montés dans son Théâtre des Bouffes du Nord, comme « Le Songe d’une nuit d’été », « Le Mahabharata » ou « La Tempête ». Il est mort samedi à l’âge de 97 ans.
Comme les chats, il semblait avoir eu (au moins) neuf vies. Mais Peter Brook est définitivement passé de l’autre côté, du côté de cet invisible, dont il n’avait eu de cesse de vouloir s’approcher, encore et encore. Le metteur en scène britannique, installé en France depuis 1974, est mort samedi 2 juillet à Paris, à l’âge de 97 ans, a appris Le Monde dimanche. Avec lui s’éteint une des aventures théâtrales les plus importantes de la deuxième partie du XXe siècle, qui a fait du théâtre un fabuleux instrument d’exploration de l’humain, dans toutes ses dimensions, au fil de spectacles légendaires : Le Songe d’une nuit d’été, La Tempête, La Tragédie de Carmen, Le Mahabharata, La Cerisaie, L’Homme qui…, jusqu’à cette merveilleuse Flûte enchantée créée par le maître en 2010 en son Théâtre des Bouffes du Nord, jusqu’à ce Battlefield qui, à l’automne 2015, le vit offrir une quintessence pure et lumineuse de son théâtre et de sa recherche. Cette esthétique du divers, cette éthique de la curiosité avaient été trempées d’emblée dans l’histoire de sa famille. Peter Brook naît à Londres, le 21 mars 1925, de parents émigrés juifs originaires de cette Lettonie qui faisait alors partie de l’Empire russe. Son père, Simon, jeune révolté appartenant au parti menchevik, avait dû s’exiler en 1907, accompagné de sa très jeune femme, Ida. Le couple fait ses études à Paris et à Liège, avant de fuir la Belgique pour l’Angleterre en 1914, avec l’arrivée de l’armée allemande. Le nom russe de la famille, qui se prononçait Bryck, a été déformé en Brouck dans sa transcription par l’administration française, avant de devenir Brook à l’arrivée en Angleterre. Peter Brook confiait invariablement, quand on l’asticotait sur ce sujet, n’avoir aucun lien réel avec ses origines juives. En revanche, la culture russe était encore fortement présente dans sa famille, et restera, tout au long de sa vie, inscrite de manière très intime, comme une clé essentielle de compréhension de cet homme à la fois formidablement ouvert et totalement énigmatique. Ce lien avec la Russie fut ainsi au cœur de sa rencontre, en 1950, avec son épouse, l’actrice Natasha Parry (1930-2015), elle aussi d’origine russe : Peter Brook avait été frappé, notamment, par le fait qu’elle s’appelait comme l’héroïne de Guerre et Paix, de Tolstoï… Le couple nommera d’ailleurs leur fille Irina, en hommage à la plus jeune des héroïnes des Trois Sœurs, de Tchekhov – Irina Brook (née en 1962) est elle aussi metteuse en scène et dirige le Théâtre national de Nice de 2014 à 2019. Une carrière fulgurante Passionné de photo et de cinéma, le jeune homme, qui déteste une institution scolaire britannique traditionaliste et xénophobe, aimerait devenir réalisateur, dans cette grise Angleterre de la fin de la guerre et de l’après-guerre. Mais le milieu du cinéma lui paraît inaccessible. Alors il se tourne vers le théâtre, à Oxford, où il étudie la littérature russe. La carrière du jeune ambitieux est fulgurante : première mise en scène professionnelle à 21 ans, en 1946, avec Peines d’amour perdues, de Shakespeare, l’auteur-continent qu’il ne cessera d’arpenter tout au long de sa vie, et qui structurera toute sa réflexion sur le théâtre. A 22 ans, il signe avec Roméo et Juliette son premier spectacle dans le temple shakespearien de Stratford-upon-Avon. A 23 ans, il est nommé directeur de production à l’Opéra royal de Covent Garden. Il en est renvoyé quelques mois plus tard, après avoir par trop bousculé les habitudes de cette vénérable institution, et provoqué un beau scandale avec sa mise en scène de Salomé, de Richard Strauss, dans les décors surréalistes de Salvador Dali. Surnommé l’enfant terrible, Peter Brook aurait pu continuer ainsi, en jeune homme brillant travaillant sans états d’âme à la fois dans l’institution et dans le théâtre commercial. Mais, à partir du milieu des années 1950, son rapport au théâtre commence à changer insensiblement, ouvrant cette longue période de novation qui va faire de lui une des figures essentielles du renouvellement théâtral de la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de sa réflexion sur le « théâtre mortel », ayant perdu tout son sens. D’abord, il se décentre – déjà… –, en travaillant à New York, au Metropolitan Opera, et à Paris, où il met en scène La Chatte sur un toit brûlant, de Tennessee Williams, Vu du pont, d’Arthur Miller et, en 1960, Le Balcon, de Jean Genet, qui n’a pas encore été créé en France. Mais c’est surtout sa mise en scène stylisée de Titus Andronicus, en 1955, pour la Royal Shakespeare Company, qui fait date dans l’histoire du théâtre, en imposant une vision nouvelle de Shakespeare, et en posant la première pierre de ce dépouillement raffiné qui va devenir l’essence de son art. Théorie de l’espace vide Au début des années 1960, Brook, nourri des écrits des pionniers de la modernité théâtrale – le Russe Meyerhold, l’Anglais Gordon Craig et, surtout, le Français Antonin Artaud et son théâtre de la cruauté –, stimulé par l’effervescence tous azimuts de ces années-là, notamment les recherches du Living Theatre et celles du Polonais Jerzy Grotowski, rompt définitivement avec le théâtre officiel. Il s’attaque à la folie, aux camps de la mort, à la guerre du Vietnam, avec Marat-Sade et L’Instruction, de Peter Weiss, et US, une création collective. « J’étais saturé de cette imagerie que j’avais tellement aimée, et je sentais de plus en plus qu’au cœur du théâtre, il y a une seule chose, qui est l’être humain, et donc l’acteur », nous expliquait Peter Brook dans un entretien réalisé en novembre 2010. « J’ai commencé à m’intéresser au développement intérieur, aux techniques basées sur les mouvements du corps, la respiration, pour arriver à faire sortir de la personne tout son potentiel. » « Si on veut parler de l’être humain, on ne peut pas le réduire à l’être humain blanc et bourgeois de nos sociétés » Cette recherche est formalisée, en 1968, par un ouvrage théorique devenu un classique, L’Espace vide, qui s’ouvre par ces lignes célèbres : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé. » « J’avais très envie, aussi, de casser la rampe, ce quatrième mur invisible qui, au théâtre, coupe la scène et la salle, ajoutait Peter Brook en novembre 2010. Dans le théâtre classique, la structure des salles est une structure bourgeoise, qui conditionne le contenu. En parallèle, j’éprouvais la nécessité, expérimentée en 1968 grâce à Jean-Louis Barrault, d’avoir un atelier international. Si on veut parler de l’être humain, on ne peut pas le réduire à l’être humain blanc et bourgeois de nos sociétés. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés Jean-Claude Carrière, scénariste et écrivain, est mort à l’âge de 89 ans En 1970, Brook crée son dernier spectacle dans le cadre de la scène officielle anglaise, avec ce Songe d’une nuit d’été qui, lui aussi, fait date, en perchant les comédiens sur des trapèzes, dans un espace vide d’une blancheur immaculée. Mais surtout, il crée son Centre international de recherche théâtrale (CIRT), composé d’acteurs venus des quatre coins de la planète, dont certains, comme le Britannique Bruce Myers et le Japonais Yoshi Oïda, resteront jusqu’au bout des fidèles. Pendant trois ans, ils joueront un peu partout, en France, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, et surtout là où le théâtre ne va pas : dans des foyers d’immigrés en banlieue et des bidonvilles à Paris, dans les ruines de Persépolis en Iran, au fin fond du Sahara et sur des places de villages au Mali ou au Nigeria, chez les Chicanos à la frontière mexicaine et dans une réserve indienne, dans les rues du Bronx ou de Brooklyn, à l’hôpital Sainte-Anne à Paris ou en entreprise à Jouy-en-Josas (Yvelines), dans des garages, des salles de cinéma à l’abandon… L’aventure des Bouffes du Nord Pendant ces trois ans, Peter Brook a avancé dans sa réflexion sur ce qu’est un espace théâtral partagé : comment se crée le lien avec le spectateur ? Comment éviter la coupure entre le lieu clos du théâtre et le dehors, la vie, la vraie vie ? En 1974, la redécouverte miraculeuse du Théâtre des Bouffes du Nord, qui tombait en ruine, dans le quartier populaire de La Chapelle, à Paris (10e), lui offre l’occasion de synthétiser toutes ses recherches. « Les Bouffes sont vraiment l’espace caméléon dont je rêvais, propre à stimuler et libérer l’imagination du spectateur, un espace où un partage est possible » Ce sera le début d’une aventure exceptionnelle, notamment pour les spectateurs français qui l’ont suivie passionnément. Une aventure qui s’est poursuivie jusqu’à l’hiver 2010, quand Peter Brook a mis en scène Une flûte enchantée, « sa » Flûte, d’après l’opéra de Mozart, et a confié les clés de « son » théâtre à Olivier Poubelle et Olivier Mantéi, un duo d’administrateurs venus du monde de la musique. Et qui s’est encore prolongée, puisque les nouveaux patrons ont accueilli ensuite toutes les créations du maître. Peter Brook avait trouvé dans ce lieu magique que sont les Bouffes du Nord tout ce dont il rêvait, comme il nous le racontait dans un entretien en 2004 : un théâtre installé dans un quartier populaire et cosmopolite, porteur d’une histoire, d’une mémoire inscrites sur ses murs comme sur une peau, et « doté de proportions extraordinaires, uniques en Europe, dont nous avons découvert plus tard qu’elles étaient les mêmes que celles du Théâtre de la Rose de Shakespeare ». Lire aussi Article réservé à nos abonnés Les Bouffes du Nord, l’espace vide idéal « Ne dirait-on pas à la fois une cour, une mosquée, une maison ? », demandait Peter Brook avec fierté en faisant faire le tour du propriétaire. « Les Bouffes sont vraiment l’espace caméléon dont je rêvais, à la fois intérieur et extérieur, propre à stimuler et libérer l’imagination du spectateur, un espace où un partage est possible, ainsi que la concentration qu’exige le théâtre. Car le théâtre n’est rien d’autre qu’une expérience humaine plus concentrée que celles que nous avons coutume de vivre dans la vraie vie. » La recherche de cette « expérience humaine plus concentrée » va donner lieu à toute une série de spectacles inoubliables, dans cet espace unique dont Peter Brook et la codirectrice du théâtre, Micheline Rozan (1928-2018), femme de tête qui l’accompagne depuis les années 1950, ont su garder la « beauté des ruines », avec ses murs craquelés, couleur rouge de Pompéi, symboles de l’éphémère qui par essence définit le théâtre. Tout englober de l’expérience humaine En octobre 1974, pour l’ouverture, ce sera Timon d’Athènes – Shakespeare, of course –, avec François Marthouret, Maurice Bénichou, Bruce Myers… Puis il y aura Les Iks, d’après l’histoire, étudiée par l’anthropologue Colin Turnbull, d’une tribu africaine passée sans transition de l’âge de fer au XXe siècle ; La Conférence des oiseaux, inspirée par le poète persan du XIIe siècle Farid Al-Din Attar ; La Cerisaie, un Tchekhov intime, avec Michel Piccoli ; La Tragédie de Carmen, emmenée par l’irrésistible Hélène Delavault, avec laquelle Brook renouvelle totalement le théâtre musical ; Le Mahabharata, d’après le grand récit mythique indien, sans doute son spectacle emblématique, s’il fallait n’en choisir qu’un, créé dans une carrière de pierre, au Festival d’Avignon. « L’être humain est le seul ésotérisme qui mérite d’être déchiffré » Et puis encore La Tempête – Shakespeare toujours… –, avec le comédien malien Sotigui Kouyaté (1936-2010), autre acteur fétiche, dans le rôle du magicien Prospero ; L’Homme qui, inspiré par les recherches du neurologue Oliver Sacks ; The Island, Le Costume et Sizwe Banzi est mort, pièces issues des townships sud-africaines ; Hamlet, avec le comédien anglais d’origine jamaïcaine Adrian Lester ; Tierno Bokar, d’après Amadou Hampaté Ba, La Mort de Krishna, d’après Vyasa, et Le Grand Inquisiteur, d’après Dostoïevski, trois réflexions sur la religion et la tolérance… Le récapitulatif donne le vertige, et la mesure d’un homme qui semble avoir voulu tout englober de l’expérience humaine, y compris dans ses dimensions ésotérique ou mystique. L’influence fondamentale d’un théâtre élisabéthain – « Shakespeare est à l’origine de tout », disait-il – à la fois comique et tragique, politique et frivole, brut et sacré, se joignait chez lui à des recherches plus mystérieuses, notamment le travail effectué pendant des années avec des disciples du maître spirituel Georges Gurdjieff (1866-1949), personnage sur lequel il a réalisé son film Rencontre avec des hommes remarquables, en 1979. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Théâtre : Peter Brook, l’épure au bord du vide Peter Brook, pourtant, détestait qu’on le prenne pour un gourou, et qu’on lui demande quel était le lien entre sa connaissance – et sa pratique – des philosophies orientales, son goût pour l’ésotérisme et son travail avec les acteurs. Dans son loft lumineux de la Bastille, à Paris, vaste espace vide principalement meublé de tapis et de livres – d’art, d’anthropologie, de philosophie… –, son œil bleu laser se posait sur vous avec encore plus d’intensité que d’habitude, et il vous répondait que « l’être humain est le seul ésotérisme qui mérite d’être déchiffré ». Ce qui était encore une pirouette de chat, cet animal magique entre tous, puisque cet « ésotérisme » humain demande bien des clés et des techniques pour être décrypté. Le metteur en scène a fait du théâtre le lieu par excellence de cette pluralité d’approches. Mais avec l’homme Peter Brook, le mystère ne faisait que s’approfondir, au fur et à mesure qu’on le connaissait davantage. Peter Brook en quelques dates 21 mars 1925 Naissance à Londres 1946 « Peines d’amour perdues », première mise en scène professionnelle 1970 « Le Songe d’une nuit d’été », avec la Royal Shakespeare Company ; création du Centre international de recherche théâtrale (CIRT) 1974 Installation à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord 1985 « Le Mahabharata » 2010 « Une flûte enchantée », d’après Mozart 2015 « Battlefield » 2018 « The Prisoner » 2022 Mort à 97 ans Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : Peter Brook dans son Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, en août 2015. BERTRAND GUAY/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 8:31 PM
|
Sur le site de l'émission Affaires culturelles, d'Arnaud Laporte, sur France Culture Le metteur en scène présentera pour la première fois dans son intégralité "Le Nid de Cendres", un spectacle épique et fantastique d'une durée de treize heures.
Ecouter l'entretien (5 mn)
En recomposant à l'occasion du 76e Festival d'Avignon où il sera présenté à partir du 9 juillet à La FabricA pour la première fois dans son intégralité son spectacle Le Nid de Cendres (sept pièces en tout, réarrangées pour une durée totale de treize heures heures), le metteur en scène Simon Falguières s'inscrit dans la fameuse tradition des spectacles fleuves du festival pour proposer un récit épique tendu entre le monde du rêve et la réalité.
Un projet de troupe, un projet au long cours, aussi, démarré il y a sept ans au Cours Florent où Simon Falguières s'est formé.
Au micro d'Arnaud Laporte, il revient sur cette épopée
Présentation du spectacle : Enfant de la balle, Simon Falguières a déjà une longue expérience de la mise en scène et de l’écriture à son actif. Il relève un défi dont seuls quelques intrépides rêvent encore : le spectacle fleuve. Soit treize heures de théâtre interprétées par dix-sept comédiens aux soixante personnages et deux cents costumes ! À la fois conte merveilleux et épopée fantastique, son Nid de Cendres est constitué de sept pièces qui se succèdent dans un suspens qui maintient les spectateurs en alerte. Une aventure riche en péripéties qui entraîne le public dans deux mondes en péril, celui des rêves – le royaume de la princesse Anne – et celui de la réalité, qui a pour héros le comédien Gabriel. Et si au début du spectacle, ils ignorent leurs existences réciproques, bientôt guidés par une force surnaturelle, ils vont tout faire pour se rejoindre et peut-être ainsi sauver leurs mondes en les unissant…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 2022 8:25 PM
|
Par Sylvia Zappi dans Libération - 1er juillet 2022 Reportage dans les coulisses de la création de Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan jouée par une troupe d’amatrices de la ville de Seine-Saint-Denis, avant les représentations du 1er au 3 juillet.
Sur la scène, un cratère plein d’eau, une rampe électrique qui pend et des projecteurs qui jonchent le sol. Une sirène d’alarme retentit. Est-ce la guerre ? Une ville à l’abandon ? Un groupe de femmes vêtues d’un poncho de pluie force une porte et se précipite dans la pénombre, leurs lampes torches balayant la salle. Une dizaine d’enfants terrorisées entrent à leur tour, accompagnées de leur professeure de danse. Plus tard, ce sont des adolescentes trempées après une baignade à la base de loisirs qui surgissent, hagardes. Trente fillettes, jeunes filles et femmes vont trouver refuge dans cet antre délabré que constitue un vieux théâtre à l’abandon. Ce mercredi 29 juin, au Théâtre Gérard-Philipe (TGP) de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), c’est soir de répétition avant la générale et les trois soirées où va se jouer Fille(s) de, la nouvelle pièce de Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan. Durant une heure et demie, une trentaine d’adultes ou en devenir vont se raconter, tisser des liens, se reconnaître, malgré les différences d’âge : sur scène comme dans leur quotidien, des femmes dans un monde masculin, filles de mères aussi, certaines déracinées de leur propre histoire. Les deux metteuses en scène cadrent le jeu, reprennent une tirade. La troupe concentrée, en dépit de la journée de travail ou d’école, écoute et reprend. Entre petites et grandes, la complicité est visible. Projet expérimental La pièce est d’abord le fruit de la rencontre de ces trois groupes constitués pour un projet expérimental. Dans la vraie vie, enfants comme adultes sont d’abord des habitantes de Saint-Denis, banlieue populaire du nord de l’Ile-de-France. La directrice du TGP voulait recruter des amatrices issues du tissu associatif ou des maisons de quartier : « L’idée était d’être entre femmes – parce que le féminin induit un travail sur l’émancipation –, en laissant chacune partir de son histoire », explique Julie Deliquet. Des heures d’improvisation, d’écriture en groupe générationnel, de répétitions et, au final, un texte touchant et vivant réécrit par Leïla Anis. Dans ce récit de femmes mues par une envie d’être vivantes, on reconnaît les intonations de Debout les femmes ! (2021), le documentaire de François Ruffin (député LFI) et Gilles Perret. Ou encore des témoignages du film A la vie (2021), d’Aude Pépin. Chacune raconte son quotidien de labeur – les passages sur le sort des soignantes dans un hôpital à bout de souffle sont particulièrement criants de vérité –, ses défaites et ses petites victoires sur la vie. L’émotion est là, très présente quand Merbouha, la lingère, casquette à l’envers sur la tête, raconte la première femme aimée et la folle douceur éprouvée ; ou quand la jeune Soumaya décrit les sévices que, toute son enfance, sa mère lui a fait subir, avant qu’elle ne décide de s’enfuir. Derrière ces histoires, on sent les vécus de certaines jeunes actrices, et cela sonne juste. On assiste peu à peu, avec ce texte, tel un puzzle qui se met en place, à un croisement d’émotions, de peurs et de désirs s’exprimant face à l’inconnu des plus jeunes quand les plus vieilles consolent et encouragent. Mais, peu à peu, l’espoir surgit et s’installe dans cette sororité improvisée. Comme quand cette mère dit les mots de soutien que Soumaya n’a jamais entendus : « Je te promets d’être là si tu tombes, si tu te sens tomber et que tu as besoin que je te donne la main, si tu as besoin que je te regarde avancer sans dire un mot. » La mise en scène de ces moments de résilience est tout en épure. Le jeu de lumières colorées ou tamisées caresse les costumes – blouse blanche des infirmières, volants des petites danseuses ou serviette des adolescentes. Le résultat est plutôt bluffant pour une troupe amatrice. « Fille(s) de », création mise en scène par Julie Deliquet et Lorraine de Sagazan, écriture collective avec la collaboration de Leïla Anis. Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules-Guesde, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Du 1er au 3 juillet. Tarif 7 euros. Tgp.theatregerardphilipe.com Sylvia Zappi
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 9, 2022 3:19 PM
|
Brook : trois documentaires à voir en ligne
Sur la page Facebook de Jean-Gabriel Carasso (ANRAT) Disparition de Peter Brook, et c'est une déferlante de commentaires et de souvenirs !
Nous avions filmé et diffusé (à l'époque en VHS) les trois jours passés avec lui et des enseignants en 1991, dans le cadre de la préparation du premier bac "théâtre".
Ces films ne sont plus diffusés.
Vous pouvez voir et entendre ces documents en trois parties (de 20 minutes chacune), ici :
- "de l’espace vide au théâtre sacré"
https://ahp.li/cab59c22500a992f69c3.mp4
- "l’acteur, son corps, sa sensibilité"
https://ahp.li/79a3cb9b5f3aa38b8bdd.mp4
- "l’auteur, le texte, la forme"
https://ahp.li/b5014241142b2b526221.mp4

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2022 10:45 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 6 juillet 2022
La comédienne et metteuse en scène assemble trois de ses seules-en-scène dans un spectacle. Une expérience hors norme de quatre heures et trente minutes, qu’elle présente dans le « off ». Habituellement, les épopées théâtrales sont l’apanage du festival « in » d’Avignon. Dans le « off », vaste « marché » du spectacle vivant, les contraintes horaires et financières limitent grandement la durée des spectacles. Mais voici qu’à contre-courant du rythme effréné de la programmation de cette foire avignonnaise – 1 570 spectacles dans 138 lieux pour cette 56e édition du « off » –, Elise Noiraud se lance dans une expérience hors norme : proposer quatre heures et trente minutes de comédie humaine, soit l’intégrale Elise. Cet assemblage de trois formidables seule-en-scène autofictionnels (La Banane américaine, Pour que tu m’aimes encore, Le Champ des possibles) compose autant de chapitres de vie racontant les aventures d’une enfant, adolescente et jeune fille à 9, 13 et 19 ans. « Je vais faire du “in” dans le “off” », résume, dans un éclat de rire, cette comédienne et metteuse en scène âgée de 39 ans. Habituée de ce rendez-vous festivalier, elle redoutait que ce soit « ingérable » de présenter cette trilogie. Mais après les quelques représentations qu’elle a données en décembre 2021 au Théâtre du Rond-Point à Paris, elle a appelé le Théâtre Transversal et ce fut oui. Laetitia Mazzoleni, directrice de cette petite scène permanente avignonnaise (deux salles de cinquante et quarante places nichées au cœur des remparts) n’a pas hésité une seconde : « Je ne réfléchis pas en fonction de créneaux horaires, le formatage des durées de spectacle dans le “off”, ça me terrifie. » Il faut dire que les deux femmes ont appris à se connaître et ont vécu de belles aventures ensemble. Depuis 2016, Elise Noiraud a présenté dans ce lieu chacun de ses seule-en-scène et, en 2019, Le Champ des possibles s’est joué à guichets fermés dès les premiers jours du festival. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Festival d’Avignon : le bouleversant récit d’émancipation d’Elise Noiraud « Cette trilogie, c’est un pari, reconnaît la directrice. Beaucoup de confrères avignonnais m’ont demandé : ”mais financièrement, comment tu fais ?” J’ai de grandes discussions avec mon banquier et mon comptable, je lutte très fort ! » Egalement comédienne, metteuse en scène et responsable de compagnie, elle n’a « pas besoin de [se] sortir un salaire de directrice », précise-t-elle. « Cette expérience hors format peut être attirante pour le public », espère Elise Noiraud. Le spectacle se jouera de 20 h 15 à 0 h 45 (avec entractes) cinq jours sur sept. Les deux jours de relâche, elle les consacrera à son enfant, né pendant le confinement. « La foire d’exposition » La comédienne se prépare à cette traversée comme une sportive de course de fond. Le « off » d’Avignon, sa profusion artistique, sa débauche d’affiches, sa concurrence acharnée, elle connaît bien. Dix ans qu’elle y participe, que ce soit en solo, dans des pièces (Italienne scène et orchestre de Jean-François Sivadier, Un démocrate de Julie Timmerman) ou pour ses mises en scène (Les Fils de la terre). Sans jamais de mauvais souvenirs. « Je fais partie de ceux qui adorent ce festival, je le vis joyeusement », assure-t-elle, même si elle considère que ce rendez-vous relève davantage de « la foire d’exposition ». Mais « faire Avignon », comme le disent les milliers d’artistes qui s’y pressent, reste incontournable. « Tout le monde est là, c’est LE moment pour présenter son travail, échanger avec des professionnels, obtenir des contrats. » « Tout ce qui arrive au personnage d’Elise m’est arrivé. Tout est inspiré de la vérité mais ce n’est pas un pacte avec la vérité, il faut accepter la subjectivité des souvenirs » Sans Avignon en 2019, Elise Noiraud n’aurait pas décroché le Théâtre du Rond-Point et de nombreuses dates de tournée en France. « Le “off” peut faire décoller un spectacle », constate-t-elle. Et peu importe la taille de la salle. « Mieux vaut être plein dans un lieu de 50 places qu’être à demi-jauge dans une grande salle. » Elise Noiraud se définit comme une enfant de l’action culturelle. « Sans la rencontre du théâtre à l’école, rien ne serait arrivé », résume cette jeune femme qui a grandi à La Mothe-Saint-Héray, petit village des Deux-Sèvres, entre une mère enseignante et un père comptable. C’est grâce à un atelier théâtre au lycée que son champ des possibles s’est élargi. Et grâce aussi à la découverte d’un spectacle de Philippe Caubère à la Scène nationale de Niort. « Ce fut un choc. Je me suis dit : d’accord, donc on peut faire ça. » « Ça », c’est oser l’autobiographie face au public. Ou plutôt, préfère-t-elle, l’autofiction. « Tout ce qui arrive au personnage d’Elise m’est arrivé. Tout est inspiré de la vérité, mais ce n’est pas un pacte avec la vérité, il faut accepter la subjectivité des souvenirs. » Une aisance bluffante Cette aventure de l’introspection, elle l’a choisie parce qu’elle se dit « habitée par [son] enfance et [ses] rapports familiaux ». Notamment avec sa mère : « C’est l’endroit cardinal de ma vie, comme sans doute pour beaucoup de monde. » Quand l’intime est traité avec sincérité il en devient universel. Voir Elise Noiraud raconter les joies de l’enfance, les émois de l’adolescence, les questionnements du début de l’âge adulte, renvoie chaque spectateur à son propre itinéraire. Dans ce périple intérieur à la fois drolatique et bouleversant, la comédienne passe, avec une aisance bluffante, d’un personnage à l’autre, croquant avec autodérision et un sens aigu de la rupture ceux et celles qui ont participé à sa construction, sa mère, évidemment, en tête. « La question du milieu d’origine, du transfuge de classe m’intéresse énormément » Pour parvenir à bâtir ce récit d’émancipation, Elise Noiraud, formée aux Ateliers du Sudden, à Paris, et à l’université (licence de lettres modernes), a repris des études pour « combler des manques ». Elle a mené un mémoire de recherche sur le traitement de la parole familiale dans les œuvres théâtrales, notamment dans celles de Philippe Caubère et Guillaume Gallienne. En 2018, elle a créé sa compagnie (Compagnie 28) basée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Parce qu’elle n’oublie pas d’où elle vient et ce que l’école lui a apporté, elle développe des projets d’éducation artistique et culturelle auprès de collégiens du département et boucle actuellement le projet d’adaptation théâtrale du film de Laurent Cantet, Ressources humaines (1999), avec sept comédiens. « La question du milieu d’origine, du transfuge de classe m’intéresse énormément. » Déjà, en 2018, sa pièce en forme de tragédie rurale Les Fils de la terre, tirée du documentaire d’Edouard Bergeon, mêlait famille et enjeux sociaux en décrivant avec force le drame de Sébastien, jeune agriculteur ayant repris l’exploitation familiale et croulant sous les dettes. Pour la trilogie Elise, la comédienne a travaillé sous le regard de son conjoint, monteur cinéma : « Il m’a aidée à couper, à trouver la dramaturgie, à “faire récit”. » Et le tout est si bien écrit que l’histoire d’Elise a fait l’objet d’un livre, publié aux éditions Actes Sud. « Ils m’ont contactée après le succès du “Champ des possibles”. » « Quel luxe inouï d’avoir eu ce projet textuel et la possibilité de la trilogie », se réjouit-elle encore. Pour cette intégrale avignonnaise, elle a troqué les photos d’enfance et d’adolescence de ses précédentes affiches contre un portrait d’elle contemporain. Parce qu’Elise, la trilogie, c’est le retour sur un parcours. Un parcours de travail et un parcours tout court. Elise, trilogie seule-en-scène, de et avec Elise Noiraud, collaboration artistique Baptiste Ribrault, du 7 au 26 juillet à 20 h 15 au Théâtre Transversal, à Avignon. Durée : 4 h 30. Sandrine Blanchard Légende photo : Elise Noiraud dans son seule-en-scène « Elise, la trilogie », à Parthenay (Deux-Sèvres), lors du festival Ah ?, le 14 mai 2022. STÉPHANE RIBRAULT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 8, 2022 9:17 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - 8 juillet 2022 Évacuer la parole des représentations : c’est le parti pris plusieurs spectacles de cette édition, qui privilégient la force visuelle et les sons. Exemple en trois pièces : “Flesh”, “Milk” et “Sans tambour”. Quand le théâtre s’affranchit des mots pour faire place aux images, le dialogue silencieux qui se trame entre le public et le spectacle change de nature. Il se fait plus sensitif et plus intuitif. Au Festival d’Avignon, certains metteurs en scène évacuent la parole de leurs représentations. Ils lui préfèrent les récits pris en charge par la musique ou le corps des acteurs. Ils font confiance à la force visuelle pour bousculer les perceptions, s’en remettent aux sons pour troubler les écoutes et placent ainsi chacun dans un état de vigilance accrue. “Flesh” : de l’ordinaire vers le fantastique « Amputer le langage permet de vivre une expérience plus viscérale que raisonnée », affirme Sophie Linsmaux, conceptrice avec Aurelio Mergola de Flesh, une traversée du quotidien qui, en quatre séquences de vie, bascule de l’ordinaire vers le fantastique. Les comédiens mutiques ne s’adonnent pourtant pas à de la pantomime. « Nous cherchons à être au plus près de ce qu’on voit lorsqu’on regarde les gens dans la rue. » En transposant le réel dans l’espace-temps de sa fiction, Sophie Linsmaux traque l’invisible sous le visible. « Nous reprenons la main sur des images qui nous échappent et dont nous subissons la surconsommation. » “Milk” : célébrer la douleur des femmes Pour le Palestinien Bashar Murkus, directeur artistique de l’ensemble Khashabi (également palestinien), c’est « la langue qui peut parfois se transformer en cage » en réduisant et enfermant le sens dans l’identité, la culture ou l’histoire d’un peuple. « Lorsque la langue parlée s’estompe, elle fait place à un langage plus libre. » L’auteur-metteur en scène de Milk célèbre la douleur des femmes dans une performance où le temps se scinde en deux après une catastrophe. Dans la faille qui sépare l’avant de l’après apparaissent des corps meurtris. Chair, sang, mannequins médicaux auscultés : le drame bascule du noir au blanc sans qu’une phrase soit prononcée. « Les personnages sont incapables de parler après le drame. Ils ne trouvent rien à dire. Ils ont perdu leur bouche, au sens figuré ou au sens littéral. » “Sans tambour” : désosser la musique Auteur et metteur en scène de Sans tambour, Samuel Achache démarre pour sa part son spectacle par un double effondrement : celui d’une maison et celui d’une musique (les lieder de Robert Schumann). Une façon radicale de faire table rase pour observer les rebonds qui surgissent du néant. L’artiste qui dit vouloir « désosser la musique » pour « savoir de quoi elle est faite » dirige une dizaine d’interprètes sur scène. Tous musiciens, acteurs, chanteurs. Ensemble et sans filet, ils édifient une partition audacieuse. « Les lieder nous obligent à nous déplacer, nous devons prendre la composition de Schumann et l’amener ailleurs, l’utiliser comme une matière, la décomposer, voir, une fois qu’elle est mise à nue, comment la rebâtir. » Les mots qui se font entendre sont traités « comme de la musique ». Pour Samuel Achache, s’il ne devait rester qu’un son, à l’ultime fin du monde, ce serait une note. « Elle est pour moi toujours plus satisfaisante qu’un mot », conclut cet architecte des croches, des double croches, des bémols ou des dièses. Joëlle Gayot / Télérama Flesh, conception et mise en scène Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola, gymnase du lycée Mistral, du 18 au 25 juillet à 18h, relâche le 21. Milk, conception et mise en scène Bashar Murkus, l’autre scène du Grand Avignon, Vedène, du 10 au 16 juillet à 15h, relâche le 13 juillet. Sans tambour, conception et mise en scène Samuel Achache, cloître des Carmes, du 7 au 13 juillet à 22h, relâche le 10.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2022 12:05 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 7 juillet 2022 Pour son premier passage à Avignon, le danseur a conçu un spectacle à la chorégraphie très dessinée, inspirée par l’œuvre de Claude Monet.
Sa longue silhouette découpée dans la tranquillité a rayonné durant quinze ans auprès de l’artiste allemand Raimund Hoghe (1949-2021). « Il m’a appris l’écoute, à aller à l’essentiel et à poursuivre les choses telles qu’on a envie de les faire », glisse Emmanuel Eggermont. A la scène comme à la ville, le danseur et chorégraphe semble naviguer dans une bulle de sérénité et d’élégance. A l’affiche pour la première fois du Festival d’Avignon avec All Over Nymphéas, pour cinq interprètes dont lui-même, qu’il a dédié à Hoghe, il a déjà une bonne dizaine de pièces et de performances derrière lui. A la tête de la compagnie L’Anthracite depuis 2007 – le nom est un hommage au minerai de son Nord natal et à la chanson de Gainsbourg –, Eggermont, 41 ans, raffine un geste rare entre danse et arts plastiques. Concepteur de ses scénographies, il y incruste une danse très dessinée. Paradoxalement, aussi précise soit apparemment son écriture, celui qui fouille d’abord la matière et la texture du geste comme on malaxe une pâte aime la transformer en direct sur un plateau. « Je veux être dans le concret et le présent, déclare-t-il. Beaucoup de matériaux que je crée en studio apparaissent ensuite pendant la représentation comme des réminiscences que j’accueille au milieu d’un canevas très écrit. Il y a le désir d’une acceptation de soi comme on est, dans la sincérité, à un moment précis. » Culture coréenne Emmanuel Eggermont parle avec autant de soin qu’il met en scène ses images spectaculaires, hautement singulières. Sa trajectoire, riche, explique en partie ses partis pris. Né à Lille, il commence par la danse classique à l’âge de 5 ans, découvre le contemporain à 12 ans à l’école du Ballet du Nord, puis intègre le Centre national de danse contemporaine d’Angers en 1998. Deux ans après, il fait ses premiers pas d’interprète dans la compagnie de l’Espagnole Carmen Werner, personnalité de la scène contemporaine ibérique, et tourne dans le monde entier. En 2001, il s’envole pour Séoul (Corée du Sud) pour donner un atelier d’un mois. Il y reste deux ans et plonge dans la culture coréenne qui, elle aussi, le pousse à resserrer son geste à l’essence. Il y développe aussi son goût pour l’architecture et pour l’environnement. « J’aime aller au-delà du théâtre, dans les musées, les galeries, dit-il. Je me pose toujours la question : quel est le bon spectacle pour le bon endroit ? » C’est au gymnase du lycée Saint-Joseph qu’il installera All Over Nymphéas. « Il y a des lieux superbes en extérieur à Avignon, mais je tenais à être à l’intérieur pour déployer la scénographie », précise-t-il. Après avoir œuvré sur le noir dans Polis (2017), sous influence du peintre Pierre Soulages, sur la perception des couleurs pour le spectacle jeune public La Méthode des phosphènes (2019), puis sur le blanc dans le solo Aberration (2020), Emmanuel Eggermont change encore une fois de palette. « Monet a été un choc pour moi, poursuit-il. J’avais 10 ans lorsque j’ai vu pour la première fois son œuvre Le Parlement de Londres. » Cette fascination longue durée s’épanouit dans ce nouvel opus autour du motif repris à l’infini par le peintre. « Décliner sur plus de deux cent cinquante toiles son bassin de Giverny est incroyable, commente-t-il. Monet a inventé la série en passant de la figuration à l’abstraction. Quant à moi, je conçois ce spectacle comme un jardin en transformation constante. » All Over Nymphéas, d’Emmanuel Eggermont. Gymnase du lycée Saint-Joseph, du 8 au 13 juillet à 15 heures. Durée : 1 h 20. Festival-avignon.com Rosita Boisseau Légende photo : Emmanuel Eggermont, à Lyon, en 2020. JIHYÉ JUNG

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2022 5:11 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 6 juillet 2022 Le metteur en scène et scénographe prendra ses fonctions en juillet à la direction de la salle parisienne d’avant-garde.
La Ménagerie de verre, haut lieu de fabrication de spectacles et baromètre des tendances depuis le début des années 1980, a trouvé son nouveau patron. C’est le metteur en scène et scénographe Philippe Quesne qui succédera à Marie-Thérèse Allier (1931-2022), fondatrice du lieu qu’elle dirigea avec force et fougue jusqu’à sa mort en mars. Il a été choisi par le Fonds de dotation Marie-Thérèse Allier pour l’art contemporain, composé de cinq personnalités du spectacle vivant, mis en place par l’ancienne directrice pour perpétuer son projet. « Mais nous parlions depuis un an environ avec Marie-Thérèse de la possibilité de lui succéder, précise Philippe Quesne. Nous évoquions une sorte de passation artisanale, un tuilage en quelque sorte pour fêter les 40 ans de la Ménagerie en 2023. Malheureusement, les choses ont été plus rapides que prévu. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La mort de Marie-Thérèse Allier, directrice de la Ménagerie de verre A partir de juillet, l’ancien directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers de 2014 à 2020, créateur de plus d’une vingtaine de pièces, s’installera donc dans les locaux de l’ancienne imprimerie du 11e arrondissement, devenue une plate-forme de studios pour les têtes chercheuses de tous poils. « C’est un lieu de travail exceptionnel, de pratique et d’entraînement pour les danseurs, mais aussi un laboratoire de recherche, où de nombreux artistes, émergents et confirmés, se croisent », poursuit Quesne qui connaît le lieu comme sa poche. « Je l’ai d’abord fréquenté en tant que spectateur dans les années 1990 car j’habitais en face, ajoute-t-il. Puis, Marie-Thérèse a découvert mon travail de metteur en scène en 2003, à Dijon, m’a invité dans la foulée et m’a soutenu pendant des années. Notre amitié date de vingt ans. » Science-fiction du quotidien Son premier opus, La Démangeaison des ailes (2003), autour des thèmes de l’envol et de la chute, y fut présenté. Comme un manifeste qui ne disait pas totalement son nom, on y trouvait déjà quelques éléments qui allaient devenir la signature de Quesne. L’apparente simplicité du propos, plus proche d’un raout entre quatre copains buveurs de bière que d’une pièce de théâtre au sens classique du terme, rappelait que l’art doit compter sur la vie pour rester frais et qu’il s’invente à partir de rien. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Gaëtan Vourc’h, comédien sur le fil du rêve Tout aussi étrange, La Mélancolie des dragons (2008) piégeait une bande de potes hard-rockeurs dans une voiture en panne sous la neige. Best-seller de Quesne, L’Effet de Serge (2007), dans l’interprétation de Gaëtan Vourc’h, dépliait comme un papier de soie la soirée du dimanche d’un gars qui se demande comment habiter sa vie en jouant au ping-pong avec lui-même. Plus disjoncté mais parfaitement maîtrisé, Farm Fatale (2019) faisait criser cinq épouvantails-survivants de l’apocalypse sur des bottes de foin. Le théâtre de Philippe Quesne, « sans conflit, doux et bienveillant, plein d’attention pour ses personnages » selon la définition de Gaëtan Vourc’h, tourne aujourd’hui à l’international Ce théâtre « sans conflit, doux et bienveillant, plein d’attention pour ses personnages » selon la définition de Gaëtan Vourc’h, tourne aujourd’hui à l’international. Il compte sur le talent d’une bande de comédiens-amis dédiés à cet univers unique façon science-fiction du quotidien revu par un esprit follement extravagant. « Je vais continuer à concevoir mes pièces en dehors de la Ménagerie, explique Quesne. De mon passage par Nanterre-Amandiers, j’ai appris à être attentif aux autres artistes et c’est toujours très stimulant de rencontrer des metteurs en scène, des chorégraphes et des plasticiens. Je vais continuer, comme Marie-Thérèse le faisait, à être disponible pour réagir vite et dans la spontanéité aux propositions des uns et des autres. » Avec une écoute particulière pour la danse, le travail du corps et les arts visuels, Philippe Quesne, dont la nouvelle pièce, Fantasmagoria, sera à l’affiche du Festival d’automne, à Paris, prend le relais. Il entend conserver les deux rendez-vous majeurs de la Ménagerie de verre : Les Inaccoutumés, annoncés du 17 octobre au 5 novembre, et Etrange Cargo, programmé au printemps. Avant de mourir, Marie-Thérèse Allier avait invité le cinéaste Jean-Luc Godard, pour l’exposition « Eloge de l’image », du 22 novembre au 16 décembre, parcours à travers ses films récents installé dans toute la Ménagerie de verre. Rosita Boisseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2022 7:26 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Télérama - 4 juillet 2022 Le metteur en scène britannique est mort samedi à 97 ans à Paris. Très vite, il avait banni le décor, faisant du dépouillement et de la simplicité ses marques de fabrique. Peter Brook, 97 ans, est mort samedi 2 juillet. Jusqu’en avril dernier, avec Tempest Project, il offrait au public des Bouffes du Nord, autour d’une Tempête de Shakespeare en raccourci, un de ses spectacles les plus lumineux, les plus drôles, les plus chaleureux. Jusqu’au bout il alla chercher chez l’illustre compatriote William — qu’il servit tout au long de sa carrière — de quoi réfléchir à la liberté, au pardon, à la rédemption. Peter Brook aimait à rendre ses spectateurs meilleurs. Plus intelligents. Plus humains. Un homme-théâtre. En 2019 encore, à 94 ans, ce grand théoricien de l’espace vide, apôtre d’une scène multiculturelle et architecte de représentations intensément fraternelles, proposait dans Why? une magistrale leçon de jeu, assortie d’une évocation du Russe Meyerhold, tué en 1940 à l’âge de 66 ans sur ordre de Staline. Inventeur de la biomécanique, celui-ci avait révolutionné la mise en scène en substituant à la psychologie l’énergie des corps articulés entre eux. Dans Why?, trois comédiens se passaient le relais d’un récit oscillant entre narration et adresse directe. Leurs mots n’avaient pas besoin de décor. Seule comptait leur osmose. La méthode Peter Brook. Depuis des décennies, il avait pris le parti de circuler en souplesse dans les textes, ne se fiant qu’aux paroles des auteurs et à l’incarnation des acteurs pour déclencher une avalanche de visions dans la tête du public. Pourquoi consacrer sa vie au théâtre ? La superbe réponse de Peter Brook Né le 21 mars 1925 à Londres, Peter Brook, père d’Irina (metteuse en scène) et de Simon (documentariste), est devenu, à force de travail, un maître du dépouillement et de la simplicité. Attiré, à l’orée de sa carrière, par les aventures avant-gardistes, le Britannique franchit d’un bond les frontières qui cloisonnent les disciplines. Dès 1942, il crée, à un rythme soutenu, des pièces de Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Jean Anouilh, Arthur Miller, Jean Genet ou Peter Weiss. Et ne cesse de revenir vers Shakespeare, inépuisable source de savoir et d’inspiration. Il alterne théâtre et opéra (un genre où il excelle) et s’empare très tôt de la caméra pour se muer en cinéaste. Il adapte, en 1953, Le Roi Lear, de Shakespeare, pour un film avec Orson Welles dans le rôle-titre. Puis, en 1960, sort Moderato cantabile, d’après le roman de Marguerite Duras, avec deux jeunes stars françaises, Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. Le plateau, l’espace-temps de la nudité, de l’immédiateté et de la vérité En 1962, avec la troupe de la Royal Shakespeare Company, il monte un Shakespeare de plus (Le Roi Lear). Et renonce définitivement au décor. Ce rénovateur assumé nettoie le plateau de ses oripeaux pour en faire l’espace-temps de la nudité, de l’immédiateté et de la vérité. Dans un livre fondateur, L’Espace vide (publié au Seuil en 1977), il théorise ses positions. Pour ne pas mourir, le théâtre doit se repenser en permanence, les formes se réinventer à chaque seconde, l’acteur puiser dans le visible et l’invisible. Il écrit : « Le théâtre est un art autodestructeur. Il est écrit sur le sable […]. L’instrument du théâtre, c’est la chair et le sang du comédien. » Issu d’une lignée de maîtres allant du Russe Constantin Stanislavski (1863-1938) au Français Antonin Artaud (1896-1948), Peter Brook plaide pour un théâtre brut où, rappelle-t-il, « on tape sur un seau pour évoquer une bataille, on se sert de farine pour évoquer la pâleur d’un visage effrayé ». À la surcharge des intentions, au surlignage des émotions, il préfère l’économie des signes et ressuscite une forme d’artisanat. Il affirme : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé. » Ces derniers mots sont étroitement associés à l’arène chaleureuse d’un théâtre nommé les Bouffes du Nord et situé dans le nord de Paris. En 1971, Peter Brook et sa partenaire, la productrice Micheline Rozan, poussent la porte d’un immeuble situé dans le quartier de la Chapelle. Ils découvrent, ceinte de hauts murs consumés par un vieil incendie, une magnifique salle à l’italienne. Dans cet écrin qui porte toujours les stigmates du feu, l’artiste installe le Centre international de recherche théâtrale (Cirt), qu’il vient tout juste de fonder. L’endroit est un laboratoire où il expérimente les possibles du jeu et de la représentation. “Peter Brook, sur un fil”, la parentèle enchantée C’est avec Timon d’Athènes, de Shakespeare, en 1974, qu’il ouvre au public les portes du 37 bis, boulevard de la Chapelle. Aux côtés de François Marthouret prend place Maurice Bénichou (qui cosignera avec l’artiste en 1981 une fabuleuse Cerisaie de Tchekhov), ainsi que Bruce Myers, comédien britannique et fidèle complice. Sur les tapis des Bouffes viennent travailler, au fil des ans, des acteurs étrangers, issus de cultures lointaines, porteurs de leurs propres rituels. Marqué par d’anciens voyages en Orient et en Afrique, le maître des lieux, bien avant que résonne l’appel à plus de diversité sur les plateaux français, pratique un théâtre multiculturel. Le Japonais Yoshi Oïda et le Malien Sotigui Kouyaté deviendront ainsi des piliers de sa troupe. Ainsi que l’écrivain Jean-Claude Carrière, dont le talent d’adaptateur va éclater en 1985. L’adaptation du “Mahabharata”, son chef-d’œuvre de neuf heures 1985 est une date phare dans le parcours de Peter Brook. Cette année-là, il concrétise un projet qu’il porte depuis dix ans. Il met en scène au Festival d’Avignon l’adaptation du Mahabharata, livre sacré de l’hindouisme, long de deux cent cinquante mille vers. Dans la Carrière de Boulbon, le spectateur assiste à une épopée de neuf heures qui retrace les origines de l’humanité. Sous les étoiles, une trentaine d’interprètes internationaux, parmi lesquels des musiciens, déploient cet exceptionnel récit dans une ambiance de pierre calcaire, d’eau et de feu. Cette création phénoménale, entrée dans la légende, fera par la suite l’objet d’une adaptation cinématographique par le metteur en scène. Peter Brook réadapte magistralement son premier chef-d'œuvre L’ampleur du Mahabharata ne doit pas faire oublier que l’artiste ciselait avec une concentration identique des spectacles plus modestes. Creusant au gré des créations la piste des dérèglements humains (L’Homme qui, d’après un texte d’Oliver Sacks, en 1993), celle de la monstruosité tapie en chacun de nous (Le Grand Inquisiteur, d’après Dostoïevski, en 2004) ou encore celle de l’inquiétante étrangeté des vies ordinaires (The Suit, de Can Themba, en 2012), Peter Brook a semé derrière lui de scintillants cailloux. Sans jamais déroger à la sobriété de la forme, il a révélé au public les multiples strates imaginaires qui s’agitent sous l’opacité du réel. Il lui a indiqué le chemin pour accéder à l’intériorité. Il l’a fait sans tapage, mais avec entêtement, d’un geste gracieux et généreux. Avec lui, le théâtre a pu réconcilier le concret et le spirituel, connecter l’homme à ses aspirations métaphysiques. Grâce à lui, nous savons désormais que le vide est un plein. Joëlle Gayot /Télérama Légende photo : Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, en février 2018. LIONEL BONAVENTURE / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2022 11:18 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération 3 juillet 2022 Ayant débuté avec le metteur en scène britannique ou admiratives de son œuvre, des personnalités de la scène évoquent la mémoire d’un génie avant-gardiste en quête de formes libres. par Anne Diatkine publié le 3 juillet 2022 à 19h49 «Pas un soir où l’on ne pleurait tant le public applaudissait», Anne Consigny, interprète d’Ania dans «la Cerisaie» d’Anton Tchekhov (1981) «Je me souviens qu’on répétait douze heures par jour, mais qu’on consacrait le trois-quart des répétitions à des jeux d’enfants comme la chandelle et ce, jusqu’au dernier jour. Je comprenais très bien qu’il s’agissait de nous mettre tous au même niveau, de nous faire oublier et l’expérience, et la hiérarchie, et l’autorité, par de simples gestes : se saluer en se serrant la main le plus vite possible, par exemple. Pour moi, qui n’était personne et qui avait si peu d’expérience, c’était extraordinaire. Etre une débutante n’était plus un signe de quoi que ce soit. Je me souviens que, trois semaines avant la première, Peter Brook a commencé à faire venir dans la salle des publics étranges ou inhabituels. Il nous a fait répéter devant toute une salle de non-voyants, par exemple, ou encore avait invité tous les commerçants de son quartier. Toujours trois semaines avant la première, il nous avait fait jouer dans le gymnase d’une école devant des enfants, si bien qu’on perdait tous nos repères. On avait plus de coulisses, la mise en scène telle qu’on la connaissait n’existait plus. Nous, on pensait que le spectacle ne serait jamais prêt, ne serait jamais fixé. Le jour de la première, on était au café, on a vu des gens dans une file d’attente, et on était sidérés. Que faisaient-ils ? Quand on s’est mis à jouer, il n’y a pas un soir où l’on ne pleurait pas tant le public applaudissait, tapait du pied, on pensait qu’il allait casser le théâtre. On était surpris à chaque représentation par son émotion. Je me souviens que la veille de la première, Niels Arestrup avait demandé à Peter : «Vous pensez que ça va marcher ?» Peter avait répondu : «Je n’en sais rien, mais en tout cas, ce sera de votre faute.» Ça m’est resté. Il pensait qu’il n’y avait jamais de mauvais public, que les acteurs étaient entièrement responsables de la représentation. Je me souviens de l’Espace vide, son essai, et de comment il nous mettait dans l’espace vide pour laisser la place à l’imagination. Le décor de la Cerisaie, c’était juste un tapis, un tapis roulé ou un tapis qui tombe. Pour nous tous, ça a été notre plus grande émotion théâtrale. Robert Murzeau, qui était un très vieil acteur et qui jouait Firs, m’avait dit : «Tu n’as pas de chance, toi. Parce que comme tu commences ta vie d’actrice avec Firs, tu seras toujours déçue.» Je n’ai pas été toujours déçue, mais il avait raison : une telle expérience ne s’est jamais retrouvée. Une dernière fois, juste avant le confinement, presque quarante ans après cette première, on a dîné tous ensemble, avec Peter. Il était notre unique.» «Il avait un génie particulier pour dénicher ce qu’il y a de plus vivant en chacun de nous», François Marthouret, rôle-titre dans «Timon d’Athènes» de Shakespeare (1973) «La toute première rencontre a été en coulisse. J’avais 19 ans et je voyais pour la troisième fois le Roi Lear que Peter mettait en scène en anglais avec la troupe de la Royal Shakespeare Company. J’étais tellement bouleversé que je m’étais glissé dans les coulisses et, quand j’avais vu sa silhouette, je m’étais précipité sur lui pour l’embrasser. Je me suis enfui avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit. «La deuxième rencontre a été en 1970, lorsqu’il a constitué sa troupe d’acteurs du monde entier. Le travail était intense et ouvert, il nous plongeait dans le théâtre comme un artisan engagé. Il avait un génie particulier pour dénicher ce qu’il y a de plus vivant et de plus mystérieux en chacun de nous, grâce à des exercices qui nous poussait vers la plus grande sincérité. Pour moi, Peter incarnait les deux qualités nécessaires pour que le théâtre advienne : la présence et l’imaginaire. J’ai mis plus d’un an avant d’être capable de le tutoyer. Bien sûr, la recherche était importante et elle s’étalait sur plusieurs mois, sans que l’on compte le temps. Mais il ne s’agissait pas de travailler en vase clos. Durant cette période, certains travaux étaient présentés en public, car Peter proclamait que le théâtre n’existe qu’avec ce troisième partenaire qu’est le public. On avait par exemple créé Gaspard, la pièce de Peter Handke, dans les lieux les plus improbables, aussi bien à l’Ecole polytechnique que dans des bidonvilles. C’était avant qu’il déniche avec Micheline Rozan, cette salle en ruines et abandonnée depuis des lustres, les Bouffes du Nord dont il a fait le plus beau théâtre de Paris et qu’on a ouvert avec Timon d’Athènes de Shakespeare. «La richesse et la fraternité de ce groupe, sa solidité et notre entente alors qu’on avait tous des expériences, des langues, et des vies très différentes n’ont pas cessé de m’étonner. Peter n’avait rien d’un gourou. Il n’était pas un prosélyte, n’avait aucune doctrine à nous inculquer, car lui aussi cherchait. Il savait s’y prendre pour qu’on travaille en paix dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, il avait cette intelligence et cette culture hors du commun. Mais il n’était jamais guidé par un besoin d’autorité. Son exigence était dépourvue de tyrannie, même s’il y avait une force de fer derrière sa douceur. C’était un homme plein, porté par une ouverture permanente. Jusqu’à son tout dernier souffle, Peter est un homme qui n’a jamais perdu l’enfance. Je l’aimais énormément.» «Je me souviens du visage des acteurs aux saluts», Isabelle Huppert, actrice «Le premier grand spectacle que j’ai vu dans ma vie, c’était le Songe d’une nuit d’été avec la Royal Shakespeare Company que Peter Brook présentait en tournée au Théâtre des nations [l’ancien nom du Théâtre de la ville, ndrl]. Un éblouissement. Je me souviens des saluts, du visage des acteurs aux saluts. Des visages livides. Ils avaient été au bout d’eux-mêmes. Ça m’avait beaucoup frappée. Je m’en suis souvenue longtemps et cette image me revient en force aujourd’hui. On sentait qu’ils venaient de vivre une expérience exceptionnelle. Tout comme nous… Tout comme moi…» «Sa vision du théâtre a élargi notre esprit», Marilú Marini, comédienne, «Tempest Project» (2022) «Avoir connu Peter Brook, avoir travaillé avec lui sur sa dernière mise en scène avec Marie-Hélène Estienne, Tempest Project, a été un cadeau de la vie. Il illuminait ce qu’il attendait de vous sur le plateau, mais toujours avec précision. On lui doit tellement de choses : sa vision du théâtre a élargi notre esprit. En répétitions, il était non seulement présent et actif, mais son oreille était d’une finesse extraordinaire. Il savait guider le comédien vers l’essentiel.» «Cette rigueur dans la liberté» David Geselson, acteur et metteur en scène «J’avais 20 ans et jeune étudiant au conservatoire. l’Espace vide, son essai sur le théâtre qui était déjà ancien puisqu’il est paru en 1977, était le livre qu’on lisait et relisait sans cesse. Un passage n’a pas cessé de m’habiter. C’est le moment où Peter Brook explique qu’il ne sait pas s’il va être metteur en scène. Quelqu’un lui répond : «Tu n’as pas besoin de le savoir. Décrète-le et ensuite tu le deviendras. Il n’y a aucun prérequis.» Je ne sais plus si cette petite voix est son double, mais il est certain que cette liberté et cette détermination sont comme une signature de Peter Brook, à l’œuvre dans ses plus beaux spectacles. Cette rigueur dans la liberté, sans pareil et avec légèreté.» propos recueillis par Anne Diatkine / Libération Légende photo : «Le Costume» de Mothobi Mutloatse, mise en scène de Peter Brook, en février 2012. (Victor/ArtComPress. Opale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 4, 2022 9:31 AM
|
Actualités : hommage au très shakespearien Peter Brook, dans l'émission de Frédéric Martel sur France Culture, Soft Power Ecouter l'hommage dans l'émission Soft Power sur France Culture (37 mn en début d'émission) HOMMAGE | Retour sur le parcours du dramaturge, directeur des Bouffes du Nord et figure emblématique d'une approche de la scène simple et dépouillée. Né en 1925 à Londres ans une famille ashkénaze d'origine lettone, Peter Brook s'est éteint ce matin à l'âge de 97 ans, après une vie dédiée à la création théâtrale.
Armelle Héliot revient sur les incursions au cinéma du metteur en scène (Moderato Cantabile, Sa Majesté des mouches...). Les marqueurs de son œuvre : une esthétique vers l'épure de plus en plus prégnante et un fil conducteur axé sur l'universalité, où Shakespeare avait toujours sa place.
Son héritage est sans aucun doute le goût du théâtre : des créateurs comme Peter Brook et Ariane Mnouchkine ont eu la force de créer un nouveau public, ce que Brook a pu faire dès son arrivée aux Bouffes du Nord en 1974.
Pour Emmanuel Wallon, Peter Brook incarne la figure de l'intellectuel du théâtre. Théoricien, on peut même dire qu'il vivait pour la recherche-création puisque la pratique tenait une place centrale dans sa méthode de travail. Si Shakespeare était au centre de son œuvre, il prenait tout de même soin de conserver une place libre pour l'expérimentation, qui lui a permis de se pencher sur des sujets comme l'espace vide et de s'ouvrir à des cultures théâtrales jusqu'alors lointaines - au premier rang desquelles le Nô japonais - et d'être éminemment en avance sur des thématiques comme la décolonisation.
Enfin, Bernard Faivre d'Arcier retient sa singularité. dimension cosmopolite majeure. son idée : faire travailler des acteurs de toutes les régions du monde.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 6:05 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 3 juillet 2022 Il aura vécu presque un siècle. À la suite des grands maîtres du théâtre depuis le début du XXème siècle auquel il consacra plusieurs spectacles, Peter Brook sut s’en nourrir pour tracer son chemin et être leur égal. Avec pour boussole William Shakespeare auquel il ne cessa de revenir jusqu’à ses derniers jours. Souvenirs vagabonds de cet homme-monde. PeterBrook dans ue rue d'Avignon © dr Peter Brook s’est éteint la nuit dernière. À 97 ans. Doucement, lentement. Toutes ces dernières années son corps lui faisait des signes. Ses jambes, de plus en plus faibles malgré la canne, son pas de plus en plus court, sa voix de plus en plus fluette, ses yeux qui y voyaient de moins en moins jusqu’à ne plus y voir malgré leur lueur demeurée intacte. Coûte que coûte, il revenait s’asseoir dans ce théâtre miraculé où son nom restera à jamais attaché : le théâtre des Bouffes du Nord . Un théâtre dont lui et Micheline Rozan, loin de le reconstruire et de le réhabiliter, en avaient fait une ruine d’hier et d’aujourd’hui, une scène-ressac de l’Orient, de l’Afrique et d’ailleurs, un havre pour voyageur, comme une place de village ayant trouvé son juste abri. Accompagné d’une main amie ces dernières années, il prenait place sur les gradins, toujours la même place au troisième rang du parterre, côté cour. Il écoutait plus qu’il ne voyait. Dans une attention au moment présent, lestée de souvenirs inouïs et vagabonds. Comme nous de lui. Il avait commencé par Shakespeare c’est avec lui qu’il nous a quitté nous léguant son Tempest Project. Un texte et des acteurs, un jeu entre le visible et l’invisible, l’ailleurs et l’ici, un présent habité de fantômes. Combien de fois, ce Prospero de notre temps a-t-il remis sur le métier la Tempête durant son long parcours dont Shakespeare fut comme la boussole, le talisman et la vigie. Je me souviens d’un été avignonnais à l’écart de la ville, où dans la carrière des Taillades il avait réuni comme toujours une distribution cosmopolite : le griot burkinabé Sotigui Kouyaté dans le rôle de Prospero, Bakary Sangaré dans celui d’Ariel, David Bennent en Caliban, Shantala Malhar-Shivalingappa et Romane Bohringer se relayant dans celui de Miranda. Maurice Bénichou et Marie-Hélène Estienne étaient crédités de la collaboration artistique et Jean-Claude Carrière signait l’adaptation. Peter Brook aura eu le chagrin de voir partir plus d’un de ses acteurs et collaborateurs, alors que tous étaient nés bien après lui. Un homme-siècle. D’un Prospero, l’autre, il martelait la même antienne : « les acteurs occidentaux ont en eux les qualités nécessaires pour explorer dans les pièces de Shakespeare ce qui concerne la colère, le pouvoir, la sexualité, l’introspection. Mais quand il s’agit de toucher au monde invisible, la difficulté émerge et tout bloque. Dans les cultures dites “traditionnelles”, les images de dieux, de magiciens, de sorcières sont naturelles ». Nul mieux que lui aura su faire du théâtre un art de la conversation et de la convivialité. D’un metteur en scène avec un auteur, des acteurs avec un personnage, le tout en partage complice avec le public. D’où son art de déjouer les premières et leur stress. Commencées au théâtre, les répétitions se poursuivaient dans les lycées, les places de villages. Les premières n’en étaient pas. Une pièce ne chassait pas l’autre, toutes se tricotaient. Combien de fois est-il revenu sur une pièce, des années après. Par exemple Oh les beaux jours de Beckett. Il avait monté plusieurs fois cette pièce avec succès. Une première fois avec son épouse Nastasha Parry. Chloé Obolensky, collaboratrice fidèle, avait fait un décor « qui suivait à la lettre les indications scéniques que j’ai moi-même suivies à la lettre dans la mise en scène » se souvenait-il. Des années passent. Le voici signant une version allemande de la pièce avec Miriam Goldschmidt. Et là il va plus loin : « j’ai découvert que nous pouvions lire la pièce à la table, tout en la jouant et en lisant à haute voix les indications scéniques magnifiquement écrites par l’auteur. C’était une révélation : tout trouvait sa place, et le rôle du mari, confiné habituellement dans le bas du décor, prenait une forme exceptionnelle car c’était à lui qu’incombait la tâche des magnifiques indications. Il devenait un narrateur, un personnage aussi central que sa femme. Et tout était limpide, claire touchant ». Et c’est ainsi que Brook mit en scène Happy days aux Bouffes du Nord avec Kathryn Hunter et Marcello Magni, une actrice et un acteur anglais que l’on avait pu voir dans Why ?, l’un de ses nombreux spectacles qui ne partent pas d’une pièce mais d’une recherche. Ainsi, parmi d’autres, Qui est là en 1995 et cinq ans plus tard Warum Warum où Brook et sa collaboratrice Marie-Hélène Estienne croisent et interrogent des textes signés Artaud, Brecht, Craig, Meyerhold, Stanislavski, Zeami et bien sûr, Shakespeare. Qui est là était une leçon de théâtre pleine de récréations, jamais professorale ou sentencieuse, où telle l'ombre après laquelle le chien aboie et court, la vérité du théâtre se déplace ou se dérobe quand l'acteur croit la rattraper, mais elle est là cependant, diffuse et divine, évidente et impalpable. Un voyage dans le théâtre qui dit sa halte, le chemin accompli, gigantesque et dérisoire, dans une simplicité conquise, comme on le dit des sommets difficilement accessibles, sereine et modeste à la fois. Qui est là était une méditation gaie et toujours en actes, sur les pouvoirs du théâtre à travers le prisme du metteur en scène qui, depuis son apparition il y a un siècle, en est le maître de cérémonie. Ces voix des « pionniers », Brook les ignorait quand il commença très jeune à faire du théâtre. Mais au fur et à mesure qu'il les découvrit, il ne cessa d'entretenir avec elles un dialogue permanent. Sans exclusive et sans exclusions. « Pour Artaud le théâtre est un feu ; pour Brecht, le théâtre est une clarté révélée ; pour Stanislavski, le théâtre, c'est l'humanité. Pourquoi devrions-nous choisir l'un ou l'autre ? », disait-il en 1973 dans une conversation avec Denis Bablet, reprise dans un livre - Points de suspension, Seuil - où il relate également la visite qu'il fit au vieux Gordon Craig en 1956. Ou encore, ceci, écrit en 1965: « Tout ce qu'il y a de remarquable chez Brecht, Beckett ou Artaud, se trouve dans Shakespeare. Pour qu'une idée marque, il ne suffit pas de l'énoncer; il faut qu'elle brûle dans nos mémoires. Hamlet est une idée de ce genre. » Ses « recherches théâtrales » aussi. Si Strehler ne jurait que par Copeau, si Barthes plaça le seul Brecht sur un piédestal, Brook est curieux de tous les dieux du théâtre, depuis le Ta'zieh iranien jusqu'aux danses Chhau de l'Inde, aucun homme de théâtre n'était plus curieux que lui. On sait son amitié (payée de retour) pour Jerzy Grotowski et l'importance maintes fois réaffirmée qu'il accorda à son travail. Comme, pour lui, les cultures non-occidentales, et particulièrement orientales, ne sont pas une curiosité exotique mais une mine. Avant eux, les cinq « pionniers » du théâtre occidental choisis par Brook se sont tous tournés vers ces théâtres (chinois, japonais, balinais, etc.), s'en sont nourris et ont montré le chemin. Que « chaque nouvelle génération est obligée de refaire », « pas à pas », disait Brook. Cet Orient-extrême du théâtre occidental était depuis longtemps présent dans les spectacles de Brook en la personne de l'acteur Yoshi Oida. Formé par le nô et le Bunraku, Yoshi est venu en Europe en 1968 : Brook cherchait un acteur japonais pour compléter une distribution française et anglo-saxonne afin de mener un travail sur la Tempête de Shakespeare. Rien d'étonnant donc à ce qu'au cours du travail, la voix de l'acteur et auteur japonais Zeami, vieille de cinq siècles mais portée « au présent » par celle de Yoshi Oida, vint s'ajouter à celles des « aventuriers » de la mise en scène au XXe siècle. Et puis, il y a l'Afrique. Ce continent oublié du théâtre occidental et de ses pionniers. Rares sont les hommes de théâtre comme Roger Blin et Jean-Marie Serreau à s'être penchés sur ce continent sans des bésicles héritées peu ou prou du colonialisme. Brook, venu habiter Paris en 1970, crée avec Micheline Rozan, le Cirt(Centre international de recherche théâtrale) et, le 1er décembre 1972, part avec ses acteurs en Afrique pour trois mois. Ce n'est pas une tournée bien que des séances soient ici et là improvisées , mais un temps de rencontres, de partages et de moisson devant « un public aux réactions vives et totalement ouvert aux formes », pour qui « ce que nous appelons le faux-semblant, base du théâtre, revient simplement à passer du visible à l'invisible, et réciproquement » une phrase brookienne par excellence. D'une certaine façon, Brook n'est jamais tout à fait revenu d'Afrique. Ce voyage verra son accomplissement avec l'arrivée, dans la troupe cosmopolite du Centre international, d'acteurs africains, singulièrement à partir du Mahabharata en 1985. Ce sont deux de ces acteurs, Bakary Sangaré et Sotigui Kouyaté, qui les premiers entraient en scène dans Qui est là . Bientôt l'un demandait à l'autre: « Si vous aviez à donner des conseils à un jeune homme qui veuille faire une mise en scène d'Hamlet, comment vous y prendriez-vous ? » Sotigui-Craig répond que, dans chaque scène, il montrerait « un esprit, l'esprit qui y est latent », et que dans le costume, le visage, partout et par tous les moyens, il évoquerait « la présence de ces esprits, si bien que l'apparition du spectre, loin de nous donner à rire, nous semblerait naturelle et terrible ». Et c'est ce que l'on voyait, Bakary disant les mots d'Hamlet, Sotigui ceux de son père mort le spectre, donc, après s'être paré d'une chasuble rouge (un peu plus tard, il endossera le rôle du frère de son père, son assassin et le nouvel époux de sa mère, en chemise rose un peu cow-boy et en jean noir), marchant vers nous simplement, avec une intensité qui nous foudroyait, héritée des sorciers et des griots burkinabés. Que nous disait Brook ? Que l'acteur africain dont la culture traditionnelle est encore vivante est mieux à même de jouer un spectre. C'est une réponse, ce n'est pas la réponse. La folie d'Ophélie en est une autre. « Chaque culture exprime une partie différente de notre atlas intérieur : la vérité humaine est globale, et le théâtre est le lieu où ce puzzle peut être reconstitué », déclarait-il en 1976 au New York Times. Qui est là fut une figure accomplie de ce puzzle, entre la conférence et l'oiseau, entre Craig et l'Afrique. Sans doute un des travaux les plus intimes de Peter Brook. Et le poète persan Attar, l’auteur de La conférence des oiseaux (autre spectacle mémorable) de passage au Bouffes du Nord en ami, de lui souffler : « Vous avez fait un long voyage, pour arriver au voyageur ». De même après le fabuleux Mahabharata en 1985 dans la carrière Boulbon près d’Avignon qui commençait à la nuit tombante et s‘achevait au lever du soleil, trente ans plus tard, Peter Brook, devait revenir au grand poème épique indien avec Battelefield, un spectacle beau comme une virgule, un souffle léger d’une heure quinze. Quatre acteurs entraînés dans le mouvement brookien. Tout s’achevait avec le musicien japonais Toshi Tsuchitori, compagnon de route de Peter depuis longtemps. Un seul instrument, un tambourin à la peaux circulaire comme le disque solaire. À la fin, ses mains laissaient place à deux doigts de chaque main, puis un seul, ultime clapotis et puis rien d’autre que le silence. Il y aurait tant à dire encore, tant de spectacles à évoquer. Restons-en là.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 6:42 AM
|
Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires culturelles" sur le site de France Culture 3 juillet 2022 Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. Ecouter l'entretien radiophonique sur le site de France Culture (56 mn) Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. avec : Peter Brook (Metteur en scène et réalisateur). Avec quatre-vingt-quinze printemps à son compteur, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook est assurément le doyen du théâtre moderne dont il est un protagoniste essentiel. Ancien directeur des Bouffes du Nord, il a également marqué la discipline pour son approche multiculturelle et sa quête du théâtre dans son plus simple appareil. L’explorateur n’a toutefois cessé de revenir à Shakespeare tout au long de son parcours, de ses débuts à la Royal Shakespeare Company à la parution aujourd’hui du texte de sa pièce Tempest Project, d’après Shakespeare, aux éditions Actes Sud (cocréé avec Marie-Hélène Estienne). L’occasion de revenir, en sa présence et au micro d’Arnaud Laporte, sur le parcours hors normes de Peter Brook pour en savoir plus sur ses sources d’inspirations et son processus créatif… L'artisan d'un théâtre multiculturel De Londres à Paris, en passant par l’Amérique Latine, les Etats-Unis et l’Afrique, Peter Brook n’a cessé de prendre le monde pour terrain de jeu. Dès ses débuts en tant que collaborateur avec le Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon puis directeur de production au Covent Garden de Londres, le metteur en scène jette les conventions du théâtre, le bon goût et le savoir-vivre, et propose des formes différentes, des récits inédits. Peter Brook : "Je travaille dans le West End et tout le monde, les acteurs, les critiques, pensaient que le théâtre anglais c'était le meilleur théâtre du monde. Moi, j'ai trouvé ça très bien, mais il y a une phrase de Shakespeare qui contient tout : "There is a world elsewhere". Il y a un monde ailleurs et pour moi, il faut y aller soi-même pour voir, pour découvrir, pour choisir, pour filtrer." 27 janvier 2022Écouter plus tard 1h 00 F in des années soixante, Peter Brook pose les valises dans un théâtre désaffecté derrière la Gare du Nord à Paris que lui a déniché Micheline Rozan, son agente et complice de toujours. Avant d’en faire le Théâtre des Bouffes du Nord que l’on connaît, il est d’abord le quartier général du Centre international de recherche théâtrale qu’il fonde en 1971. Avec une troupe multi-ethnique, Peter Brook écume le monde durant trois années, de l’Iran à l’Amérique du Sud, en passant surtout par l’Afrique où il découvre alors un territoire digne d’intérêt théâtral dont il va beaucoup apprendre, autant en matière de jeu d’acteur que de répertoire. Peter Brook : "Très tôt, j'étais horrifié parce que je ne pouvais pas comprendre le racisme, comment ça se faisait que pendant les vingt premières années de ma vie en Angleterre, je n'avais jamais vu sur scène un acteur noir. Là-dessus, je vais voir pour moi même en Afrique et à chaque instant, c'est une révélation." Peter Brook : "Les frontières, c'est utile jusqu'à un certain point, mais ça crée l'hostilité, la division. C'est pour ça que j'ai énormément voyagé quand j'étais très jeune. Non seulement pour le plaisir de voyager, mais pour cet esprit de recherche. Et chaque fois, à chaque voyage, je découvre quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné dans la petite vie de Londres." De retour à Paris, Peter Brook dirige le Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’en 2010. Il y déploie un théâtre pour tous, la jeunesse comme les classes populaires, toujours au service de la diversité. Pas à pas, la ruine devient un phare en matière d’expérimentation théâtrale. Shakespeare y côtoie le théâtre sud-africain. Les Bouffes du Nord furent la maison de grands acteurs et actrices et l’écrin de nombreuses œuvres de Peter Brook parmi lesquelles on peut citer le Mahabharata, une épopée sanskrite de la mythologie hindoue dont l’adaptation de Brook a marqué l’Histoire. Peter Brook : "La base de l'expérience théâtrale c'est une expérience vivante au moment même et partagée" La quête du dépouillement Peter Brook est à bien des égards l’un des artisans pionniers de la modernité théâtrale. On lui doit notamment le concept d’espace vide qu’il introduit en 1968 dans son livre du même nom. Exit le décorum, l’artifice, place aux comédiens et à leur jeu : l’austérité se fait la condition de l’invention. Au naturalisme, il préfère désormais le minimum requis pour que le théâtre advienne. Peter Brook : "On a besoin de très peu pour toucher l'imagination et quand j'allais très jeune voir des spectacles immenses et compliqués, c'était pour moi moins convaincant que ce que je pouvais faire avec mon petit théâtre chez moi, avec de très simples moyens." Peter Brook : "J'ai appris de mon père qui adorait les citations « un rien et c'est déjà trop »" Engagé dans une quête de dépouillement le plus extrême, le metteur en scène épure de plus en plus son geste. Dans Why ?, sa dernière pièce en date présentée aux Bouffes, Peter Brook s’interroge sur le sens de son art et sur la nécessité du théâtre. Comme souvent, la spiritualité y est au centre. Peter Brook : "Pour moi, la seule chose qui est vraie et qui était dans toutes mes mises en scène de cinéma et de théâtre, c'est l'immédiat. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que ça touche ou pas ?" Son actualité : Le texte de sa pièce Tempest Project (d’après Shakespeare) a paru aux éditions Actes Sud (co-créé avec Marie-Hélène Estienne). Sons diffusés pendant l'émission : - Extrait de son film “Moderato cantabile”, réalisé en 1960, d’après le livre de Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo.
- “Gracias a la vida” par Violeta Parra (1966)
- Sonate pour violon piano en la majeur (1886) de César Franck, 2ème mouvement (Allegro). Interprètes : Augustin Dumay & Maria Joao Pires.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 4:55 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 3 juillet 2022 Le metteur en scène à la carrière immense marquée par Shakespeare, théoricien d’une écriture scénique sans artifice, réduite à la quintessence du texte et quasiment sans décor, est mort à 97 ans. Sur scène, il y avait de moins en moins d’éléments. Seulement quelques tapis, parfois des coussins et des cadres pour signifier le dehors et le dedans et leur réversibilité. Cette raréfaction suffisait à Peter Brook pour nous faire voyager partout dans le monde, lui qui fut le premier, à l’orée des années 1960, à jeter les oripeaux du théâtre occidental du bon goût et du savoir-dire pour se lancer à la recherche de récits alors complètement inconnus, tel le Mahabharata, l’épopée sanskrite de la mythologie hindoue qu’il fit découvrir en neuf heures à Avignon en 1985, après une bonne dizaine d’années d’investigation. Peter Brook vient de mourir à 97 ans et avec lui, c’est une mémoire de plusieurs continents théâtraux qui s’ensevelit ou s’écroule, tant il avait fait de la recherche de toutes les formes scéniques existantes la matière même de son œuvre. La curiosité de Peter Brook n’avait aucune limite et pas plus d’interdit. Elle ne se nourrissait d’aucun goût pour l’exotisme mais d’un émerveillement inlassable de la diversité contenue dans ce mot : théâtre. Elle le poussait à se passionner autant pour le tazieh iranien que pour la danse chhau en Inde, en passant par la tradition yoruba de la possession au Nigéria, ou les théâtres afghan, japonais, balinais. Elle nécessitait des voyages de plusieurs mois avec sa troupe constituée d’acteurs du monde entier. Mais elle l’avait poussé aussi à visiter plusieurs hôpitaux psychiatriques (à Paris, notamment à la Salpêtrière, mais aussi à Miami) pour concevoir les histoires tragiques et réelles de L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, d’après le best-seller du neurologue Oliver Sacks. Sans oublier de forer le répertoire – une enlevée et sobre Cerisaie qui fit date avec Natasha Parry et Michel Piccoli en 1981, un Oh les beaux jours de Beckett, toujours avec Natasha Parry, son épouse adorée, en 1995, et tant d’autres, avec une prédilection pour le monument Shakespeare qui l’accompagna et le questionna toute sa vie et avec lequel il commença sa carrière (mais le mot lui allait si mal) si jeune, à Stratford, auprès de la Royal Shakespeare company. Peter Brook le disait : «Il y a d’un côté le théâtre, de l’autre Shakespeare.» Shakespeare dont il a fait redécouvrir de nombreuses pièces peu ou jamais jouées en France sur un mode toujours plus aérien et épuré, trois bambous suffisant pour signifier la Tempête. Pièce qu’il remonta inlassablement, sous une forme toujours plus minimaliste, une esquisse, comme s’il s’agissait d’en saisir son essence, et dont on avait pu suivre la recherche avec des apprentis acteur de l’école Jacques Lecoq. Mais dans Shakespeare pour Brook, il y avait par dessus tout Hamlet, qu’il a monté souvent sans jamais, disait-il, épuiser le mystère de la simplicité du «to be or not to be» et de la permanence de la fascination qu’exercent ces quelques mots partout dans le monde. Un art du dépouillement tenant de la prestidigitation Pourquoi devient-on metteur en scène ou dramaturge ? Pourquoi choisit-on le théâtre, un art qui, dans les années d’immédiat après-guerre, était communément «rasoir» comme il le qualifiait dans son œuvre phare, l’Espace vide ? (1) Peter Brook ira même plus loin en assurant que toute mise en scène porte en elle les germes de son autodestruction. Qu’elle est établie pour être reproduite soir après soir mais que, «du jour où elle est fixée, quelque chose d’invisible commence à mourir» et que tout metteur en scène se bat sur du sable pour vaincre cette mort annoncée. Selon lui, aucun spectacle, aussi prodigieux soit-il, n’y échappait et ne pouvait être rejoué à l’identique à une décennie d’intervalle. A 93 ans, donc, Peter Brook disait à Libération ignorer encore pourquoi il était devenu metteur en scène. «Le destin», concédait-il. Et l’on remarquait que son ouverture à toutes les formes scéniques, d’où qu’elles proviennent, avait pour corollaire une remise en question constante des limites du théâtre. En témoignait sa pièce testamentaire, Why ? co-écrite et co-mise en scène avec sa complice de trente ans Marie-Hélène Estienne. Dedans, il s’interrogeait encore une fois sur les fondements de l’art dramatique et les raisons d’y consacrer sa vie. Peter Brook s’y prenait simplement, sans jamais que les questions essentielles s’habillent d’une tournure théorique. Il s’interrogeait sur le sens de son art comme un tout jeune metteur en scène à l’orée d’une vie professionnelle. Et il cherchait des réponses en revisitant les traces laissées par les plus grands dramaturges, Stanislavski et Meyerhold – fusillé sous ordre de Staline – comme, quelques décennies auparavant, il avait sondé les mystères d’Edward Gordon Craig, Brecht, ou Artaud, dans un autre spectacle au nom hamlétien, Qui est là ? Une fois de plus, son art du dépouillement tenait de la prestidigitation. On était bien en peine de saisir comment les acteurs parvenaient à montrer de multiples vies, lieux, ou temporalités sur le plateau vide du théâtre des Bouffes du Nord. Un regard transperçant, une douceur susceptible d’effrayer : il faut croire que l’attention aux autres et une gentillesse qu’on n’aurait tort d’associer à de la mièvrerie gardent l’esprit en alerte. Quand on avait rencontré Peter Brook dans les hauteurs d’un immeuble au centre de Paris, la ville où il vivait depuis les années 1960, sa sagacité rigoureuse et sa prévenance interdisaient qu’on esquive ses questions, qu’il posait en fixant son interlocuteur de ses yeux bleus. On ne pouvait pas mentir à Peter Brook, éluder, lui répondre à côté et ce fut une expérience surprenante d’être soumise à la question par un homme de 93 ans. A moins que le secret de sa longévité ne réside dans son don pour le bonheur ? Car Peter Brook avait une particularité rarissime et frappante lorsqu’on plonge dans son autobiographie Oublier le temps, parue en français en 2003 : il fut un artiste heureux. Aussi bien son enfance que sa vie se déroulèrent dans la joie. Et contrairement à beaucoup de ses collègues, il ignora les affres de la création, les cris, les rapports de force, pariant plutôt que la puissance de ses acteurs et collaborateurs serait décuplée s’ils étaient mis en confiance par un climat «serein», l’épithète est de lui. Il est significatif que Peter Brook n’éprouva jamais le besoin d’être un gourou et d’exercer un pouvoir sur ses collaborateurs et ses acteurs. Et que chaque rencontre artistique se doubla d’une amitié pérenne. Peter Brook n’a pas eu son Philippe Caubère (ancien acteur d’Ariane Mnouchkine) pour se moquer de ses travers, et il semble bien que lorsqu’un acteur ou une actrice quitte la troupe, ce soit sans amertume ni blessure d’un côté ou de l’autre. Il semble faire partie de ces rares personnes qui ne suscitent ni la médisance, ni la rumeur. Et si des différends adviennent, leur tournure n’est pas celle du règlement de compte. La cave d’un magasin de chaussons Peter Brook est né à Londres le 21 mars 1925 dans le quartier de Chiswick, de parents juifs lituaniens immigrés, un père ingénieur et une mère scientifique. Leur nom fut anglicisé à partir de Bryck, qui devint un temps Brouck, avant qu’un préposé à l’état civil ne tranche définitivement l’affaire. Lui et son frère grandissent dans une atmosphère familiale qu’il décrit comme idyllique même si ses parents ne s’entendent pas. «Nous étions encouragés, mon frère et moi, à croire que la vie était une corne d’abondance et notre maison une terre de profusion, où tout pouvait, à tout moment, nous être procuré. L’illusion, non sans danger, contribua a créer en nous et pour toujours un sentiment de sécurité intérieure.» Jeune adulte, cette sécurité intérieure se double de la croyance, certes un peu «périlleuse», qu’une «main du destin» le sauvera de tous les mauvais pas et qu’il ne doit donc avoir peur de rien. Ses notices biographiques indiquent – sans pour autant que l’anecdote soit inscrite dans ses mémoires – qu’il effectua sa première mise en scène d’Hamlet dans son petit théâtre de marionnettes quand il avait cinq ans. Pour autant, la première passion du jeune Peter ne fut pas le théâtre, mais le cinéma ou plus spécifiquement un projecteur à la séduction irrésistible, rouge et brillant comme une trottinette, qu’il contemplait dans la vitrine d’un magasin de jouets. Finalement, un après-midi, il assiste dans une librairie à une représentation dans un théâtre miniature pas plus grand qu’une maquette. Cette première expérience théâtrale demeure, affirme-t-il plus de quatre-vingts ans plus tard dans son autobiographie, «non seulement la plus vivante, mais la plus réelle», réelle signifiant sans doute que le mirage fonctionne à plein. Quand il pénètre, jeune adolescent, dans un vrai théâtre, c’est moins ce qui se passe sur scène qui le captive que les portes, les coulisses et l’étrangeté des acteurs s’évanouissant dans un hors-champ inatteignable. Un appareil de projection, des disparitions inexplicables : c’est bien la machination et le fonctionnement de l’illusion qui attirent le futur metteur en scène dès son plus jeune âge. Peter Brook ne fut pas un bon élève, et à seize ans, avant de réintégrer un parcours classique, il effectue un stage dans un labo dans l’espoir de devenir cinéaste. A peu près au même moment, il réquisitionne la cave d’un magasin de chaussons de danse, pour organiser sa première mise en scène. Le spectacle – une pièce élisabéthaine sanglante – en resta au stade des répétitions, mais le jeune Brook déclara un peu partout, jusqu’à y croire lui-même, que les représentations avaient été un triomphe. Après un passage par Oxford, il monte, en pleine guerre, la Machine infernale, pièce qu’il entraîne en tournée. Le jeune homme échafaudait encore d’autres projets théâtraux quand des bombes réduisirent à néant la maison de ses parents. Peter Brook débarrasse la scène de son rideau rouge, et monte, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un «Roi Lear» affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Après-guerre, expliquait Peter Brook, le terrain était vierge, il y avait peu de metteurs en scène, du moins en Angleterre. Dès lors, rien ne lui résiste et ce qui l’étonne, c’est plutôt lorsqu’il rencontre des obstacles. Le roi Jean, Peines d’amour perdues, Roméo et Juliette : Shakespeare l’aimante et, de Stratford à Londres, les salles les plus prestigieuses le recherchent. A 23 ans seulement, il est chargé de monter l’opéra Boris Godounov à Covent Garden. La salle est pleine à craquer, mais la scène aussi, et l’armée de figurants peine à se déplacer. Chaque geste pèse des tonnes. Est-ce après ce qu’il estime être un désastre qu’il théorise que le théâtre n’a besoin de rien, que d’«un espace, un espace vide» ? A cette époque, et les années qui suivirent, Brook enchaîne les spectacles dont les répétitions ne durent que trois semaines, il est le plus jeune metteur en scène au monde, et dit-il, il devient «un phénomène de foire», se produisant de Londres à New York. Il a brûlé les étapes, n’a jamais été assistant, n’a pas de maître, son statut est sans précédent, mais plutôt que de lui monter à la tête, il lui permet, écrit-il rétrospectivement, de mépriser les fruits du succès et «les récompenses sans intérêt véritable». Sans intérêt véritable : c’est aussi ce qu’il éprouve lorsqu’il se rend dans les salles de spectacles d’Angleterre au début des années 1950. Anti-intellectualisme, théâtre moribond, ennui fracassant : les grands acteurs ironisent, refusent de réfléchir à leur art. On n’utilise pas l’expression de théâtre de boulevard car c’est l’ensemble du théâtre londonien qui est alors boulevardier, empesé dans du velours rouge et emprisonné dans les conventions. Peter Brook ne renonce pas, mais il a l’intuition qu’un autre théâtre que celui qui assomme les foules et vide leur porte-monnaie est possible. Comment s’y soustraire et que faut-il soustraire ? ll lui faudra encore quelques années, pour débarrasser la scène de son rideau rouge, et monter, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un Roi Lear affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Ce n’est pas un style, c’est une raison d’être et un problème : comment essorer les pièces de tout superflu pour en montrer la quintessence ? Cette absence d’artifice s’accompagnera ensuite parfois d’une élimination progressive de personnages. Carmen, Hamlet, la Flûte enchantée : autant d’œuvres dont Brook tentera d’extraire la note absolue, les quelques éléments premiers. Le miracle derrière la palissade Déjà, lorsqu’il accepte de codiriger la Royal Shakespeare Company, c’est à condition d’y créer un groupe de recherche sur l’histoire des conventions théâtrales et du métier d’acteur. Peter Brook réalise que tout ce qui sépare les acteurs du public dans les théâtres à l’italienne – l’épais rideau, les places les plus chères près de la scène – n’avait pas trait dans le théâtre élisabéthain où, à l’inverse, le public le plus populaire était debout au plus près du plateau. En 1970, ce groupe de recherche est accueilli dans un Paris alors en effervescence, et devient le Centre international de recherche théâtrale, chargé d’explorer non seulement toutes les formes théâtrales mais aussi les langues et les sons, en confrontant le japonais, le bambara, l’anglais, le portugais, le persan et même le français. Les comédiens sont de toutes nationalités. Le projet est d’éprouver la langue dans sa matérialité, de faire glisser les sons, de saisir la façon dont ils imprègnent le sens, et modulent aussi bien la gestuelle que la pensée. Sont aussi étudiées des langues anciennes ou disparues telles l’avestique, le zoroastrien, le grec ancien… Le poète Ted Hughes va jusqu’à inventer une nouvelle langue nommée «orghast», dont la signification des mots se transmet par la forme et la sonorité. Cette nouvelle langue est utilisée pour des créations jouées dans des endroits inattendus – un supermarché – ou expérimentaux – le festival des arts de Chiraz en Iran – mais aussi sur des places de villages en France, en Afrique ou en Amérique Latine. A la même époque, une rencontre capitale a lieu, avec Jean-Claude Carrière, alors scénariste attitré de Luis Buñuel (entre autres). L’écrivain demande à se glisser dans la troupe en tant qu’observateur et Peter Brook l’y autorise à condition qu’il soit un participant à part entière. Leur collaboration durera jusqu’à la mort de l’écrivain, en février 2021. Dans son dernier livre, Du bout des lèvres, Peter Brook évoque leur amitié immédiate faite d’une compréhension «instantanée» et d’une même hantise du langage «fleuri» au détriment de la clarté, surtout lorsqu’il s’agit de traduire Shakespeare. C’est également au début des années 1970 que Peter Brook ressent le besoin d’avoir un lieu à lui et se lance, avec son administratrice Micheline Rozan, à la recherche d’un théâtre. Au fil de promenades, ils tombent d’abord en arrêt sur un bâtiment du XVIIIe siècle abandonné et dissimulé au cœur de Paris où une supplique est restée gravée sur la porte d’entrée : «On demande poliment aux spectateurs de laisser leur épée à l’entrée.» Mais c’est finalement, à la Chapelle, dans le nord de la capitale, derrière une palissade, que le miracle a lieu : voici une friche pleine de décombres en déshérence depuis plus de vingt ans. Les murs sont noircis, le sol est bourré d’ordures en tout genre et Peter Brook éprouve le sentiment d’être dans le lieu idéal. «Trois années de voyages et d’expériences nous avaient appris – à la dure – ce qu’est un bon espace, et ce qu’est un mauvais espace… Nous remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous frayâmes un chemin à travers un tunnel poussiéreux, pour soudain nous redresser et découvrir, délabrées, carbonisées, ruinées par la pluie, grêlées, et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle : les Bouffes du Nord. Nous prîmes deux décisions : l’une, de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne rien effacer des marques qu’une centaine d’années de vie lui avaient laissées ; l’autre, de ressusciter l’endroit aussi vite que possible. On nous prévint que c’était impossible, un fonctionnaire du ministère nous dit que cela prendrait deux ans pour obtenir l’argent et les permis. Micheline refusa leur logique, accepta le défi.» Finalement la salle qui devait devenir le port d’attache de Peter Brook pendant presque cinquante ans rouvrit le 15 octobre 1974. François Marthouret incarnait Timon d’Athènes. Une pièce méconnue de Shakespeare. Et quarante-huit ans plus tard, en avril dernier, c’est sur cette même scène à la magie intacte, qu’il enchantait le public, par quelques représentations de Tempest project, co-mis en scène par Marie-Hélène Estienne. Un «projet» évidemment, le mot tourné vers l’avenir lui sied. Et encore une fois Shakespeare. (1) Une œuvre où il démontrait que si le théâtre assassinait par l’ennui si souvent son public, c’est qu’il usait de formes mortes, n’ayant plus aucun sens, revenant comme des zombies. (2) Editions Odile Jacob, 2018. Légende photo : Peter Brook (à gauche) et Jean-Claude Carrière, aux Bouffes du Nord, discutant de l'adaptation du «Mahabharata» au début des années 1980. (Julio Donoso/Sygma. Getty Images)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 3, 2022 5:30 AM
|
Cet été, le maître du vaudeville investit les places des villages du Nord Vaucluse Saisie par les premières contractions, Léonie défoule ses douleurs et sa mauvaise humeur sur Toudoux, son époux. Auprès de la future mère se succèdent Madame puis Monsieur de Champrinet. Sous le regard de Clémence, soubrette imperturbable, les parents de Léonie réitèrent leur dédain à l’égard d’un gendre roturier. Arrive enfin Madame Virtuel, sage femme autoritaire, limite militaire… . Après Les Vilains, farce de Ruzzante, montée l’an dernier, Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse choisit le roi du vaudeville pour sa tournée estivale. Co-directeur du CDDV avec Frédéric Richaud (Mr de Champrinet), Gilbert Barba met en scène son premier Feydeau dans le respect de la lettre, la mécanique mais aussi de l'époque : salon bourgeois, costumes fin XIXème, ici d’une rare élégance. Concentré sur un acte, Léonie est en avance fustige le mépris de classe et l’obsession des bonnes réputations. L’injustice, la bêtise soutendent les caprices des unes et les bassesses des autres. Mais toujours pour le meilleur et pour le rire. La sarabande est emmenée par la troupe du CDDV, dont Sarah Nedjoum vitupérante Léonie, Elsa Kmiec immarcescible Clémence et Benjamin Kerautret qui dote Toudoux du burlesque indispensable. Sans oublier Gilbert Barba mémorable Madame Virtuel. Interview de Gilbert Barba et Frédéric Richaud à l’issue de la première sur la place de Saint Roman de Malegarde. Léonie est en avance ou le mal joli : Ven. 17 juin – 21h place de l’église Notre Dame de Val Romigier Mornas Ven. 24 juin – 21h devant l’Espace Peyrolles – Colonzelle Ven. 1er juillet – 21h place sous le Barry – Buisson Sam. 02 juillet – 21h boulodrome – Montségur-sur-Lauzon Lun. 04 juillet – 21h place Humbert II – Visan Mar. 05 juillet – 21h place du village – Richerenches Mer. 06 juillet – 21h ancienne cours de l’école Jules Ferry – Lapalud Jeu. 07 juillet – 21h Ferme Saint-Agricol – Savoillans Ven. 08 juillet – 21h théâtre de verdure – Mollans-sur-Ouvèze Sam. 09 juillet – 21h salle des fêtes – Réauville Vendredi 22 juillet 21H30, Place Colonguin Grillon (dans le cadre des Nuits Théâtrales de l’Enclave).
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...