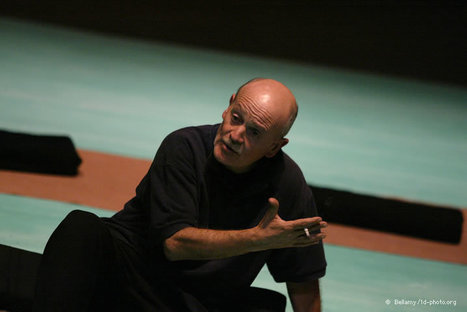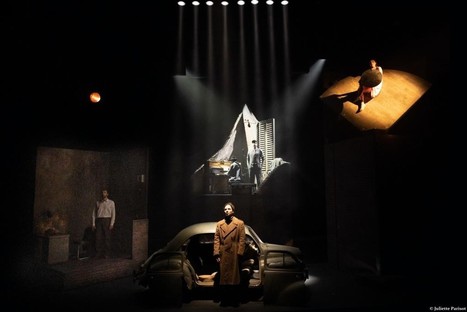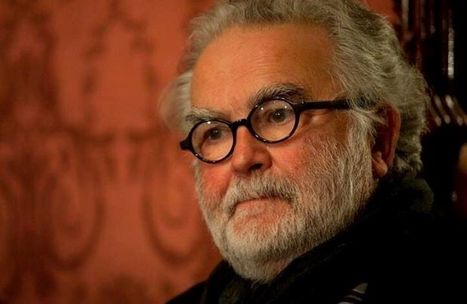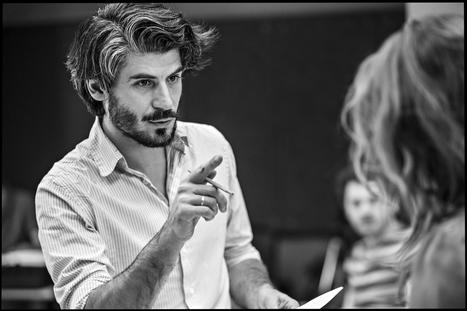Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 27, 2023 7:27 AM
|
Par Jérémy Piette dans Libération - 26 janvier 2023 Le comédien et cinéaste se réconcilie avec l’aigu de sa voix dans «la Porcelaine de Limoges», premier disque entre enfance et langueurs amoureuses où il chante «de façon nette et franche l’amour des garçons». Nicolas Maury nous donne à découvrir une autre facette de ses multiples talents, disséminés jusque-là au théâtre, au cinéma, à la télé. ( Photo : Elina Kechicheva) Nicolas Maury tente d’empêcher une larme de couler et c’est un peu de notre faute. Face à lui sur la banquette d’un restaurant quai de Valmy, le long du canal Saint-Martin dans le Xe arrondissement de Paris, nous n’avions pas prémédité l’effet de notre question : «Pour qui avez-vous écrit cet album ?» Difficile alors de ne pas voir sous les traits doux-mélancoliques de l’acteur et cinéaste français Jérémie, ce rôle qu’il incarna pour les besoins de son beau (et drôle) premier long métrage Garçon chiffon, cet être consumé par l’amour ainsi que son cœur coulant sombre : la jalousie. Le film, sorti officiellement en novembre 2020 mais handicapé par un second confinement, est retourné en salles quelques mois plus tard, révélant en sa toute fin une chanson simili-Alex Beaupain pour Christophe Honoré, baptisée Garçon velours et interprétée par l’acteur lui-même : «Je prends ce que tu me donnes et en fait notre amour /à nos visages de velours.» Dans une scène filmée sur le quai de Valmy, dont l’acteur est le voisin proche, avec sa voix et ses déplacements de biche brisée sur pavés inégaux, Nicolas Maury nous donnait à découvrir une autre facette de ses multiples talents, disséminés jusque-là au théâtre, au cinéma, et révélés plus populairement parlant par la série à succès Dix pour cent. Et c’est de ce morceau composé pour l’occasion par Olivier Marguerit, signature assez discrète d’une pop française et auteur-compositeur de BO (Onoda d’Arthur Harari, la Nuit du 12 de Dominik Moll…) que naquit sûrement l’envie pour Nicolas Maury de formuler un geste plus ample, plus ouvert encore : un disque, sorti ce mois-ci et intitulé la Porcelaine de Limoges. Dandy en pilou-pilou «Grâce à cet album, j’ai enfin pu rejoindre la nudité de ma voix.» La larme essuyée vient de là, plus heureuse qu’elle n’y paraît, de cet homme de 42 ans qui nous dit avoir pu enfin «s’autoriser un truc de chant, ouvrir la fenêtre», puis d’ajouter : «Enfant, j’avais honte de cette “clarté” dans ma voix. Au collège, on me huait, on me disait : “Il a une voix de fille”… Je devais la déguiser. Ma prof de chant actuelle m’a d’ailleurs dit que si je n’avais pas eu à faire ça, elle serait encore plus haute.» Nicolas Maury a donc fait cet album pour l’enfant qu’il était. La voix y est joliment vaporeuse, claire, diaphane, susurrante parfois, d’une candeur déguisée. Qu’elle soit chantée, parlée, soufflée, elle irrigue chaque recoin de l’album, filet aigu qui agrippe la vénéneuse Paris ou retrouve tel le pays perdu l’enfance près de Limoges, Maury étant né et ayant grandi à Saint-Yrieix-la-Perche. Elle ausculte aussi l’amour : «Je chante de façon nette et franche l’amour des garçons. Je ne pense pas que ce soit si courant dans la chanson française d’être aussi transparent sur un homme qui chante un autre homme. Souvent ça a pris pas mal de détours.» Tout est en apparence soyeux et chic : le conte, vulnérable ; le chanteur, un vrai dandy en pilou-pilou, préciosité d’une Delphine Seyrig qui aurait mangé du Françoise Hardy au goûter. Les rivages de l’album auxquels s’arrimer sont multiples, disco pop sur Gentleman, Nicolas Maury se mue Jane Birkin sur son titre Paris, puis très intimiste et déclaratif sur Vers les falaises. L’album se déplie en un lot d’élans mélos, façon comédie musicale pour errance blessée dans les grandes villes à la nuit tombée. La folk s’y déploie atmosphérique : Porcelaine de Limoges touche au cœur tant elle nous renvoie à l’obscurité craquelée de l’Américain Sufjan Stevens, période Carrie & Lowell. L’un des morceaux, Ou un baiser, est composé par la chanteuse Keren Ann et Doriand, auteur-compositeur-interprète qui a écrit pour mille autres personnes (de Katerine à Lio en passant par Bashung). Pour le reste, Nicolas Maury a tout fomenté et peaufiné pendant deux ans avec Olivier Marguerit et sa compagne, Shanti Masud, que l’on connaît pour ses beaux films peuplés de métamorphoses fantastiques (Nicolas Maury y endosse certains rôles), et qui signe aussi la majorité des textes. Le couple et l’acteur s’échangeaient, dès novembre 2020 et de loin, confinement oblige, les chansons missives après d’amples discussions sur Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani, Jane Birkin, Vanessa Paradis («la numéro 1 dans ma vie»), et plus généralement l’énergie complexe des duos pygmalions-muses. «Le mythe de la muse a pu me fasciner dans ma construction adolescente. C’est une image que j’admire, tout à fait ambiguë, dont il faut savoir se détacher aussi. Ça peut être agréable d’être dans les fantasmes de quelqu’un. Mais là, je trouve plus urgent de me dire oui à moi. Etre habillé d’un très bel album par quelqu’un, c’est très beau, mais me concernant, ça m’inquiète intellectuellement…» «Un peu trop roi en mon domaine» Le chanteur dit être mieux armé qu’avant pour pas se laisser faire, en parallèle, il est enthousiaste d’annoncer une forme de «lâcher-prise» lié à la chanson, après s’être «enfanté comme réalisateur» pour son Garçon chiffon : «J’adore ce film, mais si je suis honnête, en tant qu’acteur et metteur en scène, je suis un peu trop roi en mon domaine. Alors qu’avec la musique, je suis dans une zone où je n’ai pas de prise, vraiment. Et puis la formulation excessive de soi peut m’enliser, qu’elle soit poétique ou non. Ici, je ne parle jamais directement de ce que j’ai vécu.» La musique, pour Nicolas Maury, est l’endroit où suspendre le «vouloir dire». «Il faut croire en des sensations, en des paysages, en des souvenirs, plus qu’en des manières d’être malin avec le langage. De devoir chanter avec nudité une note qui a déjà en elle une charge émotionnelle, ça m’a «désembarrassé» du poids de vouloir bien jouer. J’y trouve une forme de dépossession magnifique.» Le chanteur s’émerveille qu’en quelques minutes, un morceau tel que la Porcelaine de Limoges puisse contenir quelque chose comme seize ans d’une vie, de sa petite enfance au moment où il décide de partir pour la capitale à 20 ans : «C’est sublime et effroyable, comme une épitaphe.» Comme la pop aussi, c’est là toute son habileté souriante, ses refrains, ses mots que l’on répète jusqu’à tue-tête, ses formules condensées qui doivent taper au cœur et au corps, ses phrases légères qui dissimulent des failles qui à l’écoute seront exhumées ou non : «C’est ce que j’adore dans le secret entre l’auditeur et toi. S’il comprend, il sait que derrière les choses légères il y en a de moins légères. Mais cette décision de rester léger de la part du chanteur plutôt que de formuler explicitement est comme une politesse que je trouve magnifique dans la pop. Tu l’entends dans des voix comme Damon Albarn avec ses projets solo, ou Neil Hannon de The Divine Comedy, il faut avoir tutoyé les gouffres, avoir été pris dans des vertiges, pour opérer ce genre d’audaces.» Maury sait de quoi il parle, des gouffres il dit s’en être approché, comme face au micro, au studio, ne chantant pas toujours bien : «J’ai dû dépasser cette dépréciation. J’en pleurais. Ce qui est bien, c’est qu’Olivier Marguerit dans sa façon de me diriger ne rentrait jamais dans ça, il me disait : “Non mais c’est comme ça la musique, tu vas y arriver.” Il m’a tout de suite considéré comme le chanteur que je devais être. Il a quelque chose de très architecturé comme compositeur, et très savant sur la pop… Par exemple, un truc très con mais je vais prendre un album de Blur, genre Think Tank (2003) prêt à lui évoquer une chanson que j’aime et il va me devancer en sachant laquelle. C’est ce qui nous a permis de parler des terres que je cherchais dans ma voix.» Romantique et spleenétique Le chanteur a également pris des cours, avec Nathalie Dupuy, coach habituée des émissions The Voice et la Nouvelle Star, qui l’aide également pour les lives passés et à venir. C’est à cet instant que l’on se demande ce que l’acteur pourra bien faire de ce corps qu’il a emmené et déplacé au théâtre comme devant la caméra, mais encore très peu sur une scène de concert : «En préparant tout cela, j’ai pas mal parlé du metteur en scène Roméo Castellucci [spécialiste de grandes scénographies très sophistiquées, ndlr] avec mon petit langage du théâtre, et la tourneuse me regardait avec de grands yeux parce que ce n’est évidemment pas les mêmes grilles techniques. Je sais par exemple que j’ai envie d’inquiéter le plateau. D’inquiéter là où ça devrait rouler. J’ai des prévisions, des flashs et aussi des chaussures. Moi je suis un peu un faiseur de buée, j’aime bien envoyer de la buée, des matières comme ça, des nuages, de la fumée. Ce sera un plateau très très… glacier, très blanc.» Sur ces promesses d’Antarctique, on quitte le chanteur en écoutant l’album une fois encore afin de mieux traverser Paris à pied. Il est 15 h 30, deux jeunes femmes boivent des spritz, les sapins de Noël sont abandonnés par dizaine sur les trottoirs, un garçon aux cheveux gominés et sourire charmeur nous fixe tandis que le chanteur prononce sur sa très romantique et spleenétique Désir en fuite : «Je rêve à nous /J’me fais des films /Et dans la foule /Bat mon cœur anonyme.» Un album pour se faire son cinéma. Quelques minutes plus tôt, Maury nous disait : «J’aimerais qu’il y ait des rencontres avec mes chansons. Je trouverais ça beau que ça résonne dans les secrets des autres. Et je pense qu’en vrai, qu’on soit un homme ou une femme, qui aime les hommes ou qui aime les femmes, ou qui aime les plantes, les chiens, les bébés chatons… y a quelque chose dans cet album qui dit “on a pu vivre et on vivra”.» Jérémy Piette / Libération Nicolas Maury, la Porcelaine de Limoges (Parlophone) En concert le 10 février à la Cartonnerie (Reims), le 16 février au Rocher de Palmer (Bordeaux), le 17 février au Paloma (Nîmes), le 18 février à la salle Molière (Lyon), le 2 mars aux Docs (Lausanne), le 4 mars à la Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand) et le 31 mars au Café de la Danse (Paris).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 26, 2023 8:34 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 25 janvier 2023 Danseur, chorégraphe et directeur de festival, il s’illustra aux côtés de figures emblématiques de la danse, dont Pina Bausch. Il s’est éteint le 22 janvier, à l’âge de 75 ans.
Lire l'article sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/la-mort-du-danseur-jacques-patarozzi_6159298_3246.html
Sa chaleur immédiate, son sourire tout aussi fulgurant accompagnaient des points de vue affûtés sur la danse contemporaine, qu’il a arpentée en tous sens et connaissait sur le bout des chaussons depuis les années 1970. Le danseur, chorégraphe et pédagogue, formateur de générations d’artistes et directeur de festival Jacques Patarozzi est mort le 22 janvier, à l’hôpital d’Angoulême. Il avait 75 ans et souffrait d’insuffisance rénale depuis de longues années. C’est à Paris que ce Corse, né le 28 avril 1947 à Ajaccio, se forme à la danse jazz auprès de Gene Robinson, professeur à l’Opéra national de Paris. Dès 1967, il décroche ses premiers contrats d’interprète auprès des compagnies fameuses de l’époque, celles de Félix Blaska et Joseph Russillo. Il file aux Etats-Unis en 1970 et travaille avec Paul Sanasardo. C’est là qu’il rencontre, en 1972, Pina Bausch (1940-2009) ainsi que le danseur Dominique Mercy, qui deviendra l’une des figures emblématiques de la troupe de l’artiste allemande basée à Wuppertal (Allemagne), et Malou Airaudo. De retour en France en 1975, Jacques Patarozzi prend la direction de l’école de danse du Nouveau Carré Silvia Monfort, à Paris. Un an plus tard, en 1976, avec Mercy, Airaudo, Dominique Petit et Helena Pikon, ils fondent La Main, qui présentera des spectacles pendant quatre ans. Sur l’invitation de Pina Bausch, il la rejoint, à Wuppertal, en 1978, et collabore avec elle le temps d’une saison. Il y crée notamment le personnage d’un ange dans Renate wandert aus (1978). « Il y était très touchant, se rappelle Dominique Mercy. Jacques était quelqu’un de très doux, très généreux. Dans son travail de chorégraphe, il était à la recherche d’une forme d’épure, d’essentiel. » « Trouver le goût du mouvement » Expressive, suggestive, avec un accent sur le dos et les ports de bras, l’écriture de Jacques Patarozzi rayonne à partir de 1982 dans une autre troupe, Balmuz. Il y met en scène des pièces jusqu’en 1996, dont A Mossa, où il décline des tableaux de la vie quotidienne en Corse sur des chants polyphoniques. Il donne aussi des cours et s’affirme en pédagogue de plus en plus couru. Dans son studio de répétition parisien se retrouvent nombre de jeunes interprètes et chorégraphes des années 1980-1990. « Son travail au sol était prodigieux, commente Philippe Le Moal, inspecteur de la création artistique au ministère de la culture. Une de ses expressions favorites était : “Tu dois trouver le goût du mouvement comme si tu le mangeais.” » Frédéric Seguette, ancien élève : « Avec lui, j’ai appris le sens du travail du danseur et le corps joyeux, qu’il comparait souvent à un instrument de musique » Cette gourmandise et cette saveur du geste, Frédéric Seguette, complice de création du chorégraphe Jérôme Bel, aujourd’hui directeur du Dancing, Centre de développement chorégraphique national, à Dijon, qui a été son élève et interprète de 1992 à 1997, s’en souvient également. « Il s’accompagnait d’un petit tambour et en chantant. Avec lui, j’ai appris le sens du travail du danseur et le corps joyeux, qu’il comparait souvent à un instrument de musique, un tambour ou la corde d’un piano, dont on cherche la bonne tension pour qu’il résonne pleinement. Je pense à lui chaque matin lorsque je fais mon training. » Privilèges abonné Le Monde événements abonnés Expositions, concerts, rencontres avec la rédaction… Assistez à des événements partout en France ! Réserver des places En 1999, Jacques Patarozzi endosse un nouveau rôle, celui de directeur de festival, et crée Le Printemps de la Danse en Charente, à Villebois-Lavalette. Une « manifestation qui reste assurément une magnifique folie et une profonde illustration de sa capacité à marier rêve et énergie, affirme Philippe Le Moal. Il me disait en riant qu’il y montrait la danse contemporaine au cul des vaches ». Patarozzi dirige ensuite le théâtre L’Avant-Scène Cognac, de 2009 à 2014, dans le cadre duquel il pilote un nouveau rendez-vous, « Danse et vous », à partir de 2010. Parallèlement, il commence à pratiquer le zen avec son maître, Jacques Brosse (1922-2008), philosophe et moine bouddhiste. Ordonné lui-même moine en 2004, il proposait des séances de méditation à Angoulême. Il vivait dans le petit village de Salles-Lavalette (Charente) avec sa compagne, et danseuse, Fabienne Soula, avec laquelle il a eu deux enfants, Mathieu, interprète remarqué auprès des chorégraphes contemporains Thomas Lebrun et Olivia Grandville, et Lucie, costumière pour des compagnies de danse. Jacques Patarozzi en quelques dates 28 avril 1947 Naissance à Ajaccio 1975 Dirige l’école de danse du Nouveau Carré Silvia Monfort 1999 Crée et dirige le festival Le Printemps de la Danse en Charente, à Villebois-Lavalette 2009-2014 Dirige le théâtre L’Avant-Scène Cognac 22 janvier 2023 Mort à Angoulême Rosita Boisseau / Le Monde Légende photo : Jacques Patarozzi, alors directeur du théâtre L’Avant-Scène Cognac, en 2011. MARIE MONTEIRO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 26, 2023 7:52 AM
|
Propos recueillis par Joëlle Gayot / Télérama - 26 janvier 2023 À 89 ans, Françoise Fabian lit, aux côtés du rappeur Oxmo Puccino, des extraits d’“À la recherche du temps perdu”, de Marcel Proust. Un auteur qui habite cette comédienne dont la vie est nourrie de théâtre, de musique et de cinéma. Qui est Marcel Proust pour vous ? Une drogue, une passion ravageuse. J’ai lu huit fois À la recherche du temps perdu. Je pense de la vie exactement ce que Proust en pense. Ses vérités sont les miennes. Je suis, comme lui, sujette à la mémoire involontaire. Un rien ravive en moi des sensations tapies. Un bruit, une image, une odeur : c’est la fameuse madeleine de Proust. Lorsque ces sentiments et ces souvenirs enfouis se réveillent et s’épanouissent, il m’arrive de pleurer sans que personne ne sache pourquoi. Quel est votre plus vieux souvenir ? Je me revois enfant, à Alger, avec ma petite sœur dans une buanderie. Il fait chaud et ma mère nous rafraîchit avec des serviettes trempées avant de nous envoyer à la sieste. Un moment que je déteste, car je trouve que c’est du temps perdu. Il y a tant de choses à faire ! Étiez-vous une petite fille imaginative ? Oui. Mon père, directeur d’école, possédait une immense bibliothèque dans laquelle je piochais des livres sans que jamais il ne contrôle mes choix. Le soir venu, il nous lisait Les Mille et Une Nuits ou Les Misérables. J’étais au conservatoire de musique d’Alger, je jouais du piano et je chantais. Je me racontais beaucoup d’histoires, empêchant ma sœur de dormir ou m’enfermant dans les cabinets pour continuer mes récits tranquillement. Pourquoi avoir arrêté le piano ? Je me suis cassé le poignet en quatre morceaux. Ma main droite ne répond plus, alors que, de la gauche, je pense pouvoir encore interpréter un morceau de Rachmaninov. Le théâtre a-t-il pris toute la place ? Il est devenu très vite important. Mon premier flirt était un comédien. Il m’a convaincue de le rejoindre dans un cours de comédie. Une professeure m’a encouragée à poursuivre dans cette voie. Elle m’a donné des cours, puis a suggéré à mon père de m’envoyer à Paris pour que je fasse le Conservatoire. Je n’avais que 16 ans, mais il a accepté. Il me faisait parvenir un peu d’argent chaque mois, je dormais dans des chambres de bonne, mangeais dans les restaurants universitaires. Et suivais des cours avec Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle. C’est comme ça que j’ai intégré cette bande d’acteurs. Pourquoi n’êtes-vous pas entrée à la Comédie-Française ? L’exemple d’Annie Girardot, qui pendant deux ans n’y a rien fait de réellement important, à part jouer dans une pièce de Cocteau, m’en a dissuadée. Lorsque le metteur en scène Jean Meyer a proposé de m’engager pour jouer au Théâtre de la Madeleine, je n’ai pas hésité. J’ai travaillé avec lui à huit reprises. D’où vient votre goût pour la liberté ? De mon éducation. Mon père m’a toujours fait confiance et j’ai été élevée par une mère coriace qui m’a appris à me défendre. À l’adolescence, dans le bus qui me ramenait à la maison, il arrivait que des hommes se frottent contre moi. Furieuse, elle m’a dit : prends un compas et, s’ils s’approchent trop, pique-les ! Je suis la femme compas ! Vos rôles au cinéma sont souvent ceux d’une femme forte. Êtes-vous ainsi dans la vie ? En réalité, je suis une personne timide. Je n’ai jamais aimé mon physique et j’ai toujours eu l’impression de ne pas être à la hauteur de ce à quoi j’aspirais. Par défense et pour lutter contre cette timidité, je suis devenue insolente. Mais je n’ai jamais été soumise. Ce n’est pas dans mon caractère. “Je suis contente d’avoir mon âge. Ce qui se profile ne m’intéresse pas. Nous vivons dans un monde de fous qui va à sa destruction” La caméra ne vous a-t-elle pas appris à vous aimer ? Vous n’imaginez pas à quel point j’ai haï le cinéma. Lorsque j’ai été engagée pour la première fois, j’étais tétanisée et n’espérais qu’une chose : qu’un incendie consume le plateau de tournage. Je n’aime que le théâtre. Sur les planches, je maîtrise ce qui se passe, je vais au bout de l’histoire. Qu’est-ce qui manque à votre parcours ? Tchekhov et Dostoïevski. J’ai raté ma vie. Les deux m’ont échappé, je ne les ai pas joués. Pourquoi ? Je suis un personnage de Tchekhov ! Et Molière ? Il m’a tout appris. À 12 ou 13 ans, j’avais lu toutes ses pièces. J’en connais des phrases par cœur. Il n’y a pas, chez lui, un geste ou une pensée inutile. Le soir, dans mon lit, je redis certaines de ses répliques. La langue de Molière m’est une seconde nature. Quelle est la plus belle période que vous ayez vécue ? Mai 68. J’étais amoureuse et je manifestais. Quelque chose alors se passait qui valait la peine de se battre. Mais, aujourd’hui, quel avenir attend la jeune génération ? Qu’est-on en train de devenir ? Je suis contente d’avoir mon âge. Ce qui se profile ne m’intéresse pas. Nous vivons dans un monde de fous qui va à sa destruction. Je milite pour l’euthanasie choisie. Si je ne meurs pas de maladie, je me suiciderai probablement. Marcel, mise en scène de Jérémie Lippmann. Du 26 janvier au 4 mars. Du mer. au dim., horaires variables : 15h, 19h, 20h ou 21h. Le 13e Art, centre Commercial Italie 2, place d’Italie, 13e, 01 48 28 53 53. 25-59 €. Légende photo : Françoise Fabian © SMITH / Modds, Paris, Janvier 2023

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 2023 11:04 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 25 janvier 2023
La compagnie La Cordonnerie invente un spectacle d’une poésie folle, porté par une mise en scène inventive.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/ne-pas-finir-comme-romeo-et-juliette-au-monfort-theatre-quand-l-amour-s-epanouit-par-dela-le-pont-et-les-conventions_6159293_3246.html
Ils s’appellent Romy et Pierre. L’une et l’autre vivent de chaque côté d’un pont que personne ne traverse jamais, en vertu d’une interdiction ou d’une impossibilité mystérieuses, jamais formulées par les autorités. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, que l’on peut voir au Monfort Théâtre, à Paris, puis en tournée en France, raconte leur histoire. Et c’est une petite merveille de spectacle, qui confirme le talent de la compagnie La Cordonnerie pour inventer un théâtre-cinéma tout public de haut vol, et d’une poésie folle. Il était une fois deux villes séparées par un pont, donc, il était une fois Romy et Pierre, dont l’histoire ne s’inspire que lointainement de la pièce de Shakespeare, même si le grand Will traverse tout le spectacle comme une figure tutélaire et bienveillante. Romy vit du côté où les êtres sont devenus des invisibles, des créatures dont l’existence-inexistence s’incarne dans des corps de pantins aux visages lisses et aux yeux doux. Romy, qui est championne de ping-pong dans sa partie du monde, perd son père. Et, comme celui-ci avait rêvé, toute sa vie, de voir un jour la mer, elle transgresse l’interdit : elle traverse le pont pour aller disperser ses cendres dans l’océan. Invisible aux yeux des humains qui vivent de ce côté-ci du monde, elle n’en rencontre pas moins Pierre, et tous deux tombent amoureux l’un de l’autre, pris par l’amour vrai, celui qui va au-delà du visible. Pierre est un vieux garçon doux et solitaire, journaliste-écrivain à ses heures. Il vit avec son chat, prénommé Othello, et son grand œuvre, c’est un horoscope shakespearien à haute teneur poétique, qu’il délivre chaque jour à la radio de la ville. Sens du détail Métilde Weyergans et Samuel Hercule, les animateurs de La Cordonnerie, sont à la fois metteurs en scène, cinéastes, auteurs, comédiens et bricoleurs. Ils racontent l’histoire à leur manière, qui dissocie les plans de narration entre le jeu sur le plateau, les images projetées sur l’écran, la musique, interprétée en direct, le bruitage, l’animation d’objets divers et la conception de créatures d’ordre marionnettique. Et c’est ce dispositif, superbement maîtrisé tout en gardant un côté résolument artisanal, qui envoûte et réjouit, ouvrant grand les portes de l’imaginaire. Tout concourt ici à créer un climat, une atmosphère où l’on entre avec bonheur, qu’il s’agisse des magnifiques images portuaires et maritimes, tournées au Havre, du choix raffiné d’objets vintage ou du sens du détail en toutes choses : autant d’éléments qui viennent soutenir la capacité des deux créateurs à donner vie à des personnages on ne peut plus attachants. Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont l’élégance de ne jamais tirer trop lourdement les fils de leur histoire. A chacun de laisser jouer les belles métaphores que file le spectacle, sur toutes les frontières – géographiques, sociales, raciales, humaines, transhumaines… – que l’homme peut se créer dans son besoin de toujours vouloir dominer un « autre » créé de toutes pièces. A chacun de méditer les résistances à inventer, l’amour impossible qui peut toujours devenir possible, quand deux êtres se trouvent par-delà les assignations édictées par leur société. Quitte à choisir de devenir invisible, de passer sous les radars, pour échapper à l’ordre en place, surtout quand il ne dit pas son nom. Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : « Ne pas finir comme Roméo et Juliette », par Métilde Weyergans et Samuel Hercule. PIERRICK CORBAZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 2023 5:44 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 25 jan. 23 A 87 ans révolus, Bernard Sobel revient creuser plus avant « L’Empédocle» d’Hölderlin, poème dramatique à jamais inachevé. Empédocle tutoie les Dieux comme Sobel tutoie le poète et son héros. Dialogue avec vue sur l’Etna en fusion. Du théâtre d’un gaz extrêmement rare. Depuis plusieurs spectacles, Bernard Sobel n’en finit pas de ne pas en finir avec l’ Empédocle d’Hölderlin. Pas à pas, il l’accompagne jusqu’au au bord de l’Etna. (Il s'y jettera, on ne retrouvera qu’un soulier dit la légende). Sobel s’était d’abord arrêté prendre pension au château de Kafka, dire bonjour ou plutôt adieu à Amélia (lire ici) . Et puis, rasséréné, son bâton de berger du théâtre en forme de livre entre les mains, il a repris la route. Empédocle l’attendait au carrefour des trois sentiers. Depuis, ils font route commune. De l’étroite scène du 100 rue de Charenton où Empédocle et son disciple Pausanias devisaient, Bernard Sobel a gagné une salle bien plus ample dans le bois de Vincennes. Passé les cuisines de Mnouchkine, il a établi son campement au Théâtre de l’Epée de bois. Pas de falbalas. Une scène nue, au sol comme patiné par le passage de maints spectacles. Quand le public entre, des mains habiles finissent d’accrocher un calicot où l’on peut lire en grandes lettres : « hommage à François Tanguy ». Connivences entre deux travailleurs de force du théâtre, de générations différentes, mais mus par une commune exigence perpétuelle .Le calicot est hissé dans les cintres qui n’en sont pas, le spectacle peut commencer. Son titre ? La mort d’Empédocle. On est prévenu, aucun suspens. Un cheminement ultime. « Ceci est son jardin ! Là dans le secret/ de l’ombre où jaillit la source, Il était là » dit Panthéa interprétée par la fidèle Valentine Catzéfils. Elle s’adresse à Délia interprétée par Julie Brochen dont les élèves du théâtre école Thélème entreront bientôt en scène pour former le chœur du peuple. Panthéa est pétrie d’admiration envers Empédocle, Délia plus réservée. Entrent Hermocrate (Marc Berman, en alternance avec Claude Guyonnet) ) et Critias (Gilles Masson), le père de Délia, eux se méfient d’Empédocle, jalousent aussi sa proximité avec les Dieux. Ils décident de convoquer le peuple pour qu’Empédocle expie « l’heure funeste où il s’est pris pour un Dieu ». Ils sortent. Entre, enfin, Empédocle interprété, de façon d’autant plus habitée et bouleversante que dénuée de tout artifice, par l’admirable Mathieu Marie qui nous avait déjà ébloui rue de Charenton. « J’étais aimé, aimé de vous , les Dieux » dit-il . Pausanias ( remarquable Laurent Charpentier ), son disciple, rejoint « l’être d’exception » Le prêtre, le peuple et les autres arrivent pour prononcer « l’anathème sacré ». Empédocle demande à ce qu’on lui accorde « de poursuivre en silence le sentier que je suis,/ Jusqu’au bout, le sentier silencieux de la mort » L’anathème et prononcé et vaut aussi pour Pausanias. Empédocle fait ses adieux aux trois esclaves qui le servent et le vénèrent. A l’acte deuxième nous retrouvons Empédocle et Pausanias dans une cabane non loin de l’Etna. A l’acte troisième, Empédocle demandera à Pausanias, de le quitter. Son disciple finira par obéir à contre cœur. Surgira enfin le vieux Manès (Asil Raïs) « ...un mortel comme toi/ envoyé à temps, à toi qui t’imagines/ Le Préféré du Ciel, pour te nommer/Du Ciel la colère, du Dieu qui n’est pas désœuvré. » Deux vieilles connaissances, l’un encore vivant, l’autre presque déjà mort. Pausanias part enfin. Resté seul, Empédocle lui adresse ces derniers mots ambigus : « Laisse-moi maintenant, Quand là-bas/Je jour sera couché, c’est alors que tu me reverras ». Du grand théâtre à mains nues. Hölderlin, dit-on, s’identifiait à Empédocle. Le spectateur, dont l’imagination est sans bornes, peut imaginer que Bernard Sobel s’identifie à la fois au poète et à son héros. Cartoucherie, Théâtre de l’Epée de bois, du jeu au sam 21h, sam également à 16h30 , dim à 16h30, jusqu’au 5 février. Sur la photo : Bernard Sobel. © H. Bellamy

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 12:44 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 23 janvier 2023 Dans Grief and Beauty, Deuil et Beauté, Milo Rau dirige comédiens professionnels et amateurs. Au-dessus du plateau, un grand écran et l’image d’une femme euthanasiée, qui meurt sous nos yeux. Sans doute, évidemment, Johanna B. « à l’écran » comme le précise la feuille de distribution du spectacle de Milo Rau, avait-t-elle donné son accord. Son accord pour être filmée alors qu’on lui fait la piqûre qui va la faire mourir. Son accord pour qu’on la voie mourir. Son accord pour que le film fasse partie d’un spectacle, et des années durant. Grief Beauty (Deuil et Beauté) a été créé en septembre 2021 au NTGent. Certainement. On a vérifié : elle avait donné son accord et sa famille également. A cette réserve près que l’on n’utilise pas, en dehors des représentations, vidéo, paroles, photos. Encore heureux, non ? Mais disons-le, ce film cloue le spectateur dans une position d’indiscrétion épouvantable. On ne va pas au théâtre pour voir une personne que l’on ne connaît pas mourir. On ne va pas au théâtre pour être contraint à l’indécence d’un voyeurisme certain. On assiste les mourants, on peut demeurer auprès des êtres jusqu’à leur dernier souffle, on voit des morts, on voit mourir dans des accidents, des guerres. Dans la vie, dans la vraie vie ou dans des reportages, des documentaires. En toute conscience. Mais on ne va pas au théâtre pour voir une femme être euthanasiée. Avec Familie, premier volet de la Trilogy of Private Life (Trilogie de la vie privée), vu à Nanterre Amandiers il y a plusieurs saisons, on était épouvantablement éprouvé, mais on demeurait dans un espace de théâtre, de jeu. Avec ce deuxième volet, on est contraint. On subit cette mort en faux direct. C’est malsain. Pour le reste, comme toujours, le récit fragmenté est conduit avec une intelligence profonde des expériences sensibles des uns et des autres. Beaucoup de savoir-faire. Il est très fort, Milo Rau. Depuis le temps qu’il plonge dans le réel et fait du théâtre un filtre, un crible, une manière de transmuer tout en dilatant les enjeux d’événements véritables. Guerres ou faits divers. On a rarement refusé les obstacles. Familie nous avait rendu malade. Grief and Beauty nous scandalise. Sur le plateau, parfois filmés en direct, les comédiens sont remarquables. Le vieux souffrant joué par un pas si vieux, né en 49, dans une famille d’agriculteurs, Staf Smans. Ouvrier d’usine, brillant comptable, il est devenu acteur après sa retraite. Vétérinaire et inspectrice alimentaire, Anne Deyglat, travaille au NTGand. Elle est « dog sitter » dans Familie (car il y a un chien dans la famille des calaisiens qui inspire le spectacle). Elle joue, se livre plus exatement. Il y a la belle qui raconte sa vie, impressionnante, Princess Isatu Hassan Bangura, qui nous plonge dans les tragédies des XX-XXIèmes siècles). Magistrale et bouleversante. Il y a le jeune aux yeux clairs et désarmants que l’on connaît à la Colline puisqu’il y a joué Edouard Louis, Arne de Tremerie. Il dit et il chante, parle, magnifiquement sensible et intelligent. Il y a une pudeur dramatique, ici. Même quand un vieux se déshabille. Moritz Von Dungen filme en direct les protagonistes tandis qu’à l’espace opposé du plateau, Clémence Clarysse assure en direct la musique, certains sons. Belle présence, consolante et mystérieuse. Armelle Héliot La Colline Grand Théâtre, du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 15h30. S’est donné du 19 au 21 janvier et est repris du 2 au 5 février. Tél : 01 44 62 52 52. Par internet : billetterie.colline.fr Durée : 1h35.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 6:51 AM
|
Par Véronique Hotte dans Webthéâtre - le 22 janvier 2023 Savoir approcher et apprivoiser l’intimité de la mort. Avec Grief & Beauty, le deuxième opus de La Trilogie de la vie privée, spectacle créé au NTGent dont il a la direction, Milo Rau privilégie un théâtre de l’existence quotidienne - l’exploration du thème de la mort, de l’adieu, du deuil, de la mémoire et de l’oubli. Avec la fin de vie - réalité solitaire et solidaire -, le dramaturge convoque des témoignages - beauté entre réalisme et poésie. Sur scène, selon le manifeste théâtral de 2018, Milo Rau dirige des acteurs professionnels de toutes générations mais aussi des amateurs ayant côtoyé la mort ou accompagné un proche dans ses derniers instants, ou éprouvé soi-même la maladie, ou exercé un assistanat professionnel. Le titre Grief & Beauty décrit, selon le concepteur, un paradoxe existentiel : la capacité de chacun à penser l’infini, intellectuellement et émotionnellement, tout en se sachant intuitivement un être fini, destiné à mourir, comme si la beauté du terrestre résidait dans son caractère éphémère. Soit l’épreuve du refoulement de sa mort, de son animalité, de son état de « créature ». Le metteur en scène tente d’établir un lien entre différentes formes de deuil et de disparition, celle des espèces animales, des milieux de vie, des langages, de la mémoire et de l’existence individuelle. Le spectacle a pris forme, entre répétitions, recherches, histoires collectées ou vécues, dans le temps de l’actualité des statistiques de décès du Covid, des images de victimes de guerre - renouvelées par la Guerre en Ukraine -, et de catastrophes - quotidien saturé d’images de mort. Selon Heiner Müller, « le théâtre est le lieu où les vivants dialoguent avec les morts », tel le désir d’Orphée de vaincre la mort par le chant. Grief & Beauty est un rituel, une célébration intime et pré-politique du collectif. Et la musique est essentielle, ne serait-ce que les bruits du quotidien - l’eau d’un bain, le son d’une machine à café, le tintement d’un piano, le hurlement des loups. « Ecouter quelqu’un et le regarder, c’est comme se laver l’âme », commente Milo Rau. Jeunes et moins jeunes, professionnels de théâtre et amateurs, tous vivent ensemble l’expérience. Le chagrin et la douleur incontrôlables que la mort provoque chez celui qui reste sont universels. Un rayon de soleil vient réchauffer le cœur de l’assistance, quand Le Petit Prince de Saint-Exupéry est évoqué par le comédien Arne de Tremerie, retraçant son voyage à travers l’univers, faisant allusion aux planètes, et partageant ainsi et encore les probabilités de la mort, de l’existence, de la beauté. Et celle-ci s’invite sur la scène : le jeune homme se met à chanter… Un rayon de vie et de bonne humeur aussi quand Staf Smans conte son goût du théâtre, au-delà de son histoire, de ses maux propres - histoire familiale et expérience de la maladie - et la perte aussi des êtres chers. Anne Deyglat, ex-vétérinaire, toujours très active, amoureuse éconduite, danse avec grâce et gaieté. Quant à Princess Isatu Hassan Bangura, elle raconte l’éloignement familial de la Sierra-Leone, pays d’origine, préférant en fait la Belgique, son pays d’accueil. C’est elle qui commente le choix de fin de vie de Johanna B. que nous voyons pudiquement à l’écran. Un spectacle émouvant qui rend hommage à toutes ces situations que nous écartons de toute représentation sociale - grandes peines intimes, dégradation des corps malades ou âgés, face pourtant à des personnes qui s’engagent - profession ou bénévolat - à assister les plus fragiles. Soit la face cachée d’une vision de l’humanité qui serait toujours gagnante et conquérante, solaire et bienheureuse, quoi qu’il arrive - mensonge. Est restitué ici la gravité de ce que vivre veut dire. Véronique Hotte / Webthéâtre Grief and Beauty, texte et mise en scène de Milo Rau, avec Arne de Tremerie, Anne Deyglat, Princess Isatu Hassan Bangura, Staf Smans et Johanna B. à l’écran, dramaturgie Carmen Hornbostel, caméra Moritz Von Dungern, musique live Clémence Clarysse, composition Elia Rédiger, décor Barbara Vandendriessche, lumières Dennis Diels. Du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février 2023, du mercredi au samedi 20h30, dimanche 15h30, spectacle en néerlandais sur-titré en français et en anglais, présenté en alternance avec Familie, premier volet de La Trilogie de la vie privée à La Colline - Théâtre National - 15 rue Malte-Brun 75020 - Paris. www.colline.fr
Crédit photo : Michel Devijver.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 22, 2023 6:42 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération - 20 jan. 2023 Pièce miroir de l’expérience du spectateur, la deuxième comédie musicale de David Lescot met très habilement en scène des personnages dont la vie bascule après un choc esthétique. Pourquoi certains spectacles donnent-ils aux spectateurs le sentiment d’être chez eux, alors que d’autres, dont la facture peut être irréprochable, les maintiennent derrière une paroi hermétique, autre nom pour qualifier le quatrième mur lorsqu’il est infranchissable ? Qu’est-ce qui suscite une adhésion immédiate, et donc un oubli de soi, dans la Force qui ravage tout, cette deuxième comédie musicale de David Lescot après Une femme se déplace en 2019 ? Très habilement, la pièce fonctionne en miroir et s’ouvre, après un prélude à l’opéra, sur une dizaine de spectateurs qui en sortent tout juste. «Alors, ça t’a plu ?» expression qu’on emploiera immanquablement à notre tour, deux heures plus tard. Et chacun de se livrer dans une conversation chantée à deux, d’éclaircir son sentiment et de se dévoiler, mine de rien, à travers son agacement, son ennui, son plaisir, son adoration, son incapacité de parler, et les tensions que les différences de perception génèrent. Numéro de prestidigitation Une dizaine d’acteurs qui tiennent une conversation intime mais chorale, et qu’on perçoit parfaitement, c’est déjà extraordinaire. Une patinette passe. Puis deux. Un solitaire à la casquette (David Lescot himself à son aise) harangue la petite troupe dans une brasserie, car l’espace s’est transformé en un clin d’œil sans qu’on le remarque en restaurant. Les acteurs se font accessoiristes et déménageurs, mais comme c’est en musique et que l’action ne s’arrête jamais, les changements de décor à vue et à roulettes se fondent constamment dans la structure de la pièce. L’orchestre est au fond du plateau, plus ou moins visible, selon des éclairages au cordeau. Dans le rôle de celle qui regrette sa soirée, il y a entre autres l’élue Mona, irrésistible Ludmilla Dabo, «qui ne voulait pas aller à ce truc» mais on lui a dit de se montrer dans les lieux culturels, tiraillée entre ses convictions profondes et son obéissance à son parti, et qu’on verra dans une scène finale d’affrontement éblouissante à l’Assemblée nationale. Ou encore Iris, aérienne Elise Caron, merveilleuse chanteuse, qui envoie tout valdinguer sous l’influence de son choc esthétique, cette «force qui ravage tout» et va métamorphoser la vie de chacun une nuit entière. Comme dans sa précédente comédie musicale, David Lescot a tout conçu, de la partition musicale à l’écriture des textes et la mise en scène, et cette fois, il est même sur le plateau dans le rôle de l’esseulé amoureux à casquette. Toutes les transitions, les enchaînements, la manière dont notamment une chambre d’hôtel est occupée successivement par plusieurs couples sans qu’on ne les voie jamais ni entrer ni sortir du plateau, sont à la fois virtuoses et simplissimes. Le lit demeure, tandis que les acteurs se substituent les uns aux autres, leurs apparitions et disparitions tiennent du numéro de prestidigitation. Croisé plus tard dans un café, David Lescot nous livrera certains de ses secrets : «Dans la scène de la chambre d’hôtel, tous les dialogues commencent dans des noirs très brefs qui donnent l’impression d’une continuité. Les comédiens ont à peine le temps de se cacher sous ou derrière le lit.» La fluidité et la rapidité de l’ensemble sont accentuées par la manière dont chaque nouvelle séquence débute dans des décors qui ne sont pas encore complètement installés. David Lescot remarque : «Dans cette pièce, l’envers du décor, la circulation des gens et des objets organisés par le régisseur technique Pierre-Yves Le Borgne lorsqu’ils ne sont pas sur le plateau constitue une mise en scène invisible d’une importance faramineuse. On est très nombreux et l’espace de la coulisse exigu. Il suffit d’un microdécalage pour tout dérégler même si, bien sûr, les musiciens sont hyper attentifs aux acteurs qu’ils suivent.» Autre transition, elle aussi ultra-huilée : le continuum entre les moments parlés et chantés, ce que David Lescot nomme «le spoken word» et qui consiste à poser du texte parlé sur du rythme si bien qu’il est impossible de savoir si l’acteur chante ou parle – «une technique vieille comme l’Opéra de quat’sous de Brecht et Kurt Weill qui se posait déjà ce problème», précise Lescot. Autrement dit, à aucun moment on éprouve le hiatus si fréquent dans les comédies musicales, quand un acteur s’arrête de parler pour se mettre à chanter, jeux de bras à l’appui. «Folie économique» C’est pendant la fermeture des salles que David Lescot s’est mis à songer à une pièce qui montrerait des gens changer de vie à la suite d’un choc esthétique, heureux ou malheureux. «J’étais tellement triste et furieux qu’on nous dise que l’art n’est pas essentiel… J’ai eu envie de montrer tout ce qui se passe après un spectacle. Bien sûr que ça m’est arrivé de parcourir la ville la nuit, en voulant tout modifier dans ma vie après vu une œuvre.» C’est également pendant le confinement et alors que la tournée d’Une femme se déplace est annulée, qu’il imagine «cette folie économique pour une petite compagnie comme la nôtre» : une pièce avec quinze interprètes dont quatre musiciens. L’équipe est quasi identique à celle de sa précédente comédie musicale à la différence près qu’il n’y a plus de personnage phare, ils sont tous principaux et égaux, les rôles féminins un peu plus que les autres tout de même, et chaque actrice et acteur en tient plusieurs – il faudrait citer toute la distribution, arrêtons-nous à Candice Bouchet et Emma Liégeois. Pléthore de personnages, avec une élégance dans la clarté de leurs lignes qui se chevauchent le temps d’une nuit, joie de l’aboutissement. L’exploit tient aussi à la manière dont David Lescot ne succombe jamais aux clichés, les frôle parfois pour s’en éloigner, tout en n’évoquant que des situations absolument reconnaissables. La Force qui ravage tout, comédie musicale de David Lescot au Théâtre de la ville à l’espace Cardin, jusqu’au 27 janvier. Légende photo : Le lit demeure, tandis que les acteurs se substituent les uns aux autres, leurs apparitions et disparitions tiennent du numéro de prestidigitation. (Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 22, 2023 3:01 PM
|
Par Valentin Pérez dans Le Monde - 19 janvier 2023 Le philosophe et metteur en scène lance au Fort d’Aubervilliers son Centre des arts de la parole. Ce projet vise à réhabiliter une expression verbale dénaturée par les clashs et les invectives grâce à des spectacles, des conférences, des lectures…
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/01/19/gerald-garutti-repand-la-bonne-parole-a-aubervilliers-il-est-l-heure-de-s-ouvrir-de-mieux-se-parler-autrement-on-va-crever_6158561_4500055.html Sourire réservé, conversation volubile, Gérald Garutti a l’air réjoui : « C’est la première fois que je porte un projet qui fait l’unanimité, des étudiants aux patrons, des ministères au Samusocial. » La drôle d’initiative lancée en ce début d’année par le metteur en scène de 48 ans et baptisée Centre des arts de la parole (CAP) part d’un constat : « Partout, ça parle. Est-ce que, pour autant, on se parle ? » La première étincelle lui vient à Londres, un jour de juin 2019. Tandis qu’il répète un Tartuffe, monté malicieusement avec des acteurs français et britanniques en guise de pied de nez au Brexit, Donald Trump déboule dans la capitale britannique et transforme illico sa visite officielle sous protocole royal en une énième série de mensonges, d’insultes, de tweets rageurs… « Cela a été le départ d’une réflexion, accélérée ensuite par l’absence de vrai débat pendant la présidentielle française de 2022, raconte aujourd’hui Gérald Garutti, dans la vaste bibliothèque de sa maison, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). J’ai compris que nous vivions une dégradation radicale de la parole, devenue destructrice, mal maîtrisée, dégénérescente. » A l’écouter, les réseaux sociaux nous font vivre dans « une société d’émission » où il faut à tout prix donner son avis et si possible sans nuance. Comme en écho, les responsables politiques n’usent de mots que pour s’adonner à des « pilonnages mutuels ». Conséquence ? « La création de communautés fallacieuses, de groupes fermés, de boucles infernales, de cellules radicales, où le commun se fait prison, illusion », se désole-t-il dans Il faut voir comme on se parle, le manifeste de son projet, paru le 18 janvier chez Actes Sud. Entremêler la pensée, l’art dramatique et l’écriture Il lui aura fallu trois ans pour penser son contre-feu, le CAP, cette association destinée à « revaloriser tous les types de paroles » : poésie, rhétorique, dialogue, critique, théâtre. Façon d’entremêler la pensée, l’art dramatique et l’écriture. Soit le mélange acrobatique qu’affectionne Gérald Garutti depuis ses débuts, lui, l’intello touche-à-tout qui monte Shakespeare et adapte Musset, entre une mise en scène cousue main pour Pierre Richard ou Mathieu Kassovitz, un cours à Sciences Po, une tribune… Le programme a l’épaisseur des grandes ambitions. A compter du printemps, le CAP, qui compte pour l’instant une équipe de quatre personnes, prévoit ainsi de lancer un festival itinérant, une chaîne de podcasts, une revue annuelle, une collection chez Actes Sud, mais aussi des lectures, des conférences, des pièces de théâtre ou des spectacles de slam. « Nous nous adressons à toutes et tous », lassés des clashs et des invectives venus de tous les horizons, revendique Gérald Garutti. Les événements physiques – gratuits ou à un tarif abordable – n’auront pas lieu à Paris : « Je ne peux pas prétendre décloisonner des mondes en étant dans le 8e arrondissement ! » Il a préféré Aubervilliers, où il vit depuis douze ans, et son fort, une ancienne friche urbaine transformée en vaste centre culturel accueillant artistes et associations et dotée d’espaces aux jauges de 200 à 450 places. La commune dyonisienne aux 108 nationalités, que les JO de 2024 promettent de redessiner en partie, est la troisième ville française avec le plus fort taux de pauvreté, selon le dernier baromètre de l’Observatoire des inégalités, fin décembre. Des parrains venus de tous horizons Aidé par son entregent, il a placé l’initiative sous l’égide de 21 parrains qui s’engagent à y intervenir : la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, la présidente de la BNF, Laurence Engel, le rappeur Fianso, le chanteur Arthur H, le philosophe Frédéric Gros, la romancière Eliette Abécassis… « Gérald a une sensibilité anglo-saxonne : il prend plaisir à rassembler des énergies et des gens de sphères différentes », résume la documentariste Hind Meddeb, qui participe aussi au projet. Pour financer le tout, la ville d’Aubervilliers, la région Ile-de-France, le Centre national du livre, le Théâtre de la Criée, à Marseille, et d’autres jouent les partenaires, en guettant d’autres subventions ou du mécénat. Surtout, le CAP a lancé depuis quelques mois de lucratifs programmes de formation sur six jours, pour réfléchir à la place de la parole, apprendre à mieux formuler son propos et à l’assumer. Administrés par des artistes (comédien, chanteuse lyrique, art-thérapeute…), ils visent des élus ou des entreprises. Enfant du Quartier latin, fils d’une psychanalyste et d’un informaticien immigrés du Maroc et du Portugal, « Gérald avait dès le lycée ce désir de théâtre et d’écriture », se souvient Cynthia Fleury, qui le connaît depuis l’âge de 15 ans. Cinéphile et affamé de lectures, il découvre six mois avant son bac scientifique qu’« il existe un endroit où l’on peut faire de la philo, de la littérature, du théâtre et qui s’appelle hypokhâgne, au lycée Louis-le-Grand ». Ce sera la première ligne de son CV d’érudit qui aligne Normale-Sup, Sciences Po, master de philo et doctorat ès lettres. Tenté par la mise en scène, Gérald Garutti s’y lance d’abord outre-Manche, en 2002, devient un temps le dramaturge du Théâtre national populaire de Villeurbanne et ne s’arrête plus depuis de monter des pièces, au Royaume-Uni autant qu’en France. Celui qui regrette que « la gauche n’ait plus de raison suffisante à donner aux artistes de s’engager pour elle » espère que son CAP aimantera des collaborations. Il est déjà tout heureux de constater qu’affluent des messages de volontaires, professeurs, associations ou grandes écoles. « Si on veut avoir un petit impact, il est l’heure de s’ouvrir, de mieux se parler. Autrement, on va crever. » Valentin Pérez Légende photo : Le metteur en scène et philosophe Gérald Garutti, dans sa bibliothèque, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 7 janvier 2023. FRÉDÉRIQUE PLAS POUR M LE MAGAZINE DU MONDE Voir la vidéo sur "L'étranger" de Camus, par Gérald Garutti, dans la série "Dans ma bibliothèque"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2023 6:17 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 20 janvier 2023 Simon Delétang signe une mise en scène élégante et intense de la pièce de théâtre de Georg Büchner, avec une distribution éblouissante, emmenée par Loïc Corbery. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/20/a-la-comedie-francaise-la-mort-de-danton-depeint-la-beaute-d-une-revolution-au-crepuscule_6158713_3246.html
Exit le rideau de velours rouge à la Comédie-Française. Un immense drapeau tricolore s’offre au regard des spectateurs, sur lequel on lit cette phrase de Saint-Just : « Tous les arts ont produit des merveilles, l’art de gouverner n’a produit que des monstres. » La Révolution entre dans la Maison de Molière, avec une grande pièce qui n’y avait jamais été jouée : La Mort de Danton, de Georg Büchner (1813-1837). Sous la conduite du metteur en scène Simon Delétang, c’est une soirée d’une belle intensité, qui vous emmène loin dans la méditation sur ce qui fait l’échec d’une révolution et sur la roue sanglante de l’histoire. Alors que retentit l’ouverture de Don Giovanni, de Mozart, le rideau se lève sur une scène que l’on pourrait croire sortie de Barry Lyndon (1975), de Stanley Kubrick, dans la lumière chatoyante des bougies. On est au tout début d’avril 1794, Danton va mourir quelques jours plus tard sous la guillotine, il le sent. Il s’étourdit de débauche et d’ivresse, il sait qu’il a perdu la partie. Büchner met en scène ces quelques jours qui voient la Révolution se noyer dans son propre sang, et ce processus impitoyable qui fait qu’un mouvement historique majeur échappe à tout contrôle, comme mû par une force propre. « La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants », dira Danton au cours de la pièce. La Mort de Danton est une réflexion magistrale sur cette transformation en marionnettes des acteurs de l’histoire, mais c’est avant tout une pièce de théâtre, avec des êtres de chair et de sang, profondément humains, engagés corps et âme dans les débats qui les animent. Autour de Danton, jouisseur et noceur, et de Robespierre, pétrifié dans sa rigueur morale, Büchner a donné vie aux autres membres du Comité de salut public, qui voit s’opposer les modérés et les tenants d’une ligne dure, laquelle s’incarne dans la Terreur, mise en place dès 1793 : Saint-Just, Camille Desmoulins, Collot d’Herbois, Barère ou Billaud-Varenne. « Vous voulez du pain et ils vous jettent des têtes », constatera Danton, en une de ces formules lapidaires dont Büchner a le secret. Envie d’en savoir plus sur la Comédie-Française ? Test gratuit Historicisation sans lourdeur La mise en scène de Simon Delétang ne fera pas la révolution en termes formels, mais elle déploie avec une grande élégance la beauté crépusculaire de la pièce et est tenue par une profonde connaissance de ses enjeux. L’espace unique d’un salon du XVIIIe siècle permet d’enchaîner les scènes avec fluidité et de varier les atmosphères, grâce aux superbes lumières de Mathilde Chamoux. Les costumes d’époque, signés par Marie-Frédérique Fillion, et le travail sur les masques participent à cette historicisation sans lourdeur. Tous s’emparent de la langue de Büchner avec une précision et une clarté essentielles à la compréhension La révolution est un théâtre, un jeu de masques, elle a été une fête qui se finit sous nos yeux, dans les ors et les rouges ternis par des lumières déclinantes. C’est cela que met en scène Simon Delétang, avec finesse. Il est aidé par une distribution éblouissante. On n’en finirait plus d’égrener les noms des talents qui se bousculent ici − ou, plus exactement, qui s’épaulent et se complètent, tant les acteurs forment un collectif où chacun peut briller dans toute sa singularité. Tous s’emparent de la langue de Büchner, telle qu’elle est admirablement traduite par Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil, avec une précision et une clarté essentielles à la compréhension de la pièce, tout en donnant chair à leurs personnages avec leurs couleurs multiples. Qu’il s’agisse de Christian Gonon (Barère), de Nicolas Lormeau (Lacroix), de Jean Chevalier (Collot d’Herbois), de Nicolas Chupin (Billaud-Varenne) ou encore de Gaël Kamilindi, Camille Desmoulins d’une grande sensibilité, un tendre emporté par la furie de l’histoire. Et que dire de Guillaume Gallienne en Saint-Just, si ce n’est qu’il est tout simplement impressionnant dans le long monologue qui constitue l’un des sommets de la pièce ? Avec lui, on suivrait les yeux fermés l’« archange de la Terreur », comme il fut surnommé… Evidemment, les femmes n’ont que des rôles secondaires, mais Büchner a néanmoins dessiné trois magnifiques personnages, et les trois actrices qui s’en emparent leur donnent une dimension inédite. Marina Hands offre l’un des plus beaux moments du spectacle, un concentré de vie et de charme, dans le rôle de Marion, une grisette qui assume son goût de l’amour. Julie Sicard est d’une force incroyable dans le rôle de Julie, la femme de Danton. Et Anna Cervinka, en Lucile Desmoulins, d’une sensibilité qui s’accorde à celle de son époux. Robespierre, lui, s’incarne parfaitement dans la peau de Clément Hervieu-Léger, avec son port de tête altier et sa rigueur de jeu, qui épousent celle de son personnage, dont il restitue l’étrange froideur. Quant à Loïc Corbery, on sait depuis longtemps quel grand acteur il est, et il trouve enfin avec Danton un rôle à sa mesure, qu’il endosse avec infiniment de subtilité et d’humanité, bien loin des clichés attachés au personnage. Son Danton palpite de vie et de l’intelligence et de la mélancolie de celui qui a compris quel monstre avait engendré l’idéal révolutionnaire. Avec eux tous, cette pièce avec laquelle Büchner a inventé la modernité du théâtre déploie non seulement sa dimension historique, mais aussi la profondeur de sa méditation sur la condition humaine. « La révolution est le masque de la mort, la mort est le masque de la révolution », conclut Büchner. Et ce constat taraude l’esprit jusqu’à aujourd’hui encore. La Mort de Danton, de Georg Büchner (traduit de l’allemand par Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil). Mise en scène de Simon Delétang. Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1er. Jusqu’au 4 juin, à 14 heures ou 20 h 30, en alternance. De 6 € à 49 €. Comedie-francaise.fr Fabienne Darge Légende photo : Georges Danton (Loïc Corbery), lors d’une répétition de « La Mort de Danton », de Georg Büchner, à la Comédie-Française, à Paris, le 12 décembre 2022. PASCAL GELY/HANS LUCAS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 2023 7:34 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 16 janvier 2023 Après l’affront fait au livre, sujet de son précédent spectacle, Mathieu Coblentz se penche sur l’affront fait à « L’Espèce humaine ». Un livre, un homme, Robert Antelme et l’amitié partagée avec Marguerite Duras, son épouse, et Dionys Mascolo, à jamais son ami. Tricotant les textes de ces deux derniers avec un reportage de Vassili Grossman, le spectacle « L’Espèce humaine » nous emporte loin. Il faut savoir rebondir. C’est ce qu’ont fait avec acuité le metteur en scène Mathieu Coblentz et sa dramaturge Marion Canelas lorsqu’ils ont appris que les ayant-droits de Robert Antelme leur refusaient les droits de porter à la scène tout ou partie du texte de cet homme « réduit à l’irréductible » (Maurice Blanchot) titré L’Espèce humaine. Ils voulaient « chanter l’épopée d’un revenant, moins pour dire l’enfermement concentrationnaire que pour raconter le retour de cet Orphée mourant ». Ils vont le faire, autrement. Après avoir frôlé la mort, Robert Antelme racontera, la vie et la force retrouvées, ce qu’il a vécu dans les camps. Il y en avait d’autres, bien pires que les siens. « Il n’y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L’horreur est obscurité, manque de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n’aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester, jusqu’au bout, des hommes », écrit Antelme en 1947 dans son avant-propos à L’Espèce humaine. Le titre du spectacle est resté L’Espèce humaine, en référence au livre et au-delà, et le projet s’est recentré autour de la figure de l’absent qu’a été des mois durant « Robert » auprès de son épouse Marguerite Duras et de son ami Dionys Mascolo. Robert Antelme est à la fois le héros et l’absent du spectacle. Pour ce qui est de l’évocation des camps, faute de pouvoir citer L’Espèce humaine, un témoignage s’imposait, celui que le journaliste et écrivain russe Vassili Grossman (l’auteur du futur et colossal Vie et Destin) rapporta du camp de Treblinka où il a enquêté longuement à l’heure de la libération du camp, lui avec chambre à gaz et crémation. Le spectacle est ainsi atomisé entre différents pôles comme des îlots (belle scénographie de Mathieu Coblentz et Vincent Lefèvre). A gauche Mascolo (Florent Chapellière), à droite et en haut Duras (Camille Voitellier), au centre, en contrebas Grossman (dont l’acteur Mathieu Alexandre semble le sosie), au centre en haut, dans la pénombre, les musiciens (Jo Zeugma au piano et à la voix, Vianney Ledieu chant, violon et alto). A un moment entrera en scène la carcasse d’une 4CV Renault disant la route, celle du retour. A chaque pôle, son texte. Comédiens et musiciens sont tous à louer. Dans Autour d’un effort de mémoire, Dionys Mascolo raconte comment lui et Robert, en septembre 1943, adhèrent au Mouvement national des prisonniers de guerre dont François Mitterrand (alias Morland) est le responsable. Robert Antelme est arrêté en juin 1944 peu avant le débarquement des Alliés, un silence s’abat sur la rue Saint-Benoît où vit Marguerite Duras et où vient souvent Dionys. L’amitié entre Marguerite et ces – ses – deux hommes est intense. Elle a épousé Robert ; plus tard, elle épousera Dionys. Dans La Douleur, Duras dit l’attente interminable et le retour à la vie chaotique de Robert. Dionys et Duras racontent l’un et l’autre comment, juste après la Libération, Mitterrand, devenu sous-secrétaire d’Etat aux Réfugiés, Prisonniers et Déportés du gouvernement provisoire, les informe que Robert a été retrouvé à Dachau, à bout de forces, qu’il doit être rapatrié d’urgence. Sans attendre, les services de Mitterrand préparent des uniformes, des ordres de mission, des bons d’essence et Dionys part avec son ami Georges Beauchanp (qui travaille au Ministère avec Mitterrand), une fois la voiture de ce dernier réparée. Ils retrouvent Robert. Commence le retour. « Je ne puis relater ce qui suit qu’au prix d’un effort analogue à celui qu’exigent les récits de rêve », écrit Dionys. Georges conduit, Dionys se tient à l’arrière avec Robert qui, bientôt, ne cesse de parler, de parler encore, racontant « tout ce qu’il a vécu, épisode par épisode, sans ordre, l’un évoquant l’autre ». Partis de Dachau, parvenus à Verdun, ils entrent dans une vaste brasserie presque comble. « Une vague de silence gagne bientôt toute la salle. [Antelme est passé de quatre vingt à trente cinq kilos]. « Une telle manifestation spontanée d’émotion collective, d’une intensité qui n’est comparable qu’à celle de certains rêves métaphysiques, je n’en connais pas d’exemples aussi purs », écrit Mascolo, dit l’acteur. A l’arrivée rue Saint-Benoît, l’écriture de La Douleur de Duras s’impose, après qu’on l’a vue taper à la machine. A la place des pages de Robert dans L’Espèce humain, la plume précise de Vassili Grossman nous raconte l’enfer de Treblinka, les corps dépouillés de tout y compris de leurs cheveux, la marche des corps nus vers les chambres à gaz, les corps brûlés jetés dans des fosses par d’autres prisonniers avant qu’on ne les gazent eux aussi. Avant dernier paragraphe (cité dans le spectacle), Grossman écrit : « Nous continuons d’avancer sur cette terre où le pas s’enfonce ; tout à coup, nous nous arrêtons. Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, de beaux cheveux de jeunes filles piétinés, puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair, et d’autres, d’autres encore. Le contenu d’un sac, d’un seul sac de cheveux, a dû se répandre là… C’était donc vrai ! L’espoir, un espoir insensé, s’effondre : ce n’était pas un rêve ! Les cosses de lupin continuent de rendre leur son clair et les graines de tomber, et on croirait toujours entendre monter de dessous terre le glas d’un nombre infini de petites cloches. » Par effluves, la musique accompagne les récits, le continuel lamento. A la toute fin du spectacle, tous les espaces font un seul corps dans un ultime silence, une fraternité finale. Un spectacle traversé par l’amitié extrême entre Robert, Marguerite et Dionys. Seul Robert, hors champ, si présent et pourtant absent, ne salue pas. Ah, j’oubliais, le titre complet du spectacle est L’Espèce humaine ou l’Inimaginable. Oui, l’inimaginable qui est ici palpable. Après Fahrenheit 451 (lire ici), ce nouveau spectacle de la compagnie Théâtre Amer que dirige Mathieu Coblentz poursuit plus avant et avec force son exploration-interrogation des points de fractures du XXe siècle et de leur héritage aujourd’hui. TNP de Villeurbanne du mar au sam 20h30, jeu 20h, dim 16h, jusqu’au 28 janvier. Puis du 1er au 5 fév au Théâtre des quartiers d’Ivry, le 10 fév au Théâtre André Malraux de Quevilly, les 1er et 2 mars au Théâtre de Cornouaille à Quimper, le 9 mars au Canal, théâtre du pays de Redon, le 23 mars au centre culturel de Vitré, le 20 avril à l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge. L’Espèce humaine de Robert Antelme est disponible en collection Tel chez Gallimard, La Douleur de Marguerite Duras en Folio, Autour d’un effort de mémoire de Dionys Mascolo est publié chez Maurice Nadeau, le récit sur Treblinka de Vassili Grossman se trouve, entre autres, dans ses Carnets de guerre, de Moscou à Berlin 1941-1945 en livre de Poche. Légende photo : Scène de "L'espèce humaine" © HL Parisot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 2023 6:02 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 16/01/2023 A travers une scénographie travaillée, Milo Rau explore l’énigme du passage de la vie à trépas, à travers la destinées de quatre acteurs, qui entourent une vieille dame qui a choisi d’être euthanasiée. C’est le visage de la vieille dame sur l’écran qui accueille le public. C’est elle qui nous fixe, sourire aux lèvres, tandis qu’on s’installe. On sait qu’elle va mourir, elle est peut-être déjà éteinte, saisie dans un plan fixe, mais non, sa boucle d’oreille scintille, c’est donc qu’elle a bougé sinon une oreille, du moins imperceptiblement son visage. En dessous, le plateau est un appartement en plan de coupe, à la manière des maisons de poupée. De la cuisine aux douches, en passant par la chambre et le salon, les pièces sont en enfilade et chaque détail se laisse observer. Comme toujours chez Milo Rau, le décor est un peu plus qu’un décor, chaque accessoire est en état de marche, la radio grésille, la cafetière électrique est allumée, le café est passé, et s’il n’en tenait qu’à nous, on monterait sur scène l’éteindre afin que son odeur surannée n’envahisse pas la salle. Sur le côté, une violoniste joue en live les airs que Johanna B. a choisis, tandis qu’un piano sera évidemment lui aussi utilisé. Comme on testerait son endurance à la douleur Le dispositif est simple : il entrelace les histoires qu’on suppose véridiques de quatre acteurs amateurs et professionnels, pendant que Johanna B. à qui le spectacle est dédié s’endort pour toujours devant nous à l’écran. Si, en accord avec sa famille, Johanna B. tient à montrer et à immortaliser ainsi sa fin, c’est parce que «la mort est un travail solitaire» a-t-elle dit à Milo Rau et son équipe. Mais l’est-elle moins, sur une scène de théâtre, devant une assistance ? Le passage de vie à trépas est-il seulement visible ? Faut-il faire l’expérience de cette vision pour en saisir la douceur, l’insupportable ou la limite, comme on testerait son endurance à la douleur ou à l’effort ? La pièce est brève, 1h30, et si le visage de Johanna B. paraît flotter constamment au-dessus de la scène, l’intelligence de Milo Rau est d’avoir entouré la mourante d’Arne Detremmerie, Anne Deyglat, Princess Isatu Hassan Bangura et Staf Smans, aux parcours suffisamment denses et captivants pour constituer des contrepoints à sa présence numérique. Leurs récits font-ils diversion à ce qui serait sans eux difficilement supportables ? Ou s’imbriquent-ils dans celui de Johanna B. ? Doit-on s’apprêter à quitter la salle ? Plusieurs mois après avoir vu la pièce, on garde en mémoire l’histoire de Princess, jeune comédienne qui enfant était restée avec son père à la Sierra Leone et qui eut la surprise, quand elle arriva aux Pays-Bas, d’être accueillie par des caméras comme une icône, tandis qu’on ne sait plus si Johanna B. s’exprime sur son lit à l’écran. Progressivement, tous les regards convergent vers Johanna B. Par son absence supposée d’ellipse, le dispositif est l’exact opposé de son autre pièce Everywoman, qu’on a vue à Paris en octobre et qui, elle aussi, accueillait la mort sur le plateau. Dans le travail scénique de Milo Rau, qui propose d’étudier à la loupe des situations réelles par des moyens propres à la dramaturgie – il récuse le terme de théâtre documentaire –, le son est particulièrement travaillé. Ainsi d’une alarme qui perturbe et questionne l’oreille – doit-on s’apprêter à quitter la salle ? – et débute l’air de rien parmi les spectateurs avant d’amplifier sa stridence sur le plateau. Ou encore, les hurlements des loups qu’écoute durant ses insomnies une ancienne vétérinaire et qui contaminent les autres récits en les nimbant d’une aura angoissante. «Grief and Beauty» de Milo Rau. Du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février à la Colline à Paris. Légende photo : Dans le travail scénique de Milo Rau, le son est particulièrement travaillé. (photo : Michiel Devijver)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 2023 4:58 AM
|
par Anne Diatkine, envoyée spéciale à Bordeaux - Publié le 16/01/23 La pièce créée avec les Ukrainiennes Dakh Daughters donne une autre dimension à l’œuvre inachevée de Pirandello, mort en 1936, alors que le fascisme gagnait peu à peu l’Italie. On les avait quittées en mars 2022 dans la petite ville de Vire-Normandie, dans le Calvados, où Lucie Berelowitsch qui dirige le Centre dramatique national (CDN) le Préau, les avait accueillies un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine avec enfants et proches. Un an plus tard, les Ukrainiennes Dakh Daughters sont toujours réfugiées à Vire-Normandie, où leurs enfants sont scolarisés et poursuivent la tournée européenne de leur cabaret punk Danse macabre tout en créant avec des comédiens français les Géants de la montagne de Luigi Pirandello, mis en scène par Lucie Berelowitsch. Les premières représentations ont lieu à Vire-Normandie et au Théâtre national de Bordeaux. Malédiction de l’écrivain Pirandello ? Les Géants de la montagne ? Rien d’évident. Il s’agit de la dernière pièce de l’auteur de Six Personnages en quête d’auteur, laissée inachevée à sa mort en 1936. Cette pièce-monde, que l’écrivain sicilien voyait comme son chef-d’œuvre, était aussi sa malédiction. Il s’y attelait depuis 1928, sept ans déjà, la concevant autant comme un hymne au «triomphe de l’imagination», que comme «la tragédie de la poésie dans la brutalité de notre monde moderne», explique-t-il dans une lettre. Rédigée durant les années de l’ascension au pouvoir de Mussolini sur lequel il avait d’abord espéré, elle porte la marque de son éloignement d’avec le fascisme. Car les Géants de la montagne, ce sont eux, ces êtres fantoches et terrifiants, qui menacent d’envahir une petite île où une troupe de comédiens s’est réfugiée à la recherche d’une maison-théâtre, où ils pourraient monter leurs tréteaux. Ils élisent une villa surnommée «la poisse» ou «la malchance», habitée par une comtesse et pléthore d’individus rêveurs et baroques au statut incertain, inventeurs d’un langage qui leur est propre. Comment va se faire la rencontre ? Va-t-elle avoir lieu avant que les géants ne détruisent toute velléité de poésie et ce petit monde porteur d’imaginaire ? Comme par un fait exprès, Pirandello est mort en laissant en suspens le mot «peur» et le bruit de cavalcade de ceux qui dévalent la montagne. A la fois un cadeau et un don On comprend comment, par sa portée politique et par son inachèvement tragique, la pièce de Pirandello, qui fut également montée par Klaus Michaël Gruber et, il y a une dizaine d’années, Stéphane Braunschweig, a saisi Lucie Berelowitsch, qui lui interpose d’autres textes, un poème de Pessoa notamment et surtout des compositions originales des filles du Dakh. Elles sont sur scène avec maints instruments et avant tout, leurs voix, leur prosodie, leurs rythmiques, leur fantaisie, leur énergie et la langue ukrainienne. Dans cette version, la pièce est à la fois un cadeau que la metteuse en scène leur cisèle et un don que les cinq jeunes femmes offrent au public. Il est formidable de les voir occuper chaque parcelle de l’espace, dans cette maison-paysage luxuriante et inquiétante pleine de débris de miroirs colorés. Il est fascinant de voir combien elles parlent et jouent juste, malgré une sonorisation outrancière qui uniformise les voix et ne permet pas toujours de savoir de quel corps elles proviennent. Est-ce fait exprès ou problème majeur ? Les comédiens qui incarnent la petite troupe en détresse apparaissent à leur côté les suppôts d’un théâtre vermoulu. Était-ce l’objectif ? Ils déclament, leur gestuel et voix «font théâtre», expression toujours connotée négativement dans la bouche des metteurs en scène. On éteint les écoutilles dès qu’ils prennent la parole. Dès lors, dans cet étrange combat des anciens et des modernes, où les Français jouent les acteurs en fuite mais conservateurs dans la pratique de leur art, une partie de la pièce de Pirandello s’est volatilisée. Heureusement, il y a les filles du Dakh… Les Géants de la montagne de Luigi Pirandello, mis en scène par Lucie Berelowitsch, en ukrainien et en français. Du 19 au 21 janvier au CDN de Normandie-Vire. Légende photo : Les Dakh Daughters parlent et jouent juste. (Photo : Simon Gosselin)
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 26, 2023 10:12 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 25 janvier 2023
Kingdom, texte (Edit. Actes Sud-Papiers, 2021), librement inspiré de Braguino de Clément Cogitore, et mise en scène de Anne-Cécile Vandalem.
Un spectacle de théâtre et de cinéma inventif qui invite la Nature sur le plateau de scène : maisons en bois, rivière qui coule sur le devant de scène, grands arbres conifères à jardin, chants des oiseaux et tressaillements des petites bêtes sauvages dans les fourrés, sans oublier les deux chiens, qui arpentent les lieux, comme s’ils étaient chez eux, sans public en position d’observateur.
On aurait envie de pénétrer dans la petite maison aux petits rideaux de tulle et s’installer avec ses habitants autour de la table de bois, tous serrés les uns contre les autres comme la famille entière.
Les personnages semblent vivre dans un autre temps et dans d’autres rêves, vêtus de chemises de bucheron et portant barbe de sage, de jeunes enfants auprès d’eux, ouverts à la vie. Les anciens racontent des histoires d’enfance et de légende, de vrais contes en images vécues. Et les enfants courent dans les environs ou se tiennent la main, à l’écoute des grands- dont le grand-père, le père et oncle, la mère et tante. Les enfants ramassent du bois, si l’un triche en volant à l’autre son dû, il doit se soumettre une réparation – échange et partage : une ville presque idéale…
D’un côté la forêt, et au-delà de la barrière, le territoire de l’autre. Partie aux confins de la taïga sibérienne pour fuir le bruit du monde et reconstruire un mode de vie idéalisé, une famille, rejointe par sa branche cousine, est rattrapée par tout ce à quoi elle tentait d’échapper.
Entre guerre de territoires, braconnage, incendies, et une vie qui doit composer avec la nature et les animaux sauvages, se joue un drame épique, un conflit ancestral. Librement inspiré du film documentaire Braguino de Clément Cogitore, Kingdom – dernier volet d’une trilogie commencée avec Tristesses et Arctique – traverse trois décennies d’une histoire familiale, sous le regard d’une équipe de cinéma passée par là.
Une lutte sans merci pour la survie, un royaume dans la forêt vu à hauteur d’enfants. Á travers l’épreuve de cette nouvelle génération, captive d’affrontements qu’elle n’a pas choisis, la metteuse en scène Anne-Cécile Vandalem conte l’échec d’une utopie, d’une communauté impossible, un monde en train de disparaître et que les plus jeunes devront réinventer.
Anne-Cécile Vandalem est metteuse en scène, auteure et actrice belge. Elle fait de la fiction son genre de prédilection et s’engage dans la mise en scène et l’écriture en 2003. En 2016, Tristesses, le premier volet de sa trilogie sur la fin de l’humanité est présenté au Festival d’Avignon. Avec ce premier opus, elle impose un style, à mi-chemin entre théâtre, cinéma et musique, qui interroge notre capacité d’action sur le réel. En 2018, elle crée Arctique, le second opus de sa trilogie.
Aujourd’hui, elle présente Kingdom, le dernier volet de l’ensemble, soit l’histoire de deux familles qui se sont extraites du monde moderne pour vivre en paix avec la nature. Mais au bout de quelques années passées dans un environnement aussi hostile que merveilleux, les méfiances et les ressentiments débordent. Le partage du territoire est jugé inéquitable et le sort semble s’acharner sur l’une des deux familles. Les coutumes des uns et les pratiques des autres mettent en péril l’équilibre déjà fragile de cette nouvelle société…
Puis un jour, une barrière est posée entre les deux familles. La guerre est déclarée. A quelques mètres du champ de bataille, les enfants assistent à ce monde en train de disparaître. Sous l’oeil d’un réalisateur, la tragédie se raconte…
Histoire de retour à la vie sauvage, de canards siffleurs, d’yeux scrutateurs tournés vers la rivière, de guerres familiales, d’hélicoptères, de braconniers, d’incendies.
Ce dernier volet de la tragédie d’Anne-Cécile Vandalem traite de l’échec temporel ou comment le futur ne peut plus résonner avec la promesse d’un monde meilleur, un sujet abordé à travers le regard des enfants qui seront les adultes de ce futur en question. Au cours de ses recherches, elle a découvert le travail de Clément Cogitore intitulé Braguino ou La Communauté impossible.
Selon leur génération, les membres de la famille sont pris en étau, entre deux manières d’appréhender l’espace et le temps. Or, tous partagent le temps de l’action – le temps présent de la Taïga, un moment durant lequel on ne peut pas s’apitoyer sur son sort. A la fin de l’été, on finit les activités qui détermineront le bon maintien des moyens de subsistance pour les saisons difficiles…
Kingdom est le royaume pour lequel les deux familles se sont extraites du monde, la promesse d’une paix trouver. Il est le territoire érigé par la première famille, partagé avec la seconde, le lieu où se joue la tragédie, le récit jamais écrit par le père, et celui qui se joue au théâtre.
L’arrivée d’une équipe de cinéma est le point de départ du récit. Ils ont pris contact avec la famille avec le désir de réaliser un film. La famille a accepté de les rencontrer s’ils choisissent leur camp. Ils devront renoncer à rencontrer l’autre famille : ils n’auront qu’une seule version de l’histoire.
Les personnages de l’histoire entretiennent un rapport animiste au monde : leur rapport à l’animalité, leur gamme de sensibilité au vivant, sont immenses. Ils représentent une « géo-poétique ». La nature est pour eux la condition nécessaire de leur survie, une puissante alliance avec la multiplicité du vivant pour préserver l’équilibre. Ils permettent le décentrement du regard : ils habitent autrement le monde, et surtout pas en conquérants.
Tout est mouvement permanent, et quand le feu détruira tout, ils devront fuir. Ils quitteront la Taïga couverte de cendres.
S’impose tangiblement sur le plateau la présence des quatre enfants et de deux jeunes adultes. Les enfants ont l’âge de la génération de leurs parents quand leurs grands-parents les ont extraits de la civilisation, les projetant dans un mode vie non choisi. Résister ou échapper à leur condition, les jeunes adultes s’y emploieront, l’un par la fuite, et l’autre par l’amour.
Ils sont tous dépositaires d’un héritage trans-générationnel face auquel ils devront se positionner.
A travers ce regard de la jeunesse, est déployé le regard de celle d’aujourd’hui, la « sacrifiée » qui observe le vieux monde mourir, sans être abattue ni désemparée, « ébranlée de se voir confier la responsabilité de sauver un monde que leurs parents n’ont pas réussi à préserver ».
Le spectacle se raconte du point de vue du réalisateur et des séquences tournées en direct. Tour à tour, sous l’oeil de la caméra, les membres de la famille se découvrent, ils témoignent de leur arrivée, de leurs souvenirs, racontent leur présent et leur futur de plus en plus difficile à percevoir.
La pièce alterne les séquences vidéo – interviews et portraits filmés dans l’intimité de la maison de la famille, plans de la nature…- et les scènes de vie du réalisateur et des membres de la communauté, de la découverte de l’utopie au témoignage criant de son échec.
La musique composée par Pierre Kissling et Vincent Cahay est une présence essentielle au spectacle – éléments concrets de la scénographie sonorisés – eau qui goutte, volet qui claque, mobile entraîné par le vent, bruissement des arbres, instruments détournés, réinterprétés par un musicien en salle. La forêt primaire en tant que protagoniste existe.
Avec Arnaud Botman, Laurent Caron, Philippe Grand’Henry, Épona Guillaume, Zoé Kovacs et Federico D’Ambrosio, Leonor Malamatenios – équipe de réalisation. Et les enfants Léonie Chaidron, Juliette Goossens, Isaac Mathot, Daryna Melnyk, Ida Mühleck, Eulalie Poucet, Noa Staes, Léa Swaeles et les musiciens Vincent Cahay, Pierre Kissling.
Dramaturgie Sarah Seignobosc. Scénographie Ruimtevaarders. Lumière Amélie Géhin. Vidéo Frédéric Nicaise. Son Antoine Bourgain. Costumes Laurence Hermant. Maquillage Sophie Carlier.Assistanat à la mise en scène Pauline Ringeade et Mahlia Theismann.
Une nature sauvage, hostile et dangereuse : éléments qui indiquent le temps qu’il fait, chant des canards sauvages, cris des chiens annonciateurs d’une menace, bruits d’hélicoptère, fantômes passés, vivants et morts, battements de coeur de la vie, de l’oncle nommé Sioux, sa pulsation.
Le public est à la fois enchanté et ravi, inquiet et troublé par les ressorts inconnus de l’homme dont on voit que tous les enfants à venir, lucides et clairvoyants, auront un monde à préserver et à défendre.
Véronique Hotte
Du 31 janvier au 19 février 2023, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h, à L’Odéon-Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier 75017-Paris. Tél : 01 44 85 40 40 Crédit photo : Christophe Engels.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 26, 2023 7:59 AM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 25 janvier 2023 Dans « La (Nouvelle) Ronde », Johanny Bert et ses marionnettes font valser identités sexuelles et pratiques amoureuses
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/dans-la-nouvelle-ronde-johanny-bert-et-ses-marionnettes-font-valser-identites-sexuelles-et-pratiques-amoureuses_6159305_3246.html
Le marionnettiste et metteur en scène Johanny Bert ne cesse de surprendre par sa capacité à se renouveler de création en création, en inventant toujours des formes d’expression diverses. Il aime varier les plaisirs et évolue aisément d’un registre à l’autre, du solo de marionnette en mode cabaret déjanté avec Hen (2019) à l’œuvre hybride entre l’installation et le spectacle vivant avec Làoùtesyeuxseposent (2021), en passant par des projets plus classiques comme Le Processus (2022), d’après un texte de Catherine Verlaguet. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Johanny Bert, marionnettiste, « J’aime le partage entre l’enfant et l’adulte lors de la découverte d’un spectacle » Pour son dernier opus en date, La (Nouvelle) Ronde, créé au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, en octobre 2022, il s’est lancé un nouveau défi : l’adaptation scénique d’un classique du théâtre, La Ronde, d’Arthur Schnitzler (1862-1931), écrit en 1897, publié en 1903 mais censuré dès 1904, et ce jusqu’en 1920, date de sa création à Berlin. En collaboration avec l’écrivain Yann Verburgh, il en propose une (re)lecture résolument moderne, en tenant compte de l’évolution de la société et des pratiques amoureuses. Leur travail de réécriture se fonde notamment sur une série de rencontres avec des personnes ayant accepté de témoigner sur leurs relations intimes (hétérosexuelles, bisexuelles, asexuelles, polyamoureuses, etc.). Ces témoignages constituent un point de départ concret, ancré dans la vie quotidienne, permettant de nourrir la fiction du récit. Reprenant la structure dramaturgique initiale de la pièce d’Arthur Schnitzler, à savoir une succession de dix courtes scènes avec toujours deux protagonistes vivant une relation sexuelle, La (Nouvelle) Ronde renouvelle totalement la distribution des rôles : les personnages blancs et hétérosexuels de Schnitzler (cinq hommes et cinq femmes stéréotypés, réduits à un statut social, comme la prostituée, le soldat, le comte, la femme de chambre, le poète, etc.) sont remplacés par des personnages censés refléter la diversité socioculturelle et ethnique de notre société. L’introduction notamment de plusieurs personnages transgenres invite les spectateurs à s’interroger sur les schémas de pensée classiques et sur la perception genrée des rapports intimes. Onirisme à la Fellini Un dispositif scénique original et innovant permet de faire défiler sous les yeux du public, sur une sorte de tapis roulant, les éléments de décor des différents tableaux qui composent le spectacle. Cela donne un sentiment de flux permanent, de défilement d’images en continu, comme dans un travelling cinématographique. Au cœur de ce dispositif, dix marionnettes de taille moyenne (1 mètre environ), aux visages expressifs et aux corps fortement sexués, sont habilement animées dans l’ombre par six acteurs-manipulateurs (trois filles et trois garçons) tout de noir vêtus, travaillant toujours en duo. La performance réalisée par cette toute jeune troupe est à saluer car ils-elles doivent à la fois manipuler les marionnettes (un exercice auquel tous n’étaient pas habitués) et interpréter leurs textes pour donner vie aux différents personnages et les rendre crédibles. A souligner aussi la prestation musicale de Fanny Lasfargues, qui orchestre en direct les différents tableaux. La performance réalisée par la toute jeune troupe de six acteurs-manipulateurs est à saluer Très réussi sur le plan formel avec la beauté plastique de ce dispositif scénique et l’accent mis sur la dimension onirique des fantasmes sexuels des personnages, le spectacle crée cependant, parfois, une sensation de malaise en plaçant le public dans une position de voyeur de scènes érotiques. Mais ce sentiment est contrebalancé par une bonne dose d’humour, de second degré et d’autodérision (la devise de Johanny Bert pourrait être : ne jamais trop se prendre au sérieux). Certaines séquences, comme l’exploration rocambolesque d’une boîte de nuit échangiste par un couple hétérosexuel, placées sous le signe d’un onirisme à la Fellini, viennent finalement rappeler le message principal de cette création : la recherche de l’amour reste au cœur de nos pratiques sexuelles, quelles que soient les multiples formes qu’elles peuvent prendre dans la société d’aujourd’hui. La (Nouvelle) Ronde. Conception et mise en scène : Johanny Bert. Ecriture : Yann Verburgh, d’après Arthur Schnitzler. Avec Yasmine Berthoin, Yohann-Hicham Boutahar, Rose Chaussavoine, George Cizeron, Enzo Dorr, Elise Martin. Création musicale et interprétation en scène : Fanny Lasfargues. A partir de 16 ans. Théâtre de la Ville-Les Abbesses, 31, rue des Abbesses, Paris 18e. Jusqu’au 28 janvier. A 20 heures. Puis en tournée, les 2 et 3 février au Bateau Feu, à Dunkerque (Nord), du 15 au 17 mars au festival Marto, au Théâtre 71 (Scène nationale), à Malakoff (Hauts-de-Seine). Cristina Marino / Le Monde Légende photo : Virginie, l’une des marionnettes de « La (Nouvelle) Ronde », de Johanny Bert, lors d’une répétition, le 11 octobre 2022, au Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 26, 2023 5:52 AM
|
La compagnie, menée par Jean-Christophe Meurisse, présente en tournée sa nouvelle farce tragi-comique, « La vie est une fête ».
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 25 janvier 2023
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/les-chiens-de-navarre-mordent-de-plus-en-plus-fort_6159325_3246.html
Les Chiens de Navarre mordent encore. Et mordent fort. Après s’être attaquée à l’identité nationale (Jusque dans vos bras, 2017), puis aux névroses familiales (Tout le monde ne peut pas être orphelin, 2019) la compagnie s’empare du thème de la folie. Folie d’une époque dite moderne où la perte de sens mènerait à l’aliénation et pourrait nous conduire – parce que nos dépressions ne sont pas seulement dues à notre vie intime mais aussi à l’état du monde – à tous devenir fou. « La vie est une fête », antiphrase amère choisie comme titre de leur nouvelle création, présentée en tournée, ne déroge pas au style trash et à l’humour sauvage qui a fait les beaux jours de cette meute théâtrale, emmenée depuis 2005 par le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse. Dès son arrivée, le public est plongé dans une redoutable séance de l’Assemblée nationale consacrée à la « facilitation du port d’armes ». Dans les travées de la salle, les acteurs-députés de tous bords politiques s’invectivent pendant que, sur scène, ministres et parlementaires tentent de défendre leur point de vue. Quant au président de l’Assemblée, il s’acharne, en vain, à obtenir un retour au calme. Ce prologue électrique fait tomber le rideau rouge pour nous plonger dans un hôpital psychiatrique au bord de la déliquescence où un député d’extrême droite est débarqué. Pendant que nos représentants se complaisent dans les passes d’armes, le service public hospitalier, lui, part à vau-l’eau. A une patiente qui consulte après une tentative de suicide, le médecin répond : « Franchement, parfois je vous envie. » Hilarité et irrévérence S’ensuit une succession de saynètes, toutes plus déjantées les unes que les autres, illustrant une société qui aurait atteint un point de non-retour. De la quadragénaire déprimée parce qu’en mal d’amour, qui se voit conseiller par une chirurgienne esthétique de se refaire tout le corps, au quinquagénaire mis à la porte de son entreprise par deux jeunes managers tout sourire de la start-up nation (« c’est fini les boomers »), en passant par un ministre de la santé venu visiter l’hôpital et entendre les doléances du personnel tout en restant impassible face à un patient schizophrène qui l’enduit de morve et d’excréments, La vie est une fête transgresse et dérange. A l’hilarité, souvent au rendez-vous, peut parfois succéder le malaise. Mais cette irrévérence, chère aux Chiens de Navarre, se veut à l’image d’une société brutale et à cran. Alors on rit de la tragédie pour ne pas sombrer. Les Chiens de Navarre n’ont que faire de la bienséance et excellent dans les moments qui partent en vrille Comme toutes les créations de cette compagnie, la conception de cette nouvelle farce tragi-comique s’est faite au plateau, par des improvisations. Jean-Christophe Meurisse propose un thème et deux ou trois pages avec des situations puis le travail collectif débute. La troupe s’est largement renouvelée, mais perpétue avec talent un engagement sans faille à tous les délires scéniques. Et ils sont légion. Les Chiens de Navarre n’ont que faire de la bienséance et excellent dans les moments qui partent en vrille. Le cadre viré a revêtu les habits du Joker de Joaquin Phoenix parce qu’il ne supporte plus qu’on se moque de lui – « vous comprenez ça, docteur », insiste-t-il −, le personnel de l’hôpital noie sa déprime dans une fête déjantée et CRS et « gilets jaunes » baignent dans l’hémoglobine. « Est-ce que la France peut avoir un peu de calme ? Est-ce que le peuple et l’Etat peuvent se faire un petit bisou ? », supplie une médecin. Comme à la fin de leur précédent spectacle (Tout le monde ne peut pas être orphelin), la mélancolie affleure, et avec elle l’humanité. Deux patients dépressifs, assis au pied d’une machine à café qui ne délivre plus depuis longtemps de boissons chaudes, partagent leurs angoisses. « Elle est cassée la machine, comme nous », glisse la femme à l’oreille de l’homme. Mais ils tentent de se réconforter. Le besoin d’espoir et d’amour est irrépressible. Tout n’est pas perdu. « La vie est une fête » par Les Chiens de Navarre, mise en scène Jean-Christophe Meurisse. Avec Delphine Baril, Lula Hugot, Charlotte Laemmel, Anthony Paliotti, Gaëtan Peau, Ivandros Serodios, Fred Tousch et Bernie. Du 26 au 28 janvier à la Maison des arts de Créteil, puis en tournée sur les scènes nationales, du 2 au 5 février au Havre, du 24 au 25 mars à Calais, du 30 au 31 mars à Maubeuge, du 5 au 6 avril à Annecy, du 13 au 14 avril à Roubaix. Et à Paris du 10 mai au 3 juin au Théâtre des Bouffes du Nord. Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : « La vie est une fête », de Jean-Christophe Meurisse. PHILIPPE LEBRUMAN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 2023 9:56 AM
|
Par Philippe-Jean Catinchi dans Le Monde - 25 jan. 2023 L’essayiste et universitaire d’origine roumaine, mémoire vive des scènes théâtrales et de leurs metteurs en scène, de Peter Brook à Wajdi Mouawad en passant par Antoine Vitez, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy ou Patrice Chéreau, s’est éteint le 21 janvier, à l’âge de 79 ans.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2023/01/25/la-mort-de-georges-banu-critique-de-theatre_6159265_3382.html Mémoire vive des scènes théâtrales du monde entier, essayiste et pédagogue d’une lumineuse érudition et d’une générosité inouïe, Georges Banu est mort à Paris, dans la nuit du 20 au 21 janvier, à l’âge de 79 ans. Le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier qui écrivit pour lui Le Théâtre et la Peur (Actes Sud, 2016) – il parle de leur « livre commun » – salue celui qui « a accompagné le travail des artistes avec critique et amour, devenant ainsi une archive vivante du théâtre européen ». Hommage amplement justifié. Né le 22 juin 1943 en Roumanie, ce fils de médecin choisit la voie des spectacles où l’illusion de la liberté perdure. Celui qui se rêve comédien dévore la vie en poète et en curieux. Il voit soudain dans la magie du théâtre la parade à la chape de plomb qui s’abat sur une Roumanie, déjà asphyxiée par la censure de Nicolae Ceausescu, quand le « Conducator » se met à l’école nord-coréenne. La révélation salutaire vient d’un Songe d’une nuit d’été, monté par Peter Brook à l’Opéra de Bucarest, d’une liberté et d’un magnétisme insolents. L’acteur qui incarne Puck, le génie facétieux, se mêle à l’assistance clairsemée et saisit alors la main de Georges Banu. Comme une invitation à l’évasion par-delà le rideau de fer. « Je me suis dit qu’il était temps de m’affranchir de la peur de partir. » « Le pas dans le pas des autres » Un an plus tard, Banu débarque à Paris, le 1er janvier 1973, inaugurant un exil dont il fera, mieux qu’un empire, un espace d’exploration sans limites. Ce grand large, il y naviguera un demi-siècle, guidé par les éblouissements et les amitiés. Témoin scrupuleux de la révolution du théâtre d’art, il se fait le compagnon d’une communauté d’artistes qu’il va soutenir et promouvoir. Il adopte la vigilante réserve d’Horatio, le compagnon de Hamlet, dont il fera son masque, s’attribuant ce rôle pour parler des êtres qui l’ont transporté dans de stupéfiantes contrées dont il se fait le guide. Un rôle de passeur essentiel pour celui qui aime citer son ami Antoine Vitez : « Le théâtre, c’est mettre le pas dans le pas des autres. » C’est ce que fera Georges Banu sans relâche. Pèlerin infatigable en quête du singulier, rejetant toute assignation, tout dogmatisme, posture héritée peut-être du rejet des carcans qui avaient emprisonné sa jeunesse, il se veut témoin et passeur. En tant que professeur, à l’université Paris-III-Sorbonne-Nouvelle, où il enseigne les études théâtrales. Tout comme celle qui devient alors son épouse, Monique Banu-Borie. En sa compagnie, il suit, avec une assiduité gourmande, festivals et créations internationales. Comme critique aussi, puisque Georges Banu, qui assure des cours au Centre d’études théâtrales de Louvain-la-Neuve (Belgique), collabore activement à la revue belge Alternatives théâtrales, créée en 1979, qu’il codirige de 1998 à 2015. Il y assure la direction de numéros spéciaux sur « les répétitions », « débuter » ou « les penseurs de l’enseignement », comme celle du volume collectif Les Voyages ou l’Ailleurs (2013) qui lui est judicieusement dédié. Comme éditeur puisque après s’être vu confier par Vitez, en poste à Chaillot, le journal de la maison, ce qui aboutit à la création de l’ambitieuse revue L’Art du théâtre (1985), il fonde en 1987, chez Actes Sud, à la demande d’Hubert Nyssen, la collection « Le Temps du théâtre », dont il assure la direction avec le concours de Claire David. Dans cette optique, il accueille ainsi, sollicite souvent, des essais consacrés aux metteurs en scène qui définissent son panthéon, figures emblématiques de la mise en scène moderne : Peter Brook bien sûr, comme Antoine Vitez, mais aussi Klaus Michael Grüber, Giorgio Strehler, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy et Patrice Chéreau. Comme essayiste enfin puisque, s’il a lui-même écrit sur Brecht (Aubier, 1981), Brook (Flammarion, 1991) et Yannis Kokkos (Actes Sud, 2004), Banu ne cessa de célébrer le choc qu’il ressentit en découvrant La Classe morte de Tadeusz Kantor, au festival de Nancy (1975) comme son enthousiasme pour le Théâtre Laboratoire du théoricien et pédagogue polonais Jerzy Grotowski et sa figure centrale, Ryszard Cieslak. Mais Banu sait aussi veiller à ceux qui arrivent : naguère Krzysztof Warlikowski, aujourd’hui Wajdi Mouawad. Car le geste de mise en scène et son interrogation du contemporain priment sans conteste pour Banu ; même si Tchekhov comme Shakespeare font figures d’exception, bénéficiant d’études monographiques puisque ces continents commandent le palimpseste par les vibrations toujours actuelles qu’ils proposent. Réinterroger le sens de la vie Parmi ses nombreux essais on distinguera deux trilogies. Celle parue chez Adam Biro, Le Rideau ou la Fêlure du monde (1997), L’Homme de dos (2000) et Nocturnes : peindre la nuit, jouer dans le noir (2005), qui interroge les artifices et les jeux de la scène tout en célébrant la peinture, passion intime qu’annonçait Le Rouge et or (Flammarion, 1989) ; celle dont deux volets parurent aux Solitaires intempestifs (L’OubliI, 2005, Le Repos, 2009) et La Nuit nécessaire (Adam Biro, 2004). Dans la réflexion de Banu, l’acteur n’est pas oublié. En marge de la star comme du révolté, l’essayiste célèbre l’insoumis, à la flamme contagieuse, « l’acteur plus qu’acteur » au cœur de ses Voyages du comédien (Gallimard, 2012), qui affirme la règle pour la mettre en tension, la déborder, la fragiliser avant qu’advienne la révélation. Mais l’homme finit par exposer ses failles. Dans son dernier ouvrage, Horatio se livre de façon plus intime, présentant ces objets usés, polis ou marqués par le passage du temps, indices de blessures précieuses, statues brisées, tableaux endommagés, œuvres calcinées, qu’il conserve dans son appartement, vestiges de toute vie accidentée (Les Objets blessés, Cohen & Cohen, 2022). Or, sans accidents, pas d’occasion de réinterroger le sens de la vie. Et c’est encore vers Peter Brook que Banu se tourne pour avoir non la réponse mais le bon questionnement. Le maître n’a-t-il pas confié aux Bouffes du Nord en février 2020 : « Apprenez à poser des questions, mais sans toujours chercher des réponses. Gardez en vous-mêmes une question, définitivement, une question en attente de réponse ! » Et Banu de commenter dans la revue Alternatives théâtrales son « indissoluble, énigme irrésolue, inoubliable ! ». Georges Banu en quelques dates 22 juin 1943 Naissance à Bucarest 1973 Arrivée en France 1986 « L’Acteur qui ne revient pas » 1998-2015 Codirecteur de la revue « Alternatives théâtrales » 2012 « Les Voyages du comédien » 2021 « Les Récits d’Horatio » 21 janvier 2023 Mort à Paris Philippe-Jean Catinchi Légende photo : Georges Banu, chez lui à Paris, le 16 août 2013. LEA CRESPI/PASCO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 8:23 PM
|
Par Louis Juzot dans le blog Hottello, 23 janvier 2023
La Force qui ravage tout, texte, mise en scène et musique de David Lescot, compagnie du Kaïros.
La comédie musicale de David Lescot est placée sous le signe de l’Orontea, opéra d’Antonio Cesti (1623-1669) et débute sur l’air de Silandra, courtisane et protagoniste de cet opéra à l’intrigue emberlificotée, « Adio Corrinda ».
D’intrigue emberlificotée, de jeux de rôles et de masques, de fuites et de flirts dans la nuit, de trafics divers est aussi constituée « La Force qui ravage tout ». L’intrigue décrit en deux nuits et un jour les changements d’humeurs de personnages qui se sont justement croisés par hasard dans un restaurant après une représentation du dit opéra.
David Lescot a réuni la même troupe talentueuse qui a fait le succès de « la Femme qui se déplace » avec un concept similaire de comédie musicale relookée aux préoccupations du moment. Cette fois-ci, le glyphosate voisine avec les lobbyings pour ne pas dire plus (une belle prémonition des scandales actuels) au sein du parlement européen, l’économie informelle, la PMA et la relativité sexuelle, tout ce qui fait l’esprit du temps.
Mais l’émotion artistique est la valeur la plus forte, celle qui fait tomber les masques ou conduit à des dérives inattendues, depuis qu’existent l’opéra, le théâtre et depuis encore plus longtemps les transes collectives et les rituels ancestraux.
Un argument qui tient autant des méandres sentimentaux du dix septième siècle que des comédies de Broadway, mais emmené avec vivacité et talent par une troupe très homogène, sous l’impulsion du maître des lieux, David Lescot, qui incarne une âme errante, désemparée à la recherche de Silandra et de sa troupe évanouie dans la nuit.
Même si Ludmilla Dabo, Elise Caron, Pauline Collin et Mathias Girbig ont des rôles taillés sur mesure, tous les acteurs, à la fois chanteurs comédiens, sont irréprochables : Candice Bouchet, Marie Desgranges, Alix Kuentz, Yannick Morzelle en alternance avec David Lescot, Emma Liégeois, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier.
Ils se dédoublent, assumant deux ou trois rôles, virevoltant, poussant les tables et les chaises du restaurant, le lit où se font et se défont les couples, la tribune du Parlement : trois espaces symboliques où s’entrelacent les virages et les rebonds des personnages.
David Lescot assume la composition et quatre musiciens – Anthony Capelli, Fabien Moryoussef, Philippe Thibault , Ronan Yvon – assurent en fond de scène l’accompagnement des chants et des chorégraphies avec punch.
Pas de temps mort comme sur la scène, ambiance gentiment jazzy à la Michel Legrand, tradition oblige.
L’esprit Jacques Demy plane autant que celui d’Antonio Cesti, les chansons succèdent aux mouvements de groupe, pas de violence, pas d’inquiétude …
L’ensemble est cousu de main de maître et le public est ravi. On peut se dire que tout cela est bien léger et que quelques heures après être sorti de cet Orontea revisité, il ne restera l’impression que d’un bon divertissement. Mais il faut aussi savoir oublier Pascal, de temps en temps, et accepter l’artifice comme un baume réconfortant, momentané et non toxique, c’’est déjà pas si mal.
Louis Juzot
Jusqu’au 27 janvier 2023, 20h, dimanche 15h, Théâtre de la Ville, Espace Cardin.Tel: 01 42 74 22 77, theatredelaville-paris.com. Du 1er au 4 février 2023, CDN Tours. Les 28 février et 1er mars 2023, Château Rouge, Annemasse. Le 10 mars 2023, Théâtre de Rungis. Les 17 et 18 mars 2023, Scène nationale de Perpignan. Du 25 au 27 mai 2023, MAC Créteil. Le 8 juin, Scène nationale de Quimper.
Crédit photo: Christophe Raynaud de Lage.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 8:17 AM
|
Propos recueillis par Olivier Milot / Télérama le 20/01/23 L’Association des centres dramatiques nationaux (ACDN) a mené une enquête sur la situation des théâtres qui la composent. Deux dirigeants de CDN, Émilie Capliez et Joris Mathieu révèlent et commentent des chiffres parfois inquiétants pour l’avenir. lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/debats-reportages/pourquoi-les-centres-dramatiques-nationaux-vont-ils-devoir-renoncer-a-certaines-de-leurs-creations-7013897.php
Ici, « l’art et la vie ne font qu’un ». Cette phrase est celle d’une œuvre de l’artiste de street art Miss Tic. C’est celle choisie par Rima Abdul-Malak pour illustrer la carte de vœux du ministère de la Culture cette année. Ce pourrait être aussi une allégorie de ce que sont les centres dramatiques nationaux (CDN), ces fabriques de théâtre où des milliers de femmes et d’hommes œuvrent chaque jour à créer de nouveaux spectacles originaux. Comme tous les lieux de culture, les CDN ont l’obsession de renouer leur lien avec un public dont les usages ont été bousculés par la pandémie et le sont aujourd’hui par l’inflation. Ils doivent aussi composer avec une équation financière délicate avec, d’un côté, des augmentations élevées des coûts de l’énergie et une hausse des salaires et, de l’autre, des collectivités territoriales dont certaines ont décidé de faire de la culture une variable d’ajustement de leur budget et coupent dans les subventions. Dans ce contexte, l’Association des centres dramatiques nationaux (ACDN) qui regroupe les trente-huit établissements, a décidé de mener une enquête auprès d’eux pour disposer d’une vision globale de leur situation. Elle offre une photographie contrastée, avec des théâtres bien plus exposés que d’autres aux difficultés du moment, et le besoin pour tous d’inventer de nouvelles manières de créer sous la pression des bouleversements économiques et environnementaux. Émilie Capliez, codirectrice de la Comédie de Colmar, et Joris Mathieu, directeur du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, respectivement présidente et vice-président de l’ACDN, dévoilent les résultats de cette enquête et les analysent. “Certains spectateurs se montrent plus frileux à s’engager très en amont sur une date de spectacle. Il y a désormais beaucoup plus de billetterie de dernière minute.” Émilie Capliez La fréquentation des CDN a baissé en 2022 par rapport à la période pré-Covid, dans quelles proportions et comment l’expliquez-vous ?
Joris Mathieu : En moyenne, elle a baissé de 21 %, mais la situation est très hétérogène. Un tiers des théâtres a retrouvé son niveau de 2019 et, pour la majorité des autres, ce recul se situe entre 10 et 15 %. Cette baisse n’est pas notre première source d’inquiétude. Nous avons au contraire l’impression d’un retour progressif à la normale plus rapide que ce qu’on pouvait craindre. Après, comme tous nos concitoyens, notre public est confronté depuis le deuxième semestre 2022 à la hausse du coût de la vie, et on peut penser que certains spectateurs sont amenés à limiter le nombre de leurs sorties.
Émilie Capliez : On constate également une évolution des pratiques. Certains spectateurs se montrent plus frileux à s’engager très en amont sur une date de spectacle. Il y a désormais beaucoup plus de billetterie de dernière minute.
Quel est l’impact de l’inflation des coûts de l’énergie et des hausses salariales ?
E.C. : L’augmentation des coûts de l’énergie représente en 2022 1,3 million d’euros de dépenses supplémentaires pour l’ensemble de nos structures. La hausse de la masse salariale s’élève, elle, à 1,2 million d’euros pour les permanents et à 400 000 euros pour les intermittents.
“Les baisses de subvention ne sont pas toujours homogènes sur l’ensemble d’un territoire comme en Auvergne-Rhône-Alpes, où elles ont ciblé certains établissements avec des variations parfois très fortes.” Joris Mathieu J.M. : En moyenne, pour chacun des CDN, c’est une augmentation de 110 000 euros de charges avec des hausses qui, pour l’essentiel, sont intervenues sur le deuxième semestre 2022. Si on fait une projection en année pleine en 2023, on devrait avoisiner les 200 000 euros d’augmentation. C’est d’autant plus inquiétant que ces chiffres ne tiennent pas compte de charges plus invisibles mais qui pèsent lourdement sur notre activité, comme la hausse des coûts de production liée à celle des matériaux, des décors, du fret qui a pris 30 % en six mois, ou encore de l’hôtellerie. Plusieurs régions et départements ont annoncé des coupes dans leurs subventions. Le réseau des CDN est-il impacté par ces baisses ? Si oui, dans quelles proportions ?
J.M. : En 2022, un tiers des CDN ont déjà été confrontés à des baisses de subventions. L’inquiétude pour cette année est donc très forte. Ces baisses émanent de plusieurs conseils régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est et plus récemment dans les Pays de Loire. Elles ne sont pas toujours homogènes sur l’ensemble d’un territoire comme en Auvergne-Rhône-Alpes, où elles ont ciblé certains établissements avec des variations parfois très fortes. À titre d’exemple, le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon a été impacté par une réduction de 15 % de sa subvention, soit une somme de 26 000 euros. Une baisse loin d’être anodine dans notre budget, même si elle est moins importante que pour d’autres structures comme le Théâtre national populaire de Villeurbanne dont la subvention a, elle, chuté de 150 000 euros.
Lors de la présentation de ses vœux, la ministre de la Culture a dénoncé les coupes budgétaires opérées par certaines régions en affirmant que “la culture ne peut pas être une variable d’ajustement”. Vous souscrivez ?
J.M. : Évidemment. Ce qui nous préoccupe, c’est que l’État seul ne peut pas absorber toutes les hausses que nous subissons, surtout quand elles sont couplées avec des baisses de subventions. Le financement de nos structures est co-partagé entre l’État et les collectivités territoriales. Notre crainte est de voir cette co-construction des politiques culturelles voler en éclats en période de crise, du fait de l’attitude de certains exécutifs régionaux qui utilisent justement la culture comme variable d’ajustement de leur budget.
Aux dernières Biennales internationales du spectacle, on a beaucoup entendu dire que l’État avait bien du mal en ce moment à jouer son rôle de pilote dans le secteur de la culture…
J.M. : L’État reste la colonne vertébrale d’une politique culturelle à l’échelle du territoire. Ce qui peut questionner, c’est la manière dont l’exécutif d’une région comme la nôtre, Auvergne-Rhône-Alpes, peut prétendre individualiser sa politique dans le domaine culturel et se désolidariser d’une co-construction des politiques publiques culturelles alors même que la culture ne représente que 2,5 % de son budget global, soit deux à trois fois moins que ce que l’État investit dans la région.
“Il nous revient de repenser notre modèle. On va probablement produire différemment, diffuser les œuvres sur un temps plus long, responsabiliser nos pratiques en termes d’environnement…” Émilie Capliez Ces hausses de l’énergie et des salaires cumulées dans certaines régions à des baisses de subventions ont-elles un impact sur la création ?
E.C. : Tout l’enjeu est là. Les CDN abritent beaucoup d’artistes, d’artistes associés, et nous avons besoin de pouvoir soutenir toute cette chaîne de création et de diffusion de spectacles. La situation est certes hétérogène au sein du réseau, mais chacun d’entre nous sera soumis à des arbitrages plus ou moins contraignants.
Produire moins mais diffuser plus et à proximité des lieux de création pour des questions environnementales pourrait-il être une solution à ces crises ?
E.C. : Nous vivons une période de transition où nous sommes contraints d’analyser en permanence ce qui nous arrive tout en restant dans l’action. Il nous revient donc d’imaginer une forme de décélération, de repenser notre modèle. On va probablement produire différemment, diffuser les œuvres sur un temps plus long, responsabiliser nos pratiques en termes d’environnement… Ce doit être un projet global, mûri à l’échelle de toutes les scènes labellisées et dont les solutions ne pourront être que collectives.
Olivier Milot / Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 6:40 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 23 janv. 2023 Nourries des textes et expériences de psychiatres novateurs depuis Clerambault jusqu’à Oury en passant par Deligny, sur des propositions d’Isabelle Lafon, dans « Je pars sans moi », les deux actrices traversent deux siècles à travers des textes et des destins dont la folie est l’ordinaire. Une soirée folle. Si j’en crois leurs biographies, Nous demeurons, le premier spectacle réunissant Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes mettait déjà en scène des récits de personnes aliénées de la fin du XIXe siècle. Je n’ai pas vu ce spectacle. Je les ai rencontrées un peu plus tard dans Deux ampoules sur cinq, spectacle inoubliable qui se déroulait dans le terrier du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, spectacle magique dans ce sous-sol tout aussi magique où les spectateurs éclairaient les deux actrices avec des lampes torches. A travers les écrits de Lydia Tchoukovskaia sur la grande poétesse russe Anna Akhmatova et et leurs nombreuses conversations, les deux actrices racontaient l’amitié entre Lydia et Anna. Depuis Isabelle et Johanna ne se sont jamais quittées. On retrouvait Johanna, seule avec Isabelle ou avec d’autres dans les spectacles qui allaient suivre : La Mouette de Tchekhov, Bérénice de Racine , Let me try d’après Virginia Woolf, Vues lumière, la trilogie Les insoumises regroupant le spectacle sur Akhmatova, celui sur Woolf et enfin L’Opoponax de Monique Wittig où, cette fois, Isabelle Lafon était seule en scène, et récemment Les imprudents d’après les dits et les écrits de Marguerite Duras. Et les voici de nouveau toutes les deux, seules en scène, dans Je pars sans moi, une création qui renoue avec l’approche de leur tout premier spectacle puisqu’elles puisent principalement dans des travaux du psychiatre Gaétan de Clérambault et des écrits de Fernand Deligny dont l’édition des œuvres, établie par Sandra Alvarez de Toledo, est parue aux Editions l’Arachnéen il y a quelques années. A la table chargée de livres d’Anna et de Lydia d’hier succède aujourd’hui une porte posée sur un plateau nu dont il sera plusieurs fois question. Le titre du spectacle est le début d’une phrase extraordinaire de Yanis Benhissen (extraite de Le livre de Yanis. Livre de rencontre dans les écritures avec Patrick Laupin, éditions La rumeur libre) dont la totalité dit le mouvement follement binaire du spectacle : »Je pars sans moi, Tu n’as qu‘à m’attendre là-bas ». Dedans et dehors, ici et là, avec et sans, un jeu de renversements permanents. Une folie follement douce, attentionnée. Qui coagule tout, les identités et les siècles. Johanna parle d’ une couturière de de 55 ans amoureuse d’un prêtre depuis l’âge de 17 ans. « Un prêtre magnifique qui fait penser avec ses yeux bleus à Jean Oury » (fondateurs de la clinique de La Borde qu’il dirigea jusqu’à sa mort) . On entre dans cette histoire comme dans un moulin, la couturière finit par « croquer » le sexe du prêtre resté sans voix après qu’un jour elle lui ait dit ses poèmes, raconte-t-elle au docteur Clérambault à la fin du XIXe siècle , et aujourd’hui à nous. Les temps, les siècles se mêlent, la porte dressée en arrière-plan sur la scène est comme une balise. Johanna parle longuement du psychiatre catalan François Tosquelle, Isabelle parle de son grand-père. On entre dans des histoires qui cohabitent, se mêlent, à un moment on entre dans l’hôpital psychiatrique de Saint Alban. Ça va, ça vient, ça traverse. Vers la fin, Isabelle et Johanna sortent la porte en coulisses. Après avoir si intimement surfé avec l’extrême fragilité des êtres, il est temps de danser sur le plateau nu comme un parquet de bal. Dans son texte Les vagabonds efficaces, Fernand Deligny raconte ces jours où il recevait dans un ancien théâtre qui avait été celui de Dullin. « Quelquefois, en arrivant, vers neuf heures, je voyais un mur abattu. Albert S. m’attendait, assis en face de ma table. Il avait frappé. Je n’avais pas répondu. La porte était fermée. Alors, il avait abattu le mur d’un coup d’épaule. » Ensemble ils remettait en place les planches du mur, car le propriétaire du lieu leur cherchait noise. Deligny poursuit : « Albert S avait dix-neuf ans , un mètre quatre vingts. Il était nègre et pupille de cette Assistance publique dont il cassait la figure aux directeurs départementaux. Il disait : « Tu rigoles, Deligny, tu ne ne m’en veux pas ? Tu viens boire un crème ? » Histoire de voir si je n’étais pas un peu directeur de quelque chose sur les bords et dans le fond. » Le théâtre d’Isabelle Lafon, c’est cela : « sur les bords et dans le fond ». Je pars sans moi, conception et mise en scène Isabelle Lafon, écriture et jeu Johanna Korthals Altes et Isabelle Lafon. Théâtre de la Colline , mar. 19h, du mer. au sam. 20h, dim. 16h jusqu’au 12 fév. Photo Laurent Schneegans

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 22, 2023 6:10 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 22 janvier 2023 Il aurait eu 80 ans à l’orée de l’été prochain. Né en Roumanie, il vivait en France depuis cinquante ans. Universitaire, essayiste prolifique, c’était un pédagogue aimé de ses étudiants et un essayiste aux larges visions.
Il avait une voix douce et un léger accent, avec des « r » roulés et tendres. Il n’était pas immense de taille. On ne l’a jamais connu autrement que barbu. On ne sépare pas Georges Banu de son épouse, Monique Borie-Banu, qui l’accompagnait dans les salles de théâtre, et c’est à elle que l’on pense en ce triste matin d’hiver. Georges Banu s’est éteint le 21 janvier. Il avait 79 ans. Il était né à Buzau en Roumanie et avait échappé aux sombres années Ceausescu en s’exilant en France au début des années 70. Il y trouva vite une place très importante, dans le monde du théâtre. Professeur, à Paris III, Sorbonne nouvelle, il aura formé des générations d’étudiants se destinant à l’enseignement ou au jeu. Critique dramatique, il avait un jugement toujours nuancé, équilibré. Il aimait faire connaître, célébrer. Mais il était lucide et, ces dernières années, il était parfois perturbé par certaines personnalités sans culture et par des spectacles tape-à-l’œil. Il participait notamment aux émissions d’Alain Veinstein, sur l’antenne de France Culture. Notamment avec Bernard Dort. C’était le temps si brillant des années 80. Georges Banu était classique dans sa formation : des Grecs à Ionesco, son compatriote, il embrassait toutes les formes de théâtre. Il avait été très proche d’Antoine Vitez. Il se passionnait pour les écritures contemporaines, mais sans se laisser aveugler. Il était d’une génération heureuse qui put être nourrie des créations des grands maîtres. De Tadeusz Kantor à Patrice Chéreau, en passant par Peter Brook qu’il révérait. Il a écrit des dizaines d’ouvrages aussi savants que savoureux, des essais rigoureux et de très beaux albums. On ne saurait tous les citer, mais on n’oublie pas, entre autres, L’acteur qui ne revient pas, sur l’art japonais du théâtre, Le Rouge et l’Or, sur les théâtres à l’Italienne, ses biographies analytiques et beaux ouvrages de Peter Brook, Bertolt Brecht, Yannis Kokkos. Citons encore le très troublant Homme de dos, Amour et désamour du théâtre, et le dernier, Les Récits d’Horatio, sous-titré « portraits et aveux des maîtres du théâtre européen ». On peut dire que Georges Banu aura passé sa vie, riche et colorée, à faire connaître et aimer le théâtre. Il était très actif, très aimé dans le monde entier. Il voyageait. Il connaissait, découvrait. C’était un éclaireur. Il va nous manquer. Mais il laisse ses livres, précieux, et d’une lecture heureuse. Armelle Héliot Légende photo : Un homme réfléchi et généreux. Photographie DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2023 6:48 PM
|
L’ancien directeur du Théâtre du Peuple de Bussang, Simon Delétang, vient de prendre ses fonctions à la tête du Théâtre de Lorient. Quel bilan tirez-vous de vos cinq années à la tête du Théâtre du Peuple de Bussang ? Simon Delétang : Ce fut une expérience singulière, au plus près d’un territoire où il y a énormément à faire. Pendant cinq ans, j’ai poursuivi la professionnalisation du Théâtre du Peuple, multiplié les actions en matière d’éducation artistique et culturelle, mais aussi structuré un réseau grâce à un travail de terrain. Mon idée était de faire de Bussang un haut-lieu du théâtre populaire et pas seulement un lieu de divertissement estival, de répondre à cette utopie du théâtre pour tous et à la désertification culturelle qui touche cette région. J’ai dû me mettre davantage à l’écoute des gens, inventer un nouveau rapport au public et créer plus de proximité avec lui. L’instauration d’une grande création à l’automne, tout comme le projet Lenz, m’ont permis, je crois, d’apporter ma pierre à l’édifice, et de faire grandir ma conscience des territoires. Cela m’a demandé beaucoup d’énergie, m’a fait vieillir plus vite, mais cela valait le coup. Pourquoi avoir décidé de quitter Bussang alors que votre mandat courait jusqu’en 2025 ? Mon mandat a été renouvelé sur la base d’un nouveau projet sur les termes duquel, une fois leur décision prise, les membres de l’association qui gère le théâtre souhaitaient revenir. Je voulais notamment faire évoluer la saison d’été, et plus particulièrement le spectacle du soir, car l’alternance engendre une lourdeur technique et financière qui grève le disponible artistique et empêche de dégager des marges pour le reste de l’année. Prenant acte de ces blocages, j’avais dit à l’association que je tenterais de partir pour mener une aventure ailleurs. L’été dernier, j’ai aussi eu l’impression d’atteindre une forme d’accomplissement artistique, professionnelle et personnelle, d’avoir trouvé la bonne formule pour Bussang : l’organisation était impeccable, le public au rendez-vous, les spectacles ont eu du succès. Il aurait donc été particulièrement difficile pour moi de me remotiver pour imaginer une nouvelle saison si je n’avais pas été nommé à Lorient. Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce CDN en particulier ? Je le connaissais pour y avoir joué, il y a près de dix ans, La Mort de Danton dans la mise en scène de Ludovic Lagarde. À l’époque, j’avais été marqué par le fait que, depuis les loges, on puisse voir les pelouses du stade du Moustoir, par ce lien étroit entre le théâtre et le sport. Par le passé, j’ai également eu l’occasion de faire une tournée décentralisée en Ille-et-Vilaine avec un spectacle sur le foot à partir d’On est les champions de Marc Becker. Alors, au moment où j’ai appris le départ anticipé de Rodolphe Dana, j’y ai vu une contingence positive, une occasion de me rapprocher de cette région authentique, avec une spécificité culturelle très forte. Le Théâtre de Lorient est lui aussi très spécifique, et notamment marqué par l’empreinte d’Eric Vigner qui, avant Rodolphe Dana, l’a dirigé pendant 20 ans… Même dans sa structuration, celle d’un EPCC, résultat de la fusion entre un CDN et un théâtre municipal, ce lieu est atypique, et je crois que c’est cela qui m’intéresse car cet atypisme me permet de faire un pas de côté. Tout l’enjeu sera de faire la synthèse entre ce que Rodolphe Dana et Eric Vigner ont initié, entre des spectacles grand public, avec des actrices et des acteurs connus qu’on a envie de voir, et de la création contemporaine. La programmation du Théâtre de Lorient est aussi pluridisciplinaire, ce qui est nouveau pour moi, et je compte bien proposer des formes différentes et tisser des liens entre les disciplines, par exemple entre la danse et le jeune public. Comment se déclineront ces intentions ? À travers un projet intitulé « Pour un théâtre de terrain ». Le mot « terrain » a une double signification et fait référence, à la fois, au territoire et au terrain de sport. Je souhaite profiter de notre voisinage avec le stade du Moustoir pour aller au contact de tous les publics, pour encourager les supporters de foot – avec qui je désire, par ailleurs, conduire un projet de création – à venir au théâtre, mais aussi les spectateurs de théâtre à se rendre au stade, grâce à des billets couplés ou à des opérations spécifiques. Je veux aussi accentuer le travail sur les territoires, et notamment dans l’arrière-pays rural où il sera important de développer un réseau avec plusieurs partenaires. Pour cela, je m’appuierai sur le comédien Julien Chavrial qui garde son statut d’acteur permanent et sera chargé de mener différentes actions, mais aussi sur une logique de co-construction avec les communautés de communes. J’ai également l’intention de créer des nouveaux temps forts sur le territoire, des lieux du patrimoine lorientais jusqu’aux plages, afin que le théâtre sorte de ses murs et puisse toucher le public le plus large possible. Serez-vous accompagné par des artistes en particulier ? J’ai choisi d’associer à ce projet dix artistes compagnons : l’autrice Leïla Slimani – qui écrira sa première pièce de théâtre que je monterai en 2025 –, la circassienne Chloé Moglia, les chanteuses lyriques Sabine Devieilhe et Stéphanie d’Oustrac, l’autrice Magalie Mougel – qui portera notamment un projet de théâtre jeune public –, le comédien Vincent Dedienne, le circassien-conteur Bonaventure Gacon, le chorégraphe Thierry Thieû Niang, le metteur en scène Clément Hervieu-Léger et le chanteur Stéphane Degout. L’idée est de faire participer chacune et chacun à des temps forts que je veux mettre en oeuvre. En parallèle, nous soutiendrons quatre compagnies pour des créations de théâtre pur : celles de Lena Paugam, Emmanuel Meirieu, Julie Guichard et Antoine de la Roche qui travaille notamment dans les salles des fêtes. On sait que les changements de direction à la tête des CDN sont des moments charnières, parfois générateurs de tensions, notamment dans un lieu tel que le Théâtre de Lorient qui vient de vivre plusieurs années difficiles. Comment vous y êtes-vous préparé ? Je suis assez armé car j’ai déjà géré deux théâtres, ce qui me permet de ne plus avoir de fausses attentes. Lors de sa mandature, Rodolphe Dana a dû gérer la fusion du Grand Théâtre de Lorient et du CDDB. Ce fut une lessiveuse pour lui, mais cela l’aurait été pour n’importe qui. Aujourd’hui, tout va mieux et je vais pouvoir travailler avec une équipe jeune, débordante d’envie, qui a beaucoup d’attentes par rapport à ma prise de fonction. Toutefois, je les ai déjà mis en garde : mon projet se mettra en place progressivement et il faudra au moins deux ans pour qu’il soit effectif car tout ce que je veux développer prendra beaucoup de temps. Par ailleurs, j’ai conscience de ce qui n’allait pas pour unifier le CDDB et le Grand Théâtre, pour avoir trois salles, si on ajoute le Studio, mais un établissement unique. Pour le moment, les strates de l’histoire qui ont abouti à la création de ce CDN sont encore beaucoup trop perceptibles, et nous allons avoir beaucoup de travail à fournir pour donner une visibilité, une accessibilité et une lisibilité à ce projet. Afin que les Lorientaises et les Lorientais se réapproprient ce lieu, j’ai d’ailleurs décidé de mener une consultation populaire pour donner le nom d’un artiste à chacune des salles, comme gage d’unité. Parallèlement à votre prise de fonction à Lorient, vous mettez en scène La Mort de Danton à la Comédie-Française. Pourquoi avoir fait ce choix qui apparaît symbolique lorsqu’on connaît l’histoire tumultueuse de la Maison de Molière et de la Révolution française ? J’ai repoussé au maximum le moment où j’allais m’atteler à cette pièce très complexe. À l’histoire de la Révolution française, s’ajoutent de multiples références à l’Antiquité, mais aussi la vision qu’un auteur allemand, en l’occurence Büchner, a de ces événements. Mon choix s’explique avant tout par la volonté d’organiser une rencontre entre un texte et une institution car La Mort de Danton n’avait jamais été jouée à la Comédie-Française. Or, il y a un véritable vertige à croiser l’histoire de ce lieu et l’histoire de France, surtout lorsque l’on sait que la troupe du Roi avait, à l’époque, été sauvée in extremis de la guillotine par un bienfaiteur. C’est aussi une grande pièce de théâtre, très inspirée de Shakespeare et de Goethe, mais également particulièrement documentée. Elle conte, avant tout, l’histoire d’une révolution sociale qui n’a pas eu lieu et montre comment une génération d’hommes s’est auto-détruite. Au long de sa réflexion sur la mort et sur la fin, cette oeuvre développe une forme de mysticisme. Pour autant, les personnages n’ont rien à voir avec des soldats de plomb, mais sont avant tout des êtres de chair et de sang. Propos recueillis par Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 20, 2023 1:15 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 20 janvier 2023 La première création de David Bobée depuis qu'il a pris la direction du Théâtre du Nord est une réussite. Son « Dom Juan » musical et flamboyant nous plonge dans un cimetière de statues, allégorie d'un monde agonisant. La verve rebelle de Molière est restituée par une belle troupe diversifiée, dominée par la prestation galactique de Radouan Leflahi. « Dom Juan ou le Festin de Pierre »… La comédie de Molière n'aura jamais si bien porté son nom dans la mise en scène de David Bobée au Théâtre du Nord. C'est dans une forêt de statues mutilées, reflet d'un monde de héros agonisant, que le diabolique séducteur évolue deux heures quarante durant. Orgie de statues, festin de théâtre : grand faiseur d'images, le directeur de l'institution lilloise secoue la pièce au gré de flashes fulgurants. Molière tangue au son de nappes électroniques, de chants africains et de danses. Mais Molière tient le choc, jamais trahi par cette relecture spectaculaire. L'entrée en matière est superbe : le monologue sur les bienfaits (ou non) du tabac se meut en ode au théâtre, déclamée, chantée, par la troupe - beau melting-pot de diversité - alignée devant le rideau de fer. Le théâtre saute aux yeux quand le rideau se lève sur l'immense statue du dieu grec Ilissos. David Bobée a conservé les mots de Molière, mais il a déplacé quelques scènes, accentuant notamment la tension dramatique du dernier acte. Côté personnages, il s'est permis quelques libertés. Interprété par Catherine Dewitt, Dom Louis n'est plus le père, mais la mère éplorée de Dom Juan. Incarné par un acteur et une danseuse asiatique, le couple de paysans manipulé par le séducteur, s'exprime en chinois (surtitré) plutôt que dans un improbable patois français du XVIIe. Duo de choc Dans cet Olympe en morceaux, le duo formé par le maître et son serviteur fait merveille. Radouan Leflahi, révélé dans le « Peer Gynt » (du même David Bobée), est un remarquable Dom Juan. Mâle alpha cynique, dominant ses victimes de toute sa morgue aristocratique, il est aussi ce héros fatigué de l'hypocrisie du monde, marchand tel un somnambule vers un enfer auquel il ne croit pas. Le charisme et la technique du jeune comédien sont proprement sidérants. Il est secondé avec bonheur par le sémillant Shade Hardy Garvey Moungondo. L'acteur, natif du Congo, étincelle en Sganarelle : burlesque, émouvant, toujours sur le fil d'une saine rébellion. Le duo fusionnel nous propulse sans temps mort jusqu'au final, où la terrible statue du Commandeur n'est plus qu'une relique parmi d'autres. Dom Juan est détruit par ses fantômes, poussé dans le néant par les hommes et les femmes qu'il a séduits, détruits et humiliés. On constate ça et là quelques maladresses dans le jeu ; l'ensemble mériterait d'être un brin resserré et le final éclairci. Mais tant de théâtre aussi généreusement distillé ne peut laisser de marbre. Ce « Dom Juan » onirique et flamboyant est un grand festin populaire qui remet au goût du jour l'esprit de Molière, son rire et son mystère. DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE de Molière. Mise en scène de David Bobée, Lille, Théâtre du Nord , jusqu'au 29 janvier, puis tournée en France (à Paris, du 30 mars au 2 avril à La Villette). Philippe Chevilley

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 2023 6:54 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 16 janvier 2023 « Un mois à la campagne » et « L’Orage », deux œuvres atmosphériques mises en scène respectivement par Clément Hervieu-Léger et Denis Podalydès, sont à découvrir à Paris et en tournée. Lire l'article sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/16/theatre-le-sacrifice-des-femmes-dans-la-russie-du-xix-siecle-selon-tourgueniev-et-ostrovski_6158091_3246.html
L’hiver est russe du côté du théâtre. Après Le Suicidé, de Nicolaï Erdman, remis au goût du jour par Jean Bellorini, voici que reviennent se poser sur les planches, à Paris puis en tournée, Un mois à la campagne, d’Ivan Tourgueniev, et L’Orage, d’Alexandre Ostrovski. Hasard du calendrier, les deux pièces sont mises en scène par des sociétaires de la Comédie-Française, qui œuvrent en dehors de leur maison mère : Clément Hervieu-Léger pour la première, Denis Podalydès pour la seconde. Les deux pièces ne manquent pas de points communs. Elles nous arrivent depuis le mitan du XIXe siècle (Tourgueniev a mis un point final à Un mois à la campagne en 1850, Ostrovski a achevé L’Orage en 1859), autant dire un moment de bascule, qui voit la modernité commencer à pointer son nez dans une Russie encore profondément ancrée dans ses valeurs traditionnelles. Ce sont deux belles œuvres atmosphériques, qui offrent des rôles féminins magnifiques, emblématiques de la condition des femmes dans une telle société. Chez Tourgueniev, la chaleur accablante de l’été russe pèse sur la campagne. Dans le domaine d’Arkadi Sergueïevitch Islaïev, une petite société oisive trompe son ennui à coups de jeux de société et de promenades champêtres. Natalia Petrovna, la maîtresse des lieux, torture son amant platonique, Rakitine. Dans cette atmosphère immobile, l’arrivée d’un jeune précepteur, Alexeï, va déclencher un ouragan de sentiments inavouables. Natalia comme sa fille adoptive, Véra, vont tomber amoureuses du bel Alexeï. Et révéler ainsi les structures patriarcales impitoyables d’une société où l’amour ne pèse pour rien face à la machine économico-matrimoniale. Aplomb et fragilité La mise en scène de Clément Hervieu-Léger n’a rien de révolutionnaire, mais elle redonne à la pièce toute sa fraîcheur et son actualité, sans jamais forcer le trait. La traduction, signée par le grand dramaturge Michel Vinaver, est claire, précise, musicale. Le décor, réduit au minimum, laisse toute la place aux acteurs, qui sont dirigés avec une grande intelligence des enjeux profonds de la pièce. Les jeux de domination à bandes multiples, où s’entremêlent les questions de classe, de genre et de génération, sont clairement dessinés sans que la pièce ne perde sa dimension romanesque, qui s’exprime de manière vivante et incarnée. Les comédiens y sont pour beaucoup, à commencer par Louis Berthélémy en Alexeï gracieux et délicat, piégé dans une circulation du désir sur laquelle il n’a pas de prise. Face à lui, Clémence Boué incarne Natalia Petrovna avec le mélange d’aplomb et de fragilité d’une femme qui aimerait laisser parler son désir pour un homme plus jeune qu’elle, mais doit réprimer ses pulsions dans un monde qui le réprouve – un monde qui, par ailleurs, ne voit aucun inconvénient à livrer une orpheline pauvre de 17 ans en pâture à un barbon trois fois plus âgé qu’elle. Chez Ostrovski, l’orage gronde au-dessus de la Volga, la menace plane, sourde et houleuse. Là aussi, le sort fait aux femmes et aux jeunes gens est au cœur de l’histoire. L’auteur met en scène un monde brutal, gouverné par la tyrannie et la peur : le monde russe, selon lui. La tyrannie commence au sein même de la famille, où les pères et les mères font peser une chape de plomb terrible sur leur descendance. Ainsi en va-t-il de la féroce Kabanova (Nada Strancar, impressionnante comme toujours), qui règne sur l’existence de Tikhone, son fils, de Varvara, sa fille, et de Katerina, sa belle-fille, épouse de Tikhone. C’est autour de celle-ci – une cousine d’Emma Bovary et d’Anna Karénine – que le drame se noue. Malheureuse en ménage avec Tikhone, Katerina va commettre le péché d’adultère avec un jeune homme sans consistance, Boris, et le payer très cher, au prix d’une culpabilité qui va l’emmener vers la folie et la mort. Comme il est dit dans la pièce, telle que la traduit et l’adapte Laurent Mauvignier avec le même talent sans appel que dans ses romans, « ici les femmes se marient et s’enterrent le même jour, c’est pareil ». La dérision plombe le romanesque Il y avait donc là matière pour une superbe soirée théâtrale, d’autant plus que le spectacle réunit une belle distribution, emmenée par cette actrice magique et singulière qu’est Mélodie Richard dans le rôle de Katerina. Et pourtant, le temps s’étire, au fil de deux heures trente de représentation, en laissant un sentiment d’ennui. La mise en scène est pleine de qualité, et bénéficie au premier chef du superbe décor d’Eric Ruf. Le patron de la Comédie-Française est aussi un scénographe de grand talent, et il signe ici une installation tout en sensibilité, qui donne comme rarement au théâtre la sensation d’un paysage – en l’occurrence celui des bords de la Volga. Mais cet Orage souffre de la manière dont Denis Podalydès négocie les allers-retours temporels entre hier et aujourd’hui, et entre tragique et comique. Les scènes qui fonctionnent le mieux sont celles entre Katerina (Mélodie Richard) et sa belle-sœur Varvara (Leslie Menu), où les deux actrices font merveille dans le registre de la complicité féminine. Mais pour le reste, on a du mal à s’attacher aux personnages, tant Denis Podalydès a mêlé la dimension romanesque de la pièce avec une forme de dérision qui empêche totalement de croire, ne serait-ce qu’un instant, à l’histoire d’amour entre Katerina et Boris. Celui qui tire le mieux son épingle du jeu ici, outre Varvara-Leslie Menu, c’est, curieusement, le personnage du mari, Tikhone, tel que l’interprète le toujours excellent Thibault Vinçon : il en fait un homme certes fruste, mais qui est lui-même une victime d’un système impitoyable, et qui en prend conscience. Mais cette merveilleuse actrice qu’est Mélodie Richard semble se débattre un peu seule avec son personnage de Katerina, comme une mouette engluée dans une mise en scène qui semble hésiter sans cesse entre historicité et actualisation, entre tragédie et comédie, entre portée universelle et inscription dans un folklore russe, à coups de chansons traditionnelles pas toujours indispensables. Un mois à la campagne, d’Ivan Tourgueniev (traduit du russe par Michel Vinaver, L’Arche éditeur). Mise en scène : Clément Hervieu-Léger. Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 2-4, square de l’Opéra Louis-Jouvet, Paris 9e. Jusqu’au 4 février. Puis en tournée. L’Orage, d’Alexandre Ostrovski. Adaptation : Laurent Mauvignier (Editions de Minuit). Mise en scène : Denis Podalydès. Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de la Chapelle, Paris 10e. Jusqu’au 29 janvier. Puis en tournée. Fabienne Darge Légende photo : « Un mois à la campagne », d’Ivan Tourgueniev, mise en scène de Clément Hervieu-Léger, au Théâtre des Célestins, à Lyon, en novembre 2022. JULIETTE PARISOT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 2023 1:49 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération le 16 janvier 2023 Le metteur en scène aux mille projets explique comment il tente, à chaque pièce, de respecter les commandements qu’il a lui-même érigés et déplore la baisse des subventions du théâtre municipal de Gand. On a pris le train pour Gand, en Belgique, pour voir les dix commandements affichés sur un panneau central à l’accueil du NTgent, le théâtre municipal dirigé par Milo Rau depuis 2018. On voulait savoir si cinq ans plus tard, ce manifeste érigé collectivement était toujours d’équerre, si Milo Rau et son équipe parvenaient à appliquer leurs principes percutants, si étonnants vus de France, qui énoncent par exemple que chaque création doit engendrer une activité pérenne à l’endroit où elle est créée, qu’au moins deux acteurs sur le plateau ne soient pas professionnels, ou encore que les décors tiennent dans une camionnette de vingt mètres cubes au maximum, afin de ne pas (trop) polluer. On est surprise par l’effervescence joyeuse du lieu, bien loin de la solennité de la plupart des théâtres en France les soirs et non soirs de première. Ici par ailleurs, la notion de première est bannie, il n’y a pas de rupture entre le processus et son résultat, pas de jour J, où tel un gâteau, la création sortirait à point d’une cuisinière. Le metteur en scène et directeur suisse prend un café dans un passage, il est constamment abordé autant par des inconnus que par des amis, salue chacun d’un grand rire et d’un flot de paroles. Par cette hyperactivité qui le pousse à avoir constamment mille projets mis en œuvre, Milo a quelque chose de Fassbinder. Un Fassbinder clean et solaire, qui honnirait les rapports de force… Entretien avant et après la représentation, dans un brouhaha au milieu de la foule, assis, debout, en mouvements. Donc, ce manifeste ? Est-il applicable et appliqué ? Oui. En général, on réussit à suivre au moins huit préceptes sur dix. Certains des commandements sont très simples à appliquer, car ils sont techniques. Il y a eu deux ou trois projets comme la Reprise, pièce fondatrice du manifeste, où l’on s’est dit qu’on allait vraiment mettre en pratique toutes les règles. Evidemment quand on monte un monologue, il est plus artificiel de le faire jouer deux acteurs, dont l’un ne serait pas professionnel et de s’obliger à le penser en deux langues… Pendant six mois, on s’est vraiment interrogé sur les conditions de mise en œuvre de chaque commandement. J’avais des idées beaucoup plus extrêmes. J’ai dû me limiter à ce qui était faisable. Concrètement, qu’implique le commandement 3 qui énonce que «chaque pièce appartient entièrement à ceux qui participent aux répétitions et à la représentation, quelle que soit leur fonction – et à personne d’autre» ? Cette règle est intangible. Cela signifie que les comédiens, les scénographes, les techniciens touchent des droits d’auteur à chaque représentation en plus de leur rémunération. Sont exclues de ce dispositif les personnes qui ont un salaire fixe. En tant que directeur du théâtre, je ne touche donc pas de droits d’auteur, tout comme la personne qui travaille à l’accueil et qui est salariée à l’année. L’autre règle intangible est que les représentations soient ouvertes à tous, à tout moment, il faut juste annoncer sa venue la veille. S’ils répètent une scène difficile, les acteurs peuvent demander à la travailler sans public. Ce principe a été énoncé pour mettre à mal l’idée que les représentations sont plus importantes que le processus, qui se clôturerait le premier jour des représentations. Vous pourriez donner des exemples sur la manière dont vos créations changent le monde dans lesquelles elles sont produites ? L’école de cinéma qu’on a fondé avec l’Unesco à Mossoul lorsqu’on concevait notre spectacle d’après l’Orestie existe toujours, il dispense des cursus pratiques qui aboutissent à la conception de films et aujourd’hui, il y a même une biennale où sont projetées les œuvres. Le tribunal sur le Congo au service du peuple congolais est devenu une institution indépendante. Lorsqu’on a tourné en Italie le film le Nouvel Evangile, aucun des réfugiés qui récoltent les tomates et qui sont les acteurs du film n’avait de papiers parce qu’ils n’avaient pas de permis de travail. On a investi dans deux maisons pour leur fournir une adresse et une centaine d’entre eux a été régularisée. En ce moment, on travaille sur Antigone avec le mouvement des sans terre en Amazonie, qui est le plus grand mouvement social mondial. On créera la pièce en mai à Gand puis en juillet à Avignon, et on distribuera leurs produits agricoles, et notamment leurs lentilles bio durant l’ensemble de la tournée ! La distribution de lentilles n’est pas un épiphénomène heureux, mais un résultat tout aussi important sinon plus, que les représentations. De manière générale, on consacre 20 % des recettes à l’action pérenne qu’on organise en même temps qu’on travaille sur le film ou la pièce. Comment êtes-vous financés ? Le ministère de la Culture du gouvernement belge vous accompagne-t-il ? Tous les cinq ans, on doit postuler pour avoir droit à des subventions, un peu comme le font les compagnies en France. C’est extrêmement difficile et constituer ces dossiers et passer les entretiens nous prend à peu près un an de travail. Le théâtre municipal dispose aussi de trois autres scènes plus petites. Le gouvernement, sous l’influence d’élus d’extrême droite, a réduit drastiquement nos subventions, car pour eux, seuls les grands musées et l’opéra sont dignes d’attention. Avec les coproductions et les tournées on était parvenu à 60 % d’autofinancement, on était quasiment un théâtre privé, mais le Covid nous a mis à mal, d’autant que le prix de l’énergie, ici comme partout, a explosé. Le gouvernement nous a enlevé l’un de nos théâtres, qui est aujourd’hui occupé par une dizaine de troupes qui ont réussi à le récupérer. C’est une résolution heureuse car le théâtre est investi par la ville entière ! Hier, des étudiants m’ont écrit une lettre pour me dire qu’ils allaient eux aussi l’occuper. Je leur ai suggéré de se centrer plutôt sur l’église Sainte-Anne fermée qui va devenir un supermarché. Il faut vraiment se souvenir des marchands du temple dans la Bible. Je suis très ami avec l’archevêque de Gand qui prévoit que 90 % des églises vont être fermées et vendues au plus offrant dans les années qui viennent. Concevez-vous seul la programmation du théâtre que vous dirigez ? C’est un processus collectif d’une dizaine de personnes dont moi. Et chaque année, on invite un curateur extérieur qui organise 20 % de la programmation. A Gand, vit la plus grande communauté turque de Belgique. Ainsi avait-on choisi un curateur turc qui a programmé des pièces dont je n’avais jamais entendu parler. Non seulement j’ai découvert un théâtre que je ne connaissais pas du tout, mais la communauté turque a afflué et elle s’est également tournée vers d’autres spectacles qu’elle n’aurait peut-être pas été voir… Pourriez-vous nous parler de All Greeks, ce festival que vous organisez et qui aura lieu le matin en mai-juin ? On va y jouer les 32 tragédies grecques mais dans de nouvelles versions, en extérieur, dans les parcs. Chaque matin, on présentera une nouvelle pièce. A Berlin, aux aurores, par hasard, je suis tombé après une nuit de fête dans un parc et une troupe jouait Shakespeare. Je me suis arrêté, et j’ai pensé : «C’est la première fois que je comprends vraiment ce que les acteurs disent.» Le soir, quand on va au théâtre, on est déjà fatigué et négatif. Le meilleur moment pour recevoir un spectacle, c’est le matin… Vous êtes Suisse. Comment êtes-vous arrivé à Gand ? En 2016, j’ai créé à Gand Five Easy Pieces, une pièce avec des enfants, ce qui me terrifiait. J’avais très peur de ne pas savoir les faire improviser, je m’étais bardé de documentations, et finalement rien n’a été plus agréable que de travailler avec eux. C’était fantastique. Quand les représentations ont été terminées, le poste de directeur allait être vacant. Je me suis assis au café du théâtre, il y avait un rayon de soleil, c’était merveilleux. Pourquoi ne pas rester ? Légende photo : Le metteur en scène suisse Milo Rau. (Michiel-Devijver)
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...