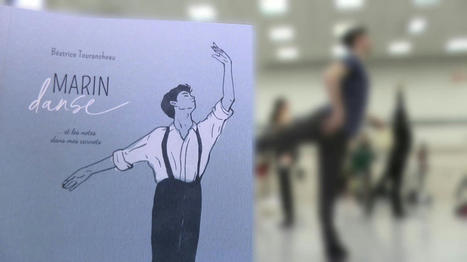Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2023 5:59 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 11/03/23 Dans sa dernière pièce jouée au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Pauline Peyrade montre la représentation des femmes à l’écran et le parcours d’émancipation des actrices.
Lire l'article sur le site du "Monde": https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/11/des-femmes-qui-nagent-mille-et-une-histoires-de-femmes-de-cinema-s-invitent-au-theatre_6165103_3246.html
Intérieur nuit. Un grand hall de cinéma Art déco comme on les a tant aimés, avec portes battantes à hublot et fauteuils clubs. On se croirait dans un tableau d’Edward Hopper, avec une femme nimbée de solitude, attendant dans la coulisse la fin de la séance, la fin du rêve. Sauf que les femmes ici sont nombreuses, elles hantent la machine à jouer qu’ont imaginée Pauline Peyrade et la metteuse en scène Emilie Capliez ou la traversent avec fracas. Elles, ce sont les actrices et les réalisatrices que l’autrice convoque en un vaste puzzle, qui jette en l’air et réagence les représentations des femmes telles que l’usine à rêves du cinéma les a mises en place depuis le début du XXe siècle. Ce qui fait tout le prix du projet, c’est que l’on est justement au théâtre, dans son ici et maintenant, et que le spectacle serait comme un long plan-séquence en chair et en os, où tourbillonnent mille et une histoires, en un kaléidoscope à la fois jouissif et réflexif. Tout part de Marilyn, bien sûr, le mythe ultime, la figure sacrificielle par excellence. Le spectacle s’ouvre avec cette citation de Blonde, de Joyce Carol Oates : « Les yeux grands ouverts et l’air de voir, mais c’est un rêve qu’elle voit. » Les « femmes qui nagent », ce sont ces actrices d’Hollywood, mais ce sont aussi Romy Schneider ou Ludivine Sagnier, et bien d’autres. Comme autant de corps, de surfaces de projection. Figures du refus et de la reconstruction En un montage aussi ludique qu’intelligent, Pauline Peyrade nous promène et nous égare avec bonheur – avec l’aide du Mulholland Drive de David Lynch − au fil d’un parcours qui est aussi celui d’une émancipation. Ophélie Bau quittant la projection cannoise de Mektoub my Love : Intermezzo, en 2019, se sentant flouée par Abdellatif Kechiche ; Adèle Haenel se levant avec fracas de la cérémonie des Césars 2020, indignée par le prix remis à Roman Polanski ; Chantal Akerman inventant un nouveau cinéma, avec la divine Delphine Seyrig en étendard… Autant de figures du refus et de la reconstruction. Emilie Capliez, la directrice de la Comédie de Colmar (centre dramatique national), inscrit ce parcours dans une mise en scène très maîtrisée, inventant un espace-temps bien particulier, qui n’est ni celui du cinéma ni celui du théâtre traditionnel. Dans le superbe décor conçu par Alban Ho Van, les fragments se télescopent en un tourbillon où l’on ne reconnaît pas toujours toutes les histoires, mais cela n’a aucune importance. Le puzzle pourra être reconstitué après coup. S’il en est ainsi, c’est bien sûr grâce aux comédiennes : Odja Llorca, Catherine Morlot, Alma Palacios (en alternance avec Louise Chevillotte) et Léa Sery. Pour elles, cette matière est un formidable terrain de jeu, dont elles s’emparent avec jubilation. Avec elles, ces Femmes qui nagent creusent un vertige. Ce cinéma que l’on a tant aimé, sur quoi a-t-il bâti son rêve ? « J’ai tant aimé le cinéma. Sans peur. Dans l’innocence », disait Chantal Akerman. Aujourd’hui, le temps n’est plus à l’innocence, et ce n’est pas plus mal. « Des femmes qui nagent », de Pauline Peyrade. Mise en scène : Emilie Capliez. Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 19 mars. Puis à la Comédie de Reims, du 19 au 21 avril. Fabienne Darge / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2023 12:39 PM
|
Par Louis Juzot pour le blog Hottello - 9/03/23 Rémi d’après Sans Famille d’Hector Malot, conception et mise en scène Jonathan Capdevielle.
Le fameux « Sans Famille » d’Hector Malot (1830-1907) est un classique de la littérature jeunesses et scolaire écrit par un homme qui fut une conscience politique à la fin du dix-neuvième siècle, ami de Jules Vallès, très engagé entre autres pour les droits de l’enfant. Sa reprise dans un manga « Rémi sans famille », presque aussi célèbre que l’original aujourd’hui, a inspiré le Rémi de Jonathan Capdevielle.
Rémi est « loué » à l’âge de huit ans par son beau-père à un comédien ambulant Vitalis qui va lui apprendre l’art de vivre du baladin accompagné d’un singe, Joli Cœur, et de trois chiens Capi , Zerbino et Dolce. Au cours de leur périple dans le Sud-ouest de la France, Vitalis est mis injustement en prison pour deux ans.
Rémi continue avec la troupe. Ils vont rencontrer Madame Milligan, anglaise originale et son fils Arthur, enfant sensible et souffrant de handicap. Une amitié forte nait entre Arthur et Rémi qui choisit malgré tout de continuer la route avec Vitalis, revenu de prison. Ils atteignent Paris après bien des malheurs et la perte de joli Cœur, Dolce et Zerbino. Vitalis veut confier Rémi à Garofoli qui accueille en pension les enfants d’artistes, le temps de reconstituer la troupe, mais il se révèle un méchant homme. Rémi repart avec Vitalis et le voit mourir de froid et de fatigue avant d’être recueilli par une famille de jardiniers. C’est ainsi que se termine le spectacle et la première partie du livre. Un deuxième épisode est accessible sur CD audio pour les familles et les classes qui veulent prolonger la découverte. Jonathan Capdevielle décrypte avec à propos ce qui fait l’universalité de ce roman d’initiation et les thèmes de la parentalité ouverte, de l’éducation bienveillante, du handicap, de la valorisation de la différence … qui résonnent en notre temps. Il utilise une palette d’effets qui vont des costumes chamarrés inspirés de l’Art Brut, aux masques, à la marionnette, des ambiances sonores et lumineuses empreintes de poésie et de mystère . Quatre comédien assurent tous les rôles dans des registres différents. Robin Causse et Sophie Lenoir passent du jeu naturaliste des parents adoptifs de Rémi à celui d’Arthur et de Joli Cœur pour lui, de Madame Milligan et de Capi pour elle, à un jeu décalé avec déguisements, masques animaliers et costumes raffinés de fantaisie. Vitalis est le tuteur bienveillant et paternel aussi bien que le musicien, le conteur qui élève, grâce à sa pratique artistique et à sa générosité, l’âme et le cœur de Rémi. Il est incarné par Babacar M ‘Baye Fall. L’enfant est Dimitri Doré: peu disert, il apprend par le regard et intériorise ses expériences pour aller de l’avant. Les deux forment un duo fraternel autant que filial qui rappelle le monde d’antan des comédiens ambulants mais revisité par la musique pop et les codes des enfants de maintenant. Le spectacle est bien construit et certains moments laissent échapper une poésie où se mêlent l’imagerie enfantine et les mystères des rencontres mais s’étire en longueur surtout pour un jeune public . Il gagnerait à être resserré et un peu plus rythmé en jouant sur les surprises et l’inattendu des évènements. Il n’empêche, Rémi est une belle approche et accroche pour aborder avec les enfants des thèmes graves et universels autour du vivre ensemble, un bel hommage aussi à une littérature mésestimée . Louis Juzot Jusqu’au 11 mars , jeudi et vendredi à 14 et 16h, le samedi à 16h, La Commune, CDN – Aubervilliers, 2 rue Edouard Poisson (spectacle dans la salle en face du théâtre) 93300 Aubervilliers. Tel : 01 48 33 16 16 .

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 8, 2023 4:52 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 7/03/2023 Rencontre avec la dramaturge et écrivaine qui, à l’occasion de la sortie de son roman «l’Age de détruire» et de sa dernière création «les Femmes qui nagent» sur nos représentations parfois destructrices des actrices, évoque son approche de l’écriture et questionne la monstration de la violence sur scène. Pauline Peyrade a une qualité rare : ses facultés d’analyse, la manière dont elle saisit parfaitement (mais après coup) ce qui meut ses personnages et son écriture ne pèsent jamais sur ses textes, ne les alourdissent d’aucune explication. En somme, son intelligence ne leur nuit pas, son art de l’ellipse rend ses narrations d’autant plus oppressantes qu’elles sont d’une clarté absolue alors que très peu est dit. Pauline Peyrade a la bonne trentaine, elle en paraît dix de moins, elle vient de faire paraître un premier roman, l’Age de détruire (éd. de Minuit), qui nous plonge sous le prisme d’une enfant qui tente de survivre à une mère aride et outrancièrement fusionnelle – mais le noter, ce dont se garde le texte, est déjà de trop. Envoyé par la poste, l’Age de détruire est, mine de rien, un succès de librairie, ce qui est rarissime surtout lorsque l’autrice est quasi inconnue. Pourtant Pauline Peyrade signe depuis une demi-douzaine d’années des pièces montées et éditées aux Solitaires intempestifs. Après avoir été étudiante à l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) à Lyon, elle est coresponsable de son département écriture. Sur sa biographie, on ne saura pas grand-chose. Elle vient d’un milieu «normal» nous lance-t-elle et, enfant, elle regardait des Walt Disney s’amuse-t-elle à préciser. Entretien près de la gare de l’Est – elle habite Reims – dans un café sonore, pendant que sa prochaine pièce, Des femmes qui nagent, qui convoque une foule d’actrices de la naissance d’Hollywood à aujourd’hui, brave l’eau pour arriver sur le plateau du TGP à Saint-Denis dans deux jours. Comment devient-on écrivain pour le théâtre ? C’est l’écriture qui m’attirait, plus qu’une discipline. En classe prépa, j’ai découvert les Bonnes et le Balcon de Jean Genet dont l’étude m’a passionnée, et un peu intuitivement je me suis tournée ensuite vers des masters pratiques. L’écriture pour le théâtre a ouvert une brèche, un chemin. Auparavant, j’avais écrit des nouvelles, mais c’était des tentatives… La première fois que j’ai «posé» un texte, c’était une pièce. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette pratique qui souvent est devenue plus collective lorsque le texte se conçoit durant les répétitions ? J’ai besoin de temps et de solitude. L’écriture de plateau n’est pas pour moi ! J’ai besoin de voguer seule avec des personnages, pour ensuite être du côté des acteurs. Ce sont les personnages qui permettent la fabrication d’une altérité. J’enquête sur ce qu’ils disent ou non, comment ils le disent, sur ce que leur parole produit. Comment l’acteur traversera la langue ? Ce n’est pas forcément en multipliant les signes d’oralité que ce qu’on écrit peut s’incarner. Ce n’est pas non plus par des indications de mouvement – fumer, bouger une chaise. Débuter par l’écriture de pièces, c’est-à-dire par des textes qui sont portés par d’autres, est-ce une manière détournée ou modeste d’apparaître autrice ? Alors que lorsque vous publiez un roman aux éditions de Minuit, cela vous pose comme écrivaine. J’avais du mal à m’octroyer la légitimité d’écrire un roman. C’était tétanisant. Je ne parvenais pas du tout à m’y mettre parce que je ne m’en sentais pas le droit. L’écriture pour le théâtre est beaucoup plus contrainte que le roman, ce qui est un appui. De plus, elle permet de porter un masque qui est celui du personnage. Avec le roman, même de fiction, on est derrière une vitre transparente. Il y a bien des reflets qui passent et nous occultent, mais on est quand même beaucoup plus exposée. Pendant les rencontres, je m’aperçois combien il est beaucoup plus intimidant de parler d’un roman que d’une pièce qui se laisse approcher comme un objet qui mène sa vie indépendamment de moi. La publication d’un texte qui ne passe pas par interprète ou une mise en scène vous expose ? Oui. Peut-être parce que lorsqu’on parle d’une pièce revient toujours la question du plateau et de la mise en scène. Cela se vérifie quand mes pièces sont travaillées dans des classes. Elles abordent des sujets pas faciles. L’une des manières pour que les adolescents se les approprient est de leur demander comment ils les mettraient en scène. Le théâtre vient à notre secours pour nous protéger de l’endroit où les textes nous atteignent. Le point commun de toutes vos pièces, qui se retrouve dans le roman, est celui de la violence et des abus… Mais comment montre-t-on la violence sur scène ? Je ne crains pas la frontalité du propos. Il faut savoir comment l’amener, comment le faire entendre, collectivement ou plus intimement dans le cas du roman. Et souvent cette écoute se confond avec le lent parcours d’émancipation d’un personnage. Dans le roman par exemple, la petite Elsa regarde mais n’a pas de mot pour dire ce qui lui apparaît, elle parle d’un mal qui habite sa mère, elle ne peut pas être plus précise. Souvent, on suppose aux gens une capacité à s’échapper d’une relation destructrice. Mais on ne se défait pas facilement d’une mère, on ne s’en émancipe pas en deux jours. Ça prend du temps, c’est très ambivalent, c’est à la fois libérateur et extrêmement douloureux. Faire la place à ce trajet dans le texte, c’est aussi faire la place au courage que cela exige. Alors que la narratrice est assez discrète, elle peut apparaître en sidération ou passive. Sa résistance permanente et implacable finit par opérer. Elle ressemble aux personnages de mes pièces pour cela. Effectivement les Femmes qui nagent décrit également un parcours d’émancipation mais collectif. La pièce donne l’impression que vous avez plongé dans un océan de documentation… Qu’avez-vous pêché ? Il s’agit d’un tout autre regard : celui d’une spectatrice sur des images qui lui parviennent et qui construisent ses propres représentations. La pièce est constituée de fragments qui dialoguent avec des images de films, des photos ou des scènes de tournage. Il s’agit d’accueillir toutes les contradictions à l’œuvre : les moments de fascination, mais aussi de lutte et de violence, la question des actrices qui se désolidarisent du féminisme. C’est un mouvement qui va des premières images de l’idéal féminin des années 50 – avec derrière les icônes hollywoodiennes, des histoires souvent tragiques, des morts violentes – à la constitution d’une parole qui se prend. Pour ce texte que m’a commandé la metteure en scène Emilie Capliez qui dirige le CDN de Colmar, au début, j’avais envie d’une somme. Je voulais que ces femmes soient en nombre, qu’elles prennent beaucoup de place. Je suis aussi passée par des moments plus théoriques, sur l’histoire des techniques… Y a-t-il un principe qui a présidé à l’ordre des fragments ? J’ai fait différentes tentatives, par chronologie, par motif, par mouvement. Mais la matière ne supportait pas d’être ainsi classée. Dès que je découpais le texte, il s’éteignait. Il y a tout un moment du travail où j’ai ouvert énormément la recherche, sur d’autres histoires du cinéma, d’autres continents… Certaines actrices m’importent beaucoup et elles ont une toute petite place… A travers cette recherche, avez-vous eu l’impression que la question de l’abus traverse toute l’histoire du cinéma ? C’est une porte d’entrée. Mais il y a aussi beaucoup d’amour du cinéma et d’hommages à des films dans la pièce. C’est dans cette ambivalence que s’est construite l’écriture. Un terrain sur lequel je reviens sans arrêt est le rapport des femmes à la violence, celle qu’elles subissent mais aussi celle qu’elles peuvent perpétrer. Je me suis demandé s’il y avait une histoire de la violence à composer à travers les images du cinéma et de la représentation des corps des femmes. L’un des moments où ce regard s’exerce avec acuité est la simple description d’un plan de Romance de Catherine Breillat… N’importe quelle situation avec une caméra produit un rapport de pouvoir. A partir du moment où une personne filme et qu’une autre est filmée, se pose la question de la domination, du consentement, de la confiance. Quelle relation se met en place et comment faire pour qu’il y ait une complicité, un travail fait à deux, afin que le sujet ne soit pas totalement dépossédé de l’image qu’il propose ? L’actrice qui pose ne se voit pas poser. Ce sont les images qui portent les traces des relations de pouvoir. Je n’étais pas sur place pour voir comment cela s’est passé. Mais je trouve beau que si l’on regarde bien, on puisse en déceler des indices. Avez-vous mené de front l’écriture des Femmes qui nagent et de l’Age de détruire ? J’ai commencé ce roman il y a six ans. Pendant quatre ans, il a pris des peaux successives, qui sont tombées les unes après les autres. Quelque chose ne prenait pas. J’avais abandonné ce projet pour commencer Des femmes qui nagent mais quelque mois plus tard, il est revenu frapper à la porte. Il ne m’a pas laissée tranquille. Vous analysez vos textes, et pourtant leur noyau vous échappe au moment de l’écriture… Comment est-ce possible ? Tout ce que je suis capable de nommer au préalable, je n’ai pas besoin de l’écrire. L’écriture n’est nécessaire que s’il y a des terrains qu’on approche uniquement grâce à elle. Je n’écris pas sur ce que je comprends déjà. Anne Diatkine Légende photo : Le reflet de Pauline dans l'armoire de sa grand-mère, à Reims, le 3 Mars 2023. (Camille Mcouat/pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 3:09 PM
|
Par Agnès Santi pour le journal La Terrasse - 20 février 2023 Dans le sillage du Voyage de D. Cholb, Bernard Bloch poursuit sa plongée inquiète au cœur du conflit israélo-palestinien en portant à la scène les paroles de gens de Jérusalem. Un théâtre humaniste de haute tenue. Que d’attention médiatique suscite le conflit israélo-palestinien, que d’ignorance et que de haine dans les jugements portés… Désireux de dépasser le stade déprimant des discours préétablis et manichéens, hélas très en vogue, Bernard Bloch fait théâtre du conflit pour éclairer la nécessité de s’extirper d’un immuable affrontement, pour tenter de combattre les enfermements au profit de l’écoute, du dialogue. Plan de l’ONU en 1947 proposant la partition de la Palestine sous mandat britannique en deux États, refus arabe et guerre ; Accords d’Oslo en 1993… Bernard Bloch ne souhaite pas exposer de faits historiques ou délivrer un discours de certitudes, il fait plutôt entendre le vécu, la subjectivité des expériences, la complexité de la situation. Il transforme la scène en agora puissante où résonne une force de vie manifeste, dévoilant les radicalités, les aspérités, les aspects inattendus, les désirs – voire les rêves – de réconciliation. Soit une situation faite d’une coprésence problématique, de multiples narrations qui se complètent, se télescopent, se contredisent… Ses œuvres précédentes déjà commencèrent à creuser ce sillon. Créé en 2017, Le voyage de D. Cholb racontait dans une forme très maîtrisée le voyage sensible et subjectif d’un moi déplacé en terres israéliennes et palestiniennes. Celui d’un double distancié, lancé dans une quête obstinée, éprise de justice. Son désaccord avec la politique israélienne, son questionnement sur ce que signifie un État juif nourrissent ses réflexions et ses émotions, adossées à sa volonté d’envisager le futur comme une possibilité plutôt que comme une impasse. Présentée en deux parties pouvant être vues indépendamment l’une de l’autre (petite préférence pour la première), La Situation aussi est née d’un voyage, qui eut lieu de février à avril 2016 à Jérusalem, ville passionnément aimée, baignée d’une lumière exceptionnelle. À hauteur d’homme Bernard Bloch a rencontré une soixantaine de personnes, puis conservé une vingtaine d’entretiens qu’il a réécrits afin de les théâtraliser, de souligner les frottements, les échos et discordances. Il insiste : « Ce sont des paroles et non des discours, car sur ce sujet nous sommes submergés de discours. » Sur le plateau, B le questionneur, et des personnages vivant ou travaillant à Jérusalem, juifs, musulmans, chrétiens, druzes, athées. Ils sont incarnés par dix comédiens et comédiennes, qui habitent leurs paroles avec intensité et sincérité. L’enjeu n’est pas de tomber d’accord, ni de s’informer sur le conflit. Plongée dans des récits qui s’entrechoquent, la pièce invite à se mettre « à hauteur d’homme » (comme dans les hôpitaux israéliens où médecins juifs et arabes travaillent ensemble), à se défaire de positions assignées. C’est compliqué. On pense aux radicalisations, aux soutiens « inconditionnels ». (Signalons en France et ailleurs celui de militants d’extrême-gauche à la cause palestinienne qui revient pour certains à faire preuve d’une complaisance brouillonne envers la violence et la haine antisémite). Sur le plateau, une tente blanche, une multitude de chaises, des pages éparpillées, des pierres éparses, des oiseaux… Dans cet espace fragile, désordonné, la mise en scène éclaire de manière subtile et percutante le partage des mots. Des mots profondément vivants, en mouvement, reliés les uns aux autres par la si sincère recherche de Bernard Bloch. Une recherche à la fois humaine et théâtrale liée à la perte, à la révolte contre l’injustice, au désir de vivre. Loin de toute complaisance et de toute facilité, ce théâtre exigeant et ambitieux secoue les esprits. Avec une parole qui se fait pensée en acte : » Lorsque l’on redescend à hauteur d’homme, le souci de l’autre est plus fort que la haine« . Agnès Santi La Situation-Jérusalem, portraits sensiblesdu mercredi 15 mars 2023 au dimanche 9 avril 2023Théâtre du SoleilLa Cartoucherie, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris mercredi au vendredi à 19h30, le samedi et le dimanche à 16h00. Tél : 07 45 06 45 50, reseautheatre.production@gmail.com Spectacle vu à L’Échangeur à Bagnolet en février 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 2:38 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 7/03/23 Dans sa pièce, Pauline Peyrade évoque les actrices qui, des années 50 à récemment, furent soumises aux regards et injonctions, mais furent aussi porteuses d’émancipation. Une création où l’abondance de citations finit par nous égarer. Des femmes qui nagent, ce sont donc des actrices – de Marilyn Monroe à Romy Schneider, en passant par Caroline Ducey (qui jouait dans Romance de Catherine Breillat), Ophélie Bau, mais aussi Isabelle Huppert, Gena Rowlands ou encore Barbara Loden, et bien sûr Delphine Seyrig – décidément omniprésente sur les plateaux cette saison – entraînées dans le fleuve des regards et des injonctions. Femmes scrutées autant que regardantes, comédiennes prises dans un filet ou qui se détachent de l’emprise du mâle gaze, comédiennes violentées – mais pas forcément par des hommes – ou porteuse d’émancipation : la multiplicité des points de vue et des situations se clôt par une voix intérieure : celle de l’ouvreuse dans Toute une nuit, de Chantal Akerman, qui ne reçoit les films qu’à travers les traces que laissent les spectateurs dans la salle, et ce qu’ils en disent à la sortie. Un puzzle par définition incomplet La pièce de Pauline Peyrade agence les morceaux d’un puzzle par définition incomplet. Le regard qui les attrape se situe à des distances ultra variables – du plus loin au plus près. La description attentive du moindre détail captive et suffit à révolter quand l’interprète Alma Palacios engage son regard sur une séquence de Romance de Catherine Breillat – reçue avec beaucoup de bienveillance (ou de complaisance) par la critique lors de sa sortie il y a vingt-trois ans. Les références ne sont pas livrées – et l’on remarque qu’on préfère reconnaître les films et les actrices, faire dialoguer l’instant scénique avec son souvenir du film, images ou propos recueillis. La pièce convainc moins et souffre d’arythmie lorsque le regard – le plan ? – est plus général. C’est trop court et schématique sur Godard pour bien s’imbriquer dans l’ensemble, mais peut-être est-ce la démarche qui embrasse trop de références pour ne pas nous égarer à certains endroits. Le chœur, pièce du puzzle constituée d’une multitude de citations piochées dans des siècles d’entretiens, devrait être un feu d’artifice évocateur. Il est, ce soir-là, statique, même si on s’étonne d’avoir nous aussi gardé en mémoire certaines phrases sans signe particulier, comme autant de trésors. Des femmes qui nagent de Pauline Peyrade, m.s. par Emilie Capliez, au Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis) du 8 au 19 mars. Légende photo :; «Des femmes qui nagent», au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis . (Klara Beck/Théâtre Gerard Philipe)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 9:55 AM
|
Grammaire des mammifères, de William Pellier, mise en scène Jacques Vincey
Avec Grammaire des Mammifères de William Pellier, qu’il a créé au CDN de Tours à l’automne 2021 et qu’il reprend à Paris, au Monfort (8-18 mars 2023), Jacques Vincey nous fait entendre un ‘son nouveau d’auteur’. Ce texte foisonnant, vertigineux, brise résolument et joyeusement les codes de la représentation pour tenter autre chose. On pourrait le qualifier d’Objet Théâtral Non Identifié : une véritable gageure pour un metteur en scène que Jacques Vincey relève avec brio grâce à la complicité du chorégraphe Thomas Lebrun, le directeur du CCN de Tours et de Vanasay Khamphommala, dramaturge et chanteuse. Pas question de vous résumer tout ce que dit la pièce de William Pellier. Ce serait trop compliqué. Et, en vérité, pas très intéressant. D’ailleurs, l’auteur lui-même l’affirme dans une note : « La Grammaire ne raconte ouvertement rien». Comme le titre le laisse entendre, nous assistons à une sorte de ‘grammaire vivante’, ou plus concrètement à une matière vivante, mouvante et malléable, dont les règles se transforment, se modifient en permanence, en fonction de ce qui arrive aux différents protagonistes sur le plateau. Il y a un renouvellement dramaturgique constant qui va, par exemple, du théâtre le plus formaliste à des scènes chantées, en passant par le théâtre d’ombres, des moments poétiques, des scènes tragi-comiques ou complètement burlesques, parfois même dadaïstes. On a le sentiment d’une liberté totale. On prend la prend la parole quand on veut. On s’habille, on se travestit comme on veut. On joue avec la nudité si on le veut. On ose. On va jusqu’au bout. S’il y a provocation, ce n’est jamais pris au sérieux. C’est aussi une mutation esthétique qui se fait sous nos yeux : on a devant nous une œuvre plastique qui change, se métamorphose comme si la scénographie de Mathieu Lorry-Dupuy s’élaborait, se construisait à vue. Voilà pourquoi, le spectacle nous fait penser à une performance. Et les interprètes, à des performers. « La Grammaire devrait montrer la vie » écrit William Pellier dans une postface à l’édition de son texte aux Éditions 34. Et, c’est précisément de ça qu’il s’agit. Vie sexuelle (« seksuelle » orthographie l’auteur), vie familiale, vie sociale, vie animale… la vie est partout, à profusion, y compris dans les plantes du décor, dans les arbres de la toile de fond. En nous faisant rire, en nous surprenant, ce sont des moments de vie que nous font traverser les huit jeunes acteurs et actrices de l’ensemble artistique du CDN de Tours. Si Jacques Vincey gagne son pari, c’est aussi beaucoup grâce à eux, à leur belle énergie. Citons-les : Alexandra Blajovici, Garance Degos, Marie Depoorter, Cécile Feuillet, Romain Gy, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc, Nans Mérieux. Au début du spectacle, ils et elles se présentent tour à tour, nous indiquant leur identité, leur date de naissance, les noms et prénoms de leurs parents etc., dans un prologue fort drôle, qui est également une profession de foi solennelle vis-à-vis de la pièce de William Pellier. C’est un vrai travail choral où le personnage disparaît au profit du protagoniste, au sens grec du mot. In fine, la pièce de William Pellier s’avère être une réflexion radicale sur le théâtre, sur les formes qu’il peut prendre, sur le récit, les histoires qu’il peut raconter, sur ce qu’il aurait à nous dire aujourd’hui, ou encore sur le rapport à réinventer avec le public. Chantal Boiron Photos : © Christophe Raynaud de Lage. « Grammaire des mammifères » est publié aux Éditions 34, dans la Collection Espace Théâtre, dirigée par Sabine Chevallier. Le Monfort (8-18 mars 2023), 106 rue Brancion 75015 Paris - Tel. 01 56 08 33 88

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 3, 2023 7:45 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 3/03/23 Christophe Perton met en scène de manière trop frileuse la pièce de Jean Cocteau.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/03/au-theatre-hebertot-a-paris-des-parents-terribles-sauves-par-les-comediens_6164069_3246.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
Mais pourquoi donc, dans les théâtres privés, la mise en scène semble-t-elle toujours s’arrêter aux portes de la salle ? Pourquoi ne vient-elle pas sur le plateau fabriquer de l’invisible pour que soit révélé au public un au-delà des mots et des images ? Christophe Perton, à qui l’on doit la représentation des Parents terribles, de Jean Cocteau, n’échappe pas à cette loi fatidique. Assumant à la perfection son rôle de directeur d’acteurs, il tente bien d’immiscer sa vision et ainsi de déplacer ce qu’on voit et entend vers une perception moins frontale et plus subliminale. Mais il s’y risque trop timidement, à l’occasion de changements de décor pris en charge par deux silhouettes coiffées de têtes de chiens. A moins qu’il ne s’agisse de gueules de loups ? On ne sait pas, ces moments-là se déroulant dans la pénombre. Face à cette frilosité de la mise en scène, il ne reste aux spectateurs qu’une pièce et des comédiens. Là est pourtant la chance, immense, des Parents terribles. Car les acteurs sont fabuleux et la pièce « incroyable », pour citer une réplique récurrente des héros. Cocteau est loin d’être un auteur poussif. En 1938, désireux de répondre au souhait de son jeune compagnon, Jean Marais, il écrit en moins de quatre semaines ce pseudo-vaudeville au goût âcre. En vérité, un drame si scabreux qu’il sera interdit lors de sa création après seulement neuf représentations. Les censeurs lui reprochent l’exposition trop frontale d’un inceste. Le fait est que l’histoire n’est pas ordinaire (Luchino Visconti la montera d’ailleurs deux fois de suite). Yvonne, une mère diabétique (Muriel Mayette-Holtz), couve d’une passion excessive son fils Michel (Emile Berling). Celui-ci vient de tomber amoureux d’une jeune femme, Madeleine, dont on apprend qu’elle était la maîtresse de Georges, père de Michel et époux d’Yvonne. Ce méli-mélo improbable, qui emprunte sa mécanique aux archétypes tragiques (Œdipe, Médée) et aux pulsions freudiennes, se déroule sous le regard froid, lucide et autoritaire de Léonie, dite Léo. Une célibataire éprise de Georges quand bien même il lui a, autrefois, préféré sa sœur diabétique. Cocteau se serait, affirment les exégètes, projeté en Yvonne. A elle l’insuline, à lui l’opium. A elle la passion pour Michel, à lui l’amour pour Jean Marais. Partition troublante Christophe Perton adapte deux matériaux. A la version éditée par Gallimard, après que l’écrivain l’a amendée et édulcorée, il greffe des bribes du manuscrit original (autrement plus retors) qu’il a acheté dans une salle de ventes. Une percutante initiative dont il dissout malheureusement l’impact dans un décor défraîchi : l’action se passe, pour l’essentiel, dans la chambre à coucher d’Yvonne. Un lit géant aux draps défaits trône au centre. Sur les bords, de hautes boiseries sombres et leurs placards débordant de vêtements. Au sol, un fatras de tissus. Au fond, une salle de bains, ses W.-C. et son lavabo. L’appartement de Madeleine se résume, pour sa part, à un morose canapé jaune. Si les plus jeunes acteurs ne manquent pas de présence, leurs aînés font des étincelles Ces deux espaces asphyxient l’œil. Ce qui rend d’autant plus remarquable le travail des comédiens : si les plus jeunes ne manquent pas de présence, leurs aînés font des étincelles. Muriel Mayette-Holtz est impériale dans son rôle de dévoratrice. L’actrice, explosive, comique et pathétique, assume tout de son personnage hors norme. Elle en fait une mère monstrueuse mais en perdition. Face à elle, Charles Berling tient avec subtilité une note délicate, se coulant dans le corps contraint d’un adulte qui n’a jamais pu grandir. Les yeux baissés, il a des enfants l’air buté, la mine hagarde et la moue hébétée lorsqu’ils viennent de casser leur jouet. Sa partition est d’autant plus troublante qu’il est, dans la vie, le père de son partenaire, Emile Berling. Et puis, surtout, il y a Maria de Medeiros. Fascinante et hitchcockienne Léonie. Blonde platine, cheveux au carré, tirée à quatre épingles, elle règne d’une main de fer sur ce chaos humain. Elle lave le linge, range les placards, calme le jeu ou excite les affects. Elle est celle qui jugule ou aggrave le désordre, celle qui, au fond, décide du cours de la fiction. Son personnage veut ça. Mais parce que l’actrice a l’envergure des grands interprètes, elle va plus loin. Tout dans son jeu suggère qu’existe, peut-être, une histoire invisible tapie sous le récit de Cocteau. Cette histoire serait celle d’une manipulatrice cynique et inhumaine. N’est-ce pas ce surgissement d’une insondable hypothèse qu’on appelle, justement, la mise en scène ? Les Parents terribles, de Jean Cocteau. Mise en scène : Christophe Perton. Avec Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling, Maria de Medeiros, Emile Berling, Lola Créton. Théâtre Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, Paris 17e. De 15 € à 53 €. Joëlle Gayot De gauche à droite : Léonie (Maria de Medeiros), Yvonne (Muriel Mayette-Holtz) et Georges (Charles Berling), dans « Les Parents terribles », dans une mise en scène de Christophe Perton, au Théâtre de Liège, le 2 avril 2022. DOMINIQUE HOUCMANT-GOLDO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2023 11:01 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - Le 2/02/23 La directrice du théâtre, Maïté Rivière, nommée en mars 2021, a été suspendue à la suite de plaintes pour souffrance au travail de la part de salariés. Lire l'article sur le site du "Monde: https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/02/le-quartz-scene-nationale-de-brest-dans-la-tempete_6163891_3246.html
La scène nationale Le Quartz, à Brest, vit une situation inédite. Mercredi 8 février, Maïté Rivière, nommée directrice par Roselyne Bachelot, alors ministre de la culture, en mars 2021, a été suspendue de ses activités. Des salariés de son équipe dénoncent sa gestion humaine défaillante. Sans consulter les tutelles qui subventionnent le lieu et auraient eu leur mot à dire, Stéphane Maby, directeur général de Brest’aim (la société d’économie mixte qui gère Le Quartz via une délégation de service public), démet alors la directrice. « De nombreux employés ont fait état de leur souffrance au travail. Face aux risques psychosociaux, j’ai pris mes responsabilités », soutient-il.
Une décision dont il n’aurait préalablement informé que Brest Métropole, laquelle se repose depuis des décennies sur Brest’aim pour s’occuper de ses établissements. Dans le giron de la société, se trouvent ainsi Le Quartz, Océanopolis (le grand aquarium de la ville), le Palais des congrès ou encore le stationnement payant. Pour Fabienne Loir, secrétaire générale de l’Association des scènes nationales, « le statut particulier du Quartz n’a jusqu’alors jamais posé problème. Mais ce qui se passe actuellement met en lumière son dysfonctionnement ». Les méthodes de Brest’aim sont en effet singulières. Au point que seul Stéphane Maby devrait recevoir les résultats de l’enquête qu’il a lui-même confiée à un cabinet de conseil privé.
Un inconfortable nomadisme
SVP Travail et organisation recueille ces jours-ci les doléances de l’équipe du théâtre. Le maintien ou le licenciement de Maïté Rivière dépend de ses conclusions. Sauf si le ministère de la culture parvient enfin à faire entendre sa voix. Il a diligenté en urgence l’Inspection générale des affaires culturelles pour une mission effectuée par des professionnels qui connaissent la réalité des scènes nationales.
Ce sera l’occasion, espère Maïté Rivière, « d’objectiver ce qui est en train de se jouer ». Et sans doute d’éviter de suspendre le sort d’un label national au verdict d’un chef d’entreprise. Du côté des salariés du Quartz, on se montre prudent. Diane Courvoisier, secrétaire générale, attend le retour du cabinet de conseil : « Il est important de prendre soin de l’équipe car c’est elle qui met en œuvre les projets. »
Maïté Rivière, pour sa part, dit n’avoir aucune information sur les faits qui lui sont reprochés : « Je suis dans l’incapacité de me défendre. » Quelles sont les fautes imputées à cette quadragénaire dont le projet artistique a dû s’adapter aux contraintes ? Depuis deux ans, le théâtre est fermé à cause d’un chantier de rénovation qui le condamne à un inconfortable nomadisme. Ce que rappelle à juste titre, sur les réseaux sociaux, David Bobée, patron du Théâtre du Nord, à Lille : « Pour avoir vu la directrice en fonctions, je l’ai trouvée présente, impliquée, dynamique, respectueuse, responsable face à une équipe éprouvée par la pandémie et les mesures sanitaires, les interminables travaux, le long “hors les murs” et qui était, malgré tout ça, engagée. » En septembre, un Quartz flambant neuf devrait rouvrir ses portes au public. Avec ou sans femme à sa tête.
Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Le Quartz, en 2003, à Brest (Finistère). MAISONNEUVE/SIPA

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 2:05 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 1/03/23 La nouvelle directrice de l’établissement public parisien explique son projet pour ce lieu où elle a pris ses quartiers depuis fin février.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/01/claire-dupont-veut-faire-de-la-bastille-un-theatre-traverse-par-les-echos-du-monde_6163798_3246.html
« J’ai toujours rêvé de diriger un théâtre, et d’en faire une maison vivante et habitée », s’amuse Claire Dupont, en ouvrant les portes du Théâtre de la Bastille, de plain-pied sur la rue de la Roquette à Paris, où elle a pris ses quartiers, lundi 20 février. A 42 ans, c’est elle qui a été nommée, à l’issue d’un long processus juridique pour transformer ses statuts, à la tête de ce lieu qui occupe une place à part dans le cœur des spectateurs parisiens. Jean-Marie Hordé, qui l’a dirigé de 1989 à la fin de 2022, a fait de la Bastille un foyer de découvertes, unique dans le rapport privilégié, intime, qu’il permet entre les artistes et les spectateurs. Dans une géographie théâtrale parisienne qui se recompose, sans forcément se renouveler, comme l’atteste le choix d’Olivier Py à la tête du Théâtre du Châtelet, l’Etat, lui, a fait à la Bastille un choix audacieux. Claire Dupont, si elle n’est pas encore connue du grand public, arrive dans le jeu avec un beau parcours et un profil de tête chercheuse à même d’affronter les évolutions qui vont affecter le secteur du spectacle vivant dans les prochaines années. Enseignante-chercheuse à l’université Paris-III et fondatrice de Prémisses Production, une officine dévolue à la jeune création fondée en 2017, elle a, dit-elle, « toujours voulu mêler ses deux amours, le théâtre et l’université ». Et c’est ce qu’elle a fait, ne cessant jamais d’enseigner, tout en travaillant au Théâtre de la Tempête, niché au cœur du bois de Vincennes, et en accompagnant, au tout début de leur parcours, des artistes comme Pauline Bureau ou Julien Gosselin. Avec Prémisses, elle a inventé un nouveau type de structure, faisant le constat qu’« il manquait un maillon pour aider les artistes sortant des écoles à démarrer, à se structurer et à entrer dans la profession ». Directement inspiré par l’économie sociale et solidaire, Prémisses est une sorte d’incubateur, qui a permis à de jeunes créateurs – souvent des créatrices, à l’image des membres du Collectif Marthe ou de Raphaëlle Rousseau – d’émerger. « Rajeunissement et diversification » Après un passage au Théâtre de la Cité internationale, il était temps pour elle d’envisager de prendre la tête d’une maison. La Bastille s’est présentée comme une occasion rêvée. « Une magie particulière habite les lieux, s’enthousiasme-t-elle. Je me reconnais totalement dans l’“expérience Bastille”, qui est celle d’un théâtre à échelle humaine, qui a ouvert nombre d’espaces créatifs. » Comme de nombreux spectateurs, c’est ici que Claire Dupont a découvert les Flamands du tg STAN, l’Iranien Amir Reza Koohestani, Nathalie Béasse ou les premiers spectacles de Tiago Rodrigues, devenu depuis directeur du Festival d’Avignon. Elle souhaite donc s’inscrire dans cette histoire, tout en la faisant évoluer. « Il existe un véritable public Bastille, qui considère ce théâtre comme le sien, ce qui est formidable, mais il a vieilli, constate-t-elle. Il va y avoir une problématique de rajeunissement et de diversification, qui est de notre responsabilité à tous dans la profession, pour la survie même du spectacle vivant. » Claire Dupont se propose donc de « désembastiller Bastille », d’en faire « un théâtre traversé par les échos du monde », ouvert sur d’autres territoires, à la fois proches et lointains, locaux et internationaux, que ceux qui ont été investis jusqu’à présent. La nouvelle patronne souhaite d’abord réancrer le théâtre dans son quartier du 11e arrondissement, par des actions hors les murs et des projets participatifs. Quant à la dimension internationale, qui fait partie intégrante de l’identité du théâtre, Claire Dupont veut « l’ouvrir sur d’autres polarités ». « L’histoire de Bastille a été très liée au formidable essor des arts de la scène en Belgique flamande depuis quarante ans, explique-t-elle. Aujourd’hui, je souhaite déplacer le regard vers les dramaturgies du bassin méditerranéen, qui sont en plein envol : au Liban, en Grèce, en Espagne, notamment, émergent des créateurs passionnants, qui offrent d’autres rapports à l’art. Et cette ouverture permet la rencontre des diversités au niveau des spectateurs : pour modifier un public, il faut modifier ce qu’on pose sur les plateaux, convoquer d’autres patrimoines culturels. » Un « parlement artistique » Pour faire de la Bastille ce « théâtre qui traverse son époque, et est traversé par elle », Claire Dupont va aussi mettre en place ce qu’elle appelle un « parlement artistique », composé de trois créateurs qui vont l’accompagner, chacun pour une saison, dans les choix de programmation : la performeuse catalane Agnès Mateus, l’acteur-auteur-performeur d’origine iranienne Gurshad Shaheman et la chorégraphe franco-camerounaise Betty Tchomanga. « Ensemble, nous allons structurer chaque saison autour d’une question contemporaine : l’identité, la montée des extrêmes en Europe, la migration, le corps colonial… » « Il s’agit donc de renouveler, tout en restant fidèle à l’esprit bien particulier de Bastille et à certaines équipes », résume Claire Dupont. « Nathalie Béasse, Nicolas Bouchaud, Pierre Maillet et sa compagnie Les Lucioles, le collectif L’Avantage du doute, et bien sûr Tiago Rodrigues s’il a envie de revenir avec des petites formes… » Autant d’artistes qui auront toujours leur place dans ce théâtre. Mais plus de la moitié de la programmation sera changée, promet-elle. Claire Dupont sait qu’elle arrive dans un théâtre dont les finances sont saines, fort de ses deux salles qui offrent un excellent rapport scène-public et d’un statut éclairci qui fait de la Bastille un établissement public, financé à 74 % par des subventions (le reste étant assuré par les recettes propres), mais sans les contraintes d’un centre dramatique ou d’une scène nationale. Bref, « le terrain est très favorable à l’invention », se félicite la nouvelle patronne, qui a déjà prouvé qu’elle pouvait joindre l’acte à la parole. Fabienne Darge Légende photo : Claire Dupont, la nouvelle directrice du Théâtre de la Bastille, à Paris, le 1er février 2023. MATTHEW AVIGNONE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 9:54 AM
|
par Ève Beauvallet dans Libération 17/02/23 En faisant monter sur scène des danseurs à la retraite, Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane interrogent dans deux spectacles le rapport au corps vieillissant. Un choix bienvenu dans un milieu où l’injonction de la performance peut être discriminante. Alors que partout s’embrasent les débats sur le manque de diversité dans les plateaux, notons qu’il est une sorte de diversité plus lésée que les autres et qui peine à gagner les bataillons de l’intersectionnalité et de la convergence des luttes : les vieux. Ces derniers, à la traîne du peloton des minorités pour réclamer leur visibilité, en tout cas dans la danse, secteur bien plus accueillant que le théâtre envers la diversité ethnique mais traditionnellement plus discriminant à l’encontre du moins performant, du plus flasque, du plus lent. Pourtant, de la même façon qu’un peintre gagne à explorer l’étendue de la palette des couleurs, le chorégraphe gagne souvent à étudier les qualités de mouvement propres au vieillissement autant que l’imaginaire que leurs gestes charrie. Certains l’ont déjà merveilleusement fait, mais isolément et toujours dans le champ du contemporain – plus démocratique, sur cette question, que celui du classique ou du hip-hop. Rappelons nous ici Pina Bausch qui recréait avec des gens de plus de 65 ans, mais aussi Pascal Rambert, Thierry Thieu Niang, Jean-Claude Gallotta, ou (La)Horde qui tous ont un jour créé pour des gens âgés. Guerriers clownesques C’est encore un ghetto de «vieux» aujourd’hui, qui s’ouvre sur la scène du Théâtre national de Chaillot à la faveur d’un événement produit par la compagnie italienne Aterballetto, et il en faut donc certainement pour que les castings daignent un jour se mixer davantage (faudra-t-il des quotas ?). Angelin Preljocaj et Rachid Ouramdane ont chacun travaillé avec d’anciens danseurs pro de plus de 60 ans pour deux pièces distinctes : celle du premier décevra ceux qui attendaient un déplacement dans l’esthétique habituelle de la grande star. Au lieu de quoi c’est la sensation que Preljocaj fait danser ici les vieux exactement comme il le fait avec les jeunes – sans doute pour témoigner ce dont ils sont encore capables ? –, dans une succession de tableaux un peu démonstratifs, qui ne gâchent cependant rien des belles ouverture et clôture de la chorégraphie, procession de guerriers clownesques pris dans un ralenti cinématographique, qui s’avancent dans la lumière, puis repartent dans l’oubli. Mais plus captivante pour nous est la plus courte (trop courte !) pièce de Rachid Ouramdane chorégraphiée pour Herma Vos, ancienne Bluebell Girl du Lido de Paris, et Darryl E.Woods, souvent vu chez Sidi Larbi Cherkaoui. Un nocturne couleur noir et paillettes, aux allures de vieux tube flottant comme un souvenir dans la poussière d’une salle de music-hall et qui convoque un couple de vieux danseurs pour une dernière danse – lui virtuose interprète de tchatcha, elle flamboyante dans son brushing Gena Rowlands. Mémoire inouïe du corps Construit comme un flash-back, avec ouverture sur la prouesse des jeunes années avant que les gestes ne se fassent plus épars et mémoriels, la pièce évoque souterrainement le vieillissement d’un couple fusionnel mais aussi la mémoire inouïe du corps, pleine d’énigmes et de courts-circuits temporels. Elle le fait avec les outils «signature» d’Ouramdane, ce piano minimaliste dont la nostalgie serre le cœur signé Jean-Baptiste Julien, un outrenoir à peine strié d’un projecteur, et des voix qui murmurent. L’effet, au final, d’une petite boîte à musique, fragile, ciselée, en train de se refermer. Programme Overdance : Un jour nouveau, de Rachid Ouramdane et Birthday party d’Angelin Preljocaj, jusqu’au 23 février à Chaillot, théâtre national de la danse à Paris. Du 2 au 4 mars au Pavillon d’Aix en Provence. Légende photo : Dans «Birthday party», Angelin Preljocaj fait danser les vieux exactement comme il le fait avec les jeunes. (Christophe Bernard)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2023 4:47 AM
|
Par Laurent Carpentier et Aureliano Tonet dans Le Monde - 26/02/23
Accusées de sexisme ou de postcolonialisme, dans les écoles d’art, de cinéma et de théâtre, les icônes d’hier sont aujourd’hui « déconstruites » et la parole des enseignants est remise en question.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/26/quand-les-etudiants-deboulonnent-godard-koltes-ou-tchekhov_6163345_3246.html
Lundi 5 décembre 2022, à la Fémis, la grande école parisienne de cinéma, Nicole Brenez tient un cours sur l’art et la manière de conclure un film. La directrice du département Analyse et culture cinématographique projette la fin de Sombre (1998), de Philippe Grandrieux : un féminicide, analyse-t-elle, après avoir averti que l’extrait contenait des images violentes. Tollé des étudiants qui quittent la salle. « Le viol n’est pas un motif narratif, il n’est pas un pivot dramaturgique, il n’est pas une pulsion de mort qui existe en chaque être humain », écrivent, deux jours plus tard, les élèves de première année, dans un long mail interpellant l’ensemble de la Fémis. « Le viol est une construction sociale largement acceptée, normalisée, esthétisée et érotisée. Il est temps d’en parler comme tel. » Signé : « Les femmes de la promotion Kelly Reichardt… » Anecdotique ? Pas vraiment. L’événement raconte un mouvement que l’on retrouve dans la plupart des lieux où s’enseigne la culture. A la Fémis, dans l’urgence, la direction organise un débat, vendredi 9 décembre 2022. « Trois heures de dialogue de sourds, entre deux générations irréconciliables », juge une étudiante. « Un échange fructueux, assure, au contraire, Nathalie Coste-Cerdan, la directrice générale, pour qui tout est rentré dans l’ordre. Un groupe de réflexion, dont font partie certaines étudiantes de la pétition, s’est réuni plusieurs fois : comment mieux encadrer et contextualiser les représentations violentes, sans les interdire ? » Fin janvier, au bar Le 61, un café parisien près du canal de La Villette, Nicole Brenez dédicace le livre qu’elle vient d’écrire, Jean-Luc Godard (De L’incidence éditeur, 336 pages, 9 euros). La petite salle grouille de cinéphiles venus l’écouter. Emue, elle parle mezza voce, tout son corps semble s’excuser d’être là, un tout petit peu dans la lumière : « Dans ma génération, on s’intéressait plus aux œuvres qu’aux gens. Je suis une formaliste, j’ai été éduquée comme ça. Alors que je suis une groupie de Godard, je n’avais pas lu une biographie et n’avais jamais imaginé le rencontrer », raconte la critique devenue une proche du réalisateur. On cherche à lui parler. On évoque la Fémis. Sa voix se tarit, submergée de tristesse. Tout juste balbutie-t-elle : « Tout mon principe de base existentiel, structurant, idéologique, m’empêche de me battre contre mes élèves. J’ai toujours été pour la liberté de la parole, la remise en question, je suis là pour les aider. On est dans une absurdité totale… » Lire aussi Article réservé à nos abonnés Un vent de diversité souffle sur les écoles de cinéma Aux Beaux-Arts de Marseille, c’est Le Mépris (1963), de ce même Godard, qui a mis sur la sellette Didier Morin, professeur de cinéma et de lettres pendant un quart de siècle. « Depuis quelque temps, pendant les projections, j’entendais un brouhaha dans le fond de la salle, je croyais que c’était de l’inattention, mais, ce jour-là, j’ai compris… » Ce jour-là, « elles » se sont levées et ont débranché le projecteur. C’était en 2019. Exit Brigitte Bardot dans le plus simple appareil roucoulant « Tu les aimes mes fesses ? Et mes seins ? ». Spécialiste de Pier Paolo Pasolini et de Jean Genet, Didier Morin pousse un soupir sans fin : « Et encore, je n’ai jamais montré Une sale histoire (1977), de Jean Eustache, où Michael Lonsdale raconte comment il est devenu voyeur grâce à un trou percé dans les toilettes des femmes… Je me serais fait incendier. » « Une génération hypersensible » Partout, des profs sur le gril. En février 2020, à Paris-VIII, une historienne travaillant sur les représentations de l’affaire Dreyfus met le film de Roman Polanski à son programme. La séance est interrompue. Un an plus tôt à la Sorbonne, Les Suppliantes, d’Eschyle, sont bloquées parce que le metteur en scène, Philippe Brunet, spécialiste de la Grèce antique dont il dit suivre la tradition, a maquillé une Danaïde couleur cuivre : délit de « blackface ». Ici, c’est un linguiste tenant une conférence anti-écriture inclusive qui est arrosé d’urine ; là, une professeure qui écrit « chère madame » à ses élèves se retrouve attaquée parce que le « chère » est jugé familier. « C’est une génération hypersensible », se désole un professeur confronté à une étudiante horrifiée par la photo de Richard Avedon, Dovima with Elephants (1955), qui heurte ses convictions animalistes. Combat de nègre et de chiens (1979), la pièce de Bernard-Marie Koltès, reste elle en travers de la gorge d’élèves de Paris-III. La liste est sans fin. L « Juste de la hargne contre notre autorité de la part de quelques harpies débiles », s’emporte un professeur d’histoire de l’art. Attaqué pour ses manières d’un autre âge – du genre à dire à une étudiante qu’elle est « jolie comme une sculpture de porcelaine » –, il a fini, poussé par son administration, par partir à la retraite bien avant ses 64 ans. Au commissariat de police où il avait été convoqué, l’inspectrice lui avait signalé : « Vous montrez des nus dans vos cours ! » Il en rigole encore. « Je travaillais sur l’arte povera et l’art brut, je n’ai jamais montré de nus, mais je lui ai conseillé d’aller faire un tour au Louvre. » Convoqué au commissariat, Didier Morin l’a été lui aussi. L’homme qui, aux Beaux-Arts de Marseille, faisait étudier Le Mépris aurait, à la cantine, touché avec son plateau-repas les fesses d’une élève. Non-lieu judiciaire, opprobre public. Il a quitté l’enseignement. Ce que, dans leur texte, les « femmes de la promotion Kelly Reichardt » de la Fémis reprochent à leur professeur, au-delà d’avoir montré quelque chose qu’elles considèrent comme du « male gaze » (le regard masculin érotisant le corps des femmes), c’est de ne pas les avoir mieux averties du contexte, de n’avoir pas actionné de « trigger warning » (« avertissement en amont »)… Né sur les campus américains, le lexique « woke » (le « réveil » des consciences) a gagné l’université française. « Cancel culture » (dénonciation publique et annulation d’événements comme méthode de lutte), « safe place » (lieu où l’on ne tolère pas les comportements stigmatisants), « blackface » (grimage du visage en noir)… Lire aussi Article réservé à nos abonnés Le péril largement exagéré d’une jeunesse « woke » en rupture « On sait bien ce que produit le “trigger warning” aux Etats-Unis : de l’injustice, de la censure, s’inquiète un professeur de Paris-III qui a longtemps travaillé outre-Atlantique. Là-bas, les élèves sont des clients. Ils paient et il faut les satisfaire. Chez nous, c’est moins le cas. » A voir. Là où l’école publique, laïque et obligatoire avait sanctifié la parole du maître, l’autonomie grandissante des établissements du supérieur et l’optimisation financière qui va avec sont en train de changer la donne. L’élève, qu’il paie chèrement ses études ou qu’il soit boursier, devient une variable économique, un consommateur à satisfaire. Le professeur, autrefois systématiquement soutenu par l’institution, est remis en question. Ajoutez la caisse de résonance des réseaux sociaux : désormais, la voix des élèves n’est pas seulement écoutée, elle est entendue. Comme le raconte Emma, en cinquième année d’un cursus de médiation culturelle à Bordeaux : « A nous, on a appris qu’on avait le droit de parler et que notre parole avait un sens. » En 2022, un de leurs professeurs tenait des propos « sexistes et racistes ». Les élèves sont allés voir la direction. Il a disparu des effectifs. Enseignement en jeu Un changement de paradigme salutaire pour les jeunes générations. Qui laisse, de l’autre côté, les enseignants parfois bien seuls face à la vague. Spécialiste de l’essai documentaire et du montage cinématographique, Bertrand Bacqué, 58 ans, est professeur associé à la Haute Ecole d’art et de design (HEAD) de Genève (Suisse). En avril, il travaille avec ses élèves sur un texte de Johan van der Keuken datant de 1967, « La vérité 24 fois par seconde » – référence à une formule de Godard, une fois de plus. Comme il le fait depuis dix ans, Bertrand Bacqué diffuse un extrait d’un film de l’auteur, Lucebert, temps et adieux (1994). « C’est un montage très serré, des travailleurs sous le soleil, un dictateur grimaçant, une chèvre qu’on égorge, et puis une fête en Espagne avec les Rois mages, dont Balthazar, le visage peint, raconte un élève. Une étudiante noire a jugé que c’était négrophobe, elle s’est couchée sur sa table. Le prof a essayé de lui expliquer que van der Keuken était de son côté. Rien n’y a fait. » L’élève ne vient plus aux cours, le professeur ne valide pas son semestre. Le voilà bientôt convoqué par l’administration pour diffusion d’images racistes. C’est que la HEAD est à la pointe de la lutte contre les discriminations. Il y a quatre ans, son président a nommé un « déléguex » à l’inclusivité – le « x » désigne le non-genré. Transgenre, Nayansaku Mufwankolo est en effet, tel que l’explique sa bio sur le site de l’université, « unx poetx et chercheurx en art contemporain diploméx d’un master de l’université de Lausanne en anglais avec spécialisation en new american studies et en histoire de l’art ». A Bertrand Bacqué, on demande de suivre une formation sur ces questions. « Ça a l’air futile, raconté comme ça, mais si l’écriture inclusive fait autant peur, c’est qu’elle questionne le pouvoir », réagit Iris Brey, 37 ans. Avec son essai Le Regard féminin. Une révolution à l’écran (Ed. de L’Olivier, 2020), cette critique de cinéma est devenue un modèle pour les élèves qui se clament « déconstruit.e.s ». « On est à un endroit de fracture et de scission. C’est un moment d’inconfort, qui peut créer des situations ubuesques, mais je pense que ça va déboucher sur une vision fructueuse du cinéma. A l’image de ce qu’a fait le mouvement structuraliste dans les années 1960, réfléchir aujourd’hui à travers une grille féministe ne peut que générer de la pensée. Godard ne disparaîtra pas, mais il rencontrerait moins de résistance si, à côté de ses films, on étudiait un peu plus ceux de Chantal Akerman. » Helléniste, venue au cinéma par la littérature et le mythe de Médée, longtemps enseignante à la New York University, Iris Brey se veut conciliatrice : « Nicole Brenez est, pour moi, une des plus grandes critiques qui existent, qui a beaucoup apporté à la compréhension d’un cinéma queer. Mais, à la Fémis comme ailleurs, c’est moins la question du “trigger warning” que celle de l’enseignement qui est en jeu. Dans les listes de films recommandés par le corps professoral, je vois une absence criante de réalisatrices ou de cinéastes issus de minorités. » Nathalie Coste-Cerdan insiste, elle, sur la marche vers davantage de parité et de pluralité qu’a entreprise son établissement : « Ce socle, coconstruit avec les étudiants, ne s’érige pas en un jour. » Iris Brey en convient : revoir sa façon d’enseigner exige du temps. « Quand j’ai commencé à donner des cours, ayant programmé A bout de souffle, j’ai vu des étudiantes me montrer des choses – le regard sur la femme enceinte, la façon dont le corps est cadré, le mépris qui en ressort –, que je n’avais pas perçues alors que je me pensais plutôt déconstruite et féministe. La nouvelle génération a un prisme qui est beaucoup plus vif sur les questions de sexisme. » Risque de l’autocensure Lisa Quiesse, 19 ans, et Enora Giboire, 21 ans, sont en deuxième année de licence de cinéma à La Sorbonne - Saint-Charles. « On est en colère depuis le début de l’année », dit l’une. « Ça fait plaisir de voir que c’est en train d’éclore un peu partout », confirme l’autre. « Par exemple, ce matin, en cours de postproduction, un élève a présenté un film sur une femme trans. Et le prof ne savait pas comment en parler. Il ? Elle ? Il parlait de transsexualité au lieu de transidentité, s’étonne Lisa. Les profs auraient besoin d’une mise à niveau. » La première vient de Caen, l’autre de Rennes. Elles sont toutes deux cisgenres et « elles » (dans le monde « déconstruit », on annonce son pronom pour mieux inclure les personnes trans et non binaires). Parents brodeuse, sculpteur, architecte… ouverts à la discussion. Elles aussi. Révoltées certes (« Entre les déconstruits et les autres élèves, il y a une rupture »), capables de tenir la dragée haute aux mandarins ou de passer à l’action (laquelle, elles ne le savent pas encore), mais aussi promptes à s’émerveiller qu’on les écoute. « On a compris que ça n’allait pas, grimace Enora, quand une prof, à qui on suggérait qu’il y avait un peu plus de réalisatrices importantes que les trois qu’elle citait, nous a répondu : “Ça fait trente ans que je fais le même cours, je ne vais pas le refaire.” » Et Lisa d’embrayer : « On a un doctorant, on dirait qu’il n’aime qu’un seul film : La Vie d’Adèle ! Quand on fait remarquer que Kechiche pose un regard masculin, que D. W. Griffith a aidé le Ku Klux Klan, que Polanski a été accusé de viol, on nous renvoie toujours au contexte. Il a bon dos, le contexte. Eux, ils ne se remettent pas dans le contexte ! » Un vent de panique passe sur l’université. A Toulouse, un colloque est organisé en mars 2022 sur « Les Nouvelles Censures ». Simple journée d’études réservée aux doctorants ? Quand nous avons voulu en savoir plus, les organisatrices ont pris peur : « Il ne faut pas en parler. D’ailleurs ce n’est pas ouvert au public », ont-elles botté en touche. « Le vrai risque derrière tout ça, c’est l’autocensure, relève une professeur de philosophie qui préférera, tout compte fait, rester anonyme. Tzvetan Todorov racontait comment, avant la chute du rideau de fer, les intellectuels bulgares s’étaient rués sur le structuralisme. Parce que c’était un sujet neutre. On parlait de forme, ça évitait les ennuis… C’est compréhensible de ne pas vouloir aller en cours la peur au ventre. » « Des pyramides de pouvoir » C’est ainsi que les rebelles d’hier, dans leur refus de tout diktat, se retrouvent en première ligne : « Quand le wokisme est arrivé, j’étais plein d’espoir, cela allait apporter de l’air frais, témoigne le plasticien Jean-Luc Verna, qui enseigne le dessin aux Beaux-Arts de Cergy (Val-d’Oise). Puis c’est devenu une idéologie, et enfin du marketing. Cela donne des groupes fermés, beaucoup d’entre-soi, les queers avec les queers, les racisés avec les racisés. Ces gens non binaires ont une vision très binaire. Quid du droit au flou ? Je n’en peux plus des “alphabet people” [référence à l’acronyme LGBTQIA+ : lesbiennes, gay, bisexuels, transexuels, queer, intersexe, asexuel]. C’est le monde d’Internet, des catégories, qui crée de la souffrance pour ceux qui n’entrent pas dans le cadre… Tout ça, ce sont des élèves qui érigent des pyramides de pouvoir. Plus ils réclament de l’horizontalité, plus ils recréent de la verticalité. » Enorme chaîne noire sur sa combinaison noire, couvert de tatouages qui ruissellent depuis le sommet du crâne qu’il a rond et lisse, un sourire brillant de dents métalliques, Jean-Luc Verna n’est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt : « Entre profs, on ne parle plus que de ça. Il y a quelque temps, on a reçu une circulaire. Règle 1 : pas d’interaction physique. Donc si quelqu’un pleure, on ne peut pas lui toucher le bras ?, commente-t-il. J’ai rassuré les étudiants : je n’aime pas les corps de jeunes. » Il prend une pose pour minauder : « J’ai 57 ans, mais j’en parais 37 », avant de reprendre : « Règle numéro 2 : des interactions “mates”. Pas d’humour, quoi. C’est dommage parce que, pour moi, c’est le lubrifiant pédagogique numéro 1. » Il en rit, mais ces « ligues de vertu » le mettent en colère. « A Cergy, mes collègues blancs, hétéros, de plus de 50 ans, rasent les murs. Ils sont considérés comme des agresseurs potentiels, suppôts du patriarcat. Le fait que je sois solidaire et que je le dise en public, ça ne passe pas. » En octobre 2022, il était invité à donner une conférence devant trois cents personnes à la Villa Arson, à Nice, où il a passé vingt-cinq ans. « Moi qui suis une vieille pédale maquillée, qui leur ai pavé le chemin, j’ai senti du flottement quand j’ai dit qu’avant d’être homosexuel, j’étais un homme, et avant d’être un homme, un artiste. Que je n’étais pas fier d’être homosexuel : je ne l’ai pas choisi, comme je n’ai pas choisi d’être blanc. Et que j’accepterai de porter le drapeau arc-en-ciel lorsqu’il comprendra une couleur pour les hétérosexuels… » Le Niçois s’est pris une bronca. « Une voie à suivre » Un mois après, une autre ancienne de l’école, l’artiste égyptienne réputée féministe Ghada Amer se voit, elle aussi, reproché de n’être « pas assez ». « C’est beaucoup plus agressif qu’aux Etats-Unis », raconte celle qui vit et travaille désormais à New York. De passage en France cet hiver, elle donne quelques conférences dans les écoles d’art. A Marseille, la voilà prise à partie. « Je suis inclusive, pas exclusive, #metoo est devenu ça. » Elle rit mais son rire sonne tristement. « Ils dogmatisent une pensée qui est importante pour moi, sur laquelle, pendant trente ans, j’étais seule à me battre. » Jointe au téléphone, elle évoque ce professeur qui, lorsqu’elle étudiait à la Villa Arson, à la fin des années 1980, refusait aux femmes l’accès à son cours de peinture. « C’est lui qui m’a réveillée. J’ai été à la bibliothèque et vu le peu de place fait aux femmes dans les arts plastiques… En Egypte, j’avais dû me battre pour le corps, en France, pour la tête. C’était angoissant, mais j’en ai fait une arme. » Lorsqu’elle revient à la Villa Arson, en décembre 2022, l’amphithéâtre est plein. De nouveau, on l’interpelle : « Quel est votre rapport au postcolonialisme ? » Elle répond qu’elle fait de l’art… « C’est comme si j’avais dit “Dieu n’existe pas” à des religieux. » La salle insiste : « Que pensez-vous du racisme systémique de la Villa Arson ? » Elle ne comprend pas. « Le directeur était là, il aurait dû réagir… », s’étonne-t-elle. Les élèves ont quitté le lieu. « Qu’une génération nouvelle s’affirme en rupture, c’est un mécanisme assez classique, considère Sylvain Lizon, le directeur de l’école. En France, il y a une histoire particulière des relations entre le pouvoir, les artistes et les œuvres que cette génération bat en brèche, revendiquant ses propres repères. On vit un moment particulier et passionnant qui invite toute la communauté à se déplacer. Après, c’est vrai que ça nous demande d’être agiles. » De l’agilité, Claire Lasne Darcueil en a : « Le tout, c’est de ne pas monter dans les tours, si vous voulez que l’autre n’y aille pas non plus », dit en souriant la directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique qui quitte son poste fin juin. « On assiste à la remise en cause d’un héritage par des gens qui n’en sont pas très contents. Si on est honnête, est-ce que l’on peut l’être de ce que nous leur laissons ? On a bouffé des fraises en hiver et on a vécu une liberté de création qui repose sur des injustices fondamentales… Je ne comprends pas les gens qui utilisent le mot de “censure” n’importe comment. Quand je passe dans la classe internationale, en écoutant les Afghanes, je pèse ce que c’est vraiment. » Lire l’enquête : Article réservé à nos abonnés Dans les écoles de théâtre, les pédagogies brutales ont toujours cours La photo des élèves du Conservatoire, témoigne-t-elle, a changé en dix ans. « On est passé de 15 % de boursiers à quelque chose comme 60 % aujourd’hui. Nous enseignons à des personnes qui ont lutté pour être là. Et qui doutent que le monde du théâtre et du cinéma les attende à bras ouverts… » Claire Lasne Darcueil est de celles et ceux qui prennent ce mouvement « comme une chance, une voie à suivre ». « Dès que des gens protestent fort, on dit qu’ils protestent trop fort, et mal, qu’ils sont dangereux. Alors que j’ai en face de moi des gens qui me font découvrir des choses. Même sur Tchekhov, mon auteur, mon chéri… » Et de citer l’acte III d’Oncle Vania, lorsque Astrov arrache un baiser à Elena Andréevna : « C’est le classique “Tu me dis non, mais tu veux dire oui.” Il y a encore trois ans, ça ne me faisait rien. Aujourd’hui, ça me saute aux yeux. Du coup, on l’a travaillé. Quinze versions différentes, quinze interprétations, c’était très riche. La question, c’est d’interroger le répertoire, pas de le mettre à la poubelle. » « Un désir de justice » Latiniste et helléniste, Pierre Vesperini, 45 ans, replace ces soubresauts dans le temps long. « A la fac, quand j’enseignais le viol de Lucrèce, l’événement fondateur de la République romaine, j’avais à l’esprit qu’il était tout à fait possible qu’une ou plusieurs de mes étudiantes aient subi un viol. Je faisais attention à la façon dont j’en parlais. C’était il y a vingt ans, bien avant #metoo. Mais il suffisait d’avoir un minimum de décence et de respect pour y penser. » L’historien ne nie pas un fossé entre des professeurs « engourdis » et des étudiants « démunis », les premiers prisonniers d’un « savoir sacralisé et sclérosé », les seconds manquant de recul, faute d’avoir reçu « un enseignement suffisamment riche pour les initier à la complexité de l’histoire de la culture européenne ». « La génération de 68 voulait en finir avec le puritanisme, au nom de l’autonomie du règne esthétique. Il fallait choquer le bourgeois, en brandissant Sade, Bataille… La nouvelle génération ramène de la morale, un désir de justice qu’il faut écouter. » Lui qui, dans Que faire du passé ? Réflexions sur la cancel culture (Fayard, 2022), rappelle que les Romains érigeaient des statues à leurs ennemis, d’Hannibal à Cléopâtre, en est persuadé : « L’esthétique doit pouvoir dialoguer avec l’éthique. » Sur quel art, quel cinéma, quel théâtre, tout cela ouvre-t-il ? Telle est la question qui travaille ces enseignants mis au défi de leur propre déconstruction. Aux Beaux-Arts de Paris, où il enseigne, le cinéaste et plasticien Clément Cogitore n’est pas inquiet, bien au contraire : « De tout ça, on me parle beaucoup, de ces échanges violents. Moi, je n’y suis pas confronté. Mes étudiants pensent la complexité, et cela me donne une grande foi en l’avenir. Parce que, entre un paternalisme qui regarde le monde d’un point de vue dominant et des slogans qui simplifient, le vrai sujet est là : celui de la complexité, souligne l’artiste de 39 ans. Tout mouvement important crée sa radicalité ; il n’en reste pas moins important. » Laurent Carpentier et Aureliano Tonet / Le Monde Illustration : SÉVERIN MILLET Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2023 4:59 AM
|
ENTRETIEN « Je ne serais pas arrivée là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. La comédienne Ariane Ascaride revient sur ses origines populaires, où elle a puisé une énergie hors du commun pour s’imposer dans un monde dont elle n’avait pas les codes.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/26/ariane-ascaride-il-ne-faut-jamais-laisser-quelqu-un-vous-dire-que-vous-ne-pouvez-pas-faire-quelque-chose_6163336_3246.html
Figure emblématique des films de Robert Guédiguian, son compagnon, Ariane Ascaride a obtenu le César de la meilleure actrice en 1998 pour Marius et Jeannette. A 68 ans, la comédienne multiplie les projets théâtraux. Elle est actuellement sur deux scènes à Paris, au Lucernaire pour des poèmes de Bertolt Brecht et à La Scala pour Gisèle Halimi, une farouche liberté, où elle raconte, au côté de Philippine Pierre-Brossolette, l’itinéraire de la célèbre avocate, une combattante. Comme elle. Je ne serais pas arrivée là si… Si je n’étais pas née dans une famille modeste, la dernière après deux garçons. En quoi cette position dans la fratrie est-elle importante ? Je suis née à Marseille, dans une famille à moitié d’origine italienne, à une époque où les filles, dans un milieu populaire, étaient là pour aider leur mère, apporter le café au lit à leurs frères, et peut-être après se marier. Si elles faisaient des études, on était content, mais ce n’était pas mis en avant. Mon père était heureux d’avoir une fille, mais en arrivant beaucoup plus tard que mes frères, dans cette famille déjà chaotique, j’ai bousculé l’équilibre qui s’était instauré. Ce sentiment de différence entre fille et garçon, l’avez-vous ressenti très tôt ? Je l’ai ressenti presque physiquement, parce qu’un jour mon père m’a coupé les cheveux. Jusqu’à l’âge de 8 ans, j’avais de longues tresses, des jupes plissées et tout le monde disait que j’étais très gentille. Quand ma mère me démêlait les cheveux et me coiffait, je pleurais beaucoup et ça la mettait en retard pour partir au travail. Elle était employée de bureau. Un matin, mon père, ancien coiffeur devenu représentant pour L’Oréal, a lancé : « Ça suffit, je lui coupe les cheveux. » Il neigeait sur Marseille. Ma mère m’avait acheté un pantalon. Je suis sortie dans la rue avec cette tenue et mes cheveux courts. Ce matin-là, la boulangère m’a dit : « Petit, qui tu es ? » J’ai adoré, c’était comme si je transgressais quelque chose. Je pouvais enfin courir comme un garçon. J’ai eu la sensation d’une grande liberté, qui ne m’a jamais plus quittée. Vous évoquez une famille « chaotique » qu’est-ce que cela signifie ? Mes parents ne s’entendaient plus du tout. Mon père avait des maîtresses, il était souvent absent. Cette névrose de couple est passée avant nous. Ils ne discutaient jamais du sort de leurs enfants. Ils étaient dans un combat. Ma mère a toujours aimé mon père, c’était le seul homme de sa vie alors elle s’est fermée, est devenue très dure pour s’en sortir. C’était une époque où on restait ensemble, quoi qu’il en soit. Ils ne se sont jamais quittés. De toute façon, pour ma mère, ce n’était pas possible de partir. Elle n’aurait pas pu s’en sortir financièrement avec trois enfants. Mes parents ne se parlaient plus, sauf pour s’engueuler. Avec mes frères, on a poussé un peu tout seuls. Il fallait juste bien travailler à l’école. Ça, c’était fondamental pour mes parents. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Ariane Ascaride : « Je suis la fille d’une femme entravée » Est-ce parce qu’ils regrettaient de ne pas avoir fait d’études ? Ma mère aurait rêvé d’être institutrice, mais elle a été mise au travail à 15 ans pour que de l’argent rentre dans sa maison. Et mon père a travaillé dès l’âge de 12 ans. Ce sont deux autodidactes. Mon père était curieux de tout, il lisait beaucoup et faisait du théâtre en amateur. Son goût pour le théâtre vient du fait que la réalité était pour lui insupportable. Je dis toujours que je suis la fille de Peter Pan parce que mon père détestait la réalité. C’était un être de fantaisie, avec les défauts et le côté difficile à vivre qui vont avec. Il aurait aimé être chanteur d’opéra. Il nous cassait les pieds à chanter tous les matins ! Il nous obligeait à écouter des émissions de radio sur l’opéra, il était aussi un conteur, avec toute une culture populaire. Il nous racontait les légendes du sud de l’Italie. Tout cela m’a nourrie. Mais il était absolument interdit de parler italien à la maison. Et c’est grâce à votre père que vous découvrez le théâtre… Quand on était petits, avec mes frères, on allait le voir sur scène les week-ends. Quand il jouait, il se grimait. J’avais une fascination pour sa grande boîte à maquillage. Je l’ouvrais pour en respirer l’odeur que j’adorais. C’était un temps où, en province, on parlait du théâtre amateur dans les journaux locaux. Mon père découpait les critiques pour les garder. Un jour, je devais avoir 7 ans, il m’a emmenée, sans rien m’expliquer, à une répétition. Je me suis retrouvée sur une scène. D’un coup, c’était un espace que je maîtrisais complètement. Comme un marin qui met les pieds sur un bateau, j’avais trouvé mon endroit, un endroit où on pouvait faire des choses folles et qui me procurait une sensation de liberté. A 10 ans, j’ai joué un rôle de garçon dans une pièce avec mon père et j’ai décroché un prix d’interprétation au concours national de théâtre amateur. Quel processus vous mène au métier de comédienne ? Au lycée de filles, un de mes profs avait monté un club de théâtre et choisi Le Barbier de Séville. Il m’a imposé de jouer Figaro. Je me suis beaucoup amusée à faire ce rôle. Les enseignants me disaient que j’étais formidable, alors que pour moi ce n’était rien. J’étais adolescente, la question était plutôt d’avoir un copain, de faire un métier de fille. Et puis ça a cheminé tout seul dans ma tête. En dernière année de lycée, je me suis inscrite au concours du conservatoire de Marseille. Je l’ai annoncé à mes parents une fois que j’ai été reçue. Puis j’ai obtenu mon bac. Personne ne m’a accompagnée pour voir les résultats. Mes frères l’avaient eu, donc c’était normal de l’avoir. La gratification, ce n’était pas le genre de la maison, alors que, quand même, merde, j’étais contente de décrocher le bac ! Au conservatoire de Marseille, il n’y avait que des filles de la bourgeoisie. Les parents de mes copines disaient : « Elle a une énergie Ascaride, mais elle est quand même un peu vulgaire. » Je n’étais pas vulgaire, j’étais juste issue d’un milieu populaire. Et je les ai eus, mes premiers prix de classique et de moderne ! A cette époque, j’ai découvert dans une émission de télévision un monsieur qui s’appelait Marcel Bluwal. Sa manière de parler avec un accent parisien insensé, ce qu’il disait sur son métier, tout m’interpellait chez ce metteur en scène. A travers l’écran de télé, c’était comme une rencontre humaine. Quand j’ai su qu’il était professeur au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, j’ai décidé de passer ce concours. Je voulais absolument le rencontrer, cela m’était nécessaire. Mais, pour l’heure, je menais, en parallèle du conservatoire de Marseille, mes études à la fac de sociologie. Socio, c’était logique pour la fille d’une famille de gauche. La discussion politique est-elle présente dans votre famille ? Tout le temps. Ça se foutait sur la gueule le dimanche. Mon grand-père français était anarcho-syndicaliste et mon père a été résistant pendant la guerre. Un de mes frères, gauchiste à mort, a occupé la fac d’Aix-Marseille pendant Mai 68. Et puis quand même, merde, je sortais d’un milieu où il n’y avait pas d’argent. Alors, soit vous vous dites « ben c’est comme ça » (je ne supporte pas cette phrase), soit vous considérez que « peut-être, on peut faire quelque chose ». Je suis de ce côté-là. Et c’est grâce à la politique que vous avez rencontré Robert Guédiguian… J’étais en deuxième année de sociologie et adhérente à l’UNEF. Lors de la rentrée universitaire, je fais, auprès des nouveaux étudiants, une intervention en amphithéâtre au nom du syndicat. Au fond de l’amphi, j’aperçois deux mecs. L’un avait de longs cheveux, un casque et un blouson de moto, il était habillé en noir avec une écharpe rouge. Je sors et reste devant la porte avec mes bulletins d’adhésion à l’UNEF. Et lui, il vient me voir et me dit [elle imite l’accent marseillais ] : « Bien parlé ». Je le regarde et je lâche : « Qui est ce con ? » Je crois que ça lui a plu que je dise ça ! Evidemment, il s’est syndiqué à l’UNEF. Il était déjà au PCF. On a d’abord eu une formidable connivence amicale. Il roulait des mécaniques, à un point dont vous n’avez pas idée ! Ça me faisait rire. Il arrivait de l’Estaque, la jouait prolo et il avait sa moto. Il m’a dit : « Toi, tu peux monter sur ma moto. » Il draguait comme un malade. Et vous vous êtes mariés très jeunes… Très, très jeunes. J’avais 20 ans. Lui 21 ans. N’est-ce pas contradictoire avec votre goût pour la liberté ? Vous pensez ça parce que vous ne savez pas comment a été faite la demande en mariage. Dans le cadre de mes cours d’ethnologie, je faisais un stage à Vauvenargues, près d’Aix-en-Provence. On était plus ou moins ensemble, Robert et moi. Un jour, il vient me chercher avec sa moto. On roule et il me dit : « Et si on se mariait ? » J’étais tellement étonnée ! Il ajoute : « Comme ça, on combattra l’institution de l’intérieur. » Cela m’a fait tellement rire que j’ai dit oui. Pour sa mère, j’étais tout le contraire de ce dont elle avait rêvé pour son fils. Puis j’ai passé le concours du Conservatoire national de Paris. Je l’ai réussi à la deuxième tentative. Dans le jury du concours, il y avait notamment Marcel Bluwal et Antoine Vitez. En première année je n’étais pas dans la classe de Marcel Bluwal, mais je pouvais assister à ses cours. Un jour, j’y suis allée. Il travaillait sur Le Cercle de craie caucasien. Dans cette pièce de Bertolt Brecht, il y a une scène où le personnage de Groucha lave le linge au bord d’une rivière. « Ça ne va pas, tu ne sais pas laver », dit Bluwal à son élève. Il se retourne et lance : « Qui veut le faire ? » Je lève le doigt. J’y vais et j’ai le geste juste parce que dans ma famille, il n’y avait pas de machine, on lavait tout à la main. « Eh ben, voilà », dit-il. J’étais tellement contente. Lui et Antoine Vitez m’ont beaucoup aidée. C’étaient des militants du PCF qui voulaient d’autres physiques, d’autres origines que ceux de la bourgeoisie dans les promotions. Avec Jean-Pierre Darroussin et Patrick Bonnel, on est tous entrés la même année au conservatoire et on est tous allés chez Bluwal. Même après ma sortie du conservatoire, on me disait que j’étais atypique. On ne savait pas où me mettre. J’ai eu une conversation avec Marcel Bluwal, il m’a prévenue : « Ça ira quand tu auras 40 ans. » J’ai failli tomber par terre. Mais il avait raison. Sans la bande de Robert Guédigian, je ne sais pas ce que je serais devenue. Cette bande, ce sont des gens qui se sont reconnus et qui ne se sont jamais fâchés. Quel a été votre moteur pour vous faire une place dans le milieu bourgeois du cinéma ? Un orgueil démesuré. L’orgueil n’est pas un défaut. Vous n’avez pas idée à quel point je suis têtue et opiniâtre. Il ne faut jamais laisser quelqu’un vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Jamais. Même si ça semble fou. Il faut essayer. Et j’ai un sentiment de survie extrêmement développé. Qu’est-ce que vous appelez un « sentiment de survie » ? Je suis une survivante. Je ne devais pas naître. Je n’étais pas du tout prévue et pas du tout voulue. A 15 ans, ma mère – qui est un peu directe – m’a dit : « Quand je pense à tout ce que j’ai fait pour ne pas t’avoir ! Mais quand même, maintenant, je suis contente. » Inconsciemment, les discours entendus enfant vous marquent. La mémoire est très importante. Je suis l’héritière de pauvres, de gens qui n’avaient rien, qui ont été obligés de quitter leur pays, de gens qu’on a traités de macaronis d’un côté, de cons, de pauvres de l’autre côté. En seconde, un prof de français m’avait dit : « Oh, mais vous, Ascaride, d’où vous venez, vous ne pouvez pas comprendre. » Je ne l’ai jamais oublié. Alors quand Annie Ernaux, lors de son prix Nobel, a parlé de revanche, de « venger sa race », j’ai adoré, c’est exactement ça. L’attribution de ce prix à Annie Ernaux a aussi suscité des réactions violentes… Cela a été immonde. Honte à ceux qui ont critiqué cette attribution ! On nous raconte que la lutte des classes est une vieille histoire… Tu parles, Charles ! C’est le monde dans lequel on est depuis des siècles. Ce qui s’est passé autour d’Annie Ernaux raconte à quel point nous n’avons pas de place, et quand on arrive à en avoir une, c’est le résultat d’une lutte inimaginable. Parce que la bourgeoisie, elle, ne laisse pas de place. On me dit souvent que je suis une actrice engagée. Non, je suis une actrice citoyenne. Je croyais qu’avec l’âge je me calmerai, mais non, les injustices me mettent de plus en plus en colère. On ne mesure pas à quel point c’est fatigant d’être pauvre, de tout le temps réfléchir à comment on va finir le mois. Que reste-t-il de la petite fille aux cheveux courts que vous étiez à 8 ans ? Je n’ai jamais abandonné mon enfance. Toute ma vie, j’ai essayé de retrouver cette liberté d’enfant. A mon âge, je suis en train d’y parvenir, je me sens beaucoup plus libre. Je suis ce que je suis. Ça a pris du temps. Au moins, je mourrai en étant ce que je suis. Je suis contente de ça. Je vais vous faire une confidence : peut-être qu’un jour je vais tomber, paf, comme ça. Alors je me dis : « Vas-y, fais des trucs, plein de trucs. » « Du bonheur de donner », jusqu’au 5 mars, au Lucernaire (Paris 6e) « Gisèle Halimi, une farouche liberté », jusqu’au 6 avril, à La Scala (Paris 10e) Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2023 5:24 AM
|
Par Farah Sadallah Publié le 10 Fév 23 par Actu Nantes Philippe et Martine ont plus de 61 ans. Ils ne peuvent toujours pas partir à la retraite. Ils sont intermittents du spectacle à Nantes. La réforme, c'est la double peine selon eux. « Je vais cotiser un trimestre de plus », affirme Philippe Gallis, technicien polyvalent, à l’Opéra de Nantes notamment. Membre du bureau national Synptac CGT, ce futur retraité aura 62 ans à la fin de l’année, mais si la réforme des retraites passe, il ne pourra partir qu’à 64 ans et demi. « Je travaille depuis que j’ai 17 ans, j’arrive à 62 ans et je ne peux pas partir à la retraite », se révolte-t-il. Sachant qu’a priori, sans la réforme des retraites, il ne pourrait de toute façon pas partir avant 63 ans, a-t-il calculé. La carrière discontinue des intermittents Les travailleurs dans le milieu du spectacle, communément appelés intermittent du spectacle, en raison de leurs contrats à durée déterminée dit « d’usage », ont souvent « des trous » dans leur carrière, ce qui les fait déjà partir plus tard à la retraite à taux plein. « On a des métiers à carrière hachée. Moi j’ai un trou de deux ans, car je me suis formé », explique Philippe. « On se forme beaucoup dans nos métiers », confirme Martine Ritz, 64 ans, membre du bureau national SFA, comédienne et toujours pas à la retraite. Cette dernière ne pourra en bénéficier qu’à seulement 65 ans, en raison de sa carrière discontinue, réforme ou pas réforme. « Je ne suis toujours pas à taux plein, et pourtant je ne considère pas avoir eu une mauvaise carrière », affirme-t-elle avant d’estimer, qu’avec la nouvelle loi, les femmes qui auront fait comme elle, risquent de partir à 68 ans. Cette réforme des retraites pourrait donc bien aggraver leur situation. L’indemnisation des intermittents du spectacle : comment ça marche ? Une bonne partie des intermittents du spectacle cumule salaires et indemnisations à la fin du mois, car ils ont souvent des missions de courte durée. En effet, leurs métiers étant très spécifiques, le régime d’assurance chômage comprend une annexe 8 pour les ouvriers et techniciens, et une annexe 10 pour les artistes.
Ainsi pour bénéficier d’une indemnisation par l’Assurance chômage, les intermittents du spectacle doivent justifier d’au moins 507 heures de travail dans les métiers du spectacle durant les 12 mois précédant leur dernière fin de contrat. Par conséquent, un intermittent qui peut justifier de 507 heures durant l’année qui précède sa dernière fin de contrat sera indemnisé pendant 12 mois à compter de cette date.
Sachant que la majorité des intermittents du spectacle travaille chaque mois. Ils cumulent alors revenus et une partie de leur allocation pour renouveler leur intermittence l'année d'après.
Ainsi, au cours d’une année normale (hors période de crise), 95 % des allocataires intermittents cumulent salaires et indemnisation. Les allocations chômage représentent en moyenne 42% de leurs revenus perçus (salaire + indemnisation).
À noter qu’au-delà d’un plafond de revenu mensuel (4 045,04€ en 2021), aucune allocation ne peut leur être versée.
« Il n’y a pas beaucoup de rôles de vieux » La fin de carrière d’un intermittent du spectacle peut ne pas être simple, surtout s’ils doivent partir plus tard à la retraite. « Les employeurs ne se jettent pas sur nous, lâche Martine. Les artistes sont impactés par la nature de leur rôle. Il n’y a pas beaucoup de rôles de vieux. » Sachant qu’à 55 ans, on peut encore avoir des enfants en étude longue. « C’est compliqué d’assurer financièrement », poursuit-elle. Le technicien polyvalent, Philippe, fait le même constat : Ça ferme des portes quand on approche de la retraite. Il n'y a plus d'espace pour les personnes qui ont plus de 50 ans. C'est compliqué de se faire embaucher dans le monde du spectacle, comme ailleurs. Philippe donne l’exemple des postes de permanent, attitré à un lieu en particulier, comme régisseur de plateau, auquel il pourrait prétendre au vu de son expérience. Mais il y en aurait peu, selon lui, et le plus souvent, ils sont donnés à des plus jeunes que lui. « Je ne peux plus monter à 25 mètres de haut, ce n’est plus possible » La pénibilité de leur métier ne facilite pas non plus leur fin de carrière. « Je suis technicien polyvalent, je monte des structures, des plateaux, je fais de la machinerie, je conduis des nacelles… », énumère-t-il. Sauf que depuis deux ans, il y a des métiers qu’il ne peut plus pratiquer. « Je ne peux plus monter à 25 mètres de haut, ce n’est plus possible, c’est dangereux. J’ai des métiers qui se ferment à moi », explique Philippe. Alors qui dit moins de travail dit moins d’heures, et donc un risque de perdre son indemnisation (lire encadré plus haut), et de voir son âge légal de départ à la retraite reculé. Une pénibilité non reconnue D’autant plus que la pénibilité de leur métier n’est pas reconnue. Travaillant de nuit comme de jour, et faisant parfois de longues distances, doublées d’un montage et d’un démontage de décors, ces techniciens sont amenés à être très fatigués s’ils enchaînent les dates. « Il y a des périodes où je n’arrive pas à récupérer », indique Philippe. « On a une pénibilité contrainte par la force des choses », poursuit-il, en faisant référence à la fragilité que peut connaître son statut d’intermittent. Il est difficile de dire non à un employeur, pour faire « une pause », par peur de ne pas avoir assez de cachets (d’heures travaillées) pour valider l’intermittence et donc obtenir l’indemnité. « À force de refuser des dates, ça peut être mal vu », explique Philippe. Alors il enchaîne sans compter. Cette dureté du travail, on la retrouverait aussi dans les dépendances aux drogues. « Pour tenir, l’addiction tient une place énorme. C’est aussi une forme de pénibilité et un problème de santé publique », observe Philippe. « C’est des métiers de passion, donc on pense qu’il n’y a pas de pénibilité » Martine, elle, parle aussi de pénibilité pour son métier de comédienne. Elle n'est pas intuitive. On y voit plus les paillettes et les strass. Ça fait rêver. On a toujours le même problème, c'est des métiers de passion donc on pense qu'il n'y a pas de pénibilité. Mais nos métiers, on les exerce pour qu'on ne voit pas le travail derrière et donc la pénibilité. On montre que le rêve... Martine Ritz Comédienne Pourtant cette pénibilité, elle existe, selon Martine. Elle est psychologique. « On dort mal. Puis, on est excité avant de jouer, et on l’est encore plus après, donc on dort encore plus mal », illustre-t-elle. La comédienne fait référence à l’ascenseur émotionnel, qui serait doublé d’une angoisse liée au risque de précarité. « Quand t’es fragile sur ton nombre d’heures, tu ne pars pas en vacances », témoigne-t-elle. L’impact de la crise énergétique Ce nombre d’heures travaillées pourrait bien se réduire encore plus, au vu de la crise énergétique. « Le spectacle, c’est extrêmement énergivore », lâche Martine. Le coût de l’énergie augmente aussi pour les salles de spectacle et cela pourrait se répercuter sur l’enveloppe budgétaire allouée à la masse salariale. Philippe l’a déjà observée et notamment à l’Opéra de Nantes. « Ils ont réduit la voilure, j’y travaille moins qu’avant. On est dans un secteur très fragile. Si en plus, on est impacté doublement », constate-t-il, en faisant référence à la réforme des retraites et à la crise énergétique. Enfin, du côté de la rémunération, les salaires des intermittents n’augmente pas avec l’ancienneté et l’expérience, explique Martine. Les salaires sont à minima. Quand on n'a pas de progression salariale, que les carrières sont discontinues, et que tu ne prends pas les meilleures années, t'es mort. Martine D’ailleurs Martine s’attend à être au minimum lorsqu’elle touchera sa retraite. « Ça va être compliqué », reconnaît-elle. Farah Sadallah / Actu Nantes Légende photo : Martine et Philippe sont intermittents du spectacle à Nantes. Pour eux, la réforme des retraites, c’est la double peine car leur régime spécifique ne leur facilite déjà pas un départ à la retraite à 62 ans. (©Farah Sadallah / actu Nantes)
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2023 10:40 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - Article publié en décembre 2019 lors de la création à Nanterre-Amandiers Jonathan Capdevielle se saisit du récit d'Hector Malot pour composer un voyage initiatique subtilement traversé par des problématiques contemporaines. «Rémi» est rythmé par les obsessions du metteur en scène dont on retrouve l'univers poético-folklorique. Du théâtre autobiographique au spectacle jeune public, Jonathan Capdevielle n’en finit pas de nous transporter. Le plateau est vide. Un jeune garçon en culottes courtes s'installe entre les deux pans du rideau entrouvert. Il rentre de l'école et s'apprête à gouter, l'oreille attentive à la radio qui diffuse un entretien avec un jeune chanteur ponctué çà et là de ses propres tubes. Parmi ceux-ci, le fameux "Sur ma route", emprunté pour l'occasion au chanteur Black M, est parfaitement choisi tant les paroles semblent coller à la peau de Rémi, raconter son histoire. Le public comprend très vite que le chanteur dont la radio dresse le portrait est la transposition de l'enfant qui l'écoute, s'écoute sans le savoir. Pour introduire la pièce, Jonathan Capdevielle nous place au coeur d’une ellipse. Le début est aussi la fin. L'histoire se répète continuellement. Avec cette adaptation libre de "Sans famille" d'Hector Malot, il s'adresse pour la première fois au jeune public. Si le choix des costumes et l'absence de scénographie – obligeant les comédiens à inventer l'espace de fiction – rendent le récit intemporel, les thèmes sociétaux abordés révèlent son ancrage dans le présent. Comme dans ses pièces précédentes, les comédiens endossent plusieurs rôles et identités, inventant une foule de personnages avec un minimum d'interprètes. Le petit théâtre du derrière L'entrée en scène bienveillante de la mère l'instant d'après indique la proximité qui les unit. Lorsqu'elle l'interroge sur son œil au beurre noir, Rémi répond que des garçons l'ont trouvé un peu trop maniéré, comme le sont les filles. Au détour de ce simple échange, l'auteur introduit une réflexion sur le genre, la non binarité. Pas de grand débat, juste une courte séquence en apparence anodine, qui inscrit l'incident dans le partage par la parole plutôt que dans la honte et le secret. Par petites touches discrètes, Capdevielle ponctue le récit d'éléments faussement naïfs – rien n'est là par hasard – renvoyant à des problématiques sociales contemporaines. La danse endiablée à laquelle se livre la mère dans la scène suivante suffit à désamorcer le potentiel drame, fixant le récit oral de l'évènement dans la norme. Le retour inattendu du père va briser cette relation filiale. On apprend sa violence peu avant, au détour d'une réflexion grinçante de la mère indiquant à Rémi les bleus que lui donnaient son père. La violence domestique s'invite dans le récit, à nouveau au détour d'une phrase. Ouvrier sur un chantier parisien, il a été victime d'un accident du travail, ce qui explique son retour soudain. S'il s'accuse de maladresse, on devine très vite que les conditions de travail sont à la limite de la légalité. La précarité nouvelle transforme les prolétaires en forçats du travail. "Si Paris m'a changé, Paris m'a bousillé" déclare-t-il. Sans doute faut-il interpréter ici l'assertion dans un double sens, à l'accident physique du père répondrait une mise à nu autobiographique. Le père, surpris par la présence de Rémi qu’il croyait depuis longtemps à l‘orphelinat – suggérant par là-même que son absence a duré des années –, se querelle violemment avec la mère. C'est ainsi que Rémi apprend, couché dans son lit, sa chambre occupant la pièce d'à côté, qu'il a été adopté. On le voit alors se rapprocher de sa mère, son sac à dos enfoncé sur la tête, la recouvrant totalement. Etrange et magnifique scène à la poésie bouleversante. Le lendemain, celui qui était hier encore son père le conduit en ville où il croise la route de Vitalis (subtilement incarné ici par Babacar M’Baye Fall) et de sa troupe. Le deal est rapidement conclut. Le lendemain, après un ultime baiser à celle qui fut sa mère, Rémi quitte son village pour une nouvelle vie. Le soir même, il se présente avec ses nouveaux acolytes devant le public, son costume de scène arbore un gilet jaune. A nouveau, le hasard n'a pas sa place ici. Pour les artistes devant attirer l'attention de la société, "le paraitre est parfois nécessaire" précise Vitalis. Plus tard, la troupe sera confrontée aux gendarmes, dont le familier accent du sud-ouest ne suffit pas à faire retomber l'inquiétude et la peur qu'ils engendrent lorsqu'ils ordonnent de museler les bêtes, traitant Joli-coeur de macaque. Quel spectacle peuvent bien donner à l'imagination des villageois un vieux saltimbanque noir accompagné d'un jeune garçon et flanqué d'animaux de foire? Vitalis, arrêté, écope de deux mois de prison. L'exécution de la peine est immédiate. Dans toutes les pièces de Jonathan Capdevielle, l'enfant joue un rôle particulier. Il se positionne comme spectateur ou acteur de ce qui se passe, pour mieux révéler la complexité du monde des adultes. "Dans mes créations, l’enfant tient une place importante. ‘Adishatz/Adieu’, ‘Saga’ et ‘A nous deux maintenant’ font toutes, directement ou indirectement, référence à l’enfance. Les souvenirs d’enfance sont souvent moteurs dans mon processus d’écriture de dialogues ou de récits. Notamment dans Saga, pièce construite à partir de matériaux issus de la mémoire et qui met en scène les souvenirs personnels." rappelle Jonathan Capdevielle (Note d'intention, septembre 2018). Ce premier spectacle destiné au jeune public lui permet d'explorer en les questionnant l'apprentissage et la construction de soi. "Sans famille", le roman d'Hector Malot, qu'il découvre à la télévision en 1990 par le biais de son adaptation manga, semble le récit idéal, réunissant tous les ingrédients nécessaires à cette réflexion. Quel autre texte en effet évoquerait-il tout aussi bien la quête d'identité que l'art comme métier ? L'acte artistique contre la fatalité "Rémi" est constitué de deux épisodes : le premier est une pièce de théâtre interprétée par des comédiens sur scène, tandis que le second est une fiction radiophonique à écouter à la maison, à l'école ou encore au théâtre, dans les chambres d'écoutes mises à disposition du public – un CD est remis à chaque spectateur à la fin de la représentation. Dans le roman d'Hector Malot, Rémi est vendu à un saltimbanque nomade qui, accompagné d'un chien et d'un singe savants, va lui inculquer l'art du spectacle, notamment le chant, formation qui ici le conduira aux portes de la gloire, comme il l'évoque à la radio au début de la pièce, rendant un hommage appuyé à son maitre, Vitalis. Rémi n'est pas sans famille, bien au contraire. C'est avec sa deuxième famille qu'il parcourt la France, se produisant dans les villes et villages qu'il traverse. Ce périple constitue un voyage initiatique dans lequel l'adolescent découvre, à travers les nombreuses rencontres avec divers personnages, les joies, le bonheur, mais aussi les peines, la mort à laquelle il sera confronté tout comme l'amour. Petit à petit, les protagonistes costumés, souvent masqués, quittent le plateau pour ne laisser entendre que leurs voix. Elles deviennent des empreintes. Jonathan Capdevielle les laisse entendre alors qu'ils ne parlent plus, comme si l'on entendait soudain leurs pensées, ou encore comme s'ils étaient les marionnettes du ventriloque. L'invention de ce décrochage poétique et formel autorise l'environnement sonore à prendre le pas sur le visuel, conduisant à la fiction radiophonique. La pièce place la transmission comme l'élément central de la relation de Rémi à Maitre Vitalis. L'attachement à l'acte artistique est ici un moyen de survie à la fatalité. L'univers folklorique de l'auteur traverse la pièce par petites touches. C'est la tenue agrémentée de bottes blanches que porte le chien Capi (qui ici semble avoir fusionner avec Dolche, une petite chienne blanche assez discrète ; dans le roman d'Hector Malot, Vitalis est accompagné non pas d'un, mais de trois chiens), lui conférant une silhouette étrangement sensuelle, à mi-chemin entre un chaman et une majorette, qui fait songer au personnage de Virginie, la copine à l'alcool triste dans "Adishatz Adieu", spectacle dans lequel l'artiste revenait sur son adolescence pour mieux lui dire adieu. C'est cet air de chanson paillarde venu tout droit de son pays basque natal ; c'est cet employé du port de Sète annonçant avec un imposant accent du sud les prochains départs de bateaux à la manière d'un agent de la SNCF ; c'est Rémi manipulant les marionnettes de Joli-coeur et de Capi lors de son séjour à bord du bateau affrété par une dame anglaise (formidable Michèle Gurtner !) pour le repos de son fils, Arthur, "un enfant pas comme les autres", gravement malade, le visage disparaissant entièrement derrière un large masque, qui rappelle dans un étonnant effet de miroir le Jonathan Capdevielle ventriloque des pièces de Gisèle Vienne. Tout doucement, le metteur en scène installe les personnages d'Hector Malot dans son intimité. Tous les spectacles de Jonathan Capdevielle sont des mises en abime à chaque fois renouvelées. Les pointes d'humour, souvent à contre-temps, viennent désamorcer une certaine mélancolie, annihilant toute lourdeur. A l'issue de la toute première représentation de Rémi, on entend : "Tu crois qu'il en faisait du jeune public Patrice Chéreau?", vrai faux aparté avec le public qui devient le complice du metteur en scène, le confident amusé de ses pensées introspectives. Une sorte de fulgurance poétique transperce la pièce comme cet orage aux éclairs de néons qui s'abat soudain sur les protagonistes, comme la leçon d'imagination d'Arthur ou encore la troublante beauté des costumes et des masques, à la fois étranges et sublimes, ils dégagent une inquiétante étrangeté. En proposant au public d'emporter la seconde partie du spectacle chez soi, Jonathan Capdevielle offre, à travers l'écoute audio de la fiction, la possibilité de prolonger le spectacle vu sur scène en l'enrichissant d'autres imaginaires. Dans l'intimité de la maison, le souvenir des personnages, dont on retrouve les voix maintenant si familières, s'estompe de plus en plus. Le dispositif est destiné à repousser les limites imposées par le théâtre pour inventer un nouvel espace en se focalisant sur le son, propice à l'apparition d'une multitude de personnages imaginaires. Le basculement de l'image vers le son est amorcé dans le spectacle sur scène pour être effectif à la fin de la représentation. Ainsi, Jonathan Capdevielle s'empare admirablement de ce classique de la littérature enfantine, se l'approprie, l'adapte à sa mesure pour finalement en gommer au fur et à mesure les aspects visuels et offrir en partage un environnement sonore dans lequel petits et grands deviennent à leur tour les metteurs en scène de leur imaginaire."Je ne sais pas d'où je viens mais je sais où je vais" conclut Rémi, faisant ainsi le choix de la liberté. Guillaume Lasserre Spectacle vu à Nanterre-Amandiers. Repris en mars 2023 à la Commune CDN d'Aubervilliers : https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/22-23-remi/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 9, 2023 4:40 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 9/03/23 L’actrice, musicienne et chanteuse, à l’affiche au cinéma de « La Grande Magie » et au théâtre de « Mélisande », bouleverse dans des rôles qui traversent sa propre sensibilité. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/09/judith-chemla-la-vie-et-l-art-emmeles_6164726_3246.html Avis à ceux qui voudraient l’enfermer dans une cage, dans une case, dans un coffret bien scellé, dans un rôle prédéterminé : Judith Chemla s’en échappera toujours. S’échapper, c’est ce que la comédienne, musicienne et chanteuse a fait, pour fuir les violences conjugales infligées par son ex-compagnon, l’acteur et réalisateur Yohan Manca, condamné à huit mois de prison avec sursis en mai 2022. Le 6 juillet de cette même année, elle a pris la parole, sur France Inter, pour raconter ce qu’elle avait subi, et enjoindre aux femmes de ne jamais retirer leurs plaintes face à des hommes violents. Dans un système médiatique comme le nôtre, et dans un temps où l’omerta se craquelle enfin sur ces questions, cette prise de parole lui a valu une célébrité sans commune mesure avec celle qu’elle avait acquise grâce à ses talents d’actrice et de chanteuse lyrique, pourtant reconnus depuis ses débuts. Aujourd’hui, on les retrouve éclatant avec bonheur, aussi bien dans La Grande Magie, le film de Noémie Lvovsky (sorti le 8 février), que dans Mélisande, le spectacle musical que le metteur en scène Richard Brunel et le directeur musical Florent Hubert adaptent de l’opéra de Debussy (à voir au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, à partir du 9 mars). Judith Chemla sera aussi dans Un hiver en été, le nouveau film de Laetitia Masson, qui sort le 22 mars. De tout cela, l’art et la vie, qui pour elle sont toujours allés ensemble et se sont renvoyé de troublants échos, de ses rôles d’actrice libre comme un oiseau et du fait de s’être fait mettre en cage par l’homme qui prétendait l’aimer, elle parle avec une passion et une force qui contrastent avec son allure de brindille diaphane. La vie et l’art se sont mêlés d’emblée chez elle, née en 1983, qui est fille et petite-fille de violonistes, et à qui son père et son grand-père ont transmis « leur amour et leur émotion inaltérables face à la musique et à la beauté ». Une artiste à part entière Judith Chemla a fait des années de piano et de violon, avant de découvrir le théâtre au collège et de ne plus le quitter, conquise d’emblée par sa capacité à « créer un trou au milieu du réel, un espace pour se rêver, se réinventer et questionner le monde ». A 15 ans, elle a suivi un stage au Théâtre du Soleil, admirant sans relâche la capacité des acteurs d’Ariane Mnouchkine à « improviser, chercher, inventer, construire, dans un mélange de liberté, de drôlerie et de travail acharné. C’était exactement ce à quoi j’aspirais, précise-t-elle : être un vrai acteur-créateur, comme Mnouchkine sait les déployer ». Parallèlement elle a toujours chanté, et elle s’est construite, entre les cours de chant lyrique et sa formation au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, avec cette idée qu’une actrice ou une chanteuse est une artiste à part entière, et pas seulement une interprète. Et elle a marqué d’emblée les premiers rôles qu’elle a joués à la Comédie-Française du sceau de sa grâce et de son originalité, que ce soit dans L’Illusion comique, de Corneille, ou, déjà, dans La Grande Magie, d’Eduardo De Filippo, la pièce qui a servi de canevas à Noémie Lvovsky pour son film. Mais, là aussi, Judith Chemla s’est échappée, quittant la Maison de Molière très vite, au bout de quelques mois, en 2009. Elle voulait vivre quelque chose de moins prévisible, de plus fou, de plus créatif, et c’est venu d’abord avec Tue-Tête, en 2010, un spectacle foutraque et bohème qu’elle avait écrit, et créé avec son compagnon d’alors, James Thierrée, inventeur d’un théâtre-cirque unique en son genre. Puis il y a eu Le Crocodile trompeur, variation déjantée et jazzy sur Didon et Enée, de Purcell, signée par Samuel Achache et Jeanne Candel, en 2013. « Un travail de dépouillement » Le spectacle a fait date, dans la recherche alors naissante d’une forme de théâtre musical plus légère, vivante et joyeusement indisciplinaire que l’opéra traditionnel. Judith Chemla y était merveilleuse, aussi bien en tant qu’actrice qu’en tant que chanteuse, et elle s’est inscrite, comme elle le rêvait depuis toujours, comme un élément-clé de cette nouvelle vague du théâtre musical. Après Le Crocodile, il y a eu Traviata, vous méritez un avenir meilleur, magnifique relecture de l’opéra de Verdi par Benjamin Lazar et Florent Hubert, en 2016, dans laquelle elle incarnait Violetta. Lire aussi : Judith Chemla extravagante, gracieuse, libre et bohème « Je ne rejette pas l’opéra traditionnel, qui peut être extraordinaire. Mais je dirais que ce qui lui manque, c’est justement le manque, s’amuse Judith Chemla. L’opéra est une grosse machine, on y attend tellement des chanteurs, ils sont tellement jugés, les spectateurs paient tellement cher pour préserver leurs traditions que les chanteurs se blindent pour être dans des postures de maîtrise totale, qui ne favorisent pas le lâcher-prise. Tout le travail que nous avons fait dans cette constellation, tout ce vers quoi j’ai eu envie d’aller, c’est de trouver le point de jonction entre la pure présence, la pure vérité de l’acteur-chanteur, débarrassé de toute posture préalable qui ferait écran, et l’émotion d’une œuvre écrite par un compositeur habité, transcendé par ses sentiments. C’est un travail de dépouillement, de mise à nu. » Cette recherche de transparence, d’accueil pour laisser une œuvre traverser sa propre sensibilité, Judith Chemla l’a menée également sur les rôles qu’elle a joués dans le théâtre de texte, qu’il s’agisse de celui de Nicole Burnell dans De beaux lendemains, de Russell Banks, mis en scène par Emmanuel Meirieu (2011), ou de Violaine dans L’Annonce faite à Marie, de Claudel, vue par Yves Beaunesne (2014). Mise bout à bout, cette collection de rôles la trouble, quant aux échos qu’ils renvoient à sa vie personnelle. « Personnages sacrificiels » « De Didon à Mélisande en passant par Violetta et Violaine, ce sont des personnages sacrificiels, constate-t-elle. Des personnages entiers, qui ne font aucune économie d’eux-mêmes, qui se livrent absolument à la tragédie de leur monde, de leur condition de femme. C’est intéressant, et très questionnant pour moi, bien sûr. D’autant plus que le théâtre est pour moi un acte sacré, et l’engagement sur scène quelque chose de vital : je ne viens pas faire mon job, je monte sur scène si je sens que ça résonne en moi d’une façon encore mystérieuse mais que je veux comprendre. C’est très étrange, d’ailleurs, mais les rôles que j’ai endossés m’ont renseignée sur ce que j’allais traverser dans ma vie personnelle : c’était presque comme des oracles, des prémonitions… » Judith Chemla reste rêveuse un moment, dans sa cuisine qu’éclaire un beau soleil de fin d’hiver. « C’est comme si j’avais vécu par avance des catharsis de ce qui allait m’arriver plus tard, poursuit-elle. C’est impressionnant, tout de même, à quel point les femmes peuvent mettre leur vie en jeu dans l’amour, et à quel point les héroïnes qui abandonnent tout pouvoir et se donnent à un homme sont glorifiées, mythifiées. » « Judith a un petit côté mystique de l’art et de l’amour », dit d’elle son amie, l’actrice et cinéaste Noémie Lvovsky, qui, elle, ne lui a écrit, de film en film, que des rôles d’émancipation. Notamment dans cette Grande Magie qui voit son héroïne, Martha, profiter d’un spectacle d’illusion pour s’éclipser et fuir un mari jaloux et castrateur. Ce « petit côté mystique » a-t-il joué à Judith Chemla des tours qui, pour le coup, n’ont rien de magique ? « Pouvoir d’illusion » « Avant que la violence d’un homme ne soit visible sur mon visage, je n’arrivais pas à avoir conscience de l’emprise de cette violence sur nos sociétés, et de la nécessité de s’ériger contre ce fléau », analyse la comédienne, qui est depuis très engagée sur ces questions, ainsi que sur celles du féminicide et de l’inceste. Elle dénonce « un système d’impunité dont bénéficient la plupart des agresseurs, détournant la présomption d’innocence en présomption de culpabilité pour des victimes présumées menteuses ». « Comme beaucoup de femmes, je n’ai pas eu conscience, pendant longtemps, de subir des comportements intolérables, précise-t-elle. Les maltraitances, je les minimisais, comme les agresseurs vous apprennent à le faire, en vous faisant croire que ce n’est pas si grave. Jusqu’à ce que cette violence se voie en plein milieu de ma figure, et que je me dise que je ne pouvais plus me regarder en face sans me mentir. Les comportements des agresseurs, l’emprise, la culpabilisation, sont maintenant bien repérés. Et pourtant nous continuons à avoir le plus grand mal à admettre que nous en sommes victimes. » Aujourd’hui, elle joue et chante Mélisande. L’héroïne imaginée par l’auteur symboliste belge Maurice Maeterlinck la poursuit depuis longtemps. Le rôle lui avait été proposé, déjà, par la comédienne et metteuse en scène Julie Duclos dans une version purement théâtrale, et elle l’a incarné dans l’œuvre de Debussy, en 2022, à l’Opéra de Montpellier. Avec ce nouveau projet, elle se glisse dans sa peau en étant portée par une version resserrée autour de son héroïne féminine – d’où son titre, qui a laissé de côté Pelléas. Encore un rôle de victime, serait-on tentée de dire. Mais Judith Chemla la voit un peu autrement. « Ce n’est pas une figure sacrificielle de plus, plaide-t-elle. Certes Mélisande se retrouve enfermée dans un royaume d’hommes nécrosés, prisonnière d’une conjugalité qu’elle n’a pas vraiment désirée et qui l’opprime, mais elle fait un choix, en décidant de vivre envers et contre tout son amour pour Pelléas. Il y a en elle quelque chose qui échappe, dont les hommes ne peuvent s’emparer, qui est sa magie, son humour, sa poésie. C’est une femme qui ne veut pas plier, même si elle ne peut s’évader que dans la mort. » Dans La Grande Magie, Martha, elle, se volatilise dans une vie que l’on devine d’autant plus exubérante qu’elle a auparavant été cadenassée par son mari. « Et cette échappée, souligne Judith Chemla, un sourire lumineux aux lèvres, advient grâce au théâtre, à sa magie, à son pouvoir d’illusion. Comment mieux dire les pouvoirs de la fiction et de l’imagination, ce qu’elles ouvrent comme perspectives dans nos vies ? Nous sommes quand même les créateurs de notre destin, si on veut bien le prendre en main », conclut-elle. Avant d’ajouter dans un souffle : « Même si souvent, pour cela, il faut travailler sans relâche. » Fabienne Darge / Le Monde Mélisande, d’après l’opéra « Pelléas et Mélisande », de Maurice Maeterlinck et Claude Debussy. Direction musicale : Florent Hubert. Mise en scène et agencement du livret : Richard Brunel. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 10e, du 9 au 19 mars. Légende photo : Judith Chemla, chez elle à Paris, le 1er mars 2023. AUDOIN DESFORGES/PASCO POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 8, 2023 4:45 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 8 mars 2023 Une commission doit au préalable donner son accord pour que l’enfant puisse se produire sur scène, selon un cadre juridique très réglementé.
Lire l'article sur le site du "Monde" https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/08/spectacles-avec-des-comediens-de-moins-de-16-ans-un-travail-tres-encadre_6164592_3246.html Le travail des mineurs de moins de 16 ans sur un plateau est très précisément encadré et réglementé. Un dossier du spectacle, qui décrit dans le détail le planning des répétitions, des représentations et des tournées, est d’abord déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Une fois l’accord obtenu par la commission, la pièce peut se monter. « L’élaboration de ce type de spectacle est particulièrement complexe », précise Solenn Réto, responsable du service production et diffusion du théâtre de la Colline, à Paris. L’emploi du temps de l’enfant est rythmé selon l’âge. Les répétitions durent une heure pour les petits de 3 ans, deux heures pour ceux entre 3 et 5 ans… Elles augmentent jusqu’à 4 heures par jour pour les 12-16 ans avec une pause obligatoire de 30 minutes. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas jouer la nuit sauf dérogation entre 20 heures et minuit. Ils ne peuvent enchaîner que deux jours de représentations, ce qui entraîne des distributions en alternance. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Sur scène, des enfants plongés dans le monde des grands Du point de vue scolaire, l’autorisation du responsable de l’établissement et du recteur d’académie est sollicitée si la durée d’emploi conduit à une absence scolaire de plus de trois jours, et la famille s’engage à ce que les cours soient rattrapés. Un membre de sa famille l’accompagne également lorsqu’il se déplace. Un coach dédié soutient les jeunes comédiens pendant les répétitions et les accompagne pendant les représentations, y compris en tournée, pour les changements de costumes, mais aussi tout simplement pour les rassurer si besoin. « Un pacte de confiance doit se créer entre tous les membres de l’équipe, commente Cyril Anrep, assistant de Wajdi Mouawad et coach sur le plateau. Le travail ne passe que par du positif, de la bienveillance. » Rosita Boisseau Légende photo : « Kingdom », d’Anne-Cécile Vandalem, le 3 juillet 2021, au Théâtre de l’Odéon à Paris. CHRISTOPHE ENGELS Sur scène, des enfants plongés dans le monde des grands La question de l’héritage laissé à la jeune génération est au cœur de plusieurs œuvres dans lesquelles jouent des interprètes âgés de 7 à 18 ans. Par Rosita Boisseau / Le Monde Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/08/sur-scene-des-enfants-plonges-dans-le-monde-des-grands_6164594_3246.html Assis tête baissée, prostré quasi. Sur sa chaise, perdu au milieu de l’immense plateau du Théâtre Sénart (Seine-et-Marne), le chorégraphe Sylvain Groud semble attendre quelque chose qui ne viendra plus. Soudain, un ado, David Dauchy, déboule, cabriolant, vibrant comme un réveille-matin qui oblige illico à tomber du lit et repartir bon pied dans la vie. Alors que la violoniste Laetitia Ringeval attise leur appétit ludique, le duo actionne à fond la courroie de transmission, chacun entraînant l’autre dans des spirales gestuelles, quel régal ! Lorsque l’enfant était enfant. C’est le titre de cette pièce, présentée samedi 11 février. Elle dit joyeusement et ouvertement le besoin et la nécessité de dialoguer. « Qui apprend le plus de l’autre ?, questionne Groud. Directeur du Centre chorégraphique national de Roubaix (Nord), il mène, parallèlement à ses créations, des actions dans les collèges et en Ehpad. Il a rencontré David Dauchy en 2018 – il avait alors 10 ans – pour un projet participatif. Dans la foulée, il lui propose des performances. « Au-delà de notre relation sans hiérarchie, j’ai eu envie d’incarner le conflit entre les adultes et les jeunes en abordant la responsabilité qui est la nôtre dans ce que nous leur transmettons », ajoute-t-il. Les enfants aux manettes ? Cet angle sociétal aiguise nombre de projets chorégraphiques et théâtraux. Le phénomène ne date pas d’hier : on se souvient de Mammame (1983), de Jean-Claude Gallotta, d’Enfant (2011), de Boris Charmatz, sans oublier, toujours en tournée, la compagnie Grenade, dirigée par Josette Baïz, et composée de danseurs de 7 à 18 ans. Il affiche aujourd’hui des enjeux autres. Reflet des débats politiques, écologiques notamment qui bouleversent le monde, il pointe du doigt les aînés et l’héritage laissé aux nouvelles générations dans un climat planétaire chaotique et anxiogène. Crapahutage contorsionniste Ces problématiques, ainsi que les parti pris esthétiques générés par la présence d’enfants sur scène, sont inscrites au tableau de la journée spéciale « Place aux jeunes sur les plateaux », pilotée par la metteuse en scène Marie Levavasseur, mercredi 12 avril, à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). « Ils ont beaucoup de choses à dire et on ne tient pas assez compte de leurs paroles, commente-t-elle. Il y a peu d’espace dans les médias pour eux. Il s’agit, à travers les créations auxquelles ils participent, de les écouter, de les valoriser pour faire société ensemble. » Elle vient de concevoir, avec Mariette Navarro, et après deux ans d’échanges avec douze amateurs âgés de 13 à 21 ans, le spectacle Et demain le ciel, sur le thème de la croyance en l’avenir. Une lecture en a été donnée dans la Cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon, en juillet 2022. Dans la foulée, la pièce a été sélectionnée par un groupe de jeunes programmateurs mis en place par Gurval Reto, directeur du THV, à Angers. « Le théâtre est aussi un forum », affirme Marie Levavasseur. Un point de vue que Michel Schweizer et Mathieu Desseigne-Ravel partagent, soucieux « d’illuminer cette jeunesse au théâtre car on voit mieux les gens sur scène ». Dans Nice Trip, les deux chorégraphes travaillent avec Abel Secco Lumbroso, 14 ans. Sur la question des flux migratoires, ils ont écrit une conférence-performance autour de la sécurité et des « 40 000 kilomètres de murs frontières qui contrarient les mobilités d’humains désireux de sauver leur vie ». En mode conversation, sur le motif épineux mais passionnant de l’évolution des barbelés « de la ronce à nos jours », le sujet évoqué est là sans être là, tout en ironie, délesté de pathos. Vendredi 10 février, dans la salle des Hivernales, à Avignon, Abel Secco Lumbroso, choisi sur audition parmi douze adolescents de 11 à 14 ans, est au milieu du public, à côté de son père. Alors que Michel Schweizer interroge le public à propos d’un crapahutage contorsionniste de Mathieu Desseigne-Ravel, il lève la main : « J’ai trouvé ça impressionnant et presque drôle, et puis très vite, c’est gênant de regarder ça, parce qu’on a presque mal pour lui. » Il rejoint ensuite Michel et Mathieu. Auprès d’eux, il endosse un rôle discret, circule tranquille avant de livrer une image funèbre ultime : le capuchon de son sweat-shirt reste accroché à une énorme épine. « Abel représente tous les Abel et l’espoir que nous mettons dans chacun d’eux, dit Schweizer. Nous insistons ici sur notre capacité à nous conformer à notre éducation, ce qu’Abel ne fait pas encore. Il est à un endroit où il peut encore refuser la normativité, les frontières pour imaginer d’autres chemins. » « Métissage générationnel » Cette dimension philosophique autour d’une réflexion commune innerve aussi la démarche d’Anne-Cécile Vandalem. Celle qui collabore avec des gamins depuis ses débuts, dans les années 2000, a imaginé Kingdom, troisième volet de sa trilogie sur « la fin de l’humanité », présenté le 18 février aux Ateliers Berthier, à Paris, avec quatre jeunes, deux chiens et un loup. « Le futur ne peut plus résonner avec la promesse d’un monde meilleur en particulier pour les enfants qui en seront les adultes, déclarait-elle lors de la création, en 2021. Dans un chalet de la taïga, sur fond de naufrage écolo, deux familles rembobinent l’increvable scénario de jalousie et de haine. La question de l’héritage, quel qu’il soit, occupe la pensée de Wajdi Mouawad. L’écrivain et directeur du Théâtre de la Colline, à Paris, revendique dans ses œuvres un « métissage générationnel ». Avec Mère, notamment, il entend, à travers son histoire personnelle et le dialogue avec un enfant – lui lorsqu’il était petit –, « faire mieux connaître, car on ne la raconte pas, la guerre civile au Liban ». Le choix d’un garçon s’est fait instinctivement. « Il y a des moments où l’idée qu’un rôle puisse être tenu par un adulte, ce que j’ai par ailleurs déjà fait, n’est pas envisageable, explique-t-il. Parce que le cœur du récit relève du moment où un enfant est mis devant un phénomène d’une grande brutalité. » Quatre jeunes d’origine libanaise se retrouvent en alternance auprès de Wajdi Mouawad. « Un enfant ne fait pas semblant d’être un enfant, il “est” enfant et se révèle puissant. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Quand les petits entrent dans la danse Cette « puissance » selon Mouawad, qui travaille également avec sa fille Aimée et son fils Ulysse, joue sur le pouvoir d’effraction de l’enfance au théâtre. « L’enfant crée du réel », poursuit-il. Anne-Cécile Vandalem, elle, aime dire que « rien n’arrive comme prévu lorsqu’on fait intervenir des jeunes et c’est ce que l’on cherche pour que la vie advienne sur le plateau… ». Schweizer et Desseigne-Ravel pointent « un degré d’intensité et d’authenticité plus fort ». Le désir d’évacuer l’artifice de la représentation au profit d’un rapport plus direct avec le public est au rendez-vous. « Nous cherchons la simplicité chez Abel, la fragilité que nous tentons de conserver pendant le spectacle, précise Desseigne-Ravel. Cela permet d’avancer sur le fil d’une écriture qui refuse la sécurité et choisit le vivant. » Précautions multiples La menace d’instrumentalisation plane néanmoins sur ces créations. « Je ne suis pas toujours tranquille avec la façon dont nous exposons Abel, glisse Desseigne-Ravel. J’ai parfois des doutes sur la pertinence de notre proposition car nous n’avons pas vraiment de prise sur l’empathie et l’émotion qu’il suscite auprès des spectateurs. » Quant à Wajdi Mouawad, il insiste sur la nécessité « de ne pas provoquer de façon malhonnête, chez le spectateur, évidemment sensible à la présence d’un enfant, un état émotif extrême. Il faut pour cela que le jeune soit en pleine conscience de ce qu’il fait et vit sur le plateau. » Cette lucidité se construit et s’affûte en répétitions. Les méthodes de création s’incurvent avec ces interprètes plus ou moins amateurs dont le bagage professionnel s’alourdit avec les représentations. Discussions longues, explications et documentations minutieuses, relations rapprochées avec la famille, précautions multiples cimentent les liens au travail. « Pour Nice Trip, nous avons pris le temps de nous connaître avec Michel et Mathieu, témoigne Abel Secco- Lumbroso. Le sujet des frontières est assez lourd et je me suis beaucoup informé. C’est vraiment une expérience très enrichissante à vivre pour moi. » Mais l’enfant est aussi un comédien ou un danseur comme un autre (ou presque). « Avec des qualités de concentration et d’analyse extrêmement claires », glisse la chorégraphe Maud Le Pladec, en parlant d’Adeline Kerry Cruz, 10 ans, en vedette dans le duo Silent Legacy. Interprété avec Audrey Merilus, il prolonge Counting stars with you, sur le motif de la sororité. Le choix de la jeune krumpeuse canadienne s’est opéré sur son talent déjà repéré dans les battles hip-hop. « Adeline est une petite fille en pleine possession de ses pouvoirs que je traite comme une professionnelle, confie la chorégraphe. Sa maturité intellectuelle et émotionnelle est incroyable. » Et si Silent Legacy n’est « pas une pièce sur l’enfance », souligne Maud Le Pladec, c’est bien une enfant que l’on contemple sur scène. Lorsque l’enfant était enfant, de Sylvain Groud, au CCN de Roubaix (Nord), le 10 mars. Journée de rencontres « Place aux jeunes sur les plateaux », Scène nationale, Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), le 12 avril. Kingdom, d’Anne-Cécile Vandalem, Teatre Lliure (Espagne), le 31 mars et le 1er avril. Mère, de Wajdi Mouawad, à La Rochelle, les 29 et 30 mars, à Montpellier, du 5 au 7 avril, au Théâtre de La Colline, Paris 20e du 10 mai au 4 juin. Nice Trip, de Michel Schweizer et Mathieu Desseigne-Ravel, le 8 mars à Besançon. Silent Legacy, de Maud Le Pladec, à Chaillot, Paris 16e, du 15 au 18 mars. Rosita Boisseau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 3:04 PM
|
Par Valentin Pérez pour M le magazine du Monde - 26 février 2023 De « Un prophète » à « Pour la France », le comédien aux silences pudiques a tracé son sillon pour devenir un des acteurs les plus désirés du moment. Il est à l’affiche de « Goutte d’or », en salle le 1er mars. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/02/26/le-jeu-magnetique-de-karim-leklou_6163331_4500055.html
Quand la directrice de casting Tatiana Vialle a partagé les images de l’audition de Karim Leklou au réalisateur Clément Cogitore pour le rôle principal de Goutte d’or, elle s’est abstenue de tout commentaire. « L’évidence était telle qu’il n’y avait rien à dire », assure-t-elle. Convoqué pour un essai, l’acteur ne savait pourtant pas grand-chose du rôle, sinon qu’il s’agissait d’un médium. Face à la caméra, il s’est présenté muni d’une petite pierre, achetée quelques euros à La Cornaline, une librairie de la rue Saint-Lazare, à Paris, qui concentre textes ésotériques et objets de lithothérapie. « Il possédait une intériorité, une puissance d’évocation que les autres n’avaient pas, souligne Tatiana Vialle. Il paraissait, dans les silences, s’emparer des pensées de son interlocuteur. » En regardant la vidéo, Clément Cogitore, qui a écrit le rôle de ce voyant, manipulateur et cérébral, surnommé « mage » par les commerçants et les migrants des environs, a remarqué « la bonté au fond des yeux » du comédien. « Parce qu’on ne se méfie pas de lui, Karim crée une empathie immédiate avec le spectateur et autorise un éventail de nuances que je n’avais pas complètement imaginé pour le personnage », explique le cinéaste. Ainsi Karim Leklou a-t-il décroché son plus beau rôle à ce jour dans ce « polar mystique urbain », comme il le résume, en salle le 1er mars. Un emploi qui achève d’offrir une épaisseur mélancolique à ce quarantenaire pudique qui s’est fait connaître avec de nombreuses partitions secondaires ces dix dernières années. Se fondre dans des univers Ramsès, son personnage, est un médium qui évolue dans le quartier parisien de la Goutte-d’Or, entre Barbès-Rochechouart et la porte de la Chapelle, et dont les compétences se fondent sur une fouille préalable du smartphone de ses visiteurs et de leurs traces numériques laissées notamment sur les réseaux sociaux. Un rôle qui « n’était a priori pas pour [lui], convient Karim Leklou. Il était décrit comme un flambeur, le prince charmant du quartier. Autant dire que j’étais une contre-proposition », assume-t-il, dans un café près de la place de Clichy. Aussi, pour dessiner une réelle adéquation entre Ramsès et lui, il s’est jeté dans un exercice qu’il affectionne, celui d’une préparation méticuleuse. Un mois et demi d’éclaircissement de dialogues, de documentation, d’essais caméra dans les rues de Paris encore soumises au port du masque contre le Covid-19, de lectures avec un groupe d’enfants, des personnages de gamins des rues, des immigrés venus de Tanger (Maroc) qui percutent la trajectoire de Ramsès… Et d’infinies discussions avec Clément Cogitore et Tatiana Vialle. « On a voulu d’emblée écarter des effets trop spectaculaires, de type harangue de pasteur évangélique américain ou les promesses improbables qui brisaient toute crédibilité, comme j’en lisais sur les flyers récupérés à Barbès, ces voyants qui disaient être capables à la fois de résoudre vos soucis sexuels et de réparer votre PlayStation », s’amuse l’acteur. Au contraire, ils lui ont composé un uniforme jeans-tee-shirt passe-partout, n’en ont fait ni un athlète ni un tombeur, au point de laisser à Karim Leklou le soin de développer une affection pour son anti-héros. « Très vite, je n’ai plus vu le personnage comme un escroc, mais comme un fin psychologue qui console les âmes », dit-il. « Avant et pendant le tournage, je suis un obsessionnel, au point de prendre trop peu de temps pour la vie. » Karim Leklou Visionnage de documentaires, recherches de musique, adaptation de tournures de phrases… En quinze ans de carrière au cinéma, le comédien a développé non pas une méthode – il conteste le terme –, mais un appétit à se fondre dans un univers, à préparer un rôle avec application. Le genre à discuter des semaines avec la costumière (Les Géants, de Bouli Lanners, 2011), à parfaire en phonétique l’arabe qu’il ne parle pas à la ville (La Source des femmes, de Radu Mihaileanu, 2011), à vouloir maîtriser chaque geste médical lorsqu’on lui assigne le rôle d’un chirurgien (Réparer les vivants, de Katell Quillévéré, 2016, ou la série Hippocrate, de Thomas Lilti, diffusée à partir de 2018), à perdre « une vingtaine de kilos » pour se tailler une silhouette de flic alerte (BAC Nord, de Cédric Jimenez, 2020)… « Avant et pendant le tournage, je suis un obsessionnel, au point de prendre trop peu de temps pour la vie », reconnaît-il. « Ce désir de maîtrise, qu’il faut quelquefois canaliser, trahit sa grande insécurité de ne pas être à la hauteur », analyse son ami Thomas Lilti, avec qui Karim Leklou commencera, dans quelques jours, le tournage de la troisième saison d’Hippocrate pour Canal+. « L’implication de Karim est totale au point qu’il est incapable de faire deux choses à la fois. Lorsqu’il est sur un autre projet, il ne m’appelle pas, tant il est concentré. Je n’en prends pas ombrage, car, lorsqu’il revient, je suis toujours très touché de le voir s’adonner à la série à 100 %. » Le cinéma en partage Gamin, le comédien ne s’imaginait pas de métier précis. « Juste m’en sortir. » Timide « indiscipliné », il grandit dans un F2 d’un HLM de Saint-Cyr-l’Ecole, dans les Yvelines, dont son père, Mustapha, originaire d’Algérie, lui a laissé la chambre pour dormir dans le salon. « Ce geste magnifique me hante aujourd’hui », souffle celui qui est devenu père à son tour, il y a quelques mois. Dans cet espace à lui, recouvert de posters des footballeurs Diego Maradona ou Roberto Baggio, une chaîne hi-fi allumée sur RFM, Skyrock ou les commentaires sportifs d’Eugène Saccomano sur Europe 1, il s’évade en rêves. « Je tirais des coups francs imaginaires en Coupe d’Europe, marquant souvent des buts décisifs dans les dernières minutes. En vérité, j’avais deux pieds gauches. » « Il a, à la façon d’un Depardieu, une manière à lui d’occuper l’espace et, dans le regard, quelque chose qui vous traverse. » Hélène Marty, professeure au Cours Florent Lorsque son père, magasinier, revient du travail et lui du collège, ils aiment regarder ensemble, sans trop de commentaires, cinéma américain contemporain (dont Do the Right Thing, de Spike Lee, qu’il cite comme fondateur dans son goût du septième art), westerns, films d’action, comédies familiales, péplums… « J’entends encore mon père prononcer à la française le nom de Steve Reeves – “Riveuss’ !” – qu’on voyait dans Le Fils de Spartacus, rembobine Karim Leklou. Je réalise aujourd’hui qu’il m’a transmis, l’air de rien, cette idée majeure que la culture est une chose importante. » Plus tard, diplômé d’un BTS force de vente (« ou plutôt vente forcée ! ») et d’une licence en ressources humaines, il passera des heures à écumer les sorties en salle, à l’UGC de Saint-Quentin-en-Yvelines ou aux 5 Caumartin, dans le quartier de Saint-Lazare, où il est retourné, le 8 février, pour y introduire avec émotion une séance de Pour la France, le beau film politique de Rachid Hami dont il tient le rôle principal. « Entre 18 et 27 ans, j’ai vivoté. J’ai vendu, en accueil physique ou au téléphone, des abonnements Itineris et Wanadoo, des lignes téléphoniques chez France Télécom, des revues. » Casque et micro sur les oreilles, phrases-types à suivre à la lettre dont il est encore capable de se remémorer : « On vous offre une montre de type Rolex… » Avec lui, chaque job comporte « une durée de vie de trois mois, relève-t-il. Au-delà, je commençais à m’éloigner du texte. Les superviseurs m’entendaient et je me faisais virer. » Comme si seul le cinéma, déjà, l’absorbait, il se mettait alors à improviser des personnages, des répliques, des accents, ou se sabordait franchement en dégainant des punchlines de Scarface à des clients stupéfaits… Rituels d’apprentissage C’est là qu’il se lance, en 2005, des cours du soir au Cours Florent, pour tenter sa chance. « Il ne savait pas trop quoi faire de sa carcasse », se souvient sa professeure Hélène Marty, qui enseigne aujourd’hui au conservatoire départemental de Carcassonne et que Karim Leklou cite souvent comme la première professionnelle à lui avoir inculqué le plaisir de jouer. Ce corps imposant qu’il traîne maladroitement dans une classe où dominent les physiques de jeunes premiers, elle le lui fait appréhender, avec notamment Horace, de Corneille, déclamé à même le sol. « Je me disais : “S’il fait carrière, il fera quelque chose de fort.” Il a, à la façon d’un Depardieu, une manière à lui d’occuper l’espace et, dans le regard, quelque chose qui vous traverse », dit fièrement Hélène Marty. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Cannes 2022 : Karim Leklou « Moi, le cinéma et mon père » Dès ses premières apparitions, comme dans Un prophète (2009), de Jacques Audiard, ou chez la crème des cinéastes émergents des années 2010, comme Katell Quillévéré, Rebecca Zlotowski ou Elie Wajeman, ce sont en effet ce corps et ces yeux singuliers que les cinéphiles remarquent. Une morphologie « d’ours » et des billes « de chien battu », dépeint la presse à ses débuts dans des métaphores animales sans délicatesse. « Son corps bouge dans un rare contraste de brusquerie et de douceur », apprécie Clément Cogitore, qui l’a entraîné, pour Goutte d’or, dans des séquences de tournage physiquement éreintantes, d’errement et de perdition, de 20 heures à 6 heures. Karim Leklou, lui, élude : « L’image que je renvoie m’intéresse peu. Je n’ai pas fait ce métier pour me rapprocher de moi mais pour m’en éloigner. » Chaque nouveau projet commence par le même rituel : l’envoi du scénario à son grand ami Taha Lemaïzi, que Karim Leklou, fils unique au civil, mentionne comme son « frère ». Ces deux-là se sont rencontrés au Cours Florent. Intérêt partagé pour les films de gangsters et les matches de football, ils ont passé ensuite des journées entières à préparer ensemble des auditions, ont débuté au cinéma au même moment, dans les studios de Gennevilliers reconstituant la prison d’Un prophète. Dans un ballet rodé depuis des années, c’est auprès de Taha Lemaïzi donnant la réplique que Karim Leklou apprend ses textes. « En général, on se retrouve dans un café et on répète encore et encore, mais cela peut aussi se faire par téléphone, sur FaceTime… On cherche ensemble. Karim a une clairvoyance du rôle, il capte vite », raconte Taha Lemaïzi, qui a grandi à Wittenheim, en Alsace, et travaille aujourd’hui comme jardinier à Vincennes et ses environs. Un emploi « sans pénibilité » Karim Leklou peut ensuite demander aux cinéastes qui l’emploient d’éclairer un terme, de rendre plus vif un dialogue, partage ses doutes sur une didascalie… « Il a l’intelligence de préférer que son personnage garde le silence plutôt qu’il parle pour ne rien dire », note Guillaume Bureau. Le réalisateur a ainsi écrémé certaines répliques de son premier long-métrage, C’est mon homme, attendu en salle le 5 avril, afin de rendre plus impalpable encore le personnage touchant de soldat brisé par la Grande Guerre qu’incarne Karim Leklou, désiré par deux femmes aux antipodes, interprétées par Leïla Bekhti et Louise Bourgoin. « Comme tout privilège, je sais aussi que c’est fugace, que tout ça peut finir par s’envoler. » Karim Leklou Très demandé, le comédien apparaîtra à nouveau dès le 3 mai, dans Temps mort, d’Eve Duchemin, où il interprète un détenu, puis reviendra, dans les mois à venir, en héros loufoque qui donne à tous ceux qu’il croise l’envie de l’assassiner dans Vincent doit mourir, premier film de Stéphan Castang. « Acteur est un emploi sans pénibilité », loue-t-il, en détachant ce terme qui apparaît au-dehors, dans la rue de Caulaincourt, en lettres noires sur des affiches contre la réforme des retraites. « On connaît tous des gens qui encaissent des vies difficiles et dont les métiers qu’ils font ne sont pas à la hauteur des hommes qu’ils sont… Je sais trop cela pour ne pas comprendre à quel point je suis, dans cette société, un privilégié. Et, comme tout privilège, je sais aussi que c’est fugace, que tout ça peut finir par s’envoler. » Ni fataliste ni tranquille, il dit ne présager de rien, ne pas se figurer de personnages à composer à l’avenir. Avant de se reprendre, hilare : « Ah, si ! ça me ferait marrer de faire un film où je pars dans l’espace ! » Comme pour mieux suggérer qu’il est prêt à tous les voyages. « Pour la France » (1 h 53), de Rachid Hami. En salle depuis le 8 février. « Goutte d’or » (1 h 38), de Clément Cogitore. En salle le 1er mars. « C’est mon homme » (1 h 27), de Guillaume Bureau. En salle le 5 avril. Valentin Pérez / M le magazine du Monde Légende photo : Karim Leklou, à Paris, le 8 février 2023. THOMAS CHENE POUR « M LE MAGAZINE DU MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 2:25 PM
|
Par Diego Caparros pour le site France tv. info le 7/03/23 Par quelles émotions sont passés les parents des danseurs professionnels qui les ont souvent vu quitter le nid très tôt ? La mère de l'un d'entre eux devenu danseur à l'Opéra national du Rhin, a raconté cette expérience sensible dans un petit livre écrit à partir de ses notes. Un écrit universel sur ces enfants prodiges qui veulent vivre de leur passion. Marin danse est un ouvrage tendre et poétique qui retrace la vie d'un petit garçon devenu danseur, par les yeux de sa mère. Marin Delavaud, aujourd’hui danseur à l’Opéra national du Rhin à Strasbourg à 28 ans, a quitté le nid familial pour la capitale à onze ans seulement. Lui dansait, et pendant ce temps-là, sa mère écrivait, posait des mots sur cet éloignement familial né d'une passion dévorante. Quinze ans de notes prises par Béatrice Tourancheau compilées en un recueil de souvenirs. Un livre délicat qui transmet les émotions de parents que la danse avait éloigné de leur fils, comme en témoigne cet extrait : "À ses dix ans, son père et moi, ne pas vouloir qu'il parte, et pleurer. À ses onze ans, comprendre. Notre fils est appelé haut et loin. Etre là pour lui." "J'avais pris des notes pendant les sept ans de Marin à Paris, et puis j'ai gardé des petites choses, comme des petits mots d'amour qu'il me laissait et je m'étais promis d'en faire quelque chose. J'ai commencé à écrire au départ pour Marin et moi et puis c'est sorti de la sphère privée", confie Béatrice Tourancheau. Un déracinement fréquent dans ce milieu L'histoire personnelle de Marin racontée par sa mère a trouvé un écho particulier chez les autres danseurs du Ballet National de Strasbourg. Ce déracinement familial, le fait de quitter sa maison ou son pays pour vivre sa passion d'enfant, beaucoup de danseurs d'un corps de ballet l'ont vécu. "Ça m'a fait comprendre un peu mes parents. C'est intéressant parce qu'on ne le voit pas, eux le cachent, parce qu'ils essayent d'être là pour nous et de montrer que tout va bien", explique une danseuse professionnelle. Une autre ajoute : "On nous demande d'être adulte très tôt, c'est important que nos parents soient là pour nous soutenir". Le précieux et délicat témoignage d'une maman devient alors un manuel à destination de tous les parents. "L'éloignement familial, c'est quelque chose d'assez universel finalement. Mais aussi jeune, ça nous est propre à nous, sportifs de haut niveau. Ça a raisonné dans la tête et le cœur de pas mal d'entre nous", souligne Marin Delavaud. Des danseurs qui ont fait du ballet leur famille d'adoption. La couverture du livre "Marin Danse" sorti en décembre dernier par Béatrice Tourancheau. (France 3 Strasbourg) "Marin danse" de Béatrice Tourancheau, Editions Edicop

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 6, 2023 5:13 PM
|
Critique de Lucile Commeaux dans Libération - 6 mars 2023 Sur la scène de la Scala à Paris, Alain Françon s’approprie le texte emblématique de l’absurde avec intelligence et finesse. Et fait s’étreindre le duo triste et burlesque de Beckett. Depuis quelques années, le metteur en scène Alain Françon passe le patrimoine théâtral français au filtre d’un conservatisme efficace, faisant entendre haut et clair sur les scènes privées et publiques des textes emblématiques – Molière, Marivaux, aujourd’hui Beckett. On aurait pu craindre que cette clarté revendiquée n’annule la charge poétique d’En attendant Godot, chef-d’œuvre de l’absurde. C’était sans compter l’intelligence et la finesse du metteur en scène, qui puise précisément dans une compréhension littéraire aiguë intentions, gestes et décors. Sur le plateau, deux hommes en attendent un troisième, qui doit leur donner, peut-être, travail et refuge. Alors qu’ils discutent en apparaissent deux autres, Pozzo et Lucky, le second est l’esclave du premier, muet et épuisé. La nuit tombe, le jour revient, et à nouveau les deux hommes attendent, et à nouveau passent Pozzo et Lucky. Dans la grande salle de la Scala, la grammaire de Françon est en place : une toile peinte dans des tons noir gris en fond de scène, d’où la lumière semble émaner, peut figurer aussi bien en haut un ciel menaçant qu’en bas une boue paralysante – la «merdecluse» dit Gogo. Entre un arbre décharné et une pierre plate, Vladimir et Estragon sont exactement ce qu’on attend qu’ils soient, dans un respect absolu de didascalies précisées maniaquement par Beckett – pieds qui boitent, faciès vieux, chapeaux melon élimés à la bordure. Paire triste et burlesque Point de fantaisie : les navets sont des navets, le pliant est un pliant. Françon a choisi des gueules de l’emploi, excellentes au demeurant. Citons André Marcon et Gilles Privat dans les rôles principaux. Ils incarnent un duo nullement éthéré, pas allégorique pour un sou, mais deux compagnons qui s’étreignent, chantent, dansent, mangent, puent ensemble. Quelque chose de charnel émane de cet organisme double que forment Didi et Gogo, une tendresse et une violence dans les intonations – ce fameux «ah oui», qui indéfiniment suit le «on attend Godot», un peu chantant, comme une douce plainte. Cul haut cul bas, costumes intervertis, ils font la paire triste et burlesque d’un music-hall dégradé dans une salle des grands boulevards parisiens, une dimension pas toujours creusée sur les scènes de théâtre. Godot ici assume son suffixe populeux, qui colle à son «God» – ce dieu absent –, des intonations gouailleuses, et convoque poivrots et godillots dans un geste poétique relittéralisant. On pense au muet de Keaton, aux numéros de Laurel et Hardy, mais aussi dans l’accent parfois désuet qui déforme un mot ou une réplique de Gogo, aux drôles qui peuplent les films de Carné. Ces personnages-là ne sont pas de purs signes dans l’abstraction de la parabole, ils sont bien là, montrant parfois d’un doigt méfiant ou rancunier le public qui les regarde n’avoir «rien à faire». En attendant Godot de Samuel Beckett. Mise en scène Alain Françon, avec Gilles Privat, André Marcon, Philippe Duquesne, Eric Berger et Antoine Hueillet. A la Scala à Paris jusqu’au 8 avril 2023

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2023 5:36 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog 2 mars 2023
Au fil du temps, l’interprète a glissé de récitals de chansons, vers des formes de contes, d’histoires racontées malicieusement. En puisant dans son premier roman, Dieu sur Terre, et très bien entouré, il offre un spectacle très séduisant à l’Athénée, puis en tournée.
Disons le vite, puisqu’il ne reste pas beaucoup de représentations à Paris, mais disons-le fermement : le spectacle mis en scène par Jessica Dalle et Benjamin Lazar, sur le plateau d’un des plus beaux théâtres de Paris, l’Athénée, constitue un délicieux moment de fantaisie, de poésie, de bonne musique excellemment interprétée. On retrouve tout ce qui fait le charme de Thomas Fersen, auteur-compositeur-interprète : une éternelle enfance, une adolescence prolongée, une maturité lucide et amusée en même temps désormais. Une dégaine de d’jeune, une tignasse de collégien, une silhouette souple, dans les costumes de Pauline Juille, et cette voix bien sûr, ce timbre original, cette trace étrange de lointain accent inassignable. Ce récital hautement théâtral est associé à la parution d’un livre chez L’Iconoclaste (20€). Un roman, son premier roman. Fragments biographiques, ton faussement désinvolte, plaisanteries à deux balles de gamin du XXème arrondissement, et ces rimes. Ce goût du vers, jusqu’aux vers blancs et vers de mirliton. Comme dans les chansons que l’on apprenait autrefois. Le livre s’intitule Dieu sur Terre. Le spectacle, Mon frère, c’est Dieu sur Terre. Magistralement accompagné de Pierre Sangra, avec en alternance Pavel Andaero ou Pavel Guerchovitch à la guitare, de Maryll Abbas à l’accordéon, de la grisante Cécile Bourcier au violon, très bien éclairé par Jimmy Boury, concepteur et Nicolas Lamatière, à la régie, Thomas Fersen donne le sentiment d’une grande liberté. Il est dirigé avec leur intelligence et leur sensibilité, leur humour, par Jessica Dalle et Benjamin Lazar. Ils parlent avec admiration et profondeur de l’univers de Thomas Fersen et le mettent formidablement bien en valeur. C’est très drôle, souvent cocasse, vif, enlevé. C’est touchant. Cela charrie de la vraie vie et sans doute beaucoup d’inventions. Vous le découvrirez ! C’est une proposition très originale et séduisante. Voyez le spectacle, mais lisez aussi le livre car, évidemment, il est plus fourni que ce moment bref et charmeur, attisé par la voix si prenante de Thomas Fersen. Théâtre de l’Athénée, jusqu’au 4 mars, à 20h00. Durée : 1h15. Tél : 01 53 05 19 19. Adresse : athenee-theatre.com Tournée du 9 mars au 23 mai à travers toute la France. Légende photo : Thomas Fersen, sur la scène du Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, lors de la première de son spectacle « Mon frère c’est Dieu sur Terre », le 23 février 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 2:26 PM
|
Par Yonnel Liégeois pour le site "Chantiers de culture" - 28/02/23 Jusqu’au 8/04 pour l’une à La Scala, au Théâtre de l’Atelier pour l’autre jusqu’au 16/04, se jouent à Paris En attendant Godot et Fin de partie. Deux classiques du répertoire contemporain, deux chefs d’oeuvre de Samuel Beckett… Avec de prodigieux interprètes magistralement mis en scène par Alain Françon et Jacques Osinski.
Un événement, le plus français des auteurs irlandais, prix Nobel de littérature en 1969, à l’affiche de deux grandes salles parisiennes : Samuel Beckett, le maître de l’insolite, subtil défaiseur de langage et tricoteur de mots ! Qui fit scandale en 1953, lors de la création d’En attendant Godot par Roger Blin, les spectateurs n’y comprenant rien, excédés qu’il ne se passe rien, au point d’en venir aux mains : Godot, qu’on attend toujours 70 ans plus tard, n’en demandait pas tant, le succès était assuré ! « Je ne sais pas qui est Godot. je ne sais même pas, surtout pas, s’il existe. Et je ne sais pas s’ils y croient ou non, les deux qui l’attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ça doit être pour rompre la monotonie. Tout ce que j’ai pu savoir, je l’ai montré. Ce n’est pas beaucoup. Mais ça me suffit, et largement. Je dirai même que je me serai contenté de moins ». Samuel Beckett. Lettre à Michel Polac, 1952 Sur les planches de la Scala, un duo époustouflant de naturel et de naïveté ! Laurel et Hardy des temps modernes, le petit rondouillard et le grand escogriffe à la Tati attendent Godot sans désespérer. La lune se levant au jour couchant, les godillots blessant les pieds, la faim tenaillant le ventre, le froid s’immisçant au pied de l’arbre décharné… En fond de scène un paysage vaporeux et gris noir, un gros caillou au devant sur lequel Estragon (André Marcon) soulage son fessier tandis que Vladimir (Gilles Privat) le rejoint braguette ouverte. Le dialogue s’engage. Répétitif, désopilant : sur la mémoire qui flanche au souvenir d’être déjà passé par là, sur l’état miséreux des deux paumés que lie une tumultueuse mais solide amitié, sur le rendez-vous sans cesse décalé avec l’énigmatique Godot. Comme chaque soir, ils croisent le chemin du fantasque Pozzo (Guillaume Lévêque) tenant en laisse Lucky (Eric Berger), son porteur de valise. Chacun y va de sa tirade, pleureuse ou rieuse, doucereuse ou coléreuse. Rien n’avance ni ne bouge, l’action au point mort alors que s’agitent les protagonistes, en perpétuel mouvement ! Estragon et Vladimir repartent comme ils sont venus, même pas déçus lorsqu’un jeune messager (Antoine Heuillet) leur annonce un nouveau report. Demain, les deux compères en sont convaincus, ils rencontreront l’étrange inconnu. Alain Françon, qui fit hier les beaux jours (oh, Beckett…) du Théâtre national de la Colline, a fouillé le texte du bel et grand irlandais pour en extraire la substantifique moelle. Posant chaque tirade et dialogue dans le bon geste et la bonne intonation de ses interprètes, rendant tout à la fois limpide et sulfureuse l’écriture du dramaturge, faisant advenir complicité et compassion envers cette galerie d’êtres égarés et détonants, déconcertés et déconcertants. Une tranche d’humanité partagée entre rire et détresse, cruauté et tendresse dans l’aridité d’un monde où la rencontre avec l’autre désormais ne va plus de soi. Et pourtant… Quand l’arbre dégarni, d’une unique feuille au final luit, l’espoir reverdit ! Un plaisir des planches renouvelé au Théâtre de l’Atelier, toujours en compagnie de Samuel Beckett ! Jacques Osinski met en scène Fin de partie, là encore avec une sacrée bande de comédiens, Denis Lavant et Frédéric Leidgens dans les rôles-titre… « Ma bataille sans espoir contre mes fous continue (avec l’écriture de Fin de partie, ndlr), en ce moment j’ai fait sortir A de son fauteuil et je l’ai allongé sur la scène à plat ventre et B essaie en vain de le faire revenir sur son fauteuil. Je sais au moins que j’irai jusqu’à la fin avant d’avoir recours à la corbeille à papier. Je suis mal fichu et démoralisé et si anxieux que mes hurlements jaillissent, résonnant dans la maison et dans la rue, avant que je puisse les arrêter ». Samuel Beckett. Lettre à Pamela Mitchell, 1955 Comme l’affirme le génial irlandais à propos de sa pièce préférée, un vieil homme condamné en son fauteuil, aveugle et paralytique… Près de lui, un type plus jeune, boiteux et agité. Hamm (Frédéric Leidgens) et Clov (Denis Lavant), le père et le fils peut-être, le maître et le serviteur plus vraisemblablement : l’un parle l’autre agit, l’un ordonne l’autre obéit. Qui s’interpellent et se répondent du tac au tac, des dialogues de basse ou haute intensité, comme Clov qui n’en finit pas de monter et descendre de son échelle, d’une aigreur vacharde ou d’une mielleuse condescendance. Le vieux, acariâtre, vit la peur au ventre, redoutant que son garçon de compagnie le quitte. L’autre, fielleux, ne cesse de répéter qu’il va fuir, s’en aller bientôt, et si ce n’est aujourd’hui ce sera demain assurément. La vie, les jours s’écoulent ainsi en ce salon sans chaleur ni luminosité, d’un rituel l’autre à servir le repas, surveiller le bon ou mauvais temps du haut de la fenêtre, cajoler le petit chien en peluche qui a perdu une patte : comme le précise Beckett dans la missive à son amoureuse, un monde de fous qui, paradoxe, semblent pourtant toujours maîtres de leur raison, les parents de Hamm (Claudine Delvaux et Peter Bonke) sortant la tête des deux grands tonneaux où ils sont cloîtrés, à priori à leur insu mais de leur plein gré au vu de leur visage rayonnant ! Là encore, peu d’action mais forte agitation, Lavant et Leidgens au sommet de leur art, entre tragédie et comédie, dans leurs rôles de composition et leurs tirades à la pointe acérée. Jacques Osinski maîtrise l’univers beckettien. Du maître irlandais exilé à Paris depuis 1937 et reposant désormais au cimetière Montparnasse, l’ancien directeur du Centre dramatique national des Alpes de Grenoble a déjà mis en scène nombre de ses textes, du Cap au pire à La dernière bande au milieu de quelques Foirades… Avant que ne se lève le rideau, un interminable noir silence invite le spectateur à se défaire des affaires du temps présent pour entrer dans un univers hors d’atteinte de toute normalité : l’ancien monde qui se meurt au fond d’un tonneau, le nouveau où les vivants se répartissent la tête et les jambes, l’un râlant et l’autre claudiquant. Une alliance forcée, une solidarité fondée dans la contrainte, un piteux jet de lumière laissant entrevoir un semblant de bonté et d’espoir. Avec Beckett, c’est peu dire, entre humour et férocité, les rapports entre humains sont d’une étrange complexité. D’une pièce l’autre, de Godot à Fin de partie, chacun est convié, selon son humeur du jour, à rire ou pleurer au banquet de la comédie humaine. Deux spectacles accessibles à quiconque, avec les mots du quotidien – décalés, disjonctés, déphasés -, pour donner à voir les maux d’un monde où la graine ne germe plus, l’éclaircie se fait rare, l’autre se terre dans l’absence et le silence. « Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir », nous alerte Beckett avec une hauteur et une intelligence d’esprit prophétiques. Yonnel Liégeois / Chantiers de culture En attendant Godot : jusqu’au 08/04 à la Scala, à Paris. Du 12 au 14/04 au Domaine d’O, à Montpellier. Du 03 au 05/05 au Théâtre national de Nice. Du 07 au 29/07 à la Scala Provence, à Avignon. Fin de partie : jusqu’au 16/04 au Théâtre de l’Atelier, à Paris. Les 12 et 13/04 à Châteauvallon-Liberté, scène nationale. Les écrits de Samuel Beckett (théâtre, nouvelles et récits, essais et poèmes) sont disponibles aux éditions de Minuit.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 11:14 AM
|
Publié par Véronique Hotte dans son blog Hottello 22/02/23 Rencontre avec André Markowicz autour de Les Juifs de Evgueni Tchirikov, traduit par André Markowicz. Hall du Théâtre Nanterre-Amandiers, le samedi 18 mars de 15h à 17h. Entrée libre. A 18h, spectacle Le Dragon, mise en scène par Thomas Jolly.
Comment parler de ma Russie aujourd’hui, quand la Russie – quand l’armée de Poutine – commet les crimes qu’elle commet en Ukraine ?, interroge André Markowicz. La Russie a toujours connu la dictature, et, toujours, ce sont des écrivains et des poètes, souvent au risque de leur vie, qui ont porté la flamme de l’humanité dans une société où ne règnent que la peur et la haine. Auteur invité au Théâtre Nanterre-Amandiers, après avoir traduit l’ensemble des oeuvres de fiction de Dostoïevski, Eugène Onéguine de Pouchkine, l’ensemble du théâtre de Tchekhov – avec Françoise Morvan – et plus d’une centaine d’autres textes, André Markowicz parlera du travail qu’il mène aujourd’hui, sur des textes moins connus, mais tellement essentiels, les derniers livres parus aux Editions Mesures qu’il anime avec Françoise Morvan – , et surtout d’une pièce dont la publication a été soutenue par le Théâtre : Les Juifs d’Evgueni Tchirikov, – aujourd’hui sombrés dans l’oubli, tant pour la pièce que pour l’auteur, mais d’une acuité incroyable. Ce qui se passe, à l’intérieur du monde juif, quelques jours, puis un jour, puis pendant un pogrom. La pièce a été écrite en 1905, après les pogroms effroyables qui avaient traversé l’Empire russe. Cette pièce, il voudrait que tout le monde la lise… Paru aux éditions Mesures en 2023, l’ouvrage d’Evguéni Tchirikov Les Juifs raconte un drame bouleversant et d’une grande complexité sur toute la vie juive dans la Russie du début du siècle dernier. André Markowicz décide alors de la traduire du russe et d’écrire une préface pour cette parution en France. « Nous avons voulu lui donner une deuxième vie », écrit les éditions Mesures. Cette pièce, montée par Meyerhold en 1906, fut interdite en Russie mais jouée à travers l’Europe et aux Etats-Unis. Véronique Hotte Rencontre avec André Markowicz autour de Les Juifs de Evgueni Tchirikov, traduit par André Markowicz. Hall du Théâtre Nanterre-Amandiers, le samedi 18 mars de 15h à 17h. Entrée libre. A 18h, spectacle Le Dragon, mise en scène par Thomas Jolly.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 27, 2023 7:32 AM
|
Par Bruno Lesprit dans Le Monde - 26/02/23 Au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, le chanteur présente son premier spectacle, un monologue en octosyllabes intégrant ses chansons. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/26/thomas-fersen-plonge-dans-le-grand-bain-poetique-du-theatre-avec-mon-frere-c-est-dieu-sur-terre_6163387_3246.html
L’idée de Mon frère c’est Dieu sur Terre était déjà en gestation en 2019, quand nous avions interviewé Thomas Fersen pour son douzième album studio, C’est tout ce qu’il me reste. Le chanteur songeait alors à développer ces « monologues en vers » qui ponctuaient ses concerts. « Au départ, j’étais dans la comédie, pas dans la musique, rappelait-il. Quand j’étais gamin, je fermais la porte de ma chambre et j’incarnais des personnages, parfois avec de la musique pour illustrer la “pièce” que j’improvisais. Personne n’était au courant, je ne nommais pas cette activité, car je n’avais pas l’impression que c’en était une. » Le voilà qui ressuscite cette fantaisie d’enfance. A cette différence de taille près que son goût pour le jeu quitte la plus stricte intimité pour s’exposer au public jusqu’au 4 mars, au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, à Paris. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Thomas Fersen sort son douzième album, autoproduit : « Le digital ne me rapporte rien » Le fabuliste, dont le riche bestiaire lui a valu d’être rattaché à La Fontaine alors que ses portraits doivent autant aux Caractères de La Bruyère, remonte ainsi sur les planches après avoir été récitant de L’Histoire du soldat, d’Igor Stravinsky et de Charles Ferdinand Ramuz, en 2013. Il fait par la même occasion son entrée en littérature puisque Dieu sur Terre est publié comme son premier roman, mêlant souvenirs autobiographiques et fruits de son imagination. Fersen l’a voulu comme « une chanson de trois cents pages » entièrement écrite en octosyllabes, avec comme cadre le Ménilmontant et le Pigalle des décennies 1960 et 1970, de l’école élémentaire Julien-Lacroix au lycée Jacques-Decour. Scène désordonnée On y retrouve les thèmes qui traversent sa discographie depuis trente ans : la cellule familiale avec, en vedette, ce frère choyé qui serait « Dieu sur Terre », l’inquiétant voisinage (« Gros singe », « Le Baveux ») qui peuplait l’album Le Pavillon des fous (2005), les premiers émois amoureux, la fascination pour l’étrange et le macabre… Et, au terme de ce récit d’initiation, la vocation qui se dessine à la contemplation des guitares électriques en vitrine des magasins de Pigalle. Fersen en profite pour livrer cette considération sur le métier de musicien : « La musique fait rarement recette et, en général, [le musicien ] en bave. Sa place est souvent à la cave, ce qui lui vaut ce teint d’endive, voire de champignon de Paris. Mais la raison qui le motive, c’est pas d’avoir l’air mal nourri. C’est que c’est un piège à gonzesses, le meilleur qu’on ait inventé. Et, pour un malade de la fesse, c’est par là qu’il doit s’orienter. » Des stars internationales (Bruce Springsteen ou Bono, chanteur de U2) ont utilisé récemment leurs Mémoires comme support de lectures scéniques émaillées de chansons. Fersen s’en distingue en écartant l’exégèse ou l’anecdote. La forme qu’il propose est tout à fait originale et fusionne une poésie incarnée, à partir d’extraits de son livre, et un répertoire – les classiques que sont Hyacinthe, Bijou, Monsieur, Punaise ou Les Papillons – mobilisé pour les liaisons, l’inverse en somme de sa pratique en concert. Sur une scène désordonnée comme peut l’être une chambre d’adolescent, il est à son aise pour camper ce personnage récurrent dans son œuvre, un garçon fainéant et peu sûr de lui, perturbé par sa sexualité depuis sa découverte des chansons paillardes et invisibilisé par plus grands et plus costauds que lui. La forme qu’il propose fusionne une poésie incarnée et un répertoire mobilisé pour les liaisons Fersen débute seul en jaugeant l’eau d’une bassine, qui serait le grand bain de la piscine d’Oberkampf. Avec son plongeoir « barré depuis un accident mortel », le risque d’attraper une verrue pour la gloire d’un premier triton et l’au-delà qui « fait des avances » dans les profondeurs. Une métaphore possible de ce que vit le chanteur en se jetant ainsi à l’eau. Du théâtre, il utilise les accessoires, tels cet édredon douteux doublé d’un manteau herminé de monarque et cette boule de démolition qui se transformera en boule à facettes pour l’évocation des premières boums. Le néo-sexagénaire parle en effet d’un temps où sa classe d’âge devait effectuer ses obligations militaires et se souvient de la présidentielle de 1974 : « Giscard a gagné l’élection. Il est bon à l’accordéon. » Trois musiciens le rejoignent, le fidèle guitariste Pierre Sangra, la violoniste Cécile Bourcier et l’accordéoniste Maryll Abbas, le conteur s’emparant à l’occasion de son ukulélé. Cette configuration acoustique ramène aux cabarets de ses débuts, entre élans tsiganes et celtiques. Jusqu’à la chute, le spectacle est finement ciselé, comme le sont les textes de ce polisseur de la chanson. Fersen concédera un unique rappel chanté (Le Chat botté), pas plus, afin de ne pas détourner en concert ce projet inédit. En remerciant les spectateurs de lui avoir « fait confiance » pour cette expérience risquée et réussie. Mon frère c’est Dieu sur Terre, textes et musique de Thomas Fersen, mise en scène de Jessica Dalle et Benjamin Lazar, Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, 2-4, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris 9e. Jusqu’au 4 mars, à 20 heures (le dimanche, à 16 heures), puis en tournée. Durée : 1 h 15. Dieu sur Terre, éd. L’Iconoclaste, 288 p., 20 €. Bruno Lesprit / Le Monde Légende photo : Thomas Fersen, sur la scène de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, lors de la première de son spectacle « Mon frère c’est Dieu sur Terre », le 23 février 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2023 4:51 PM
|
"
Par Laurent Carpentier dans Le Monde 25/11/22 La comédienne de 43 ans prête sa voix aux mots de Vanessa Springora au théâtre. Dans les locaux de l’école de cinéma Kourtrajmé, à Montfermeil, où elle dirige la section acteurs, elle trinque à la bière et à la diversité.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/11/25/un-apero-avec-ludivine-sagnier-weinstein-m-a-invitee-au-ritz-mais-je-n-avais-d-yeux-que-pour-le-buffet_6151654_4497916.html
Montfermeil, entre chien et loup. Une pluie d’hiver enveloppe ce plateau de l’Est parisien et ses immeubles battus par les vents. Après les émeutes de 2005, l’Etat a massivement investi ici, dans ce territoire de Seine-Saint-Denis. Ludivine Sagnier ouvre la porte du petit hangar moderne où elle a donné rendez-vous. Une table, quelques chaises pliantes, noix de cajou, tomates cerises, un pack de bières ; sur le frigo, des stickers (« Essonne Antifas ») ; et, dans le four de la cuisinière, quelques brochettes au fromage qu’elle a mises à chauffer. Bienvenue à l’école de cinéma Kourtrajmé. Lorsque, il y a quatre ans, Ladj Ly (Les Misérables, 2019), pilier de ce collectif (avec Romain Gavras, Kim Chapiron – qu’elle a épousé –, Toumani Sangaré ou Oxmo Puccino…), crée ici, aux Ateliers Médicis, une école pour former, chaque année, une dizaine de scénaristes et de réalisateurs, l’actrice lui lance : « A l’heure où on dit manquer de représentation des minorités sur scène, ce n’est pas cohérent. Il faut aussi une formation pour les acteurs… » Réponse : « Tu sais quoi ? Tu vas t’en occuper. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Ludivine Sagnier, personnelle qualifiée C’est ainsi que Ludivine Sagnier se retrouve, bénévole et ravie, à la tête d’une page blanche : de 500 à 800 candidatures chaque année, douze étudiants à l’arrivée pour une formation – gratuite – de six mois. « Une forme d’engagement politique », souligne-t-elle en décapsulant les bouteilles qu’on biberonne au goulot. Sur le bâtiment, côté rue, traînent les traces de l’ancien occupant des lieux. « Un fabricant de croquettes. C’était dégueulasse. Des crottes de rats partout. On a tout nettoyé nous-mêmes », raconte-t-elle. A l’étage, une demi-douzaine de lits peuvent héberger les plus démunis. En bas, dans le coin cuisine, on trinque à la beauté du système D, de la précarité et de l’esprit collectif, qui sont la matière première de la tribu Kourtrajmé. Pas une victime Depuis, Ludivine Sagnier fait le grand écart entre, d’un côté, Montfermeil et, de l’autre, les châteaux de Maintenon et de Chantilly, où elle donne la réplique à Michael Douglas, dans une série sur Benjamin Franklin dont elle interprète la bonne amie. Et puis, aujourd’hui, le Théâtre de la Ville, à Paris, où sur la scène de l’Espace Cardin, jusqu’au 30 novembre, elle donne à entendre ces mots de Vanessa Springora : « Un père aux abonnés absents. Un goût prononcé pour la lecture. Une certaine précocité sexuelle. Et, surtout, un immense besoin d’être regardée. Toutes les conditions sont maintenant réunies… » En 2020, dans Le Consentement, l’écrivaine racontait sa liaison sous emprise, dans les années 1980, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, qui avait fait de son amour pour les très jeunes filles sa fierté et sa gloire : « A 14 ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, souffle, seule sur scène, Vanessa-Ludivine, pour se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter… » C’est ici, à Montfermeil, qu’elle a répété. « Ce que Vanessa Springora a vécu adolescente, elle le raconte à 45 ans. Il m’a fallu refréner mon empathie pour me rapprocher non pas de la victime mais de la résiliente », explique-t-elle. Ludivine Sagnier choisit ses mots. Elle se sent si peu légitime pour parler, préfère porter la parole des autres. Celle de la chanteuse Mai Lan, la sœur de Kim, par exemple. « Ce spectacle, dit-elle, est une façon d’apporter ma pierre à l’édifice de guérison qu’elle a commencé à dresser. » Il y a deux ans, sa belle-sœur a publié un livre pour enfants dans lequel elle raconte son combat avec le loup. En l’occurrence, un grand-père incestueux, aimé, au fantôme d’autant plus redoutable. On peut militer pour #metoo et ne pas figurer parmi les victimes. C’est le cas de Ludivine Sagnier. Bien avant de rencontrer, à 19 ans, François Ozon, dont les films (Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, Huit femmes, Swimming Pool) la propulseront en haut de l’affiche, elle travaille, toute jeune, pendant trois semaines, sur le doublage de Natalie Portman dans Léon, de Luc Besson (accusé de violences sexuelles par une actrice, il a bénéficié d’un non-lieu sur lequel la Cour de cassation doit encore se prononcer) : pas un geste déplacé ou un mot de travers. Harvey Weinstein l’invite à petit-déjeuner au Ritz : « Mais je n’avais d’yeux que pour le buffet, je n’étais intéressée que par la bouffe. En tout cas, il ne s’est rien passé. » Elle fronce les sourcils. « Au cinéma, l’ambiguïté, on vit avec… Entre le désir qu’éprouve un réalisateur de filmer quelqu’un et celui, pour les acteurs, de s’ouvrir au maximum, il y a prise de risque. Et la nécessité d’une distanciation… Après, les hommes grossiers et les gros cons, je ne les compte plus. Ni, quand j’étais petite, les exhibitionnistes. La première fois, j’ai eu peur : il m’avait coincée dans une rue, j’ai crié [elle met ses mains en porte-voix] : “Dégaaage ! Tu n’as pas hooonte ?” Il est parti. Ensuite, ça m’a aidée. L’exhibitionniste est peut-être un vaccin contre le prédateur… » Elle rit. La babtou de la bande L’actrice a grandi à Sèvres, au bord du parc de Saint-Cloud. La face bourgeoise de la banlieue parisienne. Le grand-père flûtiste à l’ORTF – « Même à la retraite, il avait un rapport rigoureux à la musique qui me terrorisait. » Elle dit avoir choisi le théâtre pour fuir le piano. Le père travaille au service de l’immigration à la préfecture de Nanterre et la mère se dépense dans les actions sociales. « Je me considère très privilégiée, mais j’ai toujours senti que, pour mon équilibre mental, il me fallait une diversité sociale. Les Quilapayun [groupe chilien réfugié en France après l’assassinat par la junte de leur leader] venaient jouer à la maison, mais l’image des gens faisant la queue à la préfecture est restée inscrite chez moi. Ladj, Kim, Oxmo, Romain, ils portent tous les stigmates de l’immigration. » C’est Vincent Cassel, rencontré en 2008 sur le biopic de Mesrine, qui lui présente Kim Chapiron et la bande de Kourtrajmé : « Ici, je suis la babtou. » La Blanche. « J’ai une grande confiance dans la génération qui arrive » Elle allume une cigarette. On frappe à la porte. C’est Sébastien Davis, l’ami d’enfance, qui dirige la section acteurs avec elle. Frigo. Nouvelle tournée de Heineken. Dans la cosmogonie de « Lud » – comme il l’appelle –, Sébastien Davis, c’est le grand frère. A l’époque où Bernard Pivot invitait Gabriel Matzneff sur le plateau d’« Apostrophes » (elle imite l’animateur, levant le menton d’un air goguenard : « Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? »), « Lud » et « Seb » sont déjà sur les planches d’un cours privé, dans un garage de Sèvres. Elle a 9 ans, il en a trois de plus. Sur la photo de 1988, on peine à reconnaître l’actrice sous les joues rondes. Les deux enfants jouent Le Satyre de la Villette, une histoire de pédophilie sur le ton de la farce dénonciatrice, écrite en 1963 par René de Obaldia. Grimace amusée : « C’est incroyable qu’on soit là, trente-cinq ans plus tard, à jouer Le Consentement. » Car c’est lui, Sébastien Davis, qui met en scène la pièce. Et c’est un autre copain des fêtes adolescentes, Dan Levy, le guitariste de The Dø, qui signe la musique. A Montfermeil, l’an passé, une des élèves a rejoué un viol qu’elle a vécu dans son enfance. « Les jeunes qui suivent la formation ont souvent des histoires personnelles douloureuses. Face à ça, on ne tient aucun discours. Il y a juste entre eux un mélange de respect de la souffrance, de dignité et de joie de vivre, comme un antidote au malheur », témoigne-t-elle en entassant les bouteilles dans la poubelle. Dehors, la pluie a redoublé. Elle sourit. « J’ai une grande confiance dans la génération qui arrive. Je les vois avec de meilleurs acquis que nous, avec une vraie conscience », dit celle dont les trois filles – 17, 14 et 8 ans – assistaient à la générale du Consentement, dimanche 20 novembre. « Une société ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. C’est comme un jardin, il faut replanter, mettre éventuellement en jachère, et attendre. » Laurent Carpentier Ludivine Sagnier, dans les locaux de répétition de l’école Kourtrajmé, à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), le 18 novembre 2022. EMMA BURLET POUR « LE MONDE » Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2023 3:38 PM
|
Critique de Joëlle Gayot dans Le Monde 25/02/23 Au Théâtre des Célestins, à Lyon, le metteur en scène croise des destins singuliers dans une mise en scène aussi audacieuse qu’excessive.
lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/25/sommeil-sans-reve-de-thierry-jolivet-entre-theatre-et-cinema-douze-personnages-au-bord-de-la-crise-de-nerfs_6163304_3246.html
L’heure est grave au Théâtre des Célestins, à Lyon. Sur scène, un architecte annonce à sa fille comédienne qu’il part se faire euthanasier en Suisse. Le spectre d’une femme victime d’un cancer hante sans relâche l’esprit de son fils orphelin. Un patron d’entreprise, coupable d’avoir pollué les eaux de la ville, cherche comment échapper à ses responsabilités. Les parents d’une fillette contaminée par cette pollution se suicident en voiture. Un sympathique voyou pleure la mort de son furet. Une dépressive veut se noyer dans les eaux sombres d’un canal. N’en jetez plus, la coupe est pleine. La mort, la folie et la maladie sont l’ADN de Sommeil sans rêve, un spectacle conçu par Thierry Jolivet. Agé de 37 ans, ce metteur en scène, artiste associé aux Célestins, a jusqu’ici travaillé des œuvres de Dante, Dostoïevski, Boulgakov ou encore de l’autrice espagnole Angélica Liddell. Autant dire qu’entre la quiétude et l’angoisse, il a fait son choix. Les trois heures quarante de cette représentation folle furieuse s’inscrivent sur un fond de musiques omniprésentes. L’ensemble est scindé par un entracte dont profitent des grappes de spectateurs pour prendre la poudre d’escampette. A raison ? Certainement, si on se rend au théâtre en exigeant de lui qu’il coche les cases de la cohérence, de la maîtrise, du raisonnable et de la pertinence. Trop longue, touffue et bien souvent perdue dans de vains et obscurs dédales, cette proposition hirsute donne de féroces envies de coupes au ciseau pour la soulager de ses scories. Et pourtant, en dépit de ses boursouflures, et peut-être même à cause de ses excès, le projet vaut le détour. Chacune de ses secondes est une seconde de vie. Au-delà de l’agacement, une certitude : on n’est pas si souvent le témoin d’un désir artistique qui se moque de séduire. Et assume de déplaire. La mise en jeu convoque l’instantané. Donc l’accident et l’imprévu. Au soir de la première, cela se traduisait par des problèmes que le temps résoudra : micros défaillants pour les comédiens sonorisés, images mal cadrées projetées sur un écran lui-même occulté par des éléments mobiles de décor, scènes qui s’éternisent et séquences inutiles. Beaucoup d’écueils, mais une énergie collective indéniable mise au service d’une gageure : suivre à la trace les trajectoires de douze héros que les aléas du quotidien amènent (ou pas) à se croiser. Sens de l’autodérision Thierry Jolivet, formé au Conservatoire d’art dramatique de Lyon, directeur artistique depuis 2015 de la compagnie La Meute, revendique ses inspirations cinématographiques. Son spectacle doit sa forme aux films de Robert Altman (Short Cuts, 1993) et de Paul Thomas Anderson (Magnolia, 1999) : deux récits choraux qui tressent, dans un même souffle, des destins singuliers. Rapatrier le procédé au théâtre est un défi de taille. Le metteur en scène, ses douze interprètes et deux preneurs de vues tentent le coup sans complexe avec un sens aigu de l’autodérision. Une actrice pique ainsi une crise de nerfs. Elle ne comprend rien à ce qu’elle joue et ignore de quoi sera fait son monologue à venir. Thierry Jolivet sait rire de lui et faire rire de ses errances. Une qualité. Le rapport de Thierry Jolivet à l’outil caméra est actif. Il sait en faire une écriture à part entière Dans la salle à l’italienne des Célestins, tout déborde : les états nerveux des héros ; le sang qui gicle ; les histoires nées des improvisations ; la surdimension de l’écran où se déploie le film du spectacle tourné en direct. Réalisées caméra à l’épaule, les images asservissent le théâtre en le soumettant au cinéma. En France, Julien Gosselin ou Cyril Teste sont passés maîtres dans la pratique de cette hybridation. Thierry Jolivet leur emboîte le pas. Son rapport à l’outil caméra est actif. Il sait en faire une écriture à part entière qui décrit le réel, le révèle ou même le trahit. C’est pour l’œil de l’objectif, ses gros plans, ses travellings, ses tremblés, ses flous et ses flashs que jouent les comédiens. Certains le regretteront. On aimerait leur dire qu’il suffit d’un acteur pour qu’advienne le théâtre. Laurent Ziserman est cet acteur. Barbe fournie, lunettes d’intello, cheveux blancs, il est l’architecte en route pour l’euthanasie. Il est aussi l’homme qui, à la fin de la représentation, sauve du suicide la femme dépressive. Lui qui voulait en finir tomberait-il amoureux ? « L’amour est fort comme la mort », est-il écrit dans le Cantique des Cantiques. Ce pourrait être la biblique conclusion de ce spectacle diablement païen. Sommeil sans rêve, mise en scène par Thierry Jolivet. Théâtre des Célestins, Lyon. Jusqu’au 4 mars. De 7 € à 40 €. Joëlle Gayot (Lyon, envoyée spéciale) / Le Monde
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...