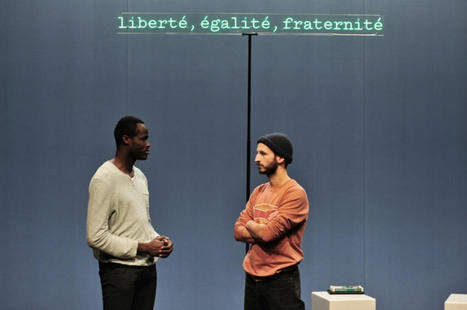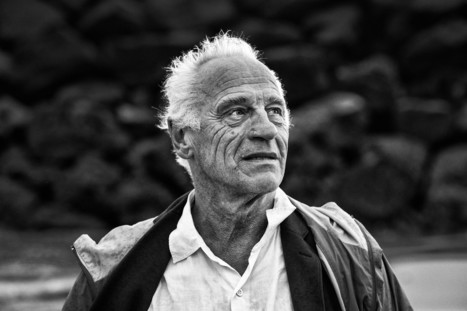Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2023 5:49 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 11 avril 2023 L’acteur, âgé de 24 ans, impressionne dans le rôle muet qu’il joue dans la pièce « Kliniken », de Lars Noren, mise en scène par Julie Duclos. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/11/maxime-thebault-un-comedien-au-puissant-magnetisme_6169117_3246.html
Comment expliquer le charme qu’exerce un acteur ? Pourquoi impose-t-il sa présence au risque d’estomper celle de ses partenaires ? Est-ce à la précision de sa profération qu’il doit d’être remarqué plus que ses camarades ? A son physique, son expressivité, sa créativité ? Il y a mille raisons de s’attacher à un comédien ; de guetter ses apparitions quand, grâce à lui, quelque chose se passe, qui sort de l’ordinaire. Maxime Thébault a ce talent, sans doute même ce don. A peine surgit-il que la question ne se pose plus : il est à sa place au théâtre. Il est chez lui sur scène. Cette certitude est d’autant plus troublante qu’elle se fonde sur un silence. Celui de Marcus, héros de Kliniken, une pièce de l’auteur suédois Lars Noren (1944-2021) qui raconte le quotidien de patients enfermés dans un asile psychiatrique. A son aise dans la peau de Marcus, le comédien traverse la représentation sans faire le moindre bruit. Il erre d’une salle blanchâtre à un hall d’accueil blafard : le décor du spectacle est d’un tel réalisme que, s’il tourne le dos au public, Maxime Thébault oublie la fiction au point de se croire cerné par de vrais murs d’hôpital. Membre d’une communauté émouvante réunissant soignants et patients qui parlent, hurlent et parfois même donnent des coups, lui se tait. Il n’a pour exister que l’éloquence de son corps et le tourment de son visage. Mais ce visage est un paysage qui fascine et inquiète. Et ce corps une silhouette obsédante qu’on ne quitte pas des yeux. Créée à Rennes en 2021, cette mise en scène saisissante de Julie Duclos est reprise actuellement au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux (Hauts-de-Seine). Formé à l’école du Théâtre national de Bretagne (TNB) de 2018 à 2021, Maxime Thébault, 24 ans, a joué neuf spectacles à ce jour, presque tous accomplis dans le cadre de son cursus. Ancien élève de la promotion 10, il a expérimenté une méthode novatrice élaborée par les directeurs pédagogiques, Arthur Nauzyciel (patron du TNB) et le comédien Laurent Poitrenaux. Le saut dans le vide a démarré dès le concours d’entrée. Il a fallu remplir un dossier, activer l’imaginaire et se livrer à l’introspection. « J’ai eu la sensation que, pour la première fois, on me posait de vraies questions sur qui j’étais. Il était possible de se donner à voir au-delà d’une rédaction sur un bout de papier. » La perche était belle, il s’en est emparé, étoffant ses réponses d’enjeux qui excédaient le cadre officiel : « Je voulais lire un poème de Paul Verlaine. Je savais que, si je le faisais, alors j’enclencherais une sorte de nouveau départ de ma vie. » Apprentissage intensif La vie nouvelle a démarré. L’ancien étudiant en lycée horticole a troqué son BTS de commerce pour une carrière de saltimbanque. Jusqu’en 2018, il ignorait pourtant tout du théâtre. « Je ne lisais que des bandes dessinées, et mes parents mettaient plus d’argent dans le sport que dans la culture. » On ne le dira jamais assez : l’éducation artistique en milieu scolaire est capable de changer le cours d’un destin. La preuve : c’est en participant à un atelier mené par un artiste de Saint-Brieuc, Hubert Lenoir, et en jouant sous sa direction dans Fanny et Marius, d’après Pagnol, que le lycéen a découvert l’ivresse des planches. « Près de trois cents personnes nous scrutaient. La pression était énorme. J’en aurais presque vomi de peur. Mais mes amis m’ont incité à aller plus loin. » Campé à l’écoute de son imaginaire, il s’en remet à son corps pour écrire dans l’espace ce qu’il est en dedans. Le geste est son alphabet, les mouvements sont sa grammaire A Rennes, il s’est plongé dans les affres d’un apprentissage intensif. Il a lu Marivaux, Claudel, Racine. Travaillé les textes d’arrache-pied, apprivoisé la prosodie classique, fait l’expérience du collectif. Il a beaucoup écouté et beaucoup regardé. Parmi ses formateurs, les metteurs en scène Jean-François Auguste et Madeleine Louarn, qui le dirigent en 2020 dans Opérette, du Polonais Witold Gombrowicz. Le spectacle associe élèves du TNB et comédiens en situation de handicap mental de l’atelier Catalyse. Une hybridation fructueuse qui floute les frontières entre vérité de l’être et artifice de l’interprète. La grâce, la fragilité, l’instabilité de Marcus sont-elles nées dans les plis d’Opérette ? L’acteur a su saisir de quoi construire son personnage : « On ne sait jamais comment, ni même si les comédiens de Catalyse vont dire leur texte. Cela met forcément dans un endroit de tension et d’improvisation. Face à eux, pas le choix, il faut être présent à chaque seconde. » Etre présent suppose d’être disponible à ce qui peut arriver chez l’autre mais également en soi, là où l’inconscient n’a aucun besoin de l’articulation sujet-verbe-complément pour se faire comprendre. Raison pour laquelle Maxime Thébault ne ressent pas de frustration lorsqu’il est privé de texte sur le plateau. Répétant le rôle de Marcus, il s’est prêté à l’exercice conçu par Julie Duclos. Il a inventé de toutes pièces une existence à son héros. L’a nourrie à sa sauce, avec de l’amour, des ruptures, des bonheurs, des traumatismes, une famille, des amis, une enfance. Mais il a gardé pour lui ce monologue intérieur. Ce récit sans parole lui sert de colonne vertébrale. Campé à l’écoute de son imaginaire, il s’en remet à son corps pour écrire dans l’espace ce qu’il est en dedans. Le geste est son alphabet, les mouvements sont sa grammaire. Ce processus de construction lui va comme un gant : « Le travail corporel brûle en moi à un endroit plus intime que le théâtre. » Il ne veut s’enfermer dans aucune discipline. Il a l’âge des possibles et des commencements. Hier dirigé par Pascal Rambert (Dreamers), Mohamed El Khatib (Mes parents), Phia Ménard (Fiction Friction), il ignore de quoi demain sera fait. Pour l’heure, il est Marcus, ce « moi imaginaire » qui, en faisant silence dans l’obscurité du théâtre, lui permet, dans la vie, de s’exprimer à haute voix. Kliniken, mise en scène de Julie Duclos. Les Gémeaux, Sceaux (Hauts-de-Seine). Du 12 au 15 avril. De 18 € à 28 €. Les 11 et 12 mai à la Comédie, Reims (Marne). De 6 € à 23 €. Joëlle Gayot Légende photo : Maxime Thébault, à Rennes, en juin 2021. LOUISE QUIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2023 7:06 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 9/05/23 La région présidée par la socialiste Carole Delga maintient ses subventions et entend valoriser « les créations en immersion dans les territoires ».
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/09/en-occitanie-une-politique-culturelle-etablie-dans-la-concertation_6168868_3246.html
Pour faire face à la crise, chacun a sa méthode. Tandis que la région Auvergne-Rhône-Alpes taille à la hache dans ses budgets culture, l’Occitanie opte pour la manière douce. Concertations entre tutelles et artistes, négociations avec les syndicats, ajustements au cas par cas : « Nous ne sommes pas dans une région qui ampute les financements », admet Nicolas Dubourg, président du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). A défaut d’être augmentées, les subventions attribuées par la région présidée par Carole Delga (PS) à ses opérateurs culturels sont maintenues pour l’année 2023. Une décision saluée par les professionnels du spectacle vivant, même si elle est loin de les mettre à l’abri. Entre inflation, revalorisations salariales ou flambée des factures d’énergie, la stabilité des subsides équivaut, en réalité, à une érosion progressive des marges de manœuvre des théâtres. « Nos déficits sont structurels et conjoncturels », explique Nathalie Garraud, codirectrice du Centre dramatique national (CDN) de Montpellier. « Sans refinancement public majeur, nous ne nous en sortirons pas », renchérit Sandrine Mini, directrice de la Scène nationale de Sète (Hérault). « Comment gérer un présent qui s’effondre tout en se projetant, sans visibilité, vers l’avenir ? », insiste Sébastien Bournac, directeur du Théâtre Sorano, à Toulouse. L’équation paraît insoluble au moment où les factures frôlent des niveaux stratosphériques. Au Théâtre de la Cité, à Toulouse (second CDN de l’Occitanie), le codirecteur Stéphane Gil fait l’addition : « Par rapport aux années précédentes, nous payons 200 000 euros de plus pour le gaz, 120 000 pour l’électricité, 11 000 pour l’eau, sans compter l’augmentation de 5 % des salaires : 90 000 euros. » Désir d’assainissement Du côté des collectivités locales, le bilan n’est guère plus brillant. La capacité d’endettement de la région flirte avec le seuil d’alerte. Vice-présidente du conseil régional chargée de la culture, Claire Fita n’accomplira pas de miracles. « Nous préservons le budget culture, mais nous ne serons pas en mesure de répondre au surcroît de sollicitations. Certaines structures exigent une mobilisation immédiate. Pour d’autres, l’urgence est moins évidente. Nous réalisons du sur-mesure. Nous serons très revendicatifs sur la responsabilité de l’Etat par rapport aux augmentations subies par les lieux. » Si le ministère de la culture a débloqué des aides exceptionnelles (3,5 millions d’euros) pour amortir la hausse des fluides, le compte n’y est pas : « Cet apport représente environ 30 % du surcoût », détaille Nathalie Garraud, qui refuse de ponctionner sa marge artistique pour acquitter ses dettes. Et s’interdit d’augmenter le prix des billets. « Une élévation des tarifs se traduirait par un tri des spectateurs, ce qui serait contraire à la notion de service public », analyse Nicolas Dubourg. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le Théâtre national populaire de Villeurbanne, reflet d’une culture publique en crise : « On est au bout d’un modèle » Quels leviers alors activer pour que ces scènes subventionnées ne soient pas contraintes de fermer leurs portes par mesure d’économie ? En Occitanie, l’offensive se partage entre le terrain et les cabinets politiques. Le diagnostic posé par la région a débouché sur un désir d’assainissement. « Face à l’engorgement des créations, aux difficultés de diffusion et au faible nombre de représentations, nous modifions nos accompagnements. Il n’y a plus d’appel annuel à projets mais un appel tous les deux ans. » La méthode devrait permettre, assure Claire Fita, « de mettre fin à un système sclérosé qui entraînait une absence de turn-over entre les compagnies conventionnées ». L’élue ne s’en cache pas : l’objectif est aussi de valoriser « les créations en immersion dans les territoires ». Priorité aux compagnies dont l’action « structurante » se vérifiera en Occitanie et qui sauront prouver qu’elles n’y font pas de la figuration. Moins de spectacles Ce recentrage ne fera pas que des heureux. Il va pourtant dans le sens d’une obsession commune : la rationalisation. Assez peu poétique, le mot convoque des logiques gestionnaires qui se déclinent tous azimuts. A la Scène nationale de Sète, Sandrine Mini s’est résolue à restreindre le nombre de représentations par saison. Cent soixante avant le Covid-19, 110 en 2022-2023, sans doute moins en 2023-2024. La directrice se démène, par ailleurs, pour trouver des ressources en dehors des circuits habituels : « Le club des mécènes est notre troisième financeur. Il arrive devant la région et rapporte, en moyenne, 250 000 euros par an. » Au Théâtre de la Cité, à Toulouse, un plan d’attaque ratisse large : gel de certains recrutements, limitation des durées et des lieux de chauffage, réduction des achats de spectacles et diminution des coréalisations avec les lieux partenaires. « Nous minimisons l’itinérance et le pluridisciplinaire. Nous augmentons le nombre de représentations par projets », annonce Stéphane Gil. Moins de spectacles, mais des durées d’exploitation allongées : si la méthode doit attirer un public élargi, le directeur a toutefois pris soin de prévenir ses tutelles : « Tout le monde doit accepter ce qu’impliquent les longues séries. Après vingt ans d’un théâtre à succès où chacun se gratifiait d’un taux de remplissage à 85 % ou 90 %, nous allons passer à un taux de 60 % ou 70 %. Il s’agit donc d’adopter une nouvelle grille de lecture. » « Nous ne concevons pas de fermer des lieux en difficulté alors qu’ils participent à la dynamique de la ville » - Michaël Delafosse, maire (Parti socialiste) de Montpellier Le volontarisme de la démarche a convaincu la mairie de Toulouse, qui n’a plus l’intention de répondre sans contrepartie aux appels au secours. « Nous aiderons plus spontanément ceux qui se prennent par la main et sont forces de proposition. » Dans le collimateur de l’adjoint à la culture, Francis Grass, les compagnies qui se contenteraient de réclamer des subventions mais ne participeraient pas à l’effort collectif. L’élu a aussi dans son viseur l’Orchestre et le Théâtre du Capitole, dont les activités et les équipements actuellement disséminés sur une dizaine de lieux sont autant de passoires thermiques et de débauche d’essence (de 10 000 à 15 000 litres par an). Un gaspillage auquel la municipalité mettra fin en regroupant les installations dans un espace unique. « Nous ne nous étions pas franchement occupés jusqu’ici du diagnostic énergétique de nos bâtiments », admet Francis Grass. Parce que la crise n’épargne personne, l’exigence d’exemplarité ne tient que si tout le monde est logé à la même enseigne : ce message est implicitement adressé par les tutelles à des responsables de théâtres qui en redoutent les effets pervers. Aujourd’hui solidaires, les collectivités locales ne risquent-elles pas, demain, de se défausser en invoquant l’impératif économique ? A Toulouse, Sébastien Bournac s’inquiète : « Les collectivités nous tiennent un discours très horizontal en répercutant leurs problèmes comme si nous étions sur un pied d’égalité. Or, ce qui est en jeu, c’est l’effondrement du service public. » Une perspective que certains élus oublient, comme en témoignent les sapes opérées en Auvergne-Rhône-Alpes. Mécènes « Il faut tenir ! », s’exclame à l’inverse Michaël Delafosse. Le maire (PS) de Montpellier plaide la cause de l’art : « Nous ne concevons pas de fermer des lieux en difficulté alors qu’ils participent à la dynamique de la ville. Les créateurs doivent être programmés. Nos engagements ne doivent pas être de vaines utopies », poursuit l’élu, qui voudrait faire de sa ville la prochaine capitale européenne de la culture. Il augmente le budget, sollicite les mécènes, mutualise ce qui peut l’être. Ce sera ainsi le cas du Printemps des comédiens, festival dirigé par Jean Varela, et de l’EPIC (établissement public industriel et commercial), deux entités appelées à fusionner sur le Domaine d’O, où elles sont situées. Avoir les pieds sur terre n’empêche pourtant pas Michaël Delafosse d’invoquer la nécessité impérieuse de l’art dans le quotidien de ses administrés : « Dans un monde où Vladimir Poutine a détruit 243 lieux de culture, le devoir des maires est de défendre la culture. Ce choix est plus que jamais politique. » A Perpignan, le maire (Rassemblement national – RN), Louis Aliot, partage-t-il ce sens du devoir ? Tandis que la scène nationale, l’Archipel, attend que soit nommée à sa tête une nouvelle direction, une pétition circule. Elle s’alarme de l’hypothèse d’un choix qui pourrait être imposé par l’équipe municipale, nonobstant l’Etat, qui labellise le lieu. Implanté dans la ville, où il collabore étroitement avec la communauté gitane, Benjamin Barou-Crossman, jeune metteur en scène, lutte pied à pied pour maintenir (avec l’aide financière de la région et du département) un festival de culture gitane. Il refuse de laisser le RN faire et défaire la vie culturelle. La ville est « un no man’s land qui vaut la peine qu’on se batte pour elle », soupire-t-il. Ce qui se joue ici excède les frontières d’une cité, d’un département, d’une région. Il faut tenir. A Perpignan plus que partout ailleurs. Joëlle Gayot

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2023 12:16 PM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 9 avril 2023 Au Théâtre de la Cité Internationale, le comédien s’approprie avec aisance et panache le magnifique roman de Valérian Guillaume, où un homme, enfermé dans sa solitude et fasciné par la société de consommation, se laisse dévorer par ses pulsions. Qu’attend-il cet homme, assis, là, sous un abribus ? Un autocar qui ne viendra jamais ? Un moyen d’échapper à sa vie ? Ou plutôt à se délester de son histoire, à recracher ses mots et ses maux, avant d’embarquer pour un aller simple vers sa dernière destination ? Juste au-dessus de lui, un panneau lumineux indique modestement « Les Ruisseaux d’Or ». Une appellation commune, tristement banale, qui pourrait aussi bien correspondre au nom d’un arrêt de bus qu’à celui d’un centre commercial, où le roman de Valérian Guillaume, Nul si découvert, prend le plus souvent ses quartiers. Conçue par James Brandily, cette scénographie instaure, d’entrée de jeu, un univers inquiétant à mi-chemin entre le théâtre de Koltès et celui de Beckett, où, dans un purgatoire qui, à la fois, ouvre et ferme le champ des possibles, le monde et ses excès s’apprêtent à dévorer les individus. À moins que ce ne soit déjà le cas. Habillé en survêtement, l’homme a l’allure d’un quidam, comme on en croise au quotidien, apparemment bien sous tous rapports. Ses journées, il les passe la plupart du temps au « Grand Centre » qu’on devine non loin de chez lui. Après une halte au Corner, le bar de Martine, où il s’enquille quelques verres, il se plaît à déambuler dans les allées de ce temple de la consommation, à regarder les téléphones chez SFR, les bijoux chez Claire’s, les perceuses chez Leroy Merlin, les crèmes chez Yves Rocher, avant d’atterrir chez Flunch où, à travers son regard, le déjeuner steak-frites ressemblerait presque à celui de La Tour d’Argent. De boutique en boutique, il participe à toutes les animations possibles, à la matinée mexicaine chez Carrefour, au jeu du caddie-contre-la-montre, avec, toujours, cet engouement qui, dans un premier temps, le rend attachant. Et puis, par petites touches, comme autant d’indices semés çà et là par Valérian Guillaume, tout se dérègle, et s’obscurcit. Il y a, d’abord, cet attrait malsain pour la palpation exécutée par les vigiles, cet enthousiasme excessif qui peut, soudainement, se transformer en colère noire, cette tendance à la sur-consommation de tout et n’importe quoi, et, surtout, ce coup de cœur pour Leslie, la caissière du centre aquatique LaBaleine qui, rapidement, tourne à l’obsession et traduit un mal-être beaucoup plus profond. Longue phrase sans interruption, ni ponctuation, le roman de Valérian Guillaume est construit à la manière d’un flux de conscience, d’un flot continu de paroles et de pensées qui, peu à peu, fait dériver son géniteur en même temps qu’il le dévoile. Malgré sa forme condensée, l’adaptation scénique concoctée par Baudouin Woehl et l’auteur lui-même parvient à conserver la finesse originelle de la langue et de la dramaturgie. À la manière d’un tableau pointilliste, tout n’est affaire que de détails, de soubresauts, de virages qui, par leur accumulation, emporte le personnage vers l’abîme. Enfermé dans son ultra-moderne solitude – « Pourquoi je n’ai pas le droit à l’amour et aux choses belles », se désespère-t-il dans un ultime déchirement –, aveuglé par les lumières du consumérisme, victime de la cruauté de ses semblables, il devient une créature à part, rongée de l’intérieur par un « démon » aux visages multiples. Boulimique, schizophrénique, érotomane, vecteur d’hypersexualisation, il transforme les êtres, les gestes et les objets – y compris les touches d’un distributeur de billets – en biens prêts à absorber pour combler un vide intérieur, alors qu’il ne s’agit, en réalité, que d’une illusion, d’une fausse promesse de la société de consommation. Sur cet homme aux reliefs escarpés, Valérian Guillaume ne porte d’ailleurs jamais de jugement, ce qui fait tout le sel, la sensibilité et la beauté de ce portrait. Les dérèglements intimes de son personnage, l’auteur et metteur en scène les relient à son environnement qu’il tient, avec justesse, pour responsable. Traduits scénographiquement dans les lumières de William Lambert, et surtout dans la création vidéo de Pierre Nouvel qui semble progressivement parasitée, avant de prendre le relais de l’homme, incapable, par « honte », de poursuivre son récit, ils le sont tout autant dans le jeu d’Olivier Martin-Salvan. Avec l’aisance qu’on lui connaît, le comédien s’approprie cet individu, qu’il investit avec un morceau de lui-même, à commencer par son goût prononcé pour le comique. Il renforce alors sa bonhommie naturelle, son côté naïf, voire grotesque, et même un brin clownesque, qui, par ses excès, ouvre les portes de la folie, sans jamais tout à fait les franchir. Gorgée d’humanité, sa performance se fait encore plus intense lorsque le rire des débuts laisse place à l’inquiétude, et même à une certaine forme de stupeur, qu’il ne surjoue jamais, mais accompagne seulement grâce à la force de son jeu. À l’image de la simplicité bouleversante de cet homme qui, avant d’être un bourreau, s’impose comme une victime inconsciente de la société de consommation. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Nul si découvert
Texte et mise en scène Valérian Guillaume
Avec Olivier Martin-Salvan
Adaptation et dramaturgie Valérian Guillaume et Baudouin Woehl, d’après le roman de Valérian Guillaume publié aux Éditions de L’Olivier (2020)
Scénographie James Brandily
Composition musicale Victor Pavel
Vidéo Pierre Nouvel
Lumière William Lambert
Costumes Nathalie Saulnier
Construction du décor ARTOM – Thomas Ramon et Olivier Dupont
Assistante à la scénographie Lisa Notarangelo
Assistant à la mise en scène Nans Ballarin Production déléguée compagnie Désirades
Coproduction Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Théâtre Sorano, scène conventionnée (Toulouse) et Le Vent des Signes (Toulouse) ; Le ScénOgraph, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création – Art en territoire (Saint-Céré)
Avec le soutien d’Artcena au titre de l’aide à la production, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’aide au projet, du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD – PSL) dans le cadre du dispositif SACRe (Sciences Arts Création Recherche), de l’Onda – Office national de diffusion artistique, et la participation du Jeune théâtre national Le roman Nul si découvert est lauréat de l’aide nationale à la création de textes dramatiques Artcena (mai 2019). Valérian Guillaume a bénéficié d’une résidence d’écriture à La Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle. Il est artiste en résidence de création et d’action artistique de 2023 à 2025 au Théâtre de la Cité Internationale, action financée par la Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle. Durée : 1h20 Théâtre de la Cité Internationale, Paris
du 7 au 18 avril 2023 L’arc, scène nationale, Le Creusot
le 27 avril Théâtre Sorano, scène conventionnée, Toulouse
les 30 mai et 1er juin Festival de Figeac
le 25 juillet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2023 8:34 AM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog 6/04/23 Avec fantaisie, humour et poésie, le collectif belge a imaginé un spectacle drôle et attachant en quatre-vingt-dix minutes, librement inspiré du roman La Montagne magique de Thomas Mann mais remis dans un contexte actuel. à l’instar de Hanz Castorp, Andréas débarque après un long voyage en train dans une auberge campagnarde entourée d’un jardin rendu à l’état sauvage au milieu d’une prairie. Il y restera un temps indéfini. Là, retranchés du monde séjournent des gens dont on ne sait rien et qui se livrent à des activités futiles : tir à l’arc, lancer de pierres depuis le viaduc, excursion au bord du lac, contemplation des étoiles, cuisine ou menues réparations et travaux d’aménagement. On y forge aussi des récits imaginaires, on a des conversations philosophiques et on y croise Gürkan, un énigmatique écrivain qui peine à finir un roman. « C’est un drôle d’endroit, pas particulièrement bucolique », écrit Andréas à un ami, dans une lettre qu’il n’enverra jamais. «Tout le monde ici est positivement gentil mais tout semble difficile à comprendre.» Déstabilisé par la façon de penser et de vivre qu’ont ses habitants, le nouveau venu s’adaptera à la banalité d’un quotidien sans aspérités. Au point que le monde extérieur s’estompe. « Vous faites quoi dans la vie?», semble être une question saugrenue dans ce lieu où se dessine une utopie joyeuse. Mais on n’y oublie pas la violence du monde. Andréas la rencontre en arrivant sous forme de quatre grands tableaux d’un peintre anonyme de la Renaissance, ornant les murs de l’entrée. Ce polyptyque représente la bataille de Cajamarca au Pérou en 1532. menés par Francisco Pizzaro cent soixante-huit conquistadors espagnols assoiffés d’or massacrèrent dans une embuscade des milliers d’Incas et capturèrent leur empereur Atahualpa. «Le récit de cette bataille sanglante nous est apparu comme un récit archétypal de la construction de notre Europe moderne, dit Benoît Piret. Nous avons aimé être saisis d’emblée par cette violence constitutive de notre monde.» Les Incas, pour la petite communauté, représentent un âge d’or, symbolisé par cette fresque monumentale. Leur point de vue peut se résumer par la formule paradoxale qui clôt le roman de Gürkan, enfin terminé : «Gloire aux vaincus.» Car, selon la pièce, les perdants ont des ruses pour survivre et préserver leur culture: ainsi, les Perses, vaincus par les Mongols, avaient tissé des tapis, à l’image de leurs jardins détruits par les envahisseurs. Le temps semble suspendu dans ce camp retranché et la représentation se distend. Comme Andréas, le public se laisse couler dans un climat lisse et bienveillant mais ne s’ennuie pas. Il pénètre avec le héros, dans une espèce de zone à défendre (Z.A.D.) mentale, où l’on peut poétiser, philosopher, inventer d’autres formes sociales et réécrire l’Histoire dans le bon sens, sans pour autant l’oublier. «Nous avons travaillé à la construction d’un lieu autre, une hétérotopie comme la définit Michel Foucault : un espace concret abritant l’imaginaire et des lieux qui, à l’intérieur d’une société, obéissent à d’autres règles. » Aucun décor. Avec quelques accessoires, Éléna Doratiotto et Benoît Piret, avec Salin Djaferi, Jules Puibaraud, Gaëtan Lejeune et Anne-Sophie Sterk, donnent matière à ce lieu par la seule force des mots et nous font ainsi voir la bataille de Cajamarca en décrivant avec force détails, ces tableaux qui prennent alors forme et couleur dans notre imaginaire. De même, nous “voyons“ le jardin, sans images ou vidéos à l’appui. Et les personnages se dessinent au fur et à mesure dans un esprit joyeux et polémique, emprunté à la banalyse, un mouvement initié en 1982 par des universitaires rennais : Yves Hélias et Pierre Bazantay. Avec à l’origine, une seule activité : attendre d’éventuels congressistes en gare des Fades, une gare perdue dans le Puy-de-Dôme, « au risque de l’ennui et de perdre son temps par la libre confrontation au banal».
Retrouver cet humour au théâtre fait du bien…. Mireille Davidovici Jusqu’au 31 avril, Théâtre de la Bastille, 79 rue de la Roquette, Paris (XI ème) T. : 01 43 57 42

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2023 10:09 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 7/04/2023 Le lundi, jour de relâche, lorsqu’il ne joue pas dans l’« Othello» de son ami Jean-François Sivadier, Cyril Bothorel retrouve son complice Yann-Joël Collin qui le met en scène dans un entrelacs de textes signés Francis Ponge, à commencer par « Le verre d’eau ». On le vérifie une fois encore, Bothorel est un grand acteur et Ponge un grand écrivain qui désaltère, dans la joie, la langue française. Cyril Bothorel est un grand acteur (hauteur et talent rivalisant sous la toise et l’applaudimètre), le voici seul en scène dialoguant avec Francis Ponge. D’emblée il nous cueille, c’est éblouissant et cela le restera jusqu’au bout. A l’avant-dernier paragraphe de Pour un Malherbe (sublime livre de Ponge comme les autres), l'écrivain écrit: « le grand art est de prendre le lecteur de plain-pied (sans qu’il s’en aperçoive et s’effraye) et de l’enlever aussitôt ». Et il poursuit : « L’attaque a donc une grande importance. Le saisissement doit être immédiat et l’enlèvement réel : il ne faut pas que le lecteur bute, bronche, s’effraye, hésite, ait l’impression non peut-être de ne pas comprendre mais de n’être pas compris, concerné ». Remplacez lecteur par spectateur et c’est exactement ce qui se passe chaque lundi soir sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche. Bothorel nous chauffe par une série de menus plaisirs comme Les plaisirs de la porte , l’un des textes du recueil le plus célèbre de Ponge (en poche et en vente au théâtre) : Le part pris des choses. L’un des textes de ce recueil, De l’eau, annonce Le verre d’eau, texte beaucoup plus conséquent. Comme d’autres textes de Ponge tels La Fabrique du pré (collection Les sentiers de la création chez Skira) ou La table ou encore Le savon (les deux chez Gallimard comme ses autres livres), Le verre d’eau avance non seulement en ne cachant rien de sa fabrication, mais constitue cette dernière comme chemin de l’écriture. Le verre d’eau figure dans Le grand recueil (second de trois volumes) entre Le porte plume d’Alger et diverses Fables logiques, soit 55 pages. Après une première note ancienne, le texte est écrit entre le 9 mars et le 4 septembre 1948. « Voici un sujet dont il est par définition difficile de dire grand-chose. Il interrompt plutôt le discours. Cela est admis par l’auditoire. Je veux parler du verre d’eau du conférencier, qui ressemble à celui du condamné à mort, un peu comme son contraire » note Ponge le 14 mars. Le lendemain, il poursuit : « L’eau (qu’il contient) ne change presque rien au verre, et le verre (où elle est) ne change rien à l’eau. C’est que les deux matières ont plusieurs qualités communes, qui leur font une sorte de parenté .» Le 16 mars : « Si les diamants sont dits d’une belle eau, de quelle eau donc dire l’eau de mon verre ? Comment qualifier cette fleur sans pareille ? -Potable ? » Le 28 mars : « Fraîcheur je te tiens. Liquidité, je te tiens. Limpidité, je te tiens. ». Quel bonheur pour un acteur comme le grand Bothorel de ce saisir de ce texte et de mettre en scène sa jubilation qui nous contamine. D’autant que l'acteur ne se contente pas de réciter, surtout pas, il entre dans une sorte de corps à corps avec les mots. Diablement contaminant lui aussi. En bonus, vous aurez le droit pour finir à La serviette éponge, bijou pongien s'il en est, serviette qui, celle chez l’acteur comme chez le boxeur, le math fini, vient enserrer sa nuque et caresser la glotte, comme une couronne accrochée au sourire du vainqueur. Théâtre de la reine blanche, tous les lundis à 19h, jusqu’au 24 avril. https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/le-verre-d-eau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2023 5:41 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 6/04/23 Inconnus, débutants et grands noms du théâtre nourrissent la programmation de la première édition du directeur Tiago Rodrigues qui tient à renouer avec une manifestation populaire et en finir avec «l’obsession de l’exclusivité». On ira tous à Avignon et on fera des tonnes de découvertes ! On ira à Avignon même si on refuse de découvrir de nouveaux artistes car les plus grands noms du théâtre mondial y sont également invités. Et on ira à Avignon même si on n’y a jamais mis les pieds, car le directeur Tiago Rodrigues et son équipe, qui présentait le 5 avril le programme de cette première édition en conférence de presse, ont mis au point un dispositif «première fois» pour accueillir ceux qui n’y sont jamais allés, qui n’a rien d’un gadget. Non seulement il y aura 12 000 places supplémentaires en vente par rapport aux éditions précédentes – le nombre de représentation par spectacle étant plus élevé – mais l’équipe du festival organise le voyage de 5 000 jeunes de 13 à 18 ans, en les logeant, les accompagnant, leur offrant de (bonnes) places, leur faisant rencontrer des artistes. Ou comment renouer avec un festival populaire selon le vœu et la réussite de son fondateur, Jean Vilar. Ouvertures toutes : c’est ce qui ressort lorsqu’on regarde le riche et enthousiasmant programme de cette première édition, structurée autour d’une langue invitée, l’anglais. Un peu de données chiffrées ne nuisent pas : Tiago Rodrigues, très en forme, a construit une édition riche en création – 33 sur les 44 spectacles présentés dont 16 premières mondiales – et 55 % des spectacles sont portés ou co-portés par des femmes. Selon le directeur du festival d’Avignon, la bonne nouvelle est que l’équipe n’a pas eu besoin de chercher la parité, celle-ci s’est imposée sans effort et elle n’est apparue qu’à la fin. C’est d’ailleurs Julie Deliquet, directrice du Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui ouvrira le bal dans la cour d’honneur du palais des Papes en signant une adaptation très personnelle de Welfare, d’après le film de Frédérick Wiseman paru en 1973. Une adaptation de nos jours, risquée et attirante : Julie Deliquet a pour particularité de ne jamais fixer le texte né d’un travail d’improvisation. Inconnus, débutants et grands noms Bonne nouvelle encore : près de 75 % des artistes invités viendront cet été pour la première fois à Avignon, et beaucoup d’entre eux n’ont même jamais été montrés en France ! Le festival offrira donc l’occasion de voir enfin des artistes archi repérés dans leur pays et qui travaillent depuis une bonne trentaine d’années, tel Tim Crouch en Angleterre, qui proposera deux spectacles, ou encore les Américains John Collins et Greig Sargeant du collectif Elevator Repair Service, passés totalement sous les radars chez nous. Parmi les grands inconnus, relevons aussi la présence du collectif espagnol Mal Pelo, très identifié en Europe mais curieusement pas en France. Et les artistes plus débutants et qui ne connaissent pas Avignon, son festival et ses coutumes, n’ont pas non plus été oubliés par l’équipe défricheuse. Parmi les nouveaux venus, citons au hasard l’activiste-actrice-autrice-metteuse en scène d’origine anichinabé Emilie Monnet et sa Marguerite : le feu, d’après l’histoire de Marguerite Duplessis, première esclave noire à revendiquer ses droits face au tribunal de Québec. Les grands noms de renommée internationale maintes fois coutumiers de l’été avignonnais sont de la fête : cela fuitait depuis l’hiver, le grand metteur en scène polonais Krystian Lupa présentera bien sa version des Emigrants d’après le livre culte de Sebald, tandis que Milo Rau revisitera la figure d’Antigone en Amazonie, sans-terre parmi les sans-terre. Philippe Quesne est de retour lui aussi avec le Jardin des délices, variation autour de Jérôme Bosch dans un lieu réouvert, la carrière de Boulbon. Julien Gosselin montrera Extinctions d’après Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler, qu’il aura auparavant créé en juin à un jet de pierre des remparts au Printemps des comédiens, tout comme la chorégraphe Mathilde Monnier fêtera son retour avignonnais en présentant Black Lights, montré auparavant à Montpellier danse. Représenter un spectacle phare C’est suffisamment rare pour qu’on le répète, l’explicite et même l’écrive en gras : «On ne regarde plus les autres festivals comme des rivaux, on considère qu’on a suffisamment d’inédits pour en finir avec l’obsession de l’exclusivité. Elle ne peut pas se substituer à des principes plus forts comme l’écoresponsabilité», explique Tiago Rodrigues. Il développe : «Ainsi accompagne-t-on mieux les artistes et leurs créations au bénéfice du public tout en veillant à la cohérence des tournées, de manière à faire baisser les émissions carbones qu’elles génèrent.» Autre bonne idée – mais on ne parvient plus à les comptabiliser : représenter chaque année un spectacle phare d’une édition précédente. Cette année, le choix se porte sur En attendant d’Anne Teresa de Keersmaeker, que la chorégraphe avait créé à Avignon en 2010. La chorégraphe et danseuse flamande est l’une des figures marquantes de cette 77e édition où le public découvrira également sa dernière œuvre, Walking Songs. De manière inattendue, Avignon sera également le lieu où il sera possible de voir ou revoir des spectacles de jeunes artistes tels Rébecca Chaillon et sa Carte noire nommée désir, mais que la nouvelle équipe du Festival d’Avignon juge qu’ils n’ont pas été assez vus. En finir avec le culte ou la culture de l’exclusivité, vient-on de vous dire. A-t-on oublié des gens ? Oui, quasi-tout le monde. David Bowie et Lou Reed ressusciteront avec des albums de 1970, et David Geselson, artiste bien aimé à Libération, est de la partie, pour faire renaître des traces antédiluviennes avec Néandertal. Légende photo : Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon, à Paris, le 17 septembre 2022. (Iorgis Matyassy/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 5, 2023 7:42 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hotello - 28/03/23 L’Amour et les forêts, mise en scène de Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des Bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traductions d’André Markowicz et Françoise Morvan, et les films réalisés par Anna Darcueil, création et régie lumière Sébastien De Jésus, costumes Lucie Duranteau, scénographie Nicolas Fleury, au CNSAD-PSL. Avec Chara Afouhouye, Vincent Alexandre, Chloé Besson, Théo Delezenne, Hermine Dos Santos, Ryad Ferrad, Myriam Fichter, Mikaël-Don Giancarli, Eva Lallier Juan, Shekina Mangatalle-Carey, Basile Sommermeyer, Padrig Vion, Clyde Yeguete. A l’écran, Alexandre Gonin, Tom Menanteau, Ava Baya, Zoé Van Herck, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard.
L’Amour et les forêts, écrit Claire Lasne Darcueil, metteuse en scène et directrice en fin de mandat du CNSAD-PSL – Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique -, est un spectacle né d’un accident, de l’annulation d’un autre, dans les périodes tourmentées et inédites du Covid et post-Covid. Un spectacle qui s’est construit avec l’atelier d’élèves de 3è année, par petits morceaux de répétitions, rejoint par les anges protecteurs d’une promotion autre, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard. « Le hasard permet parfois d’aller à l’essentiel: partir librement dans toutes les langues et chemins possibles, à la recherche d’Anton Tchekhov, de ces deux versions d’un même texte que sont L’Homme des Bois et Oncle Vania, c’est faire ensemble le rêve de soigner le monde, de rester des enfants amoureux du théâtre et du cinéma, dont la découverte est contemporaine de son écriture, et de devenir capable d’aimer. » Le chemin de Claire Lasne Darcueil vers Anton Tchekhov a commencé en 1996, « main dans la main avec André Markowicz et Françoise Morvan », avant de mettre en scène L’Homme des Bois en 2002, spectacle festif sous chapiteau avec l’équipe du temps d’amis inoubliables. Le voyage dans le temps, cette quête de l’écriture tchekhovienne, vingt ans plus tard, suit avec la même constance et patience intenses la recherche infinie de l’amour et des forêts – « un risible mais sincère désir de sauver le monde et soi-même avec lui ». Et être capable d’aimer, en dépit de tout. Dix années au moins s’écoulent entre la rédaction de L’Homme des Bois en 1889, considérée comme la première version d’Oncle Vania, et la mise en scène de celle-ci au Théâtre d’Art en 1899, soit la réécriture d’un vaudeville volubile en un drame psychologique et métaphysique tendu. « L’effet Vania, c’est ce mélange de distance ironique, de tendresse désabusée, de vulnérabilité cachée que Vania et le spectateur partagent, l’espace d’une représentation. » (Patrice Pavis). L’écriture – élaboration conceptuelle et graphie mécanique – s’invite sur la scène avec ses deux machines à écrire sonores, côté cour et côté jardin, que les compositeurs sollicitent alternativement : « Non, c’est pas ça ! », résonne sur la scène, rappel de Nina dans La Mouette qui rejoue devant Treplev le rôle endossé des années auparavant dans sa belle jeunesse innocente. On entend des bribes de lettres de Tchekhov adressées à Olga Knipper, et de celle-ci à celui-là, amante et actrice qui retrace le rôle d’Elena porté dans L’Homme des Bois en 1899, à moins que ce ne soient les souvenirs mêmes de la metteuse en scène Claire Lasne Darcueil, en 1999. Un chassé-croisé d’impressions et de sensations, entre vie intime passée et renaissante toujours, présente à vie. Avec pour décor, les pianos mélancoliques soutenant sur des draps blancs des chandeliers aux bougies tremblantes, un éclairage du temps qui ajoute sa patine dorée à l’atmosphère romantique, donnant de la lumière aux portes battantes et fenêtres vitrées dans le lointain, alors que l’on cogne fort aux portes de bois, appelant quelqu’un, le sollicitant : l’être aimé auquel on n’ose se déclarer. Les scènes sont re-jouées – répétition et variation -, par les comédiens qui se ressaisissent du rôle en alternance, selon leur tempérament qui va de la mesure à la démesure, comme il sied à la jeunesse. Et l’écran offre des scènes filmées significatives du bonheur d’être chez des jeunes gens qui fêtent un anniversaire, en palabrant sur leurs soucis actuels et un désir in-abouti d’agir. Des scènes qu’on croirait tirées d’un film en noir et blanc, Les Tricheurs (1958)de Marcel Carné, figures dessinées de lumière pour des vies qui s’épanouissent et se sentent empêchées déjà. Des scènes burlesques et comiques à la Chaplin ou Buster Keaton, avec petit homme facétieux au chapeau melon et vêtu de noir s‘amusant du drap de l’écran, mimant les petits pas, les situations des personnages et les accompagnant de sa compassion. Un rappel aussi des Ailes du désir (1987) de Wim Wenders avec son ange annonciateur blanc et ailé. La belle Elena figure l’ennui, la paresse, le désœuvrement, l’amour – objet de convoitise – qu’elle provoque chez les autres : Astrov, protecteur des forêts, la figure avant-gardiste d’une écologie engagée et active; Vania aussi qui ne se défend pas de son attirance pour la jeune femme du vieux professeur Serebriakov qui l’agace. La tonique Sonia, héritière du domaine et nièce de Vania, résiste sans aménité à Elena : elle est amoureuse, de son côté, du talentueux Astrov qui ne la voit pas. Lumineuse vision nostalgique d’un monde perdu qui renaît des cendres mêmes de la jeunesse, à travers le plurilinguisme – arabe, français, espagnol, créole – et le désir universel de se sentir vivre, malgré les petits arrangements de l’existence. Véronique Hotte Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars à 19h, relâche le 30 mars, le 1er avril à 18h, le 2 avril à 15h au CNSAD-PSL 2 bis, rue du Conservatoire 75009 – Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2023 5:38 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - Publié le 04/04/23
Le metteur en scène décortique finement les enjeux politiques, médiatiques et sociétaux de l’histoire du voile à la crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes, qui ont eu lieu entre 2008 et 2014.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/04/avec-la-creche-mecanique-d-un-conflit-au-tgp-de-saint-denis-francois-hien-s-empare-d-une-affaire-nationale-autour-de-la-laicite_6168262_3246.html
Jackpot au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, qui aligne coup sur coup deux propositions passionnantes. Un sacre, de Lorraine de Sagazan. Et, depuis le 31 mars, La Crèche : mécanique d’un conflit. Son auteur et metteur en scène, François Hien, est de ceux qui donnent envie de croire à un théâtre populaire et de qualité. Agile, subtil, ambitieux, mais pas prétentieux, son spectacle saute hors du rang des certitudes en imposant un temps de cogitation collective où la nuance tient la dragée haute aux clichés réducteurs. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Lorraine de Sagazan célèbre le « sacre » de la mort et de la vie Dans la petite salle du TGP, deux gradins de spectateurs se regardent. Au centre, le plateau où a lieu la représentation. Sur cette scène nue, des éléments de décor (un bureau, des poufs, des chaises) surgissent du hors-champ avant d’y repartir fissa. Ils sont apportés, installés et déménagés par neuf jeunes actrices épatantes. Enfin, il y a le texte de François Hien, qui déplie, sans jamais les juger, les enjeux d’un conflit : le licenciement d’une directrice adjointe de crèche parce qu’elle souhaitait porter son voile au travail. Cette histoire a eu lieu entre 2008 et 2014, dans les Yvelines. Elle est donc bien réelle. La crèche se nommait Baby-Loup. Mais la représentation, elle, est une fiction qui ne prétend pas détenir la vérité. François Hien, 41 ans, ancien documentariste, s’est formé à l’art du montage. D’où le rythme impeccable de La Crèche, qui, malgré sa durée – trois heures avec entracte – et son début un peu laborieux, ne connaît pas de temps mort. Le metteur en scène ne livre pas une œuvre refermée sur elle-même. Il jette sur le plateau la mise en forme de faits et la possibilité pour chacun d’y réfléchir. Avec une simplicité confondante (à l’évidence, le résultat d’une intense préparation), il détricote les fils d’un dilemme né dans l’intimité d’un face-à-face et qui circule de main en main jusqu’à devenir une affaire nationale. Processus d’une dérive Après une absence de cinq ans pour congé parental, Yasmina (Saffiya Laabab) souhaite retrouver son poste dans la crèche dont elle était directrice adjointe. Problème : elle exige de garder son voile. Francisca (Estelle Clément-Bealem), directrice de cette structure associative bâtie au cœur des cités de la ville, refuse. Le règlement intérieur impose la neutralité confessionnelle et idéologique. L’affrontement s’envenime jusqu’à échapper aux deux femmes. Les mères des enfants s’en emparent, le voisinage s’en saisit, les avocats s’en mêlent. Ensuite déboulent la presse et les politiques, talonnés par le cortège de l’opinion, du fantasme, des préjugés, des dialogues de sourds et des hurlements agressifs. Implacable mécanique, dont l’issue ne se fait pas attendre : en lieu et place de la modération, on assiste au retour de la rigidité, de la binarité et des pensées toutes faites qui ne savent plus s’écouter. Sauf que, sur le plateau, la représentation prend le temps de mettre à plat ces nœuds épidermiques sans dévier de son cap. Plutôt que d’inciter le public à prendre parti en prenant elle-même position, elle décrypte le processus d’une dérive : celle qui métamorphose une divergence de vues en véritable impasse idéologique. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Baby-Loup : la Cour de cassation confirme le licenciement de la salariée voilée Il faut peu de chose pour échauffer les esprits lorsque est abordé le thème épineux de la laïcité. Les raisons de s’enflammer sont avancées une à une au gré de dialogues animés. Islamophobie, discrimination, féminisme, radicalisation, émancipation : pas un sujet ne manque. Mais François Hien passe habilement au large de l’ornière « pour ou contre » en s’arrimant à son fil d’Ariane : la singularité des êtres. Sur scène, au-delà des généralités, ce sont les personnes qui l’emportent. Ce qui veut dire que la présence, l’intelligence et la clarté des actrices nourrissent à 100 % la justesse du spectacle. Elles sont neuf à donner corps aux dizaines de personnages ayant été emportés dans cet imbroglio juridique, médiatique et politique : employées de crèche, mécène de l’association, familles des bébés, policiers, avocats, maires ou journalistes. Troquant la jupe pour le pantalon, enfilant veste, chemise, sweat, le cheveu voilé ou ébouriffé, les actrices progressent à mots précis et à pas résolus dans les étapes du conflit. Elles sont à l’unisson, mais ne s’amalgament pas. Celles dont le jeu est campé et solide tirent leurs camarades plus fragiles vers le haut. On les écoute toutes, et toutes sont attachantes. Avec La Crèche : mécanique d’un conflit, François Hien ne bouleverse pas l’esthétique et ne révolutionne pas l’art de la mise en scène. En revanche, il rejoint le clan des artistes qui, au théâtre, veulent (et savent) élever les débats. Ce qui est tout sauf un détail. La Crèche : mécanique d’un conflit, de François Hien. Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules-Guesde, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Jusqu’au 16 avril. De 6 € à 23 € Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : « La Crèche : mécanique d’un conflit », de François Hien, au TNP-Villeurbanne, le 16 février 2023. Photo : JULIETTE PARISOT

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2023 4:10 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 24 mars 2023 Dans la grande salle de La Scala Paris se joue «En attendant Godot », magnifique mise en scène par Alain Françon de la pièce phare de Beckett dans sa version ultime. Dans la petite salle, le maître Françon nous convie à un rendez-vous plus intime avec « Premier amour » (1946), œuvre de jeunesse du génie irlandais fortement autobiographique. Pour incarner le narrateur de cette nouvelle, aussi insolente que déroutante, il a joué d'audace en sollicitant une femme : une grande dame du théâtre, Dominique Valadié, son épouse.
La comédienne surdouée campe avec brio cet homme en bout de course, trouvant la paix dans les cimetières, qui se remémore le seul amour fugace de son existence, vécu à l'âge de 25 ans. Cheveux ramassés en chignon, vêtue d'un ensemble noir austère, l'actrice donne un supplément d'ironie et de diablerie à cet antihéros misogyne et misanthrope, qui fuit la compagnie des vivants. Chaque mot, prononcé avec une clarté gourmande, provoque le rire ou le trouble.
Les flèches du jeune Beckett piquent l'esprit sans discontinuer. Dominique Valadié incarne, au-delà du genre, l'homme universel, terrassé autant qu'amusé, voire enivré par l'absurdité du monde. Jamais évanescente, elle confère une dimension charnelle, concrète à ce monologue mêlant souvenirs - la mort du père, l'éviction de la maison familiale, la rencontre avec la jeune femme « tenace » sur un banc, son installation chez elle, puis sa fuite - et réflexions débridées, tour à tour prosaïques et philosophiques. Absence au monde Badine dans les séquences provocatrices, acides, morbides et scatologiques du texte, la comédienne nous cueille à froid quand elle exprime avec une fulgurante gravité l'absence au monde de son personnage. Semblant s'être échappée de toutes les passions, elle s'embrase, soudain rattrapée par l'émotion, quand elle évoque la splendeur de la montagne aperçue par la fenêtre ou qu'elle décrit la rupture déchirante avec la femme trop peu aimée, alors qu'elle vient d'accoucher de leur enfant. Silhouette élégante se détachant sur une discrète toile bleu gris, Dominique Valadié concilie tous les contraires d'un texte qui oscille entre désir de mort et chant de vie, burlesque et tragédie, soif et absence d'amour. Econome de ses gestes elle surfe sur le fil d'une insoutenable légèreté. Ce soir, à La Scala Paris, Beckett est une femme. PREMIER AMOUR de Samuel Beckett Réalisation de Dominique Valadié et Alain Françon La Scala Paris, lascala-paris.fr jusqu'au 19 avril durée : 1 h 15 Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Dominique Valadié se plongeant dans la lecture de « Premier amour » (@ Thomas O'Brien)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 3, 2023 6:38 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 02/04/23 Pièce écrite pour les comédiens et élèves du TNS à la demande de Stanislas Nordey, Pascal Rambert signe « Mon absente » autour d’une mère morte. Fils, fille, petits-enfants et autres s’y reflètent. Rambert fait du Rambert, Quand il s’éloigne de ses terres, cela s’embourbe. Rambert aime les actrices, les acteurs et c’est réciproque. Tout baigne. Il y a quelques années, Stanislas Nordey, directeur du Théâtre National de Strasbourg, avait proposé à Pascal Rambert, l’un des auteurs associés au TNS, d’écrire une pièce pour les actrices et acteurs associés, et ce, avant qu’il ne parte de la direction du théâtre qu’il aura extraordinairement dirigé pendant plusieurs mandats. Comme Rambert aime particulièrement écrire pour les actrices et les acteurs (il avait pensé à Stanislas Nordey et Audrey Bonnet en écrivant Clôture de l’amour, très belle pièce traduite en de nombreuses langues), il n’allait pas dire non à une telle proposition. Rambert a choisi cinq des actrices et acteurs associés au TNS ; Audrey Bonnet qu’il connaît plus que bien et d’autres pour lesquels il n’avait jamais écrit : Vincent Dissez, Claude Duparfait et Laurent Sauvage, et, bien sûr, l'acteur Stanislas Nordey. La distribution comprend également des anciens élèves du groupe 44du TNS avec lesquels Rambert a avait déjà monté un spectacle : Océane Caïraty, Houédo Dieu-Donné Parfait Dossa,Yanis Padonou, Mélody Pini, Claire Toubin . Mata Gabin, venue d’ailleurs, complète la distribution. Onze personnages. Chaque actrice et chaque acteur a donné son prénom au personnage interprété. Au départ, Rambert pensait partir de Véronique Nordey, la mère de Stanislas Nordey (Stan dans la pièce), actrice et professeur de théâtre renommée, disparue il y a quelques années. Il s’en est éloigné : reste une morte. Celle de la pièce , titrée Mon absente, écrivait des livres avec des héroïnes femmes et plutôt féministes (on pense vaguement à Duras ou Wittig), elle a vécu entourée de ses enfants et des enfants de ces enfants, les pères (la mère a eu deux maris) semblent loin, inexistants. En revanche, Rambert nous apprend que le grand-père de Stanislas Nordey était noir (comme l’arrière grand-père de Pouchkine), ce qui orientera la fiction vers une coloration en partie africaine. Tout se passe aujourd’hui (les portables bipent, envoient et reçoivent des sms) autour du cercueil entouré de fleurs de la mère dont les propos reviennent dans la bouche de certains de ses enfants. Il y a là ses fils : Laurent « le préféré », un peu rebelle, un peu paumé et complètement fauché; Stan « le petit affectueux » devenu ornithologue il vit sur une île pelée et, malade, marche avec une canne ; Claude, le moins disant, le plus vieux jeu ; Houedo surnommé « le petit sensible », Vincent « l’aimé », le petit dernier qui porte une robe et l’ôtant dansera nu devant le cercueil de sa mère ; enfin l’unique fille Audrey aux nerfs fragiles, amoureuse des oiseaux, elle écrit des poèmes et, à la fin, s’est beaucoup occupée de sa mère incontinente, lui essuyant sa merde, la faisant manger. Il y a là les enfants des enfants. i Claire, la fille de Claude (elle n’aime guère son père, est une grande lectrice des livres féministes de la morte) et sa compagne Ysanis (couple de filles ce qui insupporte Claude); Océane, la fille de Stan (« Oui tu es comme elle, nous reproduisons nous reproduisons à l’infini les mêmes schémas toi tu laisses ta fille tu as laissé ta fille je ne t’en veux pas j’ai de la tendresse pour toi mais pas d’amour » dit-elle à son père); enfin Mata la belle-mère de Houédo et Melody, sa fille. La plupart ne se voient plus. La vie, le temps, l’espace, les rancœurs, les jalousies , etc , les ont séparés, la morte les réunit. En commun souvenir, le vaste appartement parisien au quatrième étage du 102 boulevard Haussmann où ils ont vécu enfants et ados dans l’immeuble où habitait naguère Proust (au premier), partageant des souvenirs d’Afrique noire francophone où la mère et les enfants ont vécu. Le mari, les maris de la morte, sont invisibles, absents, morts peut-être, ils sont hors sujet. Tout ce qui relève de l’intime, du familial, de l’amoureux est, comme souvent chez Pascal Rambert, bien venu, c’est là que son écriture carbure à plein régime. En revanche, dès qu’elle s’ éloigne de la sphère intime, en prenant la pose ou en se mêlant d’Histoire, l’écriture faiblit, se banalise. C’est le cas lorsque Rambert évoque les guerres en Afrique, les massacres, les exils. La platitude, le convenu, voire la fiche Wikipédia plombent alors l’écriture. Quand il revient aux relations de chacun avec la morte, l’écriture se muscle, Rambert est là dans son registre d’élection. Tout se passe comme si le cercueil était un aimant et un miroir où chacun.e est, tour à tour, attiré et se reflète. Le reste du temps chacun rôde alentour. Enfin il y a une chose qui passe bien à la lecture mais très mal à la scène, ce sont les accumulations de sms. Ils ont la vertu de nous entraîner ailleurs en un clic, d’évoquer une autre face du personnage mais théâtralement c’est pauvre et projetés en lointains sous-titres cela n’arrange rien. L’amour de la mère est partagé, l’amour entre frères et entre frères et sœur et entre père et fille, ne l’est pas ou peu. Comme si la mère servait de miroir révélateur et d’exutoire pour chacun.e. Houedo, « la pièce rapportée », songe à raconter cette famille. Stan en a trouvé le titre du futur livre: « Les conséquences » . Je me souviens qu’aux États-Unis il y a une ville qui a pour nom « Truth or conséquences ». Renseignements pris, la ville doit son nom, non à Pascal Rambert mais au titre d’une émission à succès de la télévision américaine. Dans le livre de Houedo « on verrait la vie l’amour la souffrance ceux qui en réchappent ceux qui sombrent ceux qui s’émancipent et ceux qui deviennent fous » dit Stan. Un peu comme dans la pièce. Les acteurs et les actrices, tous à louer, savourent cette écriture qui les enveloppe, faisant en sorte que le public lui caresse le poil. C’est écrit sans ponctuation comme toujours sur l’ordinateur jamais en panne de Pascal Rambert, grand pourvoyeur de scènes de vie, amoureuses et filiales. Mon absente, au TNS tous les jours à 19h jusqu’au 6 avril. Le spectacle a été crée le 23 mars à Châteauvallon, il sera en tournée la saison prochaine à Bonlieu-Annecy, à la MC93 de Bobigny, au Théâtre de Nice, à Marseille au théâtre de la Criée, etc. Comme toute l’œuvre de Pascal Rambert, le texte de la pièce suivi de Je te réponds est paru aux éditions Les solitaires Intempestifs, 94 p, 15€. Légende photo : Scène de "Mon absente" © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2023 9:47 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 28 mars 2023 Aux Ateliers Berthier, à Paris, la metteuse en scène adapte l’ultime roman de l’écrivain américain, sans parvenir à en exploiter toute la complexité.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/28/a-l-odeon-theatre-de-l-europe-tiphaine-raffier-reste-a-la-surface-de-nemesis-d-apres-philip-roth_6167336_3246.html
Chez les Grecs, elle était la déesse de la vengeance, abattant son courroux sur les humains coupables d’hubris, autrement dit de démesure. Némésis donne son nom à l’ultime roman de Philip Roth (1933-2018), signé par l’écrivain américain en 2010. Un roman de maître, cachant sous la limpidité de sa surface une polysémie riche et complexe, des lames de fond puissantes. Et notamment celle-ci, qui résonne avec autant de force que de trouble aujourd’hui : ce qu’une épidémie révèle et fracture dans une société. La jeune autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier, qui, pour la première fois monte un texte qui n’est pas de sa plume, a pourtant évité de tirer avec trop de facilité sur cette corde, et c’est tout à son honneur. Elle s’attache à restituer la complexité du roman, que Roth situe au sein du quartier juif de Newark, sa ville natale. C’est l’été 1944, un été caniculaire, où le soleil et la chaleur pèsent comme une chape de plomb. L’Amérique est en guerre sur deux fronts. Bucky Cantor est un jeune et vigoureux professeur de gymnastique, mais il a été réformé, à cause de sa vue défaillante. Bucky est rongé par la honte de ne pas être au front avec les autres, quand un mal sans visage s’abat sur sa petite ville à l’écart de l’histoire : la polio. L’épidémie se propage à la vitesse de l’éclair et touche particulièrement les jeunes. Elle est aussi une guerre, qui provoque la même stupeur impuissante que l’autre, dans laquelle sont exterminés des millions de juifs. Et elle entraîne la chute de Bucky Cantor, un garçon sain, honnête et droit, à l’image de l’Amérique telle qu’elle se rêve. Mais telle qu’elle n’est peut-être pas : Bucky est une déclinaison d’Œdipe, qui provoque la tragédie par tout ce qu’il fait pour lui échapper. Il a aussi quelque chose d’Ivan dans Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : une indignation sans effet, qui passe à côté de son but. Richesse polysémique Un tel roman est un défi pour le théâtre, dans la mesure où sa richesse polysémique se joue dans les replis de la narration, sans démonstration ni explication. Et le spectacle de Tiphaine Raffier reste en surface, très à plat, à l’image de la grande toile déployée dans l’espace scénique dans la deuxième partie, sur laquelle est imprimé un superbe paysage de lac et de montagne. Sa maîtrise du plateau est indéniable, les idées de mises en scène ne manquent pas, notamment dans cette deuxième partie, interprétée en comédie musicale (avec des petits chanteurs venus du Chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Denis), comme pour mieux jouer avec les paradis trompeurs de l’Amérique. Mais les enjeux et les personnages ne s’incarnent pas vraiment, de même que la matérialité du soleil, de la chaleur, du sentiment de souillure provoqué par l’épidémie, et l’ensemble reste largement anecdotique. Le Bucky Cantor un peu trop cérébral, fantomatique, d’Alexandre Gonin participe à cette sensation de désincarnation, de flottement à la surface. La troisième partie du spectacle, pourtant, qui se situe longtemps après les deux autres, en 1971, alors que Newark est frappé par des émeutes raciales (dans la réalité, elles ont eu lieu en 1967), retrouve une vraie force théâtrale, en revenant sur la tragédie de Bucky d’un autre point de vue et de manière rétrospective. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent la dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant Bucky Cantor, alors âgé, retrouve par hasard un de ses anciens élèves, Arnold Mesnikoff, qui lui aussi a été touché par la polio en 1944 et en a gardé des séquelles, mais a su néanmoins se construire une vie heureuse. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent cette dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant. La confrontation humaine entre Bucky et Arnold, qui a su dépasser la tragédie, rejoint la dimension la plus profonde du roman de Roth : son interrogation sur le complexe de culpabilité dans ce qu’il a de plus destructeur, notamment au sein de la communauté juive. Dommage alors qu’il ait manqué à Tiphaine Raffier un vrai corps-à-corps avec ce texte magnifique, dont la moindre des beautés n’est pas ce fil rouge, déroulé tout du long, du geste sportif comme métaphore du geste artistique. Beauté du geste du lanceur de javelot, et plus encore du plongeur, qui mêle l’envol et la profondeur. S’élever haut avec grâce et piquer sans éclaboussures inutiles vers les abîmes : tout l’art de Philip Roth. Némésis, d’après Philip Roth. Mise en scène : Tiphaine Raffier. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, Paris 17e. Jusqu’au 21 avril. De 7 € à 36 €. Puis les 16 et 17 mai au Théâtre de Lorient (Morbihan). Fabienne Darge Légende photo :« Némésis », d’après Philip Roth, dans une mise en scène de Tiphaine Raffier, le 19 mars 2023, au Théâtre de l’Odéon à Paris. photo : SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2023 10:58 AM
|
Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 28/03/23 Réalisée par les membres du Jeune Théâtre en Région Centre (JTRC), la programmation de la 7ème édition du festival de création émergente WET° à Tours (organisé par le Théâtre Olympia – CDN de Tours) a donné à découvrir des artistes traversés par un fort désir d’émancipation des esthétiques dominantes actuelles pour en inventer de nouvelles. Ce qui va de pair avec une remise en question des rapports de pouvoir existants. Un mouvement prometteur, malgré des résultats contrastés. En sept ans, le festival WET° a su s’imposer comme un lieu majeur pour la jeune création. Bien des artistes passés par là il y a quelques années font désormais partie du paysage théâtral. Le collectif OS’O, par exemple, y était programmé en 2016, année de création de la manifestation par Jacques Vincey, directeur du Théâtre Olympia – CDN de Tours (T°). Ont suivi des artistes comme Marion Siéfert, Hugues Duchêne, Julie Delille, Camille Dagen, Eddy d’Aranjo dont plusieurs étaient invités aux Rencontres de la jeune création organisées cette année en préambule du WET° afin, lit-on dans le dossier du festival, de « porter un regard rétrospectif, sensible et critique sur ce qui s’est joué ces dix dernières années dans le champ de l’émergence et nourrir des désirs pour la décennie à venir ». Les structures en question Le WET°, encadré cette année pour la dernière fois par Jacques Vincey – son mandat de direction s’achève à la fin de la saison – et son équipe, n’a pas attendu d’arriver à l’âge de sept ans, déjà respectable pour un festival, pour regarder en face la jeune création, pour en interroger les pratiques et s’interroger sur lui-même. Le questionnement du modèle institutionnel, dont la hiérarchie très marquée fait du directeur l’unique ou presque responsable du geste de programmation, est dans ce festival chose naturelle. En confiant les rennes de son lieu aux huit membres du Jeune Théâtre en Région Centre (JTRC) – cinq comédien·nes, deux technicien·nes et une chargée de production –, l’équipe du T° fait en période de WET° l’expérience d’un fonctionnement tout autre, plus horizontal. Chaque édition interroge ainsi le milieu théâtral tel qu’il fonctionne, et démontre la possibilité de faire autrement. Cette année, plusieurs des spectacles choisis ont très clairement reflété cette remise en question des structures existantes, théâtrales et autres. Avec Sous l’orme de Charly Breton, que nous avons pour notre part découvert au Théâtre des Quartiers d’Ivry à sa création, le festival s’ouvrait sur un refus absolu du monde tel qu’il va aujourd’hui. Interprété par Guillaume Costanza, ce seul en scène donne voix à l’imaginaire torturé d’un jeune homme qui s’apprête à commettre une action violente au nom d’un Ogre niché dans son esprit. À rebours de toute forme de naturalisme, ce monologue crépusculaire abordant les phénomènes de radicalisation plaçait le WET° 7 sous le double signe de la recherche formelle et de l’ancrage au présent. Deux aspirations peu aisées à concilier, ce qui rend les tentatives toutes intéressantes et riches dans le cadre d’une réflexion sur la nature et les enjeux actuels de la création théâtrale. Adieux à la fiction Les quatre autres propositions que nous avons pu voir au WET° unissent de manières très différentes désir de révolution esthétique et traitement, toujours critique, du présent. Toutes entretiennent toutefois un rapport problématique avec la notion de fiction. Même Poil de Carotte, Poil de Carotte de Flavien Bellec et Étienne Blanc, dont le titre laisse présager une histoire au sens classique, met à mal ce type de récit. Du célèbre roman de Jules Renard, il ne reste en effet que quelques traces ici, à partir desquelles les deux concepteurs du spectacle construisent un dialogue dont l’unique sujet est… le théâtre. Interprétée par Flavien Bellec et Solal Forte, cette conversation brouille d’emblée les frontières entre réel et fiction : les deux comédiens se présentent sous leurs vrais prénoms, et commencent à dérouler leurs parcours artistiques respectifs. C’est ainsi sur un mode proche de la performance que s’opposent deux pratiques opposées du théâtre : l’une très cadrée par l’institution, qui la légitime, l’autre indépendante, empruntant des chemins non balisés. Des neuf pièces de ce WET°7, Poil de Carotte, Poil de Carotte est celle qui aborde de la manière la plus frontale la question de l’institution théâtrale. Sa place au festival est donc parfaitement compréhensible, d’autant plus que l’exercice est subtilement mené par les acteurs, qui prennent le temps nécessaire pour rendre sensibles tous les mécanismes de l’humiliation. On peut toutefois se demander si ce tête-à-tête est en mesure de s’adresser à un public étranger au milieu théâtral dont il détaille les problématiques. La violence qui se dit ici peut-elle en évoquer d’autres ? Il faudrait sans doute la confronter à d’autres contextes pour le vérifier, et l’ouvrir davantage à cette possibilité. Il est toutefois évident qu’il y a là en germe un geste singulier, où une écriture très précise, tendue, va de pair avec la recherche d’une forme susceptible d’agir fortement sur le spectateur. Des mères et des sirènes Amer Amer de Jérôme Michez et Elsa Rauchs va plus loin encore que Poil de Carotte, Poil de Carotte en matière de mélange entre théâtre et performance. La question de la relation au public est au cœur de la proposition du jeune duo belge, qui a déjà créé auparavant deux spectacles : à chaque représentation, l’un des deux rôles de la pièce est confié à un spectateur. Les règles sont exposées au moyen d’un texte projeté sur le mur tandis que Jérôme Michez – en alternance avec Tom Geels – arpente le plateau : Amer Amer commencera lorsqu’une personne du public voudra bien le rejoindre pour jouer le rôle de la mère du protagoniste, en suivant seulement quelques consignes. Le jour de notre venue pourtant, ce dispositif était incompréhensible : connaissant visiblement le spectacle, et répétant absolument toutes les phrases et gestes de l’artiste, le volontaire avait des airs de complice si évidents que la part de hasard essentielle à la proposition était nulle. L’au revoir fils-mère raconté ici avait alors bien peu d’existence, d’intensité théâtrale alors qu’avec leur création, Jérôme Michez et Elsa Rauchs voulaient justement exprimer l’urgence de sortir de l’inertie, d’entrer dans l’action. Comme ces deux artistes ainsi que Flavien Bellec et Étienne Blanc, le trio créateur de Sirènes – Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche – fait du théâtre hors de la hiérarchie habituelle, encore largement dominée par le metteur en scène. Sirènes fait d’abord miroiter un riche horizon, à la croisée des arts plastiques, du théâtre et de la performance. Le but des artistes, qu’elles expriment dès un premier tableau très réussi de transformation en femmes-poissons : explorer un mythe pour le déconstruire. Composé d’une succession d’images en mouvement, parfois accompagnées de quelques rares paroles, l’espèce de vivarium qu’elles déploient ensuite perd hélas assez vite de sa puissance. L’envie d’en découdre avec les fictions dominantes a tendance à limiter l’imaginaire des artistes, qui pour démonter des clichés choisissent souvent de les représenter d’une manière plus ou moins bien détournée. On rencontre par exemple une créature lascive face à un équipage de marins, des femmes s’échangeant des futilités en s’étalant sur la figure des crèmes multicolores… Cela au détriment de l’invention d’une féminité théâtrale vraiment originale, libérée des chaînes dénoncées. Le parti-pris de la diversité Le cas de Dernier amour de Hugues Jourdain n’est pas sans points communs avec celui de Sirènes. Trois personnes trop malheureuses en amour pour continuer de vivre sur Terre y décident de la quitter ensemble et d’aller vivre dans l’espace. Mais avant le grand départ, elles réalisent un dernier spectacle en forme d’au revoir à l’Humanité. Autant que les rapports amoureux, le théâtre est donc l’objet ici d’une réflexion assez désabusée. Très fragmentaire, composée de scènes détournant des numéros ou types de spectacles bien connus – nous avons par exemple un one-woman show inversé –, la pièce prétend liquider un régime théâtral sans proposer à la place un langage qui n’appartiendrait qu’à elle. Ou qui du moins prendrait la voie de l’indépendance. Pour répondre à leur désir d’émancipation des formes et des hiérarchies existantes, les artistes programmés cette année au WET° prennent des chemins très divers. Voulu par les membres du JTRC, cet éclectisme témoigne d’un fort désir au sein de la jeune création d’explorer autant de voies que possible hors des cadres dont elle a hérité. En se focalisant sur des démarches originales, du moins par rapport à un théâtre centré sur le texte, les programmateurs de cette édition ont pu mettre quelque peu de côté la qualité. Même avec ces fragilités toutefois, ce WET° fut riche en réflexion. Nous sommes là dans un précieux espace du galop d’essai qu’il faut vivre et juger comme tel, avec l’assurance que dans ses déceptions autant que dans ses révélations, ce festival aide à penser la création d’aujourd’hui et de demain. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2023 5:12 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 22/03/23 A 80 ans passés, la Vietnamienne Tran To Nga, exilée en France, traduit en justice les multinationales américaines qui ont durablement ravagé son pays (champs, forêts, corps) durant la guerre du Vietnam. Marine Bachelot Nguyen en témoigne dans un spectacle aussi militant que saisissant. Les lumières ont commencé à baisser, c’est alors que, dans la quasi obscurité, Tran To Nga s’est avancée à pas lents et s’est assise à la place qui lui avait été réservée au premier rang, le soir de la première. Une bonne heure durant, elle a regardé, à quelques pas devant elle, une jeune actrice raconter l’histoire et les luttes de sa vie mouvementée et obstinée, un monologue écrit par une troisième femme qui a accolé à son nom celui de sa famille d’origine : Nguyen. Tran To Nga est aujourd’hui une veille femme vietnamienne octogénaire dont la vie est faite de luttes, Angélica Kiyomi Tisseyre-Sékiné, est une jeune actrice française d’origine japonaise et vietnamienne, passée par l’ERAC et Marine Bachelot Nguyen est autrice et metteure en scène française d’origine vietnamienne au sein du collectif Lumière d’août à Rennes depuis bientôt vingt ans.Quant à Julie Pareau, elle signe les vidéos intégrées au spectacle. C’est en 2019 que la metteure en scène a lu Ma terre empoisonnée (éditions Stock), le livre autobiographique de Tran To Nga. Marine Bachelot Nguyen en a fait un premier travail à Nantes au Grand T à l’invitation de Catherine Blondeau. Un an plus tard , quand le collectif Vietnam Dioxine a sollicité des artistes d’origine vietnamienne pour soutenir le combat de Tran Tio Nga, Marine Bachelot Nguyen s’est portée volontaire et a écrit le texte de Nos corps empoisonnés. Le spectacle s’ouvre par le procès qui s’est enfin tenu au tribunal d’Évry le 25 janvier 2021 après six années de procédures et 19 reports d’audience . « Ce moment on l’a attendu tant d’années » dit la vieille femme via la jeune actrice. « Je suis là pour incarner les victimes. Ceux et ceux qui ne peuvent pas parler, celles et ceux qui ne peuvent plus parler ». En face d’elle, quatorze avocats représentant les quatorze multinationales (dont Monsanto) qui, via l’armée américaine, ont déversé 75 millions de litres d’agent orange sur les champs, les forêts et les habitants pendant la guerre du Vietnam. Champs devenus impropres, forêts ravagées, corps bousillées ou durablement atteints. Avant d’aller plus loin, le spectacle décline la vie de Tran To Nga depuis sa naissance le 30 mars 1942. L’école où elle apprend le français, les drames de sa famille et ses luttes « contre les impérialismes américains », les tonnes de bombes qui s’abattent, et son engament personnel qui va grandissant. Après dix ans de séparation, elle retrouve sa mère dans un pays aux paysages dévastés par les bombardements et les épandages massifs de produits toxiques. Des soldats américains en seront eux aussi victimes mais en 1981 les firmes les dédommageront en èchange d’une absence de procès. Mais côté vietnamien, rien, pas le moindre dédommagement. Le mal n’atteint pas seulement les vivants mais les enfants qui naissent comme Viêy Hat la fille de Tran To Nga qui en mourra. Ses deux autres filles, comme leur mère, auront des maladie de la peau et des insuffisances respiratoires. Quand les Américains fuient Saïgon, le nouveau régime communiste « choisit la sanction et la purge ». Tran To Nga finira par choisir l’exil en France. Après avoir combattu l’armée des USA, son ennemi c’est l’ensemble des firmes américaines meurtrières, un combat dont elle est l’une des figures emblématiques. Retour au procès : la cour se déclare incompétente pour juger les faits. Un appel est en cours. L’actrice salue et Tran To Nga, se lève et va la rejoindre. Nos corps empoisonnés aux Plateaux sauvages, 20h, jusqu’au 25 mars . Puis le 6 avril à la Sorbonne nouvelle Paris3, le 11 avril au théâtre du champ du Roy à Guingamp, le 14 avril au festival Mythos à Rennes, les 2 et 3 mais au festival Eldorado au CDN de Lorient et cet été dans le off Avignon à la Manufacture du 7 au 23 juillet. Photo : Scène de "Nos corps empoisonnés" © Hélène Harder
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2023 10:28 AM
|
Par Sandrine Blanchard (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) du Monde - 10 avril 2023 Comme plusieurs lieux culturels d’Auvergne-Rhône-Alpes, le théâtre tente d’adapter sa programmation pour faire face à l’augmentation des coûts et à la réduction des subventions régionales.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/10/le-theatre-national-populaire-de-villeurbanne-reflet-d-une-culture-publique-en-crise-on-est-au-bout-d-un-modele_6168905_3246.html La grande roue lumineuse installée dans le hall d’entrée du Théâtre national populaire (TNP) donne un air de fête à ce temple de la décentralisation théâtrale. Ce décor enchanteur, vestige de Liliom, l’un des spectacles créés par Jean Bellorini, directeur de ce lieu culturel central de Villeurbanne (Rhône), apparaît, sans le vouloir, comme un clin d’œil à la pétition titrée « N’éteignez pas les lumières sur le spectacle vivant ». Lancé début mars à l’initiative du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles, ce texte, qui a recueilli près de 12 000 signatures, interpelle le gouvernement sur un secteur au bord de la rupture financière. « Au moment où les tensions inflationnistes et énergétiques ne tarissent pas, où le soutien des collectivités territoriales s’effrite, nous sonnons l’alarme », s’écrie le principal syndicat des scènes publiques. Coûts qui explosent, subventions qui stagnent, le spectacle vivant subventionné se sent attaqué dans sa capacité à répondre à ses multiples missions de service public. Même un paquebot bien doté comme le TNP − 18 000 mètres carrés, quelque 90 permanents, trois salles de spectacle, dont une de 660 places, quatre salles de répétitions − est ébranlé. « Je pensais diriger l’un des théâtres les mieux protégés, de par son histoire, son statut, et je me retrouve à joindre avec difficulté les deux bouts et à avoir comme seule solution de réduire l’activité. C’est fou », témoigne Jean Bellorini, à la tête de ce Centre dramatique national (CDN) depuis janvier 2020. Aux surcoûts engendrés par la facture énergétique (en hausse de 100 000 euros) et par la pression salariale (due à l’augmentation du point d’indice) viennent s’ajouter les choix politiques opérés depuis un an par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Tout est à la baisse Au nom d’un « rééquilibrage territorial », la région, présidée par Laurent Wauquiez (Les Républicains – LR), a réduit, sans concertation, les subventions de plusieurs institutions culturelles, dont le TNP. Au printemps 2022, l’équipe du théâtre apprenait dans la presse que la région se désengageait à hauteur de 150 000 euros, faisant passer sa dotation annuelle de 500 000 à 350 000 euros. Un an plus tard plane le risque potentiel d’un retrait total. La programmation de la saison 2023-2024 est en cours de bouclage sans connaître le futur montant de subvention du conseil régional, la commission régionale culturelle, initialement prévue en mars, ayant été annulée. « Actuellement, on vit au-dessus de nos moyens, résume Pauline Huillery, administratrice du TNP. Sur l’exercice 2023, on atteint 450 000 euros de déficit. » Jean Bellorini assume de « prendre ce risque », parce qu’il a encore trois ans de mandat pour réajuster les comptes si la situation empire, et qu’il veut, pour l’heure, maintenir un théâtre « ouvert et vivant » sans augmenter le prix moyen du billet (13,50 euros). « Je lutte contre la tendance à alléger les formes artistiques. Le TNP continue à revendiquer, en matière de maison de production, des formes fortes, qui habitent complètement la cage de scène. Sinon, on va montrer, dans quelques années, que nos maisons sont inutiles. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés En Occitanie, une politique culturelle établie dans la concertation En attendant, l’équipe fait des efforts partout, coupe, renonce. Tout est à la baisse : le nombre de créations, de pièces d’envergure et de spectacles internationaux. Il y aura bien le premier spectacle de Nanni Moretti, mais pas celui d’Angelica Liddell. La fréquence de levers de rideau passera de 220, cette année, à 197 pour la prochaine saison − soit une perte de 7 000 entrées. « On essaie de maintenir l’équilibre entre œuvres du répertoire, comme la reprise de Tempête sous un crâne, mon premier spectacle, la création et la transmission avec La Troupe éphémère, composée d’une vingtaine de gens de Villeurbanne et ses environs », explique Jean Bellorini. Pour tenter de trouver des subsides supplémentaires, un « cercle des mécènes » a été créé afin d’attirer le monde de l’entreprise. Car l’augmentation des coûts et la contraction des subventions (non indexées sur le taux de l’inflation) entraînent un effet ciseaux dévastateur. Le TNP a beau disposer de 7,6 millions d’euros d’aides publiques (Etat, ville de Villeurbanne, métropole du Grand Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes) sur un budget total de 11,5 millions, sa marge artistique − c’est-à-dire ce qu’il reste après imputation des charges fixes de fonctionnement − fond comme neige au soleil. Cette « marge » − poumon des établissements de spectacle vivant pour la création et l’accueil d’équipes artistiques − est passée, au TNP, de 2,2 millions, en 2011, à 1,3 million, en 2023. Et tombera à 1,1 million, en 2024. « A ce rythme-là, dans quatre ans, on sera une coquille vide, une magnifique structure mais qui n’aura plus de projet », redoute Florence Guinard, directrice adjointe du TNP. Pourtant la saison 2022-2023, qui a débuté avec éclat (La Cerisaie, avec Isabelle Huppert, La Douleur, avec Dominique Blanc, L’Avare mis en scène par Jérôme Deschamps, Le Roi Lear, avec Jacques Weber) et s’est poursuivie avec le succès du Suicidé, mis en scène par Bellorini, affiche une belle vitalité. La crise conjoncturelle liée au Covid-19 semble digérée, le public est revenu, et le TNP devrait terminer sa saison avec 90 % de taux de remplissage. Et ce, malgré une baisse sensible, comme partout, du nombre d’abonnés (5 000 en 2018, 3 800 en 2023), liée à un changement de pratique de réservation. Florence Guinard, directrice adjointe du TNP : « A ce rythme-là, dans quatre ans, on sera une coquille vide, une magnifique structure mais qui n’aura plus de projet » « On a en France un maillage territorial de structures, d’outils incroyables. C’est vraiment le moment de poser la question : que veut-on comme service public de la culture ? Il faut profiter de cette période de crise pour réinterroger en profondeur le sens même du théâtre public, mais cela doit s’accompagner d’une volonté politique nationale, insiste l’homme de théâtre. Ce qui nous tue tous, c’est cette sensation d’être au pied du mur et d’être face à notre petite mort. Soyons honnêtes, on est tous paumés. On est au bout d’un modèle. Aujourd’hui, un théâtre public flirte avec les mêmes questionnements de rentabilité, d’efficacité, de star-système qu’un théâtre privé. Ce n’est pas normal. On ne devrait pas être là pour ça. » « Réinterroger le modèle économique » A l’heure où il faut trouver toujours plus de coproducteurs pour monter une création, où les contraintes économiques poussent à multiplier les spectacles de petit format, légers, alors qu’il serait « important de confectionner de grands spectacles qui rendent justice aux outils dans lesquels on est », Jean Bellorini plaide pour une forme de « décroissance saine ». Comprendre : faire moins, mais mieux et plus longtemps. « Au TNP, on ne devrait jamais faire moins de dix représentations d’un même spectacle dans la grande salle. » Le maire socialiste de Villeurbanne et vice-président à la culture de la métropole de Lyon, Cédric Van Styvendael (Parti socialiste), estime lui aussi qu’« il faut réinterroger le modèle économique de création et de diffusion des établissements culturels ». Si la municipalité et la métropole ont maintenu leurs montants de subvention au TNP, ni l’une ni l’autre n’est en capacité de suppléer le désengagement de la région. « Le dialogue est totalement rompu, je n’ai jamais rencontré mon homologue du conseil régional », constate l’élu « profondément convaincu qu’il est plus que jamais nécessaire d’investir dans la culture à condition d’être transparent ». Collaboration, mutualisation des moyens, sobriété, programmations partagées, « une nouvelle génération de dirigeants de lieux culturels est prête à travailler ensemble, il faut saisir cette occasion », insiste-t-il. Lors de sa prochaine saison, le TNP va accueillir des spectacles de la Biennale de la danse et du festival de théâtre Sens interdits, une solidarité entre structures culturelles régionales qui est poussée par la crise. En outre, une expérimentation d’échange de spectacle va être lancée avec le Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon. L’idée est de sortir de la « logique commerciale » de la diffusion, alors qu’il s’agit d’argent public, et de remplacer le principe de la cession par celui de la réciprocité. Pour cette première tentative, il s’agira de spectacles légers, deux solos. Montluçon recevra la création Vie et mort de mère Hollunder du TNP et Ex Machina, création de Monluçon, se jouera au TNP pour le même nombre de représentations. Initiatives de rapprochement « Il faut faire évoluer nos modèles économiques, les CDN n’ont pas été créés pour être une boîte de prod, pour vendre, il faut trouver d’autres manières de faire », martèle Carole Thibaut, directrice du Théâtre des Ilets. « La diffusion rapporte de moins en moins, car plus personne n’est en capacité de payer au-delà du coût plateau. A quelques exceptions, ce leurre selon lequel on pouvait se faire de l’argent en tournant n’est plus vrai. Il faut redonner du sens au réseau des CDN. C’est incohérent de mettre le réseau en concurrence », juge Jean Bellorini. A la mairie de Lyon aussi, Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, milite pour des rapprochements. Elle se félicite, par exemple, que le Théâtre lyonnais municipal des Célestins et le TNP se soient associés pour le prix Incandescences, concours réservé aux compagnies théâtrales régionales. Chaque année, les deux lauréats sont programmés dans l’un des deux établissements. « Ce type d’initiative solidifie une politique publique de culture », considère l’élue municipale. Elle attend désormais avec crainte, les prochains choix budgétaires du conseil régional. « Les arbitrages sont en cours de finalisation, et les structures culturelles recevront, d’ici dix à quinze jours, un courrier indiquant les montants de subvention », explique laconiquement Sophie Rotkopf (LR), vice-présidente de la région chargée de la culture. « Notre budget culture se maintient à 62 millions d’euros, mais le rééquilibrage territorial se poursuit. Certains établissements verront leur subvention baisser et d’autres augmenter », précise-t-elle. Que deviennent les 4,2 millions d’aides supprimées en 2022 ? « Un appel à projet “culture en territoire” d’une enveloppe de 2 millions d’euros est en cours, et nous allons aussi pousser fortement le curseur sur les festivals parce qu’ils représentent une culture populaire de proximité qui s’adresse au plus grand nombre : 530 seront aidés, contre 475 actuellement », assure la vice-présidente. Aucune nouvelle date de commission culturelle régionale n’est annoncée. Sandrine Blanchard (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) pour Le Monde Illustration : SÉVERIN MILLET

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2023 5:21 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog 4/04/23 Au TNS, huit élèves de l’école (actrices, régisseuses, scénographes et costumières) réunies en un collectif « exclusivement féminin », mettent en scène et interprètent « Beretta 68 » autour des écrits et de la personne de Valérie Solanas. Au TGP, neuf actrices interprètent « La crèche : mécanique d’un conflit », un texte de François Hien librement adapté de l’affaire Baby-Loup. Berreta 68 est une carte blanche saisie haut la main par huit élèves du groupe 47 du TNS, huit femmes entre elles. Loïse Beauseigneur est élève en section scénographie-costumes comme Jeanne Daniel-Nguyen et Valentine Lê, Léa Bonhomme est en régie-création comme Charlotte Moussié et Manon Poirier, Jade Emmanuel est en section jeu comme Manon Xardel. Elles jouent, font la régie son et lumière, ont conçu le décor, choisi et agencé les propos souvent incendiaires avant de les proférer. Toutes ou presque jouent, toutes signent cette création collective enlevée et têtue. Le pistolet Beretta 92 est un pistolet remarquable, Beretta 68 est un spectacle qui fait mouche. Chacune des neuf a participé à l’écriture en acte du spectacle, chacune essayant « des métiers qui n’étaient pas ceux pour lesquels nous avons été formées à l’école du TNS ». « Par quelles voies passe la violence des femmes aujourd’hui ? Comment s’est elle manifestée par le passé ? Comment a -t-elle été censurée ?... ». Ce sont quelques unes des questions qu’elles se posent et qui traversent le spectacle à travers des extraits du Scum manifesto de Valérie Solanas (et sa « « société pour tailler les hommes en pièces ») et des extraits de la pièce que Sara Stridsberg a consacré à cette femme qui, un jour de 1968, avait tiré plusieurs balles sur Andy Warhol. Le spectacle s’appuie tout autant sur divers textes féministes dont le King kong theory de Virginie Despentes, Dirty week-end d’Helena Zahavi ou Les orageuses de Marcia Brunier. C’est un spectacle qui martèle des mots souvent audacieux, met en branle une énergie scénique collective peu commune et particulièrement inventive tout en donnant une impression de qui vive et d’urgence. Le spectacle s’est donné six fois du 29 mars au 1er avril. La crèche :mécanique d’un conflit est un spectacle, lui aussi impressionnant mais d’une toute autre nature. Au départ il y a l’affaire Baby Loup, une crèche associative à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, ouverte 24h sur 24 et sept jours sur sept, ayant pour but d’aider les femmes seules ou en grande difficulté à gagner une certaine autonomie. Partie en congé parental durant cinq ans (naissance de plusieurs enfants), Fatima Afif, directrice adjointe de la crèche avant son long congé , au moment de reprendre le travail, demande à venir travailler revêtue de son voile. Refus de la directrice Natalia Baleato, une exilée chilienne de gauche, féministe et laïque : le règlement intérieur de l’association impose une neutralité confessionnelle. Mise à pied et licenciée Fatima crie à la discrimination Entre 2008 et 2014, l’affaire va défrayer la chronique médiatique et bouleverser la vie du quartier. Montée en puissance dans les médias, etc. La crèche finira par fermer et ira s’installer ailleurs. Stricte laïcité républicaine ou acte islamophobe ? La question a évolué avec le temps et les femmes voilées au travail se sont en parties banalisées. François Hien est reparti enquêter sur cette affaire des années plus tard, sans pouvoir rencontrer Fatima Alif mais en rencontrant longuement Natalia Baleato. Il en a fait un livre Retour à Baby-Loup sous-titré « Contribution à une désescalade » (Éditions Petra), puis il a écrit La Crèche : mécanique d’un conflit, une pièce s’inspirant de l’affaire mais s’en détachant. Sa première pièce. En 2016. Nicolas Ligeon et François Hien ont créé la compagnie l’Harmonie communale qui monte les pièces de l’auteur maison, ils entendent pratiquer « un théâtre reposant principalement sur le texte, le jeu et une adresse directe à l’intention du public », un théâtre d’acteurs où la « mise en scène est assumée le plus souvent collectivement par les comédiens au plateau ». Les pièces traversent les fractures de la société sans pour autant relever d’un théâtre d’actualité ou d’un théâtre documentaire insistent-ils.. François Hien a écrit d’autres pièces et c’est une nouvelle version de La crèche qui est actuellement à l’affiche du TGP de Saint Denis après l’avoir été au TNP de Villeurbanne. François Hien et son équipe de l’Harmonie communale entamant ainsi un travail au long cours au sein du TNP qui débouchera sur un création en janvier 2024. Neuf actrices se partagent le plateau ; Estelle Clément-Bealem, Clémentine Beth, Kadiatou Camara, Imane Djelalil, Saffiya Laabab, Katayoon Latif, Flora Souchier, Émilie Waiche et Amélie Zekri. La mise en scène est signée L’Harmonie communale. Les actrices se tiennent au centre d’un dispositif bi-frontal, le décor étant réduit à quelques accessoires. Hormis la directrice Francisca (Estelle Clément-Bealem, formée à l’Ensatt) et l’ héroïne Yamina (Saffiya Laabab, formée à l’école de Saint-Etienne), chaque actrice joue plusieurs rôles. Un jeune acteur, David Achour, viendra brièvement les rejoindre. On assiste, degré par degré, à l’instrumentalisation de l’affaire par les médias, les religieux , les politiques et comment tout cela pénètre dans la crèche. Montée des haines et des incompréhensions, ostracismes, aveuglements, manipulations. François Hien, par sa fiction, donne à voir les rouages du conflit et ses mécanismes. Cela ne se fait pas en une poignée de minutes mais en près de trois heures et c’est juste le temps qu’il faut pour éviter les amalgames et les raccourcis, pour opérer le conflit à cœur ouvert, dans sa complexité. Comment des êtres qui s’aiment, s’entraident et s’admirent, sous la pression de groupes, finissent par se déchirer, se haïr. « Ce qui m’intéresse, dit François Hien, c ‘est moins d’avoir une opinion arrêtée sur le sujet que d’observer comment les crispations s’emparent d’un groupe. C’est mon seul endroit de souveraineté dans l’écriture. Sur les questions politiques, notre équipe reste en débat permanent et s’offre comme garante des propos qui se déploient dans la pièce ». A la fin , actrices et public se retrouvent mêlés au centre du plateau. La discussion continue. Sur le sujet plus que sur le jeu (formidable) des actrices ou la force (puissante) de la mise en scène collective. Le théâtre, ayant fait son boulot, retourne en coulisses. Jean-Pierre Thibaudat La crèche, mécanique d'un conflit, Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, du lun au ven (sf mardi) 20h, Sam 18h, dim 15h30, jusqu’au 16 avril. Légende photo : Scène de "Beretta 68" © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2023 12:22 PM
|
Par Laurent Carpentier dans Le Monde du 8 avril 2023 Le comédien incarne, dans le film de Mathias Gokalp, le sociologue maoïste Robert Linhart lors de son passage à l’usine. Un rôle politique de plus pour celui qui aime incarner des personnages « en quête de sens ».
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/08/swann-arlaud-dans-l-etabli-la-gauche-au-c-ur_6168791_3246.html
« Il y a longtemps que je me suis défait de cette illusion que le cinéma pouvait changer le monde », constate Swann Arlaud, un morceau de sandwich dans une poche, une gourde dans l’autre. Pour preuve ? « Petit paysan [César du meilleur acteur en 2018] montrait la situation des agriculteurs à une époque où l’on voit énormément de suicides. Les prix du lait qui doivent s’aligner sur l’Europe. Donc, des gens qui travaillent à perte. Au ministère de l’agriculture, ils ont vu le film, ils ont trouvé ça super. Il n’y a pas moins d’agriculteurs qui se suicident. » Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « L’Etabli », de Mathias Gokalp : la lutte des classes à la chaîne Swann Arlaud est né en 1981, avec la gauche au pouvoir, et un prénom à faire se pâmer ses profs de français, mais se goberger ses camarades de lycée. Il a hérité des deux : la gauche ancrée au cœur, et la mélancolie de Proust face à un monde vacillant. A regarder sa filmographie, on se dit que la plupart de ses rôles sont à cette aune. Des hommes en résistance ou en résilience dans des films « engagés ». Lui dirait plutôt « en quête de sens ». Citons Grâce à Dieu, de François Ozon, sur les abus des prêtres dans l’Eglise (César du meilleur acteur dans un second rôle en 2020), Exfiltrés, d’Emmanuel Hamon, sur le djihadisme, Tant que le soleil frappe, de Philippe Petit, sorti en février… On le retrouve donc dans L’Etabli, interprétant Robert Linhart, l’un des fondateurs du mouvement maoïste en France, professeur de philosophie parti « s’établir » à l’usine pour y guider les masses vers le grand soir, et qui en reviendra avec une inextinguible dépression et un livre best-seller. « Le truc de l’acteur engagé, je ne suis pas tout à fait d’accord, se défend Swann Arlaud. Pour moi, l’engagement, ça se passe dans la rue. Si je me retrouve parfois à faire des films avec une dimension politique ou sociale, c’est que ce sont des sujets qui me touchent et qui résonnent. Mais je ne me considère pas comme un comédien au service d’une idéologie. Avec le recul, si, effectivement, on peut établir un lien entre des rôles, c’est en fait toujours un peu malgré moi, c’est inconscient. » Rap et adolescence rebelle Il est jovial, sans cachotteries, soucieux de parler juste. Il ne cache pas qu’entre lui et le réalisateur, Mathias Gokalp, cela n’a pas été une lune de miel. On essaye de faire la synthèse entre le jeune homme sympathique et fluet en face de nous et les traits de caractère lus ici ou là : « écorché vif », « impulsif », « devant la caméra, il a l’air charmant et, la minute d’après, inquiétant ». Il éclate de rire : « Qui a dit ça ? » Pour le coup, on l’imagine, à 16 ans, au lycée de Rambouillet – sa mère, la metteuse en scène et directrice de casting Tatiana Vialle, et son beau-père, le célèbre directeur de la photographie et réalisateur Bruno Nuytten (Camille Claudel), ont fui Paris pour cette campagne bourgeoise de proximité. En classe, le gamin déconne avec Grégoire Ludig (du Palmashow) avant d’aller se tartiner des rimes de rap d’adolescent rebelle. « Ma génération, c’est celle des années 1990. Le film qui marque c’est La Haine. Notre culture, c’est le hip-hop, NTM et IAM, Oxmo Puccino… Mais bon, il faut laisser les autres parler de moi. On a du mal à se voir soi-même et j’ai envie de croire que l’on est tous multiples. On est forcément un mélange de plein de choses contradictoires », convient le quadragénaire, père d’un enfant de six ans, pris dans ce grand écart entre son statut privilégié d’artiste qui abat film sur film – trois cette année, dont un réalisé par Justine Triet, Anatomie d’une chute, à venir – et ce monde qu’il voit se disloquer, entre crise climatique et crise sociale. Ce qui frappe lorsqu’on l’observe, c’est sa façon d’écouter. Comme s’il lui fallait tout capter, tout engranger On l’a vu, en 2016, traîner ses guêtres aux rassemblements de Nuit debout. Il appose, en 2019, sa signature au bas d’une tribune en soutien aux « gilets jaunes », puis rejoint, quelques mois plus tard, la place du Châtelet occupée par le groupe Extinction Rebellion. Ce qui frappe lorsqu’on l’observe, c’est sa façon d’écouter. Comme s’il lui fallait tout capter, tout engranger. De toutes ces expériences, il raconte surtout les rencontres, les échanges « enrichissants ». Sa « politisation » a commencé avec le film d’Elie Wajeman Les Anarchistes (2015). Pour le tournage, le comédien se plonge dans l’histoire du mouvement révolutionnaire. « De ces lectures, j’ai compris qu’il y avait une pensée qui avait toujours été réprimée par la force. De là, j’ai décidé qu’il fallait continuer à lire pour comprendre. » Plus désarmé que manichéen. « Il n’y a pas, d’un côté, le noir, de l’autre, le blanc, ça se mélange. Clément Cogitore [avec qui il a étudié aux Arts déco de Strasbourg et qui l’a dirigé dans Ni le ciel ni la terre (2015)] en parle mieux que moi : la frontière n’est pas une ligne fixe, mais quelque chose de mouvant, qui peut déborder d’un côté ou de l’autre. » Refus de grands rôles S’il parle avec conviction de « convergence des luttes », le comédien dit ne plus voter. « En fait, je ne sais plus pour qui voter. Sur l’échiquier politique, je me place évidemment à l’extrême gauche. Mais, en même temps, qu’est-ce que l’extrême gauche, sinon la gauche d’avant-hier ? On a l’impression que l’échiquier politique entier s’est déplacé à droite. Cette manière de se focaliser sur trois poubelles qui brûlent. Qui pour dénoncer les violences policières ? » Le risque serait, dans sa position, de devenir porte-étendard. Il le sait, ce chemin-là éloigne des étoiles. « Je suis justement à un moment où je me dis qu’il faut que je sorte de ces rôles hyper émotifs et fiévreux, et ne pas devenir le comédien qui fait “ce genre de films”. D’une manière générale, dans ce métier, dès que l’on vous colle une étiquette, il est intéressant d’en sortir. » Pour autant, le milieu bruisse de ses refus de grands rôles. D’où lui vient cette force qui l’autorise à ne pas quémander la lumière quand un système le dérange ? Est-ce d’être né enfant de la balle ? Jean Carmet, qui fut le beau-père de sa mère – un grand-père, en somme –, a longtemps fait le machino au théâtre avant d’enchaîner des kyrielle de films. Quant aux potes de cette figure tutélaire, Michel Audiard ou Gérard Depardieu, ils se sont toujours moqués des trajectoires. Dans L’Etabli, Swann Arlaud/Robert Linhart affirme qu’il est « légitime de rêver un monde meilleur. Et peut-être de le faire ». Les lendemains chanteront ? On le regarde. Il soupire : « Franchement, je ne sais pas. Mais ça serait con de ne rien faire. » Laurent Carpentier Légende photo : Robert Linhart (Swann Arlaud) dans « L’Etabli », de Mathias Gokalp. JULIEN PANIE/LE PACTE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2023 11:17 AM
|
Par Eric Demey dans Sceneweb - 6/04/23 Simple et légère, instructive et touchante, sentimentale et politique, la petite forme élaborée par Alice Carré, Olivier Coulon-Jablonka et Carlo Handy Charles traverse les relations entre la France et Haïti, et plus largement entre l’Occident et ses anciennes colonies. Kap O Mond ! prend talentueusement le train de l’Histoire qu’il installe dans notre aujourd’hui, et pour quatre mois au Théâtre de Belleville. Alice Carré poursuit donc son exploration du passé colonial de la France, Olivier Coulon-Jablonka, à la mise en scène, son édification d’un théâtre qui traverse l’Histoire. Et puisqu’il s’agit dans Kap O Mond ! de parler d’Haïti, Carlo Handy Charles a collaboré à l’écriture de ce texte. Au départ, le metteur en scène du Moukden Théâtre ambitionnait une grande production, mais les complications consécutives à la Covid ont compliqué son projet. Sur scène, deux jeunes hommes racontent donc leur rencontre et les relations qui s’ensuivent, qui vont permettre au spectateur de reconsidérer celles entre la France et son ancienne colonie. Petite forme simplissime, à la scénographie minimaliste et transportable, Kap O Mond ! se révèle sous cette forme d’une efficacité et d’un charme considérables. Avec un plaisir d’apprendre au premier plan pour qui connaît mal – et nous devons être nombreux dans ce cas – l’Histoire qui lie la France à Haïti. Révolution française, abolition de l’esclavage et lourde dette imposée avec les canons qui place d’emblée le pays sur les plus mauvais rails qui soient. Quelques grands noms familiers traversent les dialogues– Toussaint Louverture, Jean-Bertrand Aristide mais aussi le tristement fameux Duvalier et ses tontons macoutes, et Dessalines, moins connu mais pourtant tout aussi décisif dans les combats pour l’indépendance. Haïti, c’est certainement pour les français un pays frappé du sceau des malheurs – dictatures, catastrophes naturelles et corruption en guise de gangrène– qui empêchent la République de se sortir du chaos et d’une endémique pauvreté. La France n’en prend pas pour autant la responsabilité qui lui incombe, ni matériellement, ni symboliquement via un exercice de la mémoire et de clarification de l’Histoire. Kendy et Mathieu parcourent tout cela à travers une relation qui commence donc lors d’un concours pour entrer à Sciences Po Paris. Au menu de l’épreuve, la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Les deux jeunes gens se lient – d’amitié ? d’amour ? – et commencent ensemble leurs vies de jeunes adultes. Mathieu, fils de prof d’histoire, va ensuite s’engager pour une ONG et prendre un virage anti capitaliste. Kendy, lui, continuer à chercher à satisfaire les espoirs placés en lui par ses parents restés en Haïti. A travers leurs relations, se dessine celle d’un Occident, qui, même s’il est disons progressiste et de bonne volonté, conserve un rapport paternaliste avec ses anciennes colonies et leurs ressortissants. Valeurs plaquées, dysfonctionnements des ONG et autre compassion mal placée perturbent l’entente entre les deux jeunes gens qui ne renoncent pourtant pas à essayer de bâtir un avenir ensemble. Le plus étonnant est que la relation fonctionne. Scéniquement parlant. Ce qui aurait pu être démonstratif et artificiel, par la grâce de l’écriture et du jeu de Roberto Jean et Charles Zevaco (qui seront en alternance avec Sophie Richelieu et Simon Bellouard) prend vie et embarque sans réticence. Récits relatés avec un naturel parfaitement feint alternent avec des scènes jouées avec juste ce qu’il faut de théâtralité. La relation jamais vraiment définie entre les deux jeunes gens paraît prendre l’atmosphère de l’époque et la faculté des deux jeunes gens à s’expliquer sur leurs différents fait le reste, dans le registre irrésistible de ces pièces où les personnages s’expriment avec une lucidité et une précision qu’on aimerait tous avoir au quotidien. On en ressort déplacé, s’interrogeant sur son regard, ses convictions et le monde tel qu’il change. Rafraîchi et touché. Eric Demey – www.sceneweb.fr Kap o Mond ! Texte Alice Carré et Carlo Handy Charles
Mise en scène Olivier Coulon-Jablonka
Avec Roberto Jean et Charles Zevaco (en alternance avec Sophie Richelieu et Simon Bellouard)
Dispositif scénique Anne Vaglio
Production Compagnie Moukden Théâtre
Coproduction Théâtre de La Vignette, Scène conventionnée, Université Paul-Valéry Montpellier, Théâtre du Champ au Roy- Guingamp
Coréalisation et soutien Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri.
Le Moukden Théâtre est une compagnie conventionnée par la Drac Ile de France et soutenue par la région Ile de France au titre de la permanence artistique et culturelle. Durée : 1 heure Du 05 avril au 30 juin 2023
Théâtre de Belleville – Paris du 12 au 19 janvier 2024
Théâtre de Bretigny

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2023 8:47 AM
|
fff - Article de Denis Sanglard dans "Un fauteuil pour l'orchestre" 3/04/23
« On ne fait pas de politique en passant au-dessus des gens. » Au fin fond du Finistère, à Châteaulin, dans un abattoir de poulets placé en liquidation judiciaire, explose la colère. Ouvrières et ouvriers séquestrent le secrétaire d’état à l’industrie. Cernés par les forces de l’ordre, l’état de siège et la lutte qui se refuse à être finale, s’organisent. On débat et c’est houleux. On s’engueule, on diverge, on s’entend, mais la solidarité n’est plus ici un vain mot et l’on apprend à se connaître, à se respecter. La parole circule et libère, chacun retrouve sa part d’humanité, espère en de nouveaux lendemains où les blessures et la misère changeraient de camps. Et en en attendant la catastrophe, la révolte devient fête, un baroud d’honneur avant la tragédie.
Des châteaux qui brûlent c’est d’abord un roman d’Arno Bertina paru en 2017, remarquablement adapté ici par Anne-Laure Liégeois pour une mise en scène, une œuvre chorale non moins remarquable. Crispation sociale aigue, rupture des politiques avec le peuple que traduit un pouvoir devenu vertical et un refus du dialogue, un ultralibéralisme décomplexé et un patronat sans scrupule, un monde ouvrier broyé par une crise économique dont ils sont les victimes méprisées, une variable d’ajustement dans le jeu de la mondialisation. De ça, « Nous sommes innocents » dit l’une. Qu’importe, ils en paient le prix fort. Les gilets jaunes en furent la manifestation, aujourd’hui la loi sur les retraites réactivent les cendres encore rougeoyantes d’une colère qui embrase l’espace public. Des châteaux qui brûlent n’exprime rien moins que cette colère-là, ce désarroi, cette détresse et cette impuissance. Ils sont douze, pour une fresque d’un monde ouvrier qui soudain se découvre capable de prendre en main son destin, entre doutes et espoirs. Dans cette usine d’abattage, on peut y voir une métaphore, où la déshumanisation liée aux conditions de travail et de productions abrutit chacun, ces ouvrières et ouvriers expriment enfin, puisqu’ils ont pris la parole, le mal-être d’une existence que le politique et le patronat ignore sciemment. Chacun dans sa diversité est le visage d’une souffrance au travail, d’une souffrance existentielle, l’une n’allant pas sans l’autre, qui éclatent dans l’urgence de cet état-de-siège improvisé. Anne-Laure Liégeois, c’est la force de son adaptation et du roman, donne à toutes et tous une bouleversante humanité, sans jamais de manichéisme. C’est dans la confrontation avec l’autre qu’ils se révèlent, avec leur force et fragilité, leur contradiction. Ces « sans-dents » ou ces « illettrés » puisent soudain dans ce collectif qui se structure peu ou prou, une force de vie et de combat qui leur rend leur dignité et leur fierté. C’est tout ça qui est brassé ici, sans pathos aucun. Avec cette question incongrue et formidable à la fois, la révolution peut-elle passer par la fête, qui ne soit pas une défaite ? Elle aura bien lieu cette fête, scène surréaliste (et réussie) d’une kermesse, avant la curée et le drame.
Entre prise de parole individuelle, au public adressé, et scènes de groupes, circule une conviction et une énergie qui vous poignent rudement, ouvrent de même à la réflexion. On ne peut rester indifférent à ce qui se dit et se partage sur le plateau, dans un sentiment d’urgence, où la contradiction fait dialogue et non confrontation. Même avec Montville, le secrétaire d’état séquestré, bientôt sacrifié par le politique, au final bouc émissaire des deux parties. Anne-Laure liégeois va droit à l’essentiel dans une mise en scène rigoureuse, épurée, fluide et dynamique, une ligne claire et sans heurt où la parole, et les corps, circulent en continue sans que jamais nous ne perdions le fil de ce qui exprimé là et mis en jeu. Avec ça une langue singulière, celle d’Arno Bertina, travaillée à l’os, se refusant sciemment, intelligemment à toute imitation de ce que pourrait être la langue supposée d’un ouvrier, qui participe sans conteste à la dignité et à la valeur de ces personnages. Sans nullement sacrifier la pertinence et la justesse de son propos, lui offrant au contraire plus d’acuité. Langue que s’approprient avec intelligence les comédiennes et comédiens qui offrent à leur personnage une vérité sans fard, sans triche, une humanité non ébarbée. C’est aussi à ça que l’on reconnaît la réussite d’une création, car c’est une réussite sans conteste, de savoir fédérer autour d’un projet une troupe talentueuse, unie dans un même élan à défendre une œuvre polémique, polémique parce prémonitoire et ancrée dans une réalité sociale et politique qui la rattrape. C’est du théâtre dans son essence première, celui des affaires de la citée, engagé, fort bien foutu qui plus est, et en ces temps quelques peu difficiles il est bien, il est nécessaire de nous remettre les pendules à l’heure, et qu’importe nos idées, de ne pas regarder ailleurs quand les châteaux brûlent avec raison.
Crédit photo © Christophe Raynaud de Lage
Des châteaux qui brûlent d’après le roman d’Arno Bertina
Adaptation et mise en scène d’Anne-Laure Liégeois
Avec la collaboration d’Arno Bertina
Avec Alvie Bitemo, Sandy Boizard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Fabien Joubert, Mélisende Marchand, Marie-Christine Orry, Charles-Antoine Sanchez, Agnès Sourdillon, Assane Timbo, Olivier Werner, Laure Wolf
Scénographie : Aurélie Thomas, Anne-Laure Liégeois
Lumières : Guillaume Tesson
Création sonore : François Leymarie
Costumes : Séverine Thiebault
Vidéos : Grégory Hiétin
Régie générale : François Tarot
Régie plateau : Alexandrine Rollin, François tarot,
Construction décor : atelier de la Comédie de Saint-Etienne
Régie : Laurent Cupif, Wilhelm Garcia-Messant
Du 1er au 23 avril 2023 à 20h
Dimanche 16h
Théâtre de la Tempête
Cartoucherie
Route du Champ-de-manœuvre 75012 Paris
Réservations : 01 43 28 36 36
www.la-tempete.fr
Un fauteuil pour l'orchestre :
Bienvenue sur notre journal d’actualités et de critiques théâtrales
Un fauteuil pour l’orchestre est un collectif d’artistes professionnels dont l’objectif est de vous guider vers un théâtre divertissant, tragique, performeur, politique etc. tout en réfléchissant à sa situation au cœur de la cité. Des articles, des critiques, des entretiens, des lectures serviront pour la rédaction de nos informations : en découvreur de talent, en chercheur insatiable de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Bien sûr les maîtres et les classiques seront visités et commentés comme il se doit. Notre démarche va de pair avec notre expérience et notre inévitable subjectivité. Nos goûts et nos couleurs, mais aussi nos divergences, seront partagés avec vous. Bien amicalement, Le collectif Un fauteuil pour l’orchestre
Les ƒ du Fauteuil
ƒ = Bien
ƒƒ = Très bien
ƒƒƒ = À ne manquer sous aucun prétexte
(S’il n’y a rien, et bien… non… ce n’est pas un oubli de notre part !

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 5, 2023 12:51 PM
|
Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde 5/04/23 Pour sa première programmation, le nouveau directeur qui a succédé à Olivier Py confie l’ouverture à la metteuse en scène Julie Deliquet et proposera 12 000 places de plus à la vente.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/05/tiago-rodrigues-deploie-les-nouveaux-paysages-du-festival-d-avignon_6168426_3246.html
Un nouveau paysage se dessine à Avignon, riche de promesses et de découvertes : Tiago Rodrigues, le directeur du Festival, a annoncé, mercredi 5 avril dans la cité des Papes, le programme de sa première édition (et 77e du nom depuis la fondation de la manifestation par Jean Vilar en 1947), qui se déroulera du 5 au 25 juillet. Un geste inaugural qui ne se prétend pas révolutionnaire, mais entend faire bouger les lignes en douceur, ouvrir de nouvelles pistes, défricher des sentiers de déambulation partagée, retrouver des chemins oubliés. A l’image de son titre, Avignon réunira (emprunté à Vilar), et de la belle affiche de ce festival, qui décline, en bleu sur un fond blanc comme neige, le motif de la trace, de l’empreinte, animale ou humaine. On retrouve là le cœur du travail et de la réflexion de Tiago Rodrigues sur la mémoire et l’art comme interprétation toujours inscrite dans le présent, aussi ancienne que puisse être la partition d’origine. L’audace de la programmation de ce premier festival sous la conduite de l’auteur et metteur en scène portugais se lit d’emblée dans le choix du spectacle d’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des papes : la metteuse en scène Julie Deliquet, 43 ans, y proposera Welfare, d’après le film, réalisé en 1975, du grand documentariste américain Frederick Wiseman sur le système de santé américain. Elle est ainsi la deuxième femme, dans toute l’histoire du Festival, dont la mise en scène entre dans le saint des saints d’Avignon, succédant à Ariane Mnouchkine, qui y avait présenté sa trilogie shakespearienne en 1984. Cette édition d’Avignon, qui propose un savant cocktail de générations, de genres (à tous les sens du terme) et de provenances géographiques et linguistiques, voit aussi le retour très attendu de deux maîtres. Le Polonais Krystian Lupa présentera sa vision des Emigrants, le livre-monde de W.G. Sebald. La chorégraphe anversoise Anne Teresa De Keersmaeker sera doublement présente, avec la reprise de son chef-d’œuvre En atendant, tissé des polyphonies de l’ars subtilior, apparues lors de l’épidémie de peste noire au XIVe siècle, et avec une Création 2023 basée sur les « walking songs » et sur ce principe : « Si tu ne peux pas le dire, chante-le. » Une « épopée rétrofuturiste » Du côté des grands artistes qui ont accompagné l’histoire du Festival, on retrouvera Mathilde Monnier, avec Black Lights, une création inspirée de la série télévisée choc H24, sur l’impact des violences subies par les femmes ; Milo Rau, avec Antigone in the Amazon, qui situe le mythe antique dans la province de Para au Brésil, et réunit comédiens, musiciens et activistes indigènes et membres du Mouvement des sans-terre ; ou le Britannique Tim Etchells et son théâtre explosif, drôle et grinçant, qui signera le spectacle itinérant de cette édition, L’Addition. La foisonnante génération intermédiaire française sera largement présente. Outre Julie Deliquet, David Geselson présentera Neandertal ; Julien Gosselin, Extinction, d’après Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler ; Gwenaël Morin, Le Songe (démonter les remparts pour finir le pont), d’après Shakespeare ; Pauline Bayle, Ecrire sa vie, d’après Virginia Woolf ; Rébecca Chaillon, la reprise de son spectacle Carte noire nommée désir. Enfin, Philippe Quesne créera Le Jardin des délices, une « épopée rétrofuturiste » inspirée de Jérôme Bosch, et avec cette création arrive une des nouvelles les plus réjouissantes de ce festival : la réouverture de la carrière de Boulbon, ce lieu magique entre tous, situé en pleine nature, à une quinzaine de kilomètres de la cité des Papes. La langue anglaise étant la grande invitée de ce festival, une flopée d’artistes sont à découvrir, en tête desquels l’auteur-metteur en scène britannique Alexander Zeldin, qui signe The Confessions, ainsi que ses compatriotes Tim Crouch et Alistair McDowall. De même les Américains du groupe Elevator Repair Service, et la Canadienne Emilie Monnet, qui, avec Marguerite : le feu, travaille sur la question des peuples autochtones. Du côté des découvertes, il faudra aussi guetter l’Allemande Susanne Kennedy, qui arrive, avec Angela (A Strange Loop), précédée d’un bouche-à-oreille flatteur, ou encore le Belge Patrick Corillon et la Brésilienne Carolina Bianchi. Budget de 17 millions d’euros On y danse, aussi, à Avignon. C’est Trajal Harrell qui signera le deuxième spectacle dans la Cour d’honneur, intitulé The Romeo. Grand amoureux ou séducteur invétéré, ce Romeo ? Bonne question dont on attend avec impatience la réponse du chorégraphe américain. Dans ses pas dansants, il y aura aussi Bintou Dembélé, qui ouvrira le Festival avec G.R.O.O.V.E., une déambulation performance. Et encore Martine Pisani (avec Michikazu Matsune), Maud Blandel ou le collectif espagnol Mal Pelo. Un des moindres intérêts de ce festival n’est pas de mettre à son menu deux expériences de ce que l’on pourrait appeler du « théâtre en marchant » (Tiago Rodrigues cherche encore l’expression exacte), toutes deux au départ du village de Pujaut (Gard), bien connu des amateurs de côtes-du-rhône : Paysages partagés. Sept pièces entre champs et forêts, par Caroline Barneaud et Stefan Kaegi ; et Que ma joie demeure, une adaptation du roman de Giono par Clara Hédouin. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Tiago Rodrigues : « Le Festival d’Avignon est une partition à interpréter » Et Tiago Rodrigues lui-même, alors ? Il a choisi de ne pas présenter de création pour son premier festival en tant que directeur. « Je tiens à être disponible pour les inquiétudes collectives, pas pour mes inquiétudes individuelles », fait-il savoir. Mais il offrira une représentation unique, le dernier soir du Festival, dans la Cour d’honneur, de ce qui est sans doute son spectacle le plus emblématique, créé il y a dix ans : By Heart, magnifique variation sur la mémoire, l’amour de la littérature, la trace. Autant dire qu’il y aura de quoi faire avec ce festival qui pousse les curseurs à la fois politiques et artistiques, et propose, sans en faire tout un plat, une proportion légèrement supérieure à 50 % de projets conduits par des femmes, ce qui est inédit dans l’histoire d’Avignon. Tiago Rodrigues a hérité d’un budget constant à 17 millions d’euros, largement mangé par l’explosion des coûts des voyages et de la facture énergétique, mais il a serré les boulons, et propose 12 000 places de plus à la vente (sur un total de 125 000). Il a aussi légèrement augmenté le tarif maximal dans la Cour d’honneur, où les billets passent à 40 euros. Autre innovation : la billetterie ouvrira deux mois plus tôt que d’habitude, dès le 7 avril, sur le site Internet du Festival, où les places devraient s’arracher. Alors à vos marques, prêts, partez. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / Le Monde Légende photo : Tiago Rodrigues, à la FabricA, à Avignon, le 5 avril 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 5, 2023 5:14 AM
|
Par Louis Juzot dans le blog Hottello - 5 avril 2023 Des caravelles et des batailles, écriture et mise en scène Elena Doriatiotto et Benoit Piret.
La Montagne Magique exerce une fascination sur les lecteurs en distillant l’ambiance particulière d’un sanatorium de Davos où un jeune ingénieur hambourgeois, en visite auprès de son cousin, développe une affection et s’immerge peu à peu dans la vie d’une petite communauté de patients et de soignants.
Cette communauté vit en ignorant la guerre qui se prépare et se nourrit aussi de grands débats existentiels, de philosophie politique, esthétique, autant que d’occupations oisives … Ces principaux protagonistes sont devenus des types littéraires : Hans Castorp, jeune homme à la recherche de lui-même, mais aussi les pédagogues Lodovino Settembrini, l’homme des lumières, et Léon Naphta, le théoricien radical, Claudia Chauchat, séduisante et mystérieuse qui deviendra l’amante de Hans après une soirée mémorable, le Docteur Krokovski, conférencier infatigable… Indéniablement Elena Doriatiotto et Benoit Piret et tous les comédiens se sont inspirés de ces personnages pour créer leur propre type : Andréas, Jules Puibaraud, a un peu beaucoup de Hans Castorp mais on retrouve des traces du Docteur Krokovski dans le personnage de Benoit Piret, d’Adriataca Von Mylendonk dans celui d’Elena Doriaticco, un composite des autres femmes pour Anne-Sophie Sterk qui reprend le nom de l’une d’entre elles ou des deux théoriciens pour Salim Djaferi et Gaëtan Lejeune. On retrouve des réminiscences de certaines scènes, de certains lieux : l’accueil, les promenades, la poste, l’enveloppement dans les couvertures… Cette Montagne magique revisitée est croisée avec une fresque de la bataille de Cajamarca, celle ou en 1533 Pizarro et ses 168 soldats ont massacré dix milles Incas et fait prisonnier l’empereur Atahualpa, un fait paradigmatique de la colonisation la plus cruelle et finalement de l’emprise marchande et technologique de l’anthropocène sur toute la vie terrestre. La fresque, c’est l’irruption du réel dans la vie languide et cotonneuse de la petite communauté, même si Andréas tentera de la faire disparaître par un acting qui rappelle les mouvements écologiques radicaux. Bien que le jeu des acteurs sciemment cool et soft, comme si la réalité était en suspens dans ce monde, autant fermé sur lui-même qu’idyllique, soit systématique, le spectateur pris à témoin par le regard se laisse embarquer dans cette nonchalance et cette quiétude savamment distillée. Les acteurs font face constamment au public comme si celui-ci était la ligne d’horizon et leurs mouvements sont calculés voir esquissés, suspendus dans un ailleurs. La seule violence, le tabassage d’Andréas, après son acte radical, est suggéré par un œil au beurre noir et finit dans une accolade amicale. Du lard ou du cochon ? Evidemment comme dans le roman, la fable conduit à la prémonition du désastre, cela aurait pu être la guerre à nos portes comme en 1908, mais c’est plutôt la destruction écologique qui est évoquée par l’intermédiaire du seul élément du décor : un arbre fait de planches assemblées que les protagonistes essaient de maintenir en érection. Même si on est un peu frustré par un parti pris de jeu qui ne décolle pas vraiment, le spectacle Des caravelles et des batailles se laisse voir comme une promenade tranquille en eau calme avant le désastre, C’est bien senti ! Louis Juzot Jusqu’au 21 avril à 20h30, relâche les dimanches et le 6 avril, Théâtre d la Bastille, 76 rue de la Roquette , 75011, Paris ; Tel :0143 57 42 14 ; http://www.theatre-bastille.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2023 5:23 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 01/04/23 Une personnalité très forte. Un physique, une beauté puissante, visage tourmenté, regard clair, voix prenante. Il avait tout pour être un interprète fascinant. Ce qu’il fut. Il avait évoqué sa vie en ellipses cinématographiques, il y a quelques années. Il s’est éteint le 30 mars. Il venait d’avoir 73 ans. Il avait quelque chose d’un personnage de Maeterlinck. Une poésie. Quelque chose qui faisait trembler imperceptiblement sa puissance physique, sa beauté. Quelque chose d’évanescent qui l’apparentait au monde des songes. Johan Leysen était l’un des plus bouleversants des comédiens européens. Insaisissable et inoubliable. D’une présence, comme on dit sur les plateaux, d’une présence forte et diffuse à la fois. Comme s’il n’avait pas tout à fait appartenu au cercle des pauvres humains que nous sommes, mais comme s’il était un envoyé. Parmi ceux qui l’ont appelé, ces dernières années, parmi ceux qui ont mis le mieux, le plus profondément et le plus lumineusement, les secrets de cette âme fière, il y a Jacques Osinski. Avec lui, il a notamment porté à l’incandescence, dans un décor d’images hivernales, le Lenz de Büchner. C’était il y a cinq ou six ans…Il y a Christian Schiaretti, un peu plus tôt, lui confiant le rôle du Capitaine dans la pièce de Strindberg, Père, au côté de Nada Strancar. C’était il y a dix-huit ans…Mais c’est tellement vif dans les mémoires. Au théâtre, il y eut aussi Guy Cassiers, Heiner Goebbels, on ne sait plus dans quel ordre on les a découverts, ses spectacles ! Mais on n’oublie pas ses traversées nocturnes avec Milo Rau. Johan Leysen, chez lui, au plus vrai de son âme. Il était né dans une célèbre ville du Limbourg, Hasselt. Une ville de la Belgique flamande, plus près de l’Allemagne que de la France, plus près des légendes que des raisonnements. Il avait plusieurs voix : le flamand, le néerlandais, le français, l’anglais, l’allemand. Un homme des frontières, un homme qui traversait les murs. Son chemin, au cinéma au comme au théâtre, est riche, contrasté. Godard l’a voulu dès Je vous salue Marie en 1985. Marion Hänsel l’avait engagé pour Le Lit, son premier film, très récompensé, en 82. La cinéaste, elle aussi morte très tôt, adaptait alors un livre de Dominique Rolin. Delvaux l’engagera pour son adaptation de L’œuvre au noir, et Johan Leysen ne cessera de tourner, au cinéma, à la télévision de qualité, un peu. Patrice Chéreau n’aurait pu le laisser passer et ce sera La Reine Margot en 94. Mais Leysen tourne aussi sous la direction de Raoul Ruiz, d’Enki Bilal, François Ozon, pour ne citer que les très connus. Mais Johan Leysen a tracé son chemin du côté de la recherche, des artistes exigeants parfois demeurés dans l’ombre. Nous ne referons pas ici la liste des pièces de théâtre, des films dans lesquels le génie poétique tourmenté de Johan Leysen s’est exprimé. On repense à son film, projeté un jour aux Bouffes du Nord. Un film elliptique et très personnel. Il plongeait dans son enfance, en appelait à Rilke, évoquait la mort du père… A son tour il s’éclipse. Trop jeune dit Jacques Osinski. Et c’est vrai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2023 3:47 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération, 4 avril 2023 Tiphaine Raffier déploie son inventivité scénographique dans une adaptation limpide du dernier de roman de Philip Roth où la culpabilité ronge un jeune prof de sport, persuadé d’avoir transmis la polio à ses élèves. La pièce s’ouvre sur un noir plein, à peine strié d’une fine ligne horizontale éblouissante. Un narrateur, qu’on ne perçoit pas, nous parle. Est-il sur le plateau ou simple voix off ? L’espace se dévoile peu à peu comme une chambre dont on devinerait les contours des meubles. Sur le devant, un aquarium empli de deux gros poissons rouges dévoreurs et bien vivaces, placé entre deux hommes. Ils parlent de la mort, la pire qui soit. L’un annonce à l’autre celle de son fils, tandis que l’œil du spectateur se fixe sur le mouvement des poissons gloutons et indifférents. L’un des deux hommes est M. Cantor, professeur de gymnastique dévoué et bien-aimé. Nous sommes à l’été 1944 à Newark, dans le New Jersey. La guerre ravage l’Europe tandis qu’une double épidémie de canicule et de polio mortelle écrase la région. La seconde décime les plus jeunes et exacerbe le racisme. M. Cantor est jeune et myope, trop pour aller au front, et il s’en veut. Il sait en tout cas qu’il n’abandonnera pas ses élèves de Newark – les plus fortunés ayant pu partir. Il a désormais son propre front, sa propre guerre à mener. Malle aux trésors La metteuse en scène Tiphaine Raffier, 37 ans, pleinement repérée mais pas encore reconnue à l’égal d’un Julien Gosselin avec qui elle a débuté, n’a besoin de presque rien pour nous faire éprouver tout à la fois les maigres terrains sportifs urbains, une chaleur extrême, une situation paroxystique intime et collective. Elle fait partie de cette poignée de metteurs en scène qui plongent les spectateurs à l’intérieur d’un livre, comme certains dessins font entrer à l’intérieur d’une pomme ou d’une noix. Qu’on ait lu ou pas Némésis, l’ultime roman de Philip Roth paru en 2012, importe peu. Si l’on perçoit une fidélité aux mots de Roth, l’objet scénique qu’elle conçoit est autonome. Particulièrement brillante est la manière dont elle enchâsse les dialogues dits par les acteurs avec des moments narrés qui supposent un décrochement temporel. Frappant est son art des contrastes, notamment scénographiques. Le plateau que l’on croyait dépouillé se révèle une malle aux trésors. Non seulement, à l’arrière, un orchestre joue en direct, mais certains instruments semblent provenir de la jauge elle-même. Incroyable est la façon dont on est soudainement projeté dans les monts Pocono, à Indian Hill, c’est-à-dire dans un paysage qui rappelle l’emballage des chocolats suisses. Nous voici entourés d’enfants qui tournoient au bord de vertes prairies. Dans ce paradis, les gens ne parlent plus mais ils chantent et la référence aux comédies musicales hollywoodiennes, bien qu’absente du livre de Roth, n’a rien d’arbitraire. Lorsqu’ils plongent dans le lac, ils volent – scènes géniales d’apprentissage de plongeons. Cantor le pédagogue est parti rejoindre celle dont il est amoureux. Elle l’aime, ses parents approuvent le mariage, et tout irait pour le mieux si l’amoureux ne s’éprouvait pas tragiquement responsable et coupable. Peu après son arrivée, l’épidémie s’est abattue dans le paysage idyllique qu’il s’accuse d’avoir contaminé… Grain de sable Dans la mythologie grecque, Némésis est le nom de la déesse de la vengeance qui punit les humains coupables d’hybris, c’est-à-dire d’une démesure souvent engendrée par l’orgueil. La culpabilité de Cantor, sa manière de se croire responsable de la catastrophe, est-elle une forme d’hybris ? Les enjeux narratifs du roman de Roth sont clairement narrés, et on ne peut que louer Tiphaine Raffier d’opter pour la limpidité. Au risque d’être parfois un peu trop explicite. Est-ce grave, docteur ? Non, pas spécialement. Les metteurs en scène savent bien que les spectateurs perdent 80 % des informations qui leur sont délivrées, et on leur sait gré quand ils en tiennent compte. Ce qui dérange légèrement, à la manière d’un grain de sable mal placé, est plus subtil. Les acteurs ont beau pour la plupart être excellents, et en premier chef Alexandre Gonin qui interprète Cantor, tout se passe comme s’ils pouvaient en partie se passer du public. Ils ne jouent pas tout à fait au présent, avec nous, dans la même temporalité. C’est une option de mise en scène qui se défend et n’a pas fini de questionner. Némésis adapté de Philip Roth, mise en scène de Tiphaine Raffier, à Odéon (Ateliers Berthier, 75017) jusqu’21 avril. Légende photo : Sur le plateau qu’on croyait dépouillé, on se retrouve soudain projeté dans un camp de vacances des monts Pocono. (Photo Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2023 4:47 AM
|
Par Eric Demey dans Sceneweb - 31 mars 2023 Jean-Michel Rabeux vient de l’annoncer, il mettra un terme à l’activité de sa compagnie après la reprise d’Un sentiment de vie au Lokal à Saint-Denis. Avec le temps, va, tout s’en va, on connaît la chanson. Mais ce départ, au-delà du cours normal des choses, pose question sur les évolutions de l’époque. Il l’a annoncé via la newsletter de sa compagnie, sans en faire plus de cas. Jean-Michel Rabeux cesse son activité théâtrale. Après 47 ans de mises en scène, c’est un punk qui quitte la scène, tellement iconoclaste qu’on l’aurait bien vu poursuivre jusqu’au bout. Une signature, un style et un esprit transgressifs, des personnages à poil ou en sacs poubelle, des hommes qui ressemblent à des femmes et des textes, des textes toujours en pointe et à la marge, au milieu de classiques revisités version crue. « C’est comme si je n’avais plus envie de m’adresser à mes contemporains, explique le metteur en scène, comme si je voulais que mes contemporains s’adressent dorénavant à eux-mêmes ». Rabeux a toujours eu un certain franc-parler. Alors blasé ? En guerre contre son époque ? Pas du tout. « Je vois naître des spectacles qui me bouleversent, et qui ont besoin de vivre, et dont j’ai grand besoin qu’ils vivent » ajoute-t-il. Il se souvient de ses très difficiles débuts et se réjouit que ses subventions aillent maintenant nourrir d’autres artistes. Côté face de cet éternel jeune homme, il y a toujours eu une douce bienveillance. Rabeux place d’ailleurs ce départ dans la continuité du travail qu’il effectuait au Lokal. Une salle à Saint-Denis que sa compagnie loue depuis quelques années à un privé pour y accueillir gratuitement des artistes, plutôt jeunes et dans le besoin, et leurs créations, ainsi que pour effectuer ces actions vers le public qui ont toujours constitué l’ADN de la compagnie et bien sûr diffuser ses propres spectacles. Avec le départ de Rabeux, le Lokal fermera aussi sous cette forme. Deviendra on ne sait quoi. C’était la première et dernière maison d’un artiste de premier plan qui n’a jamais cherché à diriger un lieu, de crainte que cela ne nuise à son travail artistique, mais aussi parce « que je ne sais faire qu’une chose, c’est être sur scène et voir ce qui va ou ne va pas, le reste, tout le travail de direction, ça me dépasse. Heureusement j’ai été très, très, très aidé par Clara Rousseau, ma co-directrice depuis trente ans parce que je suis inopérant dans les fonctionnements sociaux ». « J’ai fini par m’autocensurer » C’est aussi pour cela d’ailleurs, qu’il ne se sent plus vraiment à sa place dans cette époque. Des directeurs et directrices de lieu qui l’ont soutenu et accompagné ont maintenant quitté le milieu. Jean-Marie Hordé pour dernier exemple, qui vient de partir du théâtre de la Bastille, compagnon de longue date des spectacles de Rabeux. Ou encore des journalistes qui l’ont défendu quand il le fallait et qui n’officient plus. « Pour Onanisme avec troubles nerveux chez deux petites filles, s’il n’y avait pas eu Colette Godard dans Le Monde, c’était foutu. Je me souviens aussi d’une critique de René Solis dans Libé, qui nous a beaucoup aidés contre Pasqua ». Le théâtre, c’est une affaire de réseaux, Rabeux ne l’ignore pas, « mais aussi d’amitiés ». Surtout quand on propose comme lui « un théâtre de rupture ». « Et puis je travaillais pour les gens, les spectateurs, pas pour les professionnels. Je me disais si un jeune voit un vieux de 60 ans juché sur des talons avec de belles guiboles, ou un homme dont il s’aperçoit à la fin qu’elle est une femme, ça va lui faire ding dong. ». La recherche du choc, non pas pour sa vertu provocatrice, mais « pour que toutes mes folies en rupture rejoignent les ruptures que chacun a au fond de soi ». D’où ces travestis, ces personnages interlopes, ces hommes en talon et ces femmes à voix d’homme – sa compagne Claude Degliame entre autres – qui ont souvent occupé ses plateaux. Bien avant LGBTQ+, #Metoo et les polémiques qui les accompagnent . « Aujourd’hui, si je monte Onanisme, le seul titre va poser problème. Je ne suis pas un réac nostalgique du passé, mais que des censures viennent de nos rangs même, et pas forcément pour les bonnes raisons, ça me pose problème », évoque-t-il à propos d’événements récents qu’il ne veut pas que nous nommions « tant ils sont nombreux ». « Moi-même, j’ai fini par m’autocensurer. L’époque actuelle pose sur les corps que les années 70 dénudaient, glorifiaient, pour nous rendre plus libres, un regard différent du mien. » Rabeux ne renie pas l’aujourd’hui pour autant. « Les débats actuels me passionnent mais je n’y ai plus voix. Les jeunes ne savent plus ce que j’ai fait. Des femmes puissantes, des trans, des homos, j’en ai tellement mis sur scène, ce sont mes amants, mes amours, comme tous les acteurs ou actrices de mes plateaux d’ailleurs. Mais les jeunes ne connaissent pas mon travail passé. C’est normal. Le théâtre ne vit que dans la mémoire des spectateurs. C’est un art du moment. Ce n’est plus mon moment, ni pour moi, ni pour l’époque, et j’ai très envie que ce ne soit plus mon moment, que ce soit celui des jeunes, surtout les filles. On en manquait tellement ». En attendant, il y aura quand même une dernière danse. En Juin, la reprise d’Aglaé, créé au Rond-Point, et début avril, donc, celle d’Un sentiment de vie, texte de Claudine Galéa, qu’on a déjà pu voir à la Bastille, interprété par Claude Degliame et Nicolas Martel. « Claudine, à plus de 50 ans, parvient enfin à parler de son père. C’était un militaire, pied noir, colonialiste, réac limite facho. Sa mère était communiste et anti colonialiste. Mais son père l’aimait. Et sa mère la battait. » Une histoire de famille qui ne vaut que par ce qu’elle a d’universel. « Au fond, assister au tragique familial de Claudine, ça aide à vivre. Ça montre que l’amour circule au delà des différences de pensée. Une pensée progressiste, qui est évidemment aussi celle de l’autrice, peut dissimuler des violences, et une pensée réactionnaire laisser place à l’amour. La vie est complexe ». Et l’époque aussi… Eric Demey – www.sceneweb.fr Un sentiment de vie
Texte Claudine Galea (Editions Espaces34)
Mise en scène Jean-Michel Rabeux
Avec Claude Degliame, Nicolas Martel
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Costumes Sophie Hampe
Assistanat à la mise en scène Sophie Rousseau
Production La Compagnie
Coproduction La Compagnie, Théâtre de la Bastille – Paris
Avec l’Aide à la création de la Région Île-de-France Du 7 au 16 avril 2023 au Lokal à Saint- Denis Photo Benoit Linder

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2023 5:26 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog 29/03/23 Quelque part dans le Finistère, le Secrétaire d’État à l’industrie est séquestré par les salariés d’un abattoir de poulets autour duquel se sont massés journalistes et forces de l’ordre. Anne-Laure Liégeois adapte « Des châteaux qui brûlent », le roman d’Arno Bertina paru en 2017 et met en scène un huis-clos improvisé dans lequel la lutte collective s’organise. Tandis que le public s’installe dans la salle, plusieurs écrans en surplomb de la scène diffusent les mêmes images d’une usine de volailles qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus insupportables, d’autant plus qu’elles sont accompagnées par une petite musique classique dont la douceur et le raffinement contrastent fortement avec ce qui est montré. Cette grande beauté musicale et la barbarie sanguinaire carnivore à échelle industrielle ont pour point commun d’être le produit de l’humanité, capable du meilleur comme du pire, allant de la fange au sublime. D’emblée, le ton est donné. Les images de ce camp de concentration pour poulets servent de mise en bouche à la contextualisation du récit qui est sur le point de commencer. Les écrans se lèvent, s’envolent littéralement sur une dernière image où l’on coupe des têtes de poulets, puis disparaissent. Nous sommes à La Générale Armoricaine, usine d’abattage de volailles dont l’entière production est à destination du marché saoudien. Pascal Montville, Secrétaire d’État à l’industrie, revient pour la troisième fois à la rencontre de salariés inquiets, la délocalisation de leur site étant sur le point d’être officialisée. Cet homme de gauche, sincère, juge criminel le rapport qu’entretient l’entreprise aux animaux – il évoque notamment les décapitations à la disqueuse. La mondialisation et son bilan carbone justifient la décision de l’État de ne pas s’opposer à sa fermeture. Lors de cette ultime intervention, menée contre l’avis du préfet et de la direction de l’usine, il ne veut être accompagné que de Céline Aberkane, l’une de ses conseillères, ancienne syndicaliste – formidable Anne Girouard –, déchirée entre ces deux mondes, celui qui fut le sien et celui à qui elle appartient désormais. Elle se fera quelquefois narratrice de l’histoire. L’homme d’État va être séquestré. Sa collaboratrice tentera en vain de rester mais sera renvoyée hors du huis-clos improvisé qui se met en place. Tous ensemble, « faire dérailler le système » Anne-Laure Liégeois est une résistante. La metteuse en scène oscille entre textes antiques et classiques et écrits contemporains à connotations sociales, entre pièces du répertoire et insurrection ouvrière. Elle adapte ici le roman paru en 2017 « Des château qui brûlent[1] » avec la complicité de son auteur, Arno Bertina, et dont le titre est emprunté à une chanson de Neil Young, « Don’t let it bring youn down » (Ne te laisse pas abattre), « It’s only castles burning » (Ce ne sont que ces châteaux qui brûlent). Huis clos choral racontant huit jours de la vie de femmes et d’hommes qui prennent conscience de la force du collectif, de leur existence en tant que groupe, « combat joyeux de celui qui s’identifie, qui se découvre intime[2] », ce récit a une vocation universelle. Parce que les personnages n’existent pas réellement, le groupe de l’usine de Châteaulin qu’ils forment dans le roman est aussi celui de tous les autres employés d’usines. Évitant soigneusement tout manichéisme qui verrait le patron forcément méchant et les salariés miséreux, le roman et la pièce travaillent la nuance, évitent de désigner l’endroit du bien et du mal. La violence sociale subie par les ouvriers est mise en perspective avec celle qu’ils infligent involontairement aux travailleurs des pays non européens, en premier lieu africains, à la faveur de la politique agricole commune (PAC), mais aussi avec la violence physique animale de l’abattoir. Dans les deux cas, les ouvriers occupant l’usine ne le voient pas, pris qu’ils sont dans un système où chacun doit assurer sa propre survie. Tout commence donc par le roman d’Arno Bertina. On pourrait croire que l’auteur est dans le document. Il va à la rencontre des ouvriers dans les usines, participe aux mouvements de grève, mais la façon qu’il a de retranscrire cette parole passe par le filtre de l’écriture et sa sensibilité. Il « met toute sa volonté à déplacer le réel, un réel vu autrement que par les faits, il crée une œuvre d’art, quelque chose de beau qui sonne juste et qui intéresse particulièrement la langue[3] » rappelle Anne-Laure Liégeois dans sa note d’intention. Et le temps du roman n’est pas celui du théâtre. Les personnages du premier parlent une langue qui a le temps. « Comme les ‘êtres de la vraie vie’, les personnages de théâtre parlent depuis l’instant » indique la metteuse en scène avant de préciser : « Si tout spectacle commence par un défi exalté aux mots, j’ai trouvé celui-là : représenter des êtres qui racontent une histoire, des êtres à la ? langue qui a le temps, qui en cela ne sont ni personnes ni personnages. Les faire entendre particulièrement. Et faire une œuvre d’une œuvre ! » La révolution est une fête Dans cette « nef des fous à la Bosch », pour reprendre l’expression d’Anne-Laure Liégeois, qui dérive durant quelques jours, l’occupation est racontée par ceux qui la font avec l’odeur du poulet comme seule arme. Adaptant une formule présidentielle récente, « On est en guerre », le groupe tente de renverser le pouvoir. « La violence, elle est d’abord contre nous » s’écrit Fatoumata. « On garde le Secrétaire d’État et on change la violence de camp ». Et avec elle la peur. « On ne s’engueule pas ! ». Les portes de l’usine sont désormais cadenassées. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Le bonnes intentions, l’honnêteté, ne paient pas. « Les gentils ça ne fait jamais une grosse armée » entend-on. On évoque France Télécom, la chemise du DRH d’Air France… Le groupe recevra le soutien des employés municipaux, songera à la création d’une société coopérative et participative (scop), union ouvrière disposant d’une gouvernance démocratique à l’image de ce qu’ont fait les Fralibs dans le sud de la France. Certains confieront leur état de colère : « Dès que vous l’ouvrez la rage elle monte » s’entend dire le Secrétaire d’État. « Je ne veux plus de la haine. Je ne veux plus de cette colère qui m’étrangle là ». On évoque Jean Oury et la clinique de La Borde installée dans un château abandonné en 1953 après une errance avec trente-trois malades. « Ce soir la nef des fous vient d’accoster en Bretagne ». Fatoumata, point levé, chante au crépuscule. Comment faire la révolution par la fête ? Ce qui transparait dans le roman et qu’Anne-Laure Liégeois réussit à restituer sur scène, c’est une incroyable force d’optimisme, un élan humain. Les ouvrières et ouvriers unis, se regardent, se découvrent, apprennent à se connaitre sans doute pour la première fois. Ils dévoilent leur humanité. L’histoire qui est contée est celle des rapports entre un individu de pouvoir et des ouvriers. « Je vois tout ce qui est sorti depuis qu’on est enfermés ici » leur dit Montville dont le visage se confond un instant avec celui d’Arnaud Montebourg. Dans cette confrontation au pouvoir, des choses se révèlent. « Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout » écrit la philosophe Simone Weil en 1936. « Cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure. Une joie sans mélange[4] ». La réalité aujourd’hui rattrape la fiction. Que la fête commence. Le théâtre polyphonique d’Anne-Laure Liégeois promet une révolution joyeuse. Guillaume Lasserre [1] Arno Bertina, Des châteaux qui brûlent, Paris, Gallimard, 2017, 424 pp. [2] Anne-Laure Liégeois, Note d’intention, dossier artistique Des châteaux qui brûlent. [3] Ibid. [4] Simone Weil, « La Vie et la grève des ouvriers métallos », paru sous le pseudonyme S. Galois, La Révolution prolétarienne, n° 224, 10 juin 1936 DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT - D’après le roman d’Arno Bertina, adaptation Anne-Laure Liégeois avec la collaboration d’Arno Bertina, mise en scène Anne-Laure Liégeois, avec : Alvie Bitemo, Sandy Boizard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Fabien Joubert, Mélisende Marchand, Marie-Christine Orry, Charles-Antoine Sanchez, Agnès Sourdillon, Assane Timbo, Olivier Werner, Laure Wolf. Scénographie Aurélie Thomas, Anne-Laure Liégeois, lumières Guillaume Tesson, création sonore François Leymarie, costumes Séverine Thiebault, vidéos Grégory Hiétin, régie générale François Tarot, construction décor Atelier de la Comédie de Saint-Étienne, production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois ; en coproduction avec Le Volcan – scène nationale du Havre, La Comédie de Saint-Étienne, la Maison de la Culture d’Amiens, La Filature – scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, L’Équinoxe – scène nationale de Châteauroux, Le Manège–scène nationale de Maubeuge; avec l’aide au montage d’Artcena ; avec la participation artistique du Studio-ESCA ; en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. Le texte est lauréat de l’aide à la création dramatique d’Artcena en 2022. Spectacle créé le 9 novembre 2022 au Volcan - Scène nationale du Havre, vu à La Filature – scène nationale de Mulhouse, le 14 décembre 2022. Légende photo : Des châteaux qui brûlent, Anne-Laure Liégeois d'après Arno Bertina © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 28, 2023 5:19 AM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération le 28/02/2023 Le metteur en scène se plonge dans ses souvenirs de l’école de théâtre, intégrée en 2001, pour raconter vingt ans après l’évolution d’une génération qui s’est construite dans un monde en ébullition. En 2021, Guillaume Vincent, metteur en scène qui n’a pas signé de pièce depuis trois ans, est appelé par l’Ecole du Nord pour animer un stage avec la promotion 6, dont sont issus les sept comédiens qui formeront le casting des représentations en cours sur la scène du Théâtre des Bouffes du nord. Le Covid et son confinement leur tombent dessus, l’occasion de faire le point, de regarder vers le passé. Pour Guillaume Vincent, ce sera un flash-back de l’année 2001, celle où il intègre l’école du TNS de Strasbourg. Qu’en retient-il ? Loft story, les attentats du 11 septembre, et un an plus tard, en France, la sidération de voir le Front national au second tour. Vingt ans plus tard, la téléréalité fictionnalise nos vies sur écrans et réseaux sociaux, le terrorisme islamiste a fait de multiples ravages internationaux et Marine Le Pen s’est enracinée comme jamais. Tout cela sera donc la toile de fond de cette pièce qui raconte la destinée de ces jeunes hommes et femmes, qui en 2001, entrent dans une école, rêvent de scènes politiques pour un théâtre qui changerait le monde. Que vont-ils devenir ? Roman d’apprentissage, éducation sentimentale et illusions perdues, voilà leur histoire construite en aller-retour entre les souvenirs du metteur en scène et la biographie que les jeunes acteurs s’inventent – c’est leur exercice de stage. Toute la fragilité de la pièce est là, dans l’extrême scénarisation des parcours, des personnalités bien identifiés à leur storytelling : la «blonde» aux prises de parole systématiquement ponctuées d’un gimmick de stand-up («j’rigole… non j’rigole pas»), ou l’homme gay qu’on suit depuis le diagnostic de sa séropositivité jusqu’à l’avènement de sa paternité… Chacun a bien travaillé son registre, des bons élèves qui n’oublient pas d’évoquer les débats actuels : le manque de diversité dans les écoles de théâtre – et qui se vérifie une fois de plus sur le plateau –, une baise alcoolisée reconsidérée vingt ans après en viol, et même la mobilisation contre la réforme des retraites avec un texte lu en solidarité avec les manifestations jeudi dernier, soir de la première. On peut saluer ici le souci de coller à son époque, d’exprimer le «vertige» d’une génération désenchantée, mais qu’est-ce qui se dit de leur pratique du théâtre ? La réponse : ironie et second degré avec deux exercices de mises en scène en miroir de Feydeau et Platonov d’Anton Tchekhov volontairement et caricaturalement «contemporaines» : nouvelle traduction bite et cul pour Tchekhov, fesses à l’air pour rajeunir Feydeau. A ce point de la représentation, on se demande quelle est cette idéologie masochiste qui anime la pièce. Le sauvetage vient des autres textes qu’injecte et superpose Guillaume Vincent : la prose splendide des Vagues de Virginia Woolf et des extraits de l’œuvre angoissée de Tchekhov, qui trouvent ici une convergence nouvelle. Vertige 2001-2021 de Guillaume Vincent. Jusqu’au 8 avril au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, du 12 au 14 avril à la Comédie de Reims, du 25 au 27 avril au Centre dramatique national Besançon Franche-Comté, et du 6 au 9 juin au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Légende photo : Guillaume Vincent en 2020. (Louise Quignon/Hans Lucas)
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...