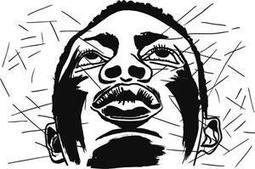Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2017 7:29 PM
|
Par Ève Beauvallet dans Libération/Next
Julie Duclos peine à troubler avec son portrait d’une petite fille meurtrière inspiré d’un fait divers des années 60.
Preuve ultime que les enfants criminels provoquent une fascination sans bornes : le site de divertissement spécial «best-of» Topito.com consacre un «Top 11 des enfants tueurs, ceux qui vont bien te faire flipper». La première place revient à Mary Bell,Anglaise de 11 ans jugée en 1968 pour avoir étranglé deux garçons de 3 et 4 ans et qui fait toujours parler d’elle. Si Topito.com est ferme sur le sujet, «Mary Bell effraie par la gratuité totale de ses actes», la journaliste et écrivaine Gitta Sereny avait tenté, en 1998, de s’attarder sur le profil socio-psychologique de la meurtrière dans sa biographie Cries Unheard (Une si jolie petite fille en France).
Traumatisme
Aujourd’hui, c’est sur le plateau de la metteure en scène Julie Duclos, avec un texte signé Dorothée Zumstein, que se poursuit cette entreprise de dédiabolisation. La psychiatre et psychanalyste Francesca Biagi-Chai, invitée à débattre à la Colline, insistait auprès de Julie Duclos : «Ce que vous amenez, c’est un regard sur cette enfant. Un regard pour savoir et non pour jouir, comme peuvent le faire les médias qui se repaissent de cette histoire.» On est d’accord, c’est déjà beaucoup. Mais pas forcément suffisant pour faire de MayDay l’œuvre désarçonnante, touchant à la «fascination pour l’incompréhensible» qu’elle aurait pu être. Dommage, par exemple, que la place du spectateur (ses attentes, son voyeurisme, sa morale) n’ait pas été davantage malmenée. Une histoire de parti pris : MayDay s’éloigne en fait du mélodrame social pour choisir le chemin de l’investigation psychanalytique, en remontant le fil du temps sur trois générations, jusqu’à dénicher le traumatisme originel. La pièce se construit ainsi sur une succession de portraits intimistes : Mary Bell adulte repense à Mary Bell enfant (épatante Alix Riemer), maltraitée par une mère prostituée, elle-même victime du silence de sa propre mère, etc.
On comprend l’attrait de Julie Duclos et Dorothée Zumstein pour la mécanique étrange et romanesque de ces secrets de famille qui peuvent «suinter» sur plusieurs générations.
Balises
Et lorsque le rêve récurrent de Mary Bell adulte (un bras immobilisé l’empêche d’actionner la poignée d’une porte) trouve sa source dans une action clé, bien réelle, effectuée par la grand-mère à des décennies de distance, on se prépare à prolonger la soirée en lisant les Secrets de famille (PUF), un ouvrage qui regorge de jeux de pistes similaires dans lequel le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron décrypte ces phénomènes de ricochets entre passé et présent. C’est d’ailleurs le principal effet de ce spectacle un peu scolaire, trop attaché aux balises du bon goût (un juste dosage entre jeu live et vidéo, entre fantasmes et réalisme, et une pincée de sound design) pour susciter un trouble plus puissant.
Ève Beauvallet
MayDay de Dorothée Zumstein ms Julie Duclos, jusqu’au 17 mars au théâtre national de la Colline, du 21 au 25 mars aux Célestins - Théâtre de Lyon, en tournée à Besançon, Orléans, Reims et Dijon jusqu’en mai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2017 2:20 PM
|
Par Emilie Grangeray dans M le magazine du Monde
Tout jouer, tout oser… La comédienne change de registre comme de costume, avec une aisance folle. Cette année encore, à la Comédie-Française, elle jonglera entre « La Règle du jeu » et « Lucrèce Borgia ».
Certes, c’est l’essence même du travail des comédiens que de sans cesse changer de peau. Certes, à la Comédie-Française plus qu’ailleurs, ils jouent parfois plusieurs rôles dans la même journée. Mais de novembre 2016 à janvier 2017, il fallait voir Elsa Lepoivre, 44 ans, quitter ses couettes et sa salopette de Marinette, dans Le Cerf et le Chien, de Marcel Aymé, pour endosser une heure plus tard celui de l’intrigante Sophie von Essenbeck dans Les Damnés, la pièce mise en scène par Ivo van Hove, à partir du scénario de Visconti. Et voici qu’elle recommence. Depuis le 4 février, elle est Geneviève dans La Règle du jeu, de Jean Renoir, mise en scène par Christiane Jatahy, et la Lucrèce Borgia de Victor Hugo dirigée par Denis Podalydès. « Elle fait partie des rares à pouvoir interpréter n’importe quel rôle, à pouvoir entrer dans n’importe quel répertoire », commente le comédien-metteur en scène.
Le prestige des rôles qu’elle enchaîne n’est pourtant pas sa motivation première. « Ce que j’aime, c’est aller à la rencontre de la femme – ou de l’homme, mais ça ne m’a encore jamais été demandé – qui m’est proposée. C’est me fondre, me perdre dans ce personnage. L’autre m’intéresse dans la vie. Un rôle m’enrichit toujours. C’est comme si j’avais des parts manquantes et que les rôles remplissaient ces cases. » Une manière d’aborder son métier révélatrice de sa personnalité.
« J’AI UN CÔTÉ BONNE OUVRIÈRE. LA CONSCIENCE ET LE RESPECT DU TRAVAIL, J’Y TIENS BEAUCOUP. » ELSA LEPOIVRE
Elsa Lepoivre confie douter de sa légitimité. En 2003, quand Marcel Bozonnet, alors administrateur général du Français, l’appelle pour lui proposer de rejoindre la troupe, elle croit à une blague. Il faut dire que c’était un 1er avril. Quatre ans plus tard, le jour où elle devient sociétaire, c’est tremblante qu’elle appose sa signature en bas de son contrat avec la Maison de Molière. « Je n’arrivais pas à croire que j’avais ma place. Une place parmi eux, avec eux, raconte-t-elle les yeux mouillés. Ce n’est pas une grande place que je veux, mais être acceptée ; une “juste” place. Je me dois d’être à la hauteur. J’ai un côté bonne ouvrière. La conscience et le respect du travail, c’est quelque chose qui me vient de ma famille et auquel je tiens beaucoup. »
L’amour du collectif
Les rôles et les textes, elle les a découverts au lycée, à Caen. Elle commence à y faire du théâtre, sans envisager alors de devenir comédienne. Arrivée à Paris, elle s’inscrit à l’école Claude Mathieu. Ce fut un vrai apprentissage de la vie : habiter dans 8 m2, cumuler les petits boulots pour soulager ses parents. Être indépendante, financièrement d’abord, est pour elle une nécessité. D’autant que ses deux grands-mères n’ont eu de cesse de lui répéter : « Ne te marie jamais. » « De fait, je ne me suis pas mariée », dit-elle dans un grand rire, tout en évoquant son compagnon ingénieur du son. Entrée à l’école de Pierre Debauche, elle participe à la création du Théâtre du Jour, à Agen. Pour le spectacle d’ouverture, en 1994, elle joue Nina dans La Mouette, d’Anton Tchekhov. « Je crois que ce qui m’attirait le plus alors c’était le collectif. J’étais en quête de légèreté. »
Confirmation d’Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, qui souligne le côté clown d’Elsa. « Sa beauté, et c’est rare, ne l’embarrasse pas. En coulisses, c’est une gamine qui aime à faire des grimaces. » C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle Véronique Vella l’a choisie pour jouer Marinette dans Le Loup puis Le Cerf et le Chien : « Elsa, c’est un soleil. Elle met un point d’honneur à ne pas se plaindre. Elle traverse les épreuves, prenant le meilleur, même du pire. C’est sa manière d’être au monde – que je trouve particulièrement inspirante. »
« Je mesure la chance qui est la mienne, dit Elsa Lepoivre. La joie est là, intacte. Je l’entretiens, je la cultive. Parce que la vie est difficile aussi et parce que, comme tout le monde, j’ai traversé des épreuves douloureuses. » Notamment il y a sept ans. Une grave maladie. La mort de son père. L’effondrement de sa mère. « Même si c’est étrange de l’énoncer ainsi, je n’ai pas peur de mourir. Je prends donc tout ce qui m’arrive comme si c’était du “en plus”. » Elle ajoute : « On peut toujours baisser les bras. Je le comprends, l’observe avec douleur quand cela touche celles et ceux qui me sont proches. »
« Se laisser traverser »
Raison pour laquelle, sans doute, elle est très attachée au rôle de Macha, dans Les Trois Sœurs, d’Anton Tchekhov, qu’elle a jouée dans la mise en scène d’Alain Françon. Une Macha à la « mélancolie active », comme elle dit. « C’est un personnage que je trouve bouleversant. J’aime sa colère sourde, la lutte qu’elle mène. Le côté stagnant, irréversible, me terrifie. J’aime faire bouger les lignes. » Elsa Lepoivre a fait plusieurs psychanalyses, dont elle parle aisément : « Les gens enfermés dans leurs névroses, ça ne m’intéresse pas. Apprendre à être le plus honnête, le plus clairvoyant possible avec moi-même, oui. D’autant que je suis persuadée que cela n’ôte rien émotionnellement à ce que j’ai envie d’explorer, au contraire. »
Pour expliquer sa boulimie de rôles, elle cite Opening Night, de John Cassavetes : « S’inventer une vie à travers celles qu’on incarne me protège du monde réel. Je suis constituée d’une foule de personnages. J’aime bien le terme de “porosité”. Se laisser traverser, j’en ai besoin, ça me rassure. C’est devenu une drogue, poursuit-elle. Le théâtre, c’est toute ma vie aujourd’hui, c’est d’ailleurs un peu angoissant, j’ai du mal à refuser un rôle. »
Ses proches soulignent son humilité, le regard, attentif, précis, toujours bienveillant qu’elle porte aux autres et qui en fait une camarade exceptionnelle. « En ce moment, je réfléchis beaucoup au collectif. Enfant, je voulais aller en colonie, à l’internat. Manque affectif ? Peut-être. Je suis la deuxième de trois sœurs, j’étais celle qui apaise. Le théâtre a été pour moi un moyen de sortir des choses. Mais au-delà, j’aime être en bande. » À la Comédie-Française, Elsa Lepoivre s’est trouvée autant de rôles que possible. Et une tribu.
« La Règle du jeu », de Jean Renoir. Mise en scène de Christiane Jatahy. Jusqu’au 15 juin. « Lucrèce Borgia », de Victor Hugo. Mise en scène de Denis Podalydès. À la Comédie-Française, site Richelieu, place Colette, Paris 1er. Jusqu’au 28 mai. www.comedie-francaise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 28, 2017 8:15 PM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks
S’emparant du théâtre comme d’un média sensible et politique, Milo Rau questionne l’époque sans hésiter à traiter de façon subversive des sujets aussi brûlants que l’affaire Dutroux ou les massacres dont sont victimes les Syriens.
Auteur d’un théâtre documentaire multiprimé dans toute l’Europe, Milo Rau a installé son camp de base en Allemagne. Sa maison de Cologne abrite sa famille et l’International Institute of Political Murder (IIPM), un outil de production à la dénomination explicite créé en 2007 pour décider en toute liberté des sujets de ses spectacles. Engagé sur le terrain du politique, le metteur en scène suisse-allemand a fait de “l’intime partagé des victimes” son cheval de bataille pour traiter de l’actualité et des questions de société à partir de témoignages souvent relayés par la vidéo.
Et il se saisit d’instinct de notre échange pour le transformer en un minireportage sur sa vie. S’amusant des possibilités de Skype, il cadre entre deux questions Blini, son chat en boule sur le canapé. Quand une sonnette retentit, il se lève, l’ordinateur à la main, pour ouvrir et nous présenter à Romy, l’aînée de ses filles qui a 9 ans et rentre de l’école. Cette volonté d’intriquer en permanence de l’humain à chacun de ses actes est constitutive de la générosité de son travail. Après des études en littérature et linguistique, c’est à Paris que Milo Rau se familiarise avec la sociologie en suivant l’enseignement de Pierre Bourdieu, avant d’aborder la scène.
Empire, dernier acte de la trilogie consacrée à l’état de l’Europe
Critique de littérature et de cinéma à la télé et dans la presse en Allemagne, auteur d’essais politiques et professeur d’art dramatique, il est un boulimique qui revendique, à 40 ans, le statut d’artiste-citoyen. “Je ne vois pas de conflits d’intérêts à développer une pensée critique en parallèle à mes créations, précise Milo Rau, qui poursuit en riant : J’essaie de me rapprocher de l’idée défendue par Antonio Gramsci d’être un ‘intellectuel organique’ capable de produire et de réfléchir.”
Avec deux spectacles à l’affiche, le théâtre Nanterre-Amandiers propose un portrait en actes du metteur en scène. Empire est le dernier volet de la trilogie que Milo Rau consacre à l’état de l’Europe aujourd’hui. Faisant suite à The Civil Wars qui, se référant à Tchekhov, traitait de la radicalisation d’un jeune jihadiste bruxellois, et à The Dark Ages qui prenait modèle sur Shakespeare pour dénoncer le populisme, Empire, dédié à la tragédie grecque, se tisse des vies de quatre comédiens. Maia Morgenstern est roumaine, Ramo Ali est kurde, Rami Khalaf est syrien, Akillas Karazissis est grec. Mêlant histoires personnelles et parcours professionnels, ils nous entraînent du tournage du film de Theo Angelopoulos, Le Regard d’Ulysse, à une représentation de Médée, de l’enfer de la prison de Palmyre aux images de Qamichli, lieu de naissance de Ramo Ali, dévasté par la guerre et les attentats-suicides. Milo Rau : “Nous avons filmé en Irak et en Syrie. Ces champs de batailles décident de l’histoire au présent alors qu’ils représentaient ceux de l’antiquité pour les Grecs. Cela me fait dire que l’Europe est devenue un monde antique au regard de l’avenir.”
Five Easy Pieces et les crimes du pédophile Marc Dutroux
Avec Five Easy Pieces, c’est à l’invitation du centre d’art Campo, à Gand, que le metteur en scène s’essaie pour la première fois à diriger des enfants. Après Compassion – L’histoire de la mitraillette, où il épinglait l’impuissance des organisations humanitaires dans les conflits africains, cette pièce est le second volet de son chantier ouvert sur le thème de l’histoire du théâtre. S’agissant d’une troupe de comédiens âgés de 8 à 13 ans, l’entreprise inquiète quand on sait qu’elle a pour sujet les crimes du pédophile Marc Dutroux.
“L’inspiration vient de la méthode d’apprentissage du piano de Stravinsky qui donne son titre à la pièce. Les cinq actes commencent par de petits films ; les enfants doublent des adultes que nous avons filmés lors de notre enquête. Dutroux demeure un vide, un champ gravitationnel. Aborder avec eux ce sujet interdit est aussi une manière de faire tomber un tabou.” Une démarche qui fait écho à une phrase des Cahiers de prison de Gramsci : “L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, dans ce clair-obscur surgissent les monstres”. Un exergue taillé sur mesure pour qualifier le théâtre de Milo Rau et le combat dénonciateur qu’il mène sur tous les fronts.
Empire conception, texte et mise en scène Milo Rau/IIPM, en grec, roumain et arabe, surtitré en français, du 1er au 4 mars
Five Easy Pieces conception, texte et mise en scène Milo Rau/Campo/IPPM, en néerlandais, surtitré en français, du 10 au 12 mars et du 17 au 19 mars, au CDN Nanterre-Amandiers

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 28, 2017 4:14 PM
|
Publié par Jean Delterme dans Le Figaro :
Le comédien, au cœur de la tourmente depuis l'exhumation de ses messages racistes publiés entre 2012 et 2014 sur Twitter, a vu Fabrice Roux, le producteur de son spectacle Fabrice Luchini et moi exposer son point de vue dans une lettre ouverte. Dans une lettre ouverte postée peu avant midi ce mardi sur Facebook et supprimée depuis, mais toujours visible sur le site du Point, Fabrice Roux, producteur d'Olivier Sauton, lui apporte son soutien tout en exprimant son indignation provoquée par les vieux tweets assassins postés par l'artiste entre 2012 et 2014 qui visaient principalement à la communauté juive. S'adressant «à ses amis» et «à ses collaborateurs», le producteur s'est senti dans l'obligation de leur fournir «une explication». Depuis maintenant trois ans, Fabrice Roux produit au théâtre parisien de La Bruyère, le spectacle d'Olivier Sauton "Fabrice Luchini et moi".
Dans sa lettre, il distingue d'abord clairement le one-man-show, «élégant et rare, rempli de tendresse, d'intelligence et d'Amour», de la sombre affaire qui l'a semble-t-il surpris: «Le texte du spectacle ne ressemble en rien aux tweets que j'ai découverts ce week-end et dont j'ignorais jusque-là l'existence».
«Dans le métier d'acteur, on existe dans le désir de l'autre et certains artistes avides de réussite sont assez mal inspirés dans leur choix. C'est sans aucun doute le cas d'Olivier». Fabrice Roux
Fabrice Roux raconte qu'en 2014, Olivier Sauton l'avait prévenu sur l'orientation de certains de ses films et sur «une possible vague de protestation» qui s'ensuivrait. En effet, le comédien, ami de Dieudonné, avait coécrit avec lui le film L'antisémite dans lequel jouait le polémiste ainsi que son «éminence grise» Alain Soral, idéologue d'extrême droite et Robert Faurisson. À l'époque, Sauton avait dit «regretter» cet incident de parcours, rapporte encore Fabrice Roux, et ce dernier avait jugé bon de ne pas lui en tenir rigueur. Aujourd'hui, le producteur tente une justification: être «acteur est un métier où l'on est choisi, où l'on existe dans le désir de l'autre. Et parfois, certains artistes avides de réussite sont assez mal inspirés dans leur choix. C'est sans aucun doute le cas d'Olivier». Or, «ce week-end, [Roux] a reçu un coup de massue»», écrit-il. Les films de Sauton ne sont plus mis en cause. Mais il reste les tweets, «ni drôles, ni conformes à l'idée qu'[il] se fait d'Olivier». Et son producteur argumente: «Je suis laïc, républicain, et catholique pratiquant de surcroît. Je suis catholique et ma foi repose sur les fondements du judaïsme. J'ai toujours cherché à servir l'Amour et à combattre la haine.» «Meurtri, abîmé, sonné», tels sont les mots employés par Fabrice Roux qui reste encore sans voix. Mais impossible de «laisser un homme se repentant à terre, blessé, seul».
Le comédien a présenté ses excuses et exprimé «sa honte», lundi, à l'AFP. «J'attends d'Olivier qu'il m'explique l'inexplicable, [...] qu'il soit conforme à ce qu'il est sans doute devenu en partie grâce à son spectacle : un homme responsable» Fabrice Roux Son ami et producteur depuis trois ans attend désormais des confessions. «J'attends d'Olivier qu'il m'explique l'inexplicable. J'attends d'Olivier qu'il demande qu'on lui pardonne l'impardonnable. J'attends d'Olivier qu'il soit conforme à ce qu'il est sans doute devenu en partie grâce à son spectacle et qu'il n'était pas lorsqu'il a écrit ces tweets: un homme responsable», martèle-t-il dans sa lettre ouverte. «Chacun de nous peut commettre une erreur ; c'est aussi ce qui fait de nous des Hommes (…) J'ai l'espoir que les hommes peuvent changer parce que je suis avant tout un humaniste [...]», conclut Fabrice Roux. Dans le paysage médiatique français, de nombreuses personnalités ont réagi aux tweets haineux d'Olivier Sauton. Sur le réseau social, l'essayiste Raphaël Glucksmann et le politologue Laurent Bouvet sont notamment intervenus ce mardi, faisant enfler la polémique.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 27, 2017 7:15 PM
|
ParCorinne Denailles dans Webthéâtre
Style et grâce de chroniques croquées sur le vif
Généralement, on connaît de Colette les Claudine, éventuellement Chéri où la fiction anticipe la réalité (bien après la publication, elle épousera le jeune fils de son mari) ou Dialogues de bêtes que tous les enfants ont lu à l’école, son style libre et imagée, son accent bourguignon, sa passion pour les chats. On connaît peut-être moins son anticonformisme, ses talents de journaliste qu’on reconnaît dans ses points de vue sur le monde, son tempérament provocateur et sulfureux qui pousseront l’Eglise catholique à lui refuser un enterrement religieux en 1954. Au début du siècle elle s’habillait comme un homme, ne se cachait pas de ses liaisons homosexuelles. C’est justement auprès d’une de ses amoureuses, Missy, fille du duc de Morny, qu’elle découvre la scène et y prend goût. Elles jouent des spectacles de pantomime, parfois nue, dont l’érotisme fera scandale. La première mime féminine se plaisait-elle à dire. Colette a adoré le music-hall. On en trouve des échos dans La Vagabonde mais surtout dans L’Envers du music-hall, petites chroniques quotidiennes des coulisses du métier.
Dans le cadre du festival Singulis, Danièle Lebrun a choisi de faire entendre ces petits bijoux, ces instantanés capturés par la patte sûre et gracieuse de l’écrivain. La comédienne, vêtue à la Colette d’un ensemble rouge pas du tout féminin, donne vie avec grâce et humour aux saynètes dans lesquelles elle efface joliment la frontière entre personnages et narrateur, même quand Colette est elle-même personnage. Colette raconte les coulisses du métier de saltimbanque au début du XXe siècle qui n’était pas une sinécure. De train en train, d’hôtels borgnes en loges pas chauffées, les artistes ont la vie dure et c’est avec une tendre ironie qu’elle se moque de leurs travers et presque avec un souci de journaliste de révéler la dure réalité qui se cache derrière les paillettes et le rêve :« Nous sommes laids, sans grâce et sans humilité. Pâles de surmenage, ou bien rouges d’un déjeuner hâtif. La pluie de Douai, le soleil de Nîmes, le vent salin de Biarritz ont verdi, roussi ces lamentables « pelures » de tournée, grands manteaux cache-misère qui se targuent d’un genre anglais. […] Je n’ai pas passé si vite devant la vitrine de l’horloger que le miroir ne m’ait montré mes secs cheveux ternes, et ces deux ombres tristes sous les yeux, et la bouche sèche de soif, et la taille veule sous le tailleur marron dont les basques molles se soulèvent et retombent... J’ai l’air d’un hanneton découragé, battu par la pluie d’une nuit de printemps... J’ai l’air d’un oiseau déplumé... J’ai l’air d’une gouvernante dans le malheur... J’ai l’air... mon Dieu, j’ai l’air d’une actrice en tournée, et c’est assez dire... »
Colette n’a pas son pareil pour mettre en scène une tranche de vie. Parallèlement à sa carrière dans le music-hall, elle est journaliste au Matin, chroniqueuse judiciaire, critique de théâtre, rédactrice de mode, et c’est en témoin, intérieur et extérieur, qu’elle rend hommage à ces gagne-petit, à ces laissés-pour-compte. Non seulement on goûte avec gourmandise les portraits croqués par Colette mais on se régale de l’interprétation de Danièle Lebrun, tendrement malicieuse, qui, avec virtuosité et sans jamais appuyer le trait, campe les nombreux personnages, précision du trait, de l’attitude, de l’accent, ou esquisse rapide, et passe de l’un à l’autre dans un souffle, dans un mouvement. De la belle ouvrage.
L’Envers du music-hall de Colette, conception et interprétation Danièle Lebrun, adaptation et collaboration artistique, Marcel Bluwal ; lumières,, Jacques Rouveyrollis. Au Studio théâtre de la Comédie-Française jusqu’au 5 mars à 20h30. Résa : 01 44 58 15 15Durée : 1h20.
Texte au éditions Flammarion

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2017 7:20 PM
|
Propos recueillis par Alexandre Demidoff dans Letemps.ch
Il a magnétisé les plus grands acteurs, Gérard Depardieu, Michael Lonsdale et Isabelle Huppert. A 93 ans, le metteur en scène français signe son ultime spectacle, «Rêve et folie», à l’affiche du Théâtre de Vidy dès mardi. Rencontre à Paris avec un alchimiste de la nuit
Partager Tweeter Partager
Sous les toits, Claude Régy attend son visiteur comme le hibou dans sa forêt. Il est là, laineux sur l’escalier qui conduit à son repaire parisien, ce nid dissimulé dans les hauteurs d’un immeuble patricien. Il vous embrasse de ses petits yeux plissés où passe souvent la lueur d’un étonnement. Comme si dans chaque chose, même la plus triviale, il y avait toujours une faille, la possibilité de l’inconnu.
Mais on entre dans sa pièce de travail, ce belvédère ordonné où il rêve depuis si longtemps, chasse l’inutile, s’harmonise en vieil enfant. Claude Régy, 93 ans, vit comme un moine taoïste. Sur une table, des livres, dont «Les Démons» de Dostoïevski qu’il relit, mais aussi un recueil de poèmes de Georg Trakl, ce jeune homme hanté qui enjambe les interdits, dans les bras de sa sœur adorée, dans l’extase des paradis artificiels, dans l’espérance d’un accomplissement. D’une apocalypse au fond qui le sauverait du désespoir.
Une œuvre qui a valeur d’odyssée intérieure
Georg Trakl meurt à 27 ans, en 1914, dans un hôpital à Cracovie, épouvanté par ce qu’il a vécu sur le champ de bataille. Symbole: c’est à un desperado, encore un, que Claude Régy consacre son ultime chant. A l’affiche du Théâtre de Vidy dès mardi, «Rêve et folie» est la dernière station d’une œuvre qui a valeur d’odyssée intérieure.
«Je fais un spectacle par an depuis soixante ans, je n’ai plus la force pour continuer», pose doucement Claude Régy. Ce hibou-là, si peu doué pour les relations sociales, comme il l’avoue dans «Du régal pour les vautours», le film* délicat qu’Alexandre Barry lui consacre, aura réussi à entraîner les plus grands comédiens de l’époque au-delà des ténèbres. Il aura magnétisé Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Yann Boudaud aujourd’hui. «L’acteur est un excitant, d’un ordre érotique», écrit Claude Régy.
Le Temps: Pourquoi Georg Trakl, cet enfant déchiré de l’empire austro-hongrois?
Claude Régy: Je l’ai découvert il y a deux ans en lisant son histoire qui m’a fasciné, notamment sa passion incestueuse pour sa sœur. Je me suis plongé ensuite dans ses poèmes et j’ai eu la conviction qu’il fallait faire un spectacle sur son écriture, sur ce qu’elle souffle. Trakl a lu Arthur Rimbaud grâce à sa gouvernante, il s’inscrit dans son sillage.
– Qu’ont-ils en commun?
– Tous deux bouleversent l’interdit pour accéder à l’inconnu. Mais Georg Trakl est une contradiction vivante. Il a mûri pour cet inceste qui a illuminé toute sa vie une culpabilité conventionnelle. Il est exceptionnel parce qu’il secoue tous les tabous de la bourgeoisie, ceux qui concernent le sexe, l’alcool, les drogues. Mais il n’échappe pas à son éducation chrétienne.
– Quelles qualités doit posséder un acteur pour s’engouffrer dans cette matière?
– J’ai avec Yann Boudaud une relation particulière. Il a beaucoup joué pour moi à une époque et puis il en a eu assez. Il me trouvait trop obsessionnel. Il a changé de métier, il s’est tourné vers la maçonnerie, il a construit des maisons. Quelques années plus tard, il est revenu et ne m’a plus quitté. Ses qualités? Une puissance physique très grande, une voix particulière, une folie suffisante surtout pour affronter Trakl. Une petite folie, ce serait sans intérêt: il s’agit ici de toucher à des zones graves de l’âme.
– Que faites-vous le premier jour de répétition?
– Je ne demande pas à mes acteurs de connaître par cœur leur partition. Il faut la laisser flotter, travailler sur les égarements possibles. Le premier jour donc, nous lisons le texte à haute voix, j’apporte des commentaires, je suggère des images, mais je n’ai aucune idée de la suite. Pour aller loin, il faut être ignorant.
– N’avez-vous jamais de vision préalable du spectacle?
– J’espère bien que non. Je suis d’une école de gens qui ne savent pas. Sinon, comme explorer?
– La lumière, c’est-à-dire chez vous cette ligne de crête avant la nuit, est capitale dans vos spectacles. A quel moment la déterminez-vous?
– Elle naît d’une manière secrète, instinctive. Il est important que le son, le corps, l’ombre s’interpénètrent. L’élément essentiel à mes yeux est le texte. Et à partir de là, l’acteur et donc le public. L’ambition est de constituer une identité de l’écriture, de l’interprète et du spectateur.
– Vous dites privilégier le gros plan au théâtre. Pourquoi?
– On ne peut pas vivre certaines expériences dans des salles de mille spectateurs. Il faut préserver une intimité. D’où le rôle de la lumière. Quand j’ai monté «Ode maritime» de Pessoa avec Jean-Quentin Châtelain en 2009, je me suis aperçu que le travail de l’acteur était plus sensible s’il n’était pas éclairé. J’essaie de créer cette zone-là, impalpable, entre l’ombre et le jour. Les deux éléments se mêlent et à partir de là des images peuvent naître pour le spectateur.
– Vos acteurs ne jouent pas un rôle au sens convenu du terme. Ils sont conducteurs d’une parole, à la limite de la tonalité parfois.
– L’acteur est comme l’auteur, il est traversé. Je veux dire par là qu’il est d’abord un passeur, il s’abandonne aux forces qui l’animent. L’écrivain Peter Handke affirme que quand il se met à sa table, il ne sait pas ce qu’il va écrire. Ça devrait être la même chose pour l’interprète.
– Quelles sont les indications que vous lui donnez?
– On ne peut pas le dire. Il faut là aussi préserver le non-savoir, le non-agir, ces notions qui font partie du tao, cette philosophie qui est une des découvertes de ma vie. C’est parce qu’on est passif d’abord, immobile et silencieux, qu’une action et une parole seront possibles.
– Vous avez noué des liens forts avec d’immenses écrivains, Peter Handke, Nathalie Sarraute, Jon Fosse, Marguerite Duras. Qu’est-ce que cette dernière vous a apporté?
– C’était dans les années 1960, j’étais un inconnu et je lui ai demandé si je pouvais monter sa pièce «Les Viaducs de la Seine-et-Oise». Elle m’a dit oui et elle est venue à toutes les répétitions. Elle s’est retirée ensuite pour écrire un roman, «L’Amante anglaise». Elle m’appelle quelque temps plus tard et me dit: «Je crois qu’on peut faire du théâtre avec ça.» Ce qu’elle m’a appris ce jour-là, c’est que le théâtre, ce n’est pas une pièce, mais une écriture.
– A 18 ans, comment imaginiez-vous votre vie?
– Je ne pouvais pas penser que je ferais du théâtre. Je viens d’une famille bourgeoise protestante très conventionnelle. Mon père était officier, il voulait que je sois fonctionnaire dans l’administration coloniale. Il m’avait interdit de faire du théâtre: «Si tu tombes là-dedans, tu ne seras qu’un raté et un aigri.» J’ai donc fait du droit pour lui obéir, jusqu’au jour où un de mes camarades m’a lancé à Paris: «Pourquoi te consacrer au droit si tu ne penses qu’au théâtre?» J’ai traversé la Seine et j’ai poussé la porte du Théâtre Sarah Bernhardt alors dirigé par Charles Dullin, un maître. Son école était au dernier étage, tout en haut du bâtiment. Le soir, nous passions par le grenier pour accéder en catimini au poulailler et assister à ses spectacles.
– Avez-vous été heureux?
– Je ne crois pas au bonheur. On franchit le mur de l’impossible, sinon à quoi bon vivre. Et surtout à quoi bon faire ce genre de métier.
– Vous êtes intéressé par la science, par ce qu’écrit notamment Jean-Claude Ameisen, ce médecin et biologiste, producteur sur France Inter de l’émission «Sur les épaules de Darwin». En quoi est-ce inspirant pour vous?
– Il dit que la mort est une façon de sculpter le vivant. Parce qu’à chaque seconde, un million de cellules meurent, parce qu’elle est donc présente dans notre organisme, jusque dans la vie fœtale. De cette mixité entre la vie et la mort je me suis toujours occupé. On les dit antinomiques, or elles coexistent. Chercher dans cette direction donne beaucoup de force.
– «Rêve et folie» est-il vraiment l’acte ultime?
– Je le reprendrai sans doute avec «Intérieur» de Maeterlinck que j’ai monté en 2013 avec des acteurs japonais. Mais il n’y aura plus de création. J’ai l’impression d’être allé au bout de quelque chose et peut-être au-delà.
*«Du régal pour les vautours», Lausanne, Cinémathèque, lu à 18h30.
«Rêve et folie», Lausanne, Théâtre de Vidy du ma 28 février au 4 mars; http://www.vidy.ch/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2017 6:55 PM
|
Par Martine Horovitz Silberpour son blog Marsupilamima ``
Quand on passe la moitié de la semaine dans les salles des théâtres, il y a - heureusement - toujours un moment où on se dit qu'on a bien fait de sortir, d'affronter les ors du soir qui tombe (souvent plus noirs qu'autre chose) et d'aller s'asseoir quelque part pour se prendre quelque chose sur la tête qui vous emmène ailleurs.
Inspiré nous dit-on de la Conjuration des Imbéciles de John Kennedy Toole et de L'Idiot de Fédor Dostoievski, La Gentillesse de Christelle Harbonn, suprend dès les premières minutes. Gilbert emberlificote et déberlificote de longs fils colorés avec l'aide de Blandine qu'il engueule copieusement. Mais elle est gentille Blandine, elle veut surtout l'aider, le sortir de sa solitude, de sa misanthropie, de son isolement. Mais elle aussi a peur d'être seule alors elle sourit. Tout le temps.
Elle arrive à le persuader de venir chez sa mère qui lui trouvera un boulot, un petit boulot, un boulot qui lui conviendra. Et Gilbert va devenir Gloria, une sorte majordome qui a pour mission de sélectionner les intrus et de les introduire par la bonne porte. La mère, Marianne, immobile, rêve qu'elle est morte mais quand elle se réveille, elle se pose là. Là et bien là en attendant de partir pour les îles Kerguelen refaire le monde ou du moins le sien. Il y a l'autre fille, Solenne, celle qui est très belle. Et puis survient un visiteur, Adrien.
Ce mélimélo de solitudes, ça fait une famille pas plus improbable qu'un rêve et ça donne matière à anicroches, à conversations, à digressions. Chaque personnage porte le prénom de l'acteur qui l'incarne, ce n'est pas un hasard.
Il tombe des trucs du plafond, des trucs blancs, morceaux de plâtre qui se cassent comme des assiettes ratées par un jongleur maladroit, des plumes d'ange ou des confettis qui atterrissent en douceur. Des images surgissent, lorsqu'ils se mettent tous à nu, dans cette blancheur des corps du Jardin des Délices ou de sculptures de marbre ou de l'Enfer de Dante ou encore lorsque Solenne reçoit en cadeau d'anniversaire un tableau sans tableau. Les divans sont profonds mais sans assise, facile de tomber au fond. Au fond. Au fond de la Nef des Fous voguant vers un inutile et éternel ailleurs.
Photo: Ronald Reyes
Toutes les infos ici : http://www.lechangeur.org/event/la-gentillesse/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2017 8:14 AM
|
Par Hélène Girard dans La Gazette des communes
L’Observatoire des politiques culturelles (OPC) a publié le 23 février 2017 une « note de conjoncture sur les dépenses culturelles territoriales » pour la période 2015-2016. Si la tendance à la baisse des crédits se confirme, elle n'est pas généralisée et tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon.
Lire l'article sur son site d'origine, avec les graphiques http://www.lagazettedescommunes.com/491524/budgets-culture-en-baisse-dans-59-des-collectivites-territoriales/
CHIFFRES-CLÉS
59% des collectivités ont baissé leurs crédits culture en 2015-2016
25% envisagent à nouveau une baisse en 2017
(Source : OPC)
Pour la première fois, une étude fait le point sur les budgets « culture » des collectivités sur une période récente : 2015-2016. Habituellement, les enquêtes du ministère de la Culture portent sur des données remontant à 4 ans. Cette fois, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) associé au ministère de la Culture, produit une « note de conjoncture sur les dépenses culturelles des collectivités territoriales » sur la période 2015-2016, qui permet de visualiser des évolutions dont les impacts sont en train de faire sentir sur le terrain.
Fléchissement
L’implication financière des collectivités (crédits de fonctionnement), tous échelons confondus, a fléchi sur la période 2015-2016. 59% d’entre elles ont fait le choix de baisser leur budget culturel. 30% seulement, l’ont augmenté. Selon les échelons, les comportements financiers s’avèrent différents, tant pour la tendance que pour les secteurs jugés prioritaires.
(Source : OPC) LF 2017, ces crédits culture qui vont irriguer les territoires
Régions : le soutien aux associations préservé
En moyenne, la baisse des crédits culturels des régions’établit à 4%. Les arts visuels et plastiques constituent le secteur le plus sévèrement touché. Meilleure nouvelle, en revanche, pour l’éducation artistique et culturelle (EAC), dont les crédits sont stabilisés dans 4 des 9 régions étudiées et même en hausse dans 2 d’entre elles. De même, le soutien des régions aux structures et aux associations culturelles sortent, durant la période étudiée, quasi-indemnes des turbulences budgétaires.
Départements : repli sur les missions historiques
Du côté des départements, la tendance est au désengagement financier, en moyenne, à hauteur de de 5%. Mais pour un tiers d’entre eux, la coupe dépasse les 10%. « Un mouvement contenu depuis 2008 », soulignent les auteurs de la note de conjoncture. Et qui donne encore plus de relief au choix d’autres conseils départementaux qui décident d’intensifier leur engagement financier pour la culture : soit un quart des départements étudiés.
« Ces écarts sont révélateurs d’une disparité croissante des politiques culturelles départementales, souligne l’OPC. Tandis que certains continuent d’assumer un rôle moteur dans la gouvernance culturelle territoriale, en particulier en milieu rural, d’autres, plus nombreux, semblent se retirer fortement du jeu de la coopération entre collectivités. »
Parmi les premiers sacrifiés figurent les associations, touchées dans plus de 60% des départements. Egalement lourdement frappés, les événements, à commencer par les festivals, le spectacle vivant et, plus généralement, la création artistique. A contrario, les bibliothèques, les archives et le patrimoine, trois missions historiques, et même obligatoires (à travers les bibliothèques départementales de prêt et les services d’Archives départementales pour les deux premières) restent préservés.
Grandes villes : baisse modérée, mais impact « saisissant »
Environ la moitié des villes de plus de 100 000 habitants (catégorie étudiée) a réduit son budget culturel de fonctionnement. Mais dans une amplitude plus faible que dans les départements : – 7% en moyenne, avec quelques cas seulement à – 10%.
Un constat que l’OPC explique par la nature des dépenses des villes : charges de gestion de structures et charges de personnel, ces dernières ayant d’ailleurs augmenté sur la période étudiée. « Du fait de la place majoritaire des villes dans le financement culturel, l’impact sur les politiques territoriales d’une telle tendance à la baisse est particulièrement saisissant, que ce soit du point de vue des moyens, de la vitalité culturelle ou de la spirale de désengagement que cela peut susciter », s’alarme l’OPC.
Là encore, c’est l’événementiel qui trinque. L’EAC, le spectacle vivant, la création artistique étant moins touchés.
(Source : OPC)
Horizon budgétaire incertain
En 2017, la moitié des régions compte stabiliser leurs budgets culturels. Du côté des départements et des villes de plus de 100 000 habitants, les dés ne sont pas encore jetés, entre stabilité pour les uns (34% des départements et 36% des grandes villes) ou baisse pour les autres (27% des départements et 29% des grandes villes).
Au total, tous échelons confondus, ce sont près de 25% des collectivités qui envisagent une baisse des crédits pour la culture, et un peu plus de 30% qui espèrent les stabiliser. Un autre tiers n’a pas encore déterminé la tendance qui sera suivie. Seulement 3% des collectivités affirment avoir l’intention d’augmenter ces dépenses.
(Source : OPC)
FOCUS
Coopération renforcée contre l’« affaissement » des ambitions politiques
Globalement, l’OPC parle de baisse « dans des proportions qui restent contenues ». Sa note de conjonctuure avance deux raisons pour expliquer ces coupes budgétaires imposées aux politiques culturelles territoriales. Pour la première – la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, ces dernières ne font que subir de plein fouet une décision qui leur est extérieure. Et cette explication peut malgré tout laisser espérer une réflexion des collectivités pour limiter autant que faire se peut l’impact de cette pénurie de fonds publics.
En revanche, la seconde a de quoi inquiéter : «l’affaissement de l’ambition politique dans ce domaine. Bref, la culture n’a plus la même évidence dans les politiques territoriales. » Et l’OPC de faire un rappel historique qui sonne comme une exhortation : « les politiques culturelles en France ont progressé lorsqu’elles faisaient l’objet d’une ambition partagée entre État et collectivités territoriales et entre pouvoirs locaux eux-mêmes. C’est cette perspective du renforcement des coopérations qui peut redonner un élan à la culture dans les territoires. »
FOCUS
La nécessité d’un suivi rapproché
Avec cette « note de conjoncture » établie sur les deux dernières années, 2015-2016, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) veut mettre fin à un suivi trop espacé des évolutions enregistrées par les budgets culturels des collectivités territoriales. En effet, les études, complètes et détaillées, réalisées par le Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture, ne sont publiées que tous les 4 ans. Pendant longtemps, explique l’OPC, « l’absence d’un repérage réactif des budgets culturels des collectivités territoriales n’était pas un problème majeur dans la mesure où la France a connu, dans la dynamique de l’essor de la décentralisation, une longue période de progression ou de consolidation de l’effort des pouvoirs locaux en matière culturelle. » Et de préciser que la crise budgétaire apparue à la fin des années 2000 provoquent des « fluctuations rapides » de ces dépenses, que les acteurs de terrain ont besoin de connaître pour opérer négociations et arbitrages.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 6:11 PM
|
On connait le Henning Mankell écrivain de polar, auteur de l’excellente série policière des Wallander. On connait un peu moins le dramaturge engagé et passionné de l’Afrique, qui a passé une partie de sa vie au Mozambique où il dirigeait le Teatro Avenida à Maputo. C’est dans cette ville que se déroule l’histoire de Nelio, enfant jeté à la rue par les guerres civiles, Gavroche africain qui a aiguisé son intelligence face à l’adversité. Ce conte contemporain nous est narré par Antonio Maria Vaz, son ami et protecteur boulanger. Nelio est le héros tragique des temps modernes, dont Françoise Lepoix restitue la voix frêle et la précocité d’enfant sagace, accompagnée par la musique de Bertrand Binet. La légende réaliste d’un enfant du siècle, qui croise toute celles, immémoriales, des enfants défiant les adultes par leur sagesse.
COMÉDIA INFANTIL de Henning Mankell
Avec Bertrand Binet & Françoise Lepoix.
Françoise Lepoix : adaptation, mise en scène / Françoise Lepoix :adaptation / Agneta Ségol & Pascale Brick-Aïda (éditions du Seuil 2003) :traduction / Frédéric Leidgens : collaboration pour l’adaptation du texte / Raffaëlle Bloch : scénographie / Bertrand Binet : musique / Quentin Dumay : son
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers
25 Février au 10 Mars 2017
ven à 20h30, sam à 18h et dim à 16h / séances scolaires lun, mar, jeu à 15h
Théâtre d’Ivry
Le jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mars 2017

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 12:43 PM
|
Publié dans Télérama
Le Centre recherche théâtre handicap propose une formule originale pour permettre aux aveugles d'accéder au musée et au théâtre. Explications de sa directrice, Emilie Bougouin.
En quoi consistent « Les Mythes revisités » ?
C'est un parcours qui s'adresse au public aveugle et malvoyant, qui comporte des spectacles en audiodescription ou avec les Souffleurs d'images et des visites contées ou tactiles. Ce qui est inédit, c'est la richesse de l'offre culturelle proposée.
Pourquoi ce thème ?
Nous avons joué sur la correspondance de la programmation de nos trois partenaires, le Théâtre national de la Colline, le Théâtre de l'Aquarium et le musée du Louvre. Chacun avait déjà travaillé sur l'accessibilité des publics et, au-delà, nous avons voulu explorer la question du sens : revenir aux mythes, c'est raconter, écouter, apprendre, rêver ensemble...
Concrètement, comment ça se passe ?
Le spectateur compose lui-même son parcours. Il s'inscrit pour deux spectacles, Les Larmes d'OEdipe à la Colline et Les Métamorphoses à l'Aquarium, a accès à l'expo « Le corps en mouvement » et à l'Ecole du regard à la Petite Galerie du Louvre, à une répétition des Métamorphoses, ainsi qu'à des visites tactiles des décors de la pièce. Il peut aussi faire appel à l'un de nos Souffleurs d'images pour l'accompagner. Ce dernier va s'attacher à donner l'information que le spectateur souhaite avoir, en s'adaptant à ses besoins et à son niveau de handicap.
« Les Mythes revisités », jusqu'au 2 avril, 24 €. Réservation sur crth.org/?page=souffleurs et au 01 42 74 17 8

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 5:55 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde
Paru en août 2015, Un amour impossible a été publié en poche (J’ai lu) en septembre 2016, avec la « Conférence à New York », un texte dans lequel Christine Angot revient sur le chemin qui l’a conduite au roman. Un long chemin : depuis qu’elle écrit, trente ans, Christine Angot pense à un livre non pas sur sa mère – elle déteste ce « sur » qui, selon elle, surplombe la réalité mais ne la contient pas –, mais un livre qui raconterait la mère, ce que sont l’amour maternel et l’amour pour une mère. Avant d’en arriver là, elle est passée par le père, qui a scellé sa vie par l’inceste, et qui est mort après la parution de L’Inceste, justement, en 1999. De la mort de sa mère, âgée de 83 ans, Christine Angot écrit : « Je ne la supporterai pas. » Elle écrit aussi : « Ça m’ennuierait beaucoup de devoir attendre la mort de ma mère pour faire ce livre. Ce serait nul. Ce serait pathétique. »
Lire l’entretien avec Christine Angot : « Le théâtre est le seul endroit du présent »
Le désir de lui rendre hommage fut donc le plus fort, comme le raconte Christine Angot dans sa conférence prononcée à New York, qui a constitué un socle important dans le travail mené par Célie Pauthe pour faire passer Un amour impossible au théâtre. Car il est beaucoup dit, dans ce texte que Christine Angot a lu, un soir de décembre 2016, lors de la création du spectacle au Centre dramatique national de Besançon, dirigé par Célie Pauthe, et qu’elle lira de nouveau à Paris, aux Ateliers Berthier de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, où le spectacle est présenté du 25 février au 26 mars. C’est un spectacle simple, qui ne cherche pas midi à 14 heures, mais restitue le roman, devenu une pièce écrite par Christine Angot et nourrie par les discussions entre l’auteure et la metteuse en scène.
Une admiration folle
Au départ, Célie Pauthe voulait se concentrer sur la fin du roman, qui réunit la mère et la fille dans un restaurant parisien où les mots viennent enfin, après des années de luttes sourdes ou violentes, et de silences tout aussi lourds. Evidemment, la question qui retient l’attention, c’est celle qui traverse les débats « sur » l’inceste : pourquoi n’as-tu rien dit ? Pourquoi n’as-tu rien fait, toi qui savais ? Mais cette question, peu à peu, s’efface devant celle qui est essentielle pour Christine Angot : comment ? Comment elle, jeune fille née de l’amour entre une mère juive pauvre et un père bourgeois antisémite, et élevée par sa mère seule, le père n’ayant pas voulu d’une femme indigne de son rang, a-t-elle été l’objet de l’inceste ? Pour cette raison même. La raison sociale, qui a fait qu’un homme s’est donné tous les droits, au nom d’une supériorité dont il ne doutait pas.
CHRISTINE, SUR SCÈNE, C’EST MARIA DE MEDEIROS, QUE L’ON VOIT TROP PEU EN FRANCE
Prendre la fille comme objet de l’inceste, c’était en sorte une manière définitive de sceller une guerre sociale, dit Christine Angot, qui donne ainsi une explication à l’inceste, sans pour autant fournir plus d’explication. Mais il y eut de l’amour, entre la mère et le père. Mais il y eut un amour grand comme l’enfance, entre la mère et la fille, à Châteauroux, puis à Reims, avant la première rencontre entre le père et la fille. Et il y eut de l’admiration, une admiration folle de la fille pour le père quand elle le connut et découvrit un monde de culture et d’aisance qu’elle ignorait. Ainsi, il y eut une vie, celle de la mère et de la fille, indissociablement liées jusqu’à l’arrivée du père. Puis il y eut deux vies, celle de la mère et celle de la fille, liées par un amour impossible. Et un long, si long chemin pour reconquérir cet amour.
Christine Angot voulait que ce chemin soit visible dans la pièce. Avec raison : comment comprendre, sinon ? Elle a donc écrit des scènes qui suivent, comme de petits cailloux, l’histoire de la mère et de la fille, Christine, dans le roman. Christine, sur scène, c’est Maria de Medeiros, que l’on voit trop peu en France. Elle a en elle tous les âges de la vie, comme elle dit (pas la vieillesse, tout de même !), et elle sait aller les chercher pour sautiller comme une enfant à la voix haute, pour crier comme une adolescente en pleurs qui ne peut pas dire ce qui lui est arrivé, mais voudrait que sa mère le comprenne, pour parler comme une femme déchirée, devenue mère, qui n’arrive plus à voir sa propre mère, puis comme un écrivain adulte, décidé à poser les mots qui libéreront.
Justesse décalée
Face à elle, brune, il y a Bulle Ogier, blonde. Non pas le jour et la nuit, mais un jour et une nuit. Portée et accablée, ou accablée et portée, par le souvenir de l’amour pour le père de sa fille. Dévastée par l’inceste qu’elle sait, mais qu’elle ne peut pas nommer ni combattre, sinon par la maladie, quand il lui est dit par un ami de la famille. Déséquilibrée par cet « entre » qui désormais la lie à sa fille. Patiente et attentive. Complexe. Bulle Ogier joue cette femme par petites touches : elle a vécu, elle aussi, un « trop » qu’elle ne peut effacer, mais qu’elle voudrait tenir à distance. Là encore, c’est comme l’amour pour sa fille : impossible. Et Bulle Ogier le rend avec cette belle justesse décalée qui n’appartient qu’à elle.
Quelques éléments de décor, quelques images filmées pour certains passages : Célie Pauthe n’en rajoute pas. Elle est même un peu contenue, comme sur la défensive. C’est en tout cas le sentiment que donnait le spectacle, quand nous l’avons vu à Besançon, à la création. A Paris, il a un mois pour se délier. Un temps à l’image, théâtrale, de celui qu’il a fallu à la mère et à la fille pour se retrouver. Ou se trouver.
Un amour impossible, d’après le roman de Christine Angot, adapté par l’auteure. Mise en scène : Célie Pauthe. Avec Maria de Medeiros et Bulle Ogier. Odéon-Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier, 1, rue André-Suarès, Paris 17e. Tél. : 01-44-85-40-40. Du mardi au samedi, à 20 heures. De 8 € à 38 €. Durée : 1 h 40. Jusqu’au 26 mars.
Samedi 4 mars, à 16 heures : lecture de « Conférence à New York », par Christine Angot.
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 4:47 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Au départ, le mystère d’un double meurtre d’enfants commis par une enfant d’onze ans. Au final, un spectacle qui s’assassine. Entre-temps, un livre de bon journalisme qui inspire une pièce qui manque de mystère.
Il arrive qu’une scénographie (plus spatiale qu’un décor) écrase un spectacle comme un camion écrase un chien. C’est ce qui arrive à Mayday, le nouveau spectacle de Julie Duclos présenté actuellement sur la grande scène du théâtre de la Colline. Il ne faut nullement incriminer la scénographe Hélène Jourdan qui fait son boulot, mais la commande qui lui a été faite et qui s’avère meurtrière.
Un monde de femmes meurtries
La pièce écrite (il y a onze ans) par Dorothée Zumstein est fondée sur un fait divers relaté dans un ouvrage publié par la journaliste anglaise Gitta Sereny. Cette dernière a suivi le procès d’une enfant d’onze ans, Mary Bell, meurtrière de deux petits garçons un peu plus jeunes qu’elle. La journaliste retrouve la meurtrière, trois décennies plus tard : elle est sortie de prison depuis près de vingt ans, elle s’est mariée, a mis au monde une petite fille, elle a dû déménager après avoir vu son logis être la cible de pierres. Depuis son procès elle n’a plus jamais parlé des deux enfants qu’enfant elle a étranglés mais là, devant la journaliste, elle parle d’elle, du double meurtre ,de sa mère, de sa grand-mère. C’est ce livre, Une si jolie petite fille (traduction parue en Points Seuil), qui a inspiré sa pièce Mayday à Dorothée Zumstein.
Fascinée par l’acte terrible d’une petite fille d’onze ans, l’auteur remonte le temps avec comme point d’appui l’interview avec la journaliste où, devenue femme d’un âge mûr, toujours ravagée par son acte trente ans après, renommée Mary May, elle revient sur sa vie, son enfance, sa mère, sa grand-mère. Dorothée Zumstein note que les rôles peuvent être éventuellement tenus par la même actrice, ce que Julie Duclos ne choisit pas de faire avec raison. C’est un monde de femmes meurtries où l’homme n’est pas absent mais interdit. En remontant le temps, on arrive à la source de cet interdit à la fin de la pièce. Lequel n’explique rien mais émet des signes du côté du fatum. C’est un fait divers dont le mystère demeure (ce sont deux meurtres sans cause) et c’est ce mystère que Dorothée Zumstein entend déployer, mais elle le fait trop timdiement, par le biais du rêve introductif qui ouvre la porte de la pièce mais aussi la referme, et par une langue qui se voudrait poétique mais manque d’ampleur, de déflagrations.
Une envie de cinéma
C’est cette pièce qu’a lue d’abord Julie Duclos avant de savoir qu’elle était basée sur un fait divers réel. Ce soubassement lui a donné l’envie d’aller « sur les lieux de l’affaire » à Scotswood, « d’aller voir de plus près ». Et on peut penser que les lieux traversés ont été à la source de ce que l’on voit sur scène : un chantier d’immeuble éventré avec un étage branlant, de gros piliers, un tas d’ordures, un lieu d’abandon assez réaliste et surtout massif.
A droite, au fond de la scène, devant un grand vide, un petit cabanon tenant lieu de cuisine, de compartiment de chemin de fer, un lieu peu visible pour les spectateurs, c’est en fait un lieu de tournage de scènes projetées au-dessus sur un grand écran où apparaissent également les images de l’interview de la meurtrière d’onze ans devenue quadragénaire. La vidéo est très présente dans ce spectacle, comme elle l’était dans Nos Serments que Duclos avait présenté dans le même théâtre il y a deux ans, c’est un axe qu’elle privilégie dans son travail. On ne retrouve pas ici la légèreté, l’aisance du précédent spectacle inspiré librement du film de Jean Eustache La Maman et la Putain. On se croit trop souvent sur un plateau de cinéma et la scénographie serait, en effet, un passionnant lieu de tournage. Peut-être Julie Duclos aurait-elle dû baisser le rideau, tout filmer, monter en direct et projeter le tout sur un écran déroulé devant le rideau de fer. Assumer jusqu’au bout son envie de cinéma.
Les acteurs semblent perdus dans cet espace trop imposant pour cette pièce d’où toute une série de gesticulations, de traversées errantes du plateau et de danses rageusement piétinées, voire d’étreintes avec un homme (un intrus dans cet univers) pour « meubler » l’espace et les limites du texte. Seules Marie Matheron, l’ancienne meurtrière, devenue mère, et Alix Riemer (déja remarquée dans Nos serments), la jeune meurtrière, parviennent à donner, ici et là, une certaine épaisseur à leur personnage.
Théâtre de la Colline du mer au sam 20h30, mar 19h30, dim 15h30, jusqu’au 17 mars ;
Théâtre des Célestins (Lyon) du 21 au 25 mars ;
CDN de Besançon du 11 au 14 avril ;
CDN Orléans du 26 au 28 avril ;
Comédie de Reims, du 10 au 13 et du 16 au 18 mai ;
Théatre de Dijon lors du festival Théâtre en mai (dates à préciser).
La pièce, initialement titrée Big Blue Eyes et publiée aux éditions Quartett avec une préface de Philippe Duclos, vient de reparaître sous le titre Mayday choisi par l’auteur pour sa traduction de la pièce en anglais.
Scène de "Mayday" © Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2017 7:34 PM
|
PARIS (AFP) -
Le comédien Jean-Pierre Jorris, qui a incarné Rodrigue dans le premier "Cid" monté à Avignon par Jean Vilar, est décédé mardi à Paris à 91 ans, a annoncé mercredi son fils à l'AFP.
Né en 1925, Jean-Pierre Jorris, de son vrai nom Jean-Pierre Leroux, a rejoint peu après sa sortie du conservatoire la première troupe de Jean Vilar.
Il débute dès 1944 dans Feydeau ("Monsieur chasse!") et fait partie du Festival d'Avignon dès sa fondation par Vilar en 1947, puisqu?il joue dans ce qui s'appelait à l'époque "la semaine d'art d'Avignon" deux pièces: "L'Histoire de Tobie et Sara" de Paul Claudel et "La Tragédie du roi Richard II" de Shakespeare.
C'est ensuite le premier Cid donné en Avignon, en 1949, avant celui incarné par Gérard Philipe (qui le mettra plus tard en scène dans "Lorenzaccio" en 1952).
Jean-Pierre Jorris n'a pas quitté les planches jusque dans les années 2000, et a joué sous la direction d'Albert Camus, Jean-Louis Barrault, Georges Wilson, Peter Brook, Philippe Adrien ou Roger Planchon.
Il retrouve Avignon en 1985 dans "Lucrèce Borgia" par Antoine Vitez puis "Don Carlos" de Schiller en 1986.
Homme de théâtre, Jean-Pierre Jorris a peu joué pour le cinéma (une dizaine de films) et pour la télévision. Il aura marqué de son empreinte pas moins de 57 spectacles, tant dans le théâtre privé que public.
Photo © AFP/Archives | Jean-Pierre Jorris et Nada Strancar sur scène pour Lucrèce Borgia, au festival d'Avignon, le 25 juillet 1981
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2017 7:24 PM
|
Par Brigitte Salino das Le Monde
Le Suisse met en scène deux spectacles, l’un sur l’Europe, l’autre sur l’affaire Dutroux, à Nanterre.
Milo Rau présente deux spectacles frappants au Théâtre Nanterre-Amandiers : Empire et Five Easy Pieces. Dans le premier, il y a des adultes sur scène. Dans le second, des enfants. Tous sont là pour raconter des histoires comme le Suisse les aime et les recherche : des histoires qui nous parlent d’aujourd’hui, de ce qui travaille le monde et façonne les gens.
Avec Empire, le Bernois né en 1977 clôt une trilogie sur l’Europe. Avec Five Easy Pieces, il revient sur l’affaire du pédophile belge Marc Dutroux révélée en 1996. Toujours en suivant la même démarche, celle d’un ancien élève de Pierre Bourdieu, et en optant pour la même esthétique, qui repose sur des dispositifs simples, propices à concentrer l’attention sur la force de récits.
A la croisée des chemins
L’Europe, c’est dans une cuisine qu’on la trouve. Une cuisine toute petite, qui semble flotter sur le plateau de la grande salle de Nanterre-Amandiers. Mais, dès que le noir se fait et que trois hommes et une femme entrent dans cette cuisine, plus rien n’existe que cet espace étroit, surmonté d’un écran où l’on verra, filmés en gros plans, les visages des uns et des autres. Il y a là Ramo Ali, Akillas Karazissis, Rami Khalaf et Maia Morgenstern : ce sont leurs vrais noms, ils se présentent, nous disent d’où viennent leurs familles, comment ils ont grandi. Ils ont en commun d’être devenus acteurs, mais ce n’est pas l’essentiel.
Ce qui importe, ce sont leurs chemins, qui tous portent la trace de l’exil : un exil intérieur pour Maia Morgenstern, juive dans la Roumanie antisémite des Ceaucescu, un exil qui mène Ramo Ali, Kurde, et Rami Khalaf hors de leur pays, la Syrie de Bachar Al-Assad. Sans retour pour Rami Khalaf, qui vit en France. Ramo Ali, lui, est revenu dans sa ville natale. Akillas Karazissis aussi est rentré dans son pays, la Grèce, qu’il avait quitté au mitan des années 1970 pour fuir le régime des colonels.
Leurs récits dessinent une géographie dont l’étrangeté repose sur un socle : une Antiquité de l’Histoire que l’Europe d’aujourd’hui condense, en croisant des chemins qui vont de Babylone à la mer Egée, sous le soleil, ou l’ombre, de dieux fluctuants.
A écouter ces quatre intervenants, qui se passent la parole comme dans un relais, on se pose plus de questions que l’on n’acquiert de certitudes, sinon celle d’un bouleversement à venir, un nouvel Empire dont le spectacle de Milo Rau donne les préliminaires.
Regard et responsabilité
Dans Five Easy Pieces, le bouleversement a déjà eu lieu, mais il ne cesse d’opérer, dans la Belgique d’aujourd’hui : c’est l’affaire Dutroux, sur laquelle le metteur en scène a choisi de se pencher, en la faisant jouer par des enfants belges de 8 à 13 ans. Ce simple énoncé pourrait faire fuir le lecteur : comment peut-on avoir une idée pareille ?
Allez à Nanterre, vous comprendrez que tout est question d’approche, de regard, de responsabilité. Milo Rau fait confiance aux enfants, mais il les dirige en partant de leurs propres histoires, comme dans Empire, et il les protège en les accompagnant d’un adulte sur scène, où l’on ne verra pas Marc Dutroux, mais son père, filmé.
Oui, ces enfants jouent les scènes d’horreur qu’on n’a pas besoin de rappeler. Mais ils le font avec leur rituel, qui ne recule pas devant leurs peurs et ne triche pas avec leurs souterraines noirceurs. On ne les regarde pas comme des enfants embrigadés dans un projet : on les suit comme des personnes qui lèvent un nouveau voile sur l’innommable, à leur hauteur.
Comme Empire, Five Easy Pieces est découpé en séquences. Dans la dernière, les enfants dansent et chantent. « C’est fini ? », a demandé avant l’un d’entre eux. Oui, c’est fini, mais cela continue, autrement : l’affaire Dutroux a façonné une identité belge. Les enfants de Five Easy Pieces n’étaient pas nés quand elle a éclaté, en 1996. Mais ils savent, et témoignent de la force cathartique du théâtre.
Deux spectacles écrits et mis en scène par Milo Rau : « Empire », jusqu’au samedi 4 mars (durée : 2 heures) ; « Five Easy Pieces », du vendredi 10 au dimanche 12 mars, puis du vendredi 17 au dimanche 19 mars (durée : 1 h 30). Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, avenue Pablo-Picasso, Nanterre (Hauts-de-Seine). Tél. : 01-46-14-70-00. De 10 € à 30 €.
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 2, 2017 12:29 PM
|
Par Véronique Hotte dans Théâtre du blog
Sweet Home-Sans états d’âme d’Arthur Lefebvre, conception et mise en scène de Claire Dancoisne, par le Théâtre de la Licorne
Petit polar, forme théâtrale cinglante à deux degrés ou «partition à deux mains», selon Claire Dancoisne qui en a réalisé l’écriture visuelle, est aussi un théâtre d’objets, expressif et facétieux, à la trame verbale bien frappée. Le conte noir fraie ici avec le suspense : horreur, humour et cynisme.
Comédienne et artiste de cirque, Rita Burattini incarne une anti-héroïne choisie, comme une abstraction paradoxalement vivante d’une femme sans âge, très seule, qui vit recluse dans un immeuble dont elle a été la première habitante.
De nouveaux arrivants, trop envahissants à son goût affreux, sales et méchants, ont investi les lieux mais elle se débarrassera sans état d’âme de ces gêneurs.
Ce fantasme d’éradication des autres, de fermeture à l’étranger et à la différence, de repliement sur sa pauvre petite vie à soi, grandit la dame à ses propres yeux.
En voisine infernale et butée, elle s’assure les moyens de sa guerre: accessoires et couteau, et jusqu’à la contemplation satisfaite du spectacle macabre de ses victimes: chat de gouttière, chien de rue et oiseau de fenêtre.
Rien ne manque au répertoire des stratégies inavouables et des petits coups bas : lettres d’insultes déposées à la sauvette dans les boîtes aux lettres ennemies, et réponses de ces derniers déposées sur le paillasson de l’entrée, que la réceptrice jette sans ambages dans sa grosse poubelle dévoreuse.
La vie n’est pas tranquille, et la combattante reste sur le qui-vive et l’urgence. Grosses lunettes, yeux bleus immobiles, perruque blonde synthétique, ensemble printanier robe courte rose et talons hauts, la tenue de cette femme est l’expression tonitruante d’une vision de la vie, avec des objets qui tiennent à la fois d’armes et d’obstacles à franchir, ceux d’un monde dur et vindicatif, à s’approprier dans l’instant présent.
Menue mais musclée et tenace, Rita Burratini hypnotise le public attentif aux déplacements dans un espace plutôt réduit, encombré, parsemé de barrières montées et créées illico presto. Une rangée de boîtes aux lettres accrochées au mur humble d’un couloir, une porte d’entrée, une table de stratifié bleu, de petits espaces de travail et des tiroirs de cuisine ici et là, mais la comédienne se déplace à la fois avec aisance, et comme sur des œufs, enjambant ce qui l’empêche d’avancer, simulant la station assise en pliant une jambe sur l’autre, avec une gestuelle inouïe. Enfermée dans un monde hermétique, elle ne parle qu’à sa seule conscience, et mauvaise fée, elle commente ses victoires et fait l’inventaire de ses trophées : les couples de voisins qu’elle a «dégagés» de son entourage et qui ont tous subi une chute fatale dans un néant aspiré par l’imaginaire noir de cette dame sans cœur.
Les disparus se replient, morts, dans des boîtes-sarcophages, reproduits encore dans l’espace de leur habitacle, sortes de poupées-squelettes-gigognes, figurines macabres assises à table, ou dans un fauteuil de leur intérieur, aujourd’hui anéanti.
Quand la sorcière ouvre une fenêtre, un objet dans la main en guise de poignée, elle semble faire de l’autre main un signe sympathique à untel. Mais la fenêtre refermée, jurons et insultes montent à la bouche de celle qu’on croyait voir paisiblement regarder le paysage familier alentour : isolée volontaire, elle ne s’attendrit jamais et ne montre aucun signe de compassion.
Les objets rares et expressifs et les animaux de Maarten Janssens et Olivier Sion, nappe, tablier, chat et oiseau, aux formes surréelles, sont métaphoriques de la vie au jour le jour d’une petite classe moyenne et une alarme de voiture en guise de fantasme policier impose sa stridence.
La peinture de Chicken et la toile de fond de Deflet Runge sont comme un patchwork de paysage existentiel. La fameuse Jacqueline, rivale énigmatique de l’héroïne, restera absente, recluse au sous-sol, sous une bouche d’égout.
Cet univers radical résonne fortement dans le public, comme une évocation juste et sans sourdine, du timbre sec de nos relations quotidiennes.
Véronique Hotte
Spectacle vu à la Scène nationale d’Évreux-Louviers, le 25 mai.
Le Théâtre de la Licorne sera aussi au Festival Villeneuve-en-scène, Cloître de la Collégiale, à Villeneuve-lès-Avignon, du 8 au 21 juillet (relâche le 14) à 19h.
Macbêtes sera joué à 21h dans ce même lieu, et au Théâtre du Peuple à Bussang (Vosges) les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, du 4 au 27 août. T : 03 29 61 50 48.
Photo : Rita Tchenko dans "Sweet home" @Pascal Gély 4_1

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 28, 2017 7:37 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Christine Angot : « Un amour impossible », un spectacle improbable
Après l’avoir lu, Célie Pauthe a tout de suite voulu mettre en scène « Un amour impossible » de Christine Angot, récit de l’amour difficile entre Christine et sa mère. Pas simple, cette transposition théâtrale, même servie par deux grandes actrices, Maria de Medeiros et Bulle Ogier.
Dans un roman ou dans un film, on passe d’un espace à l’autre en un clin d’œil. Un retour à la ligne, un changement de plan et, hop, c’est fait. Au théâtre, c’est beaucoup plus coton. Par exemple, dans la deuxième journée de la pièce de Claudel Le Soulier de satin, la scène 7 se passe la nuit sur le bateau de Don Rodrigue en pleine mer et la scène suivante dans la forteresse de Mogador. Comment faire ? La réponse choisie par Iannis Kokkos et Antoine Vitez fut d’abord de construire un plancher légèrement incliné, d’y apporter des petits éléments disparates et de laisser les spectateurs imaginer le reste. Aujourd’hui, les changements de décor quand ils existent (on en observe de moins en moins) se passent de plus en plus souvent sous le regard des spectateurs. Dans le dernier spectacle d’Ariane Mnouchkine Une chambre en Inde, c’est l’un des charmes du spectacle : en quelques secondes, tout a changé.
Changements de décor
Tout ce préambule pour en arriver au spectacle Un amour impossible, le livre le plus récent de Christine Angot adapté par ses soins dans un dialogue permanent avec Célie Pauthe qui signe la mise en scène. Cette dernière, après avoir lu le livre, a tout de suite voulu le porter au théâtre.
Cette fois, les changements de décor disent des changement d’espace mais aussi de temps : de l’enfance de Christine (Maria de Meideros) à la rencontre tardive avec son père et ce qui s’ensuivit (c’est le sujet de L’Inceste, premier succès de librairie pour Christine Angot en 1999), jusqu’au présent de sa mère (Bulle Ogier), octogénaire. Un amour impossible se concentre sur ces rapports fille/mère au fil du temps jusqu’à une longue scène d’explication (et de réconciliation) finale entre les deux femmes, une scène le plus souvent dialoguée dans le livre.
Le parti pris de Célie Pauthe et de son scénographe Guillaume Delaveau est aux antipodes de celui du Théâtre du Soleil et proche de l’esprit d’un Vitez. L’espace, nullement réaliste, est essentiellement composé de fauteuils, d’une étroite table de travail (sur laquelle l’enfant fait ses devoirs puis, devenu’écrivain, écrit), d’une autre table un peu moins étroite où la mère et la fille s’assoient pour grignoter et discuter et encore une table de restaurant, tout cela apparaissant, disparaissant, se déplaçant au gré des scènes. Il y a également une ouverture centrale au fond de la scène, c’est là qu’une machiniste de l’Odéon déroule un tapis (qui n’est pas rouge) avec un geste magistral du pied droit. Tous les changements sont théâtralisés. Ils auraient pu être effectués dans le noir en une poignée de secondes, ils se font en pleine lumière calmement, lentement, accompagnés d’une musique. Les quatre machinistes du Théâtre de l’Odéon qui les effectuent (un seul, Julien Cosqueric, est nommé dans le programme car il « joue » dans une scène en servant des petits pains à la table du restaurant) viennent saluer à la fin du spectacle et c’est justice. Ces hommes et femmes vêtus de noir comme des corbeaux et comme les manipulateurs du bunraku marchent sans se presser, chacun ayant son lot de tâches à effectuer ; cela frise parfois la chorégraphie. Autant de moments de grâce dans un spectacle qui peine à se trouver.
C’est la scène finale
Célie Pauthe voulait concentrer le spectacle sur les trente dernières pages, le long dialogue entre Christine et sa mère. Elle avait raison car c’est la partie la plus forte du roman, avec un dialogue nourri. Christine montre à sa mère que le refus du futur père de Christine de se marier avec elle, de ne pas reconnaître l’enfant dans un premier temps, de renvoyer constamment la mère à ses origines prolétaires et juives, que tous ces événements sont d’abord dictés par des considérations de classe, lui « dans son monde supérieur » n’ayant de cesse de rabaisser la mère dans un « monde inférieur », et que la transgression de l’interdit fondamental (l’inceste) participe à cette entreprise générale d’humiliation sociale.
Face à la proposition de Célie Pauthe, Christine Angot a raison de faire remarquer que l’on ne peut comprendre cette scène qui si on connaît tout ce qu’ont vécu la mère et la fille depuis l’enfance de cette dernière. Et même avant. Alors Angot se propose d’écrire ces scènes explicatives sous forme de dialogues. Célie Pauthe accepte cette proposition. Christine Angot est familière du théâtre, l’un de ses premiers textes, Corps plongé dans un liquide, a été publié en 1992 dans la collection Tapuscrit de Théâtre Ouvert.
Le résultat est cependant bancal. D’abord, ces dialogues avancent sans enjeu sinon celui de nous informer ; scéniquement, la matière est faible, le dialogue paraît artificiel. Or ce n’est pas le cas lorsque, reprenant le récit du livre, les deux personnages filmés nous parlent par écran interposé. Le contraste est flagrant. Enfin, ce sont des êtres qui, sous nos yeux, vieillissent, Christine au début est une enfant, à la fin elle a l’âge de Christine Angot aujourd’hui. Pas simple pour un comédien adulte de jouer un enfant. Célie Pauthe et son actrice Maria de Medeiros optent pour la pire des solutions : une transformation de la voix (qui devient criarde, etc.) et un jeu du corps de petite fille nerveuse assez caricatural. Tout cela va peser sur le reste de la représentation. Dans le cas de Bulle Ogier (la mère), partant d’un âge plus avancé, les dégâts sont moindres.
C’est d’autant plus regrettable que le spectacle semblait vouloir se détacher de tout réalisme. Mais il y retourne. De plus, l’écriture au quotidien de Christine Angot peine à atteindre le tragique que Célie Pauthe croit y déceler. Cependant, il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas se laisser emporter dans la dernière scène quand Bulle Ogier-la mère dit qu’elle aurait bien voulu garder le souvenir des « bons moments » passés avec l’homme follement aimé, malgré toutes les humiliations subies. Mais non, après ce qu’il a fait à sa fille et qu’elle n’a pas su pressentir, « ce n’est plus possible ». Cet amour-là aussi est devenu impossible.
Théâtre de l’Odéon aux ateliers Berthier, du mar au sam 20h, dim 15h sf le 28 fév, jusqu’au 29 mars. Puis au Théâtre de Vannes le 6 avril.
Un amour impossible est paru en poche J’ai lu, suivi de la Conférence à New York qui en explique la genèse et que Christine Angot lira à l’Odéon le samedi 4 mars à 16h.
Scène de "Un amour impossible" © Elisabeth Carecchio

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 27, 2017 8:11 PM
|
Par Maïté Darnault, Correspondante à Lyon pour Libération
Le musée des Confluences, à Lyon, inauguré en décembre 2014, vient de perdre sa subvention du département. (Photo Patrick Aventurier. Sipa)
Les instituts culturels de la région ont vu leurs subventions baisser drastiquement en 2016. Une situation concomitante à la fusion des régions et à l’arrivée du nouveau président, Laurent Wauquiez. Et qui varie selon l’orientation partisane des villes.
Mais que se passe-t-il dans les institutions culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Le musée des Tissus de Lyon est au bord de la noyade, celui des Confluences vient d’être privé de subvention départementale (lire encadrés), les dotations aux compagnies baissent, les structures d’animation culturelle ferment… Tout au long de l’année 2016, les échos n’ont guère été rassurants. Si le cas particulier du musée des Tissus ne saurait être érigé en symptôme, un faisceau convergent pointe néanmoins un net désengagement de la région dans le domaine culturel. Nombre d’événements et de structures sont touchés par une baisse budgétaire. Au conseil régional, le groupe d’opposition des socialistes et apparentés s’est livré à un recensement pour 2016. Dans la seule zone Rhône-Alpes, la dotation de la région aux compagnies a diminué de 400 000 euros, celle des centres de culture scientifique, technique et industrielle de 200 000 euros et celle des radios associatives de 70 000 euros. «Et on n’a aucune garantie sur la répartition pour 2017, déplore Anne Meillon, patronne du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon et déléguée régionale du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, le Syndeac. La région nous a dit que les lieux et les compagnies n’auraient pas de réponse avant mai… Avant, on savait dès décembre ou janvier sur quel montant tabler.» Florence Verney-Carron, vice-présidente à la culture, attribue ce décalage à une «vision rénovée» : «On n’est pas un guichet de distribution de subventions.»
Certes, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas la seule à faire de la culture la première victime collatérale du désengagement de l’Etat dans le financement des collectivités territoriales. Selon le Syndeac, les départements ont pour la plupart suivi le mouvement en 2016 (- 15 % sur le budget de la culture dans le Cantal, - 17 % en Ardèche, - 14 % dans l’Allier, - 10 % dans l’Ain et en Savoie…). Sans oublier les villes, à l’instar de Grenoble (- 600 000 euros en 2015 puis en 2016) ou de Lyon (-7 % entre 2015 et 2018). Mais c’est cet effet d’accumulation, ajouté au flou engendré par la fusion entre Auvergne et Rhône-Alpes, qui rend la situation particulièrement tendue dans la région.
Diminution globale de 9 %
Selon une étude publiée en juin 2016 par le Syndeac avec Télérama, toutes tutelles publiques confondues, les aides au spectacle vivant ont baissé de 0,3 % en France, «avec un décrochage (- 3 %) plus marqué des départements, débordés par leurs missions sociales […] et des régions (- 1 %), dont la fusion en cours et les changements politiques - Auvergne-Rhône-Alpes en particulier - brouillent les engagements». Dans la présentation du budget 2017 qu’a faite l’équipe de Laurent Wauquiez, le spectacle vivant arrive en tête, avec 19 millions d’euros, soit 49 % des crédits de fonctionnement. Mais la diminution globale de l’enveloppe allouée à la culture a largement dépassé les 1 % en 2016 pour atteindre 9 %. Un chiffre déjà important que conteste pourtant Farida Boudaoud, ancienne vice-présidente à la culture en Rhône-Alpes, conseillère régionale et membre de la commission culture : «La baisse est d’au moins 15 %, si ce n’est pas plus : en 2015, le budget culture de Rhône-Alpes était de 65 millions d’euros, sans inclure le patrimoine. Et celui d’Auvergne de 7 millions d’euros, sans compter tous les dispositifs d’accompagnement alloués aux lycées, à la jeunesse, à la politique de la ville, qui concernaient in fine la culture.»
Particularité de la nouvelle gouvernance régionale : la chasse aux structures d’animation culturelle, dont le président de région LR a reconnu «se méfier» dans une interview au Dauphiné libéré l’été dernier. En 2016 déjà, beaucoup de ces structures avaient connu des baisses de subvention importantes : - 300 000 euros pour le Transfo, l’agence de développement culturel d’Auvergne, - 100 000 euros pour l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (Arald) et - 63 000 euros pour l’Agence de développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes (Nacre). Pour 2017, la région a décrété la «fin des intermédiaires», et le Transfo en a fait les frais. Début janvier, l’agence a été placée en liquidation judiciaire et ses onze salariés sont en voie de licenciement. «On voulait donner l’argent directement aux créateurs», justifie Florence Verney-Carron, vice-présidente à la culture. «On n’a pas impacté la culture elle-même, on a impacté la procédure, les études, les cabinets», complète Etienne Blanc, vice-président délégué aux finances.
«Poste de stagiaire»
Même flottement au sujet des festivals, qui représentent le quatrième poste de dépenses, soit 4,8 millions d’euros, auxquels la région propose d’ajouter un «fonds d’intervention» spécifique. Or, en 2016, bon nombre d’événements ont vu leur subvention amputée, tandis qu’elle explosait pour d’autres : + 100 % pour Jazz à Vienne, dont le président, Thierry Kovacs, est aussi maire de la ville et chef de file LR en Isère ; dans le même département, + 233 % aux Belles Journées de Bourgoin-Jallieu, ville remportée par la droite en 2014 après plus de quarante ans de règne à gauche ; + 275 % à Cosmojazz, à Chamonix (Haute-Savoie), dont le maire UDI, Eric Fournier, est également vice-président à l’environnement du conseil régional.
Le Printemps de Pérouges (Ain) a, lui, connu l’une des plus importantes baisses : - 50 % de dotation. «C’est soit un concert, soit un poste de stagiaire en moins, déplore sa directrice Marie Rigaud. C’est d’autant plus mal vécu qu’on démontre une vraie capacité d’autofinancement.» En 2016, 92 % de ses ressources provenaient du privé (sponsors, mécènes, partenaires) et de la billetterie. «Je m’autoproclame entrepreneuse de la culture, reprend Marie Rigaud. On gère notre festival comme une PME, on ne s’est jamais laissé aller au confort des déficits comblés par l’argent public.» Pour d’autres, le bilan est en demi-teinte : le festival de théâtre de rue d’Aurillac (Cantal) bénéficie depuis 2015, du fait de l’ancienne majorité, d’une subvention passée de 130 000 à 210 000 euros par an. Une hausse entérinée par le nouveau conseil régional sur tout son mandat. «C’est un soutien réel et je les en remercie. Mais j’attends de voir, je n’ai pas encore de lecture globale, explique Pierre Mathonier, maire PS d’Aurillac. Certes, c’est important, les manifestations phares, mais je suis plus inquiet sur le soutien diffus aux associations, aux conservatoires, aux théâtres, aux petits musées, les premiers à contribuer au vivre-ensemble.»
L’entrée du musée des Tissus et des Arts décoratifs, à Lyon. Photo Robert Deyrail. Gamma-rapho.
Le Musée des Tissus acclamé, mais pas aidé
Menacé depuis plus d’un an car trop coûteux pour la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) régionale, à qui il appartient, le musée des Tissus de Lyon recèle des trésors, comme la tenture «aux vers à soie» de Charles-Simon Colliot, la robe d’intérieur de Vaucanson ou encore cette tunique d’une princesse de la XIe dynastie exhumée à Déchachèh, en Egypte. Le hic ? Personne n’en veut la charge. Ni la CCI qui, pour absorber une baisse de ses ressources fiscales de 38 % d’ici à 2017, cherche à s’en débarrasser ; ni la ville et la métropole, qui clament ne pas en avoir les moyens (elles injectent déjà 35 millions d’euros dans les musées de la ville, le Gallo-Romain et celui des Confluences) ; ni la région, qui a offert cet automne une enveloppe de 5 millions d’euros pour les travaux et l’évolution scénographique nécessaires, sans pour autant s’avancer sur le budget de 1,7 million d’euros requis chaque année pour faire tourner l’institution. Aux dires de Georges Képénékian, premier adjoint à la Culture à la mairie de Lyon et conseiller métropolitain chargé de la coordination des grands équipements, la ville et la métropole lyonnaise auraient contacté un certain nombre d’entreprises pour solliciter un mécénat, sans succès. En 2016, les réunions «de la dernière chance», intégrant également le syndicat professionnel textile Unitex, se sont succédé sous l’égide de l’Etat. Un cabinet conseil est en passe d’être mandaté pour proposer un projet associant les différents acteurs. Tous conviennent de l’importance des collections du musée… Et campent sur leur position, en refusant tout engagement financier à la hauteur de la «nouvelle donne» tant de fois invoquée.
Le département lâche les Confluences
Christophe Guilloteau, président LR du département du Rhône, à l’origine du projet, a décidé de supprimer dès janvier 2017 la subvention annuelle accordée au musée des Confluences, invoquant d’autres priorités budgétaires. L’enveloppe départementale représentait 10 % des 14 millions d’euros d’argent public (les 90 % restants proviennent de la Métropole), pour un budget total de 18 millions d’euros. «Ce sont 10 % qui ne vont pas revenir. Cela a déjà des incidences sur la planification des expositions, leur durée, leur nombre», constate Béatrice Schawann, directrice de l’administration générale des Confluences. Inauguré en décembre 2014, ce musée a accueilli les expositions «Dans la chambre des merveilles», «L’art et la machine» ou encore «Antarctica». Sa spécificité : une baisse de fréquentation très modérée entre sa première et sa deuxième année de fonctionnement - de l’ordre de 13 %, contre 30 à 40 % pour la plupart des grands musées français ouverts ces dix dernières années. «Les gens viennent et reviennent, on a réussi ce pari de fidéliser», se félicite-t-elle. Une dynamique «fragile» que l’augmentation du prix du billet d’entrée pourrait remettre en cause : «Ça nous ferait décrocher du public visé», dit Béatrice Schawann.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 27, 2017 7:12 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Dieudonné Niangouna et Sony Labou Tansi aboient quand passe le théâtre
En montant « Antoine m’a vendu son destin » de Sony Labou Tansi, en écrivant « Sony chez les chiens » et en mettant en scène ces deux pièces tout en les jouant, Dieudonné Niangouna honore son maître en l’offrant aux chiens. C’est un jeu, c’est du théâtre chien.
C’est un vieux constat : au théâtre les morts ont la vie dure. Morts dans leur lit, sur un champ de bataille, assassinés, pendus ou étouffés de notoriété officielle, la vie leur manque. C’est ainsi que depuis sa disparition à 47 ans en 1995, le poète, romancier, dramaturge et homme de théâtre congolais Sony Labou Tansi n’a jamais été aussi vivant, si l’on en juge par la publication récente d’inédits ou la réédition de son théâtre complet chez Lansman.
« La sorcellerie du devenir »
Les poètes morts sont comme des personnages, ils veulent encore jouer un rôle, alors il reviennent sur la scène (du monde). Subrepticement ou orgueilleusement avec l’air de ceux qui ont tout vu, à qui on ne la fait plus, ils se font passer pour des dieux, des éléphants, des singes, des oiseaux, ils aiment porter des masques pour mieux démasquer les faux héritiers, les voleurs.
De leur côté, les poètes vivants aiment aussi parler aux morts, dans les cimetières, dans leur lit, dans leur tête, au théâtre c’est la moindre des politesses. Dieudonné Niangouna, auteur et acteur congolais, est ainsi. Comme tout ce qu’il fait, cela tient du débordement. Non seulement il convoque le défunt Sony Labou Tansi (qu’il avait un peu croisé de son vivant) et, au passage, ses œuvres complètes et sa vie bien remplie, mais il instaure un dialogue permanent avec son œuvre. Premier mots du prologue de sa pièce Sony chez les chiens en 6 chienneries (anciennement scènes ou tableaux) :
« L’autre fois j’ai dit à Sony Labou Tansi, on n’aurait pas dû se croiser, vieux, que j’allais rester chez moi au pieu... J’ai dit à Sony Labou Tansi : t’inquiète, mon vieux, je fais mon œuvre, mais je termine la tienne. » Et après que Niangouna a parlé de l’écriture comme de « la plus belle sorcellerie de la naissance des choses » et ajouté qu’elle est « la sorcellerie du devenir », Sony lui répond : « oui, c’est toi, Dido, c’est toi qui as raison. » Alors Dieudonné, « devenu Dido par la force de Sony », déploie « La Sonyfication des énergies ».
Il joue un sale tour d’amour en envoyant Sony comparaître chez les chiens dans une pièce qui est comme le noir miroir de la pièce de Sony Labou Tansi Antoine m’a vendu son destin. Dido Niangouna met en scène ces deux pièces dans la même soirée. Un enchâssement permanent. De souffle à souffle. Dans l’héritage de la Phratrie léguée par l’écrivain congolais Sylvain Bemba (1934-1995) et portée jusqu’aux rives du théâtre par Tchicaya U Tam’si (1931-1988) auquel Sony empruntera son nom.
« L’ouvrier du refus »
La pièce de Sony Labou Tansi est l’histoire d’un complot, mais un « complot loufoque » organisé par le chef de l’Etat Antoine lui-même pour devancer ceux qui s’agitent pour lui piquer la place. La prison où il se laisse enfermer volontairement par stratagème deviendra un piège mais quand, in fine, les puissances occidentales le supplient de revenir diriger le pays pour ne pas le laisser partir à la dérive, Antoine décline, s’improvise ouvrier du refus ». Et quand les délégués des forces armées du pays viennent à leur tour « négocier la concordance nationale », il leur répond :
« Négociez, messieurs, négociez le bordel et la vérole, négociez la magouille, la zizanie, les pots-de-vin et la pacotille luisante des bric-à-brac, négociez votre rôle de singes de l’Histoire, diplômés en agenouillements et en clowneries simiesques, négociez votre fonction d’aboyeurs alternés, intégrés et idéologiques. Mais de grâce, comprenez qu’Antoine est le grand feu flambant, l’espoir et l’avenir, l’immense baobab destiné à inverser les regards et, qu’à ce titre, Antoine n’est pas négociable ».
C’est par cette langue flamboyante, et nerveuse, née de la parole et faite pour être proférée que Dido Niangouna est l’héritier direct de Sony Labou Tansi. « Je suis la gueule de secours de Sony, son rechange et son museau », écrit-il. Deux auteurs qui ne cessent de parler « la parole du ventre » (Dieudonné Niangouna) de « l’humanité bâclée » (Sony Tabou Tansi) à travers leur pays, le Congo, et à travers la langue de ceux qui ont colonisé la région, la langue française. Sony Tabou Tansi résume ces rapports aussi conflictuels que productifs, en une belle formule : « Je n’ai jamais eu recours au français, c’est lui qui a eu recours à moi. » Il l’a diablement enrichi.
« Tout nommer »
Dans Sony chez les chiens, Niangouna aboie l’éloge de celui auquel, jeune homme, il alla porter ses premiers poèmes. Mais c’est un éloge renversé : un jeu de massacre, impitoyable et carnassier. Sony fait face à un tribunal de chiens. Des chiens affamés comme des loups. Ils accusent Sony de tous les maux, de toutes les traîtrises : « Et d’abord qu’est-ce qu’il a fait pour le théâtre ici ? Il a passé toute sa carrière à aller faire rire les blancs de Limoges en parlant de notre misère ! Comme si nous "on" n’avait pas besoin de rire de nous-mêmes ! »
Limoges, c’est la ville du Festival international des Francophonies. C’est au troisième Festival, en 1986, que Sony Labou Tansi et son Rocado Zulu Théâtre créèrent Antoine m’a vendu son destin.
« Tout nommer, nommer jusqu’à ce que la gueule démissionne », écrivait-il dans une lettre à un ami. Dido s’y emploie en égrenant dans sa pièce la longue liste (cinq pages) de ses amis chiens artistes ou pas, avant de porter l’estocade : « Aucun de ces chiens ne t’a maudit ! Et toi tu les a foutus dans le pâté ! Sony t’es ingrat ! Tu sais qu’y a pas plus bas que quelqu’un qui fait du théâtre dans ce con de pays de chiens. C’est un individu ! Ce que tu nous a énervés comme une fille qui découvre ses règles à nous parler de ton vagin sans cesse, matin, midi, soir, vagin, vagin, vagin, vagin, va, vagin, vagin, vagin de chien ! Dégueulasse ! Tuez-le encore ! Fusillez-le dans les yeux, le ventre et les couilles. » La mort est un baiser. Sony définissait son métier d’écrire en quatre mots : « être dingue sans déconner. »
Dans sa pièce, Dieudonné Niangouna apostrophe amicalement « Greta Rodriguez de la Corse » qui vient de publier des « inédits de Sony ». Le nom est écorché mais l’information exacte : Greta Rodriguez-Antoniotti a réuni les Textes critiques de Sony Labou Tansi devenus pour la plupart introuvables. On y lit ceci, extrait d’un vieux numéro de la revue Autrement : « Je travaille sur le théâtre parce qu’il est la meilleure possibilité de mettre les choses à la dimension du corps, du sang, de la sueur, de l’aura, du muscle qui dit sa part du monde à voix basse ou bien à haute voix. L’acteur est la seule occasion qui nous reste de donner la chair de poule aux choses et à l’idée. » Dido, Dieudonné Niangouna, est cet acteur-là.
Théâtre de la Colline, du mer au sam à 20h, mar 19h, dim 16h, jusqu’au 18 mars.
Sous le titre Encre, sueur, salive et sang, un choix de ses textes critiques au Seuil (l’éditeur de ses romans), 208 p., 17€. A lire aussi : La Chair et l'Idée, théâtre et poèmes inédits, témoignages, regards critiques, éditions Les Solitaires intempestifs, 368 p., 15€.
Sony chez les chiens suivi de Blues pour Sony de Dieudonné Niangouna et Antoine m’a vendu son destin de Sony Labou Tansi sont édités chez Acoria, 12€ chaque volume.
Photo : Scène de "Antoine m'a vendu son destin/Sony chez les chiens" © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2017 6:58 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog Hottello
Mayday de Dorothée Zumstein (Editions Quartett), mise en scène de Julie Duclos
L’enfance moderne est une prouesse et une menace – un monde qui diffère et dont l’exploration est à la fois passionnante et troublante dans le reflet parfois effrayant qu’elle renvoie non seulement de l’adulte à venir mais de l’être en herbe déjà réalisé.
Le mythe romantique d’une enfance enchantée remplace la désillusion manifestée par les enfants malfaisants ou criminels dénoncés par les classiques. L’innocence est un leurre, et comme l’écrit Bertrand Blier, « L’enfant il naît chargé comme une bombe à fragmentation. Toute la crapulerie des générations précédentes il la transbahute dans ses bagages, autant de grenades dégoupillées. »
L’enfance déplore l’héritage néfaste des générations successives. Zola estime l’enfant piégé par l’hérédité – ses passions, ses préjugés et ses fureurs adultes.
Après avoir assisté en1968 au procès de Mary Bell, meurtrière à l’âge de onze ans de deux petits garçons, Gitta Sereny, journaliste anglaise, écrit Meurtrière à onze ans. Trente ans plus tard, après avoir rencontré celle qui a expié et raconte son histoire, dix-sept ans après sa sortie de prison, la journaliste écrit Une si jolie petite fille. Dorothée Zumstein s’est inspirée de ces ouvrages pour écrire sa pièce Mayday.
Pour l’auteure de théâtre, le fait divers – extraordinaire – n’obéit pas à l’attrait pour le macabre mais à la fascination pour l’incompréhensible. De son côté, la metteure en scène Julie Duclos, s’interroge sur les conséquences de la diabolisation d’une petite fille qui a accompli l’horreur, les effets sur celle-ci et sur la société entière alentour.
L’envie d’aller voir de plus près cette histoire revient à mieux la comprendre pour « savoir ce qu’il y a dedans ». Ainsi parle Mary adulte – narratrice autobiographe – qui invite sur la scène trois générations de femmes, la fillette dans le temps maudit de son enfance, sa mère absente et sa grand-mère mutique, à la même époque.
Enterrer son enfance reste impossible, si ce n’est vivre sèchement coupé de tout.
La fillette du passé qui a investi la mémoire de l’adulte et l’empêche de vivre, victime d’hallucinations répétitives, revient hanter ses cauchemars. Se tient à la porte de son domicile une fillette « dans son petit manteau rouge – six boutons ceinture à boucle », qui reste inaccessible puisque Mary adulte ne peut physiquement ouvrir.
Elle est ce Petit Chaperon rouge qui n’a pas été mangé par le loup mais l’a mangé.
« Il y a juste cette putain de poignée à tourner. Je peux pas, /Je suis glacée, / Je suis glacée parce que je sais qu’Elle est là, /…Dans la nuit – de l’autre côté. »
Pour se libérer de cette douleur au bras qui l’empêche de tourner la poignée de la porte, la femme revenue à une vie normale doit accepter une interview qui la délivre.
Le rappel énigmatique de cette scène initiatrice, à l’orée de la décision de parler au journaliste, résonne étrangement à la fin du spectacle dans le dénouement final.
Mayday peut être l’écho au Mois de Marie – l’anniversaire de la fillette, comme ses méfaits, ont lieu en mai – ou bien la traduction du « Venez m’aider » d’un pilote français en détresse mal compris d’un opérateur anglais, un « Mayday » officialisé et réglementaire depuis 1927 dans l’usage radiophonique.
La petite fille non aimée par sa mère n’a jamais pu faire entendre ses « Mayday ».
La pièce fragmentée est à l’image de l’imposante scénographie de Hélène Jourdan – une maison abandonnée et dégradée d’un quartier défavorisé de Scotswood aux murs démolis et troués que les herbes folles vivaces envahissent ; un premier étage dangereux aux parquets défoncés et usés des vieilles demeures promises à la démolition, devenues terrain de jeux à risques pour les enfants appauvris du coin. Les pères ont perdu leur emploi dans les mines de la région, frappées de fermeture.
Instantanés d’images, bribes de conversations filmées sur le plateau avec caméraman et preneur de son, projections des visages inquiets sur grand écran, apparitions bouleversées de l’intériorité des figures féminines des trois générations – danses farouches scéniques sur des tubes anglais d’époque, adresses malicieuses et ludiques au public, pleurs insoutenables, longs silences lourds, non-dits pesants – et jusqu’aux fuites furtives dans une petite guérite-refuge qui tient lieu de cuisine, de compartiment de train qui file sur la voie ferrée dans un bruit strident d’enfer.
La mise en scène est éloquente – un manège inventé avec la distribution tournante des scènes, ses portes de maison ouvertes au vent qui laissent surgir ou se retirer les personnages malheureux de l’histoire. Cette vision répond à l’impermanence de l’enfance, un état provisoire et instable de sensations et impressions, dont la parole significative – cris, courses, gestes vifs et échappées – n’est guère entendue.
Un spectacle tendu d’émotion et d’effroi qui porte un regard attentif et non complaisant sur l’éternelle condition des femmes et des enfants malmenés – des présences absences qui comptent souvent peu dans la société des hommes.
Les actrices Maëlla Gentil, Vanessa Larré, Marie Matheron et Alix Riemer sont des femmes effectivement remarquables.
Véronique Hotte
La Colline – Théâtre National –, du 27 février au 17 mars. Tél : 01 44 62 52 52

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2017 8:33 AM
|
Par Philippe Venturini dans Les Echos
« Fantasio » inaugure avec panache la nouvelle saison de l'Opéra-Comique (qui a trouvé refuge au Théâtre du Châtelet). Photo Pierre Grosbois
Il faudra bien finir par débarrasser Offenbach de son déguisement étriqué d'amuseur. Ses « Contes d'Hoffmann » ont commencé, depuis longtemps, ce travail salvateur. La redécouverte de « Fantasio », présenté au Théâtre du Châtelet le temps que l'Opéra-Comique achève ses travaux, va assurément le poursuivre, grâce à l'infatigable Jean-Christophe Keck, qui en a restitué la partition. Dès les premières mesures de l'ouverture, murmurées, le compositeur entraîne le public dans un univers de tendresse et de mystère. Durant tout cet opéra-comique, il déploie un art délicat de l'orchestration, enveloppant, ici, la voix d'un hautbois, transformant, là, les instruments à cordes en une gigantesque harpe. Son inspiration mélodique demeure inépuisable et soutient, de bout en bout, cette histoire d'étudiant désargenté qui prend la place du défunt bouffon à la cour du roi de Bavière pour échapper à ses créanciers. Inspirée de la pièce d'Alfred de Musset et adaptée en livret par son frère Paul, « Fantasio » est une oeuvre qui mêle amour, humour et politique (le peuple refuse de se soumettre aux caprices belliqueux des souverains) sous des allures de conte.
Thomas Jolly n'a pas cherché une actualisation qu'un tel ouvrage n'aurait pu supporter. Il en a au contraire préservé l'ambiance onirique, plongeant le plateau dans une semi-obscurité, propice aux habiles jeux de lumière d'Antoine Travert et Philippe Berthomé, et à la poésie cinématographique des décors de Thibaut Fack (la porte principale du château s'ouvre à la façon d'un obturateur photo). Des grappes de ballons roses et blancs, une nature stylisée en métal et en lumière, un dispositif scénique malin participent à la magie autant qu'à l'énergie d'un spectacle qui ne laisse rien au hasard (remarquable direction d'acteur).
COULEURS ET NUANCES
Le plateau apporte autant de satisfactions musicales. Laurent Campellone dirige avec souplesse un Orchestre philharmonique de Radio France riche de couleurs et de nuances. On pourrait attendre davantage de séduction dans le timbre de Marie-Eve Munger, mais elle incarne la princesse avec une touchante spontanéité. De même, Marianne Crebassa, auréolée de sa récente victoire de la musique, devrait soigner sa diction alors qu'elle incarne un Fantasio avec une aisance désinvolte et une agilité féline. Bravo à Jean-Sébastien Bou et à Franck Leguérinel, ainsi qu'à toute l'équipe de ce spectacle, qui inaugure avec panache la nouvelle saison de l'Opéra-Comique.
FANTASIO
de Jacques Offenbach. Direction d'orchestre : Laurent Campellone. Mise en scène : Thomas Jolly. Paris. L'Opéra-Comique au Châtelet, jusqu'au 27 février (08 25 01 01 23), 2 h 45.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 6:26 PM
|
Publié par Frédéric Perez dans le blog Spectactif
Deuxième volet de sa Trilogie Fantôme, après « George Kaplan » en 2013, et avant « B. Traven en 2017, Frédéric Sonntag écrit BENJAMIN WALTER en 2015. Cette pièce revêt les habits d’un récit de voyage vécu au présent dont le parti-pris fictionnel se mêle à des données réelles tirées de l’Histoire ou de l’actualité sociale.
Le doute sur ce qui est vrai et ce qui est faux est maintenu délibérément tout le long, nous laissant voyager à notre tour, aux détours des propos et des images, sur la trace de Benjamin Walter, écrivain parti sans laisser d’adresse en 2011 pour vivre une odyssée solitaire aux allures de déambulation par l’errance.
Quand nous nous installons, une troupe de comédiens sur le plateau nous attend déjà comme ils attendront pendant tout le spectacle qu’ils construisent devant nous, les informations envoyées par Frédéric Sonntag, l’auteur, parti sur les traces de Benjamin Walter pour le retrouver, au prétexte d’un documentaire qu’il souhaite réaliser sur lui.
Des mails, des SMS, des envois de manuscrits courts ou élaborés, des photos, des cartes postales, des extraits de livres… Autant de données transmises en temps réel aux comédiens pour qu’ils élaborent, imaginent, répètent, discutent. Ils tendent tous vers une création artistique, se disputant leurs compréhensions des éléments signifiants parmi les informations reçues. Ils se perdent dans le doute, se retrouvent dans leurs désirs de transcender l’incertitude par l’imaginaire. Ils le vivent devant nous, prenant tour à tour les rôles de Walter, de Sonntag ou de personnes rencontrées dans le récit.
La mise en abyme de la création d’une pièce en même temps que se déroule le voyage se révèle une expérience théâtrale adroitement réussie. Elle nous fait partager une épopée où l’errance est confiée au hasard.
Que de questions posées au fil de la pièce qui distribue sans innocence une kyrielle de doutes et de possibles réflexions sur l’identité, la reconnaissance et la valeur de soi.
Qu’en est-il du vrai, du vécu, du dit, de l’écrit ? Construire sa vie, est-ce imaginer s’engager dans un labyrinthe et se perdre sans laisser de traces, au désir secret d’une renaissance possible ? Peut-on renaitre de son oubli ? Quel parcours emprunter pour une quête initiatique de soi ?
La contemplation de cette errance nous interroge également sur la perte volontaire de contrôle. Le contrôle de soi, de son rapport au réel, du sens de la réalité et de ses traces. Les mots seront les seules traces reconnues de l’existence possible de Benjamin Walter. Tirés de livres, de tags ou de manuscrits, ils subliment la pensée écrite et la hisse au rang de preuves tangibles de la réalité.
La mise en scène de Frédéric Sonntag donne tout le temps nécessaire à son texte pour faire son œuvre de trouble et d’envoutement du public. Nous sommes baignés dans l’irrationnel et pourtant touchés par des éléments plausibles qui nous déroutent. Savoureux et adroit maillage des jeux avec la musique aux accents d’une balade façon Léonard Cohen et la vidéo qui renseigne sur les lieux de l’errance. Maillage qui crée une ambiance où l’onirisme se confronte à la réalité comme ces rares moments où pris par le texte qu’il lit, un lecteur ne sait plus, un court instant, où il se trouve.
Une échappée quasi surréaliste dans l’imaginaire d’un écrivain qui ne dédicace pas. Une expérience théâtrale riche et laborieuse qui, trois heures durant, nous envoute et nous emporte dans un univers proche du merveilleux, truffé de fulgurances réflexives. Un spectacle impressionnant.
Texte et mise en scène de Frédéric Sonntag, assisté de Jessica Buresi. Scénographie de Marc Lainé assisté de Lucie Cardinal. Création vidéo de Thomas Rathier. Création musicale de Paul Levis. Création et régie lumière de Manuel Desfeux. Costumes d’Hanna Sjödin. Avec Simon Bellouard, Marc Berman, Amandine Dewasmes, Clovis Guerrin, Paul Levis, Lisa Sans, Jérémie Sonntag, Fleur Sulmont et Emmanuel Vérité.
Jusqu’au 7 mars, du lundi au samedi (sauf mercredi) à 19h30 et le dimanche 6 mars à 16h00 – 17 boulevard Jourdan, Paris 14ème – 01.43.13.50.50 - www.theatredelacite.com/programme/frederic-sonntag

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 6:06 PM
|
La Gentillesse, digression autour de L’Idiot de Fiodor Dostoïevski et La Conjuration des Imbéciles de John Kennedy Toole, dramaturgie et mise en scène de Christelle Harbonn
Qu’est-ce que la gentillesse ? L’abdication des faibles, selon la malicieuse Blandine, l’une des figures énigmatiques – dégaine estivale, attitude un rien étonnée et souriante, voix enfantine moqueuse – de la dernière création de Christelle Harbonn.
Attitude charmante, geste délicat, signe bienveillant, regard plaisant – la morale généreuse dont la teneur pourrait paraître superficielle -, telle s’impose la Gentille.
La sœur aînée de Blandine, Solenne, propose à celle-ci, en fin de représentation, d’« apprivoiser » encore et toujours la gentillesse : « Plutôt crever ! », lui répond-on.
En effet, le spectacle de La Gentillesse, loin de dire les douceurs attendues – choses spirituelles et habiles -, pencherait plutôt – ironie voltairienne – du côté des traits méchants, des injures et des mauvais traitements imposés aux autres et au monde.
Le constat de nos sociétés occidentales certes n’est guère engageant, d’autant que le regard, portant loin au-delà de notre seul monde, n’est guère davantage consolé.
Grossièreté, rudesse, dureté et méchanceté semblent s’imposer, d’un côté comme de l’autre de l’hémisphère. Il reste ainsi à un autre personnage, Gilbert, de refuser de façon déterminée à entrer dans ce jeu-là. Au sens propre, puisque l’acteur désentrave un fouillis de fils colorés suspendus entre scène et salle, et au sens figuré, il dénoue les fils emmêlés de notre vie à tous inscrite dans des relations politiques et sociales confuses et brouillées, livrées depuis longtemps à l’anarchie sauvage et décomplexée des seules données capitalistes de l’économie de marché.
La mère, Marianne, déplore tout autant l’échec du communisme, comme la prétendue valeur d’une laïcité, décrite comme trop sûre d’elle, totalitaire et activiste.
En guise de métaphore d’un monde pressenti comme perdu, est suspendue au-dessus du plateau de scène, une installation plastique singulière, un continent de déchets plastique, une soupe de détritus légers et de porcelaine blanche – macro déchets épars et petits éléments -, une pluie de poussière irisée sous les lumières, un vaste mobile et un nuage âcre, en suspension menaçante sur les acteurs, déversant et laissant chuter habilement bribes de gravats et pertes de matière.
Une scénographie lumineuse et particulièrement éloquente de Laurent Le Bourhis.
Les figures scéniques, dont celle d’Adrien encore qui vient de l’extérieur, sont des êtres en décalage avec l’existence normée et convenue par la société : des « hors venus » à la Supervielle, et des réconciliateurs, tels qu’on les trouve dans La Conjuration des imbéciles de J. K Toole et L’Idiot de Dostoïevski, des enfants ou des fous. Des êtres si inconséquents que leur résistance aux attentes paraît naturelle.
Christelle Harbonn offre au public un voyage initiatique et poétique – onirisme, rêves et images mythiques entêtantes – dans « la nuit obscure des âmes », une quête existentielle qui rayonne autour de l’identité à l’épreuve de notre contemporanéité.
Les personnages se dénudent pudiquement : le dernier arrivé pourrait incarner le Christ déposé de la Croix, étendu modestement sur une banquette ancienne dont la tapisserie trop usée n’est plus, socle renversé à même le sol. Autour de lui, des figures maternelles le protègent paisiblement, tandis que dans la nuit de Dante, des monstres aux bois saillants s’aventurent et errent, boucs, chèvres et chimères.
Un méli-mélo énigmatique d’images rêveuses qui façonnent une étrangeté fort sympathique dont le leitmotiv serait l’humilité et l’attention accordée à l’autre.
Avec les interprètes ravis et habités que sont Adrien Guiraud, Marianne Houspie, Solenne Keravis, Blandine Madec et Gilbert Traïna, qui à un moment ou à un autre, ont tous échangé un long baiser mystérieux : une belle leçon de savoir vivre.
Véronique Hotte
Théâtre L’Echangeur à Bagnolet, du 20 au 27 février. Tél : 01 43 62 71 20

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 6:23 AM
|
Propos recueillis par Brigitte Salino dans Le Monde
Son roman, « Un amour impossible », est à l’affiche de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, dans une mise en scène de Célie Pauthe.
Elle scande les mots, enchaîne les « ça », multiplie les répétitions qui font avancer sa pensée. Quand Christine Angot parle, on retrouve l’énergie physique qui se déploie dans ses livres. Sa façon de ne pas lâcher, d’aller au bout de son propos, quoi qu’il advienne. Le sujet du jour, en ce mois de février, c’est le théâtre : Un amour impossible (Flammarion, 2015), son dernier roman, est à l’affiche de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, à partir de samedi 25 février.
Lire la critique : Du roman à la scène, un amour possible
Le spectacle a été créé en décembre 2016 à Besançon (Doubs), dans une mise en scène de Célie Pauthe, avec deux comédiennes merveilleuses, Bulle Ogier et Maria de Medeiros. Le théâtre tient son rôle dans le parcours de Christine Angot, qui se définit comme un écrivain, et surtout pas une écrivaine. Elle a écrit une dizaine de pièces, ses romans attirent les metteurs en scène, et elle-même est une lectrice hors pair de ses textes.
Qu’est-ce qui vous a décidée à écrire du théâtre ?
D’abord, il y a un constat. En 1990, je publie un premier roman, Vu du ciel, après un long parcours de refus par les éditeurs, qui dure six ans. Six années de refus dans la boîte aux lettres, c’est long. Le roman sort, il ne fait pas grand bruit, mais je suis contente parce qu’il existe. C’est très important pour moi.
Ensuite, logiquement, je cherche à écrire un autre livre. Et il commence à ce moment-là à m’arriver une chose qui malheureusement m’arrivera ensuite tout le temps, à savoir que je n’y arrive pas. Je vois vaguement autour de quoi ça pourrait tourner, une espèce de brouillard que je pourrais éclaircir, pas plus. Et ça ne marche pas. Je n’y arrive pas. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça commence à devenir très difficile pour moi. Je me dis : « Qu’est-ce qui se passe ? Pendant six ans je cherche à être publiée, je publie un livre et c’est terminé ? C’est ça, le truc ? »
Je suis inquiète, et puis je m’acharne, je m’acharne, je m’acharne. Et à un moment, ne me demandez pas pourquoi, je me dis : « Et si je faisais une pièce ? » Et là, ça s’écrit tout seul, de A à Z. Ensuite, j’ai réécrit un roman. Puis une pièce. Donc ça s’est alterné, comme ça.
Quand vous écrivez une pièce, que voyez-vous ?
Je vois la scène, qui est un espace abstrait. Sur cette scène, il y a une personne, seule, ou il y a des gens qui se parlent, et il y en a d’autres, en face, qui regardent. Je pense énormément à ça, tout le temps. A cette adresse. A comment faire pour que le spectateur trouve sa place. Qu’il ait une possibilité de ne pas être là, juste à observer. Parce qu’on s’ennuie, quand même, au bout d’un moment, quand on observe. Quand le spectateur est réduit à réfléchir à ce qu’il voit, il ne pense pas à ce qui se passe. Et il ne trouve pas d’autre place que commentateur : « Ah oui, c’est bien, ou c’est pas bien. »
Pourquoi aimez-vous le théâtre ?
J’aime le théâtre parce que c’est vraiment un endroit du présent, et du plain-pied. Ce qui est dit apparaît vraiment par le corps des acteurs. Par la présence, avec laquelle personne ne peut tricher. Ou alors le masque tombe. Si quelque chose n’est pas juste, si quelque chose n’est pas vrai, si la parole est un peu fausse, eh bien il s’ennuie, le spectateur. Si un grand acteur joue un texte intéressant, on se dit : « Ah, c’est un grand acteur. » Si le texte est moyen ou pas très bon, il plafonne, le grand acteur.
Comment définiriez-vous un grand acteur ?
C’est quelqu’un qui comprend l’intégralité d’une phrase. Qui comprend l’intégralité d’un mot. Qui parvient, sans appuyer, à faire résonner chez le spectateur toutes les ondes des mots, des ponctuations, des phrases, et donc de la pensée. Un grand acteur comprend tout, mais il n’est pas dans le savoir pour autant. Etre dans le savoir, dans les romans comme au théâtre, ça ne m’intéresse pas. Mais être dans la compréhension, oui. Et ce n’est pas la même chose. Je fuis le discours.
Pour vous, cette compréhension acquiert une acuité particulière au théâtre ?
Oui, parce que le théâtre est un endroit, pour ne pas dire l’endroit, le seul, où il est possible de dire quelque chose physiquement. Au tribunal, vous ne pouvez pas. Chez les flics, vous ne pouvez pas. En société, vous ne pouvez pas. En famille, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez nulle part.
Même pas dans la relation amoureuse ?
Je pense que dans la relation amoureuse, on peut se dire les choses, mais pas en phrases. On les dit par le silence, on les dit par le toucher, on les dit par la vie en commun. On les dit de toutes sortes de façons, mais pas en phrases. Au théâtre, on peut les dire en phrases, c’est-à-dire avec des mots, qui résonnent en nous de façon très, très, très sensible. Partout où on vous invite à parler : « Dites, on est là, on vous écoute, allez-y, dites la vérité », vous ne pouvez pas. C’est impossible. Vous êtes toujours trahi par les conditions de la mise en scène du truc. Au théâtre, c’est possible. Je ne dis pas que c’est facile, hein. C’est super difficile. Mais si on piétine ça, je le vis très mal, ça me déprime, et si je peux, je m’en vais.
Que pensez-vous de ce que l’on voit, actuellement, sur les scènes françaises ?
Ce que je vois, et ce que j’ai beaucoup vu, c’est beaucoup d’ironie. Très peu de premier degré. Très peu de plain-pied. Une légèreté ironique, autrement dit une fausse légèreté, une légèreté qui pèse des tonnes, une pensée ironique, c’est-à-dire pas une pensée. Beaucoup de choses comme ça qui, si je devais prendre un cliché, se matérialiseraient par l’arrivée sur scène d’un homme qui porte une cagoule. Et par-dessus la cagoule une chapka. Voilà. Là, vous avez le code de l’ironie, et une prise de pouvoir sur les spectateurs, par l’ironie.
Ce qui me gêne, là-dedans, c’est un bien-pensant esthétique, fait pour dire qu’on n’est justement pas bien-pensant. Moi, le théâtre qui m’intéresse, le théâtre qui me plaît, c’est celui où, demandez à Dominique Valadié, demandez à Gérard Desarthe, c’est celui où vous pouvez jouer au premier degré. C’est le plus difficile parce que, pour qu’il y ait la liberté du premier degré, il faut que toutes les couches de degrés aient été questionnées.
Vos textes sont peu portés au théâtre. Pourquoi ?
Parce qu’à un moment donné, j’ai dit stop. Il ne faut pas oublier que, dans ce que j’écris, je me suis beaucoup affrontée à une question qui fait partie des fondements de la tragédie, la question de l’inceste. J’ai eu beaucoup de difficultés quand des metteurs en scène ont voulu s’occuper de certains de mes textes. Le pathos : combien m’ont fait ce plan-là ? Combien d’acteurs, de metteurs en scène, etc. ?
Pleurer sur l’épaule de quelqu’un et lui dire : « Ouh là là ! la vie est bien triste. » Cela a été très violent, chaque fois qu’on m’a fait ce truc-là. Le héros tragique, ou celui qui se trouve dans une situation tragique, n’est pas dans le drame. Il est dans le tragique. Or très souvent, au théâtre, les metteurs en scène ont évité de poser cette question du tragique. Ils ont montré le petit drame de quelqu’un qui a subi des violences familiales. Alors que ce n’est pas des violences familiales.
Qu’est-ce qui vous a décidée à donner les droits d’« Un amour impossible » ?
D’abord, parce que j’ai eu trois demandes. Et aussi parce que la scène a un sens pour moi. J’en avais envie. Je n’avais pas vu le travail de Célie Pauthe, ni des autres qui m’ont demandé. Célie Pauthe connaissait tout ce que j’avais fait, et c’est une très, très bonne lectrice. Ça met en confiance.
Avez-vous beaucoup suivi le travail de répétition du spectacle, dont vous signez le texte ?
Je n’ai pas suivi le travail de plateau. En revanche, j’ai été présente la première semaine, pendant le travail de lectures, autour de la table, pour répondre aux questions. Et puis je suis venue à la toute fin des répétitions, pour la générale.
Dans le programme du spectacle, « Un amour impossible » est présenté comme une « guerre sociale amoureuse ». Qu’en pensez-vous ?
Je trouve ça pas faux. C’est une explication que donne Maria [de Medeiros]. Elle se rebelle contre le fait que Bulle [Ogier] s’incline devant les représentations sociales, tout simplement. Célie [Pauthe] m’a raconté que des hommes qui ont vu le spectacle trouvent cette explication forcée, alors que les femmes n’ont pas du tout cette réaction. Il y aurait beaucoup à réfléchir à ça, je pense.
Vous dites « Maria », et pas « je »…
Parce que c’est pas « je ». C’est éventuellement Christine.
Quand vous montez sur scène pour lire un texte, comme vous le faites régulièrement, êtes-vous « je » ou actrice de vos textes ?
Non, je ne me suis jamais sentie actrice. Je suis l’auteure, celle qui a écrit, celle qui partage avec les gens qui sont là, dans la salle. Une présence simultanée. C’est un moment où vous vérifiez que les gens que vous ne connaissez pas, vous les connaissez.
Vous êtes l’auteure, l’écrivaine ?
Ah non, pas l’écrivaine ! Un mot doit être une sensation, pas une déclaration. Il doit être employé sans qu’on y pense. Si je dis aux gens que je suis écrivaine, ils ne vont pas penser que j’écris, ils vont penser : « Ah, tiens, elle dit écrivaine. » Ils vont penser au mot, pas à l’activité. C’est le contraire de ce que je fais. Encore une fois, je fuis le discours.
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2017 5:30 AM
|
Par Yves Poey pour son blog "De la cour au jardin":
Une leçon.
Danièle Lebrun nous a donné une leçon.
Une leçon de théâtre, bien sûr !
Avec son adaptation de cet Envers du Music-hall, écrit par Colette, l'immense comédienne qu'elle est a purement et simplement subjugué (le verbe n'est pas encore assez fort) tout le Studio-Théâtre.
Véritablement subjugué !
Dès son apparition côté cour, elle envoûte le public.
Aucun décor. Quelques chaises blanches, un escabeau de bibliothèque.
Et c'est tout.
(On reconnaît la volonté et le parti-pris minimalistes de Marcel Bluwal, le mari-collaborateur artistique...)
Un très bel ensemble début XXème siècle veste/jupe longue couleur brique, chemisier blanc avec un col-Claudine (forcément...), une petite cravate noire, un canotier de la même couleur, sublimes bottines assorties, elle est splendide.
Et Melle Lebrun commence à parler, de sa voix reconnaissable entre toutes.
Durant une heure et trente minutes, elle va interpréter cette galerie de personnages que Colette à connus, lors des différentes tournées de music-hall.
(Colette a en effet sillonné la France, on l'oublie souvent, dans une carrière de mime, montrant parfois, ô scandale pour l'époque, un sein nu.)
La comédienne incarne, durant une heure trente, en une quinzaine de tableaux, ces compagnons de tournée de la future auteure du « Blé en herbe » et de la série des Claudine.
Elle fait d'ailleurs plus que les incarner : elle est ces « abeilles pauvres et sans butin », cette jeune première, cette femme aux haltères, cette directrice de troupe, ce régisseur, ce Gonzalez tout timide et en permanence fauché, j'en passe et des meilleures...
Elle EST ces artistes ambulants en tournée !
Elle en tire le portrait parfois tendre, touchant, parfois caustique, parfois vachard, elle les raconte, elle les vit.
Sa façon de dire ce texte, sa manière de dérouler les mots, ses intonations, sa diction parfaite, sont autant de démonstrations du métier et de l'art du comédien.
Durant cette heure et trente minutes, j'avais devant moi ces hôtels plus ou moins miteux, ces artistes de music-hall brinquebalés par la vie.
Je vivais pleinement ces situations de jalousies, de petites mesquineries, de petits bonheurs, de grandes tristesses, de joies et de déceptions vécues par les différents personnages.
Et pourtant, bien entendu, Danièle Lebrun était seule sur scène.
Tous les apprentis-comédiens, tous les étudiants dans les conservatoires et écoles supérieures de théâtre devraient venir voir ce Singulis, et écouter ces mots magnifiés de Colette.
Et se dire en sortant du Studio-théâtre « Voilà, je veux devenir Danièle Lebrun ! »
Une leçon, vous dis-je !
Yves Poey
Singulis, l'envers du Music-hall de Colette. Par Danièle Lebrun http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1543&id=595
Jusqu'au 5 mars au Studio-Théâtre de la ComédieFrançaise
(c) Photo Y.P. -

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2017 7:48 PM
|
En attendant Godot est une pièce de théâtre en deux actes, en français, écrite en 1948 par Samuel Beckett et publiée en 1952 à Paris aux Éditions de Minuit.
La particularité de ce livre vient du fait que le nombre de scènes n'est ni décompté ni annoncé. La première page du manuscrit français porte la date du « 9 octobre 1948 », et la dernière celle du « 29 janvier 1949 » Elle s'inscrit dans le courant du théâtre de l'absurde. Résumé ... Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, se retrouvent sur scène, dans un non-lieu (« Route de campagne avec arbre ») à la tombée de la nuit pour attendre « Godot ». Cet homme - qui ne viendra jamais - leur a promis qu'il viendrait au rendez-vous ; sans qu'on sache précisément ce qu'il est censé leur apporter, il représente un espoir de changement. En l'attendant, les deux amis tentent de trouver des occupations, des "distractions" pour que le temps passe. Des inquiétudes naissent : Est-ce le bon jour ou le bon endroit ? Peut-être est-il déjà passé ? Que faire en attendant ? Au milieu du premier acte, un autre couple entre en scène : Pozzo et Lucky. Le premier est un homme très autoritaire, le propriétaire des lieux si l'on en croit son discours. Le second est un Knouk, une sorte d'esclave, un sous-homme tenu en laisse, que Pozzo commande tyranniquement. Le jeu continue quelque temps, Estragon reçoit des os de Pozzo. Pour Vladimir, le traitement subi par Lucky est une honte, un scandale ajoute Estragon mais sans réelle conviction. Peu de temps après, les deux vagabonds infligeront les mêmes sévices à Lucky. À la demande de Pozzo, Lucky interprète une danse, la « danse du filet ». Muet le reste du temps, il se lance ensuite dans une tirade de plusieurs pages sans aucune ponctuation, morcelée et inintelligible. Les deux nouveaux venus disparaissent, et les deux vagabonds se retrouvent à nouveau seuls sur scène. Godot n'est pas encore venu. Un jeune garçon apparaît, envoyé par l'absent pour dire qu'il viendra demain. Vladimir a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, mais le garçon ne se le rappelle pas. Fin de l'acte I.
Acte II, la lumière de la scène se rallume sur le même décor. Seul l'arbre a changé d'apparence : il a quelques feuilles. Au début de l'acte, en l'absence d'Estragon, Vladimir est « heureux et content », ce qui fait de la peine à Estragon à son arrivée sur scène : « Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là ». Le premier acte se rejoue à l'identique, plus rapide et avec quelques variations. Estragon ne se souvient pas du jour précédent malgré les efforts de Vladimir pour le lui faire rappeler. Arrivés sur scène, Pozzo et Lucky tombent au sol. L'aide se fait attendre, Estragon souhaitant la monnayer, et Vladimir se lançant dans des tirades sur la nécessité d'agir. Pozzo affirme être devenu aveugle et Lucky est devenu muet, mais il ne se rappelle plus quand, « un jour pareil aux autres ». Après leur départ, étant le seul à se souvenir des événements de la veille, Vladimir réalise la futilité de son existence. La fin de la pièce ne réserve aucune surprise : le garçon de l'acte I vient délivrer le même message, sans se souvenir être venu la veille. Les deux compères envisagent de se suicider en se pendant à l'arbre.
Estragon dénoue sa ceinture, son pantalon tombe. Ils y renoncent, car ils cassent la ceinture en voulant s'assurer de sa solidité. Enfin, un dernier échange: « Allons-y » dit Estragon. « Ils ne bougent pas » précise Beckett en didascalie...
FILM: En attendant Godot, 1989 production de la TV avec Jean-François Balmer : Estragon, Jean-Pierre Jorris : Pozzo, Roman Polanski : Lucky etRufus : Estragon
Regie: Walter D. Asmus
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...