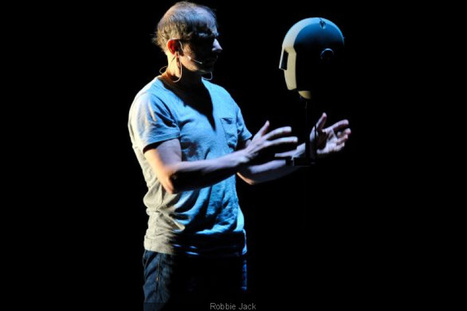Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2018 8:15 AM
|
«Poussière» de Lars Norén: une grande pièce qui fait vivre la fin de vie
Par Jean-Pierre Thibaudat Blog : Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat - 26 févr. 2018
Il fait bon quand un théâtre français commande une pièce à un auteur. La preuve par «Poussière» de Lars Norén, une commande de la Comédie-Française pour son excellente troupe. Une pièce au long cours, saisissante et crépusculaire. Dommage que le metteur en scène Norén soit dépassé par l’immensité de sa pièce.
A la page 78 de Poussière, la dernière pièce traduite du Suédois Lars Norén, I et D échangent quelques mots : « I. Il se passe pas grand-chose. D. Je crois que c’est ça le principe. Enfin il ne se passe rien. I. Non. D. Est-ce que ce n’est pas ce à quoi on a toujours aspiré ? » Tout est dit. Deux voix en fin de souffle. Deux corps en attente du dérèglement final.
Une odeur de pourri
Nous sommes à peu près à mi-parcours de la pièce (qui tourne autour de 130 pages) où évoluent dix personnages retraités de modeste condition le plus souvent, ayant pour nom une lettre de l’alphabet, de A à J. Ils, elles ont été ouvrier dans le bâtiment, coiffeuse, médecin, chauffeur routier, pasteur, agent d’hôpital, livreur ; ils ont connu des hauts et des bas mais n’ont pas été victimes d’un chômage de longue durée. Seule à avoir un prénom, une jeune fille, déficiente mentale, Marylin, apporte un vent d’ailleurs en fredonnant des chansons tristes de Françoise Hardy comme le sublime Message personnel.
Qui sont ces personnes qui attendent, n’ont plus de projet de vie ? Des Français, comme le sont les acteurs pour qui la pièce a été écrite, ou des Suédois, comme l’est l’auteur ? On ne sait. Disons qu’ils sont de modestes retraités européens de l’ouest séjournant dans un hôtel moyen du bord de mer d’un pays chaud, probablement en Afrique (du Nord ou pas), un continent qui dans l’autre sens nourrit le flux des réfugiés, comme dit l’un des personnages. Ce n’est pas le grand luxe, cet hôtel dont on ne voit pas le personnel. Ils le fréquentent pour certains depuis plus de trente ans, ils ont vieilli avec lui, et l’hôtel aussi a vieilli, des chaises manquent, il n’y en a pas pour tout le monde.
Il ne s’est pas passé grand-chose depuis le début et il ne se passera rien de notable jusqu’à la fin de la pièce. Ceux qui disparaissent, ou plutôt s’éteignent un à un sans faire grand bruit, se contentant de peu : on cesse de parler, on ferme les yeux, on s’oublie. La mort des uns et des autres n'’est pas un drame, elle est ce qui vient après le dernier mot. L’odeur de pourri et de putréfaction est déjà là avant, elle prépare le terrain, « on sent quand on se couche à quel point on pue. Comme si on était déjà mort », dit J. La mémoire est un feu qui a des soubresauts, des retours d’enfance quand on souffle sur ses dernières braises. Il y a longtemps que l’on a jeté la dernière bûche au feu.
Tout s’étiole, on entend de moins en moins, on perd l’appétit, on a de plus en plus froid. Certains ne sont pas si vieux que ça, semble-t-il, mais la retraite, la cessation d’activité les a plongés dans une léthargie de vivre, un repli sur soi souvent poisseux, égoïste. Seuls ou en couples (lesquels ne sont pas bien vaillants voire effroyables), ils soliloquent plus qu’ils ne font la conversation.
Ils n’ont pas tous atteint le grand âge mais leur cohabitation ne les rajeunit pas. « Je n’ai pas eu le temps de devenir jeune », dira B par trois fois. Leur vie est faite de redites. Leur vie est derrière eux. L’âge importe peu, ils attendent l’échéance en trompant l’attente comme ils peuvent, en se souvenant, en se chamaillant, en se supportant. Seul, I dit être né en 1943, soit un an avant l'auteur, Lars Norén qui signe avec Poussière une pièce crépusculaire, tendrement impitoyable.
« Nous sommes là »
La pièce est une commande. C’est suffisamment rare aujourd’hui en France pour être signalé. Une commande faite par l'Administrateur de la Comédie-Française, Eric Ruf, à l’auteur suédois qui était déjà venu il y a quelques années mettre en scène l’une des ses pièces, Pur, au Théâtre du Vieux Colombier. Cette fois, c’est le lieu saint, la salle Richelieu. Et pour onze actrices et acteurs de la maison de Molière, onze personnages comme souvent dans les pièces de Jean-Baptiste Poquelin. Ce n’est pas aux personnages de ce dernier qu’on pense en lisant Poussière mais à d’autres empruntés à Samuel Beckett. « C’était une belle journée aujourd’hui », dit par E, fait forcément écho à la vieille Winnie de Oh les beaux jours (« encore une journée divine », « quel beau jour ça aura été »).
Premiers mots de Poussière, entre A, le mari, et B, sa femme : « A. Nous sommes là. B. Oui. Pause. A. N’est-ce pas. Pause. B. Comme d’habitude. A. Oui, c’est ce que je dis. Pause. B. Ensemble. Pause. A C’est ce que je dis. Tousse. » Une musique de mots qui rappelle Beckett, certes, mais on en est loin. A et B ne sont pas seuls au milieu de nulle part, mais dans un lieu de villégiature et au sein d’un groupe conséquent. Poussière tient sa force dans la présence continuelle des onze personnages qui restent ensemble tout au long de la pièce ou presque. La maigreur beckettienne laisse place à des répliques qui semblent sortir d’un robinet coulant continuellement où chacun vient s’abreuver, le joint en lambeaux du robinet rafistolé de ficelle ne parvenant plus, même fermé, à arrêter le débit. On parle court, goutte par goutte, mais parfois un souvenir, une douleur dégouline aux lèvres en abondance.
Poussière est une communauté de solitudes faite d’épluchures d’adieux sans cérémonie, de deniers bavardages en attendant que ça finisse. Beaucoup ont perdu une épouse, un époux, un enfant, un chien. Au bord de leur propre mort, ils vivent avec leurs morts en bonne compagnie.
Lars Norén s’est entretenu avec sa collaboratrice artistique Amélie Wending en marge du spectacle et c’est comme un sous-texte à sa pièce : « Avant, mes pièces étaient très remplies, ma poésie aussi ; maintenant, j’enlève, je « décrée », on pourrait dire. Avant, il était important pour moi de savoir où mon texte finirait. Maintenant, si j’écris et si je sais ce que ma pièce va devenir, j’arrête immédiatement. » Poussière n’a pas de fin, la pièce s’arrête par épuisement, parce qu’il n’y a plus rien, plus personne, plus de bouche à nourrir de mots.
« Dans la phase de vie où je suis... »
Ce n’est pas une pièce à part, elle participe du dernier temps de son œuvre, nous dit Norén. « Ces pièces sur les personnages âgées sont nées parce que moi-même je vieillis. Je ne suis plus intéressé par les phrases intelligentes et bien huilées, je connais cette machinerie. Je veux créer différentes atmosphères, différents mouvements. Dans la phase de la vie où je suis, je réalise que ce sont les choses très simples qui recèlent les plus grands secrets. » C’est cela que Lars Norén traque et thésaurise dans Poussière.
Jusqu’à la veille de la première, Lars Norén a modifié le texte et taillé dedans. La version publiée dont je parle ici est sensiblement différente de celle qui est jouée. Norén a travaillé à l’écoute des acteurs du Français. Il n’est pas le premier à procéder ainsi. Je me souviens de ces pages où Jean-Louis Barrault raconte comment Paul Claudel qui assistait à ses côtés aux répétitions d’une de ses pièces, revenait le lendemain avec une nouvelle version d’une scène, laquelle, répétée la veille, lui avait paru insatisfaisante. Les acteurs devaient tout recommencer, apprendre le nouveau texte. C’est un peu ce qui s’est produit avec Poussière, sauf que Norén qui signe la mise en scène de sa pièce n’a pas à ses côtés un Barrault pour relancer la machine, serrer les boulons, huiler les mécanismes.
Dans dix ans, dans vingt ans
Le soir où j’ai vu le spectacle, c’était l’une des premières représentations, le jeu des acteurs flottait. Ils n’avaient pas atteint la légèreté et la souplesse que requiert cette vaste pièce. Etait-ce dû à la difficile mémorisation de ce texte ? Sans doute. Mais pas seulement. Claudel pouvait s’appuyer sur Barrault, Lars Norén n’a pas cet appui. Il lui fallait diriger onze acteurs ensemble. Pas simple. C’était trop. Le metteur en scène semble aussi avoir porté toute son attention sur les mots que disent les acteurs mais en négligeant leur corps. Il manque le regard qu'aurait pu porter sur eux un Thierry Thieû Niang. Si je cite ce danseur et chorégraphe, c'est que pendant le spectacle me sont revenues des images du film de Valéria Bruni-Tedeschi Une jeune fille de 90 ans où on le voit travailler avec les pensionnaires aux corps bloqués ou engourdis du service de Gériatrie à l'hôpital Charles Foix d'Ivry.
Trop vert les soirs des premières représentations, le spectacle a aussi besoin de vieillir. De se simplifier. De renoncer à ce tulle blanc ridicule derrière lequel les morts vivent une seconde vie. Il a besoin de se décharner.
En Slovénie, un metteur en scène-poète a écrit et mis en scène un spectacle qui ne se donne qu’une fois tous les dix ans. La première a eu lieu il y a plus de trente ans, la quatrième représentation aura lieu dans quelques années. Si un acteur meurt entre temps (cela n’a pas encore été le cas), un robot, cette marionnette des temps modernes, le remplacera.
Rêvons pour Poussière d’un destin similaire, en remplaçant le robot par un tas de cendres. Que les acteurs qui viennent de créer Poussière à la Comédie-Française – et il faut tous les citer car ils sont tous irréprochables : Hervé Pierre (A), Dominique Blanc (B), Anne Kermesse (C), Alain Lenglet (D), Danièle Lebrun (E), Christian Gonon (F), Bruno Raffaelli (G), Martine Chevallier (H), Françoise Girard (Marylin) – que tous ces acteurs donc se retrouvent dans dix ans pour reprendre Poussière. Et ainsi de suite, tous les dix ans. Jusqu’à leur mort. Le texte de Poussière leur survivra. Vieillira-t-il bien ?
Comédie-Française, salle Richelieu, en alternance jusqu’au 16 juin.
Le texte de Poussière est paru aux éditions de L’Arche, 144p., 14€.
Légende photo : «Poussière», création de Lars Noren à la Comédie Française. © Brigitte Enguérand coll. Comédie Française

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2018 5:09 AM
|
Par Gallia VALETTE-PILENKO dans Le Tout Lyon - le 21 février 2018
CRUE (anticipation climatique), mise en scène de Jean-Pierre Baro
Après sa création à l'ENSATT, le premier spectacle de la promotion Joel Pommerat est à découvrir sur le grand plateau du Théâtre nouvelle génération. Mis en scène par Jean-Pierre Baro, Crue explore et brasse le changement climatique, les migrations, et les bouleversements que cela entraine dans une joyeuse sarabande de petites scènes qui s'emboitent.
Chaque saison, l'ENSATT propose son lot de spectacles conçus par la promotion qui sort l'année en cours. Le spectacle qui ouvre les festivités est une « anticipation climatique » imaginée par la section écrivain-dramaturge et mis en scène par Jean-Pierre Baro, dont les lyonnais ont pu voir le travail tout récemment au Théâtre de Vénissieux à l'occasion de la venue de la pièce À vif de Kery James.
Et ce sont les élèves de la 77è promotion, placée sous l'égide de Joel Pommerat, qui s'emparent de ce montage de saynètes, entre fantaisie et réalité, entre légendes et actualités. Composé de 12 scènes écrites à 14 mains en six mois sur le changement climatique, Crue se décompose en deux parties, celle d'un avant et d'un après la catastrophe où la place Bellecour serait noyée sous l'eau, la température oscillant entre 35 et 50° Celsius et où les Atlantes se promèneraient au milieu des survivants.
Avec une scénographie plutôt inventive, constituée d'objets de récup et de planches de bois, qui se transforme au gré des besoins en phare, en radeau, en ponton ou en cabane de chantier, les onze jeunes comédiens se glissent dans ces histoires loufoques et drôles, où il est question d'une orque dépressive, d'une Brigitte Bardot irrésistible, plus hystérique encore que dans la vraie vie, d'un homosexuel désespéré par la perte d'une carte mémoire et deux frère et sœur qui seront le fil conducteur (ténu) de cette « dramaturgie de la montée des eaux ».
Sans parler de l'inoubliable Mami Wata, désopilante déesse de la mer et du continent de plastique qui la porte, qui tance les humains tout en les protégeant.
Gallia Valette-Pilenko
TNG, 27 février, www.tng-lyon.fr Sur le site de l'ENSATT : http://www.ensatt.fr/index.php/14-archives-ateliers-spectacles/2028-crue

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2018 3:20 AM
|
Par Stéphane Capron dans Sceneweb - 25 février 2018/
Le conseil d’administration de Châteauvallon a nommé Charles Berling et Pascale Boeglin Rodier à la direction de la Scène Nationale Châteauvallon, laissée vacante par Christian Tamet. Une nomination entérinée par le conseil d’administration du Théâtre Liberté présidée par la journaliste Claire Chazal. Châteauvallon et le Liberté partageaient depuis 2015 le label de « scène nationale ».
Châteauvallon a connu ses heures de gloires sous la direction de Gérard Paquet, maintenant contre vents et marées la programmation de l’amphithéâtre de plein air et du théâtre couvert à la fin des années 90 face aux pressions du Maire FN de l’époque Jean-Marie Le Chevallier. En 1996, avec le préfet du Var Jean-Charles Marchiani ils avaient exigé la déprogrammation du groupe de Rap Suprême NTM2. À la suite de cette affaire et du refus de Gérard Paquet des subventions de la mairie Front National, la procédure judiciaire avait aboutit à la dissolution de l’Association Châteauvallon et au licenciement de son Directeur/Fondateur.
En 1998, une nouvelle association est créée sous le nom de Centre national de création et de diffusion culturelles (CNCDC) et placée sous la direction de Christian Tamet, avec le soutien financier du Ministère de la Culture (à hauteur de 50 %), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général du Var. La ville d’Ollioules assume la gestion du site.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2018 7:27 PM
|
par Stéphane Capron dans Sceneweb
Le mandat de Pauline Sales et de Vincent Garanger à la tête du CDN de Vire va s’achever à la fin de l’année. Voici la liste candidats retenus par les tutelles et qui vont désormais plancher sur leur projet.
– Lucie Berelowitch
– Marie Lamachère et Barbara Métais-Chastanier
– Alexis Moati
– François Orsoni
– Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2018 10:06 AM
|
Par Jean-Noël Escudié / P2C sur le site Des Territoires (Caisse des Dépôts)
L'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP, voir notre article ci-dessous du 12 juillet 2016) a tenté d'apporter une réponse au contentieux récurrent autour du statut des artistes amateurs participant à des spectacles à but lucratif. Une question qui n'a rien de théorique lorsqu'on sait qu'un spectacle comme celui du Puy du Fou emploie environ 3.400 bénévoles...
Un dispositif complexe
La loi LCAP précise ainsi qu'"est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération", les frais occasionnés pouvant toutefois être remboursés sur présentation de justificatifs. Autre précision importante : "La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L.7121-3 et L.7121-4 du code du travail", définissant les contrats de travail dans le secteur artistique.
Un décret du 10 mai 2017 "relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif" est venu détailler les modalités - complexes - de mise en œuvre de cette mesure et préciser les diverses limitations et dérogations (voir notre article ci-dessous du 22 mai 2017).
Le contenu de la convention avec l'Etat ou les collectivités
Un arrêté du 25 janvier 2018 vient parachever l'édifice et permet ainsi au dispositif issu de la loi LCAP d'entrer en vigueur. L'arrêté commence par préciser le contenu de la convention qui doit être signée entre la structure organisatrice du spectacle et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements. Cette convention doit préciser l'objectif et les moyens de "la mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs", qui justifie le recours à des artistes amateurs.
Elle doit aussi mentionner la durée et l'échéance de la convention, les dates ou les périodes prévues pour la mise en œuvre des actions réalisées dans le cadre de la mission, les moyens prévus "en particulier pour l'accompagnement des artistes amateurs, en distinguant le temps de transmission pour les ateliers et heures d'enseignement, et le temps de répétition" (avec un nombre d'heures consacrées au temps de transmission supérieur à celui des répétitions), le nombre de représentations publiques envisagées, leur territoire géographique, les modalités de publicité de la convention et, enfin, le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité de la structure signataire.
Un autre article de l'arrêté prévoit également que la convention précise les modalités d'information des artistes amateurs sur le "document unique d'évaluation des risques de l'entreprise" et sur le ou les programmes de prévention des risques, ainsi que sur la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle.
Une télédéclaration très détaillée...
Enfin, l'arrêté du 25 janvier 2018 détaille le contenu - particulièrement détaillé - de la télédéclaration que la structure organisatrice doit adresser, deux mois avant le spectacle, sur un registre national tenu par le ministère de la Culture. Doivent notamment figurer dans cette télédéclaration le numéro de licence de l'entrepreneur, tous les éléments relatifs à l'identité et à la nature du spectacle, mais aussi "le nom, les prénoms et le nombre d'artistes amateurs intervenant dans chaque représentation d'un spectacle ainsi que, pour chaque artiste amateur, le nombre de spectacles et le nombre de représentations" (soit environ 3.700 noms pour le Puy du Fou...).
Doivent aussi figurer le nombre total de représentations lucratives entrant dans la programmation de la structure signataire de la convention pour les douze mois précédant la première représentation prévue du spectacle, ainsi que la part de recettes attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs . Le formulaire de télédéclaration en ligne sera accessible via le portail "mes-demarches.CultureCommunication.gouv.fr"
Références : arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif (Journal officiel du 31 janvier 2018).
inPartager
TÉLÉCHARGER
La notice explicative de la télédéclaration, éditée par le ministère de la Culture. https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171059401&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
POUR ALLER PLUS LOIN
L'arrêté du 25 janvier 2018.
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/25/MICB1719091A/jo/texte
Le décret du 10 mai 2017 http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/MCCB1712946D/jo/texte
L'article 32 de la loi LCAP du 7 juillet 2016
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/article_32
LIRE AUSSI
Culture - Emploi d'amateurs dans le spectacle vivant : une fiche pratique en attendant l'arrêté
10/11/2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280032648

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 5:34 PM
|
Publié dans Sortir à Paris
Le metteur en scène Simon McBurney et son Théâtre de Complicité présentent The Encounter à l'Odéon Théâtre de l'Europe, un spectacle solo de Simon McBurney lui-même qui plonge le spectateur muni d'un casque audio dans la découverte d'une autre culture.
Au début des années 70, le reporter-photographe américain Loren McIntyre part en expédition dans les fins fonds de l'Amazonie. En s'enfonçant dans la jungle, entre le Brésil et le Pérou, il fait une découverte fascinante : celle d'une tribu singulière, les Mayoruna, dont la première particularité est la croyance qu'ils descendent des jaguars. Au plus près de cette tribu semi-nomade, le journaliste va vivre une expérience inédite, unique, qu'il n'oubliera jamais. Quelques années plus tard, il fera le récit de cette aventure à l'écrivain roumain Petru Popescu qui en écrira un livre de cinq cents pages, intitulé La Rencontre (The Encounter : Amazon Beaming).
C'est de ce livre passionnant, à la fois document anthropologique, carnet de voyage et roman d'aventures que le metteur en scène Simon McBurney s'est inspiré pour créer son spectacle, The Encounter, présenté à l'Odéon Théâtre de l'Europe le temps de quelques représentations. The Encounter est une installation singulière elle aussi puisqu'elle met le spectateur seul face à la découverte. En effet, muni d'un casque, il est immergé dans un univers sonore où le récit se fait parcours initiatique à travers les échos d’une autre nature, aux frontières immémoriales de la conscience.
Infos pratiques :
The Encounter, à l'Odéon Théâtre de l'Europe du 29 mars au 8 avril 2018.
Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Deux représentations à 15h et 20h le samedi 7 avril.
Tarifs : de 6 à 40€
Réservations : 01 44 85 40 40
Marine S.
Dernière modification le 24 février 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Odéon Théâtre de l´Europe
2 rue Corneille
75006 Paris 6
ACCÈS
Métro Odéon
TARIFS
TP : 40 €

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 5:14 PM
|
Par AFP, publié le 24/02/2018 dans Le Point
Le festival du film de Berlin a décerné samedi soir son prix du meilleur acteur au jeune Français Anthony Bajon, à l'affiche de "La prière" de Cédric Kahn dans un rôle de toxicomane en quête de rédemption.
"J'ai beaucoup prié pour avoir cet Ours (rires), c'est tout à fait incroyable, c'est un rêve pour moi", a-t-il déclaré devant la presse, décrivant l'accueil "splendide" de la Berlinale.
"Je me sens en fait comme un enfant qui ne peut pas contrôler ses émotions", a-t-il ajouté, avant d'évoquer son empathie pour les drogués, "des gens qui veulent s'en sortir" et son espoir de réussite pour le film, qui évoque des sujets "touchant le monde entier".
L'acteur de 23 ans a fit ses débuts dans "Les Ogres" de Léa Fehner en 2015 et a eu des rôles secondaires dans "Maryline" de Guillaume Gallienne, "Rodin" de Jacques Doillon ou "Nos années folles" d'André Téchiné.
Avec ce prix, il devient le 7ème acteur français primé à Berlin et prend la suite d'acteurs aussi illustres que Jean Gabin (récompensé en 1959 et 1971), Jean-Pierre Léaud (1966), Michel Simon (1967), Jean-Louis Trintignant (1968), Michel Piccoli (1982) et Jacques Gamblin (2002).
"La Prière" brosse le portrait de jeunes qui rejoignent une communauté isolée en montagne, où ils se soignent à force de discipline, dans l'amitié et la prière, pour en finir avec leurs addictions. Un mode de vie qu'ils adoptent parfois pendant des années avant d'espérer revenir à la vie à l'extérieur.
Anthony Bajon incarne Thomas, 22 ans, accro à l'héroïne. Du parcours de ce jeune, on ne saura presque rien, mais les blessures de l'enfant en lui affleurent parfois sur son visage poupin, notamment dans une scène inoubliable où il est face à l'actrice allemande Hanna Schygulla.
"Anthony a passé le casting au même titre que les autres. C'est lui qui avait le plus grand spectre de jeu. Il a quelque chose de candide", a estimé le réalisateur Cédric Kahn, interrogé par l'AFP.
"Ce qu'a apporté Cédric, c'est quelqu'un de très précis. Dans "Les Ogres" je pouvais être en impro, en roue libre totale alors que là Cédric savait où il voulait aller", a souligné l'acteur.
Le film sortira le 21 mars sur les écrans français.
Légende photo : Berlinale: le jeune Français Anthony Bajon sacré meilleur acteur © AFP / John MACDOUGALL

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 1:10 PM
|
Par Judith Chaine dans Télérama-Sortir à Paris
La vidéaste Juliette Deschamps met en images le célèbre opéra de Mendelssohn et y insuffle toute la beauté et la force des enfants des bidonvilles d’Angola.
Shakespeare et Mendelssohn en Angola ? Voilà le projet que nous propose la metteuse en scène Juliette Deschamps. « Lors d’une résidence à l’Opéra de Montpellier, confie-t-elle, on m’a suggéré de développer des vidéos autour du Songe d’une nuit d’été… Etant de la génération frappée par le travail de Bill Viola, ça m’a parlé tout de suite ! »
Les mots du barde anglais et les notes du compositeur romantique allemand trottent dans sa tête alors qu’elle traverse l’Afrique de l’Ouest… En Angola, tout se cristallise : Juliette Deschamps décide de filmer les enfants des musseques (bidonvilles) en train de jouer cette féerie. Leur sens du théâtre ne fait aucun doute, leur beauté non plus.
Trois voyages, douze jours de tournage et des milliers d’images plus tard, Un songe d’une nuit d’été est créé à Montpellier. « Un dispositif permet d’envoyer ces images en live sur scène. Moi qui ai toujours rêvé d’être dans l’orchestre, j’ai trouvé le moyen d’y parvenir ! Comme si j’étais soliste, je me tiens près du chef et je joue mes images selon des tops précis. »
Entretien Le pantsula, une danse sociale et contestataire née dans les townships de Johannesbourg
Est-ce alors chaque fois le même spectacle ? Non ! Chaque chef a son tempo, chaque orchestre son propre son et la vidéaste s’en inspire, improvisant l’assemblage de sa centaine de séquences : « Cette œuvre est punk ! Par exemple, le récitant, ici incarné par le génial Hamlet de Peter Brook, William Nadylam, intervient au milieu d’une phrase jouée par l’Orchestre de chambre de Paris, pour dire une scène entière de Shakespeare ! » Alors précipitons-nous pour (re)découvrir cette partition, avec sa fameuse Marche nuptiale.
A VOIR
Un songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare et Mendelssohn, le 24 février, 20h, Centquatre, 5, rue Curial, Paris 19e, 01 53 35 50 00 (complet).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 12:17 PM
|
Michèle Jacobs-Hermès pour TV5 Monde - 13.02.2017
Un théâtre est toujours une aventure culturelle mais c'est aussi une entreprise. Avec une équipe, des moyens, un modèle économique, des objectifs... Exemple avec Le Théâtre des Déchargeurs, situé en plein cœur de Paris.
« Les Déchargeurs » ? Une vraie fabrique, au sens noble du terme. Ce théâtre, créé au début des années 1980, découvre, lance des spectacles et aide de très nombreux artistes à se professionnaliser. Il répond à des acteurs, des musiciens confirmés, désireux de tenter de nouveaux formats. Cerise sur le gâteau : Philippe Geluck, papa du Chat, dessinateur adulé des francophones, est un jour passé par là. Il a déposé l’empreinte de sa patte facétieuse sur une fresque monumentale qui, dès l’entrée du théâtre, invite chacun à jouer la carte de l’adoption… d’un fauteuil en déshérence.
Guillaume Apollinaire, Michel Houellebecq, Samuel Beckett, Israël Horovitz sont, pour l’heure, simultanément à l’affiche. Avec d’autres. Olivier Py, Michael Lonsdale, Mario Gonzalez se sont essayé dans ces murs. Des acteurs comme Denis Lavant s’y produisent, de même que des musiciens et des chanteurs, sur les traces d’Emily Loiseau, des Têtes Raides, d’Arthur H, d’Antoine Chance (premier lauréat des « Jeunes talents » de TV5MONDE) ou de Vincent Delerm. Beaucoup ont fait ici leurs premières armes. La poésie y fait aussi salle comble. Et les soirées citoyennes viennent d’y prendre leur envol grâce aux « Amis des Déchargeurs », particulièrement présents dans l’animation des lieux.
Un duo de quadragénaires passionnés aux commandes
Ne dîtes pas à Ludovic Michel, son co-directeur avec Lee Fou Messica, que sa programmation est « éclectique » ! Il déteste le mot. L’homme est loin d’être un touche-à-tout. Lorsqu’il est arrivé de Besançon aux Déchargeurs pour y produire un spectacle autour de la poétesse Anna de Noailles, voici 25 ans, le lieu était déjà un « bastion ». Il n’en est jamais reparti, pris par la passion que lui inspirait l’implication de l’équipe menée par Vicky et Lee Fou Messica.
Nous sommes à deux pas du Châtelet à Paris. A l’époque des Halles, le bâtiment qui abrite aujourd’hui Les Déchargeurs était un hôtel de maître. Avec sa façade, sa cour intérieure et son escalier, aujourd’hui classés, les lieux qui avaient hébergé le premier directeur de l’Opéra de Paris servaient à faire mûrir des bananes et affiner des fromages, jusqu’à leur fermeture au début des années 1970.
Vicky Messica venait de débarquer de Tunisie. Il accompagnait Claudia Cardinale pour un casting. Ses origines mêlant sangs grec, russe, italien lui donnaient un tel charisme, qu’il convainquit immédiatement la propriétaire du bienfondé de son projet artistique et de l’adéquation des lieux. Il consacrera trois ans à mettre en place son théâtre, grâce notamment à ses gains de jeu : « Vicky était grand joueur de poker. Il jouait avec Yves Montand, Serge Reggiani. Des fortunes misaient sur lui. Le soir il venait dire de la poésie ici. » Vingt-trois tonnes de gravats seront évacuées… pour laisser place aujourd’hui à deux petites salles de spectacle, un club de poésie dans les caves voûtées, un joli bar où le Chat de Philippe Geluck côtoie des photos de SDF. Et un grand bureau vitré, à fleur de cour, où règne l’atmosphère d’une ruche plus qu’active.
La prise de risques chevillée au corps et au cœur
C’est que le Théâtre des Déchargeurs est bien plus qu’un théâtre classique. Trente-cinq ans qu’il tourne. Ludovic Michel et Lee Fou ont d’ailleurs décidé de mener un long travail de patrimoine sur la vie du lieu après avoir célébré récemment l’anniversaire de son ouverture avec Christopher Hampton. Une manière de prouver la légitimité de son activité, son utilité vitale dans le métier. « Nous assurons chaque année quelque 640 levers de rideau », confie Ludovic Michel.
En février, ce ne sont pas moins de dix spectacles de théâtre qui sont proposés simultanément aux spectateurs. Certains sont présentés en primeur ou repris, avant de partir sur de grands plateaux. Encore tout récemment à l’affiche « Le Dépeupleur » de Samuel Beckett dans une mise en scène d’Alain Françon (ancien directeur du Théâtre de la Colline) et interprété par l’immense comédien Serge Merlin (oui, oui, le peintre un peu fou du film « Amélie Poulain ». Il va reprendre le spectacle en avril au Théâtre de la Ville, puis au TNP de Villeurbanne, passant ainsi d’une jauge de 80 à plus de 600 spectateurs.
D’autres spectacles émanent de professionnels qui démarrent ; ils ont, le cas échéant, reçu des aides à l’écriture ou à la production et viennent ici pour susciter si possible des tournées ultérieures. D’autres encore arrivent depuis des scènes situées ailleurs en France, petites troupes, mais aussi scènes nationales ou régionales, pour se faire découvrir des Parisiens.
Tous les cas de figure se retrouvent, tous les types de contrat, les Déchargeurs jouant – au travers de ses deux petites salles - la partition de la production ou de la co-production, de la réalisation ou de la co-réalisation, de l’accueil, etc. Cette activité, cette prise de risques est rendue possible grâce aux autres métiers de l’équipe. Mais les équilibres restent fragiles…
Aider les professionnels et nouer des partenariats à travers la France, la Suisse, le Liban, la Bulgarie et au-delà
L’équipe a développé des outils, des réseaux, noué des partenariats, tels ceux qui la lient de manière très suivie au Printemps des Poètes à Paris, ou au Théâtre des Halles dirigé par Alain Timar à Avignon. « Depuis trois ans, nous apportons une "aide à la direction" dans ce théâtre municipal et labellisé DRAC, qui va inaugurer sous peu des résidences d’écriture ».
Les liens peuvent être aussi plus ponctuels, comme c’est le cas avec le Théâtre du Rond-Point à Paris, la Scène nationale de Châteauvallon, le Théâtre d’Antibes (avec Daniel Benoin), le Théâtre Liberté de Toulon (où officie Charles Berling), le Théâtre du Crochetan à Monthey en Suisse, ou encore le Théâtre du Passage à Neuchâtel…
« Nous sommes probablement les seuls à avoir développé autant de pôles d’activités, ce qui nous donne une belle visibilité dans le milieu. Nous aidons les compagnies, si elles en éprouvent le besoin, à élaborer leur budget, leur cahier technique avec les différents scénarios utiles selon les configurations dans lesquelles elles vont se produire ensuite. Nous intervenons en outre, fréquemment, sur la circulation des spectacles. Nous tenons aussi à nos rencontres autour de poètes. Vicky Messica, le fondateur des Déchargeurs, avait ouvert la voie, lui qui détenait les droits de Blaise Cendrars. Nous organisons toutes les trois semaines, une rencontre, un échange, mêlant des poètes qui ont pignon sur rue sans toutefois que le public sache toujours qu’ils ont touché à la poésie (c’était le cas récemment avec Tahar Ben Jelloun et Michel Onfray) avec des écrivains méconnus, tel Hervé Annoni, qui, le jour est peintre en bâtiment, et qui anime nos soirées "Poésie mon amour" ».
Sans parler des lettres que Guillaume Apollinaire envoya durant toute la Première Guerre mondiale à son aimée, et qui font l’objet d’un spectacle selon l’adaptation à la scène assurée par Pierre Jacquemont : « C’est le petit-fils du poète qui les lui a confiées car elles n’avaient jamais été publiées, à quelques exceptions près, par Gallimard. » La lecture à deux voix intitulée « Madeleine, l’amour secret d’Apollinaire » est un petit bijou de tendresse et d’émotion (jusqu’au 27 mars).
Ludovic Michel est intarissable quand il évoque les projets du Théâtre : de « I feel good », une pièce écrite par un jeune auteur, Pascal Reverte, sur une rencontre hallucinée entre un homme et une femme, le temps d’un bref évanouissement dans un service de réanimation, qui sera jouée à partir du 21 février. De la production de « Cloué au sol » avec Gilles David, sociétaire à la Comédie Française, qui va être montré au Théâtre du Rond-Point.
Jusqu’à la venue, imaginée avec l’ami des Déchargeurs, Jean-Pierre Siméon, d’Anouk Grinberg qui jouera « La Femme qui parle à ses pieds » la saison prochaine, en passant par un grand rendez-vous programmé pour fin mai, avec la mairie du 1er arrondissement de Paris, le Conservatoire, le Forum des Halles, la Comédie Française : « Pendant trois jours nous proposerons "Le Théâtre tient parole" avec des spectacles gratuits dans différents lieux. On se battra ici aussi pour faciliter l’accès à la culture. »
Autres rendez-vous attendus parmi une foultitude : la relecture du texte « La France contre les robots » de Bernanos : « Gilles, son petit-fils, viendra nous parler de son grand-père dont on oublie souvent qu’il s’est fermement opposé au maréchal Pétain. Tout ce qu’il a écrit il y a 70 ans sur l’inhumanité est en train de se vérifier ! » Et Fabrice Luchini, qui viendra à partir du 28 mars, dira des textes de Charles Péguy, Emile Zola, Pascal Bruckner, Sandor Ferenczi et Jean Cau sur le thème « Des écrivains parlent d’argent ».
Les Déchargeurs, c’est aussi parfois des passerelles avec des scènes étrangères, notamment en liaison avec la fondation Alliance française : en Ukraine, en Bulgarie, dans les Emirats, en Colombie, en Chine, en Corée, au Pakistan, au Liban, avec même une incursion dans le théâtre africain.
Une société qui développe l’entraide, cela peut aussi passer par le théâtre
Enfin, ce théâtre multicartes et au profil si ouvert, accueille des « Rencontres citoyennes », initiées grâce aux « Amis des Déchargeurs », à l’initiative de son président François Vignaux et de son complice, le réalisateur Jean-Michel Djian. La ligne poétique des Déchargeurs leur doit beaucoup. L’ouverture sur les questions de santé publique, de solidarité avec les SDF, d’éducation républicaine, au travers de rencontres le samedi en avant-soirée est leur initiative et elle a immédiatement résonné dans le cœur de Ludovic Michel : « Les moments que nous avons passés ces dernières semaines avec le Samu social et avec la Ligue de l’enseignement m’ont énormément ému, moi qui ai été élevé grâce au Secours populaire. Que serions-nous aussi sans Victor Hugo, son discours à la République, porté par Juliette Drouet… Parmi mes récentes émotions, celles nées d’un débat autour de la personnalité de Jack Ralite, animé par Franz-Olivier Giesbert et Jean-Michel Djian : nos débatteurs sont sortis éreintés et bouleversés du dialogue avec l’assistance. »
François Vignaux, qui exerça dans le passé de hautes fonctions au service de la coopération universitaire francophone et qui soutient aussi l’émergence de documentaires en participant discrètement à des financements participatifs, croit intimement à l’utilité de favoriser les échanges entre les personnes qui bénéficient de programmes d’entraide. D’où sa proposition aux Déchargeurs de dialoguer avec le Samu social : les hôtels qui hébergent des familles en difficulté comptent 5 000 enfants qui ne se parlent que si des activités leur sont proposées. Parmi les initiatives de l’équipe du théâtre engendrées par cette rencontre, une représentation offerte de « Play », le spectacle jeunesse joué par Lee Fou Messica, pour des enfants défavorisés.
Il a longtemps été question que le Théâtre des Déchargeurs soit théâtre municipal. « Nous le souhaitions », aquiesce Ludovic Michel. Le ministère estimait que c’était à Paris de gérer la situation. « Nous aimerions tellement que le ministère, avec lequel nous travaillons très harmonieusement, nous labellise. L’année 2016 a été très dure. Les attentats ont été "meurtriers". L’écriture contemporaine est plus complexe à faire vivre. De grands créateurs qui ont quitté la direction de grandes salles nationales sont obligés de louer des salles à Paris pour poursuivre leur travail. Ce n’est pas normal. Nous en aidons, comme Claude Regy. On pourrait attendre que le Théâtre des Déchargeurs soit reconnu comme un lieu de diffusion nécessaire au centre de Paris. Et pourquoi pas la plus petite scène nationale de France ? Nous sommes la seule de cette taille (80 places) à avoir reçu des Molière et à avoir été nommée à plusieurs reprises. »
Et Ludovic Michel, décidément passionné, convaincu et convaincant, mais aussi tout en retenue, de conclure : « Oui je crois que la poésie peut sauver le monde. Souvenons-nous de ce qu’est la littérature, de ce qu’elle a apporté dans nos vies. »
Le Théâtre des Déchargeurs - 3, rue des Déchargeurs. Paris 1er.
www.lesdechargeurs.fr
Michèle Jacobs-Hermès
Mise à jour 13.02.2017 à 17:07

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 9:49 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 23.02.2018
Le chorégraphe est en vedette aux Hivernales d’Avignon avec trois pièces, dont « Littéral », œuvre anniversaire.
Une texture fine qui file comme un nuage, s’évanouit à la façon d’une goutte de lait dans le café et laisse une saveur de longue durée. Cette délicatesse est celle, conservée précieusement depuis ses débuts dans les années 1980, du chorégraphe Daniel Larrieu, poète de la matière qui n’impose rien mais offre au spectateur de disposer à l’envi de sa danse.
Daniel Larrieu est en vedette au festival Les Hivernales d’Avignon avec trois productions. Emmy, créée en 1993, en réaction à la pandémie du sida, transmis au jeune danseur Enzo Pauchet. Avenir, conférence dansée, se mélange les pinceaux entre souvenirs de plus de trente ans de travail, commentaires à chaud et performances sur le vif. Quant à Littéral, créée en 2017, elle fête les 60 ans du chorégraphe en sortant littéralement soixante balais de derrière les fagots pour jouer les accessoires et le décor de cette pièce-anniversaire.
Alors, coup ou corps de balai ? Les deux et bien davantage. Harry Potter est passé par là ! Dans Littéral, Larrieu joue les sorciers tout en douceur. Posés sur le côté et prêts à l’emploi, plantés sur scène ou voltigeant dans les airs comme un improbable mobile façon Calder, les ustensiles ménagers se révèlent magiques entre les mains du chorégraphe et de ses cinq interprètes. L’artisanat de la danse s’offre ici un geste de sculpteur qui bâtit l’espace et l’illumine en y accrochant quelques fétus de paille.
Quelque chose de l’enfance
Ces soixante balais n’ont pas entamé la fraîcheur de la danse. Seul au début du spectacle comme une bougie sur le gâteau, Larrieu donne le ton, prend la mesure de son corps et semble écrire un code secret. Bras en couronne, pas glissé de patineur, pirouette l’air de rien, il rafraîchit son style en claquant des mains et en se grattant la tête. Tout ce temps-là condensé dans quelques entrechats ! La langue des signes n’est pas loin de cette écriture d’un corps singulier, fondement de la danse contemporaine.
La marche est le plus sûr moyen pour débusquer d’où le mouvement s’élance, chez Larrieu. Elle trame et tisse, circule sur un rythme tranquille. Des petits mouvements de tête contredisent les battements des jambes. La ligne est graphique avec quelque chose de l’enfance qui flotte dans le rose layette des costumes et les jeux auxquels s’amusent les danseurs. La musique entraîne le mouvement sur un tapis volant. Elle enchaîne un extrait d’Alcina d’Haendel, des compositions cristallines de Quentin Sirjacq et de Karoline Rose. Les sons se laissent parfois à peine entendre, ils diffusent comme les gestes dans l’atmosphère.
Métaphore des trois petits cochons
Littéral, c’est la question du corps qui vieillit. « Devant la course à l’émergence et au jeunisme de la danse, il me paraît comme un acte nécessaire de présence et de transmission que de rappeler l’importance d’une démarche proche des poètes… », déclare Daniel Larrieu dans le programme de la pièce, présentée, le 1er décembre 2017, au Centre des arts d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise). Dont acte. La jeunesse, mais encore tous les âges y sont bien représentés avec des interprètes entre 25 ans et 45 ans.
Ce spectacle met aussi en scène à sa façon la maison en paille que l’un des trois petits cochons construit pour la voir soufflée par le grand méchant loup. Métaphore pour la danse, art de passion mais trop éphémère, comme une merveilleuse cabane ? Daniel Larrieu a dirigé le Centre chorégraphique national de Tours de 1994 à 2002 pour reprendre les rênes d’une compagnie indépendante dans un contexte économique bien raide. Depuis, il poursuit sa route, se jetant dans des expériences inédites. Mais, avec Littéral, il redit fort qu’il est danseur d’abord et que c’est parti pour durer.
LITTERAL 2017 TRAILER from Daniel Larrieu and SO-ON ... on Vimeo.
Les Hivernales d’Avignon, du 2 février au 3 mars. hivernales-avignon.com. Emmy/Avenir, de Daniel Larrieu. 25 février, Théâtre Golovine. Littéral, de Daniel Larrieu. 27 février, Théâtre Benoît-XII. www.daniellarrieu.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 6:40 AM
|
Par RFI Publié le 23-02-2018
Après son succès aux Nouvelles Zébrures dans le Limousin et au Festival d’Avignon, «Obsessions de lune», la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Soeuf Elbadawi, se joue pendant deux jours (les 23 et 24 février à 20h30) à Alfortville en région parisienne. Sur scène, trois personnes : Soeuf Elbadawi, l’acteur et directeur du Théâtre Studio d’Alfortville, Christian Benedetti, accompagnés du guitariste malgache Rija Randrianivosoa.
« Pour ce qui est de l’île de Mayotte, les Comores sont une unité et il est naturel que leur sort soit un sort commun ». On reconnaît la voix... Obsessions de lune, la pièce écrite et jouée par Soeuf Elbadawi, débute par un discours de l’ex-président français Valéry Giscard d’Estaing ; et nous entrons de plain-pied dans l’histoire de la politique française aux Comores.
« C’est la tragédie du visa Balladur, explique à RFI Soeuf Elbadawi. Il faut savoir que depuis 1995, les Comoriens sont empêchés de circuler dans une partie de leur archipel d’existence, c’est-à-dire Mayotte, et l’histoire du spectacle c’est un type qui raconte la mort d’un cousin et qui dit ‘On n’a pas pleuré, on n’a pas crié’, parce que, en fait, c’est beaucoup plus grave que ça. C’est un peuple qui est en train de s’éteindre ».
L’obligation d’un visa pour voyager entre la République des Comores et la 4ème île de l’archipel, le 101ème département français, Mayotte, est cause tous les ans de milliers de morts comoriens, noyés en tentant la traversée. Mais dans ces Obsessions de lune, qui mettent en scène l’auteur et son personnage, Soeuf Elbadawi confie aujourd’hui le rôle de l’auteur à un acteur français, se réservant celui du personnage.
Pourquoi ce parti-pris ? Soeuf Elbadawi poursuit: « parce qu’aujourd’hui nous sommes tous tributaires de cette histoire qui nous complique la vie. Je me suis dit : Et si cette histoire-là était juste le droit de retrouver une part d’humanité et pas du tout une histoire comorienne ? »
Et à travers cette tragédie dont on ne parle pas, Obsessions de lune prend effectivement une dimension universelle.
► le théâtre-studio d'Alfortville : https://www.theatre-studio.com/saison/obsession-lune
Légende photo : Soeuf Elbadawi, ici en février 2017 au théâtre Saint-Gervais avec «Mémoires blessées» se produit au théâtre Studio d'Alfortville les 23 et 24 février avec la pièce «Obsessions de lune» ©Isabelle Meister

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2018 4:44 AM
|
Par Stefano Lupieri / Journaliste Les Echos Week-End | Le 23/02/2018
Avec le Comedia et le Sentier des Halles, dont il vient de s'emparer, Jean-Marc Dumontet contrôle désormais six salles parisiennes. Arrivé sur le tard dans le spectacle vivant, l'heureux producteur de Nicolas Canteloup et d'Alex Lutz en a bousculé les usages et les méthodes. Fidèle soutien d'Emmanuel Macron, il continue d'avoir l'oreille du président.
Entrer dans le bureau de Jean-Marc Dumontet, c'est un peu comme franchir le seuil d'une galerie d'art. La pièce regorge d'oeuvres de street art. Il y en a partout. Au mur, au sol, sur les fauteuils. Avec, visiblement, une affection prononcée pour Shepard Fairey (Obey) et Klet Abraham. C'est une passion récente, mais lorsque ce producteur de spectacles se pique d'intérêt pour quelque chose, il ne le fait jamais à moitié - il assume sans aucun problème son appétit d'ogre.
Son ascension sur la scène parisienne en témoigne. Après avoir démarré à la fin des années 90 ayant pour premier poulain un jeune inconnu, un certain Nicolas Canteloup, Jean-Marc Dumontet est aujourd'hui l'un des poids lourds de la place. Pierre Richard, Alex Lutz, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Fary, Vérino, Les Coquettes... ont rejoint l'écurie. Pour mieux les accompagner, le producteur a acheté un premier théâtre en 2006. Puis un autre, et un autre encore. Déjà à la tête du Point Virgule, de Bobino, du Théâtre Antoine, du Grand Point Virgule, il a cru bon, il y a quelques semaines, d'ajouter à son tableau de chasse le Comedia et le Sentier des Halles. « J'ai la chance ou la malchance d'être un insatisfait chronique, en permanence happé par l'aventure suivante, confesse ce développeur de talents. Ca favorise l'action, mais c'est un puits sans fond. » Son terrain de jeu n'est d'ailleurs pas limité au spectacle vivant. Le dernier « stand-upper » pour lequel il s'est pris de passion n'est autre... qu'Emmanuel Macron. Diplômé de sciences Po Bordeaux, ce fils et petit-fils de notaires aquitains a contracté très tôt le virus de la politique. En 1988, à 22 ans à peine, il anime un meeting de Jacques Chirac devant 15 000 personnes à Bordeaux. L'année suivante, il est sur la liste du maire de la capitale girondine, Jacques Chaban-Delmas, aux municipales (en position non éligible).
Un monstre d'énergie
Son goût pour l'entreprenariat va ensuite l'entraîner vers d'autres horizons, mais l'intérêt pour la chose publique persiste. Le jeune candidat d'En Marche, dont il fait la connaissance au Théâtre Antoine, va réveiller la flamme : « J'ai été d'emblée séduit par sa détermination à sortir de l'impuissance publique. Et par le renouvellement total de l'offre politique incarné par son projet. » Jean-Marc Dumontet décide alors de s'engager avec les Marcheurs. Comme à son habitude, sans réserve. Il participe à tous les meetings, met son « oeil » de producteur de spectacles au service du disrupteur de 2017 pour analyser, décortiquer et améliorer ses prestations. Au point que beaucoup le voient comme un coach. L'intéressé rejette le terme : « J'ai joué un rôle infinitésimal. » Il n'empêche. À mesure que les chances d'Emmanuel Macron se précisent, son nom circule comme potentiel ministre de la Culture. N'a-t-il pas le profil de l'entrepreneur à succès cher au fondateur de La République en Marche ? « Je n'ai rien demandé et on ne m'a rien proposé », assure-t-il. Il figure tout de même parmi les quelques invités non officiels de la cérémonie d'investiture à l'Elysée. Preuve que le président a apprécié son travail. « Je pense qu'il a été sensible à mon engagement et à ma franchise », concède le producteur.
Deux qualités constitutives du personnage. « C'est un monstre d'énergie », dit de lui Philippe Tesson, qui l'a vu un jour débouler dans son bureau au Quotidien de Paris, alors qu'il était encore étudiant, pour revendiquer le poste de correspondant à Bordeaux. « Il y avait chez lui un feu, une folie, tempérée par de l'éducation et de la culture qui portait déjà la promesse d'un avenir. » Reste que l'homme s'est longtemps cherché. Il lance à 22 ans une agence de communication. Libéral assumé, il prend en charge les relations presse du président RPR du Conseil régional d'Aquitaine, Jean Tavernier. Opportuniste, il anticipe l'explosion du marché des pin's au début des années 90 et lance une petite « boîte » qui prospère rapidement, affichant à son apogée un chiffre d'affaires de 22 millions de francs (3,4 millions d'euros) et 4 millions de francs (610 000 euros) de bénéfices. Une manne qui va lui permettre de financer de nombreux autres projets nés dans son esprit fécond. Coup sur coup, il reprend et redresse un hebdomadaire économique local, Objectif Aquitaine, lance une entreprise de livraison de pizzas, Pizza Coyote, ouvre deux restaurants... Autant d'activités qu'il mène de front : « Entre 1990 et 2000, j'ai appris mon métier d'entrepreneur. »
Coup d'essai, coup de maître
Entre deux projets d'entreprises, il trouve le temps de s'initier à la production de spectacle. Sa première incursion dans ce milieu a lieu en 1991 avec La Java des mémoires, une pièce découverte au fin fond du Lot-et-Garonne, au Théâtre de Poche de Monclar. Il l'emmène jusqu'au Théâtre de la Renaissance, à Paris, où elle reste à l'affiche huit mois - elle est même nommée aux Molières. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Rebelote en 1995 avec Les Années Twist, qui décroche cette fois le Molière du spectacle musical de l'année. Mais c'est avec Nicolas Canteloup, dont il fait la connaissance lors d'une convention d'entreprise, en 1998, pour l'un des clients de son agence de com, que sa carrière de producteur prend véritablement tournure. « Nicolas était chargé de parodier la journée. J'ai tout de suite été frappé par son talent », se rappelle Jean-Marc Dumontet. En près de vingt ans de compagnonnage, les deux hommes ont développé une relation quasi fraternelle.
En dépit du succès, aucun contrat écrit ne les lie : tout marche à la confiance. « Jean-Marc est une personne d'une grande droiture, assure l'imitateur. Il n'hésite jamais à vous dire ce qu'il pense, quitte à vous bousculer, mais c'est toujours fait avec respect et bienveillance. Il séduit par son élégance. » Ancien directeur de la rédaction d'Europe 1, Fabien Namias confirme : « Lors des petits-déjeuners organisés avec les candidats à l'élection présidentielle de 2017, après leur passage dans la matinale où officie Canteloup, je l'ai vu s'écharper avec Nicolas Sarkozy, alors candidat à la primaire de la droite, et défendre bec et ongles ses arguments à propos des jeunes de banlieue et de leur rapport à la laïcité. » Intrigué par l'aplomb de ce « Dumontet » qui lui tient tête, l'ancien président demande à Denis Olivennes, directeur de la station, d'organiser un déjeuner avec l'intéressé la semaine suivante.
« Je ne l'ai jamais vu en situation d'échec, souligne Nicolas Canteloup. Jean-Marc sait prendre des risques tout en ne laissant rien au hasard. C'est un homme de solutions. » Et l'humoriste sait de quoi il parle ! Au début des années 2000, sa carrière tarde à décoller. Son producteur tente alors un coup de force : il loue l'Olympia pour un soir, le 10 mars 2003, remplit la salle via son réseau de comités d'entreprise et, grâce au prestige du lieu, parvient à faire venir journalistes et programmateurs. Le talent du comédien fait le reste.
Quelques semaines plus tard, il est invité chez Drucker. Les portes du succès s'ouvrent à lui. L'épisode annonce la manière dont Jean-Marc Dumontet va investir et bousculer le milieu du spectacle vivant. En 2005, il accepte de prendre la direction du Théâtre des Variétés. « Je comprends alors que posséder une salle donne beaucoup plus de liberté de production », souligne-t-il. Dès l'année suivante, il achète le Point Virgule, dont il va faire un lieu de découverte de jeunes humoristes. Mais il faudra attendre la fin des années 2000 pour que ce touche-à-tout abandonne ses autres affaires et s'investisse à fond dans la production. En 2010, il reprend Bobino. Il en profite aussi pour quitter son Bordeaux natal et « monter » à la capitale. L'année suivante, c'est le tour du Théâtre Antoine, dont il partage la direction avec Laurent Ruquier. Puis il fait l'acquisition du cinéma Gaumont Bienvenue, qu'il transforme en Grand Point Virgule. Repris en perdition, tous ces lieux retrouvent avec lui une seconde jeunesse.
« L'obsession commerciale »
Son secret : « Je me focalise d'emblée sur la gestion avant qu'elle ne me rattrape. » En clair, il diminue les coûts fixes en favorisant la polyvalence du personnel, augmente la productivité en multipliant les séances, voire en louant ses salles pour des conventions. Surtout, il cultive ce qu'il appelle « l'obsession commerciale ». « À chaque spectacle, nous récupérons environ 30% des adresses mails de nos clients, grâce notamment à des jeux concours. » Au début, la profession l'a un peu regardé comme un ovni. Parler d'une pièce de théâtre ou d'un artiste comme d'un produit, ça ne se fait pas. « Ses méthodes décomplexées d'entrepreneur sont loin de faire l'unanimité. Mais sa réussite force le respect », concède Stéphane Hillel, directeur du Théâtre de Paris. De fait, c'est vers lui que la profession se tourne, il y a quatre ans, pour relancer la cérémonie des Molières, interrompue pour cause de rivalités intestines, en particulier au sein du théâtre privé. Une fois de plus, le sauvetage réussit.
Son langage abrupt ne l'empêche pas d'être authentiquement ému par les artistes qu'il produit. C'est pour lui une condition sine qua non de leur association. Une fois conquis, il se montre très exigeant. « Il nous a poussés à sortir d'un registre purement 'coquin' et donner plus de fond à notre spectacle, raconte Marie Facundo, du trio des Coquettes. On a eu des propositions financièrement plus intéressantes de la part d'autres producteurs, mais on a compris qu'avec lui on allait grandir. » Avec Nicolas Canteloup, il fait carrément office de rédacteur en chef. Rien n'est dit à l'antenne d'Europe 1 ou de TF1 sans que Jean-Marc Dumontet l'ait lu et éventuellement amendé. « Il déteste l'humour facile », confie l'humoriste.
Si le producteur n'hésite pas à monter au front pour défendre son poulain lorsqu'il est attaqué, il sait aussi faire amende honorable si nécessaire. Comme en février dernier, après l'affaire du jeune Théo, violenté par des policiers à Aulnay-sous-Bois : le rebond sur Europe 1 était raté, voire déplacé. « Je crois aux vertus de la franchise et de l'honnêteté », répète l'intéressé. Une attitude qui lui a plutôt réussi jusqu'à présent : l'an dernier, ses spectacles ont totalisé près de 700 000 entrées, pour un chiffre d'affaires global de 35 millions d'euros. Des chiffres qui lui facilitent l'accès au crédit pour financer ses achats de salles.
Le contrecoup de la campagne
Pourquoi lui fallait-il absolument deux théâtres de plus ? « Une salle se programme un an et demi à l'avance. Une fois le planning établi, c'en est fini des nouveaux projets, explique-t-il, désolé. Pour la pièce 'À droite, à gauche' que j'ai produite l'an dernier, j'ai dû réserver 200 dates dans un théâtre extérieur au groupe. » Trop frustrant pour ce boulimique. Si le Sentier des Halles a vocation à venir renforcer le Point Virgule sur la scène humoristique, le Comedia devrait lui donner de la marge pour sa future programmation théâtrale. De quoi l'occuper toute cette année et chasser tout soupçon de blues.
Car Jean-Marc Dumontet admet avoir subi le contrecoup de la fin de la campagne présidentielle : « J'étais un peu en deuil. » A-t-il coupé le lien avec Emmanuel Macron ? Non - la relation se poursuit. Mais le producteur ne le concède que du bout des lèvres, de peur sans doute qu'on lui reproche une forme de fatuité. Pourtant, « il a incontestablement un contact privilégié avec le président », assure Fabien Namias. Lors de la première interview télévisée du président après son élection, sur TF1 en octobre dernier, Jean-Marc Dumontet était là pour scruter la prestation. Comme il le fait avec tous les talents dans lesquels il croit - et qu'il souhaite voir réussir.
-------------------------------------------------------------------------------
Quand les salles attirent les grands groupes
L'irruption de l'entrepreneur Jean-Marc Dumontet sur la scène du spectacle vivant a préfiguré un mouvement de concentration du secteur. De Fimalac (la Madeleine, la Porte-Saint-Martin, Marigny) à Lagardère (Folies Bergères, Casino de Paris), en passant par Vente-privee.com (Théâtre de Paris, Bouffes Parisiens, Michodière) ou encore Vivendi (Théâtre de l'OEuvre), plusieurs grands groupes ont fondu ces dernières années sur ce marché sous-capitalisé. Avec souvent des logiques d'intégration verticale, en lien avec leurs activités de billetterie en ligne (Vente-privee, Lagardère) ou la production d'artistes (Lagardère, Vivendi, Fimalac). Pour Jean-Marc Dumontet, on pourrait assister à un retour en arrière d'ici quelques années : « Le théâtre reste avant tout un métier d'artisans, avec un modèle économique aléatoire et de faibles rentabilités. » De fait, c'est à Fimalac qu'il vient de reprendre le Comedia et le Sentier des Halles.
------------------------------------------------------------------------------
Fan de Macron
« J'ai, avec Emmanuel Macron, un peu le même rapport qu'avec mes artistes. Je lui dis tout avec tendresse et bienveillance. Même si je ne sais pas exactement à quoi mes observations lui servent. »
Le leader de La République en Marche a réussi à réveiller la fibre militante de l'ancien jeune chiraquien épris d'intérêt général. « J'ai été conquis par son volontarisme à réconcilier les Français avec la politique. » Le producteur s'est fendu l'an dernier de plusieurs tribunes dans Le Point pour défendre la politique du gouvernement, par exemple sur la réforme de l'ISF. « Au début de son mandat, les Français ne le connaissaient pas et doutaient peut-être de son autorité. Ce qui explique sa chute dans les sondages. Mais depuis, ils ont pu constater sa détermination à combattre l'impuissance publique. Et qu'en dépit de son apparence juvénile, il fait preuve de beaucoup de sang-froid. Un président qui préside. »
@LupieriStefano
Légende photo : Jean-Marc Dumontet, de Canteloup à Macron ©Manuel Braun pour Les Echos Week-End

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 22, 2018 6:13 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan, 22 février 2018
Les pièces de Pauline Peyrade roulent de nuit. Du moins les deux premières, réunies en un seul volume et toutes les deux créées au Théâtre de Poche de Genève. Après le remarquable « Ctrl-X » par Cyril Teste la saison dernière, voici le non moins remarquable « Bois impériaux » par le collectif Das Plateau.
Sur l’autoroute A6, l’automobile passe à hauteur de l’aire de Fleury « sous un ciel chargé ». Il est 22h53, le compteur kilométrique affiche 10250 km, celui des vitesses 141 km/h, la température extérieure est de 0,5°C. La pièce s’achève à hauteur du panneau de l'aire « Bois impériaux », 62 pages et 640 kilomètres plus loin ( ce qui laisse rêveur: l 'espace comme le temps se dilatent). Il est 7h01, le jour se lève, il fait -2,5°C, « Irina allume une cigarette », la vitesse tombe à 76 km/h, « il neige ».
Les nuits sont plus longues que le jour
Au début de Ctrl-X, la première pièce publiée de Pauline Peyrade, Ida allume une cigarette avant d'entendre vibrer son portable.. Il se peut qu’Irina ait emprunté la voiture d’Ida et fumé les dernières cigarettes du paquet oublié dans la boîte à gants. J’imagine. Les pièces de Pauline Peyrade proposent des pistes sans imposer une voie unique, ce qui laisse beaucoup d’espaces au lecteur, au spectateur, où il fait bon vagabonder.
Les personnages de Bois impériaux n’ont pas la précision du tableau de bord de la voiture conduite par Irina avec à ses côtés son petit frère Johannes. Ces informations factuelles, réitérées tout au long de la route, rythment les heures qui passent, la nuit qui avance, la température qui baisse. Les précisions biographiques, tel l’amour immense et ambivalent que porte Irina à son petit frère et réciproquement, nous arrivent par bribes, au ricochet de ce qui se passe : un sac que l’on ouvre, un téléphone portable qui sonne, l’arrivée du brouillard. Des petits riens, des chutes d’informations. Rien d’univoque.
Si Pauline Peyrade aime tant la nuit, c’est peut-être parce que les corps, les sentiments et les voix y sont plus vulnérables, les contours plus incertains, le silence plus intense et le temps plus dilaté. Tous ceux qui, seuls, en perdition, sujets à une émotion extrême ou simplement écoutant la radio, ont roulé toute une nuit sur une autoroute ou des petites routes désertes en se laissant guider par les noms inscrits sur le panneaux routiers, recevront en plein cœur Bois impériaux.
Dépressions d’identité
De quoi souffre Johannes ? D’une déficience mentale, d’une maladie incurable, d’une extrême fragilité ? Est-il bipolaire ? Pourquoi est-il non dans la fureur mais dans la terreur de vivre ? On ne saura pas exactement. Où Irina l’emmène-t-elle ? Johannes se pose la question, tout comme nous. Johannes a peur d’être enfermé dans un « centre ». Irina lui dit qu’il n’en est rien. Ment-elle ? « Tu ne sais pas mentir », lui dit Johannes. L’incertitude est fille de la nuit. Le téléphone vibre. Au bout du vibreur, pas un amant comme pour l’Ida de Ctrl-X, mais des hommes qui parlent à « Constance » et qui jouiront en l’écoutant dire ce qu’ils veulent qu’elle dise (queue, chatte, etc.). Ce qu’Irina dit mécaniquement, comme absente à elle-même.
Il y a chez les personnages de Peyrade comme des dépressions d’identité. Ainsi Serge, cet homme vendant bonbons et friandises dans une station service déserte au milieu de la nuit, avec lequel Irina noue un contact. Une vraie rencontre entre deux éclopées de la vie où la séduction, n’étant ni vraiment absente ni platement présente, joue les contre-pieds. Une relation qui chiffonne le temps puisqu’elle nous vient en plusieurs scènes tout au long de la nuit alors que ce n’est que vers le petit matin que la voiture en manque d’essence s’arrêtera pour faire le plein. La nuit, le temps bouscule plus facilement son ordonnance.
Pauline Peyrade dit être partie sur les traces de Florence Rey et Audry Maupin, un fait divers sanglant des années 90, plusieurs policiers et passants tués après un braquage raté par deux anarchistes peu au fait du grand banditisme. Maupin fut abattu lors d’une fusillade et celle qui l’avait suivi par amour fut lourdement condamnée. Le visage d’adolescent de Florence Rey, son visage égaré et balafré, toute la détresse qui émanait de ses yeux, en disaient long. Et c’est sans doute cela qui perdure dans Bois impériaux où le fait divers s’est éloigné jusqu’à disparaître pour laisser la place à un frère et une sœur. Pauline Peyrade se rend alors compte que son histoire n’est pas sans faire écho au conte de Grimm lu enfant, Hansel et Gretel. Ce cheminement dit bien le positionnement ambivalent du texte de la pièce oscillant entre la vie quotidienne et le conte ; les rigueurs mathématiques du tableau de bord et la poésie des panneaux de signalisation.
Sons, miroirs et lumières
Le collectif Das Plateau qui porte à la scène Bois Impériaux réunit Jacques Albert (auteur et danseur), Céleste Germe (architecte et metteuse en scène), Jacob Stambach (auteur et compositeur) et la comédienne Maëlys Ricordeau qui joue dans tous les spectacles du collectif et trouve dans le personnage d’Irina un rôle dont elle déploie avec aisance la sensualité rêveuse et la force rentrée. Depuis leur premier spectacle Sig Sauer Pro (lire ici), les membres de Das Plateau questionnent la notion de visibilité et de présence au théâtre par toute sorte de machines et dérivatifs. Ils ont trouvé dans Bois impériaux un matériau de choix. Outre le jeu, leur réponse est d’abord optique par un jeu complexe de miroirs, de glaces sans teint, de surfaces transparentes propices aux multiplications des reflets et aux brouillages des lignes. Das Plateau ne commet évidemment pas l’erreur d’illustrer la pièce en installant sur le plateau un véhicule ou en reconstituant une station service. L’équipe adosse les jeux de miroitements à un canapé passe-partout. Une réponse poétique. Elle l’est aussi par le traitement du son auquel l’équipe a l’habitude de prendre grand soin.
Une belle pièce. Un passionnant travail de traduction scénique (Maxime Gobatchevsky dans le rôle du frère et l’étonnant Antonio Buil dans celui du vendeur de bonbons à la station service complètent la distribution). Et un théâtre qui n’a pas froid aux yeux.
C’est dans le Poche
Depuis que l’auteur et metteur en scène Mathieu Bertholet en a pris la direction en 2015, le Théâtre de Poche de Genève a pris un tournant radical : il ne présente que des spectacles réalisés à partir de textes inédits d’auteurs vivants. Un théâtre de texte. Un groupe de douze personnes lit plus de deux cents textes nouveaux par saison, en choisit une vingtaine et l’équipe du Poche « se met en quête des équipes artistiques prêtes à se mettre au service » des textes retenus.
Ensuite : deux voix possibles. Soit celle habituelle d’un collectif artistique qui répète entre quatre et sept semaines avant de présenter le spectacle au Poche pendant deux à trois semaines (théâtres français, prenez exemple) puis de partir en tournée. C’est la formule dite « cargo » adoptée pour Bois impériaux. Soit la formule « sloop » : un collectif artistique est constitué et se voit confié plusieurs textes soit parce qu’ils sont thématiquement proches, soit parce qu’ils requièrent une semblable distribution. Ce qui permet de découvrir de nouveaux textes et de nouveaux actrices et acteurs. Proscrites sont les lectures et les mises en espaces. Rien que des spectacles où, au commencement, est le texte inédit à la scène. Les deux pièces de Pauline Peyrade créées tour à tour au Poche font l’une et l’autre leur miel des bouleversements de l’usage des mots et des signes et de la façon dont les nouvelles technologies sont entrées dans nos vies. Souhaitons que ces deux spectacles, Ctrl-X par Cyril Teste (lire ici) et Bois impériaux par le collectif Das Plateau, soient prochainement présentés ensemble car les deux pièces forment bel et bien un diptyque.
Théâtre de Poche, Genève, 19h les lun, mer, jeu, sam, 20h le mar, 17h le dim, jusqu’au 11 mars ; puis Comédie de Reims, 19h les jeu et mer, 20h30 les mar, ven, sam, relâche les dim et le lun 19, du 15 au 23 mars . Tournée en cours d’élaboration pour la saison prochaine.
Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées ensemble aux éditions Les Solitaires intempestifs.
Scène de "Bois impériaux" © Samuel Rubio
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2018 7:22 AM
|
Par Didier Méreuze dans La Croix le 26/02/2018
Sur fond d’histoire d’amour et de cavale, Lola Molina signe une pièce aux allures de road-movie tragique, porté jusqu’à son incandescence par un couple d’acteurs magnifiques : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage
Seasonal affective disorder de Lola Molina au Lucernaire, Paris
Elle, c’est Dolly. Lui, c’est Vlad. Tous deux en rupture de ban et de société. Elle, si jeune, 14 ans ! Lui, « quadra », en route pour la cinquantaine. Un soir, ils se croisent, par hasard, porte de Bagnolet, à Paris. Il lui propose de l’accompagner à l’hôtel. Elle accepte. Bien vite, il lui apprend qu’elle est recherchée, soupçonnée d’avoir tué une copine lycéenne. Très vite, elle comprend que le passé de son nouveau compagnon n’est guère plus net. Tous deux ont le même intérêt à éviter la police.
Alors, quand cette dernière se montre trop pressante, ils n’ont d’autre choix que de fuir. S’arrêtant ici, repartant là, se reposant un instant pour disparaître aussitôt, des fleurs… ou un fusil à la main. Braquant un commerçant. Tirant sur des policiers. Dormant dans la voiture. Rêvant de se retrouver ensemble dans une petite maison.
Un road-movie noir, façon Bonnie and Clyde
Dernière pièce de Lila Molina, Seasonal affective disorder est une œuvre étrange, troublante, construite sur le mode, inattendu au théâtre, du road-movie noir, façon Bonnie and Clyde. Sans décor – sinon deux micros sur pied et un écran sur lequel sont projetées des images de route, de paysages – l’écriture, vertigineuse, laisse toute la place à l’imaginaire du spectateur.
Dans les entrelacs savamment tricotés de monologues, voix intérieures, soliloques, dialogues… le passé et le présent s’entremêlent, au fil d’un verbe à la fois réaliste et poétique, doux et violent, crû et pudique.
Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage, un couple subjuguant
Mis en scène avec une rigueur sans faille par Lélio Plotton (par ailleurs, le compagnon de Lola Molina), le spectacle évite toute mièvrerie, tout misérabilisme, laissant le soin aux seuls acteurs, investis par le texte jusque dans leurs chairs, de le porter comme d’autres portent le feu.
Anne-Lise Heimburger est Dolly. Blonde, tee-shirt et jean, juvénile et fragile, elle est animal sauvage que rien ni personne ne saurait contraindre. Il y a encore de l’innocence de l’enfance, chez elle, mais aussi de la dureté de la femme vieillie avant l’âge, décidée, au point, elle qui n’en a pas, d’aller voler un bébé…
Laurent Sauvage est Vlad, l’homme au costume gris qui, croit-il, porte malheur, le sien et celui des autres. Vivant d’expédients et de braquages, il est comme revenu de tout, fatigué, prêt à renoncer. Contrairement, ou plutôt en contraste avec celui d’Anne-Lise Heimburger, son jeu est plus distant, épuré, mais tout aussi puissant. Avec cette dernière, il forme un couple exceptionnel, subjuguant, mythique dirait-on au cinéma, que l’on n’oublie pas. Rejetons en perdition, par-delà les différences d’âge, d’un monde où « la nature et le temps se dérèglent ». « Où le soleil ne se lève plus ».
Didier Méreuze
21 heures. Jusqu’au 31 mars. Rens. ; 01.42.22.66.87, www.lucernaire.fr
(1) Trouble affectif saisonnier : trouble de l’humeur caractérisé par des symptômes dépressifs survenant habituellement lors de changements saisonniers. Particulièrement lorsque les périodes d’ensoleillement diminuent.
Légende photo : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage dans Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, mise en scène par Lélio Plotton. / Victor Tonnelli/lucernaire.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2018 3:23 AM
|
Par FM pour le site Gre'Net
FIL INFO – La Région demande aux salles de spectacle labellisées « scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes » de faire figurer dans leurs programmes un éditorial et… une photographie de Laurent Wauquiez. Une « wauquiezerie » et une « dérive », estiment les conseillers régionaux d’opposition du groupe RCES.
Une nouvelle « wauquiezerie » juste après l’affaire du « bullshit » ? C’est ainsi en tout cas que les élus du groupe d’opposition régionale RCES (Rassemblement Citoyens, écologistes et solidaires) moquent la demande adressée à différents lieux de spectacle par la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’inclure dans leur programme un édito et une photographie de son président Laurent Wauquiez.
L’exigence en question accompagne l’obtention du label « scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes », créé par la Région en 2017. Un label, accompagné d’une subvention, réservé aux établissements prenant en considération « les esthétiques peu représentées », apportant un « soutien conséquent » à la création, ou mettant en œuvre des projets à destination des lycéens ou des publics éloignés de la culture.
« Culte de la personnalité et instrumentalisation de la culture »
Vingt-cinq salles ont obtenu le fameux label, parmi lesquelles l’Espace 600 de Grenoble ou le Grand Angle de Voiron. Aux côtés du Théâtre de Vienne, du Théâtre Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu ou du Théâtre du Vellein de Villefontaine. Autant de salles qui ont reçu, le 15 février dernier, un courriel de la Région contenant des outils de communication à inclure dans leur programme.
Quels sont ces éléments « à faire figurer dans les premières pages [des] plaquettes » ? Un portrait de Laurent Wauquiez et un éditorial. En l’occurrence, un texte type dans lequel le président de la Région vante son ambition « d’allier la proximité à la qualité », tout en laissant à la salle le soin de remplir les blancs. Avec notamment une mention « Nom du directeur » qu’apprécieront les directrices au nombre des destinataires.
Juste retour des choses ? Pas du tout, considèrent les élus d’opposition, pour qui cette exigence régionale est « une dérive à mi-chemin entre le culte de la personnalité et l’instrumentalisation de la culture ».
Et le groupe d’opposition de rappeler que d’autres financeurs des salles de spectacle, parfois plus importants, comme les communes ou les métropoles, n’imposent pas de leur côté les mêmes conditions aux établissements qu’elles accompagnent.
Légende : La photographie que Laurent Wauquiez veut voir figurer sur les plaquettes. © Région Auvergne-Rhône-Alpes
FM

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2018 7:39 PM
|
Par Olivier Fregaville-Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier
23 février 2018
Ils sont treize sur scène. Comédiens ou amateurs, migrants en cours de régularisation, ils s’unissent pour conter le parcours semé d’embûches de ces réfugiés, objets de sombres fantasmes, confrontés à l’inhumanité, l’absurdité d’une politique migratoire devenue un business juteux. Théâtre documentaire et politique, Ceux que j’ai rencontrés… est une œuvre nécessaire à voir de toute urgence.
Tout commence par une bande son en anglais, surtitrée en français. C’est à la fois un avertissement, un code de bonne conduite à tenir, une mise en garde sur ce qui va être dit au cours de l’heure quarante à venir. Prononcé par une voix d’hôtesse de l’air, cet étonnant prologue sonne comme les annonces faites avant le décollage d’un avion, le départ d’un bateau en mer, comme si nous embarquions pour un voyage sidérant, hallucinant au cœur d’un système qui broie des femmes et des hommes qui ont fui un pays où leur vie était menacée.
En nous immergeant dans le parcours chaotique, douloureux des migrants, le Nimis groupe, composé de comédiens belges et français, ne cherche pas à nous tirer des larmes, mais bien à nous pousser à la réflexion. Né de la rencontre avec six exilés enfermés dans un centre d’accueil en attente d’une décision concernant leur droit d’asile, qui vont au fil des discussions intégrer la troupe, ce projet théâtral entre fiction réaliste et acte politique s’est construit de témoignages et de documents issus d’une recherche minutieuse, d’informations puisées sur le terrain de Lampedusa à Calais, de données universitaires, de statistiques issues d’institutions, d’ONG. Bien sûr, la vision, qui nous est proposée, est subjective mais elle a le mérite de nous éclairer sur les zones d’ombre du flux migratoire, de mettre à mal les fantasmes si communément véhiculés sur ces apatrides, ces exilés.
Une partition chorale pour dénoncer la politique criminelle migratoire européenne
Derrière les mises en situation de migrants perdus face aux circonvolutions d’une bureaucratie migratoire aveugle, inhumaine et absurde, une autre réalité fait jour, encore plus sombre, plus glauque. Avec finesse et habilité, le Nimis Groupe oppose aux récits de vies bouleversants, les chiffres d’un business particulièrement juteux et dévoile les enjeux économiques que cachent les politiques migratoires particulièrement dures et austères. Ainsi, depuis 2000, l’Union européenne a dépensé plus de 12,9 milliards d’euros pour protéger ses frontières, financer des programmes de recherche et de développement militaires dans le but d’innover dans les systèmes hypersophistiqués de surveillance et de dissuasion. En parallèle, les migrants ont déboursé plus de 16 milliards pour quitter leur pays et tenter d’approcher le rêve européen et ne plus avoir la peur au ventre, cet argent a enrichi des passeurs peu scrupuleux. Ce constat effrayant de vies monnayées, bradées sans d’autres considérations que leurs valeurs marchandes, que l’intérêt de faire fructifier des sociétés capitalistes fait froid dans le dos.
Face à l’absurdité des règles, les migrants se laissent aller face caméra à des confidences
Bien sûr tout n’est pas sombre, bien sûr la pièce est montée à charge, mais elle force nos consciences de bons Européens à ouvrir les yeux, à ne plus nous laisser berner par l’opinion commune qui pointe les migrants comme un problème insoluble, un poids à charge pour nos sociétés bien-pensantes. Porté par des comédiens, qu’ils soient professionnels ou amateurs, habités et passionnés, ce spectacle nécessaire et vital offre une très belle tribune aux migrants soulignée avec force et puissance par la mise en scène chorale, dénonçant preuves à l’appui une situation inacceptable et des compromissions criminelles de l’Union européenne. Une pièce de théâtre engagée à ne rater sous aucun prétexte.
Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu,
un projet du Nimis groupe
Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine
1 Place Jean Vilar
94400 Vitry-sur-Seine
le 8 & 9 mars 2018 à 20H
durée 1h40
Maison de la Culture d’Arlon
Centre Culturel Régional du Sud-Luxembourg
Parc des Expositions
1 B- 6700 Arlon
le 21 février 2018
conception et mise en scène NIMIS Groupe – Romain David, David Botbol, Jérôme de Falloise, Yaël Steinmann, Anne-Sophie Sterck, Sarah Testa et Anja Tillberg
écriture et jeu NIMIS Groupe – Jeddou Abdel Wahab, Samuel Banen-Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka
coordination générale et costumes Édith Bertholet
assistants – Sarah Hebborn & Pierrick De Luca
médiatrice culturelle et lien associatif Olivia Harkay
vidéo Yaël Steinmann et Matthieu Bourdon
directeur technique et son Julien Courroye
lumière Pierre Clément et Alice Dussart Légende photo : Le NIMIS Groupe nous invite à suivre le parcours semé d’embûches des migrants à leur arrivée en Europe © DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2018 11:40 AM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 25 février 2018
Que nos vies (aient l’air d’un film parfait) de Nathanaël Frérot, mise en espace de Catherine Marnas, avec les élèves de l’École du Nord.
L’École Pratique des Auteurs de Théâtre Ouvert (EPAT) est un laboratoire où des auteurs « sont invités à remettre sur le métier leur texte avec la collaboration d’artistes sur le plateau : « un maître d’œuvre » et des interprètes ». Il y a aussi certaines sessions prises en charge par une équipe d’élèves-comédiens, ce qui permet de tester une dramaturgie mais aussi de familiariser les jeunes acteurs à sa mise en jeu. Les quatorze élèves de L’École du Nord (dont deux élèves-auteurs), déjà aguerris aux écritures contemporaines (Voir Le Théâtre du Blog), ont choisi, parmi plusieurs textes, de travailler l’écriture complexe de Nathanaël Frérot.
« C’est une expérience intense de confronter son écriture à leur passion et l’acuité du regard de Catherine Marnas », remarque le jeune auteur qui n’en est pas à sa première pièce et s’apprête à publier un roman à l’automne… Apparemment simple, mais d’une construction peu évidente, la pièce s’appuie sur la géographie d’un territoire : la Manche où Nathanaël Frérot travaille avec plusieurs compagnies. La pièce, issue d’une commande, met en scène un groupe d’artistes débarquant à Coutances, non pas en quête d’auteur mais de personnages et d’une histoire à raconter, d’une spectacle à composer collectivement : « On sait ce qui rassemble ces personnages. Des lieux, le département de la Manche… » Ils s’interrogent, remettent leur travail en question, et s’élaborent devant nous des mini-séquences, des amorces d’intrigue, à partir de lieux précis : un appartement, une station balnéaire, une place de village, un gros bourg, les rues d’une ville moyenne…
Entre poésie, petits drames banals et étude ethnologique, la pièce s’articule en trois parties où les scènes opèrent comme des mises en abyme du récit global (l’arrivée d’une troupe d’acteurs en quête d’un spectacle), et s’annoncent par des didascalies très littéraires. On suit quelques personnages du début à la fin, d’autre passent seulement… S’inventent ici des paysages où vivent des gens au quotidien : des agriculteurs à la retraite dans leur cuisine, deux copines à la terrasse d’un café, des couples de néo-ruraux confrontés à la laideur «rurbaine»…
La première partie expose la situation et des tentatives d’écriture. La deuxième, avec une « libération de la situation, le réel, on y mélange l’ordre », se présente comme un tournage de film, dans le désordre de courtes séquences avec des histoires banales, un polar politique et des dénouements comiques. Enfin, l’aventure théâtrale se termine dans une joyeux chaos : «Une grande carte aura été déroulée…», conclut l’un des personnages.
Catherine Marnas et les élèves-comédiens ont débroussaillé cette pièce qui joue sur plusieurs niveaux fictionnels : du naturalisme au poétique, du polar politique à la dramatique télé. Le texte, ouvert à tous les vents, fourmillant de vies minuscules, ressemble à un chantier permanent et convient parfaitement au travail collectif proposé ici. Qu’en adviendra-t-il? Après ces échanges dramaturgiques entre le plateau et la page écrite, la balle est dans le camp de l’auteur. A suivre…
Mireille Davidovici
Travail vu à Théâtre Ouvert 4 bis Cité Véron, Paris 18ème. T. 01 42 55 55 50, le 24 février.
Prochain rendez-vous de l’EPAT : Sur/Exposition d’Aurore Jacob, mise en espace de François Wastiaux et Sarah Jane Sauvegrain, avec les élèves du groupe 44 de l’école du Théâtre National de Strasbourg.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2018 9:51 AM
|
Par Joëlle Gayot sur le site de son émission "Une saison au théâtre" sur France Culture :
Ouvrons aujourd'hui deux pages conjointes de notre encyclopédie mouvante du théâtre : le masculin et le féminin. Mouvantes, ces catégories le sont aussi, dans la vie, sur scène. Notre invité, chercheur, éclaire des pièces qui réfléchissent ce souci du genre : elles le reflètent et elles le pensent.
Ecoutez l'émission en ligne (30 mn) : https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/tous-les-spectacles-parlent-du-genre ;
Alors qu’Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon, a fait l’an passé une annonce officielle pour dire qu’en 2018, “le Festival explorera le genre, la transidentité, la transsexualité”, demandons-nous ce que cela signifie : le théâtre, un art trans par excellence ? Il est sans doute temps en effet, que le Festival, et au delà de lui, le théâtre du XXIème siècle, se mette au diapason de la société contemporaine.
Avec Thomas Cepitelli, docteur en Littérature comparée, chercheur indépendant. Après avoir enseigné à l’Université Paris III - Sorbonne Nouvelle et dans la section "Théâtre" du département des Arts (Université Sophia Antipolis, à Nice), il enseigne désormais en collège (Nice). Il est spécialiste en sociologie de la réception des œuvres théâtrale, des représentations des minorités (sexuelles, racisées) au théâtre, des Queer studies, études gays et lesbiennes au croisement des arts de la scène. Sa thèse, soutenue en 2015, portait sur l'interprétation par les publics des rôles de l'homosexuel masculin dans le théâtre en France au XXème siècle.
Sa connaissance des questions englobées sous le terme galvaudé de “genre”, terme qui renvoie pourtant à une réalité vécue par tous, il l’applique au champ du spectacle vivant. Spectateur aguerri, il analyse avec nous la façon dont selon lui “tous les spectacles parlent du genre”. Dès lors que le masculin et le féminin sont l’objet d’une partition sociale, symbolique, politique, ces catégories et leurs porosités sont sur scène un souci autant que dans nos vies, qu’il s’agit de considérer, d’embrasser dans toute leurs complexités. A la lumière d’exemples, textes et mises en scène dont la plupart datent de ces dernières années jusqu’à tout récemment, il nous aide à qualifier et à regarder ces œuvres qui font la part belle à ces questionnements, fondamentaux, qui nous concernent tous.
Avec les voix (INA) de Fanny Ardent, Olivier Py, Phia Ménard...
Aller plus loin : lire l'article passionnant Quand le récit ne dit pas : l'indétectable. Thomas Cepitelli y analyse l'invisibilisation du personnage de l'homosexuel masculin dans le théâtre, à partir de trois œuvres dramatiques françaises du XXème siècle (Un Taciturne de Roger Martin du Gard ; La Cage aux Folles de Jean Poiret ; Les Œufs de l’Autruche d’André Roussin).
A la question de savoir ce que seraient le masculin et le féminin, Thomas Cepitelli leur formule un ennemi commun, depuis lequel brancher les luttes - qu'il s'agisse de lutter pour meilleure visibilité et égalité des femmes, des hommes, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, l'enjeu est d’œuvrer à la reconnaissance d'une coexistence possible de ces catégories chez une même personne :
L'ennemi commun, c'est la domination masculine. [...] Ce que la société dit du théâtre, dit quelque chose de la société [...] Par exemple dans "La cage aux folles", le duo masculin- féminin permet absolument d'anesthésier le fait qu'on est face à un couple de garçons, qui élèvent un enfant. Je suis un grand défenseur de cette pièce, car il est exceptionnel de trouver un spectacle qui raconte ceci, et qui remplit des salles entières.
Il y a trente ans, en créant son personnage de Miss Knife, Py fait un geste que redécouvre la scène contemporaine maintenant : c'est de dire qu'il se situe entre les deux - entre le masculin et le féminin. Il dit que les frontières sont poreuses.
L'intérêt porté par la sphère publique à des artistes ayant opéré une transition pour faire correspondre leur sexe biologique à leur identité de genre - occasion pour notre invité de nous rappeler qu'un mot existe pour qualifier les personnes pour qui le genre vécu correspond au sexe assigné à la naissance : "cisgenre" s'oppose ici à "transgenre" - lui fait mesurer l’ambiguïté d'une question en pleine mutation :
Je trouve dommageable qu'une artiste comme Phia Ménard, lors de nombreuses rencontres avec les publics à l'issue de représentations, se voit systématiquement poser des questions sur sa transition. Alors que je trouve ses pièces, en elles-mêmes, remarquables et bouleversantes, d'un point de vue scénique. C'est vrai que, souvent, la question de société occulte la question artistique... En même temps, cela prouve que les publics sont profondément intéressés par cette question de société, fondamentale.
Méfions-nous en effet de ne pas poser une grille transidentitaire ou transsexuelle sur certaines pièces, au prétexte que leurs auteurs sont homosexuels ou transsexuels.
Car toujours, le souci de l'autre est plein et entier, dans le rapport aux œuvres :
Produire des spectacles, les jouer, aller en voir, ça reste un acte militant, parce que ça nous confronte à l'altérité.
INTERVENANTS
Thomas Cepitelli
docteur en Littérature comparée, chercheur indépendant, enseignant
Olivier Py joue Miss Knife, son double féminin, "Les premiers adieux de Miss Knife"• Crédits : Rebecca Greenfield / Opus 64

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 5:26 PM
|
Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox
Publié le 22/02/2018
266
PARTAGES
Au lendemain de la présentation d'un projet de loi controversé sur l'asile et l'immigration, Françoise Nyssen a salué jeudi à l'Opéra Bastille l'engagement de onze établissements culturels dans un programme d'insertion en faveur des réfugiés, a constaté une journaliste de l'AFP.
Ces lieux culturels d'Île-de-France, majoritairement de spectacle vivant (Théâtre National de la Colline, Opéra de Paris, Comédie-Française, Théâtre de l'Odéon, Théâtre de Chaillot, Philharmonie de Paris, Grande Halle de la Villette, MC 93, Théâtre Mogador, Théâtre Le Comédia et Institut du Monde Arabe), se sont portés volontaires pour participer au programme d'insertion HOPE (Hébergement Orientation Parcours pour l'Emploi), lancé par le gouvernement et visant plus largement à accompagner l'insertion dans l'emploi de mille réfugiés tous secteurs économiques confondus.
Dans ce cadre, 28 réfugiés, venant d'Afghanistan, du Soudan ou encore d'Erythrée, ont été reçus jeudi par des représentants de lieux culturels pour des entretiens de recrutement, dont douze seront sélectionnés pour des postes d'"agent du bâtiment" (petits travaux de peinture, électricité, plomberie...). Ils les intègreront en contrat de professionnalisation de six mois.
"C'est par la culture que nous accueillons"
"Ce programme Hope est très important. Nous avons vraiment souhaité d'entrée de jeu l'accompagner, parce que c'est évident que c'est par la culture que nous pourrons reprendre confiance, par la culture aussi que nous accueillons", a souligné la ministre de la Culture lors d'un discours prononcé avant le lancement de ces entretiens, en présence du député LREM Aurélien Taché, auteur d'un rapport sur l'intégration des étrangers arrivant en France.
"Je tiens vraiment à défendre ce que nous pouvons faire avec la culture", a-t-elle encore dit. "Souvent en tant qu'artiste, nous vivons en contradiction totale avec ce que nous prétendons défendre (...) Je crois que l'on a la responsabilité de mener à bien ce projet", a souligné pour sa part le directeur du Théâtre National de la Colline Wajdi Mouawad.
Ce déplacement de la ministre est intervenu alors que le gouvernement français a défendu mercredi son projet de loi sur l'asile et l'immigration, un texte dont la fermeté est critiquée par la gauche et les associations et qui a fait des vagues jusque dans la majorité du président Macron.
Légende photo : L'Odéon Théâtre de l'Europe, à Paris (2011) © Loïc Venance / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 4:21 PM
|
Par Anne Elizabeth Philibert pour Culturebox
Mis à jour le 24/02/2018 Depuis Marcel Marceau, l'image des mimes est tombée en désuétude. Pourtant, cet art redevient à la mode ! De retour d'une tournée dans le monde entier, la star du moment s'appelle Julien Cottereau. Son spectacle "Imagine-toi" est à découvrir sur la scène du théâtre des Mathurins, à Paris, jusqu'au 8 avril prochain.
Décédé en 2007, Marcel Marceau, qui avait acquis une notoriété planétaire, a porté l'art du mime à un niveau inégalé. Aujourd'hui, si cet art de magie comique peut sembler un peu défraîchi, il n'en est rien en vérité. Voici le nouveau petit prince du mime : Julien Cottereau.
Issu du Cirque du Soleil, Julien Cottereau, 48 ans, est de retour à Paris avec "Imagine-toi". Après plus de 13000 représentations dans le monde entier, il présente au public parisien ce spectacle sans parole, poétique et tendre, qu'il a lui-même écrit. Sur scène, il aime jouer avec les gens en faisant appel à leurs sens et leur imagination. Et les embarquer dans un monde virtuel où l'invisible devient visible.
Reportage : Medhi Weber : Voir le reportage https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/le-retour-du-mime-l-art-qui-se-passe-de-mots-269711
L'art du mime retrouve une deuxième jeunesse grâce à son côté intemporel. De nombreux jeunes artistes reprennent le flambeau et les compagnies se multiplient. Mais savoir mimer, cela s'apprend comme à l'École internationale du mime, basée en région parisienne.
Extrait du spectacle "Imagine-toi" de Julien Cottereau - https://youtu.be/ZgDsn4eNhqU
Sur scène, aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire. Juste un personnage au physique incertain, mélange d'un Buster Keaton, d'un Pierrot Lunaire et d'un Pinocchio. Absurde, tendre et naïf, habillé de pantalons trop courts et coiffé d'un drôle de chapeau, ce garçon commence à balayer la scène quand il découvre qu'il est observé. Un spectacle universel qui s'adresse à ce que l'humanité a de plus beau : l'enfance.
INFOS PRATIQUES
Imagine-toi
Théâtre des Mathurins
36 Rue des Mathurins, 75008 Paris
Jusqu'au 8 avril 2018
01 42 65 90 00
Le théâtre des Mathurins : http://www.theatredesmathurins.com/
Légende photo : Le mime Julien Cottereau sur scène à Londres en 2012 © AFP/ADRIAN DENNIS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 12:42 PM
|
Par Aïnhoa Jean-Calmettes & Emmanuelle Tonnerre dans Mouvement - publié le 26 déc. 2016
Le théâtre public déroule son tapis rouge à l’actrice-réalisatrice. Nouvelle artiste associée de la Comédie de Clermont-Ferrand, les moyens déployés pour sa première création sont à la hauteur des ambitions : grands. Assez pour créer un malaise ? Le pourquoi du comment Mélanie Laurent révèle bien d’autres choses.
À force de répéter « Mélanie, c’est vraiment une artiste », le directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand finit par transformer notre conversation en opération de légitimation. D’un désamorçage à un autre, ses propos transpirent l’inquiétude que sa nouvelle artiste associée ne soit pas reconnue à sa juste valeur. La faute à cette « image de star qui occulte beaucoup de choses », visiblement autant qu’elle fait rêver. À quelques minutes de la fin du rendez-vous, Jean-Marc Grangier laisse apparaître malgré lui une légère fascination. « Là, elle arrive en mobylette avec un chapeau et un super manteau. Et je lui dis : "Bah Mélanie, qu’est-ce qui t’arrive ?" Et elle me répond : "Ce soir je rencontre Bradley Cooper." !! » Il ponctue alors l’anecdote d’un rire enfantin et siffle son coca. C’est l’heure de retrouver Mélanie Laurent pour la représentation des Français de Krzysztof Warlikowski. S’engouffrant dans la nuit parisienne, l’homme de théâtre glisse d’une voix douce : « Je suis content que vous écriviez sur elle, qu’on puisse la découvrir sous un autre jour et apprendre à la connaître différemment. »
La fin du « Mélanie bashing » ?
Si Jean-Marc Grangier se sent obligé de déminer le terrain, c’est qu’il pourrait y avoir malaise. En 2011, l’histoire d’amour entre Mélanie Laurent et la presse prend l’eau. Cette année-là, l’actrice sort son premier album En t’attendant, coécrit avec le chanteur de folk irlandais Damien Rice, présente la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes et réalise son premier film, Les adoptés. Sauf que, « plus t’es partout, plus on t’en veut ». Devant sa tasse de thé, les yeux dans le vague, l’intéressée préférerait éviter le sujet. « C’est un peu réducteur de penser que toute sa vie, on a envie de cinéma ou de théâtre. J’ai toujours trouvé ça intéressant, les artistes qui changent de case. C’est aussi un risque, mais le pire serait de s’autocensurer. »
Suivant cette ligne, et contre l’avis de ses proches, elle coréalise en 2015 le road-movie écolo Demain. Unanimement salué par les professionnels (César du meilleur documentaire) et par le public (plus d’un million de spectateurs), ce documentaire joyeux qui part à la rencontre de ceux et celles qui inventent des solutions pour éviter la catastrophe écologique a contribué à changer durablement son image. Une journaliste à France inter, analyse : « Beaucoup de gens du milieu se sont rendus compte que, pour une fois, une star pouvait faire un documentaire engagé sans resservir l’image d’Épinal de la conscience humanitaire façon Lady Di au milieu des Africains. Le film a été ensuite projeté à Nuit debout. Et applaudi!… Qui l’eu cru franchement ? »
En s’engageant auprès de Mélanie Laurent, sa première chargée de production, Anne-Lorraine Vigouroux « [s]’attendai[t] à ce que certaines personnes du théâtre subventionné fassent un peu la fine bouche avec un a priori négatif, parce que c’est une actrice de cinéma, qu’elle est belle, qu’elle est blonde et qu’on aime bien taper sur elle ». Mais l’arrivée dans le théâtre public de la jeune femme de 33 ans et l’annonce de cet énième tournant de carrière n’ont fait jaser personne. La critique de sa pièce, Le dernier testament, est, si ce n’est élogieuse, du moins extrêmement bienveillante. Cheveux ébouriffés et regard perçant, la metteure en scène fait la couverture du numéro novembre-décembre de Théâtral magazine. Dans le milieu, il semble que l’on se soit rapidement dit, qu’après tout, il n’y avait rien d’incroyable à ce qu’elle devienne artiste associée d’une scène nationale avant d’avoir créé sa première pièce. Ce cas est pourtant inédit, même dans les structures les plus attentives à l’émergence. Acquérir ce statut, c’est bénéficier d’un accompagnement au long cours, financier (aide à la production de spectacle), matériel (accueil en résidence) mais aussi relationnel, autant dire le saint Graal dans un réseau public marqué par la précarité et la baisse croissante de subventions.
Une histoire de rencontres
Coté production, tout le monde a l’air de trouver cette situation naturelle. À les entendre, rien de plus qu’une histoire de rencontres. Jean-Marc Grangier a « tout de suite été s… oui, sans doute, séduit, mais par l’artiste ». Anne-Lorraine Vigouroux, par « sa détermination » : « Mélanie est une femme généreuse, enthousiaste et brillante, humainement comme intellectuellement. »
Derrière cette importance de la rencontre et la tonalité affective et protectrice de ces propos, il est possible de lire un effet paradoxal de la célébrité. Dans son ouvrage De la visibilité, la sociologue Nathalie Heinich décrit ce désir de rencontrer les personnalités médiatiques. Elle insiste sur le fait que, plus un visage est présent dans l’espace public et les médias, plus l’envie de se confronter à l’original de chair et d’os est forte. Derrière la star de cinéma, c’est toujours la femme qui fascine, car au-delà de l’image sur papier glacé ou à l’écran, c’est le visage que l’on attend.
Pour autant, Mélanie Laurent ne raconte pas les choses autrement. « Ça doit être un mélange de chance et de gens qui, tout d’un coup, doivent me trouver un peu exotique, folle et débordante d’énergie et qui se disent "Bon, allez…" » (rires) Comme dans tous les projets qu’elle entreprend, elle voulait avant tout « raconter une histoire », en l’occurrence celle d’un messie new-yorkais des temps modernes. « Le désir de mise en scène au théâtre est venu à la lecture du Dernier Testament de Ben Zion Avrohom de James Frey. Avant, je n’y avais jamais pensé. » Bouleversée par le best-seller de cet auteur américain, elle décide de l’adapter. « La solution que Ben Zion propose, c’est tout simplement de baisser les armes, d’être heureux et de se faire du bien. Pourquoi parler d’amour et de choses simples, ça paraît complètement à côté de la plaque ? C’est la même chose avec Demain. Je crois qu’aujourd’hui, on a besoin de causes, de héros et de personnes qui nous inspirent. » Puisqu’« au théâtre tout est possible », comme lui souffle son ami comédien Jocelyn Lagarrigue, l’idée fait son chemin. De rencontres en rencontres, un directeur de théâtre lui offre sa confiance, charmé, aussi, par sa manière de mettre l’humain au centre de sa démarche.
Légitimité et classicisme
Trois films déjà réalisés, un quatrième bientôt en salle (Plonger), Mélanie Laurent n’en est pas à son premier fait d’armes en matière de direction d’acteurs. Elle accorde une attention toute spécifique à ce domaine. « Je fais toujours confiance à mes acteurs, je suis persuadée qu’ils ont toujours raison. J’ai vécu quelque chose de très fort avec eux et quand je les vois jouer, ils m’émeuvent. Je suis très admirative de ce qu’ils donnent sur le plateau. »
Peu au fait du fonctionnement du théâtre public, elle a dû apprendre « tout, très vite » et sa première pièce n’a rien à envier à d’autres, créées dans le réseau subventionné. Pourtant, là où l’on se serait attendu, de la part d’une artiste venant d’une autre discipline, à un renouvellement des formes et des langages scéniques, Le dernier testament a quelque chose du travail trop bien fait. Avec ses adresses au public récurrentes, l’abstraction de sa scénographie, la volonté, trop visible, de faire passer un message, cette proposition respire malgré elle les codes d’un théâtre contemporain devenu, à force, un peu classique.
Mélanie Laurent avait-elle besoin de se faire accepter par cette nouvelle sphère professionnelle ? Pas vraiment. Elle semble plutôt se moquer des « logiques de milieu ». Du moins espérer qu’on puisse y échapper. « J’avance parce que j’ai une part d’inconscience et que les artistes qui me fascinent ont souvent dit "soyons fous". Bien sûr, je doute. J’ai peur tout le temps mais il n’y a que le doute qui nous fait avancer. C’est à la fois épuisant et passionnant. »
Avec Marc Lainé à ses côtés – scénographe également reconnu pour ses mises en scène –, Philippe Berthomé et ses savants jeux de lumière, la dramaturge Charlotte Farcet – qui lui a « appris à rendre [s]es idées théâtrales » –, Mélanie Laurent se serait-elle entourée de collaborateurs à la personnalité artistique trop affirmée ? Quand on lui avoue qu’on a trouvé sa pièce presque trop attendue, elle réfléchit et répond à tâtons, après un long silence. « On est jamais très libre quand on fait une première création. Surtout quand on est autodidacte et plutôt instinctive. Donc oui, je pense que, d’une certaine manière, je suis peut-être dans une forme trop "théâtrale". Ou déjà vue ? Après, est-ce que j’ai été poussée pour arriver là ou est-ce que, dès le départ, j’étais là-dedans ? Je ne sais pas. En tout cas, je n’aurais jamais fait quelque chose que je ne ressentais pas… »
Dans la couveuse d’une scène nationale
Le montage financier et la tournée du Dernier testament se sont bouclés en quatre ans – des délais traditionnels au théâtre – avec une facilité qui ferait sans doute pâlir les jeunes compagnies. Tout semble avoir été mis en place pour que Mélanie Laurent devienne metteure en scène, dans les meilleures conditions possibles. Anne-Lorraine Vigouroux raconte : « En organisant des rendez-vous, l’idée c’était d’essayer de s’offrir le luxe de trouver des coproducteurs qui soient aussi des conseils, des oreilles, des yeux, intelligents. Pour l’accompagner au mieux, c’est-à-dire sans interférer dans le cœur de son travail. » Un rôle tout trouvé pour Jean-Marc Grangier. Prévenant, il lui a appris la différence entre le théâtre public et le théâtre privé ; l’a emmenée « voir beaucoup de pièces pendant deux ans » pour qu’elle développe son regard ; et l’a conseillée et présentée, pour qu’elle s’entoure de la meilleure équipe possible.
Le budget de production, 250 000 euros, est loin d’être insolent au vu du nombre de comédiens sur le plateau, mais reste néanmoins inédit pour une première production. Cofondatrice de Copilote, une coopérative de développement de projets artistiques engagée auprès de la jeune création, Juliette Medelli nous fait part de son expérience. « Pour un premier spectacle, il n’y a, a priori, pas de production. Tu répètes où tu peux, tu essayes de trouver des lieux pour t’accueillir et tu paies les gens quand c’est possible. C’est souvent un peu moins pire la deuxième fois. » À titre d’exemple, le jeune metteur en scène Tanguy Malik Bordage fait presque figure de privilégié. Grâce au soutien des tutelles locale, départementale et régionale, il a pu monter une première production de 15 000 euros. 800 euros de scénographie payés de sa poche, et toujours aucune certitude quant à d’éventuelles dates de tournée, malgré l’inventivité formelle et les partis pris radicaux de son Projet loup des steppes.
Là où la production du Dernier Testament fait figure d’ovni, c’est surtout au regard de sa part de financements privés : plus de la moitié. Lorsqu’on lui fait remarquer que trois mécènes (Galeries Lafayette, Dior Parfums et Tory Burch) pour du théâtre public, c’est du jamais vu en France, Anne-Lorraine Vigouroux reste un peu sur la défensive : « Les coproducteurs, très judicieusement, ont décidé d’utiliser la capacité de Mélanie à générer des fonds privés pour boucler la prod, c’est formidable qu’elle ait joué le jeu. Et, à ma connaissance, les mécènes n’ont absolument rien demandé en termes artistiques… Enfin, y’a pas de pub pour Dior dans le spectacle. »
Clermont-Ferrand capitale
Jean-Marc Grangier s’en défend, choisir Mélanie Laurent comme artiste associée pendant trois ans, n’avait « rien d’un calcul ». C’est néanmoins une décision intelligente et hautement rationnelle, au vu du désengagement croissant de l’État et des collectivités dans la culture. Sous la houlette de M. Wauquiez, le conseil de Rhône-Alpes a ainsi décidé, en juillet dernier, une baisse globale de 400 000 euros des subventions allouées aux compagnies régionales. L’adjointe à la culture de la mairie de Clermont-Ferrand, Isabelle Lavest, nous apprendra d’ailleurs que l’enveloppe artistes associés de la Comédie (250 000 euros), a été remise en cause aussitôt promise. « Les Drac ont changé d’avis… enfin vous connaissez la situation politique… »
S’il a séduit les grandes marques, le nom Mélanie Laurent n’a eu que peu d’influence sur la vente de billets à Clermont. À la tête de la scène nationale d’Auvergne depuis 14 ans, Jean-Marc Grangier s’est forgé la réputation de réaliser un travail de terrain et de médiation intelligents. Et d’avoir su gagner la confiance de son public, qu’il parvient à « emmener vers des propositions artistiques parfois difficiles ». En témoignent les taux de remplissage des salles avoisinant, en moyenne, les 95%. Avec ses 98%, Le dernier testament a fait un peu mieux. Pour la Comédie, la prochaine étape est la construction d’une vraie salle de spectacle. Fin du chantier prévue pour 2019. « C’est l’un des gros cailloux dans [la] chaussure » de Jean-Marc Grangier : « Ne pas avoir un théâtre à nous depuis 20 ans ! On est la seule scène nationale dans ce cas...» Grâce au soutien de la municipalité, la Comédie accueillera également les trois artistes choisis par le directeur – le chorégraphe Fabrice Lambert, le marionnettiste Johanny Baert et, bien sûr, Mélanie Laurent. Pendant les trois ans de ce partenariat, cette dernière prévoit de réaliser un documentaire avec les élèves du lycée agricole de Vernet-la-Varenne et de créer une seconde pièce.
Si la mairie de Clermont-Ferrand a décidé de se substituer à la Drac pour rendre possibles ces projets de résidence prolongée – « reste à trouver comment » – cela n’est sans doute pas sans lien avec la future candidature de la ville au statut de Capitale européenne de la culture 2028 (à déposer en 2021). Une préfiguration grandeur nature de ce projet, nommée Effervescence, sera lancée dès 2017. Isabelle Lavest est enthousiaste : « Avoir des artistes de l’envergure de Mélanie Laurent à Clermont-Ferrand pendant trois ans, ça nous aide à asseoir ce projet de Capitale européenne de la culture. Des gens comme elles qui disent avoir envie de travailler sur ce territoire, c’est un message extrêmement positif. » À ce jeu-là, tout le monde semble gagnant : institution en quête de visibilité, artiste avide de créer. La conversation bascule alors une fois de plus dans l’affect. « Mélanie a une vraie curiosité, elle est dans une vraie réciprocité. » La faute, peut-être, à cette foutue image de star de cinéma.
Texte : Aïnhoa Jean-Calmettes
Photo : Louis Canadas pour Mouvement

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 10:13 AM
|
Par Florence Olivier dans Clicanoo.re (La Réunion) :
THÉÂTRE.
Une nouvelle ère s'ouvre pour la filière théâtre à La Réunion. Dès septembre une nouvelle plateforme pour la formation à l'art dramatique dédiée aux outre-mer ouvrira ses portes au Centre Dramatique National du Limousin. À l'initiative de l'Académie de l'union de Limoges et du Centre dramatique du Limousin, il s'agira de la première classe préparatoire intégrée exclusivement réservée aux territoires ultramarins. "Depuis quelques années, je constate une faible présence d'élèves comédiens et comédiennes issus des territoires d’outre-mer", explique Jean Lambert-wild, directeur du Centre dramatique du Limousin, lui-même originaire de La Réunion. Constat que partage Luc Rosello, directeur du Centre Dramatique de l'océan Indien qui œuvre pour inverser cette tendance.
Prôner le multiculturalisme
Pour le dramaturge "kréopolitain" (il a quitté l’île à l’âge de 18 ans pour se lancer dans la carrière) cette plateforme est "une solution qui donne aux Ultramarins la possibilité de préparer les concours des grandes écoles de théâtre mais surtout de les accompagner dans leurs démarches." Les élèves comédiens bénéficieront ainsi d'un cursus adapté. Le parcours va donc se décliner sous la forme d'une alternance. La première année, consacrée à la classe préparatoire, se passera à Limoges, au sein même du Centre Dramatique. La seconde année, les élèves relayeront les spectacles et représentations sur les territoires d'outre-mer. Ce qui permettra, selon Luc Rosello, "d'enrichir le vivier des futurs candidats." Car l'ambition de la formation est également d'amplifier la richesse du multiculturalisme. "Des formateurs issus des territoires viendront enseigner afin de montrer la lumière des territoires ultramarins, la vitalité de leurs langues et de leurs théâtres. Car il ne s'agit pas de formater de jeunes créoles", poursuit Jean Lambert-wild. L'objectif est donc de "métisser les élèves" en leur donnant le privilège de rencontrer des artistes, des formateurs et des pédagogues de métropole ou de d'autres nationalités. À terme, et si la plateforme arrive à se pérenniser, cette démarche pourrait voir l'ouverture d'une filière.
Florence Olivier
Ouverts aux élèves, comédiens des outre-mer, les concours pour intégrer la classe préparatoire à La Réunion se dérouleront les 14, 15 et 16 mai. Les résultats seront connus dès le 5 juin.
Légende photo : Jean Lambert-wild (à gauche) et Luc Rosello (au centre) : les centres dramatiques du Limousin et de la Réunion ensemble pour l'avenir des jeunes comédies péi.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 24, 2018 9:47 AM
|
Publié par E.F. dans l'Est Républicain
Si Transversales a trouvé, avec l’église sainte Jeanne d’Arc, un lieu fixe pour sa programmation, dans les faits, les choses sont bien plus compliquées. Car il n’y a pas que les scènes de nu qui ne peuvent pas y être jouées. Le cirque peut également poser soucis, tout comme les concerts de musique classique, et ce pour des raisons techniques et sonores.
Bref, coté public, il faut s’accrocher. D’abord parce que forcément, troquer le joli théâtre à l’italienne de Verdun contre une église ou une salle polyvalente pour assister à des spectacles n’est pas très séduisant. Et puis, il faut parfois attendre un moment pour connaître le lieu où se déroulera un événement. Les plus fidèles seront au rendez-vous. Mais cette saison, Transversales a connu une baisse d’adhérents notable.
Rajoutez à tout cela les tensions entre l’association et le Grand Verdun et le cocktail est vite explosif ! Dernier événement en date, la décision de l’agglo de ne plus prendre en charge la régie générale des spectacles. « Ce n’était plus possible », assume Antoni Griggio, « il y avait toujours des changements de dernière minute, ce n’était plus gérable. » D’après nos informations, c’est pour Transversales une charge de travail en plus, qui lui demande financièrement des efforts supplémentaires. Un point négatif de plus pour l’association.
Si elle retrouvait le théâtre, les choses iraient mieux, c’est certain. Mais ce n’est pas demain la veille.. Début janvier et trois ans après le dépôt du dossier par la nouvelle municipalité, la bonne nouvelle est tombée : la commission des affaires culturelles du Grand Est a décidé d’inscrire le théâtre de Verdun à l’inventaire des Monuments historiques. Avec des subventions conséquentes à la clé pour les travaux.
Mais quand débuteront-ils ? Là est la question. Et il n’est pas certain que Transversales existera encore pour profiter des lieux. Du moins, on peut légitimement se poser la question.
E.F.
La scène de nu qui dérange dans une église : https://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2018/02/24/la-scene-de-nu-qui-derange

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2018 7:45 PM
|
Dans une tribune au « Monde », un collectif d’artistes venus de la francophonie et de politiques, parmi lesquels Jack Lang, Alain Mabanckou et George Pau-Langevin, s’indigne de la fermeture annoncée du Tarmac, à Paris, l’unique scène dédiée à la francophonie.
Tribune. Le ministère de la culture, par un communiqué publié le 31 janvier, annonce la fin du Tarmac [avenue Gambetta, à Paris], l’unique scène dédiée à la francophonie. L’intérêt affirmé du président de la République pour la francophonie nous a enthousiasmés et a fait naître un espoir nouveau parmi le monde de la culture.
Mais derrière les déclarations d’amour à la langue française, une politique brutale serait-elle en train de se mettre en place ? La machine administrative aurait-elle mandat pour livrer bataille contre la culture et ses artistes francophones ? On entend que le Tarmac disparaîtrait brutalement. Une décapitation en silence organisée par le ministère de la culture. Nous ne pouvons le croire.
Alors que nous espérons une nouvelle impulsion, nous pourrions être victimes d’une politique de l’ancien monde, à bout de souffle, qui cloue les créateurs francophones au pilori, qui bafoue les publics, qui ignore superbement le travail quotidien mené avec le monde éducatif et associatif.
Le Tarmac est un lieu très identifié, la maison reconnue et familière des artistes francophones. C’est l’un des plus grands réseaux sur la scène internationale, qui entretient des échanges constants avec des écrivains, intellectuels, interprètes, chorégraphes, metteurs en scène des quatre coins du monde, de Brazzaville au Caire, de Ouagadougou à Beyrouth, en passant par Montréal ou Marrakech. Faire disparaître le théâtre du Tarmac, c’est choisir de détruire notre maison.
Les défis contemporains de l’Europe
C’est aussi choisir de détruire un théâtre populaire, ancré sur un territoire vaste et métissé. Les innombrables établissements scolaires, universités, médiathèques, associations auprès desquels nous intervenons chaque jour construisent avec nous l’identité culturelle des nouvelles générations. C’est maintenant qu’il faut conforter Le Tarmac dans sa mission. Vous ne pouvez, monsieur le Président, en faire table rase au moment même où tout milite à porter haut les valeurs humanistes de la France. La mission de ce théâtre mérite d’être défendue avec d’autant plus de vigueur aujourd’hui que les idéologies extrémistes et xénophobes se font légion.
Monsieur le Président, quelle serait une refondation de la francophonie qui commencerait par couper les vivres à ses artistes ? Comment pourrait-on vouloir impulser un nouvel élan en détruisant un symbole ? Défendre aujourd’hui Le Tarmac, c’est aussi regarder dans les yeux les défis contemporains de l’Europe dans le contexte des nouvelles migrations, c’est porter un regard lucide et généreux sur une histoire partagée. Alors, nous refusons l’improbable.
Nous sommes nombreux à nous opposer résolument à la disparition du Tarmac, fer de lance des cultures francophones en France. Monsieur le Président, nous vous demandons instamment de porter une politique ambitieuse pour la francophonie, ses acteurs et ses publics. Aujourd’hui, au cœur de cette action, il s’agit, avec fierté de soutenir Le Tarmac.
Les signataires : Zeina Abirached (auteure de bandes dessinées), Marguerite Abouet (écrivaine, scénariste et réalisatrice), Gustave Akakpo (auteur, dramaturge et metteur en scène), Laura Alcoba (romancière), Jacques Allaire (metteur en scène), Pouria Amirshahi (rapporteur de la mission d’information parlementaire sur « l’ambition francophone », 2014), Hakim Bah (auteur et dramaturge), Kidy Bebey (écrivain et journaliste), Yahia Belaskri (écrivain), Pascal Blanchard (historien), Ali Chahrour (chorégraphe), Serge-Aimé Coulibaly (chorégraphe), Louis-Phillipe Dalembert (écrivain), Jean-Paul Delore (metteur en scène), Ananda Devi (écrivain), Abdelkader Djemaï (écrivain), Ahmed El Attar (auteur, metteur en scène/directeur D-CAF festival - le Caire), Hassan El Geretly (metteur en scène/directeur d’El Warsha – le Caire), Nedim Gürsel (écrivain), Gaël Faye (chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète), Hassane Kassi Kouyaté (directeur de la scène nationale Tropiques Atrium Martinique/membre du collège de la diversité), Jack Lang (président de l’Institut du monde arabe), Sébastien Langevin (rédacteur en chef de la revue Le français dans le monde), Henri Lopes (écrivain), Alain Mabanckou (écrivain, professeur à l’université de Californie à Los Angeles), Yamen Manaï (écrivain/prix des cinq continents de la francophonie 2017), Daniel Maximin (écrivain), Achille Mbembe (philosophe et professeur à l’université de Witwatersrand à Johannesburg), Boniface Mongo Mboussa (essayiste et critique littéraire), Fiston Mwanza Mujila (écrivain), Fabrice Murgia (auteur, metteur en scène/directeur du théâtre national de Bruxelles), Criss Niangouna (auteur et comédien), Dieudonné Niangouna (auteur, dramaturge et metteur en scène), Wilfried N’sondé (écrivain, musicien), Gabriel Okoundji (poète), George Pau-Langevin (députée PS du 20e arrondissement, ancienne ministre des outre-mer), Jean-Luc Raharimanana (écrivain), Rodney Saint-Eloi (écrivain, directeur des éditions Mémoires d’encrier, Montréal), Salia Sanou (chorégraphe), Boualem Sansal (écrivain), Soro Solo (journaliste), Véronique Tadjo (écrivaine et universitaire), Sami Tchak (écrivain), Minh Tran Huy (romancière et journaliste), Abdourahman Waberi (écrivain et professeur à l’université George Washington), Aurélien Zouki (membre du collectif Kahraba).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 22, 2018 6:53 PM
|
Par Gérard Mayen dans Danser canal historique 22 février 2018
Le phénomène est rare. Il faut le saluer. Le Théâtre de La Commune à Aubervilliers, haut lieu historique de la décentralisation de l'art dramatique, n'est pas spécialement repéré comme un lieu phare pour la danse. Or on s'y soucie d'y accompagner une artiste associée, Marion Siéfert, qui a plus qu'un pied dans ce domaine. Et on s'y donne les moyens de la programmer sur une série de quatre représentations, dans la grande salle, alors qu'elle n'en est qu'à son second projet scénique et que son nom ne dit à peu près rien à quasiment personne. Bilan : la semaine dernière, un bouche-à-oreille fulgurant a fait s'y précipiter des assistances en nombre appréciable. Parmi lesquelles pas mal de professionnels, qui dans la file d'attente, se renvoyaient la question, un rien étonnés de se croiser là : « dis, tu la connais, toi ? »
Ainsi venait-on voir Le grand sommeil, pièce de Marion Siéfert, qui relève d'une configuration plutôt exceptionnelle. Cette pièce aurait dû s'interpréter en duo, avec sur scène Helena de Laurens, et Jeanne, une enfant de onze ans. Sans en dérouler le détail des péripéties, il se trouve que les dispositions relatives au travail des enfants se sont soldées par l'empêchement, opposé à Jeanne, de poursuivre plus avant dans ce projet. Lequel aura été poursuivi néanmoins en solo, la seule Helena de Laurens endossant le personnage de Jeanne en position de narratrice, et sa propre position de partenaire de cette Jeanne. D'où une dramaturgie très singulière, sorte de projet entrant en autofiction de lui-même : il prend forme, et se performe, par le mouvement même de s'élaborer en récit des aléas de son propre développement.
Il y a de la rareté dans cette configuration. Une torsion en découle dans le jeu d'Helena de Laurens désormais seule en scène, en figure de narratrice et de performeuse tout à la fois, sur le fil d'une présence de l'absence, et débrayant en postures d'actions, mais aussi de description d'actions, mais encore de commentaires du personnage et de ses actions. Ce personnage est pris dans un tourbillon de distributions et de transitions entre ses positions diverses et interchangeables. Notamment, la voici présente en tant qu'adulte, mais incarnant tout autant l'enfant qui aurait dû s'adresser à elle. D'où une circulation entre niveaux de jeux, et niveaux d'âges, qui s'entremêlent. Ainsi voit-on apparaître le motif de l'enfant grande en position de moteur de cette pièce. Un principe d'hybridité, peu contrôlée, en est le sel.
Chorégraphiquement parlant, ce qui en découle est passionnant. Cela d'autant que l'idée d'origine, avant qu'elle se trouvât en partie empêchée, questionnait la position de l'interprète en tant que vampire des projections imaginaires des spectateurs ; et que Jeanne n'était pas alors la dernière à déchirer, résolument, toute image d'enfant sage. Il y a du soufre au fond de toute présence en scène. On a aussi appris qu'Helena de Laurens s'est beaucoup intéressée, dans son parcours, à la figure de Valeska Gert, sorcière moderne d'un art du corps grotesque, et de la monstruosité scénique, à tout jamais rebelle dans le cabaret berlinois ultime précédant l'avènement du régime nazi.
A la rencontre de cette multiplicité d'éléments, la présence corporelle de la soliste a quelque chose d'excavé, dans un corps en état de griffure, aussi bien replié en boule à ras du sol, qu'intrépide dans une dévoration de l'espace, farouche en tensions cataleptiques, ou bien sectionné dans le dépliement heurté d'une segmentation sur-aiguë. Résolument expressionniste, ce vocabulaire gestuel trouve aussi maintes terminaisons du côté de la mimique et des grimaces. Il se produit là quelque chose de très fort dans l'acharnement d'un corps – dans ce cas, on veut donc dire : d'une personne – en état de déchirure.
Un texte est prononcé, par ailleurs, d'abondance. Il est clairement audible, avec une sécheresse de brindilles, arrimé sur une logique de la péripétie et de l'anecdote, du commentaire et du dialogue, théâtrale. Terriblement théâtrale. Tout à sa factualité, et s'imposant en jeu dramatique, ce texte doit s'écouter, et alors il envahit et distrait l'attention, en échouant à se constituer en masse de puissance. Dans cette acception assez surannée d'une danse-théâtre, il nous a souvent semblé que le geste n'était pris qu'en relai, au moment de dépasser physiquement le manque à exprimer de l'oralité atteignant sa limite.
De sorte que, par soupçon assez détestable, on a pu craindre, qu'une part essentielle de l'adhésion du public, bruyamment manifestée aux saluts, tînt à cet attachement, indéracinable dans le monde du théâtre, au fait que des mots doivent venir rassurer, en égrenant un récit, dont l'intelligibilité littérale devra, au bout du compte, rassurer toute inquiétude d'une éventuelle entrée dans l'incertain. Celle que ménage le corps, et qui se passe d'une obligation à illustrer des mots.
Gérard Mayen
Légende photo : "Le grand sommeil" - Marion Siéfert © Marion Siéfert
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...