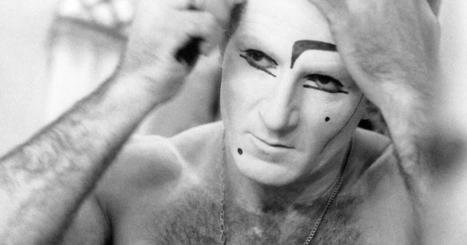Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2024 11:08 AM
|
Tribune publiée par Libération le 9 novembre 2023 Le dramaturge libano-québécois, directeur du Théâtre de La Colline, appelle à ne pas tomber dans le piège tendu depuis le 7 octobre par l’esprit destructeur du Hamas qui veut faire en sorte que «l’après» soit avant tout la haine du Juif. par Wajdi Mouawad, auteur libano-québécois et directeur du théâtre de la Colline publié le 9 novembre 2023 Cela vient à peine de commencer et il nous faut déjà «panser» l’après. Un après qui, au rythme où vont les choses, nous arrivera aussi meurtri que l’effroyable 7 octobre dernier. «Panser» l’après, c’est se préparer à accueillir quelque chose dont nous ignorons encore tout, c’est tenter de soigner un temps pas encore arrivé, pour que, défait de ses pulsions de meurtres, il puisse être un réel après. La volonté des gouvernements qui nous dirigent tout comme leurs enjeux géopolitiques échappent à notre volonté. Et si nous pouvons nous exprimer, nous ne pouvons pas, sur un temps court, agir sur les événements qui nous impactent et cette incapacité, à partir du moment où la question de l’action se pose, crée chez chacun un insupportable sentiment d’impuissance. Qu’y puis-je, moi, contre le Hamas ? Qu’y puis-je contre la frange suprémaciste du gouvernement israélien ? Qu’y puis-je contre le Hezbollah ? Qu’y puis-je contre le gouvernement iranien ? Qu’y puis-je contre la politique américaine au Moyen-Orient ? Qu’y puis-je contre le cynisme sanglant de Vladimir Poutine ? Qu’y puis-je contre la zizanie qui mine la communauté européenne ? Qu’y puis-je contre l’opportunisme de Xi Jinping ? Peut-être que la question ne devrait pas se poser en ces termes et au lieu de viser ce qui est hors de ma portée, rapprocher la cible et me demander : «Sur quoi suis-je capable d’agir ?» A cette question la réponse la plus concrète est aussi la plus simple : sur moi. Je peux commencer par agir sur moi et me demander, à l’aune de la situation, qui suis-je réellement. Qu’est-ce que cette situation est en train de faire de moi ? Comment est-elle en train de me transformer ? Comment me révèle-t-elle à moi-même ? Qu’est-ce qu’elle dit sur ce que je suis et sur ce que je crois être ? Quel est l’œdème qu’elle met en lumière et qui menace mon cerveau ? Si «panser» dès à présent l’après c’est faire en sorte que ce qui l’a précédé ne se reproduise plus, alors un changement drastique incombe à chacun. Il ne suffit pas de dire que les autres, Israéliens ou Palestiniens, doivent changer, mais reconnaître que quelque chose en moi doit se transformer. Pour de bon. C’est la somme de la transformation de chacun qui fera en sorte que cet après en sera un. Une fleur immortelle et indéracinable : la détestation Né au Liban en 1968 au sein d’une famille chrétienne maronite, je n’ai nullement manqué d’amour. Mes parents ont tout sacrifié pour moi, fuyant la guerre civile libanaise dans le seul but de me permettre d’étudier sereinement. Mais, du fait de l’ignorance et des préjugés ; du fait, aussi, que le Liban a vécu cinq siècles sous le joug ottoman obligeant chaque confession à se refermer sur elle-même, du fait de paramètres autant historiques qu’intimes, mes parents, en plus de l’amour et l’affection, ont aussi planté en moi la graine d’une fleur immortelle et indéracinable : la détestation. Et dès mon plus jeune âge j’ai su détester ceux qui n’étaient pas de mon clan. A l’âge de huit ans, j’ai dansé à l’annonce de la mort du chef druze Kamal Joumblatt et en septembre 82 j’ai considéré qu’après l’assassinat de Bachir Gemayel [trois semaines après son élection à la présidence du pays, ndlr], les civils palestiniens des camps de Sabra et Chatila, massacrés par les miliciens chrétiens, n’avaient eu que ce qu’ils méritaient. Je n’ai pas eu à apprendre à détester : je détestais par héritage. Et si je détestais consciemment, heureux de détester, heureux de haïr, je n’avais pas conscience de combien j’étais esclave de cette détestation car ma haine était viscérale et, ne m’animant pas de manière intelligible, je n’avais aucun moyen de l’interroger. Car cette détestation vient de loin et se transmet de génération en génération. En prendre conscience est difficile, comme il est difficile à celui qui porte un sac à dos vide de sentir le poids s’additionner si, de jour en jour, quelqu’un y déposait un caillou. Le poids augmente sans que l’on s’en aperçoive. Ainsi en est-il de cette détestation. Elle pousse à notre insu, grandit, fait des ramures, s’enracine à jamais, s’intrique tant à notre identité que l’on finit par élaborer des schémas de pensée pour la légitimer, nous transformant par la même occasion en victime éternelle. Paradoxalement, il a fallu la guerre, l’exil, la découverte d’une autre langue, la découverte de l’art, la qualité de certains professeurs (Gérard Pouchain, Sylvette Montale, Philippe Guettier, soyez ici éternellement remerciés) ; il a fallu l’amitié, la mort de ma mère, Sophocle, Kafka, François Ismert, le théâtre, des voyages, des mots, des poèmes, des histoires d’amour, pour que je prenne conscience de sa présence. Elle m’est apparue dans toute son horreur, sorte d’épiphanie impitoyable et, réalisant ma monstruosité, j’ai voulu l’arracher de moi. Mais la détestation plantée dès la naissance ne se déracine pas. C’est une plante immortelle, imbriquée à jamais et, chez qui elle a été semée, elle demeure. Me découvrant une terre propice à sa floraison, je ne pouvais plus me fier à moi-même, je ne pouvais plus présumer de moi. Je me devais à jamais de monter la garde, faire preuve de prudence et m’assurer constamment que rien n’allait ni la nourrir ni l’abreuver car si on ne peut pas s’en débarrasser, on peut cependant l’isoler, la mettre sous verre, cesser de nourrir sa terre, travailler jour après jour à l’assécher pour l’empêcher de fleurir. Mais pour y parvenir, il faut commencer par ne plus nier sa présence et, au contraire, l’assumer. Se souvenir que tout fleuve a un marécage qui le tient en santé. Marécage où vont se déposer les poisons et les pollutions qui pourraient le tuer. Si c’est vrai des fleuves, c’est vrai aussi des humains. Cette plante de la détestation est mon marécage où se dépose tout ce qui est nauséabond chez moi. Ma responsabilité consiste alors à empêcher le débordement du marécage, l’empêcher, par des digues fortes, d’envahir mon esprit, putrifiant mon lien au monde. Cette responsabilité, ces digues, cette vigilance, sont ce que j’appelle effort d’empathie, d’humanité, de sensibilité et d’amour. Volontés inhumaines Delphine Horvilleur [rabbin et philosophe, ndlr] m’a fait remarquer qu’une image biblique qui pourrait correspondre à celle du marécage pourrait être celle de l’arbre de la vie du jardin d’Eden. Pourquoi au paradis fallait-il un arbre interdit ? Justement pour rappeler que le mal n’est pas séparé de la vie, rappeler la vigilance constante que nous devons avoir face à sa présence. En ce sens, ce n’est pas le marécage qui est mauvais : il rend puissant le fleuve ; ce ne sont pas les sentiments que nous éprouvons qui sont mauvais : ils nous apprennent à les dépasser ; c’est le fait de nous laisser aller à leur bestialité qui est mauvais. Or, si la plante de la détestation a la capacité de donner des fleurs de haines multiples, chacune déployant un parfum différent envers un groupe différent à haïr (musulman, noir, homosexuel), il se trouve qu’une des fleurs qui se déploie le plus aisément en nos contrées et qui dégage le parfum le plus envahissant, est la fleur de l’antisémitisme. Je l’ai observée partout où j’ai vécu. Au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord. Un instant de distraction et la voilà qui refleurit. Tous les clichés qui incombent à cette détestation sont au fond de nous. Il est si aisé de détester le Juif. C’est un peuple d’une commodité extraordinaire. Tout est de sa faute. Maux passés, maux présents, et même maux futurs, il est x dans l’équation de nos frustrations, l’inconnue qui s’accorde comme on veut à nos haines. A l’heure où les images de Gaza nous parviennent dans toute leur violence, où les morts se comptent par milliers, à l’heure où la colonisation de la Cisjordanie se poursuit, que des volontés inhumaines issues du pire de l’extrême droite ont droit de parole dans un gouvernement israélien ouvertement raciste et pour qui la brutalité militaire est la seule réponse possible, à l’heure où des forces d’une obscurité folle travaillent des deux côtés pour empêcher le moindre espoir, où les empathies vont vers les civils palestiniens mais où la mémoire des victimes israéliennes du 7 octobre est en train de se diluer et que les otages ne sont plus, pour l’opinion publique, qu’un détail secondaire, il est vital de voir le piège dans lequel nous jette le Hamas en nourrissant et abreuvant la plante de la détestation faisant fleurir partout l’antisémitisme. Deux mille ans d’un christianisme dont une partie de la propagande consistait à répéter que les Juifs ont assassiné le Christ nous ont formatés pour en être une terre fertile. Cela l’Europe le sait bien. Jamais la fleur de l’antisémitisme n’aura été si bien nourrie Ce qui se passe à Gaza est monstrueux. Il faut que les bombardements cessent, que les morts cessent, que les otages soient libérés. Il faut trouver comment faire pour que le Hamas ne puisse pas recommencer son ouvrage de destruction, lui qui n’a de cesse d’affirmer qu’il recommencera. Il faut trouver une autre voie à la justice qui ne soit pas celle de la destruction dont les Palestiniens depuis si longtemps paient un effroyable prix. Il faut que le gouvernement israélien accepte de s’intégrer en intégrant les Palestiniens et les pays arabes dans cette bataille contre le Hamas et qu’il cesse de croire qu’Israël seul contre tous peut assurer sa survie. Mais pour que tout cela advienne je n’ai, pour ma part, que des vœux. Par contre, je sais que jamais la fleur de l’antisémitisme n’aura été si bien nourrie, si bien arrosée par les images qui nous proviennent d’Israël et de Gaza, jamais depuis longtemps elle n’aura été aussi opulente. L’islamophobie gronde partout en France et c’est une lèpre aussi dévastatrice que l’est toute forme de détestation. Un constat pourtant s’impose. Bien des personnes à qui l’ont dit «antisémitisme» répondent avec raison «oui, mais il ne faut pas faire l’impasse de l’islamophobie», et ils ont absolument raison. Mais lorsqu’on dit «islamophobie», la plupart d’entre nous qui ne sommes pas juifs n’avons pas le réflexe de dire «oui, mais il ne faut pas faire l’impasse de l’antisémitisme». Cette petite différence est un des symptômes du danger qui nous guette. Je dois, à la lecture de l’actualité de chaque jour, ériger en moi des digues de plus en plus hautes pour empêcher le débordement du marécage. Or c’est précisément là que se trouve le piège tendu depuis le 7 octobre par l’esprit destructeur du Hamas : faire en sorte que l’après soit avant tout antisémite. Que l’après soit un tombeau pour tout Juif où qu’il se trouve. Que l’après soit un temps où chaque Juif vive dans l’effroi, terrorisé, viscéralement méfiant envers le monde. Que l’après soit une autre forme de diaspora. Que l’après soit synonyme d’exil pour tout Juif. C’est contre ce piège que nous devons lutter, chacun. A cet endroit il est possible d’agir : prendre conscience de ce que la situation tente de faire de moi, lutter contre elle, faire en sorte que le marécage ne déborde pas et par tous les moyens assécher la plante de la détestation pour espérer que les prochaines générations, sans doute encore lointaines, parviennent un jour à couper le fil macabre de sa transmission.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2024 4:03 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama - 10 avril 2024 TTT Très Bien L’autrice Claudine Galea et la metteuse en scène Laëtitia Guédon revisitent le mythe. Face à trois femmes qui l’ont affronté, aimé – Hécube, Calypso, Pénélope – on découvre un Ulysse tiraillé entre doutes, désirs, envies de fuite et de retour. Jusqu’au 8 mai au théâtre du Vieux-Colombier.
C'est un spectacle-poème, un spectacle-rituel comme on n’en voit peu. Comme peu d’artistes ont le courage d’en rêver, d’en écrire, d’en mettre en scène en nos temps où l’emportent les obsessions et angoisses quotidiennes. Sauf que les mythes disent autant nos tourments que la photographie théâtralisée de nos existences actuelles. Depuis longtemps passionnée par ces légendes visionnaires, Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux sauvages à Paris, a l’habitude de commander à des dramaturges des pièces qui s’en inspirent. Ayant déjà travaillé sur la guerre de Troie (Troyennes. Les morts se moquent des beaux enterrements, en 2014), cité rayée de la carte par les Grecs sous prétexte d’y récupérer la belle Hélène, elle a ainsi demandé à Claudine Galéa, un texte sur Ulysse, tiré d’Homère. Et c’est merveille de redécouvrir grâce à la belle autrice féministe, un modèle masculin qu’on a tant dit « rusé, ingénieux, sagace, divin, unique, brillant, vaillant, avisé, subtil et à la langue de miel », et qui se révèle ici face à trois femmes qui l’ont affronté, aimé — Hécube, Calypso, Pénélope — dans toute sa violence forcenée comme sa vulnérabilité, son désarroi comme sa solitude. Sur le sable pâle qui couvre la scène, le blanc squelette d’une énorme tête de cheval. Symbole de l’immense statue de bois laissée aux Troyens sur la plage par les Grecs faisant mine de s’enfuir après dix ans à assiéger la ville. Une ruse d’Ulysse : la statue est pleine de guerriers qui ravageront Troie dès qu’elle y sera emportée. Et sur le plateau, le crâne bougera selon les trois femmes confrontées à Ulysse dans une langue à la fois archaïque et pleinement actuelle, brutale et douce, incantatoire et guerrière. Derrière le squelette, un immense écran vidéo, comme un tableau aux couleurs changeantes et lancinantes : Laëtitia Guédon est fille du peintre martiniquais Henri Guédon (1944-2006). Un héros clé de notre humanité Tout au long du spectacle, se promènera encore de la salle à la scène le chœur chanté d’Unikanti, pour accompagner la tragédie. Ou plutôt la révéler. Car Hécube (Clotilde de Bayser, impressionnante de puissance meurtrie), Calypso (la spectaculaire Séphora Pondi, éclatante de sensualité), Pénélope (la lumineuse Marie Oppert) vont ici rendre Ulysse à sa vérité trop souvent tronquée. Face à celle qui lui a été donnée en butin comme esclave, Hécube, épouse aux dix-neuf enfants du roi de Troie Priam (la plupart massacrés par les Grecs), le premier Ulysse (Sefa Yeboah, étonnant tragédien) prend conscience de sa rage destructrice et combien l’instinct de mort, la mort même lui sont intimes. Face à l’amante Calypso qui aura su le retenir amoureusement sept ans avant de le laisser repartir, le second Ulysse (Baptiste Chabauty) endure le doute, l’angoisse de la séparation, le questionnement sur le retour, l’amour. Face à Pénélope, enfin, celle qui l’aura attendu vingt ans et sur laquelle, justement, le temps n’a plus de prise, le troisième Ulysse (Éric Génovèse, bouleversant) découvre l’énigme d’une existence : « qu’est ce que nos yeux nous empêchent de voir ? / qu’est-ce que nos paroles remplacent ? / as-tu remarqué : / dans l’obscurité le silence est plus vaste / le repos plus grand », lui murmure l’épouse. Prélude à une vie nouvelle, à la mort ? « Marchons », ainsi Pénélope conclut-elle cette épique traversée, où l’on aura avec beauté redécouvert un héros clé de notre humanité, de ceux qui ont forgé des millions de petits hommes après lui. Au travers de ses femmes délaissées ou maltraitées, Claudine Galea interroge majestueusement la masculinité. Non sans compassion et tendresse pour cet Ulysse ballotté entre doutes, désirs, envies de fuite et de retour, toujours en quête de femmes protectrices que raconte vaillamment Laëtitia Guédon. Sacrée et dérangeante odyssée… Fabienne PASCAUD - Télérama
Le texte est publié aux Éditions espaces 34. 13,50 euros.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2024 3:58 PM
|
Par Nathalie Simon dans Le Figaro - 8 avril 2024 L'écrivain Claudine Galea et la metteuse en scène Laëtitia Guédon revisitent L'Odyssée d'Homère à travers un oratorio.
Le plateau du Vieux-Colombier est dans la pénombre. Se détache un crâne de cheval monumental avec les silhouettes blanchâtres de ses oreilles dressées. Incendiée, saccagée, Troie est tombée. Une mélopée lancinante et la voix de Clotilde de Bayser fait entendre la parole d'Hécube, qui a vu périr ses enfants et est donnée en « cadeau » à Ulysse. Martyre involontaire, elle harangue « cet ennemi du vrai, cette vipère sans loi ». « Pourquoi ne peux-tu pas te passer de moi ? », lui demande-t-elle. Mobile, le décor est retourné par le Chœur Unikanti (issu de la Maîtrise des Hauts-de-Seine), et révèle alors la grotte, sanctuaire de la déesse Calypso (Séphora Pondi en robe bleue), qui propose à Ulysse de « sortir du temps ». Suite à l'injonction d'Hermès, les larmes aux yeux, l'amante du héros grec l'autorise à la quitter après sept ans de vie commune. Enfin, le guerrier sanglant revient à Ithaque et retrouve sa femme, Pénélope (la blonde chanteuse Marie Oppert). Elle l'a attendu sans prendre une ride, mais reste d'abord muette. Dans le très exigeant Trois fois Ulysse (Éditions Espaces 34, représenté par L'Arche), Claudine Galea rend hommage aux femmes de L'Iliade et de L'Odyssée d'Homère. Elle redessine une image du personnage qui n'a rien à voir avec le « héros sans peur et sans reproche » des manuels scolaires. Joué successivement avec ferveur par Sefa Yeboah, Baptiste Chabauty et Éric Génovèse, l'amant, époux et le combattant est tour à tour violent, hargneux, fougueux et amoureux, faillible, voire « en dépression ». « L'art, c'est la beauté quoi qu'on dise. Violence et désordre, mais beauté », assure l'auteur. Il y a tout cela dans ce spectacle plein de soufre, où la cruauté des cœurs le dispute à un infime espoir. Pénélope finit par s'exprimer. Les rôles s'inversent. L'homme dépend de la femme qu'il a cru soumise. Précision et raffinement Claudine Galea a travaillé en accord avec Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux sauvages, à Paris, qui signe sa première pièce dans la maison de Molière. Cette dernière illustre les intentions de sa consœur à travers une mise en scène d'une précision chirurgicale dans une scénographie d'un raffinement extrême (sur un panneau défilent des soleils rougeoyants et des vagues sombres). Trois séquences immortalisent le destin de trois couples qui, en l'absence des dieux, prennent leurs responsabilités, surtout les femmes. Les acteurs de la Comédie-Française prouvent, s'il en est besoin, qu'aucun registre ne leur résiste et qu'ils savent donner de la voix à tous les sens du mot. Alliant théâtre, musique et vidéo, le texte de Claudine Galea se déploie en majesté avec le risque que la forme prenne le pas sur le fond. Impossible d'être attentif tout du long de cet oratorio où les sentiments humains sont transcendés par la présence du Chœur Unikanti qui déclame aussi bien des chants du XIIe siècle, de l'araméen ou un Tri martolod. Beau comme l'antique ! Nathalie Simon / LE FIGARO Trois fois Ulysse, au Théâtre du Vieux-Colombier (Paris 6e), jusqu'au 8 mai. Rés. : 01 44 39 87 00. www.comedie-francaise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 5:16 PM
|
Publié par Le Monde avec AFP le 8 avril 2024 La police croate a ouvert une enquête après les aveux du réalisateur de 49 ans, qui a souvent utilisé ses films pour faire la critique de la culture patriarcale et des violences faites aux femmes. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/04/08/prime-au-festival-de-cannes-dalibor-matanic-celebre-realisateur-croate-avoue-plusieurs-agressions-sexuelles_6226678_3210.html
L’un des réalisateurs les plus célèbres de Croatie, Dalibor Matanic, 49 ans, a avoué dans un long post sur Facebook, après la publication de plusieurs articles de presse, avoir agressé sexuellement plusieurs femmes, déclenchant un tonnerre de réactions. La police croate a ouvert une enquête. « Tout ça a eu lieu à des moments où j’étais sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Notre travail est terriblement stressant – mais cela ne justifie certainement pas mon comportement », a-t-il écrit, après la parution d’articles de presse faisant notamment état de gestes et d’invitations déplacés et d’envois de photos et de messages à caractère sexuel. Environ deux cents femmes seraient concernées par les agissements du réalisateur, qui a annoncé qu’il allait entrer dans un centre de désintoxication. « D’après les informations publiées dans la presse, il pourrait s’agir d’actes criminels », a déclaré le responsable de la police, Antonio Gerovac, cité par l’agence de presse officielle HINA, annonçant l’ouverture d’une enquête. Jusqu’à présent, la police n’a enregistré aucune plainte, a-t-il ajouté. « Il se présentait comme un allié » Par ailleurs, l’Académie des arts dramatiques de Zagreb, où M. Matanic donnait occasionnellement des cours, a annoncé que leur coopération avait « pris fin à la fin du semestre d’hiver » et qu’elle ne serait pas renouvelée. Le réalisateur, primé à Cannes en 2015 pour son film Soleil de plomb (Prix du jury Un certain regard), a souvent utilisé ses films pour faire la critique de la culture patriarcale et des violences faites aux femmes. « C’est un choc terrible, car il se présentait comme un allié », a réagi la militante des droits des femmes Sanja Sarnavka. La violence et les agressions sexuelles ont longtemps été considérées comme des sujets tabous dans les Balkans, où les valeurs patriarcales restent très ancrées. Ces questions ont cependant pris davantage d’importance ces dernières années après l’avènement du mouvement #metoo et une affaire en Serbie voisine où une actrice a accusé son ancien professeur d’art dramatique, Miroslav Aleksic, de viol, ce qui a incité des milliers de femmes à raconter leur propre histoire. Le Monde avec AFP --------------------------------------------- Violences sexuelles #MeToo cinéma : le réalisateur Philippe Lioret accusé par dix comédiennes d’agressions sexuelles et «d’abus de pouvoir» Radio France a recueilli le témoignage de dix actrices dénonçant le comportement «inapproprié» du cinéaste, en particulier lors des castings pour son film «Toutes nos envies», en 2010. par LIBERATION La chape de silence entourant le cinéma français se fend-elle, pas à pas ? Ce mardi 9 avril, c’est un nouveau réalisateur qui est mis en cause, après les cas Doillon et Jacquot en début d’année. Pas moins de dix comédiennes dénoncent auprès de la cellule investigation de Radio France le comportement de Philippe Lioret, mêlant baisers forcés, gestes et demandes inappropriés. C’est en particulier le casting de son film Toutes nos envies, inspiré du roman D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, qui est pointé. En été 2010, le cinéaste, auréolé des succès Je vais bien ne t’en fais pas et Welcome, effectue des castings avec le Tout-Paris. «Une cinquantaine d’actrices», reconnaît-il auprès de Radio France, dont Judith Godrèche, Emma de Caunes, Mélanie Bernier, Cécile Cassel, Laetitia Casta, Virginie Efira ou encore Marie Gillain, auditionnées pour le rôle de Claire, magistrate en couple avec Stéphane (joué par Vincent Lindon) et Céline, une mère surendettée. Les témoignages recueillis par Radio France font état d’un même procédé, Lioret donnant rendez-vous pour une séance de travail, parfois le samedi alors que les bureaux de production sont fermés, et choisissant une scène intime dans laquelle il donne la réplique à l’actrice auditionnée. «Je me dis : “Pourquoi ce choix de scène ? Il est le réalisateur, pas l’acteur avec lequel je jouerai.” C’est gênant, relate Hélène Seuzaret, l’une des actrices qui témoignent, avec Elodie Frenck, Emilie Deville, Marie Gillain, Amandine Dewasmes et d’autres qui ont préféré garder l’anonymat. Une fois dehors, alors qu’on retourne à nos véhicules respectifs, [Philippe Lioret] essaye de m’embrasser sur la bouche. Ce n’est pas du tout ce dont j’avais envie. C’est comme un abus de pouvoir : il se permet, parce que je suis en attente de ce rôle, de me voler un baiser.» «Avec le recul, je pense que c’est une agression sexuelle» Une comédienne, anonyme, ayant vécu la même chose dans les années 90, raconte : «C’est humiliant de se faire embrasser violemment comme ça. D’où a-t-il le droit de m’embrasser sans que j’aie donné mon consentement ? D’où a-t-il le droit de me traiter comme ça, de manière brutale ? A cette époque, je ne me disais pas que c’était une agression sexuelle. Mais aujourd’hui, avec le recul, je pense que c’en est une.» C’est le cas aussi d’une autre actrice, embrassée sur la bouche par surprise après un dîner vécu comme un «piège», en marge des auditions de Toutes nos envies : «Il voulait sans doute savoir si j’étais ‘‘souple’’, si j’étais prête à ça pour avoir un rôle, raconte l’actrice. J’ai été utilisée à cette fin de pouvoir me consommer. Voilà comment je l’ai vécu. Il n’y avait rien d’artistique là-dedans.» La comédienne Emilie Deville, elle, parle «d’abus de pouvoir». Elle raconte, lors d’un essai pour ce même film, le choix d’une scène entre une mère et son enfant. «[Philippe Lioret] fait l’enfant de 6 ans, il se met à genoux et il attrape mes hanches. Il colle son visage sur mon sexe en disant : “Maman !” Il me demande de caresser ses cheveux, de consoler le soi-disant enfant que j’ai entre les jambes, lui qui à l’époque avait 53 ans !» Certaines comédiennes, relate Radio France, affirment que le réalisateur leur aurait demandé de «montrer leurs seins». L’assistante de la directrice de casting témoigne également que le cinéaste «ne se privait pas de toucher la naissance des seins, de se mettre dans le cou des comédiennes. Les actrices étaient tellement mal à l’aise dans les bras de Philippe de se faire tripoter comme ça». «Je n’ai jamais eu la sensation d’essayer d’abuser de qui que ce soit de toute ma vie», s’est défendu Philippe Lioret, interrogé sur ces témoignages. «Qu’il ait pu tenter de séduire, ça, c’est tout à fait possible. Mais il s’est toujours arrêté dès lors qu’il s’est trouvé face à un refus», a réagi son avocate, Solange Doumic.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 3:13 PM
|
Article publié sur le site d'Artcena - 2 avril 2024 RAPPORT
Son rapport déplore principalement que le pilotage des Programmes d’investissements d’avenir et de France 2030 ait contribué à dessaisir le ministère de la Culture de ses missions stratégiques. Le 20 mars 2024, la Cour des comptes a publié un rapport – fruit d’une enquête diligentée par la Commission des finances du Sénat – sur les plus de 3 Md€ de crédits exceptionnels engagés de 2017 à 2023 en faveur du secteur culturel, hors budget du ministère de la Culture ; soit « presque l’équivalent, est-il précisé, d’une année des crédits de la mission Culture de ce ministère ». Cette enveloppe concernait, d’une part le Plan de relance (1,6 Md€), et d’autre part les Programmes d’investissements d’avenir (PIA 1 et 3) et France 2030, à hauteur d’1,5 Md€ au total. Un plan de relance élaboré dans la précipitation Annoncé à l’été 2020, au sortir de la crise sanitaire, le Plan de relance a été doté d’1,6 Md€ pour la culture (pour un peu plus d’1,4 Md€ de dépenses), afin de poursuivre deux objectifs : soutenir les revenus du secteur culturel, et favoriser « une accélération des transformations structurelles identifiées comme nécessaires ». Si le premier a été rempli, il en va différemment du second, traité de façon marginale. En cause, selon la Cour des comptes, un objectif « trop ambitieux dans le cadre d’une action conjoncturelle » et un plan élaboré « dans la précipitation ». Celle-ci critique, entre outre, une répartition des crédits « très hétérogène entre secteurs culturels » et l’utilisation d’une partie d’entre eux « pour boucler les plans de financement de grands travaux d’établissements publics ». Le rapport conclut ainsi à « un pilotage par la dépense, parfois au détriment des objectifs de politique publique », qui a, par ailleurs, produit « un effet inflationniste dans certains secteurs ». PIA : des opérations trop risquées Concernant cette fois les PIA 1 et 3, la Cour estime que ceux-ci « ont faiblement investi le champ culturel et celui des industries culturelles et créatives ». Elle en veut pour preuve le fait que depuis 2017, seuls 278 M€ ont été consommés à ce titre, dont 190 M€ transférés au budget de la culture afin de financer deux grandes opérations patrimoniales (Villers-Cotterêts et le Grand Palais). Le rapport admet toutefois que plusieurs projets culturels emblématiques (le Grand Palais immersif et la Philharmonie des enfants) portés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Bpifrance ont eu « une réelle portée en termes d’expérimentation et d’innovation ». De même, le soutien apporté à l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), « qui dispose d’une excellence connaissance des entreprises culturelles et de liens anciens avec les financeurs de la place, apparaît cohérent avec l’ambition des PIA et économe des finances publiques ». La Cour se montre, en revanche, plus critique sur les financements attribués à « des entreprises au modèle économique fragile » et qui ont traversé depuis de « graves difficultés ». Pour évoquer « une prise de risque particulièrement élevée », elle cite l’appel à manifestation d’intérêt « Culture, patrimoine, numérique » lancé par la Caisse des dépôts et consignations, qui « a connu un taux de sinistralité de 35%, bien supérieur à celui admis en général par la CDC ou Bpifrance », entraînant la disparition de l’argent public investi. De plus, le rapport note que les projets financés « relèvent parfois d’une conception très extensive des industries culturelles et créatives ou n’en font pas clairement partie », « voire relèvent d’un champ spéculatif ». D’où ce constat sans appel : « ces premières expériences d’investissement dans le secteur culturel ont souffert d’une absence de stratégie formalisée avec le ministère de la Culture comme de réflexion sur les outils mobilisés, sur la typologie des projets structurants et sur les effets d’accélération recherchés ». La stratégie peu lisible de France 2030 De semblables griefs sont adressés à France 2030, alors même que ce programme a bénéficié de « moyens considérables » : 400 M€ engagés fin 2020 dans le cadre du PIA 4, puis 600 M€ à l’automne 2020 destinés aux industries de l’image et du numérique dans le cadre de France 2030. Les deux étant rattachés fin 2022, le volet culturel de France 2030 a disposé au total d’1 Md€. Grande lourdeur des processus décisionnels, éparpillement de l’information rendant complexe un suivi rigoureux, et surtout manque de transparence constituent de nouveaux reproches adressés par la Cour. « Ni la stratégie d’accélération, issue des États généraux des industries culturelles et créatives (..) ni même la liste des 19 mesures retenues n’ont été rendues publiques », regrette-t-elle, avant de remettre en cause la pertinence même du programme. « Les mutations structurelles du secteur culturel peuvent justifier un accompagnement par l’État. Les plans d’investissements d’avenir apparaissent cependant globalement inadaptés au secteur. En effet, ils sont insuffisamment articulés aux objectifs et enjeux de la politique publique », estime-t-elle. Le ministère de la Culture privé de ses missions Enfin, plusieurs dérives sont imputables, selon le rapport de la Cour des comptes, aux PIA : « mise en œuvre rapide d’appels à concurrence » susceptible de créer « des effets d’aubaine » ; effacement progressif de « la logique originelle des PIA consistant à utiliser des avances remboursables ou à co-investir pour inciter le secteur privé à s’engager », au profit d’une « logique de subvention ». « Dès lors, ajoute le rapport, la Caisse des dépôts et BpiFrance se retrouvent dans la situation paradoxale de verser, très majoritairement dans ce secteur, des subventions, une mission qui incombe en principe au ministère de la Culture ». Plus globalement, la Cour déplore que « le pilotage des PIA et de France 2030 par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) contribue à dessaisir le ministère de la Culture de ses missions de pilotage stratégique, d’allocation des financements et de contrôle sur l’équivalent d’une part significative de son budget annuel ». À ses yeux en effet, bien qu’à l’origine de la conception de la stratégie (rédaction du cahier des charges), le ministère de la Culture siège souvent uniquement comme observateur au sein des comités désignant les lauréats, ce qui l’empêche d’être « pleinement en situation de garantir la cohérence de ces financements conséquents avec les objectifs de la politique culturelle ». « Si l’on ne veut pas courir le risque de priver durablement le ministère des moyens de remplir ses missions, celui-ci doit reprendre le pilotage des dispositifs initiés dans le cadre de France 2030, et en renforcer significativement le suivi », assure la Cour. En conclusion, elle formule sept recommandations : 1. Avant toute nouvelle consommation de crédits, procéder à une évaluation indépendante du dispositif « Mondes Nouveaux », notamment du point de vue de la rémunération des artistes et de l’articulation avec les dispositifs et institutions préexistants.
2. Définir de façon concertée les objectifs poursuivis par les investissements d’avenir et délimiter plus nettement le périmètre d’intervention des PIA dans le secteur des industries culturelles et créatives.
3. Veiller à une articulation lisible entre l’architecture budgétaire et la stratégie de France 2030, pour le volet culture.
4. Appliquer strictement la doctrine des investissements d’avenir et réserver les financements des PIA à des projets répondant à des critères d’innovation préétablis.
5. Instaurer une procédure de suivi et d’évaluation des crédits des PIA et de France 2030 robuste, afin de permettre le contrôle parlementaire.
6. Prévoir une procédure explicite de restitution ou de réallocation des crédits exceptionnels non utilisés.
7. Dans les processus décisionnels de France 2030 accorder dès à présent au ministère de la Culture une place lui permettant d’assurer son rôle de chef de file de la politique culturelle. « Un rapport à charge », selon Bruno Bonnell Lors de leur audition devant la Commission des finances du Sénat, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles, et Sophie Zeller, cheffe du service du spectacle vivant et adjointe au directeur général de la création artistique, ont réagi à différents points soulevés par la Cour des comptes. Bruno Bonnell a tout d’abord réfuté le titre du rapport qui évoque des « crédits exceptionnels » attribués à la culture et aux industries créatives (ICC). « Ces crédits n’ont rien d’exceptionnels puisqu’il s’agit de crédits d’investissement votés par le Parlement comportant, dans le cadre de France 2030, un volet spécifique d’investissement destiné à soutenir les industries culturelles et créatives », a-t-il indiqué. Concernant France 2030, le secrétaire général pour l’investissement a dénoncé « un rapport à charge et, de plus, inexact », assurant que le ministère de la Culture était associé à toutes les stratégies et décisions et présidait le comité de pilotage qui alloue les budgets. Le manque de transparence lui apparaît, de même, un reproche infondé. « Nos stratégies sont rendues publiques sur les sites web du gouvernement, a-t-il affirmé. Nous avons également communiqué un rapport au Parlement, et effectuons un reporting permanent auprès d’un Comité de surveillance des investissements d’avenir (CSIA) composé notamment de quatre députés et de quatre sénateurs. Je ne peux donc accepter l’idée que nous ne soyons pas précis dans le suivi. » Florence Philbert, quant à elle, a rappelé que s’agissant des industries culturelles et créatives, « nous sommes au croisement de la politique culturelle et de la politique industrielle, mais aussi au croisement des financements publics et des financements privés », les ICC souffrant d’une « faible structuration capitalistique », notamment en matière de fonds propres. Ce constat justifie « une logique de continuum de financements » : « au-delà des financements via des subventions, assurés par le ministère de la Culture, il s’agit de voir comment la puissance publique peut faire en sorte que les acteurs des ICC soient financés par le secteur privé », a expliqué la directrice générale des médias et des industries culturelles. Interrogée, par ailleurs, sur la recommandation n°7 formulée par la Cour des comptes, elle a répondu : « cette politique ne peut être uniquement centrée sur le ministère de la Culture ; elle se fait en partenariat avec le ministère qui la conçoit et définit la stratégie ». Sophie Zeller enfin a concentré son intervention sur « Mondes nouveaux », dispositif doté de 30 M€. « Celui-ci a suscité un très grand élan créateur : 3 200 projets déposés, et 264 soutenus, portés par 430 artistes. Une rémunération directe d’un peu moins de 6 M€ a été versée aux artistes, à laquelle il faut ajouter les retombées en termes de présentation ou de vente des œuvres, ou de droits d’auteurs », a-t-elle souligné. La cheffe du service du spectacle vivant et adjointe au directeur général de la création artistique a cependant convenu du manque de visibilité de « Mondes nouveaux » pointé par la Cour, qu’elle a justifié par les différences de temporalité de réalisation des œuvres ainsi que leur répartition sur l’ensemble des territoires, « qui ont pu complexifier les opérations de communication ». « Afin de redonner de la visibilité au programme, nous avons mis en place en avril 2023 une présentation des projets à l’École nationale des Beaux-Arts », a ajouté Sophie Zeller, promettant, lors du lancement d’un nouvel appel à projets fin 2024, la mise en œuvre de « liens plus étroits entre les Frac et les Centres d’art, et l’ensemble de l’écosystème ».

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 8:07 AM
|
Article de Gilles Costaz dans Webthéâtre - 8 avril 2024 Une grande figure du théâtre parisien vient de nous quitter. Renée Delmas, qui dirigea le Poche-Montparnasse avec Etienne Bierry, vient de mourir à la Résidence retraite du cinéma et du spectacle, à Vigneux, le jour même de ses 94 ans. Après de bonnes études, elle avait pensé suivre la voie de la médecine mais, suivant des conseils d’amis, elle avait tenté sa chance comme comédienne. Interprétant un petit rôle au théâtre de Poche après quelques années de formation, elle avait appris que la salle où elle jouait était à vendre. Son père, commerçant et inventeur, la lui offrit. Elle requit le concours d’un comédien très brillant, Etienne Bierry, très connu à la radio. C’est ainsi qu’un couple se forma puis une famille : Marion et Stéphane naquirent et devinrent des acteurs qui commencèrent au Poche avant de jouer avec succès dans d’autres réseaux (ils dirigent actuellement le Girasol à Avignon). Le duo fonctionna merveilleusement sans renoncer à la politique des risques. Ils montèrent surtout les auteurs novateurs de leur temps : Ionesco, Eduardo Manet, Billetdoux, Dubillard, Weingarten (L’Eté fut un triomphe historique avant et après 1968), Duras, Orton, Horovitz, Robert Poudérou, Gérald Aubert, Daniel Delabesse, Charles-Louis Sirjaq, Sergei Bebel… Ils s’intéressèrent plus rarement aux classiques mais Marion Bierry en mit en scène quelques-uns selon son style très subtil – d’ailleurs, alors même que le Poche n’appartient plus à sa famille, elle y a récemment monté, à l’invitation de Philippe Tesson, un Menteur de Corneille tout à fait éblouissant, où joue le dernier-né de la dynastie, Alexandre Bierry.
Renée Delmas était la responsable du Poche (qu’elle rebaptisa Poche-Montparnasse) côté affaires. Etienne Bierry gardait la main du point de vue de l’artistique. Il ne s’attribuait pas tous les rôles. S’il jouait et mettait en scène – très brillamment -, il accueillait avec amitié et curiosité de jeunes auteurs et de nouvelles équipes. Le couple Delmas-Bierry, intégré au système du théâtre privé (Renée Delmas développa beaucoup le principe du Fonds de soutien) mais aidé par le ministère de la Culture, fit des étincelles pendant cinquante ans, en cherchant essentiellement à monter des spectacles inédits. Agés, fatigués, héroïques, ils vendirent le théâtre à Philippe et Stéphanie Tesson en 2011.
Renée Delmas fut une grande directrice, sachant s’aventurer entre le goût traditionnel du public et l’insolite des poètes audacieux. Elle tenait fermement le bateau, à son bureau comme au contrôle dans l’étroit hall du théâtre. Elle s’entretenait avec franchise avec auteurs, acteurs et spectateurs. Elle racontait que Ionesco l’appelait tous les jours quand l’une de ses pièces était représentée là, moins pour savoir ce qu’il allait toucher que pour vérifier que le public aimait encore ses pièces. Elle s’en est allée, riche de tant de secrets.
Photo Laurencine Lot : le trentième anniversaire du Poche, 1986, de gauche à droite, Marion Bierry, Stéphane Bierry, Renée Delmas, Etienne Bierry.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2024 8:48 AM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 5 avril 2024
Le spectacle jeune public, mis en scène par Olivier Letellier à partir d’un texte de Rodrigue Norman, est servi par l’interprétation tout en sensibilité du comédien Alexandre Prince.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/05/venavi-un-conte-initiatique-pour-parler-de-la-mort-aux-enfants-sans-tabou_6226193_3246.html
Le Lavoir moderne parisien (LMP), en plein cœur du quartier de la Goutte-d’Or, à Paris, s’est de nouveau associé aux Tréteaux de France et au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines pour la deuxième édition du festival Le Lavoir en famille, qui se tient jusqu’au 14 avril. L’occasion pour parents et enfants de découvrir ensemble, en cette période de vacances scolaires, trois spectacles, dont deux créations. Le premier des trois à être présenté est Venavi (ou pourquoi ma sœur ne va pas bien), créé en 2011. Olivier Letellier, directeur des Tréteaux de France depuis juillet 2022, spécialisé dans le théâtre pour la jeunesse, a travaillé avec deux auteurs, Rodrigue Norman et Catherine Verlaguet – cette dernière a déjà adapté plusieurs textes pour ses mises en scène, notamment Oh, boy !, d’après un roman de Marie-Aude Murail, récompensé en 2010 par le Molière du spectacle jeune public et recréé avec succès à Broadway, en 2017. Pour Venavi, Rodrigue Norman s’est inspiré d’une croyance encore très présente dans son pays, le Togo. Les jumeaux y sont vénérés comme des dieux. Lorsque, par malheur, l’un des deux enfants meurt, il faut fabriquer au plus vite une statuette à l’effigie du défunt, le « venavi », et l’offrir au survivant pour qu’il ne soit pas tenté de rejoindre l’autre dans la mort. C’est l’histoire tragique qui arrive à Akouété et à Akouélé. Le garçon, Akouété, est emporté par une mauvaise fièvre dès ses 6 ans, laissant sa sœur, Akouélé, seule face au deuil et à l’absence. Mais, plutôt que de dire la vérité à Akouélé et de lui donner le « venavi » en bois représentant son frère, les adultes du village, ses parents les premiers, ont préféré lui mentir et lui raconter que son jumeau est parti dans la forêt pour couper du bois. Alors Akouélé décide d’attendre son retour et, pendant des années, coincée dans son corps d’enfant, elle refuse de grandir sans son frère. Objets astucieusement manipulés Pour raconter l’histoire de cette fillette qui apporte deux assiettes quand on ne lui en demande qu’une et qui redouble cinq fois de suite son CP à l’école pour attendre son jumeau, l’auteur a choisi de se placer du point de vue d’Akouété : c’est de sa bouche que l’on apprend les mésaventures de sa sœur. Le comédien Alexandre Prince, dont la famille est originaire du Togo, et qui a un frère jumeau, incarne avec finesse et sensibilité le jeune narrateur. Il donne également vie à toute une galerie d’autres personnages, notamment les parents d’Akouélé et Akouété, mais aussi les villageois, l’institutrice de l’école, etc. Et ce, grâce à un simple changement de voix, à une gestuelle différente ou à l’aide de quelques objets astucieusement manipulés et dotés parfois d’une simple paire d’yeux : une anodine paire de chaussures à talons, un banal morceau de bois retourné… Les rares éléments de décor se transforment ainsi, au fil du spectacle, en personnages, en arbres, en bancs d’école, en maisons, en cercueils… L’interprétation d’Alexandre Prince constitue indéniablement l’une des clés de la réussite de ce récit initiatique sur un sujet souvent tabou, la mort – et a fortiori celle d’un enfant. Venavi est la parfaite illustration que l’on peut parler de tout au jeune public, même des thèmes les plus graves, à condition de savoir le faire avec intelligence et subtilité, en y apportant une nécessaire touche d’humour pour donner, comme l’explique Olivier Letellier dans un entretien recueilli en novembre 2010, « une lueur d’espoir », et « créer des respirations dans l’histoire et rendre le propos plus accessible ». Avec pour objectif de « faire travailler l’imaginaire des spectateurs, petits et grands, et générer des questions à se poser en famille ». Venavi (ou pourquoi ma sœur ne va pas bien), par les Tréteaux de France, Centre dramatique national. Texte : Rodrigue Norman. Adaptation : Catherine Verlaguet. Mise en scène : Olivier Letellier. Scénographie : Sarah Lefèvre. Avec Alexandre Prince. Au Lavoir moderne parisien (LMP), 35, rue Léon, Paris 18e, jusqu’au 13 avril. Dans le cadre du festival Le Lavoir en famille, jusqu’au 14 avril. Cristina Marino / LE MONDE Légende photo : Alexandre Prince dans « Venavi », mis en scène par Olivier Letellier, lors de la reprise du spectacle aux Tréteaux de France, à Aubervilliers, en juin 2020. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2024 7:10 AM
|
Par Faustine Kopiejwski dans Les Inrocks - 2 février 2024 Dans un premier livre sidérant, “Notre silence nous a laissées seules”, l’actrice, comédienne et chanteuse lyrique Judith Chemla livre le récit des violences conjugales qu’elle a subies. Et éclaire les mécanismes les plus sombres de l’âme humaine, ainsi que de la société. Le premier livre de Judith Chemla est un chemin. Un chemin vers la lumière et vers la vie, d’abord, pour celle dont le visage tuméfié s’est affiché sur Instagram un 4 juillet, en 2022, révélant les violences subies un an plus tôt au sein de son couple. Dans Notre silence nous a laissées seules, qui vient de paraître chez Robert Laffont, Judith Chemla raconte : deux relations conjugales consécutives violentes (l’autrice a souhaité anonymiser les protagonistes, qu’elle désigne par “Le Prince” et “Le Loup”), aussi bien physiquement que psychologiquement, qui l’ont vue mourir un peu, avant qu’une sage-femme ne lui annonce, au cours d’un avortement, sa propre (re)“naissance”. L’amour qui n’en est pas, le mécanisme infernal de l’emprise, la sidération, les rechutes, l’aliénation, l’impuissance de la justice, l’incapacité de la société à protéger les mères et les enfants, l’impunité des agresseurs. Mais aussi l’extrême consolation de l’art, la bienveillance qui répare, la sororité qui panse, la maternité qui exige. Au cours de ces trois cents pages, dont le style lyrique du début se dépouille progressivement pour laisser place à la puissance crue des faits, Judith Chemla parcourt également un chemin de la fiction vers la réalité, tout en questionnant sa place de créatrice et de femme dans la société. Le récit d’un éveil féministe et un témoignage puissant, sidérant souvent, qui transcende la matière noire. Vous relatez dans votre livre, parfois de manière très précise, les faits de violence physique et psychologique que vous avez subis. Ces faits, quand avez-vous commencé à les décrire et dans quelle optique ? Judith Chemla – Ceux qui concernent ma première relation violente sont ceux qui m’ont marquée. Il ne s’agit pas d’un inventaire : je ne raconte pas tout. S’ils se sont imprimés comme ça dans ma mémoire, c’est qu’ils m’ont impactée, saisie et, sur le moment, sidérée. Au départ, j’ai voulu continuer ma vie sans m’appesantir sur ces événements, en les transcendant par l’art, la résilience. C’est au cours de la deuxième relation violente que j’ai réalisé que je n’étais pas sortie de ce cercle. Dans la dernière année de calvaire, de harcèlement, j’écrivais quasiment tous les jours pour m’en sortir, pour comprendre. L’écriture était ma seule façon de tracer une ligne entre les événements qui m’accablaient et la vie vers laquelle je tendais, une vie dans laquelle je pourrais enfin respirer. Pour cette seconde partie du livre, j’avais donc beaucoup de notes de faits très précis, plus d’éléments, des photos, des vidéos, des papiers, des audios de scènes terribles que j’ai enregistrées pour me protéger. “Ce trajet-là m’a appris que l’amour, ce n’est pas tout accepter jusqu’à se faire broyer” Chacune de vos deux histoires commence par un faisceau d’avertissements que vous avez ignorés. Certains signaux vous alertaient du danger à vous engager dans ces relations, mais vous l’avez fait quand même. Avec le recul, comprenez-vous pourquoi vous avez muselé votre instinct ? Au début de ma première histoire, mon instinct m’alertait, en effet. Mais j’ai choisi d’aller dans les bois, de faire l’expérience. À l’époque, j’étais très mal informée. Je n’étais pas du tout au fait de la lutte des femmes pour exister à travers l’Histoire. Je croyais complètement au récit de l’égalité des sexes, à ma liberté. Pour moi, elle était acquise. C’est pour cela que c’est si important de savoir d’où l’on vient. Et puis, je me sentais très puissante aussi, comme on se sent avec l’amour. L’amour nous donne beaucoup de force, on est capable de tout. Mais aimer, ça s’apprend. Ce trajet-là m’a appris que l’amour, ce n’est pas tout accepter jusqu’à se faire broyer. Vous écrivez qu’à l’époque de votre première relation, avec celui que vous appelez Le Prince, vous vous sentiez “chanceuse de vivre avec un génie”. Cette admiration pour l’artiste a-t-elle été la condition de votre emprise? Elle l’a été, aussi, car mon émerveillement pour son œuvre était sans borne, mais pas seulement. La culture de l’amour romantique, cette image usée de la femme transie, abandonnée, qui nous est répétée, rabâchée, était très prégnante en moi. J’ai l’impression que c’est structurel, ce fantasme de l’accomplissement à travers l’amour d’un homme, c’est hallucinant à quel point on nous vend le modèle du couple comme réussite sociale. On ne valorise pas le fait d’être une aventurière de sa propre vie : ils sont rares, les modèles de femmes libres ! On en a pourtant plus que jamais besoin aujourd’hui. On a besoin de se construire avec des figures féminines fortes qui ne soient pas forcément déchirées par l’amour ou le manque d’amour. Sinon, pour peu que l’on ait des failles affectives, on n’apprend pas bien à tenir debout par soi-même. C’est tellement puissant ce sentiment amoureux, ça comble tellement, que c’est un vrai piège aussi. Avez-vous adhéré par le passé à ce mythe du génie dont les débordements sont nécessaires à la création ? Non. J’ai toujours su, en ce qui concerne celui que je nomme Le Prince, qu’il n’avait pas besoin de ça pour être génial. J’espérais qu’il comprenne qu’il pouvait être cet artiste fantastique tout en se départissant de ses accès de cruauté, car moi, j’en étais persuadée. Penser que si l’on renonce à nos pulsions destructrices on va perdre quelque chose, vraiment, je n’y crois pas une seconde et il me semble que ça mérite d’être déconstruit de toute urgence, car l’attachement à cette fausse croyance nécrose les artistes. Chez moi, la possibilité de l’emprise s’est ancrée à d’autres endroits, mais pas à celui-là. Vous dénoncez en creux la complicité qui se met en place autour des hommes violents : celle des collaborateur·ices, ami·es, celle des parents. S’agit-il d’un déni généralisé ? En ce qui concerne le milieu professionnel, c’est un réseau complexe car tout le monde voit, mais tout le monde subit. L’écrasement des autres, au fond, personne n’en jouit vraiment. Tout le monde est un peu désolé mais personne ne sait quoi faire. Personne ne se sent le droit de dire que c’est intolérable. Au pire, les gens partent les uns après les autres. Ce sont des choix personnels à chaque endroit. Mais, maintenant, cela tend vers autre chose. Si l’on arrive à s’emparer de ce mouvement, chacun va se sentir autorisé à se dire que même au travail, certaines situations sont intolérables. Le plus grand déni, aujourd’hui, réside pour moi dans les familles et se retrouve dans la société au niveau politique et institututionnel. Sauver ce qui brille et couvrir ce qui est laid. C’est un réflexe de préservation, comme si on allait pouvoir ne retenir que le beau. Mais non, ça fout tout en l’air en fait, de ne pas oser dire que même pour tel grand artiste, ce comportement est intolérable. Que c’est non. Ce déni-là, il crée de la folie, la perpétuation des violences et une société malade, car ce sont des réalités parallèles qui se creusent, une schizophrénie qui se développe. On est obligé de se raconter des histoires dans lesquelles les responsables deviennent les victimes. “C’est une stratégie de survie de l’agresseur. Retourner la culpabilité, nier et attaquer en retour” Dans l’histoire de celui que vous appelez Le Loup, justement, ce motif revient sans cesse : il se fait constamment passer pour la victime… Ça, c’est un sujet majeur. C’est partout et tout le temps. La défense de l’agresseur est ingérée partout, dans tous les recoins de notre société. Nos institutions ont du mal à se départir de cette inversion des responsabilités chère à ceux qui veulent conserver ce pouvoir d’écraser dans l’intimité. Je reçois des témoignages par centaines et quel que soit le milieu social, la culture, c’est un systématisme, un modus operandi. C’est une stratégie de survie de l’agresseur. Retourner la culpabilité, nier et attaquer en retour. Le pire, c’est que ça marche! Ça marche un temps avec les victimes, qui pensent être responsables du mal qu’on leur fait. Elles subissent le dénigrement, l’écrasement de leur dignité, se prennent des coups, mais c’est quand même de leur faute. Et ensuite, si elles osent dénoncer, la pauvre victime devient celui qui va en garde à vue, qui est jugé, qui est mis en lumière publiquement. Mais on n’aurait pas à mettre publiquement en lumière les agresseurs si la justice pouvait vraiment faire son travail. Si les tribunaux n’étaient pas surchargés, si 80 % des plaintes n’étaient pas classées sans suite, si la chaîne pénale était mieux formée à ces violences de l’intime, il n’y aurait pas de “tribunal médiatique”. On pourrait enfin vivre notre vie tranquille. On pourrait enfin “parler d’autre chose”, comme le dit Lola Lafon. En 2017, année de #MeToo, vous avez déjà vécu une première relation violente et vous mettez votre fille au monde. Dans votre livre, le mouvement ne résonne que comme un écho lointain. Comment l’avez-vous vécu au départ ? C’était très loin de moi, en effet. Les personnalités avec lesquelles j’ai vécu m’empêchaient totalement, par leur pensée, d’être une féministe – même si c’était aussi un manque de culture de ma part à l’époque. J’étais conditionnée à “faire la part des choses”, respecter la “présomption d’innocence”, à m’apitoyer sur “les pauvres hommes accusés qui ne pourront plus jamais travailler”. Des années plus tard, je comprends pourquoi. Il y avait une telle peur que ce qui est dans la sphère privée, intolérable, surgisse dans la sphère publique. Désormais, le dénigrement de la pensée féministe est pour moi un red flag total. Votre éveil féministe vous semble-t-il correspondre, cinq ans après #MeToo, à celui de l’ensemble de la société ? Le vieux monde réactionnaire dit sa peur de se voir guillotiné par les féministes radicales mais, si l’on regarde bien, combien d’affaires y a-t-il ? Au-delà de celles qui sont emblématiques, très peu, finalement. Les femmes ont peur, elles préfèrent tout faire pour d’abord réussir leur vie, leur carrière. Personne ne gagne jamais à s’exposer de la sorte. C’est très lourd et cela, les femmes le savent. Dans l’image publique, cela les enferme, les assigne à une place de victime. Personne ne désire cela. Ça ne rapporte pas non plus d’argent, au contraire. Les procédures judiciaires nous saignent, littéralement. On n’a pas les moyens. On le fait par survie, et quand on en a la capacité, mais on est peu à pouvoir aller au bout. Tant vivent encore dans l’injustice, tant sont écrasées, condamnées à survivre dans le danger. Les stigmates des violences subies dans le secret des familles abîment les êtres à vie, et corrompent des générations futures si on garde le silence. Ce qu’il faut bouger, au-delà des consciences, ce sont nos institutions. Et pour l’instant, ça ne bouge pas. Pourquoi, d’après vous ? C’est une question de volonté politique. On a beau dire que c’est la grande cause du quinquennat, ce n’est pas parce que l’on dit quelque chose qu’on l’a fait. Là, ce serait même l’inverse, d’ailleurs : on fait des annonces POUR ne pas faire les choses. C’est complètement schizophrénique. On met en place la CIIVISE (Ndlr : Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) pour ne pas appliquer ses préconisations. On dit qu’on va protéger les enfants pour ne pas le faire. C’est ça, la réalité. Aujourd’hui, il n’y a plus de secrétariat à l’Enfance. Le juge Durand a révélé l’ampleur des dégâts, des failles judiciaires, des dossiers qui sont traités n’importe comment et qu’est-ce qu’on fait ? On le vire, on essaie d’étouffer ses révélations. On ne peut pas vivre dans ce monde-là, dans ce monde à l’envers. On sent que le sujet des violences faites aux enfants vous porte aussi beaucoup, notamment à la fin de votre livre… Oui, beaucoup de femmes qui vivent des violences sont des mères. Et les violents conjugaux ne se transforment pas en pères responsables en un coup de baguette magique. Le titre de votre livre déplore en creux la solitude des femmes victimes de violence, et votre récit rend hommage à toutes celles, victimes ou non, qui vous ont tendu la main. La bienveillance entre femmes est-elle l’une des clefs pour lutter contre les violences patriarcales ? Absolument. Pour moi, c’est l’autre monde que le patriarcat a étouffé. Ce sont nos forces vives et réelles, c’est un tissu différent. C’est la matière du monde non-violent, elle est entre nos mains. On est en train de le créer en se parlant, de le retisser en se reconnaissant, en étant des alliées, en s’écoutant, en se tendant la main, en se rassemblant, en se sentant responsables les unes et les uns des autres. Car, ce qui est très beau aussi, c’est de voir des hommes sensibles à cette nécessaire transformation du monde. Des alliés masculins qui désirent vivre dans le respect. Vous avez vécu des violences visibles et d’autres pas. Les violences psychologiques, invisibles, sont-elles pour vous l’angle mort de la lutte contre les violences conjugales ? Oui, et elles sont souvent pires car on croit que, comme les bleus qui disparaissent, l’esprit se régénère. Moi, j’ai une grande force de résilience et de régénération mais quand on se régénère et qu’on oublie, cela creuse des sillons d’acceptation de plus en plus dangereux. “J’ai repris vie par le fait de formuler des phrases, de chercher le sens, de questionner” Ces sillons sont-ils colmatés aujourd’hui ? Le chemin intellectuel que vous avez parcouru vous protège-t-il ? Oui, écrire m’a permis de retourner sur les lieux, de décoller mon corps encore englué dans ces situations et de remettre de la vie là où il n’y en avait plus, là où j’avais fait silence. De faire retentir un peu ma voix dans ce passé-là. J’ai repris vie par le fait de formuler des phrases, de chercher le sens, de questionner, de frapper aux portes de ces moments de ma vie, de me harnacher à mon propre pouvoir pour en sortir vraiment. C’est gigantesque d’écrire, c’est un acte extrêmement puissant. Comme je le dis dans le livre, je me suis beaucoup nourrie de fiction, de beauté, de la création d’autres mondes. Le monde réel, jusqu’ici, je ne me le coltinais pas trop. C’est ça, qui m’est arrivé ces dernières années. Ce chemin est douloureux et laborieux, mais c’est une grande vitalité retrouvée pour moi. Et cela me permet de sentir que le reste de ma vie, je vais vraiment l’inventer. Votre parcours s’est-il accompagné de lectures ou d’œuvres qui vous ont aidée ? Oui, bien sûr. J’ai enregistré dernièrement un livre audio de Phyllis Chesler, Lettres aux jeunes féministes, tellement limpide dans le récit de son réveil et de ses expériences de lutte. Le livre de Titiou Lecoq, Les Grandes oubliées, m’a beaucoup éclairée. J’ajouterais Défendre les enfants, du juge Édouard Durand, et Réinventer l’amour, de Mona Chollet. Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés, m’a vraiment permis de reconstituer mes forces de l’intérieur lors de ma première relation. Mais c’était à double tranchant, car ce livre m’a convaincue un temps que tout se jouait à l’intérieur de moi-même, que j’allais régler les choses de l’intérieur, ce qui est vrai quelque part… Mais parfois, il faut juste se barrer (rires) et exiger une société moins violente. Et puis Impunité, le livre d’Hélène Devynck, que j’ai par ailleurs rencontrée, a aussi nourri mon trajet. Parce que c’est dur d’oser parler de soi. C’était dur d’oser accepter cette proposition de l’éditrice. C’est parce que j’ai vu que ça rejoignait l’histoire de tant de femmes que j’ai compris que mon récit révélé dans l’espace public pouvait avoir un sens. Après ce retour forcé au réel, la fiction peut-elle être de nouveau un champ d’exploration, un endroit où transformer ces histoires? Retourner à l’imaginaire, à la fiction, voilà ce à quoi j’aspire, évidemment. Parce qu’avant tout, je crois à l’art. Je crois aux pays imaginaires, à nos pays intérieurs et je crois qu’ils sont vastes et qu’on doit leur donner des espaces nouveaux. Il faut se confronter au réel, réussir à le voir tel qu’il est, et puis il faut des espaces d’invention immenses en nous, aussi. C’est vital et c’est ce qui fera un monde sain. C’est aussi pour ça que j’ai fait ce livre, c’est mon rempart. Maintenant, je veux être protégée et pouvoir créer, inventer de nouveaux mondes. Pour impacter le monde réel. Et faire surgir de la beauté. Notre silence nous a laissées seules de Judith Chemla, Robert Laffont, 368 p., 21 euros

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2024 6:35 PM
|
Par Olivier Milot dans Télérama - 4 avril 2024 INFO TÉLÉRAMA – Sous pression de Bercy, le ministère de la Culture est contraint d’effectuer 28 millions d’euros de réduction de subventions. L’Opéra et la Comédie-Française sont les plus touchés. Le couperet est tombé. Les grandes institutions culturelles qui doivent mettre la main à la poche pour financer en partie les 96 millions d’euros de baisse de crédits du ministère de la Culture dans le secteur du spectacle vivant savent désormais à quoi s’en tenir. Le plus touché est l’Opéra de Paris qui voit sa subvention réduite de six millions d’euros. Sans doute pour le récompenser d’avoir dégagé pour la première fois depuis six ans un bénéfice en 2023 (2,3 millions d’euros). « C’est une nette amélioration mais cette performance ne pourra pas être reproduite tous les ans », avait pourtant prévenu son directeur général Alexander Neef. La Comédie-Française est elle aussi lourdement ponctionnée puisqu’elle perd cinq millions d’euros sur une subvention de 25,5 millions. Un coup dur pour la prestigieuse institution qui ne dispose après paiement de ses coûts fixes (salaires, énergie…) que d’une marge artistique de deux millions d’euros. « Comme la Comédie-Française marche bien, qu’elle a un taux de fréquentation moyen de près de 95 % sur les quelque 900 représentations qu’elle donne chaque année, on a l’impression qu’elle est riche, ce n’est pas vrai du tout, s’agace Éric Ruf. Il faut en permanence faire un effort considérable pour arriver à équilibrer les comptes. Avec cette baisse de subvention, on a l’impression d’être complètement fragilisé. » Réserve de précaution D’autres établissements sont également touchés à des degrés divers : la Villa Médicis à Rome et la Manufacture de Sèvres pour un montant d’un million d’euros, le Théâtre de la Colline et le Théâtre national de la danse de Chaillot (500 000 euros), la Philharmonie (250 000 euros de crédit d’investissement). D’autres encore. Selon nos informations, la plupart des ces établissements ne verraient également pas la dernière tranche de leur subvention « dégelée » cette année. Cette « réserve de précaution » est généralement débloquée à l’automne et représente des montants non négligeables à l’échelle de certains lieux : 500 000 euros pour la Comédie-Française, 300 000 pour le Théâtre national de la Danse et 230 000 euros pour Le Théâtre de la Colline. « Au total, c’est une perte de 730 000 euros, soit un peu près la moitié de notre capacité de programmation », déplore son secrétaire général Arnaud Antolinos. À lire aussi : Rachida Dati envisage de “fermer certaines écoles” d’art en France « C’est beaucoup, confirme en écho Rachid Ouramdane, le directeur de Chaillot. Nous travaillons tous à plus d’élargissement et plus d’ouverture, notamment en direction des territoires fragilisés, explique-t-il. Une institution comme la nôtre dispose certes d’un ancrage parisien mais elle rayonne sur l’ensemble du territoire. Quand on touche à Chaillot, on touche un écosystème qui va bien au-delà du périmètre de nos murs. Et, c’est cela qu’on met en péril quand on baisse notre subvention. C’est incompréhensible, surtout dans le moment de tension sociale extrême que nous vivons. » Ces baisses de subventions qui n’ont pas encore été notifiées officiellement aux directions des établissements culturels, représentent en cumulé 28 millions d’euros. Pour le reste, le ministère de la Culture a, comme il l’avait annoncé, abondamment puisé dans sa réserve de précaution (47 millions d’euros), une enveloppe de crédits gelée en début d’année pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion. Il a également utilisé ce qu’on appelle des « décrets de virement », un mécanisme qui permet de redéployer des crédits entre les différents programmes du ministère. Il est ainsi allé chercher sept millions d’euros dans le programme « livre » et sept autres dans celui dit des « industries créatives ». Ce mécano fait de baisses de subventions et de mesures techniques qui auront néanmoins un impact pour ces deux secteurs touchés, permet au ministère de la Culture « de ne pas enlever un euro au spectacle vivant en région » comme il s’y était engagé. Promesse tenue donc, du moins pour l’instant. Tant que tous les théâtres, les centres chorégraphiques, les salles de spectacles labellisées par le ministère n’auront pas touché l’intégralité de leur subvention, la prudence reste de mise. D’autant que de nouvelles coupes budgétaires sont à prévoir dans le projet de loi de finances rectificative qui s’annonce pour le mois de juin. De même si le ministère a promis à tous les responsables des établissements culturels qui voient leur subvention baisser cette année qu’il n’en ira pas de même en 2025, beaucoup se montrent circonspects sur une promesse qui n’engage que ceux qui la donne. Olivier Milot / Télérama Légende photo : La Comédie-Française perd cinq millions d’euros sur une subvention de 25,5 millions. Photo Vincent Loison/1h23 ----------------------------------------------------- par Ève Beauvallet A la suite de l’annonce d’une baisse de crédits de 204,3 millions d’euros pour le ministère de la culture, les établissements nationaux, essentiellement situés à Paris, voient leur budget 2024 amputé, de façon à réduire la casse ailleurs. Une décision qui affectera par ricochet les artistes indépendants. Depuis le décret d’annonce par Matignon et le ministère de l’Economie, fin février, de coupes historiques dans le budget de la Culture, à ventiler sur les programmes «création» (96 millions d’euros) et «patrimoine» (99,5 millions), une question planait comme une épée de Damoclès : quoi sacrifier ? Collée au pied du mur sitôt arrivée rue de Valois, la ministre Rachida Dati serait, dit-on dans son entourage, particulièrement échaudée de l’absence de concertation préalable et du fléchage imposé dans les coupes à opérer (le controversé Pass culture, lui, est entièrement préservé). En mars, la voici qui tentait cependant de rassurer un secteur qui, loin d’avoir rejeté en bloc sa nomination, avait au contraire placé en elle maints espoirs de victoire dans le jeu de bras de fer avec Bercy. Disant prendre au sérieux le degré d’asphyxie du secteur du spectacle vivant notamment, confronté à la hausse des coûts de fonctionnement de ses établissements, le ministère certifiait : «Pas un euro ne sera pris sur les crédits des réseaux et labels du spectacle vivant en région.» Traduction : c’est essentiellement aux structures parisiennes sous tutelle directe de l’Etat qu’un effort de «solidarité» sera, entre autres, imposé. Le reste des sommes à trouver sera notamment prélevé dans la réserve de précaution dont dispose chaque ministère pour faire face à l’«imprévu». Privilégier les «valeurs sûres» La logique est compréhensible : l’Etat ponctionne dans les établissements qu’il finance seul, pas dans ses «labels» déployés sur l’ensemble du territoire (scènes nationales, centres dramatiques nationaux, qui reposent sur l’association des collectivités locales). A quelques semaines du lancement d’assises nationales dévolues à la culture en ruralité, l’opération permet en outre, par ricochet, de conserver un semblant de cohérence. Ainsi, plusieurs navires amiraux de la capitale apprenaient-ils ces jours derniers l’ampleur exacte de l’amputation dans leur budget 2024 : 6 millions de crédits en moins pour l’Opéra de Paris, 5 millions pour la Comédie-Française, 3 millions pour le musée du Louvre, 1 million pour l’Académie de France à Rome, ou encore 500 000 euros pour le théâtre national de la Colline ou Chaillot, le théâtre national de la danse. Des coups de sabre que le ministère dit «soutenables», sans «conséquences opérationnelles» sur les projets en cours, pour des structures comme l’Opéra de Paris notamment, enfin redevenu bénéficiaire après plusieurs années noires. De quoi préserver les petits au détriment des grands ? Ce serait méconnaître le fonctionnement de la chaîne de fabrication. Mercredi 3 avril, invité de la matinale de France Inter, Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de la Colline où il vient d’être reconduit pour un nouveau mandat, faisait exercice de pédagogie. Lorsqu’une baisse budgétaire est actée, ce n’est pas dans la plomberie, dans l’électricité, dans les emplois ou autres frais fixes qu’un théâtre peut couper, «c’est dans les artistes». Alors combien d’artistes indépendants seront touchés en bout de chaîne ? Le directeur adjoint du théâtre de la Colline, Arnaud Antolinos, dit en tout cas devoir refuser «bien plus qu’[il] ne le faisai[t] d’habitude» les sollicitations des compagnies «qui trouvent de moins en moins de lieux de diffusion». Une précision sur le montant de l’«effort» demandé, ajoute-t-il : «C’est 500 000 [euros], plus la réserve budgétaire, donc 730 000. Le seul levier qu’il nous reste au mois d’avril, dans l’urgence, c’est la programmation de l’automne 2024.» Cet hiver, l’Odéon, théâtre national de l’Europe, avait communiqué sur le fait que la totalité de sa subvention (13 millions d’euros environ) ne servait plus qu’au fonctionnement de l’établissement, et que rien ne restait pour la mission censée être la sienne : produire et montrer des œuvres d’art. La situation sera la même pour la Colline fin 2025 si la coupe est réitérée l’an prochain. A moins d’attendre de la billetterie qu’elle ne parvienne à couvrir l’entièreté des frais de programmation – ce qui ne peut être le cas qu’au prix d’un renoncement à une mission de service public. Les structures touchées seront donc contraintes, lorsqu’elles disposent d’un répertoire, d’augmenter les reprises d’anciennes pièces (dont la production n’a pas à être refinancée) pour pallier la diminution du volume des créations, de réduire drastiquement l’accueil aux artistes émergents, mais aussi la prise de risque artistique pour privilégier les «valeurs sûres» qui rempliront les salles. Disette non argumentée par Bercy Si les coupes se pérennisent, expliquent les acteurs concernés, les solutions à trouver devront être structurelles. Cela signifie : plan social, audit des dépenses, révision de l’activité, réduction du coût de fonctionnement. Est-il si exorbitant dans ces grosses maisons ? Ce serait oublier qu’en leur sein travaillent au quotidien des équipes de techniciens œuvrant pour une multitude d’artistes non programmés mais accueillis dans des salles de répétitions, de concepteurs de décors, de chargés d’actions culturelles dans les écoles, les hôpitaux, les prisons. «Bien sûr, on pourrait se transformer en autre chose, mais auquel cas, on ne répondrait plus à une politique culturelle d’Etat», poursuit Arnaud Antolinos. Ces annonces interviennent alors que deux programmes du ministère ont déjà été lancés en 2024. Nombre d’acteurs s’interrogent donc sur les crédits qui seront exactement alloués à ce «Printemps de la ruralité» voulu par Rachida Dati en faveur d’une nouvelle étape de la décentralisation, mais aussi au plan «Mieux produire, mieux diffuser», lancé pour enrayer un effet pervers diagnostiqué depuis vingt ans : une inflation d’œuvres qui peinent à jouer plus de quatre fois. A l’approche des festivals d’été, le milieu de la culture n’entend pas se satisfaire de cette disette pour l’instant non argumentée par Bercy. D’autant que le secteur apprenait que les crédits exceptionnels dont il avait bénéficié ces cinq dernières années avaient été fort mal utilisés, si l’on en croit un rapport cinglant de la Cour des comptes publié le 20 mars, attribuant en partie le naufrage à une fâcheuse tendance de Matignon à court-circuiter le ministère de la Culture. Eve Beauvallet / Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 3, 2024 7:10 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 4 avril 2024 Le festival a été avancé d’une semaine et se tiendra du 29 juin au 21 juillet, en raison des Jeux olympiques. La langue invitée est l’espagnol, et l’« artiste complice », le chorégraphe français Boris Charmatz. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/04/festival-d-avignon-2024-le-programme-de-la-78-edition-cherche-les-mots-d-un-monde-trouble-et-menace_6225858_3246.html
En 2024, Avignon parlera espagnol et les langages les plus pointus de la création contemporaine. Tiago Rodrigues a présenté, mercredi 3 avril dans la cité des Papes, le programme de la 78e édition du festival, et la deuxième sous sa direction. Une édition particulière : en raison des Jeux olympiques, le festival a été avancé d’une semaine par rapport à sa périodicité habituelle et se tiendra du 29 juin au 21 juillet. Mais une édition qui poursuit la ligne, tracée en 2023, d’une évolution en douceur, dans l’équilibre à tenir entre l’ouverture de nouvelles pistes et la redécouverte de chemins oubliés. Dans un monde troublé, Avignon se devra de « Chercher ses mots », à l’instar du titre choisi par Tiago Rodrigues pour cette édition 2024 : « Nous sommes un festival qui cherche les mots pour parler d’un monde menacé par la guerre, les inégalités, les extrémismes et l’urgence climatique », écrit le directeur dans son éditorial. Après l’anglais en 2023, la langue invitée est cette année l’espagnol, et le festival se pare d’une identité visuelle aux couleurs du Sud (jaune et rose vif), évoquant des taches solaires aussi bien bénéfiques que maléfiques. Chercher ses mots mais aussi ses gestes : l’« artiste complice » de cette édition, selon la terminologie adoptée, est le chorégraphe français Boris Charmatz, désormais directeur du Tanztheater de Wuppertal fondé par Pina Bausch, qui avait déjà été « artiste associé » à Avignon en 2011. Il sera présent tout au long du festival avec trois spectacles, marquant la dimension hybride de cette programmation où les formes mixées entre théâtre, danse, cirque, musique et performance sont nombreuses, reflétant l’interdisciplinarité toujours en marche de la création contemporaine. C’est d’ailleurs une des papesses hérétiques de la scène actuelle qui aura les honneurs de l’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des papes : l’Espagnole Angélica Liddell, avec Damon. El funeral de Bergman, une création (librement, comme toujours chez elle) inspirée par le grand cinéaste suédois. L’ouverture, forte, de ce festival sera aussi assurée par Séverine Chavrier, une des metteuses en scène les plus électrisantes d’aujourd’hui, qui présentera sa vision d’Absalon, Absalon !, de Faulkner, à La FabricA. Et par Tiago Rodrigues lui-même, avec Hécube, pas Hécube, à la Carrière de Boulbon : cette interprétation personnelle de la tragédie d’Euripide voit aussi le retour à Avignon de la troupe de la Comédie-Française, avec une de ses plus grandes actrices, Elsa Lepoivre, dans le rôle-titre. Des découvertes venues d’Amérique du Sud Autre retour très attendu, celui du Polonais Krzysztof Warlikowski, qui prendra la suite dans la Cour d’honneur, avec Elizabeth Costello. Sept leçons et cinq contes moraux, d’après l’œuvre de J. M. Coetzee, qui l’accompagne depuis toujours. Ainsi que celui de Caroline Guiela Nguyen, avec Lacrima, une création originale autour de la confection d’une robe de mariée. Sans oublier Gwenaël Morin et sa façon bien à lui de dynamiter les classiques – en l’occurrence, le Quichotte de Cervantès, avec Jeanne Balibar dans le rôle-titre. Ainsi que Baptiste Amann, un enfant des quartiers d’Avignon, devenu un des meilleurs auteurs d’aujourd’hui, qui se lance dans un thriller théâtral intitulé Lieux communs. Dans ce menu riche et varié, on compte aussi des artistes qui ont déjà tracé un chemin significatif dans le paysage mais n’étaient jamais venus à Avignon : la chorégraphe La Ribot, avec Juana ficcion ; le collectif catalan pluridisciplinaire Baro d’evel, avec Qui som ? ; l’auteur-metteur en scène Mohamed El Khatib, avec La Vie secrète des vieux ; les metteuses en scène Fanny de Chaillé et Lorraine de Sagazan, avec Avignon, une école, et Léviathan ; le chorégraphe Noé Soulier, avec Close Up. Les découvertes espérées, elles, s’inscrivent dans la programmation en espagnol du festival, telle que l’a présentée le polyglotte Tiago Rodrigues, avec aisance, dans la langue de Cervantès. La plupart de ces artistes viennent d’Amérique du Sud, et notamment d’Argentine, comme Lola Arias (Los dias afuera) et Tiziano Cruz (avec deux spectacles : Soliloquio et Wayqeycuna). Péruvienne installée en Espagne, Chela De Ferrari présente La Gaviota, une version de La Mouette, de Tchekhov, interprétée par des acteurs malvoyants. La surprise à guetter particulièrement viendra peut-être de l’Uruguayienne Tamara Cubas, avec son Sea of Silence, qui convoque le rituel et les femmes désobéissantes. Rajoutons un autre Argentin, Mariano Pensotti, dont on connaît déjà en France le théâtre fin, drôle et délicat, qui signera le traditionnel spectacle itinérant du festival, intitulé Une ombre vorace. La Polonaise Marta Gornicka pourra enfin présenter son projet Mothers. A Song for Wartime, mené avec des femmes ukrainiennes et longtemps retardé. De quoi satisfaire tous les appétits. L’achat des places pour cette prochaine édition est ouvert sur Internet dès le samedi 6 avril. Vamos, date prisa, comme on dit en espagnol avignonnais. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2024 1:06 PM
|
par Anne Diatkine dans Libération, le 2 avril 2024 Avec une scénographie captivante, le metteur en scène se réapproprie «Une pièce pour les vivant·e·s» et sauve le spectacle du pensum didactique. Une lampe non à pétrole mais à huile de colza nous éclaire lorsqu’on s’installe dans la petite salle de la MC93. Son miroitement dans l’obscurité rappelle les lampes de poche que tenaient les ouvreuses – le féminin s’impose car le métier était genré – quand un spectateur en retard se glissait en catimini au cinéma. L’ouvreuse, en l’occurrence, c’est Juliette Navis, qui accourt sur le plateau. Se présente : elle est dramaturge pour la compagnie Lieux-dits et elle est désolée, David Geselson est à l’hôpital avec sa mère qui a fait une petite chute. Plutôt que d’annuler la représentation, le metteur en scène lui a intimé de prendre le relais, puisque ce spectacle, Vivant.e.s, elle le connaît sur le bout des doigts. Elle va faire ce qu’elle peut. Du reste, les perturbations sur la ligne 5 du métro parisien l’obligent à rester puisque des spectateurs vont arriver très en retard. La petite précision véridique embarque. Bougies en cire de soja On se laisse mener par l’actrice, seule en scène avec la violoncelliste Myrtille Hetzel. Aucun projecteur. Pas d’électricité. Des bougies sur le plateau, partout. Des paraboles qui concentrent la lumière et la distillent à la manière d’un kaléidoscope. La scénographie, conçue par David Geselson et Jérémie Papin, nous plonge dans un rituel. L’éclairage à la flamme découvrira à la fin du spectacle des listes inscrites à la craie parmi les 130 000 espèces déjà disparues depuis la sixième extinction en cours, cathédrale d’écriture. Rien que pour ses inventions scénographiques, le spectacle mérite qu’on se déplace, et avec des enfants. Le texte, didactique et direct, rend (beaucoup) plus dubitatif. Le spectateur habitué du travail de David Geselson commence par s’étonner. Comment ça ? Il n’y a pas d’humour, pas de recul, pas de décrochage, pas de second personnage balourd et mauvais écolo qui permettrait de réfléchir et de se projeter ? Pourquoi nous narre-t-on aussi frontalement le désastre de la sixième extinction ? C’est qu’il y a une consigne : inventer le spectacle le plus écolo possible, sans électricité, ni intervention sur le texte de la jeune autrice américaine très en vogue, vivant à Brooklyn, Miranda Rose Hall. David Geselson a néanmoins pu se l’approprier en le retraduisant avec ses propres mots, comme on dit aux enfants. Assortie à une deuxième consigne : que l’actrice ne soit pas blanche. Ce sont des vélos qui alimentaient les dalles de LED lors de la création de ce texte en Europe par Katie Mitchell. David Geselson a préféré ne pas reproduire ce modèle trop coûteux selon lui en carbone. Une réflexion qui l’a conduit avec son équipe et l’atelier de la MC93 à utiliser des bougies en cire de soja et à inventer un genre de parabole, c’est-à-dire à se poser des questions esthétiques qui, pour le coup, sont passionnantes. Une pièce pour les vivant·e·s en temps d’extinction de Miranda Rose Hall mis en scène de David Geselson Jusqu’au 7 avril à la MC9 à Bobigny. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Dans «Une pièce pour les vivant·e·s en temps d’extinction», on se laisse mener par l’actrice, seule en scène avec la violoncelliste Myrtille Hetzel, sans projecteur ni électricité, mais des bougies sur le plateau. (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2024 4:20 PM
|
Critique publiée par Stéphanie Janicot dans La Croix - 6 mars 2024 Alors qu’une enquête littéraire tente de prouver que l’œuvre théâtrale la plus célèbre au monde a été écrite par une aristocrate anglaise, un livre de poche réhabilite le roi Richard III… Plongée dans les mystères shakespeariens. Depuis le XIXe siècle, la question de l’auteur des pièces attribuées à Shakespeare revient comme un serpent de mer. « On compte environ soixante-quinze prétendants », souligne François Laroque, traducteur, universitaire et lui-même auteur d’un Dictionnaire amoureux de Shakespeare, chez Plon. Mais pourquoi les doutes entourent-ils cette œuvre magistrale ? Premièrement, nous répond notre expert, parce qu’il était issu d’un milieu qui n’était pas intellectuel et ne disposait pas d’une bibliothèque personnelle, alors que son œuvre est truffée de références antiques, classiques, littéraires, issues de centaines d’ouvrages différents. « Un vieux préjugé d’ordre social voudrait que sans éducation, il n’y ait pas de culture possible », précise-t-il. Deuxièmement, il n’existe aucun manuscrit de Shakespeare hormis son testament (et une scène unique exposée au British Museum), dont les pattes de mouche laissent penser que ce géant de la littérature écrivait « comme un cochon ». Ces raisons et bien d’autres sont évoquées en détail dans ce Mary Sidney, alias Shakespeare, écrit par Aurore Évain, laquelle est la directrice artistique de la compagnie théâtrale La Subversive qui s’est spécialisée dans la production de pièces du matrimoine. Son enquête est basée sur les recherches de l’américaine Robin P. Williams, publiées sous le titre Sweet Swan of Avon – Did a Woman Write Shakespeare ? Car cette thèse si troublante a déjà quelques adeptes aux États-Unis. Fauconnerie Mais qui est donc Lady Mary Herbert Sidney, comtesse de Pembroke ? Cette aristocrate est connue des spécialistes de la littérature anglaise des XVIe et XVIIe siècles. Issue d’une famille proche des Tudors, elle est née dans un manoir à la frontière du pays de Galles (trois ans avant Shakespeare), où elle reçut une éducation remarquable, poésie, rhétorique, sciences, médecine, langues anciennes ou étrangères, musique, fauconnerie – ce qui n’est pas un détail dans l’œuvre du dramaturge. Ses parents, auteurs de poésie, l’initièrent tôt à la recherche littéraire. Appelée à 13 ans à la cour de la reine, elle y fut remarquée par Henry Herbert, comte de Pembroke. Mariée à 15 ans, elle fut mère à 18 d’un premier fils, William Herbert. Trois autres enfants suivront. Lady Mary possédait une bibliothèque riche de plus de 5 000 ouvrages dans différentes langues, et son frère aîné Philip Sidney fut, lui aussi, un écrivain célébré malgré son décès prématuré. Très jeune, Mary, fascinée par Cléopâtre, écrivit un Antoine en pentamètres iambiques. Une écriture que l’on trouve déjà chez Christopher Marlowe et qui deviendra propre à William Shakespeare. François Laroque reconnaît qu’il est vraisemblable que la première pièce de Shakespeare ait été jouée à Wilton House, chez Mary Sidney, une mécène de premier ordre. Mais fut-elle encore plus que cela ? Aurore Evain déploie, avec une grande force de persuasion, l’ensemble des thèmes shakespeariens pour nous montrer à quel point ils épousent la biographie de Mary, ses deuils, ses doutes, ses passions. Collaboration Sammy Frenée, maître de conférences de littérature anglaise de la Renaissance à l’université d’Orléans est sceptique : « J’aurais bien aimé abonder dans ce sens mais, même si je crois beaucoup à l’idée d’une œuvre collective, rien ne prouve qu’il y ait pu avoir collaboration entre Mary Sidney et Shakespeare. Quant à l’idée qu’elle ait pu l’écrire seule, ça ne me paraît pas plausible. Elle n’avait pas accès au milieu social décrit par Shakespeare dont les pièces étaient assez vulgaires, très populaires, comme des best-sellers. C’était le grand cinéma de cette époque ! » Ce scepticisme est partagé par François Laroque. « Mary Herbert Sidney est d’une famille puritaine protestante proche des Tudors, alors que l’œuvre shakespearienne est empreinte de cryptocatholicisme. » Le fait que Mary Sidney soit apparentée aux Tudors ne pourrait-il pas être rapproché de cet autre livre qui vient paraître en poche ? Réédition d’un polar des années 1950 qui avait alors fait scandale, La Fille du temps, de Josephine Tey (10/18) raconte l’histoire d’un homme hospitalisé qui, pour s’occuper, démontre que le dernier des Plantagenêts, le roi Richard III, n’était en rien le roi sanguinaire présenté par Shakespeare, mais un homme doux et bienveillant. La version théâtrale que l’on connaît est une manœuvre des Tudors pour justifier leur prise de pouvoir. « C’est tout à fait vrai, reconnaît François Laroque. Richard III a été réhabilité il y a une dizaine d’années. Shakespeare n’a pas été le premier à le salir mais il a certainement saisi cette opportunité pour flatter la couronne. » Shakespeare n’a pas fini de faire parler de lui. Et si le livre d’Aurore Évain mérite d’être lu, ce n’est pas forcément pour se convaincre de sa thèse mais parce que son raisonnement nous plonge dans la Renaissance anglaise, le règne élisabéthain, les cercles littéraires aristocratiques et, bien sûr, dans l’œuvre immortelle d’un auteur qui est, ou n’est pas, Shakespeare. Comme il vous plaira. ----- Mary Sidney, alias Shakespeare Aurore Evain Ed. Talents Haut, 384 p., 22 € Avant de devenir un essai foisonnant d’informations, cette hypothèse audacieuse fut une pièce de théâtre, et la forme de la narration s’en ressent, pour notre plus grand plaisir. Après avoir brossé le profil type de la personne susceptible d’avoir écrit les pièces de Shakespeare, l’auteure (dramaturge et metteuse en scène) passe en revue les suspects. Elle étudie à la loupe leurs affinités avec les thèmes shakespeariens, leur style, leur cercle de connaissances, leur biographie, presque année par année, leur rapport avec le pouvoir royal. Pour en discuter avec elle, elle convoque deux personnages, l’un à charge, l’autre à décharge. Cette forme rend la lecture vivante, presque ludique. In fine, chacun pensera ce qu’il veut de cette thèse mais on ne pourra nier l’immense intérêt de cette plongée dans le XVIe siècle anglais. Quoi qu’il en soit, revisiter l’œuvre de Shakespeare est toujours un grand bonheur. Stéphanie Janicot / LA CROIX --------------------------------------------------------------------------------------- Article publié sur le site de TV5 Monde Par Louise Pluyaud le 24 février 2024, émission Terriennes Et si l’oeuvre de William Shakespeare avait en réalité été écrite par une femme ? Dans un livre enquête captivant, l’autrice française Aurore Evain avance un nom, Mary Sidney, aristocrate anglaise née au 16e siècle, proche d’Elisabeth Ière et l’un des plus brillants esprits de son temps. Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth … Les pièces du plus célèbre dramaturge anglais n’ont pas livré tous leurs secrets. Encore moins la véritable identité de leur auteur (ou autrice ?). Justement, l’oeuvre de William Shakespeare aurait-elle pu être écrite par une femme ? C’est une théorie défendue outre-Manche, et par Aurore Evain. Dans un livre enquête captivant, l’autrice française, à l’origine des Journées du Matrimoine, avance un nom, Mary Sidney. Entre influence politique à la Cour d'Elisabeth Ière, passions amoureuses, épreuves familiales et travail d'écriture remarquable, la vie de cette comtesse semble étrangement synchronisée avec les cycles de l'œuvre de Shakespeare ... Entretien avec Aurore Evain Terriennes : Pourquoi remettre en question l'identité du plus célèbre poète et dramaturge anglais ? Quel est le point de départ de votre enquête ? Aurore Evain : Je connais bien les autrices du théâtre classique, car j’ai consacré près de trente ans à l’édition et la mise en scène de leurs œuvres. Néanmoins, j’ai toujours buté devant ce mur du génie shakespearien… Certes, on veut bien concéder aujourd’hui que ces autrices aient pu écrire de bonnes pièces. Mais revient sans cesse l’idée qu’aucune n’aurait pu rivaliser avec Shakespeare. Virginia Woolf déclare dans Un lieu à soi que si la sœur de Shakespeare avait existé, même avec le talent de son frère, elle n’aurait pu créer une telle œuvre. Mais c’est oublier que Virginia Woolf écrivait à partir d’une Histoire amputée de la moitié de l’humanité… Et puis, dans les années 2010, je découvre l’essai de Robin P. Williams dans lequel elle attribue l’oeuvre de Shakespeare à une femme, Mary Sidney. Avant d’écrire cette enquête littéraire, j’en ai d’abord tiré une pièce, Mary Sidney Alias Shakespeare, qui a reçu un très bon accueil. Généralement, en sortant du spectacle, les personnes sont au minimum troublées, et le plus souvent secouées par la démonstration. Il leur devient soudain vraisemblable qu’une femme, au temps de Shakespeare, a eu le génie de Shakespeare… Un siècle plus tard, l’état des recherches nous permet donc de répondre à Virginia Woolf que Shakespeare fut peut-être sa sœur de plume ! Votre principale suspecte se nomme Marie Sydney. Qui était cette femme ? Mary Sidney, comtesse de Pembroke, évolue dans les milieux de la grande aristocratie élisabéthaine. Elle est l’une des femmes les plus cultivées et brillantes de son temps, mais aussi l’une des plus illustres inconnues qui peuplent l’histoire littéraire… Elle et son frère ont l’ambitieux projet de créer de grandes œuvres en langue anglaise, à une époque où l’anglais était loin d’être une langue de premier plan. Il meurt jeune, et Mary Sidney va poursuivre seule cette mission : elle va alors développer le plus important cercle littéraire de l’histoire anglaise. Polyglotte, parlant couramment latin, et maîtrisant sans doute le grec, d’une érudition exceptionnelle, elle pratique l’alchimie et la médecine, la musique, la fauconnerie, la politique, l’occultisme… Elle est aussi la première femme dans son pays à publier une pièce en anglais : une tragédie traduite du français, qui fut une source d’inspiration pour ses contemporains et servit de modèle à l’Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Le génie littéraire et artistique de Mary Sidney était donc reconnu à son époque. Pourquoi n'aurait-elle pas signé de son nom les œuvres que l'on attribue à William Shakespeare ? Et comment a-t-elle pu tomber dans l'oubli ? A l’époque, il était impensable pour un homme de l’aristocratie de publier sous son nom des pièces de théâtre jouées par des troupes professionnelles. Et donc inimaginable de la part d’une aristocrate ! Les actrices elles-mêmes n’étaient pas autorisées sur la scène publique. En dehors même du théâtre, publier une œuvre pour une femme de son rang n’était pas admissible : afficher ainsi son nom, en faire commerce, c’était devenir une "femme publique", comparable à de la prostitution. Ou alors il lui fallait intervenir dans des genres bien spécifiques, comme la traduction, si possible d’œuvres religieuses ou morales. Il existait des hommes féministes à l’époque. On les appelait les "champions des dames"… Mais certainement pas ce William Shakespeare... Aurore Evain Or Mary Sidney va être la première autrice à ne pas s’excuser de publier ses œuvres. En tant qu’éditrice de l’œuvre posthume de son frère, elle va également promouvoir une culture de l’impression qui va très vite remplacer celle du manuscrit, qui prévalait encore. En revanche, si elle est parvenue de son vivant à faire tomber une partie des barrières imposées aux femmes désirant écrire et publier, à sa mort, elles vont à nouveau retomber sur elle, et effacer son nom de la postérité. Seul son frère, Philip, décédé à 31 ans, est resté dans les mémoires de la littérature anglaise. "Shakespeare n'a pas de héros, il n'a que des héroïnes !", affirmait l'un de ses éminents traducteurs, Marcel Proust. Vous-même insistez sur le fait que ses pièces mettent en scène des personnages féminins "forts, agissants, indépendants d'esprit et qui se travestissent parfois en garçon pour faire ce qui doit être fait". Pour autant, cela prouve-t-il qu'elles ont forcément été écrites par une femme ? En effet, il existait des hommes féministes à l’époque. On les appelait les "champions des dames". Un auteur aurait donc très bien pu écrire une telle œuvre aux voix féminines puissantes… Mais certainement pas ce William Shakespeare né à Stratford-sur-Avon ! Le peu de choses que l’on connaît de sa vie laisse le portrait d’un homme qui n’a pas éduqué ses filles et qui suspend leur héritage à la condition qu’elles aient des descendants mâles. En revanche, un grand nombre d’aspects de la vie et des œuvres de Mary Sidney coïncident étrangement avec l’œuvre shakespearienne. Comme cette grotte dans Cymbeline qui correspond trait pour trait à celle du château de Pembroke où vivait Mary Sidney. Les éléments de sa vie, notamment son histoire d’amour avec son médecin, se raccordent au script de Tout est bien qui finit bien. Il n’existe pas de preuves irréfutables en soi, mais un amoncellement de faits documentés, d’arguments sourcés, de coïncidences troublantes, qui, mises bout à bout, interrogent, déconcertent, et finissent par convaincre de la vraisemblance de cette thèse. Au vu de tous ces éléments, à chacun et chacune ensuite de poser son propre verdict ! Que répondre à celles et ceux qui accuseraient votre enquête de "théorie du complot" ou affirmeraient : "Qu'importe qui a écrit les oeuvres ! Tant que nous avons les pièces" ? Face à la vacuité des arguments en faveur du William Shakespeare de Stratford, ses défenseurs se bornent à renvoyer la question de l’identité littéraire shakespearienne à une "théorie du complot". Or il n’est nulle part question de complot : personne n’est accusé de vouloir sciemment cacher la véritable identité de Shakespeare. En revanche, le vide biographique qui entoure le fameux William Shakespeare de Stratford-sur-Avon soulève à juste titre des questions depuis plusieurs siècles déjà, et chez des esprits éminents. On devrait donc pouvoir interroger sereinement cette construction littéraire sans être dénigré.e ou taxé.e de conspirationnisme. D’autant que ce "mystère" auctorial est au cœur même de l’œuvre shakespearienne, qui ne cesse de questionner l’être et l’apparence, de cacher le vrai derrière le faux, et de travestir des filles en garçons… C’est aussi ce qui justifie la pertinence de cette question, du point de la vue de la recherche. Savoir qu’une femme est probablement à l’origine d’une telle œuvre ne changera pas sa puissance, mais renverse l’histoire de la littérature. Aurore Evain Enfin, savoir qu’une femme est probablement à l’origine d’une telle œuvre ne changera pas sa puissance, mais renverse l’histoire de la littérature telle qu’elle s’est écrite. Cela remet en question son androcentrisme, et ses conséquences sur la légitimité des femmes à penser, créer, diriger, participer au mouvement du monde. Cela permet également de relire Shakespeare avec d’autres lunettes. Bref, c’est la promesse de redécouvrir une œuvre sous un autre jour, et de voir s’y déployer plus clairement la parole féministe de Shakespeare, de réaliser notamment combien elle est traversée par la Querelle des femmes, ce long débat sur l’égalité femmes-hommes qui occupait déjà beaucoup ses contemporain.es à l’époque. Si le fantôme de Mary Sidney pouvait apparaître à la barre, telle une mystérieuse héroïne shakespearienne, quelle(s) question(s) lui poseriez-vous ? Êtes-vous toujours d’accord avec Juliette quand elle déclare à Roméo : Qu’y-a-t-il dans un nom ? La fleur que nous appelons rose embaumerait autant sous un autre nom... Et bien sûr : "Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?"… Mais surtout, pour pouvoir boucler notre enquête sur des preuves tangibles : où sont passés vos manuscrits ?! Propos recueillis par Louise Pluyaud / Emission Terriennes - TV5 Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2024 8:46 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 30 mars 2024 Conférence écolo responsable ou spectacle mortifère ? A travers « Les vivant·e·s », via Katie Mitchell, Miranda Rose Hall et l’actrice Juliette Navis, David Geselson nous parle d’extinctions en cours : humains, chauve-souris, Léopard des neiges, etc, tout va disparaître. C’est une morne veillée subtilement éclairée par l’ingénieux Maurizio Moretti.
Au départ, il y a un texte titré Une pièce pour les vivant.e.s en temps d’extinction écrit par Miranda Rose Hall et mis en scène par Kate Mitchell. Il fallait aller à Lausanne, à pied ou en vélo, au Théâtre Vidy pour voir la chose en spectateur responsable. Le protocole du spectacle stipule qu’il ne tournera mais pourra être recréé partout dans le monde en respectant quelques règles : sobriété (attention aux émissions de carbone), non recours à l’électricité pour éclairer la scène, de plus l’interprète unique du texte ne doit pas être issue de la majorité visible du pays où il se joue. C’est là une application du projet STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) dont les théâtres de Vidy, Liège ou la MC93 sont partenaires avec d’autres théâtres européens ainsi que les artistes Kate Mitchell et Jérôme Bel. Geselson voit dans tout cela « une provocation à la pensée ». Il ne cherche nullement à imiter les présentations passées de Lausanne et d’ailleurs, il traduit puis adapte le texte et se pose la question de l’éclairage de la scène sans avoir recours à l’électricité. Pas simple. Comme souvent, tout se noue autour de rencontres. D’une part celle de Monsieur A qui à Paris tient l’unique exemple de magasin de lampes à huile, à pétrole et à gaz. Et, d’autre part, celle de Maurizio Moretti, responsable de l’atelier construction de la MC93 qui construit des paraboles en bois pour accueillir les lampes à huile. Des objets « faits à la main, pas avec une imprimante 3D sur ordinateur » note fièrement Geselson dans ses notes de travail. Fin novembre dernier, en plein travail sur le spectacle, l’actrice Juliette Navis envoie un mail à David Geselson : « Les vivants, de par ses contraintes de fabrication, permet d’ouvrir une réflexion sur des questions que nous ne pourrons plus éviter désormais: comment le théâtre va-t-il continuer à exister dans un contexte d’épuisement des ressources ? Comment réduire l’impact écologique de nos créations artistiques, de nos tournées ? Comment mutualiser nos moyens et nos forces ? Comment s’entraider et continuer à créer malgré tout ? » Ce questionnement ne figure pas dans le spectacle qui s’avère être plutôt une conférence théâtralisée qui égrène les disparitions en cours (animaux, flore, etc). En contrepoint un violoncelle joue du Bach. Le charme est ailleurs : dans les histoires d’amour qui se nouent entre les lampes à huile et les paraboles de maître Moretti. Les vivant.e.s, une pièce pour les vivant.e.s en temps d’extinction , MC93, du mar au ven 19h30, sam 18h30, jusqu »au 3 avril
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2024 10:51 AM
|
par Lara Clerc et AFP publié par Libération le 11 avril 2024 Le directeur du théâtre de la Colline à Paris devait mettre en scène sa nouvelle pièce au théâtre Le Monnot dans la capitale libanaise à partir du 30 avril. Mais en raison d’une campagne contre lui, que certains jugent trop pro-israélien, la direction a été contrainte d’annuler les représentations. Une nouvelle conséquence du conflit au Proche-Orient. Le théâtre Monnot à Beyrouth a annoncé mercredi 10 avril l’annulation de la nouvelle pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, Journée de Noces chez les Cromagnons. La création du dramaturge devait démarrer dès le 30 avril dans la capitale libanaise, pays en proie à de vives tensions en raison de la guerre entre le Hamas et Israël. La cause de cette rétractation : une campagne menée contre l’auteur libanais et québécois, directeur du théâtre de la Colline à Paris depuis huit ans, accusé par des militants de «normalisation avec Israël». Cette campagne a entraîné des «pressions inadmissibles et de menaces sérieuses faites au théâtre Le Monnot et à certains artistes et techniciens», selon le communiqué de l’établissement. «Les acteurs ont été harcelés via leur téléphone» précise Josyane Boulos, la directrice du théâtre. Une ONG demande l’interdiction de la pièce et l’arrestation de Wajdi Mouawad En plus de ces pressions, l’ONG The Commission of Detainees Affairs (chargée du bien-être des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes) a annoncé lundi avoir demandé au Parquet militaire «l’ouverture d’une information judiciaire contre Wajdi Mouawad […] pour délit de communication avec l’ennemi israélien, en contravention de la loi sur le boycott d’Israël». L’ONG demande aussi l’interdiction de la pièce et l’arrestation de Wajdi Mouawad. Pour cette ONG créée en 1998, les pièces du dramaturge seraient «financées par l’ennemi israélien» et feraient «la promotion de la normalisation» avec Israël. En cause, la pièce Tous des Oiseaux en 2017 sur le conflit israélo-palestinien et l’identité, création accusée par des militants d’avoir été financée par l’ambassade d’Israël à Paris et le théâtre Cameri de Tel-Aviv – ce que Wajdi Mouawad a réfuté dans un entretien à L’Orient - Le Jour en 2017 : «l’ambassade a payé les billets d’avion des artistes israéliens qui sont sur ce plateau, comme il se fait très régulièrement dans le théâtre. Rien de plus». Autres points de tensions : la présence d’une actrice israélienne dans Tous des Oiseaux, et la collaboration du dramaturge en 2023 avec le réalisateur israélien Amos Gitai dans l’adaptation théâtrale de sa trilogie documentaire House. Autant d’éléments qui ont poussé le 6 avril le collectif «Campagne de boycott des partisans d’Israël au Liban» à demander l’interdiction de la pièce de Mouawad, mentionnant son «passif de normalisation et de promotion de l’occupation israélienne». Ce «passif» est également alimenté par les prises de position de Mouawad sur le conflit israélo-palestinien loin de correspondre à la ligne de «boycott d’Israël» portée par le Hezbollah, qui interdit à ses ressortissants de se rendre en Israël ou d’avoir des contacts avec cet Etat. Un mois après l’attaque terroriste du Hamas en Israël, le dramaturge publiait une tribune dans Libération avertissant des risques de montée d’antisémitisme et expliquant comment il s’est émancipé d’une haine «par héritage». Le 2 avril, il expliquait au micro de France Inter que «depuis toujours, l’artiste a pris position dans les guerres», et que la solution dans ce conflit était un cessez-le-feu et une empathie pour les deux camps. Son équipe rentre donc en France pour la suite des répétitions de sa nouvelle création. La première de Journée de Noces chez les Cromagnons aura lieu à Montpellier au Printemps des Comédiens, du 7 au 9 juin 2024. Lara Clerc avec AFP / LIBERATION Légende photo : La pièce du dramaturge libano-québécois fera finalement sa première à Montpellier le 27 juin 2024. (Stéphane de Sakutin/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 10, 2024 5:00 AM
|
Par Roxana Azimi dans Le Monde - 9 avril 2024
Le dispositif, lancé en 2022, par la commune des Yvelines vise à encourager l’accès à la culture des adolescents.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/04/09/a-trappes-les-jeunes-se-font-ambassadeurs-culturels-de-la-ville_6226853_3246.html
Sur la scène du théâtre et centre d’art L’Onde, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), neuf danseurs s’agrippent et s’éloignent, s’apostrophent et s’esclaffent, sous l’œil bienveillant d’une femme aux longs cheveux blancs. Calé dans son fauteuil, Aziz, 13 ans, croque dans son sandwich sans perdre une miette de l’entraînant Portrait, signé du chorégraphe Mehdi Kerkouche. « L’ambiance est très bizarre », chuchote le collégien à sa voisine. « Chut ! », lui intime un spectateur. Un siège plus loin, Kande, 13 ans elle aussi, gratte son cahier. « Le spectacle paraissait bien, les gens dansaient et bougeaient. On aurait dit une secte bizarre, mais c’était bien, ils n’arrêtaient pas de balancer et de tourner », a-t-elle griffonné, surlignant certains mots avec des feutres violet, vert et bleu. « J’aurai plein de choses à écrire au retour », murmure l’adolescente à sa sœur jumelle, Assita. « Moi, ça me fait penser à carpe diem, le temps qui passe », extrapole cette dernière, poétique. Aziz, Kande et Assita font partie de la troisième promotion des jeunes ambassadeurs culturels (JAC) de Trappes (Yvelines). Pendant une saison, une trentaine de jeunes Trappistes assistent à des spectacles en Ile-de-France avant d’en sélectionner plusieurs, qui seront programmés l’année suivante à la halle culturelle La Merise. Dans cette commune populaire de 32 000 habitants, qui a vu émerger une génération de stars, comme l’humoriste Jamel Debbouze, le rappeur La Fouine et le comédien Omar Sy, mais dont sont aussi originaires une soixantaine de djihadistes qui, de 2014 à 2016, ont rejoint les rangs de l’organisation Etat islamique, la mairie fait mieux que transformer ses plus jeunes administrés en consommateurs de la culture. « On veut sensibiliser les jeunes à des univers artistiques et à des lieux auxquels ils pensent ne pas avoir accès, mais aussi les aider à développer leur propre argumentaire, se mettre dans la peau d’un programmateur culturel et décider ce qui, à leurs yeux, serait bon à voir pour leur communauté », résume Yohann Nivollet, directeur de la culture à Trappes. Et aussi piquer suffisamment leur curiosité pour leur donner envie d’aller plus loin, par eux-mêmes. Partenariat avec la Comédie-Française « La culture, ce n’est pas un luxe, c’est un droit, martèle le maire, Ali Rabeh, qui dégage chaque année 35 000 euros pour financer l’opération. Mon obsession, c’est que les gamins aient accès à ce que je n’ai pas eu à leur âge. » Grandi en politique dans le giron de Benoît Hamon, qu’il a suivi à Génération.s après son départ du Parti socialiste, lui-même n’a découvert le théâtre qu’à l’âge de 27 ans – « et encore, c’était pour accompagner mon enfant ». Aussi l’édile a-t-il sauté sur l’occasion de nouer, en 2023, un partenariat avec la Comédie-Française, permettant à 2 500 jeunes Trappistes de découvrir gratuitement des dizaines de pièces pendant trois ans. C’est Alain Degois, surnommé « Papy », qui lui a soufflé l’idée de ce jumelage, comme il a encouragé le lancement, en 2022, des JAC. « Je suis le plus vieux des jeunes ambassadeurs de la culture », blague cette figure locale, connue pour avoir révélé Jamel Debbouze au Déclic Théâtre, la compagnie d’improvisation qu’il a fondée en 1993. « Missionnaire de la culture laïque », selon ses mots, l’inlassable militant croit dur comme fer dans la méthode : « C’est une façon de dire aux jeunes : l’espace culturel est aussi à vous. On croit en vous, en votre intelligence et en votre perception du monde. » Les deux premières années, les équipes municipales embarquaient les adolescents, à l’instar d’une colonie de vacances, au Fest’arts, le festival international des arts de la rue de Libourne (Gironde), et au festival Au bonheur des mômes du Grand-Bornand (Haute-Savoie). Le dispositif, toutefois, ne touchait que les jeunes déjà passionnés de culture. Car les freins, symboliques et géographiques, restent puissants. Apprendre à vaincre le poids des représentations et des codes n’a rien d’aisé. S’aventurer hors de son quartier, prendre le RER pour Versailles ou Paris ne va pas de soi. Pour ferrer les moins captifs, accros au ballon ou aux consoles de jeux, les animateurs jeunesse de la ville ont été appelés cette année en renfort afin de bâtir six parcours autour du spectacle vivant, de la danse, du cinéma, des musiques actuelles, de la littérature et de la comédie. Rompue à la psychologie adolescente, Sandra Fekir déroule ses arguments : « Je leur dis : “Tu fais quoi vendredi soir ? Rien ? Tu ne veux pas faire autre chose que rester seul chez toi sur ta PlayStation ?” » Pouvoir transformateur Pauline Crépy, responsable adjointe de La Merise, le sait. Pour attirer les réticents, il faut « associer la culture au plaisir ». Une sortie dans un théâtre parisien s’accompagne parfois d’un dîner dans un café. Quant au programme, il obéit à un savant dosage de spectacles populaires et exigeants. Car tout l’enjeu, « c’est de ne pas les perdre en cours de route », ajoute-t-elle. Pour harponner les JAC 2024, elle a trouvé un « argument massue » : Le Roi Lion, au Théâtre Mogador, à Paris. La comédie musicale estampillée Disney a captivé Aziz, regard espiègle, la tchatche qui va avec. « Je me sentais riche, les gens autour de nous étaient en costard-cravate, ils avaient tous payé le prix fort, alors que, pour nous, c’était gratuit, savoure-t-il. Tout est intelligent, bien pensé, les décors sont sublimes. C’est un peu long, mais t’es sûr que tu ne vas pas t’endormir. A côté, tout le reste est fade. » Enfin, presque tout, rectifie le volubile garçon, également bluffé par 3D, un spectacle de cirque à l’Espace Alphonse-Daudet, à Coignières (Yvelines), qui a fait l’unanimité dans le groupe. Du haut de ses 17 ans, Linda a préféré Cendrillon, un opéra de Jules Massenet joué à l’Opéra Bastille, à Paris. « C’était vraiment un autre monde, tout était grand, tout était beau », se souvient-elle, les yeux brillants. Aziz acquiesce : « Les décors étaient magnifiques, surtout le cœur qui brillait. Mais je n’ai pas aimé le chant, qui partait trop dans les aigus, et j’avais mal aux yeux à force de lire les sous-titres. » Quoique conscient de ne pas atteindre la frange la plus radicalisée des Trappistes, M. Rabeh veut croire dans le pouvoir transformateur de la culture. « Pour certains, c’est juste un intermède, mais, pour d’autres, ça va changer leur vie. » Yasmine Khiari, 21 ans, première génération des JAC, inscrite en 2022, le confirme : il y a un avant et un après. « Avant, je n’allais pas de moi-même au théâtre. Ce n’est pas que j’en avais pas envie, je n’y pensais tout simplement pas, confie l’étudiante en promotion immobilière, vacataire à La Merise en parallèle de ses études. Maintenant, prendre une place à la Comédie-Française, ça me semble banal » − la salle parisienne propose des places à 10 euros pour les moins de 28 ans. Conquise, elle a inscrit cette année sa sœur de 18 ans au parcours littérature des JAC. « Elle est déjà mordue ! » Roxana Azimi Légende photo : Présentation du dispositif Jeunes ambassadeurs culturels aux candidats de la saison 2024 au Conservatoire de Trappes (Yvelines), le 12 janvier 2024. VILLE DE TRAPPES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 2024 1:57 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - 8 avril 2024 « Nom » ou le droit de vivre libre
Seule en scène sur un plateau entièrement nu, Victoria Quesnel se lance dans une poursuite effrénée de liberté, une quête absolue de soi, époustouflante d’intensité et de rage. Adapté du troisième roman de Constance Debré, « Nom » est un combat, celui d’une femme contre les faux-semblants d’une société qui se ment à elle-même. À quel point peut-on vivre libre ?
« J’ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l’héritage, de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression de l’autorité parentale, je suis pour l’abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, je suis pour l’abolition de la filiation, je suis pour l’abolition du nom de famille, je suis contre la tutelle, la minorité, je suis contre le patrimoine, je suis contre le domicile, la nationalité, je suis pour la suppression de l’état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la suppression de l’enfance aussi si on peut. » D’abord, il y a les mots, ceux qui sont projetés sur le mur en fond de scène et qui, tel un prologue, mettent en garde, préviennent, quant à ce patronyme encombrant : cela aurait pu être n’importe quel nom, n’importe quelle famille, l’histoire aurait été la même. C’est l’histoire d’une mue, une transition vers la liberté, l’amour, l’absolu. L’histoire d’une urgence, celle éprouvée par Constance Debré, dont l’œuvre littéraire fait l’objet d’une première adaptation au théâtre à travers la proposition du jeune metteur en scène Hugues Jourdain qui s’empare de « Nom », troisième roman autobiographique, l’aboutissement d’une quête de liberté, une quête de soi, entamée avec « Playboy » en 2018 et « Love me tender » en 2020. « Le Christ a une gueule d’assassin et il porte des Nike Requin, je l’ai croisé souvent, je l’ai croisé dans les taules et les tribunaux, devant les juges… » C’est par ces mots que commence la pièce. Avant de devenir autrice, Constance Debré était avocate. Issue d’une famille de la grande bourgeoisie française, petite-fille de Michel Debré, premier ministre de Charles de Gaulle, nièce du ministre Jean-Louis Debré et du médecin Bernard Debré, elle va se défaire de son milieu, tout quitter. Dans quelques instants, Victoria Quesnel incarnera, seule sur scène, le personnage du roman avec une incroyable puissance, une force bien nécessaire pour porter le récit qui vient, celui d’un dépouillement extrême, un renoncement pour une renaissance. S’émanciper vraiment. S’émanciper de tout : condition sociale, travail, mode de vie, famille… « Mes affaires tiennent dans deux sacs. Je jette quand ça déborde[1] » dit-elle. « Règle morale. Règle esthétique ». Dans l’œuvre littéraire qu’elle élabore depuis 2015, Constance Debré épure, fait le vide, liquide sa vie d’avant. Seule désormais, elle essaie de trouver un moyen de vivre comme elle l’entend, loin des simulacres de la société. Du mieux qu’elle peut, être vraie. Accorder ses actions avec ses convictions nécessite de se battre contre les impensés. Elle accompagne ici son père dans la mort en dehors des voies convenues, sans tabou ni langue de bois, contrairement à sa sœur qui, comme dans un jeu de miroir inversé, en prendra le contrepoint en faisant tout ce qu’on attend d’elle. Une soif éperdue de liberté Si le texte se veut libérateur, il dit des choses qui questionnent, qui peuvent agresser parfois. Les écrits de Constance Debré autorisent à penser par soi-même, en tout cas ils démontrent cette possibilité et c’est vertigineux. Elle dit tout, assène tout, convaincue de détenir la vérité. Le spectacle tente de montrer cela, la vérité de quelqu’un qui essaie de trouver la vérité, une mise à nu bouleversante dans la force mais aussi la vulnérabilité qu’elle offre au monde. La mise en scène s’efface devant le texte si puissant. Être au plus près de soi, se laisser traverser, nécessite de se délester des contraintes matérielles. Sur le plateau laissé vide, seuls une chaise et une paire de Nike requins serviront d’accessoires, Victoria Quesnel – vu chez Julien Gosselin et très récemment dans la création française de « Finlandia » de Pascal Rambert – déploie la pensée et les mots de Constance Debré. Crus, violents, implacables, ils sont prononcés sans le moindre regret par un « corps vivant, seul sur scène, qui dit « Je » et se propose en héros » explique Hugues Jourdain dans sa note d’intention. Ils vont jusqu’à chercher à tuer les symboles : « Ma chance ce n’est pas ma famille de ministres. Ma vraie chance, celle vraiment que tout le monde devrait m’envier, c’est les parents camés ». La pièce est née de la rencontre entre Victoria Quesnel et Hugues Jourdain, de l’envie de travailler ensemble et d’une profonde admiration pour le travail de Constance Debré, en particulier pour ce troisième roman. Elle est toutefois augmentée de scènes provenant de ses romans précédents : lorsqu’elle explique son besoin vital de natation, seule activité régulière qui lui permet aussi de prendre conscience du temps : « Alors je nage tous les jours, je ne réfléchis même plus. Je le fais et puis c'est tout. C'est ma discipline, ma méthode, ma folie pour échapper à la folie [2] ». Si le titre fait bien sûr référence au patronyme de Constance Debré, il s’entend aussi, dans le jeu de l’homonymie, comme le refus, la négation de ce patronyme. « …c’est rien le nom, c’est comme la famille, c’est comme l’enfance, je n’y crois pas, je n’en veux pas… » dit-elle. Peut-on vivre et aimer plus librement ? Quel en est le prix à payer ? À quel point peut-on vivre libre ? La pièce et le texte font naitre chez le spectateur quelque chose d’essentiel, la conscience amère de l’absurdité du monde. « Je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge » dit-elle, « qu’il faut tout réinventer, mais qu’avant il faut tout détruire, que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir, il faut tout passer par l’acide, l’essence et le feu, avoir fait ça ». On ne sort pas indemne de la pièce, pourtant, on ne s’est jamais senti aussi vivant. Guillaume Lasserre [1] Constance Debré, Nom, Paris, Flammarion, 2022, 176 pp. [2] Constance Debré, Love Me Tender, Paris, Flammarion, 2020, 192 pp. NOM - Adapté du roman de : Constance Debré. Mise en scène : Hugues Jourdain. Avec : Victoria Quesnel. Création lumière : Coralie Pacreau. Création sonore : Hippolyte Leblanc. Création musicale : Samuel Hecker. Régie générale à la création : Roméo Rebière. Administratrice de production : Virginie Hammel / Le Petit Bureau. Texte publié aux éditions Flammarion. Production Cie Je t’embrasse bien. Coproduction Maison du Théâtre d’Amiens MétropoleAvec l'aide à la diffusion de la Ville de Paris. Avec le soutien du Channel – Scène nationale, Malakoff – Scène nationale, Théâtre Ouvert - CNDC. Compagnie en résidence à la Maison du Théâtre d’Amiens Métropole. Spectacle créé le 16 janvier 2024 à la Maison du Théâtre à Amiens, vu le 5 avril 2024 au Théâtre du Rond-Point, Paris. Théâtre du Rond-Point Paris, du 19 mars au 6 avril 2024.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 3:37 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 8 avril 2024 Dans « Trois fois Ulysse », Claudine Galea explore les zones d'ombre du héros grec et rend hommage aux femmes puissantes qui l'ont façonné. Son texte, répétitif et ampoulé, peine à convaincre. Transformé en oratorio tragique par la metteuse en scène Laëtitia Guédon, le spectacle est sauvé partiellement par le jeu des comédiens-français et le beau chant du choeur Unikanti. « Hécube, Pas Hécube », la tragédie d'Euripide revisitée par Tiago Rodrigues, sera créée cet été au Festival d'Avignon par la troupe de la Comédie-Française dans le cadre magique de la Carrière de Boulbon. Mais, dès ce mois d'avril, la reine de Troie transformée en chienne déploie sa vindicte sur la scène de Vieux-Colombier, deuxième salle du Français. Avec Calypso et Pénélope, elle est l'une des trois héroïnes de la pièce de Claudine Galea, inspirée de l'Odyssée, « Trois fois Ulysse ». Tentative de déconstruction du héros grec, elle prend la forme d'un poème lyrique, voire d'un oratorio. La metteuse en scène Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages, a en effet adjoint aux six comédiens-français (dont trois Ulysse), huit chanteurs du choeur de chambre Unikanti. Décor symbolique L'argument est simple : en étant confronté à trois femmes qui ont marqué son odyssée, Ulysse dévoile sa vraie nature et ses zones d'ombre. Face à Hécube, humiliée et trahie, il est ce jeune guerrier, fou de conquête et brutal derrière son allure aimable. Face à la nymphe Calypso qui l'a ensorcelé, il montre son caractère pusillanime et dépressif avant de la quitter subitement et de reprendre la mer. Face à sa femme Pénélope, qu'il retrouve à Ithaque, il est ce héros vieilli qui a surfé toute sa vie sur le temps perdu et marche vers la mort. Le texte recèle quelques beaux passages. Mais, répétitif et ampoulé, il s'avère indigeste à la longue. Succession de monologues, il impose aux acteurs un jeu déclamatoire périlleux. Laëtitia Guédon fait ce qu'elle peut pour créer une atmosphère onirique et opératique. Son décor symbolique - un crâne de cheval géant qui pivote pour révéler la grotte de Calypso ou une colline d'Ithaque, des vidéos de ciels et de mer impressionnistes - ne manque pas de charme. Le côté oratorio est plutôt bien maîtrisé. Mais cela ne suffit pas à maintenir l'attention durant toute la représentation. On se consolera avec les belles envolées du choeur Unikanti qui nous balade d'un chant araméen au traditionnel breton Tri Martolod. Et on appréciera la performance de la troupe, attachée à faire vibrer les mots de cette odyssée postmoderne : Clotilde de Bayser, reine déchue vibrante de colère ; Eric Génovèse (qui sera aussi de l'aventure avignonnaise), Ulysse anéanti et revenu de tout ; Séphora Pondi, lumineuse Calypso… Avec le plaisir de découvrir en scène un jeune pensionnaire plein de promesses : Sefa Yeboah, qui campe avec charisme un Ulysse fougueux et tragique. Philippe Chevilley / LES ECHOS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 11:07 AM
|
Par Lara Clerc dans Libération - 8 avril 2024 L’association des professionnels de l’administration du spectacle estime que les représentations diminueront de plus de moitié l’année prochaine, en comparaison avec la saison actuelle. Une prévision qui s’ajoute à la liste d’effets négatifs des coupes budgétaires opérées dans le spectacle vivant. publié aujourd'hui à 15h39 Une enquête confirme les conséquences désastreuses des coupes budgétaires dans le milieu culturel – en substance, une baisse de crédits de 204,3 millions d’euros pour le ministère de la Culture. L’Association des Professionnels de l’Administration du Spectacle (LAPAS) a publié le mercredi 27 mars les résultats d’une «enquête flash» effectuée parmi ses adhérents, selon laquelle la saison 2024/25 compterait 54 % de représentations de moins que la précédente. Une prévision qui confirme ce qu’Arnaud Antolinos, directeur adjoint du théâtre de la Colline, nous expliquait la semaine dernière : quand le budget diminue, les artistes sont les premiers à en pâtir. Ce que Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de la Colline, expliquait déjà sur France Inter le mercredi 3 avril, «ces coupes signifient moitié moins de spectacles, moitié moins de créations, […] et que ce sont les jeunes générations d’artistes qui vont écoper». Dans les faits, Arnaud Antolinos a déploré refuser de plus en plus de sollicitations de compagnies, alors que son théâtre accuse une amputation de 500 000 euros dans son budget 2024. En plus de la question des représentations, l’APAS rapporte également un mal-être chez les artistes, parmi lesquels 22 % réfléchissent à arrêter leur carrière ou dissoudre leur compagnie, le manque grandissant de perspectives ou de viabilité de leur activité étant à mettre en rapport avec fla grande instabilité du secteur : «27 % des bureaux de production et 40 % des compagnies ne pensent pas pouvoir maintenir les emplois du personnel administratif tels qu’ils sont aujourd’hui», rapporte l’association. Pour remédier à ces changements, 25 % des artistes interrogés comptent travailler plus pour le même salaire et 5 % travailler autant pour un moindre salaire. Si le ministère de la Culture estime ses coupes «soutenables», sans «conséquences opérationnelles» sur les projets en cours, LAPAS les qualifie d’une toute autre manière, évoquant «une casse sociale et une casse artistique». Légende photo : Manifestation du secteur public à l'appel de huit syndicats représentatifs, le 19 mars à Paris. (Valérie Dubois/Hans Lucas. AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2024 11:08 AM
|
par LIBERATION publié le 6 avril 2024 Alexis Gruss, grand écuyer et figure du milieu du cirque, est mort ce samedi 6 avril à l’hôpital Saint-Joseph de Paris, révèle le Figaro. L’homme de 79 ans, patriarche de la famille Gruss, a succombé après «un accident cardiaque». «C’est avec une immense douleur et tristesse que la famille Gruss annonce le décès aujourd’hui, samedi 6 avril 2024, à 9h40, de Monsieur Alexis Jacques André Gruss, suite à un accident cardiaque, à l’âge de 79 ans», lui rendent hommage ses proches dans un communiqué. Jusqu’à récemment encore, le saltimbanque, aussi bien trapéziste, que voltigeur, clown ou saxophoniste, se produisait sous le chapiteau familial, niché dans le bois de Boulogne. «Alexis Gruss était bien plus qu’un homme de talent ; il était un pilier, un maître des arts équestres, du spectacle, dont l’empreinte restera à jamais gravée dans nos cœurs, saluent son épouse, son frère, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il a consacré sa vie à faire perdurer les arts équestres de la piste par ses enseignements et sa transmission, inspirant des générations entières. Les fondements de sa vie ont été jusqu’à la fin, sa famille, les chevaux, la piste.» La compagnie Alexis Gruss est issue «d’un couple formé en 1868 par le mariage entre Charles Gruss, initialement tailleur de pierres, et Maria Martinetti, membre d’une famille d’écuyers et acrobates menant son propre chapiteau depuis les années 1850», peut-on lire sur le site de la compagnie. La spécificité équestre de la famille s’est affinée au fil du temps et, à la quatrième génération, Alexis Gruss a donné un nouvel éclat en créant le Cirque à l’Ancienne en 1974. Cette structure, lancée avec la comédienne Silvia Monfort, est considérée comme majeure dans la rénovation des arts du cirque. Une passion venue de son père Le Cirque à l’Ancienne «crée une profonde rupture de style avec le cirque dit traditionnel des années 1970, notamment par la prédominance des exercices équestres», peut-on lire sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BnF). «En plaçant le cheval au cœur même du projet, les Gruss (...) préfigurent le Théâtre équestre Zingaro et le Théâtre du Centaure, respectivement créés en 1986 et 1989», développe l’institution. La compagnie avait célébré récemment 50 ans de créations à Paris, sous l’appellation «Les Folies Gruss», avec un show pensé comme une comédie musicale, réunissant 50 chevaux et 25 artistes. Alexis Gruss était né le 23 avril 1944, à Bart (Doubs). Son père, André, était l’auguste «Dédé», clown à la chemise blanche et au chapeau melon. C’est lui qui lui a transmis l’art du spectacle équestre, la musique et la voltige à cheval. Directeur de cirque dès l’âge de 27 ans, Alexis Gruss a su faire du cirque familial une enseigne reconnue pour sa spécificité équestre. Au cours de sa vie, l’écuyer a reçu de nombreuses distinctions, comme celle de chevalier des arts et des lettres ou chevalier de la Légion d’honneur. Il était aussi titulaire de l’ordre du mérite agricole. Une cérémonie religieuse est prévue jeudi 11 avril à 9 h 30, à l’église Saint-Roch à Paris. Libération Légende photo : Alexis Gruss, patriarche du cirque équestre, est mort | L'hommage de Libération @scoopit http://sco.lt/...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2024 8:32 AM
|
Par Louis Juzot dans Hottello - 5 avril 2024 « Partie », texte, mise en scène et scénographie, Tamara Al Saadi, création sonore Eléonore Mallo, création lumière, conception technique et scénographie Jennifer Montesantos, costumes Pétronille Salomé, regard chorégraphique Sonia AL Khadir avec Justine Bachelet, Eléonore Mallo, Tamara AL Saadi, Jennifer Montesantos. « Quelle connerie la guerre », disait Prévert, même si cela ne s’adresse pas à Barbara, les mots de la chanson pourraient l’être à Louis, jeune parisien incorporé dans un régiment d’infanterie qui va monter au front du côté de la Somme pendant la Grande Guerre. L’esprit de Prévert habite le spectacle de Tamara Al Saadi : la tendresse envers les humbles, le goût charnel de la liberté et de la vie, la haine des puissants et des nationalismes qui broient sans pitié des générations de jeunes gens… Louis est vendeur de mouron – plante qu’on donnait aux oiseaux pour les nourrir – et aime écouter chanter ces derniers; sa mère est une marchande de légumes et couve ce fils rêveur et doux. Louis va être emporté dans la guerre, sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Son parcours va être minutieusement circonstancié, de son incorporation jusqu’à son état « d’obusité », on dirait aujourd’hui syndrome ou stress post-traumatique, après les chocs à répétition subis dans les tranchées et les attaques meurtrières. Les lettres que Louis envoie à sa mère entretiennent le lien avec la vie d’avant, autant qu’elles décrivent les conditions de survie du jeune poilu et de ses camarades, comme son copain Edouard, grande armoire taciturne qui ne sera pas épargnée par les combats. Justine Bachelet incarne Louis, jeune femme jouant le jeune homme, elle fait d’autant plus ressortir sa fragilité et sa délicatesse dans un monde brutal, violent de bêtises et d’horreurs. Elle est seule comédienne, mais pas seule en scène. L’originalité du dispositif scénique repose sur tout un univers visuel et sonore, incluant le public, qui littéralement porte la jeu de la comédienne en recréant directement et continuellement l’environnement des situations et des sensations vécues par Louis. La bruiteuse, Eléonore Mallo, évolue à vue côté jardin, jouant de l’amplification sonore d’objets manipulés comme d’ambiances enregistrées. De l’épluchage guilleret des légumes au début de l’histoire, jusqu’aux roulements lugubres des bombardements. Jennifer Montesantos, éclairagiste et régisseuse, soutient la comédienne, déroulant un tableau qui titre les chapitres de l’histoire de Louis, apportant les matières, comme la terre ou le sang sur lequel s’appuie le jeu, maniant les projecteurs, incarnant au besoin un Edouard prostré par un choc tellurique. Tamara Al Saadi gère en lien avec la salle un ensemble de fiches de lecture dont chaque spectateur est muni. Elle dirige à l’aide d’un tableau les modulations des lectures à voix haute effectuées par le chœur des spectateurs. Ce dispositif qui joue de multiples registres et techniques est à la fois simple, il utilise surtout des éléments manuels et complexe, car les interventions autour du cheminement de Louis sont réglées au cordeau. Le travail est finement ourlé, une ambiance prégnante, et la triste histoire du soldat Louis se déroule telle une tragédie, pleine de bruits et d’innocence martyrisée, à laquelle on prend part sans réserve. Louis Juzot Jusqu’au 6 Avril, vendredi 19h, samedi 18h au Théâtre Silvia Monfort, 106 rue Brancion, 75015 Paris. Tel : 01 56 08 33 88 theatresilviamonfort.eu

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 5, 2024 8:40 AM
|
Par Gilles Renault dans Libération publié le 4 avril 2024 Metteur en scène sans complexe, jusqu’à être victime de sa fougue, Hugues Duchêne adapte le roman de Bertrand Guillot autour d’un épisode marquant de l’histoire de France. Quel est le rapport entre la nuit du 4 août 1789 et la méthode masculine de contraception consistant à porter un slip chauffant ? De prime abord, on ne voit pas bien. Sinon, du point de vue de la translation, telle qu’opérée par Hugues Duchêne, qui, aux deux tiers de l’Abolition des privilèges, spectacle historique qu’il met en scène, jaillit inopinément du public pour rejoindre sur le plateau le comédien, Maxime Pambet, le temps d’une mise en abyme contemporaine, mêlant indications dramaturgiques et échanges plus personnels, voire intimes. Dont le mode d’emploi de ce slip, hélas détaillé avec une crudité si scabreuse qu’elle grève la démonstration. Dommage, car, optimisant l‘effet de surprise, l’incise iconoclaste avait pourtant du cran. Mais plus de deux siècles séparent bien ce moment clé de l’histoire de France, durant lequel, divisée entre noblesse, clergé et tiers état, l’Assemblée nationale va débattre à Versailles pour voter l’universalité de l’impôt, des préoccupations socio-économiques actuelles brassant traque des paradis fiscaux, lutte pour le climat, marasme des banlieues, etc. Avec un trait d’union pérenne : la grogne du peuple – «les paysans n’en peuvent plus d’être écrasés». Sprint théâtral Longtemps militant actif au PS, Hugues Duchêne n’a pas tant tourné le dos à la politique, qu’il a commuée en suc sagace d’une exploration théâtrale documentée, mâtinée d’ironie. Insolente odyssée bluffante de culot, sa précédente création, Je m’en vais mais l’Etat demeure, nous avait ainsi scotché, qui cadrait sous tous les angles les premières années du règne d’Emmanuel Macron. «Tu devrais faire un prochain spectacle plus léger, avec deux acteurs maximum, d’une heure tout au plus. Parce que tu comprends, un spectacle de cinq heures sur la politique française, écrit par un metteur en scène émergent, c’est pas ce qu’il y a de plus simple pour remplir.» Appliquant à la lettre ce conseil amical, donné par le directeur de la Scène nationale de Châteauroux, le trentenaire (à la tête d’une compagnie qui, jusque dans son nom, le Royal velours, révèle un intérêt pour les rapports de classes) a donc épluché le roman paru en 2022 de Bertrand Guillot, l’Abolition des privilèges, qui détaille la fameuse nuit du 4 août 1789 ; ainsi qu’il résume, d’une part, les quinze années précédentes, d’autre part, les mois ayant suivi le vote du décret. Ces deux dernières parties formant la portion congrue d’un sprint théâtral, où, au centre d’un dispositif quadri frontal proche du ring, Maxime Pambet ne ménage pas sa peine – au risque d’en faire trop – pour reconstituer la joute oratoire entre les Adrien Duquesnoy, Louis Marie Antoine de Noailles ou Isaac Le Chapelier, entre autres députés tissant un digest didactique, sinon édifiant, ingénument pensé pour être «joué le plus longtemps possible». Y compris en milieu scolaire (version compactée en cinquante minutes), où adresses au public et images filmées maintiendront l’auditoire en éveil. «L’Abolition des privilèges», de Hugues Duchêne, en tournée dans le Nord (Lezennes, Erquinghem…), puis dans le off d’Avignon (théâtre du Train bleu) et à nouveau en tournée (Lyon, Amiens…). Gilles Renault / LIBERATION Légende photo : Sur scène, le comédien Maxime Pambet. (Blokaus808)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2024 3:29 AM
|
par Anne Diatkine dans Libération - publié le 3 avril 2024 En plus des metteurs en scène emblématiques de la mémoire avignonnaise, la 78e édition du Festival, dont le riche programme a été dévoilé ce mercredi 3 avril, mettra en avant de nombreux artistes qui n’ont jamais montré leur travail en Europe. Un peu moins de spectacles mais sur des durées d’exploitation plus longues, autant de nouveaux venus totalement inconnus que d’artistes réinvités, une programmation paritaire sans que ce soit le fruit d’un effort, et constituée à 80% de créations, c’est-à-dire de spectacles sur lesquels le Festival d’Avignon s’est engagé sans avoir pu les voir, puisqu’ils n’existent pas encore. Voici quelques grandes lignes du riche programme de cette 78e édition, constitué de 35 spectacles et de 2 expositions, que le directeur, Tiago Rodrigues, vient de dévoiler ce mercredi 3 avril avec l’élan, l’enthousiasme, et la vélocité qu’on lui connaît. En juillet, on retrouvera effectivement des artistes attendus et choyés parce qu’ils font partie de la mémoire avignonnaise, et ont provoqué parfois des scissions et débats enflammées – entre autres Krzysztof Warlikowski, ou l’iconoclaste Angélica Liddell qui ouvre la cour d’honneur avec Dämon, une création sur… Ingmar Bergman, cinéaste déifié s’il en est. Mais aussi, et c’est merveilleux, une foule d’artistes qui n’ont jamais eu l’occasion de montrer leur travail en Europe. Cet afflux est sans doute l’un des intérêts du choix d’une langue comme fil conducteur – cette année, l’espagnol – belle idée pour découvrir non un unique pays reclus dans des frontières, mais au contraire leurs traversées à travers nombre d’artistes sud-américains, en particulier argentins, chiliens, uruguayens ou encore espagnols. Concocté avec Magda Bizarro et Géraldine Chaillou, cette édition est aussi le fruit d’un dialogue avec un artiste «complice» : cette année, le danseur et chorégraphe Boris Charmatz, et la team Libé, fan de la première heure, ne cache pas sa joie. Rituel ancestral On connaissait depuis longtemps quelques pépites de cette programmation, mais elles étaient éparses : Jeanne Balibar qu’on se réjouit de retrouver dans Quichotte de Gwenaël Morin avec le grand retour de Marie-Noëlle Genod (qui avait annoncé ses adieux) et Thierry Dupont de la compagnie l’Oiseau-Mouche en Sancho Panza, Séverine Chavrier qui adapte Absalon, Absalon ! de Faulkner, ou encore Lacrima, sur le savoir-faire des couturières et des secrets qui entourent la confection d’une robe de mariée par Caroline Guiela Nguyen. Voici à présent qu’un dessin apparaît à la manière des clichés Polaroid qui mettent un certain temps à devenir net : ce dessin est celui de la mémoire, et comment vacillante, elle se transmet, se transforme, et fait l’objet, dans les arts vivants, d’une réappropriation continuelle et non d’une copie. Ainsi dans Cercles, Boris Charmatz transmettra à un groupe de 200 personnes une collection de danse en cercle. Ou encore avec Avignon, une école, Fanny de Chaillé invitera 15 jeunes comédiennes et comédiens à raconter des bribes de leur histoire à travers celles du Festival d’Avignon. Entre mille projets, dont une incursion dans la sexualité des personnes âgées par Mohamed El Khatib (pour la première fois à Avignon) qui elle aussi parle de la mémoire du corps, on peut citer Forever, cette déambulation toujours par Charmatz dans le Café Müller, la pièce la plus connue de Pina Bausch. On a tendance à se jeter sur les noms qu’on connait, c’est un tort ! Car les fils de la mémoire tissent aussi entre elles les œuvres d’artistes encore méconnus tels Reminiscencia du Chilien Malicho Vaca Valenzuela qui cartographie son histoire familiale et celle des internautes de son quartier, ou encore The Disappearing Act de Yinka Esi Graves qui recherche ses racines africaines dans le flamenco hispanique. Encore un exemple ? Wayqeycuna de l’Argentin Tiziano Cruz qui en se plongeant dans un rituel ancestral remet en cause (et peut-être détruit) le triomphe du néolibéralisme. Parmi les nouvelles initiatives adossées au désir de transmettre citons aussi la constitution d’une académie, confiée à Mathilde Monnier, qui, avec l’aide de la fondation Hermès, promet plein de workshop avec pléthore d’artistes. De quoi s’agit-il ? On n’a pas compris, on verra bien… Quant au café des idées, toujours matinal, il sera renforcé et effervescent avec la venue de personnalités et oratrices hors pair, telles Christiane Taubira qui nous parlera de justice éthique, ou de Delphine Horvilleur… Motif d’étonnement Tiago Rodrigues avait promis qu’il ne phagocyterait pas le Festival d’Avignon avec ses propres créations. Il tient parole. On ne verra de lui qu’un seul spectacle – et il serait décevant qu’il se l’interdise ; Hécube, pas Hécube, une écriture libre avec la Comédie-Française, à la carrière de Boulbon, lieu magique réouvert l’année dernière pour sa première édition en tant que directeur. A propos de lieux, la direction d’Avignon n’a pas eu le choix : une étude géologique commandée par l’étude du Festival a mis en évidence une faille mettant en danger la vie des artistes, du public et des techniciens aux Carmes et à la chapelle des Pénitents blancs. Ces deux lieux patrimoniaux emblématiques du Festival seront donc fermés cette année. Mais le gazon du stade de l’île de la Barthelasse, lui, accueillera bien Boris Charmatz et son cercle. Et sinon ? Et sinon, on ne comprend pas encore très bien comment la majestueuse cour d’honneur sera employée avec trois spectacles prévus dont une seule création, celle d’Angélica Liddell, et très peu de jours d’exploitation à chaque fois ! Dans un tout autre genre, autre motif d’étonnement, à part Mothers de Marta Górnicka à la cour d’honneur, on constate l’absence quasi totale de l’Ukraine, de la Palestine, et d’Israël. Une béance qui ne manque pas de questionner. Attendons le off.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2024 1:37 PM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 28 mars 2024 Le “Bérénice” de Romeo Castellucci partage avec son héroïne un désamour avilissant, reflet d’une époque où la grâce est devenue, semble-t-il, anachronique. Disons-le d’emblée : Bérénice mise en scène par Romeo Castellucci et interprétée par Isabelle Huppert est sublime. Forcément sublime, aurait ajouté Marguerite Duras. Romeo Castellucci, qui n’a cessé de nous éblouir depuis la découverte de Genesi : from the Museum of Sleep en 2000, propose une plongée fascinante aux tréfonds de la détresse du personnage racinien – à la façon du fameux soliloque de Molly Bloom de James Joyce. Un grand plongeon dans les affres écœurantes et étourdissantes de douleur d’un amour sacrifié, démoli, renié. Une performance qui s’empare de la tragédie racinienne avec une liberté folle et une confiance absolue dans la capacité du théâtre à métamorphoser la condition humaine, à la fois comme objet de contemplation et comme sujet d’expérience, d’autant plus puissant qu’il est vulnérable. Des relents réactionnaires Mais voilà… ces derniers jours, après une série de critiques pour le moins mitigées dans la presse quotidienne, on entend surtout parler de Bérénice pour l’accueil (sic) déplorable que lui réserve une partie du public. Celle que l’on connaît bien quand on va à l’opéra par exemple, où il est de bon ton de huer à tout-va les mises en scène qui ne vont pas dans le sens du poil. Krzyzstof Warlikowski en a souvent fait les frais à l’opéra Bastille en proposant des œuvres inoubliables et ça ne l’a d’ailleurs pas empêché d’offrir, depuis des années, quelques joyaux, d’Iphigénie en Tauride à Parsifal. De même que Romeo Castellucci a subi les foudres de Civitas en 2011, avec Sur le concept du visage du fils de Dieu, les intégristes religieux manifestant devant le théâtre de la Ville pour en empêcher les représentations. Si, depuis août 2023, la dissolution de l’organisation Civitas a été lancée par Gérard Darmanin, la bêtise et la méchanceté gratuite ne se dissolvent pas sur décret gouvernemental, hélas… S’épargner l’obscurantisme Suite à la tribune parue dans Libération de Mathieu Bermann et Anthony Berthon, atterrés et attristés par la violence verbale d’un spectateur apostrophant Isabelle Huppert en pleine représentation, l’affaire a pris un nouveau tour médiatique. Notamment sur France Inter, où de la chronique de Lucile Commeaux, revendiquant “le théâtre comme lieu de chahut“ au billet, grossièrement potache, de Daniel Morin, en passant par l’article de Didier Péron dans Libération, il s’avère finalement de bon ton d’en revenir à cette bonne vieille tradition d’un public clamant haut et fort son désaccord. Surtout, écrit Didier Péron : “À l’heure des polémiques flashs sur les réseaux sociaux, où tout le monde s’insulte à longueur de journée, on constate une tendance plutôt inverse dans l’espace des théâtres et cinémas à une grande docilité ou civilité du public, inversement proportionnelle à la foire d’empoigne numérique.“ Eh bien non. NON ET NON. Je pense souvent à ce titre magnifique de la pièce de Jean-Luc Lagarce, Les Règles élémentaires du savoir-vivre. Lesquelles nous font tant défaut aujourd’hui, au point que pour certain·es, il est tout à fait approprié de s’approprier les créations d’une star ou d’une diva, d’en faire un objet de consommation qu’on jette quand il ne nous plaît plus, ou qu’on insulte et qu’on lapide symboliquement, car c’est bien à ça que revient le fait de huer, verbe antonyme d’applaudir ou ovationner. Il y a effectivement, comme le dit (pour mieux le justifier) Didier Péron, suffisamment de violence dans le monde et les colonnes de nos journaux, pour préserver un espace où la transgression et l’aventure artistique ont droit de cité. Et libre à ceux qui n’aiment pas de partir. En silence. Hier, 27 mars, veille de la dernière de Bérénice à Paris avant une longue tournée européenne, pas une seule huée n’a perturbé le spectacle. Mieux encore, comme il est de coutume de le faire en Russie au théâtre, une spectatrice est venue offrir un bouquet de fleurs lors des saluts à Isabelle Huppert. L’art est précieux, ne le matraquons pas. Fabienne Arvers / Les Inrocks

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2024 8:57 AM
|
Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 30 mars 2024 Je suis la Bête d’Anne Sibran, mise en scène de Julie Delille
Julie Delille a fondé sa compagnie, le Théâtre des trois Parques en 2015. Artiste associée à Equinoxe-Scène Nationale de Châteauroux, elle y a créé ce spectacle en 2018. Depuis l’an passé, elle dirige le Théâtre du Peuple à Bussang (Vosges) et intervient aussi actuellement auprès des jeunes acteurs de la Belle Troupe aux Amandiers-Nanterre.
Plusieurs minutes de noir et de silence avant qu’une voix fluette naisse de l’obscurité: « Nous, c’est le silence qui raconte, les hommes, il leur faut une voix. » Ici, c’est la bête qu’on entendra. Julie Delille, féline et souple, donne chair à Méline, une enfant sauvage qui a appris sur le tard le langage des humains. Jusqu’à ses six ans, l’enfant quadrupède s’ébat dans les bois, glapit, miaule, rugit et fouit dans les terriers. Avant d’être capturée par un vieil apiculteur et forcée de s’adapter au monde civilisé. Dans une langue poétique et drue inventée par l’autrice, Julie Delille nous fait vivre la forêt, sa beauté et ses dangers… Dans un cache-cache permanent entre lumière et obscurité, d’une voix modulée, Méline raconte sa vie intérieure, ses plaisirs et ses douleurs, le goût du miel et aussi du sang: dans le règne animal, il faut tuer pour vivre. Pas de sentimentalisme: «Les bêtes n’ont pas de larmes, c’est une eau qui part dans leur salive. Les bêtes ne savent pas pleurer. Car il faut la parole pour nourrir un chagrin et le faire durer.» Anne Sibran, comme son héroïne, réside entre la France où elle a commencé à écrire et l’Equateur. Elle a appris le quechua pour aller auprès des Indiens d’Amazonie, menacés par l’extraction pétrolière et la déforestation: «La langue peut dire : la bête est moins que l’homme. Et la bête se tait.» Ici, l’animal parle. Une langue puissante, crue et organique qui nous fait vivre l’expérience de Méline. La mise en scène est d’une grande beauté et, des savants clairs-obscurs d’Elsa Revol, naît un paysage vierge puissant et sauvage; l’environnement sonore d’Antoine Richard donne toute son intensité à ce conte dramatique. Seule sur le grand plateau nu, la comédienne, enfantine et animale, naïve et rusée, se glisse dans la pénombre brumeuse, rampe sous un sol arachnéen, semble disparaître dans un fourré, échappe à la blessure mortelle d’une fouine… Puis, quand elle rejoint le monde des humains, elle relate l’apprentissage laborieux du langage, les vêtements qui entravent, les murs qui encagent… Quand le jour bascule, dit-elle, alors j’ai besoin de viander. » Survivra-t-elle parmi ses semblables-les plus cruelles de bêtes qui l’ont abandonnée- et résistera-t-elle à l’appel de la forêt? « Soudain, toutes les paupières s’écartent, en une fois, en même temps. Toutes les paupières des bêtes descendues jusque là, dévalé la montagne pour regarder les hommes en face. Leur ouvrir ces pupilles luisantes comme des miroirs tendus. » (…) « Ainsi, la forêt s’embrase d’une prodigieuse attention où ce qui se cachait depuis toujours, est plus présent que l’arbre. »
Ni femme ni bête, Méline incarne la part animale qui sommeille en chacun de nous, oubliée, et la nature dont l’homme contemporain s’est éloigné, jusqu’à la saccager… Dans certaines scènes, l’actrice happée par son récit nous y entraîne. Il y a d’autres séquences, présentées avec plus de distance où Anne Sibran questionne notre humanité. Un texte admirable porté par une comédienne rare.
On pourra y voir prochainement ici, mise en scène par Julie Delille, La Jeune Parque, un long poème de Paul Valéry sous le titre Le Métier du Temps. Une artiste à suivre.
Mireille Davidovici Jusqu’au 4 avril Je suis la bête. Du 30 mars au 7 avril Le Métier du Temps au Théâtre Nanterre -Amandiers-Centre Dramatique National, 7 avenue Pablo Picasso, Nanterre (Hauts-de-Seine) T. : 01 46 14 70 00 RER A arrêt : Nanterre Préfecture. Attention, plus de navette pour venir: prendre le bus 259. Mais il y en a une pour le retour vers le RER. Le roman, Je suis la bête, a été a publié aux éditions Gallimard (2007). Photo © Florent Gouëlou

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 31, 2024 3:53 PM
|
Publié par le Figaro avec AFP - 31 mars 2024 Lors d’une représentation de la pièce Bérénice au théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt, l’actrice-star avait été interpellée par un spectateur mécontent. Le directeur du théâtre Emmanuel Demarcy-Mota évoque un cas «isolé». L'interpellation récente d'Isabelle Huppert par un spectateur dans un théâtre parisien interroge sur l'attitude du public pendant une pièce et sur ses réactions, complexes, vis-à-vis de mises en scène déroutantes voire transgressives. L'actrice star interprétait ces dernières semaines Bérénice , personne phare du répertoire de Racine, au théâtre Sarah Bernhardt. Lors de l'une des représentations, un homme l'a apostrophée pour lui lancer : «On comprend pas ce que tu dis Isabelle». L'actrice a néanmoins poursuivi. Entre les fans d’Isabelle Huppert et le public de Racine, le ton est monté jusqu’à la sortie du théâtre. Romeo Castellucci est connu pour ses propositions clivantes, souvent éloignées du texte original. Cette fois, il a décidé de ne reprendre que les monologues de Bérénice, avec des tirades où la voix est parfois modifiée par ordinateur ou bien marquée par des bégaiements volontaires, a constaté l'AFP. « Le théâtre, précisément, est un endroit où les acteurs s'exposent. C'est ce qui les rend si vulnérables, même quand ils sont très reconnus. » Florence Naugrette, professeur d'histoire et théorie du théâtre à La Sorbonne «Depuis la fin du XIXe, la norme est plutôt au respect de l'œuvre et des artistes. Le silence est donc de mise et les manifestations du public repoussées en fin de spectacle», rappelle Alice Folco, maître de conférences en arts du spectacle à l'université de Grenoble. Pour autant, relativise Florence Naugrette, professeur d'histoire et théorie du théâtre à La Sorbonne, «le théâtre, précisément, est un endroit où les acteurs s'exposent. C'est ce qui les rend si vulnérables, même quand ils sont très reconnus». «Le spectacle vivant, par définition, comprend ce risque: on a peur pour un danseur qu'il tombe et pour un acteur, qu'il ait un trou de mémoire ou soit interpellé. Un spectacle où il n'y a plus ce risque, ce n'est plus du théâtre, c'est du cinéma», ajoute-t-elle. Isabelle Huppert n'a «pas du tout été dérangée», assure à l'AFP le directeur du Théâtre Sarah Bernhardt, Emmanuel Demarcy-Mota, évoquant un «dérapage» émanant d'une «personne isolée». Selon lui, un tel incident ne s'est produit qu'une seule fois sur une vingtaine de représentations. Mais il est «important d'empêcher toute forme d'auto-censure, tant pour l'artiste, qui aurait peur d'être interpellé, que pour le public qui voudrait qu'on lui rende Racine et qu'on censure les formes artistiques ne correspondant pas à ce qu'il avait prévu de voir». Une position assumée par Romeo Castellucci. En 2019, il affirmait à l'AFP qu'«on ne va pas au théâtre, à l'opéra, pour se voir confirmer ce que l'on sait déjà», refusant toutefois le terme de «provocation». Ces réactions peuvent «rejoindre l'indignation qui saisit une partie du public quand on touche aux classiques depuis les années 1960», que ce soit «dans la critique (littéraire, ndlr) et dans les mises en scène», avance Olivier Goetz, maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Lorraine. Ces manifestations du public ne sont cependant pas nouvelles, souligne Jean-Claude Yon, historien du théâtre et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. «Dès le XVIIe siècle en France, le théâtre est une arène où les artistes s'attendent à avoir des réactions de la salle». Ce n'est qu'«à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que le public s'assagit, au moment où le théâtre devient une activité réservée à une certaine élite», dit-il, expliquant que cela coïncide avec «le moment où on se met à faire le noir dans la salle». Les incidents ne préjugent pas du succès d'une œuvre : Bérénice a été vite «archi-complet» et part en tournée internationale avant d'être repris à Paris «la saison prochaine, car il y a une demande très forte», a annoncé M. Demarcy-Mota.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...