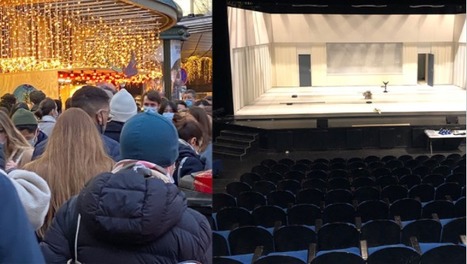Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 21, 2020 2:07 PM
|
Par Philippe Noisette dans Paris-Match le 19/12/2020 A 47 ans, la sociétaire de la Comédie-Française ne cesse de se réinventer, en jouant aussi bien Proust que Visconti. Ou en chantant « Grease ». « Mais quelle Comédie ! » Le titre du spectacle que la Comédie-Française répètent pour la fin de l’année pourrait à lui seul résumer la carrière d’Elsa Lepoivre. De « La règle du jeu » à « Phèdre », sans oublier « Le côté de Guermantes », la vie de l’actrice est une succession de rôles plus remarqués les uns que les autres. Dans cette revue hommage à la comédie musicale mitonnée par le tandem Serge Bagdassarian et Marina Hands, Elsa se mue notamment en chanteuse. « J’ai choisi un titre de la BO de “Grease” », s’amuse-t-elle, consciente d’être à mille lieues de la tragédie. J’aime par-dessus tout le côté artisanal du théâtre, où le travail seul porte ses fruits Après un début de carrière du côté d’Agen, elle entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique à la fin des années 1990. Surtout, l’actrice se voit proposer de rejoindre la Comédie-Française en 2003. « Comme si on me disait : “Viens avec nous.” » Le 1er janvier 2007, elle devient la 516e sociétaire du Français. « J’étais bouleversée. Molière est le sociétaire numéro 1. J’imagine qu’avec tous ces acteurs avant moi, on pourrait remplir les deux tiers du théâtre ! Je dois à mon tour m’inscrire dans cette histoire-là. » On peut dire que c’est réussi. Elle porte chaque personnage avec une intensité à part. Ivo van Hove ne s’y est pas trompé, la choisissant pour « Les damnés », qui lui vaudra un Molière en 2017. Elle garde un souvenir brûlant de cette descente aux enfers inspirée du film de Visconti. Elle y jouait Sophie von Essenbeck. « Lorsque vous avez une pièce aussi dure à traverser, où la haine et le chagrin sont les moteurs des héros, avoir une compagnie aussi soudée que l’est la Comédie-Française, c’est essentiel. » A la rentrée, Elsa Lepoivre endossait encore un autre costume, celui de la duchesse de Guermantes, d’après Marcel Proust. « Christophe Honoré, notre metteur en scène, avait de quoi être frileux face à une troupe qui se connaît si bien. Mais la Comédie-Française, c’est une matière vivante à malaxer. Il faut juste sentir que l’on peut être autonome dans cette communauté. » On y voyait la duchesse partir dans une danse improbable. « Christophe, dans son cahier servant à préparer le spectacle, décrivait cette scène en faisant référence à Nadine Morano levant les bras dans un meeting ! Pas évident », plaisante à peine Elsa Lepoivre. Mais voilà justement ce qu’elle aime par-dessus tout : « Cette prise de risque, ce point d’équilibre à trouver. Toutes les nouvelles propositions font un peu peur. On se doit de dépasser ces angoisses, de les malmener. » Un verbe revient souvent dans sa bouche : oser. Elle a d’ailleurs fait siens ces quelques mots de Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » C’est cela qui fait que « l’on est vivant ». Pourtant, elle avoue avoir le trac avant de monter sur scène. « Je me fais une italienne – une répétition sans mettre le ton – pour moi-même avant la représentation. J’aime par-dessus tout le côté artisanal du théâtre, où le travail seul porte ses fruits. » C’est en jouant que je peux “passer” mon art, plus qu’en donnant un cours Comme le reste de la troupe, Elsa Lepoivre s’est réinventée durant le premier confinement, jouant les speakerines d’un soir ou répondant dans « La causerie » aux questions d’internautes pour « La Comédie continue ! », Web TV du théâtre. Le rythme au Français est soutenu, favorisé par l’alternance des spectacles. D’un seul coup, la mécanique se grippait. Etre présent autrement, garder un contact avec le public aura été une chance pour tous. « Nous avons un petit fan-club mais, durant cette période, on a compris que l’on élargissait notre audience. Notamment à des gens jamais venus dans nos murs. On voit parfois encore la Comédie-Française comme un mausolée, un musée du théâtre. C’est dans l’inconscient collectif de certains. Or, depuis une vingtaine d’années, aucune maison n’a autant évolué. Le Français se transforme de l’intérieur comme jamais. » De Muriel Mayette à Marcel Bozonnet ou Eric Ruf, son directeur actuel, l’institution prend même des risques. La preuve : on y croise Thomas Ostermeier, la star du théâtre allemand, ou Julie Deliquet, on y joue « Fanny et Alexandre » d’Ingmar Bergman et on y chante Serge Gainsbourg. De quoi ravir une interprète « transformiste » comme Elsa. « Je suis toujours disponible pour les metteurs en scène dans un premier temps. Je ne me sens pas pour autant marionnette », résume celle qui n’hésite pas à proposer une idée qui fait sens. « Après, les directeurs d’acteurs rebondissent ou pas. » Elle ne se voit pas diriger à son tour, ni même enseigner. « C’est en jouant que je peux “passer” mon art, plus qu’en donnant un cours. » Elsa n’a pas peur d’être blasée, juste de perdre sa curiosité. Ivo van Hove lui a un jour demandé pourquoi elle ne faisait pas une autre carrière en dehors de la Comédie-Française. « Je me sens forte avec et pour cette troupe. Et puis peut-être que je n’ai pas reçu de proposition au cinéma qui me ferait m’absenter un long moment. » A croire que les réalisateurs français sont parfois aveugles… On la verra heureusement en janvier sur Arte dans la série « En thérapie », avec aux manettes le duo Olivier Nakache et Eric Toledano. Pas l’ombre d’un regret néanmoins dans les propos de la comédienne. « J’aime être dans le concret. Je ne trimballe pas mes personnages avec moi, heureusement. » Elle défend tous ses rôles de la même manière et s’avoue encore et toujours exaltée. « Cela dit, il y a des spectacles qui me rendent plus ou moins heureuse… » Avant qu’on ne se quitte, Elsa Lepoivre nous interpelle en riant : « Je me sens encore comme une débutante. Parfois je me dis : “Elsa, est-ce que tu vas grandir un peu ?” » Etre au sommet de son art, c’est bien là le plus beau des vertiges.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 21, 2020 7:14 AM
|
Par Rosita Boisseau et Brigitte Salino dans Le Monde le 19 décembre 2020
RÉCIT L’établissement public parisien, haut lieu du théâtre et de la danse, œuvre depuis sa création à la démocratisation de la culture.
Par quelle face attaquer la montagne qu’est Chaillot-Théâtre national de la danse ? Par la face sud, celle de l’entrée officielle, incroyablement majestueuse avec sa volée de portes dégageant sur les fontaines du Trocadéro ? Ou par la face nord, aujourd’hui la seule utilisée car à quelques pas du métro Trocadéro ? Et ensuite, par où commencer ? Les peintures chatoyantes des Nabis restaurées en 2019 ou la toile rougeoyante sur La Tragédie (1937-1938), de Louis Billotey, située au-dessus de la caisse centrale ? Et pourquoi ne pas plonger directement dans le ventre de la bête en se faufilant dans le couloir « des gazés » datant de la première guerre mondiale ou dans le souterrain relié aux catacombes et aux égouts ? Vertige de Chaillot ! Ce haut lieu du théâtre et de la danse est une mine de merveilles, un monstre architectural fabuleux de 26 000 mètres carrés. « Je fais chaque jour plus de six kilomètres dans ce dédale, glisse Olivier Morales, directeur technique. J’adore ce théâtre où les styles et les époques des années 1930 aux années 1970 et à aujourd’hui se télescopent sans le dénaturer. » Où que l’on aille, on est happé par une sculpture, la volute d’une rampe d’escalier ou le rythme visuel des baies vitrées ouvrant sur la tour Eiffel. Une explosion d’images que l’on retrouve dans le film Intouchables (2011), d’Olivier Nakache et Eric Toledano, ainsi que dans la série de France 2, Dix pour cent. Et même, depuis le 15 décembre, sur l’application TikTok. A la suite d’une proposition d’Eric Garandeau, de TikTok France, qui veut secouer les habitudes de ses ados, des performances ont été réalisées dans les espaces les plus insolites de Chaillot. Ce monument du spectacle vivant fête ses 100 ans. Si l’édification du premier bâtiment, le pharaonique Palais du Trocadéro, date de 1878, c’est en 1920 que fut inauguré le premier Théâtre national et populaire par le metteur en scène Firmin Gémier (1869-1933). « Chaillot additionne les symboles, déclare Didier Deschamps, directeur depuis 2011. Il incarne dès le début un lieu de création, de rassemblement populaire et de mixité qui ne tient pas compte des origines sociales ni des convictions religieuses. C’est à Chaillot qu’en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme – auxquels on devrait d’ailleurs ajouter ceux de la femme ! – est adoptée par cinquante-huit pays. Il participe depuis toujours à la démocratisation de la culture en portant l’excellence théâtrale et chorégraphique au plus grand nombre. » 125 salariés permanents Avec 125 salariés permanents, cinq studios de répétition, et deux salles qui fonctionnent à plein régime, Chaillot vend chaque saison 120 000 tickets pour une quarantaine de spectacles et plus de deux cents représentations. La première salle est dédiée à Jean Vilar (1912-1971) et compte 1 200 places : son système-son est l’un des plus sophistiqués du moment. « C’est un outil très novateur du point de vue acoustique que peu de théâtres possèdent, affirme Séverine Krouch, régisseuse-son. C’est ce qui m’a d’ailleurs tentée lorsque j’ai postulé ici. Je me suis par ailleurs beaucoup attachée au lieu et j’aime passer de Vilar, avec ses grandes troupes, à Gémier, un peu plus confidentielle. » La seconde salle, celle donc de Firmin Gémier, refaite en 2017 en creusant dans la carrière de calcaire qu’est la colline, est modulable et dotée de 390 sièges. Cocon noir et rouge, elle abrite des pièces plus intimistes. Deux ans d’étude et quatre ans de travaux ont été nécessaires pour cette réhabilitation menée par l’architecte Vincent Brossy, car « l’enveloppe historique de Chaillot est intouchable ». Un puits de 15 mètres a été foré, deux tunnels de 45 mètres et 22 mètres de long ont été creusés en excavant 45 000 mètres cubes de terre pour gagner mille mètres carrés. Et économiser les forces des techniciens dont les trajets, de 12 kilomètres en moyenne parfois par jour entre les salles, se sont raccourcis. Lire le reportage (en 2017) : Le Palais de Chaillot rouvre le bal à Paris Bascule majeure dans la saga de Chaillot, le cap vers la danse contemporaine. Depuis le 13 novembre, un décret entériné par le premier ministre, Jean Castex, sur proposition de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a officialisé l’appellation Chaillot-Théâtre national de la danse. Il compte parmi les six théâtres nationaux dont la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris. « Cela fait plus de dix ans que Chaillot soutient et diffuse la danse, et ce décret marque une réalité, poursuit Didier Deschamps. Il met surtout un point final au combat souterrain persistant qui oppose les partisans du théâtre à la danse. On oublie trop souvent que l’art chorégraphique était déjà très présent dès les années 1920 ici. » Et de rappeler la venue, en 1913, d’Isadora Duncan (1877-1927) dans l’Orphée et Eurydice, de Gluck, puis sa présence trois ans après pour le festival Schubert-Tchaïkovski-Beethoven-Wagner. Un peu plus tard, le ballet fait son apparition avec Giselle, de Serge Lifar, en 1939, puis avec les Ballets de Monte-Carlo. Théâtre populaire et engagement politique L’histoire du théâtre pèse merveilleusement lourd. La liste des neuf directeurs depuis 1920 raconte dans ses plis les mille et une péripéties d’un art qui cavale en permanence sur le front de l’audace artistique et du partage populaire. Aiguillonné par Romain Rolland et Maurice Pottecher, le fondateur du Théâtre du Peuple, à Bussang (Vosges), Firmin Gémier dirige Chaillot jusqu’à sa mort, en 1933, sans réussir à lui donner forme, faute d’argent. Mais la graine est plantée : le désir d’un théâtre pour tous, civique, élevé. C’est au début des années 1950 que commence la grande histoire du TNP, dont la part la plus flamboyante se joue entre les deux V : Jean Vilar et Antoine Vitez (1930-1990). Fort de son succès au Festival d’Avignon, qu’il a créé en 1947, Vilar ancre son utopie à Chaillot : prix bas, élargissement du public en travaillant avec les comités d’entreprises ; prise en compte des banlieusards en adaptant les horaires. Les pièces sont jouées par des comédiens entrés au panthéon : Gérard Philipe, Maria Casarès, Jeanne Moreau… Le répertoire est une éducation littéraire – Molière, Corneille, Musset, Kleist… –, et l’engagement politique s’affirme à travers des œuvres comme La Résistible Ascension d’Arturo Ui (1941), de Brecht, ou La Paix, d’Aristophane. Quand, en 1963, Vilar quitte Chaillot, le sigle du TNP est connu dans le monde entier. Mais il faudra attendre l’arrivée d’Antoine Vitez, en 1981, pour que le théâtre à Chaillot retrouve son lustre. Avec son fameux oxymore du théâtre « élitaire pour tous », Vitez renouvelle le vœu de Vilar. Lire le récit :Avignon, 1947, et Jean Vilar transmit le virus du théâtre… Pendant sept ans, il déploie ses spectacles dans la grande salle totalement remodelée par des travaux engagés sous la courte direction de Jack Lang. Il met en œuvre une esthétique plastique au service de Shakespeare, Victor Hugo ou Paul Claudel, avec Le Soulier de satin, spectacle majeur de la décennie. Il fait aussi événement avec la création d’auteurs contemporains comme Pierre Guyotat ou René Kalisky. « J’avais 18 ans lorsque j’ai été embauché en 1981 à Chaillot, se souvient Alain Lefrançois, chef électricien. La création était foisonnante avec de grosses productions mais aussi, par exemple, un castelet de marionnettes dans le grand foyer pour les enfants. J’ai travaillé ensuite sous la houlette de Jérôme Savary, on faisait venir des chevaux sur le plateau. C’était extraordinaire ! J’adore ce lieu tellement étrange dont les éclairages patrimoniaux sont aussi sous ma responsabilité. J’ai passé quarante ans ici : c’est toute ma vie ! » Art multiple Après Jérôme Savary (1942-2013) et son style festif, Chaillot prend un virage avec Ariel Goldenberg, en 2000 : le directeur, qui n’est pas un artiste, est assisté du chorégraphe José Montalvo pour la danse. Il privilégie l’international, en invitant les metteurs en scène Frank Castorf ou Christoph Marthaler, qui côtoient dans la programmation les chorégraphes comme William Forsythe et Philippe Decouflé. En 2008, le pas est franchi : Chaillot devient un théâtre consacré à la danse. Depuis 2011, Didier Deschamps, militant discret mais déterminé, l’enracine dans une histoire qui n’a jamais cessé de s’écrire au pluriel. De la compagnie de Katherine Dunham (1909-2006), personnalité fonceuse d’une danse afro-caraïbe, en 1949, aux Ballets de Bali, en 1957, en passant par Zizi Jeanmaire (1924-2020) elle-même, en 1963, l’art chorégraphique est multiple. En personnalité phare, Maurice Béjart (1927-2007), régulièrement présent entre 1950 et 2000. « Il était même question qu’il dirige Chaillot en 1972 mais il refusa car il voulait aussi y installer son école, commente M. Deschamps. Il aurait fallu construire des studios sur les toits de Chaillot et ça n’a pas marché. » Aujourd’hui, Chaillot voit défiler les plus fameux chorégraphes, comme l’Israélien Ohad Naharin, le Nederlands Dans Theater de La Haye, la Brésilienne Lia Rodrigues, ou encore Carolyn Carlson, Blanca Li, Olivier Dubois, Thomas Lebrun… Les jeunes pousses se bousculent aussi comme Jann Gallois ou Arthur Perole. « J’aime beaucoup Chaillot, déclare le chorégraphe Angelin Preljocaj. Le bâtiment semble prendre à bras-le-corps la place du Trocadéro d’un côté et embrasser la tour Eiffel de l’autre. Quant à la salle Vilar, son volume, ses gradins créent une relation forte avec le public que je n’ai vécue dans aucun autre théâtre au monde. Le Théâtre national de Chaillot en quelques dates 1920 Inauguration du premier Théâtre national et populaire par Firmin Gémier qui le dirige jusqu’en 1933. 1951 Jean Vilar prend les rênes du Théâtre national populaire (TNP). 1981 Antoine Vitez est nommé à la tête de Chaillot. 2011 Didier Deschamps prend la direction du théâtre et affirme le virage vers la danse contemporaine. 2020 Le Théâtre national de Chaillot devient officiellement par décret Chaillot-Théâtre national de la danse sous la direction de Didier Deschamps. Rosita Boisseau Brigitte Salino

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2020 5:18 PM
|
Par Vincent Bouquet pour la série d'articles Génération sceneweb (12/30). Publié le 12/12/2020 Au long d’un parcours plus progressif qu’il n’y paraît, la metteuse en scène a patiemment gravi les marches, du CDN de Lorient à la Comédie de Reims qu’elle dirige aujourd’hui. Chloé Dabert aura pris son temps pour éclore. Entre sa sortie du Conservatoire, en 2002, et le prix du jury du festival Impatience, décroché en 2014 pour Orphelins de Denis Kelly, la metteuse en scène aura ménagé sa monture, appris à se faire confiance et à dompter son art. « A l’époque, il y avait beaucoup moins de lieux d’émergence qu’aujourd’hui et il était assez compliqué de faire de la mise en scène en étant comédienne, se souvient-elle. J’avais déjà une petite compagnie, je montais des pièces à côté, mais il était difficile, au milieu des figures de mise en scène impressionnantes du moment, de montrer ce travail et d’avoir de la visibilité. » Pour faire ses armes, et gagner en assurance, Chloé Dabert trouve alors refuge au CDN de Lorient où, pendant sept ans, elle anime des ateliers à destination des jeunes et des amateurs. Jusque ce que Bénédicte Vigner, alors directrice artistique du lieu, l’aide à monter une tournée pour Orphelins, et que le directeur du Centquatre-Paris, José-Manuel Gonçalvès, la repère. « Cette période m’a permis de me construire à l’abri de la pression et je crois que j’en avais besoin pour dissiper mon trac naturel, analyse-t-elle. Le spectacle a aussi rencontré le public au bon moment de mon travail, qui avait gagné en maturité et esquissait un tournant artistique. » Comme pour rattraper le temps passé, la metteuse en scène ne s’est depuis plus arrêtée, de Nadia C. à Girls and Boys, en passant par J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne au Vieux-Colombier et Iphigénie au Festival d’Avignon. La famille d’abord Au-delà de son compagnonnage avec Denis Kelly, et exception faite de son incursion chez Racine, Chloé Dabert trace sa voie parmi les auteurs contemporains, dans l’univers de ceux qui ont, à un endroit ou un autre, une parole qui résonne. « Je cherche des auteurs qui questionnent, plus qu’ils n’assènent, car, pour moi, le théâtre sert, avant tout, à se poser des questions ensemble, précise-t-elle. Mais je fonctionne aussi beaucoup sur l’écriture puisque, à mon sens, le fond est aussi important que la forme. » Outre le texte, à qui elle ménage toujours une place de choix, la metteuse en scène accorde aussi beaucoup d’importance à la collégialité, aux apports de cette famille artistique qui la suit de spectacle en spectacle. « Je me vois comme l’élément qui fait le lien entre plusieurs créateurs très investis et toujours force de proposition, assure-t-elle. Il est très important que nous cherchions ensemble, notamment avec les acteurs, pour occasionner une rencontre et voir comment le texte nous déplace. » Un sens du collectif qu’elle cultive désormais à la tête du CDN de Reims. Mue par la volonté de rendre ce qui lui a été donné lorsqu’elle était à Lorient, elle a ressenti le besoin d’être implantée afin de tisser un lien avec un endroit, une équipe et des spectateurs. « En plus des relations avec les artistes associés, en résidence, ou simplement accompagnés, que nous soutenons plus que jamais dans cette période compliquée où nous devons tout faire pour réussir à sauver ce qui devait voir le jour, j’aime avoir un contact avec le public, avec des personnes qui ne font pas de théâtre, histoire de rester dans la vie. » Preuve que, même en pleine lumière, Chloé Dabert garde la tête solidement vissée sur les épaules. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 14, 2020 6:57 PM
|
Messages aux spectateurs, par des directrices et directeurs de théâtres
Catherine Marnas, directrice du TNBA Théâtre national Bordeaux-Aquitaine : Cher, cher, cher public Vous voilà encore une fois « baladés » de reports en annulations, de changements d’horaires en changements de date et je voulais tout d’abord vous remercier pour votre grande patience mais aussi partager avec vous aujourd’hui ma colère. Nous avons été jusqu’à présent sages et obéissants ; conscients de notre responsabilité vis-à-vis de vous et de la société toute entière.
Après les dernières déclarations du gouvernement, nous informant 5 jours avant la date prévue que finalement nous n’ouvririons pas, faisant fi des répétitions, des montages et démontages de décor, de tous les services mobilisés pour vous avertir des changements, le sentiment d’une injustice, voire même d’une punition, mettant la culture dans un état de dépendance la conduisant au découragement et à la soumission nous assaille.
Car enfin, puisqu'on nous apprend jour après jour à analyser des données sanitaires, il nous paraît évident que l’augmentation exponentielle de la propagation du virus correspond à l’assouplissement des règles de confinement. Nous l’avons tous constaté dans les rues, dans les transports en commun, dans les commerces : « cela » circulait plus. Mais pas dans « les établissements recevant du public » puisque nous étions fermés. Et, double peine, nous ne pouvons pas rouvrir !
Je me permets, ici, de souligner l’absurdité du sort qui nous est réservé ! C’est pour cela que le TnBA s’est associé à la demande de référé porté au niveau national sur un principe d’égalité. À règles sanitaires égales, à jauges égales, bénéficier du même traitement.
Pour l’instant, en attente de la réponse du Conseil d’Etat, nous sommes toujours dans la même incertitude angoissante, une attente au jour le jour qui n’est plus possible.
La prochaine échéance est fixée au 7 janvier, date à laquelle les chiffres seront réexaminés pour une éventuelle réouverture.
Que faisons-nous vis-à-vis de vous d’ici là ? L’équipe d’Hamlet répète dans nos lieux pour des représentations qui devaient commencer le 5 janvier. Ils seront prêts, vous attendront, mais peut-on encore vous faire attendre ? Une nouvelle fois ? Et jusqu’à quand ?
Nos équipes sont épuisées par le « stop and go » et risquent de se démobiliser. Vous êtes fatigués par le « stop and go » et risquez de vous démobiliser.
Quel gâchis !
Je parlais d’absurdité, je n’en suis plus si sûre.
Il s’agit bien d’un projet de société et des valeurs que l’on défend.
Travailleurs, consommateurs d’accord. Citoyens émancipés, désireux de mener leur vie au plus près de leurs interrogations, de leurs rêves, de leurs émotions communes, quel intérêt ?
Non essentiel ?
La société tout entière souffre, la peur, l’angoisse du monde futur quand les certitudes sont ébranlées sont des virus puissants et délétères. Les interroger collectivement, par le partage de la poésie, la défense de l’invisible ou de l’indicible, du « tremblant » du fragile, de l’insoupçonné, de l’inédit, sont les anticorps du monde de demain. Un vaccin « essentiel » contre la désespérance et la perte d’énergie vitale…
Au début de la pandémie nous avons tous entendu les propos de notre président ; cette crise sans précédent devait nous inciter à changer les modèles jusqu’alors en vigueur ; l’urgence climatique, la découverte soudaine que les plus mal payés d’entre nous étaient ceux qui permettaient à notre société de fonctionner, l’importance vitale d’un service public de la santé…
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Cette remise en question de notre monde, où a-t-elle disparu ?
Cette lettre veut partager avec vous mes doutes, mes espoirs et mes croyances en cette période troublée où votre confiance est un moteur et une motivation de chaque jour.
J’ose dire à bientôt et bonnes fêtes ! Catherine Marnas -------------------------------------------------------------- Jean Bellorini, directeur du TNP Villeurbanne : Résistons encore. Soyons du côté des optimistes. Depuis plusieurs mois, l’idée que le théâtre, l’opéra, la musique, le spectacle qu’on dit « vivant » pourraient nous parvenir aussi bien via nos écrans que dans une salle, que l’œuvre d’art pourrait se dématérialiser et s’exprimer pleinement à distance, s’insinue dans les esprits. Nous faire croire que l’on peut avoir accès à l’art par le biais du numérique est un mensonge. Car l’appréhension solitaire d’un spectacle le transforme automatiquement en produit. Pour révéler son essence même, esthétique et symbolique, l’art nécessite de partager en silence le temps du regard. Et de former ainsi communauté, bien qu’on soit en présence d’inconnus. L’ absence, le manque révèlent en profondeur ce besoin. Nous ressentons alors combien il est impossible de faire société sans un art partagé. Le fait, en tant que spectateur de se sentir acteur (c’est-à-dire agissant pendant la représentation, par l’écoute, la présence, l’appartenance à un groupe) est unique et n’a lieu qu’en présence d’Hommes face à d’autres Hommes. Au théâtre, c’est précisément la question de l’être qui est proposée. Le spectateur n’est pas passif, il ne consomme pas. L’ art est une valeur et non un produit. Ce moment de crise aura au moins permis de délimiter plus précisément cette frontière. Alors aujourd’hui, je ne m’adresse pas au gouvernement qui, sans lui faire de procès d’intention quant au mépris affiché envers le monde du spectacle vivant, démontre surtout une méconnaissance profonde de ce besoin vital d’art. Je m’adresse à vous, spectateurs. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, trop longtemps que vous n’avez pas franchi les portes du TNP. Nous n’avons même pas eu le temps de faire connaissance, alors que mon arrivée à la tête de ce grand théâtre remonte maintenant à une année. Quelle année… Choc après choc, j’ai tenté d’adapter, de reconstruire, d’impulser un travail d’équipe où tous (artistes, techniciens, personnel administratif) trouvent une place juste. Le second confinement a été, d’une certaine façon, moins douloureux que le premier, car nous avons au moins pu répéter. Nous avons tenté de préparer l’avenir et j’ai eu le sentiment de pouvoir faire une partie de mon métier. L’ annonce jeudi 10 décembre du maintien de la fermeture des lieux de culture a brisé net l’illusion fragile de cette semi-liberté. Car sans vous, notre existence n’a pas de sens. Nous ne sommes que trop prêts. Nous vous attendons. Nous attendons que le noir se fasse de nouveau avant le début de la représentation. Nous attendons ce vertige partagé, ce suspens au-dessus d’une promesse. Pour que les histoires des Hommes parviennent aux Hommes, pour que la chaîne ne rompe jamais, pour que la reconnaissance de soi dans l’autre répare, pour que la poésie des mots traverse les corps. Pour voir vos yeux brillants allumés par une voix. Comment continuer à faire du théâtre sans vous ? Comment supporter encore ce silence qui est un vide, celui de votre absence ? Malgré tous ces doutes, je veux croire à votre retour proche. Je vous souhaite, pour les fêtes de fin d’année, du repos après les épreuves. Reprenez souffle. À bientôt, chères spectatrices, chers spectateurs. -------------------------------------------------------------------------------- Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, co-directeurs du Théâtre des 13 Vents, CDN de Montpellier : En ce mois de décembre, nous avons failli entrouvrir les portes…. Failli… Et nous reviennent, à la fin de cette année si dure, et comme maxime pour l’année qui vient, ces mots de Samuel Beckett : « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » Car dans les temps qui viennent, il faudra persister sans céder à une continuité (ou à des discontinuités) intenable(s), il faudra creuser le chemin en évitant les autoroutes et les culs-de-sac. Pour l’heure, nous sommes signataires, en tant que membres du Syndeac et de l' ACDN - Association des Centres dramatiques nationaux du référé-liberté qui a été transmis au Conseil d’État pour contester la décision de fermeture des théâtres et des cinémas, qui écarte encore de nos vies quotidiennes les lieux où l'art se pratique, se discute, se fréquente. Et en attendant la décision, nous sommes d’ores et déjà contraints d’annuler trois des quatre lectures prévues cette semaine, en nous réservant la possibilité de vous inviter vendredi soir à un programme impromptu… Puis viendra janvier, et l’équipe d’ Adeline Rosenstein, pour jouer deux pièces tellement importantes, ou ne pas les jouer… Mais maintenir l’invitation, maintenir la porte ouverte aux artistes, maintenir le temps et l’argent alloués à leurs travaux est aujourd’hui essentiel, charge à nous d’inventer des points de rencontre souterrains entre ces œuvres, avec un public, et ces moments si durs, historiquement durs, que nous traversons collectivement. Nathalie Garraud, Olivier Saccomano et l'équipe du théâtre des 13 vents. ---------------------------------------------------------- Marc Lainé, directeur de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche Chère spectatrice, cher spectateur, Nous espérions vous retrouver le 15 décembre. Le gouvernement a finalement choisi de laisser fermer les lieux de culture. Ils sont donc sacrifiés alors que les centres commerciaux, qui brassent chaque jour une population beaucoup plus grande, ainsi que les lieux de culte sont, eux, autorisés à ouvrir. Cette décision nous semble inique et incohérente, aucun cluster n’ayant jamais été signalé dans un théâtre, une salle de cinéma ou un musée, preuve de l’efficacité du protocole sanitaire mis en place dans ces lieux. C’est pourquoi l’ensemble du monde de la culture se mobilise : un référé-liberté est déposé ce jour devant le Conseil d’État pour que soit reconsidérée la situation des lieux culturels avec une ouverture dès le 15 décembre. Cependant, même si ce recours aboutit, nous sommes malheureusement contraints d’annuler les représentations de Mithridate de Racine mis en scène par Éric Vigner prévues du 15 au 18 décembre et celles du mois de décembre de Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière mis en scène par Guillaume Bailliart. Bien que nous fassions preuve d’une grande réactivité depuis le début de la pandémie, présenter un spectacle au public demande du temps de préparation pour les équipes technique et administrative, comme pour les équipes artistiques. Nous attendons maintenant une réponse claire de la part du gouvernement afin de savoir si nous pourrons rouvrir dès la rentrée du mois de janvier. Nous vous tiendrons informé.e.s dans les prochains jours. Marc Lainé et l’équipe de la Comédie de Valence. .----------------------------------------------------- Clément Poirée, directeur du Théâtre de la Tempête (Cartoucherie) "Resituer notre colère... " Cher public, Nous ne pourrons donc pas vous retrouver dans l’immédiat, ni même prendre date sans craindre de faire faux bond. Cette situation est profondément injuste. Elle relève d’une inégalité de traitement devant la loi. Les commerces ont rouvert leurs portes. Pourquoi pas les lieux artistiques ? Pourtant, nous respectons scrupuleusement les normes sanitaires : distanciation, port du masque, désinfection, aération. Je doute fort qu’une représentation journalière réunissant un nombre limité de spectateurs regardant en silence, dans la même direction, soit plus dangereuse que le flux ininterrompu de consommateurs dans un centre commercial tout au long d’une journée par exemple. Les lieux de cultes eux aussi ont pu rouvrir. Ce choix injuste est incompréhensible, malheureusement il n’est pas incohérent. Il s’inscrit sur une échelle de valeur nouvelle, édictée sans égards pour les principes républicains. On y hiérarchise les activités en fonction de leur utilité : être essentiel ou ne pas être. Au bas de cette échelle, on retrouve pêle-mêle les arts, la convivialité et la jeunesse estudiantine. Faisons l’expérience, fort difficile en ces temps d’épidémie bien réelle et ravageuse, d’oublier un instant les circonstances. Que dire du tableau que nous offrent les orientations politiques de ces derniers mois ? Une société en état d’urgence prolongé qui restreint massivement les libertés, gangrénée par la violence d’état, se détournant des arts et de la jeunesse, proposant à l’un de l’argent et des larmes de crocodiles, à l’autre, des psychiatres. Est-ce incohérent ? Toute ressemblance avec des régimes ayant existé est, soyez-en sûrs, fortuite. Il ne s’agit pas ici de parler politique politicienne mais bien de resituer notre colère qui dépasse l’inquiétude légitime que nous ressentons pour le vivier bouillonnant des compagnies indépendantes qui sont la richesse, la diversité et le garant de la liberté de notre pratique aujourd’hui gravement fragilisée. Ces compagnies se trouvent dans l’impossibilité de jouer et par là même de diffuser leur spectacle, et bien souvent aussi, d’amorcer leur création future. Cela signifie qu’elles subiront les conséquences des fermetures sur les deux, trois voire quatre années à venir. Combien d’entre elles seront encore debout alors ? Cette période est dure pour tous et nous pensons à vous qui êtes privés de votre activité artistique de spectateurs. Elle est aussi éclairante, et nous décille : l’art est toujours intempestif, il n’est pas socialement utile – et d’ailleurs utile à qui ? à quoi ? Il est le lieu du divertissement, du doute, du paradoxe. Les temps sont graves, le théâtre ne l’est pas ; il est fondamentalement jeu et légèreté. Nous revendiquons cette fonction même : désordonner joyeusement notre représentation du monde. C’est avec ces armes que nous attendons la réouverture. Nous respecterons les règles sanitaires et le calendrier imposé, bien entendu, mais nous ne respecterons en rien cette vision du monde qui ne sait plus espérer en son propre avenir. Clément Poirée et l’équipe du Théâtre de la Tempête. --------------------------------------------------------------------------- Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, Le Monfort, Paris Revenons sur votre allocution, Monsieur Castex, tout en sachant que vous avez pris votre décision à la hâte dans l’après-midi du 11 décembre - ce qui prouve encore une fois le peu de considération que vous nous portez. Dans un premier temps, vous rassurez les français en prenant une décision qui vous semble sage : laisser nos lieux fermés en raison des chiffres de contamination en hausse. Pas d’objection : nous suivons scrupuleusement l’actualité, nous sommes d’accord avec vous, un objectif sur deux n’a pas été atteint, la barre des 5 000 contaminations. Vous évoquez une réouverture dans 3 semaines, ce qui n’est pas complètement contestable au regard de ces chiffres, nous en convenons. La décision est douloureuse déstabilisante, difficile à accepter. Nous nous sommes tous battus pour offrir une fin d’année plus réjouissante et moins anxiogène aux spectateurs. Les équipes artistiques et techniques avaient déjà réintégré nos salles, nous étions tous prêts ! Mais nous vous suivons, il faut que cette pandémie disparaisse au plus vite. Dans un second temps, vous employez ces mots « revoyure le 7 janvier ». Ce qui nous laisse perplexes. Que voulez-vous nous dire exactement ? Vos éléments de langage ne sont pas très clairs. Le 20 janvier est aussi évoqué. Ouvrons-nous donc dans 3 semaines, ou encore plus tard ? Alors que vous disparaissez des écrans, nous nous empressons de joindre l’Elysée qui nous précise qu’une réouverture est seulement « probable » à partir du 20 janvier, soit presque 7 semaines plus tard … Coup de massue. La colère nous envahit. Si, depuis le début de la crise sanitaire, le milieu culturel s’est adapté à toutes vos injonctions et a respecté toutes les mesures à la lettre, pour la première fois, nous réagissons et faisons entendre notre voix : trop, c’est trop ! Arrêtez de nous infantiliser, de nous mépriser. Vos mensonges sont inadmissibles et portent atteinte à la crédibilité de la parole publique. Ayez au moins l’honnêteté d’assumer votre position : en l’occurrence, celle d’avoir fait un choix politique (et certainement pas sanitaire). Assumez les contradictions flagrantes qui sautent aux yeux de tous : rouvrir les lieux de culte (à croire que nous ne sommes plus dans un pays laïque ?), les grandes enseignes commerciales, laisser les gens s’entasser dans les transports pour travailler et consommer … mais taxer la culture de « non essentielle » à la nation et lui faire quasiment porter la responsabilité de la crise sanitaire. Chercher à nouveau à nous calmer avec des aides financières publiques, pour faire face à des salles closes ne suffit pas (nous vous laissons imaginer la souffrance de notre équipe permanente qui alterne entre chômage partiel et travail en urgence pour l’ouverture tant attendue de mi-décembre). C’est le sens même de nos métiers, nourri par la passion et le lien avec les spectateurs et les artistes, que nous sommes en train de perdre, Monsieur Castex. Et il faut bien l’avouer, la charge de travail va fatalement se réduire dans les mois à venir si cela continue ainsi … Vous avancez trois arguments : - Le premier : le risque majeur d’attraper le covid dans nos salles. Celui-ci est réfuté par de grands médecins sur toutes les antennes, qui constatent la rigueur des protocoles sanitaires mis en place par les lieux culturels pour accueillir le public. Il semblerait que le corps médical soit écouté quand cela vous arrange … - Le deuxième : ce n’est en fait pas nos salles elles-mêmes qui sont le danger (puisque qu’aucun foyer ne s’y est déclenché) mais le « flux » de personnes qu’elles occasionnent. C’est peut-être la seule chose que nous apprécions encore dans votre gouvernance, votre sens de l’humour malgré vous ! « Je vous invite à vivre un flux extraordinaire ! Les Galeries Lafayette, Métro Opéra entre 14h et 17h un samedi après-midi de décembre. C’est la libération, le bonheur. Le covid a disparu dans cet arrondissement chic de Paris. Nous déambulons dans les allées – jeunes, moins jeunes voire très âgés, le masque dans le cou. Il faut dire qu’il fait très chaud et puis ça donne un certain style ! On se regarde de nouveau, on se sourit, on est heureux, les vêtements s'entassent dans les cabines d’essayage. Au vu de la situation et pour être aussi nombreux, c’est certain, nous sommes en sécurité maximale. Concernant l’ascenseur qui mène au parking, c’est un futur gag pour grand humoriste : nous sommes entre 10 et 12 personnes tassées, les sacs pleins les bras, les enfants ne portent pas de masque et hurlent après avoir déambulé plusieurs heures au milieu de cette foule compacte, le visage écrasé sur les parois de l’ascenseur jamais désinfecté et qui fait le manège du 1er au 5e sous-sol depuis 9h du matin … C’est effectivement extraordinaire de vivre ces moments qui nous manquaient tant. » - Enfin, le troisième : rester fermé en décembre, pour mieux ouvrir en janvier. Soit une parfaite contradiction avec vos discours sur les fêtes de fin d’année qui feront presque inévitablement remonter le niveau des contaminations. Alors s’il vous plaît, cessez de nous décrédibiliser face aux français et à nos spectateurs, qui continuent à nous soutenir. Nous sommes respectueux de la République, responsables, nous avons su protéger nos maisons, nos équipes permanentes, le public, les artistes et toute la chaîne de nos différents corps de métiers, costumier.e.s, régisseu.ses.rs, ingénieur.e.s son et lumière... et toutes les professions invisibles. Les protocoles sanitaires que vous nous avez imposés ont tous été respectés et nous n’avons demandé aucun traitement de faveur. Nous ne sommes pas dans le complotisme ou toute autre forme de déni face à cette terrible crise sanitaire. Mais ne nous incitez pas trop à être désobéissants. Cette décision est absurde et injuste. Nous serons donc fermés car nous ne sommes pas un secteur assez fiable et nous ouvrirons au mieux le 20 janvier (peu probable), ou peut-être en février, au pire après les élections présidentielles en 2022 ! “ Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel et toute l'équipe du Monfort Théâtre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2020 5:36 AM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama 16/12/2020 La vibration unique d’une salle remplie, les échanges d’émotions intenses avec les spectateurs, le don de soi, ce que l’on reçoit : le comédien Denis Podalydès comme l’actrice-chanteuse Ludmilla Dabo sont dans les starting-blocks pour retrouver la scène. Dès que possible. Sentir l’ombre peuplée d’âmes vibrantes, respirer ensemble, deviner les sourires ou entendre l’émotion sourdre dans le silence… Autant de sensations précieuses que les acteurs désirent ardemment retrouver. Joie la plus grande de leur métier, sans doute, que cette relation avec le public — instinctive et viscérale, propre à leur art si vivant. Mais pourtant déséquilibrée. Car si l’un avance sur scène à visage découvert, l’autre se niche avec volupté dans l’obscurité. Comment les comédiens envisageaient-ils la fête des retrouvailles ? Denis Podalydès, 57 ans, acteur phare de la Comédie-Française, polymorphe et suractif (il a tourné dans quatre films, dont ceux d’Arnaud Desplechin et des frères Foenkinos, depuis la fin du premier confinement), n’est pas remonté sur les planches depuis mars dernier. Alors le 505e sociétaire du Français est impatient. Lui qui s’apprêtait à endosser avec délices la chasuble des médecins de Molière pour la reprise du Malade imaginaire dans la mise en scène de Claude Stratz. “Soliste sur scène, on est comme sur une île déserte, étrangement si proche et si loin du public. On a plus de mal à déterminer si le silence de celui-ci est soutien ou condamnation.” Denis Podalydès Sa « première » aurait dû avoir lieu le 25 décembre, salle Richelieu. Une date festive envisagée avec bonheur mais pas sans trac, même s’il comptait en savourer tous les instants : « Les grands rôles comiques de Molière se jouent avec la conscience du public et ce rapport direct est si fort que les spectateurs sont des partenaires : les rieurs deviennent des acteurs malgré eux. Comme je n’ai jamais vécu de période si longue sans fouler la scène, je me sens un peu rouillé. Or les rôles de Purgon et de Diafoirus demandent un engagement précis et rythmé. » La difficulté de se projeter dans l’avenir Le comédien avoue pourtant un « trac encore plus grand » à l’idée de créer début 2021, aux Bouffes du Nord à Paris, La Disparition du paysage, monologue écrit par le romancier Jean-Philippe Toussaint et mis en scène par Aurélien Bory : « Il n’y aura pas de troupe pour se sentir secouru, le cas échéant. Soliste sur scène, on est comme sur une île déserte, étrangement si proche et si loin du public. On a plus de mal à déterminer si le silence de celui-ci est soutien ou condamnation. » Il travaille son futur solo sans trop oser se projeter dans l’avenir. « Par superstition » : il avoue avoir été tellement « douché » par les arrêts et reprises successifs. Mais, à cette joie des retrouvailles, même teintée d’angoisse, il ne renoncerait… « pour rien au monde » ! “Nous, artistes de la scène, sommes le miroir déformant dans lequel les spectateurs aiment se regarder. Et nous-mêmes, sans lui, ne sommes rien !” Ludmilla Dabo On sent la même fébrilité chez Ludmilla Dabo. Actrice-chanteuse surdouée de 34 ans et meneuse de revue d’Une femme se déplace — comédie musicale concoctée par le metteur en scène David Lescot —, elle fut stoppée net dans son élan, à la mi-octobre, en pleine tournée. D’autant plus « fauchée en plein champ » qu’elle a ensuite attrapé le Covid-19 et s’est recluse longtemps, par précaution. La perspective de reprendre le spectacle est pour elle une « libération et une immense joie ». Partagées par une équipe de techniciens et d’interprètes (une quinzaine) qui n’attend que ça « pour finir avec grâce une année bouleversante ». Car il y est question d’une femme qui réinvente sa vie : « L’héroïne cherche dans son passé à quels endroits elle aurait manqué de légèreté ou d’autodérision pour envisager son existence avec moins de pression. Une dynamique idéale, au moment où il s’agit d’interroger nos manières de vivre ! Le public sort en fredonnant et j’ai hâte de lui offrir cela à nouveau. Nous, artistes de la scène, sommes le miroir déformant dans lequel les spectateurs aiment se regarder. Et nous-mêmes, sans lui, ne sommes rien ! » Emmanuelle Bouchez - Télérama Légende photo : L’actrice-chanteuse Ludmilla Dabo rêve de repartir en tournée pour défendre la comédie musicale de David Lescot, Une femme se déplace. Photo Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2020 1:31 PM
|
Par Louisa Benchabane dans Le Monde 16/12/2020 Le personnel des théâtres a travaillé « sans relâche » pendant le second confinement pour préparer la réouverture à l’origine prévue le 15 décembre. Mais l’annonce de la prolongation de la fermeture a plongé leurs salariés dans une profonde détresse. Gérant de La Boîte à Rire, un petit théâtre lillois de comédie, Sébastien Martinez ne cesse de compter les pertes. Plein d’optimisme à l’annonce d’une réouverture probable le 15 décembre lors de l’allocution d’Emmanuel Macron sur les modalités du déconfinement, il avait rallumé les projecteurs de la salle, qui compte 39 places, pour accueillir son futur public. Les tracts et les affiches des représentations à venir, fraîchement sorties des rotatives d’une imprimerie du Nord, n’attendaient qu’à être distribuées pour attirer les spectateurs pendant la période des fêtes de fin d’année. « Mais elles ne serviront plus jamais », déplore Sébastien Martinez, qui les a rangées comme un triste souvenir. Son enthousiasme a été freiné jeudi 10 décembre, lorsque le premier ministre Jean Castex a annoncé que les lieux culturels garderaient finalement portes closes, au moins jusqu’au 7 janvier. Face à la persistance de l’épidémie et au risque d’une nouvelle flambée du nombre de contaminations lors des fêtes de fin d’année, l’exécutif veut « éviter d’accroître les flux, les concentrations, les brassages de public », a justifié Roselyne Bachelot, la ministre de la culture. L’annonce a provoqué la colère et la frustration du monde de la culture, qui pointe le contraste frappant avec les grandes surfaces et boutiques, qui accueillent de nouveau leurs clients depuis le 28 novembre. Les professionnels et syndicats du secteur dénoncent « une mise à mort » et réclament la réouverture de tous les lieux culturels, faisant valoir la mise en place d’un protocole sanitaire strict auprès de la ministre. Lire notre analyse : La fermeture prolongée des lieux culturels, inéquitable et inquiétante Etre prêts à « tout annuler » du jour au lendemain Pour appeler le gouvernement à l’aide, la CGT-Spectacle a organisé mardi plusieurs rassemblements dans toute la France. A Paris, quelque 3 500 professionnels du monde de la culture ont manifesté sur les marches de l’Opéra Bastille, puis plusieurs dizaines d’entre eux devant le théâtre de l’Atelier à Montmartre. Parmi eux, nombreux étaient ceux qui se disaient déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu’à la réouverture des lieux culturels. Syndicats et artistes ont annoncé saisir le Conseil d’Etat, via un « référé liberté », une procédure d’urgence. Car tous sont allés jusqu’à l’épuisement pour préparer la réouverture le 15 décembre dans le respect des normes sanitaires. En vain. Récit : A Lyon et Villeurbanne, les élus réclament la réouverture des lieux culturels dès le 15 décembre Au milieu de la foule parisienne, à Bastille ce mardi, François Lecour brandit une pancarte bleue, aux couleurs de la scène nationale de l’Essonne dont il est secrétaire général : « la ministre de la culture nous avait envoyé tous les signaux pour que l’on puisse rouvrir, alors on s’est attelé à la tâche pour pouvoir travailler pendant la période des fêtes », s’indigne-t-il. Pendant le confinement, malgré la fermeture au public, le théâtre public est resté ouvert aux salariés. De la billetterie à la technique, toutes les équipes étaient sur le pont pour continuer d’informer les clients en vue de l’ouverture. Une cadence de travail « plus intense » qu’à l’accoutumée, décrit Mariame Diop, chargée de production au sein de la même structure. Chaque jour, elle emprunte les transports bondés pour se rendre dans les locaux du théâtre vide. Dans sa boîte mail, une cinquantaine de messages quotidiens, tous urgents, venant d’artistes et de compagnies. « Il faut que je confirme des contrats et que je sois prête être à tout annuler dans la foulée, explique Mme Diop. On ne s’ennuie jamais. » Désormais rodée aux procédures d’annulation, elle a pris l’habitude de rédiger les contrats et leurs avenants en même temps. « On écoute, on rassure aussi et on met un point d’honneur à payer les artistes pour les commandes passées », souligne-t-elle. Un financement plus facile pour les théâtres subventionnés, « moins soumis au risque de fermeture », confie François Lacour. Car les annulations ou reports de spectacles, qui n’ont fait que s’enchaîner, vont de pair avec le remboursement de la clientèle et pèsent sur le budget des théâtres. « Notre quotidien était de faire et de défaire : on vendait le spectacle aux clients, puis on devait les rappeler pour annuler quelques jours plus tard », explique Maxime Bailly, employé à la billetterie du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Pour maintenir un lien avec le public, plusieurs salles subventionnées ont organisé des représentations et des lectures consultables sur Internet, une mission supplémentaire pour les équipes techniques en charge de la scénographie. « On avait sûrement deux fois plus de choses à faire qu’avant, entre la mise en œuvre d’un protocole draconien dans la salle, la captation des spectacles et leur diffusion », décrit le directeur technique de la scène nationale de l’Essonne, Jean-Louis Martineau, pour qui les représentations enregistrées à huis clos sont une première en 25 ans de carrière. La valse de l’incertitude Le directeur du Théâtre Firmin-Gémier-La Piscine d’Antony et de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) navigue lui aussi à vue. Depuis un mois, Marc Jeancourt et son équipe visaient une réouverture en décembre. La programmation n’a cessé d’être bouleversée. « Les trois quarts de nos projets, sur lesquels nous avons abouti pendant le confinement, tombent à l’eau. Maintenant, nous devons arbitrer entre les reporter tous à la saison prochaine, ou bien attendre une décision claire. » L’incertitude, jusqu’ici diluée dans « beaucoup d’espoir », a refait surface chez le directeur, attristé par la grande précarité qui s’installe dans le paysage artistique. C’est avec impuissance qu’il observe le départ d’une compagnie de cirque, dont il avait réservé les services un an plus tôt. La troupe du collectif Baraka a installé son chapiteau le mardi 8 décembre à Antony, où elle devait donner ses premières représentations une semaine plus tard. « On était impatients de retrouver la scène et le public », témoigne Olivier Pasquet, l’un des artistes du spectacle qui avait été adapté afin de répondre aux normes sanitaires. « Défaire le chapiteau sans y avoir vu de spectacle, c’est une première. On ne voit même pas le fruit de notre travail », déplore Hakim Galie, régisseur du théâtre, agacé par la volte-face de l’exécutif. D’ordinaire, le stress et la fatigue que génère l’installation se dissipent dès que les comédiens foulent la scène et que le public les acclame. « On s’était activé juste pour pouvoir revivre cette adrénaline qui nous manquait », insiste le régisseur. « On a encore six mois de trésorerie » D’autres, comme Jean-Marc Dumontet, directeur de théâtres prestigieux comme le Point-Virgule ou le théâtre Antoine à Paris, n’ont même pas imaginé rouvrir, dissuadés par les pertes financières qu’une telle décision pouvait entraîner en cas de revirement. M. Dumontet garde les yeux rivés sur les chiffres de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Des chiffres qui le guident dans toutes ses décisions. Pour lui, « le 15 décembre était une illusion ». « Pour que l’on retrouve notre public, il faut que l’épidémie soit derrière nous », ajoute-il. Un report qui n’assombrit pas les perspectives de cette grosse machine dont la trésorerie permet de passer sans trop craindre la tempête. M. Dumontet annonce mettre à profit la période pour découvrir de nouvelles pièces et artistes qui pourront fouler ses planches une fois l’épidémie passée, tout en suspendant plusieurs répétitions. « C’est illusoire et vain d’avancer un travail si on ne sait pas quand on va le délivrer », estime M. Dumontet, prudent dans ses dépenses. Le directeur a confiance en son public d’habitués, qui « reviendra » lorsque les portes rouvriront. Un optimisme déjà entamé dans les plus petits théâtres qui, eux, craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Lors du premier confinement, La Boîte à Rire a frôlé la faillite avant de se relever grâce au soutien de son public, qui s’est mobilisé autour d’une cagnotte solidaire. « On a encore six mois de trésorerie devant nous grâce à eux, aux comédiens professionnels qui ont fait don de leur cachet en juin et aux aides de l’Etat, mais on n’attend que la réouverture, c’est insoutenable de ne pas pouvoir jouer », signale Sébastien Martinez. Pour tenter de calmer la grogne, le premier ministre a confirmé qu’une « rallonge de 35 millions d’euros » serait accordée au secteur de la culture. Mais comme la scène lilloise, de nombreux lieux de spectacle plaident surtout pour une réouverture au plus vite, avant qu’une nouvelle vague de Covid-19 vienne balayer encore fois leurs efforts et fasse vaciller ce secteur déjà dans la tourmente. Louisa Benchabane Légende photo : Les professionnels de la culture ont manifesté, mardi 15 décembre, pour protester contre le report de la réouverture des salles de spectacle. THOMAS COEX / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2020 5:29 PM
|
par Véronique Hotte dans son blog Hottello 15/12/2020
Giordano Bruno, Le Souper des Cendres, adaptation et mise en scène de Laurent Vacher, à partir des textes de Giordano Bruno et des minutes de son procès.
Giordano Bruno, Le Souper des Cendres, adaptation et mise en scène de Laurent Vacher, à partir des textes de Giordano Bruno et des minutes de son procès. Musiques de Clément Landais, à la contrebasse. Avec Benoit Di Marco.
Dès la fin du XVI è siècle, porté par une intuition inouïe, Giordano Bruno (1548-1600) affirme avec détermination ce sur quoi étudient encore et toujours actuellement les astronomes contemporains : « un nombre infini de soleils existent, un nombre infini de terres tournent autour de ces soleils, des êtres vivants habitent ces mondes… ».
La Terre n’est plus le centre du monde et, dans le cosmos, l’homme sort enfin de l’ombre pour voir les étoiles – la lumière. L’écriture du Souper des Cendres, raconte Laurent Vacher, s’immisce dans la philosophie et l’histoire des sciences, de l’astronomie et des religions, afin de comprendre l’époque, les idées qui la traversent et la violence de l’Eglise.
Le génial novateur de la pensée est répudié par sa hiérarchie; il part en exil à Genève, Toulouse, Paris et Londres, avant de se réfugier en Allemagne, pour revenir enfin en Italie, à Venise, où il est arrêté par l’Inquisition et transféré à Rome où se tient son procès.
Il ne consent pas au choix alternatif que lui tend l’Eglise, celle de l’abjuration, une trahison. Le Nolain – originaire de Nola – ne s’y résoudra jamais, tentant inlassablement d’attirer ses détracteurs sur le terrain objectif de la science, en vain, jusqu’au bûcher de l’Inquisition :
« J’aspire sans varier, sans me lasser, au but de ma carrière.
Je sens mes souffrances, mais les méprise, je ne recule point Devant le trépas et mon coeur ne se soumettra à nul mortel. » écrit-il.
Prêtre rebelle, visionnaire et philosophe, réformateur et insoumis, Giordano Bruno s’accroche à ses convictions « révolutionnaires », quand bien même celles-ci bafouent le dogme de l’époque, une posture impensable pour l’Eglise qui chasse les « hérétiques ».
Le Souper des Cendres s’impose comme un plaidoyer contre l’intolérance et l’obscurantisme, faisant le récit d’une pensée révoltée, qui propulse en même temps un homme à la découverte du monde dans une Europe en pleine guerre de religions.
En 2002, le metteur en scène Laurent Vacher avait créé Des Signes des temps, spectacle déambulatoire sur Giordano Bruno déjà; le Nolain était en errance à travers l’Europe. La nouvelle création offre un point de vue autre, depuis la cellule du condamné, l’impasse à laquelle il est réduit par les tenants du dogme, et prenant la décision de ne rien abjurer.
Arrêté en 1592, il passe huit ans en prison, avant d’être placé dans sa cellule romaine ultime, le 8 février, dans laquelle il « voit » mentalement sa défense, à partir de son seul raisonnement et de la science. Le 17 février 1600, il est livré au bûcher de l’Inquisition, une planche de bois clouée sur la langue pour avoir proféré ce qui ne saurait être pensé : la Terre n’est plus un centre mais une planète appartenant à un système, une planète douée d’une force interne, relative à son évolution dans l’infini, tournant à la fois sur elle-même et tournant autour du soleil, d’où le cycle régulier des saisons selon les positions.
Une cellule monastique de dépouillement et d’austérité impose l’ombre tandis que la lumière – métaphore de la cosmologie – perce l’obscurité, donnant à voir la vie mouvante.
Incarné par le comédien Benoit Di Marco – à la fois figure réfléchie et emportée, en même temps que convaincue de la force existentielle de ses propos émancipateurs -, le philosophe et scientifique vit une libération, un sentiment d’ivresse face au vide vaincu.
La dernière journée au fond de sa cellule est vécue par le condamné à la façon d’un combat dont l’arme est le verbe : il a écrit son oeuvre en moins de dix ans (1582-1591).
Une écriture précise et vivante qui met à mal le mensonge et l’ignorance, usant d’images poétiques, parfois crues qui désignent ainsi, comme des ânes, ses ennemis incapables de toute réflexion objective hors du carcan de la religion. Des animaux qu’il ne méprise pas pourtant : il est né non loin de Naples, à Nola, au pied du Vésuve, d’où le feu qui l’élance.
L’élaboration de son discours ultime suit les mouvements d’une pensée entre doutes et tempêtes, un discours mental construit sans papier ni crayon, depuis « l’art de la mémoire », discipline dont il est exemplaire, sachant par coeur maints longs textes érudits.
Mouvements d’humeur et caractère emporté, impétueux et haussant aisément le ton, le discoureur suit un raisonnement courageux et frondeur qui ne peut que forcer l’admiration.
Au côté du comédien pris par les pleins et les déliés d’une pensée articulée dans le temps même où elle s’énonce, résonne la contrebasse du musicien Clément Landais. La capacité d’expression humaine de l’instrument – fantaisie et gravité – prolonge la fluidité des propos, telle une entrée en résonance et en écho avec l’infini en question. La musique et ses vibrations semblent faire physiquement partie de la compréhension de l’univers.
Mystère, vie bouleversée et résistance, la mélodie mène à une autre plus sentie – l’univers infini qui brise le dogme et accorde la liberté à une pensée et à une réflexion autonomes.
« Six planètes ont été placées par Ptolémée autour de la terre, plus le soleil et la lune, puis la sphère des étoiles fixes. Chaque planète a été placée et ordonnée comme une partition parfaite où chaque note semble être à sa place », rapporte Laurent Vacher.
Un spectacle grave et lumineux, vif et tonique, infiniment poétique et politique, qui stimule naturellement, de façon implicite, la perspective urgente de sauvegarde de notre planète.
Véronique Hotte
Spectacle vu le 14 décembre à La Reine blanche, scène des Arts et des Sciences, 2 bis passage Ruelle 75018 Paris. En tournée en 2021…
Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 13, 2020 3:00 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde le 13/12/2020 Les confinements et les couvre-feux dus à la pandémie en 2020 poussent les lieux à s’interroger sur l’amplitude de leur ouverture au public.
Les théâtres resteront portes closes au moins jusqu’au 7 janvier 2021. Ils avaient espéré rouvrir le 15 décembre, mais leur espoir a été douché par les mauvais chiffres de l’épidémie de Covid-19 qui ont poussé le gouvernement à maintenir la fermeture des lieux culturels. En réalité, pour bon nombre de théâtres subventionnés, ces trois nouvelles semaines d’arrêt ne correspondent qu’à une semaine sans lever de rideau pour le public. En effet, l’immense majorité des centres dramatiques nationaux (CDN) et une très grande partie des scènes nationales allaient, quoi qu’il en soit, être fermés pendant les vacances scolaires, comme c’est le cas chaque année. Les deux confinements de 2020, qui ont contraint les lieux à réorganiser sans cesse leurs programmations, n’avaient pas pour autant modifié le calendrier traditionnel de fermeture. Mais la crise liée au Covid-19 pousse les lieux à s’interroger sur l’amplitude de leur ouverture au public. « Les vacances scolaires sont très souvent des moments de créations et de résidences d’artistes. Pour cette fin d’année, il y avait peu de changement de planning de représentations, uniquement quelques ajustements qui permettaient de profiter de cette fenêtre entre le 15 et 22 décembre avant la reprise, qui était prévue autour du 6 ou 12 janvier », constate-t-on à l’Association des centres dramatiques nationaux après un sondage auprès des trente-huit centres répartis sur le territoire. En dehors de celui de Vire (Calvados), qui prévoyait de maintenir la deuxième édition de son festival Les Feux de Vire, du 26 au 28 décembre, seul le CDN de Nice devait rester ouvert jusqu’au 31 décembre. « Ce n’était pas une habitude ici, explique Muriel Mayette-Holtz, à la tête du Théâtre national de Nice depuis novembre 2019. Mais on a tellement enchaîné de difficultés que des liens de solidarité ce sont créés, et cela avait été facilement accepté par l’équipe. » « Pas le moment de tout bousculer » Au CDN de Normandie-Rouen, la question d’ouvrir pendant les vacances de fin d’année « ne s’est pas posée », assure son directeur, David Bobée. « JoeyStarr va venir répéter comme c’était prévu. Le personnel permanent du théâtre est très perturbé, a besoin de repos. Ce n’était pas possible de les mobiliser à nouveau pour tout chambouler sur des calendriers pensés depuis un an. Il ne fallait pas ajouter de la crise à la crise », estime le metteur en scène. A Toulon, Charles Berling, directeur de la scène nationale Châteauvallon-Liberté, a interrogé ses administrateurs sur la possibilité d’un prolongement de la programmation pendant les fêtes. « J’avais obtenu une ouverture jusqu’au 20 au lieu du 18 décembre, mais pas au-delà. Les gens sont tendus, fatigués, ce n’était pas le moment de tout bousculer, argumente-t-il. Les équipes ont été très mobilisées pour faire et défaire la billetterie. J’ai pesé le pour et le contre et ne voulais pas rouvrir à tout prix. Je préférais me battre pour la motivation de l’équipe plutôt que pour ces dix jours. » Sans compter que les théâtres publics « se heurtent aussi au droit du travail », ajoute le comédien, les congés et RTT étant pris pendant les vacances scolaires. « Pourquoi ne pas ouvrir pendant les vacances, lorsque le public est davantage disponible ? C’est une bonne question, reconnaît Frédéric Maurin, coprésident du Syndicat national des scènes publiques. Même si c’est compliqué pour les équipes, le service public des arts et de la culture se doit de remplir au mieux sa mission. » A la faveur de la crise engendrée par le Covid-19, « de plus en plus d’opérateurs s’interrogent sur le rythme de nos maisons, et notamment sur les fermetures pendant les congés scolaires, poursuit M. Maurin. Mais cela a des conséquences en termes de budget et de ressources humaines ». Déjà, à l’issue du premier confinement, peu de lieux avaient ouvert pendant l’été. Néanmoins, un peu comme s’est posée la question de l’ouverture des bibliothèques le dimanche, le débat est désormais ouvert sur l’étendue du calendrier des théâtres publics. « A situation nouvelle, réponses nouvelles » Interrogez Emmanuel Demarcy-Mota sur l’ouverture des théâtres pendant les vacances scolaires et vous ne l’arrêtez plus. « La crise est un révélateur et un accélérateur des carences du système, insiste le directeur du Théâtre de la Ville, à Paris. Il est indispensable de travailler aux modifications structurelles de nos institutions dans le temps présent, car cela permettra de construire le temps d’après. A situation nouvelle, il faut des réponses nouvelles. » Au Théâtre de la Ville, qui a fait le choix de rester ouvert cet été et avait prévu plusieurs spectacles pendant les fêtes pour tous les âges, « les priorités ont été réarbitrées dans une démarche de solidarité avec les artistes, défend Emmanuel Demarcy-Mota. Nous avons utilisé une partie du budget que nous consacrons habituellement à la communication, aux pots de première et aux voyages à l’étranger pour découvrir de nouveaux artistes – bref, tout ce qui a été stoppé à cause du Covid –, pour soutenir les intermittents ». Au CDN de Nice, des propositions ont aussi été faites aux spectateurs pendant tout l’été en extérieur. Et deux spectacles auraient dû se jouer jusqu’au 31 décembre : du théâtre avec Chat en poche, de Georges Feydeau, et de la magie avec Larsene magie. « Du fait de la situation, on avait densifié notre calendrier. L’équipe avait conscience qu’on jouait notre avenir en faisant cela, il y avait une grosse envie de rester vivant, sinon on avait l’impression de ne pas être nécessaire », souligne Muriel Mayette-Holtz, pour laquelle « il est logique de jouer pendant les fêtes ». Mais, reconnaît-elle, « c’est grâce à la présence d’une troupe sur place et parce que c’est moi qui fais la mise en scène du Feydeau qu’on a pu réagir très vite ». Emmanuel Demarcy-Mota en est persuadé, « l’année 2020 restera comme un pli dans l’histoire. On ne peut pas en ressortir à l’identique en reprenant les pratiques d’avant. Nos institutions, notre système doivent avoir l’humilité de se réinventer ». De cette crise sans précédent, qui va entraîner un fort embouteillage avec les spectacles reportés sur la saison 2021-2022, émergeront de nouvelles questions. Et Frédéric Maurin de lister tout ce qui pourrait sortir de « positif » de cet annus horribilis : « Il faut réinterroger notre rythme de travail, se questionner sur la possibilité de semestrialiser nos programmations, ouvrir davantage nos séances à un public occasionnel, de non-abonnés, et inventer de nouvelles propositions artistiques, notamment dans les espaces publics. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 12, 2020 7:39 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 8 décembre 2020 La Tempête de William Shakespeare, nouvelle traduction et adaptation de Clément Camar-Mercier, mise en scène de Sandrine Anglade.
La Tempête de Shakespeare, avant-dernière pièce avant Henri VIII, jouée à la cour de Jacques Ier en 1611, est une comédie-féérie tragi-comique et pastorale publiée en 1623. L’époque est à la découverte du globe par la mer, à la recherche philosophique et à la littérature de la Renaissance, le monde des modernes se superposant à celui des anciens. Exilé sur son île depuis douze ans avec sa fille Miranda, Prospéro, duc de Milan et magicien, déclenche une tempête, conduisant un bateau au naufrage. A son bord, Antonio, frère de Prospéro qui a usurpé son pouvoir, Alonso, roi de Naples, et Ferdinand, fils de ce dernier, et d’autres hommes honnêtes ou plus douteux mêlant sérieux et comédie. La magie du conte se mêle à la critique des excès et des mensonges, en appelant aux valeurs de tolérance et de compassion. Les humains s’acheminent vers la vertu, le salut et la mort finale à travers les obstacles et les péripéties de la vie : « (…) nous sommes de l’étoffe/ Dont les rêves sont faits, et notre vie/ Infime est entourée par un sommeil. » L’île de Prospéro est un théâtre dans le théâtre, le lieu de l’illusion extrême, car metteur en scène et manipulateur, il crée sa comédie sur le plateau avec l’aristocratie et le peuple. Une île à la fois allégorique et poétique et théâtre du monde – vents violents et tempêtes. Dans cet exil, près de ses livres, le magicien a acquis maturité et sagesse. Lucide sur son erreur – le goût de l’étude l’ayant conduit à délaisser le gouvernement de Milan au profit de son frère -, il pardonne à ses anciens ennemis qui avaient su mal négocier cette faute. Indépendant et puissant grâce à la « prescience » de sa magie, Prospéro préfère démissionner pour se fier davantage aux autres, préférant un chemin moral et existentiel. Sandrine Anglade fait naviguer le spectacle sous le pavillon d’un imaginaire heureux et festif, grâce aux soins du scénographe Mathias Baudry, avec Caty Olive aux lumières, un jeu onirique d’apparitions et de disparitions soutenu par les musiciens Nina Petit à l’accordéon et Benoît Segui aux guitares, visitant les baroques Johnson, Purcell… , et chœurs et voix solistes sous la baguette du chef de chant, Nicola Takov.. Quand gronde la tempête, les voiles se hissent – parois de plastique transparent qui jouent des éclairs et de la foudre menaçante, illuminant ou bien assombrissant un ciel indistinct. Théo Cardoso est à la création sonore, et le public est comme embarqué sur le pont, au milieu des grondements du tonnerre. Et à la baguette de la direction des vents, l’orchestrateur Prospéro, incarné avec recul et sérénité amusée, par Serge Nicolaï. Le magicien sourit à la présence de sa fille Miranda à ses côtés, père admiratif d’une jeune beauté qu’il veut conduire sur les chemins du monde et de la rencontre des autres. Marie Oppert est une Miranda ravissante, à la fois comédienne et chanteuse lyrique. Le père – narrateur et commentateur – et la fille forment un duo inattendu et convaincant. De plus, métamorphosée en clown, Marie Appert interprète également le bon Gonzalo, débarqué du bateau, dont les paroles sont pleines d’humour et de raison. Les costumes significatifs reviennent à Cindy Lombardi. L’autre figure de modération est Ariel au service de Prospéro, qui aimerait s’en affranchir, comme promis. La facétieuse Sarah-Jane Sauvegrain est un esprit sincère et libre. Elle chante avec talent et assiste à l’action, moqueuse et tranquille, dans les coulisses de scène, quand elle n’est pas opportunément sur le plateau, juchée sur des talons brillants. Figure négative, associée au mal, Caliban est réduit en esclavage par le maître de l’île. Condamné à travailler, il grogne, se plaint, ramasse du bois, plie les voiles du navire. Damien Houssier compose la voix et la gestuelle d’un être tordu et malin, alors même qu’il assume alternativement le rôle du jeune premier Ferdinand, héritier du trône de Naples. Echoué sur l’île avec les siens, il les croit morts. Pour Miranda, Ferdinand est le seul être digne qu’elle ait croisé, après son père : ils se reconnaissent un coup de foudre mutuel. Telles sont les figures heureuses ou malheureuses des habitants de l’île; restent d’autres naufragés de la dernière tempête, peu recommandables, si ce n’est le trouble Alonso – Marceau Deschamps Segura -, roi de Naples, et Gonzalo, son vieil et honnête conseiller. Les rôles de déchus ou de pauvres bougres reviennent à Sébastien et à Antonio, deux traîtres, frères des rois légitimes Alonso et Prospéro. Entre mensonges et tromperies, ils sont de faux civilisés en mal de régicide, empêchés par la magie du maître et d’Ariel. A Antonio et Sébastien correspondent encore le grotesque Trinculo et Stefano l’ivrogne – les quatre tristes sires sont joués alternativement par deux comédiens, Alexandre Lachaux et Laurent Montel -, ridicules et misérables, voleurs des vêtements du maître qui sèchent. Le divertissement final et grandiose que s’offre pour le plaisir Prospéro avec l’aide d’Ariel – spectacle dans le spectacle et image merveilleuse de scénographie inventive -, est l’apparition d’opéra du char de Junon avec Iris, Cérès, nymphes et moissonneurs. Aux prises avec le déchaînement des éléments, des mouvements et des vents, cette Tempête est bouleversante, comme attendu, grâce à d’excellents comédiens à l’esprit de troupe, spectacle qui, plus il sera joué, plus gagnera en envolée scénique, rythme, élan. Véronique Hotte Création les 13 et 14 octobre à Bayonne – Scène Nationale du Sud Aquitain. Spectacle vu au Théâtre Jacques Carat à Cachan, le 4 décembre. En tournée en 2020-2021 : à l’Espace Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan; au Théâtre de Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse; au Théâtre de l’Olivier à Istres; à la Scène 55 à Mougins; à Théâtres en Dracénie à Draguignan; au Théâtre Ducourneau à Agen; à la Comédie de Picardie à Amiens.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2020 7:11 PM
|
Par Clarisse Fabre dans Le Monde - 11 décembre 2020 En décidant de ne pas rouvrir les théâtres, cinémas et musées, et en donnant la priorité aux commerces – et aux églises –, le gouvernement offre la preuve de son désintérêt pour le secteur et fragilise les pratiques culturelles futures. Le feuilleton de la fermeture/réouverture des cinémas, mais aussi des salles de spectacle et des musées, est devenu un mauvais film à suspense. Le verdict est tombé, jeudi 10 décembre, peu après 18 heures, au terme d’un long préambule « diplomatique » et sanitaire, visant à faire passer la pilule auprès des artistes et acteurs de la culture : s’appuyant sur les derniers chiffres disponibles, délivrés par le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, le premier ministre, Jean Castex, a annoncé que les lieux culturels resteraient finalement fermés pendant trois semaines supplémentaires (jusqu’au 7 janvier 2021), au lieu de rouvrir mardi 15 décembre – le 16 décembre pour les cinémas. Certes, Emmanuel Macron avait prévenu que le déconfinement de la mi-décembre était conditionné au fait que le seuil de nouvelles contaminations quotidiennes devienne inférieur à 5 000, ce qui n’est pas le cas, le chiffre s’établissant aujourd’hui aux alentours de 11 000. Cette décision « crève-cœur » a été prise pour éviter l’effet yoyo (j’ouvre, je ferme, etc.), s’est justifiée Roselyne Bachelot, vendredi 11 au matin, sur BFM-TV, en précisant que le 7 janvier était une « date de revoyure ». Autrement dit, rien ne dit que les lieux culturels pourront rouvrir au début de l’année 2021. Pas de yoyo sous le sapin, mais pas de sifflet non plus annonçant la réouverture… Après les fêtes, la gueule de bois sera aussi culturelle. Aucun foyer de contamination Si la colère du secteur ne cesse de grandir d’heure en heure – une manifestation est annoncée pour le mardi 15 décembre à Paris, à l’initiative de la CGT-spectacle –, c’est que l’arbitrage gouvernemental prête le flanc à la critique sur plusieurs points, bien au-delà des conséquences économiques et sociales pour le secteur, déjà fortement fragilisé. Sans compter que les lieux culturels n’ont pas ménagé leurs efforts lors du premier déconfinement, le 22 juin, pour mettre en place un protocole sanitaire exigeant (masque obligatoire pendant la projection ou la représentation, jauge limitée, modification des flux, etc.). De fait, aucun foyer de contamination n’a été repéré dans les cinémas, les théâtres et les musées. Reportage au Théâtre du Rond-Point : « Il y avait devant nous un mur et je ne voyais pas comment on pouvait le franchir » Sur la forme, tout d’abord, en annonçant aux professionnels que les salles resteront fermées, presque au dernier moment, soit quatre ou cinq jours avant la date prévue de réouverture, le gouvernement témoigne d’une méconnaissance profonde – voire d’un mépris – du fonctionnement du secteur artistique et culturel. Une salle de cinéma (ou un théâtre) n’est pas un lieu que l’on ouvre ou que l’on ferme comme une boutique. La sortie d’un film se programme au moins quatre semaines à l’avance, mettant en œuvre toute une chaîne de travail (distributeur, exploitants, attaché(e) s de presse, etc.), générant aussi d’importantes dépenses, qui se chiffrent en dizaines (et parfois en centaines) de milliers d’euros. De même, pour le spectacle vivant, le théâtre doit se préparer à accueillir les équipes artistiques, le public, en plus d’embaucher les techniciens (intermittents…). Certes, le premier ministre aura beau jeu de rappeler que des mesures de soutien perdurent et que les professionnels ne sont pas, sur un plan financier, totalement laissés à l’abandon. Mais là n’est pas le seul enjeu. Question de l’équité Se pose aussi la question de l’équité. En effet, à l’appui de sa décision, le gouvernement invoque les « flux » que n’aurait pas manqué de générer la réouverture des lieux culturels. Mais a-t-on mesuré les mouvements de population qui ont suivi la réouverture des magasins, depuis le 27 novembre ? Si le critère primordial est bien sanitaire, et s’il est évident qu’il faut prévenir les risques d’une nouvelle flambée de contaminations, alors le gouvernement ne prend-il pas un risque majeur en laissant ouverts les grands magasins, dans lesquels les clients peuvent aller et venir, toucher les produits ? Pourquoi ne pas avoir établi une égalité de traitement entre les établissements, en instaurant les mêmes contraintes horaires, avec des jauges adaptées à chaque situation ? Dans une lettre ouverte, le comédien Samuel Churin a estimé que la décision gouvernementale était susceptible d’être annulée pour iniquité devant le Conseil d’Etat, si celui-ci était saisi d’un référé-liberté – le directeur du théâtre Paris-Villette, Adrien de Van, vient d’ailleurs d’annoncer dans un communiqué, vendredi 11 décembre, qu’il allait « saisir le Conseil d’Etat pour contester cette violation du principe de l’égalité des personnes devant la loi ou le règlement ». L’Eglise catholique, elle, a réussi à faire modifier le décret gouvernemental qui limitait à trente le nombre de fidèles admis lors d’une messe. Le Conseil d’Etat a estimé, le 29 novembre, que la jauge devait être calculée en fonction de la superficie du lieu, et non fixée arbitrairement – Samuel Churin note d’ailleurs, accessoirement, que les églises sont ouvertes, mais les théâtres et cinémas fermés, alors que le gouvernement défend son projet de loi sur la laïcité… De leur côté, les stations de sport d’hiver, qui ont contesté la fermeture des remontées mécaniques, n’ont pas obtenu gain de cause : ce vendredi 11 décembre, le Conseil d’Etat a donné raison au gouvernement, en relevant que l’interdiction vise à « limiter les contaminations supplémentaires occasionnées par des flux importants de déplacements » et qu’elle « ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par les requérants ». L’espoir et l’énergie rabotés Certains diront que le monde de la culture est bien naïf : il était prévisible que le gouvernement protégerait le commerce, surtout à l’approche de Noël, au détriment de la culture, considérée, de fait, comme « non essentielle » si l’on se réfère aux précédents épisodes – fermeture dans un premier temps des librairies, absence totale du mot « culture » dans une précédente allocution de Jean Castex, etc. C’est pourtant nier que la culture est un enjeu de société. Elle aide même des gens à vivre, au sens existentiel. Pendant les fêtes, les gens seuls seront encore plus seuls, et n’auront pas la perspective de partager une expérience collective. On n’oublie pas la phrase de Jean-Luc Godard : « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Il reste encore possible, à Noël, d’offrir une carte d’abonnement à un cinéma, un « pass » dans un musée ou un billet de spectacle, mais à utiliser quand ? L’incertitude quant aux perspectives de sortie du tunnel est sans doute le pire des maux, rabotant semaine après semaine l’espoir (et l’énergie) des programmateurs, des artistes et du public, sans compter l’effet boomerang, potentiellement dévastateur, à terme, sur la pratique culturelle. Légende photo : La scène de la salle principale du théâtre La Filature, à Mulhouse. SEBASTIEN BOZON / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2020 4:51 PM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks 11/12/2020 Le monde du spectacle vivant réagit pour les Inrockuptibles au report de la réouverture des salles de spectacle jusqu'au 7 janvier au moins. Le couperet est tombé jeudi 10 décembre à 18 heures lorsque le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu'en raison de la situation sanitaire les théâtres, les salles de concert et les cinémas ne rouvriraient pas le 15 décembre - elles resteront finalement fermées jusqu'au 7 janvier a minima. “C’est le désastre absolu pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle, martèle Stanislas Nordey, metteur en scène et directeur du TNS de Strasbourg. Il faut absolument que le budget pour lequel se bat la ministre de la Culture soit fléché au maximum sur les plus fragiles, les petits lieux, les compagnies, les jeunes artistes. Ce que pose cette décision, c’est une question philosophique qui concerne la société dans son ensemble. Pourquoi rouvrir les magasins et les lieux de culte avant les lieux culturels ? Mais l’énorme colère qu’on a ressentie hier, c’est la ‘close de revoyure au 7 janvier’. Ce n’est pas possible. Il faut qu’on nous donne une date. Les équipes sont épuisées, particulièrement à l’accueil, la billetterie, les techniciens qui montent et démontent les décors. On sent monter un immense ras-le-bol. L’incertitude nous tue et je réclame que ce gouvernement revienne sur sa décision en nous fixant une date de réouverture pour qu’on puisse travailler à partir de ça.” Même réaction de la part d’Emmanuel Demarcy-Mota, metteur en scène, directeur du théâtre de la Ville et du festival d’Automne à Paris. “2020…. c’est deux fois zéro, deux fois zéro, c’est-à-dire zéro partout ! C’est ma pensée du jour, il ne me reste plus que ça, réfléchir sur ce chiffre magique. En plus, comme on a découvert hier qu’être testé négatif, c’est positif, on a vraiment atteint le sommet… On a compris qu’on ne sait plus rien, c’est l’année de René Descartes, le doute métaphysique absolu sur l’existence. Ce que je pense de la déclaration du gouvernement d’hier ? On a vraiment une problématique de représentation de la parole… On avait tout organisé pour que le théâtre de la Ville puisse être ouvert pendant la période des fêtes. Dans ce que nous défendons, il est essentiel que les théâtres qui défendent une mission de service public la tiennent en montrant leur capacité d’ouverture. Le monde de la culture se doutait que ça ne se passerait peut-être pas comme on le souhaitait et on avait anticipé le risque que tout s’arrête à nouveau, mais on est sidérés par la manière dont ça arrive. Il ne s’agit pas de se lamenter sur son propre sort, mais de se dire : qu’est-ce qu’on va pouvoir construire ? Cela génère beaucoup d’incompréhensions devant des contradictions flagrantes : certains lieux ouverts, d’autres fermés.” Les théâtres se réorganisent Passée la sidération des annonces, lui et ses équipes ont travaillé jusqu’à 4 heures du matin pour réorganiser la programmation du théâtre de la Ville. Presque une habitude : c’est la troisième période d’annulations et de remboursements cette année : 64 représentations étaient prévues entre le 15 décembre et le 7 janvier, pour neuf spectacles. Total : 15 000 places à rembourser. Du 13 mars au 21 juin, c’étaient 46 spectacles annulés pour 200 représentations, et du 30 octobre au 14 décembre, 27 spectacles annulés pour 130 représentations. Finalement, l’année se sera passée à trouver des reports pour les spectacles annulés, à accompagner les artistes. Idem pour le festival d’Automne à Paris. Depuis hier soir, des solutions de reports pour les spectacles qui devaient se jouer à partir du 15 décembre sont à l'étude. Mais pour autant, il se passera des choses au théâtre de la Ville pendant les fêtes de Noël. Des spectacles seront filmés en direct et visibles par le public sur le site du théâtre. Alice traverse le miroir de Fabrice Melquiot, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota sera visible par 500 écoles sur le territoire lors du direct programmé le 18 décembre à 10h du matin, et pourra ainsi toucher 30 000 enfants. Un autre direct du spectacle est prévu le 19 décembre dans le cadre d’une convention avec les hôpitaux pour les enfants malades. La compagnie de danse d’Hofesh Shechter, dont le spectacle Political Mother Unplugged est annulé pour la deuxième fois, jouera également en direct. Mais surtout, deux projets se sont élaborés dans la nuit, soutenus par la Mairie de Paris : “Le 23 décembre, on va organiser une scène extérieure de 10h à 18h pour fêter Noël de manière artistique où tous ceux qui sont empêchés de travailler seront invités à présenter leur travail durant 10 à 30 minutes. Et le 31 décembre, ce sera une Nuit du théâtre où nous diffuserons tous les directs (25 depuis le début du deuxième confinement, ainsi que des interviews) qui se sont déroulés au théâtre. Il s’agit de maintenir notre engagement d’ouverture d’un théâtre et de maintenir nos rendez-vous pour être ensemble même si on en est empêchés.” La lettre ouverte de Samuel Churin Enfin, Samuel Churin, comédien et porte-parole des intermittents, a fait paraître une Lettre ouverte aux directeurs de cinémas et de salles de spectacle, dans laquelle il passe clairement à l’offensive. En voici un extrait : “Arrêtons d’être défensifs et optons pour des stratégies offensives. Le Gouvernement décide que les cinémas et théâtres ne rouvriront pas le 15 décembre et il est certain que les pétitions n’inverseront pas cette décision. La seule solution : attaquer le gouvernement au conseil d’état avec un référé-liberté. Le référé-liberté est une procédure qui permet de saisir en urgence le juge administratif lorsqu’on estime que l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics) porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté d’expression, droit au respect de la vie privée et familiale, droit d’asile, etc.). Le juge des référés a des pouvoirs étendus : il peut suspendre une décision de l’administration ou lui ordonner de prendre des mesures particulières. Pour rappel les professionnels de la restauration et des stations de sports d’hiver l’ont fait et leurs demandes n’ont pas été retenues. Seule l’Eglise a gagné et le gouvernement a dû revoir sa copie sur la limitation à 30 personnes lors des cérémonies religieuses : la jauge est calculée en fonction de la superficie, elle n’est plus limitée. Pourquoi ce référé-liberté devrait être gagnant ? Parce que les juges administratifs du conseil d’état sont très attachés à la notion d’équité. Et les conditions d’accueil dans une église sont en tous points comparables à celles d’un cinéma ou salle de spectacle. Chacun est assis, masqué, ne bouge pas et tous regardent dans la même direction. Ironie de l’histoire, Jean Castex lors de la présentation de sa loi sur le séparatisme n’a cessé de vanter la laïcité à la française. Or, dans les faits, les églises sont ouvertes et les théâtres sont fermés ! Nous n’avons que trop tardé. J’appelle donc les directeurs de cinémas, théâtres et autres lieux de spectacle à déposer de toute urgence un référé-liberté au conseil d’état. Cette démarche est essentielle. Et si le juge nous donne tort, il devra justifier sa décision. J’ai hâte de savoir en quoi le fait d’assister au récit de la naissance d’un homme nommé Jésus serait sans danger, alors que le récit d’un homme nommé Tartuffe serait source de contamination.” Nous aussi…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2020 3:57 AM
|
Par Laurent Carpentier, dans Le Monde du 10 décembre 2020 On peut être normalien, avoir été reçu premier à l’agrégation d’anglais (en 2004), être passé par Harvard, et proposer une expérience performative déroutante à prendre au pied de la lettre : Je viens chanter chez toi toute nue en échange d’un repas. Le/la comédien.ne Vanasay Khamphommala, longs cheveux noirs, corps émacié, qui proposait cet été aux déconfinés de débarquer chez eux avec son ukulélé, a un parcours tout ce qu’il y a de plus classique. Sauf peut-être le sujet de sa thèse de DEA : « L’érotisme anal dans les comédies de Shakespeare ». Après avoir enseigné à l’université, il/elle a compris que sa vie était sur scène.
Stéphane Braunschweig, Benoît Lambert, Marie-José Malis, Frédérique Aït-Touati, Jade Herbulot, Thibaud Croisy, Marie-Sophie Ferdane (ancienne pensionnaire de la Comédie-Française), Bruno Bayen, Alice Zeniter, Louise Vignaud, Sébastien Bournac, Irène Bonnaud, Philippe Brunet, Camille Dagen, Pierre-Angelo Zavaglia, Cécile Falcon (professeure au Conservatoire national supérieur d’art dramatique), Guillaume Poix, Sacha Todorov, Pauline Noblecourt, Eddy D’Aranjo, Lisa Guez (qui a gagné le festival Impatience en 2019), Manon Worms… Tant de normaliens peuplent le théâtre aujourd’hui qu’on pourrait en dresser un annuaire.
Sans parler de la musique – Agnès Gayraud (La Féline), Sébastien Wolf (Feu ! Chatterton), Christine and the Queens –, du cinéma (Emmanuel Bourdieu, Rebecca Zlotowski, Jeanne Balibar), de la danse (Romain Bigé), de la BD (Jul) ou de la photographie (Aude Tincelin, devenu Adel Tincelin, « militant écoqueer » et auteur d’On n’a que deux vies. Journal d’un transboy, en 2019 chez Cambourakis). Tous ont laissé tomber la chaire du professeur pour la chair vivante de l’art. L’école qui, au monde, a formé le plus de prix Nobel, le Graal de la méritocratie française, rempart de la pensée universaliste, serait-elle devenue un chaudron à saltimbanques ? « Le choix de l’art, c’est aussi le choix du corps, affirme Vanasay Khamphommala, dont les parents immigrés étaient devenus médecins et enseignants à Rennes. C’est sortir de ma tête et revenir vers le champ social. J’aurais été très malheureuse si j’étais restée dans la vie à laquelle me prédestinait l’école, cet endroit de revendication de la norme, de l’institution. Je me suis rendu compte, à un moment donné, de la violence du rail, de cette machine à assimiler, à laquelle il a fallu que je mette un terme brutalement. Pas facile de devenir soi en tournant le dos à ce qui nous construit. » Lieu d’ébullition Le scénariste Benjamin Dupas (Vernon Subutex, Vampires) ne s’attendait pas à être reçu lorsque, en 1994, il présente le concours. Nantais, il a suivi sa petite amie. Admis tous les deux, ils se sont séparés dans l’intervalle. A la cantine de l’Ecole normale supérieure (ENS) Fontenay (Hauts-de-Seine), on lui glisse : « Ça te dirait de faire du théâtre ? » Il y a deux troupes, il intègre les deux. Celle de Nathalie Hertzberg, elle aussi scénariste aujourd’hui, et celle de Sébastien Bournac, qui dirige désormais le Théâtre Sorano, à Toulouse. « Ce fut un déraillement positif, se souvient Benjamin Dupas. Tu arrives là, tu sais que tu as un énorme privilège, mais tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. L’école fonctionne comme un accélérateur. Une sorte de cabine qui va te transformer. Mais tu ne sais pas trop en quoi. Pas forcément en Superman. C’est plein de gens intelligents, inhibés, complexés. On refait le monde jusqu’au bout de la nuit, on picole, on assiste à des leçons brillantes… Et je découvre le théâtre. » Nommé enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand, il monte une troupe avec des anciens du Théâtre national de Strasbourg. Même si, quelques années plus tard, il préférera in fine l’écriture à la vie foraine. La « fabrique de la République » est un lieu d’ébullition. « Un patchwork intellectuel passionnant », témoigne Louise Vignaud. Celle-ci, alors qu’elle a déjà monté en khâgne, à Louis-le-Grand (Paris 5e), un Lorenzaccio salué par Jean-Pierre Vincent (1942-2020), entre néanmoins à « Ulm » – « sur dossier, pas par le concours », précise-t-elle avec humilité – parce qu’elle a envie « d’un bagage intellectuel fort ». « On ne l’imagine pas forcément, mais être artiste demande énormément de travail, souligne la jeune metteuse en scène et directrice du Théâtre des Clochards célestes à Lyon, qui est, ces temps-ci, sur tous les fronts. Normale m’a apporté ce rapport au travail, cet effort de quête perpétuelle, cette exigence, ce jamais-assez-bien. Comme un entraînement sportif. » « On était libres » A l’époque où Vanasay Khamphommala est pensionnaire rue d’Ulm, la salle de théâtre est désaffectée. Lui et ses copains – une petite troupe rebaptisée L’Ecole de la nuit – l’occupent en douce : « Il y avait un côté illégal dans cette activité théâtrale qui me plaisait. On était libres. A la fois d’un point de vue économique puisque, en temps que normalien, on touche un salaire. Et parce qu’on était peu fliqués. » Aujourd’hui à la retraite, l’écrivain Hédi Kaddour (Waltenberg, Les Prépondérants, publiés chez Gallimard), qui fut à l’origine de la création du département théâtre à l’ENS de Lyon (fruit de la réunion des écoles de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud), se remémore comment, à la fin des années 1980, alors qu’il tenait un cours d’agrégation et était chroniqueur de théâtre à La Nouvelle Revue française, des élèves venaient lui confier qu’ils aimeraient faire le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD). Il leur répondait : « Je suis la dernière personne à qui vous en parlez dans cette école », avant de les accompagner dans cette démarche semi-clandestine en leur cherchant des postes de thésard ad hoc pour embrasser la carrière théâtrale. Seulement 2 % suivent la voie artistique Qu’on se rassure : tous les normaliens ne sont pas devenus artistes et ne le deviendront pas. Si l’on en croit une étude sociologique réalisée en 2015 par un chercheur de l’université de Lausanne, Pierre Bataille, seulement 2 % des anciens élèves suivraient la voie artistique. Même si on imagine que nombre d’anciens ont mené les deux carrières de front, même si on voit bien que la méthodologie et le corpus étudié (un questionnaire envoyé à près de 1 500 anciens élèves des années 1981 à 1987, auquel un tiers seulement a répondu), laissent place à une large sous-estimation, l’enseignement reste la voie royale. Il n’empêche qu’il y a eu révolution. Le plus loin que l’on cherche à remonter dans le temps n’amène qu’en 1958, avec un premier normalien devenu metteur en scène : Jean-Marie Villégier. Auparavant, c’est le désert. Une pléthore d’écrivains, d’hommes politiques, de scientifiques, une marée de professeurs. Et puis vient Jacques Nichet (1942-2019), en 1965. Il monte le Théâtre de l’Aquarium (toujours implanté à La Cartoucherie de Vincennes), dont le nom est un hommage au hall d’entrée de l’école. L’année 1965, c’est l’époque où la France voit le théâtre se réinventer sur les campus… « Emerge alors du théâtre universitaire toute une génération : des Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent… Même une Ariane Mnouchkine, qui venait au mythique Groupe de théâtre antique de la Sorbonne… C’est le Festival de Nancy, énumère Anne-Françoise Benhamou, la professeure en études théâtrales de l’ENS et pilier de la filière. L’école est le reflet du mouvement de fond qui traverse la société. Les universités bougent. On trouve alors au théâtre la qualité de porter à la fois des enjeux politiques et d’être un spectacle. Et c’est ce qui fait écho aujourd’hui : une quantité de jeunes gens sont à la proue de pensées nouvelles que l’on retrouve dans leurs spectacles. C’est ce qui remet les normaliens en piste. » Parallèlement à ses cours à l’ENS, Anne-Françoise Benhamou travaille comme dramaturge à l’Odéon, au côté de Stéphane Braunschweig. « Ce qui a changé, par rapport à ce temps-là, c’est la permission d’être artiste, dit-elle. Les projets artistiques se reconnectent avec des enjeux profonds, sociologiques, anthropologiques, politiques… Il n’y a plus de méfiance de la part du théâtre de se connecter à une pensée comme ce put être le cas dans la génération précédente. » Ligne de fuite Eddy D’Aranjo, 27 ans, doit présenter Jean-Luc Godard (1) – Je me laisse envahir par le Vietnam, en janvier 2021 au Théâtre de la Commune à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), puis en mars à la Cité internationale universitaire de Paris. « Le théâtre, dit-il, c’était pour moi une manière de continuer la philosophie. De vérifier que ce que l’on pense, on peut aussi le sentir. » Il est originaire de Laon (Aisne), en Picardie. Sa mère travaille à la poste, son père a tâté de la prison, et son beau-père l’a pris en grippe. Avec sa sœur, ils sont les premiers de la famille à avoir passé le bac. « Ce qui impose le rapport que j’entretiens avec l’art et la culture », conclut-il en repoussant la mèche rebelle qui lui tombe dans l’œil. L’école sera sa ligne de fuite… Eddy D’Aranjo sait lire à 3 ans. Bac à 16 ans. Revers de la médaille, il est trop jeune pour pouvoir travailler et payer ses études à Paris, forcément Paris, où il rêve d’aller et où il est pris à Sciences Po. « Je rêvais d’être diplomate à l’ONU, je voulais faire le bien. » Au lycée Henri-IV (Paris 5e), on ouvre une nouvelle section, pour préparer trente élèves boursiers aux concours. Il intègre la « rue d’Ulm » à 20 ans. Le saint des saints. « La culture m’a servi inconsciemment à humilier ma famille. Ce que m’offrait l’école, c’était une manière de m’identifier autrement », analyse-t-il. Homosexuel revendiqué et un parcours qu’il ne cesse d’autoanalyser à l’aune de celui d’un autre Eddy, Edouard Louis (lequel a aussi intégré Normale, sur dossier), le jeune homme résume à lui seul la rébellion de ces bêtes à concours, lecteurs infatigables, transfuges en quête de territoires, sur lesquels Didier Eribon et son Retour à Reims (Fayard, 2009) auront une influence importante. C’est le cas de Keti Irubetagoyena. « Depuis toujours je voulais faire de la mise en scène, confie la jeune femme. Mais ce n’était pas possible financièrement de faire une prépa théâtre. » Son père est instituteur à Isturits (Pyrénées-Atlantiques), petit village du Pays basque. Elève studieuse, apprenant qu’une section théâtre est en train de se créer à l’ENS de Lyon, elle s’y présente. « D’un côté, j’obéissais aux parents ; et de l’autre, je poursuivais mon but. » A 36 ans, Keti Irubetagoyena est directrice de la recherche au CNSAD, à Paris, et artiste associée au Centre dramatique national (CDN) de Poitiers. « Moi qui ai grandi dans un théâtre très politique, outil de mobilisation des masses, l’école m’a aidée à complexifier cette pensée. Et puis j’avais un accent très marqué. Le théâtre que je fais est lié à ce parcours de déracinement. Je me rends compte que tous ceux avec qui je suis restée amie étaient des transclasses. » Elle qui, après l’école, avait épousé un coreligionnaire matheux, fils d’avocats parisiens, a aujourd’hui divorcé et s’est installée dans la Creuse avec sa compagne pâtissière, dans une « fermette » dont elle aspire à faire un lieu de théâtre et de résidence. « La puissance intellectuelle, un carcan » Sortis de Normale, les bons élèves de la République se retrouvent sur les bancs du CNSAD à Paris, de l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, de la Manufacture à Lausanne, du Théâtre national de Strasbourg, dirigé par Stanislas Nordey. « A l’école, ils sont assez liés entre eux. Ils se reconnaissent, remarque ce dernier. Une forme de réseau assez naturel dans ces promos très mélangées, où l’on trouve également beaucoup de gens qui viennent, à l’inverse, de classes “égalité des chances”. Les normaliens ont une avance en termes de méthodologie, de discipline… Cela n’en fait pas nécessairement de meilleurs metteurs en scène, mais ils ont une constitution, ils apportent une singularité, qui en fait assez vite des chefs de bande. » Metteurs en scène plus souvent que comédiens. L’ENS serait-elle devenue un passeport pour accéder au haut de l’affiche ? De ses confrères normaliens, Stanislas Nordey sourit : « Ce n’est pas à leurs spectacles qu’on les repère mais quand on parle avec eux. La façon dont ils vont mener leur chemin de répétitions, dont ils présentent un projet. » Il n’a pas toujours été bien vu d’être bardé de diplômes dans le monde du théâtre où a longtemps régné, comme le rappelle l’un de ces jeunes « hussards » du théâtre, « un très fort courant anti-intellectualiste, qui est une forme de l’anti-brechtisme ». Le directeur du CDN de Dijon, Benoît Lambert, se souvient que lorsqu’il déposa son premier dossier à l’Adami, la société de gestion des droits des artistes, le directeur de l’action artistique lui glissa : « On ne va pas indiquer que tu es normalien, ça peut les mettre mal à l’aise. » Le metteur en scène avait intégré « Ulm » en sciences sociales en 1991. Ses condisciples avaient pour noms les futurs économistes Thomas Piketty, Esther Duflo et Philippe Askenazy. « Le théâtre, c’était une façon de fuir l’école. Si j’y avais été heureux, je n’aurais pas été faire du théâtre dans les banlieues. Parce que c’est comme ça que tout a commencé. Ma compagnie m’a sauvé la vie face à cette solitude qui me glaçait », témoigne Benoît Lambert, qui avoue avoir pratiqué un « désapprentissage » : « Parce que ta capacité rhétorique, ta puissance intellectuelle, peut aussi être un carcan. Ce que Bourdieu appelait le “biais scolastique” t’encombre autant qu’il t’aide. Un jour, Braunschweig m’a dit : “Toi, on n’a pas l’impression que tu as fait Normale-Sup.” J’ai trouvé que c’était un formidable compliment. » De ses années à l’école à la fin des années 1980, Marie-José Malis, directrice de La Commune, à Aubervilliers, fille d’ouvriers agricoles à Pézilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales), près de Perpignan, assure n’avoir « rien compris. En y repensant, je crois que j’étais en état de choc ». Elle réfléchit et ajoute : « Je n’ai pas fait du théâtre parce que j’étais normalienne. Mais peut-être que je fais du théâtre “en” normalienne. La façon dont je parle, le rapport au texte… Le verbe, c’était ma seule arme. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu’on pouvait trouver la modernité dans le texte. » La scène comme service public Mais les temps changent. Alice Zeniter, première et unique élève à avoir intégré « Ulm » en option théâtre lorsque la filière fut créée, en 2006, dit souffrir plus en réalité de son « statut de romancière que de celui de normalienne. Depuis L’Art de perdre [Flammarion, prix Goncourt des lycéens et prix littéraire du Monde en 2017], on me demande régulièrement : “Mais pourquoi voulez-vous soudainement faire du théâtre ?” Alors que j’ai toujours fait ça. J’ai gravi un à un tous les échelons, depuis assistante de l’assistante jusqu’à avoir, depuis 2013, ma propre compagnie, L’Entente cordiale ». Avec laquelle elle vient encore de monter un seul-en-scène, Je suis une fille sans histoire. Autrefois, les normaliens rêvaient d’un poste à l’université (ils sont de plus en plus rares), de devenir chercheur ou d’intégrer l’ENA. Désormais, ils montent sur les planches. Il n’y a pas d’opposition mais une continuité, plaident-ils. « Aujourd’hui, c’est le théâtre qui peut faire évoluer la société, suggère l’un d’entre eux. Après tout, c’est une assemblée de gens, c’est faire société. » La scène considérée comme un service public. L’émancipation par la culture et la pensée. Culture et contre-culture comme les deux médailles d’une même pièce. « L’Ecole normale est une institution adornienne: elle porte à la fois la culture et sa critique », propose Hédi Kaddour. Et, de mémoire, de citer Michelet écrivant, à propos de l’école : « Spectateurs de l’invention continuelle de leurs maîtres, ils allaient inventant aussi… » On retrouve Vanasay Khamphommala tirant sur sa longue chevelure noire. « “Normale”, c’est un truc, on le cache un peu et, quand on en est sorti, on le refoule beaucoup. Je vois bien tout ce que cette expérience m’a apporté comme cadre, comme basculement traumatique et crucial. Mais je me rends compte que le chemin que je cherche à articuler au théâtre tourne le dos à l’école, c’est-à-dire à ne surtout pas instrumentaliser l’art à des fins pédagogiques et universalistes. L’école rêvée comme un espace de nivellement par le haut et l’impensé républicain qui construit des valeurs patriarcales, blanches, occidentales. » Quand on lui raconte que, parti à la rencontre des normaliens, on a l’impression d’être tombé sur une mine d’« anormaliens », il se marre : « Fier d’être “team monstres” plutôt que “team hussards” ! » Sous l’appellation ENS, quatre écoles existent aujourd’hui Ulm, Sèvres, Fontenay, Saint-Cloud… L’histoire des Ecoles normales supérieures destinées à former les cadres de l’éducation nationale et de la recherche française est un mille-feuille où on a tôt fait de se perdre. Tout remonte à l’Ecole normale de l’an III, créée en 1794 par la Convention. Elle servira de fondement à la création, en 1826, de l’Ecole normale supérieure, dite « de la rue d’Ulm », à Paris. En 1881, les écoles ayant été ouvertes aux filles, sont créées une Ecole normale supérieure de jeunes filles à Sèvres (Hauts-de-Seine) et deux écoles normales chargées de former les enseignants des primaires dans le même département, à Fontenay-aux-Roses pour les filles et à Saint-Cloud pour les garçons. La mixité – avec un certain temps de retard – va de nouveau changer la donne. En 1980, les écoles de Fontenay et de Saint-Cloud fusionnent. Dans un premier temps, leur filière scientifique est installée à Lyon, pendant que les littéraires forment l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, pour ensuite tout réunir à Lyon. Quant à Sèvres, elle est finalement fusionnée avec Ulm en 1985. Outre ces deux grandes écoles, Paris et Lyon, deux autres appartiennent au réseau des écoles normales supérieures. En 1956, l’Enset, qui réunissait depuis 2012 les différentes écoles d’enseignement supérieur technique, s’est installée à Cachan (Val-de-Marne). Puis, en 2013, sa filière rennaise a pris son autonomie, devenant les Ecoles normales supérieures de Cachan et de Rennes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 10, 2020 6:47 PM
|
Par Rose Baldous dans Les Inrocks - 10/12/2020
Lors de sa conférence de presse ce jeudi 10 décembre à 18h, le Premier ministre Jean Castex a déclaré que la réouverture des salles de spectacle le 15 décembre, tant attendue, était finalement reportée en raison de la situation sanitaire. L'hypothèse d'un report de la réouverture des salles de spectacle était pressentie depuis quelques jours... La décision a été confirmée ce jeudi 10 décembre par le Premier ministre lors de sa conférence de presse. Musées, salles de cinéma, de théâtre et de concert devront encore attendre a minima le 7 janvier prochain - en fonction de la situation sanitaire - pour espérer accueillir à nouveau leur public. Jean Castex a résumé la situation : “Les chiffres ne baissent plus (...) Et nous savons que les fêtes de fin d'année constituent des expériences à risque. Nous ne pouvons pas baisser la garde.” Il poursuit avec un mot à l'attention de la culture : “Je sais à quel point les acteurs du secteur culturel se sont préparés. (...) Il s'agit d'une décision particulièrement douloureuse. Mais si nous nous laissons tenter par l'ouverture des salles, la situation sanitaire pourrait être pire en janvier.” En lieu et place de la réouverture des salles, ce sera donc un couvre-feu à 20h que nous devrons respecter à partir du mardi 15, mais l'attestation ne sera toutefois pas nécessaire la journée. Rappelons que le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron avait posé des conditions chiffrées pour la potentielle réouverture mi-décembre : “Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5 000 contaminations par jour et environ 2 500 à 3 000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement sera levé (...) Les salles de cinéma, les théâtres, les musées, pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés.” Or, selon Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, le lundi 7 décembre dernier, on dénombrait un peu plus de 10 000 contaminations quotidiennes. “Le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus”, avait-il annoncé alors. Un report de dernière minute catastrophique pour les professionnels L'inquiétude et la colère des professionnels du secteur culturel étaient palpables depuis ce matin face à cette éventualité. En effet, nombre de distributeurs avaient relancé leur campagne de promotion et avaient établi un nouveau calendrier des sorties pour le 15 décembre. Face à ce nouveau report, un embouteillage de films et spectacles est à craindre pour 2021. “Les salles ne sont pas des lieux de contaminations, elles doivent ouvrir”, déclarait Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français, au journal La Croix, ce jeudi 10 décembre au matin. “On ne peut pas imaginer le contraire compte tenu de l'investissement de dizaines de milliers de personnes qui s'y préparent.” Le producteur et fondateur de la société Le Pacte, Jean Labadie, a de son côté interpellé la direction des César sur Twitter : “Il serait bien que la direction des César se mobilise pour mettre le gouvernement en face de la possible possibilité de la faillite de beaucoup d’entre nous ! Sachant qu’ils représentent tout le métier. Qu’ils fassent un communiqué dès cette après-midi !!”
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 21, 2020 10:25 AM
|
Par Le Figaro et AFP publié le 19/12/2020 Le directeur du Théâtre du Nord, à Lille, prendra en janvier les rênes du prestigieux théâtre des Amandiers, à Nanterre Quand on lui demande dans quel état d'esprit il s'apprête à prendre le 1er janvier les rênes du prestigieux théâtre des Amandiers à Nanterre, Christophe Rauck répond quasiment du tac au tac : «Je suis serein». On croit d'abord avoir mal entendu. Comment un metteur en scène et patron de théâtre pourrait-il être «serein» à l'heure où l'incertitude plane sur la date de réouverture des salles et où le secteur du spectacle vivant redoute de ne pas survivre à la crise sanitaire mondiale ? «Je ne l'appréhende pas mal, je m'attends à tout», dit d'une voix posée celui qui est encore le directeur du Théâtre du Nord, en jouant avec sa tasse de café. «On voit bien qu'on peut difficilement prévoir, donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Il faut continuer et essayer de passer cette tempête en étant le plus calme possible pour éviter de sombrer.» A 57 ans, Christophe Rauck affiche le pragmatisme et le recul de ceux qui ont déjà traversé des épreuves et à qui les défis ne font pas peur, voire attirent. Son arrivée à Nanterre ne dérogera pas à la règle. Au-delà de l'épidémie de coronavirus, sa nomination coïncide avec le coup d'envoi de deux ans de travaux prévus de longue date dans le théâtre francilien. Une gageure qui n'est pas pour lui déplaire. «Quand j'ai appris qu'il y aurait des travaux, je me suis dit que ce serait intéressant de rentrer par la petite porte, par les coulisses, dans ce lieu aussi énorme», se souvient-il. Les Amandiers, dirigés entre autres par Patrice Chéreau ou Jean-Pierre Vincent, «c'est un théâtre de géants», poursuit l'ancien étudiant des Beaux-Arts. «La première fois que je suis venu à Nanterre, j'étais tout jeune, c'est là que j'ai fait mes armes de spectateur, là que j'ai appris à aimer le théâtre, là que j'ai vu les choses les plus puissantes.» Sa nomination intervient aussi après une période de crispation entre le maire de Nanterre Patrick Jarry et son prédécesseur à la tête du théâtre Philippe Quesne. Ce dernier a choisi de ne pas renouveler son mandat, dénonçant le «mépris artistique absolu» du maire à l'égard de sa programmation, quand l'édile déplorait lui un lien affaibli entre l'établissement et la population. Même pragmatique et philosophe, Christophe Rauck a tout de même été ébranlé cette année par l'épidémie de coronavirus, qui l'a contraint d'annuler sa mise en scène de «La Faculté des rêves», de l'auteure suédoise Sara Stridsberg. S'il s'était «muré dans le silence» lors du premier, la fermeture des salles à l'occasion du deuxième confinement décrété en novembre par le gouvernement ne l'a pas laissé insensible et l'a même conduit à cosigner une tribune appelant à la réouverture des théâtres. Le débat sur ce qui est essentiel ou pas essentiel est un faux débat Christophe Rauck «Le débat sur ce qui est essentiel ou pas essentiel est un faux débat», estime Christophe Rauck. «Si le président de la République dit que ce n'est pas essentiel, tant pis pour lui, pour moi ça l'est», ajoute-t-il. «Ça m'a révolutionné, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ça m'a permis d'être plus calme et plus construit. Si ça m'a permis cela, ça peut le permettre à d'autres.» «Choc émotionnel» Sur la politique, il n'en dira pas plus. Sur son parcours, en revanche, il accepte de revenir rapidement. Il voulait initialement devenir sculpteur, étudie aux Beaux-Arts, s'arrête, fait sur les conseils d'un ami un peu de théâtre avant d'abandonner, rebuté par l'ambiance. La révélation et «le choc émotionnel» viendront plus tard en assistant à la répétition de «L'illusion comique», mise en scène par Giorgio Strehler. L'ancien comédien d'Ariane Mnouchkine devient alors metteur en scène avec «le Cercle de craie caucasien» de Brecht en 1996. Il dirige ensuite le théâtre du Peuple à Bussang (Vosges), met en scène le Mariage de Figaro à la Comédie française, prend la tête du théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis avant de rejoindre Lille. À Nanterre, il entend mettre en place des «saisons partagées» avec quatre metteurs en scène - Anne-Cécile Vandalem, Joël Pommerat, Julien Gosselin et Tiphaine Raffier. 2021 sera «constructif, passionné, engagé», promet-il.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 20, 2020 5:57 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog de Mediapart - 20-12-2020 Avec « Une femme se déplace », David Lescot s’empare du genre très codifié de la comédie musicale, ici à tendance surnaturelle. Amenée par l'irrésistible Ludmilla Dabo ainsi que dix comédiens-danseurs-chanteurs et quatre musiciens live, la pièce livre le portrait poétique et plein de fantaisie d'une femme d'aujourd'hui. Une magistrale histoire d'émancipation qui se chante et se danse. La pièce s'ouvre sur l'intérieur d'un restaurant où deux amies de longue date se retrouvent pour déjeuner. Georgia, trente cinq ans, a rendez-vous avec Axelle à Platitude, dernier restaurant à la mode déniché par cette dernière. Avec pour slogan « Un plat, une attitude », le lieu, où triomphent les plats fades, sans saveur aucune, et où s'écoute les silences enregistrés dans les espaces naturels du monde entier, est la métaphore du conformisme qui, au fil des années, rattrape beaucoup de personnes à l’image de Georgia, qui confondent le bonheur avec le confort douillet de la bourgeoisie. Ainsi, après avoir exposé à Axelle son bonheur professionnel et familial de manière ostentatoire, Georgia voit son monde parfait s'écrouler au fur et à mesure des appels et messages qu'elle reçoit sur son téléphone portable. C'est son congé recherche – elle est professeur de littérature à l'université – qui est attribué à son collègue, son fils qui débarque avec sa sœur vêtue d'une burka, quarante étudiants et leur dossier d'équivalence qu'elle doit valider qui l'attendent devant son bureau et qu'elle a complètement oublié, c'est son mari qui prend le large. Lorsque s'affiche le numéro de sa femme de ménage, Georgia s'attend à juste titre à une nouvelle catastrophe. Mais ce monde qui s'effondre sous ses yeux en quelques minutes était-il si parfait que cela ? Ne s'est-elle pas laissé aller avec le temps à l'aisance d'une vie conventionnelle ? Ne s’est-elle pas arrangée avec ses idéaux d'autrefois ? Un brumisateur de table va lui donner l'occasion abracadabrantesque de voyager dans sa vie, revisiter son passé, sonder son futur. C'est en branchant par accident son téléphone portable, dont les batteries sont à plat – symbole de sa propre fatigue mentale – au brumisateur qu'elle commence son exploration intérieure. Soudain, au comble de sa panique, alors qu'elle cherche à arrêter à tout prix cet enchaînement de cataclysmes, elle se retrouve projetée dans son passé, son enfance où, avec sa sœur, elle fait face à son père en train de réciter la prière qui précède le repas, et leur marâtre. Car quitte à faire une comédie musicale, autant y aller franchement, à l'américaine, et ça marche formidablement bien. D'ailleurs, les situations, les personnages - jusqu'au prénom de l'héroïne -, évoquent d'avantage une vie outre-Atlantique que parisienne. Au début, elle tâtonne, ne s'absente que brièvement, revient toujours exactement au même endroit temporel, quelques minutes avant l'invraisemblable voyage, lorsqu'elle retrouve Axelle au restaurant Platitude. Un retour au début de la pièce qui crée à chaque fois une situation cocasse de répétitions dans laquelle Georgia revit toujours le même événement : la commande du déjeuner, clin d’œil au film « Un jour sans fin » (1993) d'Harold Ramis dans lequel Bill Murray ne cesse de vivre encore et encore la même journée, dans une atmosphère aussi hilarante qu’angoissante. « Le temps est rayé comme un disque vinyle » répète Georgia en chantant. Alors qu’elle n’a pas encore tout à fait réalisé ce que cela signifie de posséder le pouvoir de voyager dans sa propre vie, Georgia voit s’avancer vers elle Phoebe, cliente jusque là silencieuse du restaurant. Elle lui apprend qu’elle aussi a vécu la même chose et qu’elle sait contrôler ses voyages, la persuade de recommencer. Georgia revit alors les épisodes marquant de son passé : le premier amour, la première manifestation, les soirées à expérimenter des produits illicites avec sa meilleure amie dépressive, la radicalisation de son petit ami, la relation compliquée de sa mère avec l'argent, d'autres épisodes encore, certains joyeux, d'autres beaucoup plus sombres, l'apprentissage de sa vie. La musique est performée en direct par quatre musiciens qui apparaissent lors des scènes chantées à la faveur d’un fond de scène qui alterne entre transparent et opaque selon les scènes. La forme et le fonctionnement du récit viennent précisément des moments chantés et dansés et des voyages dans le temps. David Lescot voulait qu’il y ait un écart entre le contenu et la forme. « Ainsi la possibilité du voyage dans le temps "intra-biographique" permet de raconter l'ensemble d'une vie en assumant les ellipses et surtout le récit par bribes discontinues[1] » confie-t-il. La science-fiction devient un joli prétexte pour dérouler, par fragments, toute une vie de femme. Et c’est à nouveau du côté du cinéma que lorgne le metteur en scène, de « Je t’aime, je t’aime » (1965) à « Smoking No Smoking » (1993), deux films d’Alain Resnais, de « Peggy Sue s’est mariée » (1986) de Francis Ford Coppola à « Camille redouble » (2011) de Noémie Lvovsky. « Le ciel peut attendre », chef-d’œuvre hollywoodien réalisé en 1943 par Ernst Lubitsch, bijou d’humour et de tendresse, semble servir de modèle ici. Dernier grand succès critique du réalisateur, le film diffère quelque peu du point de vue du récit mais est rythmé par la même trame : celle du voyage temporel de sa propre vie. David Lescot tente – et réussi remarquablement – de rendre palpable cet effet de retour en arrière en mobilisant les seules possibilités offertes par le théâtre, sans recours à la vidéo. A propos de l’écriture musicale, il confie lui-même : « Je ne suis pas loin de penser que les contraintes de l’écriture musicale sont en fait libératrices pour l’écriture », précisant sa pensée : « Écrire en vers, devoir se plier à une formule rythmique, chercher des rimes, solfier un dialogue, voilà qui donne d’emblée à l’écriture un style, un écart par rapport au langage parlé ». Il donne volontairement aux chansons des thèmes invraisemblables mais qui font pourtant partie de la réalité de notre quotidien, qu’il s’agisse des chargeurs de téléphones portables, du fonctionnement du GPS ou encore, de la liste des objets lors d’une saisie. Ces thèmes racontent la société dans laquelle on vit, disent l’importance de son aspect matériel et désormais technologique. Le chant et la musique couvrent ici le spectre des émotions. La dimension affective de l’expérience extraordinaire que vit Georgia s’éprouve par la musique. Les morceaux sont stylistiquement variés avec « une tendance tournée vers la pop, la soul et le spoken word, qui consiste à poser du texte parlé sur du rythme ou de la musique » précise le metteur en scène. Qui d’autre pouvait mieux incarner Georgia que Ludmilla Dabo avec qui David Lescot a créé son précédant spectacle, « Portrait de Ludmilla en Nina Simone » ? Formidable chanteuse, elle apparaît irrésistible de bout en bout du spectacle. Pour David Lescot, elle est « l'une des rares actrices qui sache combiner avec autant de talent l'art de la comédie et celui du chant au même niveau ». Elle n’en finit pas en tout cas de nous transporter. Autour d’elle, la distribution apparaît impeccable, à commencer par Elise Caron, artiste polyvalente, autrice de ses propres chansons, qui incarne Phoebe, ou encore, Antoine Sarrazin, mari délicieusement mou qui dit oui a tout, dans une touchante déclaration d’amour. La pièce résonne avec aujourd’hui : le premier amour anarchiste de Georgia pourrait incarner une figure des « Black Bloc » qui mettent, comme lui, la violence au service d’un projet politique. L’histoire se répète. On y apprend aussi que les geeks du futur, plutôt que de s’intéresser aux technologies à venir – tout a été inventé – se font archéologues du passé, ressuscitant, pour la plus grande joie de sa mère, les prises électriques qui ont disparues en même temps que les fils. « C'est un spectacle qui a de la classe[2] » commentait récemment Anna Sigalevitch sur France culture, « dans lequel il y a beaucoup de vie et de générosité » poursuivait-elle très justement. David Lescot réussi à s’emparer d’un genre qui se joue en permanence sur un fil. Il livre un spectacle entièrement structuré par la musique et la danse, où tout est réglé au millimètre près, où tout s’enchaine remarquablement. « Une femme se déplace » est une réflexion sur la vie et sur le temps, à l’image de ces « dettes de temps » que Georgia doit à sa mère dépensière. Désormais sans ressource, sans domicile, âgée, cette femme a besoin d’attention. Georgia, qui jusque là se contentait de payer pour la tenir à distance, va devoir apprendre à partager son temps et son espace avec cette génitrice encombrante. En faisant le choix de la comédie musicale, dont il signe le texte, la musique et la mise en scène, David Lescot porte un regard décalé sur les épisodes compliqués qui construisent nos vies, y instille un peu de légèreté. En vedette, Ludmilla Dabo imprime le tempo, donne le rythme, alterne entre douceur et gravité à la perfection. Pour ces deux là, le ciel peut assurément attendre. Guillaume Lasserre [1] Sauf mention contraire, les propos de David Lescot sont extraits de la note d’intention qui accompagne le dossier de presse. [2] Lucile Commeaux, « La critique », France culture, 11 décembre 2020, https://www.franceculture.fr/emissions/la-critique/une-femme-se-deplace-et-move-le-spectacle-vivant Consulté le 20 décembre 2020 © Photo : Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2020 10:56 AM
|
Sur la page de l'émission de Chloë Cambreling L'Invité(e) Culture sur France Culture 12/12/2020 écoute en ligne de l'entretien (30 mn) A l'heure où le spectacle vivant est plus que jamais fragilisé et tandis que la fracture culturelle n'en finit pas de se creuser, la directrice de la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, Hortense Archambault. Il n'y aura pas de réouverture des lieux de culture mardi prochain. Il y avait certes du conditionnel lorsqu'avait été énoncée cette date du 15 décembre. Mais dans les cinémas, les musées, les salles de spectacle, on était prêt. C'est le cas de la MC93, que dirige notre invitée Hortense Archambault, ancienne co-directrice du Festival d'Avignon avec Vincent Baudriller de 2003 à 2013 et chargée, en 2014, d'une mission sur le régime des intermittents du spectacle. Extraits de l'entretien La pensée, ça ne se fait pas tout seul dans sa chambre : nous avons besoin d'incarnation, de fiction, de beauté et de poésie. La question du corps aujourd'hui n'est vue que du point de vue de la maladie : on se rabougrit, on dépérit, nous sommes de plus en plus enfermés et craintifs. Il faudrait que nous puissions réfléchir ensemble, les lieux de culture sont les premiers lieux pour cela : ils permettent de réfléchir et d'éprouver ensemble. La résilience a des limites : la situation aujourd'hui est très douloureuse pour les artistes. C'est un type de difficulté particulière : ce n'est pas de la survie, ça ne concerne pas les besoins primaires, mais c'est cette question de "Est ce que ce que l'on fait a un sens ?", qui peut vraiment casser des gens. Il faut faire attention à nous : pas parce que nous sommes des petites choses fragiles mais parce que tout cela renvoie à des questions de société. Il y a peu d'opportunité aujourd'hui pour rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas : des gens de milieux, de classes sociales, de culture, d'histoires de vie différentes. Je crois que nos lieux sont des lieux où l'on doit pouvoir partager des émotions, des pensées, des réflexions et, en ce sens, contribuer à la question démocratique. C'est l'idée simple et qui date des Grecs, selon laquelle le théâtre est un endroit où la société se représente, et s'interroge sur elle-même et sur cette représentation des artistes. Légende photo : La directrice de la MC93, Hortense Archambault. • Crédits : Joël Saget - AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2020 1:45 PM
|
Propos de William Bourdon au micro de Marie Sorbier, émission Affaire en cours sur France Culture 17/12/2020 Ecouter l'entretien sur le site de France Culture (10 mn)
Suite à un appel de plus de 4500 professionnels de la culture, un recours a été déposé devant le Conseil d'Etat le 15 décembre pour demander la suspension de la fermeture des établissements culturels. William Bourdon, un des avocats en charge de cette procédure, explique en quoi elle consiste.
Les avocats Vincent Brengarth et William Bourdon ont déposé le 15 décembre 2020 devant le Conseil d’Etat les premiers recours contre la décision du gouvernement de maintenir fermés l’ensemble des établissements culturels. L'avocat William Bourdon, spécialiste du droit pénal des affaires et du droit des médias, détaille les tenants et aboutissants de cette démarche, portée par un appel de plus de 4500 professionnels de la culture, qui demande la suspension du décret du 29 octobre 2020.
"Ce n'est pas parce que des gens sont en colère que nous allons gagner"
Suite à l'annonce par le premier ministre d'un décret prolongeant d'au moins 3 semaines de la fermeture des lieux culturels accueillant du public, plusieurs professionnels du spectacle vivant ont fait appel au cabinet d'avocat de William Bourdon pour demander la suspension du décret auprès du Conseil d'Etat.
Dans la grande majorité des cas, le Conseil d'Etat statue sur pièce, sans audience. Mais nous avons appris hier soir qu'il a ordonné pour notre recours une audience publique. C'est un premier motif de satisfaction, pour nous et pour les théâtres que nous avons l'honneur de représenter.
William Bourdon
Concernant ce qui sera dit lors de cette audience, William Bourdon précise que devant une juridiction administrative, ce n'est pas le principe de l'oralité qui prévaut, mais les écrits et textes préexistants. Seront ainsi débattus entre les avocats et les représentants du ministère de la Culture des arguments qui ont déjà été développés dans des requêtes préalablement initiées.
Ce n'est pas parce que des gens sont en colère que nous allons gagner. Ce n'est pas parce que les établissements culturels souffrent que nous allons gagner, car les mesures prises depuis des mois occasionnent des souffrances collectives et individuelles dans ce pays extrêmement lourdes.
William Bourdon
Outre la situation économique désastreuse qui affecte tous les secteurs, y compris les établissements culturels, et les menace d'une série de faillites irréversible, William Bourdon s'appuie également sur le rôle que la culture devrait et pourrait jouer dans cette période trouble.
Plus que jamais, la culture doit être considérée comme l'âme de la démocratie et comme une espèce de bouclier, d'antidote contre la violence, contre l'intolérance. Elle est une vitalité indispensable pour un bien vivre commun qui est si gravement atteint et meurtri aujourd'hui. Nous avons des arguments très forts, très puissants, qui devraient convaincre le Conseil d'Etat de suspendre cette décision.
William Bourdon
Dans l'attente d'une réplique de la part du Conseil d'Etat, le cabinet de William Bourdon se prépare activement à défendre les acteurs de la culture lors de l'audience publique qui se tiendra lundi 21 décembre.
Principe de légalité
Un point clef de cet argumentaire en préparation est le principe de légalité, qui est prévu à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Personne ne comprend que la fermeture des théâtres ait été prolongée alors que les établissements cultuels, eux, sont autorisés à ouvrir. La situation y est exactement la même au niveau des protocoles sanitaires, et plusieurs études ont démontré que les théâtres ne sont pas des clusters. Ce principe de légalité est totalement violé. Nous allons demander au Conseil d'Etat de corriger cette incohérence.
William Bourdon
Les théâtres ont continuellement amélioré leurs protocoles sanitaires pour correspondre aux recommandations de plusieurs études et être en adéquation avec la limitation de la propagation du virus.
Cette décision apparaît plus politique que sanitaire. Il ne faut que l'incompréhension que l'on peut avoir pour le tâtonnement du gouvernement conduise à perdre l'esprit critique face à ces mesures qui ne respectent pas le principe de légalité, la protection de la liberté d'entreprendre, le droit à la culture, la liberté d'association. Sans être trop confiants, nous pensons avoir des arguments très sérieux pour que le Conseil d'Etat corrige ce décret funeste et permette aux théâtres de trouver une respiration, sans quoi ils pourraient sombrer définitivement.
William Bourdon
Résistance ou désobéissance ?
La résistance n'est pas de la désobéissance. La résistance utilise des moyens légaux, ce que nous faisons, pour s'opposer aux abus de l'administration. C'est la délibération démocratique.
William Bourdon
Le sentiment d'illégitimité et d'illégalité fabrique des colères d'autant plus légitimes. On peut donc avoir une forme de mansuétude à l'égard d'un certaine nombre de désobéissances. C'est un moyen ultime, quand la résistance par les moyens légaux et démocratiques a montré son épuisement. Il faut espérer dans ce pays que cette résistance légale puisse atteindre ses objectifs pour éviter une contagion de désobéissance, qui n'est pas la solution. William Bourdon
Légende photo : Le Conseil d'Etat donnera le 21 décembre 2020 une audience publique suite au recours porté devant lui contre la fermeture prolongée des lieux culturels.• Crédits : BERTRAND GUAY - AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2020 1:59 PM
|
Par Jean-Pierre Han dans Profession-Spectacle le 16/12/2020 « N’allez pas au théâtre, couchez-vous ! » Un siècle après le cri lancé non sans provocation par Roger Vitrac, voilà que nous y sommes, contraints par le confinement et les errements de nos gouvernants. Quand nous nous risquons dans un théâtre, nous ressemblons aux figurants du Dernier métro de Truffaut, pris dans une clandestinité assez dérisoire… Vagabondage théâtral Entre clandestinité et résistance : dérisoire ! « N’allez pas au théâtre, couchez-vous ! » lançait dans les années 1920 Roger Vitrac, un rien provocateur, à son habitude. Il est vrai que le théâtre de ces années-là, sur les scènes parisiennes, ne devait guère inciter à sortir. Avec son ami Antonin Artaud, l’auteur de Victor ou les enfants au pouvoir décida donc de secouer le cocotier théâtral. « Couchez- vous ! » Comment faut-il entendre cette invitation ? À rêver comme l’entendait l’auteur surréaliste ? À lire ? Peut-être, mais pas que. En tout cas, pour aujourd’hui, un siècle plus tard, pas besoin de faire le paresseux effort de ne pas aller au théâtre : le confinement nous y contraint. Couchons-nous donc et tentons de rêver, ce qui est loin d’être évident après les coups de massue du confinement, du reconfinement, puis des errements – un petit pas en avant, trois de côté, deux en arrière, une vraie chorégraphie – assénés par nos gouvernants… Couchons-nous donc, répétons-le, et lisons ou plutôt tentons de lire : bibliothèques et librairies n’étant pas considérées, lors de ce deuxième (que l’on aimerait second) confinement, comme vraiment nécessaires à notre survie. Déjà que dans le milieu théâtral, la lecture n’est pas un acte très courant… Si nous nous couchons aujourd’hui, c’est hâve, au bord de la dépression – plus envie de se lever ! – : notre nourriture (théâtrale) quotidienne nous est enlevée ! Et ce ne sont pas les ersatz télévisuels qui nous aurons consolés, bien au contraire : l’effet est même inverse. Alors dans un ultime sursaut, prêts à affronter tous les dangers, munis de nos fameuses « attestations de dérogations de déplacement temporaire », nous nous glissons dehors, rasons les murs, et filons vers un de ces lieux que l’on appelait autrefois théâtre, et qui, toutes lumières éteintes, se livre aujourd’hui à une activité quasi clandestine. On se retrouve là, après avoir franchi une porte que l’on a bien voulu déverrouiller en toute discrétion pour nous, perdu au milieu d’un hall quasi désert et plongé dans une semi-pénombre. Une autre silhouette vous fait signe que la chose se passe par là, en bas des escaliers, et que vous pouvez vous y rendre. Là, ô merveille, nous sommes bien une dizaine, un peu gênés aux entournures, de lointaines connaissances sur lesquelles vous ne parvenez plus à mettre un nom, et d’ailleurs vous ne pouvez voir qu’une partie de leurs visages, voilà qui donne un alibi à toutes les confusions. On chuchote dans l’attente de l’ouverture des portes de la salle, enfin du lieu où doit se dérouler la cérémonie. Vous y êtes enfin, assis à deux, voire trois sièges d’un autre « privilégié » (car vous avez été choisi, bien sûr, journaliste ou professionnel, comme on dit), une salle quasi déserte face au plateau encore vide et plongé dans l’obscurité. Juste une petite lumière pour éclairer une personne (c’est parfois carrément l’auteur et/ou le metteur en scène) venu vous expliquer la règle du jeu, s’excuser et vous remercier : tout ça à la fois. Nous avons vraiment la sale impression d’être des figurants du Dernier métro de François Truffaut, avec le danger qui nous guette, dehors, à chaque coin de rue. Entre clandestinité et résistance : dérisoire ! Jean-Pierre HAN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 14, 2020 7:30 PM
|
Par François Berthier/Paris Match 14/12/2020
Il brûle les planches de la Comédie-Française et fait des étincelles au cinéma en décrochant le rôle principal du « Discours », de Laurent Tirard. Rencontre avec un acteur aussi éclectique que discret. Toujours se méfier de l’eau qui dort. Discret, réfléchi, presque timide à la ville. Virevoltant, exubérant, brillant sur les planches et à l’écran. Benjamin Lavernhe est presque une énigme. Qu’il cultive, d’ailleurs. « Voir un acteur dans ses films ou au théâtre, c’est finir par le connaître un peu, non ? Je suis toujours étonné quand les gens me demandent : “Alors, Untel, il est comment dans la vie ?” Je crois que les acteurs donnent quand même beaucoup d’eux-mêmes dans les rôles qu’ils endossent. » Il acquiesce du bout des lèvres quand on le rapproche de son personnage de meilleur pote dans « Mon inconnue », d’Hugo Gélin : « Un gentil un peu fêlé », botte en touche ce trentenaire à l’allure de Pierrot lunaire. Quand on le retrouve à la nuit tombée, il sort de dix heures de répétition à la Comédie-Française pour « Les Serge (Gainsbourg point barre) », qu’il va reprendre le 15 décembre (et pour lequel il a appris la basse), et « La dame de la mer », de Henrik Ibsen, prévu en 2021. Le quotidien intransigeant du 534e sociétaire de la Comédie-Française qu’il est devenu l’année dernière, après son entrée il y a huit ans dans la grande maison, porté par son incroyable performance dans « Les fourberies de Scapin ». Une pièce qu’il transcende depuis 2017 sous la houlette de Denis Podalydès et pousse parfois jusqu’à ses limites physiques, quitte à y perdre quelques kilos. C'était intimidant, presque écrasant de devoir jouer avec la froideur d'une caméra Côté cinéma, s’il s’est fait connaître en incarnant le marié hautain du « Sens de la fête », il pose sa silhouette dégingandée sur grand écran depuis 2012. Du post-ado lunaire (« Radiostars ») au jeune homme atteint du syndrome d’Asperger (« Le goût des merveilles », avec Virginie Efira). Aujourd’hui, il est enfin tête d’affiche dans « Le discours », de Laurent Tirard, avec un rôle taillé à sa mesure, la caméra et le public comme partenaires principaux des pensées de cet homme en pleine rupture amoureuse, contraint à participer à un dîner de famille éprouvant. « Comme pour “Scapin”, j’y joue beaucoup avec le public, je le prends à partie, comme un conteur qui s’amuse avec la restructuration du récit, note Benjamin Lavernhe. C’était jouissif mais aussi intimidant, presque écrasant, de devoir jouer avec la froideur d’une caméra. Elle est proche, intrusive et on ne sait jamais vraiment ce qu’elle va prendre de vous. » Il a aussi travaillé comme au théâtre avec ses partenaires de jeu – Julia Piaton, François Morel, Sara Giraudeau –, et Laurent Tirard pour donner vie à cette aventure intérieure, dans le regard comme dans l’intonation, entre dialogues réels et pensées enfouies. Un pur plaisir de comédie. Excepté le fait de devoir « tourner pendant quinze jours une scène de dîner avec gigot à volonté dès 8 heures du matin quand vous avez fait votre marathon “Scapin” la veille au soir », plaisante-t-il. S’il a joué Molière, Shakespeare, Tchekov ou Feydeau, il dit aimer aussi l’improvisation, qu’il a pratiquée au Cours Florent. Mais chassez le naturel, il revient au galop : chez Laurent Tirard, les Nakache-Toledano ou Hugo Gélin, jusqu’à la télévision et aux formats courts (« Un entretien », dans lequel il incarne un DRH aux pensées vagabondes), on le choisit pour des monologues face caméra ou des scènes virevoltantes de dîner qu’il contrôle à la perfection. « Peut-être parce que les gens sentent mon amour du verbe », s’interroge-il. Il s’amuse qu’une voyante lui ait prédit qu’on lui proposerait un jour un biopic, ce qui le ferait se confronter à la réalité d’un autre, à un vrai décalage. Le sujet ? « Je ne sais pas. Chirac ? Ou Jean Rochefort ! » Avec un sketch décalé aux César et trois films, dont « Antoinette dans les Cévennes », qu’il soit devenu quasi incontournable en 2020 l’inquiéterait presque en cette année maudite où deux de ses films ont reçu le label d’un Festival de Cannes qui n’aura jamais eu lieu. « La situation a provoqué beaucoup de frustrations. Nous devions reprendre “Scapin” le soir même du premier confinement. Et aujourd’hui, je suis triste de ne pas pouvoir aller fêter “Le discours” avec le public dans une tournée d’avant-premières. » Lui qui magnifie si talentueusement la prose des autres réfléchit même à se mettre à l’écriture. Un seul-en-scène ou, mieux encore, un film. Je vis ce que me donne le cinéma comme un rêve de gosse Car si le jeune Benjamin rencontre Molière en classe de quatrième à Poitiers (son prof lui demande de jouer « La jalousie du Barbouillé »), à l’époque c’est le cinéma qui le fait fantasmer. Il dévore un mensuel spécialisé (il s’y retrouvera en pleine page quelques années plus tard), découpe les articles et consomme les comédies et blockbusters du moment, de « Dumb & Dumber » à la série des « Allô maman ». Fellini ou Antonioni viendront bien plus tard. Un détour par des études de journalisme (« pour me cultiver », explique-t-il), avant que le Cours Florent et le Conservatoire ne l’emportent vers le théâtre. En 2012, Muriel Mayette le fait entrer à la Comédie-Française sans même l’avoir vu jouer. La même année, il tourne « Radiostars ». Six ans plus tard, les Molière le citent meilleur acteur quand les César le nomme meilleur espoir. Tout un symbole. « Le cinéma m’invite alors que le théâtre est une famille, une troupe. Ce n’est pas une stratégie, mais je pense qu’inconsciemment je me protège. Histoire de ne pas perdre pied. Je vis ce que me donne le cinéma comme un rêve de gosse. » Et tout laisse à penser que le talent de Benjamin Lavernhe n’a pas fini de lui faire vivre son rêve éveillé.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 14, 2020 11:45 AM
|
Par Léna Lutaud dans Le Figaro 13/12/2020 Ce lundi, l’actrice dévoile au studio 104 de Radio France sa première comédie musicale, On va se quitter pour aujourd’hui. L’occasion de revenir sur cette année si particulière et sur le féminisme. Des notes de jazz s’échappent du studio 109 de la Maison de la radio à Paris où Agnès Jaoui répète sa première comédie musicale. Deux sœurs, Constance et Vera, jaillissent de l’arrière d’un paravent. La scène se passe dans un bar. L’une fait semblant d’attraper une coupe de champagne. «C’est fou le monde qu’il y a», lâche-t-elle. Sous la houlette du directeur musical Alexis Pivot, le trio piano contrebasse et claviers accélère le tempo. Près du pianiste, un certain Boris s’avance et se met à chanter : «Elle me regarde pour la première fois.» Assise bien en face de ses comédiens, Agnès Jaoui, dûment masquée, se lève : «On la refait.» Avec beaucoup de bienveillance, elle conseille d’ajouter un geste à tel moment, d’exagérer un regard surpris à un autre. Des petits riens mais qui tirent indéniablement la troupe vers le haut. Avec On va se quitter pour aujourd’hui, Agnès Jaoui et Alexis Pivot ont créé un petit bijou. Une élégante comédie musicale à la française sans esbroufe. Drôle, poétique, bien écrite, bien jouée et chantée. Une création dans la lignée de 31, de Virginie Lemoine, succès de la saison 2016-2017 et d’Une femme se déplace, de David Lescot, couvert d’éloges par la critique en 2020. Trois des quatre comédiens-chanteurs viennent du jazz. Connue pour son Scarlet Swing Band, Clara Brajtman est la coordinatrice artistique du Cabaret de poussière, à Paris. Pablo Campos est l’un des meilleurs chanteurs et pianistes de la jeune scène de jazz. Élise Caron, récompensée par une Victoire du jazz en 2010, a doublé Virginie Ledoyen dans Jeanne et le garçon formidable. Repérée par Bob Wilson, Emma Liégeois, la plus jeune, s’est spécialisée dans le théâtre musical. Ce quatuor a eu très peu de temps pour être prêt. La première et unique représentation de cette comédie musicale aura lieu ce lundi 14 décembre en direct du studio 104 de la Maison de la radio. Dans cette grande salle de 900 fauteuils, il n’y aura pas de public à cause des règles sanitaires. Les spectateurs regarderont la retransmission de chez eux, sur le Facebook et la chaîne YouTube de France Musique. 2 heures 30 de bonheur Ce 14 décembre, c’est le grand rendez-vous annuel de la comédie musicale organisé par Laurent Valière*, producteur et animateur de l’émission «42e Rue» sur France Musique. Soit 2 heures 30 de bonheur pour les amateurs du genre. Sur scène, se succéderont dix-sept troupes, dont beaucoup auraient dû dévoiler leurs créations le 16 décembre. Finalement, les théâtres ne rouvriront pas. Le rideau se lèvera sur tous ces spectacles quand la situation sanitaire le permettra. Ce lundi soir, chacun présentera un extrait de sa comédie musicale, accompagné par le grand orchestre de «42e Rue», sous la direction de Thierry Boulanger et Patrice Peyrieras. On découvrira, entre autres, Les Producteurs, d’Alexis Michalik, Joséphine B, de Xavier Durringer, Chantons sous la pluie, d’Ars Lyrica, The Black Legends, de Valéry Rodriguez, Mars-2037, de Pierre Guillois, Charlie et la chocolaterie, de Philippe Hersen, The Music Man, par Meredith Willson. «Je suis tellement heureux de montrer la créativité de tous ces artistes, confie Laurent Valière. Avec un grand orchestre en fosse, du monde sur scène qui chante et qui danse, la comédie musicale est à l’arrêt depuis neuf mois. C’est un genre compliqué à monter en période de pandémie.» La comédie musicale est un genre qui me plaît beaucoup. Il réunit tout ce que j’aime, le théâtre et la musique. Quand c’est réussi, c’est une joie contagieuse Agnès Jaoui À son programme s’ajoute «une création produite en interne que j’ai confiée cette année à Agnès Jaoui, poursuit-il. Comme Michel Fau, Laurent Lafitte et bien des invités que je reçois dans mon émission, elle avait envie de monter une comédie musicale.» Les deux y pensaient depuis deux ans, mais Agnès Jaoui avait trop d’engagements. Le confinement en mars, avec l’arrêt net de ses tournages et de ses concerts, lui a permis d’accepter. «C’est un genre qui me plaît beaucoup. Il réunit tout ce que j’aime, le théâtre et la musique. Quand c’est réussi, c’est une joie contagieuse, explique-t-elle en se rappelant avec nostalgie les cours au Théâtre des Amandiers de Patrice Chéreau. Nous étions tous partis à Broadway, c’était dément.» Points de vue Elle qui sait si bien écrire, jouer et chanter aurait-elle pu se lancer plus tôt? «C’est un genre peu aimé en France. Les auteurs ont peu d’occasions pour en écrire. Face au public et au théâtre, c’est un risque, car cela coûte un peu cher, regrette-t-elle. Le cloisonnement entre acteurs et chanteurs, qui n’existe pas dans les pays anglo-saxons, est un souci. Il y a soixante ans, à l’époque de Bourvil et de Gabin, ce n’était pas comme ça. Chanter et jouer, c’est pourtant le même métier. À Londres, dans le West End, j’ai vu Judi Dench dans Little Night Music. Elle ne chante pas parfaitement certes, mais c’était fabuleux. Elle faisait passer plein d’émotions.» On a besoin de culture. Ce n’est pas essentiel, c’est vital. Les gens ont besoin d’autre chose que de regarder des plateformes. C’est aussi une économie importante en France qu’on est en train de tuer Agnès Jaoui Pour écrire et composer les chansons d’On va se quitter pour aujourd’hui, elle est partie à la campagne pendant le premier confinement avec Alexis Pivot. Son livret repose sur des malentendus, des différences de points de vue. Une psychothérapeute se rend compte que l’homme dont lui parle une patiente est peut-être son mari. Évidemment, elle reconsidère sa vie. «L’idée du jazz, c’est le choix d’Alexis Pivot qui est un jazzman brillant, raconte Agnès Jaoui. Je l’ai rencontré sur le film La Maison de Nina, il y a quinze ans et nous sommes restés amis. Je suis souvent allée l’écouter en concert. Enfin, j’ai adoré son travail sur le théâtre immersif Close.» Écrire, puis avoir l’occasion de faire ces répétitions, lui a fait beaucoup de bien. «Cela montre que même sans public présent physiquement, c’est possible, souligne Agnès Jaoui. Ce qui se passe pour la culture est tragique. Je n’avais jamais été traitée de “non essentielle” et en plus, ce n’est pas vrai. Là, je suis tout le temps masquée, je fais très attention. On a besoin de culture, martèle-t-elle en soupirant. Ce n’est pas essentiel, c’est vital. Les gens ont besoin d’autre chose que de regarder des plateformes. C’est aussi une économie importante en France qu’on est en train de tuer. Apprendre que les théâtres, musées, cinémas ne rouvriront pas avant janvier est le coup de trop.» Étrange année Depuis le premier confinement, elle a pu tourner «entre les gouttes» deux films. Compagnons, de François Favrat avec Pio Marmaï, et À l’ombre des filles d’Étienne Comar avec Alex Lutz. À cause de la pandémie, «je ne sais pas quand ils sortiront», soupire-t-elle. Cette année étrange ne l’a pas particulièrement inspirée pour écrire. «C’est trop tôt. C’est une expérience de vie complètement folle et riche de remise en cause. On a pu réfléchir sur notre rythme de vie, sur les relations humaines, de qui on avait besoin. Il y a eu plein de premières fois. C’était la première fois qu’une telle épidémie avait lieu en même temps dans le monde entier. La première fois qu’on paye les gens même s’ils ne travaillent pas. J’ai besoin d’une période plus longue pour digérer. Dans un premier temps, c’est comme les attentats, cela assèche ma plume. Il me faut du temps pour comprendre.» Les jeunes générations sont étonnantes. Il n’y a pas très longtemps, il y a sept ans, se dire féministe c’était comme si on se disait paléontologue Agnès Jaoui Évidemment, impossible de ne pas lui parler des Assises pour l’égalité, la parité et la diversité dans le cinéma organisé par Le Collectif 50/50, le 25 novembre dernier. Agnès Jaoui y a prononcé un discours très fort sur la place des femmes. Elle est revenue sur son enfance, marquée par les agressions sexuelles, puis sur son rapport au cinéma et au théâtre. «Mon texte m’est venu d’une traite. Je n’avais jamais publiquement parlé de ce qui m’était arrivé étant petite. C’était l’occasion. J’ai eu la sensation que cela allait avec mon parcours, sur la façon dont on peut prendre sa place malgré les embûches. S’il y avait eu davantage de films et de dessins animés où les filles se défendent, peut-être que j’aurais mieux su répliquer.» Aujourd’hui, les choses évoluent, «car les jeunes générations sont étonnantes. Il n’y a pas très longtemps, il y a sept ans, se dire féministe c’était comme si on se disait paléontologue, plaisante-t-elle. Tout à coup, il y a une prise de conscience fabuleuse. Cela dit, dans les faits, cela change très lentement. Regardez les femmes en politique, les écarts de salaires. C’est fou, quand même. Il y a des résistances mais je préfère rester optimiste.» *Les Plus Belles Comédies musicales, livre-disque, 27,99 €, Éditions Radio France.
Agnès Jaoui lors des répétitions de la comédie musicale On va se quitter pour aujourd’hui, à la Maison de la radio, le 8 décembre à Paris. Radio France / Abramowitz Christophe
À LIRE AUSSI :«Vers 5 ans, je me suis fait abuser «: le choc Agnès Jaoui aux Assises du collectif 50/50

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 13, 2020 2:34 PM
|
Par Richard Schittly (Lyon, correspondant) dans Le Monde 13/12/2020 Si le courrier adressé samedi au premier ministre ne donne pas lieu à une réponse, le président de la métropole de Lyon envisage de rouvrir deux musées malgré l’interdiction gouvernementale. Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), le maire (EELV) de Lyon, Grégory Doucet, et Cédric Van Styvendael, maire (PS) de Villeurbanne et vice-président métropolitain de la culture, ont cosigné un courrier adressé à Jean Castex, samedi 12 décembre, dans lequel ils réclament la réouverture des lieux culturels dès le 15 décembre. Jeudi 10 décembre, le chef du gouvernement a prévenu que pour faire face à la crise sanitaire, les lieux culturels ne pourraient pas ouvrir en France avant janvier 2021, et non le 15 décembre comme cela avait été envisagé dans un premier temps. Une annonce qui a provoqué la colère et l’incompréhension du monde culturel. « Nous vous demandons de prendre en considération les efforts faits, en responsabilité, par l’ensemble des salles, des musées et de tous les acteurs culturels pour assurer la sécurité de leurs publics. Et, en conséquence, d’autoriser leur réouverture au 15 décembre. Il en va, nous le croyons, de notre humanité commune », écrivent les trois élus au premier ministre, dans le courrier que Le Monde a pu consulter. Le président de la métropole de Lyon et les deux maires invoquent le respect des normes sanitaires pour justifier leur demande : « Les protocoles sanitaires sont organisés, les jauges calculées, les équipes d’accueil rodées. Le public accepte les consignes de préréservation et de distanciation, comme l’a d’ailleurs montré la période entre deux confinements où aucun cluster n’est parti de lieux culturels. » « Une société plus que jamais fracturée » Ils dénoncent aussi « l’absurdité » de la situation : « Les lieux de grands passages – centres commerciaux, aéroports, gares, métros, ou encore l’ensemble des commerces – ont repris leur fonctionnement, tandis que les lieux de culte ont obtenu le droit à accueillir du public notamment par un recours devant le Conseil d’Etat. Et la culture ? Elle attend. Et se meurt. » Outre la référence à la pièce d’Eugène Ionesco Le Roi se meurt, les trois signataires citent Albert Camus pour convaincre le premier ministre d’une décision salutaire : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Pour eux, la culture joue un rôle déterminant dans une « société plus que jamais fracturée ». A Lyon, par exemple, le Musée des Confluences est fermé, mais sa boutique est ouverte. « Un modèle de société reposant essentiellement sur la capacité à surconsommer ne saurait réduire les inégalités, ni retisser du lien », disent les élus lyonnais à Jean Castex. Si le courrier reste sans réponse, le président de la métropole envisage de contourner l’interdiction. Il pourrait rouvrir deux établissements emblématiques : le Musée des Confluences et le Musée Lugdunum, sur le site gallo-romain de Lyon. « Je souhaite que l’on étudie cette réouverture même si nous n’avons pas de réponse favorable », dit Bruno Bernard dans un entretien accordé dimanche au journal Le Progrès. Richard Schittly(Lyon, correspondant) Légende photo : Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, le 2 juillet 2020. PHILIPPE DESMAZES / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 12, 2020 6:36 PM
|
Par Carole Boinet dans Les Inrocks 11-12-2020 Jeudi 10 décembre, Jean Castex a annoncé la reconduction de la fermeture des lieux culturels, ainsi qu'un couvre-feu dès 20h à compter du mardi 15. Pourquoi la culture est-elle autant méprisée ? Oh mais quelle surprise de découvrir que les cinémas, musées, théâtres et salles de concert resteront fermés trois semaines supplémentaires (a minima) ! Comme pour toutes les autres conférences de presse, le gouvernement avait déjà fait courir les rumeurs : 1- de reconduction de la fermeture des lieux culturels qui devaient rouvrir le 15 décembre ; 2 - de l'instauration d'un couvre-feu. Une façon de s'assurer que les Français·es seront déjà au courant par voix de presse et, ainsi, de transformer la prise de parole de Jean Castex et Olivier Véran en simple confirmation de ce que tout un chacun savait déjà pertinemment. Petite malice gouvernementale supplémentaire : plusieurs médias avaient évoqué la possibilité d'un couvre-feu dès 17h sous les yeux stupéfaits d'une population en PLS depuis le mois de mars. Dès lors, l'annonce d'un couvre-feu à 20h pouvait presque paraître clémente voire anecdotique. “20H ? Olala, mais ça va, easy, j'aurais le temps de boucler ma journée de travail !” Le plus cynique étant la désormais impossibilité de critiquer les mesures gouvernementales sous peine de passer pour un sombre complotiste anti-masques, un hors-sol baignant dans le caviar, un camé de la fête, une limace du dance-floor, quelqu'un qui aimerait jouir de sa vie (my god quelle idée) ! Une impossibilité renforcée par la monstration - lors de cette fameuse conférence de presse - des courbes des contaminations et décès avant la révélation des nouvelles mesures nécessaires pour endiguer la pandémie. Ainsi, le lien de cause à effet est tiré et strictement noué. Les lieux culturels participent hautement de la propagation du virus. Laissons-les fermés. Questionner les mesures prises, même face à une pandémie mondiale qui nous dépasse toutes et tous, relève pourtant de la bonne santé mentale. Il faut toujours questionner le systématisme, preuve en sont les combats des minorités politiques, qu'il s'agisse de l'anti-racisme ou du féminisme. Il faut questionner le pointage du doigt systématique d'une jeunesse qui pourrait bien perdre le désir de vivre à force d'être prise pour le bouc-émissaire. Il faut questionner l'abandon systématique de l'Art et de la Culture par un gouvernement au climax du mépris. Il faut questionner les priorités, la hiérarchisation. Il faut questionner la lecture dichotomique d'un monde désormais partagé entre les essentiels et les non-essentiels. Bientôt jugés sur notre taux de production et de rentabilité ? Franchement, on en est à deux doigts. Il faut questionner la dangerosité d'une salle de cinéma où tout le monde est assis et masqué. Questionner la dangerosité d'une salle de théâtre où tout le monde est assis et masqué. Questionner la dangerosité d'une salle de concert où tout le monde est assis et masqué. Questionner la dangerosité d'un musée où tout le monde est debout certes mais masqué, à bonne distance (régulation de la jauge par un personnel compétent), et - sauf distribution de kéta par quelqu'un devenu fou (ou pas) – où personne ne se saute dessus pour se rouler de grosses pelles. Quelle différence existe-t-il précisément avec le BHV situé dans le Marais, à proximité de l'Hôtel de Ville, hystériquement blindé le week-end dernier puisque le grand magasin (grand au sens commercial du terme, attention) avait carrément instauré non pas un mais trois jours de Black Friday ? Des scènes de folie capitalistique donnaient à voir des consommateur·trices se pressant collé·es-serré·es dans les rayonnages étroits et surchauffés afin de faire bouillir voire fondre leur carte bleue. Quelle différence existe-t-il précisément avec le métro bondé aux heures de pointe (les heures qu'utilisent celles et ceux qui n'ont pas le luxe du télétravail, soit pas mal de gens qui font tourner la France, ce pays transformé en vaste entreprise) ? Ce métro où l'on se colle les un·es aux autres, où l'on touche la même barre pour ne pas tomber ? Il se dirait qu'on ne peut se passer des grands magasins et des transports en commun. Parce qu'il faut bien “faire ses achats de Noël” selon l'expression consacrée. Parce qu'il faut bien se rendre au boulot. L'essentiel réside donc dans la production/ consommation placée sous le signe d'une fête chrétienne que le gouvernement estime indispensable à notre survie mentale. Réaffirmer l'importance de Noël, c'est embrasser une religion (et une seule), mais aussi les liens du sang. Les regroupements entre ami·es sont interdits mais il faut préserver les familiaux vous comprenez. Préserver Noël au détriment de tout, c'est oublier la violence de la famille pour celles et ceux qui en ont été rejetés pour leurs opinions politiques, pour leurs envies de liberté, pour leurs orientations sexuelles, pour leurs besoins de survivre loin des brimades et des coups. Préservons donc le 24 au soir où le couvre-feu sera exceptionnel-lement levé afin que les familles se réunissent sous le sapin. Faisons en sorte que tout le monde craque et dîne avec leurs parents et grands-parents. Faisons circuler le virus sur tout le territoire, instillons le dans toutes les familles histoire que l'on se reconfine à la sortie de ces vacances exceptionnelles, en janvier. Et puis personne dans les rues après 20h hein ! On le sait désormais, le virus circule la nuit. Le jour, le travail doit le repousser. Et puis le jour, c'est la normalité, le contrôle, la sérénité, la production, la consommation. Le jour, c'est cadré. La nuit par contre, on pourrait bien aller se faire une petite promenade dans les rues, dans cet espace de plein air qui ne nous appartient plus depuis longtemps. Les femmes la connaissaient déjà, l'impossibilité d'être maîtressesdu territoire géographique, de sentir la nuit glisser sur son corps, de s'aventurer seule dans une exploration nocturne. Les autres la découvrent désormais. Ce manque de liberté de mouvement, l'enfermement, la dépossession de soi, mais aussi l’annihilation de la Pensée. Alors il reste le numérique oui. Mais ce n'est pas que ça la vie, pas uniquement. Et que restera-t-il de la vie justement à la sortie ? Qui sera encore debout, vaillant ? Qui aura envie ? Qui croira en une utopie collective ? Qui créera ? Qui donnera, gratuitement ? Qui sera envahi du désir de l'Autre ?

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2020 6:03 PM
|
Publié dans les Dernières nouvelles d'Alsace le 11 décembre 2020 C’est avec Phèdre, de Racine que le Théâtre National de Strasbourg devait renouer avec sa saison dès le 15 décembre. On sait depuis jeudi qu’il n’en sera rien.. Réaction de Stanislas Nordey, directeur du TNS : « Au-delà de la déception, de la fatalité qui tombe sur la culture, se posent des questions de fond importantes, pourquoi la culture vient après le commerce, pourquoi pas avant ? Cela renvoie à ce que nous sommes, à nos sociétés. Qu’est ce qui est important ? La vie est importante, la santé, mais aussi l’art et la culture, commente le patron du TNS. Cela n’est pas un acharnement contre la culture, mais cela dit quelque chose sur le fonctionnement de la société. On se prive des artistes et des spectateurs un peu plus longtemps encore. C’est un dommage qui touche en profondeur, même si on ne le voit pas sur la peau ». Demeure la situation préoccupante de l’écosystème du spectacle vivant. « En l’absence de spectateurs, poursuit Stanislas Nordey, on va aider les artistes. Il y a les jeunes artistes, les intermittents. On prend le camion dans la figure, il faut que ce gouvernement prenne ses responsabilités, mette ses actes en accord avec ses décisions. Il faut soutenir les artistes, les jeunes, les intermittents. »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 11, 2020 12:31 PM
|
Par Eric Demey dans Sceneweb 11/12/2020 On l’a senti, dès les premières réactions à l’intervention de Jean Castex : la décision de n’envisager la réouverture des salles de cinéma et de spectacle qu’à partir du 7 janvier 2021 aura du mal à passer. La colère gronde de partout dans le monde de la culture et les salles de spectacle vont adresser un référé auprès du Conseil d’État pour faire valoir leurs droits. « Le Conseil d’État est le garant de l’équité. Ça fait 15 jours que tout le monde, cinémas et théâtres, aurait dû faire un référé. A partir du moment où l’État a autorisé les églises à rouvrir. En gros, si vous autorisez une boucherie à ouvrir, il faut aussi autoriser la charcuterie. Alors, on ne va pas discuter de ce qui est essentiel ou ne l’est pas. Mais les théâtres et les églises, ça se ressemble autant qu’une boucherie et une charcuterie. Ils ont exactement le même dispositif sanitaire. Vous avez des gens masqués, espacés qui font face à une personne qui s’adresse à eux. Du point de vue du protocole, il n’y a pas plus similaire », explique Samuel Churin, comédien et tête de file de bien des combats sociaux. « J’ai hâte de savoir en quoi le fait d’assister au récit de la naissance d’un homme nommé Jésus serait sans danger, alors que le récit d’un homme nommé Tartuffe serait source de contamination » lâchait-il hier après-midi sur son profil Facebook pour conclure sa lettre ouverte. Il y appelait les responsables de salles de cinéma et de théâtre à introduire un référé auprès du Conseil d’État au nom de ce principe d’équité. Depuis, le mouvement est lancé. « Jean-Paul Angot de l’Association des Scènes Nationales, Robin Renucci de l’ACDN (Association des Centres Dramatiques Nationaux) veulent y aller. Bien sûr, tous ne vont peut-être pas suivre. Je connais des directeurs de CDN (Centre Dramatique National) qui ne veulent pas s’attaquer à l’État de peur de perdre leurs postes. Mais ça y est, ça se bouge enfin » conclut Samuel Churin. Le mouvement prend une ampleur spectaculaire Et en effet, ça décolle. Et pas seulement du côté des syndicats du théâtre public. « On était en réunion avec la SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques) et PROFEDIM (Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique) ce midi. Les organisations du théâtre privé doivent encore voter mais sont d’accord sur le principe. La CGT-F.O se lance aussi. Et les salles de cinéma se rencontraient en parallèle de nous » explique Nicolas Dubourg, Président du SYNDEAC (Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles). Le mouvement prend donc une ampleur spectaculaire. Mais, pour lui, il ne faut pas se précipiter. « Le décret sur la fermeture des salles n’est pas encore publié et il faut bien réfléchir à l’argumentaire. On devrait déposer un recours mardi ou mercredi, ce qui permettra d’avoir une réponse pour le 15 ». Suivant une optique sensiblement différente de celle proposée par Samuel Churin. « Il nous semble plus judicieux d’attaquer du point de vue du « service à la personne ». A partir du moment où on a rouvert les magasins, non pas parce qu’ils sont essentiels, mais parce qu’ils proposent des services à la personne, il n’y a pas de raison que nous, on soit interdit d’ouvrir. Les restaurants, on doit enlever le masque pour manger. Je veux bien comprendre. Mais les salles de cinéma et de spectacle ont des protocoles sanitaires, une distanciation, des spectateurs qui gardent le masque. Si nous devons fermer quand les galeries marchandes sont ouvertes, il va falloir nous expliquer pourquoi ». Deux argumentaires différents donc, qu’il faudra départager. L’affaire devient celle des spécialistes du droit desquels structures et syndicats se sont rapprochés. Mais pour , Samuel Churin les chances de voir sa logique aboutir ne sont pas minces. « Évidemment, un lieu de culte, ce n’est pas comme un lieu payant. Mais à part ça il faudrait prouver que les conditions sanitaires sont différentes. Et ça ne peut pas être non plus une question de nombre. Il y a plus d’églises que de théâtre en France. Pas plus que de fréquentation quand on pense au nombre de gens qui vont aller à la messe de Noël ». « Personne ne souhaite qu’on lui dise ce qui doit être essentiel et ce qui ne le serait pas ou s’il faut préférer la Bible au Roi Lear » « Devant une crise qui ébranle totalement notre monde, les choix faits sont des choix de société et on ne peut pas en réduire les existences à leur seule dimension religieuse ou commerciale et n’en respecter que ces aspects « explique Adrien de Van, directeur du Théâtre Paris-Villette dans un communiqué qui concilie les deux logiques. « Il ne s’agit pas de défendre une « boutique ». Ce ne sont pas les théâtres qui sont en danger mais les hommes et les femmes qui y créent. On peut se passer de théâtre pendant des mois, on ne peut pas se passer de justice » poursuit le directeur du TPV en ajoutant « Personne ne souhaite qu’on lui dise ce qui doit être essentiel et ce qui ne le serait pas ou s’il faut préférer la Bible au Roi Lear ». Dans un texte où il annonce que son établissement s’associe au mouvement, Charles Berling directeur du Théâtre Chateauvallon – Liberté, scène nationale toulonnaise – lance « Nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous laisser abattre ». Sous l’impulsion de Christian Benedetti, directeur du Studio-Théâtre d’Alfortville, en banlieue parisienne, du théâtre Monfort, le mouvement s’étend aux théâtres de la ville Paris. Edouard Chapot et Mathieu Touzé, les co-directeurs du Théâtre 14 ont annoncé sur twitter qu’ils saisissaient « le Conseil d’Etat pour contester notre fermeture que nous ne comprenons pas ». Longtemps compréhensif et faisant bonne grâce aux injonctions présidentielles de se réinventer, le spectacle vivant, lourd d’un sentiment d’iniquité dans le traitement ainsi que d’avoir préparé une reprise qu’on lui interdit au dernier moment, cette fois, a décidé de passer à l’action. Eric Demey – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 10, 2020 7:25 PM
|
Par Eric Verhaeghe dans Le Courrier des stratèges 10/12/2020 Jean Castex a annoncé, s'agissant de l'épidémie de coronavirus, des mesures auxquelles nous nous attendions tous : face à la persistance du virus, il reporte de trois semaines les ouvertures esquissées pour le 15 décembre, il instaure un couvre-feu à 20 heures, et il interdit les fêtes de Nouvel An (signe qu'il connaît gravement la symbolique païenne de cette fête). Tout cela n'est pas une surprise sur le fond. Toute la question est de savoir par quelle perversité, par quel sadisme, cette décision sanitaire se transforme en examen collectif de conscience, et en culpabilisation déprimante et anxiogène pour tous les Français. Sur l’épidémie de coronavirus, et sur le confinement plus ou moins strict qui en découle, il existe deux lectures. Epidémie de COVID et mesures prophylactiques La première lecture, la plus simple, consiste à en revenir aux faits et aux choses. Un virus s’est répandu à la faveur des températures hivernales. Comme tous les virus saisonniers, il s’impose aux humains (c’est en quelque sorte le tribut que la nature impose aux hommes) lorsque les températures baissent, et il s’évanouit lorsque les températures montent. Nous pourrons inventer tous les vaccins du monde, ce virus saisonnier reviendra, et il faudra s’en prémunir. Nous pourrons inventer tous les confinements du monde, ce virus fera son oeuvre. Il est là, il fait partie de nos vies, désormais, et nous devons apprendre à vivre avec lui. Pour limiter les pertes humaines que ce virus cause, on peut prendre des mesures. Mais ce sont des mesures défensives, prophylactiques, destinées à diminuer ces effets. Elles peuvent être plus ou moins rigides, plus ou moins désagréables. Elles sont imposées par la nature et par l’adversité. Dans la pratique, le caractère saisonnier du virus est connu depuis plusieurs mois et nous n’y pouvons pas grand chose. Seulement imposer des carcans plus ou moins forts aux relations entre humains pour éviter sa propagation. Ces carcans peuvent être drastiques comme en Extrême-Orient, où l’appétence pour la liberté est faible, ou souples comme en Occident où le risque de mourir n’a jamais justifié le sacrifice complet des libertés. Dans tous les cas, le virus est un phénomène naturel, comme nous en avons connu des milliers depuis que nous habitons sur cette terre, et comme nous en connaîtrons des milliers tant que nous l’habiterons. Une chose est sûre : en hiver, à part interdire tout contact entre les humaines, nous ne pouvons nous prémunir efficacement contre la circulation de ce virus. Epidémie de COVID et culpabilisation collective Une deuxième lecture consiste à prêter à ce surgissement naturel du virus un sens métaphysique, ou téléologique comme disent les philosophes. Au fond, ce virus est là pour punir les hommes d’un excès d’hybris, d’arrogance vis-à-vis de leur place dans l’histoire et dans la création. Cette croyance selon laquelle les épidémies arrivent par la faute de l’homme, par son arrogance, par sa jouissance excessive, par son impiété, est tout sauf nouvelle. Dans son « De Rerum Natura », Lucrèce la décrivait déjà. Et lorsque la peste noire a décimé l’Europe entre 1347 et 1349, des Flamands ont empoigné des fouets et ont fait la tournée des villages en se fouettant le dos pour expier les fautes qui avaient conduit à l’épidémie. Ils étaient à l’unisson d’une certaine conviction de l’époque selon laquelle la maladie était le résultat d’une faute qui aurait pu ne pas être commise. Jean Castex, en bon flagellant, ainsi que Macron, en bon élève des Jésuites, ne nous suggèrent pas autre chose : au lieu de nous expliquer qu’il faut confiner la France en hiver pour ralentir l’épidémie, ils font reposer celle-ci sur le comportement des Français. Et dans la logique du discours officiel, on n’est pas très loin des péchés mortels que la société du Moyen-Âge se reprochait pour expliquer la peste. Le virus circule parce que nous ripaillons trop, nous folâtrons trop, nous jouissons trop. Vivons en ascète, et l’ordre reviendra. Deux salles, deux ambiances, donc, pour une seule maladie. D’un côté la rationalité scientifique qui met en avant l’objectivité d’un fait naturel contre lequel nous ne pouvons pas grand chose, sinon attendre. De l’autre côté la passion religieuse qui attribue à l’homme la responsabilité d’un phénomène naturel qui ne lui incombe pourtant pas, ou si peu. Mais il est si humain, et (allions-nous dire) si chrétien, de ramener à une culpabilité subjective tout phénomène naturel qui déstabilise l’homme. Les rationalistes ne sont pas ceux qu’on croit Il est frappant de voir comment le pouvoir temporel qui nous conduit officiellement selon les canons de la raison est resté profondément marqué par les réflexes religieux des temps passés. Emmanuel Macron se réclame du siècle des Lumières. Jean Castex se veut rationaliste. Mais là où ils pourraient se contenter d’expliquer aux Français que la nature a ses lois auxquelles nous devons nous plier, tous deux préfèrent transformer l’épidémie en faute morale collective des Français. Nous ne devons pas nous confiner parce que la maladie sévit, parce que nous l’avons mal combattue, à force d’indiscipline, de désobéissance, de jouissances en tous genres. Nous devons nous confiner pour interrompre la malédiction qui pèse sur nous du fait de nos jouissances excessives. Et que n’avons-nous entendu ces derniers jours pour nous rendre coupables de la virulence d’une maladie qui nous tombe sur le dos à l’improviste ? Et soudain, nous jouons à front renversé. Ceux qui nous parlent des Lumières et de la raison sont les vrais praticiens de l’obscurantisme que Lucrèce décrivait dans l’Antiquité. Ce sont eux qui expliquent la nature par la faute des hommes. Et les Gaulois réfractaires sont les vrais rationalistes, qui abordent l’épidémie sans calcul et ne prêtent à la nature aucune intention, aucune finalité morale qui sanctionnerait des péchés. Le coût social de la culpabilisation collective sera lourd à payer Cette croyance naïve selon laquelle la virulence de l’épidémie proviendrait de notre propension à faire la fête explique la perversité avec laquelle le gouvernement gère la crise. Au lieu de décider d’un confinement clair et net par temps froids (puisque le vrai déterminant du virus est le climat et non les fêtes), le gouvernement tente en permanence de rendre les Français responsables de la circulation du virus. Il ne faut pas chercher un autre sens aux « critères » énoncés par Emmanuel Macron pour décider d’un déconfinement. Il faut vraiment porter un magnifique formatage religieux pour transformer avec autant de sadisme un phénomène naturel en culpabilité collective. Alors, si, collectivement, vous n’atteignez pas trois critères chiffrés de santé publique, vous serez punis par du confinement ? L’affaire est bien montée : elle fait croire aux Français qu’ils sont la cause d’un phénomène, alors qu’ils n’en sont que les victimes. Ce qu’il faut mesurer maintenant, c’est le coût social et humain de ce sadisme. On parle beaucoup de la détresse psychique des Français, mais elle est pour le coup parfaitement orchestrée par une élite technocratique imbibée d’esprit animiste, pour qui les phénomènes naturels s’expliquent par des fautes humaines. Si l’on confine, ce n’est pas parce que le virus sévit, ni parce que la France était mal préparée à une épidémie pourtant maintes fois annoncée depuis 15 ans. Si l’on confine, c’est parce que nous sommes trop indisciplinés. Combien de temps faut-il pour reconstituer l’énergie vitale d’un peuple qu’on traite aussi mal ? Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est sûre : le directeur général de la santé, qui a fait carrière en suçant la roue d’Emmanuel Macron, est toujours en poste, alors qu’il a tout fait pour nous abordions cette crise sans disposer du moindre stock de masques, du moindre test, de la moindre capacité hospitalière nouvelle pour absorber le choc des réanimations. Cette incompétence-là se traduit par des millions de travailleurs indépendants en détresse, de salariés au bord du gouffre. Mais nous continuons à protéger l’un, et à culpabiliser les autres, qui n’y sont en réalité pour rien. Au nom des Lumières, bien entendu.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...