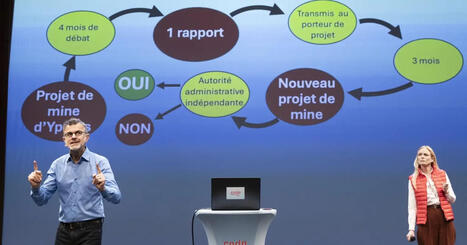Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre
Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://x.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'entonnoir (Filtres) et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 10, 11:38 AM
|
Critique d'Emmanuelle Bouchez / Télérama - publié le 9/02/26 Emmanuel Demarcy-Mota met en scène avec maestria ce conte mouvementé, porté par une quinzaine de comédiens pleins de fougue. L’ensemble répand une énergie folle. À voir jusqu’au 20 février.
TTT Très bien Article réservé aux abonnés De la pièce écrite en 1945 par Bertolt Brecht (1898-1956), alors qu’exilé aux États-Unis il se souvient de 14-18 et observe de loin la Seconde Guerre mondiale, le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota affirme toute la puissance épique. En abrégeant, avec raison, le prologue daté, où un rude débat a lieu entre deux kolkhozes du Caucase sur la manière la plus « utile » d’exploiter la terre après les destructions de l’armée nazie. Son spectacle donne tout de suite libre cours à la légende convoquée par les orateurs et située en des temps féodaux, où le gouverneur de la province tyranise son peuple avec l’aide de sa femme, qui vient d’accoucher de « l’héritier ». Mais la révolte gronde, l’ordre explose, tout le monde fuit. Reste en rade, dans le chaos, l’innocent bébé… C’est donc l’histoire d’un sauvetage et d’une générosité à toute épreuve — Groucha, « la fille de cuisine », sauve l’enfant du despote déchu — dont s’empare Demarcy-Mota avec sa maestria théâtrale. Au fil de situations campées par de très belles images et des chansons populaires sans lien avec celles de Brecht mais davantage traitées comme des récits, nous voilà projetés sur les pas de Groucha, alias Élodie Bouchez, qui serre les poings en courageuse têtue. Il y a de la randonneuse chez elle quand, dans une scène saisissante, elle traverse un précipice sur une passerelle branlante. Elle est touchante aussi dans sa froide soupente où elle s’encourage elle-même en berçant le nourrisson. Du mélange des tons, la fidèle « troupe » du Théâtre de la Ville (une quinzaine d’acteurs et d’actrices !) s’empare avec fougue. Soldatesque prête à violer, factions flattant le peuple, puissants en déroute ou noceurs cocasses surgissent tour à tour dans cette pièce-fleuve, balayant chaque fois ceux qui pensaient avoir conquis le pouvoir. Celle-ci s’achève sur un procès où le juge, élu malgré lui, est un compatissant filou. Dans cet autre rôle phare, Valérie Dashwood déploie une énergie versatile, entre ironie lasse et virulence folle. Mais il faudrait les citer tous et toutes, de Philippe Demarle à Gérald Maillet (touchant soldat amoureux), en passant par Sandra Faure (un prince ubuesque), ou cette jeune Ilona Astoul dans le rôle de l’enfant, capable pourtant d’entonner un blues viscéral. Tous défendent avec hardiesse ce conte mouvementé, qui n’oublie pas de servir sa « morale » à la fin… Que Demarcy-Mota concentre en un message simple — dont on vous laisse la surprise — qui redonne confiance en l’humanité. Emmanuelle Bouchez / Télérama -
Titre Le Cercle de craie caucasien -
Genre Théâtre -
Auteur Bertolt Brecht -
Lieux Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt, 2 place du Châtelet, 75004 Paris -
Dates Du 28/01/2026 au 20/02/2026 Légende photo : Élodie Bouchez dans le rôle de Groucha. Photo Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 10, 11:23 AM
|
Par Lucile Commeaux / Libération - Publié le 10 février 2026 L’écrivain et metteur en scène reconfigure la pièce de Sophocle pour creuser l’histoire de sa propre famille dans un spectacle hybride, cérébral et de toute beauté.
«L’inceste est la texture de ma vie» : un homme seul parle sur une scène blanche comme une page vide, les bras ballants, le verbe bas, et le sourire du désastre directement adressé aux spectateurs. Eddy D’aranjo, à la fois écrivain, metteur en scène et acteur de cet Œdipe largement reconfiguré, joue pendant quelque quatre heures un spectacle qui prend tout – mythe, réel, langue, image – pour tisser une grande œuvre à la fois douce et rêche. C’est qu’il faut, pour représenter l’inceste, coudre ensemble le théâtre antique, la psychanalyse moderne, les sciences sociales, la performance et la littérature, et surtout prendre soin de laisser les coutures et les accrocs visibles ; à cette condition seulement, le spectateur pourra voir. De fait, on est assailli par ce spectacle hybride qui a quelque chose de cérébral et d’immature à la fois, et qui, pour peu qu’on lui résiste, abat bien de nos réticences, à force de beauté. Le premier tour du spectacle consiste à escamoter la pièce de Sophocle sous la matière autobiographique. En fait de Thèbes, nous sommes en Picardie dans la maison d’Eddy D’aranjo, figurée seulement d’abord par une machine à laver et une baignoire carrelée, un des lieux sans doute où le père viola la grande sœur, avant que la mère ne fuie avec ses deux enfants. Comment on montre ça sur une scène ? Comment on fait avec les attentes des spectateurs, parmi lesquels statistiquement il existe sans doute à la fois des victimes et des agresseurs ? Est-ce qu’il s’agit là de réparer ou de creuser la plaie ? Doit-on selon la doxa inspirer terreur et pitié ? De toutes ces questions, le spectacle ordonne un prologue très (trop) rhétorique. Il souffre sans doute du fait qu’avant lui, on ait lu et entendu pléthore d’un contenu hybride entre le récit de soi et l’analyse, entre les sciences et la fiction. Eddy D’aranjo le sait, cite Neige Sinno, et se perd dans un dédale de prétéritions, disant sans cesse ce qu’il ne va pas faire, tout en le faisant un peu quand même (pleurer dans les chaumières /choquer le bourgeois /sortir les statistiques). Pieuvre terrible On s’agace un temps, mais sans doute on se soumet devant un tel déploiement cérébral, qui semble d’abord limiter le théâtre, mais qui finalement constitue son espace. La scène d’abord presque vide, puis augmentée d’un écran et d’une petite maison de bois, se transforme en une carte mentale, celle d’un homme qui enquête sur les siens, avant de les incarner dans un dispositif bien connu désormais des spectateurs, qui consiste à filmer et diffuser en direct ce qui se passe dans un décor demi-clos. On déplore les quelques tics d’une grammaire trop vue, mais aussi le relais pris par des comédiens par ailleurs irréprochables, car c’est Eddy D’aranjo et sa prosodie étrangement molle qu’on veut seulement entendre. Au cœur du spectacle résonne ainsi un exposé remarquablement mené par le principal intéressé, vêtu ironiquement d’un uniforme de policier, qui une heure durant raconte, documents à l’appui, l’histoire de la famille D’aranjo. Une famille minée par le désordre, l’errance, la misère, l’alcool, et la reproduction de l’inceste, pieuvre terrible figurée par des flèches sur un arbre généalogique projeté plein écran. On comprend alors que l’hémorragie explicative du début reproduit dans le fond celle indispensable de l’enquête, et que sur cette scène parfois trop encombrée de mots et de théories, le symptôme travaille sans résoudre, dans le conflit et la contradiction. Retournement spectaculaire Une image flanque le vertige et d’un coup fait tout basculer : sur l’écran se superposent brièvement l’image d’un antique et grec rameau d’olivier et celle du motif végétal caractéristique d’un papier peint, de ceux qui tapissaient les intérieurs populaires. Se joue là le retournement le plus spectaculaire de la pièce, celui qui permet que les dialogues de Sophocle résonnent dans une cuisine picarde : la littéralisation du mythe. Le théâtre ne rend pas l’expérience incestuelle, c’est elle qui le rend dans un processus à l’inverse de la transfiguration. La violence n’est pas symbolique, elle est littérale : c’est le mot «pute» prononcé au téléphone par un oncle et qui résonne dans le noir de la salle, c’est l’odeur d’un oignon qu’on épluche sur le plateau, c’est la faute d’orthographe au mot «violée» dans une lettre froissée. Œdipe roi d’après Sophocle, écriture et mise en scène Eddy D’aranjo, au théâtre de l’Odéon - Ateliers Berthier (75017) jusqu’au 22 février. Lucile Commeaux / Libération Légende photo : La scène se transforme en une carte mentale, celle d’un homme qui enquête sur les siens. (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 9, 5:35 AM
|
Par Ainhoa Jean-Calmettes dans Libération - 6 février 2026 Si les violences sexuelles intrafamiliales ont toujours existé, les metteurs en scène s’en emparent plus librement aujourd’hui, comme «Œdipe roi» d’Eddy D’aranjo qui démarre le 7 février à l’Odéon.
- En 2010, la romancière Marielle Hubert, alors metteuse en scène, crée les Ames rouges. Une mère y impose quotidiennement à sa fille de «jouer à papa». Sur scène, si des actes sexuels sont explicitement mimés, beaucoup ne voient pas l’inceste. «Une spectatrice est revenue plusieurs fois et ne comprenait toujours pas. Il y a le tabou, et puis le tabou dans le tabou : les abus des mères», explicite l’autrice qui a, depuis, remis ces problématiques au travail dans son deuxième livre. Seize ans plus tard, l’impression que les pièces de théâtre sur l’inceste se multiplient devient dès lors sujette à caution. Réalité statistique ou illusion d’optique propre à la levée du déni ? C’est avec Œdipe roi, d’après Sophocle, qu’Eddy D’aranjo abordera prochainement ces questions à l’Odéon. Un texte vieux de plusieurs millénaires. Les violences sexuelles intrafamiliales ont toujours été là. Et se perpétuent. En France, 160 000 enfants en sont victimes chaque année selon la Ciivise. Ils et elles ont toujours parlé. On ne les entend toujours pas. Christine Angot, un symbole Dans cette dernière pièce, l’acteur Pierre-François Garel joue le père. Le comédien connaissait bien les livres de l’écrivaine. «Nous lui devons tous d’avoir, la première, eu le courage de mettre les mains dans la merde, tout en sculptant entièrement la littérature, la langue, la forme.» Voyage dans l’Est marque, selon lui, un tournant : «Son écriture s’est ramassée et est devenue plus évidente. Ce dont elle parle ne peut plus être évitable. Les mauvaises langues disent qu’elle écrit tout le temps le même bouquin, qu’il ne s’agit jamais que d’elle. Non : elle ne traite que de la société. Tant que la société n’aura pas cessé d’éluder cette question, tout en affirmant se charger du problème, il faudra qu’elle y retourne.» Pour ce rôle, il a travaillé les notions d’amour et de douceur pour rendre plus saisissante la mécanique de la manipulation et la perversion du piège qui se referme sur l’adolescente. Ici, c’est le corps du bourreau, et non celui de la victime, qui est exposé et isolé, offert comme un objet d’observation, «un cas d’école». Pierre-François Garel se souvient, bouleversé, de la réaction de certains spectateurs. «Des hommes et des femmes sortaient en pleurant, comme si la représentation avait eu un effet cathartique. Quelque chose avait lieu, qui dépassait le simple cadre de l’œuvre.» «Les adultes se défaussent trop souvent» Anticipant ce que sa création tout public (à partir de 9 ans) traitant de l’inceste pourrait provoquer, la metteuse en scène Hélène Soulié a mûrement réfléchi au dispositif de médiation l’accompagnant. Les représentations scolaires de Peau d’âne et La fête est finie sont toutes suivies d’une discussion lors de laquelle, contrairement à l’usage, c’est l’équipe artistique qui interroge le public. «Face à l’inceste, la responsabilité est collective, explique-t-elle. Les adultes se défaussent pourtant encore trop souvent les uns sur les autres. Nous ne pouvions pas poser notre spectacle et dire : “Maintenant, débrouillez-vous avec ça.”» Ces échanges permettent de préciser la compréhension. «Nous entendons fréquemment des discours piégeux type : “C’est parce que son papa l’aime trop.” Au-delà de l’éducation à la sexualité, nous aurions besoin d’éducation sentimentale pour apprendre aux enfants que l’amour, ce n’est pas ça. L’amour ça doit produire de la joie.» L’écriture a été laborieuse. «Avec Marie Dilasser, c’est comme si nous avions, nous aussi, avalé l’impossibilité à dire. Or, la problématique n’est pas, contrairement à ce que relaient beaucoup de fiches d’information, de permettre à l’enfant de dire non. Cela peut même avoir l’effet délétère de remettre la responsabilité sur lui. La problématique, c’est : comment la silenciation de la parole crée des situations permissives. Ne pas réussir à écrire, c’était être complice.» Le résultat ne porte aucun stigmate de cette difficulté. Après une première partie qui met en lumière le lent parcours des victimes pour comprendre ce qui leur arrive et les signes qui peuvent permettre de les identifier, la pièce trace une trajectoire d’émancipation. Ecrite à hauteur d’enfant, avec ses personnages hauts en couleur, sa joyeuse fugue à bord d’une auto-tamponneuse et son procès victorieux, celle-ci souligne également un enjeu fondamental : c’est l’alliance qui permet à la parole d’être entendue. Domination adulte Si l’inceste nous concerne tous, c’est que «théoriquement interdit», il se révèle en réalité «structurant de l’ordre social», comme l’écrit l’anthropologue Dorothée Dussy. «Outil pédagogique majeur dans la palette du bon écraseur», l’inceste inculque la soumission dès le plus jeune âge. Appréhender précisément le phénomène nécessite alors autant d’en saisir les logiques qui le rendent possible, que le type de collectif qu’il constitue en retour, où la domination adulte est le terreau de toutes les autres. La metteuse en scène Léa Drouet n’a eu de cesse de se tenir «auprès de l’enfance» pour ausculter nos sociétés par le prisme du continuum des violences faites auxdits mineurs, d’abord étatiques et policières, puis administratives. Sans traiter ouvertement d’inceste, sa prochaine création abordera notamment la persistance des traumas familiaux. Pour comprendre le Covid long dont elle souffre, l’artiste est retournée sur le territoire de son adolescence chez son père. «Un climat de négligence, de rejet, la confusion des places et le stress continu peuvent durablement fragiliser le système nerveux.» Dans Rodéo, l’inflammation du corps physique, social et terrestre dialogueront, l’intime entrera en écho avec les révoltes pour plus de justice. Les individus souffrent, mais c’est la société qui est malade. Œdipe roi d’Eddy D’aranjo, du 7 au 22 février à Odéon Théâtre de l’Europe, Paris. Peau d’âne – La fête est finie d’Hélène Soulié, du 9 au 11 février aux Quinconces & L’espal au Mans ; du 13 au 14 mars au TSQY ; à l’Onde à Vélizy-Villacoublay ; le 1er avril à l’Empreinte, Brive-Tulle… Rodéo de Léa Drouet, du 17 au 25 septembre à Bruxelles puis au festival Actoral à Marseille. Ainhoa Jean-Calmettes / Libération Légende photo : Les représentations scolaires de «Peau d’âne» et «La fête est finie» sont toutes suivies d’une discussion lors de laquelle l’équipe artistique qui interroge le public. (Marc Ginot)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 5, 6:02 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog de Mediapart - 3 février 2026 Jana Klein et Stéphane Schoukroun réinventent leur autofiction originelle de 2020 à l’aune des fractures contemporaines. « Notre histoire (se répète) » se déploie comme une conversation dialectique entre deux corps et deux intelligences artificielles, Alexa et Siri, érigées en impitoyables maîtres du jeu. Rarement un spectacle aura atteint une telle justesse.
« Ça dépasse l’entendement. On est là à répéter notre spectacle. On est là à réécrire notre histoire. C’est impossible à attraper. Ce que ça me fait. En tant que juif. En tant qu’être humain. J’en parle pas à la famille. C’est impossible sinon on se parlerait plus. J’en parle pas aux amis. Je sais que ce que j’ai à dire ils ne peuvent pas l’entendre. Ça leur sort par les oreilles. L’état d’âme du Juif. L’histoire du Juif. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et tu sais quoi. Je les comprends. Ils sont fatigués. Je suis fatigué. On est tous fatigués. Et pendant ce temps-là. Ils roulent sur les cadavres. Ils rasent tout. Ils effacent tout. Tout ce qui fait lien. Tout ce qui fait sens [1] » Dans un coin, au fond de la scène par ailleurs dépouillée, sont entassés du mobilier, des malles, des cantinières métalliques, que le public ne distingue pas encore, recouvertes qu’elles sont par des bâches en plastique. Les contenants renferment des objets domestiques qui sont autant de reliques d’une intimité fracturée, le décor de « Notre histoire »,pièce très personnelle que Jana Klein et Stéphane Schoukroun créent en 2020, et dans laquelle ils racontent leur histoire qui se confond avec celle du XXème siècle. Jana, Allemande aux racines tchèques, flanquée d’un grand-père nazi et d’un autre tsigane, résistant et déporté, et Stéphane, Juif séfarade marqué par l’exil maghrébin lié à l'histoire des indépendances, exhument les vestiges de leur rencontre amoureuse à Avignon, de la difficile construction de leur couple et de leur condition de parents qui les oblige, six ans après les avoir mis en scène, pour les confronter à l’actualité géopolitique post-7 octobre 2023 et à la montée insidieuse de l’antisémitisme et de l’islamophobie en France. Parce qu’il était impossible pour eux de reprendre « Notre histoire » là où ils l’avaient laissé, parce que la donne a changé, le couple s’interroge sur la meilleure façon de l’incarner à nouveau sur scène, sur sa possibilité même. Comment préserver, raconter, adapter la mémoire familiale et historique lorsque l’actualité ébranle la lecture de celle-ci ? Côté jardin, vêtue d’une veste de sport, casque vissé sur les oreilles, Jana court sur un tapis électrique. Elle court depuis un moment déjà. S’épuiser pour conjurer le sort, pour faire face à une histoire qui se répète, à ceci près que les victimes sont maintenant les bourreaux, pas toutes heureusement. Lorsqu’elle s’arrête de courir, posant son casque sur l’accoudoir du tapis, elle se dirige vers l’amas que forme le décor intime plastifié de sa vie. « C’est encore la nuit. C’est l’heure des contes mon amour mais tu dors » dit-elle à l’adresse de Stéphane. Pour se souvenir de leur spectacle passé, ce dernier convoque deux intelligences artificielles (IA), Alexa et Siri, enceintes-robots que Jana réfute. Lui en a besoin comme aide-mémoire, elle se souvient. Ces oracles numériques forment un chœur mécanique qui impose récit, cadence et injonctions médiatiques, quitte à devenir vite intrusif. Si loin, si proche À rebours des récits linéaires qui figent l’Histoire en monument inaltérable, « Notre histoire (se répète) » opère une sorte de palimpseste vivant, effaçant et réécrivant sans cesse les strates d’une mémoire collective et intime. La scénographie, des bâches froissées évoquant des ruines précaires aux cantinières abritant des objets-souvenirs extraits d’un ensemble pavé de fragments, traduit cette instabilité. Dans cet espace théâtral à la fois géopolitique et domestique, le plateau devient un chantier identitaire en perpétuelle reconstruction. Les deux interprètes, en binôme à la dramaturgie et à la mise en scène, incarnent leur couple « mixte » avec une sincérité électrique. Jana, radieuse et incisive, distille un texte tendre et affûté, tandis que Stéphane navigue entre émotion à vif et parodie outrancière, rappelant les écarts beckettiens entre farce et désespoir existentiel. Leur fille, absente mais omniprésente, sert de catalyseur. C’est pour elle que s’ouvre cette quête, une transmission qui refuse l’amnésie, interrogeant comment éduquer un enfant face aux évènements de l’actualité et aux réactions antisémites à l’école ou sur les réseaux sociaux qu’ils entrainent. Au cœur de cette tragi-comédie amoureuse, les thèmes s’entrelacent avec une profondeur grinçante. L’héritage des fracas du XXème siècle se heurte à la post-vérité contemporaine, où les positions de victime et de bourreau se brouillent jusqu’à s’inverser dans un vertige dialectique. Parmi ceux-là même qui ont survécu à la Shoah, victimes de l’innommable, tache indélébile inscrite au plus profond de l’inconscient européen et occidental, certains, se sentant légitimés par la terrible tragédie des attaques du 7 octobre 2023, répètent les gestes de leurs tortionnaires. Pour vivre en sécurité sur cette terre promise au sortir de la Seconde Guerre mondiale par une Europe rongée par la culpabilité, ils sont maintenant prêts à éradiquer ceux qui vivent là depuis des siècles et des siècles, dans une inversion totale de l’Histoire que le déni rend invisible à leurs yeux, condamnant les Gazaoui au même sort tragique qu’avait été celui de leurs parents et grands-parents. L’écho de la guerre de Gaza est planétaire et dévastateur. La responsabilité de l’Europe dans le drame actuel de la Palestine est immense. L’humour sert ici de scalpel pour traquer poncifs et contradictions, évoquant les réflexions de Freud sur le rire comme mécanisme de défense face à l’horreur, ou celles d’Hannah Arendt sur la banalité du mal revisitée dans l’intimité quotidienne. Dans une scène surréaliste, Stéphane convoque la grand-mère Klein, l’épouse du grand-père nazi de Jana, fantôme surgit du passé, « Celle qui a dit oui. Celle qui a choisi. Celle qui a la solution », pour savoir, pour comprendre, pour ne pas que l’histoire se répète. « Je ne suis pas l’oracle » lui dit-elle « je suis le monstre ». Elle explique, avec un cynisme déroutant, que son mari est « passé de la Wehrmacht à l’ascension sociale. Du prolo au cadre plus-plus. De la Shoah par balles aux gros chantiers », faisant fortune après-guerre dans la construction de funiculaires. BMW, Hugo Boss, pendant les Trente Glorieuses, tout le monde voulait la qualité allemande. « On se positionne. On entre dans l’Histoire. Ou on disparait » lui intime-t-elle encore. La répétition, motif central, n’est pas un simple refrain mais une procédure analytique. Il s’agit de rejouer les mêmes gestes pour en extraire des micro-vérités. Le texte navigue entre la confession et la formule politique, parfois lapidaire, souvent acéré, et laisse affleurer une colère contenue. Mémoire, transmission, répétition des violences symboliques et réelles : il y a ici une plainte sociale tenue. Le spectacle évite le sermon sans pour autant renoncer à la dénonciation. Sa force tient à la capacité de rendre matière sensible ce qui est souvent pensé comme abstrait. Des archives vivantes numérisées Outrepassant leur fonction utilitaire pour devenir des protagonistes à part entière, des démiurges impitoyables qui orchestrent le chaos intime et historique du couple pour mieux le pousser dans ses retranchements, les IA ajoutent une couche méta-théâtrale. Loin d’être de simples gadgets scénographiques, Alexa et Siri incarnent un rôle multifacette, d’abord comme catalyseurs narratifs, intervenant pour relancer le dialogue lorsque la mémoire du couple flanche, fournissant des faits historiques ou des définitions avec une neutralité glaçante qui contraste avec l’émotion humaine. Elles se font archives vivantes, devenant dépositaires d’une mémoire effacée par la disparition des survivants de la Shoah, questionnant l’altérité entre humain et machine, et par extension, entre « nous » et « l’autre » dans un monde polarisé. Jana et Stéphane, en couple mixte, utilisent ces outils pour tester leurs propres limites. Siri, interrogée sur l’antisémitisme contemporain en France post-7 octobre 2023, renvoie des statistiques à priori implacables, mais en réalité contestables, notamment en raison d’une collaboration entre le Conseil représentatif des Juifs de France (CRIF) et le ministère de l'intérieur[2]. Elles forcent le duo à affronter les échos actuels de leur héritage. Cette réécriture, née de l’impossibilité de rejouer la version originale sans la confronter au chaos actuel, marque une maturité transgressive. Le spectacle embrasse l’inconfort, flirtant avec le mauvais goût pour cueillir dans les abysses de la peur, de la colère et de la douleur. Lors de leur rencontre à Avignon, Stéphane avait interrogé Jana sur son éventuelle judaïté. Klein c’est juif ! Non, lui avait-elle répondu, c’est allemand. À la différence de Monsieur Klein[3] dans le film éponyme de Joseph Losey, qui sera envoyé à la mort parce qu’on l’a cru juif et qu’il ne s’est jamais rétracté, elle ne se tait pas, ne ment pas par omission. Le poids de l’histoire est bien trop lourd pour jouer avec. « Notre histoire (se répète) » est une pièce à l’écriture serrée et l’ambition politique, qui invite à repenser les récits qui nous constituent. Si elle n’y répond pas – mais est-ce le rôle du théâtre que d’apporter des réponses ? –, elle pose tout une série de questions existentielles salutaires dans ce nouveau monde au paradigme inversé, là où le bien se confond avec le mal, où la haine exacerbée de l’autre devient le moteur d’une société déshumanisée, dont la majorité semble s’en satisfaire, résignée. La pièce transcende l’autofiction pour devenir un acte de résistance collective, un théâtre sur le qui-vive qui ravive les fantômes du passé pour mieux les fouler au pied, inscrivant la mémoire comme matrice infinie de réparation. À l’image des enquêtes dialectiques de Bertolt Brecht revisitées à l’ère des algorithmes, cette réécriture audacieuse de l’autofiction initiale de 2020 bouscule sans langue de bois, et laisse le public imprégné d’une urgence vitale, celle de dialoguer pour composer avec l’autre dans les soubresauts d’un monde qui, hélas, se répète, et s’impose comme une immersion incontournable pour quiconque interroge les contours mouvants de l’identité contemporaine. Entre farce et tragédie, Jana Klein et Stéphane Schoukroun questionnent la possibilité de dire et d’écouter aujourd’hui. En passant de l’intime au politique, à travers la volonté de décrire comment les histoires individuelles s’inscrivent dans des structures plus vastes, leur histoire devient aussi un peu la nôtre. Guillaume Lasserre / Un certain regard sur la culture [1] Texte à paraitre aux Éditions esse que en juin 2026, https://www.esseque-editions.com/309-notre-histoire-se-repete.html [2] « Face aux appels à une solidarité inconditionnelle avec Israël émanant de responsables du CRIF ou des dirigeants israéliens, d’autres voix juives se sont fait entendre. Des personnalités connues comme le fondateur et ancien président de Médecins sans frontières Rony Brauman, l’ancien président du CRIF Théo Klein ou le rabbin Daniel Farhi, ont appelé à ne pas soutenir inconditionnellement une politique israélienne négatrice des droits des Palestiniens ; pour sa part l’historien Elie Barnavi, qui venait de quitter son poste d’ambassadeur d’Israël en France, a publié en octobre 2002 une Lettre ouverte aux juifs de France dans laquelle il les exhortait à refuser le « suivisme politique », Martine Cohen, « Chapitre IX. Dissonances politiques : le malaise des juifs de France », in Fin du franco-judaïsme ? Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2022, https://doi.org/10.4000/14t3t [3] Monsieur Klein, film franco-italien, réalisé par Joseph Losey en 1976, avec Alain Delon dans le rôle principal. L’acteur a également produit le film. Voir Samuel Blumenfeld, « Monsieur Klein, un double ambigu », Le Monde, 27 juillet 2018, https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/07/27/monsieur-klein-un-double-ambigu_5336776_5325928.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 5, 5:38 AM
|
Par Martine Robert dans Les Echos - Le 2 février 2026 Le spectacle vivant traverse une crise profonde. Entre baisses de subventions, difficultés de diffusion et montée des censures, les professionnels s'inquiètent pour l'avenir. Les modèles économiques sont remis en question et les réductions de voilure dans les salles subventionnées rejaillissent sur le secteur privé. L'heure est grave pour Nicolas Marc, le fondateur des Biennales internationales du spectacle (Bis) qui réunit tous les deux ans le monde du spectacle vivant. « Jamais la culture, le spectacle vivant et celles et ceux qui les font vivre n'auront été aussi attaqués : resserrements budgétaires, crise de la diffusion, polarisation idéologique, montée des réflexes illibéraux, menaces sur la liberté de création et de diffusion. Des menaces qui n'ont pas manqué de frapper les Biennales internationales du spectacle », énumérait récemment le responsable, à Nantes, lors de la dernière édition de ces rencontres. Parmi les intervenants, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait fait le déplacement pour défendre la culture publique. Celle-ci repose essentiellement sur des financements croisés (Etat-collectivités) et il peut y avoir un risque de choc systémique dès que l'un des partenaires se retire comme l'ont fait certains départements ou régions. Réduction des tournées Pour leur part, les acteurs de la culture privée ont témoigné d'un effet domino, en période de restriction budgétaire, constatant qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à vendre leurs productions aux salles publiques victimes de baisses de subventions. « Les tournées deviennent compliquées à construire, c'est difficile d'avoir plus de dix dates alors qu'on pouvait en avoir jusqu'à quatre-vingts avant le Covid. Par conséquent, nous avons réduit nos créations d'une trentaine à une douzaine dans l'année », confie Fleur Houdinière, qui codirige le théâtre La Bruyère à Paris et la société de production et de diffusion de spectacles Atelier Théâtre Actuel. L'Association Festival & Compagnies, qui organise chaque été le Off d'Avignon avec 1.600 spectacles à l'affiche, a mené un sondage auprès de ses adhérents et s'est rendu compte que 80 % des spectacles présentés ont vendu moins de cinq dates dans la foulée. « Cela a été un électrochoc car le festival Off n'est que le miroir déformant du malaise de la diffusion en France », pointe Laurent Domingos, coprésident de AF&C. Pour les artistes émergents qui assureront la diversité des propositions demain, la baisse progressive des aides publiques, comme le Fonpeps lorsqu'elles tournent dans les petites salles, est un vrai sujet. Ce fonds, qui a apporté 60 millions de soutien l'an dernier, pourrait diminuer de 40 % d'ici à 2028. « Sans lui, on devra accepter de très mal se payer, voire de ne pas se payer, confie Camille Jouannest, directrice artistique de la compagnie Janitor. Par exemple, au Théâtre du Champ de Bataille à Angers, on a joué deux dates dans une salle de 90 places et empoché seulement 560 euros TTC de billetterie. » « Je sens l'épuisement, le découragement » « Le spectacle vivant est sous pression même si nous n'avons jamais eu autant de spectateurs - 65 millions en 2024. Mais la situation est contrastée, je sens l'épuisement, le découragement. Et avec la montée des populismes, je crains la progression d'une vision utilitariste de la culture », n'a pas caché lors des Bis Christopher Miles, à la tête de la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. « Les nuages s'amoncellent et rarement on a ressenti une telle interdépendance entre tous les maillons de la filière. Les mouvements capitalistiques de grande ampleur dans la musique inquiètent la scène indépendante, la hausse des coûts interroge la soutenabilité du modèle culturel, les collectivités se désengagent, le consensus transpartisan dont la culture jouissait s'effrite, des censures émergent ici ou là », souligne quant à lui Jean-Baptiste Gourdin, président du Centre national de la musique. Martine Robert / Les Echos Légende photo : La compagnie Janitor et son spectacle « A la limite de la crédibilité » sur le vrai-faux, jusqu'au 28 février au théâtre de Belleville (Paris). (Amélie Kiritzé-Topor)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 30, 9:14 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 23 janvier 2026 Servi par les comédiens de la Comédie-Française, le metteur en scène flamand sonde le psychisme détraqué du prince, sans réussir à trouver son propos. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/23/le-hamlet-en-surregime-d-ivo-van-hove-a-l-odeon-theatre-de-l-europe_6663827_3246.html
Zoom vidéo sur la pupille de Hamlet. Le laser d’une caméra s’enfonce sous son crâne pour se crisper sur son cerveau en fusion. Ivo van Hove, metteur en scène flamand de la pièce de Shakespeare, traduite par Frédéric Boyer et resserrée autour des personnages phares du drame, ne tourne pas autour du pot. Le spectacle qui a lieu sur la scène de l’Odéon-Théâtre de l’Europe surgit d’un psychisme atomisé par la démence. Autant dire que la représentation sera soumise à des courts-circuits, à des stridences et à des convulsions, puisque ce qui « est pourri dans l’Etat du Danemark » l’est aussi dans la tête de Hamlet. Le prince va mal. Son père est mort, empoisonné par le frère de ce dernier, Claudius, qui lui a succédé sur le trône et dans le lit conjugal (en épousant Gertrude). Instruit de ce meurtre par le spectre paternel, l’orphelin tente de démasquer le coupable grâce au truchement d’une représentation théâtrale. En vain. Exit l’art et ses impuissances : Hamlet bascule dans la violence. C’est cette radicalisation d’une jeunesse acculée aux passages à l’acte par le cynisme de ses aînés qu’Ivo van Hove entend représenter. Un projet dramaturgique clair sur le papier, mais peu perceptible dans les faits, malgré la présence engageante et survoltée des cadors de la Comédie-Française : Christophe Montenez (Hamlet), Guillaume Gallienne (Claudius et le spectre du roi mort), Denis Podalydès (Polonius), Loïc Corbery (Horatio), Florence Viala (Gertrude), Jean Chevalier (Laërte et Fortinbras) et Elissa Alloula (Ophelia). Des cris aux gesticulations, des larmes aux caresses ou aux coups, les comédiens ne lésinent pas sur les moyens pour mettre le public sous tension : il assiste à la descente aux enfers d’un homme, d’une famille, d’une société, d’un pays. Difficile, à cet égard, de ne pas penser à Donald Trump et au Groenland, même s’il faut tendre l’oreille pour percevoir, au gré de répliques furtives, des échos du réel. Ivo van Hove n’appuie qu’à peine sur le levier de l’actualité géopolitique. Enchevêtrement de registres Dans un espace nu – coulisses à vue, néons au sol, chute répétée de rideaux jaunes, blancs, ocres, comme autant de voiles qui occultent ou révèlent de sales vérités, plancher d’où sortent des nappes de brouillard et où se traîne le spectre du père –, le metteur en scène active un spectacle en surrégime qui semble chercher les équilibres entre un premier et un quinzième degré, les paliers intermédiaires convoquant la parodie, le cinéma d’horreur, le tragique pur, le drame bourgeois, le clip musical, etc. Un enchevêtrement de registres qui ne serait pas un problème si l’axe du propos n’était à ce point insaisissable. Le jeu des acteurs est si hétéroclite qu’on se demande s’ils évoluent dans la même pièce. Les dénivelés de la langue, tantôt lyrique, tantôt terre à terre, sont si arbitraires que la boussole de l’écoute s’affole. On a beau se savoir dans le brasier des turbulences intérieures du héros, ce charivari qui s’autoentretient avec une forme de complaisance finit par devenir suspect : quelle est la stratégie qui sous-tend ce chaos ? Pas question, cela étant, de bouder le plaisir que provoque l’ingénieuse idée d’Ivo van Hove : il s’empare du drame pour le transformer en comédie musicale. Immiscés à d’opportuns moments, des tubes pop, rock et folk s’insèrent dans la texture de la pièce. Ophelia entonne le Tristesse de Zaho de Sagazan et L’Enfer, de Stromae, tandis que Hamlet, bad boy aux cheveux longs, clame Bohemian Rhapsody, de Queen, et que la troupe entière se déhanche (mal) sur Death Is not the End, de Nick Cave. Les chorégraphies sont saugrenues, mais les paroles des chansons, étonnantes d’à-propos. Si le but est de suggérer que Hamlet peut être aussi mainstream qu’un refrain populaire et que ses protagonistes sont nos contemporains, la démonstration fait mouche. Reste que, au-delà de cette hypothèse, au-delà du regard fiévreux d’un Christophe Montenez hanté par son rôle, au-delà des excitations trépidantes d’un spectacle ovationné au soir de sa première, ce qui persiste, une fois le Danemark piétiné et les Danois à terre, est le sentiment d’un grand vide enveloppé par beaucoup de bruit. Hamlet, d’après Shakespeare. A l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris 6e). Mise en scène : Ivo van Hove. Avec la troupe de la Comédie-Française. Jusqu’au 14 mars. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Loïc Corbery et Christophe Montenez dans « Hamlet », d’après Shakespeare, mis en scène par Ivo van Hove, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, en janvier 2026. JAN VERSWEYVELD/COMÉDIE-FRANÇAISE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 29, 12:14 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 26 janvier 2026 La dernière pièce proposée par le dramaturge et metteur en scène avant de quitter la tête de l’institution est une pseudo-farce qui déroute et déçoit. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/26/avec-willy-protagoras-enferme-dans-les-toilettes-wajdi-mouawad-rate-sa-sortie-du-theatre-de-la-colline-a-paris_6664149_3246.html
Quel dommage de dire au revoir au Théâtre national de la Colline en recréant Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Ce sentiment ne nous quitte pas en sortant de cette pièce non aboutie, la dernière proposée par Wajdi Mouawad après dix ans à la tête de cette institution culturelle. L’auteur et metteur en scène libano-canadien quittera son poste de directeur le 8 mars, en laissant quelques excellents souvenirs (comme la tétralogie Le Sang des promesses, Racine carrée du verbe être ou encore Journée de noces chez les Cromagnons), mais pas cette fois. En choisissant de reprendre un spectacle imaginé à l’âge de 20 ans, alors qu’il était en exil au Canada pendant que la guerre civile faisait rage dans son Liban natal, Wajdi Mouawad nous perd et nous déroute. Ce qui se veut un cri de colère de la jeunesse contre le monde, un « manifeste contre l’enfermement et le repli », selon la note d’intention, se transforme en deux heures trente interminables d’un récit faussement culotté, d’une pseudo-farce à la grossièreté dérangeante. Tout commence plutôt bien : le long d’une vaste façade d’immeuble en bois, une dizaine d’habitants, accoudés à leurs fenêtres, s’épient, s’insultent, se jugent les uns les autres. Leurs commérages, comme leur allure, sont grotesques et pathétiques. Ce jour-là, ce qui les excite tous, ce sont les problèmes de la famille Protagoras. Ce couple et leurs deux grands enfants habitent le plus bel appartement de l’immeuble, une de leurs fenêtres donnant sur la mer. Ils ont recueilli, par solidarité, une autre famille (les Philisti-Ralestine) chez eux. Ces derniers abusent de leur hospitalité, et la cohabitation se passe très mal. Nelly, la fille Protagoras préfère partir plutôt que d’être « ensevelie » par cet enfer domestique, et son frère, Willy, fait le choix de s’enfermer dans les toilettes pour « faire chier le monde » et obliger les adultes à trouver une solution pour évacuer les « intrus ». Scènes scatologiques La façade de l’immeuble est alors retirée et tout le spectacle va se dérouler dans l’appartement des Protagoras où tout part à vau-l’eau. Pendant que les W-C sont fermés de l’intérieur, un notaire cynique (le diabolique Eric Bernier) veut prendre le pouvoir, et tous les voisins vont finir par débarquer. Le spectateur ne sait plus où poser son regard tant la mise en scène est désordonnée et noie la thématique, pourtant intéressante, de l’opposition entre une jeunesse qui rêve de création, d’évasion et d’amour, et des adultes égoïstes, arc-boutés à leur territoire. Wajdi Mouawad ne fait pas dans la dentelle, ni en matière d’écriture (le langage est souvent cru, voire vulgaire) ni dans certaines scènes scatologiques. Il cherche à déranger – pourquoi pas –, mais la farce ne prend pas, et l’outrance devient repoussante. Est-il nécessaire d’enlaidir à ce point la mère Philisti-Ralestine (Johanna Nizard) et la faire déféquer sur le plateau ? Enfermé dans les water-closets, Willy (interprété avec sincérité par Micha Lescot) prend peu à peu conscience de la radicalité de son geste et considère qu’il n’a plus rien à perdre dans ce monde de merde. « D’une certaine façon, l’immeuble de Willy représente le Moyen-Orient, et l’appartement des Protagoras le Liban », explique Wajdi Mouawad dans le dossier de presse de la pièce. Mais cette métaphore fonctionne très difficilement dans ce fatras scénique où l’émotion ne surgit jamais. Le jeu est inégal parmi les 19 comédiennes et comédiens qui interprètent cette pièce. Certains parlent si vite ou crient tant qu’ils en deviennent inaudibles, d’autres, à leur décharge, ont très peu de textes à défendre. Quant au quinquagénaire Micha Lescot, il parvient remarquablement à prendre les traits et à exprimer la vitalité adolescente du jeune Willy, sorte de double de Wajdi Mouawad jeune. Avec Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, le directeur de la Colline a voulu boucler la boucle et redécouvrir l’auteur qu’il était à ses débuts. Cette fausse bonne idée prend l’allure d’un spectacle d’étudiants et – pour parler comme dans ce spectacle – ça fait « chier » alors qu’il y aurait tant à dire sur cette époque « dégueulasse ». « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes », texte et mise en scène Wajdi Mouawad, jusqu’au 8 mars au Théâtre de la Colline, Paris 20e. Durée : 2 h 35. Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes », mis en scène par Wajdi Mouawad, au Théâtre national de la Colline, à Paris, le 15 janvier 2026. SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 28, 8:40 AM
|
Par Sonya Faure dans Libération - 27 janvier 2026 Dans le seul-en-scène «le Plaisir, la Peur et le Triomphe», joué au théâtre de la Bastille, Joaquim Fossi s’imagine en scientifique exhumant des reliques de notre civilisation. Astucieux jusqu’à un certain point. Derrière son petit pupitre, l’archéologue encore ébahi de sa propre découverte nous l’annonce fièrement : «On a retrouvé Internet !» Nous sommes en 7026 et, assis dans la salle du théâtre de la Bastille à Paris, nous assistons à une conférence scientifique. Slides à l’appui, voilà l’archéologue du futur qui exhume sur son écran devant nous les traces d’un passé depuis longtemps révolu : photos de coucher de soleil, vidéos abîmées de la déesse Evelyne Dhéliat, «qui selon les humains maîtrisait le ciel», nous explique l’homme. On dit «l’homme», mais le mot est sans doute mal choisi : le scientifique parle des «humains» comme il parlerait des tricératops − on devine que l’espèce humaine, comme l’Internet et les couchers de soleil, a disparu depuis belle lurette. Le laboratoire du chercheur multiplie les hypothèses sur les reliques de notre vie numérique. Deux points et une parenthèse qui se ferme : que pouvait bien signifier, pour les humains, cet artefact très répandu dans les courts messages qu’ils échangeaient entre eux sur les réseaux ? «Deux points : j’aimerais m’exprimer. Une parenthèse qui se ferme : mais je préfère me taire. Ce symbole était l’expression, sans doute, du désarroi métaphysique humain qui se savait perdu», conclu l’archéologue du futur avec un air à la fois ahuri et inspiré. Moult trouvailles Dans le court spectacle le Plaisir, la Peur et le Triomphe, une phrase revient à plusieurs reprises : «Quand les humains avaient peur, ils faisaient une image.» Ici se niche la tentative de Joaquim Fossi et de son seul-en-scène : explorer, et révéler par l’absurde, notre relation obsessionnelle aux images, qu’elles nous rassurent (mais pourquoi donc les humains faisaient-ils de longs voyages pour prendre en photo un monument dont les images avaient déjà 1000 fois fait le tour du monde ?) ou nous angoissent (dans les reliques de notre civilisation, il y aura beaucoup de photos d’ours sur un bout de glace). Il y a moult trouvailles amusantes dans le spectacle du jeune acteur tout récemment passé à la mise en scène (lauréat l’an passé du dispositif Prémisses, Fossi prépare notamment avec l’actrice Suzanne de Baecque un deuxième spectacle, Short Message Service, qui sera montré au Rond-Point à Paris en avril). Mais l’affaire s’arrête vite et le spectacle restait, ce soir de première où on l’a découvert, encore à roder : au-delà de l’accumulation (le même procédé se répète sur Google Earth, les Sims, Facebook…) que nous dit ce spectacle sur ce que nous font les images, puisque c’était la promesse, sur la manière dont elles façonnent nos corps et nos désirs, mais aussi notre anxiété à voir un monde qui disparaît ? Face au tendre regard posé sur ce visage d’acteur de Pornhub retrouvé parmi les pixels du passé, on est comme l’archéologue : on cherche en vain ce que l’humain Joaquim Fossi a voulu nous dire. Le Plaisir, la Peur et le Triomphe, texte de Joaquim Fossi et Noham Selcer, mise en scène de Joaquim Fossi. Au théâtre de la Bastille jusqu’au 30 janvier. Puis en tournée au Volcan du Havre les 10 et 11 février; au Théâtre et cinéma de Fontenay-le-Fleury le 13 février; Aux Célestins de Lyon le 9 et 21 mars; à la MC2 de Grenoble les 28 et 29 avril; et au Manège de Maubeuge le 6 mai. Durée : 50 minutes. Sonya Faure / Libération Légende photo : Le laboratoire du chercheur multiplie les hypothèses sur les reliques de notre vie numérique. (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 27, 5:46 AM
|
Par Joëlle Gayot / Le Monde - 25 janvier 2026 Marcos Caramés-Blanco met en scène un spectacle cousu main pour Sacha Starck, acteur intersexe, qui conte l’histoire d’une émancipation. Lire l'article sur le site du "Monde"
https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/25/a-theatre-ouvert-a-paris-la-performance-disruptive-de-ix-variations_6664076_3246.html
A Théâtre Ouvert, à Paris, bastion des écritures contemporaines, une nouvelle génération prend le pouvoir, à l’invitation d’une équipe qui fait de la place à la jeunesse. Ce qui veut dire aux voix d’aujourd’hui, qui parlent la langue d’Internet, des combats féministes, queer, antiracistes ou postcolonialistes. Cette vague du renouvellement se vérifie dans les salles avec un public de moins de 30 ans, et sur les scènes avec la présence d’artistes issus de la génération Z. Né en 1995, Marcos Caramés-Blanco est un auteur metteur en scène dont les textes, qui circulent depuis 2019, sont suivis de près par le monde du théâtre. Ix : variations est une performance disruptive qu’il a cousue main pour Sacha Starck, acteur qui interprète un personnage intersexe né dans le sud de la France, sous le régime d’une indétermination de genre difficile à encaisser, à l’époque, par son entourage. Piqûres d’hormones et pressions familiale, sociale, scolaire et scientifique ont décidé de son identité sexuelle : il sera un garçon, donc un homme. Face à cette oppression mentale, aux torsions imposées à son corps, aux violences subies, que ces dernières aient eu lieu dans un salon de coiffure ou dans une cour d’école, Ix assume d’être ce qu’il est : un queer. Sa rébellion le sauve. Elle est le carburant d’un spectacle qui semble lui-même ruer de fureur entre les murs du théâtre. Présence irremplaçable Déclinée au fil d’une playlist de 17 variations, l’émancipation de Ix, rebaptisé « Sacha », un prénom épicène, passe par une rafale de mots, d’images et de musiques qui imposent leurs contenus, leurs contours et leurs tempos sans rendre de comptes à l’autorité supposée du plateau. Ce qui a lieu ici pourrait tout autant se dérouler dans une galerie d’art. La performance de Sacha Starck tient dans l’invention réitérée et martelée de sa présence. Couché dans son lit, nu en train de danser, se maquillant face à son miroir, mimant ses camarades de classe, enfilant perruques, robes, blouson de cuir, le comédien ne s’attarde jamais dans un code de jeu. Il lui faut toujours échapper à ce qui vient d’avoir lieu pour se précipiter dans ce qui pourrait advenir. L’urgence colle aux pas d’une représentation qui connaît des fulgurances, mais aussi pas mal de trous d’air, dans lesquels le spectacle disparaît, comme si le texte s’épuisait, faute d’essence dans le moteur. Ces dépressions disent à quel point le projet dépend de l’énergie de l’interprète. Et à quel point la forme théâtrale qui s’élabore doit tout à l’hybridation en un seul organisme de l’acteur et de son texte. Ce qui soulève une question subsidiaire : qui d’autre pourrait jouer Ix : variations ? De toute évidence, personne. Ix : variations. Théâtre Ouvert, Paris 20e. Texte et mise en scène : Marcos Caramés-Blanco. Mise en scène et jeu : Sacha Starck. Jusqu’au 31 janvier. A voir aussi, en alternance, à Théâtre Ouvert, et du même auteur : Ce qui m’a pris (jusqu’au 31 janvier). Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Sacha Starck dans « Ix : variations », de Marcos Caramés-Blanco, à Théâtre Ouvert, à Paris, en novembre 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 8:05 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 20 janvier 2026 A la MC93 de Bobigny, le dramaturge livre le dernier volet de sa trilogie consacrée à l’histoire amoureuse de ses parents.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/20/avec-la-chambre-de-l-ecrivain-marc-laine-solde-le-passe-familial-au-theatre_6663381_3246.html
Après Nos paysages mineurs, puis En finir avec leur histoire, Marc Lainé achève une trilogie consacrée à l’histoire amoureuse de ses parents par La Chambre de l’écrivain, un spectacle attachant, plus touffu mais plus ambitieux que les deux précédents. Dans le premier volet, l’auteur metteur en scène racontait la rencontre dans les années 1970 de son père, normalien et futur écrivain (un pur produit de Saint-Germain-des-Prés), et de sa mère venue de la province et issue d’un milieu populaire. Dans le deuxième, on retrouvait le couple seize ans plus tard, à l’heure des désillusions politiques et de la rupture sentimentale. Séparés mais unis par Martin (double de Marc Lainé), le fils né de leur amour, Paul et Liliane étaient amenés à se revoir. Ce troisième opus les projette au cœur du temps présent. Devenu quadragénaire, l’enfant assume la narration du récit en rapatriant ses parents sur le plateau du théâtre. Il veut mettre en scène leur histoire. Une réappropriation de leur réel à laquelle il convie un public transformé en voyeur d’intimités révélées par fragments incisifs. Enchâssement du passé dans le présent, de l’imaginaire dans le biographique, du théâtre dans la vidéo (et l’inverse) : La Chambre de l’écrivain se déploie dans une scénographie écartelée, mouvante et un peu encombrante. Créé à Lyon en octobre 2025, repris à Valence, le spectacle se joue désormais à la MC93 de Bobigny. A vue, face au public, un appartement, son salon, ses bibliothèques, sa petite salle de bains. En coulisses, filmée par une caméra montée sur un rail, la chambre conjugale. Le décor (dont les éléments s’élèvent ou s’abaissent) est planté. Injonctions maternelles Vladislav Galard (en alternance avec Alexandre Pallu) et Adeline Guillot réendossent les habits de Paul et Liliane versus années 1970. Ils sont rejoints par Marcel Bozonnet et Stéphane Excoffier qui incarnent le couple en 2021. A leurs côtés, Charles-Henri Wolff prête ses traits à Martin-Marc Lainé (à qui il ressemble de troublante manière), tandis que Selma Noret-Terraz interprète une jeune régisseuse de plateau. Le metteur en scène multiplie les va-et-vient d’une époque à une autre, basculant des confidences aux règlements de comptes, dans l’espoir éperdu mais pas vain de donner sens à son existence. Quelle est sa place ? Comment s’affranchir de la tutelle paternelle et esquiver les injonctions maternelles ? Paul, guetté par les pertes de mémoire, répond aux questions de son fils par ellipses et énigmes. Liliane, repliée loin des villes, le maudit depuis qu’il veut faire d’elle l’héroïne d’un spectacle. Confrontation générationnelle Des conflits de loyauté à la quête de légitimité, l’autoportrait que dresse de lui-même Martin-Marc est hérissé d’hésitations et de résolutions. L’artiste met un point d’honneur à assumer les autocritiques, jusqu’à remettre en cause la pertinence de son travail au cours d’échanges tendus avec la régisseuse. Une confrontation générationnelle qui brasse patriarcat, utilité et vanité de l’art, désir mais échec du théâtre à changer la vie des gens. Si l’intention qui anime ces conversations est louable, leur nature démonstrative alourdit une dramaturgie qui ricoche par ailleurs en souplesse des parents jeunes aux parents vieux. Jamais aussi inspiré que lorsqu’il ravive la relation de Paul et Liliane, jamais aussi aigu que lorsqu’il prend frontalement ses parents à partie, Marc Lainé développe un théâtre narratif qui se savoure comme on tourne les pages d’un roman dont l’intrigue tient le lecteur en haleine. Un théâtre sincère, même s’il recompose le réel sans prétendre lui être fidèle, l’émancipation de l’auteur dépendant de sa capacité à trahir les figures qui l’ont inspiré. « La Chambre de l’écrivain ». MC93 Bobigny. Texte et mise en scène : Marc Lainé. Du 22 au 25 janvier. En tournée à la Comédie de Caen, 28 et 29 janvier. Joëlle Gayot / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 18, 4:59 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - Le 17/01/2026 Artiste prolifique, habitué du Festival d’Avignon, Valère Novarina s’est éteint le 16 janvier à 83 ans. Il était entré au répertoire de la Comédie-Française. Sa dernière pièce joue encore sur quelques dates.
Lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/mort-de-valere-novarina-dramaturge-peintre-poete-pour-qui-les-mots-sont-la-vraie-chair-humaine-7029245.php Deux images à l’opposé qui disent tout de la recherche d’une vie. D’un goût de l’exploration, de l’invention maximale. En 1989, au Festival d’Avignon, un homme surgissait sur scène pour peindre de larges arabesques sur une toile rectangulaire, avant de disparaître. Puis, un chorégraphe, Daniel Larrieu, prenait ensuiste sa place pour danser de profil. Le peintre était aussi auteur de la pièce, au titre magnifique, qui invitait le public dans la boucle : Vous qui habitez le temps. Intrépide Valère Novarina, visage blond et yeux bleu si clairs ! Il vient de nous quitter, ce vendredi 16 janvier 2026, à l’âge de 83 ans. La dernière image qu’il nous laisse date de février 2025. Il était un homme heureux, quoiqu’un peu détaché, au milieu de ses tableaux, affiches et dessins, suspendus comme des décors de théâtre, dans l’exposition historique que lui avait consacré la Cité internationale de la langue française, trois mois durant, à Villers-Cotterêts. La lumière nuit, magnifique oxymore de son cru y trônait en néon lumineux à l’entrée du logis royal de François 1er. Paul Rondin, le directeur de la Cité, lui avait alors donné carte blanche, et se souvient : « Il était joyeux, avait des fulgurances, te prenait par la main et te guidait vers les vidéos de ses spectacles : “Regarde, c’est pour eux, les acteurs, que j’ai fait tout ça !”. Il témoignait d’une réelle émotion, un peu testamentaire, non pas devant ses propres textes, mais devant la performance virtuose des comédiens. » Langue nouvelle Novarina était donc à la fois peintre et écrivain – il s’était mis à dessiner à l’encre de Chine parce que l’inspiration lui faisait défaut pendant l’écriture du Drame de la vie, au début des années 80. Et il fut quarante ans durant un étrange auteur se mettant lui-même en scène. Plutôt poète du plateau que dramaturge. Un artiste ovni qui a creusé un sillon bien à lui dans le paysage, lui qui aimait les sommets des Alpes contemplés depuis le bord du Léman, où il a passé son enfance et son adolescence à Thonon-les-Bains, après être né, à Genève, en 1942. D’un père architecte (Maurice Novarina) et d’une mère comédienne (Manon Trolliet). Bâtir et dire… Il n’y a pas de théâtre possible chez Novarina sans langue nouvelle. Sans mots tronqués, écorchés, rapprochés ou recousus pour mieux devenir neufs, dans une langue sonnant parfois comme le franco-provençal du patois savoyard. Mots bizarres mais capables de nous adresser des messages qui touchent, compréhensibles par on ne sait quel mécanisme. Nous parlant de nos corps, de nos âmes, de notre mémoire ancestrale, de notre futur imaginaire. De la mort et du temps. Contre le déferlement d’images marchandes qui enferment les humains et les hypnotisent, il a brandi une langue sortie des zones les plus viscérales : « Ni instruments ni outils, les mots sont la vraie chair humaine comme le corps de la pensée : la parole nous est plus intérieure que tous nos organes dedans. Les mots que tu dis sont plus à l’intérieur de toi que toi. Notre chair physique c’est la terre mais notre chair spirituelle, c’est la parole ; elle est l’étoffe, la texture, la tessiture, le tissu, la matière de notre esprit. » (Devant la parole, POL, 1999.) Au répertoire de la Comédie-Française La situation la plus théâtrale pour lui ? La profération de la parole, évidemment. Le verbe y est alors action. Il fut invité cinq fois au Festival d’Avignon, entre Le Drame de la vie en 1986 et Le Vivier des noms, en 2015. Pour le premier texte, féroce et cru, il a créé 2587 personnages – de Nordicus à Jean Singulier en passant par l’homme de Stalingre… Dans le second, long fleuve poétique, une autre et unique litanie de noms propres nous a tenus en haleine, malgré le mistral tourbillonnant, dans le Cloître des Carmes. Les mots s’envolaient, les acteurs arrimés à la scène libéraient dans le vent cette foule éphémère. Noms qu’il leur avait fallu d’abord greffer en eux de mystérieuse manière : Claire Sermonne, qui rejoignait alors pour la première fois cet univers, se souvient de sa « concentration “extraordinaire”, de l’état de rêverie convoquant une autre logique que celle de la raison : celle du souffle, du lâcher-prise pour mieux voir les mots et les phrases dans l’espace d’une mémoire visuelle. » Ce théâtre du grand saut dans l’inconnu n’a pas été entendu ni reçu tout de suite, même si Jean-Pierre Sarrazac monte, en 1974, L’ Atelier Volant, qui dénonce de manière ubuesque la folie d’un capitalisme dévorant. Car ce passionné de philo, de linguistique, et d’Artaud, passé par la Sorbonne, a dû patienter une bonne dizaine d’années avant que son œuvre ne commence à être produite. Il nous avait autrefois confié avec une ironie sans aigreur : « On ne savait pas si c’était du théâtre ou de la poésie. Moi je disais “roman théâtral” ou “théâtre utopique” ». Il a fallu, en 1985, toute la force d’un acteur comme André Marcon pour affirmer enfin sur scène la « novalangue » dans Le Monologue d’Adramélech, puis dans Le Discours aux animaux, en 1987. Dix ans plus tard, Novarina entrait au répertoire de La Comédie-Française avec L’Espace furieux. La métaphysique de l’éclat de rire Son univers participait aussi d’un joyeux et foutraque mélange des genres, d’un goût absolu pour l’hybridation des arts du clown et du burlesque à la musique ou à la chanson. Des airs entêtants étant facilement poussés à l’accordéon par Christian Paccoud, son complice de toujours pour la partition musicale. En 1998, Novarina fut capable de se lancer dans L’Opérette imaginaire mise en scène par Claude Buchwald pour Avignon, et de recommencer, deux ans plus tard, une autre aventure sonore, dans la Cour d’honneur, avec L’Origine rouge. Créateur d’un théâtre jamais très loin de la farce comique, il avait réhabilité Louis de Funès auprès des snobs grâce à une déclaration d’admiration parue en 1986 (Pour Louis de Funès). « Ce sont eux les grands artistes, les Serrault, les Louis de Funès. L’aventure profonde, physique du théâtre, c’est l’acteur qui la vit, nous avait-il expliqué quelques années plus tard. Quand je quitte mon travail d’écriture pour devenir metteur en scène, je sais que celui-ci en sait plus que moi. » Le comédien Olivier Martin-Salvan a découvert Novarina à l’âge de 24 ans, à l’occasion de L’Acte inconnu, créé dans la Cour d’Honneur d’Avignon en 2007. Il a demandé des conseils d’interprétation aux grands interprètes novariniens comme Dominique Pinon, Dominique Lelièvre, Michel Baudinat, Valérie Vinci ou Agnès Sourdillon. « Sois plus bête que ce que tu fais, laisse la place aux sensations », lui ont-ils répondu en chœur. Plus tard, il a compris que « l’écriture de Novarina s’articulait à ce que celui-ci avait lui-même éprouvé à ce moment-là : l’odeur de foin derrière le tracteur, ou la vision d’une envolée de cygnes. C’était sa main qui écrivait toute seule pour lui. Et nous, nous devenions sur scène “les ouvriers du drame”. Son amitié avec Jean Dubuffet et sa proximité avec l’art brut l’a rassuré. » Sa langue, terrienne, concrète, pouvait parler à tous, avec ce moyen du rire « pour fendre l’armure », poursuit Salvan. « Valère nous parlait sans cesse de la métaphysique de l’éclat de rire et de sa dangerosité. Un héritage à défendre absolument. » En novembre 2023, au Théâtre national de la Colline à Paris, Valère Novarina mettait en scène son dernier opus, Les Personnages de la pensée, qui va repartir en tournée – pour trop peu de dates, hélas – à partir de mars prochain. Spectacle magnifique telle l’ultime consécration d’une œuvre qui n’en finissait pas de s’écrire, fidèle à elle-même et toujours différente. L’une de ses plus belles mises en scène sans doute, tant celle-ci mélangeait de manière alchimique l’éclat vif de ses tableaux manipulés par les acteurs eux-mêmes, à la force à souple et tranchante de sa parole. Lui qui, dans le secret de son atelier, suspendait ses textes avec des pinces à linges pour mieux les visualiser, avait enfin accompli la symbiose tant recherchée. Claire Sermonne en témoigne avec émotion : « Des interprètes anciens s’y mêlent à des voix nouvelles. Grâce à ça, peut-être, sa langue résonne particulièrement fort dans la frénésie de l’époque. Il y a aussi glissé de très anciens textes, avec de drôles d’histoires entendues au fil de sa vie, sur le terrain. Tout est toujours vrai chez Novarina, d’une certaine manière. Cette pièce fait rire mais évoque de manière profondément spirituelle le destin de l’humanité. La dernière chanson, en yiddish, dit “la maison brûle”. » TTT Les Personnages de la pensée, texte et mise en scène de Valère Novarina, le 7 mars, Châteauvallon-Liberté, Toulon (83) ; le 14 mars, L’Estive, Foix (09) ; les 19 et 20 mars, Théâtre national de Nice (06). Emmanuelle Bouchez / Télérama Légende photo : Valère Novarina est un auteur de théâtre, essayiste, metteur en scène et peintre franco-suisse, né le 4 mai 1942. Ici à son domicile parisien en octobre 2023. Photo Léa Crespi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 14, 12:19 PM
|
Par Véronique Hotte dans Webthéâtre - 5 janvier 2026 Entre la vie et la fiction, la rencontre joyeuse de deux olibrius imprévisibles qui contrent le malheur. Paradoxe est issu d’une complicité et d’une collision où les récits agissent comme des bouffées cathartiques. Paradoxe est la représentation de nos êtres démontés et remontés, de nos cœurs à vif, ouverts à ceux qui sont là, vivants, avec nous, quelque part entre ce qui existe et ce qui n’existe plus. Paradoxe est le nom de notre enfant imaginaire, note Florence Janas : la force de la scène et du théâtre vivant transcende ainsi les chagrins intimes. D’un côté, le retour chez sa mère à Uzès pour Guillaume, une mère aux prises avec les problèmes de l’âge - perte de confiance et fragilisation -, petits maux très sérieux auxquels remédie le fils attentif, autant que faire se peut, sur le chemin d’une médicalisation irréversible - angoisse de la fin. Et c’est le passé et l’enfance du garçon qui s’invitent à sa conscience éveillée. De l’autre, la mère même de Florence Janas est victime d’un AVC, connaît des troubles du langage et l’aphasie que sa fille-aidante imite avec tendresse. L’expérience est ainsi commune pour Lui et pour Elle qui se familiarisent avec les maladies neuro-dégénératives maternelles, avec la fin triste de toute vie. L’occasion théâtrale est d’accorder à la scène une autofiction, soit une fiction d’événements et de faits réels donnant à l’auteur la liberté de romancer ou de prolonger sa propre vie, à travers un bol d’air d’imagination ou de poésie. La situation parentale dégradée que connaissent les protagonistes est certes universelle, mais tous deux ont l’invention et l’audace scéniques de retourner la tristesse et la mélancolie de l’épreuve - la souffrance de la fragilisation irrémédiable des siens - en un rire bienfaisant, réparateur et salvateur - comédie grotesque et fantasque dont l’effet de consolation réjouit. Ecouter les deux clowns qui vivent l’instant présent, en recourant au passé. Guillaume, seul en scène semble attristé et comme abasourdi par une chape de plomb de laquelle il ne peut décidément pas s’extraire, en train de peindre à la brosse non pas « le petit pan de mur jaune », mais un grand pan élevé. Convaincu, l’artisan d’un jour ? Il ne le semble pas, tant le chagrin est lourd. Or, Florence est là sur le plateau face public pour prendre en charge les afflictions et les peines de son partenaire. Prothèse d’un nez fort et petite moustache insolite, bonnet sur la tête, elle incarne, en même temps ou successivement son camarade masculin navré, jouant de l’humour et des facéties que sa gourmandise du plateau révèle en majesté, miaulant tel le chat Musette, aboyant tel le chien Sultan, avec la voix chevrotante de la mère, qui se souvient d’un passé de sage-femme et de patientes au destin tragique. Le parler de la comédienne est inénarrable, populaire et trivial - un numéro désuet et inusable de clown d’enfance -, mais dont la témérité est sublime, tant elle révèle une authenticité pleine d’humanité. L’actrice joue tous les personnages, jeunes et moins jeunes, joggers ou animaux domestiques. « wouaf wouaf Tais toi Sultan (bas) Tu commences à me casser les couilles, je me ferais à bouffer tout seul… Alors je me mets dans ma bulle et dans mon univers. (mains sur les oreilles) Pis heureusement... qu’Sultan l’est là... parce que... c’est l’seul... qui m’comprend... c’est vrai, il me comprend... Sultan, y me fera jamais d’mal... Y s’ra toujours là pour moi...Moi si un jour mon chien y meurt, j’serai plus triste qu’à l’enterrement d’mon père ou d’j’sais pas qui.... Ce chien y est comme un... pour moi... y est mieux qu’un humain même j’veux dire… » Ainsi parle la mère qui se sent dessaisie du monde, de la vie.
Un concert sonore et théâtral réussi qui laisse fuser les réalités de la vie, ses trivialités et ses atermoiements désordonnés, tellement justes et pertinents que le public est ravi au sens propre par ces interpellations qui invitent à ce qu’on se reconnaisse dans ces petits détails de l’existence qu’on néglige car jetant une ombre ou mettant un peu en sourdine la belle aventure de vivre.
Les protagonistes prennent le taureau par les cornes, et sortent vainqueurs. Véronique Hotte - Webthéâtre Paradoxe, création de et avec Guillaume Vincent et de Florence Janas, dramaturgie Marion Stoufflet, scénographie Daniel Jeanneteau, Guillaume Vincent, son Yoann Blanchard, lumière Sébastien Michaud, costumes Fanny Brouste, couture Lucile Charvet, regard chorégraphique Zoé Lakhnati, régie générale et lumière (en alternance) Karl-Ludwig Francisco, Matthieu Marques Duarte, régie plateau Muriel Valat, prothèses Jean-Christophe Spadaccini, stagiaire à la mise en scène Katarina Jungova. Du 15 au 26 janvier 2026, lundi, jeudi, vendredi 20h, samedi 18h, dimanche 16h, T2G – Théâtre de Gennevilliers. Du 11 au 13 mars 2026, Centre Dramatique National de Tours – L’Olympia.
Crédit photo : Gwendal Le Flem.
|
Par Sonya Faure / Libération - Publié le 11/02/2026 Avec son conte cruel et burlesque dans un château retranché du monde, la jeune metteuse en scène fait rire aux éclats et pose la seule question qui vaille : dans un monde devenu fou, comment inventer des histoires qui tiennent debout ? Parfois, un spectacle touche à cette alchimie rare : sortir les tripes d’un monde devenu dingue pour les étaler bravement sur la scène et de nos angoisses nous faire rire aux éclats. C’est le cas avec le Roi, la reine et le bouffon de la metteuse en scène Clémence Coullon, une farce sombre et hilarante, un spectacle sans vaines prétentions mais d’une grande précision comique – grâce au jeu des jeunes comédiens notamment, tous remarquables. Une conteuse arrive sur scène (Myriam Fichter) et on sait déjà qu’on n’oubliera pas son visage souriant et éberlué. Elle pose une chaise en déclamant : «Une chaise. Je commence par une chaise.» Mais c’est tout un monde qu’elle pose immédiatement, le cadre d’un théâtre burlesque et excessif, un univers clos, déréglé, fantasque et de plus en plus cruel, d’une puissance visuelle folle avec son noir et blanc à la Murnau, ses costumes impeccables et pourtant sans grands moyens : un piano, deux kakemonos qui tous ont un rôle à jouer dans cette affaire. Le roi se meurt d’ennui Le roi, l’immense reine (Clémence Coullon elle-même) et leur bouffon bossu (Guillaume Morel) sont cloîtrés dans leur château. La conteuse avait prévenu : «Un jour leur monde s’arrêta. Un souffle empoisonné disait-on, traversait les rues, saccageait les corps, prenait les plus vieux, les plus faibles, les plus pauvres. Les portes se claquèrent, les rues se vidèrent.» Dans ce confinement sans cesse prolongé le roi se meurt d’ennui (formidable Tom Menanteau déjà vu récemment en toxicomane chez Raymond Carver). Clémence Coullon, mourant d’ennui elle aussi, a écrit sa pièce lors du confinement de 2020, s’inspirant également, dit-elle, de ses années d’internat au lycée de la Légion d’honneur à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Puis tout s’est emballé pour la jeune femme, on vient de la croiser au cinéma dans A pied d’œuvre de Valérie Donzelli et bientôt dans Ari de Léonor Serraille. Lors de son passage au conservatoire, elle devient le personnage pivot du documentaire de la cinéaste Valérie Donzelli, Rue du Conservatoire (2024), qui suit les répétitions du spectacle de fin d’année justement mis en scène par Coullon, Hamlet(te), qui tourne encore aujourd’hui. Déjà Clémence Coullon tordait les règles : dans son adaptation du classique shakespearien, Hamlet mourrait accidentellement au milieu de la pièce qui continuait sans lui. Dans le documentaire de Donzelli, Clémence Coullon au début se planque, assume du bout des lèvres seulement son rôle de metteuse en scène et le pouvoir qu’il confère sur les autres : «Je regarde… je cherche à bien structurer la pièce, mais c’est surtout pour les acteurs… et sans mon assistant je ne sais pas ce que j’aurais fait.» Elle a tort de tordre le nez, le Roi, la reine et le bouffon le prouve de manière éclatante. «Je veux que nous restions fantasmés !» Dans son château, le roi veut mourir donc, et tout s’emballe. Les personnages laissés à eux-mêmes ne respectent plus leur rôle, ni les règles du conte. Le bouffon Jean découvre le secret de ses origines, le roi meurt en effet mais pas comme prévu et, dans une inversion carnavalesque, le gentil Jean devient le nouveau maître des lieux, métamorphosé en un angoissant despote. Le roi ressuscite. «Je veux que nous restions dignes, je veux que nous restions fantasmés !» crie la reine qui se casse le nez contre le quatrième mur – littéralement. Car à travers cette cour confinée et derrière la tyrannie du bouffon, c’est la question de la fiction qui se joue. S’il n’y a plus de règles qui tiennent dans le vrai monde, si un roi à la peau orange peut se donner le droit d’enlever celui du royaume d’à côté ou transformer une scène de guerre en riviera, si une population menacée d’une nouvelle peste peut vivre cloîtrée pendant des mois avant que la vie reprenne exactement comme avant, bref si le réel n’a plus de sens comment alors comment raconter encore des contes ? Comment désormais inventer des histoires qui tiennent debout ? Le roi, la reine et le bouffon de Clémence Coullon, avec Myriam Fichter, Tom Menanteau… Au théâtre de la Tempête (75 012) jusqu’au 22 février. Légende photo : Les personnages laissés à eux-mêmes ne respectent plus leur rôle, ni les règles du conte. (Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 10, 11:32 AM
|
Par Kilian Orain dans Télérama - 10 février 2026 Jusqu’au 20 février, la comédienne joue dans “Le Cercle de craie caucasien”, de Brecht, au Théâtre de la Ville. Son rôle dans la pièce, sa collaboration avec le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota, son rapport au théâtre… L’artiste s’est confiée à nous. Dans Le Cercle de craie caucasien, que le dramaturge allemand Bertolt Brecht (1898-1956) avait monté au Théâtre de la Ville en 1955, Élodie Bouchez est dirigée pour la cinquième fois par Emmanuel Demarcy-Mota. Sur cette même scène, elle y interprète Groucha, une jeune servante qui devient mère en recueillant un enfant abandonné pendant la guerre. Un rôle à sa mesure ? Depuis ses débuts dans Stan the Flasher, réalisé par Serge Gainsbourg en 1990, la même lumière discrète, la même humanité habite la comédienne. Au cinéma comme au théâtre. Vous êtes venue au théâtre à 34 ans. Pourquoi si tard ?
Pendant longtemps, ses portes m’étaient fermées. Je n’avais pas le bon cursus, n’ayant pas étudié dans un conservatoire, ni au cours Florent, ni au sein d’une école nationale. Et le cinéma m’a happée. J’ai bien reçu des propositions du théâtre privé, mais rien qui ne m’ait plu. Jusqu’à ce que Sylvie Testud me propose de jouer dans sa pièce Gamines, en 2007. Lire la critique TTT “Le Cercle de craie caucasien” au Théâtre de la Ville, toute la puissance épique de Brecht D’où vient votre goût du théâtre ?
Je ne sais pas l’expliquer. Quand un désir surgit si jeune, il est peut-être question de vocation… J’ai commencé la danse à 4 ans, mais je n’étais pas douée. Je me suis vite aperçue que je voulais faire de la scène. J’adorais monter de petits spectacles devant ma famille ou en colo. Je ne viens pourtant pas d’un milieu artistique. Mes parents m’emmenaient rarement au spectacle. J’ai des souvenirs du Lac des cygnes vu au Palais des congrès, ou des spectacles de Chantal Goya, mais c’est tout. Ma porte d’entrée était la culture populaire. Je regardais beaucoup de films à la télé et allais un peu au cinéma. La banlieue sud, où je résidais, était dotée de bonnes scènes nationales mais pas toujours accessibles en transports en commun. Quant aux cours de théâtre, ils étaient encore rares autour de chez moi.
Comment vous êtes-vous formée ?
En faisant un bac qui s’appelait à l’époque A3 théâtre, à Paris. J’avais un professeur italien qui était anarchiste, il nous enseignait un théâtre d’agit-prop. Je n’ai donc pas suivi le programme ni développé une culture dans les clous. Après ça, j’ai commencé des études théâtrales à Nanterre, c’était un peu déprimant ; il n’y avait rien de ce sur quoi je fantasmais. Pour pratiquer, il fallait passer des concours, ce que j’ignorais. J’ai tout abandonné quand ma carrière au cinéma a décollé. Mais le désir de troupe, propre au théâtre, ne m’a jamais quittée.
Grâce à la troupe du Théâtre de la Ville, j’ai vécu un renouveau. Emmanuel Demarcy-Mota vous a proposé d’intégrer celle du Théâtre de la Ville en 2009.
C’était un accomplissement. Comme si j’avais eu raison d’attendre patiemment, de ne pas faire des choses qui ne m’intéressaient pas. En plus, tout s’est fait très vite. J’étais venue voir Sylvie Testud jouer dans une pièce qu’il mettait en scène, Casimir et Caroline, écrite par Ödön von Horváth en 1932. Le spectacle devait tourner, mais Sylvie ne pouvait en être. Il m’a donc proposé le rôle, sans audition. L’aventure a été extraordinaire.
Comment fonctionne cette troupe ?
Ce n’est pas une troupe officielle ; nous n’avons pas les mêmes statuts ni les mêmes obligations qu’à la Comédie-Française. Il s’agit plus d’une famille de théâtre, créée par Emmanuel Demarcy-Mota : nous sommes vingt-cinq ! Grâce à cette troupe, j’ai vécu un renouveau. Que ce soit dans Le Songe d’une nuit d’été (2024) ou Les Sorcières de Salem (2019), j’ai pu jouer des jeunes premières, moi qui ai passé l’âge !
Comment travaille Emmanuel Demarcy-Mota ?
Sa méthode diffère en fonction de la pièce. Pour Le Cercle de craie caucasien, nous avons passé plus de temps « à la table », à étudier la pièce, échanger nos points de vue, que lors des précédentes créations. Emmanuel est un leader, précis, avec beaucoup d’énergie. Parfois plus que nous !
Groucha, votre personnage, vous ressemble-t-elle ?
C’est une jeune mère qui n’est pas une vraie mère mais le devient malgré elle, en recueillant cet enfant abandonné pendant la guerre. Au cinéma, j’ai incarné des rôles de mère ; en ça, elle me parle. Mais je ne sais pas qui elle est vraiment. Je ne cherche pas à le savoir.
Êtes-vous une comédienne plus instinctive qu’intellectuelle ?
Oui, je suis plus tournée vers l’idée de rendre vivant un personnage que de le comprendre intimement.
Mettre en scène est-il un de vos désirs ?
Je suis heureuse d’être interprète. Après plus de trente ans de carrière, ça me paraît un travail incommensurable que de réaliser un film ou créer un spectacle ! Il faut avoir un feu intérieur et une vision, ce que je n’ai pas.
TTT Le Cercle de craie caucasien, de Bertolt Brecht, mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota, jusqu’au 20 février, du mardi au samedi 20h, dimanche 15h, Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet, Paris 4e, 01 42 74 22 77 (5-34 €). Légende photo : Au Théâtre de la Ville, la comédienne est dirigée pour la cinquième fois par Emmanuel Demarcy-Mota. Photo Jérôme Bonnet pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 10, 10:37 AM
|
Par Sonya Faure / Libération, publié le 9 février 2026 Inspirée d’une pièce de Lachlan Philpott, la première mise en scène de la comédienne explore le contre-monde que se construisent deux jeunes filles mais peine à donner chair à un spectacle en hypertension. Il y a un faux ami dans le spectacle Bestioles. Un mot qui revient sans cesse mais ne renvoie à rien de réel : protection. C’est le lycée qui répète sa priorité de «protéger» ses élèves des écrans et d’internet sans jamais y parvenir. Ce sont Bee et Ellie, les deux jeunes héroïnes de la pièce mise en scène par Séphora Pondi, qui demandent : «Mais qui nous protégera ?» Personne, ou pas grand monde ou trop tard : ni leurs mères trop occupées à gérer leurs propres addictions (à dieu ou à l’alcool), encore moins les pères qui se sont absentés de la pièce, ni les psys ni les gynécos impuissantes face au contre-monde que se sont construit les deux adolescentes. Contre l’ennui, contre les petits copains qui les pressent de leur envoyer des photos de leurs seins, leurs modèles de femmes libres, issues de la téléréalité, les incitent plutôt à vendre leur corps que leurs idées. Bee (Léa Lopez) et Ellie (Marie Oppert) sont-elles de fausses amies ? Certainement pas. Elles s’aiment sans aucun doute mais se tirent l’une l’autre vers le pire. On le comprend dès le début de la pièce qui commence en cavalcade et en cris furieux depuis la salle vers le plateau. Que s’est-il passé sur l’aire poids lourd qui borde l’autoroute juste à côté du lycée ? L’événement coupe l’histoire en deux (telle la psy qui regarde Bee «comme si elle allait s’ouvrir en deux») et le texte se construit sur ce va-et-vient permanent entre passé et présent dont les comédiennes annoncent le surgissement par ces mots : «Avant», «Maintenant». Avant, maintenant : Bestioles, une pièce sur le passage excitant, accablant et vulnérable entre deux âges. Un texte sur la mise en danger des filles malgré leur envie de vivre – ou justement à cause de cette envie. A ses meilleurs moments (car il y a aussi des facilités dans ce texte, sur la dénonciation faiblarde du rapport des jeunes aux écrans ou de la sexualisation des adolescentes), Bestioles révèle à quel point le monde n’est pas fait pour ces filles dont on disait il y a peu qu’elles ont le diable dans le corps – ce sont elles, à la fin, qui se blessent à ses angles. Rien d’étonnant à ce que la comédienne Séphora Pondi, pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2021, s’attaque pour sa toute première mise en scène à cette pièce inspirée d’un fait réel au dramaturge australien Lachlan Philpott. En septembre, elle a publié un premier roman remarqué, Avale, qui plongeait d’une manière très singulière, parce qu’à la fois réaliste et horrifique, dans l’adolescence de ses deux protagonistes. «De minuscules bestioles grimpent sur mes cuisses, c’est une rancœur céleste qui me prive de jouir.» Cafards et mouches, les bestioles se répandent sur la scène du petit studio de la Comédie-Française, montent sur la paillasse de la gynéco et viennent nicher dans les cheveux des filles, mais alors qu’Avale rendait bien les corps et les sucs de l’adolescence, jusqu’aux «pulpes pleines de fourmis» de l’âge adulte, les héroïnes de Bestioles manquent de sève et de modulation dans l’interprétation : dans ce flot incessant de cris et de paroles, les filles restent à l’état de figures types et caricaturées de l’adolescence. Et si Séphora Pondi échappe au réalisme plan-plan grâce aux échos fantastiques de sa mise en scène (elle se dit «férue de cinéma de genre et de body horror») l’hypertension de sa pièce empêche finalement que l’intrigue trouve son rythme. Bestioles, tirée de la pièce Truck Stop de Lachlan Philpott (traduction Gisèle Joly). Au studio théâtre de la Comédie-Française jusqu’au 1er mars. Durée 1h30. Légende photo : Bee et Ellie, les deux jeunes héroïnes de la pièce mise en scène par Séphora Pondi, demandent : «Mais qui nous protégera ?» (Vincent Pontet)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 5, 6:07 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 5 février 2026 La pièce de théâtre inspirée de l’affaire French Bukkake, du nom du site Internet qui diffusait les viols de centaines de femmes, organisés par un homme, secoue le public et plonge la salle parisienne dans un profond malaise. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/02/05/aux-bouffes-du-nord-sideration-ou-aversion-face-aux-chiens-de-lorraine-de-sagazan_6665569_3246.html
Chiens, mis en scène par Lorraine de Sagazan au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris (10ᵉ), est une liturgie contemporaine qui suscite des réactions contradictoires allant de la sidération à l’aversion. Embarrassant, un peu poisseux, voire nauséeux : on quitte ce spectacle avec l’envie de marcher très longtemps dans la ville pour évacuer le malaise dans lequel il plonge. Ce qui prouve à quel point l’artiste a su secouer en profondeur un public pourtant averti de ce qui l’attend par un cartel projeté d’entrée de jeu sur les murs : « Ce spectacle contient des descriptions de violences sexuelles, exploitations et humiliations racistes et sexistes. Nous vous invitons à prendre soin de vous et à vous sentir libre de quitter la salle à tout moment. » L’argument de Chiens ? C’est l’abjection à l’état pur. La metteuse en scène a compulsé les détails de l’affaire French Bukkake, du nom d’une société de vidéos porno, dont la spécialité était la diffusion de « bukkake », une pratique sexuelle consistant à éjaculer à plusieurs sur le visage d’une femme. L’histoire est vraie : sous prétexte de réaliser des vidéos pornographiques, un homme, Pascal Ollitrault, a organisé et filmé le viol par des centaines d’hommes de plusieurs dizaines de femmes. Un système de prédation dont le déroulé méthodique est décrit par Vladislav Galard, un acteur d’une plasticité remarquable. Visage masqué par un bas et voix trafiquée, le comédien fait tout à la fois la victime et ses bourreaux : Daphnée, jeune fille crédule, fragile et dans le besoin, tombe dans le piège tendu, sur les réseaux, par un rabatteur qui lui inflige un premier viol (dit « d’abattage »), avant de l’expédier, brisée et sans défense, dans l’enfer du tournage de la vidéo porno. « Rester neutre est déjà une position » Cette séquence d’ouverture aura son pendant en fin de spectacle, avec l’intervention de Lorraine de Sagazan elle-même. Equipée d’une oreillette, face au public sur son tabouret, la metteuse en scène répétera le mot à mot d’une interview qu’aurait pu lui accorder Daphnée si elle n’était pas juste un personnage de fiction. Entretien qui s’achèvera par ces mots : « Je veux que le public ressente que rester neutre est déjà une position, que détourner le regard a des conséquences. Je veux qu’en sortant ils se demandent : qu’est-ce que je fais maintenant que je sais ? » Largement diffusées sur de multiples plateformes en ligne, les vidéos des tortures ont été visionnées par des centaines de milliers de consommateurs. La justice s’est saisie de l’affaire en 2020. Quarante-deux victimes se seraient portées parties civiles. Une quinzaine d’hommes doivent encore être jugés devant la cour criminelle de Paris. Aux Bouffes du Nord, pas une image documentaire n’est montrée, mis à part celle, glaçante, d’une interminable cohorte de violeurs gagnant à la queue leu leu un hangar sinistre. Sur un écran suspendu s’inscrivent sans discontinuer les consignes du réalisateur et la description des sévices infligés. Des lettres blanches obsessionnelles (« pénétration pénienne buccale » en est le leitmotiv) vers lesquelles le regard revient en permanence, cherchant à concilier ce rappel sec du réel et la cérémonie qui se tient en dessous, sur le plateau, à l’endroit du théâtre, de la transfiguration, du symbolique et de la métaphore. Cathédrale des immondices Au sol donc, un patchwork plastifié agrégeant des centaines de vêtements se termine en un tas de déchets érigé sur 2 ou 3 mètres de haut. Les Bouffes du Nord se transforment en cathédrale des immondices où vont se déployer des rituels déviants, les créatures convoquées arborant des têtes de chien, des mitraillettes ou des cagoules de tortionnaire. Organisé autour de deux cantates de Jean-Sébastien Bach, adaptées par Othman Louati, également compositeur de la musique originale, le spectacle (fruit d’une écriture collective) entraîne dans un univers spectral où les chants (bien trop cabalistiques) sont des psalmodies dénuées de psychologie. Lorraine de Sagazan sacrifie la clarté de sa dramaturgie à son désir de s’ancrer dans l’antique ou l’archaïque. Un monde de la sauvagerie barbare dont les principes fondateurs auraient été édictés par le chien qui se tapit dans l’homme. Pendant près de deux heures, le plateau subit les assauts de visions enchevêtrées et obscures au cours desquelles les collusions se multiplient entre signaux opposés : mélopées mélodieuses, stridence des hurlements, corps tenus en laisse ou vierges marchant à quatre pattes, cérémonie païenne teintée de religiosité. Le territoire est celui du tragique, mais l’humour s’immisce : une femme qui revendique l’autonomie de ses seins, une metteuse en scène intrusive qui déshabille de ses commentaires les acteurs masculins, un clown (facétieux Léo-Antonin Lutinier) dont les interventions sur la déconstruction du mâle cisgenre hétérosexuel sont censées détendre l’atmosphère. Ce mélange des genres installe chacun dans un hiatus inconfortable. Un œil sur ce plateau abscons et confus, l’autre sur les horreurs qui s’écrivent en lettres blanches sur l’écran, le public absorbe une forme hybride qui en appelle au sacré quand le sujet relève du sordide. Pas simple d’articuler, du gradin où on joue les voyeurs consentants, la pensée d’un réel irreprésentable et la métamorphose de celui-ci en objet esthétique. Les violences sexuelles, suggère le personnage de Daphnée, commencent dès lors que le regard se détourne. Fallait-il rester et scruter l’obscénité en face ou bien partir, « prendre soin de soi » et fuir la vérité ? La réponse n’est pas simple mais rares sont les créations de Lorraine de Sagazan qui ne perturbent pas le public. Cette fois encore, et jusqu’à l’indigestion . Chiens. Mise en scène : Lorraine de Sagazan. Direction musicale : Romain Louveau. Composition et adaptation musicale : Othman Louati, avec l’ensemble Miroirs Etendus. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris (10ᵉ). Jusqu’au 15 février. Joëlle Gayot / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 5, 5:44 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 3 février 2026 Pour sa première adaptation d’une pièce du dramaturge russe, l’auteur et comédien en offre une version grinçante à souhait, avec Nicolas Bouchaud dans le rôle-titre. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/02/03/dans-ivanov-le-metteur-en-scene-jean-francois-sivadier-s-attaque-avec-acuite-a-anton-tchekhov_6665262_3246.html
Que d’ironie, que de malaise et que d’humour dans cet Ivanov revisité par Jean-François Sivadier ! C’est la première fois que le grand metteur en scène français aborde une pièce d’Anton Tchekhov (1860-1904). Bien lui en a pris. Portée par la traduction française d’André Markowicz et Françoise Morvan, cette tragi-comédie humaine dans la Russie de la fin du XIXe siècle, où la mélancolie et la petitesse de ses protagonistes sont d’une étonnante contemporanéité, reste en tête tant par la force du texte que par la qualité de la distribution. En quatre actes qui vont crescendo (le premier gagnerait à être un peu resserré), Ivanov, interprété par le remarquable Nicolas Bouchaud, et la communauté qui l’entoure (toute la troupe est au diapason) ne dégagent que déprime, ivrognerie, pitoyables commérages et quotidien qui tourne en rond. Ce petit monde étouffant d’ennui et de mesquinerie s’avère, au fil du spectacle, de plus en plus passionnant à observer et à écouter. Ils s’ennuient, nous pas. Rien ne va pour Ivanov. La vie le submerge et son esprit part à la dérive. Sa femme, Anna, est malade de la tuberculose, seule une cure en Crimée pourrait la sauver. Mais Ivanov, propriétaire terrien lourdement endetté auprès de Zinaïda, l’épouse avare de son ami Lebedev, ne peut pas payer le voyage. Bien qu’il assure avoir épousé Anna par amour, sa réputation est détestable. On l’accuse d’avoir choisi une femme juive pour une dot qu’il n’a finalement jamais obtenue. Anna s’étant convertie au catholicisme pour vivre avec lui, ses parents l’ont reniée. Force comique du texte Dépressif, affligé par la vacuité de son existence, n’ayant plus, comme tout son entourage, de « vision du monde », Ivanov tente sans conviction de trouver l’argent nécessaire. Abandonnant sa femme sous le regard accusateur du docteur Lvov, allant jusqu’à la traiter de « sale juive », il se laisse aller, lors d’une fête d’anniversaire, dans les bras de Sacha, la fille de son ami. Sacha lui jure qu’elle l’aime depuis toujours et qu’elle va le « sauver ». Dans un décor d’une ingénieuse simplicité, baignée de belles lumières, cette nouvelle version grinçante à souhait de la pièce de jeunesse de Tchekhov scrute la condition humaine, entre rire et désespoir, avec une remarquable acuité. La force comique du texte est parfaitement célébrée, et la troupe de Sivadier dégage une vitalité et une justesse d’interprétation jamais démenties. Entre le monologue d’Ivanov, antihéros qui n’attend plus rien de la vie, son face-à-face avec le médecin sur l’impossibilité de comprendre l’autre ou encore la discussion pathétique de ses congénères soûlés à la vodka, certaines scènes se révèlent mémorables. Ni l’alcool, ni l’argent, ni même l’amour ne permettent aux personnages de changer leur vie et d’en finir avec leur fatigue morale. Il y a quelque chose d’universel dans cette bande de clowns tristes, dont la mélancolie prégnante nous pousse à réveiller nos existences. Ivanov, d’Anton Tchekhov, mise en scène : Jean-François Sivadier. Avec Nicolas Bouchaud, Yanis Bouferrache, Christian Esnay, Zakariya Gouram, Gulliver Hecq, Charlotte Issaly, Jisca Kalvanda, Norah Krief, Frédéric Noaille, Agnès Sourdillon. TNP de Villeurbanne (Métropole de Lyon), jusqu’au 6 février. Puis en tournée : à Caen, du 18 au 20 mars ; à Douai (Nord), du 25 au 20 mars ; à Douai (Nord), du 25 au 27 mars ; à La Rochelle, les 1er et 2 avril, etc. Durée : 2 h 40. Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : Frédéric Noaille, Zakariya Gouram, Yanis Bouferrache, Gulliver Hecq et Christian Esnay dans « Ivanov », mis en en scène par Jean-François Sivadier, au TNP de Villeurbanne (Rhône), le 17 janvier. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 30, 9:25 AM
|
Par Eric Demey dans le Journal La Terrasse - 27 janvier 2026 Marthe Gautier est la femme qui a découvert les origines chromosomiques de la trisomie 21. Avec simplicité et talent, Elisabeth Bouchaud et Julie Timmerman rendent justice à cette scientifique que les hommes ont invisibilisée. On le sait, bien des femmes scientifiques ont été effacées de l’Histoire par leurs collègues masculins qui ont accaparé la lumière et sont entrés à leur place dans la postérité. On le sait, mais de manière confuse, et tout le travail d’Elisabeth Bouchaud, dans sa série « Les Fabuleuses », est de donner un nom, un visage, une histoire à ces femmes dont le travail a basculé dans l’ombre. Il s’agit là de rétablir une certaine forme de justice historique, bien sûr, mais aussi d’ouvrir un autre imaginaire des sciences qui montre aux jeunes femmes d’aujourd’hui qu’elles peuvent exceller dans le domaine, et également d’illustrer les mécanismes d’une des nombreuses formes d’invisibilisation que peut produire le patriarcat. Après Lise Meitner, Jocelyn Bell, Rosalynd Franklin, c’est donc à l’histoire de Marthe Gautier que s’est attaquée Elisabeth Bouchaud dans La découvreuse oubliée. Celle-ci a, la première, isolé le chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21, sous la direction du professeur Turpin. Sa route a malheureusement croisé celle de Jérôme Lejeune, qui s’attribuera le mérite de la découverte, en fera la publicité, avant de mener croisade contre la légalisation de l’avortement. Une histoire ordinaire et exceptionnelle Au plateau, c’est Marie-Christine Barrault qui incarne Marthe Gautier – morte en 2022 – dans son âge avancé, sa gentillesse et son humilité. Et sa petite fille, Marie Toscan, qui redonne vie à Marthe Gautier, plus jeune mais tout aussi modeste, quand, en 1958, elle découvre qu’un chromosome surnuméraire qui se fixe sur la paire n°21 (nous en comptons tous 23) est à l’origine de ce qu’on appelle alors le mongolisme, dorénavant nommé trisomie 21. Jérôme Lejeune manœuvre alors pour paraître comme l’auteur de cette découverte. Sa stratégie, d’une simplicité désarmante, facilitée par le contexte de ces années 50, est restituée de manière éloquente. On glisse ainsi rapidement dans le spectacle d’une époque à l’autre, de ce passé récent où Marthe Gautier, longtemps résignée à l’accepter sans broncher, décida de révéler la vérité, à cette époque plus éloignée où elle s’est laissé invisibiliser. La mise en scène de Julie Timmerman, via une interprétation enlevée, des transitions fluides, des jeux de lumière qui permettent aux différentes temporalités de communiquer entre elles et des personnages aux individualités nuancées, pris en charge côté masculin par Matila Malliarakis et Mathieu Desfemmes, développe une simplicité théâtrale juste et efficace. Elle permet ainsi à partir de cette histoire ordinaire et exceptionnelle de construire un spectacle à la fois instructif et émouvant. Eric Demey / La Terrasse Du jeudi 22 janvier 2026 au dimanche 29 mars 2026
La Reine Blanche - Scène des arts et des sciences
2 bis Passage Ruelle, 75018 Paris
à 19h, samedi à 18h, dimanche à 16h, relâche le lundi et le mardi. Tel : 01 40 05 06 96. Durée 1h15

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 30, 9:08 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog, publié le 30 janvier 2026 En transformant le vaudeville en un monologue polyphonique, Nastassja Tanner et Grégoire Strecker orchestrent une rencontre intime et explosive avec l’esprit de Georges Feydeau. Réjouissant seul-en-scène et véritable prouesse physique, « Monologue Feydeau » est une déclaration d’amour au genre en même temps qu’une déconstruction impertinente de ses mécanismes.
Le plateau est nu, presque ascétique. Seule sur scène, Nastassja Tanner est un corps tendu, une voix qui module du murmure au cri. La comédienne interprète tous les personnages de la pièce de Feydeau « Mais n’te promène pas toute nue ![1] », dans un mouvement du corps proche de la chorégraphie, rappelant par moments la gestuelle du Krump[2]. Créé en septembre 2024 au Centre de culture ABC de La Chaux-de-Fonds, « Monologue Feydeau », conçu et interprété par Nastassja Tanner avec la complicité de Grégoire Strecker à la mise en scène, à la création sonore et à la scénographie, n’est pas une simple adaptation de la pièce de Georges Feydeau (1862-1921). C’est une plongée vertigineuse dans les abysses de l’humour feydeausien, un seul-en-scène vif et déjanté qui fait jaillir la folie du maître du vaudeville sans filet ni décor superflu. Le duo exhume une version inédite de la pièce et la dépouille de ses oripeaux de boulevard pour la livrer à une lecture aussi sèche que brûlante. Le texte se mue en machine à compression. On y entend la langue de Feydeau poussée jusqu’à la déflagration. Les répliques se fond des éclats qui ne cessent de rebondir contre les parois d’un salon devenu volcanique. Nastassja Tanner incarne une parade solitaire dans laquelle l’énergie comique se heurte à la solitude contemporaine, transformant le manuscrit ancien en un miroir tendu à notre époque désarticulée. Loin d’un hommage poussiéreux, cette pièce hybride, entre théâtre documentaire et performance physique – Tanner et Strecker parlent d’ « athlétisme somnambulique » pour évoquer la prouesse quasi sportive de l’interprétation –, interroge les racines de l’écriture de Feydeau, cette collision des contraires qui orchestre le chaos pour mieux révéler l’absurde du quotidien. L’idée, simple et vertigineuse, est de transformer le vaudeville en un monologue polyphonique, un corps-voix unique qui campe toutes les obsessions de l’auteur. Le procédé fonctionne quand il fait surgir la violence latente du texte. La canicule de 1911 n’est plus un simple décor mais un climat moral, et Clarisse, tour à tour enfant et ouragan, renvoie au spectateur son propre regard voyeur. La mise au jour du manuscrit originel, plus âpre et plus crue, donne à la pièce une netteté corrosive. La scène du journaliste qui « sucerait » la plaie causée par une abeille se fait alors, dans toute son abjection, un miroir de la presse-tribune et de la pornographie sociale. L’espace sonore signé Grégoire Strecker enveloppe le public dans une atmosphère de huis clos étouffant, ponctué de bruits incongrus, un rire étouffé, un claquement de porte imaginaire. Ce monologue revisité n’est pas une récitation fidèle de la comédie en un acte de Georges Feydeau mais une transcription libre dans laquelle le texte original se fond dans des improvisations contemporaines. Tanner endosse tour à tour les rôles d’une femme éperdue, d’un mari jaloux, d’un domestique maladroit, faisant surgir les quiproquos feydeausiens comme autant d’éclats de rire. Il y a quelque chose de charnel dans sa performance. Son corps se contorsionne, mime les portes qui claquent et les hommes gourmands, transformant l’absence de décor en un atout poétique. Strecker infuse à la pièce une dimension sonore qui amplifie l’absurde à l’aide d’échos distordus, de silences pesants qui soulignent la solitude de l’héroïne, piégée dans un vaudeville où le rire masque la détresse. « Il fait très chaud » lance Nastassja Tanner, reprenant les mots de Feydeau, mais ici la chaleur n’est pas seulement climatique. Elle est celle d’une société bourgeoise qui étouffe sous ses convenances, et que la comédienne fait exploser avec une vitalité contagieuse. La pièce, structurée comme un poème, est semblable à une destruction climatique, un ouragan qui va démonter cette maison et cette famille. Mettre l’auteur sur scène La pièce explore l’écriture et le processus créatif de Feydeau, mettant en lumière son génie et sa qualité poétique. Le spectacle vise à toucher le public par la force des mots et l’imagination, en incarnant les personnages avec dextérité et en créant un intense face à face avec le public. Cette résurrection de Feydeau n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une réflexion plus large sur le théâtre comme espace de subversion, où l’humour est une arme contre les rigidités sociales. Tanner et Strecker déconstruisent le vaudeville pour en extraire l’essence, cette mécanique implacable où les contraires s’entrechoquent : le sérieux et le ridicule, l’ordre et le chaos, le visible et l’invisible. Dans « Monologue Feydeau », la collision prend une teinte contemporaine. La femme, au centre du récit, n’est plus seulement l’objet du quiproquo mais son moteur, une figure émancipée qui défie les normes genrées du début du XXème siècle. Le rire feydeausien masque les violences invisibles d’une société patriarcale. Nastassja Tanner incarne ici cette dualité avec une précision chirurgicale. Son jeu polymorphe passe du grotesque au pathétique, évoquant tour à tour les influences de Buster Keaton et de Sarah Bernhardt. Grégoire Strecker, avec sa scénographie sonore, transforme ces éléments en une partition immersive dans laquelle le bruit du monde extérieur, d’une sirène lointaine à un bourdonnement urbain, s’insinue pour rappeler que le vaudeville n’est pas un divertissement innocent. Loin d’être un spectacle didactique, « Monologue Feydeau » gagne en profondeur par sa capacité à interroger les limites du seul-en-scène. En endossant tous les rôles, Nastassja Tanner questionne la solitude de l’acteur face au public. Est-ce un dialogue ou un soliloque ? Sous le rire, affleure une mélancolie subtile. Si certains mouvements ou déplacements du corps de Nastassja Tanner peuvent s’apparenter au Krump, danse de la non-violence malgré son apparence agressive, c’est que les expressions belliqueuses qu’on a l’impression de lire sur le visage de la comédienne ne sont que le reflet de ses efforts physiques intenses, offrant malgré eux une autre lecture de la pièce. Feydeau, revisité ainsi, n’est plus seulement le roi du boulevard, mais un prophète de nos folies collectives, où l’humour comble les béances d’une existence absurde. En critiquant l’hypocrisie médiatique et politique de la société, et en présentant le corps féminin et son dévoilement comme un symbole de liberté et de potentiel bouleversement social, l’auteur liquide littéralement la société capitaliste de son époque, qui résonne plus que jamais avec aujourd’hui. La pièce joue habilement entre hommage et ironie, des clins d’œil à Feydeau aux détournements méta-théâtraux et aux commentaires sociaux, discrets mais présents, sur la colère, la solitude, la représentation. Le texte parvient à actualiser le rire sans le trahir. Tanner et Strecker travestissent la folie du théâtre de Feydeau en un rite libérateur. « Monologue Feydeau » est un bijou de théâtre intelligent. Il transcende le genre pour devenir un acte de résistance joyeuse dans lequel le rire n’est pas une échappatoire mais un outil de dissection sociale. [1] Comédie en un acte de Georges Feydeau créée le 25 novembre 1911 au théâtre Femina, à Paris. [2] Danse née en 1992 dans le quartier paupérisé de South Central, dans le sud de Los Angeles. Acronyme de Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. « MONOLOGUE FEYDEAU » - D'après « Mais n’te promène pas toute nue ! » texte Georges Feydeau transcription du manuscrit, mise en scène et jeu Nastassja Tanner transcription du manuscrit et mise en scène Grégoire Strecker Administration : Mathias Gautschi Production : NTproduction Création Temple allemand-ABC. Soutiens et bourses de recherche Canton de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel & Pour-cent culturel Migros Partenariat : Théâtre de la Maison du Concert Modulation de création : Temple allemand-ABC Soutiens à la création d’origine « Mais n’te promène donc pas toute nue! »: Ville de Neuchâtel, République et Canton de Neuchâtel, Loterie romande, Migros Idéation, Fondation culturelle BCN, Fondation Bürki, Fondation Jan Michalski, CCN Pommier. Spectacle créé au Centre de culture ABC (Temple Allemand), La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 2024, vu à Micadanses, Paris, le 22 janvier 2026. Guillaume Lasserre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 28, 9:09 AM
|
Par Laurent Carpentier (Genève [Suisse], envoyé spécial du Monde), publié le 28 janvier 2026 Mise en cause anonymement à l’automne 2025 pour son management « toxique », la metteuse en scène Séverine Chavrier, acclamée pour ses créations, a été écartée du théâtre suisse dont elle doit cependant toujours assurer la programmation. Elle a porté plainte.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/28/la-comedie-de-geneve-cherche-la-sortie-d-une-crise-partie-tous-azimuts_6664403_3246.html
La situation est ubuesque, l’avenir une impasse, et pourtant Séverine Chavrier ne baisse pas les bras. Mise sur la touche par sa tutelle, interdite de se présenter à la Comédie de Genève, qu’elle dirige depuis juillet 2023, la metteuse en scène ne lâche pas prise : « De toute façon, je ne pourrais pas : si je suis déchargée des responsabilités administratives et financières, j’ai paradoxalement, jusqu’à nouvel ordre, la charge de la programmation de la prochaine saison. Et je suis censée faire ça sans avoir accès au directeur financier, et sans observer les spectacles. Une programmation, c’est comme organiser une fête. Et la seule personne qui n’est pas invitée à la fête, ici, c’est celle qui l’organise. C’est bizarre. Et illégal. » Tout commence le 22 octobre 2025 par un article violemment à charge paru dans La Tribune de Genève. Un « certain nombre » d’employés du théâtre, tous anonymes, mais « concordants », explique le journaliste, y dénoncent un « comportement toxique et pervers », des « recrutements arbitraires et dénués de logique », des « dénigrements au travail »… qui auraient poussé, affirme le quotidien, une quinzaine de personnes sur 80 salariés à partir. Comme si ce n’était pas assez, on y dénonce l’usage que ferait l’impétrante d’un acronyme, « PPSDM », pour parler de « petites productions suisses de merde ». N’en jetez plus. C’est l’Helvétie qu’on assassine. Et par une Française, de surcroît. Peu importe que, dix jours plus tard, un article de la Radio-Télévision suisse démontre que l’information sur l’acronyme était fausse – en réalité utilisée par une ancienne salariée de la production qui a été éconduite –, le mal est fait, les syndicats embrayent et la « théâtrosphère » genevoise s’en donne à cœur joie. Katia Berger, elle, n’en revient pas. Fille de l’écrivain britannique John Berger (1926-2017), elle a été pendant douze ans critique de théâtre à cette même Tribune de Genève. Confrontée à une direction qui, juge-t-elle, poussait à la roue pour faire de l’audience, elle a préféré, en 2024, prendre sa retraite de manière anticipée. « Quand Séverine Chavrier a été nommée, il régnait un climat un peu méfiant. Ma hiérarchie me harcelait pour que j’aille fouiller et que je révèle je ne sais quel méfait, témoigne-t-elle. Quand l’article est paru, j’ai été sidérée, choquée par le type d’enquête, relais de dénonciations anonymes, sans jamais donner la parole à l’intéressée. Se sont alors engouffrés dans cette brèche les créateurs locaux, une nébuleuse d’artistes qui l’ont lynchée, par amertume, par frustration de voir “leur” théâtre leur échapper. Et on les voit aujourd’hui comme effarés de leur propre pouvoir. Elle était le gage d’une programmation d’excellence, et voici que tout ça est remis en question. » Salve d’attaques Aujourd’hui directeur de la programmation du Grand Palais à Paris, Christophe Lemaire a vécu cette bronca aux premières loges. Il venait de quitter son poste auprès de Séverine Chavrier lorsque l’article est paru. Secrétaire général du Théâtre de la Ville à Paris pendant seize ans, il a pris sur les réseaux sociaux la défense de l’équipe dirigeante, se débattant avec les commentaires haineux sur son ex-patronne. « Et là, je deviens un “Frouze” », découvre-t-il. Le mot désigne de façon péjorative les Français dans un pays où, derrière le policé et le neutralisme, traînent des relents de nationalisme. « Le coup de génie des ennemis de Séverine, ce fut de sortir l’acronyme, salue Christophe Lemaire. Sur les pages Facebook, les gens ajoutaient à leur profil “I love PPSDM”. Imaginez, les “Frouzes” venant prendre l’argent des Suisses, alors qu’à Genève, en ce moment, ils ne mettent que des Français à la tête des institutions culturelles : Jean Bellorini au Théâtre de Carouge, Stéphane Malfettes au festival de La Bâtie, Lou Colombani à l’ADC, l’Association pour la danse contemporaine… » Face à cette salve d’attaques tous azimuts, les soutiens de la directrice s’efforcent d’argumenter. Les 15 départs ? Que des promotions ou des changements de vie, pas de plainte pour harcèlement ou maltraitance, plaident-ils, et un renouvellement dans la normale pour une maison de théâtre. Son management autoritaire et toxique ? « J’ai été témoin, à ses côtés, au quotidien, de la difficulté pour une femme de faire valoir sa légitimité, s’agace Christophe Lemaire. Séverine est une vraie capitaine de navire. On lui reproche à la fois d’être absente et d’avoir un management toxique : il faut choisir. » Emménageant dans de nouveaux locaux flambant neufs – deux salles, l’une de 500 places, l’autre modulable, des bureaux, un atelier technique, un restaurant… – , l’équipe de direction précédente a dû, en 2021, engager à tour de bras et à toute vitesse, passant de 25 à 80 salariés, créant des sous-directions qui vont se révéler des baronnies très autonomes. « Ils ont inauguré ces nouveaux lieux et vivent cette maison comme si elle leur appartenait », analyse Christophe Lemaire. Précédent de l’affaire Lupa Premier théâtre de l’agglomération de 200 000 habitants (pour un bassin urbain de plus d’un million de personnes), la Comédie de Genève a plus d’un siècle d’existence. Autrefois installée boulevard des Philosophes, la vieille salle s’est révélée peu adaptée au théâtre contemporain. Au tournant du millénaire, un collectif de comédiens, de metteurs en scène et de techniciens locaux a créé une association pour porter le projet d’un nouveau bâtiment. Celui-ci sera finalement mis en chantier en 2017 et ouvert quatre ans plus tard. Avec un budget de fonctionnement de l’ordre de 15 millions d’euros, la nouvelle Comédie figure parmi les maisons d’art dramatique les mieux dotées d’Europe. Lorsque Séverine Chavrier est choisie en 2023 pour prendre la tête de l’institution, c’est clairement pour sa stature d’artiste internationale et son carnet d’adresses à même de mettre la programmation sur la carte de l’Europe. Or, d’emblée, l’équipe rue dans les brancards. On s’offusque que la directrice parte avec sa troupe six semaines à Orléans – dont elle dirigeait auparavant le Centre dramatique national – répéter Absalon, Absalon !, d’après William Faulkner. Le spectacle fera sensation à Avignon, en juillet 2024. « Il n’y avait pas de salle disponible à Genève, se justifiera-t-elle. Or, après le “crash Lupa”, c’était important pour moi de montrer que la Comédie pouvait monter des projets d’ampleur. » Le précédent de l’affaire Lupa va, en effet, jouer un rôle dans la crise actuelle. En 2023, alors que la direction précédente est encore aux manettes, Les Emigrants, une pièce de W. G. Sebald mise en scène par le dramaturge polonais Krystian Lupa, est coproduite avec le Festival d’Avignon et L’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris. Les répétitions ont pris du retard. Partenaire à la ville comme sur le plateau de Lupa, Piotr Skiba est régulièrement complètement ivre. Le maître, lui, s’agace de la difficulté qu’il a à se faire comprendre de l’équipe technique. Les techniciens sont froissés que Krystian Lupa s’installe sur la scène plutôt qu’au bureau qu’ils ont installé à côté d’eux. Un jour, l’ingénieur du son, énervé, prend sa pause et ne revient pas. Impatience et orgueil forment un ménage toxique. Le ton monte. Les comédiens, eux, se taisent, à l’instigation du directeur d’alors de l’Odéon, Stéphane Braunschweig, qui, de loin, espère calmer le jeu, et que le spectacle finisse par être monté. Peine perdue. Les techniciens refusent de reprendre le travail. Victoire de la classe ouvrière ? Sans doute. Que les hommes de l’ombre de la technique fassent ainsi annuler une pièce de théâtre, c’est une première. Et son écho va se répandre dans toute l’Europe. Même s’il y a toujours deux faces à une même pièce. « Aucun travail, aussi exigeant soit-il, ne mérite de malmener ses équipes, soutient le comédien Pierre-François Garel, qui jouait dans le spectacle (lequel sera finalement monté à l’Odéon six mois plus tard). Mais c’est valable des deux côtés. Quand une équipe technique traite les acteurs de “dingues” et qu’elle répond aux demandes du metteur en scène en marmonnant : “Qu’est-ce qu’il veut encore, le vieux ?”, c’est une forme de mépris et de violence. Certaines œuvres radicales demandent un engagement auquel il faut être préparé, et, à Genève, certains ne semblaient pas l’être. Ni curieux ni préparés. » Mesure d’éloignement X est technicien à la Comédie de Genève. Il a donné rendez-vous dans un café à l’écart du théâtre, puis il nous a fait changer d’endroit (« Ici, ce n’est pas… »). On nous avait prévenus : en Suisse, la culture de l’anonymat, du secret, n’est pas un mythe réservé aux banques. « C’est maintenant que ça commence. Mais on se reverra… Là, c’est un peu trop tôt, l’audit démarre juste », explique-t-il, méfiant. « Krystian Lupa, comme Séverine Chavrier, ce sont des attitudes qui ne sont plus adaptées… C’est une enfant gâtée. Sur les “warnings”, il y a peu d’écoute. Et puis, on est passé de 32 projets à 42, on n’est pas en capacité. Quatre-vingts pour cent des salariés valident cette mise à l’écart. » On s’interroge : à quoi est due cette mesure d’éloignement, en général réservée aux criminels ? Y a-t-il eu violence de la part de Séverine Chavrier ? Qui a peur de quoi ? Et qui fait peur à qui ? Sa plus proche collaboratrice, Pauline Pierron, venue elle aussi d’Orléans, où déjà elle la secondait, est chargée de tenir les rênes en son absence. Elle aussi préfère ne pas nous parler. L’équilibre est fragile, et l’irruption d’un journaliste pourrait le briser. Derrière les vitres transparentes de l’immense paquebot, l’opacité règne. « Je ne dis pas que tout est vrai dans l’article de La Tribune, convient notre technicien anonyme. Mais il fallait que ça pète à un moment donné. Ce fut juste l’élément déclencheur. » Quand on la retrouve, au centre-ville, loin de son théâtre, Séverine Chavrier fulmine. « C’est la femme que vous venez voir ou c’est la sorcière ? », ironise-t-elle. On la dit autoritaire, elle est directe, parle cash, ne s’embarrasse pas de joliesse. Cinquante et un ans, cheveux noirs, yeux noirs, débraillée, elle tranche avec le paysage policé, elle qui a grandi à Annemasse (Haute-Savoie), juste là, de l’autre côté de la frontière, fille d’un couple de médecins. Le bac passé à 16 ans, khâgne au très coté lycée du Parc, à Lyon, éternelle bonne élève, éternelle rebelle. Le verbe haut fuse et déferle en cascade, le cerveau est une machinerie. Mais derrière, une tristesse régulièrement l’envahit, elle qui pourtant, dit-on, adore aller au charbon… « Ceux qui, à la Comédie, me critiquent n’ont aucune conscience de ce qu’est la maïeutique. Dans mes spectacles, tout le monde est en puissance, je cherche à produire des conditions de travail et d’improvisation qui permettent aux artistes, aux techniciens de créer de la matière, ce sont vraiment des créateurs que j’aide à faire accoucher. Un son, c’est une âme, le truc intouchable. Je travaille avec ça, avec l’intuition permanente de ce que font les gens et de comment je vais orchestrer ça. Et, parfois, je me plante. Parfois, je fais de mauvais choix, de construction, de dramaturgie, mais, en tout cas, voilà quelque chose qu’on ne peut pas faire en piétinant les gens », explique la musicienne (Médaille d’or de piano à Genève), philosophe (mémoire sur l’Autrichien Thomas Bernhard) et metteuse en scène (Cours Florent à Paris). Du reste, c’est au Cours Florent qu’elle a rencontré, il y a vingt ans, Laurent Papot, avec qui elle a créé sa compagnie. Ils vivent séparés depuis longtemps, mais ils ont une fille de 8 ans. « Séverine n’est pas quelqu’un de hargneux et d’autoritaire, elle est brillante si on a l’humilité de le comprendre, témoigne le comédien. On s’est pris la tête, mais parce qu’on sait que ce qu’on cherche n’est pas à portée de main. Développer un langage artistique, c’est comme une relation amoureuse, il faut se mettre d’accord sur énormément de choses. Le pire, c’est que les équipes du théâtre rejouent la lutte des classes avec des gens qui sont bien plus précaires qu’eux. Nous, on sait qui on est, d’où on vient : des squats de Ris-Orangis [Essonne] et des sous-sols de bars. Le moindre sou que la compagnie a eu dans sa vie, on l’a utilisé à bon escient. Autant vous dire qu’on ne joue pas avec l’argent public. » Au directeur d’une scène parisienne qui lui glissait : « Ils ne te reprochent pas de mal faire, ils te reprochent de faire », Séverine Chavrier répond : « Il faut du temps pour constituer une équipe et l’emmener derrière un projet. Je pense qu’on était en train d’y arriver. Mais quand tu prends une attaque personnelle, vengeresse, avec une telle déloyauté… Et que la Fondation [d’art dramatique, FAD] qui te gère, au lieu de faire paravent, te sort, c’est difficile. Ils vont jusqu’à m’interdire de créer avec l’argent de la Comédie le spectacle qu’on m’a demandé pour le prochain Festival d’Avignon. » Machisme quotidien La violence des attaques a ouvert paradoxalement les vannes. La souffrance des uns a réveillé celle des autres. « Dire à une artiste : “Tu n’as pas le droit d’aller dans ton théâtre” équivaut à une mise à mort, s’indigne Claude Ratzé, qui, jusqu’en août 2025, dirigeait le festival de La Bâtie, événement central du spectacle vivant à Genève. Il y a peu d’endroits comme la Comédie où le corpus technique a assez de force, d’unité, pour faire annuler un spectacle. Après l’affaire Lupa, on aurait dû aborder cette question-là, mais, à Genève, il y a une manière de dire les choses sans jamais s’exposer. Ça a la texture de la rumeur. Et quand vous prenez la défense, on vous rétorque : “Tu ne sais pas tout…” Sans qu’on vous en dise jamais plus. Moi qui travaille depuis vingt ans ici, je n’ai jamais vu ça, et cette crise a fait sortir des choses très nauséeuses. » Pour le meilleur ou pour le pire, le linge sale risque de ne plus se laver en famille. A 35 ans, Louise Sari est une scénographe reconnue, professeure à la réputée Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, à Lyon, où elle a elle-même étudié. Avant de connaître la Comédie, elle a travaillé avec les équipes du Centre Pompidou, du MuCEM à Marseille, du CDN d’Orléans… Depuis dix ans, elle accompagne Séverine Chavrier sur tous ses spectacles. Les deux femmes maîtrisent la technique, et adorent ça. Leurs productions en sont pétries : vidéos, sons, accessoires y ont une place à part entière. Pas toujours simple à accepter pour une équipe masculine de voir cette jeune femme leur tenir la dragée haute. « Ils ne comprenaient pas que je touche à tout, témoigne l’intermittente du spectacle que l’on retrouve près de chez elle, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Une telle défiance et remise en question des compétences, je n’ai jamais connu… Ils s’imaginent avoir une méthode, qu’ils savent mieux que les artistes. Là où je suis déçue, c’est qu’il n’y ait pas plus de fierté pour les productions. Il n’y a pas de culture de théâtre. En revanche, quand Hermès veut privatiser la Comédie… » – une référence à un défilé organisé à l’automne 2023 par la maison de luxe. Surprise par l’article de La Tribune de Genève où, dit-elle, « tout est faux », elle écrit dans la foulée au Syndicat suisse romand du spectacle (SSRS) un premier témoignage circonstancié. Celui-ci arrive bizarrement dans les mains du directeur technique, Yves Frohle, qui sort de ses gonds et lui demande, dit-elle, de ne plus s’exprimer. Elle envoie alors un deuxième rapport à la direction des ressources humaines, témoignant des propos et des actes blessants dont elle a été l’objet ou le témoin, notamment à l’égard de Séverine Chavrier : « Elle ne va pas rester longtemps, celle-ci », ou : « Elle ferait mieux de s’occuper de sa fille. » Ou témoignant de cette fois où, arrivant les cheveux en bataille, un technicien lui lance : « Tu ressembles de plus en plus à Séverine, et ce n’est pas beau à voir. » Dans les différents exemples donnés dans sa lettre, Louise Sari raconte avoir signalé au directeur technique une main clairement posée, « sans aucune ambiguïté », sur sa cuisse par un technicien ivre. « Un attouchement contraint et non consenti. » Après lui avoir proposé d’en parler à l’intéressé et pris acte de son signalement, Yves Frohle aurait ajouté : « Oui, mais bon, lui, c’est un chasseur-cueilleur. » Elles sont quatre trentenaires à avoir aujourd’hui déposé des témoignages dénonçant le machisme quotidien dont elles furent victimes. Aucune n’est salariée. « Comment voulez-vous que des gens prennent la défense de Séverine Chavrier au sein de l’institution maintenant qu’il est annoncé qu’elle ne sera plus là l’année prochaine ? », s’indigne la scénographe. On attend l’audit. Mais l’audit, basé sur des témoignages oraux volontaires, est, on le voit, déjà remis en question. « Sanction disproportionnée » L’embrasement des esprits ne s’arrête pas aux guichets du théâtre, il a envahi l’arène politique genevoise. Notamment à travers la FAD, qui contrôle la Comédie de Genève. Y sont représentés ville, syndicats, partis politiques, sous la présidence de l’avocate Lorella Bertani, figure médiatique locale, membre du Parti socialiste suisse. Contactée, elle nous répondait, le 20 janvier, poliment, que « la Fondation d’art dramatique ne s’exprime pas », précisant seulement par abondance de prudence : « Et la Fondation, ce n’est pas une seule personne. » Le 27 janvier, elle a annoncé sa démission de ses fonctions, comme sa vice-présidente. C’est que, par sa décision radicale de mettre la directrice à l’écart, l’association s’est mise toute seule sur la sellette. Comédien et metteur en scène genevois, Daniel Wolf y siégeait jusqu’à l’été 2025 comme représentant du SSRS. « Dans un premier temps, la FAD a bien réagi, juge-t-il, en interviewant les gens pour tirer les choses au clair. Et puis – qu’est-ce qui a viré, à quel moment ont-ils changé d’attitude ? –, je n’ai pas compris. Quelle que soit l’origine du problème, la sanction est disproportionnée. Les délateurs sont cachés, et la punition laisse penser que les forfaits sont graves, qu’on ne peut pas les dire. » Et de dénoncer, lui aussi, ce « tu ne sais pas tout… », qui revient sans cesse comme un leitmotiv imparable et ouvre des abîmes de non-dits. Comme Lorella Bertani, Olivier Gurtner est socialiste. Conseiller municipal, il a même été récemment le candidat malheureux au poste de délégué à la culture tenu par une autre socialiste. Directeur du service communication de la Comédie de Genève, il en est parti il y a moins d’un an. On dit qu’il a été licencié par la direction, mais, officiellement, il a démissionné, les deux parties prenantes restant silencieuses sur le sujet. Lui aussi a donné rendez-vous dans un café, puis finalement dans un lieu « encore plus discret », la Société de lecture, une sorte de bibliothèque où nous nous retrouvons dans un salon vide, entouré de rangées de livres aux reliures passées qui donnent à l’entretien un caractère solennel. Olivier Gurtner a posé sa montre sur la table, maître des horloges… Mais d’entretien, il n’y aura pas. Du moins officiellement. L’on repartira ainsi, tel un coffre de banque, dépositaire de tous ces mots secrets qu’il nous a livrés, et qu’il nous est impossible d’écrire puisque tout est off. Mais alors pourquoi nous parler, se demande-t-on ? Quel est cet off qui permettrait à un journaliste peu consciencieux d’écrire en son nom propre des propos improuvables ? « La première erreur que j’ai faite, analyse Séverine Chavrier, c’est de croire que le concours qui m’a permis d’obtenir le poste me donnait une légitimité, alors que ce qui compte, c’est d’avoir des appuis politiques. » Fin décembre 2025, elle a pris pour avocat Romain Jordan, une figure du barreau genevois, qui défend aujourd’hui les victimes de l’incendie de Crans-Montana, survenu le 1er janvier. Elle organise la contre-attaque, à commencer par une procédure au pénal. Et veut croire que rien n’est joué. Ni son éviction temporaire ni même la décision de son renouvellement par la Fondation. « Il n’y a aucune raison que je renonce. Les salles sont pleines. Le public est là. Quatre-vingts pour cent des spectacles sont suisses. Tout ce qu’on me reproche est faux. On m’a dit : “Tu as fait des erreurs de management. Fais du team building.” » Elle se marre. « Normalement, c’est le théâtre, le team building. » Laurent Carpentier (Genève [Suisse], envoyé spécial du Monde) Illustration SÉVERIN MILLET

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 27, 6:01 AM
|
Par Gilles Renault dans Libération le 26 janvier 2026 L’ancien géographe orchestre un pastiche de présentation-débat chaotique autour d’un authentique projet industriel contesté.
Mine de rien, on saura gré à Frédéric Ferrer d’avoir à lui seul anticipé deux tendances. L’une portant sur la forme, et l’autre, sur le fond, combinées dans des propositions artistiques d’où l’on ressort en général repu : d’une part, avec ses casquettes superposées d’auteur, d’interprète et de metteur en scène, celle d’avoir contribué, avec maestria, à propager la mode (assez durable, au demeurant) des vraies-fausses conférences, en abordant des thèmes a priori sérieux – voire, parfois, saugrenus ou rébarbatifs –, lestement traités sur un ton documenté et drolatique. D’autre part, celle de ne pas avoir attendu non plus la sonnerie du clairon pour, en écho à l’agrégé de géographie qu’il est également, sensibiliser le public aux affres environnementales, comme l’invasion du moustique-tigre ou l’ours polaire errant sur son bout de banquise, faisant, en l’espèce (menacée), l’objet de digressions plus volontiers cocasses que frontalement catastrophistes. Slogans captieux Et si cet article s’est ouvert sur le mot «mine», cela ne relève pas du hasard puisque, succédant à plusieurs morceaux de bravoure, parmi lesquels A la recherche des canards perdus, les Déterritorialisations du vecteur ou le Problème lapin, le docte Ferrer détricote dorénavant, avec Comment Nicole a tout pété, un projet très polémique, visant à extraire du lithium (destiné aux batteries de voitures électriques), dans une bourgade de l’Allier. Ainsi, si la petite localité d’Echassières existe-t-elle réellement, celle-ci est rebaptisée «Echapières», le temps d’échanges particulièrement vifs, censés peser le pour et le contre, dans le cadre d’un «grand débat» promu comme «outil clé de la démocratie participative». Pupitres, permettant d’asseoir la tournure sérieuse des échanges, grand écran, sur lequel vont défiler photos et graphiques, micro baladeur pour permettre à la parole de circuler librement, sur scène, mais aussi dans la salle : le cadre et le protocole paraissent respectés. Mais, comme de coutume, Frédéric Ferrer, c’est partir d’un socle solide pour mieux faire imploser un exposé – hélas, trop long – où, entre embardées vers l’absurde, arguties opaques et autres formules ou slogans captieux, les promesses de clarifications s’enfoncent méthodiquement dans le brouillard d’intérêts divergents. Des industriels au mercantilisme, peu compatible avec les scrupules, aux élus locaux dépassés (voire absents), via des collectifs ou des citoyens soucieux de protéger le triton à crête, ou juste leur lopin de terre, une cacophonie retentissante finit ainsi par prévaloir. Celle-ci étant orchestrée par une demi-douzaine de comédiens familiers du système Ferrer (qu’on voit plus souvent en solo), qui s’en donnent à cœur joie, à mesure que l’on déchante en dressant l’inventaire des «bonnes intentions» ainsi sabotées. Comment Nicole a tout pété, de Frédéric Ferrer, théâtre du Rond-Point (75008) jusqu’au 7 février, et en tournée (Vandœuvre-lès-Nancy, Villeneuve d’Ascq, Maubeuge…). Gilles Renault / Libération Légende photo : Le docte Ferrer détricote un projet très polémique visant à extraire du lithium dans une bourgade de l’Allier. (Vincent Beaume)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 27, 5:40 AM
|
Par Copélia Mainardi dans Libération - Publié le 25 janvier 2026
Etre cernée par des rayons abritant des centaines de livres peut angoisser ou apaiser, c’est selon. Penda Diouf appartient à la seconde catégorie. C’est à l’Espace ressource d’Artcena (Centre national des arts du cirque) que nous la rencontrons ; et ces «ressources» textuelles, la dramaturge francosénégalaise y puise depuis toujours. Penda Diouf a passé une partie de son enfance à dévorer la collection Bibliothèque rose ou verte dans un coin de médiathèque des environs de Dijon, où elle est née il y a quarante-cinq ans. Ces espaces ne l’ont jamais quittée : elle a été bibliothécaire, et dirigeait jusqu’à quatre médiathèques avant de choisir de se consacrer entièrement à l’écriture il y a six ans.
L’enfant solitaire qu’elle était a toujours écrit : de la «poésie romantique» à l’adolescence, puis «quelque chose de plus oral, qui [lui] semblait s’approcher du théâtre». Penda Diouf n’a alors jamais vu de pièce : les textes de Molière et Racine, dont elle tente de reproduire la structure, l’aident à mieux comprendre le genre. La jeune femme s’oriente vers des études en lettres modernes et arts du spectacle, et complète cette formation théorique par une fréquentation assidue des salles – elle est ouvreuse, travaille à la billetterie de La Commune, répond au standard téléphonique de la MC93. Sans jamais cesser d’écrire.
Aujourd’hui, elle compte plus de vingt textes à son actif, dont la moitié a été portée au plateau. Mis en scène par Lucie Berelowitsch et en tournée cette saison, Sorcières (titre provisoire) est le fruit d’un travail sur les croyances et les superstitions dans le bocage normand, où elle a rencontré médiums, coupeurs de feu et rebouteux en tout genre, qui «tissent une forme de lien social palliant des institutions défaillantes et des services publics qui ne jouent plus leur rôle». L’expérience lui a appris l’importance d’autres circulations de paroles, dites ou cachées. Même si elle le concède : «Il n’est pas aisé de représenter l’invisible au théâtre, qui est d’abord l’art du spectaculaire.» Très présent dans son travail, ce lien à l’invisible lui vient aussi de ses cultures – sénégalaise par son père, ivoirienne par sa mère. «J’aime cet autre rapport aux ancêtres, aux énergies et aux éléments – arbres, rivières et rochers existent différemment là-bas». Penda Diouf a grandi dans une maison où l’on parle wolof et mange du tiep : elle vient d’ailleurs d’acheter une maison au Sénégal, où elle se rend plusieurs fois par an, et en a demandé la nationalité il y a dix ans.
«Equilibre nécessaire»
C’est pour répondre à «la frustration, la colère et l’impuissance» – qu’elles viennent de sa trajectoire personnelle ou de la marche du monde – qu’elle écrit. Avec un objectif : la «rencontre du politique et de la fiction» pour créer un «espace de dialogue commun». Des figures l’y ont aidée : Toni Morrison (Beloved est son livre de chevet), Marie Ndiaye, la dramaturge Debbie Tucker Green, ou Chimamanda Ngozi Adichie, «qui a su croquer très justement quelque chose de l’époque pré-Black Lives Matter».
Conçoit-elle ses textes comme des objets autonomes, ou avant tout voués à être joués ? «C’est un peu des deux». Elle milite pour que les textes de théâtre soient édités, qui apporte une reconnaissance du travail littéraire et offre une vie plus longue que le temps éphémère du plateau. Sans pour autant le nier : l’absence d’incarnation laisse forcément un goût d’inachevé. Surtout, Penda Diouf aime se dire qu’une équipe donnera vie à ses personnages : cette appartenance à un collectif compense la solitude de l’écriture, façonne un «équilibre nécessaire». 2025 a marqué son passage à la mise en scène. Pistes… répond initialement à une commande de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) qui portait sur le thème du courage.
«Mais quand m’étais-je déjà sentie courageuse ?» Pour écrire son monologue, Penda Diouf repense alors à un voyage en Namibie, entrepris après une sérieuse dépression. «Je sentais le besoin de me réparer dans un endroit à la fois proche et lointain, sans attaches personnelles, mais où le regard posé sur moi ne détonnerait pas.» En sillonnant l’immensité des espaces désertiques de ce pays , elle l’entend régulièrement : «You’re a brave woman». Elle découvre aussi l’histoire du génocide des Héréros par l’Empire allemand et en fait la pierre angulaire de son spectacle.
France, Allemagne, Québec, «Pistes…» a connu plusieurs mises en scène qui l’autorisent à apposer à son tour sa pierre à l’édifice. «La dimension autobiographique a aussi contribué à l’envie d’apporter mon regard sur cette histoire», reconnaît-elle. David Bobée et l’équipe du Théâtre du Nord, où elle est aujourd’hui artiste associée, lui apportent un soutien précieux. Et l’expérience lui confère une légitimité bienvenue, qui la pousse à réitérer : deux nouvelles mises en scène sont en cours de création, dont l’une prévoit pour la première fois un texte chorégraphique porté par des danseurs.
«Individualisme ambiant»
Calme et solaire, Penda Diouf semble aujourd’hui profondément à sa place. Sa vie de nomade comporte des sacrifices – à peine deux jours par mois à Lille, où elle réside depuis cinq ans – mais elle se sent épaulée et de plus en plus libre de ses choix. Il y a dix ans, elle a fondé avec le metteur en scène Anthony Thibault le label Jeunes Textes en liberté, un incubateur qui cherche à visibiliser des auteurs contemporains plutôt issus de groupes minoritaires. Surtout, sa capacité de production (jusqu’à huit textes écrits uniquement l’an dernier !) la rassure. Fruit de cet appétit, un premier roman – sur l’histoire du compositeur afro-américain Julius Eastman, pionnier de la musique minimaliste – devrait paraître prochainement.
Sa confiance en les pouvoirs du collectif ne l’empêche pas de déplorer le climat politique délétère et les coups de butoir assénés à une profession toujours plus précarisée. Elle le sait : «Il va falloir beaucoup de ressources pour lutter contre l’individualisme ambiant.» Rappelle qu’en décembre, le Sénat a rejeté une proposition de loi comportant notamment un revenu de remplacement aux artistes-auteurs. Et soupire : «Ils ont raté le coche.»
Copélia Mainardi / Libération
Sorcières, du 3 au 7 février à la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine (94) ; le 5 mai à l’atelier Renaissance à Maubeuge (59).
Pistes, le 6 février au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France) ; 3 et 4 mars au CDN d’Orléans ; du 31 mars au 2 avril au Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) ; le 28 avril au Bateau Feu (Dunkerque)
Légende photo : Penda Diouf dans «Pistes». (Frederic Iovino)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 7:58 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 23 janvier 2026 La ministre Rachida Dati veut transformer la plateforme, destinée à l’origine à financer des activités culturelles pour les jeunes, en une ressource répertoriant les offres culturelles proches de chez soi – mais sans aide financière.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/23/le-pass-culture-ne-sera-plus-seulement-une-affaire-de-jeunes_6663791_3246.html « Le Pass culture pour tous » : la formule claque. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce slogan marketing lancé par Rachida Dati, jeudi 15 janvier, lors de son déplacement à Saint-Dié-des-Vosges ? En annonçant la « généralisation » du Pass culture, conçu depuis 2021 pour financer des activités culturelles pour les jeunes de 18 ans, la ministre de la culture utilise une expression abusive. En réalité, il s’agit d’inviter tout le monde à télécharger cette application numérique pour connaître les événements culturels proches de chez soi. Cette initiative a le mérite de ne pas coûter cher puisqu’elle ne s’accompagne d’aucun financement supplémentaire. Il n’est évidemment pas question d’offrir un crédit pour financer des sorties culturelles à toute la population mais simplement d’inciter chacun à utiliser cet outil pour géolocaliser les activités de proximité. Alors que le budget du Pass culture a été revu à la baisse (127 millions en 2026 contre 170 millions en 2025) et le montant de la part individuelle versée aux jeunes largement diminuée (150 euros, au lieu de 300, à 18 ans), ce dispositif phare de la politique culturelle voulue par Emmanuel Macron joue sa survie. Expérimenté depuis novembre 2024 dans la région Grand-Est, ce « Pass culture pour tous » sera « généralisé progressivement à tout le territoire durant l’année 2026 », explique au Monde Laurence Tison-Vuillaume, présidente du Pass culture, désormais opérateur culturel de l’Etat et non plus seulement société par actions simplifiée. « Nous offrons un nouveau service visant à permettre à tout le public, quel que soit son âge, d’accéder à l’offre culturelle près de chez lui. Le besoin est particulièrement important dans les territoires ruraux où les habitants sont en attente d’une plus grande visibilité des offres culturelles de proximité », insiste-t-elle. Dans le Grand-Est, 264 acteurs culturels supplémentaires se sont inscrits sur le dispositif à la suite de l’expérimentation (parmi lesquels le Carnaval de la forêt, la forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle, l’espace culturel George-Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges, etc.), portant leur nombre total à 3 500. « Pour recenser une offre variée et fine, englobant les fêtes locales, les salles communales, les fanfares, etc., nous avons noué des relations étroites avec les collectivités locales et les offices du tourisme », explique la présidente. La future généralisation vise donc à élargir les propositions sur une application qui regroupe déjà 46 000 acteurs culturels. Campagne de communication nationale « L’ouverture à tous est un axe stratégique nouveau pour le Pass, veut croire Laurence Tison-Vuillaume. On ne s’adresse plus qu’aux jeunes mais à tous les Français. Les acteurs culturels vont désormais pouvoir proposer des offres tout public ou familiales. » Cette idée avait été émise dès la création du Pass culture notamment par Françoise Nyssen. En 2019, l’ancienne ministre de la culture expliquait : « A terme, le Pass pourrait être un outil utilisé par tous les Français, sans argent à la clé. Ce serait alors comme un Pariscope ou un Allociné pour la culture en France. » Encore faut-il que la population s’empare de cet outil d’information pour que l’opération fonctionne. Une campagne de communication nationale est prévue courant 2026. En attendant, un arrêté en date du 3 décembre 2025 modifie les règles de fonctionnement de la part individuelle du Pass. Outre la diminution de son montant, la liste des domaines d’activités proposés a été mise à jour : aux musées, centres d’art, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, musique, instruments de musique, livres, presse, jeux vidéo et matériels d’arts créatifs viennent s’ajouter le design et les métiers d’art ainsi que la culture scientifique, technique et industrielle. En revanche, les jeux d’évasion et les activités de loisirs « ne relevant pas de dispositifs proposés par des acteurs culturels d’un des domaines éligibles » en sont exclus. En 2024, un rapport de la Cour des comptes pointait que 16 millions d’euros avaient été « indûment dépensés » pour financer des séances d’escape game grâce au Pass culture. De plus, les bénéficiaires du Pass ne pourront dépenser que 50 euros dans des offres numériques, contre 100 euros auparavant. Le bonus de 50 euros promis aux jeunes ayant des faibles conditions de ressources ou étant en situation de handicap devrait être « effectif dans les semaines qui viennent, promet-on dans l’entourage de la ministre, avec un effet rétroactif au 1er mars 2025 ». Quel sera le niveau du quotient familial retenu pour obtenir ce bonus et combien de jeunes seront concernés ? Pour l’heure, mystère. Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : Des clientes achètent des livres avec le Pass culture au Furet du Nord, à Lille, en 2023. PHILIPPE PAUCHET/« VOIX DU NORD »/MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 10:16 AM
|
Par Julia Wahl dans cult.news, publié le 14.01.2026 Victor de Oliveira poursuit l’exploration intime de l’exil amorcée dans Limbo. Victor de Oliveira poursuit l’exploration intime de l’exil amorcée dans Limbo. Un plateau faussement nu Un sol couvert de sable, une toile de fond métallique et, en léger retrait, Victor de Oliveira. Une scénographie qui joue la simplicité et le théâtre pauvre cher à Grotowski. Pourtant, cette scène nue n’est pas vide. Tout d’abord, parce que les lumières de Diane Guérin plongent la cage de scène tout entière dans un espace à part, frappé d’irréalité, où tout paraît possible. Ensuite parce que le corps de l’acteur et metteur scène est celle d’une puissante présence. Nul besoin de jouer la force : ce corps, seul, parle. Que nous dit-il ? La lenteur des mouvements est soutenue par une élocution qui prend elle aussi son temps, laissant les syllabes sortir avec douceur des lèvres du locuteur. Pourtant, ce qu’il nous expose est d’une grande violence : l’exil forcé et soudain d’un petit garçon, vu à hauteur d’enfant, la blessure jamais cicatrisée de cette fuite brutale et la terreur ordinaire des corps noyés de celles et ceux contraint·es de quitter leur pays. La création d’une nouvelle mythologie Ce texte à la première personne est bien plus qu’un énième récit autobiographique, où Victor de Oliveira se contenterait de raconter son départ du Mozambique pour le Portugal. S’il commence par la narration de son propre exode, Victor de Oliveira a à cœur de donner à celui-ci une dimension universelle, sinon mythique. À son voyage en avion répondent les « points noirs au milieu de l’océan profond » des migrant·es moins chanceux·ses que lui, cet océan qui réunit en une même eau les naufragé·es issu·es de l’Afrique ou des Caraïbes. Cette recherche d’une histoire universelle traverse le texte tout entier, qui entrelace avec bonheur des vers de Kamau Brathwaite ou Virgile, mais aussi de Pessoa ou des Lusiades de Luis de Camões, ce long poème épique inspiré de L’Énéide, vantant les conquistadores portugais et que les écolier·es portugais·es apprenaient encore, sous Salazar, par cœur. En leur prêtant sa voix, le metteur en scène interroge cette généalogie de héros aux conquêtes toujours plus sanglantes et appelle à créer de nouveaux mythes, où Ascagne, plus qu’Énée, serait le véritable protagoniste. Une intense communion Ces poèmes sont prononcés par Victor de Oliveira en langue originale avant que de se voir traduits par la grâce des surtitrages. À charge pour le public de faire le choix de se laisser bercer ou heurter par ses sonorités étranges ou de préférer le confort de la traduction française. Mais, comme chacun·e sait, traduttore, traditore : ce qui vaut est peut-être moins ici le sens des mots que la présence même de ces langues, qui fait du plateau un territoire cosmopolite où les poètes de tous les pays s’unissent. Le recours aux mots des autres crée un trouble sur l’identité du locuteur : est-ce Victor de Oliveira ou Virgile qui nous parle ? Ces auteurs de lieux et d’époques diverses communiquent entre eux autant qu’ils communient, conviés par leurs vers à une cérémonie réparatrice. La litanie, au cœur de l’écriture de Kumina, ainsi que les musiques et chants en légère sourdine, transforment la soirée en un rite sacré, qui rend un instant présents les corps des peuples décimés par les aventures des héros occidentaux. Kumina joue de magnifiques paradoxes : un plateau faussement nu, une diction douce pour dire la violence des conquêtes, une solitude qui fait surgir de multiples doubles. Elle crée surtout un moment d’une grande intensité, où le public, suspendu aux lèvres et aux – très légers – gestes de l’acteur se laisse emporter par les voix, nombreuses, des poètes comme de celles et ceux qui se sont définitivement tu·es, victimes de la mer ou des colons. Julia Wahl / cult.news

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 14, 10:10 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 14 janvier 2026 L’auteur et metteur en scène, installé à Sète, cultive les illusions dans son spectacle «Paradoxe», à l’affiche au Théâtre de Gennevilliers. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/01/14/guillaume-vincent-et-son-theatre-des-faux-semblants_6662175_3246.html
La merveilleuse certitude, avec l’auteur et metteur en scène Guillaume Vincent, c’est qu’on n’est jamais sûr de rien. Ni de la forme ni du sujet de ses spectacles. En 2023 et en 2024, il présentait deux pièces de groupe sur l’envol de la jeunesse, Vertige (2001-2021) et La Tour de Constance. Le voici au Théâtre de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) avec une représentation (en duo) subtile et malicieuse consacrée au deuil : créé au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, à l’automne 2025, Paradoxe raconte le retour d’un fils auprès de sa mère mourante dans le Sud. Une histoire vécue ? Pas du tout. Le pas de deux entre fiction et vérité est la prérogative de l’artiste. Alors qu’il vient de fêter ses 49 ans, mercredi 14 janvier, il n’a pas l’intention de s’en priver. « Ma mère va très bien. Elle a eu 80 ans le 1er janvier, précise-t-il. J’ai beau m’amuser à glisser une part de moi dans mes spectacles, les insertions biographiques restent pudiques et très cryptées. » Inutile donc de chercher un message subliminal dans la grille de mots croisés (du Monde) qu’il achève alors qu’on le retrouve dans un café. Ligne III horizontale : « Gravée dans le marbre. » Si la définition lui échappe, c’est que Guillaume Vincent n’écrit pas d’épitaphe. Son théâtre est une célébration parfois mélancolique mais toujours ardente du vivant. A commencer par la vibration des interprètes, leur puissance, leur présence et la fascination que certains exercent sur lui. Il les cite : Emilie Incerti Formentini, héroïne, en 2012, du monologue Rendez-vous gare de l’Est ; Alison Dechamps, révélation, en 2024, de La Tour de Constance : « J’ai fait ces spectacles pour elles. » Richesse imaginative Paradoxe n’existerait ainsi pas sans l’actrice Florence Janas, co-conceptrice du projet avec qui il partage les planches, lui qui n’est pas vraiment comédien. « Cette fois, je ne voyais pas qui d’autre que moi pouvait endosser mon propre rôle. Je l’ai aussi fait grâce à Florence en qui j’ai une confiance totale. Elle me rattrape si je vacille. » De son double gémellaire (ils échangent sur scène leurs identités, leurs récits, leurs genres et leurs moustaches), il dit qu’elle est « un roc d’une exigence folle qui n’autorise jamais le laisser-aller ». Ils se connaissent depuis leurs 18 ans et leur rencontre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Ils y ont fait la fac ensemble, mangé des crêpes au Nutella sur le cours Mirabeau, pris tous deux le train pour le Nord. Elle vers le Conservatoire national supérieur d’art dramatique à Paris. Lui vers l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg. « J’ai adoré y étudier. J’avais redoublé mon CM2 et ma 2de parce que j’étais dysorthographique, je me retrouvais avec des gens qui fréquentaient des normaliens ou sortaient eux-mêmes de Normale-Sup. C’était bizarre, je me sentais décalé. Mais cette gêne n’a pas duré. » Même s’il a grandi dans un mas, à Uzès (Gard), au milieu des champs et au cœur d’une famille où on est agriculteur de père en fils depuis trois générations, Guillaume Vincent n’a pas le complexe du transfuge de classe. Sans doute grâce à sa grand-mère paternelle qui, chaque été, l’amenait au Festival d’Avignon. Sans doute aussi à son arrière-grand-père, « un héritier marseillais propriétaire d’un château ». Le château est toujours là. Invendu car invendable. La richesse de l’arrière-petit-fils n’est pas matérielle mais imaginative. Elle est forte des chocs esthétiques vécus dans la Cour d’honneur d’Avignon, de la découverte, dans le « off », des textes de Fassbinder ou de Beckett, du souvenir du Footsbarn Theatre, une troupe circassienne qui a planté sa tente dans le jardin de son enfance. Un authentique poète Le nomadisme des saltimbanques ne le fait pourtant pas rêver. Le déclic vient plutôt de l’illusion théâtrale. Et d’un principe actif dans l’œuvre de Marivaux (dont il a monté, en 2005, La Fausse Suivante) : « Faire semblant de faire semblant. » Il n’est encore qu’un collégien, mais cet apprentissage lui « retourne le cerveau ». Il deviendra metteur en scène. Pour faire semblant de faire semblant et entraîner à sa suite le public dans des tourbillons mouvementés où le vrai et le faux, le passé et le présent, soi et l’autre s’entremêlent. Il ne se sent pas vraiment auteur (« Je fais du collage »), mais il est bel et bien devenu un authentique poète qui cherche la beauté dans la banalité et l’universalité dans l’anecdote. Comme bien des poètes, il se protège. Il ne postule à aucune direction de lieu : « Gérer des tâches administratives n’est vraiment pas mon truc. » Il a, voici deux ans, quitté Paris pour s’installer à Sète (Hérault) : « J’y connais peu de monde. Ce qui est bien car, étant un peu dépressif, j’ai besoin de plages de solitude. » Enfin, il refuse de livrer des spectacles vite et mal faits. « Je préfère présenter des maquettes de trente minutes et ne les transformer en véritables représentations que lorsque je suis sûr qu’elles tiendront leurs promesses. » Faire ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut, ce luxe est rare et périssable. Il le sait. Mais il dispose d’une arme magique : même invendable, un château familial est un coffre-fort symbolique. Or les symboles, les métaphores et les fantasmes inventés de toutes pièces sont les citadelles de Guillaume Vincent. Paradoxe, écriture, conception et jeu : Florence Janas et Guillaume Vincent. Théâtre de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), du 15 au 26 janvier. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Guillaume Vincent, au Musée de l’illusion, à Paris, le 13 mai 2020. DAMIEN MAESTRAGGI
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...