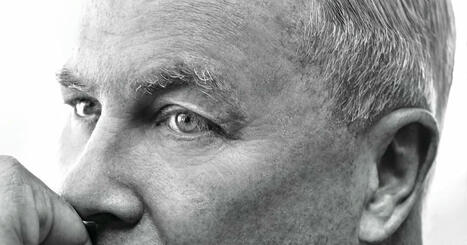Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre
Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://x.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'entonnoir (Filtres) et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 9, 9:05 AM
|
Le metteur en scène revient sur ses années de formation et explique sa démarche, soit trouver de nouveaux sens de lecture en confrontant texte et image, musique et mise en scène. A l’occasion de sa mort, le 31 juillet 2025, nous republions l’entretien qu’il nous avait accordé en 2013. Au Louvre, dont il est le grand invité jusqu’au 17 février, Bob Wilson a installé dans une salle une partie de la collection qu’il a rassemblée à Water Mill, le lieu où il vit et travaille une partie de l’année, sur Long Island, près de New York. Les objets les plus divers s’y côtoient et s’y télescopent, dans un chaos soigneusement organisé qui a pour but d’aiguiser les regards. Autre exemple d’associations inattendues, les vidéoportraits réalisés avec Lady Gaga. Trois toiles célèbres «reconstituées» en tableaux vivants où la chanteuse interprète la Mort de Marat de David, la Tête de saint Jean-Baptiste de Solari et Mademoiselle Caroline Rivière d’Ingres. «J’espère que ces portraits serviront à donner une autre image d’elle», dit Wilson qui insiste sur son «étonnante capacité à se transformer et à rester concentrée des heures durant. Dans sa robe empire, elle reste incroyablement vivante. Kleist disait qu’une bonne actrice est comme un ours, elle attend que ce soit vous qui bougiez en premier». Il y a de l’ours aussi dans la haute silhouette de Bob Wilson. Et une puissance de concentration hors du commun. Acceptant l’invitation de Libération, il ne s’est pas contenté de redessiner les têtières et les lettrines de toutes les pages, mais a voulu bousculer les habitudes de lecture, en cherchant de nouvelles connexions entre photos et textes. Quelques jours avant de venir à Libération, il nous avait fait visiter son expo au Louvre, en imaginant déjà comment il pourrait intervenir dans le journal. «Dans ce musée, tout ce qui est semblable est mis ensemble. Pas dans cette salle. Vous pouvez trouver un masque de Borneo du XIXe siècle et la tête de Mickey Mouse. Tous les deux sont rouges avec de grandes oreilles. Ici, le semblable et le dissemblable sont mis ensemble. Des restes de têtes africaines, Dietrich en train de fumer une cigarette et une céramique du XVIIIe siècle. Si je mets un ordinateur sur une commode baroque, je vois mieux l’un et l’autre. «Le but, c’est de trouver le bon contrepoids. D’instaurer des règles pour mieux les briser. Au Louvre, aucune règle n’est brisée. Quand j’ai commencé mes études d’architecte à New York, j’ai eu pour prof Sibyl Moholy-Nagy, qui enseignait l’histoire de l’architecture. C’était un cours sur cinq ans. J’arrivais du Texas, je ne connaissais rien de rien, je n’avais jamais été dans un musée, dans une galerie, et je suis rentré dans la salle de cours, qui était plutôt sombre. Elle était vêtue d’une robe noire, stricte. Derrière elle, il y avait trois écrans noirs, et des images projetées sur les trois écrans : une mosaïque byzantine, une peinture de la Renaissance, une chaise de Frank Lloyd Wright… Et son cours n’avait rien à voir avec ce que nous voyions. Tous les deux mois, il y avait une seule image sur les trois écrans : un dessin de Rome par Le Piranèse. Et cela a duré comme cela pendant cinq ans. Et puis un jour, au milieu d’un cours, elle a dit : vous avez trois minutes pour dessiner une ville. Prêts ? Partez ! Retournez vos feuilles. Il fallait que l’on pense vite. Et grand. Et pas à une seule chose à la fois, ça c’est trop compliqué. «Cela m’amène au souvenir de ma première rencontre avec Marlene Dietrich en 1971. Je l’avais invitée à dîner et elle m’avait dit : «Avec plaisir.» Et puis un type est arrivé à notre table et lui a dit : «Mais pourquoi êtes-vous si froide quand vous jouez ? «Et elle de répondre : «Mais vous n’avez pas entendu ma voix !» Elle m’a expliqué que la difficulté, c’était de placer sa voix en fonction de son expression. Ses mouvements pouvaient être glaçants, mais sa voix était très chaude et sensuelle. «Le contrepoint, c’est toute la difficulté. Prendre un article sur un sujet et une image en décalage pour l’accompagner… C’est ce que j’essaye de faire au théâtre. La plupart des gens prennent un texte, puis l’illustrent. Moi je pars des images et je travaille dessus. Puis je prends le texte séparément. Et enfin j’assemble les deux. C’est comme mixer un film muet avec un feuilleton radiophonique. Cela vous permet de trouver des connexions bizarres, et parfois il n’y a pas de connexions. Comment ce que je peux voir peut m’aider à mieux entendre ? C’est ça, le défi. Au Metropolitan à New York pour le Lohengrin de Wagner, j’avais cent cinquante choristes en marche contre la musique. La musique de Wagner, elle fonce, elle n’arrête pas de foncer, et le chœur, lui, bougeait tout doucement. Quand je vois ça, j’entends mieux la musique. «Peut-on lire quelque chose dans un journal et voir quelque chose d’autre ? Cela peut faire surgir un autre sens, une autre compréhension de ce qu’on lit et de ce qu’on voit. C’est cela que je voudrais essayer.»

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 6, 3:54 PM
|
Par Anne Diatkine, envoyée spéciale à Epidaure pour Libération - 3 août 2025 Dans le cadre magique du théâtre antique, la création chorale du metteur en scène libano-canadien a entraîné, vendredi 1er et samedi 2 août, les spectateurs dans une tragédie cathartique qui résonne autant avec nos histoires intimes qu’avec les catastrophes contemporaines. Ils sont venus pour la plupart en bus ou en voiture d’Athènes, deux heures et demie de route, et ils repartiront de même après le spectacle, à minuit. Ils grimpent prestement les hautes marches sur le sentier jusqu’au théâtre antique d’Epidaure, pour la première mondiale du Serment d’Europe, la dernière création de Wajdi Mouawad commandée pour les 70 ans du festival Epidaure-Athènes par sa directrice Katerina Evangelatos. Une foule joyeuse s’installe, avec coussins et pliants pour les plus prévoyants, et regarder les gradins de pierre se remplir pendant que la nuit tombe fait déjà partie de la représentation si particulière. Il y aura une seconde fois. Puis peut-être une tournée. Il est encore trop tôt pour l’affirmer et du reste, du metteur en scène aux stagiaires, chacun est concentré sur l’instant présent. Les derniers portables s’éteignent un à un et rallument le ciel étoilé. Une troupe ? Sans aucun doute. Formée par un acteur et cinq comédiennes d’exception et une petite fille de 8 ans, visiblement ravie d’être là, la plus star d’entre elles au moment des saluts qu’elle s’amuse à multiplier alors que ses aînés, déjà, s’éclipsent dans la nature. Cinq actrices, Violette Chauveau, Leora Rivlin, Daria Pisareva, Danai Epithymiadi et bien sûr Juliette Binoche, dont c’est le grand retour au théâtre depuis Antigone de Sophocle qu’avait monté Ivo van Hove il y a dix ans, et qui tout au long de la pièce rayonne d’une lumière noire et ombrageuse. Celle de la maternité blessée, celle de l’enfant abandonné, qui n’a pas renoncé à croire en l’amour de sa mère, Europe. Laquelle lui lancera qu’elle l’a laissée au bord de la route faute d’avoir le courage de la tuer. Attention danger : la pièce est chorale, et ce qui participe de la réussite de ce Serment d’Europe est la manière dont aucune des actrices ni même la star française internationale ne tire la couverture à elle. Chœur : elles en forment un assurément, et l’un des plus beaux moments de cette création en trois langues et des poussières tient à leur manière de ne former plus qu’un seul corps comme un puzzle à cinq morceaux qu’on découvre à l’arrière-fond du plateau. Trivialité du quotidien Le Serment d’Europe est aussi une pièce sans père, sans Zeus, mais avec un seul et fantastique acteur canadien, Emmanuel Schwartz, Zachary, petit criminel qui ne se voit pas tuer sa compagne, Wanina, quand elle lui annonce qu’elle s’en va. Long monologue final où l’acteur quitte le plateau pour s’avancer sur la terre meuble, debout, au plus près des premiers rangs : «Qui mieux que le meurtrier pour témoigner du meurtre de la victime, et qui mieux que les peuples génocidaires pour raconter l’histoire des génocidés ? Comment rendre possible la réparation pour ceux qui ont été massacrés sans le récit de leurs morts par ceux qui ont été massacrés ?» Questions qui percutent l’actualité la plus tragique et immédiate. C’est la moindre des politesses de cette pièce que de ne jamais nommer précisément et de laisser à chaque spectatrice, spectateur la liberté de songer à tel massacre, telle «apocalypse», ou à tel chanteur, auteur de féminicide. On se dit qu’il n’a pas dû être facile d’offrir une parole à Zacharie, long texte qui n’est en rien une plaidoirie pro domo. Mais alors que dire ? Zacharie-Emmanuel Schwartz, toujours : «Je peux consacrer ma vie à réapprendre à avaler ma salive pour retrouver le souffle et la parole. Mais la parole du bourreau comme signe de son humanité, est-elle seulement possible ?» Comment souvent dans les pièces de Wajdi Mouawad, chaque personnage porte un conglomérat d’histoires qui lui échappent, travaillent en lui et forgent une destinée. Comme souvent, il y a la trivialité du quotidien - un talon qui casse dans une grille, et pas n’importe quel talon ni n’importe quel quotidien puisque les semelles sont rouges. Un talon Louboutin donc, comme le talon d’Achille d’une enquêtrice des Nations unies en Suisse (Daria Pisareva, d’une intense drôlerie). Comme souvent chez Wajdi Mouawad, il y a la description précise et horrible de massacres – en l’occurrence dit en anglais – et une colère exprimée par les jurons les plus grossiers. Mais plus que toute autre, cette pièce, qui ne s’appelle pas Mère, charrie le fleuve de la maternité sans être pour autant une promenade de santé. S’échapper du filet de la malédiction Lui, Zacharie, est né d’une femme comme tout le monde. Cette femme, Weedia, Juliette Binoche, professeure d’anglais au lycée Marie-Curie, bien décidée à ne pas «lâcher» son fils, c’est-à-dire à le convaincre de dire la vérité sur le féminicide commis il y a sept ans, a été abandonnée à la naissance. Mais comment, par qui ? C’est l’un des plus beaux monologues de cette pièce fragmentée, conçue par blocs qui se frottent à la manière où deux silex font du feu. Il faut la stature de Binoche pour faire entendre, de la bouche de celle qui a été abandonnée, l’amour dans le geste de l’abandon qui suppose de longuement, à l’aurore, en février, porter et réchauffer son bébé pendant une longue marche avant de le déposer au bord d’un fleuve. Sortir de la tragédie, s’échapper du filet de la malédiction, et «oser l’effraction» pour reprendre l’un des termes de l’introduction aux leçons de Wajdi Mouawad cet hiver au Collège de France (1), c’est bien ce que font les six protagonistes de cette pièce dont les pierres tiennent sans ciment. La foule des spectateurs repart lentement du sanctuaire archéologique édifié pour Asclépios, le dieu de la médecine, dont le nom même ravive à la mémoire que l’expérience cathartique était d’abord guérisseuse. A la dernière minute, les places les plus hautes, à cinq euros, se sont arrachées. Ils seront encore plus nombreux le lendemain, près de 6 000, public en grande partie grec qui se souvient que leur pays a inventé la tragédie. Mystère acoustique de ce théâtre édifié quatre siècles avant notre ère et qui permet qu’on entende parfaitement ce qui se passe sur scène, même au dernier rang. (1) Wajdi Mouawad, Jusqu’au bord de son ravin, les verbes de l’écriture, éditions du Seuil, parution le 12 septembre. Le Serment d’Europe de Wajdi Mouawad s’est donné à Epidaure les vendredi 1er et samedi 2 août. Tournée en cours d’élaboration. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Ce qui participe de la réussite de ce «Serment d’Europe» est la manière dont aucune des actrices ni même la star française internationale Juliette Binoche ne tire la couverture à elle. (© Patroklos Skafidas/Theofilos Tsimas)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 5, 10:32 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - Publié le 01 août 2025
RÉCIT « Le théâtre avance masqué » (5/6). « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, l’objet au cœur de plusieurs des spectacles d’Ariane Mnouchkine.
Lire l'article sur le site du "Monde":
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/08/01/le-masque-au-theatre-du-soleil-ou-l-oracle-de-l-ame_6625900_3451060.html
Ne serait-ce pas Vladimir Ilitch Lénine ? Mais oui, bien sûr. On le reconnaît immédiatement, de même que Trotski, Staline, Churchill ou Hitler, dans le dernier spectacle du Théâtre du Soleil, Ici sont les dragons, créé en novembre 2024. Et si on le reconnaît, c’est grâce à son masque. Avec cette création qui embrasse la période de la révolution russe de 1917, la troupe d’Ariane Mnouchkine a renoué avec cet objet qui traverse tout son parcours, mais qui n’était pas réapparu, sous sa forme stricte, depuis Tambours sur la digue, en 1999. Dans son atelier niché au fond de la Cartoucherie de Vincennes (Paris 12e), Erhard Stiefel rembobine ses souvenirs, entouré des dizaines de visages qui peuplent cet antre magique. Il a 85 ans, et il travaille avec Ariane Mnouchkine depuis soixante ans. Il est le plus grand facteur de masques vivant, depuis que les Italiens Amleto Sartori (1915-1962) et son fils Donato Sartori (1939-2016) sont morts. Il a créé des masques pour Antoine Vitez, Alfredo Arias ou Arthur Nauzyciel, mais il a surtout traversé toute l’aventure du « Soleil » : le masque est au cœur du théâtre d’Ariane Mnouchkine, même s’il est loin d’avoir figuré dans tous ses spectacles. « Le masque est notre discipline de base, car c’est une forme, et toute forme contraint à une discipline. L’acteur produit dans l’air une écriture, il écrit avec son corps, c’est un écrivain dans l’espace. Or, aucun contenu ne peut s’exprimer sans forme. Je crois que le théâtre est un va-et-vient entre ce qui existe au plus profond de nous, au plus ignoré, et sa projection, son extériorisation maximale vers le public. Le masque requiert précisément cette intériorisation et cette extériorisation maximales. Un certain type de cinéma et de télévision nous a habitués au “psychologique”, au “réalisme”, au contraire d’une forme, donc au contraire de l’art ; on dispose les acteurs dans un décor, mais le plateau ne leur appartient plus vraiment. Alors qu’avec le masque ils créent leur univers à chaque instant », a posé la directrice du Soleil, dans un entretien avec la chercheuse Odette Aslan, dans Le Masque. Du rite au théâtre (CNRS Editions, 1985). Réinventer une tradition Aujourd’hui, Ariane Mnouchkine, jointe au téléphone en juillet, alors qu’elle voyage au Brésil, se souvient que ses premières émotions théâtrales sont liées à la marionnette et au masque : en l’occurrence à Guignol, et à l’Arlequin serviteur de deux maîtres, de Goldoni, mis en scène par Giorgio Strehler, vu à l’âge de 16 ans et qui l’a marquée à jamais. Après avoir fait une timide apparition dans La Cuisine, en 1967, le masque fait une entrée fracassante dans son théâtre avec L’Age d’or, en 1975. Les types de la commedia dell’arte sont convoqués et réinventés pour cette création collective qui parle directement du temps présent, avec ses exploiteurs et ses exploités. Philippe Caubère, en Arlequin, incarne Abdallah, ouvrier maghrébin immigré, tandis que les masques de Pantalon sont adoptés pour les personnages de Marcel Dassault ou d’un patron d’hôtel sordide. Le masque sera ensuite systématiquement utilisé lors des processus de répétition, et figurera dans plusieurs des spectacles légendaires du Soleil. A commencer par cette épopée shakespearienne d’anthologie menée entre 1981 et 1984, qui réunit Richard II, Henry IV et La Nuit des rois, et dans laquelle Mnouchkine transforme les guerriers anglais en samouraïs venus du pays du Soleil-Levant. Erhard Stiefel crée pour ce cycle de fabuleux masques en bois, lointainement inspirés du théâtre nô, permettant aux jeunes acteurs de jouer les vieillards, la souffrance et la mort dont ils n’ont pas l’expérience. Le masque réapparaît ensuite dans L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (1985), plus discrètement, tout en jouant un rôle fondamental puisqu’il figure le père du roi Sihanouk apparaissant sous forme de fantôme. Erhard Stiefel s’inspire cette fois du masque balinais du Topeng Tua, personnage de vieillard respecté. A chaque fois, il s’agit de réinterpréter et de réinventer une tradition, jamais de la copier. « Il est hors de question de tomber dans le folklore », a toujours martelé la cheffe de troupe. Soixante ans d’exploration Dans les années qui suivent, Ariane Mnouchkine utilisera plutôt le maquillage, traité comme un masque – ce qu’elle appelle les « masquillages » –, ou des masques en tissu souple, réalisés par les acteurs eux-mêmes, comme dans L’Ile d’or (2021), pour leur permettre de « japoniser » leurs visages. Le masque fait son grand retour avec ces Dragons qui se présentent comme le premier volet d’une vaste fresque traversant l’histoire européenne du XXe siècle, pour tenter de comprendre le destin d’une Ukraine martyre. « Les masques ont été le point de départ de ce travail, avec une évidence bouleversante, raconte Ariane Mnouchkine. J’avais des personnages historiques, il fallait les figurer. Je ne voulais pas d’un théâtre naturaliste, je voulais trouver une forme épique, digne de la complexité de cette époque. Mais je voulais aussi des masques respirants, pour le confort des acteurs. » Erhard Stiefel s’est alors tourné vers une tout autre tradition, celle du masque tragique grec de la haute époque (2 500 avant J.-C.), ou du moins de ce que l’on en connaît, et qu’il a explorée à sa façon. « Il fallait aller vers une dimension plus réaliste, puisqu’il s’agit de masques portraits, et non pas de caricatures. J’ai eu l’idée de masques en toile de lin rigidifiée, qui permettent de travailler avec précision sur le visage. Mais en introduisant un décalage : comme dans le théâtre grec, où visiblement les masques casques étaient plus volumineux qu’un vrai visage, pour pouvoir être vus de loin, on les a surdimensionnés. Cette modification d’échelle change tout. Paradoxalement, si vous jouez Lénine avec un masque à l’échelle, le spectateur n’y croit pas, parce qu’il sait que ce n’est pas Lénine qu’il a devant lui. Alors qu’avec une tête agrandie, non réaliste, il accepte la convention théâtrale, et il s’embarque dans le voyage. » Un voyage sans pareil, c’est bien ce que le Soleil a accompli au fil de soixante ans d’exploration de l’accessoire totémique du théâtre. « Un masque, c’est à la fois un outil, une forme qui nous relie à d’autres dimensions, notamment aux dieux, et un objet d’offrande. J’ai toujours pensé le théâtre comme étant en soi une offrande, conclut Ariane Mnouchkine. Le pouvoir du masque, c’est de donner une âme à un corps : c’est un filtre magique, pour qui sait l’utiliser. En portant le masque, on devient un oracle, on utilise son corps comme les dieux grecs utilisaient celui de la Pythie, ou comme les dieux tibétains avec leurs propres oracles. » Fabienne Darge / Le Monde Le théâtre avance masqué
6 épisodes

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 5, 10:16 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 02 août 2025
RÉCIT « Le théâtre avance masqué » (6/6). « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, l’objet utilisé par une jeune génération pour rompre avec le naturalisme.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/08/02/le-masque-contemporain-ou-l-agent-de-l-etrange_6626207_3451060.html
A quoi pourrait bien ressembler Lady Macbeth, aujourd’hui ? A un monstre, à un dragon, à une femme, à un homme, à un totem ? C’est un peu tout cela à la fois, dans l’image qu’a donnée d’elle le Munstrum Théâtre dans son Makbeth inspiré de la célèbre pièce de Shakespeare, créée en février. Et cela, grâce au masque porté par l’acteur Lionel Lingelser, qui incarne la Lady. L’objet fétiche est au centre du théâtre qu’invente depuis 2017 cette compagnie fondée par Louis Arene et Lionel Lingelser, comme artefact de leur théâtre superlatif et queer, travaillant au cœur des questions identitaires et du sentiment postapocalyptique. Emblématique de ce renouveau du travail masqué, le Munstrum n’est pas le seul à redécouvrir les pouvoirs de la persona. Le masque fait un retour spectaculaire dans les arts de la scène depuis quelques années, non seulement au théâtre, mais aussi dans la danse. Il est ranimé par des artistes de la jeune génération, qui fuient comme la peste un naturalisme devenu envahissant. Chez Louis Arene et Lionel Lingelser, il s’est imposé comme une évidence, pour le « théâtre physique, sensuel, brut, des antagonismes entre le rire et l’effroi » qu’ils voulaient créer, un théâtre de la catastrophe, de l’identité et de la métamorphose. « Mais on ne se reconnaissait pas dans les traditions existantes, ces masques en bois ou en cuir aux archétypes souvent très marqués. On voulait aller vers une étrangeté, une inquiétude, effacer le plus possible la frontière entre le masque et le visage, créer un trouble. Et donc effacer l’expression, pour que le masque devienne une surface de projection, avec l’idée de faire naître un peuple de poupées énigmatiques, de personnages un peu fantomatiques », expliquent-ils. « Un monstre à deux têtes » L’objet idéal du Munstrum s’est inventé dans la rencontre avec un matériau : le Podiaflux, une résine médicale servant entre autres à réaliser des prothèses orthopédiques. Plastique, simple d’utilisation, solide, il a permis à Louis Arene, qui, dans le duo, endosse le rôle de metteur en scène et de facteur de masques, d’inventer ce masque-casque qui épouse le visage tout en le transformant subtilement. Un objet qui s’hybride avec la tête de l’acteur, puisqu’il s’arrête sous le nez, laissant libre le bas du visage et l’émission de la parole, et dégageant largement les yeux et leur pouvoir expressif. Un masque pas tout à fait neutre, pourtant : « C’est par de petites touches sur le nez et les pommettes, notamment, que je travaille les personnages. L’idée de base de ces visages, c’est que cela pourrait être tout le monde. Il faut toujours que puisse s’instaurer ce trouble entre le moi et l’autre. Ensuite, tout se joue dans la manière dont le masque va être complété par le maquillage, les coiffes, les costumes… Et bien sûr par son inscription dans un jeu qui, chez nous, est très physique », précise Louis Arene. Lady Macbeth a été pensée dans la gémellité avec son époux, incarné par Louis Arene. « Pour nous, le couple Macbeth est vraiment un monstre à deux têtes. Il a donc fallu durcir le visage de Lionel, qui est plutôt doux. Il a suffi de lui faire un nez beaucoup plus crochu que le sien, pour lequel on s’est inspirés des personnages joués par l’actrice américaine Glenn Close : des femmes dures, puissantes. » Pour Lionel Lingelser, il n’y avait plus, du haut de son 1,90 mètre, qu’à s’amuser avec le « côté dragon » du personnage, pour figurer une Lady inédite et inoubliable. « Une image déréglée » Autre tête chercheuse du théâtre contemporain, Lorraine de Sagazan a elle aussi utilisé des masques dans son spectacle Léviathan, créé au Festival d’Avignon en 2024. Le choix ici était d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’une création reposant sur un travail documentaire, mettant en scène des justiciables pris dans la mâchoire de ces procédures expéditives que sont les audiences en comparution immédiate. De manière saisissante, la metteuse en scène oppose les magistrats, portant des masques à la fois étranges et réalistes, aux yeux vitreux et fixes, qui figent et dépersonnalisent leur visage, et les accusés, dont la tête est recouverte de bas couleur chair qui effacent leur individualité. « Le travail masqué est apparu comme ayant d’autant plus de sens que le théâtre et la justice entretiennent un rapport étroit depuis l’Antiquité, raconte Lorraine de Sagazan. La persona, qui, dans le théâtre grec, désigne le masque et par extension le personnage, a servi de fondement au droit antique : ce droit institue une “personnalité juridique” qui sert de masque à l’individu en chair et en os ; il substitue à la personne humaine une fonction du droit. Cette dépersonnalisation que l’on peut ressentir dans un tribunal, aussi bien du côté de ceux qui rendent la justice que de ceux à qui elle s’applique, le masque permet de l’incarner de manière immédiate, avec une grande force visuelle. » « Une image déréglée par le masque », voilà ce qu’a voulu créer la metteuse en scène avec le concepteur Loïc Nebreda. Il a lui aussi fait le choix de la résine pour mouler ces visages qui ne sont pas sans évoquer le théâtre nô japonais, dans le mystère et l’étrangeté qu’ils dégagent. Le choix, en particulier et rare de nos jours, de recouvrir les yeux des acteurs par des regards vitreux et figés agit comme un agent perturbateur puissant : « Dans ces yeux qui ne bougent pas, il y a quelque chose de l’ordre de la terreur, constate Lorraine de Sagazan. La beauté du visage humain, tel que l’analysait le philosophe Emmanuel Lévinas, tient au fait qu’il est animé et mortel. Quand on l’“in-anime” apparaît une forme de monstruosité qui ne dit pas son nom. » Pour Louis Arene et Lionel Lingelser comme pour Lorraine de Sagazan, la puissance de fascination du masque vient bien de l’inquiétante étrangeté créée par la dialectique de la vie et de la mort qu’il met en jeu. « C’est vraiment un objet qui crée un trouble métaphysique, note Louis Arene. Il est le visage de la mort, figé ou sans expression, qui recouvre le vrai visage et crée ainsi une angoisse. Mais il s’anime dès qu’on lui insuffle de la vie. » Fascination, aussi, due à ce va-et-vient entre figuration et défiguration, de la part d’une humanité qui ne cesse de se demander comment elle se constitue entre le divin, l’animal et la machine. « Je crois que le masque réapparaît dans les moments où l’humanité ne va pas de soi, pose Lorraine de Sagazan. Et il semblerait bien que l’on vive un de ces moments-là. » Fabienne Darge / LE MONDE Le théâtre avance masqué
6 épisodes

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 4, 3:45 PM
|
Par Baudouin Eschapasse dans Le Point - 2 août 2025 Décédé le 31 juillet, le metteur en scène américain Robert Wilson aura joué un rôle majeur dans le spectacle vivant pendant cinquante ans. Avec Robert Wilson, décédé le 31 juillet à l'âge de 83 ans, c'est un monument de la scène contemporaine qui a disparu. « Bob demeurera à jamais un révolutionnaire de l'art théâtral », a écrit Jack Lang, qui l'avait programmé, pour la première fois, en France en 1972. « C'était un artiste visionnaire, un maître de la mise en scène, un sculpteur de lumière », a déclaré de son côté la ministre de la Culture, Rachida Dati. L'artiste américain était né à Waco (Texas), le 4 octobre 1941. La révélation de son homosexualité, mal acceptée par sa famille, le pousse très tôt à quitter sa ville natale et à s'installer à Austin, où il suit un cursus d'administration des affaires à l'université du Texas avant de rejoindre la côte Est pour se consacrer à l'architecture et au design au Pratt Institute de Brooklyn. Une formation qu'il parachève au sein de l'atelier que l'Italien Paolo Soleri (1919-2013) a créé à Arcosenti, près de Phoenix (Arizona). Des spectacles, expériences scéniques déroutantes De retour à New York en 1962, Robert Wilson plonge dans l'effervescence de la scène underground et rencontre, entre autres, Philip Glass, Andy Warhol, Laurie Anderson ou encore Merce Cunningham, avec qui il sympathise. Le jeune Bob – surnom qu'il préfère à Robert – se rêve alors peintre et travaille auprès d'enfants atteints de troubles psychiatriques. Un stage effectué en 1965, au sein d'un atelier d'art-thérapie, lui fait rencontrer un enfant autiste, Christopher Knowles, de quelques années son cadet. Est-ce parce que, comme cet adolescent de 13 ans, il se sent « différent » des autres ? Les deux garçons sympathisent. Ils créeront ensemble un opéra vertigineux, Einstein à la plage, en 1976. Cette pièce va triompher au Festival d'Avignon et contribuer à faire connaître la musique du compositeur Philip Glass. Inspiré par une photographie du découvreur de la théorie de la relativité marchant au bord de la mer, ce spectacle hypnotique plonge le public dans la psyché du scientifique Des formes obsédantes sont projetées en fond de scène pour évoquer, de manière subliminale, des souvenirs d'enfance d'Einstein ainsi que la mauvaise conscience qui le taraude pour avoir contribué indirectement à l'invention de la bombe atomique. Une thématique qui inspirera à Christopher Nolan le scénario de son Oppenheimer (2023). Repris par la chorégraphe Lucinda Childs, en 1984, ce spectacle marquera des générations de spectateurs. Robert Wilson reprend ici des éléments de mise en scène échafaudés dans ses premières pièces, coécrites avec le danseur Andy de Groat (1947-2019), qui partage sa vie. Dans The King of Spain, créé en 1969, The Life and Times of Sigmund Freud, en 1970, ou encore The Village Voice, quelques mois plus tard, le metteur en scène amenait déjà les spectateurs à s'abandonner à des expériences scéniques déroutantes : l'absence de narration obligeant le public à inventer sa propre histoire. La France conquise par Bob Wilson Cette manière de faire va culminer avec Regard du sourd (Deafman Glance), joué pour la première fois dans un obscur festival expérimental de l'Iowa, en décembre 1970. Cette pièce de sept heures, totalement silencieuse, est pour le moins radicale. L'argument est des plus simple. L'histoire narre la vie d'un jeune sourd-muet. Lequel n'exprime pas un mot. L'absence de texte ne pèse pas car elle est compensée par de spectaculaires chorégraphies, sublimées par une lumière soignée. La pièce est donnée en France, en 1972 donc, dans le cadre du festival de Nancy. C'est un immense succès. Conquis, le poète Louis Aragon écrit « n'avoir jamais rien vu de plus beau au monde ». Robert Wilson décide de rester vivre dans notre pays. Il faut dire que ses créations avant-gardistes y rencontrent un accueil bien meilleur qu'outre-Atlantique. L'ancien plasticien, obsédé par les images, ambitionne de créer chez les spectateurs des chocs esthétiques qui s'affranchissent de tout dialogue. L'expérience théâtrale devient totale : il ne suffit plus d'écouter mais de regarder avec intensité les mouvements des comédiens, pour espérer sinon comprendre, du moins ressentir les émotions véhiculées sur scène. À chacun d'imaginer une narration. L'Europe n'est pas la seule à être charmée par l'art de Robert Wilson. En cette même année 1972 où il conquiert l'Hexagone, le metteur en scène ensorcelle les participants du festival de Persépolis, en Iran, avec un spectacle ahurissant. Celui-ci réunit, une semaine durant, plus d'une centaine de comédiens sur une colline proche de Shiraz. Intitulée Ka Mountain and Gardenia Terrace, cette pièce d'une ambition folle est une saga contant rien moins que l'histoire du monde ! Robert Wilson va revenir à des projets plus raisonnables dans les années 1980 après avoir échoué à créer, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Los Angeles, un opéra presque aussi pharaonique, The Civil Wars, toujours sur une musique de Philip Glass, d'une durée prévue de douze heures. Pionnier dans l'utilisation de la vidéo sur le plateau, Robert Wilson aime mélanger littérature et musique contemporaine. Il travaillera ainsi avec Tom Waits pour The Black Rider, d'après William Burroughs en 1990, mais aussi Lou Reed pour Time Rocker en 1996, et les CocoRosie pour Peter Pan en 2013. Ou Lady Gaga. À raison de cinq créations par an en moyenne, il nous lègue un catalogue d'œuvres puissantes au milieu desquelles certaines sont devenues des classiques. Telle Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, reprise sur les cinq continents depuis sa création en 1993. Robert Wilson laisse aussi derrière lui une fondation, installée dans la petite ville de Water Mill, à Long Island, non loin de New York. Un lieu dédié aux rencontres d'artistes de toutes disciplines qui lui survivra grâce à une fondation qu'il a mise en place quand il a appris qu'il n'avait plus que deux mois à vivre. Baudouin Eschapasse / Le Point

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 2, 2:35 PM
|
Par René de Ceccatty dans Le Monde - 1er août 2025 Issue d’une famille d’industriels, cette Milanaise au culte prononcé de l’intelligence, capable d’incarner des rôles fantaisistes comme dramatiques, s’est consacrée au théâtre et au cinéma toute sa vie, sous la direction notamment de Pasolini, Visconti ou Bertolucci.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2025/08/01/adriana-asti-actrice-italienne-au-talent-explosif-et-ironique-est-morte_6626068_3382.html Adriana Asti s’est éteinte dans son sommeil le 31 juillet, à Rome. La capitale lui faisait regretter Milan : à sa ville natale, elle avait consacré un spectacle musical, Stramilano, qu’elle avait montré sur toutes les scènes italiennes, et même à Paris. Giorgio Strehler, Luca Ronconi et Luchino Visconti avaient tous su, dans cette cité lombarde, exploiter le talent explosif de cette comédienne ironique, qui vouait à l’intelligence un véritable culte. Née en 1931 dans une famille d’industriels, élevée dans une pension de bonnes sœurs allemandes, elle s’était débarrassée de la pesanteur d’un tel pedigree pour suivre une troupe de théâtre de passage et ne plus jamais se détacher de cet art, sinon pour le cinéma, même si sa beauté ne correspondait pas au canon des vedettes du grand écran. Mais elle avait quelque chose de plus, que perçurent Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti (qui, après l’avoir découverte sur scène, lui donna des beaux rôles, dans Rocco et ses frères, paru en 1960, et surtout dans Ludwig, 1972) ou Mauro Bolognini. Mais c’est surtout Bernardo Bertolucci qui, dans Prima della rivoluzione (1964), mêla leurs liens sentimentaux et une fiction inspirée de La Chartreuse de Parme. Une des scènes les plus frappantes du film est un coup de téléphone réel que l’actrice donne à son propre psychanalyste (le célèbre Cesare Musatti). On ne fut donc pas étonné qu’elle ait fini par représenter sa vie dans un spectacle inspiré de son livre d’entretiens Se souvenir et oublier (Portaparole, 2011) et ironiquement intitulé Mémoires d’Adriana (2017). Parmi les nombreuses versions de son autobiographie, l’une, commencée à près de 90 ans, porte pour titre Un futuro infinito. Piccola autobiografia (« un futur infini », Mondadori, 2017, non traduit). Goût du sarcasme Fascinée par ses amis écrivains, parmi lesquels trônait Elsa Morante, à laquelle la liait un goût du sarcasme, elle les avait convaincus d’écrire pour elle. Notamment Natalia Ginzburg, dont elle avait interprété en français la pièce Teresa. Mais une amitié encore plus intense l’unissait à l’actrice Franca Valeri, dont elle joua une comédie irrésistible, et à son psychanalyste, qui se mit en tête à son tour de lui écrire une pièce sur mesure. Pour sa dernière mise en scène théâtrale, en 1973, Luchino Visconti eut l’idée de la dénuder entièrement, dans C’était hier de Harold Pinter, qui, outré, fit interdire les représentations… Mais Adriana y savoura le plaisir de la nudité. Elle réitéra son strip-tease dans les films Le Fantôme de la liberté (1974) de Luis Buñuel et Caligula (1979) de Tinto Brass, péplum déjanté qui la ravissait. Pasolini fut le témoin de son premier mariage, avec le peintre Fabio Mauri, dont il était proche, union à laquelle Adriana Asti mit rapidement un terme en inondant l’appartement conjugal. Pasolini engagea l’actrice pour son premier film, Accattone (1961), où il lui donna le rôle bouleversant de la prostituée Amore. Il refit appel à elle pour le court-métrage poétique Que sont les nuages ? (1968), où elle est, comme ses partenaires, une marionnette jouant Othello. Bien que la fantaisie surréaliste ait toujours fait partie de son monde artistique (en particulier avec Copi, qui joua avec elle Les Bonnes, de Jean Genet), elle était capable d’incarner des personnages dramatiques, comme le grand public devait le découvrir dans Nos meilleures années (2003), de Marco Tullio Giordana, ou dans Pasolini (2014), d’Abel Ferrara, elle y interprète le rôle de la mère du cinéaste écrivain. Désabusée et enthousiaste Au théâtre, elle n’avait accepté de jouer La Voix humaine (de Jean Cocteau, sous la direction de Benoît Jacquot) qu’à condition de lui adjoindre Le Bel Indifférent, version moins pathétique d’une femme abandonnée… Le pathos n’était pas ce qu’elle préférait, au théâtre, au cinéma et dans la vie tout court. Elle aimait peindre (elle avait décoré de fresques étonnantes sa maison de campagne en Ombrie, en Italie centrale) et chanter. C’est avec Giorgio Ferrara, l’assistant de Visconti et de Ronconi – ce dernier l’emmena à New York dans son Roland furieux et la dirigea un demi-siècle plus tard dans La Danse de mort –, qu’elle trouva une stabilité sentimentale pour laquelle, à tort, elle ne se croyait pas faite. Elle accompagna à Paris son mari, qui y dirigea à partir de 2003 l’Institut culturel italien, ce qui lui permit de jouer dans plusieurs pièces écrites spécialement pour elle, et surtout au Festival des deux mondes de Spolète (Italie), où Bob Wilson la dirigea dans Oh les beaux jours. Samuel Beckett et sa métaphysique amère lui convenaient aussi bien que Hermann Broch, dont elle incarna la servante Zerline dans un happening de la chorégraphe Lucinda Childs, ou que Luigi Pirandello, que Susan Sontag mit en scène. Quoique ayant longtemps vécu à Paris, ce qui lui permit de tourner plusieurs films français, elle avait une certaine nostalgie de New York, où les artistes transgenres de la Factory d’Andy Warhol l’avaient accueillie comme une jumelle. Toute bien-pensance l’assommait. Le théâtre, plus encore que le cinéma, était pour elle la vraie vie, dont elle rappelait l’absurdité, dans un mélange de désabusement et d’enthousiasme de petite fille insolente. Elle avait tenu, dans l’hebdomadaire L’Espresso, une rubrique comique dont un poulet était le héros, son double le plus authentique. Adriana Asti en quelques dates 30 avril 1931 Naissance à Milan (Italie) 1964 Prima della rivoluzione, de Bernardo Bertolucci 1974 Le Fantôme de la liberté, de Luis Buñuel 1987 La locandiera, de Carlo Goldoni, mis en scène par Alfredo Arias 2003 Nos meilleures années, de Marco Tullio Giordana 2019 La ballata della Zerlina, de Hermann Broch 31 juillet 2025 Mort à Rome Légende photo : Adriana Asti et Francesco Barilli dans le film « Prima della rivoluzione » (1964), de Bernardo Bertolucci. CINÉMATHÈQUE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 30, 3:48 AM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 25 juillet 2025 Dans un huis clos où un vieillard atteint de démence et un escort se livrent à un corps à corps étrange, les Palestiniens Bashar Murkus et Khulood Basel sondent avec justesse la vulnérabilité, les jeux de pouvoir, et la responsabilité du spectateur en position témoin. Que se passe-t-il la nuit derrière les murs d’une maison ? De bien étranges scénarios exposés sur la scène du théâtre Benoît-XII dans Yes Daddy, la dernière création des Palestiniens Bashar Murkus et Khulood Basel – de retour au festival pour la troisième fois –, in extremis à deux jours de la fin. Et ç’aurait été dommage de louper ce rendez-vous tarifé entre le jeune Amir (Anan Abu Jabir) et un type dans les 60-70 ans, appelons-le Daddy (Makram J. Khoury, un des plus grands acteurs palestiniens), manifestement Alzeihmer, en chaise roulante coincé dans un appartement meublé sommairement. «Je baise pas les vieux», annonce l’escort, «Qui êtes-tu ?» répond le vieux, qui lui donne du Samer, le prénom de son fils. Voilà. Tout se joue là. Dans ce quiproquo du désir entre deux hommes qui vont mener une bien drôle de partie fine à l’abri des regards. Jeux de pouvoir Amir nous a prévenus en ouverture : il lui faut d’abord notre consentement, il veut nous entendre : sommes-nous bien «d’accord» pour passer la soirée ensemble ? Et le public de répondre en chœur : «D’accord.» Ensuite, il précise bien qu’il fera abstraction de notre regard ; après avoir ouvert le quatrième mur, il le referme donc pour entrer par effraction dans ce huis clos qui en rappelle un autre : The Museum en 2021 au Festival, le duel homoérotique et pervers – ce n’est pas synonyme, merci ! – autour du dernier repas entre l’auteur d’un attentat mené dans un musée, qui attend son exécution depuis sept ans, et l’inspecteur de police qui l’a arrêté. Déjà les rôles se redistribuaient, jeux de pouvoir, manipulations jusqu’au corps à corps des plus moites. Yes Daddy retrouve la même dramaturgie, avec un Amir qui plonge dans les trous de mémoire de son vieux, s’y réinvente hors de lui, ose tout, le tabassage en règle, l’inceste, jusqu’au travestissement pour devenir la mère du vieillard renvoyé à son plus jeune âge. La vie privée qui nous regarde La pièce brouille les repères dans une succession de piétas dégenrées : le jeune homme prend dans ses bras le vieillard qui le prend pour son fils. Puis, cette fois, travesti en femme, le voilà qui donne son sein au Daddy retombé en enfance : «Il n’y a pas de lait», gueule le vieux qui s’étouffe sur le pectoral. Bien sûr qu’il n’y en a pas, tout est un jeu d’imposture où chacun jouit du rôle qu’il se donne en profitant de l’insuffisance, la vulnérabilité de l’autre. Et nous quel est notre rôle dans ce rendez-vous ? En exigeant notre accord au début, en nous avertissant qu’il ferait comme si nous n’étions pas là, Amir aura fait de nous les témoins – à non-assistance à personne en danger – nécessaires à la jouissance. In extremis en fin de festival, la pièce nous raconte que la violence domestique, qui se passe derrière les murs des maisons, derrière les frontières, nous regarde. Qu’on ne peut pas, au nom de la «vie privée», faire comme si nous n’étions pas là. A moins de décider une bonne fois pour toutes : ok c’est la vie privée… Mais alors privée de tout. Yes Daddy de Bashar Murkus et Khulood Basel au théâtre Benoît-XII, festival d’Avignon, aujourd’hui 18 heures.Les 6 et 7 novembre au Théâtre des 13 vents - CDN de Montpellier, dans le cadre de La Biennale des Arts de la scène en Méditerranée.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 29, 4:51 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 29 juillet 2025 RÉCIT« Le théâtre avance masqué » (2/6). « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, le masque nô, chef-d’œuvre en bois énigmatique, conservé comme un trésor. A quoi sourit-elle, la jeune Ko-omote ? Elle vient du Japon du début du XVe siècle, et elle a la fraîcheur d’une jeune fille d’aujourd’hui et de tous les temps, avec sa malice et la rondeur encore enfantine de ses traits. Son visage (omote, en japonais) est en bois, mais la chair semble vivante, palpitante. En elle s’incarne l’art du masque nô, qui n’a cessé de fasciner par-delà les temps. Alors que le masque grec de la grande époque tragique a été irrémédiablement perdu, les masques nô ont été dès l’origine gardés et conservés comme des trésors par les familles perpétuant la tradition de ce théâtre de père en fils.
L’objet dès lors s’est inscrit comme un secret théâtral toujours à creuser et à redécouvrir, notamment chez les grands rénovateurs du théâtre du début du XXe siècle. Bertolt Brecht avait un masque nô sur son bureau. Pour Paul Claudel, diplomate au Japon dans les années 1920, la découverte du nô sera une révélation, qu’il résumera avec la fulgurance du poète : « Le drame, c’est quelque chose qui arrive ; le nô, c’est quelqu’un qui arrive. » Quelqu’un, donc un visage, donc un masque – le même mot, omote, servant à désigner les deux. « Dieu, héros, ermite, fantôme, démon, le Shité [personnage principal du drame] est toujours l’Ambassadeur de l’Inconnu et à ce titre il porte un masque » (Paul Claudel, Mes idées sur le théâtre, Gallimard, 1966).
« Le masque nô, le vrai, celui qui a été fabriqué entre le XIVe et le XVIIe siècle par des sculpteurs extraordinaires, c’est comme un stradivarius pour un musicien », pose d’emblée Erhard Stiefel, au milieu de tous les visages qui peuplent son atelier de la Cartoucherie de Vincennes (Paris 12e). Unanimement considéré comme un des plus grands créateurs contemporains de masques, Erhard Stiefel n’a pas seulement accompagné le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine dans sa recherche autour de l’objet emblématique du théâtre. Il s’est intéressé depuis longtemps au masque nô, et a été un des très rares occidentaux à pouvoir contempler de près les modèles originaux, les honmen des grandes familles qui les détiennent toujours.
« Harmonieuse fusion »
« Le masque, qui est l’objet au cœur du théâtre, a toujours le même sens, depuis les Grecs, quelle que soit la tradition, et le nô ne fait pas exception : c’est un outil de communication et de transformation, poursuit Erhard Stiefel. Sauf que le masque nô, en plus, est une œuvre d’art en soi. C’est le masque de théâtre ultime, celui qui va le plus loin : c’est indépassable. »
Pourquoi ? Grâce à son mélange inédit de qualité de sculpture – sur bois d’hinoki, du cyprès japonais, enduit d’une poudre de coquillage liée à une colle de peau de poisson –, de finesse psychologique dans l’étude des visages, d’équilibre entre réalisme et abstraction, et de subtilité expressive. « Le nô est le fruit d’une harmonieuse fusion du réel et de l’irréel. Aussi les auteurs des masques eurent-ils à réaliser à leur tour ce difficile équilibre entre le rêve et la réalité. Comparés aux œuvres précédentes, les masques de nô paraissent réalistes. Mais ce réalisme est relatif, il est tamisé d’idéalisme et teinté de symbolisme », détaillait le grand japonologue François Berthier, dans un ouvrage toujours d’actualité, Arts du Japon. Masques et portraits (Publications orientalistes de France, 1981). « Ce symbolisme nuancé, accompagné d’un expressionnisme feutré, constitue l’essence du masque nô », ajoutait-il.
Le masque nô est à la fois étrange, énigmatique et familier, offrant un miroir d’émotions reconnaissables, projetées par le spectateur. Car, contrairement à ce que posait le mystique Claudel, il n’y a pas que des dieux, des démons, des esprits ou des fantômes, dans cet art théâtral. Mais aussi des personnages bien humains, définis par types, hommes et femmes, jeunes et vieux, au cœur de ce théâtre uniquement joué par des hommes pendant des siècles – quelques femmes s’y risquent aujourd’hui.
« Il glorifie le visage »
Si le masque nô est bien l’« ambassadeur de l’inconnu », c’est parce que le système symbolique du Japon ancien fait voyager l’humain, par l’art du théâtre, dans ses dimensions psychiques et intimes de fantôme, de démon ou d’esprit vengeur. Le nô est un théâtre hanté, reliant toujours les humains avec les forces obscures qui les habitent, comme pour les exorciser. Claudel encore : le nô, « c’est la vie telle que, ramenée du pays des ombres, elle se peint à nous dans le regard de la méditation : nous nous dressons devant nous-mêmes, dans l’amer mouvement de notre désir, de notre douleur et de notre folie ».
Pour Véronique Brindeau, chargée de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales et spécialiste des arts de la scène du Japon, « le nô prend forme au XIVe siècle, il est donc empreint de l’esprit du bouddhisme et du shintoïsme, avec ce que cela implique de rapport à la réincarnation et à la recherche du salut. Le bouddhisme considère que l’attachement est une forme de souffrance pour l’humanité. Le salut vient du détachement. Les personnages, dans ces drames, cherchent souvent à se libérer d’incarnations anciennes, violentes et douloureuses. Ce n’est pas sans rappeler la catharsis du théâtre grec. »
Assis dans son atelier, Erhard Stiefel contemple, ému, le visage de Ko-omote, tel qu’il s’imprime dans un imposant ouvrage de nomenclature des masques de la maison Kongo, une des cinq familles japonaises dépositaires de l’héritage du nô originel. Il est l’un des deux ou trois non-Japonais, sans doute, à avoir vu ce masque de près. « Le masque nô n’est certes pas totalement réaliste, puisqu’il est plus petit que le visage, qu’il ne couvre pas entièrement, mais, pour moi, il glorifie le visage. Une jeune fille comme Ko-omote, on en croise des centaines qui lui ressemblent dans le Japon d’aujourd’hui. Et, en même temps, c’est la déesse du Soleil, celle qui a sauvé le Japon : c’est magnifique. Comme tout masque digne de ce nom, il ne se révèle pleinement que lorsqu’il s’anime au moment de son apparition sur scène. Un masque, c’est d’abord un visage, sinon c’est un objet mort, folklorique, sans intérêt. »
Fabienne Darge / Le Monde
Le théâtre avance masqué
6 épisodes
Crédit photo : Grand Palais / RMN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 28, 5:33 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 28 juillet 2025 RÉCIT« Le théâtre avance masqué » (1/6). « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, le masque antique de l’époque d’Eschyle, dont il ne subsiste aucun exemplaire original.
Lire l'article sur le site du "Monde"
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/07/28/le-masque-tragique-grec-ou-l-enigme-du-sphinx_6624775_3451060.html
Quel était le visage d’Œdipe ? Ou celui d’Antigone, d’Electre, de Clytemnestre ? Mystère. On peut même dire que ce mystère s’est épaissi avec le temps. Seule certitude : ce visage était un masque. Mais à quoi ressemblait-il ? On n’en sait rien, ou presque. Ecrire sur le masque de la tragédie grecque, qui signe l’invention du théâtre, au Ve siècle avant J.-C., c’est mener une enquête à trous, pleine de surprises, digne de l’énigme du sphinx. « Depuis Les Perses d’Eschyle, dont la représentation a eu lieu en 472 avant J.-C. sur les contreforts de l’Acropole à Athènes, jusqu’à la fin de l’Empire gréco-romain et l’avènement du christianisme, huit siècles plus tard, l’acteur n’a donné à voir que le masque de son personnage, affirmant par là la dimension symbolique d’une scène qui ne se voulait pas l’illusion de la réalité », explique Guy Freixe, un des grands spécialistes en France du masque de théâtre, qu’il a exploré aussi bien comme acteur, comme metteur en scène que comme universitaire. « Mais nous n’avons de ces masques que des témoignages iconographiques, des marbres sculptés, des peintures sur vases, des terres cuites trouvées dans des tombes et des répliques », précise-t-il. Aucun masque ne nous est parvenu de la grande époque d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide. Autrement dit, l’image que l’on a de cet objet, le plus souvent une sculpture en terre cuite avec la bouche ouverte et des yeux exorbités, est tout simplement fausse, ou anachronique, ces masques expressionnistes appartenant à une époque bien plus tardive. Le vrai visage du masque de la grande époque hellénistique est une recherche toujours en cours, qui implique des archéologues, des historiens du théâtre, des anthropologues, des historiens des religions, des créateurs de masques et même des neuroscientifiques, comme en atteste un ouvrage dirigé par Guy Freixe, Giulia Filacanapa et Brigitte Le Guen, Le Masque scénique dans l’Antiquité (Deuxième époque, 2022). « Seconde tête » Ce qui semble – à peu près – sûr, c’est que le masque théâtral se détache nettement du masque rituel, et marque par là l’invention du théâtre. Mais quid de son apparence ? L’helléniste italien Enrico Medda a mené l’enquête. « Aujourd’hui, nous savons qu’au temps d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, les masques n’avaient pas les traits marqués ni les expressions forcées qui caractérisent les masques théâtraux d’époque hellénistique, témoigne-t-il dans Le Masque scénique dans l’Antiquité. Les vases nous montrent des visages masculins et féminins dotés d’une expression naturelle. Le corpus iconographique nous fait comprendre que le masque était une sorte de “seconde tête” que l’acteur enfilait sur la sienne. Il était associé à une espèce de perruque qui contribuait à déterminer l’âge et le sexe du personnage. » Autre – quasi – certitude : « Il est raisonnable de supposer que le masque était fait de lambeaux de lin trempés dans de la colle et moulés dans du plâtre », écrivait l’universitaire et créateur de masques italien Ferdinando Falossi, disparu en 2024, dans Le Masque scénique dans l’Antiquité. « Permettant à un acteur professionnel de jouer plusieurs rôles, le masque en lin stuqué était aussi fabriqué pour des types. » Falossi faisait l’hypothèse qu’il n’existait pas un masque d’Œdipe, de Clytemnestre ou d’Electre, mais un type de l’homme jeune ou mature, de la femme mûre, du vieillard ou de la jeune fille malheureuse. Les masques n’étaient donc pas des individualités mais des types, dont l’aspect était fondé essentiellement sur le sexe, l’âge ou le statut social, tandis que le costume et la chevelure du masque couvraient le corps et le visage d’une série de signes qui rendaient le personnage immédiatement reconnaissable. Foin donc de « cothurnes [chaussures à semelle épaisse] élevés sur lesquels avancent au ralenti des comédiens hiératiques, semblables à des colonnes corinthiennes, surmontés de grands masques hallucinés aux gueules si démesurées que même la Gorgone Méduse en resterait bouche bée, s’amuse Ferdinando Falossi. Cothurnes, porte-voix, mascarons n’appartiennent pas au théâtre des Ve-VIe siècles avant J.-C ». C’est par la pratique de la création de masques, et non par la théorie, que le chercheur italien est arrivé à la conclusion que le masque grec de la grande époque est empreint d’une forme de neutralité, et qu’il a bien figure humaine, malgré la démesure des passions exprimée par la tragédie. « Traits proprement humains » « La physionomie du héros tragique est composée de traits proprement humains puisque c’est dans la sphère humaine que se développent les thématiques de la douleur, de la souffrance et de la conscience », appuie-t-il. Et ce visage est énigmatique, marqué par le mystère et l’absence. « Il nous est difficile, aujourd’hui, de penser que ces visages étaient aptes à exprimer les fortes passions, les grands sentiments ou les lamentations déchirantes qui résonnent dans les tragédies. Mais un visage presque neutre, apparemment dépourvu d’expressions, est capable de produire, avec un habile usage de la parole et du geste, un plus grand nombre d’expressions qu’un visage avec une ou deux expressions prononcées. » La leçon sera retenue, ou réinventée, des siècles plus tard, bien plus loin vers l’Orient, par le théâtre nô japonais… Alors, quel était le visage d’Œdipe ? Ferdinando Falossi donne sa réponse : « Œdipe est roi, donc un homme dans la force de l’âge. Son visage ne portera pas la marque des bouleversements causés par ses malheureuses aventures, mais, quand l’acteur quitte la scène sur cette réplique : “Ô lumière, pour la dernière fois puissé-je aujourd’hui élever vers toi mes regards”, très probablement il effectue en coulisses un changement de masque et il en met un déjà prêt, aux orbites vides et ensanglantées, à la barbe salie de sang, aux cheveux rasés, pour que le choeur puisse dire : “Oh ! oh ! malheureux, je n’ai pas la force/de te regarder seulement en face.” » A lire : « Le Masque scénique dans l’Antiquité », ouvrage dirigé par Giulia Filacanapa, Guy Freixe et Brigitte Le Guen, Editions Deuxième époque, 45 p., 42 €. Fabienne Darge / Le Monde Le théâtre avance masqué
6 épisodes

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 26, 12:33 PM
|
Par Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) - 26 juillet 2025 La manifestation, devenue un passage obligé pour les compagnies théâtrales, a présenté 1 731 spectacles, avec de fortes disparités de fréquentation.
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/26/au-festival-off-d-avignon-un-public-en-hausse-pour-une-offre-toujours-plus-variee_6624063_3246.html
Des rues piétonnes fourmillantes, des dizaines de spectacles affichant complet dès les premiers jours, l’ambiance festive qui a rythmé le Festival « off » d’Avignon durant trois semaines, du 5 au 26 juillet, se confirme dans les chiffres. Les premières tendances de fréquentation placent cette 59e édition « sous le signe de la réussite », constatent les responsables de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C), coordonnatrice de ce vaste marché du spectacle vivant. « Selon les premières remontées, nous serions à 1,6 million de billets vendus et le taux moyen de remplissage des salles se rapprocherait des 60 % », détaillent Laurent Domingos et Harold David, coprésidents d’AF&C. Surtout, les deux indicateurs les plus fiables, sur lesquels l’association s’appuie chaque année pour établir son prébilan, affichent des hausses significatives. Ainsi, Ticket’off, la plateforme de billetterie proposée par AF&C (en parallèle de celles dont dispose chacun des 139 théâtres avignonnais et des plateformes privées telles que Billetreduc), a écoulé 290 000 tickets, contre 203 000 en 2024 et 172 000 en 2023. « C’est un record », se félicite Harold David. Même tendance pour les cartes « off » d’abonnement (offrant 30 % de réduction sur les places de spectacles) : 79 400 ont été achetées cette année, contre 62 900 en 2024 et 65 477 en 2023. Si ces données témoignent d’un fort attrait du public pour ce grand rendez-vous théâtral, elles cachent de fortes disparités de fréquentation parmi les quelque 1 731 spectacles proposés par 1 405 compagnies. Comme la récente comédie Avignon, de Johann Dionnet, l’a très bien dépeint, il y a plusieurs « off » dans le « off ». Le populaire, le contemporain, le classique, l’intello. C’est un peu à l’image du film Le Goût des autres (2000), mais au sein même de la famille théâtrale. En ne cessant de grossir (il y avait 600 spectacles en 2003, 1 491 en 2023) cette manifestation parallèle au Festival « in » d’Avignon ne se vit plus tout à fait de la même façon, que ce soit du côté du public, des compagnies ou des journalistes. Si de moins en moins de festivaliers se baladent avec le lourd programme du « off » sous le bras, ce n’est pas seulement parce qu’ils ont téléchargé sur leurs smartphones son équivalent numérique, mais parce qu’ils sont de plus en plus nombreux à avoir établi leurs choix avant même leur arrivée dans la cité des Papes. L’heure est de moins en moins aux découvertes impromptues. « Désolés, on est déjà pris », ne cessent d’entendre les comédiens et comédiennes s’épuisant à tracter dans les rues avignonnaises pour attirer des spectateurs. De plus en plus d’avant-premières « Mais comment choisissez-vous vos spectacles ? », me demande une spectatrice dans la file d’attente du Cabaret mythique au théâtre du Petit Louvre, spectacle musical et théâtral dans lequel la compagnie Les Mauvais Elèves revisite avec une folle fantaisie les personnages de la mythologie grecque. Comme bon nombre d’habitués du « off », cette retraitée constate qu’il est devenu très difficile d’accéder à certaines programmations sans avoir réservé. Rançon d’un bouche-à-oreille favorable pour certains spectacles ? Volonté de rationaliser des séjours raccourcis pour des raisons budgétaires ? Poids des prescriptions des médias qui ont pu découvrir des pièces avant leur programmation avignonnaise ? Soyons honnêtes, journalistiquement, il est impossible de couvrir de manière exhaustive un festival aussi foisonnant. Cela conduit forcément à des injustices, des spectacles de qualité passant chaque année hors des radars de la presse. Dans cet écosystème du « off », les médias sont notamment influencés par le travail des attachés de presse qu’ils côtoient le reste de l’année à Paris. Ces dernières années, de plus en plus d’avant-premières sont proposées aux journalistes dès la fin du printemps. Cela leur permet de s’avancer sur leur programme et d’anticiper la publication de listes de recommandations dès les premiers jours du Festival. Mais cette tendance a ses revers : il pousse le public à réserver de plus en plus tôt et favorise les compagnies ayant les moyens de s’adjoindre une ou un attaché de presse. Or, selon une enquête réalisée par l’AF&C, seules 30 % des compagnies ont engagé une ou un attaché de presse et/ou une ou un chargé de diffusion externe. Grande variété artistique Néanmoins, les succès du « off » 2025 reflètent la grande variété artistique de ce rendez-vous hors norme. Qu’il s’agisse de créations contemporaines comme Annette, de Clémentine Colpin, ou Made in France, de Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget ; de théâtre documentaire tel que Fast, d’Olivier Lenel et Didier Poiteaux sur les ravages de la fast-fashion ; de classiques revisités (Ubu président adapté par Mohamed Kacimi, L’Illusion comique mis en scène par Frédéric Cherboeuf) ; d’épopée historique (Cléopâtre. La reine louve, d’Eric Bouvron) ; de seuls-en-scène intimes (Michaël Hirsch, Mickaël Délis, etc.), toutes ces propositions, pour ne citer qu’elles, ont fait rapidement le plein. Attirant plus de 2 500 professionnels du spectacle vivant (programmateurs, diffuseurs, représentants de collectivités territoriales, etc.), le « off » est devenu un passage obligé aussi bien pour les compagnies émergentes que pour les producteurs déjà bien installés pour lesquels Avignon constitue une rampe de lancement avant une exploitation parisienne. En apparence, il y a une forme de paradoxe entre la vitalité de ce Festival et les contraintes actuelles de la filière du spectacle vivant confrontée aux coupes budgétaires des collectivités et aux difficultés de diffusion. Dans ce contexte, l’effet entonnoir du « off » ne cesse de croître. Il faut y être pour espérer décrocher des dates de tournées en France. Selon l’enquête menée par AF&C, 78 % des spectacles ne bénéficient pas de subventions publiques. Et les retombées de leur participation au Festival ne sont pas mirobolantes. Ainsi, 80 % des compagnies obtiennent entre zéro et cinq dates de tournée et environ 10 % entre cinq et quinze. Quant au prix de cession, il est très majoritairement inférieur à 4 000 euros par représentation. Alors que le « off » fêtera en 2026 son 60e anniversaire, des « assises nationales de la diffusion » vont être mises en place par l’association. Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo : Les affiches du Festival « off » d’Avignon, le 7 juillet 2025. ADÈLE BOSSARD/RADIO FRANCE/MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 1:43 PM
|
Par Olivier Milot, Sophie Rahal, Kilian Orain dans Télérama - 25 juillet 2025 Le metteur en scène Mohamed El Khatib semblait favori pour prendre la tête de l’institution. Mais au sein de l’exécutif parisien se déroule une bataille insidieuse pour imposer sa concurrente, Valérie Senghor. Récit, en quatre actes mouvementés. Réservé aux abonnés Lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/qui-dirigera-le-centquatre-le-feuilleton-rocambolesque-d-une-nomination-politique-7026766.php Alors, qui succédera à José Manuel Gonçalvès, emblématique patron du Centquatre, établissement tout aussi emblématique implanté dans le 19ᵉ arrondissement de la capitale, sur le vaste site (39 000 mètres carrés) des anciennes pompes funèbres de Paris ? Depuis mi-janvier et l’annonce de son départ, après cinq mandats successifs de trois ans, les noms circulent. Le paquebot parisien est réputé difficile à piloter. Il a même failli couler lorsque ses premiers directeurs (les metteurs en scène Robert Cantarella et Frédéric Fisbach) jetèrent l’éponge à l’issue de leur premier mandat (2008-2010). Aujourd’hui rayonnant, l’établissement pluridisciplinaire mêle toute l’année, dans une joyeuse ambiance, spectacle vivant, pratiques artistiques libres, résidences d’artistes, expositions (dont la Biennale Némo des arts numériques) et festivals : d’Impatience, consacré à l’émergence théâtrale, à Séquence Danse Paris, en passant par Circulation(s), consacré à la jeune photographie… Le tout agrémenté d’un café-restaurant, d’une librairie, d’espaces associatifs et d’un incubateur d’entreprises associé à un pôle d’ingénierie culturelle dont l’expertise s’exporte désormais à travers le monde. Un joyau, en somme, que la maire de Paris Anne Hidalgo aurait aimé voir dirigé par un artiste. Dès l’automne 2024, Thomas Jolly est approché, mais préfère décliner. Finalement, trois projets, portés par trois candidats aux profils différents, sont retenus en début d’année. Celui de Fériel Bakouri, directrice depuis 2017 de Points communs, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Celui de l’auteur, metteur en scène et plasticien Mohamed El Khatib, et celui de l’actuelle directrice générale adjointe du Centre des monuments nationaux (CMN), Valérie Senghor. Le futur patron (ou la future patronne) de l’établissement devrait prendre ses fonctions à la rentrée, le mandat de José Manuel Gonçalvès s’arrêtant en septembre. Mais aujourd’hui, plus rien n’est sûr. Le classique processus de nomination a déraillé, la bataille fait rage entre les soutiens de deux des candidats, le tout dans une ambiance de fin de règne d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Récit en coulisses d’une pièce en quatre actes dont l’épilogue reste à écrire. Acte 1 : Égalité parfaite Mercredi 21 mai, les trois candidats en lice défendent leurs chances, à l’oral, devant un jury composé de neuf membres. Tous ceux et celles que nous avons interrogés en conviennent : les trois projets sont d’une grande qualité. « Valérie Senghor arrivait avec une forme d’aura liée à son parcours, et une certaine légitimité car elle a déjà travaillé au Centquatre [dont elle a accompagné le lancement, jusqu’à en devenir la directrice du développement et de l’innovation entre 2016 et 2018, ndlr] : c’est rassurant quand on ne veut pas prendre de risque, se souvient l’une des personnes autour de la table. Mohamed El Khatib incarnait plus la fougue, l’audace, et une forme de prise de risque. Quant à Fériel Bakouri, bien que moins connue, elle a produit un travail sérieux et remarquable. Sa proposition était tout à fait valide, très tournée vers la culture urbaine même si, venant d’un site plus petit, la question s’est posée de sa capacité à gérer un tel espace. Elle avait tout pour devenir la candidate du consensus. » À l’issue de sa présentation, chaque candidat est interrogé par les membres du jury. Un échange classique dans ce type d’exercice qu’Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, va rompre, selon plusieurs témoins, par la différence de ton sur lequel elle s’adresse aux trois candidats. « Plutôt distante avec Fériel Bakouri, elle s’est montrée très avenante avec Valérie Senghor, mais carrément agressive envers Mohamed El Khatib », témoigne l’un des participants. L’échange entre les deux porte notamment sur la programmation pensée par le metteur en scène pour le Centquatre. « Elle lui a demandé de s’engager à ne pas programmer de manière excessive ses propres créations, ce qui est légitime », se souvient un autre membre du jury. Son programme, que nous avons consulté, prévoit de ne jouer que deux de ses pièces, seulement la première année. « Il y a la question, mais aussi la manière de la poser », conclut un troisième membre du jury. Malgré ce remous, les débats se poursuivent, puis vient le moment du vote. Résultat du scrutin : une égalité parfaite, chacun des candidats recueillant trois voix. Acte 2 : Mohamed El-Khatib sort en tête Le jury n’ayant pas réussi à départager les candidats, un second vote est organisé. Aucun débat entre les neuf membres cette fois : ils sont invités à exprimer leur préférence par retour d’un mail envoyé par les services de la Ville. La date limite du vote est fixée au 28 mai. Et le résultat est sans appel : six voix pour Mohamed El Khatib, trois pour Valérie Senghor. Le metteur en scène a rallié deux des trois voix qui s’étaient auparavant portées sur Fériel Bakouri, ainsi que celle du premier adjoint au maire de Paris, Patrick Bloche, qui avait voté Valérie Senghor au premier tour. « Par solidarité d’exécutif municipal avec Carine Rolland », adjointe d’Anne Hidalgo à la culture, précise-t-il. L’écart entre les deux finalistes est tel que beaucoup imaginent déjà Mohamed El Khatib à la tête du Centquatre. Acte 3 : Et si c’était plutôt Valérie Senghor ? Lundi 7 juillet, 10 heures du matin. Le conseil d’administration du Centquatre se réunit. Les dix-huit administrateurs sont présents ou représentés — la plupart en visio — à l’exception de l’ex-star du football brésilien (et du PSG) Raí Souza Vieira de Oliveira. Un seul point figure à l’ordre du jour : « La nomination du directeur ou de la directrice du Centquatre et l’autorisation donnée à la présidente de négocier et signer son contrat de travail. » L’enjeu est de taille. « Ce n’est pas une désignation quelconque, explique une connaisseuse du dossier, le Centquatre est situé dans un quartier complexe et ce lieu culturel est une réussite. Il ne faut pas se louper, au risque de tout gâcher. » Chose étrange pour un scrutin de cette importance, tous les administrateurs ne partent pas avec le même degré d’information. Les neuf qui ont fait partie du jury de présélection ont lu les projets des candidats, ont auditionné ces derniers, et peuvent donc émettre un vote en connaissance de cause. Non seulement les neuf autres n’ont pas interrogé les candidats, mais les trois projets ne leur ont pas été envoyés ! Autrement dit, la logique voudrait qu’ils suivent le résultat du vote du jury. Seulement voilà, Carine Rolland, adjointe à la culture, et en tant que telle présidente du conseil d’administration du Centquatre, annonce que le nom soumis au vote n’est pas celui de Mohamed El Khatib, mais celui de Valérie Senghor. Pour l’élue, l’annonce a quelque chose de schizophrénique. Elle qui a toujours été sincèrement convaincue de la pertinence de la candidature de Mohamed El Khatib, dont elle connaît et apprécie le travail, n’a pas le choix : elle doit se faire le relais de la proposition d’Anne Hidalgo et voter pour Valérie Senghor. « Carine marche sur une crête, raconte une administratrice, elle essaye à la fois de respecter le cadre de loyauté et de représentativité dans lequel elle évolue et, en même temps, d’assumer ses convictions. » Le choix de la maire de Paris a de quoi surprendre. Certes, le vote du jury n’est qu’indicatif, et rien n’oblige la maire à suivre sa recommandation. Mais dans ces conditions, à quoi sert ce long mécanisme de présélection ? « Rien ne va dans ce processus, s’agace une des membres du conseil d’administration. L’avis du jury sert à orienter le choix de la maire, à qui il revient de trancher quand l’écart est faible, mais là, il était important. Qu’est-ce qui justifie qu’on aille à l’encontre ? » Et pourquoi la maire de Paris, qui s’est ouvertement prononcée dans le passé en faveur de la nomination d’un artiste à la tête du Centquatre, ne saisit-elle pas cette opportunité de le faire en suivant la préconisation du jury ? Son entourage direct est partagé. Carine Rolland plaide pour Mohamed El Khatib, mais son premier adjoint Patrick Bloche s’est rangé dans le camp de Valérie Senghor. Quant à sa directrice des affaires culturelles, Aurélie Filippetti, elle a toujours défendu cette dernière, jusqu’à mener en sa faveur une campagne acharnée. Des proches d’Anne Hidalgo laissent entendre que la maire de Paris, qui ne se représentera pas en 2026, s’est trouvée affaiblie par la défaite de son candidat [Rémi Féraud, ndlr] à la primaire socialiste. Aussi se serait-elle désintéressée du dossier, laissant Patrick Bloche et Aurélie Filippetti prendre la main sur cette nomination. Une version contestée par Patrick Bloche et par la maire de Paris en personne, via son conseiller presse, qui précise qu’elle « a préféré Valérie Senghor car elle souhaitait une femme issue de la diversité ». C’est d’ailleurs l’argument que développe Patrick Bloche, chargé du service après-vente auprès du conseil d’administration. Les femmes ne sont pas assez nombreuses à diriger des institutions culturelles de poids, et sur les trois finalistes, la maire ne se voyait pas nommer le seul homme, explique-t-il. L’argument serait audible si la maire de Paris avait toujours fait preuve de constance en la matière. Or, en février 2023, elle nommait contre toute attente le metteur en scène Olivier Py à la tête du Théâtre du Châtelet. Sa candidature n’avait pourtant pas été retenue par le comité de sélection, qui lui avait préféré… deux femmes : Sandrina Martins (la directrice du Carreau du Temple à Paris) et Valérie Chevalier, directrice de l’Opéra de Montpellier. L’une et l’autre ont dû s’incliner devant le choix de la maire sans même pouvoir défendre leur projet. Aurélie Filippetti intervient à plusieurs reprises, au point d’agacer certains membres. Ce 7 juillet, Patrick Bloche jure que Valérie Senghor incarne le changement dans la continuité. Connue des salariés du Centquatre, elle y apporte sa vision tout en s’inscrivant dans le prolongement du projet de José-Manuel Gonçalvès. En outre, ajoute Patrick Bloche, le mandat à la direction du Centquatre étant de trois ans, elle laisse ainsi au (à la) futur(e) maire de Paris la possibilité de choisir, en 2028, une véritable candidature de rupture. On ne savait pas Anne Hidalgo aussi partageuse de son pouvoir… Le premier adjoint aborde enfin la question du management, expliquant que le Centquatre est un lieu complexe à diriger et interrogeant la capacité d’un artiste à le faire. Il vante par ailleurs « le management social et RH bienveillant » de Valérie Senghor lorsqu’elle y travaillait. Un discours auquel les deux représentants du personnel membres du conseil d’administration sont sensibles : lorsqu’ils prennent la parole ultérieurement, ils affirment que le choix de Valérie Senghor a quelque chose de « rassurant » car elle connaît le fonctionnement du lieu et ses équipes. Tout au long de ce conseil d’administration, le choix de Valérie Senghor est également appuyé par Aurélie Filippetti. L’ancienne ministre de la Culture intervient à plusieurs reprises, au point d’agacer certains membres : « Elle représente l’administration, ce n’est pas une élue et elle ne vote pas, elle n’a pas à prendre une place aussi prépondérante dans les débats », juge une administratrice. Rendez-vous en septembre Arrive enfin le moment du vote. Comme la plupart des participants sont en visio, celui-ci s’effectue à visage découvert. Une particularité qui contrevient au règlement intérieur de l’établissement, lequel prévoit un scrutin à bulletin secret. Dix voix se portent sur Valérie Senghor, dont celles de Carine Rolland, Patrick Bloche et des deux représentants du personnel. Les sept autres administrateurs s’abstiennent. « Pour quelles raisons ?, interroge un administrateur. Ce n’est pas un vote contre Valérie Senghor, mais ces abstentions ont neutralisé les votes en sa faveur, car pour beaucoup d’entre nous, la meilleure candidature était celle de Mohamed El Khatib. » Les statuts de l’établissement requérant que le candidat obtienne les deux-tiers des voix, Valérie Senghor est gratifiée d’une majorité insuffisante pour être élue. De l’avis de plusieurs membres du conseil, une discussion « lunaire » s’ensuit pour déterminer si cette majorité qualifiée doit se calculer sur la totalité des dix-huit membres du conseil [ce qui est juridiquement la règle pour un établissement public de coopération culturelle comme le Centquatre, ndlr], sur les seuls administrateurs représentés (17), ou s’il ne faut retenir que les suffrages exprimés (les voix pour ou contre et pas les abstentionnistes). Après trois heures de discussion, le conseil se clôt avec la promesse de se réunir le 11 juillet pour enfin désigner un successeur. « Ce conseil d’administration dématérialisé, où chacun était dans son coin avec, pour certains des problèmes de connexion, n’était pas la meilleure instance pour une telle élection », euphémise un des participants. Une autre est plus tranchée : « La réunion était mal préparée pour un sujet aussi sensible et engageant. » Acte 4 : Carine Rolland renvoie la dernière manche à septembre Jeudi 10 juillet, début de soirée. Un mail est envoyé à tous les administrateurs du Centquatre, signé de Carine Rolland : « La convocation d’un nouveau conseil d’administration, ce vendredi 11 juillet, ne permettant pas de garantir les conditions optimales pour une telle consultation, il semble important de vous laisser le temps pour ce faire. Soucieuse de réunir les conditions d’une décision collective éclairée et partagée, je vous propose de reporter notre conseil d’administration à partir de la dernière semaine d’août. Bien cordialement. » Quelle mouche a donc piqué l’élue à la culture pour reporter du jour au lendemain cette si importante réunion ? A-t-elle craint que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets ? Qu’un vote à nouveau prévu en visio ne soit invalidé ? Partagée entre sa loyauté qui l’obligerait à voter pour Valérie Senghor et sa préférence pour Mohamed El-Khatib, a-t-elle redouté que la première ne l’emporte ? « Elle fait tout pour empêcher son élection. Elle est dans une fuite en avant complètement folle », s’agace une proche du dossier. « Chacun dit ce qu’il veut. Les médias sont utilisés pour raconter des vérités alternatives », s’énerve de son côté Carine Rolland. Et maintenant ? Un nouveau conseil d’administration, en présentiel et avec vote à bulletin secret, est convoqué pour début septembre. Pour rejouer la même pièce, avec les mêmes acteurs dans les mêmes postures, avec au final un blocage qui obligerait à recommencer la procédure ? À moins que, dans le secret des urnes, avec une Anne Hidalgo affaiblie par son prochain départ de la mairie, certains se sentent plus libres de leur choix. « Ce conseil est souverain pour désigner le directeur du Centquatre. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Il faut arrêter de nous faire perdre notre temps. Nous sommes des adultes responsables et autonomes », assure une des abstentionnistes favorable à Mohamed El Khatib. « Valérie Senghor a obtenu dix voix, il lui en faut douze, on va rediscuter tranquillement, tempère un administrateur qui la défend. Les vacances seront passées par là. La chaleur sera retombée, la raison va revenir. » Manière de dire qu’elle avait déserté les débats en juillet Olivier Milot, Sophie Rahal, Kilian Orain / Télérama Légende photo : Le 1er octobre 2024 au Centquatre. Photo Martin Argyroglo/Divergence

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 6:17 PM
|
Propos recueillis par Anne Diatkine / Libération du 24 juillet 2025 L’écrivaine, que l’on a déjà vue sur scène et rencontrée au Festival d’Avignon, décrit ce qui l’anime dans les interactions entre acteurs et spectateurs et les apports du théâtre comparé à l’écriture. La romancière était à Avignon, notamment pour un débat sur la représentation des violences familiales organisé par Libération. Elle a plusieurs fois fait des lectures de ses textes sur scène et son livre Voyage dans l’Est a été adapté au théâtre par Stanislas Nordey. Inoubliable. On est en 1990, je vis à Nice, Vu du ciel, mon premier roman, vient de paraître. J’ai écrit une pièce, Corps plongé dans un liquide, je ne connais personne dans le monde du théâtre, pas le moindre acteur, assistant, qui pourrait m’orienter. Passe sur Arte une captation de Hamlet mis en scène par Patrice Chéreau avec Gérard Desarthe. Je suis folle devant ma télé. Folle devant cet acteur. Je me dis : cet acteur sait tout. Tout de l’humain, de l’amour, de la haine, du père, de la mère, de la société. Sa manière d’être Hamlet montre qu’il sait tout ce qu’il y a à savoir mais aussi tout ce qui échappe au savoir. Je ne connais pas Gérard Desarthe qui est alors une star du théâtre public. Je ne l’ai jamais vu. Mais je me dis «il faut qu’il lise ma pièce». Je trouve son adresse sur le Minitel. Je la lui envoie. Je ne m’attends à aucune réponse. Envoyer des manuscrits comme des bouteilles à la mer, à l’époque, je ne fais que ça. Et quelques jours plus tard, c’est lui au téléphone, sa voix est forte. Il a lu : «T’es qui ? Comment tu t’appelles ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu seras à Avignon cet été ?» Comme si c’était normal, évident d’aller à Avignon. Je réponds : «Oui je peux y aller.» Et lui : «Je serai à l’hôtel d’Europe.» On se donne rendez-vous. J’arrive à l’hôtel d’Europe, je le vois descendre l’escalier, j’ai le cœur qui bat. On s’assoit à une table. Et la première chose qu’il me dit, c’est : «Avant tout, il faut que tu m’excuses parce que, moi, je ne suis pas écrivain, je n’ai pas été à l’école très longtemps, il m’arrive de faire des fautes de français.» Et on part dans je ne sais pas combien d’heures de conversations sur Corneille, le Cid, qu’il monte à ce moment-là, et il me dit une phrase que je ne relève pas mais attrape au vol : «Ce sont les pères qui tuent les enfants.» Vous êtes parfois sur scène pour des lectures impressionnantes. Des performances ? Je n’appellerais pas ça «performance». Même si je fais un montage précis du texte, une dramaturgie, que je répète, et que la lecture dépend des lieux. Ça ne peut pas être le même montage et les mêmes déplacements à la Bourse de commerce, à la Maison de la poésie ou la Villa Médicis. Dans tous les cas, quel que soit le lieu, il y a un impératif : je ne veux pas que la lumière soit éteinte, que le public soit dans le noir. J’ai besoin d’être au présent, de m’adresser à, et de voir. Quand on parle à quelqu’un, c’est mieux de le voir, de saisir cette relation. Ce n’est pas une représentation. Je ne suis pas une actrice. Aller au théâtre : avec quel espoir ? La lecture seul chez soi est un art. Peut l’être. Doit l’être. Le lecteur est l’interprète de la partition écrite. On va au théâtre pour voir quelque chose arriver. Un livre, un film n’ont pas le même rapport au présent. Mes déceptions au théâtre, c’est quand j’ai l’impression qu’il ne se passe rien. Le spectacle peut être intéressant, il se déroule, mais il n’arrive rien, et il ne m’arrive rien. C’est la question de la «présence». Quand elle est là, à l’inverse, c’est extraordinaire. Ça peut être avec un classique, les Fausses confidences montées par Alain Françon que j’ai vu à Nanterre, et au Théâtre de la Porte Saint-Martin, et les deux fois la révélation de ce qu’on sait déjà se répète, se remanifeste. A savoir : il est possible que tout soit dit. Le langage sait faire ça. Mais pour qu’on entende tout ce qu’il y a à dire à propos de l’amour, de l’humain, des classes sociales, des stratégies du langage, dix mille détails sont à l’œuvre : une pause à tel instant, une hésitation, le retrait d’un mot ou au contraire sa mise en évidence, tel objet, tel geste. Ce sont des irisations de lumière créées par le texte, et saisies en totalité par Françon. Il faut bien qu’il devienne auteur du texte de Marivaux, pour que les mots soient là, pleinement vivants, devant nous en 2025. Et la révélation produite par le spectacle, par les acteurs, c’est celle que la langue peut tout faire. C’est une joie incommensurable. Marivaux écrit la pièce à partir de son extrême intelligence de la langue, mais de la société, mais des rapports de force mais des classes sociales. Françon, lui, fait briller le soleil. Parfois, vous êtes l’auteur du texte sur scène… Et dans ce cas, on peut avoir la crainte qu’il y ait des petits cailloux, des moments de gêne plus ou moins légère qui enrayent le texte tel que je l’ai écrit et que la partition se retrouve faussée au plateau. Et se dire alors : «Ce n’est pas ce que j’ai écrit ?» Après la première par Stanislas Nordey du Voyage dans l’Est, pour lui dire ma gratitude immense, je ne lui ai dit qu’une chose : «Rien ne m’a gênée.» Peut-on avoir la mémoire de spectacles que l’on n’a pas vus ? Il y a une ancienne journaliste de Libération, Mathilde la Bardonnie, qui dans sa délicatesse, dans sa très grande sensibilité, dans son écriture, me donnait l’impression de tout voir des spectacles que je n’avais pas vus. Les critiques jouent un rôle particulier au théâtre, ils écrivent ce qui ne reste pas. Vous pourriez dormir au théâtre ? Je ne sais pas m’absenter. Donc quand je n’aime pas ou suis imperméable à ce que je vois, je ressens un ennui que je ne supporte pas. Je ne peux pas attendre que ça se passe les bras croisés. Mais c’est hautement social le théâtre. Dans son fauteuil, on est coincé. Si on bouge, si l’ennui se voit, si on part, c’est à la vue. Et on interfère dans le spectacle. La langue invitée est l’arabe. Mais la langue qui s’invite en vous, c’est laquelle ?
|
Par Valentin Pérez dans Le Monde - 10 août 2025 Depuis plusieurs mois, le théâtre est devenu une place forte de la pensée féministe à travers les adaptations de manifestes et pamphlets signés Monique Wittig, Ovidie ou Virginie Despentes. Face au « backlash » que connaît le mouvement MeToo, actrices et metteuses en scène y trouvent un espace où faire entendre la radicalité de ces textes.
Lire l'article sur le site du "Monde" ; https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2025/08/10/la-chair-est-triste-helas-o-guerilleres-king-kong-theorie-a-la-rentree-le-feminisme-brule-les-planches_6627958_4500055.html Elle se revoit en train d’aiguiser son texte un été, isolée, donnant à son témoignage de l’allant, une intensité, avec ce style cash bien à elle. « Oui, nous, hétérosexuelles, sommes des putes gratuites, que nous nous vendions à un seul homme ou à la masse », lâche Ovidie dans La chair est triste hélas, court récit à succès, paru chez Julliard en 2023 (et en poche aux éditions Points en 2024), coup de boutoir contre le patriarcat et l’apathie confortable des hommes hétéros dans les relations sentimentales. « J’avais écrit ce texte dans la claustration et, tout à coup, j’entendais dire que des meufs organisaient des apéros où elles se lisaient des extraits, des journalistes me racontaient qu’elles prononçaient des passages à haute voix dans l’open space pour agacer leurs collègues, s’amuse aujourd’hui l’autrice. Lorsque j’ai fait des lectures musicales, des spectatrices riaient même, alors que je pensais avoir écrit un texte dramatique. »
Voilà ce qui a décidé l’essayiste et documentariste à transposer sa prose sur les planches. « Dans le collectif advient une jubilation qui n’existe pas forcément quand on écrit ou qu’on lit seul chez soi », note-t-elle. Au Théâtre de l’Atelier, à Paris, à partir du 9 septembre, l’actrice Anna Mouglalis s’emparera donc, sous sa direction, de La chair est triste hélas, qu’elle donnera de sa voix grave inimitable, seule en scène, le corps quelquefois couvert par des projections vidéo. Têtes hautes et voix qui portent Essais, pamphlets, manifestes… Depuis quelques mois et pour la saison 2025-2026, le spectacle vivant fait de la place à un féminisme fier et revendicatif, têtes hautes et voix qui portent. Après le SCUM Manifesto (1967) de Valerie Solanas, bréviaire antipatriarcal porté au Théâtre national de Strasbourg l’an passé par le jeune collectif FASP (Beretta 68), La Pensée straight (1992) de Monique Wittig, tube du lesbianisme radical, va nourrir une création de la comédienne Adèle Haenel, de la batteuse Caro Geryl et du groupe « pop et révolutionnaire » DameChevaliers, programmée dans le cadre du Festival d’automne. Intitulé Voir clair avec Monique Wittig, le spectacle, qu’on pourra découvrir en octobre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, promet de propager, dixit son argumentaire, une « pensée qui redresse et décuple la puissance de chacune et chacun ». Dans un autre genre, Anna Mouglalis sera en tournée cet automne, de Toulouse à Nantes, d’Annecy à Metz, au sein du groupe DRAGA, pour Ô Guérillères, récit en musique des Guérillères (1969), un roman éloge de l’esprit communautaire, pareillement signé Monique Wittig. « Revenir aux textes fondamentaux réénergise toujours », se réjouit la metteuse en scène Vanessa Larré, dont l’adaptation du King Kong Théorie (2006) de Virginie Despentes reviendra à Paris en novembre. Bien sûr, la rencontre entre militantisme et créations théâtrales ne date pas d’hier. Le théâtre a pu faire office de tribune dès la vague du suffragisme avec des autrices comme Nelly Roussel (1878-1922) ou Vera Starkoff (1867-1923) et, évidemment, à la grande époque du MLF. « Alors qu’Ariane Mnouchkine [qui débute en 1959] faisait figure d’exception, des comédiennes ont commencé à s’approprier la mise en scène et l’écriture théâtrale. Leurs créations dialoguent alors parfois avec l’actualité. On peut penser à des pièces qui abordent la question de l’IVG au moment des débats sur la loi Veil [de 1975], comme Légère en août, de Denise Bonal, mise en scène par Viviane Théophilidès en 1974, ou La Femme aux ciseaux, du Théâtre-Action de Grenoble en 1975 », resitue Lorraine Wiss, docteure en études théâtrales et autrice de Scènes féministes. Histoire d’un théâtre militant dans les années 1970, à paraître en novembre chez ENS Editions. Revendication émancipatrice La déflagration du mouvement MeToo, à partir de 2017, fait naître à son tour son lot de pièces à revendication émancipatrice de la part de jeunes metteuses en scène qui adoptent le ton de la comédie (Féminines, de Pauline Bureau en 2019, autour d’une équipe de foot féminin), du drame social (7 minutes, de Maëlle Poésy, en 2021), ou qui remettent en lumière des figures « oubliées ». Ainsi, de l’actrice et militante Delphine Seyrig (1932-1990), fantôme omniprésent, reconvoqué sur les plateaux (chez Raphaëlle Rousseau ou Marie Rémond et Caroline Arrouas) et qui a fait l’objet de multiples biographies ces deux dernières années – dont une nouvelle, signée Florence Andoka, que publieront les Editions de la Variation à la mi-septembre. En 2025, tandis que les féministes s’inquiètent du backlash qui menace leurs conquêtes, attisé par la vigueur des mouvements masculinistes, les créations théâtrales se font plus assertives. « Dans l’audiovisuel ou l’édition, on nous fait comprendre depuis quelques mois que ces histoires de violences sexistes et sexuelles, on en a un peu soupé », constate Ovidie. Voir portées sur les planches Solanas, Wittig ou Despentes – « des textes cousins », comme elle dit – « laisse penser que le théâtre est peut-être un bastion où les idées féministes peuvent encore s’exprimer avec une dose de radicalité ». Sa lecture de King Kong Théorie, Vanessa Larré continue de la comparer à un vent d’air frais : « C’était comme ouvrir une fenêtre dans une maison aux murs moisis. » En 2014, pour adapter le manifeste, la metteuse en scène avait donné à l’intrigue une structure bâtie autour de trois employées d’un supermarché échangeant lors d’une pause-café. Il y a quelques mois, lorsqu’elle a repris la pièce, à la demande du Théâtre Silvia Monfort, « j’ai compris qu’on n’avait plus besoin de ça, explique-t-elle, qu’il fallait un plateau plus pur, plus radical ». Ainsi, le compositeur a troqué sa bande-son délicate pour une partition plus sonore, interprétée en live ; les trois comédiennes, émancipées de leurs personnages, offrent le pamphlet au public de façon plus frontale, sans prétexte narratif. Comme si, pour se faire entendre, l’époque réclamait de parler nettement et sans détour. Ou, comme encourage Vanessa Larré, d’« aller dans le pli des choses et moins en surface ». La chair est triste hélas, de et mis en scène par Ovidie, avec Anna Mouglalis. Au Théâtre de l’Atelier, du 9 septembre au 25 octobre. theatre-atelier.com Ô Guérillères, d’après Les Guérillères, de Monique Wittig, création de DRAGA. En tournée à partir du 26 septembre. Voir clair avec Monique Wittig, création d’Adèle Haenel, Caro Geryl et DameChevaliers. Au Théâtre des Bouffes du Nord, du 8 au 12 octobre. festival-automne.com King Kong Théorie, de Virginie Despentes, mis en scène par Vanessa Larré. Au Théâtre Silvia Monfort, du 14 au 22 novembre, et au Mans en janvier 2026. theatresilviamonfort.eu Valentin Pérez / Le Monde Légende photo : Reprise de « King Kong Théorie », au Théâtre Silvia Monfort, à Paris, en juin 2024. Photo © HERVÉ BELLAMY

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 8, 7:27 AM
|
Par Sandrine Blanchard (Alloue (Charente), envoyée spéciale du Monde), publié le 7 août 2025
Entièrement rénové, le logis de l’illustre comédienne est désormais ouvert à tous. Et le domaine de la Vergne, en Charente, bat au rythme du Festival d’été jusqu’au 16 août.
Lire l'article entier sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/08/07/a-la-maison-maria-casares-une-belle-ambiance-entre-patrimoine-et-theatre-contemporain_6627337_3246.html Dormir dans la chambre de Maria Casarès, petit-déjeuner dans sa salle à manger, bouquiner dans sa bibliothèque, flâner dans son salon… Depuis le 26 juillet, le logis du domaine de la Vergne, niché dans la Charente limousine, où l’illustre comédienne (1922-1996) vécut régulièrement de 1961 jusqu’à sa mort, est désormais accessible à tous : aux artistes en résidence comme aux festivaliers et autres amoureux de l’art. La tragédienne, exilée de l’Espagne de Franco, qui fit don de ce domaine au village voisin d’Alloue en remerciement à la France pour avoir été une terre d’asile, serait sans doute heureuse de savoir qu’il est désormais entièrement restauré et consacré à la culture. Des papiers peints aux meubles rustiques, l’esprit du lieu, à la fois simple et chaleureux, a été préservé grâce à une restauration à l’identique, et cinq chambres d’hôtes peuvent y être louées. Cette rénovation, financée à hauteur de 1,2 million d’euros par l’Etat, les collectivités locales et la Fondation du patrimoine, signe la dernière étape de la métamorphose du domaine de la Vergne, inscrit monument historique, en lieu réservé au théâtre contemporain, au patrimoine et aux repas partagés. Depuis 2017, la comédienne Johanna Silberstein et le metteur en scène Matthieu Roy ont pris, avec succès, la direction de ce centre culturel de rencontre. A leurs compétences artistiques se sont ajoutées celles de « gestionnaire, maître d’ouvrage, hôtelier, restaurateur », listent-ils avec le sourire. Il faut tout ça, et beaucoup de persévérance et de passion, pour faire vivre chaque année cette initiative culturelle en milieu rural. En ce mardi 29 juillet, le désormais traditionnel Festival d’été démarre sous les meilleurs auspices – trois semaines de festivités du 26 juillet au 16 août, soit le temps fort du lieu qui, au printemps et à l’automne, accueille des artistes en résidence et des ateliers de théâtre pour les collégiens et les lycéens de la région. De 1 000 entrées lors de la première édition il y a huit ans, la fréquentation devrait atteindre 8 000 entrées cette année grâce à une fidélisation du public, composé pour moitié de Charentais. Il faut dire que le cadre est idyllique et le programme généreux. Le tout compose une sorte d’art de vivre commun entre spectateurs et artistes. Trois rendez-vous théâtraux Dans une campagne vallonnée et verdoyante, les festivaliers ou simples visiteurs peuvent se promener dans les cinq hectares de jardin et, équipés d’un casque audio, écouter, en longeant un bras de la Charente, des extraits de la correspondance amoureuse entre les deux amants, Maria Casarès et Albert Camus (Correspondance 1944-1959, publiée en 2017 chez Gallimard). « Tu es ma certitude, ma liberté, je t’aime pour toujours », écrit l’auteur de L’Etranger (1942) à la comédienne. « Comment va mon éternel angoissé ? Je trouverai toutes les patiences pour te laisser en paix pendant que tu travailles. Je t’aime à en mourir », lui répond-elle. Cette balade sonore d’une grande intimité est d’autant plus touchante que cet amour se fracassa en 1960 avec la mort, dans un accident de voiture, d’Albert Camus. Anéantie par cette disparition, Maria Casarès, alors âgée de 38 ans, cherchera un refuge, une terre où s’ancrer, tombera sous le charme du domaine de la Vergne et l’achètera avec le comédien André Schlesser (1914-1985), son compagnon de route, qui deviendra son mari en 1978. Les promenades sonores et les visites guidées du logis ne sont qu’un des aspects du Festival d’été. Au-delà de ces expériences patrimoniales, les responsables des lieux ont imaginé trois rendez-vous théâtraux ponctuant chaque journée : goûter-spectacle, apéro-spectacle, dîner-spectacle, en salle ou en plein air. Le concept prend des allures de fêtes de famille estivales. Matthieu Roy accueille les spectateurs, déroule le menu qui les attend, et, à l’issue des représentations, les comédiens et comédiennes leur servent les viennoiseries, les verres de pineau ou les plats chauds servis en bocaux. « Nous voulons trouver un autre rapport au public », défend Johanna Silberstein. La programmation repose sur trois piliers : un artiste issu du dispositif Jeunes pousses (soutien à des metteurs en scène diplômés depuis moins de cinq ans), une compagnie régionale et une pièce du répertoire de la Compagnie Veilleur, dirigée par Matthieu Roy et Johanna Silberstein. « Nous souhaitons partager des esthétiques diverses et assumons des sujets engagés », explique le duo. Sujets de société A l’heure du goûter, le spectacle familial Prélude en bleu majeur, de la compagnie Choc Trio, offre un voyage enchanteur et burlesque à partir de l’œuvre de Kandinsky. Monsieur Maurice (interprété avec justesse par Claude Cordier), tel Charlot dans Les Temps modernes (1936), enfermé dans un quotidien gris et répétitif, va voir son ordinaire bousculé par l’apparition d’une balle bleue. L’univers de Kandinsky se met à éclabousser murs et cartons dans une ambiance à la fois clownesque et poétique. Répété au domaine d’Alloue, en 2019, lors d’une résidence, ce spectacle a, depuis, été joué plus de 400 fois. Timlideur, une histoire de militantisme, proposé pour le dîner-spectacle, a, lui, été présenté en mai 2024 aux rencontres Jeunes pousses de la Maison Maria Casarès avant d’y être créé en septembre. Grâce à ce Festival d’été, la jeune troupe lyonnaise, emmenée par le metteur en scène Grégoire Vauquois, bénéficie de dix-neuf représentations, « presque comme un petit Avignon “off” », souligne Matthieu Roy. Cette fiction-documentaire, comme la définit son auteur, plonge les festivaliers dans l’itinéraire d’un jeune étudiant sans histoire, convaincu que la crise climatique est le grand combat du XXIe siècle et qui, au-delà de ses gestes écologiques individuels, se met en tête de rejoindre une association pour être « au cœur de l’action ». En plein air, à l’arrière de la Maison Maria Casarès, il est question de « bloquer la République des pollueurs » en occupant, notamment, le hall du ministère de l’écologie. Engagée, cette pièce politique évite le piège du pensum moraliste en instillant de la drôlerie. Surtout, elle est portée par cinq jeunes comédiennes et comédiens au talent rafraîchissant. Avant eux, lors de l’apéro-spectacle, un autre sujet de société, celui du monde du travail et de ses absurdités, est proposé avec l’adaptation par Matthieu Roy du roman de Mariette Navarro, Palais de verre (Quidam, 2024). Soit une femme, employée modèle, « parfait rouage » d’une grande institution, qui, un jour, « n’adhère plus », ne comprend plus les « nouvelles directives » et se détache peu à peu de cet univers de soumission, en quête d’une nouvelle liberté. Création de la Compagnie Veilleur, cette pièce sera reprise au cours de l’hiver à La Scène Maria-Casarès à Poitiers, le pendant « citadin » de la maison charentaise ouvert depuis octobre 2023. A l’issue du dîner-spectacle, 116 spectateurs se retrouvent pour un repas sous les tilleuls dans une ambiance de guinguette. « Dites donc, c’est de plus en plus engagé vos spectacles, attention », interpelle un retraité, habitué du festival. « C’est bien, continuez comme ça, se réjouit une autre convive qui vient aussi à chaque édition. C’est ma sortie théâtrale de l’année. Je ne regarde même pas le programme, je fais confiance et je viens. » Bénévoles indispensables Comme la plupart des initiatives culturelles, le modèle économique de la Maison Maria Casarès est fragile et tient, en partie, grâce à 20 % de fonds propres issus de privatisations (pour des mariages, des séminaires, etc.). « Avec la fin des travaux de rénovation, nous avons, grâce à l’investissement, un outil en ordre de marche. Mais quid du fonctionnement ? », s’interroge Matthieu Roy. La structure, qui participe à l’animation du territoire, n’a obtenu aucun financement du plan Culture et ruralité, lancé en 2024 par le ministère de la culture. Et le metteur en scène ne cache pas son inquiétude quant au renouvellement du soutien financier de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour le dispositif Jeunes pousses. La Maison Maria Casarès, c’est sans doute Nadine Boutant qui en parle mieux. Cette agricultrice fait partie des bénévoles indispensables – au-delà de la petite équipe rattachée au lieu – à la bonne marche de cette aventure culturelle. Elle aide notamment à l’organisation des repas et pour rien au monde ne louperait la moindre soirée de ce Festival d’été. « Ça fait partie de ma vie, ça me permet de sortir, ce sont mes vacances. J’ai toujours des frissons quand je franchis l’entrée du domaine et j’admire le travail des troupes de théâtre », témoigne Nadine sans cacher son émotion. En 2024, après avoir assisté à une réunion locale consacrée au plan Culture et ruralité, elle a, « exceptionnellement », écrit un courrier à Rachida Dati, à la DRAC et à la sous-préfète. « Les agriculteurs n’osent pas venir au théâtre, ils pensent que ce n’est pas pour eux. Mais une fois qu’ils ont assisté à une représentation, leur opinion change, écrit-elle. Il faut défendre ces lieux qui rapprochent les gens et créent du lien social. » Festival d’été de la Maison Maria Casarès, Alloue (Charente). Jusqu’au 16 août. Sandrine Blanchard (Alloue (Charente), envoyée spéciale) Sandrine Blanchard / Le Monde Légende photo : Le repas partagé sous les tilleuls après le dîner-spectacle lors du Festival d’été à la Maison Maria Casarès, à Alloue (Charente), le 26 juillet 2025. JOSEPH BANDERET

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 5, 2:37 PM
|
Pour redynamiser une zone rurale de l’île, le comédien a imaginé en 1998 des Rencontres internationales qui réunissent tous les étés des dizaines d’acteurs amateurs. «Libé» a assisté aux dernières répétitions avant les représentations. Au détour d’un des nombreux virages de cette route de montagne, sa brusque apparition semble aussi incongrue qu’évidente. Le cube de bois massif d’A Stazzona («la forge»), construit en pin laricio, s’impose dans une forêt de ces conifères endémiques du pays corse. Au fond du plateau de ce théâtre qui abrite les activités de l’Aria (association des rencontres internationales artistiques), de larges ouvertures donnent sur la vallée verdoyante. Ce milieu d’été est un temps fort du lieu : c’est la dernière semaine des Rencontres internationales de théâtre, stage de création en immersion qui réunit près d’un mois durant une centaine de comédiens et techniciens de tout âge, avant une restitution à ciel ouvert dans quatre villages des environs. C’est avec cette région enclavée du Giussani, parfois appelée Haute-Balagne, que Robin Renucci a décidé de renouer il y a près de trente ans – son grand-père y était forgeron, sa mère couturière. Dans le village d’Olmi-Cappella, un certain Noël Battaglini, enfant du coin ayant fait fortune en Egypte, avait bien financé en 1898 un bâtiment abritant différents services publics mais un siècle plus tard, la désertification qui touche peu à peu les villages de Corse a gagné du terrain. En s’y installant avec ses quatre enfants, Robin Renucci double l’effectif de l’école sur le point de fermer et fait un pari un peu fou : le regain d’attractivité du coin passera par le théâtre. Ainsi naît l’Aria, en 1998. «Ce n’était pas un sauvetage, mais une volonté politique», précise l’intéressé, œil mi-sévère mi-pétillant derrière de petites lunettes cerclées. Son constat est alors sans appel : «La décentralisation culturelle s’est arrêtée aux portes de Marseille» – il y dirige depuis 2022 le théâtre La Criée. On ne compte ni centre dramatique ni scène nationale en Corse. Une culture «décentralisée» Œuvrer à sortir du «rapport binaire entre ceux qui font et ceux qui voient», s’investir à son tour dans l’éducation populaire qui l’a façonné, lui paraît «un contre-don» essentiel. Habitants et élus locaux des quatre communes mitoyennes (Olmi-Cappella, Pioggiola, Vallica et Mausoléo) sont alors réunis autour de la table pour concertation ; c’est la naissance du SMG (syndicat mixte du Giussani), qui servira à lever les fonds du projet. A ses débuts, celui-ci s’articule d’abord autour de deux chantiers : réhabiliter le «bâtiment Battaglini» et créer un théâtre ex nihilo – A Stazzona est inauguré en 2010. Près de trente ans plus tard, Renucci a largement délégué la gestion quotidienne de ce qu’il appelle son «utopie en marche». Les retombées sociales de la création de l’Aria sont en tout cas manifestes : l’association, qui propose stages et formations même en basse saison, est le premier employeur de cette région rurale redynamisée. Le cadre hors du commun lui a d’ailleurs valu en 2021 l’appellation CCR (centre culturel de rencontre), label d’Etat qui salue une initiative de rencontre culturelle, artistique ou intellectuelle au sein d’un lieu patrimonial. Incontournable rendez-vous estival, les Rencontres n’ont pas beaucoup changé depuis leur création, mêlant néophytes et professionnels, la démarche permet d’amener au théâtre différents profils de la société civile. Cette année, on compte même une procureure. Sélectionnée pour conserver cette cohérence, l’équipe pédagogique partage cet idéal d’un théâtre populaire. Hugo Roux, intervenant de cette dernière édition (son adaptation des Estivants de Gorki se jouera sur la place de l’église de Pioggiola), était d’ailleurs sur la short list pour la direction du Théâtre du peuple à Bussang dans les Vosges. «Ma pratique est nourrie de ces réflexions autour d’une culture “décentralisée”, “située”, du lien entre un territoire et ses habitants, raconte-t-il attablé à l’osteria du bord de route, à l’abri de l’orage qui gronde en contrebas. Ici, jouer en extérieur, c’est croiser tous les jours des habitants qui passent par là, s’arrêtent et nous interrogent, ce qui n’arriverait pas dans un théâtre dont on n’ose pas pousser la porte.» L’été 2025 marque une nouvelle inauguration : celle du théâtre de verdure de Vallica, qui jouxte l’héliport désaffecté. A quelques mètres de l’ancienne aghia, aire de battage du blé piétinée par les bœufs, se tient un modèle réduit d’amphithéâtre gréco-romain. Derrière l’estrade circulaire en bas des gradins, se découpe le village de Vallica, toile de fond si imposante qu’elle étouffe presque dans l’œuf toute velléité scénographique. Carnaval et ChatGPT Ce samedi 2 août était programmé un Roméo et Juliette aux accents brésiliens avec des duels inspirés par la capoeira et accompagnés par la guitare de Lisandre, un habitant du village. Le spectacle est prévu au crépuscule mais en cet après-midi de filage, les acteurs se protègent comme ils peuvent de la morsure du soleil. Ici ce sont les stagiaires qui choisissent leurs intervenants et non l’inverse. Les places naviguent et s’échangent : Geneviève (qui joue Lady Capulet), qui envisage une reconversion dans le théâtre, a été spectatrice trois étés d’affilée avant de franchir le cap des Rencontres. Sarah avait 8 ans quand elle s’est greffée à une représentation des acteurs en herbe, les ateliers de création pour les enfants, et y revient vingt ans plus tard avec la ferme intention de croiser sa passion et le territoire où elle a grandi. Côté formateurs, le passif théâtral des stagiaires n’intéresse que peu : tous seront acteurs à part entière le temps de cette parenthèse immersive dont le lieu a fait sa raison d’être. Habitués à subir la restriction constante de moyens techniques et humains, les intervenants savourent pleinement le plaisir de diriger une équipe d’au moins dix acteurs, source d’énergie précieuse. Il faut prendre garde à refermer le portail rouillé (et franchement dézingué) pour empêcher les vaches de s’introduire dans le champ où Serge Nicolaï a établi ses quartiers, derrière l’église d’Olmi-Cappella. Sur la petite estrade recouverte de tapis, à l’ombre des pins, son groupe est en pleine «allemande», technique de répétition centrée sur les déplacements et l’appropriation de l’espace scénique. Cet hiver, cet ancien du Théâtre du Soleil, qui assure depuis dix ans la fonction de directeur artistique de l’Aria et y pilote toute l’année des activités, a choisi de relancer un carnaval dans la vallée. Les masques exhumés des réserves pour l’occasion s’apprêtent à servir à nouveau pour Oh my Graal ! une composition inspirée entre autres des Monty Python, du mythe du roi Arthur et de «quelques monologues shakespeariens imaginés avec l’aide de ChatGPT». En remontant vers Pioggiola, à quelques mètres d’A Stazzona, Charlotte de Casanova a de son côté préféré le repli d’un sous-bois. Son groupe exclusivement féminin se sent bien dans ce lieu encaissé, où la lumière dorée perce par intermittence à travers les feuillages. La nervosité est palpable en cette dernière semaine de travail : les équipes sont épuisées, stressées par l’imminence des restitutions face au public. Au pied d’un hamac, en contrebas, les filles avalent à la hâte leurs paniers repas avant le filage du soir. «Bienvenue dans nos loges». Les représentations se déroulent jusqu’au 9 août dans les villages de Pioggiola, Olmi-Cappella et Vallica. Copélia Mainardi /Libération Légende photo : Le cube d'A Stazzona dans l'écrin de verdure du Giussani. (Raphaël Poletti/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 5, 10:21 AM
|
Par Fabienne Darge / Le Monde - le 31 juillet 2025 RÉCIT « Le théâtre avance masqué » (4/6). « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, le masque de commedia dell’arte, avec son célèbre Arlequin, affublé d’un nez camus et d’une étrange verrue. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/07/31/le-masque-de-commedia-dell-arte-ou-la-marque-du-diable_6625636_3451060.html
Pourquoi Arlequin a-t-il un bouton sur le front ? C’est qu’il est un peu diabolique, l’animal. Et sa bosse est la trace laissée par la corne du Malin. L’Italie du XVIe siècle a beau être déjà largement entrée dans la Renaissance, contrairement à la France, les représentations médiévales y sont encore présentes. Avec la commedia dell’arte, qui s’invente dans la région de Padoue aux alentours de 1545, le théâtre occidental renoue avec le masque, qui avait disparu depuis l’Antiquité gréco-romaine. D’où vient la réapparition de cet artefact, dont le nom italien, maschera, désigne aussi bien l’objet que le type de personnage qu’il incarne, Arlequin, Pantalon, Pulcinella ou Brighella ? Le masque de commedia est-il emblématique de ce qui se joue dans cette charnière entre le Moyen Age et l’ère moderne ? Françoise Decroisette, professeure émérite de l’université Paris-VIII en études italiennes, voit d’abord dans cette renaissance du masque l’effet de circonstances historiques et politiques. « La commedia dell’arte se caractérise au départ par la volonté d’acteurs de se regrouper et de se structurer de manière professionnelle. Ces compagnies voulaient se démarquer du théâtre d’académie destiné à un public restreint, pour toucher une audience plus large. Ils vont donc inventer une manière de jouer beaucoup plus plastique, en repartant des personnages de la comédie classique et en les façonnant pour qu’ils soient reconnaissables par tous. D’où les masques, qui permettent aux personnages d’être immédiatement identifiables à l’œil. Mais, pour autant, tous les rôles de la commedia ne sont pas masqués : les amoureux et les femmes, notamment, ne le sont pas. » Fonction de caricature Les masques, dans la République de Venise du XVIe siècle, où règne une certaine liberté, ont d’abord une fonction de caricature, pour les personnages de vieillards ou de notables comme Pantalon, dont sont tournés en ridicule l’autoritarisme, la prétention, la cupidité et l’incompétence. « Ces troupes se moquaient de beaucoup de monde dans la société : la noblesse, les puissants, les doctes… Et pour cela elles ont été rapidement condamnées. Comme on ne pouvait pas les censurer, car elles travaillaient sans textes écrits, avec des canevas sur lesquels elles improvisaient, elles ont souvent été excommuniées et expulsées », explique Françoise Decroisette. L’Eglise voit le masque, cet objet qui se permet de changer le visage que Dieu vous a donné, d’un très mauvais œil. Singulièrement les masques de valets, les zani, dont celui d’Arlequin, qui devient peu à peu le symbole de la commedia dell’arte. Que signifie cette tête noire, au nez camus, percée de trous très petits pour les yeux, au front plissé arborant cette sorte de verrue étrange ? De là à voir dans ces masques « un travestissement diabolique, survivance métonymique de l’Homo salvaticus médiéval (mi-homme, mi-bête) », comme l’écrit le chercheur italien Siro Ferrone dans son ouvrage La Commedia dell’arte. Actrices et acteurs italiens en Europe (XVIe-XVIIIe siècle) (Sorbonne Université Presses, 2024), il n’y avait qu’un pas. Dont auraient joué en toute connaissance de cause les troupes de l’époque, pour séduire et épouvanter le public, fasciné par l’incursion dans les profondeurs de l’enfer représentée par ce visage. Pour Françoise Decroisette, l’explication, là encore, est peut-être plus simple, et historiquement ancrée. « Arlequin, c’est d’abord un acteur, Tristano Martinelli [1557-1630], qui est probablement le premier à utiliser ce nom pour le rôle du second zani. Or ce nom d’Arlequin est sans doute lié à l’Hellequin, un diablotin malveillant des légendes médiévales françaises que l’on retrouve aussi sous le nom d’Alichino dans La Divine Comédie, de Dante. Son origine est donc diabolique, mais en même temps Arlequin est sympathique, parce qu’il apparaît comme un peu idiot au départ et se révèle finalement plus futé qu’il n’en avait l’air. Pour un large public, il est l’occasion de s’identifier à un personnage un peu naïf, qui aime les femmes et qui a toujours faim – la faim est une donnée très importante, à cette époque. » « Du cuir de semelle » Par rapport aux masques grecs et asiatiques qui couvrent le visage, celui de la commedia est un demi-masque qui a été pensé pour que l’acteur n’ait pas le visage entièrement recouvert et puisse parler. Le demi-visage du comédien complète le masque, qui est donc un hybride entre le caractère diabolique et la figure et la voix humaines. Mi-homme mi-démon, et cela dans un personnage comique : on sait que la figuration humoristique du diable est un expédient populaire adopté depuis les temps les plus lointains pour neutraliser les puissances malignes. Le masque de commedia se distingue aussi de ses illustres prédécesseurs par la matière qui le constitue, puisqu’il est fabriqué en cuir. « On n’est pas sûr qu’il l’ait été dès le départ, précise Françoise Decroisette. Mais il y avait beaucoup de tanneries à Florence, ville qui a été importante dans l’histoire de la commedia dell’arte, ce qui a sans doute conduit à l’adoption de ce matériau. » Une tradition dont on avait perdu toute connaissance, jusqu’à ce que le grand facteur de masques Amleto Sartori (1915-1962) fasse un long travail pour la réinventer, quand le metteur en scène italien Giorgio Strehler a voulu monter Arlequin, serviteur de deux maîtres, de Goldoni, en 1947. « Il ne subsiste quasiment plus d’exemplaires de masques originels d’Arlequin, constate Erhard Stiefel, l’autre grand créateur de masques de la période contemporaine, qui a signé tous ceux figurant dans les spectacles du Théâtre du Soleil depuis cinquante ans. J’ai pisté ceux qui existent encore, à la bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris, en Italie et à Zurich [Suisse], parce que je voulais absolument comprendre comment ils étaient fabriqués et les reconstituer. Il faut être un crack pour les reproduire, c’est une perfection totale, très compliquée à atteindre. Le matériau, c’est quasiment du cuir de semelle qui n’est pas rigidifié et qu’il faut travailler à la main pendant au moins une dizaine de jours. Il n’y a pas de coupe, la pièce est d’un seul tenant, qu’il faut ensuite mouler sur la forme en bois que l’on a d’abord sculptée. L’Arlequin me fascine, parce qu’il est emblématique du lien qu’opère le masque entre l’humain et l’animal, d’un côté, et le divin ou le démoniaque, de l’autre. » Fabienne Darge / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 5, 10:05 AM
|
Propos recueillis par Guillaume Fraissard dans Le Monde - 5 août 2025 Dans un entretien au « Monde », la responsable de cet établissement, acteur de la politique culturelle de la France à l’étranger, dont le contrat d’objectifs et de performance vient d’être renouvelé, revient sur les défis de la diplomatie culturelle dans une période de tensions géopolitiques.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/08/04/eva-nguyen-binh-presidente-de-l-institut-francais-crier-haro-sur-la-culture-cela-a-des-consequences-a-long-terme_6626615_3246.html Nommée à la tête de l’Institut français en 2021, Eva Nguyen Binh a été reconduite pour un second mandat en 2024. Alors que la subvention de cet établissement public chargé de mettre en œuvre la politique culturelle extérieure de la France sous l’égide du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère de la culture a baissé de 5,5 % en 2025 et alors que son contrat d’objectifs et de performance a été renouvelé vendredi 18 juillet, sa présidente explique au Monde les défis de la diplomatie culturelle dans une période de tensions géopolitiques. La baisse de votre subvention vous oblige-t-elle à revoir vos priorités ? Je ne peux pas dire que ça ne nous a pas affectés. Mais le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui nous donne cette subvention pour charge de service public, a tout fait pour nous préserver, alors je ne me plains pas. Nous avons un budget de 45 millions d’euros et nous avons absorbé cette baisse de 5,5 % en agissant sur nos marges et en nous appuyant sur la réorganisation de l’Institut menée depuis mon arrivée. Mais je reste vigilante, car nous n’avons aucune visibilité sur l’année 2026. Il y a un moment où les choix seront difficiles à faire. Dans ce contexte, l’Institut français est-il obligé de justifier ses actions ? Je ressens le besoin d’expliquer plus que de justifier. Et cette demande est accrue dans le contexte politique et budgétaire actuel. Je l’ai signalé à mes équipes dès les élections européennes. Quand on voit la carte des résultats électoraux, avec le décalage entre Paris et le reste de la France, et sans porter aucun jugement, il est impossible de ne pas se poser la question de savoir comment on est perçus, en dehors de Paris. De chercher à davantage étayer à quoi servent nos actions, de montrer en quoi c’est utile pour la France d’avoir un pavillon à la Biennale d’art contemporain de Venise, par exemple. C’est normal mais c’est nouveau, et, en réalité, ce n’est pas si facile. Je pense que l’on doit mieux informer de ce que l’on fait sur nos territoires, avec lesquels on travaille beaucoup. On était tellement tournés vers l’extérieur que l’on a peut-être négligé la communication avec les Français. La culture est attaquée sur son utilité, avec parfois un discours décomplexé sur les coupes budgétaires à faire. Cela vous inquiète-t-il ? Les questions se posent de façon plus ouverte qu’avant, c’est une certitude. Il faut défendre notre secteur, même si on ne peut pas toujours dire « pas touche » dès que l’on parle de culture. Ce qu’il faut absolument éviter, ce sont les coups de barre brusques. Crier haro sur la culture, cela a des conséquences à long terme. Le 18 juillet, vous avez signé, avec vos deux ministres de tutelle, le nouveau contrat d’objectifs et de performance 2025-2027 de l’Institut français. Quel cadrage apporte-t-il ? Il fixe trois objectifs : l’appui au réseau culturel français à l’étranger (une centaine d’Instituts français, les Alliances françaises…), le développement des industries culturelles et créatives (ICC) françaises à l’international, le renforcement du dialogue interculturel. Ces trois axes résument bien les atouts dont nous disposons, et les enjeux culturels, politiques et économiques auxquels nous devons répondre. Nous sommes culturels, certes, mais éminemment politiques. Nous contribuons à porter la voix de la France à l’international, ses intérêts et ses valeurs. Quelle place peut avoir la diplomatie culturelle dans une période de très fortes tensions géopolitiques ? La culture fait partie de l’ADN français et de ce que la France considère comme partie intégrante de ses relations avec les autres pays. L’Institut français ou le service culturel des ambassades est souvent l’un des derniers lieux à fermer dans un pays et bien souvent le premier à rouvrir, ce n’est pas anodin. On travaille en partenariat avec des structures et des gens que l’on suit au long cours et, dans les périodes de crise, c’est un atout énorme. Quand la confiance est rompue au niveau politique, nous, on est capables de se parler, de rester en contact. Quand la Lituanie nous a demandé d’organiser une saison culturelle avec la France en 2024, c’était clairement pour se faire connaître dans un contexte géopolitique tendu. Ils se disent que, si l’Ukraine tombe, ils seront les suivants. Les saisons culturelles croisées sont des outils très forts, très demandés. Si on est capables de travailler en Ukraine, c’est grâce à cela, à ce temps long qui permet de faire face au temps court de la crise ouverte. Mais quelle est la particularité de la France dans ce domaine du soft power culturel par rapport à d’autres pays ? C’est l’universalité de son réseau. On travaille dans le monde entier, c’est un vrai choix politique. Nous sommes à l’articulation de la société civile et du pouvoir politique, donc on parle à tout le monde, c’est une valeur ajoutée. Nous avons les moyens de nos ambitions car peu de pays ont un réseau comme le nôtre. En matière de soft power culturel, le pays qui émerge le plus aujourd’hui est l’Arabie saoudite, avec une vraie vision, une stratégie et des moyens de les mettre en œuvre, dans tous les secteurs, pas uniquement la culture. Le modèle de la Corée, qui fonctionne sur une alliance entre les secteurs public et privé avec une vision très orientée business, est également intéressant. Comment vous adaptez-vous au contexte international actuel ? Nous sommes assez plastiques. Si on nous demande un projet politique, on peut le monter très vite, comme nous l’avons fait en 2020 avec le projet Nafas de résidences d’artistes libanais en France à la suite de l’explosion du port de Beyrouth. Les choses évoluent tellement rapidement qu’on ne peut plus dire : « Dans trois ans, on fait une année croisée avec tel ou tel pays. » Mais il faut se creuser les méninges. Les « saisons », on en a fait tellement qu’il faut se renouveler, être en prise sur les sujets de société alors qu’autrefois ces manifestations étaient avant tout artistiques. C’est ce que nous faisons. D’ici à la fin de l’année, nous allons organiser un festival ukrainien en France. Dès le début de la guerre, beaucoup de gens se sont tournés vers nous, des structures, pour nous demander ce qu’est la culture ukrainienne, qui sont les artistes, etc. Nous avons joué ce rôle de connexion, notre sujet a été de montrer et de dire ce qu’était cette culture, d’apporter des contacts et de monter des programmes d’échange entre professionnels car, s’il y a le front militaire, il y a aussi le front culturel. C’est aussi une question de survie pour les Ukrainiens de dire qui ils sont. Guillaume Fraissard / Le Monde Légende photo : Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français, à Paris, le 7 mars 2024. STÉPHANE GEUFROI/« OUEST FRANCE »/MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 2, 6:20 PM
|
Propos recueillis par Anne Diatkine / Libération; Publié en 2019, re-publié par Libé le 1er août 2025 A l’occasion de sa mort, le 31 juillet 2025, nous republions l’entretien qu’il nous avait accordé en 2019.
Bob Wilson nous parle d’Isabelle Huppert, à l’avant-veille de la première de Mary Said What She Said à l’Espace Cardin. Il est affable, détendu, sans téléphone, et contrairement à sa réputation, il ne règle pas plusieurs spectacles à la fois. Il parle sans qu’on n’introduise la moindre question. «Isabelle Huppert ne s’oblige pas à réfléchir de manière psychologisante. Je n’ai pas à délayer mes indications quand je la dirige. Il suffit que je lui délivre de petites annotations : « plus lentement », « plus étiré », « plus d’espace », « moins d’espace ». Il y a une dimension que l’on n’aborde jamais : celle du sens. Car ce n’est pas du devoir de l’acteur ni même du metteur en scène de s’en emparer. L’interprétation revient au public. Je suis très gêné qu’aujourd’hui autant de metteurs en scène imposent une lecture prémâchée aux spectateurs. Ce qu’il y a de bien avec le théâtre formaliste, c’est qu’on peut vraiment suggérer une idée, une émotion. On n’est jamais lourd quand on y a recours. «Charlie Chaplin est venu voir deux fois le Regard du sourd [premier spectacle de Bob Wilson en France, en 1971, ndlr], une pièce de sept heures sans le moindre mot. Après la représentation, il m’a demandé comment je tenais sept heures avec une pièce si longue et si muette. Je lui ai répondu : « Monsieur Chaplin, grâce à vous ! » Et c’est vrai. Depuis mes débuts, je pense au numéro de Charlot avec les puces, dans les Lumières de la ville. Chaplin a grandi dans la tradition du burlesque, où l’on joue le même numéro tous les soirs pendant quarante-cinq ans. La répétition permet d’acquérir une forme de liberté. Enfant, je l’ai compris de ma mère, qui était secrétaire. Elle disait : « J’adore taper à la machine car cela me laisse le temps de penser. » «Je n’ai jamais vraiment aimé le théâtre. En grandissant au Texas, j’en ai été préservé. Quand j’ai découvert cette discipline à New York, je l’ai trouvée trop compliquée : tous ces acteurs qui pensent… Je ne savais pas où me mettre. Je préfère être à la campagne et regarder un arbre. C’est très intéressant d’observer comment ses branches bougent. En revanche, la danse, et notamment les ballets de Balanchine, m’ont stimulé davantage car j’y ai décelé cette liberté. C’est en regardant la danseuse étoile Suzanne Farrell que j’ai eu envie de concevoir des spectacles. «Ce qu’il y a d’extraordinaire avec Isabelle, c’est qu’elle connaît la force de l’immobilité. Elle doit sans doute cette faculté à son expérience du cinéma car elle sait que si la caméra s’approche pour un gros plan, il est contre-productif de s’agiter. Marlene Dietrich était de cette trempe. En 1971, j’ai assisté dix-sept fois à son récital de chansons, je ne m’en lassais pas. Elle ne variait pas d’un iota. Elle finissait sa chanson, Johnny, elle essuyait une larme sur son œil gauche, toujours le même œil, toujours la même main, ces gestes étaient très rares, et ils n’en avaient que plus de puissance. Alors qu’elle était seule sur une scène immense, on avait le sentiment de la voir en gros plan. Au début, pour Mary Said What She Said, j’avais essayé quelques décors, un ou deux accessoires. Je les ai tous retirés. Car il n’y a rien de plus beau qu’une pièce vide, avec éventuellement une fenêtre qui donne sur un marronnier en fleurs. Ou une actrice qui en tient lieu.»
(Photo Yiorgos Kaplanidis)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 30, 4:41 PM
|
RÉCIT - Le théâtre avance masqué (3/6). Par Fabienne Darge dans Le Monde - 30 juillet 2025 « Le Monde » revient sur cet accessoire ancien qui dissimule le visage de l’acteur pour mieux révéler son personnage. Aujourd’hui, le topeng, théâtre dansé balinais, à l’origine rituelle.
Mais quel est donc ce rictus ? Toute dentition dehors, le front et les yeux plissés, chevelue, hirsute, la créature est-elle en train d’éructer, est-elle possédée par un rire fou et, on l’espère, libérateur ? Le masque est celui du Sida Karya, littéralement « celui qui termine le travail », dans le topeng, l’une des formes du théâtre dansé balinais, celle qui relie au plus haut point le rituel et la vie quotidienne. Il est au cœur de tout le système de représentations balinais, et exemplaire du rôle qu’y jouent les masques aujourd’hui encore, où le topeng est toujours un art vivant.
Il vient du XVIIe siècle, ce théâtre masqué musical et dansé, qui alterne danse sacrée et jeu profane, passe du raffinement le plus subtil aux caricatures de la vie quotidienne poussées jusqu’à l’absurde, et offre en conséquence des masques d’une variété fabuleuse. « Le masque est un outil indispensable à ce théâtre en raison même de son origine rituelle, explique Kati Basset, ethnomusicologue et spécialiste du théâtre balinais. Quand il n’est pas un pur divertissement, le topeng doit être joué par des acteurs-danseurs qui ont été initiés, parce que le dernier personnage masqué, celui qui clôt la cérémonie, le Sida Karya, est un officiant. Et comme les initiés ne sont pas forcément très nombreux, et que le topeng n’est joué que par des hommes, le masque permet de passer d’un personnage, ou plutôt d’un archétype, à l’autre. »
Les masques sont donc des plus divers et codifiés selon les archétypes ancestraux que met en scène le topeng, en l’occurrence la hiérarchie féodale. Masque de roi, Dalem, lisse, blanc et fermé. Masques de prince raffiné ou fou, de princesse éplorée ou coquette et jalouse, de reine sorcière, de ministre sévère ou sage… également fermés, mais déjà moins idéalisés que celui du roi. Masques des valets, ne couvrant que la moitié du visage, pour permettre la parole, indispensable à ces personnages d’intercesseurs, et qui ne sont pas sans évoquer ceux de la commedia dell’arte. Et masques de Bondres, les gens du peuple, qui autorisent toutes les libertés et les fantaisies. « Ils représentent tous une tare, un défaut ou un handicap. Il y a l’hypocondriaque, la coquette fofolle, le feignant, le bègue… On peut en imaginer autant que l’on veut, et les Balinais ont même inventé celui du touriste, doté d’un grand nez blanc », s’amuse Kati Basset.
« Fou des cimetières »
Et puis il y a le Sida Karya, autour duquel se jouent le sens et la fonction de ce théâtre masqué. Pour le comprendre, il faut revenir à cette notion d’archétypes, à la base du topeng et de ses masques. « Tout repose sur cette notion, parce que dans la culture balinaise, même la personne humaine est de l’ordre de l’archétype. Toute personne qui se croit être un individu, au sens occidental du terme, est victime d’une illusion, détaille Kati Basset. Dans cette représentation du monde, issue d’un substrat hindou, il faut penser la réalité comme un continuum gradué, et non pas comme des entités. L’illusion dans laquelle tombe l’homme, c’est de croire à des entités, et le théâtre est là pour faire remonter l’individu jusqu’à l’archétype et de là au principe, lequel est représenté par les dieux. Le théâtre sert à remettre l’homme dans cette connaissance sans même y penser, à ce qu’il soit imprégné de cette pensée de l’unité du tout, un tout qui se fractionne sans cesse et qu’il faut défractionner. On raconte aux touristes que c’est un combat entre le bien et le mal, mais ce n’est pas cela du tout ! »
Et c’est là qu’intervient Sida Karya, avec sa gueule de « fou des cimetières », comme dit Kati Basset. « C’est lui qui va permettre de réintégrer l’unité perdue. Selon le principe du tantrisme de la main gauche, il est celui qui appelle l’impur, et sait le maîtriser. Il doit faire le fou, cela fait partie de son ascèse, jouer les non intégrés, les asociaux. La lecture occidentale, biaisée, a toujours parlé d’exorcisme, mais je préfère qualifier cette opération d’endorcisme : à Bali – mot qui veut dire « retour » –, le seul véritable mal, c’est de ne pas être intégré au corps social. »
La codification du masque est donc bien ancrée, même si elle autorise de multiples variations. A Bali, les systèmes de représentations s’établissent sur des mandalas kabbalistiques, qui entre leurs quatre points cardinaux tissent des correspondances entre les archétypes de tempérament, les castes de la société et les couleurs. Etant donné la fonction du masque, le Sida Karya mêle le blanc de la pureté des prêtres et des brahmanes, le rouge du tempérament coléreux des guerriers, le jaune qui incarne le couchant, les miasmes, la dépression, et le noir qui représente la classe travailleuse.
Procéder à un sacrifice
« Etant donné la place du théâtre à Bali, la tradition du masque reste très vivante aujourd’hui, avec de vrais sculpteurs, même si s’est aussi développée une industrie de l’objet pour touristes, constate Luc Laporte, lui-même fabricant, et qui a par ailleurs photographié de nombreux masques lors d’un séjour sur l’île à la fin des années 1980. Il existe toujours des masques patrimoniaux, même si le climat n’est pas très propice à leur conservation, et que les Balinais n’ont pas la même tradition de préservation que les Japonais. »
Les masques sont sculptés dans du bois d’Alstonia scholaris (quinquina d’Inde ou d’Australie), tendre mais à la fibre serrée. Avant de pouvoir l’utiliser, il faut procéder à un sacrifice, pour que la matière puisse quitter sa vie précédente et revenir à la vie dans une autre fonction. « Autrefois, les masques étaient peints, par dizaines de petites couches, avec des pigments fabriqués avec des matériaux naturels, minéraux ou végétaux : cornes de cervidés broyées, colles à l’os ou peau de poisson… Cela prenait un temps fou, évidemment, et donc de nos jours les fabricants utilisent de la peinture acrylique, expose Luc Laporte. Alors oui, quelque chose se perd, mais en même temps la tradition reste vivante, intégrée à la vie de la population. » De son côté, Kati Basset souligne : « Un bon masque topeng, c’est un masque qui est efficace en jeu, et quand il est trop précis, il perd en efficacité. Un masque, c’est une alchimie… »
Fabienne Darge / Le Monde
Le théâtre avance masqué
6 épisodes

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 29, 11:55 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 29 juillet 2025 Pour la troisième année de suite, l’étude du ministère de la culture sur la billetterie confirme le poids majeur de la musique, un domaine qui rassemble le plus grand nombre de spectateurs.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/29/la-frequentation-du-spectacle-vivant-continue-sa-progression_6625211_3246.html Le spectacle vivant se porte bien. Le public français semble toujours autant apprécier les expériences collectives de sorties culturelles. Selon l’étude publiée, mardi 29 juillet, par le ministère de la culture, sur les données de billetterie de ce vaste domaine culturel qui englobe théâtre, musique, danse, cirque, comédies musicales, humour et cabaret, tous les indicateurs sont en progression. Ainsi, en 2024, les quelque 230 000 représentations organisées, contre 205 000 en 2023, ont rassemblé 65,4 millions de spectateurs (62 millions en 2023) et généré une recette de 2,8 milliards d’euros (2,1 milliards en 2023, soit une hausse de 11 %). Deuxième secteur culturel, après l’audiovisuel, en matière de poids économique, le spectacle vivant cache une grande diversité qui induit des résultats très hétérogènes suivant les disciplines artistiques. Si 47 % des représentations données en 2024 relèvent du théâtre et des arts associés (cirque, marionnettes, mime), c’est la musique qui rassemble le plus de public (48 %) et engendre le plus de recettes (1,4 milliard d’euros, soit 58 % des recettes totales du spectacle vivant). Ces grandes tendances ne sont pas nouvelles, mais viennent « confirmer la vitalité du secteur pour la troisième année de suite », précisent les responsables du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation de la Rue de Valois. Cette série d’études est menée à partir des déclarations des entrepreneurs du spectacle auprès du récent dispositif ministériel Sibil (système d’information billetterie), enrichies de celles du Centre national de la musique et de l’Association pour le soutien du théâtre privé. De grosses tournées Dans le domaine de la musique (31 millions de spectateurs en 2024), l’augmentation des recettes de billetterie (+ 17 %) a notamment été portée par de grosses tournées (Taylor Swift, Coldplay, Mylène Farmer, etc.) mais aussi par le succès des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors que de fortes inquiétudes pèsent sur les 290 structures théâtrales labellisées qui craignent de futures coupes budgétaires du ministère et des collectivités territoriales, ces dernières ont accueilli, en 2024, 6,3 millions de spectateurs. Si leur recette de billetterie augmente de 8 %, en revanche, le nombre de représentations de ces labels baisse de 5 %, passant de 24 200 à 23 100. En outre, les spectacles d’humour constituent, « après le théâtre, la deuxième proposition artistique » avec 26 700 représentations (25 000 en 2023) et 6 millions de spectateurs. La géographie du spectacle vivant perdure, voire se renforce : sans surprise, la région Ile-de-France concentre 40 % de l’offre de spectacles durant l’année avec 97 300 représentations, contre 89 000 en 2023. C’est en partie grâce aux festivals qu’un certain rééquilibrage s’opère au profit des autres régions. Ainsi, Provence-Alpes-Côte d’Azur cumule 30 % des représentations déclarées dans le cadre d’un festival, dont plus de la moitié pour celui d’Avignon, et la Bretagne occupe la première place en nombre de billets vendus (1,6 million). Sandrine Blanchard / LE MONDE Légende photo : Lors du concert du groupe The Offspring, au festival Rock en Seine, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), le 24 août 2024. ANNA KURTH/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 28, 6:01 AM
|
TRIBUNE par Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (93) Si la vision dominante des arts les relègue du côté du superflu et de la variable d’ajustement budgétaire, ils jouent pourtant un rôle crucial dans la création d’un « récit commun », pointe Stéphane Troussel, président (PS) du département de la Seine-Saint-Denis, dans une tribune au « Monde ». Lire la tribune sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/07/27/la-culture-n-est-pas-un-supplement-d-ame-mais-un-service-public-essentiel_6624638_3232.html
Début juillet, le parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a été le théâtre d’un week-end festif, joyeux et coloré, à la faveur de l’événement Multitude. Cette biennale interculturelle, organisée par le département, a pour objectif de mettre en lumière l’immense richesse créative que tire notre territoire de sa diversité. Un public nombreux, mêlant toutes les générations et toutes les origines sociales et culturelles, s’est retrouvé pour vibrer ensemble. Et tout cela, entièrement gratuitement ! S’agit-il d’un petit miracle, alors que le modèle économique des festivals a été considérablement fragilisé sous l’« effet ciseau » de l’envolée des charges et de la baisse des subventions des collectivités ? Non, nulle thaumaturgie ou intervention providentielle : ce succès est le fruit d’un volontarisme politique. Le département de la Seine-Saint-Denis a fait le choix de maintenir un soutien élevé à la culture parce qu’il la considère comme un bien essentiel. Au-delà de ce festival, en Seine-Saint-Denis, malgré un contexte budgétaire contraint, nous avons décidé de sanctuariser, et même d’augmenter les crédits liés à la culture – parce qu’elle est un levier indispensable pour nos politiques publiques. Elle l’est dans nos politiques éducatives par l’éducation artistique et culturelle, dans nos politiques de solidarité et d’insertion par son pouvoir émancipateur et sa capacité à créer du commun, ou encore dans nos politiques d’aménagement en mettant l’art au cœur de l’espace public. La culture aujourd’hui peut ainsi être le lieu du décloisonnement des politiques publiques. La censure progresse Nous sommes convaincus que la culture et les arts ont un rôle crucial à jouer pour lutter contre les fractures économiques et sociales, mais aussi pour faire société. Cette vision n’est malheureusement pas dominante : trop souvent, la culture est envisagée comme du superflu qui, dans des circonstances plus difficiles, devient alors une variable d’ajustement budgétaire. Il est temps pour la puissance publique de considérer la culture non pas comme un supplément d’âme, mais comme un service public essentiel qu’il est impératif de sauvegarder. Et il y a urgence, dans un contexte où la liberté de création est menacée, où la censure progresse et où l’extrême droite s’approche du pouvoir. Nous savons que, partout où ils sont aux manettes, les réactionnaires mènent une offensive résolue contre toute création artistique qui remet en cause leur idéologie. Car l’art et la culture sont le lieu par excellence de la complexité humaine, du langage commun et vont à l’encontre d’une conception manichéenne du monde. Gardons à l’esprit que la culture est cette arme contre l’obscurantisme et cet outil de résistance démocratique que nous ne pouvons pas nous permettre d’affaiblir. Parce qu’elle est et restera un refuge pour des espaces de pensée, de reconnaissance, pour recréer du commun autour d’émotions partagées… Elle offre, pour reprendre l’expression d’Edgar Morin, des « oasis de fraternité ». Elle a, à ce titre, besoin d’une mobilisation totale. Une mobilisation des autorités publiques pour la soutenir et la promouvoir. Une mobilisation des acteurs culturels eux-mêmes pour favoriser son rôle émancipateur et de cohésion. Car face aux déchirures d’une société fragmentée, où les différents milieux sociaux, géographiques se parlent de moins en moins, se côtoient de moins en moins, il est indispensable de penser la culture aussi pour recoudre et faire récit commun. Cela implique d’aller vers tous les publics, de faire de l’inclusion et de la participation des personnes, dans leur diversité, une priorité. Il nous faut agir. Et nous donner collectivement les moyens d’agir. Non seulement pour que la culture ne soit pas sacrifiée sur l’autel budgétaire, mais aussi pour proposer et financer, ensemble, ces grands projets qui feront le commun « des tours et des bourgs ». Stéphane Troussel est président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et porte-parole du Parti socialiste.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 28, 5:22 AM
|
Par Elisabeth Franck-Dumas dans Libération - 25 juillet 2025 Dans un numéro parodique de «danse du pigeon» folklorique, l’artiste Louis Chevalier et la chorégraphe luxembourgeoise Simone Mousset provoquent avec brio les moments de gêne. Peut-être était-ce ce qu’il nous fallait, à l’avant-dernier jour du festival : nous faire hurler dessus par un directeur artistique sadique devant un parterre du off («C’était juste de la meeeerde !») alors que ce dernier commande à notre rangée de spectateurs de «faire la fleur» en croisant et décroisant les bras. Nous sommes dans les jardins du Carmel rafraîchis par l’ombre bienvenue des platanes pour assister à la célébrissime «danse du pigeon» inventée par les fondatrices du ballet folklorique du Luxembourg, Joséphine et Claudine Bal, un numéro de bravoure que le monde entier leur envie sûrement et qui en serait, apprend-on en prélude, déjà à sa 10 000e représentation. Le volcanique Monsieur Chevalier va donc s’y coller, en justaucorps gris et poses exaltées, remuant les omoplates à la manière du volatile, avant de partir en vrille sous nos yeux, vitupérant, postillonnant et gueulant des ordres tous azimuts (breathe in ! breathe out !) pour finir par s’effondrer dans un grand burn-out maniaque et nationaliste tout à fait hilarant. Fous rires nerveux Simone Mousset, qui a créé le spectacle et fait office ici d’apparitrice (petits escarpins Ferragamo, accent Lagerfeld, remerciements au «club élite» pour leur soutien) tourne en ridicule l’obsession contemporaine d’une certaine frange politique pour les danses folkloriques et la culture «authentique», et elle et son comparse agité du bocal manient avec brio les grands moments de gêne propres à déclencher des fous rires nerveux dans l’auditoire. A la sortie, un petit carton est distribué qui nous encourage à retrouver l’univers de l’illustre directeur artistique sur Instagram, et reproduit une citation de Joséphine Bal (hormis nos voisines du premier rang, très remontées, tout le monde aura compris que l’existence de cette personne n’est peut-être pas à prendre au pied de la lettre) : «A travers la danse, une nation exprime les récits de son passé, les aspirations de son avenir, et l’intensité de son présent», et on jurerait avoir déjà lu ça quelque part. The Great Chevalier, de Simone Mousset, avec Louis Chevalier, programmation hors les murs du Train Bleu, sera du 1er au 3 avril 2026 au Cent Quatre à Paris dans Séquence Danse. Elisabeth Franck-Dumas / Libération

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 5:18 PM
|
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks - 24 juillet 2025 À quelques jours de la clôture du Festival d’Avignon, l’heure est au bilan, revue de détails de quelques moments forts de cette 79e édition. Sans conteste l’événement marquant de cette édition aura été l’hommage du Festival à Gisèle Pelicot. La soirée unique qui lui a été consacrée au Cloître des Carmes fut un précipité d’émotions. S’emparant du dossier judiciaire et des commentaires provoqués par l’affaire dans un geste artistique d’une grande rigueur, le metteur en scène Milo Rau et sa dramaturge Servane Décle nous ont offert un portrait magnifique de dignité de cette femme ayant décidé d’affronter l’horreur de son calvaire pour que la honte change de camp. Le décor minimal d’une cour de justice et la sobriété du jeu d’une soixantaine de représentants de la scène française resteront dans les mémoires. D’une manière plus prosaïque, on oublie parfois les risques des représentations sous les étoiles. Interrompu par des pluies torrentielles, l’une des nuits du Soulier de satin de Paul Claudel dans la cour d’honneur du Palais des papes a tourné au cauchemar. Le metteur en scène Éric Ruf, la troupe du Français et les équipes du festival ont dû se transformer en sauveteurs pour s’occuper des spectateur·rices transis et trempés qui n’avaient pas prévu d’hébergements. Des spectacles très attendus Très attendu au Festival, Le Sommet de Christoph Marthaler a été un ravissement d’humour surréaliste. Nous donnant rendez-vous dans un ultime refuge construit sur un toit du monde, le metteur en scène Suisse nous offre les plaisirs d’un huis clos pince sans rire. Un cabaret no futur s’inquiétant avec une cruauté sans pareil de la peau de chagrin que sont devenues nos libertés individuelles. Autre rencontre au sommet, le spectacle réunissant le danseur Israël Galvan et le metteur en scène Mohamed El Khatib. Avec Israël & Mohamed, ces deux-là trouvent le moyen de nous faire rire de l’incompréhension de pères se refusant à cautionner les aventures artistiques de leurs fils. De confessions cruelles en anecdotes impayables, chacun relève le défi d’offrir à son géniteur un cadeau. Israël invente pour son père, témoin de Jéhovah, un paradis miniature tandis que Mohamed propose au sien, fervent musulman, la mosquée de ses rêves. Choc esthétique d’une grande puissance, le théâtre d’images de l’Albanais Mario Banushi s’apparente à une machine à remonter le temps qui renvoie à son enfance. Avec MAMI, il réactive quelques scènes clefs de sa vie, de sa naissance à la mort d’une grand-mère et à ses premiers amours. Autant de chromos somptueux qui, sans qu’une parole ne soit dite, résonnent de la violence des contes anciens aux rythmes des musiques des Balkans. Bouquet final et perspectives pour 2026 Ouvrant entre chien et loup sur la plainte solitaire d’une trompette fellinienne, Derniers Feux de Nemo Flouret nous déborde très vite en s’amusant en pleine lumière de la folle activité d’une super production digne de Cinecittà. Multipliant les références à la peinture italienne du Quattrocento et au Tanztheater de Pina Bausch, son spectacle est un émerveillement de chaque instant qui assume avec élégance dans son infinitude la puissance du trait jeté de l’esquisse. Cerise sur le gâteau, Suzanne de Baecque nous régale en participant aux Tentatives de Vive le sujet ! Avec Charles Péguy, ta mère et tes copines, j’en ai rien à foutre, l’actrice organise une rencontre avec le chanteur Hervé Vilard sur le thème du conflit entre les générations. Après un détour par les forêts d’Amazonie, le couple est rejoint par un complice (Zakary Bairi) pour s’accorder enfin en chantant a cappella Tout fout le camp de Damia avec celui qu’elle désigne comme son chanteur fétiche. Dédiée cette année à la langue arabe, les artistes n’ont pas manqué, tous spectacles confondus, de marquer leur soutien à la cause palestinienne en portant aux saluts un drapeau ou une écharpe évoquant le pays martyr. Se refusant de dévoiler les noms des futurs invités du prochain festival, Tiago Rodrigues a annoncé que la langue mise à l’honneur à Avignon en 2026 serait le Coréen. 79e édition du Festival d’Avignon jusqu’au 26 juillet.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 6:31 PM
|
Par Elisabeth Franck-Dumas dans Libération - 24 juillet 2025 La ministre de la Culture s’est rendue en périphérie de la cité des Papes, jeudi 24 juillet, évitant tout contact avec les festivaliers mobilisés contre sa venue. Le grand remake d’En attendant Godot par la ministre de la Culture nous aura tenu en haleine jusqu’à la dernière minute. A deux jours de la fin du Festival d’Avignon, et au surlendemain de l’annonce de son renvoi en correctionnelle pour «recel de bien obtenu avec l’aide d’un abus de confiance», «trafic d’influence passif» et «corruption passive», Rachida Dati a finalement pointé le bout de son nez au pays des cigales. Non, pas dans la cité des Papes stricto sensu, où la CGT avait menacé de ne pas jouer si elle devait s’y rendre, pour protester contre «des coupes budgétaires aux effets catastrophiques», mais juste en dehors, au cœur de deux projets à part, ceux-là tout à fait digne de l’intérêt de l’Etat : l’espace social et culturel la Croix des oiseaux, et l’Ehpad la Maison paisible, où la Collection Lambert et le metteur en scène Mohamed El Khatib ont créé un centre d’art assez ébouriffant. L’occasion pour la ministre de sermonner les journalistes s’enquérant effrontément, il faut le dire, de son éventuel passage à un spectacle du Festival : «Le Festival d’Avignon, c’est aussi là.» Là, où ? A La Maison paisible, Ehpad de 150 lits, qui n’avait évidemment rien de paisible ce matin, et où un centre d’art, fruit d’un travail de trois ans déjà, a été inauguré au début du Festival. Un petit troupeau de journalistes et divers officiels accompagnent la ministre, avec en tête le directeur de la Collection Lambert, François Quintin, Mohamed El Khatib, qui a initié le projet après avoir déjà inauguré un centre d’art dans un Ehpad de Chambéry en 2022 («J’ai de grands projets pour lui !» annonce la ministre), ou encore la présidente de l’association de gestion du Festival d’Avignon, Françoise Nyssen. Les murs sont égayés par des interventions d’artistes contemporains (Mimosa Echard, Théo Mercier ou encore Bertille Bak) et par des œuvres de résidents, par exemple ces touchants petits ex-votos dorés réalisés sous l’impulsion des artistes Louise Sari et Marine Brosse. Partout, des bibliothèques d’ouvrages divers (Adel Abdessemed y croise Henri Troyat) se posent près de canapés, et dans la tisanerie, on trouve un loto des odeurs, «traduction olfactive des récits des résidents par le parfumeur Daniel Pescio et l’artiste Juliette George». Grand bain d’amour Pour ceux qui ont déjà trainé leurs basques dans de tels établissements animés surtout par des cris rebondissant sur le lino collant, il y a avait de quoi être épaté, mais là n’était pas le seul l’objet de la visite. Non, le saut de puce, dès la première minute, fut aussi comme un grand bain d’amour pour la ministre, qui rappela dès l’entrée qu’elle aussi avait été «six ans aide-soignante à plein temps», cumulant même deux pleins-temps en travaillant de nuit ! «J’ai un respect immense pour votre travail», offrit-elle à l’assemblée d’aides-soignantes souriantes réunies dans le hall. Applaudissements. Rapide coup d’œil sur la page Wikipédia de Rachida Dati : la ministre aurait accompli des tâches d’aide-soignante sans en avoir la formation ni le titre et a raté deux fois sa première année de médecine. Bref. La ministre a la voix qui porte, ça tombe bien. «Alors, vous êtes une artiste !» lance-t-elle à Mireille, fauteuil roulant, 86 ans, chic dans sa robe orange et ses lunettes en corne. Oui, elle peint et dessine. «Alors vous allez nous emmener !» Et de lui emboiter le pas pour aller contempler ses œuvres dans sa chambre. «Ces dessins sont de vous ?» Sur les murs, des marines, un portrait de Moustaki, un bouquet de fleurs. Une foule s’agglutine au dehors de la chambre 25. «Compliqué… lâche François Quintin à un membre du cabinet. —Ce n’est pas ce qui était prévu ? —Il faut reprendre la main. —Bon, on va reprendre le cours normal de la visite.» A-t-elle peur de se faire chahuter ? La ministre repart. Elle croise Jacqueline et son déambulateur. «Vous voulez aller à l’opéra ? J’ai un directeur des affaires culturelles ici. On va le faire !» La troupe monte au premier étage. Dans les escaliers, des peintures colorées égaient l’espace. Au premier, la terrasse dévoile la vue sur une roseraie, où un atelier d’artistes va bientôt être construit pour accueillir les élèves des Beaux-Arts. La troupe croise un résident assis devant l’immense télé qui diffuse Intervilles : les deux camps s’ignorent poliment. Retour au rez-de-chaussée, où une vingtaine de pensionnaires attendent la ministre dans la salle polyvalente. «Eh bien, elle n’est pas venue seule», s’amuse Marie-Thérèrese, 92 ans. Annie, l’aide-soignante qui lui tient la main, estime que les travaux des artistes et résidents apportent «de la lumière, de la couleur» et que depuis qu’il y a ces couleurs, elle voit les résidents se déplacer pour aller y voir de plus près. «C’est cet éveil qu’on constate.» C’est déjà l’heure du départ, après une longue séance de selfies. Un journaliste ose : la ministre se rendra-t-elle à un spectacle, ou a-t-elle peur de se faire chahuter ? «Bien sûr que je peux aller au théâtre ! Mais monsieur, vous croyez quoi ? Je peux aller dans la cour du palais des Papes ! J’y vais, vous me suivez là-bas : est-ce que c’est nouveau ? Est-ce que ça donne un autre regard ? Au moins, je vous ai forcés à venir dans un endroit où on ne va pas forcément dans le cadre du Festival.» Fin des questions. Il n’y a pas de troisième séquence surprise ? De réunion avec les syndicats ? Non. La troupe se disperse, c’est l’heure du deuxième service du déjeuner. Un article de nos confrères de Sceneweb nous apprend qu’elle aura ensuite rencontré «des professionnels», sans que cela ne débouche sur une annonce. Comme dirait Beckett, tout ça pour ça. Légende photo : Rachida Dati lors de sa visite à l'Ehpad «La Maison Paisible» à Avignon, jeudi 24 juillet. (Clément Mahoudeau/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 5:58 PM
|
Propos recueillis par Amaury da Cunha, Le Monde du 24 juillet 2025 « Ecrire, quand ça commence, quand ça finit » (2/5). L’écrivain autrichien, Prix Nobel de littérature 2019, revient pas à pas sur près de soixante ans de carrière. Et sur les tours et détours du désir d’écrire, qui l’anime encore aujourd’hui.
Lire l'entretien sur le site du "Monde" https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2025/07/24/peter-handke-mourir-au-milieu-de-l-ecriture-d-un-livre-ce-serait-magnifique_6623483_3451060.html?search-type=classic&ise_click_rank=1
Peter Handke n’aime pas parler de son travail d’écrivain. Il n’apprécie d’ailleurs guère le mot « travail », au sens besogneux du terme. Il préfère celui de « profession », qu’il trouve très beau, sans doute pour son rapport direct à l’expressivité – « Je professe ! », dit-il en riant. Entrer dans l’œuvre de cet immense écrivain autrichien, né en 1942, Prix Nobel de littérature 2019, c’est s’aventurer dans une expérience littéraire pleine de secousses et d’éblouissements, qui comprend de grands récits épiques (Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille, Gallimard, 2000), des pièces de théâtre (Par les villages, Gallimard, 1983), ou encore de nombreux carnets (Hier en chemin, Verdier, 2011), dans lesquels Handke explore scrupuleusement le quotidien, source d’innombrables découvertes intérieures. C’est dans sa maison de Chaville (Hauts-de-Seine), où il vit depuis 1991, qu’il a accepté de recevoir Le Monde. Condition de l’entretien : « Pas d’actualité », prévient-il d’emblée. Peut-être pour éviter de revenir sur le soutien qu’il a apporté, pendant les guerres de Yougoslavie (1991-2001), au dirigeant serbe Slobodan Milosevic, pourtant mis en examen pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Grave, drôle, provocateur, parfois brutal, Peter Handke ne cesse de dévier quand il répond à nos questions sur l’origine de son écriture, et sur la manière dont il envisage la fin de cette aventure. Il semble toujours se tenir à la périphérie du langage, jamais loin du silence, comme les narrateurs de ses plus grands récits. Vous avez parfois évoqué les histoires que votre mère vous racontait dans votre enfance. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ces premiers récits ? Je devais avoir 10 ou 12 ans. Dans la voix de ma mère, il y avait un rythme particulier qui faisait naître des images dans un horizon très lointain. C’était des détails que je voyais comme des fleurs. Des fleurs tristes. Ma mère me parlait sans plan, avec une certaine grandeur – il ne faut jamais avoir peur des mots épiques. Elle racontait, comme si c’était une histoire dans l’histoire, la disparition de ses frères morts au champ d’honneur, comment elle était venue à Berlin après la guerre, comment elle avait vécu… Ce n’étaient pas des histoires de « bonne nuit », mais plutôt des histoires de « bonne lumière », « belle lumière », « triste lumière »… Vers l’âge de 15 ans, encouragé par un journaliste culturel, vous commencez à écrire vos propres histoires. Vous avez parlé de « prose lyrique ». Que racontaient ces textes ? Cet homme écrivait dans un quotidien conservateur catholique à Klagenfurt. Il m’a encouragé, mais je n’avais pas besoin de lui. J’avais déjà écrit des fictions. Notamment une nouvelle où un jeune garçon réparait un vélo dans une cour pendant qu’un autre garçon, à l’intérieur d’une maison, était en train de mourir. C’était une sorte de tragédie grecque. Je suis triste d’avoir perdu ce texte. Pourquoi vouliez-vous déjà écrire ? A l’époque, je vivais avec ma mère et son mari, qui n’était pas mon père. Nous n’étions pas une famille aisée. J’avais envie de les sauver. Et pour moi, le modèle de l’écrivain, c’était Françoise Sagan [1935-2004], qui avait écrit Bonjour tristesse [Julliard, 1954] à 16 ou 17 ans… Elle avait eu beaucoup de succès, et je me suis dit que je pourrais faire comme elle, que je pourrais aider ma famille en leur achetant une voiture, une télévision, une maison… Pourtant, vous n’aviez pas grand-chose de commun avec Françoise Sagan dans votre rapport à la littérature. Vous l’avez même éreintée publiquement, en 1991, sur un plateau de télévision… Je regrette un peu cet emportement, mais j’étais innocent : je n’avais pas pensé qu’on ne pouvait pas critiquer des livres à la télévision. Oui, je n’étais pas du tout comme elle. J’étais plus grave, épique. Je me souviens d’un autre fragment d’un roman que j’ai également perdu. J’y ai repensé récemment, en regardant un film de Julien Duvivier [Poil de carotte, 1932], qui raconte à peu près la même histoire que la mienne : celle d’un enfant de 8 ou 9 ans qui veut se suicider, sauvé in extremis par son père. C’était le début de ce voyage vers le grand succès. J’avais 16 ou 17 ans. Vous souvenez-vous du jeune homme que vous étiez dans ces années d’apprentissage ? Je n’ai pas besoin de me souvenir de moi. J’étais déjà là, je savais ce que je devais faire. C’était mon chemin, mais je trichais un peu, notamment au petit séminaire. Tout le monde était obligé de dire qu’il voulait devenir prêtre. A l’époque, je découvrais les livres de Georges Bernanos [1888-1948] ou de Graham Greene [1904-1991], des auteurs catholiques, pourtant considérés comme scandaleux dans cet établissement. Un jour, je me souviens qu’on m’avait dénoncé devant une centaine d’élèves, en disant : « Ce garçon lit ça ! » On ne m’a pas chassé, mais c’était comme une espèce de menace. En allant voir le directeur du petit séminaire pour lui dire que je quittais l’établissement, ma mère m’a sauvé. Elle m’a fait entrer dans une école publique, où j’ai pu apprendre le grec ancien, le latin. Lorsque vous commencez vos études de droit, vous découvrez le Nouveau Roman. Vous avez dit que ces livres vous ont aidé à sortir de vous-même. De quelle manière ? Le Nouveau Roman a été pour moi une sorte d’école d’écriture. Je m’intéressais surtout à Alain Robbe-Grillet [1922-2008], qui regardait les choses depuis l’extérieur. Mon problème, c’était que j’étais beaucoup trop à l’intérieur de moi. Je voulais raconter des choses mythiques, mais je ne connaissais aucune histoire mythique, sinon celles que m’avait racontées ma mère. J’étais un peu mégalomane, même si, à l’époque, je ne connaissais même pas le sens de ce mot. D’ailleurs, je ne l’aime pas beaucoup, sauf quand il est accompagné par une timidité essentielle. Auquel cas, il passe très bien. En 1966, vous publiez « Les Frelons » (Gallimard, 1983), votre premier roman. Dans quelles circonstances ? Je venais d’abandonner mes études de droit. Mon éditeur en Allemagne, chez Suhrkamp, a d’abord hésité à publier ce roman. C’est un jeune lecteur de la maison, séduit par l’aspect avant-gardiste du texte, qui a permis sa publication. Mon éditeur, un monsieur imposant, m’a suggéré d’écrire aussi pour le théâtre. J’ai alors écrit Outrage au public [L’Arche, 1968]. C’est une joie d’avoir pu traverser ce seuil dans ma vie. Sinon, je serais devenu avocat, et j’aurais défendu des assassins. Aujourd’hui, je suis reconnaissant envers le destin. Mais rien n’arrive jamais tout seul. Après la publication de vos premiers livres, vous avez vite connu le succès, vous avez même dit que vous étiez devenu une « star »… Je ne me suis jamais vu comme un auteur – je n’aime pas ce substantif –, mais plutôt comme quelqu’un en route vers l’écriture, qui pour moi est la grande aventure de la vie. C’est mon plus grand plaisir, mon olympiade à moi. Je m’en fous, des autres. Sauf de la littérature russe, comme celle de Tolstoï ou de Dostoïevski, Tchekhov, et d’Homère, aussi. Ils m’ont guidé, ils me guident toujours. Je ne veux surtout pas imiter la littérature du XIXe siècle, comme beaucoup d’écrivains le font encore aujourd’hui. Ces pseudo-livres sont vraiment criminels. En 1971, après le suicide de votre mère, vous écrivez un livre très personnel, « Le Malheur indifférent » (Gallimard, 1975), qui occupe une place à part dans votre œuvre… Uwe Johnson [1934-1984], qui est un écrivain que j’ai beaucoup estimé, a dit qu’il ne fallait pas écrire sur la famille, notamment sur le suicide. Mais pour moi, c’était un tremblement. Et c’était évident qu’il fallait le faire. En écrivant sur ma mère, je n’ai pas voulu être abstrait, mais je suis resté sur la voie de l’abstraction. C’est grâce à elle que les petits détails ont pu commencer à fleurir dans le récit. Le mot « recommencement » revient très souvent dans vos livres. Est-ce un mot magique pour provoquer l’écriture ? En allemand, le mot « recommencement » (Wiederholung) signifie à la fois « répétition » et « récupération », comme quand on sauve quelque chose en train de disparaître. Ce sont des nuances difficiles à traduire en français. La langue allemande est magnifique avec les mots. « Recommencement », en français, je trouve que c’est un mot un peu trop mystique. Heureusement qu’il y a cette vision de la forme. Mais elle n’est jamais donnée. Il faut aller la chercher, la créer. C’est souvent une première phrase très énigmatique qui ouvre une brèche dans vos récits. Comme celle qui se trouve au début de votre roman « Le Chinois de la douleur » (Gallimard, 1986) : « Ferme les yeux et le noir des caractères va faire apparaître les lumières de la ville. » Comment vous est-elle venue ? A l’époque, j’écrivais encore à la machine. Pendant une heure, je me suis demandé comment j’allais bien pouvoir commencer ce livre. Tout à coup, en fermant les yeux, j’ai eu la vision des lettres de la machine, qui étaient devenues blanches. Comme quand on revoit, derrière les paupières, la dernière chose que l’on a regardée, devenue une image transformée. La première phrase d’un livre est comme un nouvel oiseau qui arrive. Mais je ne veux surtout pas chercher une théorie sur l’écriture. Chacun fait comme il peut, ou comme il ne peut pas. Il y a trop de gens qui peuvent. Trop de gens qui savent ! Et moi, je ne peux pas ! Dans « Mon année dans la baie de Personne » (Gallimard, 1997), vous faisiez dire à votre personnage, Georg Keuschnig : « A bientôt 56 ans, je ne me connais pas… Il était si rare que je me sente appartenir au monde… » Aujourd’hui, où en êtes-vous avec ce sentiment d’étrangeté ? Je ne sais pas du tout. Il existe peut-être un rapport de l’Etat, de la police ou d’un inspecteur des finances qui pourrait vous renseigner ? Votre question me fait penser à une autre question que l’on me pose parfois dans des cafés. « Est-ce que vous écrivez encore un peu ? » Là, j’ai envie de gifler mon interlocuteur. Qu’est-ce que ça veut dire, « un peu » ? J’écris ! Johnny Hallyday [1943-2017] aurait d’ailleurs pu écrire une chanson là-dessus. [Il chantonne] : « Est-ce que tu écris encore un peu ? Est-ce que tu cries encore un peu ? » Vous avez écrit des livres très différents, de grands récits, des contes, du théâtre… Est-ce qu’il y a plusieurs Peter Handke ? Tous ces livres sont pareils : ils suivent le même mouvement. Tout à l’heure, nous parlions des premières phrases. Les miennes ont toujours le même rythme. Mais en fait, cette histoire de première phrase, c’est une tricherie totale. Ce qui compte, en réalité, c’est la deuxième phrase, puis la troisième, la quatrième… Un écrivain qui vous dit : « Ça y est, j’ai trouvé ma première phrase ! », vous pouvez être sûr que c’est un crétin. Une bonne première phrase me remplit toujours de soupçon. La traduction du français vers l’allemand occupe aussi une place importante dans votre parcours : vous avez traduit Julien Green, Emmanuel Bove, Patrick Modiano, Francis Ponge, René Char… Qu’avez-vous appris sur votre propre langue à travers ce travail de passeur ? C’étaient des expériences magnifiques. A mon retour de voyage en Amérique du Nord, après avoir échoué d’une manière héroïque dans l’écriture d’un roman, la traduction est arrivée comme un coup de grâce. Elle m’a sauvé. Je me suis dit qu’il fallait maintenant arrêter de voyager, arrêter ce romantisme. J’étais puni, d’une bonne manière, je l’avais bien mérité, et je suis revenu vivre en Autriche. Et ce qui m’a donné vraiment un sol sous les pieds, à Salzbourg, c’était la traduction. Vous n’avez jamais traduit les romans de Georges Simenon (1903-1989), mais vous avez exprimé à plusieurs reprises votre admiration pour lui. Vous avez même dit qu’il vous faisait pleurer. Pourquoi ? Ce n’est pas simple ! Ce que je reproche à Simenon, quand il me fait pleurer, c’est qu’il me laisse tout seul. Ses livres sont trop courts. Après les avoir lus, on est foutu. Je suis très ému quand je le lis, mais que fait-il avec mon émotion ? Normalement, on doit faire fructifier une émotion, mais lui n’en fait rien dans ses livres. Cependant, dès qu’il commence à raconter une histoire, j’ai toujours confiance en lui. En 2012, pour la première fois, vous avez écrit un dialogue amoureux directement en français, « Les Beaux Jours d’Aranjuez » (Le Bruit du temps). Pourquoi le choix de cette langue ? Et comment s’est passée la collaboration avec Wim Wenders, qui a adapté le texte au cinéma ? Je l’ai écrit d’abord en français, puis je l’ai traduit moi-même en allemand. C’était une exception. Je ne sais pas pourquoi. Comme ce sont des phrases parlées, je me suis senti plus à l’aise en français. Ecrire de la prose épique dans cette langue me paraît impossible. Je n’ai pas participé à l’adaptation cinématographique de Wenders. J’y apparais seulement en tant que figurant, filmé sur une échelle, en train de cueillir une pomme. Il y a plusieurs années, vous avez dit que le prix Nobel de littérature était une « fausse canonisation » qui « n’apporte rien au lecteur ». Ce prix a-t-il changé votre regard sur votre œuvre et sur la réception de vos livres ? Il y a trente ans, j’ai entendu Antoine Gallimard dire que le Nobel, en France, ne faisait plus vendre de livres. Pour moi, ce fut l’inverse. C’était magnifique. Ce prix Nobel a été un moment de paix que je n’ai pas vécu comme un triomphe. Vous vous définissez comme un « penseur de l’instantané », à la recherche de ces « petits riens qui enserrent le monde ». Les journaux que vous publiez sont-ils aussi des matériaux pour nourrir vos récits ? Ces carnets sont faits de fragments, écrits en allemand, en grec, parfois en arabe. Ce matin, par exemple, j’ai écrit cette phrase : « Une journée perdue, ça veut dire que le voyage de la vie peut continuer. Louée soit la journée perdue ! » Ces temps-ci, j’écris aussi beaucoup à propos des merles. J’essaie de déchiffrer leurs chants, que je traduis en allemand, ou en slovène. J’ai presque envie de publier un livre uniquement sur eux. Les polémiques provoquées par vos prises de position pro-Serbes, pendant les guerres dans l’ex-Yougoslavie, ont-elles eu une incidence sur votre écriture ? Ce n’est pas à moi de dire ce que cela a changé. J’ai continué à travailler, peut-être en écrivant des fictions et des contes un peu plus étranges. C’est ma force, je crois. Il y a toujours cette ouverture possible, cette largeur. Il n’y a pas d’idéologie dans mes livres, il leur faut une structure, mais pas d’idées politiques. Je n’ai d’ailleurs pas d’idées politiques. Je déteste ceux qui en ont. Même Albert Camus [1913-1960] n’en avait pas. Mais il avait quand même des opinions, moi je n’en ai même pas. Parfois, je me reproche de ne pas avoir réagi plus vite à cette époque pour me défendre. Mais il y a quelque chose en moi qui peut tout déchirer. Je me sens toujours en danger. Comment envisagez-vous la postérité de votre œuvre ? Je ne peux pas imaginer que mes livres ne puissent pas continuer à exister. Gardez-vous une trace de l’écriture de vos textes ? Archivez-vous vos manuscrits ? Je ne veux pas faire l’important. Je me débarrasse de tout cela. Je ne corrige d’ailleurs presque plus rien. Je ne veux pas me torturer. Je me dis qu’il y a forcément une raison d’avoir écrit une phrase, puisqu’elle est toujours innocente. J’ai fait venir la grande aventure, avec la sonorité des mots, qui disent aussi le silence. Mourir au milieu de l’écriture d’un livre, cela serait magnifique ! Pensez-vous parfois au dernier livre que vous pourriez écrire ? Je vois un vieil enfant avec sa mère et son père, devant une balançoire. L’enfant dit à sa mère : « Maman, une dernière fois, s’il te plaît, encore un tour ! » Puis il se tourne vers son père : « Papa, s’il te plaît, encore un tour, une dernière fois ! » J’ai l’écho de la voix de cet enfant dans la poitrine. Aujourd’hui, quel désir d’écriture vous anime ? Je voudrais encore faire un grand voyage vers l’épique. Raconter quelque chose que je ne connais pas, et qui contiendrait tout. Propos recueillis par Amaury da Cunha / Le Monde Repères 1942 Peter Handke naît à Griffen, en Carinthie (Autriche), d’une mère d’origine slovène et d’un père allemand qu’il ne connaîtra qu’à l’âge adulte. 1966 Parution de son premier roman, Les Frelons (Gallimard, 1983). 1967 Parution d’un recueil de nouvelles, Bienvenue au conseil d’administration (éd. Christian Bourgois, 1980), retraduit en 2023 sous le titre Bienvenue au conseil de surveillance. 1972 Publication d’un récit autobiographique, Le Malheur indifférent, inspiré par le suicide de sa mère (Gallimard, 1975). 1973 Peter Handke reçoit le prix Georg-Büchner, la plus prestigieuse distinction littéraire allemande. 1987 Il collabore au scénario du film de Wim Wenders Les Ailes du désir. 1991 Il s’installe en France, à Chaville (Hauts-de-Seine). 1996 Dans son récit Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina (Gallimard), Handke prend la défense des Serbes, qu’il présente comme des victimes de la guerre civile en Yougoslavie. 2008 La Nuit morave, roman (Gallimard, 2011). 2019 Prix Nobel de littérature. L’Académie suédoise salue une « œuvre influente qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la spécificité de l’expérience humaine ». 2021 Ma journée dans l’autre pays, roman (Gallimard, 2024).
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...