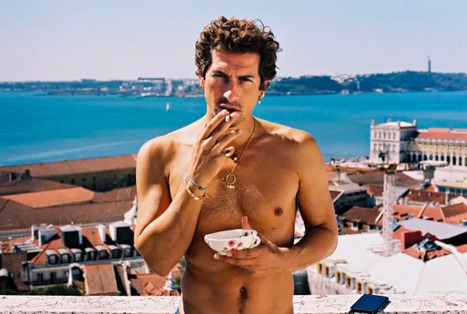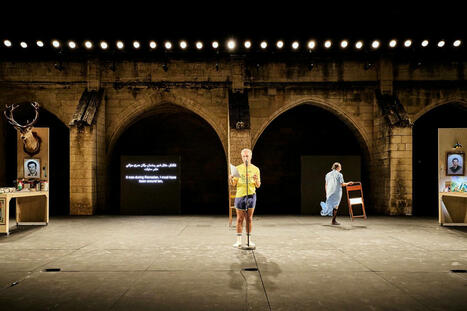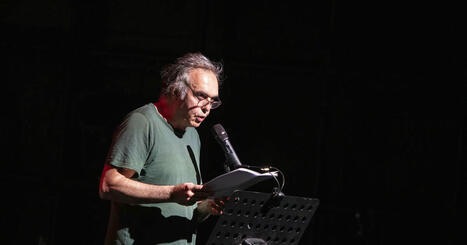Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre
Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://x.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'entonnoir (Filtres) et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso
Par Thierry Jallet dans Wanderer — 15 juillet 2025
Le Canard sauvage (Vildanden), d'Henrik Ibsen, par la Schaubühne de Berlin, Festival d'Avignon 2025
Ibsen à Avignon : Le jeu (dangereux) de la vérité
Avignon, Festival d'Avignon 2025, Opéra Grand Avignon, jeudi 10 juillet 2025, 17h Premiers pas dans la 79ème édition du Festival d’Avignon qui nous conduisent l’Opéra Grand Avignon vers l’entrée duquel les spectateurs convergent. C’est que l’élan du public est à la hauteur de l’événement avec le retour de Thomas Ostermeier, dix ans après son éblouissante mise en scène de Richard III, douze après Un Ennemi du peuple. C’était Ibsen déjà et sa peinture d’une bourgeoisie en proie à ses bassesses, à ses ombres. Ce retour attendu divise autant qu’il passionne. Les déçus perçoivent ici une forme de tassement qui tend à durer depuis les derniers spectacles du patron de la Schaubühne. On peut cependant s’accorder sur l’intérêt que son théâtre recouvre encore aujourd’hui et, même si les avis sont plus mesurés qu’il y a une dizaine d’années, ce Canard sauvage parvient à captiver. D’abord, par l’avancée du metteur en scène allemand dans l’œuvre d’Ibsen et les sujets qu’il aborde traduisant le relativisme du dramaturge – auquel notre rapport complexe à la réalité comme aux Fake news entre en résonance aujourd’hui ; ensuite, par la virtuosité des comédiens – et on retrouve Thomas Bading déjà en tête de la distribution d’Un Ennemi du peuple ; par une scénographie certes familière mais au raffinement esthétique indiscutable ; par le fait enfin, que les créations les plus fécondes du metteur en scène allemand ont par le passé, brillamment illustré et défendu un propos singulier qu’on retrouve explicitement ici. C’est pourquoi j’ai voulu me faire son opinion et même si certains signes d’essoufflement peuvent apparaître, la mise en scène de ce drame familial en forme de tragédie traduit bien sa maîtrise si reconnaissable d’Ibsen. En cette fin d’après-midi, l’Opéra Grand Avignon accueille un large public venu assister à la représentation du Canard sauvage. Ce n’est pas seulement Ibsen mais le travail de Thomas Ostermeier sur un de ses plus célèbres textes qui exerce pareille attraction sur la place de l’Horloge. Le personnel du Festival accueille, conseille, oriente chacun et chacune vers sa place dans l’effervescence des grands soirs. Le rideau est baissé : rien ne transparaît et on perçoit autour de soi l’attention de tous en direction de la scène encore dissimulée aux regards. Comme un secret bien gardé – sans doute en faut-il et, en ce sens, cela croise presque la pièce d’Ibsen. Le lever de rideau ne déçoit aucunement, laissant découvrir sans attendre le remarquable travail de Magda Willi sur la scénographie. L’utilisation d’un plateau tournant – certes déjà vu entre autres dans Vernon Subutex 1 récemment – dévoile un premier plateau figurant un intérieur raffiné bien qu’exigu, une entrée ou bien un vestibule. Une tapisserie à motifs géométriques très – peut-être volontairement trop – réguliers au mur. Des appliques à pampilles de verres, aux reflets irisés. Deux fauteuils en cuir noir signés Le Corbusier, séparés par une table à la structure chromée. On entend des voix derrière la porte qui s’ouvre et laisse entrer tour à tour plusieurs personnages qui se croisent et se font ainsi connaître du public. Une fête de famille a lieu en hors scène, on entend même des voix entonner un morceau a cappella. « Every day is so wonderful / Then suddenly it’s hard to breathe… » Une manière de se convaincre que tout va bien ? « No matter what they say » pour reprendre le refrain de Christina Aguilera. L’un des convives est Gregers Werle – prodigieux Marcel Kohler aussi émouvant que redoutable sous ses faux airs de prédicateur moderne. Il est le fils de Werle, le patriarche. Thomas Bading est toujours aussi épatant à travers cette figure dominatrice et insensible de chef de famille plus soucieux de faire prospérer ses affaires et de collectionner les maîtresses que de s’occuper de sa femme souffrante et de son fils. Cette dernière est décédée et Gregers veut en découdre avec son père qu’il rend responsable alors que Werle lui propose d’être son associé, alors qu’il est sur le point d’épouser sa dernière conquête. Cette dernière – élégante Stéphanie Eidt – leur demande de parler moins fort car on entend leur dispute – Faut-il donc sauver les apparences pour les invités ? Pour le public aussi peut-être ? Gregers explose néanmoins : « Ta vie n’est qu’un champ de bataille ». Et le père de lui répondre : « Il n’y a personne au monde que tu détestes autant que moi ». Peut-être ne fallait-il pas l’inviter alors, comme Gregers en proie à une grande agitation le lui rappelle pour éviter le drame. En effet, les secrets de famille affleurent avec l’arrogante désinvolture du père, les blessures béantes du fils. Tout rappelle l’examen cher à Ibsen des sordides turpitudes de cette bourgeoisie qui ne sont pas sans rappeler le tout aussi nordique Festen de Thomas Vintenberg, adapté sur scène par Cyril Teste en 2017. Werle reproche à Gregers de « regarder la vie à travers une vitre », d’avoir une vue déformée du monde qui l’environne. C’est que le jeune homme s’est fixé pour objectif de faire émerger la vérité coûte que coûte, de repousser le mensonge source de malheurs. Grand, droit, d’une rectitude maladive, il a toute l’allure d’un apôtre de l’honnêteté poussée à son paroxysme, indifférent à toute alternative. Redoutable même sans le savoir, même sans le vouloir. Sectaire. Il avait rencontré avant son père, Ekdal, qui passait discrètement afin de pouvoir poursuivre un travail pour Werle. Le vieil homme alcoolique et gâteux – joué avec beaucoup de brio par Falk Rockstroh – a tout perdu à cause du riche homme d’affaires. Stefan Stern est absolument remarquable dans le rôle de son fils, Hjalmar aux cheveux longs et filasses, toujours au bord de la folie. Gregers est troublé par sa présence à la soirée de Werle : avec son sens très aigu des bienfaits à dispenser, il décide donc de lui apporter son aide en réparation des actes odieux de son père qui a manipulé le sien pour échapper à ses ennuis et lui en faire endosser la responsabilité. Grâce à la tournette qui pivote lentement – autant sur la musique de Kate Bush que sur celle de Led Zeppelin à la fin – on change de décor, d’endroit pour arriver chez les Ekdal. Dans un intérieur plus vaste, on découvre une espèce de bric-à-brac associant pièce de vie plutôt modeste et mal rangée avec un lieu de travail comportant un comptoir et un photoautomat, du mobilier des années 70–80 et du matériel informatique d’aujourd’hui. En dédommagement du sacrifice d’Ekdal, Werle a permis à la famille de rebondir en tenant un commerce de photographie – art possible de l’illusion. Comme une aumône ayant permis à Hjalmar de cultiver sa supposée fibre artistique qui peine tant à s’affirmer dans cet environnement en apparence bancal, à l’apparence incertaine mais toujours ouvert avec des fenêtres, des portes, un hors-scène à cour qui laisse aller et venir les comédiens. Un autre espace hors-scène au fond à jardin attire l’attention : l’enclos du père Ekdal, ce lieu où il se voit chasseur de poules, pigeons et lapins, véritable utopie au sens étymologique, transposition d’un espace mental fantasque qu’on atteint péniblement par le regard hormis lors des rares mouvements de la tournette. C’est aussi l’enclos où le canard sauvage du titre a trouvé refuge, sans qu’on ne le voie jamais, comme dans le texte original où il est censé être abrité dans le grenier. D’emblée, le lieu est dissonant, entre réalité modeste, espoirs insatisfaits et vaines échappatoires dans le rêve. Gina – très belle prestation de Marie Burchard, toute en tension – était la domestique de Werle et elle a finalement épousé Hjalmar. Ils ont eu une fille : Hedvig, plus âgée ici que dans le texte original. Son rôle est d’ailleurs considérablement densifié et c’est l’extraordinaire Magdalena Lermer qui l’incarne avec concision et justesse. Comme son père qui se rêve en rock star – on retient sa piètre prestation de Mettalica à la guitare électrique plongeant sa famille dans une certaine perplexité, Hedvig veut devenir journaliste, voulant s’extraire de sa classe sociale, reprenant la figure de la transfuge de classe que le metteur en scène a déjà développée en adaptant le Retour à Reims de Didier Eribon. Pourtant, les événements en décident autrement. Pour chacun des personnages, la vérité est trop difficile à affronter. Même pour Gregers qui considère Hjalmar comme son meilleur ami et qui veut lui venir en aide quoi qu’il en coûte. C’est la raison pour laquelle il assène ses principes de défense d’une vérité absolue comme source de bonheur. « Le mensonge est la ruine » alors il ne peut y avoir d’autres alternatives. Quoi qu’il en coûte, sous la lumière crue des projecteurs. Même Relling que campe David Rulland ne peut rien empêcher. Et Gregers lui aussi devra affronter ce qu’il n’aurait jamais envisagé car, non, toutes les vérités ne sont certainement pas bonnes à dire. Briser le sceau du secret sur la naissance d’Hedvig, sur les raisons du mariage de Gina et de Hjalmar, lancer cette cascade de révélations et ce qu’elle engendre, tout cela rapproche le drame de l’inéluctable mécanique tragique « qui se démocratise et qui frappe la famille bourgeoise », comme le mentionne le philosophe Michel Meyer à propos du théâtre d’Ibsen. Tout cela jusqu’à la catastrophe finale, implacable et prévisible dans le mouvement circulaire de plus en plus rapide du plateau, sur les paroles de Robert Plant dans Kashmir diffusé à plein volume avant le noir final. Même s’il l’a considérablement modifiée dans son adaptation, Thomas Ostermeier parvient à restituer toute la richesse de la pièce d’Ibsen et son attachement revendiqué à l’œuvre du dramaturge norvégien n’est plus à démontrer. Ces études de mœurs à l’atmosphère nordique sont ici transposées dans une plus grande indéfinition temporelle qui, comme le cycle infernal de la tournette, nous ramène plus au présent, laissant poindre la dénonciation du profit comme vertu cardinale dans les sociétés capitalistes contemporaines, affaiblissant la capacité à être en relation avec autrui, promouvant davantage la croyance au détriment de la réflexion et du sens, rendant la vérité labile et souvent insaisissable. Loin d’un théâtre didactique trop asséchant pour le démontrer, Thomas Ostermeier s’appuie plutôt sur un texte modernisé et charpenté ainsi que sur la prodigieuse authenticité de ses comédiens malgré une première partie au rythme quelque peu distendu et quelques facilités comme l’échange de Gregers-Marcel Kohler avec le public autour du mensonge dans le couple et la famille qui s’étire et laisse Magdalena Lermer en attente en fond de scène. Ainsi, les retrouvailles entre le directeur de Schaubühne et le public avignonnais ont bien eu lieu même si elles n’ont pas tout à fait la flamboyance d’il y a dix ans. Il reste que Thomas Ostermeier est un fabuleux metteur en scène d’Ibsen et que si, comme le dit Relling dans la pièce, « à peu près tout le monde est malade », sa dramaturgie demeure un moyen privilégié de l’entendre. Crédit photo : © Christophe Raynaud de Lage
Par Thierry Jallet dans Wanderer Publié le 10 juillet 2025
Les Paillettes de leur vie ou la Paix déménage, de et avec Mickaël Délis, Théâtre Avignon – Reine Blanche, Avignon OFF 2025
Avignon, Théâtre Avignon – Reine Blanche, dimanche 6 juillet 2025 à 21h30. Clap de fin pour la Trilogie du Troisième Type de Mickaël Délis avec son dernier opus que nous nous sommes empressés d’aller voir dès les premiers jours du Festival, toujours au Théâtre Avignon – Reine Blanche. Après Le Premier Sexe dans lequel il s’attache au genre masculin puis La Fête du Slip qui aborde le sexe des hommes et le « pipo de la puissance » qui y est associé, le formidable comédien, aux textes toujours ciselés, s’intéresse enfin à la filiation et à la paternité pour achever son cycle. C’est donc un dernier spectacle un peu plus émouvant, un peu plus grave, qui révèle encore l’incroyable artiste qu’il est et qui semble avoir mûri jusqu’à ce dernier seul en scène. On retrouve son sens de la formule qui fait mouche, les personnages qui sont désormais familiers pour le public, sa fantaisie naturelle mais ici, la matière autofictionnelle se nourrit davantage du réel et de ses ombres qui traversent tout un chacun. Les Paillettes nous font tourner avec lui vers ce qui nous survit, vers les inquiétudes, les doutes que cela engendre. De surcroît, être père ne semble pas vraiment aller de soi pour un homosexuel qui en éprouve le désir. La route est souvent longue et pleine d’obstacles aux effets dissuasifs, surtout lorsqu’on passe la quarantaine. Ces zones d’ombre peuvent pousser au renoncement, a fortiori quand elles ont également trait à sa propre histoire familiale. Bien sûr, nous avons été emportés une fois de plus par l’acteur virevoltant. Mais nous avons été émus aussi par une sensibilité nouvelle qui affleure tout au long de ce dernier spectacle. Après avoir patienté dans le hall, le public attentif au signal du personnel, avance vers la salle, billet en main. Une fois le QR code reconnu, on peut alors entrer. Certains spectateurs sont déjà en salle puisqu’ils ont assisté à l’une, si ce n’est aux deux précédentes représentations qui ont permis de voir le début de la Trilogie du Troisième Type dans l’ordre. En ce premier week-end de festival, tous sont là pour voir Mickaël Délis dont ils connaissent le travail, comme les bribes de conversations entendues çà et là le confirment. Ce troisième volet à valeur conclusive pour le cycle commencé il y a deux ans, suscite un grand intérêt et à très juste titre. Il reste que l’acteur n’est pas encore arrivé : on remarque seulement de gros confettis rectangulaires blancs disposés en tas au centre de la scène. C’est alors qu’il entre, tout de noir vêtu, portant une espèce de surchemise blanche attachée dans le dos. Il s’installe parmi les spectateurs, sur un tabouret haut, face à la scène. « Ouh là, y’a vachement de monde dans cet hôpital ! » La phrase amuse autant qu’elle désarçonne. Où nous trouvons-nous ? Les réponses ne tardent pas à arriver. La scène prend place dans un service hospitalier réservé au don de sperme. Il va bien être question de la semence masculine et de sa conservation par cryogénie – les fameuses « paillettes ». Mickaël Délis fait décidément le tour de son sujet ouvert deux ans plus tôt avec Le Premier Sexe. Il endosse encore tous les rôles – y compris le sien – avec une lisibilité parfaite qu’on lui connaît parfaitement. Les personnages qu’on croise dans son parcours sont suffisamment typés pour être identifiés et véhiculent la force comique du spectacle, révélant l’absurdité des entraves du quotidien, les travers des proches égratignés affectueusement, les propres impasses et tourments que le comédien affronte ainsi sans doute – le théâtre, cet « espace où il est encore possible de réfléchir devant et avec les autres », comme le dit Georges Lavaudant. S'exposer sous les projecteurs C’est pourquoi on rencontre l’infirmière brute de décoffrage qui fait exploser un canon à confettis au moment de son souhait de faire un don de sperme ; on croise les couples de proches – mélanges subtils et fantaisistes de vécu et de fiction – avec les mamans un peu égarées (« PMA dans l’Ohio. GPA ? GPRD »), les papas un peu dépassés (« Ça se joue ailleurs pour le père ils disent en consult’, mais moi, j’ai pas encore trouvé où c’était, l’ailleurs… ») ; on croise le médecin du CECOS – Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain, pareil acronyme ne s’invente pas – qui « est APMS. Assez particulière mais sympa » ; on retrouve le docteur Jean-Daniel Deeck (à prononcer à l’anglaise évidemment) dans une nouvelle drôlissime démonstration au tableau – schéma des testicules à l’appui – convoquant en vrac données scientifiques et analogies entre la biologie, le MEDEF, Aristote, l’histoire, la pornographie, tout cela afin de rendre le propos des plus explicites, avec la même redoutable efficacité que dans les deux précédents spectacles. Le professeur Jean-Daniel Deek et son balai-néon Enfin, on reconnaît bien sûr les proches : sa mère aux inflexions de voix et à la gestuelle si reconnaissable dans son raffinement et son incorrigible tabagisme ; son frère jumeau, David « Dadou » qui ne l’épargne pas (Allez… Psychologie Magazine nous prépare un nouvel édito… ») comme un autre double de soi-même dont le théâtre permet de faire entendre les rudoiements à voix haute ; Lorenzo, l’ancien amant italien, d’abord acteur de film X puis pâtissier, qui le réconforte en lui préparant un tiramisu (« Remonte-moi ») et lui parle de sa propre future paternité en faisant la bibliographie de [ses] spectacles. « Si c’est pas marrant la vità des fois ». Des fois, oui. Mais des fois non car la Paix déménage justement. Il y a aussi le père et le séisme de l’abandon ressenti par toutes et tous dans la famille. La solitude qui s’installe et ne dit pas son nom. La violence de l’événement par-delà les années qui laisse sédimenter les doutes sur soi, sur sa capacité à être père soi-même, à procréer, même pour autrui. Dans Les Paillettes de leur vie, la tonalité se voile par moments d’une certaine mélancolie qui ne semble jamais trop quitter le joyeux comédien. Les fêlures persistent et on entend en creux le besoin de la scène pour les travestir suffisamment dans le champ autofictionnel afin de les supporter. Alors, le sourire s’efface y compris chez le spectateur. Des fois, è così, pourrait dire Lorenzo. « Y’a rien de plus galère qu’être papa quand t’es pédé. » Cette phrase prononcée au début du spectacle porte en substance le propos des Paillettes. Être père, être père homosexuel, être père dans l’ombre plus ou moins massive, plus ou moins transparente de son propre père, voilà ce que ce dernier opus aborde frontalement. Et ce sont autant de tempêtes sous un crâne que nous partageons avec Mickaël Délis, au fil du spectacle qui se déploie d’une séquence à l’autre, toujours sur le fil de l’émotion, jamais trop loin quand même d’une drôlerie qui désamorce même partiellement l’angoisse – celle de l’acteur autant que la nôtre très certainement. Puis, il y a l’absence définitive que la mort impose inéluctablement. C’est une chose de voir partir son père pour une autre vie, avec une autre femme, loin de soi, de sa mère dévastée. Autant d’impacts qui laissent assurément des blessures longues à se refermer. C’en est une autre de vivre le deuil avec ces béances et son autre lot d’incertitudes sur soi. Bien sûr, le comédien convoque ses personnages qui nous sont devenus familiers, des éléments scéniques tout aussi reconnaissables (le tissu blanc modulable, le néon lumineux qui fait office de manche à balai…) mais, avec lui, à l’occasion de cette conclusion au rythme toujours aussi enlevé, nous franchissons un autre seuil, peut-être plus intime, plus émouvant, ouvrant sur les peurs qui nous habitent tous. Toujours aussi montaignien – son inspiration dans l’ancrage bordelais ? – Mickaël Délis fait de lui « la matière » de son spectacle, plus que jamais. Et on l’y voit « tout entier et tout nu » finalement. Cette démarche artistique est tout à fait remarquable tant l’acteur ouvrant sa propre boîte de Pandore, nous invite dans un reflet spéculaire à faire de même, avec une subtilité propre à lui. Le spectacle est ici encore très écrit, charpenté avec rigueur et sa composition épouse avec justesse la courbe descendante de l’existence. Cela n’empêche évidemment pas le comique mais la gravité qu’il recèle toujours, scintille ici sous les paillettes. À l’aide des paillettes. Le corps du danseur qui n’est jamais loin, engagé dans une partition véritablement chorégraphique, exprime également tout cela avec beaucoup de grâce. On garde, par exemple, l’image – sublime – de Mickaël Délis exécutant des mouvements circulaires et emportant en l’air les paillettes au sol qui se soulèvent et volettent autour de lui, sous la lumière douce des projecteurs, comme un probable écho à ce besoin d’envoyer valser les inquiétudes. Coup de balai en public Ce dernier voler aurait dû s’achever sur un premier noir au plateau mais la vie en décide quelquefois autrement. Dans un épilogue tout en pudeur, l’acteur évoque la disparition brutale de la figure tutélaire qui a dominé sa trilogie. L’absence soudaine de cette mère si présente conduit à regarder lucidement ce qu’elle lui laisse dans un dialogue imaginaire plein d’une tendresse qui fait briller les yeux : « un courage épatant, une liberté insolente et un amour qui déborde pour le monde entier ». L’hommage n’exclut pas la pudeur mais on sent vibrer le cœur de l’artiste pour celle qui est, sera « toujours là » et qui « danse ». Il était une fois, l’homo… Il était une fois, l’homme… Mickaël Délis nous a raconté un peu de notre histoire. Crédits photo : © Pascal Gély/Hans Lucas
A 26 ans, le metteur en scène de «Mami», pièce traversée par son histoire personnelle, nourrit son théâtre de dessin et de cinéma Toute une édition sans révélation, ce ne serait pas tenable, et heureusement, cette année, au neuvième jour du Festival, Mario Banushi, 26 ans, Albanais d’Athènes, dont le In vient de montrer la troisième création et dont le travail n’avait jamais été encore présenté en France, illumine la programmation. Mami, c’est donc le spectacle du Festival, qui ne ressemble à rien de connu. Qui plus est, un spectacle sans paroles – mais avec une giboulée d’images aussi profondes que marquantes, comme sorties du tréfonds de la vie intime de son auteur. Des images oniriques ? Mario Banushi récuse ce terme quand on le rencontre à côté d’une citronnade bienvenue. «Je comprends qu’on puisse dire que mes images sont oniriques, mais pour moi, elles sont surtout extrêmement familières, elles font partie de moi. En concevoir la ligne, les dessiner, c’est un peu comme d’improviser au piano.» Il ajoute cette phrase définitive : «L’imagination est ma solution.» Théâtre nourri de dessin et de cinéma Mario Banushi est né à Athènes, mais à 8 mois, il est envoyé chez sa grand-mère dans un village en Albanie tandis que ses parents tentent de s’en sortir dans la capitale grecque. Lorsqu’il a 6 ans, sa mère le reprend avec elle. L’enfant doit accepter la séparation d’avec sa «Mami», trop vieille, trop pauvre, apprendre une nouvelle langue, s’adapter à la grande ville qu’est la capitale hellénique. «Alors vous comprenez pourquoi l’imagination est mon arme ? Elle était ma manière de voyager, d’aller voir ma famille disparue de mon monde, mon passé éclipsé.» Ses parents, qui se sont séparés peu de temps avant sa naissance, sont des rescapés. Ils survécurent au naufrage du bateau de marchandise Viora qui transportait 20 000 migrants le 7 août 1991. Le cargo parvint tout de même à accoster le 8 août. Mario nous montre sur son téléphone les images d’archives impressionnantes de la marée humaine qui tente alors de quitter le bateau et l’enfer. «Dans cette foule, il y a mes parents. Vous les voyez ?» Beaucoup sont morts durant la traversée. Partis sans leur passeport, ses parents avaient le projet de s’installer en Italie, mais finalement gagnent à pied la frontière grecque. Sage-femme en Albanie, sa mère devient femme de ménage et nettoie, du matin très tôt au soir très tard, divers intérieurs athéniens avec l’aide de son petit garçon. Le spectacle Mami, qui rend donc hommage à toutes les femmes qui ont élevé Mario Banushi n’oublie pas ce métier de sage-femme, que sa mère n’a jamais pu exercer en Grèce. Elle est aujourd’hui propriétaire d’une petite boulangerie tandis que son père a acquis une taverne. Mais le théâtre, qui durant son adolescence lui paraît un art poussiéreux : comment est-il arrivé jusqu’à Mario Banushi ? Eh bien, il aurait pu ne jamais se trouver sur son chemin même si à 13 ans, il découvre qu’il prend plaisir à concevoir des costumes et des décors à l’école. L’adolescent dessine constamment. Tourne un court métrage à 19 ans avant d’entrer, pour suivre une amie, au conservatoire d’Athènes. Encore aujourd’hui, il pense que son théâtre est nourri du dessin et du cinéma, bien plus que de l’histoire théâtrale, par nature peu revisitable – «Par exemple je storyboarde complètement mes pièces, ce qu’on fait peu au théâtre. Et des amis m’ont dit que ma manière de recruter les acteurs ressemblait beaucoup plus à la manière de faire des directeurs de casting au cinéma qu’au théâtre». Sans fil narratif autre que celui qu’imposent les images Sa première pièce, Ragada, a vu le jour pendant le Covid et a été créée dans une maison. Il avait 22 ans et a appelé tous les directeurs de lieux pour qu’ils se déplacent voir le spectacle qu’ils avaient refusé de produire. Sa deuxième pièce, Goodbye Lindita, aurait dû être jouée quinze jours au théâtre national d’Athènes, elle a tourné pendant quatre saisons sur toutes les scènes du théâtre national. Sa troisième, Taverna Miresia, a été produite par le prestigieux festival d’Epidaure et a été programmé durant deux saisons à ce même festival. Même succès international. La plus grande des reconnaissances provient des spectateurs qui lui envoient des photos de paysages ou de lieux avec ces mots : «C’est très Banushi !» On le compare souvent (déjà !) à David Lynch, mais une actrice du Sacrifice de Tarkovski lui disant que cela faisait des années qu’elle recherchait des œuvres qui puissent lui rappeler le grand cinéaste russe mort en 1986 a visé juste. Sinon Mario Banushi préfère ne pas être comparé. Il dégage un drôle de mélange de confiance en lui, simplicité et irréductibilité. Il prévoit de faire un long métrage. A condition que ce soit à sa manière, sans fil narratif autre que celui qu’imposent les images. Il préférera ne pas le tourner plutôt que de céder à des normes commerciales. Son théâtre a voyagé jusqu’en Australie mais n’a jamais été montré dans le pays où il a grandi. Et pourtant : «Toutes mes références sont albanaises.» Anne Diatkine / Libération Légende photo : Le metteur en scène Mario Banushi. (Andreas Simopoulos)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 17, 3:52 AM
|
Par Sonya Faure dans Libération, 17 juillet 2025 «La Neige est blanche», «le Journal de Maïa» et «la Peau des autres» : pensés pour être joués dans les établissements scolaires et destinés aux adolescents, ces trois spectacles sondent leurs tourments. Chacun son festival d’Avignon. Nous voilà dans une salle de cours, à attendre devant le tableau Velleda que la pièce commence. Les spectateurs sont moins nombreux que les élèves des classes surchargées de l’Education nationale, mais les néons accrochés aux faux plafonds sont bien là. Soudain notre voisine se lève d’un bond : «Toi et moi, on a une décision à prendre. Continuer ou arrêter ?» Il faut bien répondre, alors la plupart d’entre nous n’hésitons pas : continuer. La fille en tenue de sport s’avance devant le tableau et se présente, elle est en section sport-études de ski alpin, son père, qui vient d’un pays où on ne fait pas de sports de neige, est si fier d’elle qu’elle continue même si elle voudrait surtout avoir la vie d’une fille de son âge. En finir avec la compétition, utiliser son corps autrement, sortir des traces et bifurquer vers la poudreuse. Continuer ? Arrêter ? Il n’est pas évident, à la fin de la performance, qu’on soit nombreux à être si sûrs de nous. Précise, jamais maniérée comme beaucoup d’adultes qui campent des ados, la comédienne Galla Naccache-Gauthier joue d’un rien, de ce qu’il y a dans la salle de classe, du petit rideau pelé qu’elle ouvre et ferme, de la lueur des néons. Et pour toute ingénierie son et lumière, elle a une petite enceinte et une boule qui scintille et transforme le tableau Velleda en nuit étoilée. «Ce que tu vis, c’est normal et ce n’est pas si grave» La neige est blanche, monté par Marine Mane, est un seul en scène léger. «Pièce pour une interprète en établissement scolaire», elle doit pouvoir s’implanter dans n’importe quelle salle de lycée. Elle a été pensée pour ça, pour rencontrer un public de l’âge de l’héroïne. Elle est systématiquement suivie d’un moment d’échange après la représentation : et vous, vous feriez quoi ? «Dans les lycées de sport-études où nous sommes passées, les jeunes nous ont souvent répondu qu’ils ne préféraient pas y penser, rapporte Galla Naccache-Gauthier. Ils se dirigent souvent vers une carrière de sportifs de haut niveau pour faire plaisir à leurs parents, eux-mêmes anciens champions. Dans les formations de sports de glisse, ils portent aussi toute la pression de leurs profs qui doivent justifier leur existence alors que la neige fond et que, comme elle, ils sont voués à disparaître…» L’anxiété est le sujet central et diffus d’une autre pièce présentée dans le off d’Avignon, Le Journal de Maïa, du metteur en scène Cédric Orain. Sur scène cette fois, les deux jeunes filles pourraient sortir des pages d’une BD, sautillantes avec leur sac sur le dos (Louise Bénichou et Marion Brest), et tentent de trouver leur voie de collégiennes : faut-il vraiment croire la redoutée prof de français quand elle affirme qu’on peut aimer lire (et du Chateaubriand en plus) ? On a aimé chez Orain cette manière de prendre au sérieux les vagues d’anxiété des ados (un sur deux y serait confronté selon un sondage Ipsos de 2022) sans en faire un drame – seulement une pièce de théâtre. «En quatrième, j’aurais bien aimé moi aussi qu’un spectacle me dise : ce que tu vis, c’est normal et ce n’est pas si grave», répond-il. S’offrir aux adolescents Dans les collèges, il arrive sans rien. «Il nous faut juste un peu d’espace, une salle de permanence ou une grande salle de classe. On prend les chaises du lieu et si les peintures sont moches et les carrelages affreux, c’est bien aussi ! On arrive tous les trois, sans préparation technique. On est un peu nus, on n’a pas grand-chose pour se sauver : pas de lumière, pas de fond sonore. C’est intéressant et troublant.» Ce qu’il faut construire en revanche, c’est l’espace symbolique, «implanter un cadre de théâtre». Dans le dossier de sa pièce, il est écrit que le temps de montage en établissement scolaire est estimé à une heure : «Aucune installation technique n’est nécessaire, mais un temps de concentration et de prise de l’espace est précieux pour les actrices avant la représentation.» Cédric Orain explique : «On doit parfois insister, ça n’a pas l’air évident pour tous dans les collèges : pas de passage au milieu de la salle de représentation, pas d’interruption pendant le spectacle, pas de surveillant qui vienne chercher un élève.» De plus en plus de pièces s’offrent aux adolescents – les établissements s’appuient notamment sur la partie collective du pass culture pour financer leur venue. Un dernier exemple, présenté lui aussi à Avignon, La Peau des autres de Lauriane Goyet. Deux jeunes actrices (Lucie Giuntini et Colomba Giovanni) et une danseuse (Marie Orticoni), toutes excellentes, un seul banc noir comme un bloc de béton, donnent un spectacle beaucoup plus sombre et tendu, sur les violences familiales, l’amitié et les désirs adolescents. La neige est blanche, jusqu’au 26 juillet à 11 heures à Présence Pasteur. Relâche les 8, 15, 22 juillet (cinquante minutes). Le Journal de Maïa, jusqu’au 24 juillet à 9 h 45 au théâtre du Train bleu. Relâche les 11 et 18 juillet (cinquante minutes). La Peau des autres, jusqu’au 23 juillet, à 13 h 15 les jours impairs au théâtre du Train bleu (une heure et vingt minutes).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 16, 5:36 AM
|
Analyse par Fabienne Darge / Le Monde du 16 juillet 2025 A mi-parcours de la manifestation, le réel a fait une incursion dans la 79ᵉ édition, les artistes cherchant comment le dire, avec plus ou moins de naïveté ou de bonheur. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/16/au-festival-d-avignon-le-theatre-bouscule-par-l-actualite-immediate-livre-toujours-ses-lecons_6621572_3246.html
Que Gaza ou l’Ukraine ont semblé loin d’Avignon, en cette première partie de la manifestation créée par Jean Vilar, en 1947, dans l’esprit issu de la Résistance… Le Festival a donné, jusque-là, le sentiment d’être une bulle. Certes, de nombreux artistes, dans cette 79e édition, qui met la langue arabe à l’honneur, sont apparus, à l’heure des saluts, avec un keffieh palestinien sur les épaules. Certes, un rassemblement a eu lieu et une « nouvelle déclaration d’Avignon » prononcée, le samedi 12 juillet, sur le parvis du Palais des papes, pour dénoncer « les massacres orchestrés par l’Etat israélien à Gaza et dans les territoires occupés » – une déclaration lue par des artistes comme Anne Teresa De Keersmaeker ou Milo Rau, en présence du directeur du Festival, Tiago Rodrigues. Mais, annoncée tardivement et mal diffusée, cette initiative n’a pas attiré les foules : moins de 1 000 personnes devant le Palais des papes. La profession théâtrale, traditionnellement très politique, semble, en cette année 2025, tétanisée par les problèmes budgétaires qui la touchent et qui ravagent un écosystème déjà fragile. On attendait la soirée Nour (« lumière », en arabe) du mardi 15 juillet pour voir si Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, à Paris, allait prendre la parole, mais, finalement, c’est Radhouane El Meddeb, directeur artistique de l’événement, qui s’est exprimé en son nom propre avec autant de gravité que de sobriété : « Nour dénonce l’anéantissement programmé de la Palestine et le silence complice de ceux qui ne dénoncent pas cette barbarie. » Cette soirée poétique et musicale, magnifique, a sans doute plus fait pour la Palestine que bien des discours, dans le partage du sensible mis en œuvre ici, qui n’attaquait pas frontalement le sujet, mais l’a distillé de manière subtile. « La poésie est aussi une méthode qui nous permet de résister à une vie inhumaine », disait le grand poète palestinien Mahmoud Darwich, disparu en 2008. Le réel est donc là et bien là, dans cette édition, et l’on voit bien que les artistes cherchent comment le dire, quitte à vouloir le faire entrer le plus directement possible dans la représentation, avec plus ou moins de naïveté ou de bonheur. Les curseurs entre réel et imaginaire ne sont pas toujours évidents à ajuster, le théâtre documentaire, souvent réduit à un théâtre de témoignages, n’étant pas toujours le mieux à même de permettre à l’art de jouer le rôle qui est le sien, et qui n’est pas celui du journalisme ou de la politique. Aussi émouvante que réjouissante Ces questions, largement brassées ces temps-ci, ont donné lieu à l’une des créations les plus formidables de cette édition. Il se trouve qu’elle est aussi celle qui sera vue par le public le plus varié et le plus éclectique, puisqu’il s’agit du traditionnel spectacle itinérant du Festival, joué, jusqu’au 26 juillet, dans des villages de la région, de Vacqueyras (Vaucluse) à Vallabrègues (Gard). Il a été confié au metteur en scène suisse Milo Rau, actuel directeur du Festival de Vienne, en Autriche, découvert ici, à Avignon, en 2013, avec une extraordinaire pièce documentée sur le génocide rwandais, Hate Radio. Milo Rau a, depuis, développé un théâtre du réel, notamment sous la forme de représentations de procès. C’est donc lui qui sera aux commandes, également, de la soirée d’hommage à Gisèle Pelicot, programmée vendredi 18 juillet au Cloître des Carmes. Un théâtre du réel qui n’a pas toujours évité certains écueils, celui de la communion entre personnes bien-pensantes, entre autres, avec Antigone in the Amazon, présenté au Festival en 2023. Avec La Lettre, il est contraint à une forme modeste, qui s’avère ici une vraie petite leçon de théâtre aussi émouvante que réjouissante, et entrelace le réel et l’imaginaire avec autant de simplicité que de maestria. Le réel étant d’abord, dans l’art vivant du théâtre, celui de l’existence en chair, en os, en âme et en esprit des êtres humains présents de part et d’autre du quatrième mur (lequel n’existe plus beaucoup, de nos jours), le metteur en scène est parti de l’histoire personnelle de ses deux jeunes acteurs. Elle, Olga Mouak, est d’origine camerounaise et réunionnaise. Elle a grandi à Orléans, s’est passionnée très tôt pour la figure de Jeanne d’Arc, et a toujours rêvé de jouer Nina, dans La Mouette, d’Anton Tchekhov. Ce qui, jusque-là, n’a pas été possible, parce qu’elle est noire, qu’elle a un corps de femme terrienne et bonne vivante, et que cela ne correspond pas aux clichés éthérés attachés à ce rôle. Lui, Arne De Tremerie, est le petit-fils d’une femme, Nina De Tremerie, présentatrice star d’une émission culturelle de la radio flamande, qui aurait rêvé d’être actrice et de jouer Nina ou Arkadina dans La Mouette. C’est d’elle que tout part, et de cette fameuse lettre qui donne son titre au spectacle. Une lettre que Nina De Tremerie a trouvée sur une table de sa maison, quand elle avait 9 ans, et où sa propre mère, l’arrière-grand-mère d’Arne, donc, lui disait qu’elle partait, et qu’elle ne savait pas quand elle reviendrait. C’était en 1949, la mère de Nina n’est jamais revenue. Depuis qu’il est devenu acteur, Arne a un rêve : mettre en scène La Mouette de Tchekhov. La lettre est-elle vraie ou inventée ? Milo Rau entretient le flou à dessein – il semblerait qu’il y ait bien eu lettre, mais qu’elle ait été réécrite pour les besoins du spectacle. Elle est en tout cas le point de départ d’une mise en acte aussi vertigineuse que ludique sur la manière dont nos vies sont tissées d’imaginaire et de fiction, qui repose sur le talent éblouissant de ses jeunes interprètes. Lesquels joueront bien Constantin et Nina, les deux jeunes héros de La Mouette, mais aussi une foule d’autres choses, dans ce spectacle qui orchestre de troublantes correspondances biographiques. Tous deux ont un charme fou, lui, Arne, avec son côté showman, sa manière de décaler par l’agilité burlesque son air de petit prince blond aux yeux bleus. Elle, Olga (prénom tchékhovien lui aussi), avec une transparence de jeu renversante, une forme de naturel pour autant jamais banale ni ennuyeuse. Théâtre et réel, la question n’est pas épuisée, jamais épuisable, toujours à remouliner dans les coordonnées spécifiques d’une époque. La Lettre, par Milo Rau. En itinérance dans la région d’Avignon, jusqu’au 26 juillet. Puis tournée jusqu’en mai 2026, notamment au Théâtre Silvia Monfort, à Paris, du 28 décembre au 31 janvier 2026, et au Théâtre public de Montreuil (Seine-Saint-Denis), du 20 au 30 mai 2026. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo Arne De Tremerie et Olga Mouak dans « La Lettre », mis en scène par Milo Rau, au Festival d’Avignon, en juillet 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 15, 9:34 AM
|
Par Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 15 juillet 2025 Pour la première fois, la troupe de la Maison de Molière se produit dans les deux Festivals, dans la Cour d’honneur avec « Le Soulier de satin » et à la Scala Provence avec « Les Serge (Gainsbourg point barre) ».
Lire l'article sur le site du "Monde":
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/15/a-avignon-la-comedie-francaise-a-l-affiche-du-in-et-du-off_6621368_3246.html Pour la première fois, cette année, la Comédie-Française est à l’affiche des deux Festivals d’Avignon. Dans le « in » avec Le Soulier de satin au sein de la Cour d’honneur du Palais des papes, du 19 au 25 juillet, et dans le « off » avec Les Serge (Gainsbourg point barre) au théâtre La Scala Provence, du 15 au 26 juillet. Pas moins de 28 comédiens et comédiennes de la vénérable institution se répartiront sur ces deux scènes. Pour le public avignonnais, qui navigue entre le « in » et le « off » sans se soucier de savoir s’il assiste à un spectacle issu du secteur subventionné ou privé, cette double présence peut paraître anecdotique. Mais pour le milieu théâtral, elle a une portée symbolique forte. Avec un tempérament toujours prompt à s’emballer, Frédéric Biessy, directeur de La Scala Provence, parle d’un « moment de bascule. Ce qui paraissait improbable devient soudain naturel ». Pour l’occasion, l’entrepreneur a organisé, lundi 14 juillet, une conférence de presse, avec à ses côtés Françoise Nyssen, présidente de l’association de gestion du Festival (« in ») d’Avignon et ancienne ministre de la culture, et Harold David, coprésident de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C), qui coordonne le « off ». Soit un trio très rarement réuni autour d’une même table. « Après avoir été face à face, le “in” et le “off” sont côte à côte », se réjouit Frédéric Biessy, persuadé que « les lignes bougent » et que cette initiative « aurait fait sourire Jean Vilar [créateur du Festival d’Avignon en 1947] ». Décloisonnement public-privé inédit Autour d’eux, les comédiens et comédiennes du Français qui joueront Les Serge écoutent, presque surpris, ces prises de parole enthousiastes sur ce décloisonnement public-privé inédit. « Je n’ai pas le sentiment d’appartenir à une caste ou à un milieu social du théâtre, résume Noam Morgensztern. Quand on nous a annoncé que la tournée des Serge irait à La Scala, on s’est dit “chouette !, on va à Avignon”, sans penser à ces histoires de “in” et de “off”. » Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Maison, se souvient : « En 2006, je jouais aux Ateliers d’Amphoux dans le “off” et rêvais de la Comédie-Française. » « En 2009, je jouais à La Manufacture dans le “off” et dans un spectacle de Christophe Honoré dans le “in” », rappelle Sébastien Pouderoux, pensionnaire. Cette double venue de la Comédie-Française correspond aussi à une édition avignonnaise qui, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, affiche des dates communes pour les deux Festivals. Une concordance dont se félicitent aussi bien Harold David que Françoise Nyssen. « Il faut coopérer, sortir des silos ; “in” et “off”, c’est absurde, il y a d’abord un public et du théâtre », insiste l’ancienne ministre. Mais un tel rapprochement nécessite d’« inventer un autre modèle économique », précise le coprésident d’AF&C. Car si la Comédie-Française peut venir dans le « off », c’est parce que La Scala dispose d’une salle de 600 places (la plus importante de ce festival) et a les reins financiers suffisamment solides pour acheter un spectacle du Français et équilibrer, grâce aux recettes de billetterie, avec un tarif des places (48 euros à l’orchestre, 37 euros au balcon) bien plus élevé que ce qui se pratique habituellement dans le « off ». Le Soulier de satin, mis en scène par Eric Ruf. Cour d’honneur du Palais des papes, Avignon, du 19 au 25 juillet. Les Serge (Gainsbourg point barre), mis en scène par Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux. La Scala Provence, Avignon, du 15 au 26 juillet. Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 4:30 PM
|
Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 13 juillet 2025 Avec sa nouvelle pièce, qui réunit six personnages dans un chalet bavarois, le metteur en scène suisse offre un spectacle jubilatoire, à la fois politique et poétique.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/13/au-festival-d-avignon-folie-douce-au-sommet-avec-christoph-marthaler_6621016_3246.html
C’est comme une drogue. Un shoot de folie douce dans la dureté des temps, qui vous enivre et vous fait entrer en lévitation. Une ivresse indéfinissable, comme si l’air des montagnes s’était engouffré dans la fournaise avignonnaise. Avec Le Sommet, le maître suisse Christoph Marthaler, 73 ans, a offert au Festival, où il n’était pas revenu depuis 2013, une merveille de spectacle, où son sens de l’absurde aérien le dispute à l’acuité politique sur les temps de désagrégation que nous vivons. Un cadeau. Lire l’entretien avec Charlotte Clamens, comédienne : Article réservé à nos abonnés « Le théâtre de Christoph Marthaler, c’est la performance de l’antiperformance » Alors, d’abord le décor. Un chalet en bois qui semble construit directement sur la roche de la montagne, puisque celle-ci affleure à même le plancher. L’endroit est tellement perché que l’on n’y accède que par un monte-charge, qui recrache en premier lieu une copie de La Joconde ainsi que divers objets tout aussi inattendus, déclenchant l’hilarité générale. Avant de laisser la place à un petit groupe d’humains, arrivant un par un, trois femmes, trois hommes. Chapeaux à plumes, gilets en laine jacquard, culottes de peau tyroliennes et chaussures de randonnée, il semblerait bien que l’on soit dans les Alpes bavaroises – peut-être suivez-vous notre regard, déjà. Que viennent-ils faire là, ces humains qui parlent en français, en italien, en anglais (d’Ecosse), en allemand et même dans un dialecte autrichien aux accents archaïques ? S’agit-il là d’un de ces sommets entre grands de ce monde, réunis discrètement en lieu sûr (en apparence, du moins, comme on le verra plus tard) ? Absurdité des temps Après avoir chanté mezza voce à l’unisson, histoire de mieux établir leur communauté, les voilà qui ouvrent de grands classeurs pour se livrer à une irrésistible séance de traduction simultanée, d’autant plus drôle qu’elle ne porte que sur des mots aussi simples que « one », « yes », « no », et surtout « but » – le « mais » étant visiblement l’alpha et l’oméga de ces négociations entre dirigeants réduites jusqu’à l’os. Comme pour mettre à nu une structure révélant l’inanité de ces prétendus échanges. Le sens de la poésie sonore de Christoph Marthaler et de son dramaturge, Malte Ubenauf, atteint ici des sommets, avec ce concert itératif suivi d’une séance de sauna, laquelle fera dangereusement grimper la température alors que dehors il neige, en plein été. Il faut bien se détendre, après un tel effort, une telle accumulation de « mais ». Et avant la cérémonie officielle qui va suivre, réduite elle aussi, mais cette fois par l’expression des corps, à la vanité de sa représentation. Peu à peu, pourtant, l’inquiétude gagne. Un hélicoptère passe très près du chalet, et le bruit d’une forte explosion se fait entendre. Un autre appareil survole les lieux, et largue un gros paquet, qui s’avère rempli… d’extincteurs gonflables – un objet qui, oui, existe bien dans notre monde réel, destiné notamment à tous ceux qui voudraient se déguiser en pompiers. Artefact en lequel Christoph Marthaler semble avoir trouvé le symbole parfait de l’absurdité des temps. Dans la montagne, une voix résonne, annonçant que les routes sont coupées, que la zone est condamnée, pour une durée « de quinze à dix-huit ans ». Puzzle délicat La dramaturgie en apesanteur, d’essence profondément musicale, de Christoph Marthaler tisse sa toile de manière impalpable, laissant le spectateur faire les liens lui-même. Des textes du poète – trop méconnu – Christophe Tarkos, de Pasolini, d’Olivier Cadiot ou de Dylan Thomas se mêlent à des morceaux de Schubert, de Mozart ou d’Adriano Celentano, dans ce puzzle délicat qui sans cesse se redistribue entre cacophonie et harmonie, loin des formes documentaires parfois paresseuses et souvent lourdement démonstratives qui se multiplient sur les plateaux. La jubilation provoquée par ce Sommet marthalérien vient aussi, bien entendu, de la vision de ces pompiers pyromanes que sont les grands de notre monde pris à leur propre piège – celui qu’ils ont fabriqué pour les autres, d’une société invivable. Le rire est doublé d’une note de fond d’une gravité sans appel, dans ce spectacle fourmillant de détails dadaïstes, qui peu à peu, sans que ce soit jamais explicite, convoque les réminiscences d’un autre chalet : le Berghof, à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Adolf Hitler passa la moitié de sa vie, avant et pendant la guerre, dans ce refuge où, en tant que chef d’Etat et de gouvernement allemand, il reçut nombre de personnalités en visite officielle, des Britanniques David Lloyd George et Neville Chamberlain à l’amiral français François Darlan en passant par le duc et la duchesse de Windsor et une noria de diplomates. Pour un homme de la génération de Marthaler, l’histoire du nazisme n’est pas une abstraction. Ne reste alors, sur scène comme dans la salle, qu’à fredonner « Now it’s time to say good night », variation tout en douceur sur Good Night, des Beatles. En attendant la fin du monde. Le Sommet, par Christoph Marthaler. Festival d’Avignon, La FabricA. Jusqu’au 17 juillet. Puis tournée française et européenne jusqu’en avril 2026, notamment à la MC93 de Bobigny, dans le cadre du Festival d’automne, du 3 au 9 octobre. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo : « Le Sommet », de Christoph Marthaler, au Festival d’Avignon, le 12 juillet 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 7:05 AM
|
Propos recueillis par Laurent Goumarre / Libération du 13 juillet 2025 De passage dans la cité des Papes pour trois jours, la metteuse en scène raconte son Festival, où «tout va plus vite qu’ailleurs». Etre en retard, c’est possible quand on monte sur scène ? Non, jamais. L’acteur doit être, avant, bien avant que le public rentre. Parce que je crois et je sais qu’il existe quelque chose avant l’entrée des spectateurs. Le théâtre a déjà commencé. L’acteur n’est jamais en retard, il est en avance. Aller au théâtre, mais pourquoi ? Dans quel espoir ? Aller au théâtre, ce n’est pas rien. Ce chemin est déjà une histoire qui peut faire peur. Il faut aider les gens à ouvrir et passer cette porte-là. Pour espérer d’être ensemble. L’espoir s’il y en a un, c’est celui-là : trouver les autres. Quand je suis spectatrice, je garde la même place que j’ai quand je travaille : au milieu. Je ne sais pas s’il faut espérer quelque chose d’autre. La dernière fois où vous vous êtes endormie dans une salle ? Je ne dors jamais ; je peux être dans un état de rêve éveillé, je décroche, et ce n’est pas négatif. C’est comme si parfois les spectacles me permettaient d’avoir un temps à moi, de suspension, de contemplation. Je quitte le sens, je regarde une couleur, un objet, un costume, d’autres chemins pour m’échapper. Je suis dans un autre regard, donc je ne peux pas m’endormir. Jamais. Un geste de la vie quotidienne que vous ne savez pas faire quand vous êtes à Avignon ? Prendre le temps, c’est impossible, on passe d’un spectacle, à un autre avec des tas de rendez-vous. Tout va plus vite qu’ailleurs. Le plus grand risque comme spectateur ? Rester enfermé dans une idée des choses, de ce qu’un spectacle doit être. Il y a un risque à ne pas ouvrir toutes les portes, c’est l’étouffement. Le coup foudre artistique ça existe ? Oh oui. Au pluriel. C’est Raimund Hoghe au Cloître des carmes, c’est une installation de Romeo Castellucci : des petits pieds d’enfants en argile, avec un moteur dessus, qui bougeaient doucement. C’est cette étudiante de Marina Abramovic, à l’école d’art d’Avignon, de dos, qui regardait un coucher de soleil, sans bouger, pendant très longtemps. A pleurer. Qui pour mettre en scène votre vie ? Moi. tout le monde me dit ça : «Arrête de mettre en scène ta vie !» La langue invitée du festival est l’arabe, mais la langue qui s’invite en vous ? Celle du corps. Dans chacun de mes spectacles, c’est sujet-verbe-complément : un acteur à côté d’une table, et une musique, et un ventilateur, et une langue. Ce sont les seules phrases que je comprenne. Des phrases de couleur, de matière. Vous pourriez nous dire en deux mots ce que vous faites à Avignon ? Je sors d’une lecture cabine à Artcena pour présenter une commande Jeune public du CDN de la Commune en 2026 : monster parade. Je lisais des textes dans une cabine, le public ne m’entendait pas, les acteurs avaient une oreillette et disaient le texte qu’ils entendaient. Et là je pars en rendez-vous, en trois jours j’aurai vu tous ceux que j’aurais pu rencontrer en un an. Ses rendez-vous de rentrée : Velvet, 25-27 septembre au CDN de Tours, 6 novembre Scène nationale Saint-Nazaire, 13 novembre Espace Pluriel à Pau, puis une énorme tournée en 2026 Propos recueillis par Laurent Goumarre / Libération Légende photo : La metteuse en scène nathalie béasse à Paris le 4 janvier. (Lisa Miquet/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 12, 2:58 PM
|
Par Fabienne Darge, envoyée spéciale du Monde à Athènes - 12 juillet 2025 Le metteur en scène né en Albanie et installé en Grèce présente à Avignon sa nouvelle création, «Mami », dans laquelle il explore les figures maternelles.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/12/festival-d-avignon-les-voyages-balkaniques-de-mario-banushi_6620889_3246.html
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Athènes ne ressemble pas à un cliché pour touristes, en ce jour de mai. Un vent venu d’Afrique a recouvert la ville d’une fine couche de poussières sahariennes, comme un voile de cendres. On suit Mario Banushi dans un quartier modeste et tranquille aux immeubles assoupis, et l’on se croirait dans une petite ville des Balkans, loin, bien loin de la grandeur athénienne. Le jeune metteur en scène, qui est l’artiste à découvrir dans ce Festival d’Avignon 2025, où il présente sa création intitulée Mami, a grandi entre ce quartier d’Ilioupoli et la périphérie campagnarde de Tirana, en Albanie. Il emmène sur les lieux de son enfance comme autant de stations sur un parcours qui l’a vu, en quelques années et trois spectacles, devenir à 26 ans la coqueluche des programmateurs de théâtre du monde entier, d’Avignon à Taipei en passant par Montréal ou Sydney. Un « conte de fées » dont il ne revient pas lui-même. D’emblée, dès sa première création, Ragada (2022), il a imposé son univers, totalement singulier : un théâtre sans paroles, marqué du sceau du rituel et gorgé d’images à la beauté irradiante, qui fait irrésistiblement penser dans son étrangeté poétique au monde du grand cinéaste géorgien Sergueï Paradjanov. « Comme j’ai grandi dans un milieu totalement éloigné de l’art, et dans l’idée que personne n’allait m’aider, j’ai vraiment dû partir de moi-même, de mes émotions, de mes sensations, pour créer », dit-il en montrant le petit terre-plein, dans le parc jouxtant l’immeuble de son enfance, où il venait seul, en son adolescence, déclamer des monologues. Mario Banushi a très vite su que sa vie se construirait entre les arts plastiques, la musique et le théâtre, sans avoir la moindre idée de ce qui avait pu le conduire vers ce désir. Pour lui permettre de mener ses études au Conservatoire d’Athènes et économiser le loyer de leur appartement, sa mère est allée vivre avec lui dans le minuscule local qui surplombe la boulangerie qu’elle tient aujourd’hui encore à Ilioupoli. « Ma mère est vraiment mon héroïne, et plus généralement les femmes de ma famille, qui traversent tous mes spectacles, affirme Mario Banushi. C’était extraordinaire pour moi d’intégrer le conservatoire, mais, pour autant, je ne me suis pas du tout reconnu dans l’enseignement, qui était globalement très classique, stanislavskien [du nom du comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique russe Constantin Stanislavski]. J’ai vite compris que le théâtre de texte n’était pas mon truc et que ce que je voulais, c’était chercher dans le corps, dans l’énergie, pour pouvoir exprimer des motifs très personnels. » Intimité dans l’étrangeté C’est au conservatoire, pourtant, qu’il découvre le travail de Pina Bausch ou de Christoph Marthaler, dont il se sent beaucoup plus proche, et qui s’est combiné chez lui avec son « amour » pour la musicienne-performeuse Laurie Anderson et pour le cinéaste Andreï Tarkovski. Ces découvertes ont ouvert des portes, même si son univers n’a rien à voir avec celui de ces illustres prédécesseurs, de même qu’avec celui de Romeo Castellucci, avec lequel on le compare pourtant souvent. « J’ai vu mon premier spectacle de Castellucci il y a deux ans, alors que j’avais déjà créé mes trois premières pièces », dit-il en s’amusant. « Je n’ai pas créé mon propre univers parce que je me suis dit que je voulais le faire, insiste Mario Banushi. C’est vraiment venu de mon esprit, de mon âme, et de ceux de mes performeurs, et surtout performeuses, que je choisis d’abord pour les personnes qu’elles sont, ce qui émane d’elles. Mon premier spectacle, Ragada, qui a été imaginé dans une maison d’Ilioupoli, en dehors de toute institution, a été déterminant pour la suite, dans la manière de créer un sentiment d’intimité, de familiarité avec les spectateurs, au sein d’une forme d’étrangeté. » « Cette pièce, avec son parfum balkanique, a d’emblée séduit le public grec, qui se sent très coupé de cette culture, en raison de l’européanisation et de l’américanisation générales », explique Konstantinos Tzathas, le programmateur des spectacles vivants du Centre Onassis d’Athènes, qui a produit Mami. « Mes pièces sont très balkaniques dans leurs inspirations, confirme Mario Banushi. Et cela ne pose aucun problème : que l’on joue à Londres ou à Taipei, les spectateurs se reconnaissent quand même, parce que je parle à leur âme, depuis la mienne. » Le metteur en scène reste marqué par l’Albanie de son enfance, où il a vécu jusqu’à l’âge de 6 ans, chez sa grand-mère, à qui sa mère, qui élevait seule ses enfants, l’avait confié. « L’Albanie est un pays où les traditions ont été beaucoup plus sauvegardées qu’ailleurs en Europe. Les rituels y sont encore très présents dans la vie quotidienne, avec leurs costumes, leurs chants polyphoniques. Toutes ces sensations, ces couleurs, ces odeurs, ces sons sont encore très présents en moi. Et le fait d’avoir été élevé entre deux langues a certainement produit chez moi un rapport particulier au langage. » De ses spectacles sans paroles Mario Banushi dit qu’ils sont « des livres immatériels », qui doivent conduire chacun à la rencontre avec soi-même. Il les travaille en peintre, plus qu’en metteur en scène au sens classique du terme, en réinventant des formes de rituel de deuil et de renaissance : ses deux précédentes créations, Goodbye, Lindita (2023) et Taverna Miresia. Mario, Bella, Anastasia (2023), sont parties de la mort de sa grand-mère, puis de celles de sa belle-mère et de son père, qui tenaient un restaurant à Tirana. Substrat pictural Toute création commence donc par un intense travail pictural, reposant sur le dessin et la photographie. Puis vient l’étape de la composition, directement sur le plateau. « Je travaille beaucoup avec les couleurs, les corps, la lumière. Je choisis moi-même le moindre élément scénique, costumes ou objets : je veux que tout soit exactement comme le sentiment que j’ai. C’est un travail très particulier pour les performeurs : il faut essayer, essayer encore, et petit à petit on choisit, on enlève, pour que finalement il y ait une histoire, et pas seulement des images. C’est le montage entre les images qui fait histoire, il ne s’agit pas de faire de l’image pour faire de l’image. » Même si le substrat pictural est fondamental chez ce grand amoureux de Jérôme Bosch ou de Fra Angelico, de Sophie Calle ou de Nan Goldin, Mario Banushi fuit comme la peste le côté « vitrine » que pourraient avoir ses spectacles. « Même si la beauté compte beaucoup pour moi, on ne doit pas en rester à ce niveau-là, ce que l’on cherche avant tout, ce sont les formes du réel, l’expérience profondément vécue. Idéalement, ce que je veux, c’est faire pleurer les spectateurs… » Avec Mami, il revient vers la figure de la mère, qui était déjà au cœur de son premier spectacle, Ragada (mot qui, en grec, signifie « vergetures », celles que laisse la grossesse sur le corps des femmes). Mais une mère multiple, diffractée. « Cela peut paraître étrange, mais le mot “mère” a toujours désigné pour moi plusieurs personnes. J’ai été élevé par toute une série de figures maternelles, grand-mère, sœurs aînées, femmes travaillant à la boulangerie… » En Albanie, avant de venir vivre en Grèce, la mère de Mario Banushi était sage-femme. Le jeune homme a grandi entouré d’histoires d’accouchements. Après les pièces précédentes, baignées par la douleur et le deuil, Mami se tourne donc vers la naissance et la vie. « Depuis longtemps, je me demande qui protège qui, dans une famille. Est-ce toujours le plus grand qui veille sur le plus petit ? Rien n’est moins sûr. Je suis un grand amoureux d’Alice au pays des merveilles, et j’avais envie de jouer sur les rapports entre des corps très grands et très petits. J’aime travailler cette dimension onirique, de conte de fées. » En regardant le théâtre du parc d’Ilioupoli, où il a vu ses premiers spectacles, des tragédies venues du théâtre antique d’Epidaure, Mario Banushi sourit : « Mon théâtre est aux antipodes de la tragédie classique, tellement remplie de mots… Mais, finalement, nous parlons de la même chose, de ce foyer fondamental qu’est la famille. » Sauf que Mario Banushi a injecté dans le bruit et la fureur de la grande forme grecque une mélancolie et une douceur toutes balkaniques. Sa Grèce à lui n’est pas celle, calcinée par le soleil et les passions, de la tragédie canonique. Elle s’offre dans l’ombre cendreuse de sentiments plus ordinaires mais intensément éprouvés, passés au tamis des souvenirs qui forment l’étoffe de nos vies. Mami. Création et mise en scène de Mario Banushi. Avec Vasiliki Driva, Dimitris Lagos, Eftychia Stefanou, Angeliki Stellatou, Fotis Stratigos, Panagiota Υiagli, Ilia Koukouzeli. Gymnase du lycée Aubanel, les 13, 14, 16, 17 et 18 juillet à 18 h 30. Durée : 1 h 10. Fabienne Darge (Athènes) Légende photo : Ilia Koukouzeli et Fotis Stratigos dans « Mami », de Mario Banushi, lors d’une répétition à Athènes, le 4 février. ANDREAS SIMOPOULOS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 7:42 AM
|
L'hommage de Philippe Lançon dans Libération - 2 juillet 2025 Jeanne d’Arc devant la caméra de Robert Bresson, l’écrivaine et académicienne s’est éteinte mardi 1er juillet à 84 ans. Florence Delay est morte juste après l’aube, mardi 1er juillet, à 84 ans. Depuis quelque temps, le souffle lui manquait. Depuis deux jours, elle rêvait. Dans Mon Espagne : or et ciel (Hermann, 2008), elle rappelait que le lexique espagnol n’a qu’un seul mot pour désigner rêve, songe et sommeil : sueño. Cette polysémie allait comme un gant – de soie et d’acier, tenant la cape et l’épée – à la romancière, la traductrice, l’actrice qui fut à 20 ans la Jeanne d’Arc de Robert Bresson, l’amoureuse du Siècle d’or espagnol, l’enseignante universitaire, l’amie et, par-dessus tout, la femme qu’elle était. Polysémie qui conduisait, par éducation et comme par miracle, à une admirable clarté d’expression. La légèreté signait la précision, le jeu enveloppait l’érudition. Ce qui émane de cet estuaire intime entre dormir, songer, rêver, c’est en effet ce qu’elle incarnait avec un naturel souverain et discrètement scandaleux pour nous autres, pauvres bipèdes : la grâce ; autrement dit, une classe presque absolue, intérieure et extérieure. Sa voix grave, sa diction parfaite, son sourire affectueux mais inquiétant, son regard transparent, distingué mais sauvage, ce qu’on sentait parfois de rudesse retenue, rien ne semblait tout à fait soumis en elle aux lois ordinaires de la pesanteur. «Je dois une chandelle à ce tricot» Elle a raconté, entre autres dans la Vie comme au théâtre (Gallimard, 2015), sa passion d’enfance pour cet art, pour la dynamique de la troupe, qui ne l’a pas plus quittée que son amour parallèle de l’Espagne. Elle allait avoir 20 ans quand Lydia Michel, la mère de son amie la future militante maoïste et écrivaine Natacha Michel, lui dit en roulant les r, un soir d’hiver à la sortie du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne : «Notre ami Robert Bresson cherche une jeune fille pour jouer Jeanne d’Arc dans son prochain film. Je me demande si tu ne ferais pas l’affaire. Je vais dire à Natacha (elle accentuait le nom sur la deuxième syllabe), de te conduire à lui […]. J’ai oublié la pièce qu’on jouait au TNP, pas le tricot bleu marine à col roulé que je portais ce soir-là. Je dois une chandelle à ce tricot, et à Natacha qui me conduisit quai de Bourbon, île Saint-Louis, où habitait Bresson. Je conduirais là, trois ou quatre ans après, Anne Wiazemsky pour Au hasard Balthazar. Telle était, secrète et originale, la chaîne qui se créait entre les “modèles” de Robert Bresson.» Après quelques essais, elle ne fut pas retenue, jusqu’au jour, à la veille de l’été, où elle trouva sous sa porte «un petit bleu qui disait de ne pas partir en vacances, d’appeler tout de suite, que j’étais “Jeanne”. Plus rien n’existe de tout ça, ni les êtres aimés, ni les petits bleus». Cependant, «le tournage du Procès de Jeanne d’Arc à l’orangerie de l’observatoire de Meudon, l’été de mes 20 ans, est un moment important de ma vie par sa densité, sa grâce, son enseignement, ses retombées immédiates et futures». De ce tournage, quelque chose d’essentiel a survécu : «Bresson m’a appris comment dire à haute voix. Comment faire entendre une parole, un texte, sans les intonations qui fourvoient, et ce dont je lui suis peut-être le plus reconnaissante, comment dire la poésie.» «Obstination splendide» Son enfance apparaît, sous forme romanesque, dans un de ses derniers livres, Un été à Miradour (Gallimard, 2021). Madelou est un surnom de sa mère, écrit sur le porte-cigarettes de celle-ci. Son grand-père, chirurgien, a été maire de Bayonne. Son père, le psychiatre et écrivain Jean Delay, est l’auteur de livres qu’on a peut-être tort de ne plus lire, par exemple la Jeunesse d’André Gide (Gallimard, 1957). Dans la Vie comme au théâtre, elle décrit en détail ce qu’elle appelle «le coucher du père», qui est un lève-tôt. Il se déshabille avec soin, met une chemise de nuit : «Je suis contente que mon père porte des chemises de nuit et pas ces banals pyjamas à rayures qui transforment le sommeil en bagne. Je m’en souviendrai.» Il a sorti la monnaie de ses poches : «Je m’approche ensuite de la cheminée et demande si je ne pourrais pas le débarrasser de quelques centimes encombrants. Il acquiesce. Je fais un tas de centimes. Il l’augmente avec libéralité de quelques francs, puis s’assure que j’ai appris mes leçons. J’hésite un peu et c’est le terrible moment du congé.» En 1986, père et fille sont invités sur le plateau d’Apostrophes. L’émission, assez perverse, s’intitule ce jour-là : «Un stylo dans le patrimoine génétique». Emmanuel Carrère, également présent avec sa mère, raconte drôlement l’épreuve œdipienne dans son prochain livre, Kolkhoze (P.O.L, parution début septembre). Soudain, au milieu d’une phrase, «Jean Delay a écarquillé encore plus grand les yeux et il est d’un seul coup tombé en avant, le front butant sur la table basse couverte de livres, tout son grand corps distingué, sanglé dans un costume bleu nuit, glissant hors du fauteuil. A suivi un moment d’une extrême confusion, tout le monde croyant qu’il était en train de mourir en direct – un grand moment de télévision, comme on dit, dont Pivot se serait bien passé. Florence Delay s’est précipitée sur son père, lui a relevé la tête, il avait le regard vitreux, des techniciens sont arrivés pour le transporter en coulisse». Pivot enchaîne, avec embarras et souplesse, l’émission continue et Jean Delay revient sur le plateau, s’excuse. Carrère note que, dans son souvenir, tout cela dura quatre ou cinq minutes, autrement dit une éternité, mais que ces minutes, si elles ont existé, ne sont plus visibles sur le site de l’INA : «Je pourrais interroger Florence Delay, entre-temps devenue académicienne et qui m’a affectueusement serré dans ses bras à l’enterrement de ma mère.» Il ne pourra plus le faire. Jean Delay, mort l’année suivante, avait été académicien avant sa fille. Elle entre dans l’institution en 2000, au fauteuil numéro 10, qui fut celui d’Alfred de Musset, de François Coppée et de Jean Guitton auquel elle rend hommage. Elle est sans doute portée par le souvenir de son père, mais aussi animée par le souci de faire venir des écrivains qu’elle aime. Elle échouera. L’échec est une forme d’éclair qu’elle a su évoquer aussi bien que la fête. L’un de ses romans, l’Insuccès de la fête, conte comment un grand poète méconnu, Etienne Jodelle, fut chargé, sous Henri II, de composer et de mettre en scène une tragédie pour recevoir le duc de Guise, qui venait de reprendre Calais aux Anglais. Il avait quatre jours. Il échoua. Elle conclut : «L’échec retentissant que connut sa fête eut sur Etienne Jodelle des conséquences graves dont je suis, pour ma part, les traces jusqu’à sa mort et où je vois l’origine de sa double vie exemplaire, l’une, de la sinistre mobilité du jeu social, l’autre, de l’obstination splendide du secret poétique.» Florence a participé à «la sinistre mobilité du jeu social», mais «l’obstination splendide du secret poétique» a toujours prévalu en elle. «Impeccable» Elle a été chrétienne, puis cessé de l’être, avant de l’être de nouveau ; mais elle le fut à sa façon, selon ses propres rites et inspirations, à sa fantaisie. Elle a été la filleule de lettres et d’esprit de l’écrivain espagnol José Bergamín. Elle a connu le curé qui donna l’extrême-onction à Bernanos. «Affection» était un mot qu’elle aimait et employait volontiers. Elle aimait le champagne, le mystère, les chevaliers, le Pays basque (et même, à un moment, l’ETA), Biarritz où elle avait une maison. Elle aimait aussi les récits médiévaux et les chants indiens, réécrivant les uns pour la scène (ou pas) et traduisant les autres avec son ami le poète Jacques Roubaud. Ce qu’elle écrivait de Gérard de Nerval dans Dit Nerval, l ’un de ses meilleurs livres, largement consacré à son père, on pourrait le dire d’elle : «Fatalité ou providence, les chemins aussi s’écrivent, il s’empresse de les suivre.» Dans le même livre, elle se demande aussi : «Le roman rendra-t-il jamais l’effet des combinaisons bizarres de la vie ?» Dormir, rêver peut-être… «Dormir est, depuis l’enfance, a-t-elle écrit, ce que je fais le mieux et le plus volontiers, même si je fais volontiers d’autres choses. Disons : ce que je fais de plus impeccable.» Et, sensible à l’étymologie du langage comme à des racines qui vous emportent vers un terrier magique en libérant les attaches, suspendue à cet adjectif, «impeccable», que tout autre qu’elle risque toujours d’utiliser comme un juge ou un tailleur, elle ajoutait : «Ciel ! Il vient droit du “péché”. Impeccabilis, en latin ecclésiastique, signifie “incapable de pécher”. Par extension, “qui ne peut faillir”.» Pour le corriger aussitôt afin de lui redonner un sens plus ancien et, du même coup, sa «vivacité» : «Quitter la bonne route, le droit chemin, dévier, se perdre, s’égarer.» Son dernier livre, publié en 2023, s’intitule Zigzag. Elle y célèbre la forme brève, la vitesse de la pensée, de l’écrit et, en creux, son orgueil brandi et dérouté : «S’ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter, les orgueilleux auteurs de formes brèves se croient sortis de sa main et tiennent, comme eux, leur attribut à la main : le zigzag.» Légende photo : Florence Delay en juin 2021. (Vincent Muller/opale.photo)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 1, 12:34 PM
|
Par Nathalie Simon dans Le Figaro - Publié le 19 juin 2025 Selon une étude de Médiamétrie présentée ce mercredi matin au Théâtre des Bouffes Parisiens, la fréquentation dans les salles privées se maintient. Et rajeunit. Deux bonnes nouvelles en ces temps tourmentés. La première : 11,3 millions de Français sont allés au théâtre ces douze derniers mois. C’est ce que révèle l’étude de Médiamétrie qui a interrogé 1541 personnes de 15 à 80 ans. L’âge moyen est de 40,5 ans. « L’assiduité est très marquée. Elle s’est maintenue par rapport à 2024, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui communiquent de façon importante, et aux bouche-à-oreille », signale Marine Boulanger, directrice du pôle cinéma et entertainment de Médiamétrie. Seconde bonne nouvelle, le public a rajeuni : 47 % des spectateurs ont moins de 35 ans et le public est « globalement engagé dans des activités culturelles ». « L’image qu’il a du théâtre est très bienveillante et positive », reprend Marine Boulanger. Il associe spontanément au théâtre les mots « divertissement » et « plaisir ». 68 % en attendent plus de légèreté, de comédies et d’humour, ce qu’ils trouvent avec Le Roi lion à Mogador ou le Cirque du Soleil. « Des auteurs de la génération Netflix » S’ils ne sont pas enthousiastes à l’idée de voir des spectacles sur la guerre, les génocides et la religion, ils ne sont pas contre des sujets sur la « pauvreté et la misère », comme le prouve le succès de Passeport, d’Alexis Michalik, sur un migrant, au Théâtre de la Renaissance, ou Oublie-moi (4 Molières en 2023), avec Marie Julie-Baup et Thierry Lopez, qui traite d’Alzheimer. La fréquentation augmente depuis 2022. 8,6 millions de billets ont été vendus ces douze derniers mois, c’est 30 % de plus qu’en 2019 Anne-Claire Gourbier, déléguée générale de l’ASTP « Beaucoup de pièces abordent des thèmes contemporains. Plus aucun sujet ne nous fait peur, et aucun producteur n’en refuserait un disant qu’il est trop risqué, estime David Roussel, président de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). On a l’impression que les créateurs, comme Mélody Mourey (Big Mother), Nicolas Le Bricquir (Denali) ou Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi (Coupures), prennent le pouvoir. Ce sont des auteurs de la génération Netflix, qui ont été biberonnés aux séries. Ils suscitent l’engouement des spectateurs. Le devoir des artistes est de témoigner de leur époque. » « La dimension sociétale est essentielle, il y a une nécessité de se projeter », renchérit Anne-Claire Gourbier, déléguée générale de l’ASTP. On note enfin que 70 % de Français sont d’accord pour aller plus au théâtre. Même si beaucoup considèrent encore que le théâtre, ce n’est « pas pour eux », qu’il reste compliqué de s’y rendre et que l’accueil et le confort des salles laissent à désirer. Ils se disent prêts à payer 31 à 54 euros pour une place, mais continuent de penser que les prix sont trop élevés. « La fréquentation augmente depuis 2022. 8,6 millions de billets ont été vendus ces douze derniers mois, c’est 30 % de plus qu’en 2019 », assure Anne-Claire Gourbier. Des chiffres très encourageants. Nathalie Simon / Le Figaro

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 10:25 AM
|
Par Gilles Renault, envoyé spécial à Villeurbanne, pour Libération, publié le 29 juin 2025 Satire à haut risque autour des violences conjugales et de la place de l’humour dans la société, la neuvième création de la compagnie s’en sort très honorablement. Pour faire simple, disons des Chiens de Navarre qu’ils ont eu à ce jour deux vies, autour d’un seul et même homme, Jean-Christophe Meurisse. Fondateur de la compagnie, il y a maintenant vingt ans, celui-ci en est le garant, chef d’orchestre qui dirige des créations collectives dans laquelle la troupe s’investit corps et mots autour d’une écriture de plateau réputée iconoclaste. Le revers de la médaille étant qu’au gré des charivaris, l’outrance avait fini par lasser quelque peu, à mesure que les dérapages plus ou moins contrôlés confinaient aux gimmicks. Pourquoi ? Sans doute car la qualité d’échange avait baissé entre Meurisse et une bande dopant la virulence corrosive – voire scabreuse –, qui avait volé en éclats. Des Chiens de Navarre, canal historique, aucun nom ne figure plus en effet au générique, les Maxence Tual, Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer etc. étant tous partis semer leur grain de folie ailleurs à la fin des années 2010. Ce qui n’empêchera pas le public, galvanisé par quatre ou cinq pièces mémorables, de continuer à soutenir massivement une famille sans cesse recomposée au gré de trois derniers projets pourtant moindres. Jeu de quilles sociétal Ainsi entrait-on sur la pointe des pieds dans l’imposant Théâtre national populaire de Villeurbanne, où la compagnie dévoile en cette fin juin son neuvième brûlot dans le cadre des Nuits de Fourvière (qui restent leur pas de tir rituel). Comme de coutume, un thème central prévaut… à la différence notable, toutefois, qu’il y en a cette fois deux, entrecroisés, qui fusionnent sur le terrain judiciaire : les violences conjugales, d’une part, la nécessité, ou pas, de placer des garde-fous contre l’humour d’autre part – ce second axe évoquant assez explicitement le licenciement honteux en juin 2024 du chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice (cf. un logo pastichant celui de la radio). Deux sujets actuels, faisant planer une menace pondéreuse de la part d’artistes dont on connaît la réticence à appuyer sur la pédale de frein. Un écueil que vont contourner pourtant, sinon avec tact du moins dextérité, les Chiens en ne se ruant pas tête baissée dans le jeu de quilles sociétal. Nettement mieux écrit, structuré et interprété que les précédentes moutures (la distribution semblant enfin à nouveau soudée, autour de tels Gaëtan Peau, Fred Tousch ou Delphine Baril, veillant à ne jamais vociférer), I Will Survive, à une ou deux maladresses près (cette idée inutile de faire monter sur scène quelques spectateurs-jurés), retrace même avec une acuité à peine surlignée, hélas, le chemin de croix – du commissariat au tribunal – d’une femme aspirant juste à ce que justice et dignité lui soient rendues. De même que, découpée en tableaux, la pièce fustige la pusillanimité d’une parole publique désormais tétanisée par l’angoisse du shitstorm. Dont, jusqu’à nouvel ordre, les Chiens de Navarre n’ont cure. I Will Survive des Chiens de Navarre au Théâtre national populaire de Villeurbanne dans le cadre des Nuits de Fourvière jusqu’au 28 juin. Puis en tournée. A la Grande Halle de la Villette (75019) du 4 au 13 décembre. Gilles Renault / Libération Légende photo : «I Will Survive» contourne les écueils. ( photo © Fabrice Robin )
|
Par Thierry Jallet dans Wanderer - 9 juillet 2025
L'enfant de verre, de Léonore Confino et Géraldine Martineau, Présence Pasteur, Avignon OFF 2025
Avignon OFF 2025 : À quelques centimètres de la vérité…
Avignon, Festival OFF, Présence Pasteur, Salle Pasteur, dimanche 6 juillet, 14h20 Alors que le Festival d’Avignon s’ouvre en ce premier week-end de juillet, Wanderer reprend ses déambulations allant d’une salle à l’autre, commençant cette année par des spectacles dans le Off qui ont retenu l’attention. C’est à Présence Pasteur que nous nous arrêtons donc pour voir L’Enfant de verre de Léonore Confino et Géraldine Martineau, dans une mise en scène d’Alain Batis avec la compagnie La Mandarine Blanche. On connaît bien les textes de Léonore Confino depuis l’écriture de Building et de Ring en 2011 où, se fondant sur ses observations et sur son vécu personnel, elle traçait déjà finement les contours d’une réalité absurde autant dans le monde de l’entreprise qu’au sein du couple. « Main dans la main » avec Alain Batis, ils abordent ici les non-dits familiaux, les secrets enfouis, défendus au fil des générations, ces fardeaux souvent si lourds à porter dans un silence assourdissant, douloureux, et qui rend chacun, chacune, complice par héritage en quelque sorte. Dans ce projet, ils ont ensuite été rejoints par Géraldine Martineau et sept formidables artistes au plateau déroulant une fable délicate – comme le verre – montrant les corps en mouvement, en jeu, portés par la musique et un texte aux accents poétiques et écrit au cordeau. C’est qu’il y a de l’enchantement dans certaines épiphanies, même parmi les plus douloureuses. Nous en rendons compte ici. Un après-midi sous les nuages et quelques gouttes de pluie est un moment rare pour un premier dimanche de Festival. Il règne dans la cour de Présence Pasteur une effervescence, un enthousiasme contagieux. Les équipes comme les premiers festivaliers sont réjouis. Et le sourire de Léonore Confino qui nous accueille ne dément pas cette joie. Nous pénétrons donc dans la salle et nous installons dans les gradins presque pleins, avec curiosité et entrain pour ce tout premier spectacle auquel nous assistons. Le plateau est recouvert d’une toile blanche plissée – une évocation de l’écume, ou encore du sable, celui qui est constitutif du verre peut-être. Un peu derrière, au lointain, on perçoit de fins panneaux inspirés des travaux de Dan Graham, à l’aspect d’abord réfléchissant qui renvoient une image déformée du public – comme une invitation discrète déjà à regarder notre propre histoire, qui sait ? Tout commence « quelque part dans les mers du Nord », un soir de tempête où le vent mugit et où les vagues s’écrasent avec fracas contre les falaises. Des visages apparaissent derrière les panneaux devenus translucides, faiblement éclairés par une lumière bleutée et tremblante, laissant voir une famille à la recherche de la fille cadette qui a disparu. L’écho des voix porte en résonance quelque chose de cauchemardesque. « Il faut retrouver Liv ». La phrase, simple en apparence, exprime d’emblée une urgence, une nécessité absolue pour la disparue comme pour les siens. La retrouver, le verbaliser apparaît comme l’enjeu d’un retour impérieux à la lumière à travers les panneaux. En chacun, en chacune. « La résilience, j’en ai rien à foutre » dit l’une d’entre eux – perdre Liv n’est par conséquent absolument pas envisageable. La musique pulsatile accompagne cette recherche immobile et paradoxalement si affolée, si haletante. De celles qu’accompagne l’emballement du muscle cardiaque pour une question de survie. Soudain, lumières sur le plateau surplombé d’un lustre en cristal – emblème discret de cette translucidité finement ciselée, dure et pourtant si cassable, suspendue depuis les cintres. Les parents, Frederik et Esther, accueillent des invités pour le mariage de leur fille aînée, face aux spectateurs – certainement promus convives de la noce. Hella se marie avec Nino qui semble avoir tout du gendre parfait. On distribue des sourires, on formule des phrases convenues. Esther – formidable Delphine Cogniard – lâche : « J’ignore pourquoi, j’ai l’impression de ne pas être moi-même ». Cette ouverture en trompe‑l’œil ne trompe presque pas en définitive. Les meubles sont transparents hormis la structure qui les tient debout. La pièce montée, elle-même, n’est pas sans rappeler quelque bronze rapporté d’un Huis-clos sartrien déclassé. Tout paraît faux, y compris pour les personnages eux-mêmes conduits rapidement à une étrange introspection. Les habiles découpes et les superbes rasants conçus par Nicolas Gros dessinent cet espace frappé d’« inquiétante étrangeté », manifestation palpable d’une angoisse sous-jacente au cœur de cet univers familial commun, trop insécurisant néanmoins. La danse endiablée dans laquelle toute la famille se jette à corps perdu, est une autre manifestation de cette dissonance. Jouée avec grande subtilité par Sylvia Amato, Anja, la grand-mère qui perd la tête, se déhanche furieusement, toute de rouge vêtue. Mais Esther vacille sous les yeux du public qui la voit peu à peu plonger dans une crise paralysante, interrompant subitement la fête. Les invités sont renvoyés. La mère est étourdie, tendue, incapable de dire pourquoi : sa maladie nerveuse l’éreinte, éreinte tout le monde – comme le montrent les scènes de flash-back où Frederik amène les filles à la plage pour la laisser se reposer, celle où il va jusqu’à s’emporter contre elle, impuissant devant ce mouvement dévastateur qui emporte la famille au cœur d’un tourbillon invisible et redoutable. C’est aussi au cours d’une de ces scènes que l’on découvre comment Nino – Mathieu Saccucci au jeu mesuré et troublant – est entré dans la famille en livrant les médicaments à Esther. De même, on comprend comment il rencontre Hella qui a simplement le même âge que lui – le coup de foudre ne semble pas instantanément avoir eu lieu… Un lien solide unit les femmes de la famille qui se le passent les unes aux autres : c’est une mésange en verre que la mère d’Anja lui a laissée avant de partir sans jamais plus revenir. Et cet objet dont on devine immédiatement la forte charge symbolique se transmet de mère en fille, se transmet entre sœurs. Il n’est pas garant d’un savoir-faire traditionnel, pas davantage porteur de puissance. Il est transparent, dur, cassant, fait de ce sable balayé par le vent sur les plages des mers du Nord et que Pio transforme en verre, comme son grand-père avant lui. Il est conservé au cœur de la nuit et on le perçoit derrière le panneau central rendu à peine translucide : Liv – Yasmine Haller, merveilleuse dans ce rôle – le soulève alors qu’elle au lit. Il est la beauté mais surtout le mystère, qui tient à distance des mots aux vertus libératrices rendus atones. Il est le gage de l’enfermement dans le silence, du maintien dans l’ombre. Surgie du texte de Léonore Confino et Géraldine Martineau, cette image d’une grande force évocatrice est brillante et donne au spectacle une dimension allégorique aussi gracieuse que signifiante. Le lendemain des noces cependant, Liv qui est manifestement très troublée, fait comprendre – sans le dire distinctement, les mots sont encore empêchés – qu’elle a cassé la mésange de verre au cours de la nuit. Que s’est-il passé ? On le découvrira de manière feutrée, derrière les panneaux translucides, dans une lumière faible et blafarde. Liv a désormais un secret elle aussi – un nouveau secret dans la famille où ce silence reste une valeur cardinale très résistante. Cependant, avec le soutien de Pio, le seul à voir les morceaux de verre dans la plaie qui « s’infecte », elle va réussir à parler. Un peu d’abord mais on ne la comprend pas. Pio sent pourtant qu’elle « [tait] quelque chose de grave ». Et c’est alors que le Vieux Souffleur – formidable marionnette sur un fauteuil roulant, manipulée par Anthony Davy qui interprète justement Pio, son petit-fils – révèle le secret de la mésange lié à la disparition de la mère d’Anja. Ainsi, on mesure le poids de cette terrible disparition dans l’histoire familiale au cours de cette scène formidablement jouée. Et comme la parole a jailli, rien ne semble désormais pouvoir l’arrêter. Liv a disparu mais tous la recherchent. L’habile composition dramaturgique de la pièce permet de revenir à ce qui a ouvert le spectacle : l’énigme se résout progressivement – les phrases qui étaient tues sont désormais audibles. L’écheveau se sera dénoué au fil des ruptures narratives, des retours en arrière, des discrets effets d’annonce – Anja quittant sa perruque après le mariage, visible derrière un panneau, ne laisse-t-elle pas entendre d’une certaine façon que la vérité ne sera pas toujours cachée ? Au fil des ellipses aussi car le creux est un endroit essentiel à la fable ici. L’angle (presque) mort recèle la vérité qu’on ne cesse de frôler. Jusqu’à la révélation finale. Jusqu’à la parole de Liv et jusqu’à la fuite coupable de Nino dans la forêt – lieu sombre et menaçant des contes – comme dans une damnation infinie. L’enfant de verre n’est plus, l’urgence de dire non plus, les secrets se sont évanouis. Reste Liv, une autre mésange de chair et d’os, porteuse d’une parole, d’un bonheur que tous entourent étroitement. On sort ébloui de ce spectacle d’un grand raffinement dans sa dimension plastique, porté par des comédiens à couper le souffle – avec une mention spéciale pour Yasmine Haller, époustouflante. La mise en scène d’Alain Batis transpose avec beaucoup de rigueur et de justesse le texte, comme un exemple tout à fait probant d’un compagnonnage réussi entre les artistes qui ont vraiment « pris le risque de la beauté ». Pour faire entendre l’impossibilité de la parole. Pour dire qu’en brisant le silence de verre, la vérité aussi insupportable soit-elle, n’est jamais loin. Qu’il faut parfois l’affronter sans attendre davantage et que les mots dessus permettent sans doute d’y parvenir un peu plus. Légende photo : La mésange de verre entre les mains de Pio (Anthony Davy)
Par Thierry Jallet dans Wanderer - 11 juillet 2025
"Ancora tu", de Salvatore Calcagno et Dany Boudreault, Théâtre du Train Bleu, Festival OFF Avignon, 2025
Avignon, Théâtre du Train Bleu, dimanche 6 juillet 2025, 17h25 Poursuivant nos flâneries festivalières, nous arrivons au Train Bleu où, là encore, la programmation a retenu notre attention. Fondé en 2018 par Aurélien Rondeau, Charles Petit et Quentin Paulhiac, le Ttb accueille chaque année des compagnies pour une programmation exigeante « pluridisciplinaire, ouverte à la diversité et ancrée dans son temps ». On se souvient notamment de Hen, grand succès de l’édition du Off 2019 mais aussi de Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la Journaliste de Jeanne Lazar la même année ou encore Seuil mis en scène par Pierre Cuq en 2022. C’est un nouveau spectacle hors norme qui nous a cette fois encore conduit jusqu’à la rue Paul Saïn : Ancora tu – titre de ce morceau de pop italienne des années 70, inspirée de la disco, entraînante et répétitive – est une performance, un acte artistique singulier, la reconstitution d’une archive rendue vivante à l’image du spectacle, celle de la relation amoureuse entre deux hommes – le metteur en scène et l’acteur – qui vient de se terminer. Loin d’être réduit à son simple regard, le public est donc sollicité « pour faire revivre [la] personne aimée et disparue » désormais. A l’initiative de l’auteur et metteur en scène Salvatore Calcagno, associé à Dany Boudreault, lui-même auteur et acteur, le portrait de l’absent apparaît par l’intermédiaire du captivant Nuno Nolasco, comédien portugais qui entraîne la salle jusqu’à Lisbonne, sur les lieux supposés de l’amour passé, dans les bras de l’amant dont la voix ne cesse de se faire entendre. Et nous avons été résolument conquis. Les spectateurs se précipitent en salle dès l’appel du personnel signalant que le spectacle va bientôt commencer. L’accueil est toujours chaleureux mais l’attention est vite détournée. En entrant, on remarque tout de suite la présence d’un homme, assis à une table. Portant jeans et chemise blanche ouverte à l’encolure, il regarde le public s’installer. La chevelure légèrement poivre et sel, le regard sombre, il est séduisant. Il se lève, reprend sa place, dans une délicate forme d’impatience. On remarque ce qui l’environne dans l’espace de jeu réduit de la salle : au lointain d’abord, une photo au format poster fixée par des morceaux de ruban adhésif blanc. L’image est une vue de Lisbonne. À cour ensuite, un vidéoprojecteur est installé au sol, incliné pour permettre une diffusion au niveau de la photo fixée au mur. Sur la table enfin, des livres empilés, une grande tasse, un paquet de cigarettes et face au comédien, un ordinateur portable ouvert, prêt à l’utilisation. La scénographie donne l’apparence d’une conférence sur le point de commencer et dont le sujet n’est pas net encore. Un autre détail attire l’œil : sur un tableau vertical étroit et haut, à jardin, une liste de mots écrits en blanc et ordonnés en deux colonnes. Parfois, on en dénombre plusieurs sur la même ligne. La liste s’achève par « Les adieux », formule autour de laquelle le comédien vient dessiner de petits cœurs, suivie par la date du jour. Le public est d’emblée placé en tension vers cet espace porteur de questionnements multiples, incluant selon toute évidence une incomplétude que le début du spectacle devrait permettre de réduire. Sans signal particulier, le comédien commence. Il s’appelle Nuno et il est portugais. Il vient de se séparer de l’homme avec lequel il avait conçu le spectacle dans lequel il jouait en tant qu’acteur. Cet homme se nomme Salvatore. Il a « de grandes dents » et « rit toujours pour rien ». Cette première phrase lâchée dans un immense sourire trahit la force du sentiment qui les a unis. Sans attendre, il justifie la présence de la photo au lointain : c’est le lieu de leur rencontre, à Lisbonne. Il poursuit en précisant que Salvatore l’a quitté et qu’il est désormais seul devant le public. Nuno doit d’ailleurs rentrer à Lisbonne à la fin du Festival. Le champ fictionnel se déploie. Il indique alors que chaque jour, il trie les souvenirs de leur histoire d’amour terminée, souvenirs qui sont formulés par entrées dans la liste à jardin qu’on avait repérée à notre arrivée. L’acteur ajoute enfin qu’il va solliciter plusieurs spectateurs pour l’aider dans ce tri : il emportera avec lui, à Lisbonne, ce qui aura été choisi dans la liste tandis que le reste sera « brûlé ». Le projet artistique prend forme sous nos yeux. Lorsque Salvatore Calcagno et Dany Boudreault se sont rencontrés, ils ont conçu une première performance en imaginant ce qu’il se serait passé s’ils étaient tombés amoureux. Ils ont ensuite fait évoluer cette première version vers quelque chose de plus théâtral en implantant la possibilité de leur histoire dans le corps d’un autre acteur. Ainsi, c’est au terme de leur cheminement expérimental que nous nous trouvons face à Nuno Nolasco. Les deux auteurs cherchent en effet à rendre « une intimité performée », celle d’un couple d’hommes qui se sont aimés et qui se sont finalement quittés. Le théâtre devient un catalyseur pour mener une recherche qui positionne sous le regard presque clinique du spectateur, le vécu de la solitude contrainte, celle que l’autre impose quand il s’en va, quand il laisse seulement la sensation d’abandon. Le comédien seul en scène transfigure le projet des deux auteurs en y incluant sa propre sensibilité, sa propre histoire et redimensionne le propos à travers lui. Même si « c’est cruel », il lance sans attendre la sélection avec le choix d’un premier spectateur qui se porte sur « Le sable », éliminant de la liste « L’amour le martin » et « L’épreuve ». Il diffuse alors l’enregistrement de leurs voix, un dialogue qui semble avoir été pris sur le vif, à Lisbonne. « Ça t’a plu de faire l’amour avec moi aujourd’hui ? » entend-on. L’acteur regarde le public, amusé et attendri. La salle est propulsée dans l’intériorité de leur couple, sans que cela soit une confidence pour autant. Sans tentation de voyeurisme non plus, on devient témoin de ce qui s’est joué entre les deux hommes dans leur relation amoureuse et on lui confère de cette manière une nouvelle densité. On lui offre une réalité à proprement parler par l’intermédiaire de la performance artistique. L’archive vit et fait en quelque sorte revivre l’amour qui les a uni. Nuno Nolasco est radieux, il sourit. La mémoire réactivée dans l’acte artistique est une forme de magie qui permet le temps retrouvé proustien, on le sait bien. « Je ne pensais pas qu’on pouvait avoir cette ouverture-là, cet abandon-là » ajoute-t-il. Le temps retrouvé fait donc ouvrir les yeux. Les enregistrements s’enchaînent au fil des choix du public – parfois guidés par l’acteur qui considère que les souvenirs restent trop courts et qu’on peut les rassembler ou bien, à l’inverse, qu’il faut les couper parce que trop longs. Les voix résonnent. Celle de l’acteur se superpose à celles enregistrées, en français, en anglais, en portugais. La mémoire en action se réactualise en permanence au fil des étapes de la liste. Rien n’est écarté au nom de la bienséance. On entend : « Mon cul te réclame ». Le pornographique perd ainsi toute sa subversivité pour que ne demeure que l’intime dans la salle de théâtre silencieuse, transformée en lieu du témoignage et de l’existence de ce qui a été et qui, l’espace d’une heure, redevient au présent. Dans le désordre, l’appartement où ils ont vécu à Lisbonne ; la musique de Robyn, le tableau représentant Clytemnestre juste avant d’être assassinée par Oreste – « on a baisé sous le tableau de notre tragédie annoncée » ; la chemise retirée ; le « soleil noir » de la mélancolie qui les assombrit tous deux et en fait des « jumeaux cosmiques » ; les lamentations de Didon dans l’opéra de Purcell ; le costume pour la fête de quartier ; la poésie – celle de Genet, d’Aragon ou encore le bouleversant poème de Sophia de Mello Breyner Andersen intitulé « Quando » que Nuno lit lors des obsèques de sa mère ; les images projetées – celle sur laquelle est censé figurer « le bronzé », cet homme âgé dansant sur Rihanna et espérant un regard « qui remplit et qui vide » faisant prendre conscience du temps qui passe – cette tragédie ; la cigarette fumée dans le vestibule de la salle éclairé par un néon vertical : tout fait sens et matière afin de faire revivre ce qui a disparu, celui qui n’est plus là. Comme dans une forme de deuil sublimé dans la forme artistique choisie ici, la mémoire est partagée avec les spectateurs qui peuvent y inclure la leur – cette histoire appartient à tous et peut probablement croiser celle de chacun, de chacune. Dany Boudreault affirme que « toutes les histoires d’amour sont des fictions » et que cet « amour opère tant et aussi longtemps que deux personnes consentent à la même fiction ». C’est pour cette raison que le théâtre devient le lieu où l’expérimentation menée ici peut s’installer, où elle peut pleinement s’incarner et réaliser l’archive de ce qui a disparu, la faire vivre dans le présent de la performance. On sort convaincu et troublé par ce voyage esthétique dans l’intimité fictive de Nuno et Salvatore, dans l’intimité universelle de l’amour passé, dans l’épreuve du manque comme de la solitude qui concernent tous les êtres à un moment de leur existence. Et, à travers le souvenir persistant des lumières de la boule à facettes, on entend encore au loin les paroles de la chanson de Lucio Battisti. Ancora tu. Non mi sorprende lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più ? Crédits photo : "© Antoine Neufmars
Par Thierry Jallet dans Wanderersite - 17 juillet 2025
Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing, de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman, Théâtre du Train Bleu, Festival OFF Avignon 2025
Avignon, Théâtre du Train Bleu, jeudi 10 juillet 2025, 21H25. De retour dans le Off, on quitte la salle 2 de la rue Paul Sain où on a vu Ancora tu il y a quelques jours, pour gagner un lieu délocalisé du Ttb à l’autre bout de la ville car c’est dans les jardins de l’ancien carmel, rue de l’Observance que nous allons voir le troisième volet de Huit Rois (nos présidents) par la Compagnie des Animaux en Paradis. Après La Vie et la mort de Jacques Chirac qui retrace le parcours du président en interlocution notamment avec son chauffeur, après Génération Mitterrand qui fait apparaître les espoirs et désillusions d’un électorat ayant évolué depuis les deux mandats du président socialiste, voici Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing écrit par Julien Campani et toujours Léo Cohen-Paperman, également à la mise en scène. La « série théâtrale » commencée il y a trois ans se poursuit donc et c’est une fois encore une grande réussite. Au fil des spectacles, les portraits s’enchaînent sans complaisance et, pour autant, sans charge démesurée contre eux. Chaque fois, on y présente ces personnalités connues dans un régime entre la monarchie et la république avec la chronique d’une famille « sur quatre générations » et la marche de « la société française de 1958 à 2027 ». Quelque part entre « Les Rois maudits », le documentaire sociologique et « Au théâtre ce soir ». Après avoir assisté à ce dernier volet enlevé et remarquablement interprété, nous en rendons compte ici. Toujours accueilli avec la sympathie des équipes du Ttb, on serpente à travers les allées du jardin situé dans la rue de l’Observance, suivant un itinéraire balisé et avec le renfort utile du personnel. On est tout près des remparts et l’atmosphère de l’endroit dans la pénombre du crépuscule, sous le chant persistant des cigales, invite à la surprise. Et c’est bien une surprise de découvrir en avançant sur ce chemin de terre, un gradin à la cime duquel se trouve une régie avec un plateau frontal en contrebas. De nombreux spectateurs ont déjà pris place et on perçoit beaucoup d’enthousiasme dans les rangs, ce qui laisse penser que le spectacle est attendu. Une fois installé, on observe par le détail le plateau à vue, finement élaboré par la scénographe Anne-Sophie Grac dans un souci manifeste de réalisme. L’espace restitue l’intérieur de ce qui pourrait être une maison normande à colombages. Le panneau du fond de scène est percé de trois portes de jardin à cour : une qui mène à la cuisine ; une autre vers les toilettes – Anne-Aymone s’y rendra très souvent – une dernière enfin vers ce qui est supposé être l’extérieur de la maison, dans un hors-scène où est garée la SIMCA de Michel qui « fume blanc » et qui « tète à 13 au 100 ». Sur ce panneau figurant le mur de la maison, sont accrochés différents objets dans un évident souci de précision, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler les décors particulièrement léchés de Roger Harth pour la très emblématique émission de télévision des années Giscard, « Au théâtre ce soir ». À cour, on remarque une tête de sanglier empaillée, entre deux patères et près des fusibles apparents – qui vont sauter dans une scène endiablée de queue leu-leu à la bougie, montrant le temps des restrictions imposées par le giscardisme ; au centre du panneau, un crucifix entre la porte vers l’extérieur et les toilettes, figuration allégorique de la religiosité dans la France de l’époque ; plus à jardin, un fusil de chasse et des assiettes décoratives comme autant d’objets aujourd’hui désuets mais reflétant la ruralité des années 70. Devant ce panneau, une table imposante est dressée avec nappe et vaisselle immaculées – six couverts sont disposés de sorte que les personnages seront placés face au public. Tout indique qu’on se trouve dans un lieu de fête d’où hôtes et convives sont pour le moment absents, comme une sorte de diorama digne d’un musée de l’habitat local. Pour finir, on remarque à l’avant-scène la présence d’un parc pour enfant en bas âge à cour, et celle d’un poste de télévision à jardin. Il apparaît clairement que ces nombreux éléments plastiques et visuels sont placés sous le regard du public afin de les lui faire vivement remarquer : porteur de sens, le décor occupe par conséquent une place notable dans le spectacle, préparant l’arrivée des comédiens. Un homme en pyjama enfantin entre alors et salue le public pour le prologue – la composition dramaturgique de la pièce est régulière et va suivre le mandat de Valéry Giscard d’Estaing fractionnant une singulière temporalité qui va superposer les années du septennat et les plats du réveillon de la famille Deschamps-Corrini en présence du couple présidentiel. L’homme a pour nom José Corrini et il est né en 1973. Il a donc un an moment où la pièce commence. C’est Julien Campani, co-auteur du texte et formidable comédien, qui joue ce rôle ambigu, positionné à l’avant-scène sous le faisceau d’une poursuite, quelque part entre une enfance dans les années 70 et le moment présent de la représentation, entre le passé et son avenir en définitive. Cette originalité du spectacle retient particulièrement l’attention, soulignant le rigoureux travail d’écriture du texte : il va s’agir pour ce bébé devenu un homme adulte dans le XXIème siècle de la représentation, de relater les événements d’autrefois, de vulgariser avec grande efficacité leur densité politique, économique, sociologique et historique. Une sorte de jeune Alain Decaux d’aujourd’hui, dynamique et truculent, entre jeu et narration, brisant toute possibilité de quatrième mur, annulant toute illusion théâtrale afin que le public reste bien en prise avec cette chronique commentée. La famille va alors apparaître sur scène : d’abord, les parents, Marcel (Joseph Fourez) et Germaine (Morgane Nairaud), couple d’agriculteurs du Calvados ; puis, les enfants, avec la fille des Deschamps, Marie-France Corrini (Pauline Bolcatto), secrétaire chez Alsthom, et son mari, Michel Corrini (Clovis Fouin), ouvrier chez Alsthom lui aussi ; enfin, leur fils, José, que joue Julien Campani. Ce dernier apporte les informations nécessaires au public : les enfants arrivent pour le réveillon 1974 chez les parents, à Cricqueville-en-Bessin dans le Calvados. « Et cette maison, c’est la France. » La phrase clarifie ainsi la démarche adoptée grâce au choix de cette représentation symbolique. Valéry Giscard d’Estaing est joué par Philippe Canales, plus dans l’évocation que dans l’imitation, comme c’était déjà le cas de Julien Campani dans La Vie et la mort de Jacques Chirac. Suivant une approche similaire du personnage, le comédien ici ne cherche pas à reproduire le successeur de Georges Pompidou. Il reprend habilement son phrasé, certains de ses tics de langage aux accents aristocratiques si reconnaissables, pour en faire surgir une plus juste évocation. Le costume et la perruque facilitent la reconnaissance mais là non plus, il ne s’agit pas d’imiter, afin de stimuler la réflexion du public sur le théâtre qui se joue sous ses yeux. Et c’est Gaïa Singer qui interprète avec brio Anne-Aymone Giscard d’Estaing, lui donnant une épaisseur psychologique que le rôle « d’épouse de… » n’avait peut-être pas laissé voir dans les reportages télévisés qui ont pu lui être consacrés. La comédienne la dote tantôt d’une incroyable drôlerie tantôt la place sur le fil de l’émotion, l’humanisant pour mieux révéler à la fois sa condition d’épouse d’un des « Rois » de la Vème, et de femme avec ses forces et ses failles. Marie-France et Michel vont donc rapidement découvrir qui sont les deux mystérieux invités du réveillon. Comme le précise José dans le prologue, le président est « conservateur et progressiste » et son souhait est de regarder « la France au fond des yeux ». C’est pourquoi il va s’inviter « à dîner chez les Français ». L’extraordinaire idée des deux auteurs consiste à ce que le repas dans son déroulé soit l’occasion de reconstituer son parcours. Chaque étape du réveillon renvoie à une prise de parole de José ou à une archive sonore qu’il lance à l’aide d’une télécommande faisant entendre des extraits des traditionnels vœux présidentiels pour toutes les années du septennat. De « Monsieur le Président » à « Giscard ». Bien sûr, Michel le syndicaliste, Marie-France la féministe aux idées socialistes montantes, ne font pas partie de l’électorat de Giscard d’Estaing, contrairement aux Deschamps qui l’accueillent tel un authentique monarque, lui rendant hommage avec force courbettes. Seulement, de la soupe de cresson « façon…mousse » à la galette finale, les déconvenues se multiplient plus que les voix des électeurs et entraînent sa progressive disgrâce. Le réveillon laisse un goût amer dans les bouches autant que dans les cœurs. Les coiffures tombent, les vêtements se froissent, les couverts se désordonnent et le ton monte. Une scène marquante : tous sont assis dans la pénombre, face au public, le couple présidentiel au centre. Les Deschamps comme les Corrini vont tour à tour se lever, se détourner sans un regard pour eux, de la dureté dans la voix pour appuyer leur éloignement. Voilà les effets de l’amertume d’un peuple semble-t-on dire alors. Les chansons populaires de l’époque que chaque comédien entonne scandent cette lente désillusion : depuis « La Ballade des gens heureux » par Giscard lui-même jusqu’à « Attention, Mesdames et Messieurs » que chante José, en passant par l’iconoclaste « Ça plane pour moi » qu’interprète avec une délicieuse fureur Pauline Bolcatto, les événements s’enchaînent poussés par « ce grand vent de nouveauté radicale ». De la crise pétrolière que le président ne jugule pas avec une montée fulgurante du chômage, à la tentative de relance – la drôlissime démonstration de « l’usine à totottes » est exceptionnelle ! – pour glisser vers l’impitoyable rigueur qui fait que « tout le monde a une bonne raison de le détester », le président finit « coincé au centre ». Et tout s’achève après le très connu « au revoir » adressé au public dans l’embrasure de la porte que José claque ensuite violemment sur le président désormais sorti. À travers un savant équilibre entre réflexion et légèreté, les auteurs réussissent pleinement leur pari une fois de plus, sans jamais tomber dans un didactisme trop aride, sans reprendre non plus ce qui a déjà été créé avec les premiers spectacles. Porté par une extraordinaire troupe de comédiennes et de comédiens terriblement engagés, provenant pour plusieurs du Nouveau Théâtre Populaire, Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing offre un de ces moments de théâtre précieux qu’on emporte dans ses souvenirs de festivalier. Un des Rois a vécu puis est en quelque sorte mort sur scène ce soir. Alors vivement le prochain ! Légende photo : La tablée de réveillon avec de gauche à droite Marcel Deschamps (Joseph Fourez), Germaine Deschamps (Morgane Nairaud), Anne-Aymone Giscard d'Estaing (Gaia Singer), Valéry Giscard d'Estaing (Philippe Canales), Marie-France Corrini (Pauline Bolcatto) et Michel Corrini (Clovis Fouin) Crédit photo : © Valentine Chauvin

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 17, 10:41 AM
|
Par le service Culture de Libération - 17 juillet 2025 L’équipe théâtre de «Libé» vous aide à vous y retrouver parmi les 1 724 spectacles du off. Du dancefloor aux lycées en passant par l’industrie musicale, sélection de 10 spectacles. Du 5 au 26 juillet, 1 724 représentations proposées par 1 347 compagnies sont jouées dans quelque 139 théâtres (éphémères ou permanents) du off du Festival d’Avignon. Des chiffres qui font tourner la tête. Comment faire son choix dans cette offre pléthorique ? Il y a les affiches collées sur les grilles et poteaux de la ville, les discussions directes avec les artistes qui sillonnent les rues pour convaincre que leurs spectacles valent le coup d’œil, mais aussi la nouvelle sélection de l’équipe théâtre de Libé que voici. Le metteur en scène raconte avec finesse, par la voix et le chant de Pauline Legoëdec, les hésitations qui précèdent le plongeon avant un coming out. Au fil de la pièce, les corps changent, se mettent à danser, à s’habiller autrement, à raconter de nouveaux modes de vie. Il est difficile de décrire en si peu de temps (une heure !) la joie immense que représente cette liberté que le personnage d’Alex s’accorde. Jusqu’au 24 juillet à 11h45, Théâtre 11 Avignon, 11, boulevard Raspail (84 000). Une heure. ____________________________________________________________ Album de Lola Molina, mise en scène Lélio Plotton, à La Manufacture, Festival off Avignon, jusqu’au 22 juillet. Texte édité aux éditions Théâtrales ____________________________________________________________ C’est quand même la grande question : comment proposer du théâtre documentaire sans que le sujet l’emporte sur l’émotion ? Comment soutenir un propos politique sans faire passer une œuvre artistique pour une conférence TED ? Au Théâtre des Doms, vitrine de la scène belge francophone, le duo formé par Olivier Lenel et Didier Poiteaux met les pieds dans le plat de la fast fashion avec une autodérision bienvenue. Fast- Festival OFF d’Avignon, Théâtre des Doms, 1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne (84000). A 10h30 jusqu’au 26 juillet, relâche les mercredis 16 et 23 juillet. ____________________________________________________________ Jusqu’au 20 juillet à la Manufacture à 18h15 (durée 1h15). Dans la sélection suisse. ____________________________________________________________ Il y a au moins une actrice fantastique et inconnue dans nos contrées que le Off permet de découvrir. C’est Zahy Tentehar, jeune actrice autochtone, originaire du village de Cana Brava dans le nord-est du Brésil. Chanteuse, danseuse, Zahy Tentehar, qui est la première actrice autochtone à avoir remporté le prix Shell, le prix de théâtre le plus prestigieux au Brésil- raconte son enfance auprès d’une mère chamane, qui ne s’habitue pas à sa migration en ville. Un seul en scène où l’on apprend à parler de Ee’enge eté et où l’on s’aperçoit que qui que l’on soit, d’où qu’on vienne, sa mère reste pour chacun le plus grand des mystères. Fascinant et bouleversant. Azira’i, mis en scène par Zahy Tentehar avec l’aide de Duda Rios jusqu’au 13 juillet à la Manufacture à 17 h 25 (relâche le 10 juillet). ____________________________________________________________ Elle, c’est Annette Baussart, 75 ans, au centre de la pièce que lui consacre Clémentine Colpin.Une vie de femme qui se raconte. Programmée pour être épouse, mère, et prolo, Annette aura tout fait dévier, avec une conscience qui force le respect. « Annette », c’est la joie de vivre d’un corps en révolution. Annette de Clémentine Colpin au Théâtre des Doms, festival Off jusqu’au 26 juillet. ____________________________________________________________ Avec sa conférence dansée «Décoloniser le dancefloor», Habibitch propose de mettre en PLS n’importe quel élu de notre actuel gouvernement en revenant sur les concepts les plus explosifs des dernières décennies : intersectionnalité, appropriation culturelle, décolonisation, féminisme matérialiste… Les termes sont savamment décrits «car oui j’aime les grands A, petits B, petits C, après tout j’ai fait Sciences-Po», lâche-t-elle sur scène. Décoloniser le dancefloor, Habibitch, jusqu’au 22 juillet au Château de Saint-Chamand, navette 19h15, spectacle 19h40. Relâche le 17 juillet. Retour à Avignon 21h35 en navette. ____________________________________________________________ C’est un texte fait de petits déplacements, légers, un peu comme des pas de boxe. Il dit par exemple que ce qui est inéluctable ce n’est pas l’ordre du monde tel qu’il est, non, ce qui est inéluctable, c’est le changement. Le spectacle musical mis en scène par Anne Conti donneune nouvelle forme au texte puissant de l’autrice sur nos petites soumissions et surtout sur la possibilité de s’en affranchir. Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer de Virginie Despentes, mis en scène par Anne Conti, jusqu’au 26 juillet à 18 heures (durée : 1 heure), à la Scierie (relâche les 8, 15 et 22 juillet). ____________________________________________________________ La neige est blanche est une pièce légère. «Pièce pour une interprète en établissement scolaire» elle doit pouvoir s’implanter dans n’importe quelle salle de lycée. Elle a été pensée pour ça, pour rencontrer un public de l’âge de l’héroïne. Elle est systématiquement suivie d’un moment d’échange après la représentation : et vous, vous feriez quoi ? «Dans les lycées de sport études où nous sommes passées, les jeunes nous ont souvent répondu qu’ils ne préféraient pas y penser, rapporte Galla Naccache-Gauthier. Ils se dirigent souvent vers une carrière de sportifs de haut niveau pour faire plaisir à leurs parents, eux-mêmes anciens champions. Dans les formations de sports de glisse, ils portent aussi toute la pression de leurs profs qui doivent justifier leur existence alors que la neige fond et que comme elle, ils sont voués à disparaître…» La neige est blanche jusqu’au 26 juillet à 11 h 00 à Présence Pasteur. Relâche les 8, 15, 22 juillet (50 minutes). ____________________________________________________________ Sur scène, les deux jeunes filles pourraient sortir des pages d’une BD, sautillantes avec leur sac sur le dos (Louise Bénichou et Marion Brest), et tentent de trouver leur voie de collégiennes : faut-il vraiment croire la redoutée prof de français quand elle affirme qu’on peut aimer lire (et du Chateaubriand en plus) ? On a aimé chez Orain cette manière de prendre au sérieux les vagues d’anxiété des ados (un sur deux y serait confronté selon un sondage Ipsos de 2022) sans en faire un drame - seulement une pièce de théâtre. «En quatrième, j’aurais bien aimé moi aussi qu’un spectacle me dise : ce que tu vis, c’est normal et ce n’est pas si grave», répond-il. Le journal de Maïa, jusqu’au 24 juillet à 9 h 45 au Théâtre du Train bleu. Relâche les 11 et 18 juillet (50 minutes). Légende photo : Le journal de Maïa de Cédric Orain (Photo : Clément Foucard)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 17, 3:25 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 16 juillet 2025 Proposé dans le « off » du festival, le spectacle, créé en mars 2024 à Villeneuve-d’Ascq pour deux acteurs, connaît un tel succès que trois duos se succèdent désormais à la distribution.
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/16/a-avignon-l-abolition-des-privileges-poursuit-son-exceptionnel-parcours_6621650_3246.html
Histoire paradoxale d’un succès qui fait du bien, mais ne protège de rien : l’épopée de L’Abolition des privilèges (adapté et mis en scène par Hugues Duchêne à partir d’un roman de Bertrand Guillot) est l’exemple même d’un projet modeste qui a su rencontrer un large public. La raison de cet engouement ? Sa forme souple et son contenu percutant qui, sous prétexte de retracer une séquence historique, tape au cœur de préoccupations contemporaines. La fiction ressuscite la nuit du 4 août 1789, au cours de laquelle représentants du tiers état, du clergé et de la noblesse en finissent avec les privilèges et instaurent l’universalité de l’impôt. Une heure quinze de débats jubilatoires que perturbe l’insertion hilarante de thèmes sociétaux tels que le féminisme, le patriarcat ou encore le « wokisme ». « Le roman décrit un bouleversement politique qui renverse un ordre établi depuis quatre cents ans et prouve qu’il est possible de faire advenir du nouveau. Or, de quelle nuit du 4 août rêvons-nous aujourd’hui ? », s’interroge le metteur en scène qui reprend, à sa manière, le flambeau d’illustres prédécesseurs. Ariane Mnouchkine, Sylvain Creuzevault ou Joël Pommerat ont, avant lui, redonné des couleurs à la Révolution française. Proposé au Train bleu, dans le « off » d’Avignon, dans un dispositif quadrifrontal, avec deux acteurs au plateau, L’Abolition des privilèges nécessite désormais une triple distribution, les comédiens étant dans l’impossibilité d’assurer les représentations prévues dans les mois à venir. Un premier duo a ouvert le festival, le second l’a relayé du 7 au 17 juillet, le troisième fermera le ban jusqu’à la clôture de la manifestation. Ces trois équipes seront sur le pied de guerre pendant la saison 2025-2026, et c’est là l’heureux karma d’une aventure née il y a un peu plus d’un an. Quelque chose d’inédit En mars 2024, lorsque Hugues Duchêne, directeur de la compagnie Le Royal Velours, donne le coup d’envoi de L’Abolition des privilèges au Théâtre de La Rose des vents, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), il est loin de se douter de ce qui l’attend. Quelques jours plus tard, à Paris, où le spectacle se reprend dix fois au Théâtre 13, c’est le jackpot : record d’affluence dans la salle. Trois mois plus tard, l’artiste casse la tirelire familiale pour s’offrir un créneau d’exposition dans le « off » du Festival d’Avignon. Le marché est concurrentiel, mais la rumeur, excellente, sait trier le bon grain de l’ivraie. Trois cents professionnels se bousculent à la porte : « Certains n’ont pas pu entrer, ce qui a aiguisé leurs convoitises, dit en souriant le metteur en scène, pas dupe. C’est un spectacle léger et qui ne coûte pas cher : 3 500 euros la session. » En octobre 2024, Léa Serror, la directrice de production, l’avertit : il se passe quelque chose d’inédit : les demandes d’accueil affluent de toutes parts, pas question de décliner les sollicitations. Revers de la médaille : Maxime Pambet, le créateur du rôle principal, ne pourra pas être de toutes les soirées. Duchêne monte donc une équipe B, puis, en janvier, une équipe C. Il anticipe à juste titre : entre mars 2024 et juin 2026, L’Abolition des privilèges devrait cumuler 290 dates de représentation. Un nombre « inespéré et fou » dans un laps de temps aussi resserré. A la croisée des chemins Cette performance, qui rassure l’intermittent en quête de cachets, ne fait pourtant pas de Hugues Duchêne un homme riche. « Je gagnais mal ma vie, je la gagne un peu mieux, mais sans plus. » D’un point de vue économique, l’opération n’est pas une martingale. Venir à Avignon coûte cher. Location de la salle, logements, repas, voyages, communication : la note grimpe à 54 000 euros (assumée par Le Royal Velours et trois autres partenaires). Pour récupérer l’argent investi, il faut vendre 25 dates du spectacle : « Nous y parviendrons. Mais, une fois amorti le coût avignonnais, ce qui restera dans nos caisses ne suffira pas à financer ma prochaine création. » Pour son futur projet, il a besoin de 140 000 euros. Des coproducteurs ont répondu présent, mais ne peuvent, pour l’heure, préciser le montant de leurs apports. La subvention récemment attribuée par la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France (25 000 euros annuels pendant deux ans) et l’aide de la région Hauts-de-France ne suffiront pas à boucler le budget : « Je fais avec les moyens de production du théâtre public, et ils ne sont plus ce qu’ils étaient. » S’il admet malgré tout faire « partie des privilégiés du système », Hugues Duchêne est à la croisée des chemins. Réclamé par les directeurs de théâtre, plébiscité par le public, le succès de L’Abolition des privilèges n’a en rien aboli l’incertitude des lendemains qui tremblent. L’Abolition des privilèges. D’après Bertrand Guillot. Adaptation et mise en scène : Hugues Duchêne. Train bleu. Avignon Jusqu’au 24 juillet. Distribution : Maxime Pambet en alternance avec Maxime Taffanel et Oscar Montaz ; et Hugues Duchêne en alternance avec Baptiste Dezerces et Matéo Cichacki. Joëlle Gayot (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 15, 5:31 PM
|
Par Joëlle Gayot (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 15 juillet 2025 L’ancien président de la République, qui avait l’étoffe d’un personnage de théâtre, est évoqué dans deux spectacles à l’affiche du Festival, « Lettres à Anne » et « Génération Mitterrand ».
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/15/le-retour-de-francois-mitterrand-devenu-personnage-du-off-d-avignon_6621383_3246.html
La légende raconte que François Mitterrand (1916-1996), président de la République en exercice, avait l’habitude, au mois de juillet, d’échapper à la vigilance de ses gardes du corps pour débarquer, sans crier gare, au Festival d’Avignon, où le directeur, averti d’un coup de téléphone, lui réservait une place discrète dans les salles obscures. Le spectateur clandestin d’autrefois est aujourd’hui l’un des héros du Festival « off ». Il fait son entrée à pas de loup sur les scènes de deux théâtres. Il s’immisce à la Scala Provence, où Alice Faure dirige Samuel Churin et Céline Roux dans une adaptation des Lettres à Anne (magnifique et impressionnant recueil des courriers de Mitterrand, publié chez Gallimard par Anne Pingeot vingt ans après la mort de son compagnon). Il se glisse aussi au Train bleu, où Léo Cohen-Paperman, son coauteur Emilien Diard-Detœuf et trois comédiens revisitent avec impertinence et lucidité les années fastes, puis crépusculaires qui ont suivi le 10 mai 1981. Deux faces d’un même homme surgissent. L’une intime et privée, l’autre publique et populaire, les deux formant l’envers et l’endroit d’un Mitterrand qui a l’étoffe d’un personnage de théâtre. Sa personnalité, sa vie, ses secrets, ses manœuvres, ses stratégies, son ambition : qu’on l’aborde de l’intérieur ou qu’on le contemple de l’extérieur, il a toute sa place sur les scènes. Du flux ardent des lettres envoyées à Anne Pingeot émerge la figure d’un amant déterminé, dévorateur, et dont le désir relève d’une forme de prédation. Emprise intellectuelle autant qu’amoureuse et sans doute sexuelle : la jeune fille de 18 ans qu’entreprend de séduire Mitterrand n’avait aucun moyen de lui échapper. Samuel Churin n’enlace d’ailleurs pas Céline Roux, qu’il domine de toute sa hauteur. Il la sculpte, la modèle, la soumet à la caresse autoritaire de sa main. Superbe duo qui trouve son point d’équilibre lorsque l’actrice, relevant la tête, abandonne le sourire pour la rage, le hurlement et la révolte. « Laisse-moi partir », lui écrit-elle à 28 ans dans une lettre furieuse (mais qu’elle n’enverra pas). A partir de là, la balance penche vers plus d’égalité. La transposition théâtrale de ce brasier épistolaire souligne la force d’âme identique de deux partenaires qui s’enrichissent mutuellement. Elle s’émancipe peu à peu, il s’enfonce dans la vieillesse. Il a plus besoin d’elle qu’elle de lui. Leur relation et ce qu’en restitue le spectacle, tout, dans ce qui se joue à la Scala, est d’une grande intelligence. Illusions et désillusions Ce même amant consumé par la passion est élu en 1981 président de la République. La fiction mise en scène par Léo Cohen-Paperman a pour point de départ le 10 mai 1981. Jour de liesse pour les trois protagonistes qui se partagent la narration des illusions et des désillusions : un professeur à Vénissieux (Rhône), une journaliste parisienne, un ouvrier à Belfort. Quatre décennies plus tard, en 2022, le temps a fait son œuvre : l’enseignant vote pour Jean-Luc Mélenchon, la journaliste pour Emmanuel Macron, l’ouvrier pour Marine Le Pen. Ce condensé de trajectoires ne travaille pas par hasard sur les clichés. Ces clichés sont la matière première d’une représentation où chaque mot prononcé est familier aux oreilles d’un public quinquagénaire (et plus). Mais, qu’ils aient voté ou non en 1981 (beaucoup de jeunes assistent à la pièce), les spectateurs, de près ou de loin, connaissent les épisodes mis en jeu : la maladie de Mitterrand, sa détestation de Rocard, le tournant de la rigueur, l’entrée du Front national à l’Assemblée nationale, la réélection de 1988, l’Europe enfin. Ces événements, petits et grands, sont entrés dans l’histoire de la France. Ils appartiennent au peuple, sont commentés par la vox populi, qui peut en chanter par cœur les refrains. Assumant plusieurs rôles (leurs personnages, ceux des politiques), les acteurs se mettent au diapason d’une comédie endiablée piquée de politique vivante, à vous redonner le goût du militantisme. Avec son lot de volte-face, de reniements, de ruses, son précipité de cocasseries, cette farce a le rythme d’un vaudeville à la Feydeau. Et le tragique d’un drame shakespearien sur lequel plane, dès les premières lignes, dès 1981, l’ombre d’une mort à l’œuvre. « Lettres à Anne », mis en scène par Alice Faure. Avec Samuel Churin et Céline Roux. La Scala Provence, Avignon, jusqu’au 27 juillet. « Génération Mitterrand », mis en scène par Léo Cohen-Paperman. Avec Léonard Bourgeois-Tacquet, Mathieu Metral, Hélène Rencurel. Théâtre du Train bleu, Avignon, jusqu’au 23 juillet. Festivaloffavignon.com Joëlle Gayot (Avignon, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 4:38 PM
|
Par Rosita Boisseau et Fabienne Darge (Avignon, envoyées spéciales) publié dans Le Monde du 12 juillet 2025
Le danseur et chorégraphe flamenco Israel Galvan et l’auteur et metteur en scène Mohamed El Khatib sont réunis dans un joli spectacle dans lequel ils auscultent le rapport aux pères.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/12/a-avignon-israel-mohamed-un-facetieux-duo-d-iconoclastes_6620876_3246.html L’occasion était trop belle. Réunir le danseur et chorégraphe flamenco Israel Galvan et l’auteur et metteur en scène Mohamed El Khatib, c’était la promesse d’un titre choc, symbole de vivre-ensemble – et titre un peu trompeur, puisque Israel Galvan n’est pas juif, mais issu d’une famille andalouse appartenant aux Témoins de Jéhovah. Comment les deux compères allaient-ils se dépatouiller avec ça et faire la paire ? On pouvait craindre le pire, un spectacle de circonstance, mais après quelques minutes d’échauffement de ceux qui rêvaient de devenir footballeurs, la question a trouvé sa réponse positive. Israel et Mohamed sont bien assortis et ont offert une jolie surprise, lors de la première au cloître des Carmes, le 10 juillet. A gauche, donc, Mohamed, tee-shirt jaune flashy imprimé « Morocco ». A droite, Israel, en djellaba bleu ciel, gentiment prêtée par le père de Mohamed. Chacun a installé son petit univers, ramassé en quelques objets sur une table en bois surmonté d’un portrait de son papa, en une sorte d’autel. Car ce duo, léger et grave à la fois, ausculte le rapport aux pères, deux pères ogres aussi écrasants que touchants. Présents en vidéo sur le plateau, ils racontent sans fard leur relation complexe avec leurs fils, qui ont taillé leur chemin d’émancipation sans pour autant renier leurs origines. La parole revient au premier, c’est son rayon, il est rompu au théâtre documentaire, qu’il pratique depuis des années. C’est lui qui raconte leurs deux histoires, les liens qui se tissent entre elles, et qu’Israel, taiseux parce que bègue, va incarner par sa danse follement crépitante. Pour Galvan, né dans une famille flamenca traditionnelle, à la tête d’une école à Séville, devenir cet artiste iconoclaste, pourfendeur tranquille des clichés, n’a pas été sans mal. Pour El Khatib, une famille ouvrière de la région d’Orléans, musulmane pratiquante, et un père archi-strict, qui n’hésitait pas à cogner, et n’envisageait pour son fils que la place de premier de la classe. Un père pour qui le théâtre n’était pas une option. Veine expérimentale et burlesque La lutte pour le choix d’être soi explose dans le zapateado (frappes de pieds) de Galvan. Plus que jamais intrépide, en bottines, chaussures à crampons et babouches – encore un cadeau El Khatib ! –, Galvan pique et repique à la veine expérimentale et burlesque qui est la sienne depuis plusieurs années. S’écraser un œuf sur la tête ne lui fait pas peur tant son art puise au plus profond, au plus tragique de son être. Alors qu’il se met autour du cou les dizaines de médailles en or récoltées dans les concours et festivals de danse, au risque de s’en étrangler, il souligne aussi combien ces prix n’ont pas compensé pour son père, gardien de l’orthodoxie flamenca, sa sidérante liberté. Chez Mohamed El Khatib, l’adresse au géniteur est moins rageuse, tout en étant sans concession, au fil d’une longue (trop, peut-être) lettre au père inspirée de celle, célèbre, de Kafka. Le filtre de la distance et de l’humour n’entrave pas l’analyse au rasoir d’une vision patriarcale du monde : « Avec tes amis, tu disais : “Les enfants, il faut les dresser” », constate, désolé, le fils. Ce qui n’empêche pas une certaine tendresse d’affleurer dans ce duo « sol y sombra », où la lumière et l’ombre se distribuent de l’un à l’autre des protagonistes en permanence. Avec l’humour en trait d’union, cet Israel & Mohamed s’offre une merveilleuse apparition, celle de la coupole d’une mosquée posée sur les pierres du cloître. Un pied de nez facétieux parmi d’autres à toutes les orthodoxies. Israel & Mohamed, par Israel Galvan et Mohamed El Khatib. Cloître des Carmes, jusqu’au 23 juillet. Rosita Boisseau et Fabienne Darge (Avignon, envoyées spéciales du Monde) Photo extraite du spectacle « Israel & Mohamed », avec Israel Galvan et Mohamed El Khatib. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 4:20 PM
|
Par Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 14 juillet 2025
Le comédien belge donne toute l’intensité de son jeu dans une pièce aux allures de western contemporain.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/14/au-festival-off-d-avignon-felix-vannoorenberghe-enthousiasme-dans-la-s-ur-de-jesus-christ_6621173_3246.html
Dès que Félix Vannoorenberghe revêt, en arrivant sur scène, une robe rouge écarlate en hommage à l’héroïne de La Sœur de Jésus-Christ, le public est saisi par l’intensité de sa présente et la puissance de sa narration. Impossible de décrocher de ce récit qui nous plonge dans un village du sud de l’Italie où Maria, la sœur de Simenone (surnommé « Jésus-Christ »), va s’emparer d’un pistolet rangé dans un tiroir de la cuisine familiale, sortir de la maison et se rendre, sans un mot, chez Angelo, l’homme qui l’a violentée la veille. La prestation de ce jeune comédien belge est si étincelante qu’on a la sensation tenace de découvrir un futur grand nom du théâtre. Accompagné de la musicienne Florence Sauveur, Félix Vannoorenberghe nous entraîne, comme dans un long travelling, dans un récit captivant aux allures de western contemporain. A l’image de cette foule de villageois (les gars du chantier, les chasseurs, les bikers, les femmes jalouses de sa beauté, les enfants, etc.) qui va suivre ou invectiver Maria, jeune femme à la détermination imperturbable, le spectateur est pris dans un suspense, dans le besoin de comprendre pourquoi elle a décidé de prendre une arme, comment cette violence a pu se développer dans un silence collectif coupable. Félix Vannoorenberghe est à la fois le narrateur et le reflet de la communauté villageoise à laquelle il donne vie à travers une multitude de costumes qu’il endosse puis suspend au fur et à mesure de l’histoire à l’arrière-scène pour figurer le cortège des habitants. « Je suis comme un observateur qui a assisté à une histoire tellement dingue qu’il a besoin de la raconter en faisant vivre tous ses protagonistes », résume, hors scène, Félix Vannoorenberghe. « Plonger dans la parole » A 30 ans, ce comédien au visage juvénile, au corps longiligne et à la voix profonde et douce – croisé notamment dans quelques séries télévisées (Hippocrate, Salade grecque) – a suivi à la lettre les conseils du metteur en scène Georges Lini (1966-2025) : « Plonger dans la parole », travailler le texte comme une « partition de musique » et l’accompagner d’un « investissement physique ». Le résultat est tellement saisissant que La Sœur de Jésus-Christ a déclenché un bouche-à-oreille immédiat. Le spectacle fait salle comble. Mais cet Avignon qui pourrait être « de rêve » a une dimension « absurde », lâche le comédien. Parce que Georges Lini, l’artisan de ce succès, « n’est plus là ». Privilèges abonné Emporté par un cancer à l’âge de 58 ans, ce metteur en scène, personnalité réputée de la scène belge, est mort le 27 juin. « C’était mon mentor, on travaillait ensemble depuis huit ans, il m’a vraiment appris mon métier. » Félix Vannoorenberghe n’oubliera jamais cet e-mail reçu un soir de 2017, « à 0 h 11 », précise-t-il, dans lequel Georges Lini lui proposait de jouer dans La Profondeur des forêts, de Stanislas Cotton (pour lequel il recevra, en 2018, le prix Maeterlinck de la critique, catégorie meilleur espoir).iuge Alors étudiant en dernière année de l’Institut des arts de diffusion (IAD) à Louvain-la-Neuve (Belgique), Félix Vannoorenberghe avait passé le matin même un examen. Georges Lini était membre du jury et l’a tout de suite repéré. Leur collaboration, au sein de la compagnie belge Belle de nuit, n’a jamais cessé. Désormais, il s’agit, insiste le comédien, de « faire honneur à son travail ». Ce que son élève réussit pleinement. « Avignon, le lieu saint du théâtre » La Sœur de Jésus-Christ fait partie de la « trilogie des Antigone » imaginée par Georges Lini. Le premier chapitre, Iphigénie à Splott, avait déjà été l’un des succès du « off » d’Avignon en 2023 et avait révélé le talent de Gwendoline Gauthier. « Il était toujours à la recherche de la beauté dans ce monde dégueulasse, se souvient Félix Vannoorenberghe, et avait engagé plusieurs jeunes comédiens et comédiennes ces dernières années. » Après soixante dates de tournée en Belgique, La Sœur de Jésus-Christ enthousiasme désormais le public avignonnais, qui se presse au Théâtre des Doms, vitrine de la création belge francophone. « Avignon, c’est un peu le lieu saint du théâtre, la porte d’entrée française pour les compagnies belges. C’est la première fois que je viens à ce festival en tant que comédien. Je l’avais découvert, en tant que spectateur, à l’âge de 18 ans, grâce à un cadeau de ma mère. » Institutrice, c’est elle qui, en inscrivant son fils très jeune dans une école municipale de musique et de théâtre, a semé chez lui la « première graine » du virus du théâtre. Une « seconde graine » est venue s’ajouter à l’adolescence, grâce à la découverte des spectacles d’Hamadi El Boubsi. « Des claques théâtrales qui m’ont tour à tour ému, émerveillé, secoué, changé », se souvient le comédien. Cette fois, grâce à son talent, à la délicatesse de l’accompagnement musical imaginé par Florence Sauveur et à la force du texte de l’Italien Oscar De Summa, qui n’est pas moralisateur, mais pose des questions sur les racines et les ressorts de la violence, la « claque théâtrale », c’est lui. Voir le teaser vidéo La Sœur de Jésus-Christ, d’Oscar De Summa, texte français : Federica Martucci, mise en scène : Georges Lini. Avec Félix Vannoorenberghe et la musicienne et compositrice Florence Sauveur. Festival « off » d’Avignon, Théâtre des Doms. Jusqu’au 26 juillet. Tarifs : de 14 € à 21 €. En tournée en Belgique et en France à partir de 2026. Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 14, 5:29 AM
|
Enquête de Joëlle Gayot / Le Monde du 13 - 14 et 15 juillet 2025 Malgré les difficultés financières, nombre de collectivités, de bords politiques divers, maintiennent, voire amplifient, leur appui au secteur artistique. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/14/ces-elus-locaux-qui-soutiennent-la-culture-envers-et-contre-tout_6621056_3246.html
Soutenir ou ne pas soutenir la culture ? Et, si oui, comment et pourquoi le faire dans un contexte économique si tendu que chaque euro sorti des caisses des collectivités territoriales est pesé, soupesé et scruté à la loupe ? Alors que des élus locaux de tout bord, contraints par leurs budgets en berne, diminuent leurs aides aux structures culturelles, d’autres responsables politiques, venus du centre, de la droite ou de la gauche, jouent une autre partition. Ils se battent pour maintenir les crédits alloués à la culture. Ne sacrifier, donc, ni la création, ni l’émergence, ni, en bout de chaîne, le public en quête d’un art qui le bouscule et l’émancipe. Cette décision transpartisane, qui se traduit par une sanctuarisation, voire – plus rare – par une augmentation des subsides accordés, découle d’un vrai choix politique. Le mot n’est pas galvaudé, avec comme moteurs puissants à cette mobilisation pour les artistes et la liberté d’expression, la lutte contre le complotisme, les fake news, la censure ou l’essor de l’extrême droite. Maintenir le niveau des subventions culturelles, quand il serait facile d’arguer de priorités supérieures, telles que la sauvegarde de l’hôpital, de l’école ou des transports, et alors que le gouvernement cherche encore 40 milliards d’euros d’économie sur le budget 2026, témoigne d’un engagement qui va au-delà de la posture. « Si, dans les Hauts-de-France, nous y parvenons, alors tout le monde peut le faire », estime Xavier Bertrand (Les Républicains, LR), qui plaide pour une refonte du socle éducatif : « Il faut que, en son cœur, soit placée l’éducation culturelle et artistique. C’est un chantier présidentiel en soi », insiste-t-il. A la tête du conseil régional des Hauts-de-France, il a, depuis son élection en 2016, porté son budget de la culture de 76 millions d’euros à 115 millions d’euros. « Nous ne partions pas d’une page blanche, mais nous l’avons augmentée de deux tiers, ce n’est sûrement pas pour faire aujourd’hui marche arrière », assure celui qui ferraille depuis près de dix ans avec l’opposition du Rassemblement national (RN) : « Le nombre de fois où ils ont affirmé qu’il ne fallait pas voter des aides à des festivals, car on y déclamait des vers trop crus d’Apollinaire ! Culture ne rime pas avec censure, sauf pour le RN. » Elle ne rime pas davantage, à l’en croire, avec le refrain dévastateur du « non-essentiel » seriné pendant le Covid-19, et qui a relégué les rencontres entre l’art et le public à l’arrière-plan des préoccupations gouvernementales. Un Etat aux abonnés absents « La crise sanitaire a été un déclic, renchérit Cécile Helle, la maire (Parti socialiste, PS) d’Avignon. Nous avions accès aux lieux de consommation, mais pas à ceux de culture. Cette privation m’a interpellée sur l’image de société qui était alors renvoyée. » Deuxième confinement oblige, à l’automne 2020, l’édile a vu se profiler le spectre d’une France sans théâtres, sans musées ou sans cinémas. « Ce n’est pas cela que l’on veut pour notre pays et notre République », proteste-t-elle. Alors que la 79e édition du Festival d’Avignon a démarré, samedi 5 juillet, Cécile Helle rappelle que, derrière la « carte postale » d’un Palais des papes chauffé par le soleil, 30 % de ménages vivent au-dessous du seuil de pauvreté dans sa ville. C’est à cette population-là, plus qu’aux spectateurs qui battent le pavé du « in » et du « off », qu’elle veut prouver à quel point la culture est vitale. Elle y consacre 18 millions d’euros par an ; soit 10 % de son budget de fonctionnement. Elle inaugure des bibliothèques de proximité dans les quartiers populaires, a fait ouvrir, en juin, un sixième musée municipal. L’accès à ces établissements est libre. Si la gratuité n’est pas la recette miracle, « c’est une manière d’affirmer que la culture est généreuse », précise-t-elle. Et désireuse, qui plus est, de se délocaliser au-delà des remparts d’Avignon. Des mairies aux communautés de communes, des départements aux régions, la décentralisation se met en ordre de marche pour prendre le relais d’un Etat parfois aux abonnés absents. Quand elle ne se substitue pas à lui, en jouant les pompiers de service. « On sent monter des crispations, des tensions, des appels au secours », note Loïg Chesnais-Girard, président (divers gauche) du conseil régional de Bretagne. Si cette région n’est pas une « arche de Noé » pratiquant « l’open bar », cet élu social-démocrate a posé la culture comme « non négociable dans les arbitrages budgétaires de sa collectivité ». L’enveloppe de 28 millions d’euros n’a pas faibli depuis 2017. C’est peu au regard du budget total de la collectivité (2 milliards d’euros), mais essentiel sur le plan symbolique. « Le message que nous adressons au monde culturel breton est celui d’une volonté politique intangible. » La sienne se heurte tout de même à un Etat qui concentre à Paris, regrette-t-il, la majorité des ressources. « On nous dit : “Assumez, gérez, menez de grandes politiques publiques”, alors que l’on ne dispose que d’une pince à épiler, soupire M. Chesnais-Girard. Il faut redonner des capacités et des moyens financiers aux élus locaux. Les décisions doivent se prendre dans les territoires. » Une décentralisation qui se réinvente depuis sa base ? L’hypothèse pourrait faire son chemin. Les élus locaux, ajoute le président breton, « savent travailler avec des contraintes, n’ont pas droit aux déficits et peuvent mener des politiques de temps long ». Mutualiser les moyens Alors que les ministres de la culture se succèdent – cinq sous la présidence d’Emmanuel Macron –, les maires ou les présidents de région s’installent, eux, dans la durée. Cette stabilité peut-elle être un atout ? « Avoir une politique nationale est important, mais c’est aussi aux collectivités, quel que soit leur périmètre, de faire des efforts », poursuit Carl Segaud, président (LR) de l’intercommunalité Vallée Sud Grand Paris. Onze communes maillent le territoire dont il a la gestion depuis janvier. Soit onze maires aux couleurs politiques diverses, mais qui savent taire leurs divergences pour se souder autour d’une « offre culturelle qualitative ». L’intercommunalité investit 12 millions d’euros pour ses huit théâtres, plus de 20 millions pour ses huit conservatoires, 5 millions pour les quatre médiathèques. « Ce pourcentage important de notre budget n’est pas remis en cause », se félicite M. Segaud, qui étudie, avec ses partenaires, la meilleure façon de mutualiser les moyens et d’optimiser les coûts. Au nord-ouest de Paris, Patrice Leclerc, maire (Parti communiste) de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), associe le pragmatisme aux idéaux. « Il faut démontrer que l’être humain a besoin de pain et d’imaginaire, mais il faut aussi créer de la compensation culturelle pour les milieux populaires », prévient-il en revendiquant la nature « utilitariste » de son apport. Il n’a pas ôté 1 euro au budget de la culture. Où est-il allé chercher des ressources ? Il a augmenté la taxe foncière, sollicité des entreprises de Gennevilliers pour financer des opérations culturelles, limité à trois le nombre des agents de la police municipale. Ces solutions ne sont pas du goût de tous les électeurs ? Peu importe. Elles s’élaborent au cas par cas. Un exercice de fine couture, que supervise un maire convaincu que « la liberté de création » est à défendre pied à pied. Et d’autant plus qu’approchent des échéances municipales, en mars 2026. « Du jour au lendemain, tout peut être cassé. Couper les vivres est rapide, reconstruire une action culturelle beaucoup plus difficile, s’inquiète M. Leclerc. Or, le populisme et le poujadisme de la pensée qui se développent dans ce pays constituent un risque sérieux. » Quarante millions d’euros : c’est le montant stable dont dispose, à Dijon, Christine Martin, adjointe d’une mairie socialiste, chargée de la culture. « Ce n’est pas mal », admet celle dont la mission est de maintenir à flot une barque qui prend l’eau dès que les partenaires (région ou département) se désengagent. « Je ne tire sur aucune ambulance, mais, pour certains de ses équipements, la ville est assez seule. » Mme Martin active la sonnette d’alarme. Dans sa ligne de mire, une dérive insidieuse qui voit des collectivités se retrancher derrière leurs déficits pour évacuer des projets culturels dont elles ne cautionnent pas les contenus. « Ce manque financier leur autorise des choix qui, en réalité, peuvent être plus idéologiques qu’économiques. » Le risque ? « Une pensée dégradée », « une censure financière », l’essor d’un divertissement sans aspérités et des portes qui se referment devant l’émergence ou la création. Or, note l’élue, « si vous ne donnez pas les moyens aux gens de s’exprimer, ne s’exprimeront que ceux qui en auront les moyens ». Certains élus s’indignent aussi de voir la culture sacrifiée au motif qu’elle ne figure pas parmi les compétences obligatoires des collectivités. « Mes collègues se posent-ils la question de compétences qui ne sont en rien obligatoires et pour lesquelles ils consacrent parfois beaucoup d’argent ? », s’agace Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Entre 2021 et 2025, il a hissé son budget de la culture de 18,8 millions d’euros à 20 millions d’euros. « J’assume cette priorité dans un contexte où l’extrême droite approche des portes du pouvoir. » Ce n’est pas que la Seine-Saint-Denis soit riche. Mais M. Troussel refuse de plier face à des chiffres dont il connaît la teneur par cœur : « La sous-compensation par l’Etat de mes dépenses sociales ne date pas d’hier. » Son projet est d’une franche netteté : faire de la culture un levier pour les politiques qu’il développe en matière d’éducation, de solidarité, de transformation de l’espace public. La replacer au centre de l’arène, parce qu’elle « n’est pas un supplément d’âme, mais un service public à part entière ». C’est dire si l’art, en Seine-Saint-Denis, n’est pas satellisé vers les confins d’un superflu que l’on raie d’un trait désinvolte. L’élu n’en démord pas : la gauche doit se réemparer de la bataille culturelle. « Si les réactionnaires en sont là aujourd’hui, c’est parce qu’ils n’ont jamais cessé de la mener », déplore-t-il. Cette bataille fut, autrefois, au centre du projet présidentiel de François Mitterrand, lorsque, candidat à l’Elysée, il proposait aux Français, en 1981, d’être, avec lui, « les inventeurs d’une culture, d’un art de vivre, bref d’un modèle de civilisation ». Lointaine époque, il est vrai, mais qui s’envisageait alors de belle et enthousiasmante manière. Joëlle Gayot / LE MONDE Illustration : Yasmine Gateau

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 2, 7:58 AM
|
Charlie Barreira dans L'Humanité - Publié le 24 juin 2025 Valérie Donzelli filme la mise en scène de la dernière pièce de théâtre d’une promotion du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris dont la volonté est de briller sur les planches. Un régal.
La réalisatrice, comédienne et scénariste Valérie Donzelli a tenté, en 1996, le concours du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Elle l’a raté. En 2023, elle y est revenue, après une carrière déjà bien remplie, pour y donner une masterclass. Elle y rencontre Clémence, une des élèves. Un an plus tard, la jeune femme contacte la réalisatrice. Un sentiment d’urgence la traverse alors qu’elle s’apprête à monter sa dernière pièce dans le cadre de sa formation. Elle demande à Valérie Donzelli de filmer l’ensemble de cette mise en scène. Le documentaire transporte le spectateur dans les coulisses avec un groupe d’élèves de dernière année du conservatoire, de la première lecture du texte jusqu’à la dernière représentation. En parallèle, on découvre un à un les comédiens. Ils racontent leurs parcours singuliers, tous liés par le désir ardent de devenir acteurs. Pendant toute la durée du film, on traverse avec eux tous ces mois de préparation, ponctués de doutes, d’inquiétudes, et surtout d’une rage inépuisable d’exister. Une création à deux voix Valérie Donzelli et Clémence narrent et commentent les différentes étapes de la création, chacune avec son propre regard. Clémence vit la fin d’une étape, un grand tournant dans sa vie de jeune femme. Valérie, de son côté, revit une jeunesse qu’elle a quittée, avant de traverser sa vie d’adulte, avec ses promesses et ses difficultés. Toutes deux se rejoignent dans une forme de peur, celle de disparaître. C’est pour cette raison que le film existe, pour la postérité de ces deux femmes dont les chemins se sont séparés aux portes du conservatoire. À ses acteurs, Clémence, avant la dernière représentation, ne donne qu’un mot d’ordre : « Faites les sentir vivants. » C’est un documentaire qui transporte et qui transmet cette envie de monter sur les planches. Rue du conservatoire, Canal Plus, mercredi 25 juin, 22 h 35.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 1, 2:27 PM
|
Par Eve Beauvallet / Libération - publié le 1er juillet 2025 Accusé d’avoir sacrifié l’écosystème artistique local, vilipendé pour ses convergences avec le milliardaire identitaire Pierre-Edouard Stérin, le conseiller culture de la présidente de région, Christelle Morançais, assume de tailler dans les subventions publiques en invoquant «un principe de réalité» Rayonnant, alerte, Alexandre Thébault nous accueille dans un café distingué de la place Aristide-Briand de Nantes. Il est, depuis 2021, délégué à la culture et au patrimoine de la région Pays-de-la-Loire. Il est, dit-on, le stratège et l’homme de main de la présidente, Christelle Morançais, (Horizons) sur ce terrain, l’artisan de coupes budgétaires d’une ampleur inédite opérées cet hiver sans concertation avec le secteur et vues comme les prémisses d’un changement d’ère, funeste pour les artistes et le tissu associatif en général. Il a le verbe haut, l’esprit méthodique, le mocassin à glands ardent, une peau de quadra hydratée à l’eau bénite, la dent incisive. «Et un maniement redoutable de la rhétorique, nous a-t-on prévenue. Attention, il est très fort pour retourner les attaques.» Un champion d’aïkido looké en ancien communicant. Présentement, il sourit comme un charme derrière son café. On lui sourit. Il nous sourit. En plissant les yeux. Alexandre Thébault effraie le secteur culturel comme peu avant lui. Ici, traditionnellement, on a affaire à la démocratie chrétienne. «Là, il s’agit d’une droite civilisationnelle, explique Franck Nicolon, élu d’opposition EE-LV, avec des passerelles vers l’extrême droite autour de valeurs religieuses, familiales, et d’une certaine conception de l’Etat.» Jusqu’alors, au sein des collectivités locales, la droite votait toujours pour le patrimoine et s’abstenait pour le spectacle vivant, mais elle ne votait pas contre. «C’était chacun dans son rôle dans un climat plutôt bon enfant», résume une actrice culturelle du coin, parmi les nombreux souhaitant conserver l’anonymat. Même avec l’ancienne vice-présidente de région Laurence Garnier, figure d’un catholicisme de combat pro-Manif pour tous, les acteurs culturels avaient la sensation de pouvoir parler «sans mépris. Mais le fruit est mûr désormais pour se taper la culture, c’est devenu trop payant d’un point de vue électoral, poursuit-elle. La preuve, regardez : on ferme un théâtre, il n’y a personne dans la rue à part les syndicats». Guerre culturelle Pour cette directrice d’institution, Alexandre Thébault est l’incarnation la plus sophistiquée et policée d’un néopopulisme redoutable en train d’apporter les dernières retouches à son épouvantail favori : la figure de l’artiste woke, bien sûr, ce présumé «rentier déconnecté des réalités économiques et des préoccupations des vraies gens». Thébault, cet élu hier encore parfaitement inconnu de la gauche, serait le symptôme d’un moment clé de la guerre culturelle en cours. Logiquement, des visages se sont crispés, en mars, parmi la vingtaine de membres du conseil d’administration de la Maison Julien-Gracq, centre de littérature contemporaine situé en milieu rural. On annonçait alors que l’homme à l’origine de la perte de 50 % de la subvention régionale (qui représentait 50 % à 60 % du budget de la structure) prendrait le siège de président du CA, en raison du décès du prédécesseur Armel Pécheul en janvier 2025. Pile au même moment, un portrait enquêté de six pages, publié dans le magazine local spécialisé la Scène, n’aidait pas à détendre l’ambiance. Le journaliste Bruno Walter y rappelait la trajectoire de cet influent conseiller ligérien, «qui souffle à l’oreille droite de Christelle Morançais» : un passé de communicant de crise chez Areva, un pèlerinage sur le chemin de Compostelle d’où est sorti un livre, un engagement dans le mouvement ultra-conservateur anti-mariage gay Sens commun, mais aussi une convergence avec le milliardaire libertaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin, dont Alexandre Thébault favoriserait le combat identitaire dans l’octroi des deniers publics. Devant nous, l’élu roule des yeux en croisant les jambes. Et rirait presque de ces «procès d’intention», de ce portrait «complètement fantasmé», clairement «commandé» par la municipalité de Nantes, socialiste. «C’était hyper satisfaisant : ils tenaient le parfait combo du catholique ultraconservateur, soi-disant proche des idées d’extrême droite… On est bien, on se fait plaisir, ça alimente des fantasmes…» dit-il en haussant doucement les sourcils vers d’autres sphères, immunisé contre toute tentation de caricature. Comme si lui-même ne venait pas, entre deux gorgées de café, de peindre certains adversaires en extrémistes woke compromis avec «LFI l’antisémite»… Bon gaulliste Alexandre Thébault nous rencontre avant tout pour développer sa vision du financement de la culture, parce que «l’émotion» suscitée par l’annonce des coupes cet hiver a rendu «tout débat de fond inaudible». Mais vu l’ampleur des charges qui pèsent sur lui, il tient aussi, dit-il, à «rétablir certaines vérités», parce que «ce type» portraituré dans la Scène, «personnellement, je ne le connais pas». Lui se présente avant tout en bon gaulliste, «catholique en effet, même si c’est visiblement un problème pour certains aujourd’hui», particulièrement attentif à la liberté d’expression, la diversité d’opinion, au pluralisme. Donc vous lisez Libé, Alexandre Thébault ? Non, «mais je vois passer vos unes». Grand sourire. On lui sourit. Il plisse les yeux. Si l’enquête de nos confrères visait à révéler sa proximité avec l’extrême droite pour embarrasser le camp Horizons de Christelle Morançais, selon lui c’est raté. «Si je devais être au RN, j’y serai.» En dépit des défis rencontrés par sa famille politique, ce lecteur du radical Figaro Vox et de Marianne est toujours resté à LR. «J’y étais du temps de Valérie Pécresse, j’y reste encore derrière Bruno [Retailleau, ndlr].» Au risque, parfois, de cliver dans son propre camp : en décembre, quatorze vice-présidents de région, dont plusieurs LR et centristes en charge de la culture, s’exprimaient collectivement dans une tribune contre les décisions prises en Pays-de-la-Loire en matière de culture. En tout état de cause, il ne voit pas en quoi ses engagements passés prouveraient la nature «idéologique» des décisions «difficiles», «courageuses» opérées cet hiver. Il y a quelques mois, Christelle Morançais avait, certes, poussé tous les curseurs lexicaux du populisme : des artistes «shootés» à la subvention, des assos «militantes», des «groupuscules». Selon l’élu d’opposition Franck Nicolon, Alexandre Thébault «est plus malin qu’elle sur ce point, conscient de devoir se rendre inattaquable sur un quelconque biais partisan». 82 millions d’euros de coupes En aïkido, Alexandre Thébault a un coup spécial : renvoyer la gauche à «ses contradictions» et dénoncer sa tolérance «à géométrie variable». La gauche reproche à Pierre-Edouard Stérin de vouloir orienter le débat public à coups de millions d’investissements… «Mais n’est-ce pas ce que fait aussi Matthieu Pigasse [au Monde, aux Inrocks, à Nova ou au Huffington Post] ?» La gauche se fait chantre de l’inclusivité et de la liberté d’expression… «Mais n’est-ce pas elle qui, par l’entremise entre autres de l’historien Patrick Boucheron, a voulu censurer un ouvrage scientifique des PUF au prétexte qu’il porterait des idées contraires aux siennes ?» La gauche s’indigne de voir le Puy du Fou produire des œuvres colorées d’une idéologie anti-révolutionnaire au fort fumet d’encens, avec l’argent du contribuable… Les collectivités ne financent-elles pas parallèlement des spectacles partisans des causes décoloniales, écolos, féministes ? Lui, en tout cas, se défend d’avoir voulu «se payer la culture». Il veut bien qu’on l’accuse de tout, «mais encore faudrait-il prouver que je fais de l’idéologisme. Qu’on me le démontre factuellement». Alors, l’opposition chiffre à nouveau : sur les 82 millions de coupes budgétaires opérées en fonctionnement, 4,7 ont été demandés à la commission «culture, sport, vie associative, (etc.)» alors qu’elle représente seulement 2 % du budget global. Elle rappelle aussi qu’Alexandre Thébault siège au comité technique cinéma, une instance consultative composée d’experts qui examinent les demandes de subventions aux films tournés dans la région. La décision de l’exécutif reste souveraine mais, dans les faits, la région suit quasi toujours l’avis de ces professionnels. Sauf pour Vaincre ou mourir, coproduction de la société Puy du Fou et de Vincent Bolloré, en partie financée par Pierre-Edouard Stérin, «qui s’est vue gratifiée de la subvention maximale de 200 000 euros contre l’avis du comité», affirme Franck Nicolon. «C’est faux, conteste Alexandre Thébault. On ne l’a pas repêché. Sur les cinq membres présents, deux d’entre eux étaient en effet émoustillés par la marque Puy du Fou, par référence au pedigree du fondateur du grand parc, Philippe de Villiers.» Alors l’élu, «respect du pluralisme oblige», aurait simplement invité le comité à évaluer plutôt la «qualité artistique» de ce premier film (au final un bide relatif en salles), le fait aussi que cette société de production ligérienne générerait un impact considérable sur l’emploi local. Et les réticents se seraient laissés convaincre. «Quant au plafond de 200 000 euros, on l’octroie une dizaine de fois par an.» Franck Nicolon réfute cette version. Accusations de favoritisme Et ses liens avec la galaxie Pierre-Edouard Stérin, alors ? Alexandre Thébault a créé son association Concorde (pour mieux sensibiliser la jeunesse à une certaine histoire de France) avec Marin de Saint-Chamas, ancien collaborateur du milliardaire ultraconservateur. La région a financé trois années de suite une soirée de levée de fonds, intitulée «La Nuit du bien commun», initialement parrainée par le milliardaire exilé fiscal. L’an dernier, elle octroyait également une coquette subvention, 100 000 euros (sur 300 000 de budget), à un nouveau festival de littérature axé patrimoine, «un projet génial» nommé «Cultissime» , également soutenu par le fonds du Bien commun de Pierre-Edouard Stérin. L’élu rejette les accusations de favoritisme d’un revers de main. D’une part, il trouverait aberrant de «scruter quel autre partenaire public ou privé un récipiendaire de subvention peut solliciter : si l’on avait dû regarder de cette façon, il y a un ensemble d’événements qu’on n’aurait jamais financés». D’autre part, il a fermé cette année le porte-monnaie à Cultissime, à la Nuit du bien commun, comme aux autres. Et a finalement renoncé à inscrire son association Concorde à la soirée de levée de fonds. Encore une fois Alexandre Thébault n’est, assène-t-il, guidé que par le seul «principe de réalité» : les 3 300 milliards d’euros de dette pour la France. Une actrice culturelle locale : «Pour nous en convaincre, généralement, il use de la rhétorique infantilisante du bon père de famille qui doit faire des choix difficiles, avec une sorte de bon sens du Crédit agricole». Et en effet : il est désolé de «faire de la peine» en mettant en péril des centaines d’emplois, mais quiconque comprend le b.a.-ba de l’économie verra bien qu’il n’y a pas le choix. Seulement, quiconque s’intéresse au b.a.-ba de l’économie de la culture connaît aussi la loi de Baumol : non, les produits culturels ne sont pas des produits comme les autres, ils sont pour certains structurellement déficitaires et ne peuvent subir les lois de la concurrence. Ou au risque de renoncer aux prototypes pour préférer les produits duplicables industrialisés. Même son maître à penser David Lisnard, le très droitier maire de Cannes, dénonce dans un ouvrage la «myopie» des petits comptables qui ne voient dans la culture que des dépenses improductives. Alexandre Thébault acquiesce calmement, paupières closes, comme si l’on prêchait un convaincu. Précisément, dit-il, il tient à se faire comprendre : «Je suis convaincu du bien-fondé des subventions publiques pour la culture…» Ah. «Je dis juste que l’échelon régional n’est pas le bon pour cela.» Et dans un sourire tendre, il cite alors André Malraux comme apport fondamental à sa réflexion sur la culture. Valses d’étiquettes politiques Il a grandi dans un petit village de 800 habitants à côté de Rennes. On ne lui apprendra rien de la nécessité d’un service public de la culture : la médiathèque locale fut son premier lieu d’acculturation, dit-il. Il est très attaché à l’idée que «la culture existe d’abord dans les us et coutumes de nos régions, dans les folklores, les guinguettes et les fêtes de village. Tout cela préexistait à 1959 et la création du ministère de Malraux…» Pour autant, «bien évidemment», il ne s’agit pas de rétrograder le ministère au rang de secrétariat d’Etat comme un Javier Milei a pu le faire en Argentine. Mais de le relooker façon droite libérale du XXIe siècle. En «bon gaulliste», donc, l’élu ligérien est convaincu que l’Etat doit jouer un rôle «de chef d’orchestre et de vigie» mais que le ministère de la Culture souffre d’une trop grande «fonctionnarisation» et de dispositifs compliqués, «auxquels personne ne comprend rien». En «bon lisnardien» (en référence à David Lisnard), il croit principalement «à la force de frappe des communes». Que l’Etat leur délègue donc les budgets et prérogatives culture. Voici donc ébranlé le modèle du «financement croisé», considéré depuis des décennies comme le plus sûr des garde-fous. Comment éviter de livrer les acteurs culturels à la merci des valses d’étiquettes politiques des municipalités ? «Faisons confiance à l’intelligence collective.» Pour lui, chaque collectivité doit se recentrer sur ses fondamentaux. «Dans le cas des régions : transports, lycées, emploi [comme si la culture n’en créait pas].» L’élu, pourtant, a presque entièrement préservé ses subventions à l’abbaye de Fontevraud (baisse de 6 % du budget), ce navire amiral de la politique culturelle régionale où siège à la présidence le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. «Précisément, parce que la structure est pour l’heure entièrement pilotée par la région. Et que si nous n’y sommes pas, personne n’y est.» Mais la Maison Julien-Gracq est également une structure régionale et a pourtant perdu 50 % de son enveloppe, non ? Un temps. «C’est une maison à laquelle nous tenons beaucoup et cherchons actuellement des solutions pour revenir au schéma budgétaire précédent.» La Maison Julien-Gracq est aussi la seule structure régionale à s’être scandalisée des coupes dans la presse, à visage découvert. «Créer un électrochoc» Au volant, lorsqu’il sillonne les routes de la région en écoutant sur France Culture Répliques, l’émission de son penseur favori Alain Finkielkraut, Alexandre Thébault peaufine ses idées pour une rue de Valois du futur. Certaines ont laissé les auditeurs sans voix en séance du conseil régional de mars : les artistes gagneraient à développer le crowdfunding, la vente de sweat-shirt, les mapping sons et lumières immersifs qui cartonnent auprès des jeunes – un peu comme en propose Pierre-Edouard Stérin via sa start-up de divertissement Sandora. D’autres propositions sont plus consensuelles : pourquoi pas un pourcentage prélevé sur les taxes de séjour et reversé à un fonds culturel, façon d’acter la place prépondérante de la culture et du patrimoine dans les choix de destinations touristiques ? Pourquoi ne pas appliquer au spectacle vivant (privé et public confondu) le modèle du Centre national du cinéma, «qui me semble extrêmement vertueux» ? Soit un pourcentage prélevé sur les tickets pour abonder un fond, de façon encore une fois à ce que les locomotives aident aussi à financer les plus fragiles. In fine, quoi qu’on pense de ses idées, force est d’admettre qu’il a une autoroute devant lui pour en lancer, relève une actrice culturelle locale. «Ça fait plus de vingt ans qu’on dit dans tout le secteur qu’il y a de la surproduction, trop d’œuvres mortes nées, qu’on doit changer de modèle et personne ne fait rien. C’est aussi cet attentisme qu’on paie aujourd’hui.» Alors, bien fait les gauchiasses ? «Evidemment non !, poursuit cette même source. Quand une transition doit être entamée, charge aux pouvoirs publics de mettre en place des mesures d’incitation. Accompagnez-nous s’il faut vraiment faire évoluer nos modèles, formez-nous mieux !» Seulement, la région Pays-de-la-Loire a choisi la punition sans concertation plutôt que l’accompagnement. Pourquoi, au fond ? Et il concède enfin : «Pour créer un électrochoc.» Et raffermir les méthodes du parti Horizons. Eve Beauvallet / Libération Légende photo : Le conseiller régional délégué à la culture et au patrimoine du Pays-de-la-Loire, à Nantes, le 20 juin 2025. (Theophile Trossat/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 4:02 AM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 27 juin 2025 Esprit de carnaval en ouverture de la Cour d’honneur : la chorégraphe star cap-verdienne rêve ses nuits avignonnaises. Rencontre. «Ça se passe dans une maison habitée par trois poupées que je sais chacune occupée à faire des choses très différentes dans des espaces séparés. J’entre et c’est un choc : je suis saisie de les voir travailler alors même que je sais que c’est là qu’elles habitent, que je connais leur existence. En fait c’est leur apparition qui me surprend : j’ai beau savoir ce qui se passe, je suis en état de choc.» C’est le dernier rêve de Marlene Monteiro Freitas à moins d’un mois de la création de son nouveau spectacle, Nôt, en ouverture du festival d’Avignon le 5 juillet. Un rêve qui raconte peut-être la réalité du théâtre, ce rendez-vous dont on connaît les règles du jeu, la salle, la scène, et puis parfois, ça arrive, le choc. Celui qu’on attend, entre les deux murs de la cour du Palais des Papes, «le mur immense des spectateurs, le mur énorme du Palais et nous au milieu, dans la Nuit (Nôt) comme dans un rêve, où tout est disproportionné». Rituels dionysiaques le cul par-dessus tête Marlene Monteiro Freitas, lion d’argent à la Biennale de Venise 2018, star des plateaux de danse contemporaine dont elle explose les codes depuis 2005, c’est déjà le choc incarné des contraires : la douceur de sa voix et des visages étirés en grimaces sur le plateau dans des rituels dionysiaques le cul par-dessus tête, le sourire toujours et des corps grotesques qui tombaient en cascade de leur tribune devant un défilé de militaires d’opérette dans Mal – Ivresse divine, pièce magistrale de 2021. Tout se télescope chez Marlene Monteiro Freitas, Euripide et le Boléro de Ravel (dans Bacchantes. Prélude pour une purge, 2017), des acteurs automates qui gueulent du Arcade Fire (D’ivoire et de Chair, 2014). Chaque pièce est un précipité d’images surréalistes, bacchanales du temps présent qui viennent de loin. De Sal, de Sao Vicente, petites îles du Cap-Vert, dont on ne connaissait pas vraiment l’existence avant que Cesária Evora n’en devienne la porte-voix. «Je me souviens d’un séjour en Hollande, à 11 ans, pour un concours de gymnastique rythmique. On me demande d’où je viens, je cherche sur la carte. Rien. Je ne trouve pas mon île. Je me suis rendu compte ce jour-là que le monde nous ignorait, qu’une erreur de cartographie nous avait effacés. Je n’ai pas douté de notre existence, mais de l’ignorance des autres. Cesária Evora, qui était proche de ma grand-mère, nous a donné la visibilité qui nous manquait, elle m’a fait comprendre très tôt que je pouvais faire quelque chose d’artistique. Faire vivre mon pays ailleurs.» São Vicente, la possibilité d’une île, où tout se met en place pour Marlene. Un père qui raconte des histoires, une mère qui chante et danse à la maison, un grand-père compositeur à la tête d’un petit orchestre des dimanches, la grande sœur écoute Vangelis, qui servira de bande-son aux premières chorégraphies entre copines… Et l’Eglise et ses rituels théâtralisés, et le cinéma Eden plusieurs fois par semaine, vont peupler l’imaginaire de celle qui se dépense d’abord en gymnaste rythmique sur des sols en béton, avec moquette, en maillot approximatif. Déjà «le costume, le plaisir physique, l’idée d’organiser du mouvement dans un court temps de musique, créer l’apparition d’une fiction de corps dans une série de figures imposées, autrement dit : chorégraphier.» Et puis il y a le Carnaval, lieu de toutes les transgressions contrôlées, phénomène de cohésion sociale, dont l’esprit anime ses pièces avec, point d’orgue en 2010, Guintche - nom d’oiseau et pute en créole cap-verdien. Le solo révèle alors une interprète de folie, aux corps et identités bousculés, visage hyperexpressionniste, le maquillage qui dégouline et dégueulasse tout – loin de la neutralité P.A.R.T.S, l’école belge d’Anne Teresa De Keersmaeker dont elle fut l’élève passionnée de 2002 à 2004. «Tout sauf du porc» Souvenir de carnaval ? «J’en ai deux, 2023, ma mère, qui continue à défiler à 91 ans, habillée en grande dame avec une énorme fleur dans les cheveux. Et puis enfant, un groupe d’hommes qui avancent couverts de terre avec de la morve plein la bouche grande ouverte. Je ne pensais pas qu’on puisse sortir dans la rue dans un état pareil. Je me souviens qu’ils encadraient le défilé comme un service d’ordre ; on regardait sans s’approcher, entre l’enchantement et la répulsion.» L’ambivalence est au cœur de son projet, déjà marqué par le drôle de nom de sa compagnie qui fête ses 10 ans cette année : «P.OR.K.», entendre «porc». On s’en étonne, elle s’en amuse : «Beaucoup de choses dans ce nom. Une histoire en avion d’abord où je lis sur la carte qu’il n’y a pas de porc dans le menu. Ça m’a troublée parce que dans tout ce que la compagnie proposait, la seule chose importante à leurs yeux était de mentionner ce qu’il n’y avait pas. Tout sauf du porc. J’ai longtemps gardé cette carte accrochée à mon frigo, et quand il a été question de donner un nom à ma compagnie, ça s’est imposé, parce que c’est aussi un animal que j’aime beaucoup, très populaire au Cap-Vert qu’on appelle affectueusement chook. Un mot doux pour les amis, les amours, la famille. C’est l’animal de tous les transferts : l’image sale du diable, emblème du mal, alors qu’il est très beau affectueux, intelligent.» Soit la métaphore parfaite des visions chorégraphiques d’une artiste qui s’active en ce jour de répétition dans un hangar de télévision, quelque part en banlieue de Lisbonne. La fiction à la vie, à la mort Chaleur écrasante, murs et sol en béton, quelques chaises en plastique et, près de la porte ouverte, pour le courant d’air, trois musiciens redoublent de percussions sur la partition des Noces de Stravinsky. Rien n’est encore vraiment fixé, ni la musique — on entendra aussi Rotcha Scribida, de Cesária Evora – ni les séquences de Nôt. Aujourd’hui, le spectacle est dans l’attention amicale qu’elle porte aux interprètes, en va-et-vient entre le coin de musiciens et Maria João Pereira, danseuse sans jambes, postée sur une chaise, dans un jeu de masques, costumes et postures. «La danse n’est pas une histoire de corps formatés, pas plus qu’une question de professionnels ou d’amateurs, mais d’énergie commune et de conception du travail. Dans tout ce que je propose, il n’y a rien qui ne puisse avoir lieu ; ce n’est pas Tout sauf du porc. Au contraire, c’est faire apparaître tous les corps sur le plateau, tous les imaginaires, tout ce qui nous traverse, nous transforme et nous rêve.» Nôt pour nuit, «l’endroit où les perceptions changent» avec, à l’origine, le souvenir des contes des «Mille et Une Nuits», l’épopée de Shéhérazade, ou la condition d’une femme qui sauve littéralement sa peau par le récit chaque soir d’histoires en série. La fiction à la vie, à la mort. Alors on y va franco : Marlene Monteiro Freitas, qu’est-ce qui vous a sauvé la vie ? Silence, les yeux qui se ferment, et puis : «Je dirais la danse, c’est attendu je sais, mais la danse m’a aidée à comprendre et traduire mon expérience. Au départ j’ai pensé m’orienter vers la psychiatrie, la psychanalyse, mais je n’aime pas la médecine, je savais que je n’allais pas pouvoir travailler dans un hôpital. Ce qui me troublait, c’étaient les constructions de la fantaisie, approcher quelqu’un qui a un vécu plus large qui moi, une perception différente, quelqu’un qui pourrait m’ouvrir à autre chose, qui voit au-delà de ce que je vois sans que je sache comment y accéder. Ce qui me revient là, c’est la première fois que j’ai su que la psychiatrie existait. J’étais enfant, et j’avais une tante, très affectueuse, extrêmement soignée, qui a joué le rôle de grand-mère, et qui, je l’ai su plus tard, était schizophrène. Tout d’un coup, elle se transformait, sa voix, son visage ses cheveux, tout prenait une autre dimension, terrible, hors de contrôle, avec beaucoup de souffrance. Je voyais quelqu’un de proche devenir totalement autre, c’était très impressionnant. Et c’est là que j’ai vu que la psychiatrie pouvait soulager quelque chose chez elle, et faire revenir ma tante d’un monde auquel je n’avais pas accès. La danse m’a autorisé à accéder à des états que je ne soupçonnais pas, que j’ai pu expérimenter en allant aussi loin que possible, sans la souffrance.» Nôt ou la promesse d’une nuit transfigurée. Nôt, de Marlene Monteiro Freitas (création), dans la cour d’honneur du Palais des Papes, du 5 au 11 juillet, puis en tournée. RI TE, de Marlene Monteiro Freitas et Israel Galvàn. A la FabricA (Avignon) le 25 juillet à 21 h 30. Laurent Goumarre / Libération Légende photo : Marlene Monteiro Freitas le 6 juin 2025 au Centre culturel du Cap-Vert à Lisbonne. (Tatiana Saavedra/pour "Libération")

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 10:09 AM
|
Tribune de Nicolas Bouchaud lors de la soirée du 23 juin 2025 au Théâtre national de la Colline, publiée le 28 juin par Libération Opposer élitisme et culture populaire ou invoquer une «attente du public» fantasmée servent à justifier les coupes budgétaires et favoriser le capitalisme culturel, a rappelé le comédien invité par «Libé» au théâtre de la Colline le 23 juin. Il y a quelques semaines, j’ai appris, comme ça d’un coup que j’allais ouvrir la soirée du 23 juin au théâtre de la Colline sous l’intitulé «carte blanche à Nicolas Bouchaud». Vous imaginez l’effet que ça peut produire ? «Carte blanche» m’a tout de suite fait penser à «page blanche». Qu’est-ce que je vais écrire, qu’est-ce que je vais dire ? Et puis j’ai pensé à un mot que j’aime bien. Le mot de «rencontre». Je me suis dit aussi que ce mot de «rencontre» avait beaucoup à voir avec l’acte d’enseigner, de soigner et avec l’acte de jouer, de monter sur un plateau. Je suis né en 1966, c’est-à-dire une dizaine d’années seulement après que Jean Vilar eut prononcé sa célèbre phrase : «Le Théâtre national populaire est au premier chef un service public tout comme l’eau le gaz et l’électricité.» A partir des années 1990, je commence à devenir comédien et tout mon parcours théâtral jusqu’à aujourd’hui se fait au sein de ce qu’on appelle généralement le «théâtre public» et plus communément le «théâtre subventionné». Je voyais qu’au sein de ce théâtre public, des troupes, des groupes, des microsociétés artistiques se constituaient pour fomenter, comploter, élaborer et créer des formes théâtrales singulières, parfois bizarres qui tentaient d’inventer de nouvelles expériences et un nouveau rapport au public. Je garde un souvenir très précis par exemple, d’un de mes premiers spectacles mis en scène et écrit par Didier Georges Gabily, au théâtre de la Bastille en 1992, où à la fin du spectacle, une moitié de la salle criait : «bravo» et l’autre moitié hurlait : «C’est nul.» «Essayer encore, rater mieux» La création artistique n’a pas vocation à mettre tout le monde d’accord. Quand on a 25 ans, c’est une découverte très joyeuse, où la formule de Samuel Beckett prend tout son sens : «Essayer, rater, essayer encore, rater encore, rater mieux.» Dans les années 1990, même si la culture publique commençait à être malmenée, on pouvait encore lire en 1998 dans la «Charte des missions de service public pour le spectacle vivant» impulsée par Catherine Trautmann, alors ministre de la Culture de Lionel Jospin : «La recherche en art, dont l’importance pour la société est aussi grande que la recherche scientifique qu’elle côtoie et croise souvent, est une nécessité absolue.» En 2007, quatre ans après que le régime de l’intermittence fut une première fois sauvé et le Festival d’Avignon annulé, Nicolas Sarkozy qui venait d’être élu, rédige avec François Fillon une lettre de mission à sa ministre de la Culture, Christine Albanel. Au milieu de la lettre, arrive une formule qui pourrait presque passer inaperçue : «La démocratisation culturelle c’est veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public.» L’expression est lâchée : «l’attente du public». Toutes les récentes coupes budgétaires dans le spectacle vivant et tous les discours qui les justifient s’arriment autour de cette question du public. Une création, une œuvre serait donc sommée de s’adresser à tous, c’est-à-dire de plaire au plus grand nombre. Pour n’importe quel praticien, pour n’importe quelle praticienne cette injonction est absurde ; elle va à l’encontre de ce qui fonde un geste artistique. Car lorsque nous répétons ou lorsque nous jouons ce n’est pas le «tous» qui nous préoccupe le plus, c’est «l’adresse». Comment s’adresser à ce «tous» supposé ? Une pure fiction du capitalisme culturel Pour l’industrie culturelle, en revanche, c’est la bonne définition : il faut toujours satisfaire le supposé goût du public, il faut donc s’adresser à tous, plaire au plus grand nombre. Lorsqu’en 2023, Stéphanie Pernod, première vice-présidente de la région Rhône-Alpes (LR), justifie les baisses de subventions décidées par Laurent Wauquiez, elle dit la chose suivante : «Vous savez ce que c’est que le problème de la culture en France ? C’est qu’on accompagne beaucoup trop de métiers. S’ils vivaient sur leurs entrées [les saltimbanques, ndla (1)], nous aurions une certaine vérité populaire.» Là encore, le mot «populaire» est important. Il permet de l’opposer à un autre mot : l’«élitisme». La culture et a fortiori la culture subventionnée seraient élitistes c’est-à-dire pas conforme au goût de la majorité du public. C’est un mensonge. Il y a quelques mois, Christelle Morançais, présidente de la région des Pays de Loire (Horizons), qui se félicite de «briser un tabou» en s’attaquant à la culture mais qui s’est aussi attaquée aux milieux associatifs, sportifs et environnementaux, dénonce, elle aussi «l’élitisme des beaux quartiers» qu’elle oppose au «bon sens populaire». Tous ces récents discours sont idéologiquement situés. Opposer un soit disant élitisme de la culture subventionnée à une soi-disant «vérité populaire», ce sont des éléments de langage qui disent, en réalité une seule et même chose : c’est que pour le capitalisme culturel, une culture subventionnée est une anomalie. Parce que ça ne rapporte pas assez d’argent, parce qu’il n’y a pas assez de plus-values. Cette «vérité populaire» qu’on peut aussi appeler «le goût du public» ou «l’attente du public» est une pure fiction du capitalisme culturel, de l’industrie culturelle, c’est un tour de passe-passe qui permet de faire passer le pouvoir du capital pour la demande des consommateurs, comme l’écrit Diane Scott dans son livre S’adresser à tous (2). C’est ça qu’il y a au fond de ces discours-là et c’est ça qu’il faut combattre aujourd’hui. Car la culture a toujours été et est encore aujourd’hui, même minorée, même plumée, même dite «non essentielle», un champ de bataille où s’affrontent des politiques et des idéologies antagonistes. Elle est même un endroit stratégique. Car aujourd’hui, les partis populistes et fascistes en France, en Europe et ailleurs ont compris qu’il fallait d’abord gagner la bataille culturelle qui, comme le théorisait le communiste Antonio Gramsci, est l’une des étapes nécessaires à la conquête du pouvoir politique. L’accusation en élitisme est l’une des formes que prend cette bataille. Or un spectacle ne se résume jamais à la représentation de 20 h 30. Lorsque nous jouons, que nous tournons avec un spectacle en France ou à l’étranger, tout cela s’accompagne la plupart du temps de toutes sortes d’actions vers les associations, les collèges, les prisons, les universités. Le public se crée au contact d’une œuvre Je ne crois évidemment pas qu’il y aurait un public qui préexisterait à une représentation théâtrale et qu’il faudrait satisfaire. Le public se crée au contact d’une œuvre, au contact d’un spectacle, d’un film ou d’un tableau. Le public n’est pas une part de marché. Je crois que pour penser une politique culturelle, il faudrait d’abord arrêter de catégoriser les publics. Catégoriser les publics est déjà une opération douteuse. Catégoriser des publics c’est, au fond, la même chose que de les opposer. Et quand on catégorise trop on finit par sélectionner. Nous fabriquons des objets que nous adressons à un autre, au spectateur, et qui sont comme des bouteilles jetées à la mer. Nous ne savons pas toujours si quelqu’un ou quelqu’une trouvera le poème, le dessin ou la chanson cachés à l’intérieur. En ce sens nous nous adressons à tous, ce qui ne veut pas dire que nous cherchons à plaire au plus grand nombre, ni surtout que nous prétendons parler au nom de tous. Nous essayons simplement de transmettre des expériences et cela n’est pas quantifiable. Car nous ne savons jamais à l’avance comment le public sera touché, pourquoi il sera touché et à quel moment il sera touché. C’est cette incertitude de la rencontre que nous essayons de recréer chaque soir en montant sur la scène. (1) Note de l’auteur, commentaire de l’auteur de la tribune. (2) Diane Scott, S’adresser à tous. Théâtre et industrie culturelle, éditions Amsterdam, «les Prairies ordinaires», 2021. Légende photo : Nicolas Bouchaud au Théâtre La Colline ouvre la soirée «Services publics en péril, culture en résistance» organisée par «Libération», à Paris le 23 juin 2025. (Corentin Fohlen/Divergence pour Libération)
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...