ANALYSE. Tenter de faire passer pour des « catégories biologiques » de simples constructions sociales fondées sur la couleur de la peau ou la forme du nez : cette rhétorique fait un retour décomplexé dans la parole politique, sous le masque du simple constat scientifique.
Stéphane Foucart
Publié le 23 septembre 2025 à 09h00, modifié le 23 septembre 2025 à 16h01
Extrait
En France, le retour de ces idées se fait avec moins de tapage. Mais, de manière bien plus inquiétante, elles reviennent sous le masque du simple constat scientifique. En mai, le Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN), instance créée en 2018 par Jean-Michel Blanquer, publiait une proposition de « référentiel de compétences des enseignants » dans lequel ces derniers sont invités à « connaître la diversité des élèves », celle-ci étant le fait de « facteurs génétiques, [de] facteurs familiaux et sociaux, [de] facteurs environnementaux, [de] facteurs culturels et linguistiques, [d’]histoire de vie. »
Citer des « facteurs génétiques » dans cette énumération, de surcroît en première position, trahit en réalité un agenda idéologique qui s’avance. D’abord parce qu’on voit mal l’usage qui pourrait être fait, par les enseignants, de ces considérations sur des différences génétiques de leurs élèves. Ensuite, et surtout, parce que faire de la génétique un élément déterminant des capacités d’apprentissage – ou de traits complexes – est inexact, comme le rappelle l’ASHG.
Image : "La campagne de publicité lancée cet été outre-Atlantique par American Eagle, vantant les gènes de la blonde actrice américaine – en jouant sur l’homophonie, en anglais, de jeans et genes, a suscité une vive controverse dans les médias américains (...)"
via Instagram https://www.instagram.com/reel/DMdIuUoRYAL/
Via
Bernadette Cassel






 Your new post is loading...
Your new post is loading...

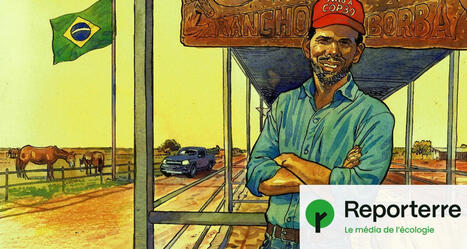
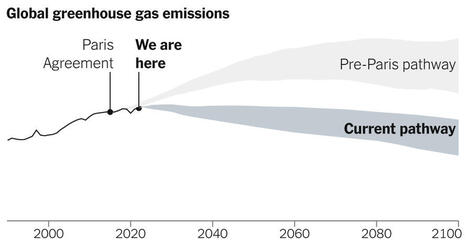











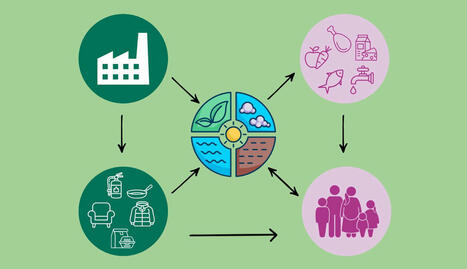















Au terme de son voyage d'études, la Fabrique de la Cité pubie un portrait de la ville de Venise et une anticipation de son avenir.