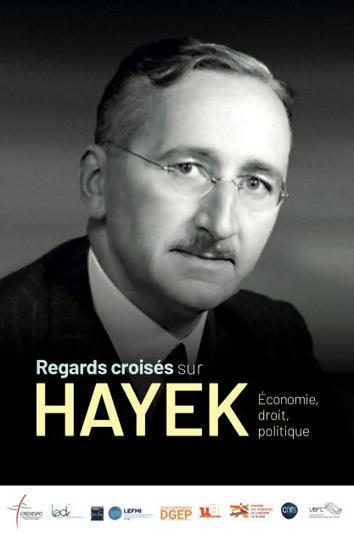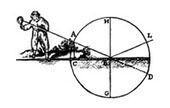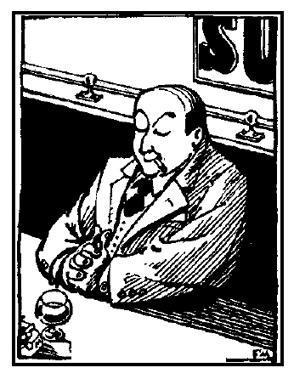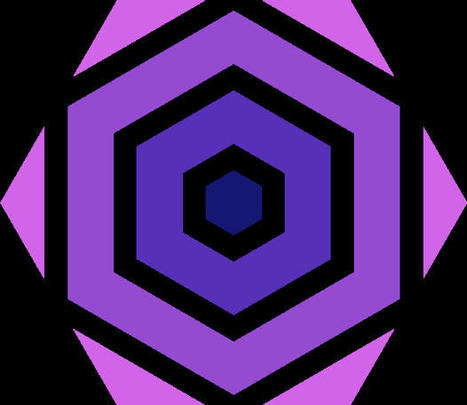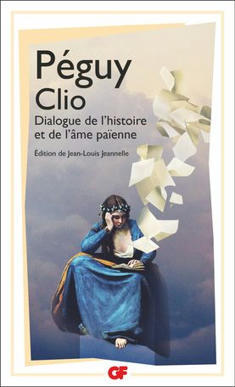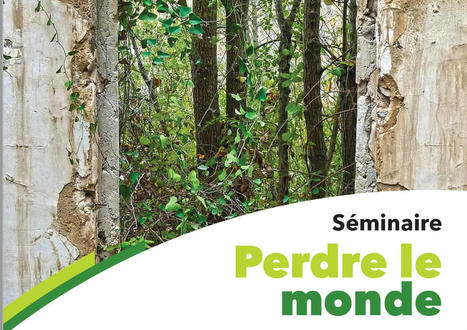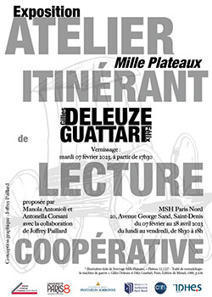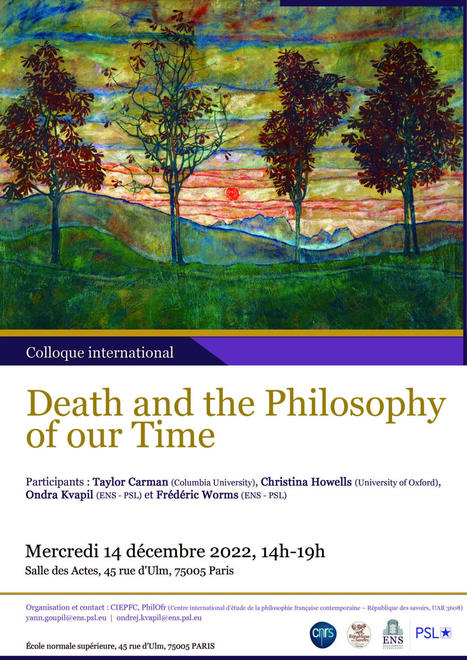Colloque d'Albi 2011 : L'ambiguïté dans le discours et dans les arts du 11 au 14 juillet 2011 à Albi (Centre Saint-Amarand 16 rue de la République)
"N'existe que pour être levée", pourrait définir l'ambiguïté à la manière du "dictionnaire des idées reçues" de FLAUBERT, à moins qu'il n'eût préféré "Intolérable pour le charbonnier". Quant à l'étymologie, si elle n'explique pas tout, ( elle est peu considérée par certains ), elle donne cependant des éclaircissements sur l'axe diachronique : les mots latins ambiguitas (atis, f) : ambiguïté, équivoque, ambiguum (i, n ): le doute, l'incertitude, etc., et la racine indo-européenne ambh- : de chaque côté qui donna en grec ̉ αμφίς : des deux côtés, autour de, à part, loin de, et αμφί : autour, tout autour, etc. nous donnent un champ sémantique qui va de l'équivoque, de l'incertain, du doute, à l'hésitation, à la polysémie, au plurivoque, à ce qui peut avoir un double sens, à ce qui est mal déterminé, à l'amphibologie, aux ambages, ou à ce qui semble signifier des qualités contraires. La phrase d'HERACLITE citée en exergue est un bel exemple d'ambiguïté car elle oblige à se poser la question, comme le souligne Marcel CONCHE[2], " de savoir dans quelle intention le philosophe écrit ce texte. Faut-il comprendre qu'il entend comparer son propre discours à la parole ambiguë du dieu ? Les dieux, détenteurs de la vérité, ne semblent pas vouloir la révéler, et se contentent d'en donner des signes…La vérité serait-elle dangereuse pour leur statut de dieu malgré la mort qui nous sépare d'eux ? La philosophie naquit-elle de l'ambiguïté comme l'ennui de l'uniformité…?
"N'existe que pour être levée", pourrait définir l'ambiguïté à la manière du "dictionnaire des idées reçues" de FLAUBERT, à moins qu'il n'eût préféré "Intolérable pour le charbonnier". Quant à l'étymologie, si elle n'explique pas tout, ( elle est peu considérée par certains ), elle donne cependant des éclaircissements sur l'axe diachronique : les mots latins ambiguitas (atis, f) : ambiguïté, équivoque, ambiguum (i, n ): le doute, l'incertitude, etc., et la racine indo-européenne ambh- : de chaque côté qui donna en grec ̉ αμφίς : des deux côtés, autour de, à part, loin de, et αμφί : autour, tout autour, etc. nous donnent un champ sémantique qui va de l'équivoque, de l'incertain, du doute, à l'hésitation, à la polysémie, au plurivoque, à ce qui peut avoir un double sens, à ce qui est mal déterminé, à l'amphibologie, aux ambages, ou à ce qui semble signifier des qualités contraires. La phrase d'HERACLITE citée en exergue est un bel exemple d'ambiguïté car elle oblige à se poser la question, comme le souligne Marcel CONCHE[2], " de savoir dans quelle intention le philosophe écrit ce texte. Faut-il comprendre qu'il entend comparer son propre discours à la parole ambiguë du dieu ? Les dieux, détenteurs de la vérité, ne semblent pas vouloir la révéler, et se contentent d'en donner des signes…La vérité serait-elle dangereuse pour leur statut de dieu malgré la mort qui nous sépare d'eux ? La philosophie naquit-elle de l'ambiguïté comme l'ennui de l'uniformité…?






 Your new post is loading...
Your new post is loading...