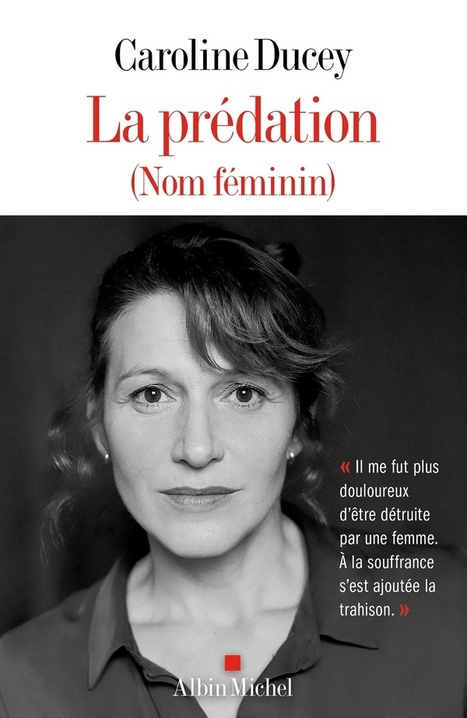Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 20, 6:46 AM
|
Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale du Monde), publié le 19 juillet 2025 `` Dans une soirée qui fera date, le metteur en scène suisse a transposé sur scène, vendredi 18 juillet, les quatre mois d’un procès hors norme, avec une rigueur sans faille et en évitant tout sensationnalisme.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/19/au-festival-d-avignon-le-theatre-du-reel-au-plus-haut-avec-le-proces-pelicot-par-milo-rau_6622196_3246.html
En apnée pendant quatre heures. Rarement on aura vu au théâtre une telle concentration, un tel unisson entre les acteurs et le public, un tel sentiment de l’essentiel. Transposer sur scène le procès Pelicot exigeait d’être à la hauteur d’un moment judiciaire historique. C’est peu de dire que ce fut le cas, vendredi 18 juillet, à Avignon, lors de cette soirée unique proposée par le metteur en scène suisse Milo Rau : historique, ce Procès Pelicot le sera aussi pour l’art théâtral, et restera dans les annales comme exemplaire de ce que peut être un théâtre du réel. Comment faire entrer en quatre heures de représentation un processus judiciaire qui s’est déroulé pendant près de quatre mois, du 2 septembre au 19 décembre 2024, et a profondément ébranlé la société française, et bien au-delà ? Comment éviter toute spectacularisation, tout sensationnalisme ? Milo Rau et sa dramaturge, Servane Dècle, répondent par une rigueur sans faille, et une confiance absolue dans les pouvoirs du théâtre, lequel a partie liée avec la justice depuis ses origines grecques. A quelques encablures à peine du tribunal d’Avignon, où s’est tenu le procès, le Cloître des Carmes, haut lieu du festival, s’est offert comme un écrin parfait pour rejouer les grands moments du procès, et toute la pensée suscitée par cet insondable que sont les événements advenus dans un village tranquille du sud de la France pendant dix ans. Nul besoin de décor ici, tout va se jouer dans la parole. Sur le plateau nu, deux rangées de bancs en bois à cour et à jardin, comme dans une salle d’audience, sur lesquels sont assis les comédiens, vêtus de couleurs sombres. Au milieu, une petite table derrière laquelle se tiennent deux autres actrices, faisant office aussi bien de narratrices que de présidente et vice-présidente du tribunal. Dissonance insupportable Marie-Christine Barrault s’avance vers le micro posé à l’avant-scène pour évoquer d’abord le cadre de l’histoire, ce village de Mazan (Vaucluse) planté au pied du mont Ventoux chanté par Pétrarque, qui abrita aussi, chose moins connue, l’un des châteaux du marquis de Sade, cruelle ironie. Puis la focale se resserre sur la maison des sévices, cette maison en laquelle Gisèle Pelicot croyait avoir trouvé le havre protégeant son bonheur conjugal, jusqu’à ce jour de novembre 2020, où sa vie a basculé dans l’inimaginable. Une maison dont Caroline Darian, la fille du couple, dit, par la voix de l’actrice Julie Moulier, l’horreur qu’elle lui inspire dorénavant, la dissonance insupportable entre le souvenir des moments joyeux et les actes commis par son père. A partir de là se met en place le puzzle savamment composé par Milo Rau et Servane Dècle, qui va mêler des moments saillants du procès avec des prises de parole extérieures qui l’ont accompagné tout du long, pour penser aussi bien la culture du viol et le patriarcat que la figure du monstre, la banalité du mal ou la question du punitivisme. Pour réunir toute cette matière, le metteur en scène et la dramaturge ont travaillé directement avec des journalistes, qui ont livré leurs notes, avec certains des avocats, des chercheurs, des membres d’associations féministes ou des habitants d’Avignon ayant assisté au procès. Ce travail documentaire, d’un sérieux irréprochable, a permis de reconstituer aussi bien les interrogatoires de Dominique Pelicot et de ses coaccusés que les deux grands discours de Gisèle Pelicot, au début et à la fin du procès, les plaidoiries des avocats, les expertises des psychiatres. Sans compter la description des vidéos des séances de viol tournées et archivées par Dominique Pelicot et qui, diffusées lors des audiences à la demande de Gisèle Pelicot elle-même, ont été au cœur du procès. Saisissant tableau La représentation s’offre donc comme un processus qui se calque sur celui de la justice, dans la tentative de comprendre ce qui s’est passé dans cette chambre, et ce que cela raconte de notre civilisation et de ses soubassements. Ce processus est tenu de bout en bout grâce aux acteurs et au travail mené sur le jeu : il ne s’agit pas de simples lectures, mais bien d’incarner avec force une parole ou une pensée, plus que des personnages. Plusieurs sommets sont atteints, avec Ariane Ascaride, portant le premier discours de Gisèle Pelicot. Avec Elios Noël, en expert analysant avec complexité le rôle de la pornographie. Avec Philippe Torreton, qui humanise de manière troublante Dominique Pelicot. Avec Clara Hédouin, défendant avec flamme les théories antipunitivisme du philosophe Geoffroy de Lagasnerie. Ou avec Camille Etienne, dans la plaidoirie magnifique d’Antoine Camus, l’un des deux avocats de Gisèle Pelicot. L’ensemble tel qu’il se présente ainsi, concentré, ramassé sur une seule soirée, brosse un saisissant tableau de cette culture du viol, avec cette interrogation en ligne de fuite : qu’est-ce qui a mené certains hommes dans la chambre de Mazan, tandis que d’autres, sollicités par le « metteur en scène » Dominique Pelicot, s’y sont refusés ? « Le pourquoi n’est pas à chercher dans un dénominateur commun », analyse Antoine Camus. On ne sort pas forcément du Procès Pelicot avec des réponses. Mais avec une méthode et une énergie de pensée et d’action, ô combien. Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : « Le Procès Pelicot », mis en scène par Milo Rau, au Festival d’Avignon, le 18 juillet 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 7, 12:28 PM
|
L’ex-acteur de la Comédie-Française, déjà jugé coupable pour des faits similaires envers une ancienne compagne, a été condamné, ce vendredi 6 juin, à neuf mois de prison avec sursis. Le parquet a dû recadrer les débats et rappeler la réalité des violences faites aux femmes. On repart au moins avec la certitude que Nâzim Boudjenah, 52 ans, a finalement été licencié de la Comédie-Française, fin février. L’ex-acteur de théâtre était jugé ce vendredi 6 juin par la 28e chambre du tribunal correctionnel de Paris, pour des menaces de morts proférées sur X dans la nuit du 18 juillet 2024. Ces cibles : l’élue parisienne Alice Coffin – absente et non représentée – et la députée écologiste Sandrine Rousseau. Soit les «porte-parole» d’un «discours qui fait qu’entre deux partis, un homme et une femme, l’homme n’a aucune chance», selon le mis en cause, dont l’attitude à la barre a fortement irrité la présidente et la représentante du ministère public, Valentine Géraud. Jusqu’à pousser cette dernière à requérir une peine «beaucoup plus lourde» que ce qu’elle avait prévu, soit six mois de prison ferme, 300 euros d’amende, un stage de deux jours de sensibilisation contre la haine en ligne et une interdiction d’entrer en contact avec les victimes. «J’ai été extrêmement choquée» Lors de cette audience, courte parce qu’il y a beaucoup d’affaires à juger ce vendredi – de quoi empêcher Nâzim Boudjenah de se lancer dans une tirade théâtrale que personne ne souhaitait vraiment entendre –, il a beaucoup été question de contexte. Celui-ci est plutôt simple. Le 18 juillet 2024, l’acteur, en chute libre après une première condamnation pour menaces de mort envers son ancienne conjointe Marie Coquille-Chambel, venue en soutien de l’élue écolo, a «tout perdu». Il est sans domicile fixe, ne travaille plus. Ce soir-là, «sous la pluie», il «craque». De nombreux messages insultants, menaçants – personne n’a le nombre précis – jaillissent sur son compte X. Lui se remémore mal du moment. Etait-il bourré ? Pour son avocate, Me Florence Bourg, l’histoire est simple. Cinq ans sans travail, plusieurs procédures judiciaires – Boudjenah est accusé de viol par Marie Coquille-Chambel –, des manifestations devant la Comédie-Française, des «tournées de la plaignante sur des plateaux de télévision». Pendant cinq ans, elle lui a dit : «Non, Nâzim. Non. On ne répond pas.» Mais à un moment ça pète, et «c’est le feu d’artifice». Lui s’est excusé, plusieurs fois. Sur X, devant les enquêteurs. Il a croisé, «par hasard», Sandrine Rousseau non loin de l’Assemblée nationale. Naturellement, il s’est présenté à elle. «C’est moi qui vous menace de mort !» Là aussi, il s’excuse. Mais la rencontre reste traumatique pour l’élue écologiste, pourtant habituée du cyberharcèlement et des menaces en tous genres. «J’ai été extrêmement choquée. Il m’arrive rarement de croiser les personnes qui me cyberharcèlent ou me menacent de mort. Ça m’est arrivé une fois au restaurant [avec un autre homme], j’étais avec ma fille et ça ne s’est pas bien passé. Il m’a dit que c’étaient juste des messages parmi tant d’autres, que j’en recevais tellement. A quel moment on minimise encore une fois la violence des propos ?» «Il va falloir essayer de canaliser votre colère» Sandrine Rousseau s’est portée partie civile, mais ne demande qu’un euro symbolique, «pour qu’il comprenne». Cependant, au milieu d’une salle d’audience acquise à la femme politique féministe, ce n’est pas l’impression que donne Nâzim Boudjenah. D’apparence d’abord, celui qui ne reviendra «jamais» sur scène paraît marqué. Crâne rasé, polo gris clair, pantalon noir, il semble ne pas en mener large et baisse la tête au moment de l’énoncé des faits. Il reconnaît tout, s’excuse encore. Puis, petit à petit, il reprend confiance, se redresse, et c’est la colère qui apparaît. Sur son corps – les pieds qui tapent le sol, les mains serrées, parfois derrière la nuque – et dans le discours aussi. «Quelqu’un est intervenu dans un travail que j’ai patiemment construit pendant trente ans, elle a tout détruit.» Ce quelqu’un, c’est Marie Coquille-Chambel. La désormais actrice est vue par le prévenu comme la cause de tous ses problèmes. «Ce ne sont pas Mme Coquille-Chambel et Mme Rousseau qui vous ont mis à la rue, si ?» fait remarquer la présidente du tribunal. Boudjenah botte en touche. «Monsieur, il va falloir essayer de canaliser votre colère. Je ressens votre colère, peut-être est-elle légitime, ou pas. Mais dans la vie, on a toujours des personnes qui n’ont pas le même avis que nous et qui, parfois, ont raison. D’autres fois non. C’est pas pour autant qu’on se pourrit tous les uns les autres. Sinon, c’est une société qui part en cacahuète.» «Vous donnez l’impression que vous allez repasser à l’acte» La procureure, elle, est moins patiente face à un mis en cause qui penserait, selon elle, «que l’homme n’a plus aucune chance depuis le début du mouvement #MeToo». «C’est mon métier au quotidien, de superviser des enquêtes, d’être aux audiences. Contrairement à ce que vous pensez, les femmes et les enfants sont particulièrement en danger face aux menaces des hommes. Que ce soit dans la rue, dans le cadre de l’intimité ou dans le cyberespace.» Elle se dit exaspérée par la rengaine «pauvre de nous les hommes» ; «ces folles de féministes», elle cite des chiffres de l’Insee : «85 % violences physiques sont commises par des hommes, 97 % des violences sexuelles sont commises par des hommes.» La magistrate finit par lancer : «Si vous voulez venir à toutes les audiences au lieu de participer à ce “ouin-ouin” général…» Après une pause due à un problème informatique, Nâzim Boudjenah est finalement condamné à neuf mois de prison avec sursis, 300 euros d’amende, un stage de sensibilisation contre la haine en ligne, un euro symbolique à verser à Sandrine Rousseau et une interdiction d’entrer en contact avec les victimes. «Dans la rue, vous voyez Mme Rousseau, Mme Coffin, vous changez de trottoir. Pas de message, pas de tweet, pas de pigeon voyageur», précise la présidente du tribunal. «A la première lecture du dossier, je me suis dit que vous étiez un troll, expliquait plus tôt la procureure de la République. Vous reconnaissez immédiatement les faits, vous aviez un positionnement modéré dans la procédure.» Puis, au vu de l’attitude «inquiétante» du prévenu à la barre, ainsi que sa «fragilité psychologique», une crainte persiste chez elle : «Vous donnez l’impression que vous allez repasser à l’acte.» Légende photo : L'acteur Nâzim Boudjenah, à la Comédie-Française, en septembre 2019. (Agathe Poupeney /Divergence)
Par Radidja Cieslak et Sonya Faure dans Libération - 30 avril 2025 Le directeur délégué du Festival n’occupera plus ses fonctions à partir du mois de juin, selon une information donnée par «Télérama» confirmée à «Libération». Le ministère de la Culture a saisi le procureur de la République alors que deux anciennes salariées l’accusent de violences et harcèlements sexistes et sexuels. Agitation à la veille de la grand-messe du théâtre. Le départ de Pierre Gendronneau, directeur délégué du Festival d’Avignon depuis février 2023, a été annoncé pour début juin selon les informations de Télérama, confirmées par la direction du festival à Libération. Très peu de temps, donc, avant l’ouverture de l’édition 2025, le 5 juillet. Ce retrait intervient dans un contexte de tensions autour de faits supposés de violences et harcèlements sexistes et sexuels qui se seraient déroulés au Festival d’Avignon, mais aussi au Festival d’automne, il y a plusieurs années, lorsque Pierre Gendronneau, 35 ans aujourd’hui, y occupait là encore les fonctions de directeur délégué. Le nom de Pierre Gendronneau a été signalé au ministère de la Culture par deux femmes, salariées au moment des faits par le «in» d’Avignon pour l’une et par le Festival d’automne pour l’autre, pour des problématiques relatives aux violences sexistes et sexuelles (VSS), comme le rapporte Télérama. Conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, le ministère en a informé le procureur de la République qui décidera des suites judiciaires à donner à ces accusations – dont on ne connaît pas la teneur exacte, les deux femmes tenant à ne pas rendre public leur témoignage. Une première enquête avec un cabinet indépendant Le directeur du Festival, Tiago Rodrigues, assure ne pas avoir eu connaissance des faits présumés avant ces signalements. «La direction du Festival en a été informée le 6 novembre 2024 par le ministre de la Culture dans le cadre de la procédure de l’article 40, explique-t-il à Libération. Le festival a décidé dans les deux jours qui ont suivi d’embaucher un cabinet indépendant [Egaé, dirigé par Caroline de Haas et spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles], qui a enquêté de novembre à décembre. Celui-ci a effectivement remonté des cas d’accusations visant Pierre Gendronneau», poursuit-il. «Rassurés de savoir que la justice avait connaissance de faits sur lesquels elle allait prendre la décision de poursuivre ou non des investigations, nous avions de notre côté à envisager les suites possibles en tant qu’employeur», dit encore Tiago Rodrigues. Qui s’entoure alors de plusieurs avocats et juristes du droit du travail. «Ceux-ci ont estimé que les cas remontés ne relevaient pas de faits de harcèlement ou de violences sexuels», assure-t-il, permettant à Pierre Gendronneau de rester à son poste jusqu’à aujourd’hui. Néanmoins, «le climat de suspicion et les rumeurs persistantes ne lui ont pas permis de remplir pleinement ses fonctions», souligne Tiago Rodrigues. «C‘est pourquoi d’un commun accord avec la direction, son départ a été annoncé ce mercredi. Il sera effectif début juin». Pierre Gendronneau ne pourra être remplacé qu’à partir de l’automne, lors du prochain conseil d’administration du festival. Le 13 janvier 2024, l’administratrice du Festival d’Avignon, Eve Lombart, avait été entendue par la commission d’enquête relative aux violences commises dans la culture dirigée par la députée écologiste Sandrine Rousseau. Elle rapportait avoir reçu 9 signalements de VSS en 2024, 11 en 2023. Aucun ne concernait Pierre Gendronneau, selon Tiago Rodrigues. Qui assure que chacun de ces signalements a provoqué une enquête interne, et parfois des sanctions disciplinaires. Comme de plus en plus de structures, le Festival s’est également doté d’une cellule d’écoute et de référents chargés d’accompagner et d’orienter les personnes victimes de violences sexuelles. Légende photo : Pierre Gendronneau, directeur délégué du Festival d'Avignon, à Avignon 1er août 2023. (Angelique Surel/Le Dauphine. MAXPPP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 5:20 PM
|
Fruit de six mois de travaux et de quasi 120 heures d’auditions, le rapport de la commission d’enquête parlementaire rendu ce mercredi dresse le tableau d’un secteur «surexposé» au risque de violences et propose des solutions. C’est une actrice anonymisée qui confie : «On m’a convaincue que c’est parce que je souffre qu’un réalisateur est heureux.» Une autre à qui un réalisateur a demandé «de [s]‘insérer un œuf dans le vagin en [lui] laissant entendre que, si [elle était] une vraie actrice, [elle serait] capable de le faire». Ou Anna Mouglalis, décrivant cette intensité recherchée chez les actrices y compris dans les silences, qu’elle appelle «vulnérabilité charismatique» et qui s’avère «particulièrement sensible chez les survivantes – d’inceste, de viol». 85 auditions et tables rondes, 118 heures d’échanges avec 350 professionnels, 87 recommandations au total. En 279 pages, le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les violences dans le milieu culturel dresse un diagnostic accablant pour les secteurs artistiques, tirant l’un après l’autre les fils d’une omerta tenace. Mise en place après les accusations de l’actrice Judith Godrèche contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, cette commission a ensuite été élargie aux secteurs «de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité». Révélations terribles et inouïes sur le métier Tuée dans l’œuf lors de la dissolution le 9 juin, après un mois de travaux, elle avait été remise sur pied début octobre, sous la présidence de la députée Sandrine Rousseau (Les Ecologistes), avec le rapporteur Erwan Balanant (Modem). Ses conclusions seront remises mercredi 9 avril. Un exercice inédit et historique pour dépasser l’accumulation de témoignages individuels, aller au-delà de ce «#MeToo en pointillés» décrit par la députée, où chaque récit de violences sexuelles en chasse un autre, sans permettre un recul suffisant sur des «violences systémiques». «C’est au nom de l’art et de la création que les aspirants artistes sont prêts à tout sacrifier ; c’est aussi au nom de l’art et de la création que d’autres commettent les plus terribles violences», résume Sandrine Rousseau dans son avant-propos. Techniques d’apprentissage maltraitantes, travail autour du corps, très forte hiérarchisation de ces milieux marqués par la précarité d’un grand nombre de professionnels, usage banalisé d’alcool et de stupéfiants, négation de la relation de travail, peur des représailles dans un milieu où le réseau est primordial… Tous ces paramètres accentuent le risque de subir des violences. L’émotion non dissimulée des députés, parfois les larmes, ont marqué les cinq mois d’auditions. Entre autres professions (dont certaines rarement représentées, tels les scénaristes ou critiques), les actrices y ont livré les récits les plus médiatisés, révélations terribles et inouïes sur leur métier. Sara Forestier, racontant avoir dû refuser d’enlever sa culotte lors de son premier casting à 13 ans ou s’être entendu dire à 15 par un régisseur de l’Esquive : «J’ai envie de te faire l’amour dans les fesses». Anna Mouglalis, évoquant les baffes improvisées par un acteur sur elle en tournant une scène d’agression sexuelle ou encore ce plan volé sur son sexe lors d’un autre tournage, conservé au montage du film et sa bande-annonce contre son consentement. Eprouvants, les extraits de ces témoignages scandent le rapport où bien d’autres disciplines, comme le spectacle vivant, ont voix au chapitre. Témoignant de son expérience au Théâtre du Soleil, la comédienne Agathe Pujol déclenchait un séisme dans l’institution d’Ariane Mnouchkine, en plus d’un signalement au procureur de la République. Protection de l’enfance Certaines recommandations cliveront. D’autres étonnent surtout parce qu’on ne soupçonnait pas l’existence du vide qu’elles viennent combler. Au centre : la protection de l’enfance, motivation initiale de la création de la commission. Avec une attention particulière aux castings, apparus comme les lieux de tous les débordements, négligés par l’inspection du travail. Professionnalisation des personnes amenées à encadrer les enfants, recours aux psychologues obligatoire, renforcement de la présence des représentants légaux… La commission souhaite aussi rendre obligatoires les coordinateurs d’intimité pour les scènes impliquant les mineurs, et interdire leur «sexualisation à l’écran et dans les photos de mode, par exemple en les montrant en sous-vêtements». Le rapport recommande aussi d’encadrer impérativement les scènes d’intimité entre adultes avec clauses de contrat et médiation d’un coordinateur spécialisé, ce qui pourrait braquer le milieu encore réfractaire à cette idée. Les parlementaires vont plus loin et préconisent un droit de regard aux comédiens sur le montage final, sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée, pour «s’assurer que leur image n’est pas utilisée de manière abusive». De quoi potentiellement bousculer l’intouchable «final cut» du cinéaste. S’attaquant à la phobie des préjudices financiers liés à des dénonciations de violences sexuelles, la commission veut rendre obligatoire la couverture assurantielle des risques VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels). L’invitation à réfléchir sur «la prescription glissante» des violences sexuelles à l’encontre des majeurs promet de relancer un débat houleux. Aide juridictionnelle sans condition de ressources pour accompagner les victimes lors du dépôt de plainte ou conditionnement des aides publiques à une exemplarité sur la parité et la diversité complètent la liste des préconisations. Confrontation de mondes professionnels Parce qu’en grande partie filmées et retranscrites en direct, quand le huis clos n’était pas réclamé, les quelques centaines d’auditions auront souvent fait l’effet d’étranges moments de télévision. Uniques, pour la teneur des sujets abordés, la nouveauté de l’adresse au législateur. Mais aussi pour la confrontation de mondes professionnels, parlementaires d’un côté et institutionnels de la culture de l’autre (la Cinémathèque française, Serge Toubiana), parfois même de critiques de cinéma (Télérama, les Cahiers du Cinéma), où personne ne semblait parler la même langue ni tout à fait de la même chose, les arguments hésitant entre l’esthétique et la morale, certitudes et approximations, débat sur le culte de l’auteur et coquettes citations de Jacques Rivette ou François Truffaut. Lorsqu’à des victimes de violences succédaient des personnes identifiées comme parties prenantes d’un système qui les autorise, le ton a pu évoquer celui d’un conseil de discipline, laissant couver la défiance voire le clash. Auditionnée en pleine polémique liée aux conditions de projection du Dernier Tango à Paris, la direction de la Cinémathèque ne bronchait pas lorsque Sandrine Rousseau déclarait en conclusion : «La résistance dont vous êtes l’un des piliers ne tiendra pas très longtemps parce que la société est bien en avance sur vous.» A l’inverse, pour avoir fulminé à l’adresse de la présidente de la commission – «Arrêtez de faire la morale à tout le monde. Ça commence à bien faire. Si c’est mon procès, je me taille !» –, l’agent Dominique Besnehard, créateur de la série Dix pour cent, aura marqué les esprits. Non sans avoir rappelé son soutien à Gérard Depardieu, revendiquant son appartenance à «l’ancien monde» et imputé les agressions d’Harvey Weinstein au comportement des actrices – «On ne va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine.» A l’issue des travaux de la commission, trois signalements pour parjure ont été réalisés, visant l’ancien président de la Cinémathèque Serge Toubiana, entendu au sujet des accusations contre Benoît Jacquot, le directeur délégué de NRJ, Gaël Sanquer, et l’équipe de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Si la plupart des mécanismes ne sont pas spécifique au milieu culturel, «certaines singularités en font vraisemblablement des secteurs surexposés au risque de violences», insiste la commission en appelant de ses vœux à la mise en place d’une étude de victimation de vaste ampleur.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 2, 2:07 PM
|
Propos recueillis par par Anne Diatkine / Libération - 2 avril 2025 Dans «Respect», qui paraît jeudi 3 avril, l’actrice revient sur les violences sexuelles qu’elle a subies depuis l'enfance, les abus psychologiques dont elle accuse son ex-compagnon Bertrand Blier, et l’omerta qui a entouré ses souffrances.
Respect, peut-on lire sur la couverture du récit d’Anouk Grinberg, sur une photo par Sarah Moon en noir et blanc, où elle pose bras serrés. Respect pour celle qui entreprend de relater non pas la totalité de sa vie, mais une part sombre, et s’oblige à soulever la gangue d’une série d’agressions sexuelles ou crimes afin de décrire leurs répercussions. Autant que faire se peut, Anouk Grinberg évite le registre plaintif sans rien éluder, par la grâce de ses formulations acérées. Cela débute à la campagne dans les années 60 et 70, dans une famille fortunée et intellectuelle. Anouk est la dernière de la fratrie de quatre enfants livrés à eux-mêmes sous couvert de liberté. Leur mère, gravement dépressive, enchaîne les hospitalisations d’où elle revient dans un état toujours pire. Son père, l’homme de théâtre Michel Vinaver, PDG le jour, écrivain la nuit, manque entre autres de temps. Sous le «cagnard de solitude», des prédateurs rodent. L’entretien a lieu un mardi après-midi chez Julliard, la maison qui publie Respect ce jeudi 3 avril. L’inquiétude n’empêche ni le calme, ni la générosité, ni la précision chez Anouk Grinberg. Dans Respect, vous décrivez une impressionnante mainmise sur le corps des femmes. Il y a la stérilisation forcée de votre mère endormie sans qu’elle ait été mise au courant, les neuroleptiques qu’on vous oblige à prendre lorsque vous refusez de tourner dans Mon homme de Bertrand Blier, le réalisateur avec qui vous avez vécu et qui est décédé en janvier. Avez-vous eu ultérieurement la possibilité d’en discuter avec les personnes qui disposaient de ces corps féminins ? C’est ma mère qui m’a parlé de cette stérilisation forcée juste après ma naissance. Ces messieurs ont cru bien faire. Lorsque c’est arrivé, elle était déjà fragile, avec quatre enfants tout petits. Mais cette prise de son corps a provoqué chez elle une très grave dépression, un chaos, qui a duré quarante, cinquante ans. Une dépression très mal soignée – probablement qu’être l’épouse du PDG de la région n’a rien arrangé. La maladie mentale s’est accompagnée de honte, elle était salissante. On n’en parlait pas, il y avait l’idée qu’elle était contagieuse, qu’on pouvait l’attraper. Elle n’avait plus aucune lumière, plus aucune dignité, plus aucune pulsion maternelle. En ce qui concerne les neuroleptiques que Bertrand Blier m’a obligée à prendre pendant six ans, bien sûr que je n’en ai pas parlé avec lui puisqu’il était celui qui me terrorisait et me menaçait. Quand j’ai trouvé les forces pour m’arracher à cette vie, je ne l’ai plus jamais revu. Comment vous a-t-il imposé la prise de ces médicaments ? Pour comprendre ma soumission, on ne peut pas faire l’économie de ce que ma mère avait déclenché chez moi comme terreur de la folie. J’ai été noyée dans son désespoir. Toute mon enfance, je l’ai vue être embarquée par des infirmiers et revenir encore plus démolie qu’avant. Donc Blier, qui me disait que j’étais folle comme ma mère, qu’il faudrait que je me fasse interner ou que j’avais du pus dans la tête, qu’on allait me retirer mes droits sur notre enfant, venait frapper quelque chose de très blessé et vulnérable chez moi. La possibilité que ma fragilité puisse rejaillir sur mon enfant, l’abîmer comme j’avais été moi-même abîmée m’était intolérable. Pourtant, je savais très bien que je n’étais pas folle. Il y a une feuille de cigarette qui sépare la folie de la vitalité. C’est bien pratique pour les prédateurs de faire passer pour folle une femme qui veut se redresser. Il y a aussi eu un médecin pour accepter de vous prescrire des neuroleptiques. C’était un psychiatre de stars. Un homme avec un cabinet somptueux. Il ne m’a pas posé de questions ou très peu. Il parlait à Blier et répondait à son désir de me neutraliser. C’est d’ailleurs à lui qu’il envoyait les ordonnances. Je n’avais pas de délire, mais il fallait briser ma volonté. Si ce n’est que pour Blier, c’était du délire que de ne pas vouloir jouer dans son film. A sa demande, le médecin a transformé une femme en poupée. Je devais être opérationnelle pour divertir en me laissant humilier. Vous êtes violée à 7 ans par un homme que vous considérez comme votre père d’adoption. Vous révélez immédiatement ce qui vient de se passer, mais vous n’êtes pas entendue. Il y a une absence de réaction totale des adultes. Mon père était le seul adulte à qui je pouvais parler avec mes mots à moi, déjà imbibés de honte. Mais quand je l’ai appelé au secours, il n’a pas compris. Il devait être requis par ses affaires, ses problèmes. Il m’a ramenée chez le violeur, qui était le beau-père de ma meilleure amie. Et il s’est mis à bavarder avec lui avant de me laisser dans cette famille. L’homme n’a pas récidivé. J’étais devenue très peureuse en sa présence. Je ne m’approchais plus de lui. Jusqu’alors, il était en effet un père de substitution. J’ai passé des mois dans cette famille, pendant des années. Les parents connaissaient mon histoire familiale, ils savaient qu’elle était difficile, mais au lieu de prendre soin de moi, de me respecter, l’homme a commis cet acte. C’était tellement violent que je n’ai pas pu m’opposer. Pas un son n’est sorti de moi, mon corps, mon âme, tout était mort, je ne pouvais plus bouger, ce qui lui a peut-être fait croire que j’y trouvais mon compte. Pourtant je ne peux pas supposer qu’un homme imagine qu’une enfant de 7 ans trouve son compte dans un viol digital qui dure au moins une heure, le temps du film qu’on regardait à la télé, allongées sur le ventre, mon amie et moi. Ça a duré, ça l’amusait, il faisait ça pendant que le film se déroulait, et comme je n’ai pas bougé d’un millimètre et que j’étais comme torpillée dans un trou noir, personne n’est venu… Il n’y avait aucun recours ni de la part de ma copine qui était sur le lit, qui regardait la télévision et qui n’a pas vu, ni évidemment de cet homme qui était un tueur. C’était un banquier. J’aimais beaucoup ce monsieur. J’étais gentille, câline, comme un chaton peut être câlin. Mais je n’ai jamais demandé de sexe. Toute une génération d’hommes a pu se persuader que les enfants étaient très sexualisés. Ils le disaient pour se laisser aller à leur pulsion de prédation. Je veux croire que ces hommes ne savent pas le mal qu’ils font lorsqu’ils agissent ainsi. Mais je me souviens très bien du sentiment de mourir, et de celui d’avoir compris que les hommes étaient tueurs avec leur sexe. Ce que je ne savais pas, c’est combien longue serait la mort qu’il avait distillée en moi. Ce mal fait pouvait durer une vie entière… Avez-vous toujours eu ce viol en mémoire ? Tout le temps. Mais j’écrasais ce souvenir au fond de moi, pour paraître la femme la plus libérée de la Terre, pour surtout ne pas avoir l’air d’être une victime. Et je me mettais sur le marché des femmes sexuelles avec un semblant de joie. Tant que je trichais avec les hommes, en tout cas, tant que je ne disais pas mon histoire, la douleur restait dans l’arrière-fond. Ce qui est bizarre quand on a été tué mais qu’on n’est pas mort, qu’on continue de vivre, c’est que cette mort ne se voit pas et elle se voit d’autant moins qu’on passe son temps à la cacher parce qu’on a honte. Honte d’être devenue une infirme. Honte d’avoir peur du sexe alors que toute la société nous dit «youpi youpi, crie, c’est comme ça que tu seras une femme». On a honte de ces blessures et de ce qu’elles empêchent. C’est le mouvement #MeToo, la parole des femmes, les témoignages parus dans Libé, Mediapart, les livres publiés récemment, qui m’ont fait sortir de ces années de solitude où je croyais être coupable, être une femme pas normale. Vous parlez effectivement le plus précisément possible de ce qu’il advient de la possibilité d’une vie sexuelle après… J’ai hésité avant d’écrire, parce que c’est très intime. Un être violé (enfant, femme, homme) le paie toute sa vie dans sa sexualité. Ça peut passer par une terreur quand le soir arrive même si on est avec celui qu’on aime. Le sexe devient le passage obligé pour avoir accès à l’amour dont on a tant besoin. Et puis il y a les flashs. J’ai mis des années avant de comprendre que les images envahissantes et terribles qui venaient hanter mon esprit étaient liées aux traumatismes. Si je suis couchée avec mon amoureux, il me faut beaucoup de sang-froid et de concentration pour ne pas me sentir une petite fille avec des petites jambes, des petits bras. J’ai toujours un couteau dans la main, et je voudrais tuer. Il faut beaucoup de douceur et de tendresse de la part de l’homme que j’aime et accepter de ne rien faire pendant un temps, pour laisser le corps à côté de lui se reposer des terreurs qu’il a emmagasinées. Et ce rien-faire est un amour immense, bouleversant. Ce qui est étonnant, c’est que mon compagnon qui, donc, parce qu’il m’aime, a dû beaucoup réfléchir au féminisme et à la vie des femmes, me dit qu’il est plus heureux qu’avant… Lui aussi prend sa place dans ce mouvement mondial. Il y a un condensé d’événements terribles qui vous arrivent pendant l’enfance. Vous évoquez un épisode incestueux avec votre frère quand vous avez une douzaine d’années. Là aussi, vous comprenez ce qui se passe. Je ne nomme pas, mais je comprends que mon grand frère ne devrait jamais faire ce qu’il est en train de faire. Il n’était pas du tout un garçon méchant, mais il l’a fait. Je me souviens d’avoir été tétanisée que mon grand frère chéri, qui était censé me protéger, agisse ainsi. C’était comme si je montais une marche supplémentaire dans l’omniprésence du sexe. Comme si dès l’enfance, on me disait : «Le sexe sera partout, tout le temps, tu ne pourras jamais y échapper.» Quand on vous tord enfant, il faut beaucoup d’efforts pour se détordre. Ce que produit l’inceste, quand de plus il se passe avec quelqu’un en qui on a très confiance, c’est qu’à jamais, le sexe et la trahison sont liés. C’est d’ailleurs à cet âge que vous voulez devenir religieuse. C’est vrai, absolument. Je pensais que l’église était le seul endroit où je pourrais me soustraire du regard et de la queue des hommes. On a vu que ce n’est pas exact. La traque a commencé enfant, elle s’est poursuivie durant toute l’adolescence puis après. Je ne sais pas ce qu’il y a dans la tête des hommes, j’aimerais tellement qu’ils parlent et qu’ils prennent leur place dans ce grand mouvement. Tout de suite après l’inceste, le silence l’a entouré. Mon frère n’a rien dit, je n’ai rien dit, mon père, qui nous a surpris, n’a rien dit. Ou n’a pas vu ce qu’il avait vu. Quand des décennies plus tard, j’ai voulu parler pour me délivrer de ce passé, l’expérience de l’omerta au sein de la famille a été parmi la plus violente de ce que j’ai eu à vivre. Il n’y a pas eu d’écoute possible ? Aucune. Pas une seule question ne m’a été posée. Mon père, qui est le seul avec qui j’ai un peu parlé de cet «abus» m’a dit : «Il y a plusieurs vérités.» Pour mes sœurs, mon frère, je suis devenue celle qui détruisait le clan. Dans cette famille où l’on s’aimait, le crime d’inceste a fabriqué de l’inhumanité. Ce n’est pas seulement le jour où ça se passe que c’est terrible. Durant toute la vie, on devient la personne à faire taire, à mettre en exil à cause d’une vérité qui ne doit pas être entendue et qu’on fait passer pour de la folie. On ne m’a pas traitée de folle mais on m’a traitée en folle. C’est aussi en raison de l’omerta que j’ai voulu percer les secrets de famille, parce qu’en les respectant, on sacrifie des personnes. Je ne pouvais pas m’en sortir avec toutes ces agressions et cette silenciation à l’intérieur de la famille. Ce silence est comme un tombeau dans lequel on vous met alors que vous êtes vivante. Je n’étais pas agressive avec mon frère lorsque j’ai essayé de parler, pas du tout. Je voulais juste lui dire : «Tu te souviens que ça s’est passé et que ça se décline encore aujourd’hui sous d’autres formes quand tu me considères comme ta chose ?» Il était dans un tel déni que prononcer le mot inceste voulait dire enfreindre une loi majeure. L’autre violence, c’est qu’à votre naissance, vos parents demandent à votre frère et vos sœurs d’exprimer leur haine et jalousie à l’égard de ce nouveau-né en vous choisissant un deuxième prénom, le plus moche pour eux. C’est comme un tatouage. Un rejet de ma personne inscrit dans l’état civil. Je vivais de façon un peu aveugle le mépris de ma fratrie, tout en courant derrière leur amour. Je savais qu’on m’avait appelée Elizabeth, mais j’ignorais que c’était par détestation. Ils ne voulaient pas que je naisse, ma mère non plus ne voulait pas, elle a raté son avortement. Et quand je suis née, ils ont retrouvé une mère malade. Ils ont perdu leur mère quand je suis arrivée, mais je n’y suis pour rien. Préadolescente, adolescente, une porte de sortie apparaît, vous commencez à jouer au théâtre avec des metteurs en scène aussi importants que Jacques Lassalle ou Alain Françon. Il se trouve que j’avais une telle rage de ne pas ressembler à ma mère, de ne pas être victime, de ne pas être brisée devant tout le monde, que j’ai eu la chance incroyable qu’on me réquisitionne pour faire du théâtre. J’avais l’obligation de briller même si j’étais démolie. L’obligation quelques heures par jour, quelques mois par an d’être dans le dépassement de ma propre histoire. Etre un moulin qui transforme le blé en farine et en pain. Je trouve un lieu où me dédoubler, je rencontre des gens pour qui je ne suis pas une criminelle mais une petite poète et ça, je n’en reviens pas. Je découvre des textes, et avec eux, en repartant à zéro, le b.a.-ba des sentiments et la faculté de les nommer, d’humaniser ce qui n’est plus. Je faisais tout ce que je pouvais pour être dans une forme de lumière. C’est aussi cette lumière que les hommes ont voulu capter. Cette increvable joie de vivre qui vient de derrière les fagots réveille des sadismes. Et avant le sadisme, des sentiments un peu paternalistes. Vous donnez le sentiment de vous être rapprochée de votre père, Michel Vinaver, en travaillant avec lui. Oui, en faisant du théâtre, on a partagé un espace poétique. On a souvent travaillé ensemble et même quand on ne travaillait pas ensemble véritablement, il me le faisait lire ce qu’il écrivait, et avant de jouer, j’aimais beaucoup faire des séances de travail avec lui. Qu’il ne m’ait pas protégée n’a pas noirci notre relation. Je cherchais et j’ai eu accès à une exceptionnelle relation intellectuelle débarrassée de toute menace. Mon père a été dépassé entre ma mère malade, les quatre enfants qui partaient en sucette, son métier de PDG, son métier d’écrivain, et quelque chose constitutif de sa personne, où il n’était pas en prise avec la réalité. Il le disait : «C’est à cause et grâce à ça que j’ai pu écrire.» C’était mon père et il a failli. Avec votre mère, vous réussissez à vous rencontrer bien que très tardivement… On a eu de grandes discussions les deux dernières années de sa vie. Je suis allée la voir en vacances. J’ai compris qu’il n’aurait jamais fallu que je sois son enfant. J’ai compris sur le tard la femme brisée qu’elle avait été par une société patriarcale, bourgeoise. Ses enfants en ont fait les frais, mais c’est elle, en premier lieu, qui a été détruite. Vous vous êtes retrouvées malgré tout. Ça engage à l’optimisme… Ce qui m’a renouée à elle de manière très forte, c’est quand j’ai passé trois ans à constituer une anthologie de textes d’art brut. Elle était au cœur de ce travail même si je n’en avais pas conscience. C’est en écrivant la préface que je l’ai compris. Malheureusement, elle n’a pas eu l’énergie créative que les artistes d’art brut ont eue pour se sauver. A sa mort, j’étais tellement étonnée. On a découvert beaucoup de gens merveilleux qui l’entouraient, des gens extraordinaires pour qui elle était quelqu’un d’extraordinaire. On l’avait mise dans le coin de la folie et on n’a pas soupçonné la richesse de sa vie affective. Qu’est-ce qui a suscité le besoin d’écrire ? Quand les femmes ont commencé à parler, j’ai eu l’impression qu’un peu partout, sur le globe, des flammes s’allumaient. Pour moi, ça a été déterminant. Ça m’a réveillée de mon anesthésie et de mon indifférence aux femmes. Je ne dis pas que ma vie se rouvrait comme un accordéon, mais en tout cas, il y avait une lueur nouvelle. La première fois que j’ai pris la parole, c’était pour défendre Charlotte Arnould. J’étais en soutien de quelqu’un qui était vraiment malmené, pas seulement par Depardieu, mais par la société qui la traînait dans la boue. Je savais très bien que ma main tendue s’adossait aux expériences que j’avais connues. Ce qui a été déterminant, c’est que j’ai été malade, malade à côtoyer la mort. Et cet événement a eu un effet tout à fait surprenant sur moi. Alors que je me soumettais à des soins très invasifs, je n’ai jamais été autant en vie. Et être en vie était synonyme de faire la clarté. Ce n’était plus négociable, je ne pouvais pas faire tout ce qu’on me demandait pour guérir et supporter encore l’injustice, les cruautés, vivre dans le noir. Mon propre déni n’était plus possible. Pas seulement sur le viol enfant, l’inceste, les années avec Blier, mais aussi les autres agressions sexuelles. Il fallait que je comprenne ma vie. Tous les gens autour de moi me disaient : «Anouk, tu dois lutter contre gros, vraiment gros. Garde toutes tes forces pour lutter contre le cancer.» Ils n’avaient pas compris que je me guérissais en cherchant enfin la vérité. Quand on a passé des années étouffée par les autres ou s’étouffant soi-même pour ne pas faire de vagues, pour ne blesser personne, il faut de la patience pour désencombrer son cœur de tout ce qui vous jette dans la mort. Cette année de maladie a aussi été l’année de l’écriture. Il fallait beaucoup d’heures pour éplucher le souvenir et faire des liens entre tous ces événements depuis la toute petite enfance jusqu’à aujourd’hui. Mais ce travail était celui de me remettre en vie. Quand on est attaqué par une puissance mortelle, on n’a pas d’autre choix que de se respecter. A devenir maternelle avec Charlotte Arnould, je le suis devenue pour moi-même. Et pas seulement pour l’enfant, mais la femme qui pendant les années Blier a tout confondu : le besoin d’affection, la prédation, la soumission, qui est devenu l’objet des fantasmes les plus dégradants. Tout ça, il fallait que je comprenne. Ça fait partie du soin. Propos recueillis par Anne Diatkine / Libération Légende photo : «Mon père, qui est le seul avec qui j’ai un peu parlé de cet “abus” m’a dit : “Il y a plusieurs vérités.” Pour mes sœurs, mon frère, je suis devenue celle qui détruisait le clan.» (Jérôme Bonnet/ Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 9:53 AM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama - 26 mars 2025 La comédienne Agathe Pujol, qui porte par ailleurs plainte pour viol contre Philippe Caubère, a déclaré lundi avoir subi “une pression sexuelle constante”, voire “une sexualité imposée” au sein de la troupe. Une réunion de crise s’est tenue à la Cartoucherie.
Lire l'article sur le site de Télérama :
https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/accusations-de-metoo-au-theatre-du-soleil-ariane-mnouchkine-traverse-ce-qui-pouvait-arriver-de-pire-7024949.php
Coup de tonnerre, lundi 24 mars, au Théâtre du Soleil. Bouleversement et sidération après que la comédienne Agathe Pujol a déclaré devant la Commission de l’Assemblée nationale sur les violences dans les secteurs artistiques (présidée par Sandrine Rousseau) avoir appris ce que sont « les manipulations constantes, le masochisme […] les addictions diverses [et] la sexualité imposée » dans la troupe d’Ariane Mnouchkine. Laquelle fut juste prévenue par l’AFP de ces déclarations avant publication de sa dépêche. Elle n’était au courant de rien. Lycéenne en option théâtre à Paris, passionnée par les créations du Soleil, Agathe Pujol affirme y être entrée en 2010 comme bénévole au service restauration, où elle a officié près de deux ans, et dans l’espoir de monter sur les planches. Mais l’expérience se serait vite transformée « en film pornographique ». Réunion de cinq heures filmée Après pareils propos, Ariane Mnouchkine convoque dès le lendemain la troupe pour une longue réunion d’information de quelque cinq heures, se refusant à tout commentaire avant cette prise de parole commune. La metteuse en scène, qui vient de fêter son 86ᵉ anniversaire, et l’année passée le 60ᵉ anniversaire de sa troupe, avoue au téléphone traverser « ce qui pouvait arriver de pire ». Et aller mal, très mal, tout en voulant maintenir le cap, c’est-à-dire chercher résolument la vérité sur ce qui s’est passé à la Cartoucherie et en ayant soin de ne pas impacter la comédienne Agathe Pujol, dont on sait par ailleurs qu’elle a porté plainte pour viol, agression sexuelle et corruption contre le comédien Philippe Caubère, grand ancien du Soleil, avec lequel elle a été liée de 2010 à 2022, selon Libération. Efforts de mémoire et de vérité. En fait, lors de la longue réunion (filmée) de la troupe, ce mardi 25 mars dans l’après-midi, très peu se souvenaient d’Agathe Pujol. Et n’imaginaient pas qu’elle ait pu rester aussi longtemps parmi eux ces années-là – la compagnie partant en effet dans de longues tournées. Quelques-uns se souvenaient juste d’une improvisation qu’elle aurait faite au cours d’un stage – à l’issue duquel, elle n’a d’ailleurs pas été embauchée. Improvisation autour du… viol. À la grande surprise de tous, et surtout d’Ariane Mnouchkine, qui aurait plusieurs fois interrompu la jeune comédienne en lui demandant si elle avait la force de continuer, si tout allait bien… Elle avait continué. Et Ariane d’expliquer collectivement le soir même aux stagiaires que pareille impro pouvait permettre d’affronter l’horreur, que le théâtre permettait ça de montrer le monstre en chacun, le mal… Ivresse et oubli Chacun a pu librement s’exprimer cet après-midi-là, raconter ses souvenirs de cette nuit du 31 décembre 2010, où Agathe Pujol aurait été victime de la tentative de viol d’un comédien devant beaucoup de témoins. Mais le réveillon avait été fort arrosé et les comédiens totalement ivres ne se rappelaient pas… Difficile de se rappeler. Difficile peut-être d’envisager que « les hommes qui travaillaient au Soleil […] faisaient peser sur nous [elle et d’autres jeunes femmes bénévoles, ndlr] une pression sexuelle constante, que nous ne comprenions pas ou mal », comme l’a dit la victime présumée. Les bénévoles, comme elle l’était, n’osaient sans doute pas aller raconter les harcèlements qu’elles pouvaient endurer à l’impressionnante patronne des lieux. Pourtant, on sait qu’Ariane Mnouchkine ne transige jamais sur ce genre d’affaires. Ni sur toute autre affaire qui contredit son féminisme militant et son sens aigu des valeurs républicaines et laïques. N’a-t-elle pas, encore récemment, giflé un comédien afghan après des gestes incorrects auprès d’une membre de la troupe ? Faits et interprétations Aujourd’hui, Ariane Mnouchkine « veut faire la distinction parmi ces terribles accusations, entre ce qui peut être factuel et donc possiblement vrai, et ce qui peut être de l’ordre de l’interprétation ». Elle cherche. Les temps, aussi, ont tellement changé où, dans la foulée des permissives années 1968, flamboyait le jeune collectif du Soleil. Certains se souviennent encore qu’on y prenait des douches collectives. Les mœurs ont heureusement évolué, et les relations entre les hommes et les femmes ont gagné en respect, même si elles peuvent toujours mieux faire. Devant la soixantaine de personnes présentes à la réunion d’information, Ariane Mnouchkine aurait même déclaré, selon des témoins, qu’elle avait envie de tout arrêter puisqu’elle n’avait pas été capable de voir les dangers qu’encouraient les comédiennes… Heureusement les anciens de la troupe sont intervenus. Et le public, lui, continue de venir en foule au spectacle. Mais le coup est rude pour celle qui est toujours prête à se battre pour rendre justice. Elle avait ainsi prévu de partir début avril en Ukraine. L’enquête et le travail qu’elle veut mener au Soleil l’en empêcheront. Fabienne Pascaud / Télérama Légende photo : Ariane Mnouchkine est metteuse en scène et directrice de la compagnie du Théâtre du Soleil. Photo Patrick Swirc pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 4, 11:53 AM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 25, 6:04 PM
|
Par Marie-Eve Lacasse dans Libération, publié le 23 janvier 2025 Hélène Soulié et Marie Dilasser donnent au personnage de Perrault les alliées et les armes nécessaires pour combattre de l’intérieur le monstre du foyer. Jubilatoire. Il ne reste rien ou presque du conte de Perrault dans ce Peau d’âne réduit à son sujet, son seul sujet, son terrible sujet. Sous la plume de Marie Dilasser, la metteuse en scène Hélène Soulié confie à six comédiennes et comédiens le soin d’incarner l’essentiel de la trame narrative avant d’en subvertir la fin. Dans un décor noir, blanc et rouge, une famille parfaite se présente aux spectateurs : une petite fille qui sourit trop, une mère toute dévouée et un père absorbé par un manuscrit qui raconte l’histoire d’un «roi porc». «Un roi porc ?» demande la mère, légèrement inquiète, la mine dégoûtée. Le père, galvanisé par ce qu’il vient de lire, se met à quatre pattes, grogne comme un cochon, effraie la fille qui ne veut pas jouer à ce drôle de jeu. Plutôt que de protéger son enfant, la mère quitte la maison, laissant sa fille subir ce «père porc» qui veut «faire un jeu de sieste» avec elle, mais seulement après qu’elle a pris son bain. Et même si c’est «rien que pour jouer», l’enfant, appelée Mon Cœur, n’a pas le droit de parler de ce qu’ils fabriquent tous les deux, dans le secret de la chambre conjugale. «Patriarcalite aiguë» La magie de ce Peau d’âne repose dans l’intelligence de l’écriture, où Marie Dilasser donne à la petite fille d’autres armes que la seule fuite sous une peau d’animal mort. Dans cette version, l’âne est un bourricot magique qui prend vie, se métamorphose en un «Francis» qui se genre au féminin, s’habille avec un microshort, des collants à résille et des sabots (on ne peut que remercier Drag Race d’avoir insufflé autant de joie, de faux cils et de lycra fluo aux productions culturelles des dernières années). Pour se sortir du joug paternel, Mon Cœur se confie à sa voisine adorée, une fermière aimante qui l’envoie chez le médecin. Et c’est là où la libération opère, quand cette femme lui diagnostique un mal grave à l’origine de bien des pathologies : la «patriarcalite aiguë». L’enfant n’y est pour rien, la rassure-t-elle, son père a agi ainsi car il profite d’un système qui le protège, tout comme l’auteur du livre sur le roi porc. La petite s’inquiète : «Mon papa ira-t-il en prison ?» «Je l’espère bien !» répond la femme, qui affirme qu’elle reçoit «beaucoup, beaucoup d’enfants» comme elle dans son cabinet. Monstre familier A partir du moment où les personnages fantaisistes entraînent Mon Cœur loin de sa maison hantée par ce monstre familier, la petite fille revit. Elle se répare, rit et fait «disparaître les monstres qui grimpent en [elle].» Ce sont des personnages queers, pris eux-mêmes dans les sables mouvants de l’identité (changeant perpétuellement de noms, de genres et de costumes au fil de la pièce, non sans humour), qui viennent en aide à l’enfant, et pas ses parents bien campés dans leurs statuts rigides (père éditeur, tout de blanc vêtu, tout comme la mère au foyer, drapée dans une forme de pureté). La pièce donne ainsi des outils bien pratiques aux parents et aux professeurs qui souhaiteront aborder avec tact le sujet de l’inceste avec un jeune public. Et c’est d’autant plus heureux qu’à la fin, Mon Cœur gagne : le sous-titre de la pièce, plus joyeux qu’il n’en a l’air («La fête est finie») sonne le glas de l’impunité – car quand la justice se fait, l’enfance peut se faire. Peau d’âne, la fête est finie, jusqu’au samedi 25 janvier à la MC93 de Bobigny. A partir de 10 ans. Légende photo : Sous la plume de Marie Dilasser, la metteuse en scène Hélène Soulié confie à six comédiennes et comédiens le soin d’incarner l’essentiel de la trame narrative avant d’en subvertir la fin. (Marc Ginot)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 12, 4:14 PM
|
Par Gwenaël Badets Publié par le quotidien Sud-Ouest le 10/01/2025
Une douzaine de collectifs et associations reprochent au comédien et humoriste, qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu, d’avoir été accusé de viol et d’évoquer l’affaire dans son spectacle.
« Nous ne voulons plus que la culture serve de marchepied aux violeurs, aux agresseurs. » Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 10 janvier, Les Collages féministes Bordeaux demandent l’annulation du spectacle d’Ary Abittan, « Authentique », programmé le samedi 25 janvier à 20 h 30 au casino Barrière. « Sans déprogrammation, nous donnons rendez-vous à toustes [sic] devant le Théâtre du casino Barrière le 25 janvier à 19 heures pour faire entendre la voix des victimes de violences sexuelles », prévient ce texte, signé par une douzaine de collectifs (1). Ceux-ci reprochent à l’humoriste et comédien (notamment connu pour « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ») sa mise en cause dans une affaire de viol. En octobre 2021, une jeune femme de 23 ans, qui fréquentait le quinquagénaire depuis deux mois, avait porté plainte contre lui, affirmant qu’il lui avait imposé un rapport anal, expertises médicales à l’appui. Ary Abittan avait été mis en examen. Puis, en 2023, placé sous le statut de simple témoin assisté. Une décision que les deux juges d’instruction chargés du dossier motivaient par l’absence « d’indices graves ou concordants ». Tout en reconnaissant le stress post-traumatique « indiscutable » de la plaignante. En avril dernier, l’artiste avait finalement bénéficié d’un non-lieu. Non-lieu et appel Le non-lieu est l’abandon d’une action judiciaire en cours de procédure. Les Collages féministes Bordeaux en concluent qu’« Ary Abittan n’est donc pas innocenté à l’issue de cette affaire ». Juridiquement, ce raisonnement est inexact : certes, la victime a interjeté appel et d’éventuelles reprises des poursuites sont toujours imaginables. Mais au regard de la loi, le comédien a toujours été innocent : la présomption d’innocence s’applique à tout mis en cause jusqu’au moment où il fait l’objet d’une condamnation définitive. « Sans déprogrammation, nous donnons rendez-vous à toustes devant le casino Barrière le 25 janvier à 19 heures » Mais les signataires ne se satisfont pas de cet arrêt des poursuites. « La justice ne consentirait-elle à traiter les faits que lorsqu’ils sont filmés, à l’image du procès contre Dominique Pélicot ? », s’interrogent les Collages féministes. Ils rappellent « qu’en 2013, Ary Abittan a embrassé de force [l’ex-Miss France, NDLR] Laury Thilleman. Cette fois-ci, la scène avait été filmée » – référence à une séquence de l’émission « Les Enfants de la télé », exhumée par les réseaux sociaux lors de l’enquête visant Ary Abittan. « L’indécence poussée à son comble » Les militants précisent ce qui les indigne particulièrement dans son cas : « Ary Abittan pousse l’indécence à son comble en utilisant cette affaire pour faire rire. En la tournant au ridicule dans son spectacle, il capitalise sur les traumatismes infligés à ses victimes, tout cela avec le soutien de plusieurs salles de spectacle à travers la France. Dont le Théâtre du casino Barrière de Bordeaux. » L’établissement n’a pas souhaité réagir à nos sollicitations. (1) Collages Féministes Bordeaux ; Assonances ; CLAP 33 ; FSE fédération syndicale étudiante ; La Foudre prend racine ; Mauves ; MEUF ; AG Montaigne ; Nous Toutes 33 ; NPA l’Anticapitaliste ; OPA Orchestre Poétique d’Avant-guerre ; Sexprimons Nous ; ULCNT-F 33

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 2, 4:46 PM
|
Enquête Libé, par Cassandre Leray - le 2 janvier 2025 Il était son idole. En 2010, Agathe Pujol a 17 ans, elle est en terminale dans un lycée parisien. Un jour de septembre, elle poste une lettre longue de plusieurs pages à l’adresse du comédien Philippe Caubère pour lui témoigner son «admiration». «J’ai lu vos livres, vos conversations, vos interviews, j’ai appris sur le théâtre plus que jamais auparavant», lui confie l’adolescente. Elle rêve d’être actrice, mais connaît très peu ce monde et ses coutumes. Elle demande : «En 1968, vous aviez mon âge, mais aviez-vous mes doutes, mes incertitudes, mes angoisses ?» A sa grande surprise, l’acteur lui répond. Philippe Caubère a alors 60 ans, il a déjà été récompensé de deux Molières, dont celui de la «révélation théâtrale masculine» en 1987. Il est une figure du théâtre du Soleil, mené par Ariane Mnouchkine. Il arpente les scènes françaises pour y interpréter des textes retraçant sa vie. Il propose une rencontre à sa très jeune admiratrice. Avertissement : Cet article relate des violences sexuelles, notamment sur des mineures, et peut choquer. Rendez-vous est pris le 6 octobre 2010. L’adolescente se rend à l’appartement du comédien, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), où il lui parle de son art avant de l’inviter à son spectacle le soir même. Cinq jours plus tard, le 11 octobre, elle retourne chez lui, «rassurée» après leur premier rendez-vous : elle voit en lui un potentiel «mentor» à qui demander conseil. Ce soir-là, après lui avoir «servi des verres de vodka glacée et discuté de théâtre pendant des heures», Caubère «m’embrasse sur son canapé avant de toucher ma poitrine», décrit Agathe Pujol. Quelques jours plus tard, elle le revoit. Il la «pénètre avec ses doigts et [lui] fait un cunnilingus», alors qu’elle est encore mineure : «C’était la première fois que quelqu’un m’embrassait ou me touchait.» S’ensuivent plus de dix ans «d’horreur». Agathe Pujol accuse Philippe Caubère de l’avoir violée et agressée sexuellement de manière répétée entre 2010 et 2022, de ses 17 à ses 29 ans. Mais aussi de l’avoir «fait violer» pendant des années par des hommes recrutés sur des sites de petites annonces. «Libération» a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte Quand Agathe Pujol coupe les ponts avec l’acteur en 2022, elle se jure de ne plus jamais parler de tout cela. Mais la police judiciaire de Créteil débarque chez ses parents le 22 juin 2023. Une plainte pour «atteinte sexuelle» sur mineure a été déposée quelques mois plus tôt contre l’artiste par une comédienne, Pauline Darcel, et Agathe pourrait être une témoin clé. Aux enquêteurs, elle retrace douze années «d’emprise» et «l’ascendance» que Caubère avait sur elle, mais aussi sur «d’autres jeunes filles naïves et vulnérables» qui «le voyaient comme un demi-dieu, car il se présentait comme tel». Après plusieurs mois de réflexion, elle dépose plainte en octobre 2023. En février 2024, Philippe Caubère, 74 ans aujourd’hui, a été mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur ainsi qu’agression sexuelle sur une personne majeure, dans le cadre de trois affaires, pour des faits qui se seraient déroulés entre 2010 et 2022. Contacté, le parquet de Créteil précise que l’acteur a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs, interdiction d’entrer en relation avec les victimes et obligation de soins. Libération a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte contre l’acteur. Parmi elles, Flora (1), une étudiante de 21 ans qui souhaite rester anonyme. Mais aussi deux comédiennes, qui s’expriment pour la première fois à visage découvert : Agathe Pujol, 31 ans, et Pauline Darcel, 29 ans. Contactées lundi 16 décembre par Libération, les avocates de Philippe Caubère, Me Julia Minkowski et Me Eléonore Heftler-Louiche, ont jugé «inenvisageable» de répondre à nos questions, alors que leur client, présumé innocent, n’a «toujours pas été entendu au fond par le juge d’instruction». Elles précisent toutefois que celui-ci «réfute» avoir «imposé le moindre acte sexuel» à Pauline Darcel, et «qu’il réfute avec autant de force avoir imposé des relations sexuelles à celle qui a été sa compagne pendant dix ans», Agathe Pujol, «par quelque moyen que ce soit». Le scénario de 2010 décrit par Agathe Pujol fait écho à celui de novembre 2011 que dépeint Pauline Darcel. Alors lycéenne en classe de première, celle-ci rencontre l’acteur – dont elle est «fan» – sur le tournage du film l’Harmonie familiale, où elle est figurante. Comme avec Agathe Pujol et Flora, il lui demande de regarder les DVD des pièces et films dans lesquels il joue, et lui offre un exemplaire de son livre Carnets d’un jeune homme, publié en 1999, dans lequel il décrit notamment sa sexualité ou encore le fait qu’il s’est masturbé sur des «photos de victimes nues des camps de concentration», des propos choquants pourtant passés inaperçus à la sortie de l’ouvrage. La première étape de ce que Pauline Darcel nomme la «caubérisation». A la même époque dans un cours de théâtre à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), elle croise la route de Théo Arnulf, un ami d’Agathe Pujol, devenu depuis éclairagiste. Quand Pauline lui raconte qu’elle a décroché un rendez-vous avec Caubère, il s’inquiète : «Agathe m’avait raconté ce qui lui était arrivé, alors j’ai tenté de la dissuader d’y aller», explique-t-il à Libération. Mais Pauline Darcel fait confiance à Caubère. Elle l’a tout de suite vu comme «un père spirituel du théâtre qui [le lui] raconterait et [le lui] expliquerait», écrit-elle dans un SMS du 29 février 2012 envoyé à l’acteur. Entre décembre 2011 et mars 2012, il l’«invite au théâtre et chez lui à deux occasions pour parler de sa carrière, sans que rien ne se passe». Lorsqu’elle le retrouve une nouvelle fois dans son appartement à Saint-Mandé le 1er avril 2012, elle croit là encore à un rendez-vous professionnel. Mais en pleine discussion, il «[l’]embrasse en [lui] saisissant la nuque par surprise», «puis il [l’]emmène dans sa chambre». Elle ne se souvient plus de ce qui s’est passé ensuite, souffrant d’une «amnésie traumatique». Elle a 16 ans, lui 61 ans. «Matzneff dit la vérité» Les récits d’Agathe Pujol et Pauline Darcel se superposent. Pendant plusieurs mois, en 2012, toutes les deux voient régulièrement Philippe Caubère sans jamais se croiser. Parfois, l’une arrive alors que l’autre vient de partir. Il leur réclame «l’épilation du pubis». Un retrait intégral des poils qui provoque à Agathe Pujol des «cystites à répétition», laquelle raconte qu’il finance l’esthéticienne quand elle ne peut pas payer. Il ne supporte pas non plus de porter un préservatif : «Il disait qu’il lui était impossible de “baiser avec un sac-poubelle sur la bite”», rapporte Agathe Pujol. Quand les deux adolescentes refusent qu’il les pénètre avec son pénis, il leur impose d’autres pratiques, rapportent-elles. Comme la fellation, dans une position qu’elles décrivent à l’identique : lui debout face à un miroir, elles à genoux. Elles l’accusent également chacune d’avoir tenté de les pénétrer par surprise. Agathe Pujol raconte qu’il «hurle» que la «frustration est trop grande» et lui «impose des sodomies» en attendant de pouvoir «la déflorer». Pauline Darcel rapporte des reproches sur une relation qui serait «platonique» car elle n’accepte «que» la fellation et la masturbation. Pour l’anniversaire des 17 ans de Pauline Darcel, Caubère prévoit une «surprise» : il la «pénètre avec un godemiché», se souvient-elle. Agathe Pujol raconte qu’il fait de même avec elle quelques semaines plus tard. Cette fois, c’est un cadeau de félicitations : elle a obtenu le baccalauréat. Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici Au-delà des souvenirs, Philippe Caubère laisse derrière lui plusieurs centaines de mails et de SMS que Libération a pu consulter. L’homme était «omniprésent» dans leurs vies. A Agathe Pujol, il écrit «Matzneff [écrivain visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, ndlr] dit la vérité : c’est merveilleux à 15 ans» ou encore : «Je te trouvais trop bonne. Même ta maigreur de déportée me faisait – mentalement – bander.» A Pauline Darcel, il dit aimer «quand tu m’embrasses avec tant de passion et de grâce à la fois, tant de fureur et d’érotisme enfantin». Des viols «organisés plusieurs fois par semaine» A l’été 2012, Pauline Darcel, 17 ans, ne «supporte plus ce que lui impose Philippe Caubère» et cesse de le voir. Elle perd du poids, fait des crises d’angoisse, se brosse les dents jusqu’à faire saigner ses gencives pour «effacer les traces de son sexe dans ma bouche». Son meilleur ami, Morgan Janoir, auteur de théâtre, 29 ans aujourd’hui, a toujours suspecté quelque chose de grave quand elle lui racontait, plus jeune, qu’elle «voyait» le comédien. Six ans plus tard, en 2018, il prévient Pauline Darcel qu’une comédienne, Solveig Halloin, a déposé plainte pour viol contre Caubère. La jeune femme s’effondre, et lui raconte «tout ce qu’elle a vécu». Pauline Darcel repense à Agathe Pujol. Elles ne se sont jamais vues mais Philippe Caubère aime raconter à l’une ce qu’il fait avec l’autre en les nommant, comme il le ferait avec d’autres jeunes femmes, selon les témoignages concordants des deux plaignantes. Il instaure entre elles un «climat de concurrence, notamment sexuel», expose Pauline Darcel. Après avoir déposé plainte le 28 octobre 2022, elle glisse donc le nom d’Agathe aux policiers. Ce que Pauline Darcel ne sait pas, c’est que l’histoire d’Agathe Pujol a duré plus d’une décennie. A ses 18 ans, Philippe Caubère la «viole avec son pénis dans le vagin pour la première fois», retrace Agathe Pujol. Le comédien l’aide ensuite à préparer les concours d’entrée dans les écoles d’art dramatique. Il le lui promet : elle est «vouée à un grand avenir», se rappelle-t-elle. A condition qu’elle soit plus «libérée». L’acteur poste alors «des messages sur les sites de petites annonces Wannonce et Vivastreet avec des photos de moi dénudée», relate-t-elle, pour «l’offrir» à des inconnus. «Elle souhaite que je la présente à un homme bien monté et circoncis (obligatoirement) pour exhib hard et humiliation symbolique, suivie d’une fellation nature, complète ou pas […]», rédige-t-il dans un mail qu’il lui transfère le 30 mai 2011. Seul critère, précise Agathe Pujol : que les «clients», à qui il demandait «une dizaine d’euros», «fassent des fautes d’orthographe». Une manière de s’assurer qu’ils ne sont pas issus du milieu de la culture, et qu’ils n’ont aucune chance de le reconnaître. Parfois, il la «donne à des amis de confiance». Ces «viols» sont «organisés plusieurs fois par semaine» par Caubère entre 2011 et 2018. En guise de décor, son appartement ou celui d’un «client», le bois de Vincennes ou encore sa résidence à La Fare-les-Oliviers, un village provençal. Agathe Pujol estime avoir été «violée par des centaines d’hommes». Souvent, Caubère «regarde et prend des photos». Une fois les hommes partis, «il me violait à son tour. Il avait des problèmes d’impuissance et disait que c’était la seule chose qui le faisait bander». Quand elle angoisse, «il [lui] fait prendre un comprimé d’Urbanyl», un anxiolytique. Des faits qu’elle a confiés à son ami Théo Arnulf dès 2011, ce qu’il confirme à Libération. Le 8 novembre 2011, ce dernier envoie un mail désespéré à Agathe Pujol : «Tu ne vaux pas ça, tu ne vaux pas 300 euros ou 100 millions […] Merde à la soumission, merde à la domination […] Merde à Philippe Caubère !» Philippe Caubère «contrôlait ma carrière, mes relations…» A l’époque, Agathe Pujol veut que tout «s’arrête». Mais, selon son récit, si elle s’oppose à Caubère, leur histoire est vouée à l’échec. Et il le lui a suffisamment dit : elle n’est rien sans lui. Elle vient d’un milieu modeste, n’a pas de contacts dans le théâtre et manque d’argent. L’acteur l’emploie comme assistante de production ou lui fait vendre ses livres, et la présente comme «sa petite amie» à des artistes pour lui trouver des rôles. «Il contrôlait ma carrière, mes relations…» se remémore Agathe Pujol. La «mainmise» de Philippe Caubère sur sa vie est «totale», dit-elle : en juin 2013, elle «tombe accidentellement enceinte de lui» et pense un temps garder l’enfant. «Mais il m’a dit que j’allais ruiner sa vie et m’a incendiée jusqu’à ce que j’avorte.» Dès les premiers mois de leur relation et de plus en plus souvent au fil du temps, Agathe Pujol pense au suicide. Elle perd du poids, jusqu’à ne peser que 46 kilos pour 1,72 mètre. En août 2022, son état de santé provoque un déclic : elle rompt avec Caubère et est hospitalisée en urgence pour «un épuisement dépressif» et des «idées suicidaires», selon le compte rendu médical. Depuis, elle n’a jamais cessé de prendre des antidépresseurs. «Si la police n’était pas venue me chercher, je n’aurais jamais osé parler.» Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici «La défense de Caubère sera de dire que si je suis restée douze ans, j’étais forcément consentante», pressent Agathe Pujol. Un «raccourci» qu’elle déconstruit : «J’étais une gamine quand je l’ai rencontré, je n’avais aucun libre arbitre.» Elle repense à l’adolescente «influençable et paumée» qu’elle était, celle «qui n’avait aucune confiance en elle, pas d’argent et pas de proches sur qui compter». Elle raconte les «maintes fois où [elle] a tenté de s’extirper de lui». Mais «il a fait de moi sa chose. Mes fragilités faisaient de moi la proie parfaite, et il le savait». Philippe Caubère n’a jamais caché ses «conquêtes» à son entourage, selon Agathe Pujol : il l’a présentée aussi bien à ses proches qu’à ses collègues. Tout comme il a convié Pauline Darcel à le rejoindre après ses spectacles. Chacune l’assure : «Tout le monde savait.» Une vision partagée par la troisième plaignante, Flora. En janvier 2024, lorsqu’elle lit dans la presse que Philippe Caubère est visé par une plainte, elle n’est «pas surprise». L’étudiante de 21 ans contacte alors la PJ de Créteil et est entendue le 23 janvier, sans penser entamer une démarche judiciaire. Mais à la suite de son récit, le parquet met en examen le comédien pour «corruption» de mineur – le fait d’imposer à un mineur des propos, des actes ou des images pouvant le pousser à adopter une attitude ou un comportement sexuel dégradant. Une décision qui motive Flora à porter plainte. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» Son récit commence en 2017. A 14 ans, Flora contacte Philippe Caubère pour son oral d’histoire de l’art du brevet des collèges. Elle a grandi dans une famille admiratrice du travail de l’acteur et prépare un exposé sur lui. Impensable : «Il me répond et m’invite au restaurant.» Quand il commence à «[l]’appeler “ma chérie” et «[lui] écrire nuit et jour», Flora se croit «chanceuse» : elle parle à «son artiste préféré». Deux ans plus tard, à l’été 2019, Véronique Coquet, l’épouse de Philippe Caubère qu’elle a déjà rencontrée lors de dîners, «m’invite chez eux dans le sud de la France pour un stage de tri des archives» de l’acteur, explique Flora. Qui plante le décor de ce séjour : le soir, elle «retrouve Caubère au bord de la piscine». Ils discutent de longues heures de «sa sexualité, du théâtre ou encore de sa petite amie Agathe». Les deux sont «si proches», se remémore Flora, que la fille de Caubère – 13 ans à leur rencontre – lui avoue des années plus tard avoir cru qu’elle était «la copine» de son père. A la fin des vacances, «il m’a envoyé une photo de son corps nu au bord de la piscine», détaille Flora. Une image que Libération a pu consulter. Elle accuse Caubère d’avoir continué à lui adresser «des messages à caractère sexuel» jusqu’en 2021. «[…] je serais trop fier. D’être accusé de pédophilie par un si beau bébé […]», peut-on lire dans un échange de juillet 2019. «Le simple fait d’être devant une élève d’école, avec son cahier d’écolière si bien tracé, faisait place à une autre sensation […] Tu me plaisais. […] Sauf que tu avais… 15 ans ? C’est ça ? Peut-être même pas ! 14 ?» lui écrit-il dans une lettre pour ses 18 ans, en juillet 2021. Philippe Caubère n’ira jamais plus loin. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» lors de cet été dans leur maison, suppose Flora. Contacté par Libération, Philippe Caubère explique, par l’entremise de ses avocates, qu’il «regrette» l’envoi de messages à l’adolescente et «présente ses excuses». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge» Selon nos informations, plusieurs personnes de l’entourage de Philippe Caubère ont été entendues par la police judiciaire de Créteil. Auditionnée le 7 février 2024, Véronique Coquet, avec qui l’acteur dit être en mariage libertin depuis 2005, a admis connaître Agathe Pujol. Mais assure avoir découvert son existence et leur liaison seulement quand elle avait 18 ans, sans que les 42 ans qui les séparent ne l’alertent. Auprès de Libération, Véronique Coquet écrit n’avoir «jamais eu connaissance de relations sexuelles de Philippe Caubère avec des mineures». Plusieurs collègues de l’acteur, eux aussi, rapportent avoir connu Agathe Pujol et la nature de leur relation. Pourtant, personne autour du comédien ne semble s’étonner de l’âge des jeunes filles croisées. Entendue par les enquêteurs le 14 février 2023, Ariane Mnouchkine, qui a lancé la carrière de l’acteur au théâtre du Soleil dans les années 70, assure alors que le comédien «n’est pas un prédateur», et qu’il n’a pas, à sa connaissance, «d’attirance» pour les mineures. Contactée par Libé, la metteuse en scène précise avoir découvert les accusations à l’encontre du comédien «dans la presse». «Philippe a quitté le Soleil en 1978, rappelle-t-elle. Nous sommes restés longtemps éloignés, et je n’ai donc pas suivi sa vie privée.» Les conclusions de l’experte décrivent un «désir de toute puissance» Au cours de son expertise psychologique en août 2024, dont Libération a pu prendre connaissance, Philippe Caubère a reconnu les «liaisons et rapports sexuels» avec «deux des plaignantes», sans préciser si elles étaient majeures ou mineures. Il explique qu’il a «eu des petites amies de tous les âges». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge qui a été multiplié par le jeu de la vie, je joue l’enfant, l’adolescent et l’adulte», dit-il encore, ajoutant avoir «du mal à différencier sexe, amour et création, en fait, c’est la même pulsion». Les conclusions de l’experte décrivent chez l’acteur un «désir de toute puissance», et un «goût du prestige» vis-à-vis de «sujets jeunes et inexpérimentés, susceptibles d’être placés dans un rapport de séduction et de subordination maître/élève». «Encore et toujours» le «prétexte de l’art», soupire Pauline Darcel. En octobre 2021, elle avait manifesté près du ministère de la Culture, à l’occasion du premier rassemblement du mouvement #MeTooThéâtre. Elle se souvient y avoir aperçu Solveig Halloin, la première femme à avoir accusé publiquement Caubère de viol. «Si sa plainte n’avait pas été classée sans suite» par le parquet de Créteil pour manque d’éléments en 2019, souffle Agathe Pujol, «nous aurions peut-être toutes osé parler plus tôt». (1) Le prénom a été modifié. Cassandre Leray / Libération
Légende photo : Agathe Pujol (31 ans) et Pauline Darcel (29 ans) accusent le comédien Philippe Caubère de plusieurs viols lorsqu'elles étaient mineures. (Cha Gonzalez/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 9, 2024 11:47 AM
|
Par Radidja Cieslak dans Libération le 9 déc. 2024 Sur le parvis du tribunal de Paris, des militantes féministes se sont rassemblées ce lundi 9 décembre pour témoigner de leur soutien à l’actrice, quelques heures avant le procès du réalisateur Christophe Ruggia, poursuivi pour agressions sexuelles sur mineure. Il fait un froid cinglant, mais qu’importe, une cinquantaine de femmes sont là, sur le parvis du tribunal de Paris, pour soutenir Adèle Haenel. Le procès du réalisateur Christophe Ruggia ouvre ce lundi 9 décembre, il est poursuivi pour agressions sexuelles sur mineure. L’actrice avait témoigné en 2019 dans les colonnes de Médiapart des violences sexuelles qu’elle aurait subies à 14 ans à peine, sur le tournage du film Les Diables. Le réalisateur, dans Mediapart, a contesté ces accusations, reconnaissant toutefois une «emprise» exercée sur la jeune fille durant le tournage. Le rassemblement, «organisé hors de toute organisation ou collectif» a été relayé par diverses associations féministes sur les réseaux sociaux, appelant à soutenir Adèle Haenel, pionnière de la vague #Metoo qui a bouleversé le cinéma français. «Je suis en pleine procédure judiciaire, pour viol» confie Sylvia, 67 ans, le regard vif sous d’épaisses lunettes, qui se reconnaît dans le récit de l’actrice de la Naissance des pieuvres. La militante tenait absolument à «être là pour elle [Adèle Haenel] et pour les autres». Quand elle évoque la justice, sa voix douce prend des accents amers. «La parole se libère mais il y a toujours un mur», soupire-t-elle, en déplorant l’inefficacité de la machine judiciaire. Une justice défaillante A ses côtés, Catherine, une camarade de lutte aussi victime de «viol et d’inceste», renchérit : «Les agresseurs nous massacrent, ensuite la police, et après la justice. Je comprends pourquoi des femmes n’osent pas porter plainte.» Membre de l’association Mouv’enfant, qui œuvre pour la protection des mineurs, la femme de 67 ans fustige le principe de la prescription, «un réel drame, pour toutes les victimes». Sans parler du «classement sans suite», qui concerne de nombreux cas de viol, et qu’elle qualifie de «dégueulasse». «Macron avait assuré mettre le sujet des violences sexuelles, les femmes et les enfants en priorité», s’exclame-t-elle, furieusement. Elle estime qu’en dépit de certaines mesures mises en place par le président comme le Grenelle contre les violences conjugales ou encore la création d’un bracelet anti-rapprochement, les hommes accusés de viols et d’inceste sont toujours insuffisamment inquiétés par la justice. La présence des femmes sur le parvis du tribunal est plutôt «symbolique», estime de son côté Alexia, 41 ans, qui affiche un air songeur. «Je n’attends rien de la justice», soupire-t-elle. «Le changement est en cours, mais n’a pas encore eu lieu», conclut-elle laconique. «Adèle, on te croit» «C’est tristement banal ce qu’a vécu Adèle», soupire Alicia, le regard vif, emmitouflée dans un manteau de laine. Venue seule au rassemblement, la militante de 34 ans salue le courage qu’a eu l’actrice de «visibiliser» cette cause et espère qu’elle gagnera ce procès. Les violences sexuelles, sujet alors «infiniment tabou il y a quelques années l’est de moins en moins» estime-t-elle. Dans la foule, des groupes se forment, des amies se retrouvent, s’étreignent avec enthousiasme, comme Catherine, 59 ans, venue avec sa «meuf», et des copines. «Il faut soutenir les personnes qui ont subi des violences, comme ce fut le cas pour Gisèle Pelicot dernièrement», martèle cette militante de la première heure. En plus de sortir dans la rue depuis des années, elle ne va «plus voir les films de tous ces mecs qui sont accusés», et ne lit «plus ceux qui disent des saloperies sur les femmes et les personnes homosexuelles». Parmi ses amies, il y a Nicole, 71 ans et co-présidente du centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui produit et diffuse des documents audiovisuels sur les droits et luttes des femmes. Familière du milieu du cinéma, cette retraitée toujours dehors pour militer constate un tournant. «Il y a eu des lois et des mesures prises, notamment par le CNC, mais également l’apparition de coordinateurs d’intimité sur les plateaux. Il y a également un mouvement citoyen», autant d’évolutions positives hors des institutions judiciaires. Dans la foule, plusieurs expriment une forte gratitude à l’égard de l’actrice, au travers de pancartes, de slogan ( «Adèle on te croit !»). «Adèle Haenel est à l’origine de ce renouveau féministe. C’est une belle vague, il faut que ça continue, merci à elle», sourit Anne-Claude, 62 ans. «Je la soutiens de tout mon cœur et de toutes mes tripes», renchérit Catherine. Il est 12 h 30, et subitement, les militantes disséminées sur la place s’assemblent en un bloc, et entonnent en chœur un chant pour témoigner, avec force, de leur solidarité. «Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère !» Radidja Cieslak / Libération Légende photo : Devant le tribunal correctionnel de Paris, des militantes féministes se sont rassemblées en soutien à Adèle Haenel avant l'ouverture du procès du réalisateur Christophe Ruggia, le lundi 9 décembre. (Cha Gonzalez/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2024 7:09 AM
|
Par Djaïd Yamak dans Le Monde - publié le 3 déc. 2024 Auditionnés au Palais-Bourbon, des organismes du cinéma, comme le Festival de Cannes et l’Académie des César, mais aussi du spectacle vivant ont exprimé leur volonté de lutter contre ce fléau, sans émettre d’idées neuves.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/12/03/face-aux-violences-sexuelles-l-examen-de-conscience-des-institutions-du-cinema-francais-a-l-assemblee-nationale_6427396_3246.html Leur parole était attendue. Le Festival de Cannes, l’Académie des César, le Festival du cinéma américain de Deauville, l’Académie des Molières et l’organisme UniFrance ont été entendus, lundi 2 décembre, au Palais-Bourbon, dans le cadre de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Réclamée par l’actrice Judith Godrèche, figure du mouvement #metoo en France, cette commission parlementaire a été créée en mai. Avec un objectif : faire la lumière sur les violences sexuelles et sexistes dans les métiers de la culture ; et faire émerger des propositions concrètes pour les combattre. Après trente-cinq heures d’audition et soixante-dix professionnels interrogés, la commission avait été enterrée par la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin. Un nouveau groupe de travail a finalement été constitué et les auditions ont repris, le 5 novembre. Devant les députés, le 2 décembre, les représentants de ces institutions détaillent les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes depuis l’émergence de #metoo, en 2017. La présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch, évoque la création d’une cellule d’écoute et la nomination de référents harcèlement au lendemain des révélations sur le producteur américain Harvey Weinstein. Patrick Sobelman, président de l’Académie des César, et Ariane Toscan du Plantier, vice-présidente, passent en revue les dispositifs mis en place durant la cérémonie, comme la « non-mise en lumière des personnes condamnées ou mises en examen » (effective depuis 2023) ou la distribution de flyers de sensibilisation. Mais, tous en conviennent, ces outils de prévention restent insuffisants pour lutter contre les violences dans le cinéma. La question de l’omerta est évoquée ouvertement. « Je suis convaincu qu’il reste une peur économique de témoigner, de perdre son emploi, de perdre ses moyens financiers, a observé Iris Knobloch. Il faut renforcer les cellules d’écoute et l’accompagnement des victimes. L’industrie a fait des pas importants, mais je crois que nous avons encore du chemin à faire. » « Multiplier les contre-pouvoirs » Après l’inventaire de leurs politiques de prévention respectives, le député (Paris, Ecologiste et social) Pouria Amirshahi déplace la discussion sur la responsabilité collective de ces institutions dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : « C’est dans le monde du cinéma qu’a commencé #metoo. Vous êtes le point de départ de cette révolution. Vous avez donné des exemples – les référents, les chartes –, autant de choses qu’il faut faire (…), mais, au fond, à quel moment la grande famille du cinéma a porté un grand message, uni, en disant : c’est terminé, ça ne se passera plus comme cela ? » La « grande famille du cinéma » que désigne le député ne se reconnaît pas derrière ce sobriquet. « C’est une fiction, un fantasme. La grande famille n’existe pas », tonne Jean-Marc Dumontet, interrogé au titre de président de l’Académie des Molières. « On ne se voit plus là-dedans », abonde Daniela Elstner, directrice générale d’UniFrance, un organisme chargé de la promotion et de l’exportation du cinéma français dans le monde. « Nous ne faisons pas partie du problème, nous sommes des éléments de réponse au problème », poursuit le producteur de spectacles. La présidente de la commission, la députée (Paris, Ecologiste et social) Sandrine Rousseau demande alors aux responsables de festivals et d’académies de se prêter à un exercice introspectif. « Vous avez un pouvoir énorme dans vos positions et vos mandats. Avez-vous conscience de votre pouvoir ? », demande l’élue. « Oui, on a du pouvoir sur nos équipes, sur les films qu’on sélectionne, reconnaît Aude Hesbert, directrice du Festival américain de Deauville. Nous avons un devoir d’exemplarité. Et nous devons multiplier les contre-pouvoirs. » Création d’une « base de données confidentielles » Comment user de ce pouvoir pour lutter contre les violences sexuelles ? Les dirigeants d’institutions ont partagé les décisions prises lors de la sélection d’une œuvre ou lors du déroulement d’une cérémonie. « Nous avons une responsabilité, et nous devons l’assumer. Lors de la dernière Nuit des Molières, Caroline Vigneaux présentait la cérémonie et a décidé d’écarter des personnes qu’elle soupçonnait, à tort ou à raison, d’être susceptible d’avoir eu des comportements déplacés », a remarqué Jean-Marc Dumontet. « On est tous des cinéphiles, des intellectuels, on se pose des questions sur la violence en général, sur la représentation de l’histoire, sur la diversité à tous égards, a affirmé Thierry Frémaux. Il arrive parfois que, nous-mêmes, on ne soit pas toujours justes dans nos choix », a-t-il ajouté. Plusieurs idées avaient été mises sur la table lors des auditions précédentes. La comédienne Mélodie Molinaro avait évoqué la création d’une « base de données confidentielles » permettant d’identifier les comportements ayant fait l’objet d’une plainte, qui soit accessible aux référents chargés de prévenir le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles sur les tournages. L’actrice Sara Forestier avait aussi suggéré, lorsqu’un cas de violence est signalé sur un plateau, de faire peser la responsabilité financière de l’interruption du tournage sur l’agresseur. L’examen de conscience des institutions du cinéma français a été moins fertile en idées neuves. Les auditions se poursuivront jusqu’en avril 2025 et devraient aboutir au dépôt d’une proposition de loi. Djaïd Yamak / Le Monde Légende photo : Judith Godrèche, à Cannes (Alpes-Maritimes), le 16 mai 2024. VALERY HACHE/AFP D'autres articles sur le thème #MeToo Théâtre/ Cinéma re-publiés par la Revue de presse théâtre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 6, 2024 11:27 AM
|
Par Samuel Douhaire dans Télérama - 30 août 2024 L’actrice fait le récit du tournage du film “Romance” et révèle le viol subi lors d’une scène du film. Un nouveau témoignage saisissant sur l’emprise exercée, cette fois de la part d’une cinéaste, sur une jeune comédienne. Après Judith Godrèche, Isild Le Besco ou encore Sarah Grappin (liste, hélas, non exhaustive), une autre actrice ayant percé à l’écran dans les années 1990 révèle l’emprise dont elle a été victime à ses débuts. Avec une différence de taille : le grand nom du cinéma d’auteur français que met en cause Caroline Ducey est une femme. Dans La Prédation (nom féminin), la comédienne raconte comment Catherine Breillat l’a « détruite » pendant le tournage, puis lors de la sortie en salles, de Romance (1999). À travers cette chronique d’une jeune femme en quête radicale du plaisir sexuel, la réalisatrice de Parfait Amour ambitionnait de « montrer qu’il existe un au-delà de la représentation du sexe, que l’on ne voit jamais dans les films pornographiques et où se tiendrait la beauté ». Avec un joli sens de la provocation, elle avait confié un petit rôle à un certain Rocco Siffredi, la superstar du cinéma X… Caroline Ducey, alors âgée de 21 ans, était fière d’être au centre d’une œuvre qui, elle en était persuadée, « devait promouvoir la liberté des femmes à disposer de leur corps, sans soumission ». Or, le tournage « a été en totale contradiction avec les prétendus enjeux féministes » du film. Pendant la préparation puis lors des premiers jours sur le plateau, la réalisatrice va entretenir le flou sur les nombreuses scènes de sexe prévues dans le scénario, malgré les demandes d’explication répétées de sa jeune comédienne. Pour Caroline Ducey, il n’a jamais été question que ces séquences soient non simulées. Arrive le jour du tournage de « l’inconnu dans l’escalier », une scène très forte où son personnage couche avec un homme qui doit la brutaliser. Une heure avant la prise de vues, l’actrice entend que la scène est désormais désignée comme celle « du viol »… qui ne sera pas du cinéma : Caroline Ducey affirme avoir subi un cunnilingus par surprise de son partenaire (un acteur non professionnel recruté dans un club d’échangisme) avec l’assentiment, voire à l’instigation de Catherine Breillat. Qui aurait ensuite masturbé le jeune homme « pour qu’il maintienne son érection » entre deux prises… Dépression et toxicomanie Dans des pages glaçantes, puis poignantes, l’actrice détaille les conséquences de ce traumatisme sur sa vie et sur sa carrière, la plongée dans la dépression et la toxicomanie l’ayant peu à peu éloignée du cinéma. Ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte. Son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, pendant lesquels elle est passée « par toutes les étapes de la déconsidération » , autant « par fierté et par déni d’être victime – pour ne pas mourir » que par peur de tout perdre : « Ma jeunesse, mon dénuement, mon absence de protection, je ne faisais pas le poids. [L’âge de Breillat,] sa fortune, sa notoriété, ses soutiens… on aurait eu ma peau pour de vrai. » Des mots qui rappellent ceux d’autres jeunes comédiennes abusées par des réalisateurs tout-puissants… Caroline Ducey raconte ensuite sa longue et patiente reconstruction qui est, d’abord, passée par une demande d’explications à la cinéaste, longtemps restée sans réponse. Jusqu’à ce que, après des années sans contact, elle reçoive en juillet 2023 un message de Catherine Breillat. Dans son livre, Caroline Ducey reproduit alors les échanges sidérants entre les deux femmes, où, entre autres amabilités, Breillat la compare à Myriam Badaoui, la mythomane de l’affaire Outreau, « qui est finalement une figure pathétique [qui] s’est prise au jeu du mensonge pour en surajouter ». L’actrice, de son côté, a des mots très durs sur la cinéaste, comparée à « un vampire » en quête de « chair fraîche », qui a « tout simplement commis un crime sur [sa] personne en abusant de [sa] confiance »… À lire aussi : #MeToo cinéma : Caroline Ducey et Marianne Denicourt, des paroles enfin entendues ? Dans son parcours de résilience, Caroline Ducey a heureusement découvert les poèmes et écrits intimes de Marilyn Monroe, qu’elle a adaptés pour un spectacle et qui lui ont permis de reprendre confiance. Avant, dans la foulée de la libération de la parole impulsée par le mouvement #MeToo, d’écrire ce récit intense non pas « pour détruire [Breillat] et son œuvre », mais pour « enfermer » sa propre douleur, « réunir le temps fracturé et dépasser l’effroi ». Et, au-delà de Catherine Breillat, interpeller tous les artistes sur leur responsabilité : « Que fait-on du pouvoir symbolique, social, financier, affectif dont on dispose ? […] L’utilise-t-on pour la création, l’utilise-t-on pour jouir de détruire l’autre, l’utilise-t-on pour assouvir une vengeance, l’utilise-t-on pour faire subir à d’autres ce que l’on a subi soi-même ? » Samuel Douhaire / Télérama La réponse de Catherine BreillatCatherine Breillat a réagi au livre de Caroline Ducey dans les colonnes du Nouvel Obs, qui revient sur le tournage de Romance. Selon la réalisatrice, les séquences avec des actes sexuels non simulés avaient été « acceptées » par la jeune actrice, « mais ce n’était pas stipulé dans son contrat, elle était donc libre de ne pas les tourner ». Catherine Breillat réfute tout viol sur le tournage et, quand la comédienne se souvient l’avoir vue masturber un acteur entre deux prises, la cinéaste annonce son intention de porter plainte pour diffamation – « C’est une accusation délirante qui vise à me nuire et à me rabaisser ». Breillat précise enfin : « Seul le film compte et Caroline y est sublime. Je ne doute pas que le cinéma soit un art carnivore et même anthropophage, mais je réfute les mots de “trahison”, de “prédation”, et tout ce fatras populiste bien dans l’air irrespirable de ces temps rétrogrades, où l’on essaie de faire plier le cinéma d’auteur sous le joug d’un totalitarisme puritain. » PLUS D'INFOS -
Titre La Prédation -
Auteur Caroline Ducey -
Editeur Albin Michel -
Prix 16.9 € -
Collection Documents Légende image : Dans ce récit intense, Caroline Ducey raconte son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 8, 6:04 AM
|
Propos recueillis par Raphaëlle Bacqué, paru dans Le Monde du 8 juin 2025 ENTRETIEN «Je ne serais pas arrivée là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. La comédienne évoque sa mère suicidaire et son émancipation lorsqu’elle est devenue mère à son tour. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/06/08/anouk-grinberg-bertrand-blier-s-est-servi-de-moi-comme-d-une-surface-sur-laquelle-poussaient-ses-fantasmes_6611144_3246.html On la connaissait actrice et, la voici, à 62 ans, engagée auprès des femmes ayant déposé une plainte contre le comédien Gérard Depardieu. On la croyait enfant privilégiée issue d’un milieu d’artistes, on la découvre petite fille abîmée par une famille dysfonctionnelle qui a longtemps fait d’elle une proie facile pour les prédateurs. Respect (Julliard, 144 pages, 18,50 euros), c’est le titre qu’Anouk Grinberg a choisi pour décrire cette jeunesse qu’elle raconte devant nous, ainsi que sa renaissance. Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « Respect », d’Anouk Grinberg : aller droit au cœur du mal Lire plus tard Je ne serais pas arrivée là si… Je pourrais aborder mon histoire par tout ce qui a pu m’abîmer, voire assassiner des parts de moi, ou, au contraire, par ce et ceux qui ont su me ressusciter. Mais si je remonte au tout début, je crois que je ne serais pas ce que je suis si je n’avais pas respiré dès la naissance le désespoir de ma mère. Si je ne l’avais pas vue, durant mon enfance et mon adolescence, se suicider tant de fois. C’est ce manque de lumière dans ma jeunesse qui m’a donné le goût de la lumière et poussée à être ce que je suis devenue aujourd’hui. Pourquoi votre mère n’avait-elle plus le goût de vivre ? Au début, c’était une femme solaire, rieuse. Elle avait été élevée pour être une bourgeoise, une bonne épouse, une bonne mère, et elle a fait une croix sur elle-même. Cette croix a fait d’elle une bombe. Le pire, c’est que mon père était un homme bien, mais il n’a rien pu contre son malheur. Lorsqu’elle l’a rencontré, elle peignait, elle était photographe, décoratrice, elle avait du talent. C’est ce qu’elle était en puissance lorsqu’elle a rencontré mon père [Michel Vinaver, 1927-2022] qui, lui, était écrivain. Seulement, très vite, il a pris la direction de Gillette France et elle qui aspirait à la création et avait épousé un artiste s’est retrouvée mariée à un PDG, à devoir assurer des dîners insipides avec d’autres PDG, à n’être plus que la femme de. Cela n’a pas tenu très longtemps, elle a craqué. Ils ont eu trois enfants, puis un quatrième, moi, et à ma naissance, elle est vraiment tombée très malade. Il y a des femmes, comme il y a des hommes, qui sont faits pour créer des œuvres, mais pas des enfants. Cela se savait-il dans l’univers de PDG de votre père ? Justement non. Il y avait la maladie mentale de ma mère, les traitements en hôpital psychiatrique, et ces traitements étaient d’autant plus mal adaptés et destructeurs qu’elle était la femme du grand patron et que cela devait rester caché. Il a fallu très longtemps avant de poser le bon diagnostic sur elle et en attendant, les traitements l’ont dévastée. La petite fille que vous étiez en a-t-elle vite été consciente ? J’avais compris qu’elle se noyait dans le malheur et qu’elle nous y entraînait avec elle. J’avais compris que l’histoire était pliée, que la messe était dite, qu’elle n’était pas une mère et que c’était une tragédie d’être son enfant. Je ne lui mentais pas comme le faisaient mon frère et mes sœurs, qui lui disaient « oui, on t’aime, tout va bien ». Je ne pouvais pas. Elle était alcoolique, avec des débordements où elle ne se tenait plus. Son malheur me terrifiait et, face à ce malheur, j’étais l’enfant difficile. Personne ne pouvait donc vous protéger ? Mon père était un homme doux et aimant, mais avec des zones d’aveuglement qui étaient très certainement le corollaire de sa clairvoyance d’écrivain. Ce que je voyais, cependant, c’est un père en costard-cravate qui me faisait un peu peur, et une mère en proie aux flammes, qui faisait peur aussi. Il n’y avait pas de sécurité auprès d’eux. J’avais cependant du ressort, une capacité de rebond et je me suis débrouillée très tôt pour me faire adopter par les familles de mes copines, là où il y avait un semblant de vie normale avec un papa et une maman. Ces familles de substitution savaient-elles ce qui se passait chez vous ? Oui, mon père leur disait les tentatives de suicide ou les départs à l’hôpital psychiatrique. Moi aussi, j’étais au courant, mais personne n’en parlait dans ces familles. Je ne sais pas si c’était de la pudeur ou une volonté de me protéger, mais en tout cas on faisait comme si cela n’existait pas, alors que je restais parfois des mois chez ces gens. C’est là qu’a eu lieu ce premier viol dont j’ai été la victime, par le beau-père d’une de mes amies… On a le sentiment d’assister à la construction méthodique d’une proie. Comme si cette famille dysfonctionnelle vous avait conduite à devenir la victime de prédateurs… Lorsqu’un enfant manque d’amour et de cadre à ce point, c’est en effet le début du chemin pour être une proie. Il n’était pas envisageable de confier quoi que ce soit à ma mère et, du coup, elle ne m’avait rien appris de la vie et de ses dangers. Et puis, un enfant qui voit sa mère se suicider régulièrement finit par penser que c’est de sa faute, et que la vie est une saloperie. C’est aussi ça qui m’a rendue tenace pour dépasser le malheur, courir plus vite que lui. Même votre fratrie n’est pas un refuge… Eux formaient un trio. J’étais la quatrième, celle de trop. Le rôle qu’on vous assigne dans une famille se reproduit souvent quasi à l’identique dans la société, jusqu’à ce qu’on bouge pour de bon. Nous étions tous assez déglingués, sans cadre, et la drogue s’en était mêlée. Mais nous étions très proches, jusqu’à l’inceste avec mon frère, et plus tard l’omerta. Cela a été la trahison ultime, l’omerta est une négation pire que l’inceste. On vous enferme dans un silence mortifère qui peut rendre fou. Pour le reste, lorsqu’on n’apprend pas à un enfant l’amour, on fait de lui un affamé qui confond l’amour et la prédation. Lorsqu’on ne lui apprend pas le respect de lui-même et des autres, il ne sait pas dire non. J’ai mis des années à comprendre que des gens avaient profité de cette fragilité et de mon besoin de reconnaissance et d’amour. Lorsqu’on est un enfant sans cadre, on se jette dans la gueule des loups, dans les bras de tous ceux qui pourraient vous accueillir. Et c’est avec cette fragilité-là que vous êtes entrée au théâtre puis au cinéma… J’avais 12 ou 13 ans. Des amis de mon père m’ont fait faire mes premiers pas sur scène et à l’écran. Ils ont aussitôt mis le doigt dans ma blessure. Ce n’est pas du sadisme, mais, dans le milieu artistique, la blessure est aussi une source de lumière pour les autres, un levier de création. J’avais d’ailleurs cette lumière en moi, cette volonté de survivre à tout et de porter beau. Je voulais être joyeuse, confiante, j’avais une sorte d’innocence qui attirait. Je ne voulais pas que l’on sache mon malheur, je voulais sentir bon la vie. Au théâtre et au cinéma, y avait-il des adultes pour vous guider et vous protéger ? Pas vraiment. Il n’y avait pas que la permissivité de mon père et la dysfonctionnalité de la famille. L’époque faisait que l’on pensait que les enfants étaient vite autonomes. Beaucoup d’hommes considéraient que les enfants étaient des petites bestioles très sexuelles qui n’attendaient que d’être révélées à elles-mêmes. Le cinéma d’auteur était aussi un milieu où il était possible de divertir en avilissant les faibles. Pour autant, j’ai eu très vite la sensation que la fiction était un lieu d’apprentissage de la vie bien plus sûr que la vie elle-même et j’ai tout de suite aimé ce travail. Et un jour, la directrice de casting Margot Capelier vous dit d’aller voir le réalisateur Bertrand Blier, qui cherche une actrice pour son prochain film… Je ne le connaissais pas du tout, je n’avais vu aucun de ses films, je n’avais même pas spécialement envie de faire du cinéma ni l’envie d’être une star. Je voulais juste être quelqu’un de bien. Lorsque j’ai rencontré Blier, j’avais 25 ans, lui 50. Il m’a fait faire des essais. Cela tournait autour du sexe, je devais jouer une fille facile. Je ne me suis pas rendu compte de ce qu’il me faisait jouer, j’étais une jeune fille paumée, extrêmement pudique, à la limite de la phobie du sexe. Je faisais semblant d’être libérée, et j’ai dû bien faire semblant puisqu’il m’a engagée tout de suite. Son plaisir, sa jubilation à me voir jouer me donnait des ailes et j’osais tout pour lui plaire. Lorsque ça lui a pris, un jour, de m’embrasser sur la bouche, j’ai été juste étonnée. Je n’étais pas amoureuse, mais j’aimais beaucoup celui qui m’aimait beaucoup. Et puis, le film s’appelle Merci la vie [1991] et j’ai eu l’impression que la vie m’ouvrait enfin les portes. Vous n’avez pas été effrayée par le rôle qu’il vous proposait ? Le tournage s’est très bien passé, mais je n’avais pas d’esprit critique. Je me prenais des gifles, on m’étranglait, on m’insultait, on me malmenait tous les jours, mais le sens de tout ça ne m’est pas parvenu. Lorsque je regarde le film aujourd’hui, j’ai la nausée. Mais Blier était dans une sorte d’adoration avec moi, et cela me faisait fondre. Du coup, il pouvait me malaxer entièrement. Depuis « Les Valseuses » (1974), il y a dans ses films une misogynie. Utilisait-il ces ressorts parce que c’est ce qu’il était profondément ou parce que c’est ce qui faisait son succès ? Je pense que sa misogynie profonde a été excitée par son succès. C’est devenu un fonds de commerce, et la société a applaudi ce qui passait alors pour de la liberté. Il avait sans doute peur des femmes. Elles étaient pour lui des étrangères, qu’il rabaissait. Il aimait rire et faire rire sur le dos des fragiles. J’ai fait Merci la vie et Un, deux, trois, soleil [1993], puis j’ai été la pute dans Mon homme [1996]. Il s’est servi de moi comme d’une surface sur laquelle poussaient ses fantasmes. Cela a-t-il pesé sur les rôles qu’on vous a ensuite proposés ? Oui, on ne me proposait que des rôles où il fallait se mettre nue ou on m’agressait comme on agresse les putes. Ou alors on ne me proposait plus rien, parce que Blier avait aussi le don d’écarter les metteurs en scène de moi. Il a réussi à me faire croire que je n’étais bonne que dans ses films, qu’il fallait avoir cet humour et ce cynisme, sinon on n’est pas libre, pas sexy, pas attractive. Du coup, je me suis entraînée moi-même à être un objet. Vous vous émancipez pourtant de ce rôle d’actrice malléable lorsque vous avez un enfant… Mon âme est née avec mon fils. Il n’était pas question, mais vraiment pas question une seconde qu’il vive avec une mère qui soit une ombre. J’en avais déjà fait l’expérience avec ma propre mère, et je me suis extirpée de mon propre malheur pour redevenir le soleil que j’étais. Je suis devenue maternelle pour lui et pour moi-même, et là Blier a trouvé que c’était moins intéressant. Il avait perdu son actrice, j’étais passée d’objet à sujet. J’ai adoré être mère, j’ai trouvé ça très facile et miraculeux. Il est faux de dire qu’on ne peut donner que ce que l’on a reçu. Avec cet enfant, j’étais comme un poisson dans l’eau, j’adorais le faire dessiner, le faire jouer, lui lire des livres. Je n’ai pas été une mère qui met son gamin devant la télé ! Avez-vous fait une psychanalyse ? Non, mais une psychothérapie avec une femme spécialement fine, intelligente, pleine de bon sens, j’ai adoré faire ce travail. Sans elle, je ne serais plus là. On m’avait cousu la bouche, je l’ai décousue. J’ai parlé à mon père, que j’aimais infiniment, de l’épisode incestueux, mais il a dû se sentir acculé à devoir choisir entre ses enfants, ce que je ne lui demandais absolument pas. Je voulais juste que la vérité soit dite et entendue, pour pouvoir passer à autre chose. Cela n’a pas été possible. On ne m’a pas écoutée, on m’a dénigrée, c’est ça l’omerta qui peut tuer. Alors, j’ai rompu avec eux, sauf avec mon père. Je ne sais pas si mon frère et mes sœurs me traitent encore de menteuse ou de folle comme ils l’ont fait alors, ni même s’ils ont lu mon livre. Et s’ils l’ont lu, s’ils y ont réfléchi et en ont parlé à leurs propres enfants. Parce que, lorsque ces horreurs se passent dans une famille, cela se transmet à travers les générations. Lire aussi (2021) | Article réservé à nos abonnés Un apéro avec Anouk Grinberg : « Est-ce que je suis quelqu’un de sincère, moi qui triche tout le temps ? » Comment trouve-t-on la force de se relever ? Je ne voulais pas être ratatinée, je haïssais le malheur. J’ai tout fait pour me sauver, et je n’ai pas été flemmarde pour conquérir ma liberté. Jouer Rosa Luxemburg [révolutionnaire germano-russe, 1871-1919] était un virage à 180 degrés, travailler à une anthologie de ses lettres m’a branchée sur la vie et sur mes propres forces. Jouer Gisèle Halimi [avocate et figure du féminisme] vous sculpte ; travailler avec de bons metteurs en scène vous nettoie et vous élève ; ça a beau être des fictions, les métamorphoses sont réelles, et elles durent. Et puis j’avais des amis fantastiques, un grand amour. Ecrire aussi est une forme de danse de vie, une vérité qu’on s’accorde. Est-ce si difficile d’être respectée dans le milieu du cinéma ? Un cercle vertueux est en train de se mettre en place. Pour ma part, ces dernières années, je ne travaille qu’avec des gens formidables, qui sont dans le plaisir de la connivence et de la complicité artistique. Et je dois dire que dénoncer les comportements déviants ne m’a pas nui. Avant d’écrire ce livre, avant sa réception, j’étais un bloc de méfiance et de honte, et c’est comme si un océan de confiance avait immergé ce bloc. J’ai l’impression d’être comme un cheval blanc qui court librement. Respect, d’Anouk Grinberg (Julliard, 144 pages, 18,50 euros).
Par Le Monde avec AFP - 30 avril 2025 Le départ du directeur délégué est prévu le 13 juin, a annoncé Tiago Rodrigues, le directeur du Festival. Une enquête interne a été menée en novembre et décembre par le cabinet spécialisé Egaé, après que le ministère de la culture a saisi le procureur de la République pour des signalements à son sujet. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/04/30/pierre-gendronneau-le-numero-deux-du-festival-d-avignon-va-quitter-ses-fonctions-apres-des-signalements-de-violences-sexuelles-sur-un-precedent-poste_6602035_3246.html
Pierre Gendronneau, directeur délégué du Festival d’Avignon, va quitter ses fonctions le 13 juin, à la suite « d’accusations » de violences sexuelles et sexistes alors qu’il occupait un poste dans une autre organisation, a annoncé, mercredi 20 avril, le directeur du Festival, Tiago Rodrigues. « Nous avons annoncé aujourd’hui à l’équipe du Festival le départ de Pierre Gendronneau des fonctions de direction délégué, pour des raisons personnelles et pour poursuivre d’autres horizons professionnels », a déclaré à l’Agence-France Presse M. Rodrigues, confirmant une information de Télérama. Ce départ « a été pris d’un commun accord », a-t-il précisé, sans confirmer s’il s’agit d’une rupture conventionnelle. M. Gendronneau avait été nommé en février 2023. Une enquête interne a été « menée en novembre et décembre » par le cabinet spécialisé Egaé, dirigé par Caroline De Haas. « Plusieurs avocats indépendants », sollicités par le Festival, ont conclu que « l’enquête ne révélait pas de faits avérés de harcèlement ou de violence de la part de Pierre Gendronneau pendant sa période de travail au Festival », a précisé Tiago Rodrigues. Des signalements étaient parvenus à propos de M. Gendronneau au ministère de la culture, qui avait déclenché l’article 40 du code de procédure pénale, et informé le procureur de la République pour qu’il décide des suites judiciaires à donner à ces accusations. Le Festival a été informé de ces signalements début novembre, a expliqué M. Rodrigues, et a décidé de lancer cette enquête interne dans les « deux jours » qui ont suivi. Une enquête menée également au Festival d’automne A la suite de l’enquête d’Egaé, « Pierre Gendronneau a continué à son poste. Cependant, le fait qu’il y ait des accusations envers lui antérieures à son arrivée au Festival d’Avignon et d’autres enquêtes déclenchées a créé un climat de suspicion à son égard. Cela devenait impossible pour lui de mener sa mission », a encore déclaré M. Rodrigues. Le Festival d’Automne à Paris, où M. Gendronneau a été l’adjoint du directeur Emmanuel Demarcy-Mota, a confirmé une information de Télérama selon laquelle le cabinet Egaé a également été mandaté pour une enquête. « Près de deux ans après son départ, soit à l’automne 2024, m’ont été signalés par une salariée qui disait en avoir été victime des faits de harcèlement sexuel de la part de Pierre Gendronneau », a expliqué à l’Agence France-Presse M. Demarcy-Mota. « Un signalement a été fait au ministère. J’ai demandé à pouvoir en parler avec tous les membres de l’équipe du Festival, et nous avons mis en place une procédure pour parvenir à un diagnostic. Mais Pierre Gendronneau n’étant plus salarié, il n’y a pas de contradictoire, et pas de sanction possible au sein du Festival d’Automne », a-t-il ajouté. Avant 2023, Pierre Gendronneau a aussi été chargé de production à la Scène nationale de Sénart et directeur de production au Centre dramatique national de Montreuil. La 79e édition du Festival d’Avignon est prévue du 5 au 26 juillet 2025. Le Monde avec AFP Légende photo : Pierre Gendronneau, directeur délégué du Festival d’Avignon, à Avignon (Vaucluse), le 1ᵉʳ août 2023. ANGÉLIQUE SUREL/PHOTOPQR/LE DAUPHINE/MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 9, 1:36 PM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 11:33 AM
|
Par Télérama avec AFP - Publié le 6 avril 2025 La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences dans la culture a longuement entendu les professionnels des secteurs artistiques. Retour sur les témoignages poignants de plusieurs comédiennes à quelques jours des conclusions. Lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/debats-reportages/humiliees-agressees-tetanisees-les-actrices-racontent-les-violences-du-cinema-devant-les-deputes-7025124.php «La violence s’ancre en vous et vous ronge » : à l’instar de Nina Meurisse, des actrices ont profondément marqué la commission d’enquête de l’Assemblée nationale en racontant les violences subies durant leur carrière. Ces prises de parole sous serment, d’Anna Mouglalis à Sara Forestier, sont la « partie émergée » de l’iceberg, explique à l’AFP la présidente de la commission, l’écologiste Sandrine Rousseau. D’autres, comme Virginie Efira, Noémie Merlant, ou Juliette Binoche ont témoigné à huis clos, et des dizaines se sont manifestées auprès des députés, pour livrer leurs expériences douloureuses. Après des mois de travail, la commission d’enquête, un temps arrêtée en raison de la dissolution en juin 2024, rend son rapport mercredi. Nina Meurisse : “Je suis tétanisée” « J’avais 10 ans quand j’ai tourné pour la première fois. […] Dans ce film, il y a une scène de viol. […] Je vois arriver en courant un jeune acteur, qui me saute dessus, qui me prend la poitrine et qui essaie de me soulever la robe. On refera la scène plusieurs fois. J’ai 10 ans, je n’ai même jamais embrassé un garçon, je suis tétanisée ». « Quelques années plus tard, à peine majeure, je dois faire une scène de représentation sexuelle avec un homme de l’âge de mon père. [Il] décide de ne pas mettre de peignoir entre les prises. […] Il doit m’appeler dans la salle de bains et me dire de me mettre à genoux pour lui faire une fellation. Moi, je dois hésiter, alors il doit me donner une baffe. On tourne la scène mais il se met à improviser. Il me met les mains sur les épaules et m’écrase au sol avec une grande force. Je me fais très mal au genou. Il enfonce son pouce dans ma bouche. J’ai la tête en arrière et, de son autre main, il me donne plein de baffes en me disant : “T’aimes ça, salope !” Je me mets à pleurer, je suis tétanisée. Il me donne une autre baffe, violente, et je m’écrase au sol. Coupez ! Le réalisateur et les techniciens trouvent cette scène bouleversante, alors on la refera, parce que ce sera beau pour le film. » Anna Mouglalis : “L’acteur m’a mis une droite” « J’ai travaillé sur un film lors duquel je devais être nue au-dessus d’un homme […] Je devais me relever pour m’allonger sur l’homme mais j’ai dit au metteur en scène que je ne pouvais pas faire ça, car l’angle de la caméra se retrouverait littéralement sur mon sexe. On m’a alors répondu de ne pas m’inquiéter […]. Je tourne la scène, puis je vérifie la prise. C’était un plan par-derrière où on voyait tout […]. Je dis alors à la scripte que je refuse le plan. Je le signale aussi à mon agent […]. Non seulement le plan initial a été conservé au montage mais il a aussi été repris dans la bande-annonce, qui est toujours visible ». Sur un autre tournage, « j’ai été frappée. C’était d’ailleurs très prévisible, puisque l’acteur et le reste de l’équipe, masculine, s’étaient alcoolisés dès le petit-déjeuner. Au moment où l’acteur m’a mis une droite, le réalisateur a dit : “On continue à tourner !” » Sara Forestier : dire “non” À 13 ans, tout premier casting : « J’ai commencé ma carrière en disant “non” […] quand on m’a demandé de retirer ma culotte et de la faire tournoyer dans les airs pour qu’elle atterrisse dans l’assiette d’un autre personnage, dans une scène soi-disant comique d’un court-métrage. […] J’ai dit non et je suis partie. » « Peu de temps après, j’ai 15 ans et je tourne mon premier film, L’Esquive. Sur le plateau, entre deux scènes, l’un des régisseurs me dit : “J’ai envie de te faire l’amour dans les fesses”. Il a 30 ans et j’en ai 15 ; je suis choquée […]. On est passés à autre chose. » Sur un autre tournage, Sara Forestier raconte avoir été giflée par un acteur, plus tard identifié comme Nicolas Duvauchelle. Elle venait de sortir de l’hôpital, après une hémorragie interne liée à une grossesse extra-utérine. L’équipe tente de la dissuader de porter plainte, puis on l’accuse d’avoir elle-même donné la gifle. « Ils ont réussi à me faire taire. Psychologiquement, c’était comme un coup de massue supplémentaire. […] J’étais, littéralement, à terre, à genoux dans mon salon, en sanglots – je revois encore cette image et ça me fait mal d’y repenser. J’ai eu envie de mourir. » Télérama avec AFP Légende photo : Anna Mouglalis, photographiée ici à Cannes le 17 mai 2024, fait partie des actrices interrogées par la commission d’enquête sur les violences dans la culture. Photo Yann Rabanier pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 11:27 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 26 mars 2025 La comédienne Agathe Pujol a détaillé devant la commission de l’Assemblée nationale les violences sexuelles dont elle aurait été témoin dans la troupe d’Ariane Mnouchkine et la tentative de viol qu’elle y aurait subie.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/03/26/apres-des-accusations-de-violences-sexuelles-la-douloureuse-introspection-du-theatre-du-soleil_6586523_3246.html
« Cette réunion est l’une des plus graves de l’histoire du Théâtre du Soleil. » Mardi 25 mars, 14 heures : Ariane Mnouchkine prend la parole dans le foyer du théâtre installé depuis soixante ans à la Cartoucherie de Vincennes. Face à elle, une quarantaine de visages fermés. La grande majorité de la troupe a répondu présente au rendez-vous décidé dans l’urgence par la directrice, après les propos de la comédienne Agathe Pujol. Hors de question de traiter avec désinvolture ce qui vient de se jouer. C’est le cœur même de la maison qui est atteint. L’accusation a eu lieu la veille, le 24 mars, devant la commission de l’Assemblée nationale sur les violences commises dans les secteurs artistiques. Une session présidée par la députée Sandrine Rousseau (Les Ecologistes, Paris), diffusée en direct et en accès libre. Pendant près d’une heure, Agathe Pujol, qui en février 2024 a porté plainte contre le comédien Philippe Caubère, l’accusant d’« atteinte sexuelle » sur mineure (l’acteur est mis en examen pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur), a détaillé les « dérives sexuelles » dont elle aurait été témoin au Soleil. Affirmant y avoir été elle-même victime d’une « tentative de viol » par un acteur dans la nuit du 31 décembre 2010, dont, ajoute-t-elle, « beaucoup furent témoins », Agathe Pujol rend compte en détail et en termes dévastateurs de son séjour, encore lycéenne, dans le théâtre. Une atmosphère « oppressante » Venue au Soleil comme bénévole dans le courant de l’année 2010, elle déplore un travail effectué gratuitement pendant, dit-elle, presque deux ans au service de la restauration, à la cuisine ou à la plonge. « On me disait qu’il fallait que je fasse mes preuves, qu’à un moment peut-être quelqu’un manquerait et qu’on aurait besoin de moi sur scène (…) j’ai longtemps été aveuglée par ce système, y étant entrée très jeune. » Elle évoque les « messes basses, les manipulations constantes, le masochisme suggéré, le diviser pour mieux régner, les addictions diverses, la sexualité imposée ». Elle précise avoir appris là-bas à fumer et à boire, l’accès au bar étant « sans surveillance » ou « limite d’âge » et déplore, au-delà de la beauté et de la magie du lieu, des conditions « très dures », une atmosphère « oppressante », un fonctionnement « en vase clos » hors de Paris, dans le bois de Vincennes. Un portrait au vitriol découvert par une équipe du Soleil sonnée, partagée entre la consternation, la colère ou la peur. Certains des membres regrettant aussi qu’« aucun contradicteur ne soit présent sur place ». Même si elles ont permis à la troupe de vérifier sa solidarité dans l’épreuve, les quatre heures de discussion menée dans le calme le mardi 25 mars n’auront pas suffi à purger les émotions. « Je pense au public. Comment le rassurer, ne pas désenchanter ces gens qui se disent heureux qu’on existe » : comme beaucoup de ses camarades, la comédienne Hélène Cinque accuse le coup avec effroi. Personne n’évacue la violence des faits qu’aurait subie Agathe Pujol : « Nous devons investiguer sur cette tentative de viol », témoigne la comédienne Shaghayegh Beheshti. Mais le sentiment d’injustice domine aussi les conversations : « On ne peut pas laisser dire que les hommes ici sont des prédateurs », lance l’acteur Maurice Durozier. « Je ne conteste pas la manière dont les choses ont pu être vécues, ajoute son collègue Vincent Mangado, mais il est faux de dire que nous organisons du travail au noir. » Démêler le vrai du faux Au Soleil, le bénévolat est depuis toujours une porte d’entrée possible vers un emploi pérenne dans les murs. La recette fonctionne pour beaucoup. Mais pas pour tous. Revenue parmi l’équipe en 2022 pour participer à un stage à Amiens dans le cadre d’une école nomade, Agathe Pujol n’a pas été cooptée en tant que comédienne. Dans le foyer où les tables ont été assemblées pour former un vaste rond, les nouvelles recrues et les vétérans discutent. Sont présents les acteurs mais aussi les équipes techniques : costumière, responsable des ateliers décors, créatrices lumière ou son. Jusqu’aux stagiaires, dont Ariane Mnouchkine a souhaité la participation : « Je leur ai demandé d’être là car elles doivent comprendre ce qui se passe dans une collectivité humaine comme la nôtre qui n’est à l’abri de rien, malgré toutes nos tentatives, efforts, espoirs. A l’abri de rien. Même si je pense que nous sommes un groupe digne. Parfois. Visiblement pas toujours. » Les mots de la directrice pèsent lourd, le silence qui les suit en dit long sur la sidération collective. Sans débordements ni invectives, levant la main à tour de rôle, les participants exposent leurs ressentis et leurs points de vue. Les plus anciens tentent de se souvenir : que s’est-il passé réellement, qui était là et n’a rien vu, ou bien a vu et n’a rien fait ? Comment faire comprendre que le Soleil n’est ni une secte ni une mafia ? Faut-il porter plainte contre l’acteur agresseur au nom du théâtre ? Consulter un avocat ? Toutes les pistes sont sur la table. Démêler le vrai du faux, tenter de faire la lumière entre des faits objectifs et leur interprétation forcément subjective : pendant quatre heures, chacun avance sur ce fil ténu en évitant les généralités. De la nuance en tout : Ariane Mnouchkine veille au grain. Elle pointe le changement des « curseurs » générationnels en matière d’agression sexuelle et appelle chacun à davantage de vigilance. La jeune génération réclame, pour sa part, un renforcement des référents VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels). Huit volontaires suivront très bientôt une formation. Arrivé dans les murs en 2022, l’acteur Tomaz Nogueira da Gama attend près de trois heures avant de s’exprimer : « Le Soleil, tout magique qu’il est, fait partie de la société. Se regarder dans le miroir, fort de notre trajectoire, c’est dire : oui, nous avons cultivé des miracles, mais nous avons aussi, sans doute, traîné quelques vices. Cela me suffit pour défendre le théâtre. » Assumer sans se défausser, prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir les dérives quelles qu’elles soient, mais ne pas, pour autant, courber la tête sous l’invective ou renier d’un trait de plume l’identité d’une maison dont les pratiques font la singularité : en introduction de cette réunion de crise, Ariane Mnouchkine avait prévenu : « Nous vivons un moment existentiel. » Le mot n’est pas usurpé. La troupe signera collectivement une lettre dûment réfléchie et adressée, dès que possible, au public. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Le Théâtre du Soleil, fondé par Ariane Mnouchkine, à la Cartoucherie, dans le bois de Vincennes, à Paris, en 2014. BERTRAND GUAY/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 18, 9:50 AM
|
Propos recueillis par Sophie Joubert pour l'Humanité magazine - Publié le 7 mars 2025 Popularisée par la série « Baron noir », la comédienne, actuellement sur les planches dans le rôle de « Phèdre », évoque pour « l’Humanité magazine » ses choix de carrière singuliers, son enfance pétrie de culture et son engagement au long cours pour toutes les émancipations. « Je me suis syndiquée à la CGT, c’est pour moi le seul discours audible, sans faille, contre l’extrême droite », explique-t-elle notamment.
On la rencontre chez elle, dans un appartement rempli de livres qui donne sur un petit jardin où un merle vient cogner consciencieusement son bec contre un miroir. Actrice au cinéma et au théâtre, Anna Mouglalis est à l’affiche de la Mer au loin, de Saïd Hamich, un très beau film sur l’exil qui traverse les années 1990, et tient le rôle-titre de Phèdre dans la mise en scène d’Anne-Laure Liégeois. Avec Lucie Antunes, P.R2B, Théodora Delilez et Narumi Herisson, elle forme le groupe Draga, qui a mis en voix et en musique les textes de Monique Wittig dans « Ô guérillères », un album qui sortira fin avril. Militante féministe, engagée dans le combat pour l’adoption d’une loi intégrale sur les violences sexuelles, elle a témoigné le 16 décembre 2024 devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences dans le secteur du cinéma. Vous jouez « Phèdre », de Racine, en tournée. Comment vivez-vous ce compagnonnage au long cours avec ce texte et ce personnage ? C’est merveilleux d’habiter avec un chef-d’œuvre. Racine demande d’aller très loin. C’est la rage ou l’égarement, on ne peut pas le jouer de façon tiède. « Phèdre » est une pièce de l’intime, mais d’un intime vertigineux. Elle est éprouvante physiquement. J’ai cru que je pourrais faire l’économie de la douleur du personnage, mais ce n’est pas le cas. Comme dit la metteuse en scène, Anne-Laure Liégeois, elle est un papillon de nuit qui va se brûler contre la lampe. On revit chaque soir la violence masculine, avec ce personnage de héros, Thésée, qui apporte la mort partout où il passe. Les fils sont, avec les femmes, les premiers à souffrir de la violence patriarcale. C’est à la portée de tous les hommes de le reconnaître. On parle de Phèdre incestueuse, mais c’est surtout un inceste non consommé. Phèdre incestueuse non, scandaleuse oui. Comment choisissez-vous vos rôles ? J’ai besoin de pouvoir y mettre tout mon esprit et que ça me nourrisse dans tous les sens du terme. Je n’avais pas rêvé de jouer « Phèdre », mais c’est comme s’inscrire dans une historicité, avec toutes les traces des comédiennes qui l’ont joué avant moi. J’ai fait peu de théâtre, car j’ai du mal à me projeter à long terme. Au cinéma, j’avais envie de participer à des films qui cherchaient des formes nouvelles. J’ai fait ce qu’on appelle du cinéma d’auteur, de création. Bien sûr j’aime jouer, mais pas à tout prix. Le désir de jouer vient-il de vos lectures, d’une cinéphilie née dans l’enfance ? J’ai grandi à Nantes. Grâce aux politiques culturelles de gauche, j’ai vu sous chapiteau les premiers spectacles de Zingaro, des pièces d’Enzo Cormann, « Mars » de Fritz Zorn. Une troupe municipale, la Chamaille, montait des spectacles très divers. Mes parents ont tenu à ce qu’on puisse aller au cinéma, j’allais toutes les semaines au Cinématographe. Il pleut sur Nantes, tout le monde le sait, je me souviens d’une dame qui m’enlevait mes collants et les faisait sécher sur le radiateur pendant la séance. On avait aussi un compte en librairie pour prendre ce qu’on voulait. Mais j’étais surtout une spectatrice comblée, il y avait les Allumées, un festival de jazz… Et je suis venue vivre à Paris pour que la vie commence, pour voir encore plus. C’est là que vous avez fait vos débuts d’actrice ? J’étais avec un garçon qui est entré à la Fémis, j’allais au lycée et je ne faisais pas de théâtre. On m’a demandé de participer à un court métrage. J’ai eu une expérience d’assistante pour un metteur en scène, j’ai fait réciter leurs textes aux comédiens. Et j’ai rencontré le comédien Yann Goven, qui m’a parlé du Conservatoire et m’a aidée à préparer le concours. C’est lui qui m’a emmenée à la Fête de l’Humanité, il vivait ce métier comme un acteur ouvrier, il ne se serait jamais sali en participant à des projets qui allaient à l’encontre de ses idées. En passant le concours, j’avais un trac monstrueux, que j’ai transformé en excitation puis en enthousiasme. L’assistante du cinéaste Francis Girod, qui faisait partie du jury, m’a demandé de passer le casting pour le film « Terminale » et j’ai été prise. J’ai aussi passé les auditions de « l’Éveil du printemps », de Wedekind, mis en scène par Yves Beaunesne. Le Conservatoire m’a accordé un congé d’un an pour que je puisse tourner le film et jouer dans cette pièce. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ? C’est là que j’ai rencontré le psychanalyste Gérard Miller, qui en était le scénariste. Le film raconte l’histoire d’une fille qui se suicide alors qu’elle a couché avec son prof de philo. Nous étions convoqués chez lui pour travailler sur les dialogues et les adapter à notre personnalité. J’ai appris des années après que les garçons n’avaient jamais eu ces rendez-vous. Est-ce que cette expérience a abîmé votre désir d’être actrice ? Non, je ne me suis pas sentie atteinte. C’était un vieux dominant qui faisait venir des jeunes filles chez lui pour les hypnotiser et les agresser sexuellement, je l’ai repoussé. Il a dit qu’il allait me retirer mes répliques pour les donner à d’autres et j’ai répondu : « Tant mieux. » J’ai essayé de disparaître le plus possible du film tout en étant payée. Francis Girod était élégant, respectueux. Il m’a appris qu’à partir du moment où on est convoqué le matin et qu’on passe au maquillage la journée est due. En cours de tournage, on a fini par apprendre que Gérard Miller avait proposé à plusieurs filles de voir son home cinéma, puis de leur faire une séance d’hypnose, et qu’il les avait utilisées comme des objets. Elles avaient honte, se sentaient coupables. Quand on dit que la honte change de camp, ce ne sont pas des mots. Cette expérience vous a-t-elle fait prendre conscience d’une violence patriarcale systémique ? Non, c’est venu bien avant. Je viens d’une histoire de violence qui se répète de génération en génération. Je m’y suis même sentie chez moi. C’est une chose de la reconnaître, c’en est une autre d’avoir envie de vivre ailleurs. Dans ma famille, on avait accès à la culture, mais j’ai grandi avec un modèle classique où les femmes étaient à la maison. Tous les récits initiatiques, tous les films qu’on voyait ne parlaient que de ça. Ou bien de personnages féminins qui avaient une fin tragique. J’ai grandi avec la misogynie et elle a grandi en moi. J’avais un mépris pour le féminin puisque tous les modèles étaient masculins. Quand je suis partie de chez mes parents, ma voix est devenue beaucoup plus grave, je me suis rasé la tête. Et c’est quand je l’ai fait qu’on m’a demandé de travailler dans la mode. Votre rencontre avec Karl Lagerfeld a été décisive ? Quand il m’a proposé d’entrer chez Chanel, je m’attendais à trouver tout ce qu’il y a de plus superficiel. Le réel est toujours surprenant. Le fait d’avoir rencontré cet homme tôt dans ma vie professionnelle m’a fait comprendre qu’il n’y avait pas que de la violence et des gens qui veulent nous utiliser. Il a été respectueux envers ma timidité, ma pudeur, ma discrétion. Il a respecté mon choix de ne faire que des films d’auteur, expérimentaux, de ne pas sortir dans les soirées mondaines. Il avait un pouvoir immense, mais ne l’a pas utilisé contre moi. Quand il me photographiait, il choisissait toujours l’image où j’étais étrange, l’angle où j’avais le nez un peu long, il voulait voir le plus singulier en moi. Être regardée ainsi m’a donné de la force. Votre voix grave vous a-t-elle posé problème ? Dans tous mes premiers films, je chuchote. Au Conservatoire on m’avait proposé une opération en me disant que j’avais une voix qui ne correspondait pas à mon physique et que je ne travaillerais pas. Dans un film à gros budget, on m’a fait comprendre qu’il allait falloir que j’aie plus de seins. Quand j’étais dans une agence de mannequins, on m’a demandé de reboucher mon trou de varicelle, de remettre mes dents droites. Parfois, j’ai eu envie d’arrêter. On me proposait des rôles de femmes fatales ou de femmes « mystérieuses ». Dans un scénario, si une femme est mystérieuse, ça veut dire qu’on ne s’intéresse pas à elle. J’en ai eu assez. J’ai dit stop, puis j’ai attendu. Et finalement on m’a proposé de jouer Simone de Beauvoir (« les Amants du Flore », 2006), ce qui a provoqué une levée de boucliers parce que j’avais été mannequin. Ce ne sont que des histoires de transgression : partir de chez ses parents, c’est bien ; garder sa voix, c’est bien. On vous voit souvent dans les manifestations, d’où vient votre conscience politique et comment l’articulez-vous avec votre métier d’actrice ? Mes parents ne votaient pas. Ils venaient de milieux prolétaires et ont réussi une ascension sociale. C’était important pour eux que j’aie accès à la culture et que je fasse de la danse. Mon grand-père était maçon, couvreur, zingueur, il est tombé et n’a pas pu continuer à travailler. Ensuite, en vivant seule, j’ai fait des petits boulots avant d’être majeure, payés à 80 % du Smic, parfois pas payés du tout. Cette conscience de l’injustice s’est aussi forgée grâce à la fiction. Enfant, si je regardais un film sur l’apartheid, je voulais être noire ; un western, je voulais être indienne. Dans cette même perspective, j’ai compris que s’il y avait bien une chose intéressante c’était d’être femme, actrice d’une émancipation. Je me suis rapprochée de milieux déjà organisés et militants quand j’ai appris que j’attendais ma fille. À partir de ce moment-là, je n’ai lu que des livres écrits par des femmes et j’ai essayé de me décoloniser. J’ai découvert des autrices exceptionnelles, des récits qui viennent remettre le monde à l’endroit : Goliarda Sapienza, Audre Lorde, Marina Tsvetaieva, Alexandra Pisarnik… La théorie féministe me porte : Andrea Dworkin, Silvia Federici, Virginie Despentes, Angela Davis, Rita Laura Segato ont changé ma vie. Vous avez témoigné le 16 décembre dernier devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans le secteur du cinéma, comment s’est passée cette audition ? J’ai toujours parlé, à mon entourage, dans mon milieu professionnel. À partir du moment où les médias ont écouté, j’ai témoigné (à propos des agressions commises par Gérard Miller et Jacques Doillon – NDLR). J’avais déjà été auditionnée par le Sénat. J’ai suivi de près les travaux de la Ciivise, 82 recommandations ont été produites pour lutter contre les violences faites aux enfants, mais le juge Durand a été évincé et elles n’ont pas été appliquées. Quand cette commission d’enquête sur le cinéma a été créée, j’étais un peu sceptique car on ne cesse de dire que les violences concernent tous les milieux. Parler spécifiquement du cinéma empêche de voir la dimension systémique. Mais j’ai été agréablement surprise par la pugnacité de Sandrine Rousseau et des autres parlementaires. Lors de cette audition, vous avez retracé votre parcours d’actrice en montrant qu’à toutes les étapes d’un film les dangers sont présents… La domination s’exerce à tous les endroits. Récemment, je me suis syndiquée à la CGT. C’est pour moi le seul discours audible, sans faille, contre l’extrême droite. Ce qui est terrible avec ce métier, c’est cette idée d’élections qui n’auraient rien à voir avec le travail. En tant que jeune acteur ou actrice, on pense qu’on a de la chance. Mais la chance est partagée. Le système pyramidal est puissant. Quand j’ai eu mon premier contrat au théâtre, on voulait me payer à 80 % du Smic, alors que j’étais majeure. On m’avait dit : certaines paieraient pour être à ta place. Je refuse cette idée construite par Hollywood selon laquelle il serait normal de sacrifier des personnes sous prétexte qu’on fait un métier qui brille. C’est un métier encadré par le Code du travail, il faut le rappeler sans arrêt. Mais on peut dire non, ça m’est arrivé récemment : pour faire des économies de transport on m’a mise sur une branche nue, à 5 mètres du sol, on m’a fait monter par une colonne d’échafaudage et on m’a dit qu’on l’enlevait. J’ai crié : « Est-ce que quelqu’un peut prendre une photo de ce dispositif ? » On n’a pas tourné la scène. Très peu de comédiens sont syndiqués. Quand on fait des heures supplémentaires ou des castings, on n’est jamais payés. J’ai passé des essais avec Godard pour deux films différents, il payait la séance de travail et le ticket de transport de sa poche. Vous qui avez fait votre formation de spectatrice à Nantes, comment réagissez-vous aux attaques menées contre la culture dans les Pays de la Loire et ailleurs ? J’ai signé la pétition « Debout pour la culture ! Debout pour le service public ! ». Avant, quand on allait dans des théâtres subventionnés, il y avait des scolaires, des rencontres en bord de plateau. Mais, quand on joue une seule fois, ce n’est plus le cas. Partout où nous allons, Anne-Laure Liégeois arrive la veille pour rencontrer les collégiens et lycéens bénévolement, c’est tout le sens de l’utilisation de l’argent public, du commun. Et c’est complètement mis à mal. Les tournées n’ont plus rien à voir avec ce que j’ai connu à mes débuts. On faisait beaucoup de dates, j’étais très mal payée mais je l’étais mieux qu’aujourd’hui. On sacrifie l’hôpital, l’école, la culture et la jeunesse, en décidant de l’appauvrir et de la faire basculer dans l’obscurantisme. Vous avez enregistré avec le groupe Draga « Ô guérillères », d’après les textes de Monique Wittig, comment ce projet vous porte-t-il ? Nous sommes cinq, sans problème d’ego, avec une sororité qui permet la créativité. Tout est beau et joyeux dans cette histoire. Adolescente, j’aurais adoré connaître cette énergie et cette jubilation du combat. Nous avons une première date en juillet au festival Days Off, à la Philarmonie de Paris. J’aime sentir ces connivences de pensées, l’énergie des possibles. Je réalise un documentaire sur une autrice sicilienne magnifique, Maria Attanasio. Son livre « Concetta et ses femmes » (édition Ypsilon) parle de la création de la première section féminine du Parti communiste, une expérience qui n’a duré que trois ans. Ce sont des révolutions, de la politique de proximité qui fonctionne. Elle est marxiste depuis toujours. Toute son œuvre s’appuie sur des archives locales de Caltagirone, où elle vit, des histoires de femmes effacées par la violence de genre. Elle a été prof d’histoire-géo et de philo pendant toute sa carrière. Son compagnon donne des cours de Pilates gratuits aux paysans qui ont mal au dos. Elle dit qu’en faisant ressurgir ces récits on se rend compte que, en tant qu’artiste ou femme qui lutte, on forme une chaîne de sœurs anonymes. Et qu’on n’est pas orphelines. Propos recueillis par Sophie Joubert / L'Humanité magazine Légende photo : « Dans ma famille, on avait accès à la culture, mais j’ai grandi avec un modèle classique où les femmes étaient à la maison », raconte Anna Mouglalis, actrice et réalisatrice, ici le 18 février 2025 à Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 30, 4:07 AM
|
Environ 80 personnes ont manifesté devant la Comédie-Française ce mercredi 29 janvier au soir. Le collectif #MeToo Théâtre fustige l’institution qui a maintenu à son poste le comédien accusé de violences. «On balance les porcs, vous les engraissez.» Micro entre les doigts et doudoune sur les épaules, Nadège Cathelineau lâche ce slogan inspiré d’un morceau de rap de sa composition. Dans l’autre main de la membre du collectif #MeToo Théâtre, une pancarte marquée des mots «la comédie a assez duré». Ce mercredi 29 janvier au soir, environ 80 personnes étaient rassemblées avec elle sur la place Colette, dans le Ier arrondissement de Paris, face à l’illustre Comédie-Française. A l’appel du collectif #MeToo Théâtre, les manifestantes et manifestants sont venus dénoncer «l’impunité» au sein de l’institution théâtrale la plus célèbre du pays. Sous une fine pluie, la comédienne et cofondatrice du collectif, Sephora Haymann, déroule ce qui a déclenché cette mobilisation au pied du théâtre à l’italienne. «Pourquoi avoir maintenu Nâzim Boudjenah parmi les pensionnaires de la Comédie-Française alors qu’il a été condamné pour menaces de mort ?» Depuis deux semaines, le cas de l’acteur de 52 ans préoccupe l’institution. Le 13 janvier, Eric Ruf, administrateur général du théâtre, était auditionné devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences commises dans les secteurs du cinéma et du spectacle vivant. C’est à cette occasion que la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui préside ce travail, a révélé avoir porté plainte en juillet 2024 contre Nâzim Boudjenah après des «menaces de mort» de l’acteur contre elle. Tout juste vingt-quatre heures plus tard, le 14 janvier, la Comédie-Française écrit dans un communiqué avoir pris connaissance «des agissements graves d’un de ses salariés», s’autorisant ainsi à «le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement». Une décision qui arrive «bien trop tard», déplore Sephora Haymann. Car dès juin 2021, Nâzim Boudjenah avait été condamné par le tribunal de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des «menaces de mort» proférées en 2019 et 2020 sur son ancienne petite amie, Marie Coquille-Chambel, figure de #MeToo Théâtre. Relaxé pour les faits de violences sur conjointe dans ce premier procès, il reste à ce jour mis en examen pour «trois viols susceptibles d’avoir été commis en février, mars, et mai 2020» à la suite d’une autre plainte de Marie Coquille-Chambel, selon le parquet de Paris. Bien que le témoignage de la jeune femme soit public, la Comédie-Française avait renouvelé le CDI du comédien à son poste. De quoi alimenter la colère de Sephora Haymann : «La question que nous sommes venues poser devant la Comédie-Française ce soir est simple : la vie d’une élue a-t-elle plus de poids que celle d’une femme qui n’a pas de statut politique ?» Soutien de la CGT Emmitouflée dans un blouson noir, Marie Coquille-Chambel est accueillie sous les applaudissements. Elle observe la manifestation d’un œil «ému» et «craintif». Depuis plusieurs semaines, elle est protégée par une sécurité privée. Elle affirme être la cible de nouvelles «menaces de mort proférées par Nâzim Boudjenah». Tout comme Sandrine Rousseau, elle a porté plainte en juillet 2024. Mais, contrairement à la députée dont le procès est prévu le 6 juin, Marie Coquille-Chambel n’a eu aucune nouvelle de la justice à ce jour. L’enquête est en cours, selon le parquet de Paris. Au micro, elle rappelle ce que la médiatisation de son affaire lui a coûté : «On m’a accusée de chercher la notoriété, mais aucune victime ne veut ça. J’aimerais être reconnue pour mon travail, mon militantisme, pas pour les violences que j’ai vécues.» Salomé Gadafi, secrétaire générale de la fédération CGT du spectacle, le rappelle à son tour au milieu des pancartes : cette affaire «témoigne de la difficulté que rencontrent les victimes» quand elles tentent de se faire entendre. L’exemple que rien ne se passe «sans pression médiatique ou politique» . La Comédie-Française, elle, se défend de toute inertie. Dans son communiqué du 14 janvier, elle assure avoir mis en place dès le départ «toutes les mesures nécessaires» pour protéger ses salariés, notamment en mettant Nâzim Boudjenah «à l’écart des plateaux». L’acteur, quant à lui, a démenti dans l’AFP, par la voie de son conseil, Me Florence Bourg, les accusations de viols pour lesquels elle compte «demander un non-lieu». Le comédien a par ailleurs déposé plainte contre Marie Coquille-Chambel pour «harcèlement, tentative d’escroquerie au jugement, disparition de preuves», selon son avocate. «Foutage de gueule» Selon les informations de Libération, l’entretien préalable en vue d’un licenciement du comédien a déjà eu lieu, sans que la décision ne soit encore publique. Contactée, l’avocate du théâtre, Frédérique Cassereau, explique l’absence de sanction du comédien jusqu’alors par le fait qu’il était salarié protégé, car membre élu du CSE, de 2019 à 2023. Impossible donc de se séparer de l’acteur sans passer par l’inspection du travail : «Il était presque certain que l’inspection du travail ne validerait pas un licenciement, nous aurions risqué une réintégration du salarié pour discrimination.» Elle ajoute également qu’il «n’est pas possible d’envisager de licencier quelqu’un pour des faits qui ont été commis dans la sphère personnelle et pas professionnelle, sauf pour de rares exceptions». L’exception est donc envisagée depuis la prise de parole de Sandrine Rousseau. «La Comédie-Française a appris que les menaces avaient été réitérées à l’endroit d’une autre femme et le trouble objectif en externe est devenu caractérisé, notamment avec les manifestations et les articles de presse depuis le témoignage de Sandrine Rousseau», justifie l’avocate. Malgré les milliers de partages du témoignage de Marie Coquille-Chambel sur X au moment du lancement du mouvement #MeTooThéâtre en 2021 et les articles qui en ont découlé. Face à la Comédie-Française, adossée contre un lampadaire, Agathe Pujol essuie une larme. La comédienne de 31 ans témoignait publiquement dans Libération pour la première fois le 2 janvier, accusant l’acteur Philippe Caubère de l’avoir violée pendant des années. Elle crie un «Sauvez nos sœurs, virez les violeurs» à l’unisson avec la foule. Pour elle, ce silence de la Comédie-Française «long de quatre années» n’est autre que «du foutage de gueule». «Ce qu’il faut retenir, c’est que les témoignages des gens lambdas, la Comédie-Française s’en fout. En revanche, quand une personne publique parle, on l’écoute.» Légende photo : Des membres de #MeTooThéâtre devant la Comédie-Française ce mercredi 29 janvier à Paris. (Benoit Tessier/Reuters)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 15, 9:34 AM
|
Par Radidja Cieslak avec AFP - 15 janvier 2025 Lors d’une commission parlementaire le 13 janvier à l’Assemblée, la députée écologiste a interrogé le patron de l’institution au sujet de l’un de ses membres, Nâzim Boudjenah, révélant avoir porté plainte contre lui en septembre pour menaces de mort. Le comédien a été convoqué ce mercredi. Mauvais coup de théâtre. Un pensionnaire de la Comédie-Française est convoqué par l’institution pour un «entretien préalable en vue de son licenciement», a annoncé cette dernière, mercredi 15 janvier, après avoir appris des «menaces de morts» proférées notamment à l’encontre de la députée écologiste Sandrine Rousseau. En juin 2021, cet acteur de 52 ans, Nâzim Boudjenah avait déjà été condamné à Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des menaces de mort proférées en 2019 et 2020 sur une ancienne petite amie, Marie Coquille-Chambel avec sursis probatoire de deux ans comportant une interdiction de contacter la victime, une obligation d’indemnisation et de soin. Il est malgré tout resté salarié de la Comédie-Française jusqu’à présent mais été soumis à «une mesure d’éloignement» et ne jouait plus au sein de l’institution selon Éric Ruf, son administrateur général. Or, «de nouveaux faits» - des «agissements graves» - ont été portés «à la connaissance de la Comédie-Française» lors de l’audition, lundi 13 janvier, d’Éric Ruf devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences commises dans les secteurs du cinéma et du spectacle vivant, affirme l’institution dans un communiqué. Des « menaces sérieuses » La présidente de cette commission Sandrine Rousseau a témoigné à cette occasion du fait que ce comédien avait, en juillet 2024, «aussi exercé des menaces de mort contre [elle]». «Ce qui m’a poussée à porter plainte contre lui, à faire un signalement au procureur» a-t-elle ajouté. A Libération, la députée précise que le comédien «a fait des publications sur X (ex-Twitter)» où il parle de la mettre dans une «baignoire d’acide» ou encore de lui «[casser] la tête sur le trottoir», sur des captures d’écran que Libé a pu consulter Elle se souvient également l’avoir croisé fortuitement devant l’Assemblée nationale. «Je ne le connaissais même pas», explique-t-elle à Libération. Nâzim Boudjenah interpelle la députée, et se présente comme étant l’auteur des menaces de mort à son encontre, comme elle le rapporte: «C’était un moment hallucinant, heureusement j’étais accompagnée d’un collaborateur parlementaire, j’étais donc plus sereine mais c’est très impressionnant. Il m’avait l’air d’avoir consommé des substances et était énervé.» Le procès qui l’oppose au comédien aura lieu «le 6 juin prochain». Un licenciement en vue Durant la commission parlementaire, la députée écologiste a interpellé Éric Ruf au sujet du comédien. L’administrateur du Français a confirmé qu’il y était toujours salarié mais qu’il avait «mis en place une mesure d’éloignement. Il n’a pas rejoué depuis» au sein de l’institution. L’affaire a pris une autre tournure ce mercredi, car le comédien va désormais probablement perdre son poste. «La découverte de ces nouveaux faits autorise la Comédie-Française […] à le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement», ajoute-t-elle, sans nommer ce salarié. Dans son communiqué, la Comédie-Française précise avoir «déjà pris des mesures à l’encontre de ce salarié en le mettant immédiatement à l’écart des plateaux». Elle «réfute fermement les allégations d’inertie, puisqu’elle a mis en place toutes les mesures nécessaires à prévenir et protéger la santé et la sécurité de ses salariées et salariés, ce qui est au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Elle réaffirme son soutien total aux victimes de violences sexistes et sexuelles». Radidja Cieslak avec AFP Légende photo : Nâzim Boudjenah au théâtre du Vieux-Colombier, Comédie Française, en 2019. (Agathe Poupeney/Libération) Lien vers tous les articles de la Revue de presse théâtre liés au thème "#MeToo Théâtre / Cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 3, 12:29 PM
|
Editorial d'Alexandra Schwartzbrod dans Libération - 3 jan. 2025 Les faits abjects dont le comédien est accusé par deux femmes dans «Libération» font tristement écho aux affaires Depardieu et PPDA, tant dans le mode opératoire que dans l’emprise que ces hommes auraient exercée sur les plaignantes. La lecture des témoignages d’Agathe Pujol et de Pauline Darcel, qui accusent Philippe Caubère de violences sexuelles et d’emprise, est doublement édifiante. Elle est édifiante parce que les faits qu’ils dénoncent sont intolérables et abjects. Elle est édifiante parce qu’on y retrouve le même mode opératoire que dans certaines grandes affaires ayant défrayé la chronique ces dernières années, celles concernant Gérard Depardieu ou Patrick Poivre d’Arvor, deux hommes de la même génération. Là encore, le scénario semble être le même : un personnage puissant dans son milieu, adulé par des femmes très jeunes, profite de son aura pour attirer dans sa toile des personnes vulnérables, soit en raison de leur jeune âge, soit en raison de leur solitude, soit en raison de leur classe sociale. Ces violences dénoncées découlent d’un narcissisme et d’un égotisme fous mais aussi d’une grande lâcheté, car quoi de plus facile que de profiter de mineures ou de femmes jeunes et sans défense qui comprennent trop tard ce qui est en train de leur arriver. Formé à l’école du théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, fondé peu après 1968 dans un esprit communautaire, Philippe Caubère a été la figure de proue d’un certain théâtre hérité de ces années-là, à la parole décomplexée, au jeu virtuose et exaltant voire exalté. Il fait partie de cette génération post-1968 pour laquelle tout semblait permis, y compris les pires interdits, ce qu’il revendiquait dans des «seul en scène» très autobiographiques qui faisaient chaque fois salle comble. Mais ça, c’était avant #MeToo, qui a soudain ouvert les yeux de la société sur les nombreux abus dont les femmes étaient victimes dans tous les milieux, et d’abord dans celui de la culture. Philippe Caubère a d’ailleurs été un de ceux qui ont très vite dénoncé les «dérives» de ce mouvement né des violences exercées sur les femmes par le producteur américain Harvey Weinstein. Comme quoi, on peut être talentueux mais se comporter en parfait salaud et ne rien comprendre aux évolutions du monde. Alexandra Schwartzbrod / Libération Lien vers tous les articles de la Revue de presse théâtre liés au thème "#MeToo Théâtre / Cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 2, 4:33 PM
|
Par Cassandre Leray dans Libération - 2 janvier 2025 Condamnée pour diffamation contre l’acteur, qui conteste les nouvelles accusations de viols qui le visent aujourd’hui, la comédienne se dit «scandalisée et meurtrie» par le traitement de l’affaire par la presse et la justice, au début du mouvement #MeToo. Elle parlait pour «protéger toutes les autres femmes et filles». Le 13 mars 2018, la comédienne Solveig Halloin dépose plainte contre l’acteur Philippe Caubère. Elle l’accuse de l’avoir violée huit ans plus tôt, en mars 2010, à Béziers (Hérault), alors qu’elle avait 35 ans. Un mois plus tard, le 18 avril 2018, elle s’exprime pour la première fois dans la presse, dans une vidéo publiée par le Huffington Post. Philippe Caubère, lui, reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, mais dément tout viol. Un an après l’explosion du mouvement #MeToo, Solveig Halloin est alors l’une des rares femmes en France à prendre la parole à visage découvert. Onze mois plus tard, le 17 février 2019, le parquet de Créteil classe l’affaire sans suite. Solveig Halloin raconte aujourd’hui à Libération son travail de dramaturge «qui s’est achevé», mais aussi «la paupérisation et la dépression qui en ont découlé». «La persécution a continué», relate-t-elle : en 2018, elle est poursuivie en diffamation par Philippe Caubère. Sur ses réseaux sociaux, en avril de la même année, la plaignante avait mis en cause le comédien. «Faire bouger les institutions pétries de culture du viol» Se disant «incapable» de croiser Philippe Caubère «après les tortures qu’il [lui] a fait vivre», il lui est «impossible» de se rendre à l’audience où elle est poursuivie pour diffamation, le 18 juin 2021. Trois mois plus tard, elle est condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l’artiste, ainsi que 2 000 euros pour ses frais de justice. Elle ne fera pas appel, ni de sa condamnation ni du classement sans suite de sa plainte, «scandalisée, meurtrie, revictimisée par les violences policières, judiciaires et médiatiques. La triple peine est un cauchemar», dénonce Solveig Halloin, aujourd’hui âgée de 49 ans. Pendant des années, elle est accusée d’avoir «instrumentalisé» la cause #MeToo, des mots de Philippe Caubère et son ancienne avocate Me Marie Dosé. A l’époque, l’acteur est soutenu par de nombreux médias, qui le dépeignent en victime des «dérives» du mouvement féministe. Dans la presse, la publication du témoignage de Solveig Halloin est ainsi désignée comme un «dérapage médiatique» aux lourdes «conséquences» pour Caubère. Au cours d’une interview, un journaliste lui demande même : «Avez-vous le sentiment d’être une victime de la vague #MeToo ?» Tandis que dans un autre article, la crédibilité de la comédienne est questionnée : «Force est de reconnaître que trois ans après le dépôt de la plainte […] aucune autre victime ne s’est jamais fait connaître.» Sur les réseaux sociaux, les mots sont violents : elle y est aussi bien traitée de «folle» que de «menteuse». En juin dernier, la comédienne dénonçait dans une enquête de Mediapart le «fiasco judiciaire et médiatique» qui a suivi sa plainte. A Libération, Solveig Halloin l’affirme : «Une femme qui parle en sauve mille, mille femmes qui parlent sauvent toutes les femmes, c’est comme cela que l’on fait bouger les institutions pétries de culture du viol.» Margot accuse Philippe Caubère de l’avoir violée en avril 2006 Dès la publication de son témoignage, Solveig Halloin reçoit des messages de femmes «qui [lui] racontent les violences perverses commises par Caubère», retrace la dramaturge, dont elle donne les noms à la police. Dans cette liste, une apprentie comédienne, Pauline Darcel, alors âgée de 23 ans. Le 23 novembre 2018, celle-ci reçoit un appel surprise de la police judiciaire de Créteil à propos de Caubère. Selon le procès-verbal de l’entretien, consulté par Libération, Pauline Darcel décrit une fellation au cours de laquelle Philippe Caubère «fait preuve de brutalité» alors qu’elle n’avait que 16 ans. Sur le papier, l’agent indique pourtant qu’elle n’a subi «aucune violence sexuelle», bien que Caubère, écrit-il, ait su «profiter de sa jeunesse et de son état de vulnérabilité». En raccrochant, Pauline Darcel pense que ce qui lui est arrivé «n’est pas pénalement répréhensible». Et abandonne l’idée d’entamer toute démarche judiciaire. «L’agent qui m’a appelée me répétait que ce que j’avais vécu n’était pas grave, que ce n’était pas vraiment du viol», souligne-t-elle. Il lui faudra «des années» pour redonner sa confiance à la justice, jusqu’à sa plainte en octobre 2022, suite à laquelle Philippe Caubère a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineure en février 2024. Quand Margot (1) est à son tour contactée par la police après avoir écrit à Solveig Halloin, elle reste «tétanisée». Elle ne répondra jamais au mail des enquêteurs. «Je ne me sentais pas prête à plonger tête baissée dans une procédure judiciaire. Encore moins avec l’emballement médiatique que cette affaire générait», confie-t-elle. Elle accuse pourtant Philippe Caubère de l’avoir violée en avril 2006, quand elle avait 20 ans. Selon son récit, le comédien l’invite chez lui, à Saint-Mandé (Val-de-Marne) après l’avoir rencontrée à la fin de l’un de ses spectacles. «Un soir, il me met la pression pour qu’on ait une relation sexuelle», relate-t-elle. Elle raconte qu’après son refus, il lui «demande une fellation à la place». De nouveau, elle dit non. «Il me répond que si j’hésite, notre relation ne vaut rien», rapporte Margot. Quelques minutes après, décrit-elle, «il m’attrape, me jette sur son lit et me pénètre brutalement. J’ai juste regardé le plafond en espérant que tout s’arrête». Questionné à ce sujet par Libération, Philippe Caubère explique, par l’entremise de ses avocates Me Julia Minkowski et Me Eléonore Heftler-Louiche, qu’il n’a «pas connaissance» de telles accusations. Soutien à Sofiane Bennacer et Gérard Depardieu Six ans plus tard, Margot, 38 ans aujourd’hui, ne souhaite toujours pas porter plainte. Témoigner dans la presse lui est déjà difficile : «La façon dont la plainte de Solveig Halloin a été médiatisée, puis sa condamnation en diffamation, en dit long sur la manière dont on recevait les témoignages des victimes à l’époque», soupire-t-elle. Un mot en particulier lui reste en tête : dans plusieurs médias, elle lit que l’acteur est «blanchi» après le classement sans suite de la plainte de Solveig Halloin. Pourtant, une telle décision met simplement un terme aux investigations en raison d’un manque d’éléments probants. Elle ne dit pas autre chose. Une situation fréquente dans ces dossiers, pour lesquels il est difficile de rassembler des preuves : selon une étude de l’Institut des politiques publiques parue en avril, 94 % des affaires de viols sont classées sans suite. 24 nov. 2022 édition abonnés Philippe Caubère n’a jamais caché ses positions vis-à-vis du mouvement MeToo. En janvier 2023, il faisait partie des signataires d’une tribune dans le Point en soutien à l’acteur Sofiane Bennacer, mis en examen pour viols sur plusieurs femmes, dont les témoignages ont été révélés par Libération. En décembre 2023, il signait cette fois dans le Figaro une tribune de soutien à l’acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour viols et appelé à comparaître en mars 2025 pour «agressions sexuelles» contre deux femmes. Chaque fois, les textes dénoncent une «présomption de culpabilité» qui serait infligée aux hommes mis en cause. Philippe Caubère s’estime lui-même touché. En 2018, il racontait à Libération «tomber des nues» devant le témoignage de Solveig Halloin. Six ans plus tard, trois autres femmes ont déposé plainte contre lui. (1) Le prénom a été modifié. Légende photo : La comédienne Solveig Halloin à Toulouse, le 19 novembre 2024. (Cha Gonzalez/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2024 12:17 PM
|
Publié par Mediapart le 3 décembre 2024 Article (incluant la vidéo de l'entretien avec Sara Forestier) en accès libre Lien avec la vidéo (1h) Invitée de « À l’air libre », l’actrice Sara Forestier revient sur son témoignage devant la commission d’enquête relative aux violences dans le cinéma. Elle s’exprime pour la première fois sur sa plainte déposée en 2023 contre Nicolas Duvauchelle, qu’elle accuse de l’avoir giflée sur un tournage.
C’est l’une des auditions les plus marquantes de la commission d’enquête parlementaire sur les violences dans le monde du cinéma. Le 7 novembre, l’actrice Sara Forestier a témoigné de violences subies pendant sa carrière, et décrit « la machine à broyer des talents », selon les mots du rapporteur (MoDem) Erwan Balanant. Invitée de notre émission « À l’air libre », l’actrice de 38 ans, révélée dans L’Esquive (2003), d’Abdellatif Kechiche, relate la difficulté de l’industrie cinématographique à prendre en charge la question des violences, la « focalisation » sur les femmes qui dénoncent des violences, et les mauvaises « réputations » qui leur seraient faites en retour : « Ils cherchent peut-être Mère Teresa, mais il n’y a pas de victime parfaite. » Elle revient aussi sur l’impact de la parole de la comédienne Adèle Haenel en 2019 – affaire dont le procès se tiendra les 9 et 10 décembre au tribunal correctionnel de Paris. Sara Forestier révèle avoir elle-même témoigné à l’appui d’une plaignante dans la procédure visant Jacques Doillon, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes (le réalisateur conteste les faits et a déposé une plainte en diffamation contre la comédienne Judith Godrèche) : « J’ai tourné avec Jacques Doillon [dans le film Mes séances de lutte (2013) – ndlr], une plaignante a porté plainte contre lui, j’ai témoigné dans ce cadre-là pour dire des choses que j’avais vues et qu’avait faites Jacques Doillon sur ce tournage, sur cette fille-là. » Sur notre plateau, la comédienne revient également sur son témoignage à l’égard de l’acteur Nicolas Duvauchelle, qu’elle accuse de l’avoir giflée sur le tournage du film Bonhomme en 2017. Selon nos informations, elle a déposé une plainte en mars 2023 et une enquête préliminaire est en cours au parquet de Paris. Elle annonce qu’elle compte aussi porter plainte en diffamation contre le comédien, qui l’a qualifiée, le 8 novembre, sur le réseau social X, de « mythomane », et qui a assuré – à rebours de ses déclarations dans le dossier judiciaire – que c’est elle qui l’aurait « giflé ». Sollicité par Mediapart pour un entretien vidéo, Nicolas Duvauchelle, qui est présumé innocent, a répondu qu’il ne souhaitait « pas [s’]exprimer davantage à ce stade ». Il nous a indiqué qu’il n’avait « jamais frappé Sara Forestier » et que les propos de l’actrice à son égard étaient « absolument faux ». De son côté, le producteur du film, Denis Pineau-Valencienne, nous a fait savoir qu’il n’y avait eu « ni gifle ni violence physique » d’après les cinq témoignages écrits qu’il avait à l’époque recueillis auprès de « membres de l’équipe présents sur place ». La réalisatrice, Marion Vernoux, nous a également répondu qu’à sa connaissance, aucune gifle n’avait été donnée par l’un ou par l’autre. « Qu’a-t-il bien pu se passer pour qu’ils en viennent à de telles extrémités verbales ? Je m’approche pour tenter de les calmer. Ils continuent de se cracher au visage des insanités. Sans doute quelques postillons haineux atterrissent-ils sur le visage de l’autre. En termes de violence physique, je ne peux témoigner que de cela », écrit-elle dans le témoignage qu’elle a transmis à Mediapart. La cinéaste explique avoir, au moment des faits, refusé d’appuyer la main courante de Sara Forestier au commissariat, car elle ne voulait pas faire « un faux témoignage », même pour sauver son film, dit-elle. Après l’enregistrement de cette émission le mardi 26 novembre, Sara Forestier a souhaité réagir à la réponse de Marion Vernoux : « J’ai fait cette émission parce que dans le cinéma et la société, il faut briser les chaînes des complicités. Les silences complices ça n’existe pas, ce sont des “tais-toi” complices, des culpabilisations complices, des minimisations d’actes des agresseurs. Il faut que cessent les complicités, pour que les agresseurs se retrouvent affaiblis, démunis, et moins forts dans leur domination. J’y crois. » * Une émission préparée et présentée par Mathieu Magnaudeix et Marine Turchi, journaliste au service enquêtes de Mediapart. Retrouvez toutes nos émissions ici.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 22, 2024 1:14 PM
|
Par Samuel Douhaire dans Télérama - Publié le 29 août 2024 La première accuse Catherine Breillat de viol sur le tournage de “Romance” en 1999. La seconde raconte dans “Elle” avoir été blacklistée après avoir dénoncé la toxicité d’Arnaud Desplechin. Des témoignages longtemps méprisés… jusqu’à aujourd’hui. Deux actrices accusent deux grands cinéastes de viol d’une part et de comportement toxique d’autre part. Caroline Ducey, après vingt-cinq années de silence, révèle dans son livre La Prédation (nom féminin), paru chez Albin Michel, avoir subi un viol en tournant une scène de Romance (1999), de Catherine Breillat, et avoir été sous l’emprise de la réalisatrice — ce que cette dernière dément. Marianne Denicourt, dix-huit ans après le procès pour « atteinte à la vie privée » qu’elle a perdu contre Arnaud Desplechin — alors que le tribunal avait reconnu que l’auteur de Rois et reine (2004) avait « créé son film autour de son histoire et de celles de ses proches » —, raconte dans le magazine Elle comment son ex-compagnon a « pillé » son existence et « utilisé son art pour la détruire psychiquement ». À l’époque des faits, la première s’était « bâillonnée par fierté et par déni d’être victime », avant d’être longtemps minée par la dépression et la toxicomanie. La seconde, dont la carrière était en pleine ascension, a pratiquement disparu des écrans pour, explique-t-elle, avoir « osé attaquer la coqueluche du cinéma français et la boîte [Why Not Productions, ndlr] qui produisait tout le cinéma d’auteur ». À lire aussi : Jacquot, Doillon… Cinéastes tout-puissants et actrices sous emprise : enquête sur un système de prédation Mais depuis, le mouvement #MeToo a libéré la parole. Et les mots d’Adèle Haenel, de Judith Godrèche, de Juliette Binoche, entre autres consœurs, ont donné à Caroline Ducey et à Marianne Denicourt la force, le courage et la volonté de s’exprimer à leur tour pour que les abus cessent enfin. Le cinéma français, qui les a largement ignorées, sinon méprisées hier, serait bien inspiré d’entendre aujourd’hui leurs témoignages. Et leur leçon : un artiste, si talentueux soit-il, ne peut pas, ne peut plus, tout se permettre au nom de la liberté de création. Samuel Douhaire / Télérama Lien vers tous les articles de la Revue de presse théâtre liés au thème "#MeToo Théâtre / Cinéma" Légende photo : Caroline Ducey dans « Romance », de Catherine Breillat, en 1999, et Marianne Denicourt dans « La Vie des morts », d’Arnaud Desplechin, en 1991. Flash Films/Odessa
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...