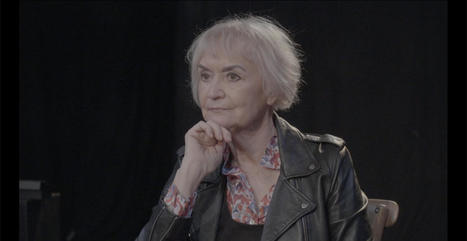Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 20, 2023 6:07 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 19 octobre 2023 Dans les Centres dramatiques nationaux (CDN), la parité est quasi atteinte en termes de direction et de programmation. Et elle progresse sur les scènes nationales. On revient pourtant de loin. Ne boudons pas, attrapons les bonnes nouvelles, même lorsqu’elles se présentent sous la forme d’une forêt touffue de chiffres. Longtemps, l’égalité des hommes et des femmes, dans et sur les scènes publiques labellisées, était un genre d’Himalaya supposé inaccessible. Pas assez d’autrices dramatiques, pas assez de metteuses en scène, pas assez d’artistes femmes ayant envie de diriger une structure, prétendait-on pour qu’il soit possible d’envisager des saisons théâtrales paritaires et une direction qui ne soit pas majoritairement masculine. Jusqu’à l’année dernière, les chiffres étaient impitoyables : lorsque les femmes étaient majoritaires, c’était parce que les spectacles dont elles se chargeaient avaient trait à la jeunesse ! Elles restent toujours surreprésentées dans cette catégorie. Pour le reste, ça s’arrange. Deux études dont Libération a eu la primeure indiquent une inflexion, qui prouve que la volonté collective vers moins de discrimination sexuelle est payante. La première provient de l’Association des Centres dramatiques nationaux (ACDN), dont les 38 directions ont signé en 2022 pendant le festival d’Avignon une charte les engageant à œuvrer concrètement en faveur de l’égalité femmes-hommes dans la programmation, les budgets alloués, ainsi que les jauges offertes aux spectacles. L’ACDN s’est associée à une chercheuse doctorante, Inés Picaud Larrandart, qui mène à ses côtés un travail d’analyse sur la mise en œuvre de la parité et explore également les questions de diversité – où tout reste à faire. L’analyse fine de la saison 2022-2023 constitue donc une sorte d’année zéro. Elle montre que dans les Centres dramatiques nationaux, ces structures dont la spécificité est d’être dirigées par un artiste, la parité est quasi atteinte en termes de direction et de programmation. On revient pourtant de loin. En 2006, seulement trois femmes étaient à la tête d’un CDN. Aujourd’hui, elles sont 19, dont 3 co-directrices qui partagent leur mission avec un directeur, sur les 38 structures existantes. Toujours dans les CDN, en termes de programmation, de durée des séries, de jauges allouées, les nouvelles sont bonnes : 50,5% des spectacles ont été mis en scène par des femmes et ils sont programmés aussi longtemps que ceux proposées par des hommes, dans des jauges légèrement plus restreintes, mais légèrement plus remplies Un seul théâtre national dirigé par une femme La metteuse en scène Emilie Capliez, qui préside l’association, incite pourtant à ne pas faire sonner trop vite les youyous de la victoire. Notamment parce qu’une disproportion dans les moyens alloués, nerf de la guerre pour produire des spectacles, est criante. Tout se passe comme si les tutelles acceptaient de nommer des femmes dans des structures à condition qu’elles soient petites, circonscrites, modestes, et qu’elles ne fassent pas trop de bruit. Leur art séculaire de savoir accommoder les restes est-il censé déteindre sur leur pratique et leur permet-il de savoir mieux que leurs homologues masculins comment faire plus avec moins ? Les cinq CDN les mieux dotés sont dirigés par des hommes tandis que quatre des cinq les moins lotis le sont par des femmes ! Qu’en est-il dans les autres structures publiques ? Et bien indiquons déjà, ce n’est pas un scoop, que si quatre des cinq théâtres nationaux – la Comédie française, l’Odéon, le Théâtre national de la Colline et Chaillot – sont dirigés par des hommes, un seul – le théâtre national de Strasbourg – l’est par une femme, Caroline Guiela NGuyen, et depuis peu. Si l’on zoome sur le théâtre du Châtelet, joyau de la ville de Paris, rappelons que c’est un homme qui vient d’y être nommé, Olivier Py, alors que la short list était constituée de deux candidatures féminines fortes (Valérie Chevalier et Sandrina Martins). Les 78 scènes nationales qui maillent le territoire français ne sont, sauf infime exception, pas dirigées par des artistes. Elles ont une mission davantage pluridisciplinaire que les CDN, au point que 23 d’entre elles intègrent un cinéma d’art et d’essai en plus de leurs salles de spectacles traditionnelles. Une autre différence de taille les distingue des CDN : la grande majorité des directions à la tête d’une scène nationale sont nommées en CDI, c’est à dire potentiellement pour la vie. Fabienne Loir , secrétaire générale de l’Association des Scènes nationales, observe elle aussi une progression nette des femmes à la tête des structures, qui passe de 26% en 2017 à 39% aujourd’hui – loin de la situation quasiment équilibrée des CDN. Et elle aussi note que les femmes, dernières arrivées, gèrent des structures plus petites et moins bien dotées que les hommes. «Plus les gens sont expérimentés, plus ils peuvent postuler à de grosses structures», constate Fabienne Loir. Nomination attendue à la tête de la Commune, à Aubervilliers On vous avait promis une forêt de chiffres, poursuivons notre promenade, armez-vous d’une machette. Les chiffres globaux de la saison 22-23 délivrés dans le nouveau rapport du Syndeac, principal syndicat des scènes subventionnées toutes catégories confondues, témoignent eux aussi d’une progression des femmes sur tous les terrains. Mais de moindre ampleur que dans les CDN, et ils sont tous en-deçà de la parité. Citons en deux : si 35% des spectacles étaient mis en scène par des femmes dans les structures adhérentes au syndicat en 2019-2020, ils sont 42% deux ans plus tard. Si elles n’étaient que 29% d’autrices représentées en 2019-2020, elles sont 35% en 2021-2022. Les pourcentages cachent de fortes disparités entre les structures, et le Syndeac promet «d’examiner, au cas par cas, la situation des adhérents dont les chiffres sont très éloignés des objectifs afin de trouver des soutions». On peut s’en réjouir : les tutelles – l’Etat, les municipalités, les collectivités locales, la région – prennent garde de nommer des femmes à la tête des structures. Mais savent-elle les renommer ? Autrement dit, les directrices jeunes et moins jeunes peuvent-elle faire fructifier leur expérience ? Ou se retrouvent-elles fatalement «à la rue» après leurs bons et loyaux services ? Pour l’instant, seulement deux femmes metteuses en scène ont pu renouveler leur expérience de directrice de CDN. La salve de nominations récentes – Bérangère Vantusso à la tête du CDN de Tours, Fanny de Chaillé au CDN de Bordeaux, Marcial Di Fonzo Bo au Quai à Angers – ne modifie pas l’équilibre. Restent encore deux lieux à pourvoir : la Comédie de Caen et, de manière imminente, la Commune – CDN d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, lieu emblématique de la démocratisation culturelle. Et où figurent en dernière sélection Célie Pauthe et Laetitia Guedon, toutes deux en fin de mandat. La Commune va donc concentrer tous les regards. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Fanny de Chaillé (CDN de Bordeaux), Caroline Guiela Nguyen (Théâtre national de Strasbourg) et Bérangère Vantusso (CDN de Tours). (Frédérick Florin/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 17, 2023 4:20 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 17 mai 2023 La pièce réécrite par la metteuse en scène Lisaboa Houbrechts peine à ancrer ses personnages dans la tragédie d’Euripide.
Lire l'article sur le site du "Monde" :https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/05/17/une-medee-sans-amarres-a-la-comedie-francaise-a-paris_6173772_3246.html
Des comédiens qui jouent assis, prostrés ou couchés à terre, ce n’est pas un détail, c’est un écueil de taille. De là à déduire que Lisaboa Houbrechts, metteuse en scène de Médée, d’après Euripide, à la Comédie-Française, veut soustraire son spectacle aux regards du public, il n’y a qu’un pas. On comprendrait qu’il soit franchi par l’assemblée, qui doit se contorsionner pour apercevoir les corps présents sur la scène. Ces corps étant eux-mêmes contraints dans de rigides costumes taillés entre l’antique et le futurisme, la tragédie a bien du mal à se connecter à notre présent. Les ponts qui la relient au monde contemporain sont pourtant nombreux : quittée par son époux Jason, le père de ses deux fils, chassée de Corinthe par le roi Créon, Médée, fille du roi de Colchide, se venge de la plus terrible des manières. Elle assassine Créüse, nouvelle compagne de son mari (et fille de Créon), puis égorge ses enfants avant de se réfugier chez Egée, roi d’Athènes. Colère d’une amoureuse trahie, rage d’une reine constamment renvoyée à son statut d’étrangère : l’emboîtement des sphères privée et politique redouble l’impact du drame. Sans compter qu’à ce condensé d’ingrédients explosifs, s’ajoute le geste ultime, l’infanticide. Médée est un brasier qui n’attend que l’allumette pour prendre feu. Mais l’incendie ne prend pas, en dépit d’une musique apocalyptique dont le volume rivalise avec les hurlements de Médée. A l’image des « si seulement », réitérés par le comédien Bakary Sangaré (il joue la nourrice de la meurtrière), qui suggèrent que ce qui a lieu aurait pu ne pas advenir, le spectacle s’inscrit dans une sorte de conditionnel dubitatif, sans jamais vraiment affirmer l’ici et maintenant du théâtre. La faute à une représentation écartelée entre ses aspirations au sensible et la raideur stylisée de sa forme. La faute aussi à ces corps trop souvent invisibilisés au profit d’images qui cultivent la métaphore. Spectaculaires cérémonies visuelles L’œil fixé sur les cintres vers lesquels s’élèvent (ou dont descendent) des éléments de décor (longue traîne bleue, vêtements d’enfants, ballons de baudruche noirs, pluie de sable doré), Lisaboa Houbrechts semble suggérer qu’existe un conflit insoluble entre verticalité (lieu du divin) et horizontalité (siège du terrien, donc de l’humain). Ce qui se passe en altitude l’emportant en beauté, tenue et éloquence, les acteurs et leurs personnages errent sur les planches, l’air de se demander ce qu’ils y font, comme abandonnés par leur metteuse en scène. Si Lisaboa Houbrechts, née en Belgique en 1992, est indéniablement une femme de plateau qui sait organiser de spectaculaires cérémonies visuelles, son rapport à l’acteur reste à préciser. Un couple a toutefois retenu son attention : Médée et Jason. Coiffée d’une haute coupe en brosse à la Grace Jones époque Jean-Paul Goude, Séphora Pondi est une Médée somptueuse, tour à tour démunie et impitoyable, enjôleuse et féroce, vulnérable et guerrière. Cette récente pensionnaire de la Comédie-Française affiche une force brute, l’aplomb de la jeunesse et un charme qui désarme même au plus fort de l’abjection. D’où le regain d’intérêt lorsqu’elle se confronte à Jason, lequel est incarné avec une justesse émouvante par Suliane Brahim. Une femme, donc, pour être tout à la fois mari infidèle, amant ingrat, père distant et homme friable. Jason ne fait pas le poids face à la fureur et l’intelligence de celle qui, en tuant ses enfants, s’est mise hors-jeu de l’humanité. Tandis que Médée quitte le drame, juchée au sommet d’une sculpture (une tête ébréchée, où elle occupe la place du cerveau mis à nu), Jason ploie sous la coulée de sable qui chute depuis les cintres. Décidément, salle Richelieu, il ne fait pas bon vivre au ras du sol. Médée, d’après Euripide. Adaptation et mise en scène de Lisaboa Houbrechts. Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1er. Jusqu’au 24 juillet. De 5 € à 48 €. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photos : « Médée », d’après Euripide, mise en scène par Lisaboa Houbrechts avec, de gauche à droite, Bakary Sangaré (la nourrice), Suliane Brahim (Jason) et Séphora Pondi (Médée), à la Comédie-Française, à Paris, le 10 mai 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/HANS LUCAS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2023 5:58 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - Publié le 10 mai 2023
L’autrice, comédienne et metteuse en scène italienne est l’artiste invitée de la 11ᵉ Biennale internationale des arts de la marionnette, à Paris, avec une trilogie sur la place des femmes dans la société patriarcale.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/05/10/marta-cuscuna-et-ses-marionnettes-se-font-l-echo-des-luttes-feministes_6172815_3246.html
Marta Cuscuna pourrait parler des heures de ses deux passions : les marionnettes et les résistances féminines. Née en juin 1982 à Monfalcone, dans la région autonome du Frioul-Vénétie julienne (Italie) – une « petite ville ouvrière connue pour ses chantiers navals où se construisent les plus grands paquebots de croisière du monde, mais aussi tristement célèbre pour son taux extrêmement élevé de décès liés à l’amiante », comme elle la dépeint sur son site Internet –, elle s’imaginait pourtant faire une carrière d’actrice classique et partager les planches avec des condisciples de chair et d’os. Une rencontre décisive a bouleversé son parcours professionnel. On est au début des années 2000, Marta Cuscuna suit une formation de quelques semaines à Prima del Teatro, l’Ecole européenne pour l’art de l’acteur, à San Miniato, près de Pise, et elle croise le chemin d’un « maître catalan de la marionnette » : Joan Baixas. C’est grâce à lui et à son enseignement qu’elle découvre les arts de la marionnette et le théâtre d’objets. Elle n’en avait guère entendu parler auparavant, car, comme elle le souligne avec une pointe de regret, « ce type de langage artistique n’est pas du tout inclus dans les programmes d’études dans les écoles de théâtre italiennes traditionnelles ». L’apprentie comédienne, qui se destinait à se faire l’interprète de textes écrits par d’autres, est alors repérée par son professeur. « Ecoutez, à mon avis, ce sont les modes d’expression qui vous conviennent, et si j’en ai la possibilité, je vous appellerai pour travailler à Barcelone avec moi », lui dit-il. Promesse tenue en 2006. Joan Baixas lui propose de travailler sur le projet Merma Never Dies, la reprise à la Tate Modern Gallery de Londres de l’un de ses spectacles-phares, Mori el Merma, créé en 1978 avec le peintre Joan Miro d’après les figures imaginées par Alfred Jarry dans Ubu roi. A la fin des années 1970, dans une Espagne qui vient à peine de sortir de la dictature de Franco (mort en 1975), ce spectacle a une portée politique considérable et se moque férocement du « Caudillo ». Cette collaboration avec Joan Baixas dure jusqu’en 2009, date à laquelle Marta Cuscuna crée sa première œuvre en tant qu’autrice, metteuse en scène et interprète, E bello vivere liberi ! Un message politique De cette première expérience, Marta Cuscuna retient deux leçons fondamentales : le théâtre est un lieu idéal pour transmettre un message politique, et les marionnettes, ces créatures inanimées auxquelles l’artiste donne vie, « permettent souvent de traiter des thèmes extrêmement politiques et peuvent même être plus efficaces que des êtres humains ». Parallèlement à un fort engagement militant personnel, la comédienne se passionne pour l’étude approfondie des luttes féministes à travers les siècles et finit par en faire sa source d’inspiration principale pour ses pièces. Ses spectacles présentés dans le cadre de la 11e Biennale internationale des arts de la marionnette (BIAM) à Paris et à Pantin (Seine-Saint-Denis), de mercredi 10 à mercredi 17 mai, forment ainsi une trilogie « personnelle » sur la résistance des femmes face au patriarcat, à différentes époques et dans diverses sociétés : dans La Semplicita ingannata (2012), les Clarisses d’Udine, une communauté religieuse italienne du XVe siècle, ont transformé leur couvent en un espace de contestation et de liberté face à la domination masculine de l’époque ; dans Sorry, Boys (2015), une petite ville américaine du Massachusetts est confrontée, de nos jours, au pacte conclu par dix-sept lycéennes qui ont choisi d’accoucher simultanément pour élever leurs bébés en communauté (un fait divers bien réel, ayant inspiré films et romans) ; dans Il canto della caduta (2018), un peuple pacifique dirigé par des femmes et vivant en harmonie avec la nature est massacré par un roi belliqueux des temps préchrétiens, d’après le mythe ladin du royaume des Fanes. « Côté performeuse » Pour Isabelle Bertola, directrice du Mouffetard-Centre national de la marionnette, qui organise la BIAM, le choix de Marta Cuscuna comme artiste invitée de cette édition 2023 « fait réellement sens » dans une manifestation placée sous le signe des « résistances ». Séduite par les multiples compétences de cette artiste, à la fois autrice, metteuse en scène et unique interprète-manipulatrice de ses créations, et par son « côté performeuse » sur les planches, Isabelle Bertola voit dans sa trilogie une réflexion intelligente sur « le pouvoir des femmes à se mobiliser ensemble pour transformer les relations humaines ». Elle l’avait découverte au Théâtre de la Ville, à Paris, en 2015-2016 dans le cadre des Chantiers d’Europe, une programmation permettant à de jeunes artistes européens de se produire en France. BIAM, Chantiers d’Europe, Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières… autant d’initiatives françaises auxquelles Marta Cuscuna a pu participer pour faire connaître ses spectacles à l’étranger et rencontrer d’autres artistes, et dont elle déplore l’absence en Italie. Elle qui est pourtant artiste associée au Piccolo Teatro de Milan depuis 2022 dénonce « la précarité du travail » et « la situation des travailleurs du spectacle en Italie, qui est décidément terrifiante, par rapport à la France ». A son grand regret, dans son pays natal, « le soin et le respect pour le travail artistique, qui existent encore ailleurs, ont complètement disparu ». Toujours seule sur scène pour manipuler jusqu’à une douzaine de corps ou de têtes de personnages différents, Marta Cuscuna évoque l’importance d’un travail d’équipe en coulisses. Tout d’abord avec sa scénographe et conceptrice de créatures − et surtout des astuces pour les commander à distance, notamment avec un système à base de freins de vélo et de joysticks −, Paola Villani, rencontrée en 2009 dans les locaux de Centrale Fies, un centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, à Dro, près du lac de Garde, dans la province de Trente, sa « maison », comme elle la surnomme, pendant près de dix ans. Mais aussi avec Marco Rogante, son complice de toujours pour l’écriture et la mise en scène. Sans oublier son indispensable traductrice, Federica Martucci, qui fait « un merveilleux travail » pour aider à la diffusion des spectacles en France, notamment en suivant de près le surtitrage qui va permettre au public de la BIAM de découvrir, jusqu’au 17 mai, la trilogie dans sa langue d’origine. La marionnette contemporaine voit grand Annulée il y a deux ans pour cause de Covid-19, la Biennale internationale des arts de la marionnette revient en force pour cette onzième édition. Avec des chiffres impressionnants : 39 spectacles proposés par 33 compagnies françaises et étrangères (sept pays représentés), répartis dans 27 lieux partenaires à Paris et en Ile-de-France, soit dix-huit villes dans six départements, pour un total de 138 représentations sur vingt-trois jours, jusqu’au 4 juin. Avec au programme, entre autres, des focus sur les compagnies Agrupacion Señor Serrano, venue de Barcelone, avec les spectacles Birdie et The Mountain, et Tro-Héol, originaire de Quéménéven (Finistère), avec Everest, Scalpel et Plastic. A noter : une sélection de formes courtes du programme OMNIprésences sportives (dans le cadre de l’Olympiade culturelle) sera visible gratuitement à Paris et en Seine-Saint-Denis. VIDEO Interview de Marta Cuscunà, artiste invitée de la BIAM Biennale internationale des arts de la marionnette. En Ile-de-France, jusqu’au 4 juin. Lemouffetard.com Légende photo : Marta Cuscuna et deux marionnettes animées de son spectacle « Il Canto della caduta », en octobre 2018. DANIELE BORGHELLO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 24, 2023 8:05 AM
|
Par Valentin Pérez dans Le Monde - 24/04/2023 Cette metteuse en scène à succès est nommée trois fois aux Molières, qui seront diffusés le 24 avril sur France 3. Au sein d’une profession encore très masculine, elle n’aime rien tant que mettre les actrices dans la lumière. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/04/24/ceremonie-des-molieres-johanna-boye-donne-les-beaux-roles-aux-femmes_6170796_4500055.html
Parmi les professionnels éligibles pour être nommés aux Molières, la cérémonie qui récompense l’élite du théâtre français et qui sera retransmise en direct sur France 3 le 24 avril à partir de 21 h 10, Johanna Boyé était celle qui pouvait avoir l’avantage du nombre. Car ce sont pas moins de quatre pièces mises en scène par ses soins, toutes proposées à Paris à l’automne 2022, qui étaient susceptibles d’être sélectionnées. « Autant de spectacles, je craignais que cela puisse jouer en ma défaveur », redoutait celle qui se consacre à la mise en scène depuis dix ans. Finalement, trois d’entre eux figurent sur la liste des nominations : La Fille aux mains jaunes, de Michel Bellier, sur la solidarité entre ouvrières en 1917, au Théâtre Rive gauche ; Je ne cours pas, je vole !, des portraits de groupes d’athlètes célèbres (Laure Manaudou, Usain Bolt…), au Théâtre du Rond-Point ; et sa libre adaptation, traversée de sous-textes féministes et écologistes, de La Reine des neiges, à la Comédie-Française. Outre la course pour les prix de la mise en scène, de la pièce de théâtre public ou du jeune public, Johanna Boyé est aussi reconnue grâce aux nominations de ses comédiennes. Au point que, du côté des révélations féminines, trois des quatre potentielles lauréates – Vanessa Cailhol, Léa Lopez, Anna Mihalcea – concourent avec des rôles que Johanna Boyé leur a confiés. « C’est ce qui me rend le plus fière, dit-elle. Parvenir à éclairer des femmes sur un plateau. » Si son travail, enlevé, souvent rythmé par des séquences musicales et dansées, ne contient pas de propos frontalement militant, elle se déclare féministe, « au sens où il m’est important de mettre en valeur les femmes dans leur puissance, dans leur autonomie ». Ces galeries de personnages qu’elle affectionne A 39 ans, elle fait aujourd’hui partie d’une relève féminine de la mise en scène, un métier qui demeure majoritairement masculin, tant dans les distributions que dans les honneurs. Théâtres privé et public confondus, le Molière de la mise en scène a ainsi été remporté, au cours des deux dernières décennies, par seize hommes pour quatre femmes (et un duo, en 2022, Valérie Lesort et Christian Hecq pour leur Voyage de Gulliver). « On dira d’un homme qu’il est exigeant là où on dira d’une femme qu’elle est dure », remarque Johanna Boyé. « Les créations où il y a davantage de femmes sur le plateau sont les plus apaisées. Plus il y a d’hommes et plus je dois m’imposer, passer en force, gronder », ajoute-t-elle, alors qu’elle développe pour les mois à venir une relecture du roman de Jane Austen Orgueils et préjugés au casting 100 % féminin. Les comédiennes joueront indifféremment femmes et hommes dans une de ces galeries de personnages qu’elle affectionne, avide de confier à une poignée d’actrices les rôles d’une trentaine de protagonistes. « J’aime la force du transformisme : enfiler un chapeau, ajouter une moustache, et hop, devenir quelqu’un d’autre. » Fille unique élevée à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) par une mère psychologue-orthophoniste et un consultant en management, elle se souvient être toujours allée au théâtre, poussée par la gourmandise de son père qui l’emmenait voir « tout ce que Télérama conseillait ». Adolescente, elle est une claveciniste « timide au point de peiner à aller vers les autres ». Son père la pousse vers le cours Florent comme on prescrit une thérapie. Et lui fait trouver sa voie. Après une dizaine d’années d’une carrière de comédienne, elle bascule vers la mise en scène à 30 ans. « Je me sentais limitée dans mon statut d’interprète. J’avais envie de dire : pousse-toi, je vais le faire ! » Admiratrice de Mnouchkine et de Pommerat Après un Feydeau, elle fait mouche, dans le off du Festival d’Avignon 2018, avec Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Ce portrait bondissant et irrévérencieux de l’actrice lui vaut un Molière du spectacle musical et fait d’elle un nom courtisé dans le théâtre privé, avec des créations appréciées du public – en moyenne entre 200 et 300 représentations par pièce –, parfois adaptés de textes contemporains, comme L’Invention de nos vies, de Karine Tuil (Grasset, 2013). Ce succès attire l’attention d’Eric Ruf, le patron de la Comédie-Française, qui lui fait confiance pour sa Reine des neiges (pièce qui a divisé les critiques cet hiver, dans un nuancier d’adjectifs allant de « poétique » à « bécasson »). « Sans forcer, Johanna est mine de rien parvenue à flirter avec cette frontière si délicate entre théâtre privé et public, un pied dans chaque », louent ses fidèles coproducteurs, Fleur et Thibaud Houdinière. De fait, peu de metteurs en scène parviennent à frayer avec les deux mondes. « On est beaucoup dans ma génération à souffrir de cette dichotomie. Personnellement, je me suis toujours sentie à mi-chemin », indique cette admiratrice d’Ariane Mnouchkine, Joël Pommerat, Thomas Ostermeier ou Ivo van Hove, têtes d’affiche du subventionné. Que faire désormais de cette « phase ascendante », comme dit l’autrice et actrice Elodie Menant, qui a à la fois coécrit et joué dans Arletty et Je ne cours pas, je vole et qui décrit Johanna Boyé comme « plus en confiance, sachant où elle va » ? Ambitieuse, l’intéressée aimerait désormais s’autoriser une échappée vers l’opéra. Pourquoi pas diriger un théâtre. Et, d’ici là, repartir, qui sait, avec son premier Molière de la mise en scène. Valentin Pérez / Le Monde Légende photo : Johanna Boyé, au Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris, le 12 avril 2023. EMMA BALL-GREENE POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 14, 2023 6:14 AM
|
par Anne Diatkine dans Libération publié le 13 avril 2023 Dans un monologue qu’elle signe, la comédienne interprète au théâtre du Rond-Point plusieurs jeunes filles pour lesquelles s’adapter n’est pas une option. Une cabine rouge, façon armoire en tissu, et à l’intérieur un petit être pris dans ce rouge, hormis des bottines très blanches, qui déploie dans une succession de phrases courtes, au présent, et à la première personne, sa vie, ses besoins, sa violence, tandis qu’elle extrait ses membres de la cabine, et s’arrache – verbe sans complément, car il s’agit de s’arracher de tout et du décor en premier pour exister. La scénographie nous plonge dans un bain de lumière amniotique rouge, des sensations de la toute petite enfance sont partagées, une vivacité âpre saisit l’auditoire. Fille, vraiment ? Ou fille-garçon ? Au tout début de l’existence, ne pas être genré(e), susciter l’indécision, est plutôt agréable. Mais voilà qu’un serre-tête qui gratte enserre «le cerveau» afin d’aider les incertains à émettre un avis sur son identité sexuelle. Et rapidement, c’est tout le corps qui devient un problème tandis que l’actrice poursuit une énumération. Elle est ado, un visage «grenade» dès qu’elle prend feu, des plaques rouges submergent le cou de celle qui se surnomme Opale. Elle se tient droite dans la petite cachette en tissu rouge, et elle fait l’arbre, son corps tient «dans un tunnel de papier crépon», costume que lui a confectionné son père. «Tout ce que je veux, c’est détruire. Je commencerai par moi» Le Caméléon est le premier texte de l’actrice Elsa Agnès, qui l’interprète seule sur le plateau mais regardée avec précision par la comédienne Anne-Lise Heimburger qui la met en scène et portée par la scénographie lumineuse, au sens propre, de Silvia Costa, par ailleurs collaboratrice artistique de Romeo Castellucci. Le caméléon est un reptile qui existe réellement mais qui fascine tant qu’on ne peut s’empêcher de vérifier s’il est chimère. L’enfant en rouge, elle aussi, se transforme, change de couleur selon les états, prend des postures sauriennes parfois, mais contrairement au caméléon, elle ne s’adapte pas. Des notations font mouche – sur le soufflet ou les vêtements d’intérieurs – et sa violence porte. Comme le serre-tête des débuts dans la vie d’Opale, quelque chose gratte, dérange, dans cette litanie d’observations autocentrées qu’un programme résume : «Tout ce que je veux, c’est détruire. Je commencerai par moi.» Opale change de nom. Elle change même de corps, de lieux de naissance, de biotope. La transition se fait en couleur. L’espace scénique s’agrandit. Belle image qui restera, lorsque le premier personnage semble aussi fine qu’une crêpe au sol, recouverte par sa cabine repliée, avant que le deuxième alter ego n’advienne. Jeunes filles parallèles et rebelles Il y aura donc plusieurs destinées de jeunes filles parallèles et rebelles. On lâche l’affaire à la troisième, ce n’est plus le texte qu’on écoute, mais son squelette, la structure des phrases, et l’analyse grammaticale surgit à la place du sens. Pourquoi donc les «Je me souviens» de Perec suscitent-ils la reconnaissance, tandis qu’on éprouve ici plutôt un sentiment d’exclusion ? L’œil vagabonde dans les couleurs, et les transformations scéniques, l’oreille adoube les choix sonores, la tempête et la pluie martèlent le toit de cette salle du Rond-Point dont on n’avait jamais perçu qu’elle était en fait une soupente. C’est très beau, lorsque la cage de scène laisse apparaître dans la pénombre le grenier. Le Caméléon d’Elsa Agnès, mise en scène par Anne-Lise Heimburger, au théâtre du Rond-Point jusqu’au 23 avril. Crédit photo : (Simon Gosselin)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 29, 2023 9:47 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 28 mars 2023 Aux Ateliers Berthier, à Paris, la metteuse en scène adapte l’ultime roman de l’écrivain américain, sans parvenir à en exploiter toute la complexité.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/28/a-l-odeon-theatre-de-l-europe-tiphaine-raffier-reste-a-la-surface-de-nemesis-d-apres-philip-roth_6167336_3246.html
Chez les Grecs, elle était la déesse de la vengeance, abattant son courroux sur les humains coupables d’hubris, autrement dit de démesure. Némésis donne son nom à l’ultime roman de Philip Roth (1933-2018), signé par l’écrivain américain en 2010. Un roman de maître, cachant sous la limpidité de sa surface une polysémie riche et complexe, des lames de fond puissantes. Et notamment celle-ci, qui résonne avec autant de force que de trouble aujourd’hui : ce qu’une épidémie révèle et fracture dans une société. La jeune autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier, qui, pour la première fois monte un texte qui n’est pas de sa plume, a pourtant évité de tirer avec trop de facilité sur cette corde, et c’est tout à son honneur. Elle s’attache à restituer la complexité du roman, que Roth situe au sein du quartier juif de Newark, sa ville natale. C’est l’été 1944, un été caniculaire, où le soleil et la chaleur pèsent comme une chape de plomb. L’Amérique est en guerre sur deux fronts. Bucky Cantor est un jeune et vigoureux professeur de gymnastique, mais il a été réformé, à cause de sa vue défaillante. Bucky est rongé par la honte de ne pas être au front avec les autres, quand un mal sans visage s’abat sur sa petite ville à l’écart de l’histoire : la polio. L’épidémie se propage à la vitesse de l’éclair et touche particulièrement les jeunes. Elle est aussi une guerre, qui provoque la même stupeur impuissante que l’autre, dans laquelle sont exterminés des millions de juifs. Et elle entraîne la chute de Bucky Cantor, un garçon sain, honnête et droit, à l’image de l’Amérique telle qu’elle se rêve. Mais telle qu’elle n’est peut-être pas : Bucky est une déclinaison d’Œdipe, qui provoque la tragédie par tout ce qu’il fait pour lui échapper. Il a aussi quelque chose d’Ivan dans Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : une indignation sans effet, qui passe à côté de son but. Richesse polysémique Un tel roman est un défi pour le théâtre, dans la mesure où sa richesse polysémique se joue dans les replis de la narration, sans démonstration ni explication. Et le spectacle de Tiphaine Raffier reste en surface, très à plat, à l’image de la grande toile déployée dans l’espace scénique dans la deuxième partie, sur laquelle est imprimé un superbe paysage de lac et de montagne. Sa maîtrise du plateau est indéniable, les idées de mises en scène ne manquent pas, notamment dans cette deuxième partie, interprétée en comédie musicale (avec des petits chanteurs venus du Chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Denis), comme pour mieux jouer avec les paradis trompeurs de l’Amérique. Mais les enjeux et les personnages ne s’incarnent pas vraiment, de même que la matérialité du soleil, de la chaleur, du sentiment de souillure provoqué par l’épidémie, et l’ensemble reste largement anecdotique. Le Bucky Cantor un peu trop cérébral, fantomatique, d’Alexandre Gonin participe à cette sensation de désincarnation, de flottement à la surface. La troisième partie du spectacle, pourtant, qui se situe longtemps après les deux autres, en 1971, alors que Newark est frappé par des émeutes raciales (dans la réalité, elles ont eu lieu en 1967), retrouve une vraie force théâtrale, en revenant sur la tragédie de Bucky d’un autre point de vue et de manière rétrospective. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent la dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant Bucky Cantor, alors âgé, retrouve par hasard un de ses anciens élèves, Arnold Mesnikoff, qui lui aussi a été touché par la polio en 1944 et en a gardé des séquelles, mais a su néanmoins se construire une vie heureuse. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent cette dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant. La confrontation humaine entre Bucky et Arnold, qui a su dépasser la tragédie, rejoint la dimension la plus profonde du roman de Roth : son interrogation sur le complexe de culpabilité dans ce qu’il a de plus destructeur, notamment au sein de la communauté juive. Dommage alors qu’il ait manqué à Tiphaine Raffier un vrai corps-à-corps avec ce texte magnifique, dont la moindre des beautés n’est pas ce fil rouge, déroulé tout du long, du geste sportif comme métaphore du geste artistique. Beauté du geste du lanceur de javelot, et plus encore du plongeur, qui mêle l’envol et la profondeur. S’élever haut avec grâce et piquer sans éclaboussures inutiles vers les abîmes : tout l’art de Philip Roth. Némésis, d’après Philip Roth. Mise en scène : Tiphaine Raffier. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, Paris 17e. Jusqu’au 21 avril. De 7 € à 36 €. Puis les 16 et 17 mai au Théâtre de Lorient (Morbihan). Fabienne Darge Légende photo :« Némésis », d’après Philip Roth, dans une mise en scène de Tiphaine Raffier, le 19 mars 2023, au Théâtre de l’Odéon à Paris. photo : SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 23, 2023 2:34 PM
|
Par Cristina Marino dans Le Monde - 22/03/23
La comédienne et directrice artistique de La Compagnie de Louise adapte un texte inédit du dramaturge britannique avec une multitude d’effets spéciaux.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/22/odile-grosset-grange-met-en-scene-la-vie-de-famille-en-version-cartoon-d-apres-mike-kenny_6166578_3246.html
La Compagnie de Louise, fondée en 2013 par la comédienne et metteuse en scène Odile Grosset-Grange, installée à La Rochelle, propose un répertoire de quatre spectacles jeune public, dont trois adaptés de textes du dramaturge britannique Mike Kenny, grand spécialiste du « young people’s theatre » : Allez, Ollie… à l’eau ! (2014), Le Garçon à la valise (2016) et Jimmy et ses sœurs (2019). Sa cinquième et dernière création en date, Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !, dont les premières représentations ont eu lieu en février, au Théâtre de la Coupe d’or, à Rochefort (Charente-Maritime), s’inscrit dans cette lignée avec la mise en scène d’une pièce inédite. Comme elle le raconte dans sa note d’intention, datant de janvier 2020, Odile Grosset-Grange a découvert un peu par hasard l’existence de ce texte, jamais joué auparavant, lors d’une rencontre avec l’auteur : « Un soir, Mike me raconte cette pièce improbable d’une famille de personnages de dessins animés. La famille Normal. Je suis curieuse, car je n’ai jamais lu ça au théâtre. Il me l’envoie et je l’aime immédiatement. » De ce coup de foudre entre la metteuse en scène française et le texte du Britannique est né un beau spectacle jeune public plein d’inventivité et d’effets spéciaux. Odile Grosset-Grange s’est donné les moyens de mettre en images les péripéties de cette famille Normal haute en couleur, sortie de l’imagination fertile du dramaturge. Elle mêle astucieusement théâtre d’objets, marionnettes, tours de magie (avec des séquences impressionnantes où les acteurs semblent marcher dans les airs), comédie musicale, jeux de lumière dignes d’une production hollywoodienne à gros budget. Personnages hors norme Dès le générique d’ouverture (qui n’est pas sans rappeler celui des films de héros Marvel), le ton est donné : nous sommes dans l’univers du dessin animé, placé sous le signe de l’exagération, de la démesure, de l’invraisemblable. Ainsi, par exemple, les deux animaux domestiques de la famille Normal – un poisson rouge, d’abord appelé Sushi, puis Bubulle, et un chien à poils longs – sont campés par des marionnettes surdimensionnées. Les références aux cartoons foisonnent, de la famille Simpson au poisson Nemo des studios Pixar. Avec, en prime, la projection, au cours du spectacle, d’un petit film d’animation avec ses images comme dessinées au crayon à papier. Il faut une bonne dose d’énergie aux quatre comédiens et deux comédiennes de la troupe pour camper les nombreux personnages hors norme de ce dessin animé transposé de l’écran aux planches. Certains d’entre eux interprètent avec beaucoup de naturel des enfants ou des adolescents : Jimmy, le fils de la famille Normal, héros de la pièce (Pierre Lefebvre-Adrien) ; sa grande sœur Dorothy (Pauline Vaubaillon) ; Craig (François Chary), le cancre de service et caïd du quartier qui fait de Jimmy son souffre-douleur. L’intrigue générale est simple, accessible pour les plus jeunes (à partir de 7 ans) et riche en rebondissements scéniques. Une famille en apparence bien sous tous rapports – le père, la mère et leurs trois enfants, un garçon, une fille et un bébé, au prénom, Bébé, aussi indéterminé que son sexe – se révèle avoir une existence beaucoup plus étrange qu’il n’y paraît. Ce sont en réalité des cartoons, des personnages fictifs qui, chaque jour, revivent indéfiniment les mêmes aventures que la veille, ne ressentent pas la douleur (ils peuvent tomber du dernier étage d’un immeuble ou se fracasser une poêle sur la tête sans souffrir), ne connaissent ni la vieillesse ni la mort. Jusqu’au jour où tout bascule et se dérègle à cause d’une potion inventée par Norma, la mère de famille, et malencontreusement ingurgitée par Bébé et Jimmy. Ce dernier va commencer à ressentir des émotions « normales », comme la douleur ou la peur de la mort, jusqu’au choix final entre un retour à sa vie aseptisée de cartoon ou la poursuite de l’aventure en tant qu’être de chair et d’os. Les petits y verront sans doute uniquement un réjouissant spectacle plein d’humour et au rythme entraînant ; les grands y discerneront peut-être une réflexion sur la normalité et ses limites, mais tous auront passé un bien agréable moment en compagnie de ces personnages de cartoon somme toute tellement humains. Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !, de Mike Kenny (texte traduit de l’anglais par Séverine Magois). Mise en scène d’Odile Grosset-Grange. Avec François Chary, Julien Cigana, Antonin Dufeutrelle, Delphine Lamand, Pierre Lefebvre-Adrien, Pauline Vaubaillon. Le 22 mars à La Comédie de Valence-Centre dramatique national Drôme-Ardèche ; du 4 au 6 avril à La Coursive-Scène nationale de La Rochelle ; les 15 et 16 avril à La Ferme du Buisson-Scène nationale de Noisiel (Seine-et-Marne). Cristina Marino / Le Monde Légende photo : De gauche à droite : Craig (François Chary), Norman Normal (Julien Cigana), avec la marionnette Bébé, Antonin Dufeutrelle avec la marionnette du chien, Norma Normal (Delphine Lamand), Dorothy Normal (Pauline Vaubaillon) et Jimmy Normal (Pierre Lefebvre-Adrien, au sol), le 22 février 2023, au Théâtre de la Coupe d’or, à Rochefort (Charente-Maritime). CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 11, 2023 5:59 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 11/03/23 Dans sa dernière pièce jouée au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Pauline Peyrade montre la représentation des femmes à l’écran et le parcours d’émancipation des actrices.
Lire l'article sur le site du "Monde": https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/11/des-femmes-qui-nagent-mille-et-une-histoires-de-femmes-de-cinema-s-invitent-au-theatre_6165103_3246.html
Intérieur nuit. Un grand hall de cinéma Art déco comme on les a tant aimés, avec portes battantes à hublot et fauteuils clubs. On se croirait dans un tableau d’Edward Hopper, avec une femme nimbée de solitude, attendant dans la coulisse la fin de la séance, la fin du rêve. Sauf que les femmes ici sont nombreuses, elles hantent la machine à jouer qu’ont imaginée Pauline Peyrade et la metteuse en scène Emilie Capliez ou la traversent avec fracas. Elles, ce sont les actrices et les réalisatrices que l’autrice convoque en un vaste puzzle, qui jette en l’air et réagence les représentations des femmes telles que l’usine à rêves du cinéma les a mises en place depuis le début du XXe siècle. Ce qui fait tout le prix du projet, c’est que l’on est justement au théâtre, dans son ici et maintenant, et que le spectacle serait comme un long plan-séquence en chair et en os, où tourbillonnent mille et une histoires, en un kaléidoscope à la fois jouissif et réflexif. Tout part de Marilyn, bien sûr, le mythe ultime, la figure sacrificielle par excellence. Le spectacle s’ouvre avec cette citation de Blonde, de Joyce Carol Oates : « Les yeux grands ouverts et l’air de voir, mais c’est un rêve qu’elle voit. » Les « femmes qui nagent », ce sont ces actrices d’Hollywood, mais ce sont aussi Romy Schneider ou Ludivine Sagnier, et bien d’autres. Comme autant de corps, de surfaces de projection. Figures du refus et de la reconstruction En un montage aussi ludique qu’intelligent, Pauline Peyrade nous promène et nous égare avec bonheur – avec l’aide du Mulholland Drive de David Lynch − au fil d’un parcours qui est aussi celui d’une émancipation. Ophélie Bau quittant la projection cannoise de Mektoub my Love : Intermezzo, en 2019, se sentant flouée par Abdellatif Kechiche ; Adèle Haenel se levant avec fracas de la cérémonie des Césars 2020, indignée par le prix remis à Roman Polanski ; Chantal Akerman inventant un nouveau cinéma, avec la divine Delphine Seyrig en étendard… Autant de figures du refus et de la reconstruction. Emilie Capliez, la directrice de la Comédie de Colmar (centre dramatique national), inscrit ce parcours dans une mise en scène très maîtrisée, inventant un espace-temps bien particulier, qui n’est ni celui du cinéma ni celui du théâtre traditionnel. Dans le superbe décor conçu par Alban Ho Van, les fragments se télescopent en un tourbillon où l’on ne reconnaît pas toujours toutes les histoires, mais cela n’a aucune importance. Le puzzle pourra être reconstitué après coup. S’il en est ainsi, c’est bien sûr grâce aux comédiennes : Odja Llorca, Catherine Morlot, Alma Palacios (en alternance avec Louise Chevillotte) et Léa Sery. Pour elles, cette matière est un formidable terrain de jeu, dont elles s’emparent avec jubilation. Avec elles, ces Femmes qui nagent creusent un vertige. Ce cinéma que l’on a tant aimé, sur quoi a-t-il bâti son rêve ? « J’ai tant aimé le cinéma. Sans peur. Dans l’innocence », disait Chantal Akerman. Aujourd’hui, le temps n’est plus à l’innocence, et ce n’est pas plus mal. « Des femmes qui nagent », de Pauline Peyrade. Mise en scène : Emilie Capliez. Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 19 mars. Puis à la Comédie de Reims, du 19 au 21 avril. Fabienne Darge / Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 7, 2023 2:38 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 7/03/23 Dans sa pièce, Pauline Peyrade évoque les actrices qui, des années 50 à récemment, furent soumises aux regards et injonctions, mais furent aussi porteuses d’émancipation. Une création où l’abondance de citations finit par nous égarer. Des femmes qui nagent, ce sont donc des actrices – de Marilyn Monroe à Romy Schneider, en passant par Caroline Ducey (qui jouait dans Romance de Catherine Breillat), Ophélie Bau, mais aussi Isabelle Huppert, Gena Rowlands ou encore Barbara Loden, et bien sûr Delphine Seyrig – décidément omniprésente sur les plateaux cette saison – entraînées dans le fleuve des regards et des injonctions. Femmes scrutées autant que regardantes, comédiennes prises dans un filet ou qui se détachent de l’emprise du mâle gaze, comédiennes violentées – mais pas forcément par des hommes – ou porteuse d’émancipation : la multiplicité des points de vue et des situations se clôt par une voix intérieure : celle de l’ouvreuse dans Toute une nuit, de Chantal Akerman, qui ne reçoit les films qu’à travers les traces que laissent les spectateurs dans la salle, et ce qu’ils en disent à la sortie. Un puzzle par définition incomplet La pièce de Pauline Peyrade agence les morceaux d’un puzzle par définition incomplet. Le regard qui les attrape se situe à des distances ultra variables – du plus loin au plus près. La description attentive du moindre détail captive et suffit à révolter quand l’interprète Alma Palacios engage son regard sur une séquence de Romance de Catherine Breillat – reçue avec beaucoup de bienveillance (ou de complaisance) par la critique lors de sa sortie il y a vingt-trois ans. Les références ne sont pas livrées – et l’on remarque qu’on préfère reconnaître les films et les actrices, faire dialoguer l’instant scénique avec son souvenir du film, images ou propos recueillis. La pièce convainc moins et souffre d’arythmie lorsque le regard – le plan ? – est plus général. C’est trop court et schématique sur Godard pour bien s’imbriquer dans l’ensemble, mais peut-être est-ce la démarche qui embrasse trop de références pour ne pas nous égarer à certains endroits. Le chœur, pièce du puzzle constituée d’une multitude de citations piochées dans des siècles d’entretiens, devrait être un feu d’artifice évocateur. Il est, ce soir-là, statique, même si on s’étonne d’avoir nous aussi gardé en mémoire certaines phrases sans signe particulier, comme autant de trésors. Des femmes qui nagent de Pauline Peyrade, m.s. par Emilie Capliez, au Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis) du 8 au 19 mars. Légende photo :; «Des femmes qui nagent», au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis . (Klara Beck/Théâtre Gerard Philipe)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 22, 2023 5:35 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 février 2023 Appels d’urgence, écriture Agnès Marietta, mIse en scène Heidi-Eva Clavier, création lumière Philippe Lagrue, interprète Coco Felgeirolles. Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03. Appels d’urgence est un projet né de l’envie de l’autrice Agnès Marietta d’écrire pour Coco Felgeirolles, travail en trio avec Heidi-Eva Clavier, depuis l’intime sur « l’obsolescence d’une mère par sa famille ». Interviews, échanges, à travers l’expérience de l’actrice, entre fiction et réalité. Mme Waller, professeure de latin dans les sixties surgit de la mémoire de la comédienne: brillante et intransigeante et d’une aura sûre pour les élèves – un texte en aller-retour sur les deux figures. La metteuse en scène dit « opérer ce tissage entre réalité et fiction et comme les couturières, retirer tous les faux-fils pour qu’à la fin, il soit impossible de distinguer l’actrice du personnage ». En exergue au spectacle de Heidi-Eva Clavier, Appels d’urgence, écrit par Agnès Marietta interprété par Coco Felgeirolles, une jolie phrase de La Voyageuse de nuit de Laure Adler, qui se penche sur la vieillesse : « Je ne veux pas me croire jeune, mais je ne veux pas que la société m’ôte, en raison de mon âge, ce sentiment de la continuité de soi qui nous permet d’exister » Le Seule en scène de Coco Felgeirolles aborde les contrées d’un âge de la vie qui avance, toute proportion gardée, car sur le plateau, l’interprète mordante a toujours son mot à dire – vivacité. Depuis le plateau, elle accueille le public, regrettant tout haut qu’il ne prenne suffisamment la peine de regarder les photos d’elle-même, à tous les âges, de l’enfance au présent, exposées un peu en vrac sur les murs de la salle ou collées sur le sol de l’avant-scène. Un peu bougonne, et comme sur le fil du rasoir, elle souligne avec humour et ironie le léger retard des derniers spectateurs. Ella a quelque chose à confier au public de la salle, ces autres « elle-même » – honnêteté et vérité. Cette femme libre remonte le fil de sa vie, au rythme de l’apparition désordonnée des nouvelles technologies – ordinateurs, écrans, internet, i-phones, messages sms, mails et réseaux sociaux. S’impose, inéluctable, l’ère du numérique qui a bousculé les vies, comme s’il n’y paraissait rien. « Je me souviens de l’arrivée du répondeur Certes ça prenait les messages quand on était absents Formidable Mais encore plus formidable Ça nous permettait de filtrer les appels Et de décrocher en fonction de qui appelait Ma mère râlait « Tu es là je sais que tu es là réponds » je répondais encore moins j’appelais le lendemain Maman j’étais au cinéma A dix heures du matin ? t’as été voir quoi Elle n’était pas dupe Je ne lui répondais pas parce que sinon j’en avais pour des heures. » Après les modifications successives des comportements, les petits arrangements quotidiens, s’ensuivent des petits heurts personnels, des difficultés d’adaptation, de réactualisation à des temps autres – leur terminologie nouvelle -, et de soutien quémandé auprès des plus jeunes, obtenu ou pas: « Les réseaux sociaux façonnent la vie en fonction de celui qui va la recevoir : l’ubiquité, être ici et ailleurs en même temps, être là et pas là pareillement ». Méthodes et stratégies de survie pour le moins avouables et défendables, nécessaires à soi : « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange » Le monde entier me dérange, répète celle qui se penche sur la qualité de toute existence intime. « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange. » Constat d’une époque, retour sur une existence – réflexion et jeu – qui poursuit son cours bien vivant, l’interprète incisive répond avec facétie à une société oublieuse qui a tôt fait de séparer jeunes et vieux : elle prend sa télécommande et danse, l’accessoire à la main – ses bras levés dessinent une gestuelle expressive, loufoque et libératrice -, face une TV qui ne la soumettra pas. Elle refuse le mot de certains qui la caractériserait : « malaisante », comme si elle était coupable. Perfecto sur le dos, l’élégante et moqueuse Coco Felgeirolles ne s’en laisse pas conter, attentive aux jours qui passent, elle s’amuse de ces petits bouleversements imposés – puis surpassés – par la technologie et les repères nouveaux d’une société qui se métamorphose et qui met à mal le sentiment d’être, l’échange avec l’autre, la vraie présence, ce contre quoi elle œuvre via le théâtre. Véronique Hotte Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 14, 2023 7:57 AM
|
par Anne Diatkine dans Libération 14/02/2023 Donnant corps à une version fantasmée de l’icône québécoise, Laure Mathis épate avec un spectacle conçu par Juliette Navis, plein d’improvisations fabuleuses. Mea culpa, on a oublié de vous alerter. Céline, comme Céline Dion, s’est adonnée au public à l’Etoile du nord, une salle située dans le soubassement d’un centre sportif du XVIIIe arrondissement parisien, jeudi et vendredi. Elle était donc là, devant nous, longues mèches blondes, justaucorps pailletés fortement échancrés, traînant avec elle une remorque qui contenait toute sa vie et le minimum nécessaire à une ultime apparition scénique. «L’étoile du nord» : c’est ainsi que durant une heure et demi d’improvisations fabuleuses, cette Céline n’a cessé de nous interpeller, avec des moments en accéléré, des parenthèses, un accouchement dans un stade, une grotte en forêt, et donc une forêt, et la mort qui s’approche, le tout en québécois – et c’est plus d’une fois qu’elle nous a fait «capoter». Vous êtes nuls en «Dionologie» ? Aucune importance. Un clown jamais moqué Cependant s’ils poussaient la porte, les millions de fans de la chanteuse canadienne ne seraient en rien déçus par cette version inédite et imprévisible de leur idole. Celle qui incarne l’aimant à public est Laure Mathis, découverte dans Doreen, le spectacle culte de David Geselson, et ici aux antipodes du rôle mélancolique qui l’a fait connaître. Dans ce deuxième volet d’un triptyque qu’a conçu avec et pour elle la metteuse en scène Juliette Navis, c’est peu dire que la comédienne stupéfie, jouant de la métamorphose telle une Cate Blanchett et pulvérise toute notion d’emploi. Ici, la star québécoise est en partie un prête-nom, un masque, un clown, mais jamais moqué, ni pris en surplomb. Nulle question d’imitation, et du reste, on ignore d’où vient cette femme au chariot à l’identité flottante. Actrice de texte, c’est la première fois que Laure Mathis joue sans partition fixée, et pourtant, jamais elle ne dilue son propos. «Je mets de la chair sur le squelette extrêmement précis établi par Juliette Navis. C’est épuisant, on croit sauter dans le vide, les mots sortent au présent, je ne me suis jamais sentie aussi libre, certains éléments – la perte des eaux par exemple – surgissent sans que je ne les prémédite», nous dit-elle. Les retrouvailles avec Céline auront lieu la saison prochaine. On rêve d’une programmation qui l’associerait avec la 7e Vie de Patti Smith de Claudine Galéa, autre manière d’évoquer une star sans passer le biopic, mais par l’incarnation d’une interprète d’exception. Céline de Juliette Navis, tournée 2023, 2024 en cours Légende photo : Dans «Céline», la comédienne Laure Mathis stupéfie, jouant de la métamorphose à la Cate Blanchett. (Philippe Couture)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 10, 2023 4:45 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 10/02/23 Dans le cadre du Festival Bruit au Théâtre de l’Aquarium, Jeanne Candel met en scène « Baùbo » la nouvelle création de la compagnie La Vie brève qui pilote l’établissement et propose un divin frotti-frotta entre musique et théâtre. Déméter est pleine de chagrin. Comme si Hadès n’avait rien de mieux à faire que d’enlever Perséphone. Déméter, sa mère, erre, pleure, elle est sans dessus dessous. La voici arrivée, déconfite, à Éleusis. Pour soulager l’éplorée, à l’entrée du bureau des pleurs, Baùbo lui propose une coupe de cycéon (une mixture d’herbes). Déméter n’en veut pas. Que faire ? Baùbo, se fiant à son intuition, soulève d’un seul coup ses jupes et lui montre son sexe et les poils qui l’entourent. La déesse éclate de rire et finalement boit la potion. Cette histoire a bien plu à Jeanne Candel et elle a donné le nom de Baùbo comme titre à son nouveau spectacle au sous-titre qui en jette comme un titre de manuel philosophique : « De l’art de ne pas être mort ». C’est pas beau tout ça? C’est d’autant plus beau que le spectacle, le bien nommé Baùbo n’illustre pas à la lettre cette légende divine, mais s’en sert comme serpillière, tremplin, vagabondage et rêverie. Ce qui n’étonnera pas les fidèles des spectacles de la compagnie La Vie brève fondée en 2009 par Jeanne Candel, une compagnie où comédiens, musiciens et techniciens des deux sexes (et plus si affinités) font table et cause communes pour signer des spectacles faits à coeur. On le vérifie une fois encore en beauté avec Baùbo sur le plateau de la grande salle du théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie, établissement subventionné dont Jeanne Candel partage la direction collégiale avec Marion Bois et Elaine Meric. Des actrices, certaines et pour ainsi dire toutes musiciennes et chanteuses (voire musicien- et acteur), s’avançant pleureuses en robes noires couleur du deuil d’amour. Elles pimenteront la soirée par une pléiade d’étonnantes facéties comme celle de littéralement agrafer les dites robes noires au mur du fond maculé de blanc ou bien d’y frotter leur popotin pour faite apparaître ici un visage, là une main (décor astucieux signé Lisa Navarro) ou encore de recouvrir les corps de papier blanc pour mieux les percer et les déchirer (voir photo). Il sera aussi question d’une tentative de suicide avec un harpon livré par colis postal, d’ un matelas amovible, d’une porte qui se ferme mal, de bandes blanches qui finiront mal, de poignées de terre, d’échelle conduisant au firmament (une branche d’arbre feuillue), liste non exhaustive. Jeanne Candel n’est pas la dernière dans un inoubliable et périlleux numéro de pelle avec livres lesquels finiront, cloués au mur, par former un arc en ciel. C’est comme dans la vie : on pleure et puis on rit. Y circule un lâcher prise qui ne manque pas d’allure, un goût de l’inachèvement qui peut surprendre les aficionados du ficelé nickel mais ravit dès lors qu’on s’y laisse aller. Comme il se doit dans l’ADN de La Vie brève, tout cela est accompagné et entrecoupé de musique live. Pierre-Antoine Badaroux a jeté son dévolu sur l’œuvre de Schütz, un allemand du XVIIe siècle formé à Venise, « un compositeur singulier, entre deux mondes, il prolonge la polyphonie renaissante mais est influencé par le baroque » commente le directeur musical. L’un des charmes du spectacle est, comme toujours à La Vie brève, mais plus follement encore cette fois, l’imbrication entre le chant, la musique et le jeu, chacune et chacun des protagonistes ou presque œuvrant des deux côtés. Nommons les tous : Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon, Thibault Perriard. Ah, j’allais oublier le prologue ! Non, je ne dirai rien de l’étonnant prologue qui d’emblée instaure l’ambivalence qui sera la note première et dernière du spectacle. Jean-Pierre Thibaudat / Balagan Baùbo a été créé au Tandem, sur la scène du théâtre d’Arras, il est à l’affiche du Théâtre de l’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes) du mar au sam 20h30, dim 17h, jusqu’au 19 fév dans le cadre du festival Bruit et en partenariat avec le Théâtre de la ville. Puis du 24 au 30 mars au Théâtre Garonne à Toulouse, avant une tournée la saison prochaine. Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 2, 2023 6:29 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 2/02/23 Géraldine Martineau met en scène et interprète le rôle principal de la pièce d’Ibsen sans parvenir à trouver le juste équilibre entre réalisme psychologique et symbolisme.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/02/une-dame-de-la-mer-entre-deux-eaux-au-theatre-du-vieux-colombier-a-paris_6160290_3246.html
Comme on les aime, ces héroïnes d’Ibsen, les Hedda, Nora et autres Rebekka, grandes sœurs venues d’un XIXe siècle nordique pour montrer la voie d’une libération féminine se levant comme une vague puissante… Celle que l’on retrouve aujourd’hui s’appelle Ellida, on la croise moins fréquemment sur les scènes que les autres héroïnes du grand dramaturge norvégien. C’est donc avec bonheur que l’on prend le chemin du Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris, pour aller à la rencontre de cette Dame de la mer mise en scène et jouée par la jeune Géraldine Martineau. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Géraldine Martineau, la revanche d’une timide La dame de la mer, c’est elle, Ellida Wangel, autour de qui la pièce s’aimante et se joue. Quelques années auparavant, elle a épousé le docteur Wangel, un homme plus âgé qu’elle, qui avait déjà deux filles d’un précédent mariage. En apparence, rien ne vient troubler l’eau calme de cette vie de famille. Quelques signes, pourtant. Tous les matins, Ellida part se baigner dans cette mer à laquelle elle semble appartenir plus qu’à l’élément terrestre, une mer que, chaque jour, elle semble avoir de plus en plus de mal à quitter pour revenir à sa « vraie » vie. Ellida est là et pas là, dans cette famille qui n’est pas tout à fait la sienne – la pièce est, entre autres, une analyse d’une modernité percutante sur le rôle ingrat de belle-mère. Elle semble possédée par un mal insidieux qu’un certain docteur Freud ne va pas tarder (la pièce est écrite en 1888) à définir du nom de névrose. Sa parenté avec la Petite Sirène d’Andersen – que Géraldine Martineau a précédemment mise en scène, d’ailleurs – est patente : ce sont des femmes qui retournent à la mer, à l’élément liquide et à sa fluidité, tant l’existence terrestre leur est impossible, plombée par des formes sociales qui enserrent les femmes dans un faisceau de contraintes et de normes. Ici, l’état d’Ellida s’aggrave lorsque réapparaît, dans la petite ville au bord du fjord où vivent les Wangel, un marin qu’elle a aimé autrefois. Fantasme, fantôme, projection ? Qui sait… L’apparition de l’homme venu de la mer, fascinant et dangereux comme elle, déclenche une crise. Ibsen est un maître dans l’investigation de la psyché féminine telle qu’elle ressort de siècles de patriarcat, mais la pièce est bien plus que cela encore. Sa beauté tient à sa manière de s’approcher des confins de l’indicible, et La Dame de la mer scintille d’images et de symboles, profonds comme la mer et le temps. Spectacle bien joué Cet équilibre délicat entre réalisme psychologique et symbolisme n’est pas évident à mettre en scène, et explique sans doute que la pièce soit rarement jouée. Et c’est ce sur quoi le spectacle que signe Géraldine Martineau achoppe, sans pour autant démériter. La pièce est jouée avec une grande clarté, le spectacle est bien fait, mais il est un peu dommage que la metteuse en scène n’ait pas réussi à choisir entre un réalisme assez académique et une épure plus poétique. Sa mise en scène est à l’image du décor (signé par Salma Bordes), qui était suffisamment beau en soi pour n’être pas surchargé par des éléments kitsch et inutiles : une toile peinte suggérant le fjord en fond de scène, de fins troncs d’arbres comme une forêt de songes, les subtiles lumières en clair-obscur de Laurence Magnée… Pourquoi alors ajouter des fleurs en plastique et des fauteuils tapissés ? On chipote bien sûr, mais il est vrai qu’en matière de mises en scène ibséniennes, on s’est habitué dans les vingt dernières années à des sommets, notamment avec Thomas Ostermeier, Deborah Warner ou Alain Françon. Laurent Stocker ne saurait être autrement que parfait, avec son jeu si juste et sobre, dans la peau du docteur Wangel Le spectacle est bien joué, comme toujours à la Comédie-Française. Il révèle notamment deux belles actrices qui viennent d’entrer dans la troupe, Elisa Erka et Léa Lopez, dans les rôles, loin d’être négligeables, des deux filles du docteur Wangel. Laurent Stocker ne saurait être autrement que parfait, avec son jeu si juste et sobre, dans la peau du docteur Wangel. Clément Bresson, qui excelle dans ces rôles d’hommes qui viennent cristalliser les fantasmes des autres, est mystérieux à souhait. Mais Géraldine Martineau elle-même, qui est une excellente comédienne, souvent remarquée dans les productions de la Comédie-Française, n’embarque pas dans le rôle d’Ellida, dont elle fait un personnage assez lisse. Peut-être n’a-t-elle pas encore eu le temps, prise par son travail de mise en scène, de se donner tout entière à cette dame de la mer, passagère entre les mondes visible et invisible. Fabienne Darge / Le Monde
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2023 5:51 PM
|
Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks, 21 juillet 2023 L’artiste bretonne Patricia Allio s’empare de la crise des migrant·es, avec une série de témoignages et une mise en scène dépouillée. Un théâtre à la lisière de l’agora citoyenne, qui prend alors une dimension européenne.
On est au théâtre, à en juger par les gradins, mais l’on pourrait être ailleurs. On assiste à un spectacle, à en juger par le programme, mais le terme ne veut rien dire, ici. Dispak Dispac’h, de l’artiste bretonne Patricia Allio, est d’abord prétexte pour s’informer sur l’exil par-delà la Méditerranée, pour écouter des témoignages sur les parcours de ses héros·ïnes et pour (re)trouver le sens d’une effervescence collective à l’heure où la justice et l’humanité se fracassent contre les portes de l’Europe. Agora citoyenne Dans l’écrin d’une scénographie quadrifrontale, spectateurs et spectatrices sont invité·es à se déchausser, puis à prendre place aux côtés des acteur·ices. Ici Stéphane Ravacley, l’artisan-boulanger de Besançon, connu pour avoir entamé une grève de la faim empêchant l’expulsion de son apprenti guinéen. Là Gaël Manzi, le fondateur de l’association Utopia 56, œuvrant pour la défense des exilé·es, d’abord à Calais puis partout en France. De l’autre côté du plateau, Élise Marie, une comédienne hypermnésique, déclamant l’acte d’accusation remarquable émis en 2018 par le Groupe d’information et de soutien des émigrés à l’occasion du Tribunal permanent des peuples, pointant la responsabilité de l’Europe pour des milliers de violations des droits de l’homme. Et bien d’autres encore, qui se relaieront ponctuellement au fil de la tournée de cette agora citoyenne ambulante. On n’est pas au théâtre dirons certains, et à raison peut-être. Parce que l’esthétique – franchement inesthétique – est réduite à sa portion congrue : c’est un CRS qui se déglingue sur un techno tonitruante, un pas de danse amateur et plutôt malheureux. C’est dommage, mais passons… Car on est au théâtre, malgré tout. Parce que celui-ci provoque l’attention, encourage l’écoute, suscite l’empathie, impose son rythme, permet les échanges de regards, et, peut-être même, engendre une forme de communion envers les oublié·es. Dès lors, la tragédie de l’exil s’incarne, avec des noms, des visages, des anecdotes et des espoirs. Ainsi, Patricia Alliot prend le relais des médias défaillants et des lieux de débats inexistants. Et nous voilà aguerri·es. Igor Hansen Love / Les Inrocks Dispak dispac’h Crépuscule européen, par Patricia Allio. À 18 h au Gymnase du lycée Mistral (ce 21 juillet, durée 6 heures). Dans le cadre du festival Actoral au théâtre la Criée, les 4 et 5 octobre. Légende photo : Dispak Dispac'h” par Patricia Allio © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2023 9:43 AM
|
Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 11 mai 2023 Son étonnant _jeanne_dark_ nous parlait de la jeunesse par le biais d’une représentation connectée, via Instagram. Marion Siéfert revient à l’adolescence avec un spectacle (offline) aux excès vivifiants. Un conte noir qui investit les sinuosités d’un monde virtuel et révèle une jeune comédienne époustouflante : Lila Houel. Elle n’a pas 16 ans, mais fait déjà preuve d’une force d’incarnation et d’expression impressionnante. Son nom est Lila Houel. Elle fera, c’est certain, parler d’elle. Elle a été choisie parmi près de 1000 candidates pour interpréter Mara, le personnage central de Daddy, une adolescente de 13 ans manipulée par un prédateur numérique qui a le double de son âge. Cet homme qu’elle rencontre en ligne se prénomme Julien. Il abuse de sa jeunesse et de son innocence, profite de ses rêves de lumière, de son désir de cinéma, de sa volonté de faire exploser les enfermements de sa classe sociale, pour l’entraîner dans les faux-semblants et la liberté factice d’un jeu intitulé Daddy. Au sein de cet environnement digital, tout devient possible. Le virtuel n’est plus vraiment virtuel, il n’y a plus d’avatar, tout s’achète et tout se vend. Les jeunes filles deviennent des valeurs marchandes sur lesquelles des daddys investissent. Ils les flattent, les entretiennent, les utilisent pour les jeter comme des kleenex du jour au lendemain. C’est un univers cynique et cruel auquel donne corps Marion Siéfert dans cette création (créée le 9 mars dernier au Centre national de danse contemporaine d’Angers, aujourd’hui à l’affiche de l’Odéon – Théâtre de l’Europe) qui creuse de troublantes réflexions sur la construction de l’individu, la parentalité, les conditionnements sociaux, les rapports de pouvoir, la dureté et la complexité de notre temps. Des monstres et des chimères du quotidien Cette escapade théâtrale au sein d’un jeu vidéo passe par diverses atmosphères et des registres variés. Elle trace le sillon d’une narration qui prend son temps, qui ne va jamais au plus direct, au plus court, qui s’accorde les obliques et les détours qu’elle estime naturels, sinon nécessaires. Elle nous raconte cette histoire de dominées et de dominants à travers autant de creux que de pleins, autant de sursauts de vérité que d’effets d’ombres portées. En se plongeant dans ce Daddy, on est pris par une vie qui se pare d’artifices parfois inattendus. On emprunte des chemins auxquels on ne s’attendait pas. Et on se retrouve dans des sphères fictionnelles qui brouillent les frontières entre réel et virtuel, tout en ouvrant sur le politique. Des monstres et des chimères du quotidien se dessinent de façon provocatrice, parfois burlesque, avant que ne s’imposent des instants de gravité, de poésie. Marion Siéfert et son complice Matthieu Bareyre signent une pièce qui déconcerte. C’est bien. Dans une société contemporaine qui survalorise le raccourci, l’efficacité, le formatage, le cadre, un tel travail sur les débordements souffle comme un vent de liberté. Ce mouvement d’affranchissement par l’imaginaire est porté par une distribution remarquable (Émilie Cazenave, Lou Chrétien-Février, Jennifer Gold, Charles-Henri Wolff), au sein de laquelle le jeune Louis Peres, dans le rôle de Julien, est lui aussi une révélation. Manuel Piolat Soleymat Daddy
du mardi 9 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023
L’Odéon-Théâtre de l’Europe
place de l’Odéon, 75006 Paris
Du mardi au samedi à 20h. Relâche les dimanches, les lundis, ainsi que les jeudis 11 et 18 mai. Durée de la représentation : 3h30 avec entracte. Tél. : 01 44 85 40 40. www.theatre-odeon.eu

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 7, 2023 3:36 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog, le 7/05/23 Après « Ce qui demeure », « Saint-Félix, enquête sur une hameau français », « A la vie ! » ou « Pères », depuis huit ans la compagnie Babel dirigée par Élise Chatauret et Thomas Pondevie poursuit, avec force et acuité, son exploration de notre société avec « Les moments doux ». Une subtile approche de la violence fondée sur des témoignages à travers un triple prisme : école, famille, travail. C’est la fin de la pièce. On se retrouve à l’école primaire comme tout début du spectacle. Entre temps, de multiples scènes de violences à la maison, au bureau, à l’école sont passées par là. Le maître qui vient de parler de la Révolution française pose la question aux enfants (et donc au public) : « Faut-il nécessairement faire couler le sang pour faire progresser les droits ? Peut-on faire aboutir les droits sans passer par la violence ? Faire aboutir des droits par la violence, est-ce encore de la violence ? Vous par exemple, vous seriez prêt à vous battre pour défendre vos copains et vos copines ? Pour défendre votre pays ? Pour défendre vos parents ? Vos idéaux ? » Alors la petite Sofa demande : « Monsieur : est-ce que ça existe les violences justes ?». Ce sont là les derniers mots de la pièce et ils résument son questionnement. C’est peu dire qu’à l’heure de l’Ukraine, de la répression policière lors des manifs contre la loi sur les retraites et celles contre les méga-bassines, des violences au parlements et dans les chambres conjugales et nombre de faits divers récurrents, ce spectacle tombe on ne peut plus juste alors que ses références en matière de violence sociale sont volontairement datées : l’affaire des chemises déchirées des cadres d’Air France et la casse sociale à France Télécom et sa vague de suicides. Dans un dynamique montage, les auteurs nous font passer tout au long du spectacle de la violence à l’école à la violence domestique et à la violence au travail (astucieuse scénographie de Charles Chauvet). Les trois axes cohabitent dans un formidable et pertinent entrelacement. Comme pour chacun de leurs spectacles, Chatauret & Pondevie, accompagnés par leurs actrices et acteurs ont d’abord mené un long travail d’enquête. Témoignages, rencontres et nombre de lectures. Les témoignages sont enregistrés et servent de base pour le travail sans s’en tenir à un paresseux verbatim. Tout est repris et relancé dans la sphère du travail théâtral : improvisations, discussions, écriture, montage. Un formidable théâtre documenté, affiné au fil des spectacles depuis Ce qui demeure (lire ici) jusqu’à Nos pères (lire ici), en passant par Saint-Félix, enquête sur un hameau français (lire ici) et A la vie ! (lire ici). On retrouve Solenne Keravis, Manumatte et Charles Zévaco vus lors de précédents spectacles, ils ont été rejoints par François Clavier, acteur buriné d’aventures théâtrales, le plus chevronné de tous, la presque débutante Samantha Le Bas (en troisième année du Conservatoire de Paris) et Julie Moulier. Tous, excellents, font troupe, bloc, manipulent le décor en le recomposant et jouent tous les rôles : le maître d’école, pour ne citer que lui, est joué tour à tour par chacun d’entre eux ou presque, le manager ici sera l’employé malmené deux scènes plus loin, etc. Le titre du spectacle st volontairement paradoxal : Les moments doux. Le spectacle commence, si l’on peut dire, en douceur, avec des scènes de violences à l’école : le maître interroge une image de bande dessinée où un kangourou, en train de sauter à la corde, se fait embêter zzzz par une abeille sous l’œil médusé d’un lapin. L’histoire se poursuivra dans d’autres scènes intercalées, le kangourou va se rebiffer en attaquant la ruche et les enfants se demanderont si sa réaction n’a pas été « disproportionnée ». On passe à une scène familiale au retour de l’école: Manon s’est battue avec Linda qui l’énervait, résultat un nez cassé pour l’une un conseil de discipline pour l’autre. La réaction des parents (« on n’utilise pas la violence physique ») sera éclairée plus loin par une autre scène similaire où les parents auront une réaction strictement inverse (« notre fils se fait tabasser et mettre en sang et lui il répond pas mais putain je vais tout casser moi ! »). Chatauret & Pondevie pratiquent un art savant du montage.Et d'éclairages internes. Ce qui leur permet d'intercaler cette jolie scène sucre d'orge: le dialogue entre un homme et une femme mariés, travaillant dans la même entreprise et débordés, se renvoyant à la face la liste des tâches domestiques à faire. C’est par le biais un peu tordu de l’école qu’on en vient à ce que les spectateurs ont plus ou moins en mémoire : l’histoire de France Télécom Orange et le plan de départ de 22000 salariés avec un détour par les écoles de management et ses jeux de rôles, du théâtre dans le théâtre donc.Par la suite, l’affaire des licenciements à Air France et des chemises déchirées des hauts cadres organisateurs du licenciement massif nous vaudra un désopilant effet de réel : une séquence audio où l’on entendra Manuel Vals, impayable, déclarer « Air France est sous le choc et quand Air France est sous le choc, c’est toute la France qui est sous le choc». L’une des dernières séquences, en forme d’arroseur arrosé, montre la troupe du spectacle réunie : les réductions budgétaires imposent le licenciement d’un des membres de l’équipe, mais qui ? Aussi cruel que savoureux. François, le plus ancien donc le plus menacé, se rebiffe : « je croyais qu’on s’appréciait, qu’on était une équipe ! Qu’on était censé vivre ensemble des moments doux. ». Le spectacle a été créé au CDN de Nancy. Il est passé par Saint-Étienne, Sevran, Béthune (où nous l’avons vu), il sera à l’affiche du Théâtre de Malakoff les 11 et 12 mai. Puis, à la rentrée prochaine, au Théâtre des Quartiers d’Ivry du 10 au 22 octobre, avant Sète, Villefranche-sur-Saône, Fontenay-sous-Bois et la MC2 de Grenoble. Crédit photo : © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 24, 2023 7:34 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 23/04/2023 Nommée aux Molières pour son rôle dans « Music-Hall », de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo, la comédienne a cultivé son art sur la frontière entre tragique et comique.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/23/catherine-hiegel-clown-magicienne-et-sorciere-la-femme-aux-cent-visages_6170720_3246.html
Lundi 24 avril au soir, après la cérémonie des Molières, Catherine Hiegel aura peut-être ajouté une statuette à toutes celles, nombreuses, qui peuplent son appartement du 6e arrondissement de Paris. Si c’est le cas, il faudra faire de la place sur la cheminée du salon, déjà surchargée de figures, de figurines, de visages, qui essaiment aussi en bande organisée dans les autres pièces de ce repaire d’artiste à l’ancienne, rempli de livres et de secrétaires où se poser pour écrire. La comédienne en plaisante, elle qui ne goûte ni les honneurs ni les récompenses officielles. A 76 ans, elle est toujours aussi peu rangée, aussi joueuse, libre et rebelle, dans son petit pull noir et gris très rock’n’roll, pour ne pas dire un peu punk. Un Molière de plus (elle en a déjà eu deux), ou pas, dans la catégorie meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre privé, ne changera pas grand-chose à l’affaire. « Hiegel », comme on l’appelle dans la profession – l’abandon du prénom étant la marque des grands –, est, une fois de plus, géniale dans Music-Hall, la pièce de Jean-Luc Lagarce mise en scène par Marcial Di Fonzo Bo, dont elle vient juste de terminer la tournée, qui l’a menée partout en France. Géniale, c’est-à-dire aussi bouleversante que flamboyante, avec ses faux cils et sa robe à paillettes, dans cette partition qui s’offre comme une métaphore des grandeurs et des misères du métier d’actrice. De ces grandeurs et de ces misères, elle a tout connu, peu ou prou, depuis ses débuts, à 18 ans à peine, en 1965, dans Fleur de cactus, de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, les rois du théâtre de boulevard. Elle avait arrêté l’école à 16 ans, encouragée par son père – c’était une autre époque –, qui rêvait de la voir devenir comédienne, lui qui avait eu le désir, déçu, d’être acteur. Pierre Hiegel (1913-1980) était musicologue, producteur pour la radio et directeur artistique de maisons de disques. « J’ai passé mon enfance à m’endormir et à me réveiller dans la musique », raconte Catherine Hiegel. « Une musique intime » Dans le vaste appartement familial passaient aussi bien les chanteuses Lucienne Delyle ou Barbara – d’ailleurs découverte par Pierre Hiegel – que les pianistes Samson François et György Cziffra ou la cantatrice Jane Rhodes. Catherine Hiegel pense que cette présence de la musique dans sa vie « a beaucoup compté » pour la comédienne qu’elle est. « Surtout dans le rapport à la justesse. J’entends quand c’est faux, tout de suite, assure-t-elle de sa voix grave de fumeuse. Tout est musical dans nos vies, et donc en scène aussi, bien sûr : chacun d’entre nous a un rythme personnel, intérieur, une musique intime. Le rapport au corps en scène, au silence, au temps, est aussi important que la phrase. Il faut savoir entendre quand un temps est trop long ou trop court, il faut savoir le mesurer par rapport à la densité de ce qui a été dit ou de ce qui va se dire. » Dans ces triomphantes années 1960, Catherine Hiegel n’en est pas encore à réfléchir sur son métier d’actrice. Elle sait faire rire, elle a depuis l’enfance un côté clown : elle est immédiatement accueillie à bras ouverts par Jean Poiret et Michel Serrault, et d’emblée on la compare à Jacqueline Maillan, qui règne alors sur le vaudeville. La jeune femme à l’air espiègle aurait pu s’en tenir là – « j’avais une autoroute comique devant moi », constate-t-elle –, mais la Comédie-Française l’a appelée et, après avoir longuement hésité, elle est entrée dans la vénérable maison le 1er février 1969. Elle va y rester quarante ans, jusqu’à son éviction absurde, le 6 décembre 2009, par le comité qui préside aux destinées des membres de la Société des comédiens-français. Et elle va y jouer toutes les Toinette, Lisette, Marinette et autres soubrettes du répertoire, de Molière à Marivaux. A l’époque – « mais c’est encore le cas maintenant ! », soutient-elle –, les « emplois » pour les actrices étaient très codifiés, dépendant de critères physiques rigides plus que de la richesse de leur jeu. « Si vous étiez petite, blonde, avec un nez retroussé, eh bien c’était les soubrettes, s’insurge Catherine Hiegel. La jeune première, l’amoureuse, devait forcément être grande, mince et belle selon des critères ultraclassiques. Dans les années 1960, les critères ont commencé à changer pour les hommes, avec l’apparition d’acteurs comme Belmondo, mais pas pour les femmes. Au Conservatoire, je n’avais tout simplement pas le droit de travailler autre chose que des servantes. Ce fut une souffrance, au départ, parce que ce sont des interdits qui vous limitent et qui viennent vous désigner physiquement. Mais rapidement, avec les soubrettes de Molière, de Marivaux et surtout de Goldoni, j’ai vu que la richesse de ces rôles était immense, bien plus complexe que l’emploi de la jeune première qui doit pleurer au bout de trois répliques. » Profondeur humaine inégalée De cette doxa issue d’un autre âge, et particulièrement prégnante en France, Catherine Hiegel a fait une force. C’est en jouant les servantes goldoniennes avec une profondeur humaine inégalée, notamment dans La Serva amorosa, mise en scène par Jacques Lassalle, en 1992, qu’elle va s’installer dans le paysage comme une comédienne majeure. Et qu’elle va être de plus en plus demandée à l’extérieur du Français, pour jouer de tout autres partitions, souvent très contemporaines, et de tout autres rôles. En 1986, Patrice Chéreau l’appelle pour jouer dans Quai ouest, de Bernard-Marie Koltès, au côté de Maria Casarès, qu’elle admire infiniment. Ensuite, il y aura Une visite inopportune, de Copi (1988), ou La Veillée, de Lars Noren (1989), toutes deux par Jorge Lavelli ; J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, de Jean-Luc Lagarce (2005), ou Embrasser les ombres, de Lars Noren encore (2005), avec Joël Jouanneau ; Les Bonnes, de Genet, avec Philippe Adrien (1997), ou Savannah Bay, de Duras, avec Eric Vigner (2002) ; ou encore De beaux lendemains, de Russell Banks (2011), où Emmanuel Meirieu avait su, magnifiquement, mettre en avant sa douceur et sa délicatesse, derrière les armes de la guerrière. Autant de rôles de femmes sauvages et déchirées, ravagées et fortes, généreuses et amoureuses, ou folles et monstrueuses, comme la Vera d’Avant la retraite, de Thomas Bernhard, jouée sous la direction d’Alain Françon, en 2020. Pour Catherine Hiegel, d’ailleurs, la frontière entre comique et tragique est souvent artificielle, tracée de manière bien trop rigide. Pour elle, « le rire vient toujours d’un fond tragique ». Elle a travaillé son art d’actrice inlassablement, au fil des rencontres avec les metteurs en scène qui ont compté pour elle : le corps avec Dario Fo (Le Médecin malgré lui, de Molière, en 1990), le sens du geste juste avec Giorgio Strehler (La Trilogie de la villégiature, de Goldoni, en 1978), l’intelligence du texte, «éblouissante » , avec Patrice Chéreau. Cherchant toujours, jamais satisfaite, dans cet art fragile qu’est celui de l’acteur, lequel est à lui-même son propre instrument et doit apprendre ses secrets, soir après soir, comme un virtuose avec son violon ou sa clarinette. « Une évidence dans le phrasé » Catherine Hiegel a aussi beaucoup regardé les acteurs qu’elle admirait, notamment le grand Philippe Clévenot (1942-2001), que tous les vrais amoureux de théâtre regrettent. « Il y avait, chez lui, une intelligence de l’incarnation, une voix, un phrasé très particuliers, une construction de la pensée simple et dense, se souvient-elle. C’est toujours ce que l’on recherche : arriver à la simplicité de l’incarnation, sans esbroufe. Quand Clévenot entrait en scène et qu’il commençait à parler, on écoutait : il y avait une évidence dans le phrasé, le chemin de pensée, la présence. » On peut en dire autant, mot pour mot, de Catherine Hiegel. Le mystère de cette présence, la comédienne ne sait pourtant pas l’expliquer. « C’est une harmonie, probablement, entre la voix, le corps et la pensée, qui avancent ensemble, se hasarde-t-elle. Ce n’est pas l’envie d’être regardé, je ne crois pas… Mais l’envie d’éprouver, peut-être. Et de partager ce qu’on éprouve, ce qui est essentiel. » Peut-être est-ce là ce qu’elle interroge, dans les multiples visages sculptés qu’elle collectionne, mais aussi les pantins, les marionnettes et autres mannequins de procession ou de parade. Autant de figures, plus ou moins réalistes ou abstraites. Mais pas de masques. Catherine Hiegel les chine dans des brocantes, inlassablement, depuis des années. Elle dit qu’elle ne se lasse jamais de regarder les êtres. Dans la rue, dans le métro, dans les cafés, partout, elle regarde les visages. « Je vois des hommes et des femmes qui pleurent, et j’ai l’impression que je suis la seule à les voir. Souvent, des visages m’apparaissent, aussi, quand je regarde une pierre, ou le sol. » Catherine Hiegel se fait rêveuse. Toute grande actrice est magicienne et sorcière, comme l’était Jeanne Moreau, dont elle est aussi une héritière. « Petite, je fabriquais des marionnettes qui devaient être des princesses, mais se transformaient inévitablement en sorcières », se rappelle-t-elle dans un souffle, avant de jouer mezza voce, rien que pour nous, le monologue final de Music-Hall : « Et jouons quand même et faisons semblant,/ tricheurs aux extrêmes, (…)/ et remplissons le temps,/ faisons semblant d’exister,/ et jouons quand même – j’en pleurerais, n’ai pas l’air comme ça mais en pleurerais et en pleure parfois, mais discrètement, avec lenteur et désinvolture, (…)/ pleure sous maquillage et déguisement, (…)/ triche jusqu’aux limites de la tricherie,/ l’œil fixé sur ce trou noir où je sais qu’il n’y a personne. » Un frisson passe. Tout est dit, dans la caverne aux multiples visages de Catherine Hiegel. Molières 2023 : les nominations Dix-neuf récompenses seront attribuées lundi 24 avril lors de la 34e cérémonie des Molières Molière du théâtre privé : Big Mother, de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey Glenn, naissance d’un prodige, d’Ivan Calbérac, mise en scène Ivan Calbérac Oublie-moi, de Matthew Saeger, mise en scène Marie-Julie Baup et Thierry Lopez Les Poupées persanes, d’Aïda Asgharzadeh, mise en scène Régis Vallée Molière du théâtre public : Amours (2), de Joël Pommerat, mise en scène Joël Pommerat Le Bourgeois gentilhomme, de Molière, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort (Comédie-Française) Je ne cours pas, je vole !, d’Elodie Menant, mise en scène Johanna Boyé La vie est une fête, de Jean-Christophe Meurisse et Les Chiens de Navarre Molière de la comédie : Lorsque l’enfant paraît, d’André Roussin, mise en scène Michel Fau No Limit, de Robin Goupil, mise en scène Robin Goupil Le Retour de Richard 3 par le train de 9 h 24, de Gilles Dyrek, mise en scène Eric Bu Une idée géniale, de Sébastien Castro, mise en scène Agnès Boury et José Paul Molière du spectacle musical : Les Coquettes – Merci Francis, de Lola Cès, Marie Facundo et Juliette Faucon, mise en scène Nicolas Nebot Moi aussi je suis Barbara, de Pauline Chagne et Pierre Notte, mise en scène Jean-Charles Mouveaux Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon, mise en scène Thomas Jolly Tous les marins sont des chanteurs, de Gérard Mordillat, François Morel et Antoine Sahler, mise en scène François Morel Molière de l’humour : Florence Foresti dans Boys Boys Boys, de Florence Foresti et Pascal Serieis, mise en scène Florence Foresti Laura Felpin dans Ça passe, de Laura Felpin et Cédric Salaun, mise en scène Nicolas Vital Manu Payet dans Emmanuel 2, de Manu Payet, mise en scène Manu Payet Stéphane Guillon dans Sur scène, de Stéphane Guillon, mise en scène Anouche Setbon Molière du jeune public : Gretel, Hansel et les autres, d’Igor Mendjisky, d’après les frères Grimm, mise en scène Igor Mendjisky Odyssée, la conférence musicale, de Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey, d’après Homère, mise en scène Stéphanie Gagneux La Reine des neiges, l’histoire oubliée, de Johanna Boyé et Elisabeth Ventura, mise en scène Johanna Boyé Space Wars, d’Olivier Solivérès, mise en scène Olivier Solivérès Molière du seul(e) en scène : Coming out, avec Mehdi Djaadi, de Mehdi Djaadi et Thibaut Evrard, mise en scène Thibaut Evrard Il n’y a pas de Ajar, avec Johanna Nizard, d’après Delphine Horvilleur, mise en scène Arnaud Aldigé et Johanna Nizard Thomas joue ses perruques (Deluxe Edition), avec Thomas Poitevin, de Yannick Barbe, Stéphane Foenkinos, Hélène François et Thomas Poitevin, mise en scène Hélène François Tout le monde savait, avec Sylvie Testud, d’Elodie Wallace, d’après Valérie Bacot et Clémence de Blasi, mise en scène Anne Bouvier Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé : Sébastien Castro, dans Une idée géniale, de Sébastien Castro, mise en scène Agnès Boury et José Paul Michel Fau, dans Lorsque l’enfant paraît, d’André Roussin, mise en scène Michel Fau Jean Franco, dans La Délicatesse, d’après David Foenkinos, mise en scène Thierry Surace Thierry Lopez, dans Oublie-moi, de Matthew Saeger, mise en scène Marie-Julie Baup et Thierry Lopez Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Marie-Julie Baup, dans Oublie-moi, de Matthew Saeger Catherine Frot, dans Lorsque l’enfant paraît, d’André Roussin Isabelle Gélinas, dans Les Humains, d’Ivan Calbérac Marie Gillain, dans Sur la tête des enfants, de Salomé Lelouch Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public : Jacques Gamblin, dans HOP !, de Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin Christian Hecq, dans Le Bourgeois gentilhomme, de Molière, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort Denis Podalydès, dans Le Roi Lear, de William Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeier Laurent Stocker, dans L’Avare, de Molière, mise en scène Lilo Baur Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public : Isabelle Carré, dans La Campagne, de Martin Crimp, mise en scène Sylvain Maurice Sara Giraudeau, dans Le Syndrome de l’oiseau, de Pierre Tré-Hardy, mise en scène Sara Giraudeau et Renaud Meyer Catherine Hiegel, dans Music-Hall, de Jean-Luc Lagarce, mise en scène Marcial di Fonzo Bo Isabelle Huppert, dans La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, mise en scène Ivo van Hove Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé : Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, pour Oublie-moi Michel Fau, pour Lorsque l’enfant paraît Mélody Mourey, pour Big Mother Régis Vallée, pour Les Poupées persanes Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre public : Jean Bellorini, pour Le Suicidé, vaudeville soviétique, de Nikolaï Erdman Johanna Boyé, pour Je ne cours pas, je vole !, d’Elodie Menant Christian Hecq et Valérie Lesort, pour Le Bourgeois gentilhomme, de Molière Joël Pommerat, pour Amours (2) Molière de la révélation féminine : Vanessa Cailhol, dans Je ne cours pas, je vole !, d’Elodie Menant Léa Lopez, dans La Reine des neiges, l’histoire oubliée, de Johanna Boyé et Elisabeth Ventura Anna Mihalcea, dans Les Filles aux mains jaunes, de Michel Bellier Lison Pennec, dans Glenn, naissance d’un prodige, d’Ivan Calbérac Molière de la révélation masculine : Alexandre Faitrouni, dans Smile Thomas Gendronneau, dans Glenn, naissance d’un prodige Mexianu Medenou, dans Tropique de la violence, d’Alexandre Zeff Thomas Poitevin, dans Thomas joue ses perruques (Deluxe Edition) Molière du comédien dans un second rôle Kamel Isker, dans Les Poupées persanes Jérôme Kircher, dans Biographie : un jeu, de Max Frisch Benjamin Lavernhe, dans La Dame de la mer, de Henrik Ibsen Bernard Malaka, dans Glenn, naissance d’un prodige Teddy Mélis, dans Le Voyage de Molière, de Jean-Philippe Daguerre et Pierre-Olivier Scotto Christophe Montenez, dans Le Roi Lear Molière de la comédienne dans un second rôle : Agnès Boury, dans Une idée géniale Manon Clavel, dans La Campagne, de Martin Crimp Marina Hands, dans Le Roi Lear Karina Marimon, dans Big Mother Elodie Menant, dans Je ne cours pas, je vole !, d’Elodie Menant Josiane Stoléru, dans Glenn, naissance d’un prodige Molière de l’auteur (trice) francophone vivant(e) : Aïda Asgharzadeh, pour Les Poupées persanes Ivan Calbérac, pour Glenn, naissance d’un prodige Léonore Confino, pour Le Village des sourds Elodie Menant, pour Je ne cours pas, je vole ! Mélody Mourey, pour Big Mother Joël Pommerat, pour Amours (2) Molière de la création visuelle et sonore
Big Mother, de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey Le Bourgeois gentilhomme, de Molière, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort Smile, de Dan Menasche et Nicolas Nebot, mise en scène Nicolas Nebot Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 5, 2023 7:42 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hotello - 28/03/23 L’Amour et les forêts, mise en scène de Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des Bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traductions d’André Markowicz et Françoise Morvan, et les films réalisés par Anna Darcueil, création et régie lumière Sébastien De Jésus, costumes Lucie Duranteau, scénographie Nicolas Fleury, au CNSAD-PSL. Avec Chara Afouhouye, Vincent Alexandre, Chloé Besson, Théo Delezenne, Hermine Dos Santos, Ryad Ferrad, Myriam Fichter, Mikaël-Don Giancarli, Eva Lallier Juan, Shekina Mangatalle-Carey, Basile Sommermeyer, Padrig Vion, Clyde Yeguete. A l’écran, Alexandre Gonin, Tom Menanteau, Ava Baya, Zoé Van Herck, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard.
L’Amour et les forêts, écrit Claire Lasne Darcueil, metteuse en scène et directrice en fin de mandat du CNSAD-PSL – Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique -, est un spectacle né d’un accident, de l’annulation d’un autre, dans les périodes tourmentées et inédites du Covid et post-Covid. Un spectacle qui s’est construit avec l’atelier d’élèves de 3è année, par petits morceaux de répétitions, rejoint par les anges protecteurs d’une promotion autre, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard. « Le hasard permet parfois d’aller à l’essentiel: partir librement dans toutes les langues et chemins possibles, à la recherche d’Anton Tchekhov, de ces deux versions d’un même texte que sont L’Homme des Bois et Oncle Vania, c’est faire ensemble le rêve de soigner le monde, de rester des enfants amoureux du théâtre et du cinéma, dont la découverte est contemporaine de son écriture, et de devenir capable d’aimer. » Le chemin de Claire Lasne Darcueil vers Anton Tchekhov a commencé en 1996, « main dans la main avec André Markowicz et Françoise Morvan », avant de mettre en scène L’Homme des Bois en 2002, spectacle festif sous chapiteau avec l’équipe du temps d’amis inoubliables. Le voyage dans le temps, cette quête de l’écriture tchekhovienne, vingt ans plus tard, suit avec la même constance et patience intenses la recherche infinie de l’amour et des forêts – « un risible mais sincère désir de sauver le monde et soi-même avec lui ». Et être capable d’aimer, en dépit de tout. Dix années au moins s’écoulent entre la rédaction de L’Homme des Bois en 1889, considérée comme la première version d’Oncle Vania, et la mise en scène de celle-ci au Théâtre d’Art en 1899, soit la réécriture d’un vaudeville volubile en un drame psychologique et métaphysique tendu. « L’effet Vania, c’est ce mélange de distance ironique, de tendresse désabusée, de vulnérabilité cachée que Vania et le spectateur partagent, l’espace d’une représentation. » (Patrice Pavis). L’écriture – élaboration conceptuelle et graphie mécanique – s’invite sur la scène avec ses deux machines à écrire sonores, côté cour et côté jardin, que les compositeurs sollicitent alternativement : « Non, c’est pas ça ! », résonne sur la scène, rappel de Nina dans La Mouette qui rejoue devant Treplev le rôle endossé des années auparavant dans sa belle jeunesse innocente. On entend des bribes de lettres de Tchekhov adressées à Olga Knipper, et de celle-ci à celui-là, amante et actrice qui retrace le rôle d’Elena porté dans L’Homme des Bois en 1899, à moins que ce ne soient les souvenirs mêmes de la metteuse en scène Claire Lasne Darcueil, en 1999. Un chassé-croisé d’impressions et de sensations, entre vie intime passée et renaissante toujours, présente à vie. Avec pour décor, les pianos mélancoliques soutenant sur des draps blancs des chandeliers aux bougies tremblantes, un éclairage du temps qui ajoute sa patine dorée à l’atmosphère romantique, donnant de la lumière aux portes battantes et fenêtres vitrées dans le lointain, alors que l’on cogne fort aux portes de bois, appelant quelqu’un, le sollicitant : l’être aimé auquel on n’ose se déclarer. Les scènes sont re-jouées – répétition et variation -, par les comédiens qui se ressaisissent du rôle en alternance, selon leur tempérament qui va de la mesure à la démesure, comme il sied à la jeunesse. Et l’écran offre des scènes filmées significatives du bonheur d’être chez des jeunes gens qui fêtent un anniversaire, en palabrant sur leurs soucis actuels et un désir in-abouti d’agir. Des scènes qu’on croirait tirées d’un film en noir et blanc, Les Tricheurs (1958)de Marcel Carné, figures dessinées de lumière pour des vies qui s’épanouissent et se sentent empêchées déjà. Des scènes burlesques et comiques à la Chaplin ou Buster Keaton, avec petit homme facétieux au chapeau melon et vêtu de noir s‘amusant du drap de l’écran, mimant les petits pas, les situations des personnages et les accompagnant de sa compassion. Un rappel aussi des Ailes du désir (1987) de Wim Wenders avec son ange annonciateur blanc et ailé. La belle Elena figure l’ennui, la paresse, le désœuvrement, l’amour – objet de convoitise – qu’elle provoque chez les autres : Astrov, protecteur des forêts, la figure avant-gardiste d’une écologie engagée et active; Vania aussi qui ne se défend pas de son attirance pour la jeune femme du vieux professeur Serebriakov qui l’agace. La tonique Sonia, héritière du domaine et nièce de Vania, résiste sans aménité à Elena : elle est amoureuse, de son côté, du talentueux Astrov qui ne la voit pas. Lumineuse vision nostalgique d’un monde perdu qui renaît des cendres mêmes de la jeunesse, à travers le plurilinguisme – arabe, français, espagnol, créole – et le désir universel de se sentir vivre, malgré les petits arrangements de l’existence. Véronique Hotte Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars à 19h, relâche le 30 mars, le 1er avril à 18h, le 2 avril à 15h au CNSAD-PSL 2 bis, rue du Conservatoire 75009 – Paris.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2023 11:09 AM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama 23/03/2023 Pour la future directrice du Théâtre national de Strasbourg, il est vital que l’humanité dans sa diversité soit incarnée sur scène. Un leitmotiv qui la guide et qu’elle compte porter au cœur de l’école qui l’a formée. Entretien et retour sur son parcours. C‘était en juillet 2017. Le public du Festival d’Avignon découvrait, bouleversé, Saïgon, un spectacle d’une originalité décapante, mêlant l’intimité d’exilés vietnamiens au désastre de l’histoire coloniale française en Indochine. L’autrice et metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, adoubée pour l’occasion, n’en était pas à son premier coup d’éclat avec sa compagnie Les Hommes approximatifs, fondée en 2009, un an après sa sortie de l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS). Elle y avait rencontré tous ses alliés artistiques et créé avec eux une dizaine de spectacles, sensibles, tissés au cœur des questions sociales – de l’endettement à l’adoption internationale –, souvent inscrits dans des lieux réalistes. Tel ce centre social où elle a campé Fraternité, un « conte fantastique » évoquant la disparition de l’humanité, créé en 2021, cette fois encore à Avignon. À 41 ans, cette grande jeune femme brune à la parole réfléchie, également réalisatrice et épisodiquement actrice (vue récemment dans l’attachant Youssef Salem a du succès, de Baya Kasmi), est l’une des rares dramaturges françaises à tourner dans le monde entier, de l’Europe à la Chine en passant par l’Australie. En septembre prochain, elle posera ses valises au TNS qui l’a formée pour en prendre la direction, remplaçant ainsi le metteur en scène Stanislas Nordey, après neuf ans d’un dynamique mandat. D’où lui vient cette passion du théâtre ? Caroline Guiela Nguyen se raconte. Quelle impression vous fait ce retour au Théâtre national de Strasbourg ?
J’y reconnais tout ! Les murs, les studios, les ateliers de couture ou de construction. Au début des années 2000, ce fut le lieu de mes plus grandes joies et de rencontres extraordinaires, avec le metteur en scène polonais Krystian Lupa ou Joël Pommerat, par exemple. J’y ai aussi été saisie par le doute. Car une question restait sans réponse : pourquoi le théâtre restait-il si vide des visages métissés qui ont peuplé mon enfance ? Celle-ci n’était débattue ni sur nos scènes, ni au sein de l’école où nous n’étions que deux étudiantes non blanches. À lire aussi : Caroline Guiela Nguyen officiellement nommée au Théâtre national de Strasbourg Pour autant, je n’incrimine pas le TNS, car Stéphane Braunschweig, qui le dirigeait, comme Dominique Lecoyer, la directrice des études, m’ont toujours poussée à aller loin : ils croyaient en moi. L’époque le voulait ainsi, le sujet n’avait pas encore « troué » le paysage théâtral. Aujourd’hui, le changement est flagrant. Dans les classes de jeu des écoles supérieures de théâtre, se croisent des jeunes issus de l’immigration et de tous les milieux sociaux. Et plus seulement ceux de la classe moyenne ou de la bourgeoisie éduquées. Il reste du travail à faire dans les filières mise en scène, régie ou scénographie. Il me fallait être nourrie d’expériences pour apporter quelque chose à cette grande maison. Vous avez longtemps refusé de postuler à la direction du TNS, pourquoi ?
Il me fallait être nourrie d’expériences pour apporter quelque chose à cette grande maison. Les quinze dernières années m’ont permis de définir mon geste théâtral. Certains artistes s’affirment vite – il faut leur confier des théâtres. Mon chemin fut plus lent. Être la seule femme depuis dix ans à diriger un théâtre national, est-ce un symbole lourd à porter ?
Je ne serai pas une « femme-étendard » car il y en a plein d’autres capables de diriger le TNS. La preuve : à la tête des centres dramatiques nationaux, la parité est désormais presque acquise. Je suis avant tout une autrice-metteuse en scène qui veut défendre un projet de direction. Lequel ?
Faire du TNS le lieu où théâtre et audiovisuel puissent s’accorder dans un même mouvement. Grâce à un partenariat avec la chaîne européenne Arte dont le siège est à Strasbourg, notamment. Parce qu’aujourd’hui les arts ne sont plus cloisonnés. Beaucoup de mises en scène – comme celles du Français Julien Gosselin, du Suisse Milo Rau ou de la Belge Anne-Cécile Vandalem par exemple – empruntent à l’écriture de scénarios, de séries ou au documentaire audiovisuel. Cette porosité ne se réduit plus du tout au seul usage de la vidéo sur scène. Des chefs opérateurs peuvent apporter de nouveaux cadrages aux éclairagistes de théâtre. Moi-même et Antoine Richard, mon collaborateur artistique, on discute « bande-son » comme au cinéma.
Dans le cadre de l’école, il y aura également un partenariat avec la CinéFabrique de Lyon, qui forme aux métiers de l’audiovisuel. Un pôle « récit », pensé comme un espace commun de réflexion, sera ouvert à tous ceux qui travaillent au TNS, étudiants ou professionnels. Il sera développé sous le regard complice de Raphaël Chevènement, le coscénariste de la série Baron noir, des documentaristes Mai Hua, à qui l’on doit Les Rivières, et Hassen Ferhani, qui a réalisé Dans ma tête un rond-point. Ou encore d’auteurs-metteurs en scène comme Gurshad Shaheman ou Tiphaine Raffier, eux aussi inspirés par l’écriture cinématographique. Comme d’habitude, les étudiants du TNS vont se nourrir du théâtre qui s’y crée. À lire aussi : Ecoles de théâtre : des ascenseurs pour les tréteaux Mais certains jeunes interprètes sortant d’écoles supérieures n’ont jamais travaillé l’alexandrin. N’est-ce pas un problème ?
Je vais le découvrir chemin faisant. Si des étudiants en éprouvent la nécessité ou si un metteur en scène invité souhaite mener un atelier en vers classiques, on trouvera le moyen de former les élèves en amont. Mais pour moi, l’alexandrin de Racine – auteur que j’adore ! – raconte d’abord une histoire. Et ce n’est pas l’étude de la technique que je privilégierais en le travaillant. Pourquoi est-ce toujours à moi que l’on pose cette question du répertoire et de l’alexandrin ? Parce que ce registre ne correspond pas à votre propre théâtre. La même question aurait été posée à Joël Pommerat…
Rassurez-vous, les élèves auront plein d’outils différents à leur disposition : ils ne deviendront pas les artistes d’une seule manière de faire. Mais la spécificité du TNS est d’être une école où les élèves de plusieurs sections – interprétariat, dramaturgie, scénographie, régie, mise en scène – se mélangent pour créer des projets. Grâce à cette immersion, certains apprentis metteurs en scène peuvent révéler ce qu’ils ont dans les tripes et impulser une nouvelle façon d’écrire. Voilà le spectacle vivant que je souhaite faire émerger, plus encore que de valoriser le patrimoine.
Sur les violences sexistes et sexuelles, on proposera des formations aux jeunes hommes qui peuvent être parfois des harceleurs qui s’ignorent. La question du genre agite les étudiants des écoles d’art. Comment l’abordez-vous ?
Au taquet sur le thème de la mixité sociale et de la diversité des origines. Sur le terrain du genre, en revanche, j’avance humblement. Je m’informe, j’écoute. Faire attention à ce que l’on dit, quand on est pédagogue, me semble la moindre des choses. Et, lors de mes derniers stages, au Théâtre national de Bretagne, je ne m’en suis pas sentie paralysée. Pour ne pas que cela devienne inflammable, il faut privilégier le dialogue : accompagner les étudiants tout en maintenant nos exigences. Les jeunes sont également soucieux du climat de travail. Si la création est un lieu d’exploration possible de la violence, le chemin pour y parvenir ne doit pas passer par cette extrémité. Les tranquilliser à cet endroit comme sur le thème des violences sexistes et sexuelles est primordial. Une charte à destination des intervenants extérieurs va être rédigée. On proposera des formations aux jeunes hommes qui peuvent être parfois des harceleurs qui s’ignorent. Vous dites que le cinéma vous a sauvée. Avez-vous vraiment voulu arrêter le théâtre ?
À la fin de l’école, j’étais paumée, en pleine dépression… J’avais passé ma dernière année à monter Macbeth, et le résultat était mauvais. Cet échec a été une chance, sinon j’aurais persévéré avec les textes d’auteurs, alors qu’une seule question m’obsédait : comment fabriquer un spectacle sans cette posture de « surplomb » qui souvent empêche le théâtre de s’adresser à tout le monde ? Alors, oui, La Graine et le Mulet, film d’Abdellatif Kechiche, sorti en 2007 pendant mes études au TNS, fut un appel d’air immense. Y entendre tous les accents possibles, voir les paroles fuser lors de grandes tablées, y reconnaître enfin le réel dans lequel j’avais baigné dans un village du Haut-Var a déclenché le désir de réunir des gens avec qui représenter un tel monde sur scène.
D’où la volonté de travailler avec des amateurs ?
C’est arrivé plus tard, en 2012, lors de la première version, participative, de mon spectacle Elle brûle, inspiré de Madame Bovary de Flaubert : Le Bal d’Emma. Le personnage – incarné par l’actrice Boutaïna El Fekkak, ma camarade du TNS – y était devenu une jeune femme venue du Maroc, prise dans l’engrenage des crédits à la consommation. Nous l’avons imaginé dans une salle des fêtes à côté de Valence. J’avais convié des amateurs à y participer : d’un côté, la bourgeoisie terrienne, de l’autre, des agriculteurs. La force de ce mélange, de cette rencontre entre comédiens et amateurs, était incroyable.
Lors de cette première aventure, une autre expérience a été tout aussi révélatrice. Après les représentations, le public me demandait systématiquement pourquoi Emma parlait parfois arabe, mais jamais pour quelle raison la vieille dame interprétant la belle-mère s’exprimait en allemand ! Pourquoi une langue est-elle soudain évidente alors que l’autre réclame une note d’intention ? De là est née l’impérieuse nécessité d’inviter sur scène l’humanité dans sa diversité. Chaque langue contient une histoire en soi – « une patrie », précisait la philosophe allemande Hannah Arendt. Les familles d’exilés, comme la mienne, n’ont d’autre choix que d’inventer des récits. Cette habitude m’a été transmise en intraveineuse. Pourquoi la fiction compte-t-elle tant ?
Elle est liée à ma biographie. Mes deux parents ont vécu l’exil : ma mère, fille d’une Indienne de Pondichéry et d’un Vietnamien de Saïgon, est arrivée en France à l’âge de 13 ans, en 1956, après la défaite de Diên Biên Phu, avec sa mère et ses huit frères et sœurs. Mon père, d’origine italienne par son père et judéo-espagnole par sa mère, est un pied-noir d’Alger. La famille, dans ces cas-là, n’a d’autre choix que d’inventer des récits : la seule solution pour entretenir un lien avec un pays qu’elle ne verra plus. Cette habitude m’a été transmise en intraveineuse… Toute petite, je réinventais les conversations en vietnamien de ma mère avec ses frères et sœurs, moi qui ne parlais pas sa langue. Les histoires furent l’espace commun entre mes parents et moi. Il n’y a rien de mieux pour être dans le partage. Au théâtre, c’est pareil.
Ces écoles de théâtre qui veulent mettre plus de diversité sur scène Quels artistes ont été vos modèles ?
On cite toujours à mon propos des artistes dont j’aime la relation avec la fiction : Joël Pommerat, Wajdi Mouawad ou Ariane Mnouchkine. Je suis bien encadrée ! En 1964, cette dernière, qui a fondé le Théâtre du Soleil, a été une grande pionnière en invitant sur scène d’autres corps et d’autres voix que ceux qu’on y voyait habituellement. Elle les recrute encore dans le monde entier, alors que moi, je les trouve aux quatre coins de la France. Voilà la grande différence. Dans mon théâtre, une grande variété de personnes qui peuple l’Hexagone vient nous raconter, à sa manière, notre histoire française. Fille de Viet kieu, ces Vietnamiens de la diaspora, je n’ai pas prétendu raconter l’histoire du Vietnam dans le spectacle Saïgon, mais plutôt celle des exilés installés en France.
Comment en avez-vous choisi les acteurs ?
Certaines scènes ont lieu avant la défaite des Français, alors trois interprètes ont été recrutés au Vietnam. Je les ai beaucoup écoutés pendant les répétitions. Grâce à des annonces diffusées dans tout Paris, j’ai aussi rencontré Hiep et Anh Tran Nghia, qui jouent respectivement l’homme exilé et Marie-Antoinette, qui tient le restaurant où se joue la pièce. On entend donc sur scène plusieurs langues vietnamiennes : celle de l’exil et celle du pays d’origine. Un tel mélange y charrie le poids de l’Histoire. Lorsque le personnage joué par Hiep revient quarante ans plus tard au pays, il découvre que la femme aimée ne parle plus la même langue que la sienne, restée figée. Si je n’avais pas été si exigeante sur la cohérence linguistique, cette scène d’une profondeur vertigineuse n’aurait pas existé. Or comprendre ce que l’Histoire a fait aux gens était la finalité du spectacle – ce que la colonisation a fait à ma propre mère, en l’occurrence.
À lire aussi : “Saïgon” : Caroline Guiela Nguyen, et le théâtre de l’exil Pourquoi vos spectacles s’inscrivent-ils toujours dans des lieux de vie très précis ?
De tels univers m’ouvrent mille possibilités théâtrales. Ils me donnent parfois l’impulsion de la fiction, bien plus encore que le choix du sujet. Car recruter une équipe en annonçant d’emblée vouloir travailler la question postcoloniale me dérangerait. J’aurais l’impression de « clouer » d’avance les comédiens dans une réalité sociale ou géographique dont ils ne pourraient pas s’échapper. Dans le restaurant vietnamien, carrefour ouvert à toutes les inter-prétations, la question coloniale apparaît naturellement, mais aussi celles du départ, de l’exil, de l’amour perdu. Mon prochain projet, Lacrima, qui sera créé à Strasbourg en mai 2024 et traversé par le destin de plusieurs femmes, se déroulera dans des ateliers de couture et de broderie.
À partir de 2025, on formera dans les collèges et lycées de quartiers très différents des binômes entre professeurs et metteurs en scène reconnus. Quelle a été votre première rencontre avec le théâtre ?
C’était à l’adolescence, pendant le Mai théâtral – un festival de théâtre scolaire entre Villecroze et Draguignan. J’ai joué dans Knock, de Jules Romains, et ça m’a marquée ! Les premiers ambassadeurs du théâtre sont toujours les profs qui en parlent très bien et aiment sortir les enfants du cadre scolaire. Je vais d’ailleurs favoriser de telles pratiques au TNS. La chorégraphe Kaori Ito vient d’être nommée au Théâtre jeune public-Centre dramatique de Strasbourg et je rêve de l’embarquer dans mon projet de grand festival interscolaire. Auquel deux marraines seront associées : la documentariste Lina Soualem et la productrice de radio Aurélie Charon. À partir de 2025, on formera dans les collèges et lycées de quartiers très différents des binômes entre professeurs et metteurs en scène reconnus.
Qu’est-ce qui vous a décidée à faire du théâtre votre métier ?
Le hasard. Je voulais être avocate. La fac de droit fut un échec. En sociologie à Nîmes, j’ai trouvé un cursus « ethno-scénologie », dédié à la science de la mise en scène, qui a fait l’affaire. Un stage de trois mois chez Ariane Mnouchkine, alors qu’elle préparait Le Dernier Caravansérail, m’a fait bouger. Pourtant, l’année que j’ai passée ensuite au conservatoire d’Avignon ne m’a pas convaincue de devenir comédienne. On m’y a alors encouragée à passer le concours de la section mise en scène du TNS. Et j’ai été prise. Je n’avais jamais lu Tchekhov ! J’ai travaillé comme une bête pour combler mes lacunes. Me prenant soudain à rêver d’habiter le Quartier latin à Paris, je me suis détachée de mes propres goûts et de mon accent du Sud. Le plaisir éprouvé à l’occasion des sorties avec ma mère dans les centres commerciaux, le samedi après-midi, n’a jamais été avoué à mes camarades de promo. Pire, je mentais. En disant que je parlais vietnamien, que ma mère avait fait Mai 68 — alors que rien n’est plus faux : elle voulait tellement s’intégrer ! —, qu’elle était bouddhiste, ce qui passait mieux que la catholique qu’elle était. Même mon premier « choc théâtral » — la mise en scène de Phèdre par Patrice Chéreau en 2003 — fut une invention : je l’avais « rattrapée » en VHS ! Quand l’équipe du TNS a compris la gravité de la situation, elle m’a envoyée faire un stage chez le metteur en scène Guy Alloucherie, dans le Nord, à Loos-en-Gohelle. Il m’a fait lire Annie Ernaux… J’ai assumé d’où je venais et c’est devenu le nerf de mon théâtre. Une réconciliation. Pourquoi avez-vous titré votre récent livre d’entretiens Un théâtre cardiaque ?
À la sortie de Fraternité, conte fantastique, un ami metteur en scène m’a envoyé un joli texto : « Ton théâtre cardiaque forever… » En effet, pour moi, il n’y a pas de théâtre sans émotion. Ni sans cœur. Ni sans la pulsation de la vie.
À lire aussi : Avignon : “Fraternité, conte fantastique”, la fable post-catastrophe de Caroline Guiela Nguyen CAROLINE GUIELA NGUYEN EN QUELQUES DATES
1981 Naissance à Poissy. 2005-2008 École du Théâtre national de Strasbourg. 2009 Fondation de la compagnie Les Hommes approximatifs. 2017 Saïgon, au Festival d’Avignon. 2022 Nomination à la direction du TNS. À voir
- Fraternité, conte fantastique, les 27 et 28 avril, Théâtres de la Ville de Luxembourg.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 13, 2023 8:11 PM
|
Propos recueillis par Fabienne Darge dans Le Monde - 13/03/2023 RENCONTRE L’écriture de la dramaturge et romancière, qui présente « Des femmes qui nagent » au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, ausculte l’emprise et les effets de la domination masculine au cœur même de sa forme. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/13/pauline-peyrade-une-prose-combat-contre-les-violences-faites-aux-femmes-portee-sur-la-scene_6165323_3246.html
Dans ce qu’elle écrit, il y a de la forêt et de la nuit, du silence, des terreurs enfantines qui reviennent s’inviter dans nos vies d’adultes. Pauline Peyrade a 37 ans, elle est dramaturge, tout nouvellement romancière, et c’est une des écrivaines dont on parle, en cette fin d’hiver. Sa dernière pièce, Des femmes qui nagent, est à voir au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jusqu’au 19 mars, avant de poursuivre sa tournée. Son premier roman, L’Age de détruire (éditions de Minuit, 160 p., 16 €), trace sa route, porté par sa puissance de saisissement et un bouche-à-oreille flatteur. Du plus loin qu’elle s’en souvienne, Pauline Peyrade a toujours voulu écrire : « Dès l’âge de 4 ou 5 ans, je prenais des feuilles de papier que je pliais en deux, comme pour fabriquer des livres, avec des petites histoires inscrites à l’intérieur, raconte-t-elle, amusée. J’ai eu depuis la petite enfance une fascination pour l’écriture et les écrivains. » Elle a fait des études brillantes, mais le théâtre s’est invité tard, alors qu’elle était en khâgne au lycée Henri-IV à Paris. « C’est arrivé par la découverte de Jean Genet et de ses pièces Les Bonnes et Le Balcon, se souvient-elle. Cette lecture a été pour moi foudroyante, d’une importance capitale : à la fois pour la puissance d’évocation de Genet, pour son travail sur les rapports de domination, mais aussi pour toute sa pensée sur une forme de métathéâtre, sur la manière dont l’écriture se pense tout en écrivant. » La figure tutélaire de Genet ne l’a jamais quittée au fil de son parcours, qui s’est poursuivi à la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, où elle a fait d’autres découvertes importantes, au premier rang desquelles Sarah Kane et Edward Bond. Pauline Peyrade a ensuite intégré l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) de Lyon, dans la même section dramaturgie où, aujourd’hui, elle accompagne de jeunes aspirants à l’écriture théâtrale. C’est donc armée d’un solide bagage théorique et intellectuel qu’elle a commencé à écrire ses textes, qui très vite ont été remarqués, notamment par le metteur en scène Cyril Teste. « Reprendre les armes » Pauline Peyrade détonne dans le paysage, où les écritures sociologiques plates et sans mystère se sont multipliées comme des petits pains ces dernières années, un peu trop faciles à fabriquer et à vendre aux programmateurs. D’emblée, ce qu’elle a proposé, avec des textes comme Bois impériaux, Poings ou A la carabine (tous publiés aux éditions Les Solitaires intempestifs en 2016, 2017 et 2020), c’était tout autre chose : de vrais dispositifs formels, des sortes d’enquêtes intimes explorant avec autant de sensibilité que de maîtrise l’intériorité de femmes en butte à différentes formes de violence. Car elle a su d’emblée que c’était cela qu’elle allait écrire : des histoires de la violence, et de celle qui s’exerce de manière spécifique, « systémique », dit-elle, sur les femmes et sur les petites filles. Pauline Peyrade parle d’une voix douce, sa sensibilité et sa timidité affleurent à chaque instant dans la conversation, mais cela n’enlève rien à la netteté de son regard et de sa parole. « Mes textes ne parlent pas de moi, mais ils partent de moi, détaille-t-elle. Je suis une femme, j’écris à partir de là, et chaque texte combat une oppression, une aliénation ou un empêchement. A chaque fois, et là encore Genet me guide, la recherche formelle est l’enjeu central de cette démarche qui consiste à reprendre les armes, à se demander comment on les prend, et pourquoi c’est si difficile de les prendre. » Quand on lui demande d’où vient cette hypersensibilité sur ces questions, Pauline Peyrade répond simplement qu’ « il ne s’agit pas d’un souci extérieur ». On n’en saura pas plus, mais la dramaturge insiste sur un point : « Comme beaucoup de femmes, j’ai eu conscience très tôt de l’inégalité de traitement entre les filles et les garçons. Et, comme beaucoup de femmes, cette prise de conscience, je ne l’ai pas menée jusqu’au bout, dans un premier temps. La plupart des petites filles et des adolescentes voient et nomment la différence de traitement qu’elles subissent, et le fait que ce ne soit pas juste. Mais elles ne prennent pas les armes contre le système ou elles les prennent mal. Parce que tout concourt à leur faire admettre que cette injustice est normale, qu’elle fait partie de la vie. » Ecriture du corps et du détail Cette violence masquée, effacée, recouverte par d’autres récits, et donc difficile à lire, à déchiffrer, est au cœur de ce que la jeune femme opère au sein même de l’écriture, au fil de textes qui sont marqués du sceau du fait divers et du conte. Même si ceux-ci ne subsistent le plus souvent qu’à l’état de traces. Dans Bois impériaux, écrit en 2015, elle était partie de l’histoire de Florence Rey et Audry Maupin, ces Bonnie and Clyde fin de siècle qui tuèrent cinq personnes dans leur cavale en 1994. Pour aller voir au final du côté d’Hansel et Gretel. Dans A la carabine, texte de 2019, le point de départ de l’écriture est l’histoire – vraie – d’une enfant de 11 ans qu’un tribunal français a estimé consentante à son propre viol. Portrait d’une sirène (2018) rassemble trois contes noirs, Princesse de pierre, Rouge dents et Carrosse, centrés autour d’une adolescente victime de harcèlement scolaire, d’une jeune femme aux prises avec les injonctions mercantiles qui veulent façonner son corps et d’une mère qui s’abandonne à la pulsion infanticide. Dans tous les cas, Pauline Peyrade procède comme si elle nous faisait entrer dans la forêt mentale des personnages, obscure, épaisse, touffue. Son écriture du corps et du détail, ses enquêtes intimes, quasi psychiques, à la temporalité éclatée, ne s’offrent pas avec facilité, mais c’est bien le but recherché par l’écrivaine. « J’assume que ce soit un défi à lire, à déchiffrer, de même que pour le personnage central, c’est dur de déchiffrer le réel, à cause de l’état de choc, d’aliénation, de domination, de sidération, de peur, qu’elle subit. Opérer une lecture opaque, c’est rendre sensible le fait que d’une part c’est difficile de le lire, quand on est victime de ce type de violence, et d’autre part de trouver la sortie », explique-t-elle. Des femmes qui nagent vient s’inscrire assez différemment de ce qui précède, de même que ce premier roman, L’Age de détruire, dont le titre, qui pourrait résumer tout le travail de Pauline Peyrade, est emprunté à Virginia Woolf. « Avec l’écriture romanesque, quelque chose s’est déplacé, même si les deux sont encore des histoires de la violence », note-t-elle. Quand la metteuse en scène Emilie Capliez lui a passé commande d’une pièce, l’autrice a eu envie de tourner son regard vers les actrices, qui, et cela n’a rien d’un hasard, sont à la naissance du mouvement #metoo. « Les actrices sont évidemment au cœur de ce que le cinéma a charrié comme représentation des femmes depuis sa naissance, rappelle l’autrice. J’ai eu envie de travailler l’image dans l’écriture elle-même, sans l’analyser. C’est très proche du roman, pour moi : il s’agit de décrire, et par le parcours de la description, raconter ce moment que l’on vit, où quelque chose se défait de ce grand rêve du cinéma, et s’interroger sur cette question du regard. » Pour écrire la pièce, elle a revu des dizaines et des dizaines de films et travaillé sur la question du « male gaze », ce concept qui fait le constat que le regard dominant au cinéma a été longtemps celui de l’homme, reconduisant voire renforçant ainsi la domination des femmes. Et elle dit avoir éprouvé un certain vertige en constatant que son propre regard « était lui-même fait de male gaze autant que de female gaze ». Avec Pauline Peyrade, on rentre bien dans l’âge de détruire un certain nombre de représentations elles-mêmes dévastatrices. Avec les armes de l’art. Lire aussi la critique : « Des femmes qui nagent », mille et une histoires de femmes de cinéma s’invitent au théâtre Fabienne Darge / Le Monde Crédit photo : MATHIEU ZAZZO Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 8, 2023 4:52 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 7/03/2023 Rencontre avec la dramaturge et écrivaine qui, à l’occasion de la sortie de son roman «l’Age de détruire» et de sa dernière création «les Femmes qui nagent» sur nos représentations parfois destructrices des actrices, évoque son approche de l’écriture et questionne la monstration de la violence sur scène. Pauline Peyrade a une qualité rare : ses facultés d’analyse, la manière dont elle saisit parfaitement (mais après coup) ce qui meut ses personnages et son écriture ne pèsent jamais sur ses textes, ne les alourdissent d’aucune explication. En somme, son intelligence ne leur nuit pas, son art de l’ellipse rend ses narrations d’autant plus oppressantes qu’elles sont d’une clarté absolue alors que très peu est dit. Pauline Peyrade a la bonne trentaine, elle en paraît dix de moins, elle vient de faire paraître un premier roman, l’Age de détruire (éd. de Minuit), qui nous plonge sous le prisme d’une enfant qui tente de survivre à une mère aride et outrancièrement fusionnelle – mais le noter, ce dont se garde le texte, est déjà de trop. Envoyé par la poste, l’Age de détruire est, mine de rien, un succès de librairie, ce qui est rarissime surtout lorsque l’autrice est quasi inconnue. Pourtant Pauline Peyrade signe depuis une demi-douzaine d’années des pièces montées et éditées aux Solitaires intempestifs. Après avoir été étudiante à l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) à Lyon, elle est coresponsable de son département écriture. Sur sa biographie, on ne saura pas grand-chose. Elle vient d’un milieu «normal» nous lance-t-elle et, enfant, elle regardait des Walt Disney s’amuse-t-elle à préciser. Entretien près de la gare de l’Est – elle habite Reims – dans un café sonore, pendant que sa prochaine pièce, Des femmes qui nagent, qui convoque une foule d’actrices de la naissance d’Hollywood à aujourd’hui, brave l’eau pour arriver sur le plateau du TGP à Saint-Denis dans deux jours. Comment devient-on écrivain pour le théâtre ? C’est l’écriture qui m’attirait, plus qu’une discipline. En classe prépa, j’ai découvert les Bonnes et le Balcon de Jean Genet dont l’étude m’a passionnée, et un peu intuitivement je me suis tournée ensuite vers des masters pratiques. L’écriture pour le théâtre a ouvert une brèche, un chemin. Auparavant, j’avais écrit des nouvelles, mais c’était des tentatives… La première fois que j’ai «posé» un texte, c’était une pièce. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette pratique qui souvent est devenue plus collective lorsque le texte se conçoit durant les répétitions ? J’ai besoin de temps et de solitude. L’écriture de plateau n’est pas pour moi ! J’ai besoin de voguer seule avec des personnages, pour ensuite être du côté des acteurs. Ce sont les personnages qui permettent la fabrication d’une altérité. J’enquête sur ce qu’ils disent ou non, comment ils le disent, sur ce que leur parole produit. Comment l’acteur traversera la langue ? Ce n’est pas forcément en multipliant les signes d’oralité que ce qu’on écrit peut s’incarner. Ce n’est pas non plus par des indications de mouvement – fumer, bouger une chaise. Débuter par l’écriture de pièces, c’est-à-dire par des textes qui sont portés par d’autres, est-ce une manière détournée ou modeste d’apparaître autrice ? Alors que lorsque vous publiez un roman aux éditions de Minuit, cela vous pose comme écrivaine. J’avais du mal à m’octroyer la légitimité d’écrire un roman. C’était tétanisant. Je ne parvenais pas du tout à m’y mettre parce que je ne m’en sentais pas le droit. L’écriture pour le théâtre est beaucoup plus contrainte que le roman, ce qui est un appui. De plus, elle permet de porter un masque qui est celui du personnage. Avec le roman, même de fiction, on est derrière une vitre transparente. Il y a bien des reflets qui passent et nous occultent, mais on est quand même beaucoup plus exposée. Pendant les rencontres, je m’aperçois combien il est beaucoup plus intimidant de parler d’un roman que d’une pièce qui se laisse approcher comme un objet qui mène sa vie indépendamment de moi. La publication d’un texte qui ne passe pas par interprète ou une mise en scène vous expose ? Oui. Peut-être parce que lorsqu’on parle d’une pièce revient toujours la question du plateau et de la mise en scène. Cela se vérifie quand mes pièces sont travaillées dans des classes. Elles abordent des sujets pas faciles. L’une des manières pour que les adolescents se les approprient est de leur demander comment ils les mettraient en scène. Le théâtre vient à notre secours pour nous protéger de l’endroit où les textes nous atteignent. Le point commun de toutes vos pièces, qui se retrouve dans le roman, est celui de la violence et des abus… Mais comment montre-t-on la violence sur scène ? Je ne crains pas la frontalité du propos. Il faut savoir comment l’amener, comment le faire entendre, collectivement ou plus intimement dans le cas du roman. Et souvent cette écoute se confond avec le lent parcours d’émancipation d’un personnage. Dans le roman par exemple, la petite Elsa regarde mais n’a pas de mot pour dire ce qui lui apparaît, elle parle d’un mal qui habite sa mère, elle ne peut pas être plus précise. Souvent, on suppose aux gens une capacité à s’échapper d’une relation destructrice. Mais on ne se défait pas facilement d’une mère, on ne s’en émancipe pas en deux jours. Ça prend du temps, c’est très ambivalent, c’est à la fois libérateur et extrêmement douloureux. Faire la place à ce trajet dans le texte, c’est aussi faire la place au courage que cela exige. Alors que la narratrice est assez discrète, elle peut apparaître en sidération ou passive. Sa résistance permanente et implacable finit par opérer. Elle ressemble aux personnages de mes pièces pour cela. Effectivement les Femmes qui nagent décrit également un parcours d’émancipation mais collectif. La pièce donne l’impression que vous avez plongé dans un océan de documentation… Qu’avez-vous pêché ? Il s’agit d’un tout autre regard : celui d’une spectatrice sur des images qui lui parviennent et qui construisent ses propres représentations. La pièce est constituée de fragments qui dialoguent avec des images de films, des photos ou des scènes de tournage. Il s’agit d’accueillir toutes les contradictions à l’œuvre : les moments de fascination, mais aussi de lutte et de violence, la question des actrices qui se désolidarisent du féminisme. C’est un mouvement qui va des premières images de l’idéal féminin des années 50 – avec derrière les icônes hollywoodiennes, des histoires souvent tragiques, des morts violentes – à la constitution d’une parole qui se prend. Pour ce texte que m’a commandé la metteure en scène Emilie Capliez qui dirige le CDN de Colmar, au début, j’avais envie d’une somme. Je voulais que ces femmes soient en nombre, qu’elles prennent beaucoup de place. Je suis aussi passée par des moments plus théoriques, sur l’histoire des techniques… Y a-t-il un principe qui a présidé à l’ordre des fragments ? J’ai fait différentes tentatives, par chronologie, par motif, par mouvement. Mais la matière ne supportait pas d’être ainsi classée. Dès que je découpais le texte, il s’éteignait. Il y a tout un moment du travail où j’ai ouvert énormément la recherche, sur d’autres histoires du cinéma, d’autres continents… Certaines actrices m’importent beaucoup et elles ont une toute petite place… A travers cette recherche, avez-vous eu l’impression que la question de l’abus traverse toute l’histoire du cinéma ? C’est une porte d’entrée. Mais il y a aussi beaucoup d’amour du cinéma et d’hommages à des films dans la pièce. C’est dans cette ambivalence que s’est construite l’écriture. Un terrain sur lequel je reviens sans arrêt est le rapport des femmes à la violence, celle qu’elles subissent mais aussi celle qu’elles peuvent perpétrer. Je me suis demandé s’il y avait une histoire de la violence à composer à travers les images du cinéma et de la représentation des corps des femmes. L’un des moments où ce regard s’exerce avec acuité est la simple description d’un plan de Romance de Catherine Breillat… N’importe quelle situation avec une caméra produit un rapport de pouvoir. A partir du moment où une personne filme et qu’une autre est filmée, se pose la question de la domination, du consentement, de la confiance. Quelle relation se met en place et comment faire pour qu’il y ait une complicité, un travail fait à deux, afin que le sujet ne soit pas totalement dépossédé de l’image qu’il propose ? L’actrice qui pose ne se voit pas poser. Ce sont les images qui portent les traces des relations de pouvoir. Je n’étais pas sur place pour voir comment cela s’est passé. Mais je trouve beau que si l’on regarde bien, on puisse en déceler des indices. Avez-vous mené de front l’écriture des Femmes qui nagent et de l’Age de détruire ? J’ai commencé ce roman il y a six ans. Pendant quatre ans, il a pris des peaux successives, qui sont tombées les unes après les autres. Quelque chose ne prenait pas. J’avais abandonné ce projet pour commencer Des femmes qui nagent mais quelque mois plus tard, il est revenu frapper à la porte. Il ne m’a pas laissée tranquille. Vous analysez vos textes, et pourtant leur noyau vous échappe au moment de l’écriture… Comment est-ce possible ? Tout ce que je suis capable de nommer au préalable, je n’ai pas besoin de l’écrire. L’écriture n’est nécessaire que s’il y a des terrains qu’on approche uniquement grâce à elle. Je n’écris pas sur ce que je comprends déjà. Anne Diatkine Légende photo : Le reflet de Pauline dans l'armoire de sa grand-mère, à Reims, le 3 Mars 2023. (Camille Mcouat/pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2023 11:27 AM
|
par Laurent Schteiner dans le blog "Sur les planches | 22 Fév 2023
La Manufacture des Abbesses nous propose pour l’heure une évocation drôle et réaliste de nos mœurs dans une société envahie par les nouvelles technologies ces dernières années. Ce spectacle subtil traduit, par glissement progressif, l’obsolescence programmée d’une frange de la population en stigmatisant nos comportements inadaptés mais jugés normaux par une société qui se dédouane de ses propres excès. Notre société a subi des mutations sociétales sur la lancée des nouvelles technologies qui ont de facto mis hors champs nos anciens, les reléguant à sa périphérie. Dissonance ou velléité délibérée de marginaliser les anciens, le cadre même de cette société les cannibalise sur l’autel des technologies. Ces nouvelles communications, qui en brisant l’intimité et la sphère privée de chacun, n’ont jamais été aussi exclusives isolant les membres de la société dans une bulle ouatée. Coco Felgeirolles endosse ce vêtement qui sied aux personnes qui n’ont pas réussi à prendre le train de la modernité en marche ou qui se sont refusées à le faire. En déchirant le voile de cette drôle de société, elle incarne une génération qui tente d’adapter, contre toute superficialité dictée par les réseaux sociaux, une logique frappée au coin du bon sens. Mais que faire lorsque la raison et la logique conspirent contre soi. Maniant les paradoxes avec outrance, elle n’hésite pas à développer sa façon de voir son monde à coups de télécommande WII ou encore en manipulant la régie lumière. L’irruption de la technologie, briseuse d’harmonie familiale ou même privée, constitue une atteinte au bonheur. Cette société, qui vrille, dévient incompréhensible à ses yeux et l’enferme de surcroit dans un espace dédié à ceux qui ne peuvent vivre de cette façon. Les situations théâtralisés sont cocasses et expriment l’inanité de nos réflexes quotidiens qui sont mis en lumière et croqués sous la plume de ce trio de femmes. Il convient de saluer, outre la performance de Coco Felgeirolles, le délicat et sensible travail de cette figure qui réunit des souvenirs personnels, de la fiction et une intangible réalité. Saluons à cet effet, l’autrice, Agnès Marietta et la metteuse en scène Heidi-Eva Clavier qui ont uni leur talent à Coco Felgeirolles pour nous proposer un spectacle où la densité et la profondeur sont de tout premier ordre. Laurent Schteiner APPELS D’URGENCE d’Agnès MARIETTA, de Heidi-Eva CLAVIER et de Coco Felgeirolles Mise en scène de Heidi-Eva Clavier avec Coco Felgeirolles Création lumière : Philippe Lagrue Manufacture des Abbesses
7 rue Véron
75018 Paris
www.manufacturedesabbesses.com
Tel : 01 42 33 42 03 Jusqu’au 29 mars 2023 à 21h Tournées :
du 24 au 26 mars 2023 au Festival Les Grands Solistes à Etampes (78)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2023 6:10 PM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 15/02/23 Revisite musicale et burlesque d’un mythe sur la fin du deuil, la pièce de Jeanne Candel n’est jamais aussi passionnante que lorsqu’elle rompt avec le texte, laissant triompher la jouissance du geste et de la pulsion. Le geste, plutôt que la parole, voilà le programme de Baùbo - De l’art de n’être pas mort, la pièce énigmatique de Jeanne Candel. Baùbo, du nom de cette femme de la mythologie grecque qui, à bout de ressources pour ranimer la déesse Déméter, endeuillée par la perte de sa fille Perséphone, relève sa jupe et lui montre son sexe. Déméter éclate alors de rire et retrouve sa place dans le monde des vivants : un geste d’exhibition qui remplace la parole. Voici une pièce qui ne trouve jamais les mots pour le dire, mais sait produire des visions, dans des installations aussi stupéfiantes que l’est cette scène mythique d’exposition sexuelle. En fait, le texte n’est pas le centre d’intérêt de Jeanne Candel ; elle devrait peut-être s’en passer – excepté dans le chant, on y reviendra. Aussi faut-il attendre un peu plus de la moitié du spectacle pour qu’enfin se passe quelque chose. Immenses feuilles blanches agrafées Il faut en passer par une ouverture interminable : une femme, devant le rideau, monologue sur une passion amoureuse dans une langue étrange et étrangère, tandis qu’un homme se fait traducteur. Puis supporter une série de séquences plus ou moins burlesques conçues comme autant de sketchs, à moins qu’il ne s’agisse de rêves de deuil – mais chacun sait que les rêves des autres sont fastidieux. Puis arrive ce qui fait basculer la pièce : une parodie d’entretien radiophonique, entre une philosophe experte des concepts de Spinoza et une journaliste qui, rompant avec le discours, passe soudain à l’acte, en se jetant littéralement dans son décolleté. L’action marque la véritable raison d’être de la pièce qui, enfin, se tait, pour faire advenir sur le plateau une succession d’images et de performances, dans une scénographie inouïe signée Lisa Navarro. Dès lors tout devient passionnant. D’abord le cadre : un sol recouvert d’immenses feuilles blanches, déroulées sous les pas de performeuses aux airs de prêtresses, en longues robes de deuil. Au fond, un mur blanc, sur lequel ces officiantes vont s’agrafer les unes les autres, robes noires clouées sur fond blanc, pour mieux s’en extraire ensuite : la pièce est le récit de la violence nécessaire pour s’arracher au deuil. Cela demande de sortir littéralement du cadre, se dégager de ce mur des lamentations pour sexuellement reprendre le pouvoir. Face à nous, les femmes de Candel remontent leur jupe et se frottent le cul sur le mur pour faire apparaitre des dessins sexuels et des yeux qui nous regardent. S’éprouve alors une jouissance, une pulsion scopique qui force le regard. La beauté du geste de Jeanne Candel est d’avoir su recréer sur scène la violence salvatrice du geste de Baùbo. Son théâtre montre, expose, exhibe du sexuel, cet «art de ne pas être mort», et pour cela, il lui faut justement faire le deuil de la parole et du discours. Mais pas de la voix. Bizarreries de percussions Si la pièce n’a rien à dire, elle s’écoute et se fait entendre. Sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux, la musique du compositeur allemand du XVIIe siècle Heinrich Schütz déploie ses bizarreries de percussions et semble éclater de rire. Sur scène, le chant circule ; les femmes sur scène ne sont jamais aussi justes que lorsqu’elles chantent les mots des autres. Puis c’est au tour des musiciens et musiciennes d’être plaqués au mur sous d’immenses feuilles blanches agrafées : il leur faut déchirer le papier pour sortir les bras, trouver l’espace de la bouche et continuer de jouer de leur instrument. C’est toujours le même geste. Trouer ce qui nous cache, forcer le regard et, autrement dit, montrer son sexe. Et cela a un nom : l’Origine du monde. Le théâtre musical de Candel se regarde comme une manière de décrocher la toile de Courbet, pour en revenir aux origines burlesques – le burlesque étant toujours la production d’une catastrophe contre l’ordre établi. Baùbo, une femme, montre son sexe à une femme, pour éclater de rire. Baùbo - De l’art de n’être pas mort de Jeanne Candel, jusqu’au 19 février au Théâtre de l’Aquarium, dans le cadre du festival Bruit ; du 24 au 30 mars au Théâtre Garonne à Toulouse. Légende photo : Au fond de la scène, un mur blanc, sur lequel les performeuses aux airs de prêtresses, en longues robes de deuil, vont s’agrafer les unes les autres. (Jean Louis Fernandez)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2023 1:17 PM
|
Par Marie Plantin dans Sceneweb- 10 février 2023 Point d’orgue de BRUIT, Festival Théâtre & Musique de l’Aquarium, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, BAÙBO – De l’art de n’être pas mort s’abreuve à la source de nos mythes communs pour mieux dépecer l’amour, ses enchantements et ses douleurs et l’épingler en entomologiste fantaisiste sur le mur de nos humeurs. Jeanne Candel une fois de plus transforme le plateau en organisme musical et transcende son sujet.
Ode à la vie qui renaît envers et contre tout, hommage au désir qui pulse et fait tourner le monde, même à l’envers, cri de douleur muette et éclat de rire tonitruant, la dernière création de Jeanne Candel, à la tête du Théâtre de l’Aquarium, est une traversée musicale et théâtrale de nos extrémités sentimentales, des états limites dans lesquels nous jette la passion sous toutes ses formes. Un remue-ménage flamboyant lesté de références iconographiques et de littérature, qui vient brasser nos héritages communs et les récits qui s’y rapportent, du bain judéo-chrétien aux mythologies grecques et romaines en passant par le bassin du Moyen-Orient.
BAÙBO puise son titre à la source de la tradition orphique dans la figure féminine légendaire de Baùbo qui dévoila d’un geste aussi compromettant que salvateur, son sexe à la déesse Déméter, noyée de chagrin depuis l’enlèvement de sa fille Perséphone, et ce faisant, la fit rire et revenir parmi les vivants. De l’art de retrouver goût à la vie via cet imprévisible lever de rideau. Mais de son origine grecque « baubàô », ce mot signifierait également « dormir, s’endormir » et c’est bien au royaume des songes que nous convie la prêtresse Jeanne, dans un spectacle qui tire sa dramaturgie des assauts de l’inconscient pendant nos trêves nocturnes. De ces images abracadabrantes qui naissent à l’arrête de nos rêves, elle tire sa liberté et sa puissance créatrice, des visions qui font fi de tout réalisme, des tableaux renversants qui impriment la rétine pour longtemps. A dominante noire et blanche, l’esthétique du spectacle rejoint sa tonalité double et antithétique, majeure et mineure, oscillant entre accents comiques jubilatoires et tragédie du désespoir. Logique et rationalité ne sont pas invitées à ce banquet de mirages aussi incongrus que sublimes.
Sur ce plateau évolutif qui rétrécit ou élargit son espace de jeu à l’envie, la scénographie (très belle réalisation de Lisa Navarro), protéiforme et conçue de façon à limiter ses impacts environnementaux, semble aussi vivante et habitée que les interprètes qui la peuplent. De l’immense rideau noir de soie, gonflé comme la voile d’un navire de mauvais augure à ce mur blanc troué d’alcôves qui découvrira ses fresques cachées par un procédé pour le moins surprenant, en passant par le désordre de cette chambre où git notre héroïne dévastée, le décor prend part à ce déchirement des apparences, ce dévoilement de la chair et du chagrin, cette mise à nu de nos abîmes. Les tourments de l’amour, de l’extase qu’il procure à la démolition qu’il opère, s’incarnent dans ce maillage de scènes en grands écarts qui nous écartèlent sans nous ménager entre Eros et Thanatos, entre rire rédempteur et larmes cathartiques. Jeanne Candel au plateau mène le chœur de pleureuses en mantille noire avec l’aplomb qu’on lui connaît et nous régale d’une parenthèse performative mémorable, pelle et poêle en main, sac au dos et cotte de mailles sur la tête. Déversant des brassées de terre au sol, c’est l’amour chevaleresque qu’elle enterre en même temps qu’elle le régénère tandis que dans une succession de tableaux saisissants, les musiciens sont agrafés au mur, comme crucifiés sur l’autel du théâtre derrière un pan de papier blanc. Mais la musique n’a pas dit son dernier mot, elle jaillit de sa retraite forcée, déchire les parois immaculées pour mieux nous enlacer de sa beauté archaïque et éternelle.
Avec son complice Pierre-Antoine Badaroux à la direction musicale, Jeanne Candel a jeté son dévolu sur des partitions du compositeur Heinrich Schütz, l’un des premiers maîtres du Baroque allemand, auteur d’une musique dépouillée, austère et lumineuse à la fois. Interprétés en direct dans des formations pour le moins étonnantes puisqu’un saxophone s’immisce dans un réseau de cordes (guitares, violoncelle, violon), les morceaux s’incarnent dans le corps des interprètes qui prennent part à l’action scénique, poursuivant une démarche artistique axée sur le tissage au plateau des matériaux musicaux et théâtraux. Et la voix de Pauline Leroy, mezzo-soprano charnelle et veloutée, nimbe ces expérimentations plastiques et sensorielles de son aura sensuelle. S’il est très présent dans le prologue éblouissant porté avec malice et gravité par Pauline Huruguen et Thibault Perriard dans un tandem réjouissant au plus près du public puis sur un autre mode dans le solo humoristique de Jeanne Candel, frontal et revigorant, le texte, volubile et mélodieux, se délite par ailleurs pour laisser place aux irruptions visuelles qui frictionnent sans peur le trivial et le sacré dans un cocktail de farce et de rituel immémorial. Spinoza, Courbet, Sainte-Agathe, sont convoqués à la table du trouble, les robes s’agrafent comme des papillons qu’on épingle mais les prisonnières trouvent la parade pour s’échapper de leurs filets, la poitrine généreuse d’Hortense Monsaingeon se goûte goulument comme une pâtisserie alléchante dans une scène hilarante, la mort se repousse autant que possible dans des tentatives d’esquive redoutables, les interprètes nous appellent et nous interpellent pour le salut de leur peau placardée, le mur des lamentations cède sa place au mur des jubilations et la vie reprend ses droits, irrésistiblement. Héroïque et fière. Rien de tel qu’un spectacle pareil qui célèbre la vie dans le deuil pour se laver de ses amours défuntes et faire le plein de joie concrète et de vitalité ardente.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
BAÙBO – De l’art de n’être pas mort
À partir de fragments des œuvres de Buxtehude, Musil, Schütz et d’autres matériaux
Mise en scène : Jeanne Candel
Direction musicale : Pierre-Antoine Badaroux
Scénographie : Lisa Navarro
Costumes : Pauline Kieffer
Assistant costumes : Constant Chiassai-Polin
Création lumière : Fabrice Ollivier
Collaboration artistique : Marion Bois et Jan Peters
Régie générale et plateau : Sarah Jacquemot-Fiumani
Régie plateau : Justin Gaudry et Camille Jaffrennou
Régie lumière : Vincent Perhirin
Habillage : Constant Chiassai-Polin et Clara Hubert
De et avec : Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon et Thibault Perriard
Production : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium
Coproduction : Théâtre National Populaire, Villeurbanne ; Tandem, scène nationale Arras-Douai ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace ; Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie) ; NEST Théâtre – CDN de Thionville-Grand Est ; Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse
Construction du décor par les ateliers de la MC93 – Bobigny en collaboration avec la vie brève – Théâtre de l’Aquarium, réalisation des costumes aux ateliers du Théâtre National de Strasbourg, avec des costumes prêtés par le Festival dei Due Mondi, Spoleto (Italie)
Avec l’aide à la création du ministère de la Culture
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Paris, du Théâtre National de Strasbourg et de l’ONDA – Office national de diffusion artistique pour la création de l’audiodescription du spectacle
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Remerciements : Théâtre du Soleil, Jean-Jacques Lemêtre et Marie-Jasmine Cocito, Adrien Béal, Jean-Brice Candel et Léo-Antonin Lutinier
Coréalisation : Théâtre de la Ville – Paris et la vie brève – Théâtre de l’Aquarium
Durée : 1h40
Du 8 au 19 février 2023
Au Théâtre de l’Aquarium
Dans le cadre de BRUIT – Festival Théâtre et Musique
En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris
Du 24 au 30 mars 2023
Théâtre Garonne – Toulouse
Tournée 2023-2024 : Italie, Théâtre Dijon Bourgogne, Comédie de Colmar
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez ---------------------------------------- La critique de Gilles Charlassier dans La Terrasse Colonne vertébrale autour de laquelle s’articule l’édition Hiver 2023 du Festival Bruit, la création de Jeanne Candel avec sa compagnie la vie brève, Baùbo, de l’art de n’être pas mort, mêle joyeusement fiction et musique dans une exploration parfois loufoque de l’après-passion, le retour à la vie après la rupture amoureuse. Sur un plateau nu, deux comédiens prennent une chaise et s’asseyent face au public : Pauline Huruguen décrit, en un monologue mi-intime mi-philosophique, la flamme de la passion amoureuse, dans une langue imaginaire riche de sonorités chuintées. L’horlogerie de la pseudo-confession évoquant quelque cadrage télévisuel, achoppe parfois sur la traduction, et finalement sur les sentiments et les souvenirs en boucle, dans des micro-dérèglements cocasses. Derrière le rideau de toile noire, on retrouve le personnage étendu sur un lit, aux côtés d’une femme en mantille noire, impassible dans son grignotage de pistache. Jeanne Candel est la meneuse des pleureuses pour quelque mise en scène où l’amante délaissée veut mettre un terme à ses souffrances de cœur en même temps qu’à sa vie avec le harpon qu’on vient de lui livrer. Mais les décalages, dans l’impossible mise en place du service funèbre comme dans l’effectif musical de la transcription contemporaine d’une Passion de Schütz par Pierre-Antoine Badaroux, au saxophone aussi incongru dans ce répertoire que son travestissement, font dévier le tragique vers une impuissance tendre, drôle et rassurante. Baùbo, de l’art de n’être pas mort, met en scène la libération, par l’imprévisibilité du rire, de la catatonie de la passion quand l’être aimé a disparu. Désamorcer la gravité Faite d’ellipses, de répétitions et de glissements saugrenus – la séquence de l’entretien radiophonique sur Spinoza où Pauline Huruguen se jette sur les seins de son invitée philosophe, comme dévorant sa poitrine, est un exemple irrésistible de déplacement onirique –, la narration hétéroclite et foisonnante tisse musique et théâtre dans la grammaire du rêve qui dissout le poids du drame. L’exhibitionnisme de la toilette intime quasi mortuaire que les pleureuses font de l’amoureuse dépressive au début revient ensuite, avec une facticité comique, dans l’imitation collective du geste de Baùbo – la prêtresse qui souleva sa jupe devant la déesse Déméter – dévoilant une photo de L’Origine du Monde de Courbet. Jalonné de tableaux surréalistes – tel le consort musical agrafé sur le mur blanc – et de performances ratées – impayable numéro de Jeanne Candel avec la pelle, la poêle et l’oeuf, les bras chargés de livres et l’accent méridional –, ce théâtre musical décalé, fait de notes et de situations tressées sans être confondues dans un seul langage, progresse par esquisses et avortements discursifs pour désamorcer toute gravité, vers une rédemption chorale finale, portée par la décantation contemporaine de la Passion baroque. Gilles Charlassier / La Terrasse

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 7, 2023 5:29 PM
|
Par Igor Hansen-Løve dans Sceneweb 7/02/23 La directrice du Théâtre de l’Union à Limoges, Aurélie Van Den Daele, met en scène un texte commandé à Marilyn Mattéi pour les étudiants de l’école adossée au CDN. Confus, le spectacle est porté par une belle distribution. Encore un beau projet initié par Aurélie Van Den Daele, la directrice du Théâtre de l’Union, CDN de Limoges. Les Comètes, dont le rendez-vous annuel sera pérennisé, sont une série de créations (deux, en l’occurrence, pour la première édition) réalisées pour les étudiants de l’École supérieure du théâtre (qui viennent de terminer leur cursus), et commandées à des autrices au style contemporain. L’enjeu ? Parler de l’ici et du maintenant (et si possible des sujets qui taraudent les nouvelles générations). Traiter du vivant, dans son ensemble (et tant qu’à faire, sans hiérarchie de valeur). Autant d’orientations, en phase avec la programmation du CDN depuis qu’Aurélie Van Den Daele en a pris la direction en 2021 : jeune, féministe, progressiste, engagée, optimiste… Le meilleur argument culturel pour venir s’installer à Limoges (et / ou y rester). Comme si, signée Marilyn Mattéi et mise en scène par la directrice, est l’une de ses deux premières comètes, donc. L’action débute en 2013, le jour des résultats du bac. Quatre copains (une fille, trois garçons) se retrouvent dans une cabane au bord d’un lac, dans les bois, pour y passer la soirée. L’ambiance est à la fête, naturellement. Ces quatre-là se connaissent sur le bout des doigts. Leur amitié fait plaisir à voir. L’alcool, on le devine, coulera à flot ; la musique, on l’entend déjà, sera dansante et fiévreuse. Mais, au fil de la soirée, il se passe un truc. Quoi, précisément ? Ce n’est pas clair, justement. Marilyn Mattéi, nous propulse ensuite dans cette même cabane, dix ans plus tard, avec les mêmes protagonistes. Seulement, quelque chose a changé… Au fil d’allers-retours entre les deux époques, un drame s’esquisse. Un incendie aurait eu lieu, dans la forêt, au cours du premier soir. Quelqu’un serait mort, peut-être. Et pourtant tout le monde est là. Bizarre, bizarre… Ici, l’essentiel se joue dans les ellipses et entre les lignes. À mesure que l’intrigue se déploie, le mystère s’épaissit. Trop, à notre goût. En maintenant les spectateurs dans le doute (qui est mort ?, pourquoi ?, comment ?), Marilyn Mattéi perd ses personnages et le sujet de sa pièce. On aurait préféré voir comment le drame affecte la bande : les répercussions émotionnelles, amicales, sociales ; la culpabilité ; le travail du temps… Mais la deuxième moitié du texte (inscrit dans le genre du polar) est parasitée par le mystère. Et c’est dommage. Car Aurélie Van Den Daele et ses quatre acteurs (formidables) nous font immédiatement accéder à l’amitié adolescente. D’emblée, on est avec eux. D’emblée, on y croit. D’emblée, on retrouve ce que l’on a tous vécu, et ce que l’on a tous (un peu) perdu en vieillissant : l’intensité du temps présent. Mâtiné de belles références cinématographiques, sérielles, littéraires (des Goonies à Stranger Things, en passant par Leurs Enfants après eux), ponctué par des tubes eighties contagieux et de jolis moments festifs, ce spectacle nous laisse de belles images en tête. En attendant la suite. Igor Hansen-Løve – Sceneweb.fr Comme si de Marilyn Mattéi Mise en scène Aurélie Van Den Daele Assistant à la mise en scène Joris Rodríguez Avec quatre comédien·ne·s issu·e·s de la Séquence 10 de l’École supérieure de théâtre de l’Union Célestin Allain-Launay, Robinson Courtois, Richard Dumy, Youness Polastron Production : Théâtre de l’Union, CDN du Limousin – École supérieure de Théâtre de l’Union Durée : 1h30 Théâtre de l’Union, CDN du Limousin du 2 au 7 février 2023 Tournée 2023/2024 en cours d’élaboration Crédit photo : Thierry Laporte
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...















![[Avignon 2023] L’agora ambulante de Patricia Allio célèbre l'humanité des exilés | Revue de presse théâtre | Scoop.it](https://img.scoop.it/kUmz5EtDD8kb-xiJjCLD8zl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)