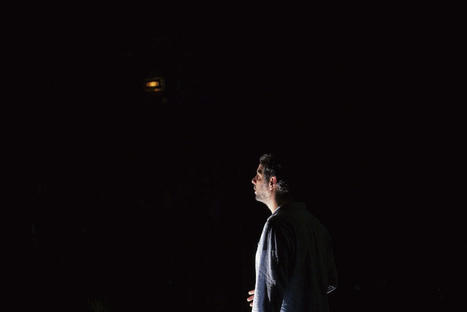Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 11, 2024 7:23 PM
|
Propos recueillis par Louise Chevillard dans La Terrasse - 23 août 2024 Avec cette création, Anne Courel met en jeu la joie, une émotion organique, théâtrale, à la fois éphémère et résistante. Pourquoi avoir mis en scène ce texte ? Anne Courel : Ce texte de Mariette Navarro, issu de dialogues avec de nombreux enfants, adolescents et adultes, est né en proximité avec un projet que j’ai mené au Théâtre de Saint-Priest de 2010 à 2014. C’est un texte profondément intergénérationnel, né d’un partage unissant des gens qui vivent avec ce qu’ils ont, à savoir un cœur et des relations, et parfois des difficultés à se sentir vivant. La trame narrative déploie six fêtes, la dernière arrivant après une mystérieuse nouvelle qui permet à tous de se rassembler, soulagés et apaisés. Le sentiment de joie que nous célébrons dans ce spectacle est très proche de ce que j’appelle mon cœur de métier. « CETTE FABRICATION COLLECTIVE DONNE À LA PIÈCE LA COULEUR D’UNE COMPLICITÉ PARTAGÉE. » De quelle manière mobilisez-vous votre public ? A.C. : J’ai eu envie de travailler en dehors du plateau, de m’éloigner du texte, en allant vers autre chose qu’un récit. D’un point de vue personnel, lorsque je suis mal à l’aise quelque part, je me mets à rendre service, c’est de là qu’est partie cette idée de faire essuyer des verres au public, pour l’aider à ce qu’il trouve sa place. À l’issue de rencontres que l’on a faites en amont, nous faisons intervenir le public au micro. Là aussi c’est périlleux, car c’est un exercice libre pour eux. Ils s’impliquent en tant que personne, dans l’idée qu’on ne peut pas faire de fête sans aller vers l’autre. Ils se laissent porter par les situations et interviennent de manière singulière. Après une représentation à Marseille, j’ai noté des idées que j’ai trouvé très stimulantes. Cette fabrication collective donne à la pièce la couleur d’une complicité partagée. Vos comédiens sont mobilisés sur tous les fronts ! A.C. : Je pars de plusieurs situations de vie très différentes. Pour les comédiens, c’est un travail difficile. Cela implique de jouer quelque chose d’intime tout en se rendant totalement disponible pour le public, qu’il s’agit de mobiliser. C’est un sacré exercice qui ouvre sur ce qu’on ne peut pas maitriser. La pièce convoque également le maniement des objets, la musique, le mouvement… Le spectacle a demandé à tous beaucoup de pas de côté. L’écriture de Mariette Navarro est très littéraire, nous l’avons adaptée à la scène en créant un spectacle participatif, accessible à des enfants dès 9 ans – et cela fonctionne ! Propos recueillis par Louise Chevillard / La Terrasse Six fêtes pour rester vivantdu mercredi 16 octobre 2024 au vendredi 18 octobre 2024Château Rouge1 route de Bonneville, 74112 Annemasse le 16 octobre 2024 à 19h30, le 17 à 14h30 (scolaire) et à 19h30, le 18 à 9h30 et 14h30 (scolaires). Tel : 04 50 43 24 24. Le Grand Angle, 6, rue du Moulinet, 38500 Voiron, le vendredi 22 novembre 2024 à 14h30 (scolaire) et 20h. Tel : 04 76 65 64 64. En tournée en 2025/2026. Légende photo : Anne Courel ©Crédit : DR
:

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2023 3:11 PM
|
Par Sarah Finger, correspondante à Montpellier / Libération le 18 mai 2023 Un vote a dû départager les candidats à la direction de la scène nationale. Pour l’heure, c’est la candidate soutenue par la ville qui l’a emporté, soulignant l’absence d’entente entre l’Etat, la région et la mairie RN. Décidément, les orages succèdent aux tempêtes autour du théâtre de l’Archipel, la scène nationale de Perpignan. Fin 2021, l’éviction de son directeur, Borja Sitjà, avait déjà provoqué un mini tsunami, de nombreux acteurs culturels estimant que la tête de cet artiste barcelonais avait été coupée par la Ville et son maire RN, Louis Aliot. Deux ans plus tard, la succession s’avère tout aussi conflictuelle. A l’issue d’un (très) long processus, quatre candidats ont été auditionnés le 29 mars. Un fin connaisseur de la scène locale, qui préfère rester discret, confie que les candidats ne se sont pas bousculés : «On les comprend… Pourquoi iraient-ils postuler dans ce bazar, sachant que le contexte perpignanais exacerbe les tensions ?» Les candidatures d’Yvan Godard, directeur d’Occitanie en scène, et de Pascale Boeglin-Rodier, cofondatrice du théâtre Liberté à Toulon, sont écartées par le jury. La shortlist se limite donc à deux noms : celui de Christophe Pomez, directeur des affaires culturelles de la Martinique, et de Jackie Surjus-Collet, directrice du théâtre de l’Archipel par intérim. La candidature du premier séduit la Drac et la région, tandis que la seconde, une Perpignanaise ancrée sur le territoire culturel local depuis de longues années, bénéficie clairement de l’appui de l’équipe de Louis Aliot et de la confiance de Maurice Halimi, président du conseil d’administration de l’Archipel. «Pourquoi flinguer quelqu’un qui a bien fait son boulot ?» Selon Claire Fita, vice-présidente de la région (PS) Occitanie en charge de la culture, un consensus se dessine malgré tout autour du projet de Christophe Pomez : «Les représentants de la Ville ont ajouté une condition, précise l’élue. Ils souhaitaient que Jackie Surjus-Collet soit nommée directrice déléguée. Tout le monde savait qu’elle voulait rester dans cette structure.» A en croire Claire Fita, cette solution semble alors convenir à tous. Mais André Bonet, adjoint à la culture de Louis Aliot, livre une version quelque peu différente des débats : «On n’arrivait pas à se mettre d’accord. Entre nous, Pomez, c’est une coquille vide, il n’a jamais dirigé de scène nationale, alors que Jackie Surjus-Collet avait bien mené la barque après Borja Sitjà ; sa candidature assurait une continuité pour l’équipe du théâtre. Pourquoi flinguer quelqu’un qui a bien fait son boulot ?» La proposition d’une direction en duo, avancée par Maurice Halimi, devait rapidement tourner court : «Jackie Surjus-Collet ne voulait pas d’une co-direction, poursuit André Bonet. Donc nous n’avions pas d’autre solution que d’organiser un vote.» Le scrutin se tient le 28 avril. Jackie Surjus-Collet l’emporte, avec 13 voix favorables et 5 abstentions : la région et l’Etat (lesquels réunissent chacun trois représentants et une personne qualifiée) se veulent «responsables» et ne souhaitent pas mettre la candidate en difficulté. Serge Regourd, vice-président du conseil d’administration et président de la commission culture de la région, démissionne pour signifier son désaccord. «La scène nationale de Perpignan est structurée juridiquement en établissement public de coopération culturelle, rappelle le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndéac) dans un communiqué. Dans un EPCC [établissement public de coopération culturelle, ndlr], la notion de coopération est essentielle et elle implique le respect et le dialogue avec l’ensemble des partenaires publics. Il n’en a rien été ici, la mairie considérant que les financements associés au label national n’impliquaient aucune obligation en matière de coopération». Un déséquilibre financier Le poids des financements respectifs n’est certes pas neutre dans ce dossier : le sociologue Emmanuel Wallon rappelait récemment dans les colonnes de Libération que la baisse des participations de l’Etat ne lui permettait plus de toujours donner «le la» en matière de nomination. C’est bien le cas pour l’Archipel à Perpignan : la Ville abonde à hauteur de 3,5 millions d’euros annuels et la métropole de 250 000 euros, tandis que les financements de la Drac s’élèvent à 600 000 euros et ceux de la région Occitanie à 500 000 euros. Un acteur culturel avisé estime que ce déséquilibre financier explique la suite : «Se sachant majoritaire, la Ville a tout de suite voulu aller au vote.» Quant au Syndéac, il estime que la mairie de Perpignan met de fait «sous tutelle» cette scène nationale. «L’art est politique, au sens noble du terme», rappelle Benjamin Barou-Crossman, un comédien et metteur en scène travaillant depuis plusieurs années avec la communauté gitane de Perpignan. «Les spécificités de cette ville, de ses quartiers, de ses habitants, doivent porter ici des acteurs culturels d’envergure, courageux et visionnaires, qui ne se laissent pas dicter leur conduite.» Le cabinet de la ministre de la Culture n’a pu que «constater qu’il n’y a pas de consensus entre les partenaires de la scène nationale l’Archipel» et que «cette situation atypique a créé beaucoup d’émoi». Rima Abdul Malak devra, avant le 28 juin, valider ou non la nomination de Jackie Surjus-Collet à la tête de l’Archipel. D’ici là, son cabinet fait savoir que la ministre s’entretiendra «avec toutes les parties» afin de trouver «la meilleure issue». Légende photo :A l’issue d’un (très) long processus, quatre candidats à la direction du théâtre de l'Archipel ont été auditionnés le 29 mars. (Jc Milhet/Hans Lucas. AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2023 6:25 PM
|
Publié sur le site d'ARTCENA - 15 mars 2023
Jusqu’ici secrétaire générale, Audrey Ardiet accède à la direction de la scène nationale avec notamment la volonté d’élargir la programmation à de nouveaux champs artistiques.
Fragilisée par le départ de Marie Didier intervenu en septembre 2021, de surcroît quelques mois seulement après la fermeture du bâtiment pour des travaux de rénovation, La Rose des Vents avait pris la sage décision de ne pas engager immédiatement une procédure de recrutement. Durant un peu plus d’un an, c’est donc une direction collégiale, accompagnée par Hélène Cancel, qui assuma la délicate mission de renouer le dialogue avec la Ville de Villeneuve-d’Ascq et de coordonner la première saison hors les murs. Aux côtés du directeur technique et de l’administrateur, y figurait Audrey Ardiet, secrétaire générale depuis 2016 et aujourd’hui nommée à la tête de la scène nationale. Si ce choix apparaît logique au regard de sa parfaite connaissance du fonctionnement de la structure et du territoire, l’intéressée confie avoir longuement réfléchi avant de postuler. « L’année de transition m’a permis de faire le point, de cerner mes envies, d’éprouver les actions que je mettais en œuvre auprès de l’équipe et du public, et finalement de me lancer », explique-t-elle. Parce que la continuité n’exclut pas la nouveauté, Audrey Ardiet porte un projet qui entend accentuer la dimension pluridisciplinaire de la scène nationale – surtout centrée sur le théâtre et la danse – en l’élargissant au théâtre d’objets, au cirque (grâce à un partenariat d’ores et déjà noué avec Le Prato de Lille), à la magie nouvelle ainsi qu’au théâtre documentaire afin d’affermir les liens entre La Rose des Vents et le cinéma Le Méliès qu’elle abrite. Quatre artistes la seconderont dans sa démarche : Thierry Collet, dans le domaine de la magie nouvelle, Cyril Teste en matière de sensibilisation à l’image notamment via la mise en place d’ateliers de découverte de ses métiers, Nathalie Béasse dont les productions mêlent théâtre et danse et qui sera conviée à élaborer une forme in situ associant une fanfare locale et la population, et enfin Jeanne Lazar. Cette jeune metteuse en scène établie dans les Hauts-de-France, qui travaille sur la question de l’oralité et a conçu des spectacles radiophoniques, présentera l’an prochain une création autour des figures de la chanson française et francophone. Outre produire leurs nouveaux projets, la directrice de La Rose des Vents souhaite faire découvrir au fil des ans leur répertoire, s’appuyer aussi sur les formats différents qu’affectionne, par exemple, Thierry Collet, pour alterner des propositions dans des lieux non-dédiés (maisons de quartiers, centres sociaux…) et sur de grands plateaux. Le désir d’ouverture à d’autres disciplines se manifestera, par ailleurs, dans l’accompagnement de compagnies régionales et/ou émergentes. Audrey Ardiet soutiendra ainsi en production et en diffusion des artistes issus d’univers très variés. Elle programmera, entre autres, Noémie Rosenblatt avec L’Ordre des choses, adapté d’un roman d’Émile Zola, le violoniste et comédien Tony Melvil pour un concert jeune public, l’autrice, metteuse en scène et performeuse Rebecca Chaillon et la créatrice lilloise de théâtre d’objets, Caroline Guyot. L’action sur le territoire se verra facilitée par la longue aventure (jusqu’à la fin de la saison prochaine) hors les murs, qui conduit La Rose des Vents à investir de nombreux équipements (Centre dramatique national, Pôle cirque, comme théâtres municipaux et salles des fêtes) de la métropole lilloise et accroît ainsi son rayonnement, mais aussi à nouer des relations de proximité avec le tissu associatif local. « Cette période de nomadisme constitue également une formidable opportunité d’augmenter et de diversifier les publics ; une nécessité, dans la perspective de la réouverture de l’équipement qui disposera de deux salles aux jauges plus importantes qu’auparavant et dont l’activité sera donc très dense », souligne Audrey Ardiet. Les festivals étant particulièrement fédérateurs, la scène nationale maintiendra son événement emblématique transfrontalier, Next, et créera deux temps forts. L’un sera consacré à la magie nouvelle, et le second placé sous l’égide d’un « Été culturel » articulé dès juillet 2023 autour de spectacles de rue, d’ateliers et de concerts, en collaboration avec les structures villeneuvoises. Attachée à la dynamique partenariale, Audrey Ardiet poursuivra en outre les co-réalisations initiées actuellement avec plusieurs établissements identifiés sur une discipline spécifique : le Théâtre du Nord-Centre dramatique national pour le théâtre, Le Prato en cirque et Le Grand bleu pour le jeune public. Enfin, la nouvelle directrice ambitionne de faire de La Rose des Vents un lieu ouvert sur la ville, facilitant ainsi son appropriation par les habitants, qui pourront le fréquenter en journée, comme par les professionnels. « J’envisage de transformer le hall en un espace de co-working où des administrateurs et des chargés de production, souvent très isolés, se rencontreront et échangeront sur leurs pratiques », précise Audrey Ardiet, qui compte mettre à profit les mois qui la séparent du retour dans les murs (prévu à l’été 2024) pour laisser libre cours à l’imagination et aux expérimentations.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 1, 2023 5:52 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 1/02/23 La fondatrice de Prémices production succèdera à Jean-Marie Hordé à la direction de cette institution de la rue de la Roquette, à Paris. Le nom est enfin officiel. C’est donc bien Claire Dupont, enseignante chercheuse à l’université de Paris-III et fondatrice de Prémisses production, officine dédiée à la jeune création fondée en 2017, qui sera à la tête du théâtre de la Bastille, poste ardemment convoité. La place était vacante depuis le départ en juin dernier de Jean-Marie Hordé, qui dirigeait la maison depuis trente-trois ans, et depuis des semaines déjà le profil de la quadragénaire circulait. Il faut dire que sous l’égide de Hordé, ce théâtre si central à Paris, à taille humaine, avec son hall de plain pied sur la rue de la Roquette, était devenu idéal pour beaucoup. Parmi ses qualités qui en font un lieu unique à Paris, il y a ses deux salles ni trop grandes ni trop petites, l’une de 261 places, l’autre de 157, l’excellent rapport public-scène, une économie saine, une équipe motivée, et ses spectateurs qui ne le sont pas moins. Et, bien sûr, il y a cette identité solide, tissée de coups de cœur, de découvertes, de fidélités en amitié, de créations transdisciplinaires, de son aptitude à innover, notamment par ses cartes blanches qui laissaient à un artiste ou collectif les clefs de la maison pendant un bon mois en mai. A la Bastille, on a pu voir et découvrir aussi bien les premiers spectacles de Tiago Rodrigues, que ceux de Tg Stan, ceux d’Alain Platel, du trio Nicolas Bouchaud, Eric Didry, Véronique Timsit, comme ceux de Nathalie Béasse, ou du Raoul collectif, mais la liste serait trop longue et oublieuse pour être poursuivie. Disons simplement que la programmation avait pour caractéristique d’être réunie par un goût et non par des modes ou un éparpillement lié à des supposés désirs du public. La Bastille avait une autre spécificité : un statut hybride, largement irrigué par l’argent public comme le sont les scènes subventionnées, mais dont les baux appartenaient à Jean-Marie Hordé, entrepreneur privé qui n’avait de compte à rendre à personne. Aujourd’hui, après s’être affronté à un casse-tête juridique qui a largement compliqué et retardé la succession et donné du grain à moudre à une équipe d’avocats, le théâtre est devenu entièrement public, financé par 74 % de subventions publiques – 64 % par le ministère de la Culture, 29 % par la mairie de Paris, et 6 % par la région – et disposant de 26 % de fonds propres liés aux recettes. «Au moins 50% de la programmation sera renouvelée» Le théâtre de la Bastille est le premier lieu que Claire Dupont dirige véritablement, même si elle a déjà connu un poste de direction, au côté de Marc Le Glatin au théâtre de la Cité internationale, ce qui ne fut pas qu’un chemin de roses. Ayant notamment accompagné à leurs débuts des artistes de sa génération tels Pauline Bureau, Julien Gosselin, Julie Bérès ou Lucie Berelowitsch, Claire Dupont peut se targuer d’avoir produit ces derniers mois le succès Discussion avec DS, premier spectacle de la très prometteuse Raphaëlle Rousseau. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, son projet pour la Bastille n’est cependant pas axé sur ce qu’on nomme du vilain terme d’émergence : «L’histoire de la Bastille est longue et elle est celle d’une fidélité aux artistes. Il n’y aurait aucun sens à faire table rase. Il y aura donc des signes de reconnaissance, des échos au passé, même si au moins 50% de la programmation sera renouvelée», explique-t-elle à Libération. L’une des lignes majeures de son projet est de construire un théâtre, «plus en relation avec le monde et la société qui le traverse», en y associant ce qu’elle nomme «un parlement artistique». Autrement dit, un trio interdisciplinaire d’artistes associés à la Bastille sur trois ans, qui travailleront sur «une question contemporaine qui habite leur geste». La directrice, qui prendra ses fonctions «aussi vite que possible», ne précise cependant pas plus son idée, préférant garder à l’équipe de la Bastille la primeur de ce qu’elle souhaite mettre en place. Elle dévoile cependant qu’elle voudrait «ancrer beaucoup plus le théâtre dans le quartier grâce à des hors-les-murs». En somme, il s’agirait de «désembastiller la Bastille». Autre idée phare : diffuser les dramaturgies nouvelles du bassin méditerranéen, qu’elle juge très peu montrées en France. Parmi les gestes forts cette fois-ci dédiés aux jeunes inconnues, la Bastille accompagnera avec le concours de Prémisses, dont Claire Dupont quitte la direction, un ou une jeune chorégraphe durant trois ans. Tout un programme axé sur le temps : le temps qu’il faut pour que le bouche-à-oreille se forme, que les artistes rencontrent leur public, et que les spectacles vivent. Claire Dupont, à la manière de la précédente direction, continuera de diffuser longuement les spectacles choisis, «de manière à installer les équipes artistiques qu’on invite». Rendez-vous à la Bastille, «dès que je serais en poste», dit celle qui ignore encore quand elle prendra ses fonctions. Demain, le 1er février ?

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2023 8:17 AM
|
Propos recueillis par Olivier Milot / Télérama le 20/01/23 L’Association des centres dramatiques nationaux (ACDN) a mené une enquête sur la situation des théâtres qui la composent. Deux dirigeants de CDN, Émilie Capliez et Joris Mathieu révèlent et commentent des chiffres parfois inquiétants pour l’avenir. lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/debats-reportages/pourquoi-les-centres-dramatiques-nationaux-vont-ils-devoir-renoncer-a-certaines-de-leurs-creations-7013897.php
Ici, « l’art et la vie ne font qu’un ». Cette phrase est celle d’une œuvre de l’artiste de street art Miss Tic. C’est celle choisie par Rima Abdul-Malak pour illustrer la carte de vœux du ministère de la Culture cette année. Ce pourrait être aussi une allégorie de ce que sont les centres dramatiques nationaux (CDN), ces fabriques de théâtre où des milliers de femmes et d’hommes œuvrent chaque jour à créer de nouveaux spectacles originaux. Comme tous les lieux de culture, les CDN ont l’obsession de renouer leur lien avec un public dont les usages ont été bousculés par la pandémie et le sont aujourd’hui par l’inflation. Ils doivent aussi composer avec une équation financière délicate avec, d’un côté, des augmentations élevées des coûts de l’énergie et une hausse des salaires et, de l’autre, des collectivités territoriales dont certaines ont décidé de faire de la culture une variable d’ajustement de leur budget et coupent dans les subventions. Dans ce contexte, l’Association des centres dramatiques nationaux (ACDN) qui regroupe les trente-huit établissements, a décidé de mener une enquête auprès d’eux pour disposer d’une vision globale de leur situation. Elle offre une photographie contrastée, avec des théâtres bien plus exposés que d’autres aux difficultés du moment, et le besoin pour tous d’inventer de nouvelles manières de créer sous la pression des bouleversements économiques et environnementaux. Émilie Capliez, codirectrice de la Comédie de Colmar, et Joris Mathieu, directeur du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, respectivement présidente et vice-président de l’ACDN, dévoilent les résultats de cette enquête et les analysent. “Certains spectateurs se montrent plus frileux à s’engager très en amont sur une date de spectacle. Il y a désormais beaucoup plus de billetterie de dernière minute.” Émilie Capliez La fréquentation des CDN a baissé en 2022 par rapport à la période pré-Covid, dans quelles proportions et comment l’expliquez-vous ?
Joris Mathieu : En moyenne, elle a baissé de 21 %, mais la situation est très hétérogène. Un tiers des théâtres a retrouvé son niveau de 2019 et, pour la majorité des autres, ce recul se situe entre 10 et 15 %. Cette baisse n’est pas notre première source d’inquiétude. Nous avons au contraire l’impression d’un retour progressif à la normale plus rapide que ce qu’on pouvait craindre. Après, comme tous nos concitoyens, notre public est confronté depuis le deuxième semestre 2022 à la hausse du coût de la vie, et on peut penser que certains spectateurs sont amenés à limiter le nombre de leurs sorties.
Émilie Capliez : On constate également une évolution des pratiques. Certains spectateurs se montrent plus frileux à s’engager très en amont sur une date de spectacle. Il y a désormais beaucoup plus de billetterie de dernière minute.
Quel est l’impact de l’inflation des coûts de l’énergie et des hausses salariales ?
E.C. : L’augmentation des coûts de l’énergie représente en 2022 1,3 million d’euros de dépenses supplémentaires pour l’ensemble de nos structures. La hausse de la masse salariale s’élève, elle, à 1,2 million d’euros pour les permanents et à 400 000 euros pour les intermittents.
“Les baisses de subvention ne sont pas toujours homogènes sur l’ensemble d’un territoire comme en Auvergne-Rhône-Alpes, où elles ont ciblé certains établissements avec des variations parfois très fortes.” Joris Mathieu J.M. : En moyenne, pour chacun des CDN, c’est une augmentation de 110 000 euros de charges avec des hausses qui, pour l’essentiel, sont intervenues sur le deuxième semestre 2022. Si on fait une projection en année pleine en 2023, on devrait avoisiner les 200 000 euros d’augmentation. C’est d’autant plus inquiétant que ces chiffres ne tiennent pas compte de charges plus invisibles mais qui pèsent lourdement sur notre activité, comme la hausse des coûts de production liée à celle des matériaux, des décors, du fret qui a pris 30 % en six mois, ou encore de l’hôtellerie. Plusieurs régions et départements ont annoncé des coupes dans leurs subventions. Le réseau des CDN est-il impacté par ces baisses ? Si oui, dans quelles proportions ?
J.M. : En 2022, un tiers des CDN ont déjà été confrontés à des baisses de subventions. L’inquiétude pour cette année est donc très forte. Ces baisses émanent de plusieurs conseils régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Grand Est et plus récemment dans les Pays de Loire. Elles ne sont pas toujours homogènes sur l’ensemble d’un territoire comme en Auvergne-Rhône-Alpes, où elles ont ciblé certains établissements avec des variations parfois très fortes. À titre d’exemple, le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon a été impacté par une réduction de 15 % de sa subvention, soit une somme de 26 000 euros. Une baisse loin d’être anodine dans notre budget, même si elle est moins importante que pour d’autres structures comme le Théâtre national populaire de Villeurbanne dont la subvention a, elle, chuté de 150 000 euros.
Lors de la présentation de ses vœux, la ministre de la Culture a dénoncé les coupes budgétaires opérées par certaines régions en affirmant que “la culture ne peut pas être une variable d’ajustement”. Vous souscrivez ?
J.M. : Évidemment. Ce qui nous préoccupe, c’est que l’État seul ne peut pas absorber toutes les hausses que nous subissons, surtout quand elles sont couplées avec des baisses de subventions. Le financement de nos structures est co-partagé entre l’État et les collectivités territoriales. Notre crainte est de voir cette co-construction des politiques culturelles voler en éclats en période de crise, du fait de l’attitude de certains exécutifs régionaux qui utilisent justement la culture comme variable d’ajustement de leur budget.
Aux dernières Biennales internationales du spectacle, on a beaucoup entendu dire que l’État avait bien du mal en ce moment à jouer son rôle de pilote dans le secteur de la culture…
J.M. : L’État reste la colonne vertébrale d’une politique culturelle à l’échelle du territoire. Ce qui peut questionner, c’est la manière dont l’exécutif d’une région comme la nôtre, Auvergne-Rhône-Alpes, peut prétendre individualiser sa politique dans le domaine culturel et se désolidariser d’une co-construction des politiques publiques culturelles alors même que la culture ne représente que 2,5 % de son budget global, soit deux à trois fois moins que ce que l’État investit dans la région.
“Il nous revient de repenser notre modèle. On va probablement produire différemment, diffuser les œuvres sur un temps plus long, responsabiliser nos pratiques en termes d’environnement…” Émilie Capliez Ces hausses de l’énergie et des salaires cumulées dans certaines régions à des baisses de subventions ont-elles un impact sur la création ?
E.C. : Tout l’enjeu est là. Les CDN abritent beaucoup d’artistes, d’artistes associés, et nous avons besoin de pouvoir soutenir toute cette chaîne de création et de diffusion de spectacles. La situation est certes hétérogène au sein du réseau, mais chacun d’entre nous sera soumis à des arbitrages plus ou moins contraignants.
Produire moins mais diffuser plus et à proximité des lieux de création pour des questions environnementales pourrait-il être une solution à ces crises ?
E.C. : Nous vivons une période de transition où nous sommes contraints d’analyser en permanence ce qui nous arrive tout en restant dans l’action. Il nous revient donc d’imaginer une forme de décélération, de repenser notre modèle. On va probablement produire différemment, diffuser les œuvres sur un temps plus long, responsabiliser nos pratiques en termes d’environnement… Ce doit être un projet global, mûri à l’échelle de toutes les scènes labellisées et dont les solutions ne pourront être que collectives.
Olivier Milot / Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 10, 2023 7:42 AM
|
Publié sur le site d'Artcena le 9 janvier 2023
La nouvelle directrice se fixe comme objectifs d’être à l’écoute du territoire et de fédérer les publics.
Ayant réalisé l’essentiel de son parcours dans le Rhône – en tant que directrice des Affaires culturelles de la commune de Genas, de L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune et depuis cinq ans du Théâtre de Villefranche-sur-Saône – Amélie Casasole change de Département et de Région pour mettre le cap sur Nîmes, Ville dont elle salue le fort engagement en faveur de la culture. Équivalent en termes de volume de spectacles par rapport à celui qu’elle s’apprête à quitter, le Théâtre de Nîmes dispose toutefois d’un atout supplémentaire : deux salles aux jauges bien différentes (le théâtre Bernadette Laffont, pourvu d’un grand plateau, et le théâtre de l’Odéon, scène plus intimiste située dans un autre quartier), permettant donc de développer une offre diversifiée. C’est précisément ce qui a séduit Amélie Casasole, attentive dans chacune de ses programmations à alterner grandes formes fédératrices et propositions émergentes et très novatrices. « Un théâtre de ville doit s’adresser à tous. Car plus le public se sent concerné, plus il est enclin de temps à autre à effectuer un pas de côté en découvrant un spectacle qu’il ne pensait pas aimer », explique-t-elle. Fidèle à ligne artistique du Théâtre de Nîmes, scène conventionnée danse qui depuis de nombreuses années promeut des chorégraphes confirmés comme des jeunes talents, la directrice continuera d’autre part à accueillir du théâtre classique et contemporain, avec une sensibilité particulière pour les auteurs dont les textes font écho aux problématiques sociétales et à l’actualité, de la musique (le Festival Flamenco, d’envergure nationale et internationale, sera pérennisé), du cirque – art, à ses yeux, intergénérationnel – et des pièces jeune public. Cette pluridisciplinarité sera également incarnée par l’une de ses artistes associées, Fanny de Chaillé, à la fois chorégraphe, metteuse en scène et performeuse, choisie en outre pour sa capacité à concevoir aussi bien des créations sur de grands plateaux que des productions adaptées à des lieux non-dédiés tels que les lycées et les universités. Elle sera rejointe par la chorégraphe toulousaine Marion Muzac, dont le travail régulier mené avec des danseurs amateurs satisfera un axe primordial de la nouvelle direction : intégrer les spectateurs au processus de création, afin qu’ils puissent s’approprier le projet artistique et culturel et y contribuer. « J’attends de ces deux artistes, que nous coproduirons et diffuserons, qu’elles soient force de propositions pour l’activité du théâtre, dans et hors les murs, et accompagnent cette volonté de toucher un large public », souligne Amélie Casasole. Outre poursuivre et affermir la programmation en itinérance, la future directrice souhaite en effet multiplier les occasions de rencontre avec les habitants : imaginer des résidences et/ou des créations in situ à l’échelle d’un quartier, dans des établissements scolaires, médicaux et sociaux et même des entreprises, participer à des événements portés par des associations et des communes, et croiser les approches ; ainsi qu’elle le fit à Villefranche-sur-Saône, par exemple en organisant dans des caveaux des concerts suivis d’une dégustation de vins. « S’immerger dans la vie d’un territoire, être à son écoute et dialoguer avec lui est nécessaire pour susciter le désir de culture chez ceux qui en sont éloignés », estime Amélie Casasole. Elle entend par ailleurs privilégier l’attention à la jeunesse, très connectée au virtuel et qui a donc d’autant plus besoin de relations humaines et d’éprouver cette expérience, irremplaçable, du spectacle vivant. « La programmation dédiée aux enfants, aux adolescents et aux familles constituera évidemment un levier important. Mais cette démarche passera aussi par des actions culturelles, en collaboration avec l’Éducation nationale et les services Jeunesse de la Ville », ajoute-t-elle. Ambitieuses, ces orientations s’inscrivent dans une perspective qui l’est tout autant : voir le Théâtre de Nîmes obtenir le label scène nationale. Si son cahier des charges actuel en respecte bien des critères, la nouvelle maîtresse des lieux préfère rester prudente. « Il faut laisser au projet le temps de se poser. Je pense que le ministère de la Culture, qui a reconnu la qualité du travail réalisé par mon prédécesseur, sera attentif à son évolution ces prochaines années », affirme-t-elle, voyant néanmoins dans la labellisation un défi très stimulant à relever. Bien que prenant ses fonctions le 1er juin 2023, elle s’y attellera dès la fin janvier, date à laquelle François Noël quittera les siennes. Car tout en achevant sa mission à Villefranche-sur-Saône, Amélie Casasole est d’ores et déjà appelée à programmer la seconde partie de la saison 2023/2024. Une excellente façon d’entrer dans le vif du sujet.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2022 12:54 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 19/12/2022 Célèbre pour ses fresques mélodramatiques et ses castings ultra diversifiés, l’autrice, réalisatrice et metteure en scène de 41 ans a été nommée à la direction du TNS. «Une femme ! Une femme !» lisait-on dans des commentaires en feu sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de la nomination très attendue de Caroline Guiela Nguyen à la tête du Théâtre national de Strasbourg, en succession de Stanislas Nordey, en poste depuis 2014. Comme si l’événement tenait de la navette extraterrestre aperçue au loin sur la colline. Il y a un peu de ça, bien sûr : l’autrice, réalisatrice, metteure en scène de 41 ans ne sera pas la première femme à diriger la prestigieuse institution et sa très sélecte école supérieure, puisque la metteure en scène Julie Brochen (2008-2014) avait déjà pilotée le lieu. Mais elle sera, à sa prise de fonction, la seule femme en poste à la direction d’un théâtre national, label pilier de la politique publique en matière de spectacle vivant. Les quatre autres théâtres de ce type sont actuellement (et depuis 2014) dirigés par des hommes : Stéphane Braunschweig à l’Odéon, Wajdi Mouawad à la Colline, Eric Ruf à la Comédie-Française, Rachid Ouramdane au Théâtre national de Chaillot. Enfin une femme, donc. Bonne nouvelle évidemment, mais il y en a une autre, et une meilleure peut-être ? La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a surtout donné le poste à une artiste précieuse: « Caroline Guiela Nguyen a l’ambition de s’adresser à tous ceux qui se sentent éloignés du théâtre, pour qu’ils trouvent leur place à la fois dans le public, sur scène, ou au sein de l’école du TNS » s’est réjouit la ministre de la culture dans un communiqué. Une grande agilité Et elle est précieuse, en ce moment, cette tout juste quadragénaire, transfuge de classe fan d’Annie Ernaux. D’une part parce qu’elle adore les récits manquants et l’histoire trouée. D’autre part parce qu’elle est d’une grande agilité pour composer des équipes comme on n’en voit jamais (rarement ?) ailleurs, réunissant et passionnant autour d’un même spectacle, ou film, acteurs professionnels et gens de la société civile, individus d’âges, de sexes, d’origines, de langues (arabe, tamoul, anglais), de milieux sociaux très différents, lesquels font puissamment bloc pour défendre à l’international de grandes sagas contemporaines mélodramatiques. On voyait cette orfèvrerie à l’échelle d’une compagnie indépendante. Qui aujourd’hui, n’en ferait pas l’urgence au plus haut échelon des labels d’Etat (budget de fonctionnement du TNS : 13,5 millions d’euros) ? Voyez les castings de ses grands succès Saïgon (carton international depuis le Festival IN d’Avignon 2017), ou Fraternité (carton international depuis le Festival IN d’Avignon 2021) : une cuisinière vietnamienne y croisait un vieil acteur irakien, une rappeuse marseillaise éducatrice spécialisée et une autre qui jamais n’avait même songé franchir la porte d’un théâtre. Bouclage de boucle enchanté Cette «diversité», qui paraît chez d’autres artificielle, contrainte par un cahier des charges, relève plutôt de l’organique et de l’évidence chez cette Franco-Vietnamo-pied-noir élevée dans un microvillage de l’arrière-pays varois et qui déclarait en 2016 à Libé : «J’ai un immense plaisir à voir se croiser lors d’une création des gens que rien ne poussait à se rencontrer. C’est pas humaniste, hein, c’est l’écriture qui a amené ça.» Elle nous confiait aussi être sortie de son village du Var sans grand «capital culturel» et avoir vécu la «séparation symbolique» d’avec son milieu d’origine en entrant dans la section «mise en scène» du Théâtre national de Strasbourg, une formation très sélecte où elle s’est convaincue qu’elle aussi aimait Jon Fosse ou Claude Régy (elle en est sortie en 2008). Elle se sentira mieux auprès du metteur en scène Guy Alloucherie, qui travaillait alors dans le Nord avec d’anciens mineurs, ou de Joël Pommerat, avec qui elle travaille à la Maison centrale d’Arles. Aujourd’hui, en revenant sur les lieux de l’inhibition sociale, Caroline Guiela Nguyen semble ainsi opérer un bouclage de boucle enchanté. Dans un lieu qui, entre-temps, a accéléré sur les questions de diversité ethnique et socioculturelle sous l’égide de Stanislas Nordey. Enorme semi-remorque Sa nomination était l’un des dossiers brûlants sur le bureau de la ministre de la Culture, laquelle devait présenter à Emmanuel Macron plusieurs profils pour succéder au metteur en scène et acteur Stanislas Nordey. En effet, à la différence des autres théâtres subventionnés, les théâtres nationaux sont placés sous la tutelle directe du ministère de la Culture, mais c’est à l’Elysée que l’on tranche sur le profil de leurs patrons. D’autres noms circulaient pour la nouvelle direction du TNS comme ceux d’Olivier Py (en partance du Festival d’Avignon), ceux aussi de Sylvain Creuzevault et Julien Gosselin, deux très bons metteurs en scène de la même génération que Caroline Guiela Nguyen qui, comme elle d’ailleurs, furent un temps portés par le désir de créer – ou de tenter de le faire – des lieux alternatifs aux labels institutionnels en place. Tous trois se sont donc laissé convaincre par l’importance de voir les plus grosses maisons compter à leur tête des projets vraiment enthousiasmants. Autant qu’il est possible de manœuvrer cet énorme semi-remorque : le TNS, c’est quatre salles, des ateliers de décors et costumes, une école mais aussi un climat social à gérer, une crise énergétique à appréhender, des budgets à contenir. En étant toutefois mieux épaulée que dans de plus petites maisons sans service de ressources humaines. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2023.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 27, 2021 6:48 PM
|
Propos recueillis par Rosita Boisseau pour Le Monde - 27/11/21 L’ancienne directrice de la danse de l’Opéra de Paris a choisi de mettre en avant des chorégraphes femmes pour sa dernière édition à la tête de la manifestation.
Brigitte Lefèvre est une histoire de l’art chorégraphique à elle seule. De l’école de l’Opéra qu’elle intègre à l’âge de 8 ans au poste prestigieux de directrice de la danse de l’Opéra national de Paris de 1995 à 2014, du ballet au théâtre, des scènes aux bureaux du ministère de la culture de 1985 à 1992, elle a traversé soixante ans de danse sans rien lâcher de sa passion intransigeante. Aux manettes du Festival de danse de Cannes depuis 2015, cette fan de Gaston Bachelard signe son ultime édition placée sous le signe de la femme et de la Terre avec vingt-huit compagnies nationales et internationales, à l’affiche du 27 novembre au 12 décembre, dans neuf théâtres de Cannes et des villes environnantes. Lire aussi Le Festival de danse de Cannes réchauffe la Croisette Pour cette programmation particulière, vous mettez de nombreuses femmes chorégraphes en avant dont la pionnière américaine Martha Graham (1894-1991) ou la nouvelle star flamenca Rocio Molina. Dans quel esprit avez-vous conçu ce menu féminin et même féministe ? Pendant la crise sanitaire, j’ai relu deux autobiographies : Ma vie, d’Isadora Duncan, et Mémoire de la danse, de Martha Graham. Leurs destins m’ont de nouveau émue et surtout donné envie de construire cette édition autour des femmes. J’apprécie les combattantes et les constructrices. L’œuvre de Martha Graham, qui est transmise contre vents et marées par Janet Eilber, directrice artistique de la compagnie américaine depuis 2005, pose le socle de la modernité dès les années 1930. Elle est enracinée dans une lecture des mythes grecs et de Freud. Elle propose un point de vue personnel sur différents thèmes dont celui de la complexité de la sexualité féminine. A partir de là, j’ai invité des artistes de toutes les générations comme Louise Lecavalier, Maud Le Pladec ou encore la très jeune Eugénie Andrin. C’est un plaisir de les soutenir car elles représentent une forme de puissance. Mais je tiens à dire qu’il y a aussi des hommes à l’affiche, dont Pierre Pontvianne. Les chorégraphes femmes abordent-elles selon vous des sujets particuliers ? Je dirais que les chorégraphes masculins ont un point de vue souvent plus global que les femmes qui, elles, me semblent pénétrer plus profondément dans les thèmes qu’elles traitent sur le plateau. Elles m’apparaissent moins conceptuelles et plus volontaristes dans l’exposition de leur sensibilité. L’onirisme de Carolyn Carlson, qui clôt la manifestation avec Crossroads to Synchronicity, est très écologique et c’est important aujourd’hui. Quant à Bintou Dembélé, elle se confronte à son histoire et ses racines africaines en inventant son propre rituel pour son solo Strates. Vous avez endossé tous les rôles, danseuse, chorégraphe, première « déléguée à la danse » au ministère de la culture de 1985 à 1992, directrice de la danse à l’Opéra national de Paris… Quelle casquette préférez-vous ? Celle de danseuse. La danse m’a permis de découvrir la musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques… Au-delà de ce que j’ai appris à l’Opéra national de Paris, j’ai particulièrement aimé collaborer, dans les années 1970, avec le chorégraphe Michel Caserta qui avait travaillé lui-même avec l’Afro-Américain Alvin Ailey dont le style sensuel et balancé me plaisait beaucoup. J’ai aussi interprété en 1971 un solo comique improbable intitulé La Curieuse, de Norbert Schmucki, dans lequel j’arborais des couettes rouges. Entendre rire le public de la Cour d’honneur d’Avignon, ça ne s’oublie pas. J’aime rire et faire rire ! Je n’étais pas, je pense, une interprète classique exceptionnelle mais j’étais travailleuse : il faut beaucoup travailler pour faire vivre la technique et c’est un chemin qui n’a pas de fin. J’adorais faire des découvertes. Pendant les différents confinements, je me suis surprise à danser seule chez moi. Quand on danse, on s’oublie, on se perd dans le mouvement. Vous avez également chorégraphié une vingtaine de spectacles lorsque vous dirigiez le Théâtre du Silence, avec Jacques Garnier (1940-1989), à La Rochelle, à partir de 1974. Avez-vous eu la sensation que c’était plus difficile à l’époque d’être à la tête d’une institution pour une femme que pour un homme ? Lorsque je dirigeais le Théâtre du Silence avec Jacques, je me sentais parfois, et quelle que fût notre amitié, institutionnellement en retrait, comme une sorte de cerise sur le gâteau. Quand il a décidé de retourner à l’Opéra de Paris en 1980 pour fonder le Groupe de recherche chorégraphique de l’Opéra de Paris (GRCOP), je n’ai pas souhaité le suivre. Je me suis retrouvée seule à la direction de la compagnie. Je me suis d’abord demandé comment j’allais faire. J’ai dû m’imposer face aux réactions des élus et du ministère qui s’inquiétaient que je puisse vraiment diriger la troupe sans lui. Il fallait que je prouve que j’étais capable de tenir la barre. J’ai mis fin au Théâtre du Silence en 1985. Même si j’aime rassembler, chorégraphier, le temps était passé. Comment la situation a-t-elle évolué selon vous pour les femmes dans la danse depuis vos débuts ? J’ai souvent envie de répondre à cette question par une formule de Marguerite Yourcenar qui dit : « Ni homme ni femme, je fais partie de l’espèce. » J’ai la sensation que, en même temps que les femmes s’expriment, elles émettent toujours un doute sur ce qu’elles affirment. Et qu’il s’agit aujourd’hui de gommer irrémédiablement ce doute pour que leurs paroles soient vraiment entendues et sur tous les sujets, en particulier celui du harcèlement sexuel. Je suis heureuse de voir aujourd’hui que nombre d’entre elles dirigent des institutions. Au passage, j’ai envie de remercier des personnalités comme Martha Graham, Pina Bausch ou encore Françoise Dupuy. Cette édition fait cohabiter les styles, du classique au hip-hop, mais aussi les troupes contemporaines et les ballets d’opéra dont celui de Bordeaux. Est-ce une façon de souligner votre point de vue sur la situation globale de la danse en France ? On ne considère pas assez les ballets d’opéra en province comme ceux de Bordeaux, de Toulouse ou de Nice. Or, ces troupes font un travail très intéressant dans le registre classique avec une ouverture contemporaine marquée qu’il faut soutenir absolument. Mais qu’il s’agisse de ces institutions ou des Centres chorégraphiques nationaux, la danse a besoin de places fortes et de moyens financiers constants. Il faut aussi conserver l’équilibre entre les différents styles, valoriser bien sûr la création mais pas seulement, et veiller à ce que les spectacles soient davantage diffusés au bénéfice du public. La danse est en bonne santé mais il reste des aspects sociétaux à toujours considérer, comme la diversité. Festival de danse de Cannes, du 27 novembre au 12 décembre. Tél. : 04-92-98-62-77. Rosita Boisseau
Légende photo : Brigitte Lefèvre, le 4 octobre 2021, au Palais des festivals et des congrès de Cannes. PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS DE CANNES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2021 8:52 AM
|
Propos recueillis par Stéphane Caruana dans Hétéroclite (Lyon) le 3 nov. 2021 Après un parcours à l’international, du Japon aux États-Unis en passant par le Chili, Courtney Geraghty a succédé à Jean Lacornerie à la tête du Théâtre de la Croix-Rousse où elle propose cette saison une programmation résolument tournée vers les questions d’identités et de genres. Pour approfondir la question, Hétéroclite est allé à sa rencontre à l’occasion d’un Grand entretien. Vous avez été nommée directrice du Théâtre de la Croix-Rousse le 21 septembre 2021 et êtes entrée en fonction en janvier 2021 dans les conditions sanitaires que l’on connait. Comment avez-vous mis à profit ce temps suspendu de la culture et qu’y a-t-il de vous dans la programmation de cette saison ? Courtney Geraghty : Il y a beaucoup de moi dans cette programmation puisque c’est vraiment une saison que j’ai construite entièrement. Les quelques spectacles reportés sont vraiment des spectacles qui avaient du sens pour moi et que j’aurais pu programmer à part entière. C’est ce qui m’intéressait en postulant à la suite de Jean Lacronerie : même si mon projet amène le Théâtre de la Croix-Rousse dans une nouvelle direction, il y avait déjà des spectacles qui m’intéressaient chez mon prédécesseur. Donc, l’idée n’est pas de faire une rupture à 360. Certes, on n’est plus sur la ligne théâtre musical qui était le fil conducteur au préalable, mais il y a quand même certains spectacles qui étaient déjà là et qui ont tout à fait leur place dans mon projet. On a cette saison 4 spectacles reportés. Et puis des continuités aussi avec certains artistes, par exemple, Johanny Bert, qui est notre artiste complice et qui avait déjà été programmé ici par le passé. En revanche, je pense qu’on peut difficilement parler d’un temps suspendu pour la culture et en tout cas particulièrement par rapport à mon arrivée, au contraire. Une prise de fonction au mois de janvier pour sortir une programmation à l’été, c’est déjà extrêmement court, en dehors de tout contexte Covid. Là, par exemple, je travaille déjà sur la programmation de la saison 22-23. On travaille normalement plus d’un an sur la programmation. Là, travailler de janvier à mars-avril pour boucler une saison, c’est très court, trop court pour être sincère et du coup, jugulé au contexte Covid, ça n’a pas du tout été un temps suspendu. On note une attention marquée pour les questions d’inclusivité et de diversité dans votre programmation, notamment sur les questions féministes, de genre et d’identité. Pensez-vous que votre parcours international a influencé ces choix ? Oui, je pense. J’ai d’abord vécu au Japon et par rapport aux questions de sexualité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont positionnées autrement qu’en France. Je ne vais pas dire qu’il y a pas de tabou, il y en a, mais ce ne sont pas les mêmes qu’en France. Mais surtout, le plus marquant pour moi, ce sont les deux dernières expériences que j’ai eu à l’étranger. D’abord au Chili, vivre dans un ancien pays colonisé, c’est quelque chose qui m’a beaucoup ouvert les yeux sur les dynamiques Nord-Sud, entre les pays occidentalisés et les pays anciennement colonisés. On a eu l’occasion d’inviter l’autrice Léonora Miano qui défend un discours post-colonial et on a vu ce que ça générait en termes de qualité et de force de rencontre avec le public au Chili que de pouvoir être dans une rencontre Sud-Sud en quelque sorte. Accompagner des discours qui questionnent ces dynamiques de domination, c’est vraiment quelque chose qui m’a beaucoup ouvert les yeux. Même sur la question du corps au Chili, il y a beaucoup plus d’acceptation de la diversité du corps, beaucoup moins de grossophobie. On ressent moins le besoin de se conformer à une certaine image. Et ça fait un bien fou. Aux États-Unis, j’ai pu approfondir encore ces réflexions parce que l’inclusivité est très présente, notamment à New York. Vous l’avez évoqué, vous avez travaillé au Japon, au Chili, aux États-Unis et en France. Que pensez-vous du rapport du théâtre en France avec les questions féministes et LGBT+ au regard de ce que vous avez expérimenté à l’étranger ? Je pense qu’en France, les questions féministes sont en train d’arriver petit à petit sur le devant de la scène. Je pense que sur les questions LGBT+ ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, en France, les spectacles que j’ai pu voir avec des personnes trans sur scène traitaient toujours de la transidentité. Bien sûr, les personnes trans sont tout à fait invitées à parler des questions de transidentité sur les plateaux. Et nos plateaux sont aussi un endroit pour ça. Mais aux États-Unis par exemple, une artiste que j’aime beaucoup emploie des interprètes trans dans des rôles et des spectacles qui n’ont rien à voir avec la question de la transidentité. Pour moi, c’est un pas de plus vers lequel on a besoin d’aller en France, c’est à dire de ne pas tomber dans l’assignation à parler nécessairement de son identité sexuelle. On est aussi un individu qui est légitime à s’exprimer sur tous les sujets. Vous avez accueilli les Universités d’automne de HF AURA en octobre, diriez-vous que votre démarche, en tant que directrice de théâtre, est résolument féministe ? Oui, ma démarche, à la fois personnelle et professionnelle, oui, je la qualifierais de féministe. Vous revendiquez le terme? Oui, je suis à l’aise avec ce terme. C’est un beau terme et je trouve que c’est un terme dont on devrait tous pouvoir se revendiquer. J’aime particulièrement les hommes aussi qui se revendiquent féministes. C’est un terme que je revendique parce que je pense qu’il n’est pas du tout un terme qui provoque. C’est un terme qui souhaite que les femmes aient une place juste et égale dans la société, je ne vois pas ce qu’il y a de répréhensible à cela. Depuis quelques jours, le mouvement #MeTooTheatre prend de l’ampleur en France. Les Célestins ont pris la décision d’annuler les représentations du spectacle de Michel Didym, dont Libération a dévoilé qu’il était accusé par une vingtaine de comédiennes de harcèlement et de violences sexuelles. Qu’en pensez-vous ? La libération de la parole des femmes est vraiment extraordinaire et essentielle. Je me sens très chanceuse de vivre dans cette ère post #MeToo. Tout ce qui se dit aujourd’hui, ce sont des choses dont, comme toutes les femmes, j’avais conscience, mais qui étaient intériorisées et dont on avait l’impression que ça ne servait à rien de parler. J’ai des tas d’exemples, de choses qu’on a toutes rencontrées dans le cadre de nos parcours scolaires ou professionnels, qui sont des gestes ou des paroles choquantes et déplacées dont on n’avait pas l’impression que ça servait à quoi que ce soit de le dire. Et tout d’un coup, de réaliser la force de cette parole collective, de cette solidarité, de cette sororité qu’on se découvre, c’est pour moi, le marqueur du féminisme aujourd’hui, cette découverte de la force collective des femmes. Le #MeTooTheatre est un épiphénomène de plus, on va en connaître d’autres. Je pense que tous les secteurs, quels qu’ils soient, auront leur #MeToo. Malheureusement, on n’en a pas fini avec les questions patriarcales. Sur le choix des Célestins, je n’ai pas nécessairement à le commenter. Je comprends tout à fait la complexité de la situation dans laquelle le théâtre des Célestins s’est retrouvé et le fait qu’il ne soit pas évident de maintenir les représentations dans ce contexte. Je m’interroge néanmoins, à titre personnel, sur le moment où il faut laisser faire la justice dans notre société. Il me semble avant tout qu’il est important d’accompagner par la parole lorsqu’il y a des mises en accusation de ce type. De donner place aux associations militantes et spécialisées sur les questions des violences sexuelles, de leur ouvrir nos portes pour qu’elles puissent venir s’exprimer, travailler, éduquer. N’est-ce pas symptomatique de la difficulté de parler face à ces violences sexuelles et de harcèlement dans une société patriarcale que même le théâtre, dont le travail est de porter la parole collective, mette tant de temps à réussir à porter cette parole spécifique ? En fait, je crois que dans le théâtre, ce qui a fait défaut, c’est qu’on ait laissé autant les hommes s’accaparer les postes de pouvoir. Et ça fait longtemps qu’on en a conscience. Le rapport Reine Prat date de 2005 et depuis, on met quand même beaucoup de temps à remonter la pente et à rééquilibrer la situation. La vaste majorité des directeurs de lieux, des directeurs d’écoles, de conservatoires et des metteurs en scène qui étaient programmés, qui bénéficiaient des moyens de production, qui étaient soutenus financièrement, ont été très longtemps des hommes dans des disproportions ahurissantes. De là a découlé, pour les femmes, un contexte d’omerta. Effectivement, c’est un secteur où la parole se déroule sur les plateaux, mais cette parole a été confisquée par les hommes. Vous faites partie d’une minorité de femmes directrices d’établissements culturels. Est-ce qu’il existe un dialogue entre vous ? Est-ce qu’il y a un travail collectif qui est fait ? On essaye de le mettre en place de manière informelle. Je suis proche d’un certain nombre d’homologues directrices avec lesquelles on partage certaines valeurs et avec lesquelles on souhaite trouver des moyens de se réunir et de travailler. On échange des informations et on a envie de structurer une sorte de réseau d’accointances. Vous vous êtes associée au metteur en scène auvergnat Johanny Bert, dont le spectacle HEN sera présenté aux Célestins en décembre. Quels contours va prendre cette collaboration ? Avec Johanny Bert, on se connaît depuis un certain nombre d’années et on a eu l’occasion de travailler ensemble quand j’étais à New York. Ça a été une expérience formidable et du coup, c’est vraiment quelqu’un avec qui je souhaitais approfondir les choses. Dans le cadre de cette collaboration, de cette complicité, il aura deux spectacles cette saison, dont une création au mois de janvier, Le Processus, qui traite de la question de l’avortement vécu par une adolescente. Et puis Épopée en juin, un spectacle jeune public. Et cette collaboration va s’étendre sur quatre années. On relève beaucoup de spectacles à venir qui font écho à la ligne éditoriale d’Hétéroclite, par exemple Julia, Les femmes de Barbe bleue, Le Processus, La Brèche ou encore Viril pour n’en citer que quelques uns. Pouvez-vous nous les présenter brièvement ? Julia, pour moi, c’est un spectacle vraiment marquant qui a presque 15 ans de Christiane Jatahy, immense metteuse en scène brésilienne qui vient pour la toute première fois à Lyon. Cette pièce adaptée de Mademoiselle Julie de Strindberg aborde les questions de domination homme-femme dans un rapport inversé, auxquelles vient s’ajouter la question de la domination de classe, et qui est d’une grande acuité dans le contexte brésilien d’aujourd’hui. Les Femmes de Barbe-bleue, c’est un petit bijou d’une jeune metteuse en scène, Lisa Guez, qui parle de féminicides à travers les femmes assassinées de Barbe-bleue et de la force du groupe pour exorciser la violence. Dans Radio Live (France Liban), quatre personnes entre vingt et trente ans interviennent et notamment le créateur d’un personnage de drag-queen qui a grandi dans une famille chiite conservatrice et qui a souffert de devoir cacher son homosexualité durant l’enfance. La Brèche, je ne veux pas dévoiler le noeud du drame mais c’est super parce que Naomi Wallace est une autrice géniale qui cerne les problématiques actuelles des États-Unis, notamment la fin de l’ascenseur social, du rêve américain. Un colloque sur les violences sexuelles sera proposé en marge des représentations. Féminines de Pauline Bureau relate l’évolution de la place des femmes, notamment dans le sport. Ça parle d’émancipation, en partant d’archétypes, c’est passionnant. Toute la programmation du Théâtre de la Croix-Rousse est à retrouver ici. Bons plans Le Théâtre de la Croix-Rousse propose une offre tarifaire réservée aux lecteur·rices d’Hétéroclite : 14€ la place en tarif plein et 8€ en tarif réduit (pour les étudiants, -30 ans, demandeur·euses d’emploi) sous réserve de choisir 2 spectacles parmi la liste suivante : Julia de Christiane Jatahy (Brésil) du 9 au 13 novembre 2021. Les Femmes de Barbe-Bleue de Lisa Guez du 30 novembre au 4 décembre 2021. Le Processus de Johanny Bert du 13 au 15 janvier 2022. Radio Live (France Liban) du 8 au 10 février 2022. La Brèche de Naomi Wallace du 1er au 3 mars Féminines de Pauline Bureau du 6 au 10 avril 2022. Avec le code promo « théâtroclite » au guichet du théâtre, place Joannès Ambre-Lyon 4 ou au 04.72.07.49.49. (Pour rappel, le tarif pour les personnes bénéficiant du RSA/AAH est de 5€)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 7:31 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 4 nov. 2021 Présentée à La Criée de Marseille, avant une tournée nationale, la formidable pièce de Molière, transposée dans les années 1960, a du mal à accrocher le spectateur. Les Tartuffe sont partout, depuis quelques années. La pièce de Molière, formidable machine de guerre contre les faux dévots et l’hypocrisie, n’en finit plus de séduire les metteurs en scène. Il est vrai que les chefs-d’œuvre de ce calibre ne sont pas si nombreux dans notre patrimoine national, et que la pièce peut renvoyer à bien des préoccupations contemporaines. Aujourd’hui, c’est Macha Makeïeff qui, en son Théâtre de la Criée, à Marseille, livre sa vision de Tartuffe, laquelle arrivera, en décembre, au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, avant de tourner tout au long de la saison. Et, dès le lever de rideau, on reconnaît la patte de la metteuse en scène et plasticienne dans le superbe décor années 1960, aux couleurs acidulées, qu’elle a imaginé pour la pièce. Et dès le lever de rideau, ou presque, on voit aussi que quelque chose ne fonctionne pas, derrière la jolie façade du salon design d’Orgon, ce bourgeois bien tranquille tombé sous l’emprise de Tartuffe, au point de tout lui abandonner : sa femme, sa fille, ses biens et sa maison. C’est comme si Macha Makeïeff n’arrivait pas à attraper la pièce, et à guider ses comédiens dans un sens précis. Des comédiens qui jouent de manière inégale, et dont certains, notamment Jin Xuan Mao dans le rôle-clé de Cléante, ont du mal à se mettre en bouche la langue de Molière, rendant certains passages incompréhensibles. Sens du burlesque Le spectacle n’est pas désagréable, il est, par moments, porté par le sens du burlesque de Macha Makeïeff, mais il n’accroche pas, restant, dans le fond, assez terne, sans pousser les curseurs ni de la noirceur ni du comique de la pièce. On peine à déceler la raison qui a poussé la directrice de La Criée à monter Tartuffe. Si l’on en croit les documents qui accompagnent la représentation, c’est notamment la question de l’emprise, de la prédation, du consentement, qui l’a intéressée, mais sans que ces enjeux s’incarnent réellement. Qui est Tartuffe ? Difficile à dire, au vu du personnage assez lunaire que compose Xavier Gallais. Une sorte de gourou, organisant des messes noires sous l’œil de corbeaux empaillés ? Certes, et cela a été maintes fois souligné, le faux dévot est avant tout une surface de projection, un révélateur des névroses de la famille d’Orgon, son protecteur. Mais encore faut-il que le personnage existe, théâtralement parlant. C’est d’autant plus dommage que Macha Makeïeff avait signé, en 2015, un réjouissant Trissotin ou Les Femmes savantes, où se réunissaient ses talents pour la composition visuelle et le burlesque à la Tati, et une lecture finement féministe de la pièce. Ce regard, on le retrouve dans le traitement du personnage d’Elmire, que joue avec une forme de liberté désespérée, et beaucoup de piquant, Hélène Bressiant. De même que l’on retrouve l’amour de Makeïeff pour les personnages secondaires et muets, comme la bonne Flipote, interprétée par Pascal Ternisien en un joli clin d’œil aux Deschiens. Mais ces petites touches ne suffisent pas, et Molière part dans le décor. Tartuffe, de Molière. Mise en scène : Macha Makeïeff. Théâtre de la Criée, à Marseille. Jusqu’au 26 novembre. Mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20 heures, mercredi à 19 heures, dimanche à 16 heures,. De 10 € à 25 €. Puis à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, du 1er au 19 décembre, et en tournée de janvier à mai 2022, à Nice, Angers, au TNP de Villeurbanne, à Toulon, Rennes, Bayonne, Créteil, Amiens et Caen. Fabienne Darge (Marseille, envoyée spéciale) Légende photo : Elmire (Hélène Bressiant) et Tartuffe (Xavier Gallais), lors d’une répétition de « Tartuffe », de Molière, mis en scène par Macha Makeïeff, au Théâtre national de La Criée, à Marseille, le 30 octobre 2021. PASCAL GELY/HANS LUCAS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 7, 2021 5:55 AM
|
Publié par Morgane Macé dans Profession-Spectacle | 7 Oct, 2021 Pluridisciplinarité, transmission, ouverture des frontières du théâtre, accueil d’auteurs associés et de projets internationaux… Maëlle Poésy, nouvelle directrice du théâtre Dijon-Bourgogne, dévoile sa vision et ses ambitions pour le centre dramatique national de Bourgogne. Après neuf ans sans changement de direction au Centre dramatique national – théâtre Dijon-Bourgogne (TDB), vient le temps du passage à témoin. Benoît Lambert est nommé directeur de la Comédie de Saint-Étienne, quand la metteuse en scène Maëlle Poésy, qui connaît bien le TDB pour y avoir été artiste associée depuis 2016, en devient la première femme directrice, à trente-sept ans. Les remaniements du festival Théâtre en Mai et des différents dispositifs d’accompagnement à la création sont prévus, avec notamment l’accueil inédit de trois auteurs et autrices associés à la direction. Focus sur le parcours et les ambitions de Maëlle Poésy pour cette maison au budget total de 3,6 millions d’euros, engagée pour favoriser l’émergence et l’éducation artistique. Un temps fort de passation Le lancement de saison s’est déroulé début septembre, un moment symbolique à plus d’un titre, en cette période de retour aux spectacles. L’occasion pour Benoît Lambert de présenter son ultime programmation de saison au sein de cette structure et pour Maëlle Poésy d’annoncer les grandes lignes de son projet artistique, en présence du public et des tutelles, dont la ville de Dijon, la région et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. La pièce 7 minutes de Stefano Massini, que Maëlle Poésy a mise en scène, est jouée à Paris depuis le 15 septembre à la Comédie-Française. « C’est un peu particulier en ce moment car ma présence est partagée entre Dijon et Paris, reconnaît-elle. Mais après je pourrai me plonger à 200 % dans le théâtre. » Une plongée qui ne sera pas difficile, puisque la metteuse en scène a déjà l’expérience d’une collaboration avec Benoît Lambert. « Je connais bien le TDB, confirme-t-elle. Toutes ces années m’ont permis de travailler sur des formes très différentes puisque j’ai fait par exemple une création pour des lycées qui a tourné pendant deux ans, j’ai monté Inoxydables, dans le cadre d’I-Nov-Art, qui n’a hélas pas été joué comme on l’aurait souhaité durant le confinement, et j’ai mené un travail de long terme, avec l’implantation de ma compagnie Crossroad en 2011. » Porter un langage invisible au théâtre Son père Étienne Guichard, directeur du Théâtre du Sable, et sa mère enseignante de lettres ont transmis aux filles Poésy – car sa sœur n’est autre que l’actrice Clémence Poésy –, ce même amour pour la comédie. Avant d’intégrer l’École supérieure d’arts dramatiques du Théâtre national de Strasbourg, Maëlle Poésy a suivi les formations des chorégraphes Damien Jalet et Hofesh Shechter. Une pratique de la danse contemporaine qui l’inspire encore aujourd’hui… « Le travail sur la tenue des corps et les énergies sur un plateau permet de prendre en charge tout un langage invisible et inconscient, explique-t-elle. C’est quelque chose que j’aime beaucoup intégrer au cœur des mises en scène. » Également enseignante à l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, elle promeut un théâtre pluridisciplinaire : « Je souhaite défendre l’hybridité des formes qui peuvent être parfois proches de la danse et du cinéma, poursuit Maëlle Poésy. Utiliser en tout cas des écritures de plateau faisant appel à différents médiums. » Ces projets hybrides seront confiés aux artistes associés tels que Tamara Al Saadi, Julie Berès, Yngvild Aspeli et David Geselson. « Il y aura des temps de résidence sur le territoire, avec la participation des habitants, et pour fil rouge : “histoire des lieux et histoire des gens”, détaille la nouvelle directrice du TDB. Ces créations pourront prendre la forme d’un spectacle écrit, d’une performance ou encore d’une session radiophonique. » Programmation internationale, “Passes murailles” et auteurs associés Pluridisciplinarité et transmission demeurent ses priorités, dans le prolongement du travail mené par Benoît Lambert sur le soutien à l’émergence, en ouvrant cette fois le festival Théâtre en Mai aux compagnies internationales. Dans une volonté d’une plus large diffusion, le dispositif “Passes murailles” fera intervenir six acteurs issus d’écoles nationales supérieures d’arts dramatiques, engagés en contrats de professionnalisation, pour travailler pendant un an en création dans les lycées : « On souhaite faire tourner les spectacles dans les lycées, mais aussi dans des lieux non théâtraux, et les ouvrir à une diffusion nationale, précise Maëlle Poésy. C’est moi qui prend en charge la première mise en scène et ce sera Gloire sur la Terre, de Linda McLean, une autrice écossaise. » Si la metteuse en scène privilégie le mélange des formes, elle n’en délaisse pas pour autant le matériau littéraire. Le TDB accueillera en effet trois auteurs et autrices associés à la direction. Il s’agit de Gustave Akakpo, Julie Ménard et Kevin Keiss : « J’aime beaucoup leurs écritures, s’enthousiasme-t-elle. C’est important de pouvoir leur proposer cet ancrage au sein d’une maison et de mettre leur art au service du territoire. Nous les soutiendrons pendant quatre ans, ce qui va leur permettre d’avoir un cadre et aussi une inscription dans l’économie de la société du spectacle. » La direction au fabricant Maëlle Poésy, qui ne néglige pas d’autres enjeux tout aussi centraux comme la volonté d’inscrire le TDB dans un développement autour de l’écologie, en faveur d’une transition forte, se considère à sa juste place en tant qu’artiste. « Il se trouve que les scènes nationales, historiquement parlant, ne sont pas des lieux qui sont dirigés par des artistes. Pourtant, en dirigeant un CDN, je suis tout à fait à ma place d’artiste et de directrice !, confie-t-elle amusée. Je dirais qu’en tant qu’artiste, ce serait même ma seule place de direction possible. Je trouve assez passionnant, de toute façon, de développer un projet artistique au sein d’une structure. Mais je pense que c’est véritablement l’histoire que nous avons entre la compagnie et ce lieu, ainsi que cet ancrage qu’on a sur ce territoire, qui ont vraiment fondé ma décision. » Pluridisciplinarité, transmission et ouverture des frontières du théâtre par une diffusion hors-les-murs et nationale des créations, ainsi que l’ouverture du festival Théâtre en Mai aux compagnies internationales, tels sont les axes de la nouvelle directrice du Théâtre Dijon-Bourgogne, avec pour valeur ajoutée, l’accueil d’auteur et d’autrice associés. Morgane MACÉ Correspondante Bourgogne-Franche-Comté

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 4, 2021 5:21 AM
|
Par Gérald Rossi dans L'Humanité - Mardi 4 Mai 2021
Légende photo : Les artistes compagnons et compagnonnes du TnBA. © Pierre Planchenault
Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA.
Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA. Le TnBA n’ouvrira pas ses portes au public avant plusieurs semaines, mais l’activité des apprentis comédiens ne s’est pas interrompue dans les salles de ce théâtre national à Bordeaux. De nombreux professionnels s’y sont aussi retrouvés afin de lancer des créations, de poursuivre des répétitions. Sa directrice, Catherine Marnas, s’explique sur cette activité foisonnante comme sur l’urgence d’une réouverture, pour les acteurs, auteurs, techniciens, comme pour le public. Rencontre. Le TnBA, comme tous les théâtres, n’accueille pas encore à nouveau le public, mais que se passe-t-il derrière les portes closes de cette belle bâtisse de la place Pierre-Renaudel ? CATHERINE MARNAS Le lieu est forcément fermé au public, mais nous n’avons cessé d’accueillir des équipes pour des répétitions, et surtout notre école de théâtre, avec ses 14 élèves, n’a pas cessé ses activités. C’est un jeune cœur de troupe que l’on entend battre au quotidien et c’est réconfortant. Entre des demandes de remboursement de spectacles annulés et la tentative d’élaboration d’une programmation sans cesse remise sur le chantier, quelle chance, pour nous, que de pouvoir entendre des bribes de Shakespeare, de Claudel… Une partie des cours est dispensée à distance, mais les autres se font sur place, dans le respect des règles sanitaires, avec des tests réguliers, etc. Vous parlez d’accueil d’équipes… CATHERINE MARNAS Je pense par exemple à la compagnie de Raphaëlle Boitel, qui s’est retrouvée dans l’impossibilité de continuer à travailler à l’Opéra de Bordeaux, et qui risquait de perdre les sommes engagées pour le filmage de son spectacle, qui s’est finalement déroulé au TnBA. Le TnBA est-il solidaire des actions revendicatives ? CATHERINE MARNAS La banderole accrochée sur la façade en témoigne. Le soutien à la lutte est clair. Tout comme l’engagement des jeunes de notre école, très motivés pour dénoncer le projet gouvernemental de réforme de l’assurance-chômage. Ils ont passé des heures et des jours à convaincre d’autres jeunes, des danseurs, à la fac, au conservatoire, à l’école de cirque, etc. À l’approche de l’été, de la période des festivals, comment vivez-vous cette situation inédite ? CATHERINE MARNAS Je suis très vigilante pour le respect des consignes sanitaires, des gestes barrières, du télétravail pour le maximum de personnes, mais vraiment il est temps que l’on en sorte. Les équipes veulent revenir au travail, se rencontrer réellement. C’est bien la preuve que les technologies, aussi performantes soient-elles, ne remplacent pas les échanges humains, la proximité, le contact d’une main… Nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet. Comment imaginez-vous la reprise ? CATHERINE MARNAS C’est en vérité encore difficile à imaginer concrètement. Certains spectacles en sont à leur quatrième report. D’ailleurs, nous n’avons pas encore édité une nouvelle plaquette de programmation. On ne veut pas gâcher du papier comme du travail. Une certitude : nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant exceptionnellement ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet, comme en tentant de transformer des pièces initialement pensées pour être jouées dans des salles en spectacles de rue. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Mais vous n’envisagez pas de raccourcir la durée d’exploitation des spectacles pour en accueillir davantage ? CATHERINE MARNAS Non. On essaie seulement de pousser un peu les murs. D’autant que nous serons sans doute contraints à une limitation du nombre de spectateurs par représentation, distanciation oblige. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Nous n’avons pas le droit moral de nous couper d’une partie de nos spectateurs. Et pour cela il faut du temps et de l’espace d’accueil. Il y a une autre inconnue : est-ce que tous ces gens vont revenir immédiatement ? Est-ce que cette vie de repli sur soi qui nous est imposée depuis des mois ne va pas trop laisser de traces ? En attendant, pourquoi avez-vous décidé de lancer Focus, festival de la ruche, qui se déroulera les 6 et 7 mai, un festival sans public ? CATHERINE MARNAS C’est un projet relativement ancien, et nous avons décidé de le maintenir en dépit du contexte. Parce qu’il est conforme au désir de transmission, au mien comme à celui de beaucoup de « compagnons et compagnonnes » qui travaillent ici. Je parle des artistes associés au TnBA, qui sont comédiens, metteurs en scène, auteurs, techniciens, musiciens… L’idée de départ était de montrer au public tout un pan du travail habituellement invisible. Lorsque l’on organise des répétitions publiques, on sait le plaisir de ceux qui découvrent la face cachée de la création théâtrale. Alors nous nous sommes dit : arrêtons le travail à un moment « T » pour le montrer en construction. Sauf que seuls quelques professionnels pourront y assister. Mais poursuivre le projet nous est vite apparu indispensable pour nous-mêmes. Et pourquoi « la ruche » ? CATHERINE MARNAS Nous avons gardé le mot « festival », parce que ces deux journées seront à l’opposé des spectacles congelés que l’on aurait fabriqués chacun dans son coin et, par ailleurs, j’ai souvent parlé du TnBA comme d’une ruche vibrante de la rumeur créative des artistes en répétition, en laboratoire, en recherche… C’est toujours vrai. Et ce n’est pas près de finir. Quelle en est l’affiche ? CATHERINE MARNAS Il y aura une dizaine de spectacles, certains très avancés, d’autres à peine ébauchés. Ce sera l’occasion de découvrir les aventures proposées par Baptiste Amann, Jerémy Barbier d’Hiver, Julien Duval, Monique Garcia, Aurélie Van Den Daele, qui travaille sur son prochain spectacle, Soldat inconnu, et qui propose là une première forme, Spectacle inconnu, Yacine Sif El Islam, les Rejetons de la reine, le collectif OS’O et sa petite forme pour le jeune public, pour ne citer qu’eux, sans oublier une table ronde sur le thème : « Pour une éthique de la relation entre artistes et lieux culturels ». Ce sera l’occasion de retrouver quelques anciens élèves de notre école, et d’autres partenaires, qui ont trouvé là un abri, un lieu de partage, de croisements de leurs expériences et cela me semble particulièrement sensible de le dire dans la période trouble que nous traversons tous. Vous présenterez aussi l’ébauche de votre prochaine création… CATHERINE MARNAS Ce sera une première approche, une lecture avec Yuming Hey d’un texte écrit par Herculine Barbin, née en 1838 dans un corps de garçon mais déclarée comme fille. Herculine s’est suicidée à 28 ans. Et ce texte est comme une bouteille à la mer pour parler du genre aujourd’hui. C’est le témoignage d’une personne que l’on disait à l’époque hermaphrodite et dont le témoignage douloureux avait été sauvegardé par le médecin qui a procédé à son autopsie ; texte retrouvé des années plus tard par Michel Foucault lors de ses recherches pour écrire son Histoire de la sexualité. Je devais d’abord m’attaquer au Rouge et le Noir de Stendhal, cet hiver, mais l’ambiance Covid ne m’a pas donné l’énergie nécessaire pour gravir cette montagne… Ce sera une future création. Entretien réalisé par Gérald Rossi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 19, 2021 5:20 PM
|
PAR ALICE PATALACCI dans Nice Matin Mis à jour le 15/04/2021 à 23:26 Publié le 15/04/2021 à 22:38 Muriel Mayette-Holtz est prête à ouvrir le Théâtre national de Nice pour le 15 mai. Eric Ottino Arrivée en novembre 2019 à la direction du TNN, Muriel Mayette-Holtz doit faire face aux aléas de la crise sanitaire et, depuis mi-mars, à l’occupation du théâtre. Interview. Çela fait un mois que le théâtre national de Nice (TNN) est occupé, comme plus de 90 autres en France. Une mobilisation que la directrice du théâtre, Muriel Mayette-Holtz, soutient, tout en préparant la saison estivale. Pourquoi vous êtes-vous opposée à la première tentative d’occupation, le 12 mars ? Une occupation, ça s’organise. Nous avons donc pris le temps de l’organiser avec eux, sereinement, dès le lundi [le 15 mars, ndlr]. On essaie d’accompagner leurs besoins, tout en continuant à travailler. Il est important que cette occupation ne vienne pas perturber l’engagement des intermittents, de l’autre côté. Ce n’est pas ce qu’ils souhaitent, donc tout se passe bien. Il y a donc toujours une activité au sein du théâtre ? Le théâtre ne s’est jamais arrêté, et les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Un spectacle, ça prend des mois, avant d’arriver à maturité. Il y a une étude dramaturgique, une distribution, une construction, des répétitions… Tout ce travail, on ne l’a pas interrompu. Nous avons emmagasiné des spectacles qui n’attendent qu’une chose : le rendez-vous avec le public. On continue aussi à intervenir dans 26 lycées et collèges. En ce moment, les acteurs de la troupe du TNN portent le projet Lettres à mon père, pour lequel les jeunes écrivent une lettre imaginaire à un père. On devait organiser un marathon des lettres, sous le kiosque de la Coulée verte, ce lundi, qui va être reporté. On a aussi accueilli beaucoup de compagnies régionales, pour leur faire profiter des locaux. Il a aussi fallu reprendre la programmation... On a reprogrammé, décalé des spectacles, on en a annulé d’autres, procédé à des remboursements… Pour refaire un programme la saison prochaine. Ce travail de l’ombre n’a jamais cessé. Les administratifs et les artistes sont donc mobilisés ? Dans tous les centres dramatiques nationaux, il y a une partie administrative et une partie technique. C’est rare qu’il y ait des troupes, mais je l’ai imposé, et ça nous a notamment permis d’être plus mobiles. En période Covid, on a pu faire de vraies propositions vidéos, que l’on peut voir sur notre site et notre page Youtube. On a, à l’année, six comédiens, un pianiste-musicien, un metteur en scène-écrivain et moi. Sur certains projets, des artistes et techniciens peuvent se greffer. Entre mars et juin, j’avais envisagé 10 000 heures d’intermittents, pour compléter les acteurs qui sont ici. Ça permet aussi de donner des heures aux intermittents. C’est un des grands sujets de cette crise : que font les artistes et comment peuvent-ils vivre sans travailler ? Des rendez-vous, cet été ? L’an dernier, on a inventé les Contes d’apéro, un peu en urgence. Du fait de leur succès, on les reprendra cette année, du 1er juillet au 15 août. Tous les soirs, à 19 heures, il y aura un spectacle gratuit au kiosque. Je vais aussi monter L’école des mères, de Marivaux. On donnera quatre représentations au château, à partir du 19 août. Le maire a offert ces représentations aux vallées sinistrées. On partira donc en tournée fin août. On finira à Aspremont, Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer. Vous seriez prête à rouvrir le théâtre, si c’était possible ? Quand on démarre dans une ville où on ne vous connaît pas, une première saison compte. Moi, je n’ai pas pu la dérouler. Si on peut rouvrir à partir du 15 mai, on est prêts. En plus des Contes d’apéro, on a rebasculé une programmation ambitieuse des spectacles qu’on n’a pas pu donner pendant cette saison, en juin-juillet. Et le maire nous a dit que, quoi qu’il arrive, on ouvrira le 15 septembre. Fermer les théâtres n’était pas forcément une bonne idée ? C’est normal d’être vigilant sur la sécurité sanitaire. Mais je trouve absolument incompréhensible que nos théâtres restent fermés, alors que nous sommes à même d’accueillir du public, et de le gérer. Mon métier, avant de faire de la programmation, c’est de recevoir. C’est ce qu’on a fait dans les rares périodes où on a été ouverts, sans déplorer le moindre cluster. Pourtant, nous allons dans les écoles, faire des spectacles sous des préaux ou dans des gymnases, avec une sécurité plus difficile à faire respecter que dans nos salles. Il me semble qu’il aurait été bon de proposer une date où nous rouvrions tous les théâtres de France, dans les respects des règles. Rester fermés n’est, à mon avis, pas une bonne solution. La culture semble peu abordée, dans les allocutions gouvernementales... Je suis inquiète de ne pas assez entendre l’importance de la culture. On a l’impression que ce serait un plus. Or, c’est l’école de la vie. Il n’y a pas plus ancestral que ce rendez-vous d’êtres humains devant d’autres, pour raconter le monde. Sur un plateau, on peut tout dire, aborder tous les sujets, avec cette distance du faux, qui nous permet de magnifier les sujets et d’oser les regarder. Rien ne peut remplacer ça. C’est le début de la liberté. Surtout en période de crise ? C’est fondamental, car on est menacé par le repli sur soi-même. Il faut que l’on soit pédagogique, pour expliquer l’importance de la culture. Surtout quand on voit à quel point nos vies peuvent se renfermer. On se lève, on mange, on travaille, on mange, on dort… Et ça recommence. L’émotion, la beauté, l’ouverture, le partage manquent. Le théâtre, c’est tout ça. C’est un rendez-vous quotidien nécessaire, et pas seulement une distraction. Soutien "modéré" pour les occupants Si Muriel Mayette Holtz dit soutenir les occupants du TNN, eux, sourient à l’évocation de cette idée. "Il y a des théâtres où le directeur a dormi avec les occupants, dans un sac de couchage. Ça, c’est du soutien !", pose Jean-Louis Ruf, membre du bureau régional du Syndicat français des artistes-interprètes (SFA-CGT). Les occupants évoquent aussi des problèmes pour franchir les grilles et sortir du parvis du TNN, le week-end. "Pour se doucher, on doit prévenir le vigile, sortir, aller à l’entrée des artistes et monter à l’étage. Sans parler du robinet mis à disposition pour faire la vaisselle, d’où coule un faible jet ", ajoutent-ils. Muriel Mayette-Holtz est prête à ouvrir le Théâtre national de Nice pour le 15 mai. Eric Ottino
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 19, 2024 6:28 AM
|
Publié sur le site d'Artcena - 19 avril 2024 De ses années d’études en géo-architecture vécues à Brest, Anne Tanguy conserve un souvenir marquant, auquel Le Quartz est nullement étranger. « Découvrir cette salle à l’histoire exceptionnelle a complètement bouleversé mon parcours », confie-t-elle. Fédérateur, son projet se construira autour de trois valeurs cardinales : la coopération, l’altérité et la solidarité envers les artistes. De ses années d’études en géo-architecture vécues à Brest, Anne Tanguy conserve un souvenir marquant, auquel Le Quartz est nullement étranger. « Découvrir cette salle à l’histoire exceptionnelle a complètement bouleversé mon parcours », confie-t-elle. C’est pourquoi la nouvelle directrice de la scène nationale se réjouit aujourd’hui de renouer avec un territoire artistiquement et culturellement très riche, mais aussi de disposer d’un magnifique outil rénové après trois ans de travaux impulsés par des partenaires (Ville, Métropole, Région et Département) qui ont fortement contribué, et contribuent encore, à son rayonnement sur les plans régional, national et international. Dans la lignée de ses prédécesseurs, proche (Matthieu Banvillet) ou plus lointain (le tout premier directeur, Jacques Blanc), Anne Tanguy poursuivra le « travail exemplaire » accompli sur les champs de la danse et des musiques populaires en maintenant – tout en les réinterrogeant – ces deux festivals emblématiques que sont No Border et Dañsfabrik. Durant la saison, son goût de l’éclectisme la portera vers des propositions pluridisciplinaires (le théâtre et la marionnette, entre autres) comme transdisciplinaires (un axe qu’elle a beaucoup creusé à la scène nationale de Besançon), aptes aussi à rassembler un large public. Une nécessité, compte tenu de la jauge conséquente – 1 500 places, l’une des plus grandes de l’Hexagone – du Quartz. « Je ferai en sorte d’allier spectacles fédérateurs et productions audacieuses, afin de former non pas le public de demain, mais celui d’aujourd’hui », ajoute la directrice, qui introduira également une programmation jeune public et familiale, jusqu’ici peu présente. Cette inflexion satisfera un double objectif : favoriser, dès l’enfance, la rencontre avec l’art, et attirer de nouveaux spectateurs qui fréquentent rarement la scène nationale en famille. Enfin, l’accueil de productions internationales reposera sur la coopération avec d’autres scènes et festivals, notamment européens, Anne Tanguy initiant, par exemple, un jumelage avec Charleroi Danse à Bruxelles. Plus globalement, sa démarche s’articulera autour de trois fondamentaux appliqués à l’ensemble des activités du Quartz. « L’Alliance » tout d’abord, illustre une volonté de consolider les partenariats avec des lieux de dimensions diverses, des associations, des compagnies et des structures sociales afin de mener des actions culturelles mais aussi optimiser la production et la diffusion. « L’Altérité » ensuite s’incarnera dans l’ouverture du lieu à de multiples usages, d’ores et déjà induite par l’organisation régulière de congrès dans l’établissement. « Partager l’équipement avec d’autres professionnels issus de secteurs différents est très enrichissant et permet d’éviter l’écueil de l’entre soi », fait valoir Anne Tanguy ; laquelle mettra aussi à profit les nouveaux espaces de convivialité aménagés lors de la rénovation du Quartz. « La Solidarité » enfin s’exercera en priorité à l’adresse des artistes, la scène nationale prévoyant une augmentation du budget de production. En matière de diffusion, la directrice s’attachera à développer une permanence artistique (gage de diversification des publics), grâce à la présence d’artistes associés (dont Nina Laisné et Renaud Herbin), la mise en œuvre de résidences d’infusion in situ et de projets culturels de territoire. Ces derniers seront facilités par la dynamique partenariale qui s’est amplifiée à la faveur de plusieurs saisons passées par Le Quartz hors les murs. Désireuse de promouvoir d’autres modes d’action culturelle, Anne Tanguy accordera une attention particulière aux quartiers populaires brestois, imaginant avec eux des jumelages sur plusieurs années. Dans le déploiement de cet ambitieux et foisonnant projet, qui suscite de nombreuses attentes, la nouvelle directrice entend « avancer tranquillement », au regard des turbulences provoquées au sein de l’équipe par le départ prématuré de Maïté Rivière en mars 2023. Grâce à « l’intérim remarquable » réalisé par Paul-Jacques Hulot, elle se dit néanmoins confiante en l’avenir, assurée de pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs et des partenaires partageant son enthousiasme et sur la fidélité non démentie du public depuis la réouverture du Quartz voici quelques mois.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2023 11:09 AM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama 23/03/2023 Pour la future directrice du Théâtre national de Strasbourg, il est vital que l’humanité dans sa diversité soit incarnée sur scène. Un leitmotiv qui la guide et qu’elle compte porter au cœur de l’école qui l’a formée. Entretien et retour sur son parcours. C‘était en juillet 2017. Le public du Festival d’Avignon découvrait, bouleversé, Saïgon, un spectacle d’une originalité décapante, mêlant l’intimité d’exilés vietnamiens au désastre de l’histoire coloniale française en Indochine. L’autrice et metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, adoubée pour l’occasion, n’en était pas à son premier coup d’éclat avec sa compagnie Les Hommes approximatifs, fondée en 2009, un an après sa sortie de l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS). Elle y avait rencontré tous ses alliés artistiques et créé avec eux une dizaine de spectacles, sensibles, tissés au cœur des questions sociales – de l’endettement à l’adoption internationale –, souvent inscrits dans des lieux réalistes. Tel ce centre social où elle a campé Fraternité, un « conte fantastique » évoquant la disparition de l’humanité, créé en 2021, cette fois encore à Avignon. À 41 ans, cette grande jeune femme brune à la parole réfléchie, également réalisatrice et épisodiquement actrice (vue récemment dans l’attachant Youssef Salem a du succès, de Baya Kasmi), est l’une des rares dramaturges françaises à tourner dans le monde entier, de l’Europe à la Chine en passant par l’Australie. En septembre prochain, elle posera ses valises au TNS qui l’a formée pour en prendre la direction, remplaçant ainsi le metteur en scène Stanislas Nordey, après neuf ans d’un dynamique mandat. D’où lui vient cette passion du théâtre ? Caroline Guiela Nguyen se raconte. Quelle impression vous fait ce retour au Théâtre national de Strasbourg ?
J’y reconnais tout ! Les murs, les studios, les ateliers de couture ou de construction. Au début des années 2000, ce fut le lieu de mes plus grandes joies et de rencontres extraordinaires, avec le metteur en scène polonais Krystian Lupa ou Joël Pommerat, par exemple. J’y ai aussi été saisie par le doute. Car une question restait sans réponse : pourquoi le théâtre restait-il si vide des visages métissés qui ont peuplé mon enfance ? Celle-ci n’était débattue ni sur nos scènes, ni au sein de l’école où nous n’étions que deux étudiantes non blanches. À lire aussi : Caroline Guiela Nguyen officiellement nommée au Théâtre national de Strasbourg Pour autant, je n’incrimine pas le TNS, car Stéphane Braunschweig, qui le dirigeait, comme Dominique Lecoyer, la directrice des études, m’ont toujours poussée à aller loin : ils croyaient en moi. L’époque le voulait ainsi, le sujet n’avait pas encore « troué » le paysage théâtral. Aujourd’hui, le changement est flagrant. Dans les classes de jeu des écoles supérieures de théâtre, se croisent des jeunes issus de l’immigration et de tous les milieux sociaux. Et plus seulement ceux de la classe moyenne ou de la bourgeoisie éduquées. Il reste du travail à faire dans les filières mise en scène, régie ou scénographie. Il me fallait être nourrie d’expériences pour apporter quelque chose à cette grande maison. Vous avez longtemps refusé de postuler à la direction du TNS, pourquoi ?
Il me fallait être nourrie d’expériences pour apporter quelque chose à cette grande maison. Les quinze dernières années m’ont permis de définir mon geste théâtral. Certains artistes s’affirment vite – il faut leur confier des théâtres. Mon chemin fut plus lent. Être la seule femme depuis dix ans à diriger un théâtre national, est-ce un symbole lourd à porter ?
Je ne serai pas une « femme-étendard » car il y en a plein d’autres capables de diriger le TNS. La preuve : à la tête des centres dramatiques nationaux, la parité est désormais presque acquise. Je suis avant tout une autrice-metteuse en scène qui veut défendre un projet de direction. Lequel ?
Faire du TNS le lieu où théâtre et audiovisuel puissent s’accorder dans un même mouvement. Grâce à un partenariat avec la chaîne européenne Arte dont le siège est à Strasbourg, notamment. Parce qu’aujourd’hui les arts ne sont plus cloisonnés. Beaucoup de mises en scène – comme celles du Français Julien Gosselin, du Suisse Milo Rau ou de la Belge Anne-Cécile Vandalem par exemple – empruntent à l’écriture de scénarios, de séries ou au documentaire audiovisuel. Cette porosité ne se réduit plus du tout au seul usage de la vidéo sur scène. Des chefs opérateurs peuvent apporter de nouveaux cadrages aux éclairagistes de théâtre. Moi-même et Antoine Richard, mon collaborateur artistique, on discute « bande-son » comme au cinéma.
Dans le cadre de l’école, il y aura également un partenariat avec la CinéFabrique de Lyon, qui forme aux métiers de l’audiovisuel. Un pôle « récit », pensé comme un espace commun de réflexion, sera ouvert à tous ceux qui travaillent au TNS, étudiants ou professionnels. Il sera développé sous le regard complice de Raphaël Chevènement, le coscénariste de la série Baron noir, des documentaristes Mai Hua, à qui l’on doit Les Rivières, et Hassen Ferhani, qui a réalisé Dans ma tête un rond-point. Ou encore d’auteurs-metteurs en scène comme Gurshad Shaheman ou Tiphaine Raffier, eux aussi inspirés par l’écriture cinématographique. Comme d’habitude, les étudiants du TNS vont se nourrir du théâtre qui s’y crée. À lire aussi : Ecoles de théâtre : des ascenseurs pour les tréteaux Mais certains jeunes interprètes sortant d’écoles supérieures n’ont jamais travaillé l’alexandrin. N’est-ce pas un problème ?
Je vais le découvrir chemin faisant. Si des étudiants en éprouvent la nécessité ou si un metteur en scène invité souhaite mener un atelier en vers classiques, on trouvera le moyen de former les élèves en amont. Mais pour moi, l’alexandrin de Racine – auteur que j’adore ! – raconte d’abord une histoire. Et ce n’est pas l’étude de la technique que je privilégierais en le travaillant. Pourquoi est-ce toujours à moi que l’on pose cette question du répertoire et de l’alexandrin ? Parce que ce registre ne correspond pas à votre propre théâtre. La même question aurait été posée à Joël Pommerat…
Rassurez-vous, les élèves auront plein d’outils différents à leur disposition : ils ne deviendront pas les artistes d’une seule manière de faire. Mais la spécificité du TNS est d’être une école où les élèves de plusieurs sections – interprétariat, dramaturgie, scénographie, régie, mise en scène – se mélangent pour créer des projets. Grâce à cette immersion, certains apprentis metteurs en scène peuvent révéler ce qu’ils ont dans les tripes et impulser une nouvelle façon d’écrire. Voilà le spectacle vivant que je souhaite faire émerger, plus encore que de valoriser le patrimoine.
Sur les violences sexistes et sexuelles, on proposera des formations aux jeunes hommes qui peuvent être parfois des harceleurs qui s’ignorent. La question du genre agite les étudiants des écoles d’art. Comment l’abordez-vous ?
Au taquet sur le thème de la mixité sociale et de la diversité des origines. Sur le terrain du genre, en revanche, j’avance humblement. Je m’informe, j’écoute. Faire attention à ce que l’on dit, quand on est pédagogue, me semble la moindre des choses. Et, lors de mes derniers stages, au Théâtre national de Bretagne, je ne m’en suis pas sentie paralysée. Pour ne pas que cela devienne inflammable, il faut privilégier le dialogue : accompagner les étudiants tout en maintenant nos exigences. Les jeunes sont également soucieux du climat de travail. Si la création est un lieu d’exploration possible de la violence, le chemin pour y parvenir ne doit pas passer par cette extrémité. Les tranquilliser à cet endroit comme sur le thème des violences sexistes et sexuelles est primordial. Une charte à destination des intervenants extérieurs va être rédigée. On proposera des formations aux jeunes hommes qui peuvent être parfois des harceleurs qui s’ignorent. Vous dites que le cinéma vous a sauvée. Avez-vous vraiment voulu arrêter le théâtre ?
À la fin de l’école, j’étais paumée, en pleine dépression… J’avais passé ma dernière année à monter Macbeth, et le résultat était mauvais. Cet échec a été une chance, sinon j’aurais persévéré avec les textes d’auteurs, alors qu’une seule question m’obsédait : comment fabriquer un spectacle sans cette posture de « surplomb » qui souvent empêche le théâtre de s’adresser à tout le monde ? Alors, oui, La Graine et le Mulet, film d’Abdellatif Kechiche, sorti en 2007 pendant mes études au TNS, fut un appel d’air immense. Y entendre tous les accents possibles, voir les paroles fuser lors de grandes tablées, y reconnaître enfin le réel dans lequel j’avais baigné dans un village du Haut-Var a déclenché le désir de réunir des gens avec qui représenter un tel monde sur scène.
D’où la volonté de travailler avec des amateurs ?
C’est arrivé plus tard, en 2012, lors de la première version, participative, de mon spectacle Elle brûle, inspiré de Madame Bovary de Flaubert : Le Bal d’Emma. Le personnage – incarné par l’actrice Boutaïna El Fekkak, ma camarade du TNS – y était devenu une jeune femme venue du Maroc, prise dans l’engrenage des crédits à la consommation. Nous l’avons imaginé dans une salle des fêtes à côté de Valence. J’avais convié des amateurs à y participer : d’un côté, la bourgeoisie terrienne, de l’autre, des agriculteurs. La force de ce mélange, de cette rencontre entre comédiens et amateurs, était incroyable.
Lors de cette première aventure, une autre expérience a été tout aussi révélatrice. Après les représentations, le public me demandait systématiquement pourquoi Emma parlait parfois arabe, mais jamais pour quelle raison la vieille dame interprétant la belle-mère s’exprimait en allemand ! Pourquoi une langue est-elle soudain évidente alors que l’autre réclame une note d’intention ? De là est née l’impérieuse nécessité d’inviter sur scène l’humanité dans sa diversité. Chaque langue contient une histoire en soi – « une patrie », précisait la philosophe allemande Hannah Arendt. Les familles d’exilés, comme la mienne, n’ont d’autre choix que d’inventer des récits. Cette habitude m’a été transmise en intraveineuse. Pourquoi la fiction compte-t-elle tant ?
Elle est liée à ma biographie. Mes deux parents ont vécu l’exil : ma mère, fille d’une Indienne de Pondichéry et d’un Vietnamien de Saïgon, est arrivée en France à l’âge de 13 ans, en 1956, après la défaite de Diên Biên Phu, avec sa mère et ses huit frères et sœurs. Mon père, d’origine italienne par son père et judéo-espagnole par sa mère, est un pied-noir d’Alger. La famille, dans ces cas-là, n’a d’autre choix que d’inventer des récits : la seule solution pour entretenir un lien avec un pays qu’elle ne verra plus. Cette habitude m’a été transmise en intraveineuse… Toute petite, je réinventais les conversations en vietnamien de ma mère avec ses frères et sœurs, moi qui ne parlais pas sa langue. Les histoires furent l’espace commun entre mes parents et moi. Il n’y a rien de mieux pour être dans le partage. Au théâtre, c’est pareil.
Ces écoles de théâtre qui veulent mettre plus de diversité sur scène Quels artistes ont été vos modèles ?
On cite toujours à mon propos des artistes dont j’aime la relation avec la fiction : Joël Pommerat, Wajdi Mouawad ou Ariane Mnouchkine. Je suis bien encadrée ! En 1964, cette dernière, qui a fondé le Théâtre du Soleil, a été une grande pionnière en invitant sur scène d’autres corps et d’autres voix que ceux qu’on y voyait habituellement. Elle les recrute encore dans le monde entier, alors que moi, je les trouve aux quatre coins de la France. Voilà la grande différence. Dans mon théâtre, une grande variété de personnes qui peuple l’Hexagone vient nous raconter, à sa manière, notre histoire française. Fille de Viet kieu, ces Vietnamiens de la diaspora, je n’ai pas prétendu raconter l’histoire du Vietnam dans le spectacle Saïgon, mais plutôt celle des exilés installés en France.
Comment en avez-vous choisi les acteurs ?
Certaines scènes ont lieu avant la défaite des Français, alors trois interprètes ont été recrutés au Vietnam. Je les ai beaucoup écoutés pendant les répétitions. Grâce à des annonces diffusées dans tout Paris, j’ai aussi rencontré Hiep et Anh Tran Nghia, qui jouent respectivement l’homme exilé et Marie-Antoinette, qui tient le restaurant où se joue la pièce. On entend donc sur scène plusieurs langues vietnamiennes : celle de l’exil et celle du pays d’origine. Un tel mélange y charrie le poids de l’Histoire. Lorsque le personnage joué par Hiep revient quarante ans plus tard au pays, il découvre que la femme aimée ne parle plus la même langue que la sienne, restée figée. Si je n’avais pas été si exigeante sur la cohérence linguistique, cette scène d’une profondeur vertigineuse n’aurait pas existé. Or comprendre ce que l’Histoire a fait aux gens était la finalité du spectacle – ce que la colonisation a fait à ma propre mère, en l’occurrence.
À lire aussi : “Saïgon” : Caroline Guiela Nguyen, et le théâtre de l’exil Pourquoi vos spectacles s’inscrivent-ils toujours dans des lieux de vie très précis ?
De tels univers m’ouvrent mille possibilités théâtrales. Ils me donnent parfois l’impulsion de la fiction, bien plus encore que le choix du sujet. Car recruter une équipe en annonçant d’emblée vouloir travailler la question postcoloniale me dérangerait. J’aurais l’impression de « clouer » d’avance les comédiens dans une réalité sociale ou géographique dont ils ne pourraient pas s’échapper. Dans le restaurant vietnamien, carrefour ouvert à toutes les inter-prétations, la question coloniale apparaît naturellement, mais aussi celles du départ, de l’exil, de l’amour perdu. Mon prochain projet, Lacrima, qui sera créé à Strasbourg en mai 2024 et traversé par le destin de plusieurs femmes, se déroulera dans des ateliers de couture et de broderie.
À partir de 2025, on formera dans les collèges et lycées de quartiers très différents des binômes entre professeurs et metteurs en scène reconnus. Quelle a été votre première rencontre avec le théâtre ?
C’était à l’adolescence, pendant le Mai théâtral – un festival de théâtre scolaire entre Villecroze et Draguignan. J’ai joué dans Knock, de Jules Romains, et ça m’a marquée ! Les premiers ambassadeurs du théâtre sont toujours les profs qui en parlent très bien et aiment sortir les enfants du cadre scolaire. Je vais d’ailleurs favoriser de telles pratiques au TNS. La chorégraphe Kaori Ito vient d’être nommée au Théâtre jeune public-Centre dramatique de Strasbourg et je rêve de l’embarquer dans mon projet de grand festival interscolaire. Auquel deux marraines seront associées : la documentariste Lina Soualem et la productrice de radio Aurélie Charon. À partir de 2025, on formera dans les collèges et lycées de quartiers très différents des binômes entre professeurs et metteurs en scène reconnus.
Qu’est-ce qui vous a décidée à faire du théâtre votre métier ?
Le hasard. Je voulais être avocate. La fac de droit fut un échec. En sociologie à Nîmes, j’ai trouvé un cursus « ethno-scénologie », dédié à la science de la mise en scène, qui a fait l’affaire. Un stage de trois mois chez Ariane Mnouchkine, alors qu’elle préparait Le Dernier Caravansérail, m’a fait bouger. Pourtant, l’année que j’ai passée ensuite au conservatoire d’Avignon ne m’a pas convaincue de devenir comédienne. On m’y a alors encouragée à passer le concours de la section mise en scène du TNS. Et j’ai été prise. Je n’avais jamais lu Tchekhov ! J’ai travaillé comme une bête pour combler mes lacunes. Me prenant soudain à rêver d’habiter le Quartier latin à Paris, je me suis détachée de mes propres goûts et de mon accent du Sud. Le plaisir éprouvé à l’occasion des sorties avec ma mère dans les centres commerciaux, le samedi après-midi, n’a jamais été avoué à mes camarades de promo. Pire, je mentais. En disant que je parlais vietnamien, que ma mère avait fait Mai 68 — alors que rien n’est plus faux : elle voulait tellement s’intégrer ! —, qu’elle était bouddhiste, ce qui passait mieux que la catholique qu’elle était. Même mon premier « choc théâtral » — la mise en scène de Phèdre par Patrice Chéreau en 2003 — fut une invention : je l’avais « rattrapée » en VHS ! Quand l’équipe du TNS a compris la gravité de la situation, elle m’a envoyée faire un stage chez le metteur en scène Guy Alloucherie, dans le Nord, à Loos-en-Gohelle. Il m’a fait lire Annie Ernaux… J’ai assumé d’où je venais et c’est devenu le nerf de mon théâtre. Une réconciliation. Pourquoi avez-vous titré votre récent livre d’entretiens Un théâtre cardiaque ?
À la sortie de Fraternité, conte fantastique, un ami metteur en scène m’a envoyé un joli texto : « Ton théâtre cardiaque forever… » En effet, pour moi, il n’y a pas de théâtre sans émotion. Ni sans cœur. Ni sans la pulsation de la vie.
À lire aussi : Avignon : “Fraternité, conte fantastique”, la fable post-catastrophe de Caroline Guiela Nguyen CAROLINE GUIELA NGUYEN EN QUELQUES DATES
1981 Naissance à Poissy. 2005-2008 École du Théâtre national de Strasbourg. 2009 Fondation de la compagnie Les Hommes approximatifs. 2017 Saïgon, au Festival d’Avignon. 2022 Nomination à la direction du TNS. À voir
- Fraternité, conte fantastique, les 27 et 28 avril, Théâtres de la Ville de Luxembourg.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 2:05 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde 1/03/23 La nouvelle directrice de l’établissement public parisien explique son projet pour ce lieu où elle a pris ses quartiers depuis fin février.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/01/claire-dupont-veut-faire-de-la-bastille-un-theatre-traverse-par-les-echos-du-monde_6163798_3246.html
« J’ai toujours rêvé de diriger un théâtre, et d’en faire une maison vivante et habitée », s’amuse Claire Dupont, en ouvrant les portes du Théâtre de la Bastille, de plain-pied sur la rue de la Roquette à Paris, où elle a pris ses quartiers, lundi 20 février. A 42 ans, c’est elle qui a été nommée, à l’issue d’un long processus juridique pour transformer ses statuts, à la tête de ce lieu qui occupe une place à part dans le cœur des spectateurs parisiens. Jean-Marie Hordé, qui l’a dirigé de 1989 à la fin de 2022, a fait de la Bastille un foyer de découvertes, unique dans le rapport privilégié, intime, qu’il permet entre les artistes et les spectateurs. Dans une géographie théâtrale parisienne qui se recompose, sans forcément se renouveler, comme l’atteste le choix d’Olivier Py à la tête du Théâtre du Châtelet, l’Etat, lui, a fait à la Bastille un choix audacieux. Claire Dupont, si elle n’est pas encore connue du grand public, arrive dans le jeu avec un beau parcours et un profil de tête chercheuse à même d’affronter les évolutions qui vont affecter le secteur du spectacle vivant dans les prochaines années. Enseignante-chercheuse à l’université Paris-III et fondatrice de Prémisses Production, une officine dévolue à la jeune création fondée en 2017, elle a, dit-elle, « toujours voulu mêler ses deux amours, le théâtre et l’université ». Et c’est ce qu’elle a fait, ne cessant jamais d’enseigner, tout en travaillant au Théâtre de la Tempête, niché au cœur du bois de Vincennes, et en accompagnant, au tout début de leur parcours, des artistes comme Pauline Bureau ou Julien Gosselin. Avec Prémisses, elle a inventé un nouveau type de structure, faisant le constat qu’« il manquait un maillon pour aider les artistes sortant des écoles à démarrer, à se structurer et à entrer dans la profession ». Directement inspiré par l’économie sociale et solidaire, Prémisses est une sorte d’incubateur, qui a permis à de jeunes créateurs – souvent des créatrices, à l’image des membres du Collectif Marthe ou de Raphaëlle Rousseau – d’émerger. « Rajeunissement et diversification » Après un passage au Théâtre de la Cité internationale, il était temps pour elle d’envisager de prendre la tête d’une maison. La Bastille s’est présentée comme une occasion rêvée. « Une magie particulière habite les lieux, s’enthousiasme-t-elle. Je me reconnais totalement dans l’“expérience Bastille”, qui est celle d’un théâtre à échelle humaine, qui a ouvert nombre d’espaces créatifs. » Comme de nombreux spectateurs, c’est ici que Claire Dupont a découvert les Flamands du tg STAN, l’Iranien Amir Reza Koohestani, Nathalie Béasse ou les premiers spectacles de Tiago Rodrigues, devenu depuis directeur du Festival d’Avignon. Elle souhaite donc s’inscrire dans cette histoire, tout en la faisant évoluer. « Il existe un véritable public Bastille, qui considère ce théâtre comme le sien, ce qui est formidable, mais il a vieilli, constate-t-elle. Il va y avoir une problématique de rajeunissement et de diversification, qui est de notre responsabilité à tous dans la profession, pour la survie même du spectacle vivant. » Claire Dupont se propose donc de « désembastiller Bastille », d’en faire « un théâtre traversé par les échos du monde », ouvert sur d’autres territoires, à la fois proches et lointains, locaux et internationaux, que ceux qui ont été investis jusqu’à présent. La nouvelle patronne souhaite d’abord réancrer le théâtre dans son quartier du 11e arrondissement, par des actions hors les murs et des projets participatifs. Quant à la dimension internationale, qui fait partie intégrante de l’identité du théâtre, Claire Dupont veut « l’ouvrir sur d’autres polarités ». « L’histoire de Bastille a été très liée au formidable essor des arts de la scène en Belgique flamande depuis quarante ans, explique-t-elle. Aujourd’hui, je souhaite déplacer le regard vers les dramaturgies du bassin méditerranéen, qui sont en plein envol : au Liban, en Grèce, en Espagne, notamment, émergent des créateurs passionnants, qui offrent d’autres rapports à l’art. Et cette ouverture permet la rencontre des diversités au niveau des spectateurs : pour modifier un public, il faut modifier ce qu’on pose sur les plateaux, convoquer d’autres patrimoines culturels. » Un « parlement artistique » Pour faire de la Bastille ce « théâtre qui traverse son époque, et est traversé par elle », Claire Dupont va aussi mettre en place ce qu’elle appelle un « parlement artistique », composé de trois créateurs qui vont l’accompagner, chacun pour une saison, dans les choix de programmation : la performeuse catalane Agnès Mateus, l’acteur-auteur-performeur d’origine iranienne Gurshad Shaheman et la chorégraphe franco-camerounaise Betty Tchomanga. « Ensemble, nous allons structurer chaque saison autour d’une question contemporaine : l’identité, la montée des extrêmes en Europe, la migration, le corps colonial… » « Il s’agit donc de renouveler, tout en restant fidèle à l’esprit bien particulier de Bastille et à certaines équipes », résume Claire Dupont. « Nathalie Béasse, Nicolas Bouchaud, Pierre Maillet et sa compagnie Les Lucioles, le collectif L’Avantage du doute, et bien sûr Tiago Rodrigues s’il a envie de revenir avec des petites formes… » Autant d’artistes qui auront toujours leur place dans ce théâtre. Mais plus de la moitié de la programmation sera changée, promet-elle. Claire Dupont sait qu’elle arrive dans un théâtre dont les finances sont saines, fort de ses deux salles qui offrent un excellent rapport scène-public et d’un statut éclairci qui fait de la Bastille un établissement public, financé à 74 % par des subventions (le reste étant assuré par les recettes propres), mais sans les contraintes d’un centre dramatique ou d’une scène nationale. Bref, « le terrain est très favorable à l’invention », se félicite la nouvelle patronne, qui a déjà prouvé qu’elle pouvait joindre l’acte à la parole. Fabienne Darge Légende photo : Claire Dupont, la nouvelle directrice du Théâtre de la Bastille, à Paris, le 1er février 2023. MATTHEW AVIGNONE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 30, 2023 5:11 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 30 janvier 2023 Un théâtre cardiaque de Caroline Guiela Nguyen, en complicité avec Aurélie Charon, éditions Actes Sud, 2023. Un théâtre intense et acharné en quête de voix et de récits manquants, un théâtre d’émotion qui s’affirme comme tel, un théâtre populaire qui se doit de représenter des pans entiers du monde absents des plateaux, ainsi le théâtre cardiaque de Caroline Guiela Nguyen, où s’intriquent parcours intime et poids historique, deuil et fraternité, amour et exil, fiction et réel. Fille d’une Vietnamienne et d’un pied-noir, Caroline Guiela Nguyen fait le pari de régénérer le théâtre, et signe, avec ce livre, son manifeste artistique. Avec la complicité d’Aurélie Charon et en donnant la parole à ses équipes artistiques, l’auteure fait entendre avec force les pulsations qui font battre ses mises en scène et son écriture ancrée dans la réalité d’un présent habité par l’Histoire. Ses pièces, Kindheitsarchive, pièce sur l’adoption internationale, FRATERNITE, Conte fantastique, SAIGON …sont jouées dans plus de quinze pays dans le monde. Caroline Guiela Nguyen est auteure, metteuse en scène et réalisatrice. D’abord étudiante en sociologie, elle intègre l’école du Théâtre National de Strasbourg et à sa sortie en 2009 fonde la compagnie Les Hommes Approximatifs. Soucieuse de mettre au plateau des visages et des corps habituellement absents – oubliés ou marginalisés -, d’imaginer avec eux de grands récits de fiction, la compagnie Les Hommes Approximatifs part longuement en recherche de ses comédiens, professionnels comme amateurs. Convaincue de la puissance de la fiction, attentive à raconter le monde tel qu’il se présente. Caroline Guiela Nguyen écrit toujours en amont, en immersion dans des lieux qui captent les problématiques de notre époque, au contact de celles et ceux qu’elle nomme « experts de nos réels ». Le 19 décembre 2022, elle est nommée directrice du Théâtre National de Strasbourg et prendra ses fonctions en septembre 2023. « Caroline Guiela Nguyen invente un nouveau monde avec des univers, des langues, des grammaires, des futurs qui ne se ressemblent pas. Sur le plateau de FRATERNITE, Conte fantastique, treize comédiens parlent le bambara, le tamoul, l’arabe, le vietnamien, l’anglais ou le français. Certains jouent sur un plateau de théâtre pour la première fois. (…) Caroline Guiela Nguyen, dans ses spectacles, occupe des espaces: une chambre dans Se souvenir de Violetta, un appartement dans Mon Grand Amour, une salle des fêtes dans Le Bal d’Emma, un restaurant dans SAÏGON, un centre de soins et de consolation dans FRATERNITE, Conte fantastique. Le lieu fait parler, puis écrire. (…) » Et à chaque fois, il y a beaucoup à dire. De son côté, Aurélie Charon est animatrice radio depuis 2011. Elle a collaboré avec Vincent Josse sur France Inter et a présenté L’Atelier intérieur et Une vie d’artiste sur France-Culture. En 2013, elle crée RADIO LIVE, une nouvelle génération au micro, une expérience radiophonique et documentaire sur scène. Depuis 2017, elle anime et produit Tous en scène, sur la même station. Son premier livre, C’était pas mieux avant, ce sera mieux après, a paru aux éditions de l’iconoclaste, en 2019. Journaux et carnets de travail, lettres et entretiens avec partenaires, comédiens et interprètes, le regard de Caroline Guiela Nguyen s’inscrit pleinement dans l’immédiat d’un monde en mutation. Véronique Hotte Un théâtre cardiaque de Caroline Guiela Nguyen, en complicité avec Aurélie Charon, éditions Actes Sud, 2023. https://www.actes-sud.fr/catalogue/theatre-arts-du-spectacle/un-theatre-cardiaque Caroline Guiela Nguyen présente le livre (vidéo)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 14, 2023 6:31 PM
|
Par Véronique Hotte dans Webthéâtre - 14 janvier 2023 A Kiev, en 2015, Lucie Berelowitsch, directrice du Préau - CDN de Normandie - Vire, avait créé Antigone, un projet franco-ukrainien composé d’une équipe artistique ukrainienne et française. Les Dakh Daughters y jouaient le chœur, et l’une d’entre elles, le rôle d’Antigone. La tournée en France a débuté en 2016, et en 2021, la reprise d’Antigone, à la Grande Halle de la Villette, n’a pu se faire vu la pandémie : la période de tournée s’est transformée en création des Géants de la montagne. Une drôle d’histoire qui a trait au théâtre et à l’art, en général, domaine que privilégie l’oeuvre de Pirandello. Qu’est-ce que le rêve ? Qu’est-ce que la réalité ? Où est la vérité ? Où se tient la fiction ? Est-on soi ou bien endosse-t-on le rôle d’un personnage ? Qu’est-ce que « être » ? Une actrice-comtesse veut donner vie à l’oeuvre d’un poète mort et aimé, sacrifiant temps et biens, menant une existence errante. Avec le Comte et les fidèles de sa troupe de comédiens, elle arrive sur une île, en quête d’un théâtre : ils parviennent au frontispice d’une villa abandonnée. La scénographie d’Hervé Cherblanc est somptueuse qui retrace pour le regard les vestiges intérieurs d’une demeure jadis cossue, dont il ne resterait que les traces d’un faste révolu - petits escalier intérieur, galerie au premier étage, panneaux transparents et colorés, répartis çà et là, comme emboîtés les uns dans les autres, un patchwork indéfinissable avec ses dalles, sa marqueterie au sol. Surélevé, un petit promontoire mobile - podium encastré pour les musiciennes -, qui fraye avec les branches ancestrales et pénétrantes d’un arbre noueux au rôle de veilleur. La Villa « Scalogna » - « La Poisse » - abrite un groupe hétérogène, marginal, mystique ou idéaliste : des réfugiés au sens propre et figuré, puisque Les Dark Daughters - un groupe cabaret-punk féminin - qui fuient la guerre en Ukraine, dans la mise en scène de Lucie Berelowitsch, endossent leurs rôles à la fois de comédiennes et de musiciennes - la communauté pirandellienne. Ces femmes, accompagnées d’un homme mutique, ont investi les lieux, font de la musique, rêvent, protégées autour de Cotrone, un maître de cérémonie loufoque, marionnettiste, prêchant l’illusion et l’imagination souveraine, mettant à disposition pantins, effigies et marionnettes. Et chacun y va de son existence, s’exprimant en déclamant, en chantant, en jouant d’un instrument.
Ces « parias » sont les seuls interlocuteurs des comédiens, invitant les acteurs à rester avec eux. Tous déploient devant leurs yeux leur monde magique où l’imagination crée tout - la découverte d’un entre-deux-mondes où s’accomplissent danses, déclamations poétiques et musiques.
La pièce est une partition de musique live et de sonorités électroniques, composition des Dakh Daughters, entre musique traditionnelle, rituelle et rock, avec piano, batterie, contrebasse, violoncelle, violon, guitare électrique : révélation de la grandeur et la misère d’un petit théâtre de tréteaux. La comtesse Ilse refuse d’abandonner son projet de représenter en public La Fable de l’enfant échangé. Cotrone propose à la troupe de la mener chez les géants de la montagne, pour y jouer la pièce. L’acte III s’achève sur les paroles d’une comédienne de la troupe, qui entend le fracas des géants descendant de la montagne : « J’ai peur... j’ai peur. » Dans le final jamais écrit, les comédiens se font tuer par les serviteurs, incapables de comprendre le prodige de l’Art. Inventer la vérité est la devise de Cotrone, un plaidoyer pour la liberté du rêve, et passer de la fiction à la réalité : le vrai miracle n’est pas la représentation mais l’imagination du poète. Il rend la vie aux marionnettes, évoque les anges et entend des voix, dans un « arsenal de prodiges ». « Toutes ces vérités que la conscience refuse. Je les fais sortir du secret des sens, ou alors, les plus épouvantables, des cavernes de l’instinct… Je m’essaie maintenant ici, à les dissoudre sous forme de fantômes, d’évanescences. Des ombres qui passent. Avec ces amis, je m’efforce de nuancer par des lueurs diffuses la réalité même, qui est dehors, et comme des flocons de nuages bariolés, je verse l’âme dans la nuit qui rêve. » (Le théâtre de Luigi Pirandello, Pierre Lepori, Ides et Calendes, Lausanne, 2020) Vapeurs de fantômes, lucioles et souvenirs d’enfance poétique au plus près de la nature, les souvenirs sont un trésor - tels les chaussons que l’une des comédiennes a rapportés de chez elle, en quittant l’Ukraine. Partir d’une demeure, en retrouver une autre peut-être, située sur la carte du monde, destin que certains de notre temps connaissent, qu’ils soient migrants ukrainiens ou africains, etc… Un spectacle politique et poétique éminemment émouvant qui emporte haut l’adhésion du public.
Les Géants de la montagne -MRIA-, un spectacle en français et en ukrainien sur-titré en français, d’après l’oeuvre de Luigi Pirandello, adaptation et mise en scène Lucie Berelowitsch, avec Les Dark Daughters - Natacha Charpe-Zozul, Natalia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, Anna Nikitina - et, Jonathan Genet, Marina Keltchewsky,Thibault Lacroix,
Baptiste Mayoraz (comédien permanent au Préau), Roman Yasinovskyi. Musique Les Dark Daughters & Vlad Troitskyi avec Baptiste Mayoraz, scénographe et accessoires Hervé Cherblanc traduction Irina Dmytrychyn, Macha Isakova et Anna Olekhnovych. Sonorisation Mikael Kandelman, costumes Caroline Tavernier, conception des pantins Natacha Charpe-Zozul & les Ateliers du Théâtre de l’Union. Du 10 au 13 janvier 2023 au TNBA - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Du 19 au 21 janvier au Préau -CDN de Normandie-Vire.
Crédit photo : Simon Gosselin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 6, 2023 11:22 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 5/01/2023 Après Lise Meitner, c’est Jocelyn Bell dont elle éclaire le destin. En alternance, deux spectacles remarquables donnés à la Reine Blanche. Remarquable. Il y a d’abord Exil intérieur ou l’histoire de Lise Mettner, née autrichienne en 1878, de culture juive, découvreuse de la fission nucléaire au sortir de la première guerre, alors qu’elle est à Berlin, en 1918. Ecrasée par la deuxième guerre, contrainte à l’exil, elle mourra en 1968, sans avoir cessé de se consacrer à la recherche. Ce premier volet, nous l’avons vu il y a plusieurs semaines et nous en avons rendu compte dans les colonnes du Quotidien du Médecin. Elisabeth Bouchaud y incarne une Lise Mettner très sensible, très intelligente. A ses côtés, Benoît di Marco est Otto Hahn, collègue allemand, chimiste qui travaille lui aussi au Laboratoire de radioactivité de l’Institut Wilhelm Kaiser de Berlin et recevra tous les honneurs. Le comédien dessine d’autres personnages, dans une narration très bien menée. De même Imer Kutllovci, Otto Robert Frisch, physicien, neveu de Lise et autres figures. On retrouve Benoît Di Marco dans ce deuxième volet de « Flammes de science ». Il est principalement Anthony Hewish, directeur de thèse de la jeune étudiante à Cambridge, Jocelyn Bell. Jocelyn est née le 15 juillet 43, en Irlande. Après des études à Glasgow, elle est à Cambridge lorsqu’elle découvre les « pulsars », en 1967. Son professeur prend d’abord avec mépris sa recherche, avant de comprendre qu’elle a raison. Il publie sous son seul nom un article dans Nature et reçoit le prix Nobel en 1974. Une partie de la communauté scientifique connaît la vérité, mais Jocelyn Bell est un grand caractère et ne dit rien. Elle poursuivra ses recherches, recevant de nombreuses récompenses. Marie Steen, qui met en scène les deux pièces, excelle à insuffler un rythme vif, en s’appuyant donc sur trois comédiens seulement, à chaque fois. Mais on est saisi par les « intrigues » et pris aussi par l’intelligence des scénographies mobiles de Luca Antonucci. Benoît Di Marco ne craint pas les personnages rugueux, voire peu sympathiques. Il est fin et délié. Très précis. Clémentine Lebocey, est une douce Jocelyn, ligotée par des complexes (être irlandaise, n’être qu’une jeune étudiante, d’une famille de quakers) et surtout d’une noblesse d’esprit extraordinaire. Et une très grande savante, toujours à l’écoute du monde ; elle aura 80 ans le 15 juillet prochain. Clémentine Lebocey est remarquable, jamais démonstrative. Comme l’est son amie, sa colocataire, Janet Smith, étudiante en théologie. Les très jeunes femmes partagent des conversations très sérieuses sur le sens de la vie, la religion, le ciel des astrophysiciens et celui des croyants. Mais rien n’est lourd jamais et Roxane Driay est elle aussi ultra-sensible et vive. Bref de très beaux moments de vrai théâtre qui nous éclairent et nous dévoilent des destins de femmes très intelligentes, flouées, volées même, mais d’une dignité et d’une hauteur de vue qui dépasse toutes les indignations. Des âmes fortes . Théâtre de la Reine Blanche, les deux pièces en alternance, jusqu’au 28 janvier pour Exil Intérieur et ensuite seule à l’affiche, jusqu’au 5 février, Prix No’Bell. Horaires à vérifier : 14h30, 16h00, 18h00, 19h00, selon les jours. Durée : 1h20 à peu près, chaque pièce. Tél : 01 40 05 06 96. www.reineblanche.com reservations@scenesblanches.com Les deux textes sont publiés dans la collection les Quatre-Vents de l’Avant-scène théâtre (15€). En vente sur place.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 10, 2021 6:59 AM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 10/12/2021 Le théâtre français est loin de la parité. Mais une nouvelle génération d'autrices et de metteuses en scène surdouées s'impose sur les planches. Avec le soutien du public. De Pauline Bureau à Nathalie Béasse, revue de troupes. Les femmes ont encore du pain sur la planche pour imposer leur voix dans le théâtre. Une double actualité le rappelle de manière cinglante. La première dissipe l'illusion d'un milieu artistique exemplaire protégé des violences masculines : quatre ans après le mouvement de révolte dans le cinéma, s'est créé fin octobre un « MeToo théâtre » visant à dénoncer les agressions sexuelles et harcèlement dont sont victimes des comédiennes. La seconde montre que le secteur est encore loin d'atteindre la parité : selon une enquête publiée tout récemment par le Syndeac (syndicat des entreprises artistiques et culturelles qui regroupe les théâtres publics) auprès de plus de 300 établissements, les spectacles mis en scène par des femmes représentent seulement 35% de la programmation. Toutes et tous rêvent d'un rééquilibrage sur les planches et dans les coulisses qui permettrait d'assurer une expression artistique équilibrée, tout en prévenant les dérives d'abus de pouvoir et de domination machiste. Programmation paritaire à Avignon Ce rêve n'est peut-être pas une utopie. Car malgré les pesanteurs de la tradition, les choses bougent… Depuis quelques années, les révélations théâtrales sont le plus souvent féminines. Alors que pendant longtemps, Ariane Mnouchkine faisait figure d'exception dans le panthéon du théâtre français, la liste des metteuses en scène renommées n'en finit plus de s'allonger. Preuve récente, Olivier Py et son équipe artistique n'ont pas eu à se forcer pour proposer une programmation paritaire lors de la dernière édition du Festival d'Avignon. Plus personne n'invoque une politique du quota quand est annoncée la nomination de telle ou telle à la tête d'une institution publique. Signe que les temps changent vraiment : dans les écoles de théâtre, les classes de mises en scène sont souvent majoritairement féminines. Ce basculement nous a inspiré un inventaire du théâtre au féminin aujourd'hui. Une sélection non exhaustive de dix artistes à suivre. Par leurs styles, très différents, elles ont bouleversé, bousculé ou enchanté le public. Elles sont à l'affiche dans les semaines et mois à venir. L'amorce d'une salutaire prise de pouvoir. Pauline Bureau, la vie en pièces Elle nous avait charmés en 2014 avec le chant de ses « Sirènes » , un envoûtant conte marin, mélange d'onirisme et de réalisme social. Elle ne nous a pas déçus depuis. La jeune autrice et metteuse en scène n'a pas peur de se colleter aux phénomènes de société : le scandale du Médiator avec « Mon Coeur » (2017) , la longue marche pour le droit à l'avortement - « Hors-la-loi » (en 2019, à la Comédie-Française)- , l'avènement du foot féminin - « Féminines » (2019) -, la GPA - Pour autrui » (2021) . En cultivant un mélange d'aplomb et d'innocence, Pauline Bureau réinvente un théâtre populaire, spectaculaire et militant qui émeut, faire rire ou frémir. « Pour autrui », tournée en France jusqu'en mars 2022. Julie Deliquet, en écran large Sa passion du cinéma a mené cette artiste de 41 ans au théâtre. Et elle parvient magnifiquement à transformer des films cultes en « bêtes de scènes » : ses adaptations limpides et fluides de « Fanny et Alexandre », de Bergman (en 2019 au Français), d' « Un conte de Noël », de Desplechin (en 2020 à l'Odéon) et de « Huit heures ne font pas un jour », de Fassbinder (en 2021 au TGP de Saint-Denis) ont marqué les esprits. Mais Julie Deliquet connaît aussi ses classiques : sa version resserrée d' « Oncle Vania », de Tchekhov a bouleversé le public de la Comédie-Française en 2016. Avec sa compagnie « In Vitro », elle a développé un style de jeu naturel qui fait mouche. Depuis mars 2020, elle a pris les rênes du Théâtre Gérard-Philipe de Saint Denis. « Huit heures ne font pas un jour », tournée en France de janvier à mars. Maëlle Poésy, justesse et précision Elle a conquis le Vieux-Colombier en septembre avec « 7 minutes », drame social à suspense de Stefano Massini situé dans une usine textile. Mise en scène précise, sens du tempo, direction d'actrices au cordeau (il n'y avait que des femmes dans la distribution)… Tentée d'abord par la danse, Maëlle Poésy a rejoint l'école du TNS en 2007. Après trois mises en scènes prometteuses, elle fait coup double en 2016 avec deux Tchekhov, « Le Chant du cygne » et « L'Ours » finement enchaînés au Studio de la Comédie-Française, et un drame politique apocalyptique « Ceux qui errent ne se trompent pas », de Kevin Keiss à Avignon. En juillet 2021, elle est nommée à 36 ans directrice du Théâtre Dijon-Bourgogne. Célie Pauthe, à fleur de peau Depuis 2013, elle dirige le CDN Besançon Franche-Comté. Célie Pauthe, 46 ans, est une metteuse en scène subtile qui brasse un vaste répertoire, souvent hors des sentiers battus. Elle impressionne en 2011 au Théâtre national de La Colline avec un « Long Voyage du jour à la nuit » d'Eugene O'Neill, spectacle ultrasensible. Elle maîtrise aussi bien les textes contemporains ( « Yukonstyle », de Sarah Berthiaume en 2013, « Un amour impossible », d'après Christine Angot en 2016) et les classiques (« Bérénice », de Racine en 2018). Sur scène, elle déploie un univers en clair-obscur, intense, à fleur de peau. Créée à huis clos début 2021, sa mise en scène d'« Antoine et Cléopâtre » de Shakespeare apparaît des plus prometteuses. « Antoine et Cléopâtre », tournée à partir de janvier. Du 7 mai au 5 juin 2022 à l'Odéon. Julie Duclos, la passion en clair-obscur Elle a été formée par Alain Françon et Dominique Valadié au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. On ne pouvait rêver mieux pour entamer une vie de théâtre. Julie Duclos nous avait emballés avec « Nos serments » , adaptation libre du film « La Maman et la Putain », de Jean Eustache, à La Colline en 2015. Essai transformé dans le même théâtre en 2016 avec « MayDay », de Dorothée Zumstein, cérémonie sauvage autour d'une sombre affaire d'infanticide. À Avignon en 2019, elle donnait une version onirique de « Pelléas et Mélisande », de Maeterlinck . On attend beaucoup de sa dernière création, « Kliniken », de Lars Noren, créée début novembre au TNB de Rennes. « Kliniken », tournée de février à mai. Du 10 au 26 mai 2022 à l'Odéon. Pauline Bayle, l'alchimiste L'«Iliade » et l'«Odyssée » d'Homère emballées en trois heures chrono, « Illusions perdues » de Balzac en deux heures trente…, le tout avec une poignée de comédien(e)s aux rôles interchangeables et pratiquement pas de décor. Pauline Bayle n'a pas son pareil pour s'emparer des textes classiques, les élaguer et produire avec sa jeune troupe surdouée un théâtre à cru. Qui dit scénographie minimale ne dit pas absence de mise en scène. La jeune artiste crée des effets de théâtre avec un rien. Plébiscitée pour son travail de passeuse de texte accessible à tous et à toutes, elle a été nommée directrice du Nouveau Théâtre de Montreuil à la mi-octobre. « Illusions perdues », tournée en France jusqu'en juin 2022. Séverine Chavrier, l'audace en bandoulière Musicienne formée hors du sérail des écoles dramatiques, Séverine Chavrier a fait une entrée fracassante dans le théâtre en s'emparant avec audace de chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Hachant menu les grands textes pour en extraire l'essence, elle déploie un théâtre de plateau « total », où se bousculent les acteurs et objets, où explosent la musique et les vidéos. Son adaptation fulgurante des « Palmiers sauvages », de William Faulkner (2014), puis celle du « Déjeuner chez Wittgenstein », de Thomas Bernhard, devenu « Nous sommes repus, mais pas repentis » (2016), ont fait sensation. Son dernier spectacle, daté de 2019, est « Aria Da Capo » une chronique musicale intimiste. En 2022, elle présentera une nouvelle création, « Ils nous ont oubliés » d'après « La Plâtrière » de Thomas Bernhard. Depuis 2017, elle est directrice du Centre dramatique national Orléans/Loiret/Centre. « Ils nous ont oubliés », les 24 et 25 mars au Tandem Arras-Douai, puis du 12 au 27 avril, à l'Odéon, Paris. Jeanne Candel, l'invention permanente Avec ou sans Samuel Achache, Jeanne Candel - directrice du théâtre de l'Aquarium depuis 2020 - est la créatrice d'Otni (Objets théâtraux non identifiés) réjouissants. Image drolatique d'un homme skiant sur une montagne de gravats dans une adaptation délirante de « Didon et Enée », de Purcell , gags en série dans un « Orfeo », de Monteverdi tout aussi débridé : l'actrice et metteuse en scène convoque dans chacun des spectacles coécrits avec son complice l'étrange et inédit. Dans ses créations en solo, l'extravagance est encore plus poussée. En témoignent ce « Goût du faux », puzzle surréaliste et musical de deux heures écrit en 2014 et ce « Tarquin » (2019), où le dernier roi de Rome est transformé en général tortionnaire reclus dans la jungle amazonienne. Caroline Guiela NGuyen, créatrice d'émotions À 40 ans à peine, Caroline Guiela N'Guyen est un phénomène. Son théâtre à la fois social, intime et spectaculaire bouleverse le public qui suit ses spectacles les larmes aux yeux et l'acclame debout aux saluts. Minutieuse (elle prépare ses spectacles pendant des mois), adepte d'un théâtre de plateau où tout s'invente en « live », elle excelle dans la création d'atmosphères surréelles et signe des scénographies d'une rare élégance. Tant pis si son écriture reste brouillonne et le jeu des comédiens un brin approximatif : « Saïgon », spectacle sentimental dédié aux exilés franco-vietnamiens (2017) et « Fraternité. Conte fantastique » , sa fresque d'anticipation compassionnelle (2021) ont triomphé à Avignon et ailleurs. Fraternité. Conte fantastique, en tournée jusqu'en mai. Nathalie Béasse, l'ensorceleuse L'art de Nathalie Béasse touche à l'indicible. Certains spectateurs n'y verront qu'un feu doux. Et pourtant le théâtre-danse de la jeune créatrice brûle d'une flamme intérieure ardente. Ses spectacles phares, « Le bruit des arbres qui tombent » (Théâtre de la Bastille, 2017) et « Ceux-qui-vont-contre-le-vent » (Avignon, 2021) mixent bribes de grands puissants (Duras, Dostoïevski, Stein), beaux gestes et musique en un troublant patchwork poétique. Les objets s'animent au contact d'énigmatiques acteurs danseurs, comme possédés par les fantômes de Pina Bausch et de Tadeusz Kantor. Nathalie Béasse nous ensorcelle avec une infinie douceur. « Ceux-qui-vont-contre-le-vent », tournée jusqu'à fin mars. Paris, Théâtre de la Bastille, du 3 au 18 février. Par Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Mathilde Mery dans une adaptation de l'«Iliade» mise en scène Pauline Bayle d'après Homère. (©Blandine Soulage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 14, 2021 9:01 AM
|
Par Fabien Massin dans 76 actu, le 13 novembre 2021 Rencontre avec le duo de marionnettistes, Camille Trouvé et Brice Berthoud, qui succède à David Bobée à la tête du CDN de Normandie Rouen (Seine-Maritime).
Le duo qui succède à David Bobée à la tête du CDN (Centre dramatique national) de Normandie Rouen a pris ses fonctions : deux marionnettistes, Camille Trouvé et Brice Berthoud, fondateurs de la compagnie Les Anges au Plafond, à Malakoff (Hauts-de-Seine). Entretien à deux voix avec la nouvelle direction du CDN, présente sur trois lieux : le Théâtre des deux rives (Rouen), le Théâtre de la Foudre (Le Petit-Quevilly) et l’Espace Marc-Sangnier (Mont-Saint-Aignan). « La marionnette contemporaine est un langage transdisciplinaire » 76actu : Camille Trouvé et Brice Berthoud, qui êtes-vous ?
Camille Trouvé : Nous sommes deux artistes multi-casquettes, à la fois metteuse/metteur en scène et interprètes, et surtout auteurs de nos spectacles. Brice est scénographe, et moi constructrice de marionnettes, 200 en 20 ans, la particularité des marionnettes contemporaines étant qu’elles sont à taille humaine.
Brice Berthoud : Aujourd’hui la marionnette contemporaine est un langage transdisciplinaire, qui mélange les arts du mouvement, les arts plastiques, les arts visuels, les nouveaux médias, le cirque et la musique. La marionnette est sortie du carcan et du castelet, elle est complètement à la croisée des arts, et son image a d’ailleurs changé. Qu’est-ce qui vous a conduit à venir ici ?
C.T. : La compagnie Les Anges au Plafond est très attachée à Malakoff, mais elle s’est développée sur tout le territoire français, avec des associations fortes dans des grandes maisons de production et dans des scènes nationales. Donc quelque part, on a rayonné avec notre esthétique partout en France. Puis il y avait cette envie, dans un parcours de compagnie, de s’implanter durablement sur un territoire, en contact avec des populations, et de pouvoir mener un travail de long terme. B.B. : Au ministère déjà ils nous appelaient le « CDN nomade »… Parce qu’avec 13 spectacles au répertoire, l’aide à des compagnies en production déléguée, des heures consacrées à l’action d’éducation culturelle — sur tout le territoire français —, des formations professionnelles, etc., nos missions s’apparentaient à celles d’un CDN.
Cela fait ainsi des années qu’on nous poussait à aller dans un lieu. Et nous avons fait une rencontre très forte ici, dans ces trois lieux. Là, nous nous sommes dit que l’opportunité était magnifique de poser un projet artistique. • Découvrez une création des Anges au Plafond : Qu’avez-vous défendu dans votre candidature ?
C.T. : Nous avons défendu un projet vraiment transdisciplinaire, un croisement des arts et des disciplines : arts du mouvement — cirque et la danse —, musique en direct, art dramatique, évidemment, et l’axe marionnettes, qui constitue en soi un endroit de convergence de ces pratiques artistiques. Par ailleurs, nous avons une grande envie de travailler hors les murs et d’être à la rencontre des habitants. Nous voulons faire surgir le théâtre partout, surtout là où on ne l’attend pas : centres sociaux, prisons, hôpitaux, collèges et lycées… Nous voulons être dans une forme de surprise par rapport à cet art, pour renouveler la curiosité du public. Aujourd’hui vous vous insérez dans une programmation déjà établie : quel regard portez-vous sur ce qui a été fait ? Connaissiez-vous David Bobée ?
B. B. : Oui bien sûr, nous avons d’immenses affinités avec David Bobée et nous allons défendre cette programmation comme si c’était la nôtre. Il y a une partie des projets que nous aurions pu programmer nous-mêmes, notamment le spectacle de Pierre Guillois Les Gros patinent bien [à l’affiche jusqu’à samedi 13 novembre Ndlr], qui fait partie de notre genre de beauté. Il n’y aura pas de rupture, mais des petits pas de côté, sur certaines choses. Le public, l’équipe, tout le monde attend cela. Nous ne serons pas des clones de David Bobée, nous avons notre identité.
Sur le public ne nous y trompons pas, la crise est là, il ne revient pas en salle et cela n’a rien à voir avec le Covid. Il y a des questions relatives au public qu’il faut remettre sur la table : les CDN ont été inventés il y a 70 ans pour décentraliser la culture, peut-être qu’aujourd’hui les centres dramatiques nationaux doivent-ils se décentraliser eux-mêmes. Il n’est plus question de faire venir 95 % de la population qui ne va pas au théâtre et qui ne viendra jamais. Or, tout le monde a le droit à la culture.
Dès lors, comment comptez-vous vous y prendre ?
C. T. : Lors du week-end d’ouverture, fin septembre 2022, qui marquera le lancement de notre saison, nous allons proposer un événement sur les trois lieux, à la fois dans les salles et dans l’espace public, avec des moments de convivialité pour se rencontrer. Je pense que dès le début, nous allons être à la rencontre des publics hors les murs, dans les structures, dans l’espace public et en milieu rural. Nous allons également créer des petites formes en appartement, pour changer la rencontre entre le public et les artistes. Le 20 heures, le grand spectacle sur le grand plateau, qui demeurera, va cohabiter avec de nouvelles formes de rencontre. B. B. : Nous voulons également proposer à un ou une auteure d’écrire une série, en trois épisodes, qui sera déclinée dans les trois lieux. La richesse de ce CDN est justement d’avoir trois lieux, un grand territoire et des partenaires très investis. « Chacun a son domaine de compétences » Vous êtes une direction à double tête, vous en avez l’expérience de 20 ans dans votre compagnie, mais ici, comment allez-vous vous répartir les tâches ?
C.T. : C’est vraiment une richesse d’être deux, et chacun a ses domaines de compétences. Brice est très attaché à la relation au public, il est très inventif dans ce domaine, il va trouver de nouvelles formes de rencontre avec le public, il est soucieux des outils de communication. Il est aussi scénographe, et maitrise tous les métiers du plateau. Moi je suis plus dans… B.B. : …dans tout le reste (rires) C.T. : Moi j’ai un rapport très fort à la pédagogie, je donne beaucoup d’heures de cours, dans les écoles nationales de théâtre et de marionnettes. J’ai aussi un rapport fort avec l’administration… B.B. : …et les budgets, c’est très important ! Et sur toute la programmation, parce que tu vas voir quand même trois-quatre spectacles par semaine, quand tu ne joues pas. C.T. : Sur la programmation, nous allons proposer des choses, sachant que dans l’équipe il y a aussi de vraies personnes ressources. La force de notre duo, c’est une capacité à fédérer autour d’un projet, c’est en tout cas ce que nous avons expérimenté dans la compagnie. Que va devenir votre compagnie, justement ?
B.B. : Elle va être mise en sommeil, nous sommes obligés de muter. Les 13 productions de la compagnie vont arriver au CDN, ce seront celles du CDN, tout comme les trois productions déléguées. Tout cela va se faire petit à petit, mais en juin 2022, normalement, tout appartiendra au CDN. C’est une mutation logique, mais aussi un deuil, évidemment. Aux Anges au Plafond, nous avons des bureaux, un atelier mais surtout des partenariats. Nous aimons travailler avec le lien, et associer plusieurs structures dans la production d’un spectacle : CDN, scène nationale, théâtre de ville… Cela apporte de la force dans le financement, et le spectacle tourne là où il a été coproduit, il va rencontrer des publics. Bien sûr, avec des grosses productions et des forces de production qu’ont les CDN, cela va plus vite. Mais à plusieurs on va vraiment plus loin, c’est plus profond. Ce maillage, nous aimerions le garder au sein du CDN. C.T. : La compagnie est mise en sommeil, en revanche nous en conservons le nom : elle possède une identité et est une force sur le territoire national ainsi qu’à l’international. Nous pensons que c’est une richesse d’apporter ce nom ici, il est porteur d’un « following » : il y a un public qui suit les Anges au Plafond et des programmateurs étrangers qui en suivent les projets. Autre spécificité de votre duo, vous êtes interprètes : allez-vous jouer ici ?
C.T. : Oui, bien sûr. Nous continuons à être interprètes, ça nous donne beaucoup d’énergie, c’est un endroit de travail qu’on adore et ça permet au public de nous connaitre. B.B. : Notre propre saison commencera en septembre 2022, mais l’ancienne direction a eu la délicatesse de laisser un créneau, aux alentours du mois de février, pour que l’on puisse se présenter au public de l’agglomération, avec une ou deux pièces de notre répertoire. Nous n’avons pas encore choisi lesquelles, nous allons le faire avec toute l’équipe. Quel regard portez-vous sur le territoire rouennais, que vous découvrez ?
C.T. : On découvre Rouen, on adore, c’est une belle ville, vivante, qui a une vie culturelle animée, beaucoup d’acteurs culturels, beaucoup de compagnies, un joli patrimoine. Nous découvrons également une terre où la solidarité a vraiment du sens. Il y a une attention particulière aux personnes en situation de handicap, on sent que la culture est très tournée vers les droits culturels, qui est une notion à la fois centrale, et finalement assez récente. Nous avons envie de la défendre et de continuer à la faire vivre sur le territoire. Donc les questions de parité, de visibilité des minorités, d’accessibilité de la culture aux personnes en situation de handicap, seront nos chevaux de bataille. . Légende photo : Le CDN de Rouen a désormais une direction à deux têtes, un duo aux compétences complémentaires qui travaille ensemble depuis 20 ans. (©FM/76actu)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 6, 2021 7:33 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 5 nov. 2021 A Bright Room Called Day….Une chambre claire nommée jour, texte de Tony Kushner, traduction de Daniel Loayza, mise en scène de Catherine Marnas. L’œuvre de Tony Kushner revient sur les scènes françaises avec un véritable engouement, rehaussée d’une urgence tonique puisqu’elle a l’audace de parler de notre temps présent, mettant au jour, en passant, nos actualités déconcertantes. En 1994, Brigitte Jaques créait en France au Festival d’Avignon Angels in America, un drame fleuve (1991) de Tony Kushner, adapté en mini-série et dont la pertinence sociologique et artistique propulsait l’auteur sur toutes les scènes internationales. Quelques vingt-cinq ans plus tard et même un peu plus, le cinéaste Arnaud Desplechin monte aujourd’hui au théâtre Angels in America à la Comédie-Française. Antérieure à Angels in America, la pièce que monte Catherine Marnas, directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine et directrice de l’étsba – Ecole supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine -, A Bright Room Called Day… Une chambre claire nommée jour, date quant à elle, de 1984, étrangement pertinente, politiquement. Elle est traduite en français par Daniel Loayza pour une première mondiale de la nouvelle version car Tony Kushner évoque, dès 2019, la figure de Donald Trump, réactualisant le propos initial en remplaçant le nom de l’ancien acteur président Reagan par celui du nouvel animateur de téléréalité devenu chef de gouvernement. La mise en scène de Catherine Marnas joue du réalisme et de l’onirisme, de la petite et grande Histoire, de Hitler à Donald Trump, tissant des liens d’une époque à l’autre. Un soir de Nouvel An 1932, dans une fête, des jeunes gens issus de milieux artistiques « éclairés et avisés », des actrices, un réalisateur de cinéma, prennent de haut l’ascension fulgurante de Adolf Hitler, un pantin, une caricature qui échouera… Les espace-temps sont superposés, les périodes historiques sont données à voir de front et de manière simultanée puisque la maîtresse de cérémonie de ce show théâtral n’est autre qu’une jeune femme « anarcho-punk », micro en main, et qui chante à l’occasion, mais qui surtout explique et déplie l’Histoire en proposant au public une série de photos emblématiques de la période qui va de 1928 à 1938. Déroulant patiemment une Histoire inavouable, la narratrice, new-yorkaise contemporaine, associe Reagan à Hitler, un raccourci dont on fera grief à l’auteur. Sophie Richelieu, stature élancée et moulée dans un pantalon de cuir éloquent, est hissée encore sur des talons hauts, en phase avec son temps, décidée et ironique. L’interprète mène la danse, sûre de sa démonstration historique, pleine de colère. Des clichés en noir et blanc qui font froid dans le dos, sont suspendus, des photos sur un écran longitudinal placé haut : saluts hitlériens, le portrait du Führer qu’on accroche partout, des cris de foule silencieux qu’on peut entendre en les imaginant. L’auteur et la metteuse en scène partagent cette vision de « glissements progressifs », propres aux démocraties, vers des valeurs d’extrême-droite. Et ces glissements, ces dérives, ces lâchetés ou ces semi-consentements ne concernent pas toujours les « autres », mais tous, autant que nous sommes, légers et changeants, tels certains anciens socialistes allemands alors passés au nazisme. Les divisions de la gauche allemande, raconte-t-on, ont favorisé l’arrivée de Hitler au pouvoir, alors que le mouvement communiste berlinois était sous la férule soviétique. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier, en pleine Grande Dépression : le fascisme n’est pas qu’un épouvantail qu’on brandit pour faire peur, une menace, une Apocalypse, il participe de notre non-engagement quotidien, pleutre et pusillanime. Gurshad Shaheman – double de l’auteur Tony Kushner – pénètre sur la scène et s’adresse au public, comme à la chanteuse au micro, expliquant pourquoi il voudrait bien changer tel passage dans le drame ou bien introduire telle variante significative. Entre la scène et la salle, le plateau et les rangées de spectateurs, il attend, efficace. Tonin Palazzotto est un diable de théâtre, une performance métaphorique du Mal. Agnès Ponthier, militante communiste, est convaincante, camarade fidèle à un mouvement d’obédience sincèrement collective, belle résistante prenant des risques. Bénédicte Simon qui joue la Vieille et une militante communiste est dévolue à la scène, mimant l’engagement politique ou hurlant les exactions et horreurs commises. Les comédiens Simon Delgrange – celui-ci interprète aussi un militant communiste -, Annabelle Garcia et Yacine Sif El Islam, incarnent des jeunes gens de leur temps, attirés par l’éclat d’une réussite personnelle, mais vivant mal en leur for intérieur les garanties politiques douteuses qui leur sont réclamées en échange, traîtres à eux. Quant à Julie Papin – Agnès -, elle porte en elle l’authenticité de ces mêmes repères de démocratie occidentale, sympathisante communiste qui cède son appartement aux camarades devenus clandestins, aimant son pays et ses amis, et ne voulant pas fuir Berlin – ville alors symboliquement ouverte -, à la différence de ceux-ci fuyant, par obligation, le nazisme pour telle appartenance politique, juive, homosexuelle. Nouvelle Antigone des temps obscurs, elle dit « Non » et résiste sur place, ne pouvant ne plus croire à ce qui l’a toujours fait tenir debout – sa foi existentielle en l’être. L’actrice émouvante et tenace accorde à sa figure emblématique force et aura. Véronique Hotte Les 18 et 19 novembre 2021 TNBA au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (Garonne). Du 23 novembre au 5 décembre 2021, du mardi au samedi à 20h30, dimanche 5 décembre à 15h, relâche les 28 et 29 novembre au Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 – Paris. Tél : 01 44 95 98 00. Le 8 décembre au Nest- CDN Transfrontalier de Thionville Grand Est (Moselle). Les 14 et 15 décembre 2021 à la Comédie de Caen – CDN de Normandie (Calvados). Du 4 au 6 mai 2022 au Théâtre Olympia, CDN de Tours (Indre-et-Loire).

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 10, 2021 10:53 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 9 oct. 2021
Avec « Huit heures ne font pas un jour », au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, la metteuse en scène signe une adaptation enlevée du feuilleton télévisé sur le monde ouvrier de Rainer Werner Fassbinder. Un spectacle sur la vie ouvrière, optimiste et joyeux, baigné par l’énergie galvanisante de la débrouille et du sens du collectif ? On prend ! Et on salue la belle idée qu’a eue Julie Deliquet, la nouvelle directrice du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), d’adapter au théâtre Huit heures ne font pas un jour, le formidable feuilleton télévisé réalisé par Rainer Werner Fassbinder en 1972. La soirée qu’elle présente, en compagnie de ses excellents comédiens, fait crépiter une étincelle d’utopie bienvenue, dans notre monde courbatu par bien des maux, et pas seulement par le Covid-19. En 1971, quand la chaîne de télévision allemande WDR lui propose de réaliser une série familiale, diffusée à des heures de grande écoute, Fassbinder a 26 ans. Il a déjà écrit treize pièces de théâtre, réalisé huit films, signé nombre de mises en scène de ses propres pièces ou d’autres auteurs. La commande de la WDR l’intéresse parce qu’elle lui permet d’investir et de subvertir un genre populaire, d’y apposer sa patte. Huit heures ne font pas un jour ne ressemble à rien d’autre, dans sa manière d’aborder le réel à rebours du naturalisme en vigueur à la télévision et d’inventer une forme d’artifice, entre conte et distanciation brechtienne. C’est aussi l’œuvre la plus optimiste de Fassbinder, qui laisse libre cours, de manière inédite chez lui, à la fraîcheur et à l’espoir. Les comédiens sont ici d’un engagement, d’une fraîcheur et d’une présence qui vous embarquent et ne vous lâchent plus Le cinéaste allemand a surtout inventé là une merveilleuse galerie de personnages, tous plus vivants et attachants les uns que les autres, qui font le prix de cette fresque située à l’exacte intersection de l’intime et du collectif. Le cœur en est une famille ouvrière de Cologne, les Krüger-Epp, que l’on découvre alors qu’elle fête l’anniversaire de son inénarrable grand-mère, Luise, dite Mamie. Lorsqu’il ressort acheter quelques bouteilles de mousseux au distributeur de la gare, Jochen, son petit-fils, rencontre Marion, et c’est le début d’une grande histoire d’amour, autour de laquelle tourne toute l’œuvre. Pugnacité et solidarité Jochen est ouvrier dans une usine d’outillage, il est beau gosse, beau parleur ; Marion travaille au service des petites annonces du journal local, c’est une jeune femme libre, indépendante. Quant à Mamie, monument d’impertinence et de vivacité, armée d’une philosophie solide – « in schnaps veritas » –, elle semble apte à résoudre tous les problèmes. Combat ouvrier pour plus d’autonomie, émancipation féminine, dignité du troisième âge, droits de l’enfant… Fassbinder fait le pari d’une lutte heureuse, trempée dans la pugnacité et la solidarité. Lire le compte-rendu de la diffusion à la Berlinale 2017 : Amour, schnaps et lutte des classes, le soap opera selon Fassbinder Julie Deliquet s’empare de ce matériau exceptionnel avec le talent qui est le sien – c’en est un – pour rendre tout cela simple et vivant, ancré dans le présent du théâtre, fortement incarné. Elle ramène les cinq épisodes de la série à un spectacle de trois heures, et pourtant tout est là, le romanesque et le réel, le social et l’intime, cousus au petit point. La metteuse en scène fait le pari d’un espace unique, vaste atelier vintage décoré avec son superbe sens de la récup, un décor qui est avant tout un espace à jouer, et qui se transforme en un clin d’œil en salle de banquet pour un mariage. Lire l’entretien : Julie Deliquet, metteuse en scène : « Je ne voulais pas qu’on devienne un théâtre fantôme » Dans ce théâtre à nu, où la peau du réel n’a pas le recours, pour s’habiller, de l’image telle que pouvait la travailler un cinéaste comme Fassbinder, les comédiens sont en première ligne. Et ils sont ici d’un engagement, d’une fraîcheur et d’une présence qui vous embarquent et ne vous lâchent plus, déployant un jeu certes réaliste, dans leurs costumes furieusement seventies, mais teinté d’étrangeté et de merveilleux. Qu’il s’agisse d’Ambre Febvre, lumineuse Marion, ou de Mikaël Treguer, Jochen intense et séduisant. De Christian Drillaud, parfait en amoureux lunaire de Mamie, de Lina Alsayed, magnifique en épouse se tirant des griffes d’un mari violent, ou d’Eric Charon, en homme (pas si) ordinaire. Mais celle qui règne sur le spectacle, comme sur l’histoire de Fassbinder, c’est Mamie, telle que la joue Evelyne Didi, en faisant souffler un irrésistible vent de folie douce sur la représentation. En elle s’incarne tout l’esprit primesautier de Huit heures ne font pas un jour, cette subversion joyeuse qui déjoue la lourdeur des destins écrits d’avance. De le retrouver aujourd’hui, ce geste de Fassbinder consistant à montrer des prolétaires bien décidés à ne pas s’enfermer dans une position de victimes, mais devenant les acteurs de leur propre histoire, cela fait un bien fou. Comme une ivresse retrouvée, après des années de gueule de bois. Huit heures ne font pas un jour, de Rainer Werner Fassbinder, traduction Laurent Muhleisen (L’Arche, 304 p., 19,50 €). Adaptation et mise en scène par Julie Deliquet. Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Jusqu’au 17 octobre, du mercredi au dimanche à 19 h 30. De 6 € à 23 €. En tournée de janvier à avril 2022, à Montpellier, Lyon, Grenoble, La Rochelle, Toulouse, Colmar, Toulon, Marseille, Limoges, Reims et Caen. Fabienne Darge Photo : PASCAL VICTOR/ARTCOMPRESS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 6, 2021 6:37 AM
|
ENTRETIEN. Un festival de théâtre d’un nouveau genre se tiendra les 6 et 7 mai à Bordeaux. Catherine Marnas évoque sa genèse et sa programmation. Catherine Marnas entend « transformer son théâtre en une ruche bourdonnante d'artistes en répétition... » © Frédéric Desmesure Ce sera un festival en petit comité… comme une répétition générale avant la grande reprise du 19 mai prochain. « Focus », la manifestation dédiée à la création contemporaine qui se tient cette semaine au théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) n'en devrait pas moins permettre aux jeunes troupes invitées de montrer enfin leur travail au public. À l'origine de ce nouveau festival, Catherine Marnas, directrice de ce centre dramatique national, en explique le principe. Le Point : Le festival Focus, dont vous organisez la première édition les 6 et 7 mai prochains à Bordeaux, intervient juste avant la réouverture des salles de spectacle. Allez-vous pouvoir accueillir du public avant les autres théâtres ? Catherine Marnas : Non. Nous ne pourrons malheureusement pas ouvrir nos portes au grand public. Cette édition sera réservée à un auditoire restreint de professionnels : programmateurs et directeurs de salle. Si l'une des propositions sera montrée en extérieur, ce ne sera que dans le cadre d'un protocole sanitaire très strict. Mais nous avons bon espoir que les spectacles qui seront montrés au TnBA pourront tourner dans l'Hexagone la saison prochaine. Comme tous les théâtres de France, nous attendons le 19 mai avec impatience… Comment avez-vous vécu la saison dernière ? Nous n'avons pu jouer que 19 fois sur la saison 2020-2021, là où, d'habitude, nous proposons entre 170 à 180 représentations par an. Mais nous avons quand même beaucoup travaillé. C'est tout le paradoxe de la crise que nous traversons. Notre lieu avait beau ne pas accueillir de spectateurs, nous n'avons pas cessé de répéter dans les trois salles de notre centre dramatique national. Si j'osais une image, je dirais que nous avons réalisé un travail de Pénélope. Comme la femme d'Ulysse, nous détricotions le soir ce que nous avions tissé pendant la journée. Certains de nos spectacles ont été repoussés quatre fois ! Cela veut dire que nous devions être prêts à la date dite, mais que les circonstances nous ont, chaque fois, contraints à retarder le moment où nous pourrions montrer le résultat de notre travail. Alors, nous reprenions les répétitions… À LIRE AUSSI Scène – L'art de se réinventer Le festival que vous créez cette année est-il une réponse à la crise que nous traversons ? Je l'ai imaginé avant la pandémie. Son objectif est de mettre en avant la création contemporaine. Je suis engagée de longue date dans ce projet qui vise à aider une nouvelle génération d'hommes et de femmes de théâtre à émerger. Je suis entourée de beaucoup de jeunes compagnies. Je dirige l'École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine (Estba), d'où sortent, tous les trois ans, quatorze diplômés. Si j'aime l'idée qu'ils se frottent à la vraie vie en sortant de chez nous, je souhaite néanmoins leur offrir la possibilité de montrer ce qu'ils font ici. Nous avons en Aquitaine de nombreux créateurs de talent, nous avons conduit avec eux de nombreux entretiens par vidéo pendant le premier confinement. Et tous nous ont dit la même chose : les conditions de production et de distribution sont de plus en plus difficiles. Pourquoi ? Les temporalités sont cruelles. Il faut deux ans en moyenne pour mettre sur pied un projet, pour réunir une coproduction, répéter et trouver des dates. Or, le monde change à une telle vitesse que ces jeunes ont envie de partager immédiatement leur travail. L'idée du festival Focus est de leur permettre de montrer une forme, même inaboutie, de ce qu'ils préparent. Un peu comme si un peintre organisait une journée « portes ouvertes », pour qu'on voie où il en est. Vous allez montrer neuf spectacles, à différentes étapes de leur réalisation. Le premier d'entre eux fait penser à une chanson de Dominique A puisqu'il s'intitule Le Courage des oiseaux… Oui. C'est une lecture-performance de Baptiste Amann. Ce sera un geste en forme de « making-of » de la trilogie qu'il a écrite et qui sera programmée au Festival d'Avignon cet été. Cela va bientôt faire sept ans que Baptiste développe ce projet intitulé « Des territoires ». C'est une exploration géographique et générationnelle de la scène qui vise à répondre à une question : quelle histoire écrire lorsque'on est, comme ses personnages, héritiers d'un patrimoine sans prestige et représentants d'une génération que l'on décrit comme désenchantée ?… Les deux premiers spectacles ont été créés en 2015 et 2017. Baptiste ne présentera pas ici le troisième opus de ce projet, mais un spectacle où il racontera les sept années qu'il a passées sur les routes pour créer ces trois œuvres. Je ne sais pas encore très bien la forme que cela prendra. Je peux juste vous dire qu'il a demandé un piano sur scène et que je ne doute pas que cela sera très abouti. Est aussi annoncée une lecture de Jérémy Barbier d'Hiver. De quoi s'agit-il ? Ce sera un texte très personnel que Jérémy a écrit : le monologue d'un homme qui parle à la tombe d'un père qu'il n'a pas connu. Cette pièce dont le titre provisoire est Mine de rien est en quelque sorte une suite à la « carte blanche » que notre théâtre lui avait déjà proposée. Ce sera son premier spectacle personnel. Il en proposera une lecture au plateau… Cet ancien élève de l'Estba est aujourd'hui membre du collectif « Les Rejetons de la reine » qui sera également programmé cette semaine. Effectivement. Ce collectif, constitué outre de Jérémy, de Clémentine Couic, d'Alyssia Derly et de Julie Papin, s'est formé au cœur de l'Estba en 2019. Il présentera sa première création : Un poignard dans la poche. Un texte de Simon Delgrange qui sera d'ailleurs à l'affiche du TnBA en octobre 2021. L'histoire se développe autour d'un repas de famille. On y parle beaucoup de politique et cela dégénère très vite. C'est du théâtre contemporain de l'absurde que je situerais volontiers entre Roland Dubillard et Roger Vitrac. Une table ronde, organisée le vendredi 7 mai, de 9h30 à midi, permettra aux « compagnons » du TnBA de partager avec le public la manière dont ils envisagent les « nouvelles relations entre équipes artistiques et lieux culturels ».© Pierre Planchenault Quels seront les autres temps forts du festival ? Julien Duval, fondateur du Syndicat d'initiative, proposera une forme courte, avec son acolyte Carlos Martins, autour d'une formule bien connue de Voltaire qui résonne étrangement par ces temps de Covid : « Il faut cultiver son jardin. » Une pièce qui est susceptible d'être jouée en appartement. Le collectif Os'o composé par des élèves de la première promotion de l'école (Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Roxane Brumachon et Tom Linton. Denis Lejeune étant « invité » pour l'occasion) mettra en scène un spectacle « jeune public » qui parlera d'ovnis et de science-fiction (Qui a cru Kenneth Arnold ?). Une pièce qui sera proposée, à la rentrée, dans les écoles du territoire. De son côté, Aurélie Van Den Daele adaptera La Chambre d'appel de Sidney Ali Mehelleb, un beau texte qui parle de mémoire. Enfin, Monique Garcia, cofondatrice du Glob Théâtre qu'elle dirige avec Anne Berger, jouera dans la rue une pièce étonnante (Fortune Cookie) à l'attention d'un seul spectateur à la fois. Pour ce faire, elle l'embarquera pour quelques minutes dans un tuk-tuk pour une parenthèse enchantée où il sera question de divination et de magie. Les deux dernières propositions du festival présentent la particularité d'être très biographiques… Yacine Sif El Islam et son compagnon, Benjamin Yousfi, raconteront l'agression homophobe dont ils ont été victimes en septembre 2020 et qui les a conduits à l'hôpital. En jetant ce choc sur le papier, en partageant les comptes rendus médicaux et l'avancée de l'enquête de police, Yacine met à distance ce traumatisme et signe un spectacle touchant (Sola Gratia) qui met en perspective cet événement avec des moments de son enfance. Reste votre propre pièce qui raconte le destin d'un hermaphrodite du XIXe siècle, Herculine Barbin. Pourquoi avoir choisi d'adapter sur scène le destin de cette femme, devenue homme ? J'étais partie pour adapter Le Rouge et le Noir, mais la pandémie m'a poussée à reporter ce projet. En racontant la vie d'Herculine, née femme en 1838, puis « réassignée » homme en 1860, sous le nom d'Abel, après examen médical, j'ai l'impression de traiter d'un sujet brûlant dans notre société. Lorsque je participe aux jurys qui doivent départager les 750 jeunes qui déposent un dossier pour intégrer notre école, je me rends compte que cette question de genre taraude cette génération. Je ne compte plus les candidats et candidates qui évoquent devant nous ce sujet lors des oraux. Or, c'est cela le théâtre pour moi : traiter dans l'urgence d'une question, à chaud. Partager avec des spectateurs, le temps d'une cérémonie païenne, une expérience qui nous bouleverse. Allez-vous modifier votre programmation pendant l'été ? Bien sûr. Nous allons prolonger les spectacles tout au long de l'été. Et jouer dehors s'il le faut. Le square en face du théâtre nous le permet. Nous avons plus que jamais besoin de théâtre… 2021ENTRETIEN. Un festival de théâtre d’un nouveau genre se tiendra les 6 et 7 mai à Bordeaux. Catherine Marnas évoque sa genèse et sa programmation.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 26, 2021 4:49 AM
|
Par Gérald Rossi dans L'Humanité - 26 avril 2021 Alexandra Tobelaim met en scène Abysses, un texte de Davide Enia. Elle donne la parole aux sauveteurs qui repêchent des corps autour de l’île de Lampedusa. Àl’image du monde dont il est question, le plateau d’ Abysses est plongé dans le noir, à l’exception de quelques étoiles rougeoyantes qui se signalent parfois. Le comédien Solal Bouloudnine et la chanteuse-musicienne Claire Vailler se partagent l’espace. Elle avec sa guitare baryton, lui avec sa seule présence, son jeu sobre mais vibrant, comme celui d’un passeur des mots du dramaturge italien Davide Enia, qui s’est déjà illustré dans des aventures de théâtre-récit. Ici, le jeune comédien est un témoin, fidèle à plusieurs personnages incarnés. « Ce qui est beau dans ce texte, comme dans la vie, c’est qu’il est construit de petites choses de rien, d’actes du quotidien. Rien d’héroïque », explique Alexandra Tobelaim, la metteuse en scène. Une humanité sincère et quotidienne Ce spectacle aurait dû être créé en novembre 2020 au Nest, le centre dramatique transfrontalier de Thionville-Grand-Est. La pandémie ne l’a pas permis et Abysses a été présenté seulement à quelques professionnels, fin mars à Paris, dans la grande salle des Plateaux Sauvages, où il était initialement aussi programmé. Quant à parler de « petites choses » comme le fait la nouvelle directrice du Nest, ce n’est qu’une tournure de langage. Car c’est de drames humains qu’il est question. Ceux que vivent des femmes et des hommes de tout âge, qui tentent de fuir la guerre, la misère… dans leurs pays, sur le continent africain et sur les rives sud de la Méditerranée, et qui souvent ne rencontrent que la mort. Ce texte, à la fois sensible, poignant, profondément humain, sans donner de leçons, est traduit par Olivier Favier, qui en 2018 l’a transmis à Alexandra Tobelaim, qui s’avoue très vite « prise dans la force de ce récit ». Il ne s’agit pas de donner la parole, comme cela a été fait souvent, aux migrants, ou si peu, mais aux sauveteurs. De faire vivre ce drame depuis leur regard, leurs gestes. Sans donner aux uns ou aux autres plus de valeur, plus de brillant qu’ils n’en méritent. Comme pour rester au niveau d’une humanité sincère et quotidienne. Les sauveteurs racontent comment cela se passe en mer, quand ils « repêchent » les corps, ceux des survivants et ceux des autres, ces derniers étant alors confiés au gardien du cimetière qui leur offre en toute simplicité une juste sépulture. Le drame, sans cesse répété depuis des années, se déroule autour de la petite île italienne de Lampedusa, pas loin de la Sicile. À ces drames, comme en parallèle, pour entretenir les feux à plusieurs voix, Davide Enia ajoute un récit (peut-être) autobiographique. Celui des débats entre un père quasi mutique et son fils, qui tous les deux, dans une tendresse filiale non dite mais transparente, se retrouvent témoins et modestement acteurs. Sur la scène, au côté de Solal Bouloudnine, Claire Vailler ne se contente pas d’accompagner ces récits parfois bouleversants. Elle interprète des chants populaires napolitains, qui n’illustrent rien, mais deviennent des éléments indispensables au spectacle. Pour participer à cet envoûtement qui conduit au fond de la mer comme au plus profond des intelligences humaines, forcément secouées par l’âpreté de ces désastres dont les images seulement dites, sans aucun accessoire ni quelconque projection, sont cruellement visibles de tous. Et là, comme le dit encore Alexandra Tobelaim « le théâtre est juste, nécessaire et joyeux dans cette fonction-là ». Gérald Rossi Tournée en reconstruction, et halte à Thionville (Moselle) dans les prochains mois. Légende photo : Solal Bouloudnine, un jeu sobre et vibrant. © Éric Chenal
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...