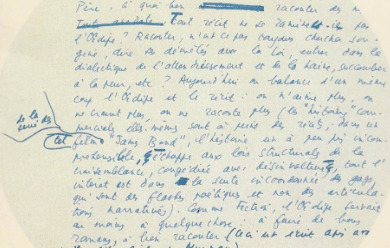Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
dm
December 4, 2024 8:40 AM
|
Interminable ou pas, si la psychanalyse fait acte, c'est quand même parce qu'elle a une fin, comme par exemple de devenir analyste. "C'est au terme d'une psychanalyse supposée achevée que le psychanalysant peut devenir psychanalyste" dit Lacan. Cela peut être plus communément de "savoir y faire avec son symptôme", c'est-à-dire que l'analysant doit parvenir à un rapport positif, apaisé, voire heureux, avec son inconscient. S'il s'agit au départ d'accueillir cette hétéronomie fondamentale qu'est l'inconscient, le travail de l'analyse doit déboucher sur cette autonomie où le sujet est enfin à son désir (ce n'est pas l'autonomie de la volonté, kantienne). Ce désir d'autonomie qui est le sien dans la mesure où il s'est engagé dans le travail de la cure, c'est précisément ce qu'il avait jusqu'alors essentiellement refoulé, ce pourquoi il n'avait pas voulu payer le prix, soit se confronter à la pulsion de mort présente dans la sexualité. Le moyen dont dispose la psychanalyse pour parvenir à sa fin, c'est, du côté de l'analysant, la fabrication de cette idole artificielle qu'est le "sujet supposé savoir", image projetée sur l'analyste, tandis que ce dernier, de son côté, se donne comme objet-déchet de la pulsion ou objet 'a'. Lacan le justifie dans sa théorie des quatre discours par la venue, dans le discours psychanalytique, de l'objet 'a' en place d'agent du discours, l'objet 'a' qu'il présente comme « être sans essence » ou encore « non-pensée » et qui n'est rien d'autre que le dépôt de la pulsion de mort. Mais si le psychanalyste a le moyen de faire acte, c'est aussi - et ce n'est pas juste manière de dire - parce qu'il dispense sa grâce à l'analysant : il le relève de l'être de déchet fasciné à quoi celui-ci s'était réduit devant l'idole ; et il le rétablit dans la vérité, à commencer par la vérité de l'inconscient présente dans les symptômes. Ce n'est pas pour rien que Lacan a dit : "Une notion aussi articulée et précise que celle de la grâce est irremplaçable quand il s'agit de la psychologie de l'acte" (L’Ethique de la psychanalyse). L'acte psychanalytique reste un acte de parole ; cette parole est acte à chaque fois que, par un jeu de mots ou une interprétation que l’analysant s’approprie aussitôt, le désir surgit, l’analysant se faisant sujet de cette parole qui est survenue. Évidemment il lui reste à devenir sujet de tout ce qu'il a pu dire, de l'ensemble de son histoire individuelle, tant qu'il n'assume pas comme tel son désir. Quant au symptôme, qui est la face jouissance de cette identité assumée (sinon retrouvée), il s’agit maintenant de “savoir faire avec”, voire le “tourner à son avantage” comme aurait pu dire Nietzsche., ce qui ne veut pas dire devenir maître es-jouissance (délire du pervers). dm

|
Scooped by
dm
December 2, 2024 4:07 AM
|
Du contrat pervers à la perversion de l'analyse
Il est une constante dans les rapports du pervers avec l'Autre en général : c'est sa façon de tourner la loi en la transformant en contrat. Mais une espèce de contrat bien particulière, d'où le tiers est absent. Par exemple dans la maxime sadienne qui me garantit le droit de jouir de la totalité ou d'une partie du corps de l'autre, aucune mention n'est faite du désir de cet autre, comme étant précisément arrimé au désir d'un tiers, un grand Autre. Dans tout contrat pervers, ou perverti, l'instance tierce se trouve ainsi en position d’exclusion. La situation analytique elle-même, dans laquelle un sujet pervers peut être amené à se trouver, deviendra perverse si ce dernier parvient à ses fins qui est d'abolir le désir du psychanalyste, de l'annihiler comme parole désirante silencieuse et de le réduire à un regard, dans une position de face-à-face. Transformer la situation analytique en mise en scène du fantasme. On peut poser la question de savoir si l'analyse ne se transforme pas quelques fois en une mise en scène perverse, et si le psychanalyste ne va pas jusqu'à manifester – sans doute à son corps défendant - une complicité active avec la perversion du patient. C'est le cas, à l’évidence, lorsque certains psys érigent à la place de l'instance tierce un être aussi peu crédible et aussi abstrait que l'institution psychanalytique elle-même. Inutile de dire que le pervers, contrairement au névrosé peut-être, n'est pas dupe : il s'oppose de tout son être à cet écran de fumée qu'est le discours, en rappelant que la vrai cause, c'est l'objet de jouissance qu'il incarne. Pire encore, si le psychanalyste entend faire triompher à terme l'ordre moral, s'il prétend faire rentrer le pervers dans la norme en vigueur, son échec est assuré. D'une manière générale, quand l'analyste tente de modifier le désir de l'Autre, de le manipuler pour quelques fin que ce soit (fût-ce le guérir ou lui faire du bien), il joue un jeu pervers et devient complice de son patient. Celui-ci aura beau jeu de l'identifier à un gendarme, gardien d'une loi stérile que l'on peut s'amuser à défier. Car, spontanément, le pervers n'aborde pas l'analyste par le biais de son savoir supposé, comme dans le transfert du névrosé, mais depuis son pouvoir supposé. Il entend démontrer que son propre pouvoir est supérieur, comme pouvoir de faire jouir. Il parviendra à ses fins si l'analyste entre imprudemment dans le contrat que souhaite établir le patient ; ce contrat stipule que chacun des deux protagonistes aura à y gagner. Donc il faut se représenter le pervers comme un être défiant a priori toute loi sociale, y compris la règle analytique lorsque celle-ci se présente comme une technique à visée normative, contractuelle, car le sujet n'aura alors aucune peine pour lui substituer son propre contrat de dupe. Au moins le pervers n'est-il pas ignorant du pouvoir de l'objet, en tant que cause du désir et de la jouissance de l'Autre. C'est toute la valeur de son "éthique", si l'on peut dire ! Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 30, 2024 3:24 PM
|
La littérature comme perversion et transmutation
Nous emploierons ici le terme de transmutation pour caractériser l'opération perverse en tant qu'elle s'effectue par l'écriture. Il ne suffit pas d'affirmer un lien entre la disposition perverse d'un sujet, voire ses pratiques considérées comme déviantes socialement, et leur expression littéraire plus ou moins marquée stylistiquement. Une telle conséquence s'impose d'elle-même, mais elle ne dit pas en quoi l'écriture en tant que telle pourrait soutenir spécifiquement la perversion et ses fantasmes. Il suffit de lire Genet, par exemple, pour s'apercevoir que l'écriture permet une transfiguration de l'abjection en son contraire, un passage de l'objet déchet vers une beauté sublime. Il semble bien que l’art poétique, exprimant le fantasme pervers, accentue et relance l'œuvre de la métonymie ; le lien entre cette figure et la structure fétichiste, notamment, apparaît clairement. Littéralement, autant que littérairement, le fétichisme opère à rebours du narcissisme : en dévoyant les traits identificatoires, uniques et aliénants, dans le sens d'une dissémination où le sujet ne se repère - en se destituant - que dans la coupure, la différence, le relais vers cet Autre par excellence qu'est le lecteur. La structure de la perversion ne consiste donc pas seulement dans le désaveu, le démenti (Verleugnung), la négation de la castration, comme Freud lui-même l'avait déjà remarqué. Elle ne réside pas non plus uniquement dans la division du sujet, précisément entre un pôle de désir (Wunsch) et un pôle constitué par la réalité (l'absence du pénis maternel). La perversion s'appuie aussi bien et surtout sur l'aveu du désaveu en question, et culmine dans la jouissance consistant à exprimer la déviance, le manque, le ratage spectaculaire de la jouissance sexuelle. C'est ce qu'attend au-delà de tout espoir l'exhibitionniste : dire à tous son désir de l'objet regard, ce qui ne peut qu'infinitiser ce désir. A cet égard, quelle jouissance, quelle exhibition ...la littérature ! On ne dira pas que l'écrivain "sublime" ou dépasse sa perversion dans son œuvre, mais plutôt qu'il pervertit la littérature ou fait de la littérature une perversion. En termes métapsychologiques, la division du sujet prend alors "consistance" dans l'imaginaire, elle devient transmutation. Force revient au "moi" et à sa Spaltung propre (le "clivage du moi" est alors à distinguer de la "division subjective"), consistant comme on l’a dit dans l'imaginaire à l'oeuvre. Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 28, 2024 12:33 PM
|
En ce qui concerne un certain "anti-lacanisme" primaire - que l'on rencontre assez souvent, par la force des choses, quand on écrit sur Lacan ! - par-delà la critique de la psychanalyse, c'est une phobie de même nature mais qui se joue à un niveau, disons plus philosophique : le rejet de Lacan fait partie d'une tentative réactionnaire de s'en prendre à la philosophie française post-existentialiste, Foucault et Derrida notamment, et même au-delà à l'ensemble de la philosophie "continentale". C'est donc une attaque qui provient des tenants ...continentaux ...de la philosophie analytique anglo-saxonne, laquelle serait, selon eux, la vraie philosophie "contemporaine", et la philosophie française dite volontiers "post-moderne" ne serait rien d'autre selon eux qu'un bullshit incompréhensible, irrationnel, sophistique, etc. Or c'est bien plutôt cette philosophie analytique, et sa conception formaliste et étriquée de l'argumentation, qui doit être qualifiée de pré-contemporaine, du moment qu'elle ignore les problématiques de l'existence d'abord, de l'inconscient ensuite, malgré un Wittgenstein proche de Freud sous certains aspects. Ajoutons à cela une tendance absolument délirante à faire proliférer les "thèses" et les "arguments" (en lieu et place des concepts) et à les identifier ipso facto comme autant de théories concurrentes, d'où une accumulation gratuite et non-justifiée de -ismes qui ne peut que donner une impression générale de relativisme (fâcheux quand on idolâtre par ailleurs la rationalité). Qu'il y ait quasiment autant de théories que d'arguments, cela ne peut que nous rappeler, dans un autre domaine, le fameux DSM-4, l'inénarrable manuel pseudo-psychiatrique (imposé par les lobbies pharmaceutiques et fossoyeur de la psychiatrie) associant à chaque "trouble", chaque manifestation pathologique le nom d'une "maladie". Parallèlement et souvent de concert avec le courant analytique, l'ignorance de la psychanalyse est manifeste au sein de cet agglomérat d'approches (essentiellement anglo-saxonnes) qu'on appelle "philosophie de l'esprit", qui se concentrent essentiellement sur la problématique de la conscience, parfois en liaison avec la psychologie cognitive, mais qui selon moi ne méritent en aucune manière le titre de théories "contemporaines". En effet parmi la grande diversité de théories parfois antinomiques (réductionnisme, fonctionnalisme, instrumentalisme, monisme, dualisme, etc.), quelques soient les solutions qu'elles proposent, force est de constater qu'elles se contentent de replacer et de rabâcher la vieille opposition de l'âme et du corps... comme si sur cette question, le triple matérialisme de Nietzsche, Marx et Freud, puis la phénoménologie, puis l'existentialisme, puis enfin le structuralisme, n'avaient pas définitivement clos le débat en rabattant la conscience d'abord sur le langage (déjà, Hegel !) puis sur le corps (cf. Merleau-Ponty, et au-delà), corps individuel et surtout corps social, avant que Lacan n'épingle conscience et inconscient comme deux types spécifiques de relations à l'autre (imaginaire dans un cas, symbolique dans l'autre), et ne parle de signifiance et de jouissance à propos de l'esprit et du corps, sans que cela fasse dualité et encore moins dualisme... Bref en tout cas, pas plus la philosophie analytique que cette "philosophie de l'esprit" anglo-saxonne, coqueluche des nouveaux diplômés en philosophie, ne sont des émanations de la pensée contemporaine : d'inspiration simplement "moderne", post-cartésienne, leur position est finalement d'attendre (ou pas, pour les plus spiritualistes) que la solution tombe, un beau jour, de la science. Elles sont, par culture, foncièrement positivistes. Mais bien entendu ce ne sont pas les fameuses "neurosciences", tant surestimées, qui auront un jour quelque chose à dire d'intelligent sur l'esprit, et pour cause. Le cerveau manigance certes quelque chose à ce titre, pour autant l'esprit n'est pas dans le cerveau, il existe dans la parole, ou dans le geste qui fait signe, ENTRE deux sujets, et encore tout de cet échange n'est-il pas forcément esprit. En tout cas il ne saurait être nulle part ailleurs... C'est très étonnant que quelque chose d'aussi sensible, d'aussi manifeste, et finalement d'aussi simple, n'aie pas traversé l'esprit des grands spécialistes de la philosophie de l'esprit ou de la neurologie ! Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 27, 2024 4:28 AM
|
Le fantasme sadien et son écriture
Qui n'est pas spontanément tenté de confondre sadisme et perversion, tant il est vrai que les deux termes semblent exprimer la même attitude, la même disposition subjective à "faire le mal" ? On sait bien pourtant qu'il n'en est rien et que l'éventail des perversions se montre des plus riches et des plus variés, que le sadisme n'existe comme tel que mis en relation structurellement avec le fétichisme ou le masochisme, notamment, et qu'il est sans doute moins fondamental, en tant que structure clinique, que ces derniers. D'autre part, si l'on rapporte l'origine du mot au personnage historique de Sade et à son œuvre, il faut éviter de confondre le "sadisme" imputable aux héros des récits sadiens et la structure psychique du Marquis lui-même, libertin dans le siècle assurément, et non moins certainement masochiste. Rappelons qu'un libertin au XVIIIè siècle n'est pas spécialement, ou pas seulement un "débauché", mais surtout un contestataire opposé aux discours dominants, notamment religieux, un athée mettant en cause le statut du Dieu chrétien comme unique "sujet-supposé-savoir". L'autre grande référence philosophique de l'époque est la Nature, en tant que système de lois universelles, et c'est elle que l'on retrouve omniprésente chez Sade sous l'espèce d'un "Etre suprême en méchanceté", non plus supposé-savoir mais cette fois supposé-jouir. Mais Sade est plus conséquent, ou peut-être plus religieux, que les libertins de son époque cultivant simplement l'immoralisme : il conçoit une vraie morale, universaliste, rigoriste, dont l'impératif catégorique consiste à obéir à la Nature et à ses lois impitoyables, cannibaliques, éminemment criminelles. Pour le dire autrement, la Loi est de jouir selon la Nature et pour la Nature. Il s'agit d'un sacrifice, plaçant cette nouvelle espèce de dévôts dans une position masochiste, et dont la portée ne va toutefois jamais jusqu'au marricide ou à l'inceste : la Nature elle-même reste inviolable, finalement le crime, non dialectisable, tourne court, se résout non dans la jouissance tant espérée mais dans le seul plaisir, indéfiniment réitéré. L'uniformité de la vie et des écrits du Marquis de Sade illustre à merveille ces principes. Voici comment Lacan formalise le fantasme du héros sadien. La position initiale du bourreau est celle de l'objet 'a', instrument métonymique de jouissance au service de la Nature comme Volonté de jouissance absolue. C'est la victime, en face, qui incarne le sujet dans sa division spécifique, entre douleur physique et soumission morale. C'est cette division qui est visée par le bourreau, au moyen de l'angoisse provoquée, et non la souffrance pour elle-même. Le reste de l'opération, en bout de circuit, devrait être le "pur sujet du plaisir" comme l'écrit Lacan, censé advenir une fois le corps expurgé de toute douleur et de tout mal. Or c'est à ce moment que le sujet défaille, pendant que le maître "décharge" (éventuellement), et tout est à refaire. Qu’en est-il du marquis de Sade que l’on dit, structurellement, masochiste ? Tout débauché qu’il fut (sans aller jusqu’au meurtre, semble-t-il), Sade a plutôt joué le rôle de la victime dans sa vie réelle, un mort-vivant qui passa presque trente années sous les verrous, sous l’emprise d'un maître (imaginaire) ayant pour nom Mme de Montreuil, sa belle-mère. C’est dans ce contexte que lui vient la nécessité d’écrire. Dans sa prison, Sade a dû convertir l'impératif de jouissance totale en obligation de dire "toute" la jouissance, de raconter la totalité de son fantasme, fût-ce sous le mode le plus rébarbatif. Le côté répétitif et comme mécanique de la stylistique sadienne, indique que cette jouissance excède de toute part le langage, et pourtant s'épuise à vouloir l'exprimer dans et par le langage. Sade écrivain s'acharne sur son lecteur comme le bourreau sadien s'acharne sur sa victime, indéfiniment ranimée pour subir d'éternels supplices. Or cette situation nous renvoie au cœur du fantasme sadien et à la véritable nature de l'objet fétiche : il s'agit de la voix, la voix forte, impérative. Que vocifère-t-il, le bourreau, que réclame-t-il de sa victime ? L'aveu. L'aveu de la jouissance cachée dont elle est censée être la dépositaire, ou la bénéficiaire grâce au traitement infligé ("avoue que tu aimes ça !", dit le violeur à sa victime - alors que dans le même temps, par principe, il exclut son consentement !). D'une part l'impératif de tout dire (de la jouissance) produit le texte mécanique, sans sujet, que les avant-gardes littéraires ont justement repéré chez Sade ; d'autre part, il produit la stupeur médusée du lecteur, de même que le bourreau finit par arracher un cri à sa victime, seulement un cri (comme "fétiche sonore" : Barthes), en guise de parole. La mise en oeuvre littéraire fonctionne alors, non comme un authentique passage à l'acte, mais comme une modalité d'érection du fétiche. L'impératif sadien de tout dire s'oppose, de toute évidence, à l'éthique du bien-dire du psychanalyste ; cependant, si ce même psychanalyste parvient à provoquer ce pivotement, d'un quart de tour sur la structure, qui exprime la différence entre le fantasme sadique et le fantasme masochiste de Sade écrivain, autrement dit s'il parvient à susciter chez son patient le désir d'écrire son fantasme, ceci allègera d'autant les occurrences où il serait tenté de le vivre.

|
Scooped by
dm
November 24, 2024 1:07 PM
|
Pourquoi, dans les domaines de l'art et de l'imaginaire, sont-ce toujours sont les mêmes mythes et les mêmes fantasmes qui transitent d’une époque à l’autre, spécialement ceux qui expriment une certaine barbarie ? Réponse plausible : ce que l’art transporte n’est autre que la transe elle-même. La transe est la clef de l’anthropologie, puisqu’elle figure l’opération par laquelle l’humain se fait humain en passant par l’animal et en faisant passer l’animal en lui : c’est un langage muet qui, en simulant le passage d’un état à un autre (mettant du coup le sujet « dans tous ses états »), témoigne surtout d’un saut symbolique décisif. Celui par lequel un humain initie, revendique, hurle littéralement son appartenance à la vie, et pas seulement à un groupe social : car s'il est une chose que la transe révoque radicalement, c'est bien la société et ses normes ! Un mythe figure à merveille la valeur ambiguë de la transe : celui du loup-garou. L’ambivalence réside aussi bien dans l’interprétation du mythe (et donc dans son traitement esthétique) : en lui-même, le loup-garou n’a guère d’intérêt s’il n’exprime que l’alternance compulsionnelle de deux états hétérogènes. La transe doit être elle-même trans-gressive, elle ne doit pas s’arrêter au caractère cyclique et bilatéral des trans-formations, ou à l’alternance narrative du naturel et du surnaturel. Elle ne doit pas non plus se figer, comme chez les patientes hystériques (sous le contrôle) de Charcot, en une attitude pointant en l’occurrence le refoulement du sexuel. La transe ne saurait se passer de danse, d’une dynamique affirmative et créatrice ; par conséquent, aucune valeur sociale ou symbolique ne peut l’investir réellement. C’est ainsi que toute figure particulière de la transe se rapporte fondamentalement à une condition en-transe - transe-cendantale pourrait-on presque dire - du vivant.

|
Scooped by
dm
November 20, 2024 5:46 AM
|
Plaisir du texte et subversion chez Roland Barthes
Les analyses de Barthes dans Le plaisir du texte partent de la distinction de deux types de texte, elle-même fondée sur l’opposition lacanienne du plaisir et de la jouissance. Soit l’on assimile l'écriture et la lecture d'un texte directement à un plaisir, ou du moins à une pratique répondant à la fonction régulatrice du principe de plaisir ; soit l’on ouvre “par le texte la brèche de la jouissance, de la grande perte subjective, identifiant alors ce texte aux moments les plus purs de la perversion, à ses lieux clandestins”. Notons d’emblée cette référence à la perversion que Barthes — avec d’autres — n’assimile pas à une structure clinique mais plutôt à une forme générale de subversion des modèles productifs sociaux. A l’intérieur de cette forme, il serait possible d’établir une sorte de “typologie des plaisirs de lecture” où l’on verrait par exemple le fétichiste et sa manie du mot, du segment découpé ; l’obsessionnel et son attachement à la lettre ainsi qu’aux langages désincarnés ; le paranoïaque avec ses constructions retorses; l’hystérique qui “prend le texte pour argent comptant”, “se jette à travers le texte”... Relève de la perversion en général — dépassant par-là le "stade" du plaisir — le fait de proposer le plaisir comme fin en soi, et donc de remplacer le principe de production par celui de consommation. Car la consommation sans retenue ne va pas sans la destruction et aussi, paradoxalement, la conservation de l’objet concerné qui n’est autre ici que la langue ; une conservation qui n’est pas néanmoins une préservation mais au contraire une défiguration distraite ou acharnée, méthodique ou anarchique. Barthes utilise alors une métaphore qui s’impose à tous : “L’écrivain est quelqu’un qui joue avec le corps de sa mère (...). J’irai jusqu’à jouir d’une défiguration de la langue (...)”. La perversion subversive ou la subversion perverse va au-delà de la simple contestation formelle voire formaliste qui ne fait qu’inverser les valeurs établies ou s’inscrit naïvement dans la marche d’un “progrès”. Barthes cite alors comme exemple de “subversion subtile”, d’évitement radical de la norme, l’écriture de Georges Bataille dont il nous dit qu’il “n’oppose pas à la pudeur la liberté sexuelle, mais... le rire”. Du point de vue de la jouissance, opposé à celui de la connaissance ou même de l’“esthétique”, le critère majeur est celui de l’opposition entre l’exception et la règle, soit entre le Nouveau et l’Ancien. “Le Nouveau c’est la jouissance” écrit-il. Freud le pensait également à propos de la sexualité chez l’adulte. Mais l’exception ou l’excès peuvent prendre aussi la forme apparemment contraire de la répétition, de sorte qu’en réalité il faut compter deux catégories de “textes de plaisir” : ceux qui jouent sur la répétition à outrance, et ceux qui produisent les séquences les plus inattendues. “Dans les deux cas, c’est la même physique de la jouissance, le sillon, l’inscription, la syncope : ce qui est creusé, pilonné ou ce qui éclate, détonne”. C’est dans une certaine passivité, une posture de pure lecture, si l’on peut dire, que Barthes décèle la perversion. Celle-ci est incarnée au mieux, selon lui, dans la lecture tragique où “je prends plaisir à m’entendre raconter une histoire dont je connais la fin (...). Par rapport à l’histoire dramatique, qui est celle dont on ignore l’issue, il y a effacement du plaisir et progression de la jouissance”. Les textes de jouissance sont sans finalité, sans transitivité. Mais ici il nous faut distinguer le texte et la lecture, l’objet et le sujet — bien que l’écart soit justement des plus ténus dans ce cas. Pour que la perversion soit au niveau de la jouissance, au point de la définir, il faut considérer l’extrême perversité de ce qui est “toujours déplacé, extrême vide, mobile, imprévisible” et non les petits déplacements métonymiques de la perversion ordinaire. Autant dire qu’il s’agit d’une perversion fomentée par le sujet lecteur, totalement idéalisée et fantasmée, qualifiée de “pure” — il s’agit autrement dit du fantasme pervers d’un sujet névrosé. C’est la “textualité” qui est perverse tandis que la lecture se définit comme névrose, pendant que le “texte” est enfin laissé à son non-sens matériel. D’ailleurs Barthes décrit explicitement la lecture comme “engageant le rapport de la névrose lectrice à la forme hallucinée du texte”. Dans un autre passage, reprenant la thèse de Lacan selon laquelle le plaisir est dicible tandis que la jouissance non, Barthes met en balance et même en concurrence la position hystérique qui consiste à appréhender directement le texte par où il nous échappe, c’est-à-dire par le vide central de la jouissance qu’on ne peut affirmer qu’en l’habitant “en un plagiat éperdu", avec la position obsessionnelle qui se contente de réitérer à l’infini la lettre du plaisir, dans la citation ou la critique : non que l’obsession ne soit pas perverse à sa manière, mais elle n’affirme pas spécialement l’essence de la lecture qui n’est en rien réécriture ou production. L’ennui, la vacance, voire le “décrochage” sont des formes de la jouissance car ils ne résultent pas d’un accident de la lecture, ne sont pas dus au texte lui-même mais à une élaboration complexe qui conduit le sujet à cette approche négative de la jouissance (autant regrettée que désirée) qui est fondamentalement absence de plaisir ; c’est pourquoi il est dit que l’ennui “est la jouissance vue des rives du plaisir”. Reste cette dualité insistante des termes “plaisir” et “jouissance”, et à l’intérieur du plaisir les syntagmes “plaisir du texte”, “texte de plaisir”. Laissons Barthes s’expliquer d’abord : “ces expressions sont ambiguës parce qu’il n’y a pas de mot français pour couvrir à la fois le plaisir (le contentement) et la jouissance (l’évanouissement). Le “plaisir” est donc ici (et sans pouvoir prévenir) tantôt extensif à la jouissance, tantôt il lui est opposé”. L’ambiguïté porte donc sur le mot “plaisir”, et nous comprenons qu’il est certaines fois utilisé au sens de jouissance et d’autres fois au sens strict de plaisir. Conséquemment l’expression “plaisir du texte” signifie la jouissance tandis que par “texte de plaisir” on en resterait à l’économie simple du plaisir, et on devrait lui opposer la formule “texte de jouissance”. Sauf que justement Barthes ne le fait pas. Tout l’intérêt du livre de Barthes réside pourtant bien dans son titre : Le Plaisir du texte. Le “plaisir” et non la “jouissance”, alors que rien, aucun accroc de consonance ou de style, n’interdisait le choix de ce terme. D’ailleurs est-ce bien sûr ? L’emploi du mot plaisir, tout comme la référence en général au plaisir, ne sont-ils pas plus subversifs — plus jouissifs, par là-même, dans la logique de Barthes — que le concept ou le terme de jouissance ? Barthes ne prend-il pas comme un malin plaisir, au nom de la littérature et plus précisément de la textualité, à subvertir voire à contredire Lacan ? Le mot plaisir se suffit à lui-même, ne remarque-t-on pas “la force de suspension du plaisir” comme l’écrit Barthes lui-même, le fait que “le plaisir est un neutre (la forme la plus perverse du démoniaque)” ? Car tout neutre qu’il soit, éventuellement tout trivial qu’il soit, il ne présente pas moins la jouissance sous un jour insolent, d’une façon peut-être moins “classique” que ne le fait Lacan lui-même. La jouissance n’est pas seulement impossible. Il reste que l’interprétation “perverse” de la jouissance, omniprésente chez Barthes, reste un fantasme littéraire ; c’est la textualité qui est perverse. Le plaisir du texte n’est pas encore le plaisir et le texte de jouissance n’est pas la jouissance. Il ne saurait l’être d’ailleurs, bien qu’il y tende chez Barthes sous l’impulsion de la lecture. Mais le “texte” barthésien n’admet la jouissance qu’à travers le prisme de la littérature — fantasme névrotique cette fois. Interdiction de jouir du texte hors littérature, interdiction de la jouissance ou du plaisir en dehors du texte... Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 12, 2024 3:08 AM
|
Réjouissance, entre joie et jouissance, philosophie et psychanalyse
La philosophie, qui s’intéresse depuis longtemps à la joie comme une expression de la sagesse ou une qualité morale, évacue parallèlement la jouissance en tant que corporelle ; la psychanalyse, elle, fait grand cas de la jouissance (en tant qu’originellement nocive, il est vrai) mais évacue complètement la signification et la réalité de la joie. La philosophie traite les phénomènes de joie et de jouissance d’abord comme des problèmes, et la psychanalyse plutôt comme des symptômes ; d’un côté il n’y en a pas assez, il en manque, de l’autre il y en a trop et c’est suspect. Et pourtant, l’occasion de rapprocher Joie et Jouissance semble offerte par l’étymologie, puisque ces deux mots viennent du même verbe latin Gaudere qui signifie “se réjouir” : la “réjouissance” serait-elle donc le dénominateur commun, le point de convergence - voire de réconciliation ! - entre joie et jouissance ? La jouissance métaphysique, jouissance de l'être D'un point de vue métaphysique, de quoi jouit-on essentiellement ? De l'être. La jouissance est d'abord possession de son être et de soi-même, par le biais d'une maîtrise plus ou moins rationnelle. Les philosophies de l'antiquité assimilent au fond la jouissance et le bonheur, mais font peu de cas de la joie réduite à une simple allégresse. Dans l'optique chrétienne, l'être qui vraiment jouit et dont on jouit vraiment est le créateur lui-même, l'être cause de soi, qui jouit de sa propre perfection et des perfections qu'il donne. Dieu donne et crée par amour. D'où cette fois un lien entre jouissance et amour davantage qu'entre jouissance et bonheur (la jouissance n'est pas de ce monde, contrairement au bonheur). Il est clair également que l'amour pour la divinité comporte une joie synonyme de paix spirituelle, d'état dépourvu d'inquiétude, pouvant atteindre asymptotiquement - comme vision ou contemplation des choses divines - la béatitude. Joie et jouissance peuvent ici se confondre. Mais l'homme aussi est capable de perfections, d'acquérir des perfections, et c'est la raison principale pour laquelle il éprouve de la joie. C'est la thèse de Spinoza qui privilégie ce que Descartes appelait la "joie intellectuelle". Spinoza écrit : "La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection…”, indiquant par-là que c'est la connaissance, l'accroissement des connaissances qui procure la joie et non directement une perfection de ce type. On en restera longtemps à cette idée, en philosophie, que la joie n'est pas un état (fût-il profane comme le bonheur, ou mystique comme la contemplation) mais un mouvement dynamique, un transport de l'âme tout entière, à ce titre essentiellement passager. D'où une certaine déception quand même dans le sillage de la joie, dans la mesure où elle alterne avec des moments d'attente, de doute, voire de tristesse... Bref, si la joie (et/ou la jouissance car la distinction n’est pas décisive à ce stade) est une possession, elle reste inévitablement en défaut, car pour la pensée métaphysique l'homme se compare toujours avec plus puissant, plus jouissant que lui. La jouissance-usufruit Le point de vue moral et juridique contredit cette idée de possession. En morale, il est question de nos relations avec autrui. Tenons-nous en à un exemple, celui de l'amitié. Qu'est-ce que jouir de ses amis ou éprouver de la joie à cause d'eux ? On peut dire que cet amour consiste à se réjouir de leur présence, voire plus abstraitement de leur existence (ainsi que l'affirme Aristote). C'est conforme à la thèse qui associe jouissance et existence, mais l'on ne peut plus identifier jouissance et possession. En effet, selon Kant, l'amour du prochain en général et des amis en particulier se fonde moins sur le désir de les posséder (comme dans la passion amoureuse) que sur le respect d'une distance. Si je perds cette distance et ce respect, je perds mon ami. De même le prochain, pour rester prochain, ne doit pas être trop proche. Et il n'est pas question que je jouisse de mon prochain, qui est une personne morale, comme d'une chose. Il en va de même dans le domaine juridique où la jouissance se dit "usufruit". Ici le "droit de jouissance" entre en contradiction avec le "droit de propriété". Cela veut dire que l'on peut user d'un bien, en profiter, en bénéficier, mais qu'il ne nous appartient pas : il est interdit d'en abuser, de l'user irrémédiablement, de le détruire ou de le vendre. On a donc la satisfaction d'un bien sans en avoir la propriété. C'était déjà implicite dans le sens religieux : on dit que Dieu nous "prête" vie, et après cela on peut effectivement jouir de la vie, mais sans en disposer soi-même. De la même façon il est agréable de jouir d'une bonne santé, mais la vie peut nous la donner comme nous la retirer, sans crier gare. On trouve encore usage de cette jouissance-usufruit dans le langage amoureux ou matrimonial. Jusqu'au 18è siècle la femme est condamnée à être la propriété de quelqu'un, elle n'a pas de droits attachés à sa personne. Le premier propriétaire, avant le mari, étant le père. Ainsi le galant, le fiancé, n'a que la jouissance ou l'usufruit de la fille... ce qui, bien entendu, nous amène au sens proprement sexuel de la chose. Selon l'usage malgré tout le plus courant du terme, la jouissance c'est le plaisir, l'extase, voire précisément l'orgasme. Un renversement d'importance se produit : l'on passe en effet d'un sens objectif de la jouissance (où l'on jouit de quelque chose, le mystique jouit de Dieu, Dieu jouit de l'être, le galant jouit de sa fiancée) à un sens subjectif : c'est le sujet qui jouit (de son corps ou d'une partie de son corps). Il est évident que, historiquement, la jouissance physique s'est heurtée à la morale. Pour une raison résiduellement religieuse : c'est que l'homme n'est pas censé se comporter en propriétaire par rapport à son propre corps, encore une fois il n'en serait que l'habitant usufuitier. Le discours de la morale laisse entendre que la jouissance sexuelle, en tant qu'hédoniste, individualiste, si elle n'est pas strictement dévolue au besoin de l'espèce (selon un plan métaphysique au nom de Dieu ou au nom de l'Homme hypostasié) n'est pas une bonne chose et ne saurait apporter aucune joie véritable. Témoin la masturbation. Tout le monde s'y est mis pour la condamner : la religion qui y voit une forme de possession démoniaque ; la morale au nom des valeurs spirituelles et du tabou de la consommation, de la dépense gratuite ; et de façon plus hypocrite, la médecine qui pendant des siècles a diagnostiqué les pires maladies et les pires débilités pour ceux qui s'adonnaient à la masturbation (cela rend sourd, etc.). Cette hypocrisie médicale prend la forme d'un paradoxe, révélant bien les limites du discours de la science : comment la masturbation pouvait-elle passer pour contre-nature au moment précis où, scientifiquement, son caractère naturel et universel devenait parfaitement observable ? Parce que justement ce discours contient un impensé, plus exactement se fonde sur un refoulement (Lacan dira une forclusion) qui n'est pas sans rapport avec la pensée du sujet (Lacan y situera le cogito cartésien). C'est en partie contre ce discours (même s'il s'en réclame stratégiquement) que Freud avance son concept d'inconscient. Jouissance et inconscient Quelque chose change radicalement, en effet, avec Freud et la psychanalyse. Celle-ci ne s'intéresse pas à l'être, à l'homme, ou au monde en général, mais toujours à un sujet (un “cas”) particulier. Et précisément à ce qui ne va pas chez un sujet, notamment dans son rapport avec la jouissance ; il y va aussi d'une déperdition extérieure de "joie", cette fameuse "dépression" qui conduit le plus souvent les sujets chez un psychiatre ou un psychanalyste. Pour autant on va voir que quelque chose, en théorie, ne change pas : la jouissance reste globalement négative, non plus problématique mais symptomatique. Quant à la joie, il n'en est presque plus question — sinon indirectement à travers l'intérêt pour le mot d'esprit. D'ailleurs le psychanalyste (du moins dans l'exercice de sa fonction) n'est pas spécialement quelqu'un de "joyeux", c'est le moins que l'on puisse dire. Freud ne confond jamais la jouissance et le plaisir. Il y a un au-delà du principe de plaisir qui tient au fait que l'homme parle. Freud n'emploie pas vraiment le concept de jouissance, mais il explique comment dans ses expériences de satisfaction, l'être humain est toujours amené à rechercher la répétition. Or une satisfaction ne se répète jamais à l'identique ; entre la première et la deuxième fois il s'est glissé mentalement un signe, un symbole de l'objet désiré. Prenons le cas des soins qu'une mère apporte à son enfant. Celui-ci éprouve le plaisir de la satisfaction de ses besoins, mais il éprouve quelque chose en plus du fait que c'est sa mère, prévenante, aimante, parlante, qui le lui donne. La jouissance se situe à ce niveau. (Il en ira évidemment de même dans l'acte sexuel : la jouissance ne se distingue nullement par sa globalité par opposition à la localité du plaisir, mais comme ce qui provient de l'Autre ou ce qui a été ravi à l'Autre.) Si l'enfant veut se remémorer et ressusciter cette jouissance, et plus seulement ce plaisir, il faut qu'il en passe par tout un univers symbolique qui est apporté par la mère. De ce fait sa jouissance est totalement dépendante de cette mère qui fait figure de grand Autre absolu. D'une certaine façon on peut dire que la mère jouit de l'enfant : c'est sa chose ; et de fait elle imprime sur cette chose (d'abord par le toucher) des marques de jouissance indélébiles (toute une carte érogène qui sera à déchiffrer ou à lire plus tard... par d'autres). Mais l'on peut dire aussi que l'enfant jouit de sa mère comme d'une Chose absolue, ou cherche à en jouir absolument, indéfiniment. Or justement ce n'est pas possible, et même interdit. D'abord parce qu’ordinairement une mère ne s’en laisse pas conter, elle met naturellement un frein à ce désir, désir de jouissance transmué en demande d’amour. Surtout cette jouissance de l'Autre, de la Chose maternelle (au double sens du génitif, objectif et subjectif), reviendrait dans l'absolu à réaliser l'inceste. Cela existe chez certains animaux : on voit par exemple des femelles ravaler leur progéniture... Retenons, pour ce qui nous concerne, ce grand principe : on ne jouit pas de l'Autre — c'est-à-dire du corps de l'Autre — comme tel. Pas seulement de la mère : on ne jouit jamais complètement du corps d'un autre homme ou d'une autre femme. On n'a jamais vu ça, on ne voit pas comment. Sauf à le dévorer, donc. Or on sait que le cannibalisme même correspond à une pratique rituelle, donc symbolique (le cannibale ne "mange" son semblable ni par faim ni par plaisir, mais par croyance - ou perversion). La seule jouissance autorisée et possible sera donc filtrée par le symbolique : Lacan la nomme "jouissance phallique". Ce concept de Phallus indique que la jouissance de la mère est à jamais inter-dite par une parole, qu'elle provienne directement de la mère, du père ou de quiconque, ou mieux encore de l'échange entre ces derniers témoignant clairement que la (jouissance de la) mère n'est pas toute pour l'enfant. A un moment donné, il faut bien que la mère “nomme” le Père comme métaphore de son propre désir : c’est ce que Lacan appelle la “métaphore du nom-du-Père”. Evidemment "phallus" fait plutôt référence au père, et à l'homme en général, car c'est la mère qui est originellement désirée, donc le père qui dans le réel fait barrage à la jouissance. Mais sa signification reste d'abord symbolique, à savoir que la jouissance de l'Autre est toujours traversée, déviée, contrariée par le langage. Ceci a des conséquences sur la jouissance corporelle de tout un chacun. Comme on ne peut pas posséder l'Autre dans sa globalité, le corps de l'Autre est en quelque sorte découpé symboliquement et fantasmatiquement par le langage. La jouissance se trouve réduite à une partie du corps de l'Autre, mais aussi de son propre corps, en tant que fantasmée. Lacan appelle cela "objet 'a'" ou "plus-de-jouir" — "plus" parce que situé au-delà du principe de plaisir. Cela peut d'ailleurs prendre la forme d'une douleur, d'une souffrance que les psychanalystes repèrent dans le symptôme lui-même. Le névrosé, en général, s'interdit de jouir, mais il jouit surtout de s'interdire : c'est le corps (symptôme) qui fait les frais de cette contradiction. Réjouissance : réconcilier philosophie et psychanalyse ? Le point de vue analytique se complaît dans les affres d'une jouissance essentiellement divisée (entre jouissance phallique, plus-de-jouir, jouissance féminine...) et irrémédiablement perdue, ou indéfiniment repoussée. Cet a priori de la perte, plus important que la jouissance elle-même, en efface tout contenu de plaisir (puisqu'elle se situe par définition "au-delà", en excès par rapport au plaisir). Quant à la joie, elle se trouve dans ce contexte réduite à une simple manifestation d'humeur, accompagnant éventuellement les aléas de la jouissance phallique, plutôt "phaïllique" d'ailleurs... Ne pourrait-on compenser ce déficit de jouissance, patent en psychanalyse, par le caractère traditionnellement positif de la joie en philosophie, et retrouver, en associant les deux, le concept de réjouissance ? La réjouissance ne peut se laisser décrire comme interdite, névrosée, empêchée, fantasmée, etc. ; elle est réelle ou elle n'est pas ; on est réjoui ou pas. Mais, rappelons-nous, la joie au sens philosophique avait ce défaut d'être exagérément spiritualisée, idéalisée : la jouissance apporte une dimension corporelle. Extrapolons vers la notion d'un "corps joyeux" adéquate avec celle d'un corps expressif ou signifiant, si l'on admet que la joie est malgré tout expression, création, communication, comme dans la danse… Corps jouissant et créant (mais aussi souffrant), corps produisant et communicant sa propre joie. Joie de vivre, littéralement ! Elle se conjugue même, inutile de le nier, avec les “plaisirs de la vie” ; elle pourrait réconcilier la psychanalyse avec un hédonisme toujours à réinventer. La réjouissance pourrait ainsi se définir comme la joie du corps tout en comblant une double incapacité : d'une part celle de la philosophie à penser la joie comme corporelle, d'autre part celle de la psychanalyse à entendre la jouissance comme effective, et à préserver la joie. Didier Moulinier (Illustration : Jean-Baptiste Carpeaux, La Danse (1869), détail, Paris, musée d'Orsay)

|
Scooped by
dm
November 7, 2024 6:02 PM
|
La division spécifique du sujet pervers
« …C’est le sujet reconstitué de l’aliénation au prix de n’être que l’instrument de la jouissance. » (Jacques Lacan) Il ne suffit pas de dresser la liste des égarements polymorphes de la sexualité humaine pour parvenir au diagnostic de « perversion ». La psychanalyse freudienne, puis lacanienne, insiste sur le fait que la perversion est une position subjective au même titre que la névrose ou la psychose. Énumérons les quatre découvertes freudiennes à ce « sujet » : 1° distinction de la pulsion, de l’objet pulsionnel, et de la perversion (1905, 1915) ; 2° prépondérance du fantasme dans la perversion, en tant que nouage du sujet et d’un point de jouissance (1919) ; 3° la perversion n’est pas une question, mais une réponse, à la différence de la névrose et notamment de l’hystérie : autrement dit, la perversion n’est pas un symptôme (1920) ; 4° la fin de l’œuvre freudienne isole un mécanisme psychique inconscient où le sujet dit non à la castration, la verleugnung, terme traduit par « déni » ou « désaveu » : le sujet pervers est divisé de façon spécifique (1927). Si la catégorie de « sujet » se déduit de l’œuvre freudienne, elle n’y est pas formée : elle apparaît chez Lacan comme sujétion au signifiant, et c’est cette sujétion que refuse le pervers, en même temps que la castration de l’Autre. Lacan montre comment le sujet pervers se « reconstitue de l’aliénation » en ne se référant qu’à un signifiant-maître (S1), auquel il s’identifie, et en se figeant dans la rigidité de l’objet, son « être », qu’il voue à la jouissance de l’Autre. Le fétiche sera construit à partir de cette coalescence du S1 et de l’objet. Des deux opérations d’où surgit le sujet chez Lacan, l’aliénation et la séparation, le pervers se pare et même se remparde de la seconde. Contrairement au névrosé, il choisit l’être plutôt que la pensée, ce qui ne l’empêche pas d’être un sujet, même si c’est un sujet pétrifié. La division, c’est chez l’Autre, qu’il prétend la causer, afin de pouvoir restaurer la plénitude perdue et se faire l’instrument d’une jouissance auquel il s’identifie lui-même. Il prétend être un serviteur, dans ce sens-là effectivement “sujet”, de la jouissance. Didier Moulinier
|

|
Scooped by
dm
December 3, 2024 9:28 AM
|
Le secret partagé du pervers
La jouissance perverse, dans la mesure où elle admet sans l'admettre la loi du désir comme désir de l’Autre, ne se déploie convenablement que par l'effet d'une médiation d'un tiers complice. Celui-ci est convoqué comme témoin d'une possible et avantageuse transgression de la loi. A la différence de l'obsessionnel qui complote (et jouit) dans la solitude de son fantasme, le pervers a besoin du regard de l'Autre qui n'est jamais qu'une transposition de la figure maternelle. Comment parvient-il à le compromettre, à le piéger au point d'en faire un véritable complice ? Au moyen du secret partagé : réduire le témoin au mutisme et à l'immobilité du simple fait qu'il sait quelque chose d'essentiel sur l'autre et que l'autre sait qu'il le sait, le condamner à faire comme s'il ne sait pas. Du fait que le secret porte sur la transgression de la loi, doublement inavouable, son ressort n'est plus la confiance mais la culpabilité. Il est possible que certains pervers tentent de piéger le psychanalyste un peu trop docile, un peu trop écoutant, vite prisonnier de son devoir de réserve et, du point de vue du pervers, complice impuissant des méfaits perpétrés. Le pervers et l'analyste partagent ainsi le savoir d'une tromperie qui fait fonds sur l'illusion de tout savoir concernant la loi : tous coupables d'ignorer l'ineptie et la fausseté de la loi paternelle ! Le pervers n'a de cesse d'exiger l'aveu même de ce désaveu, de la part de victimes transformées en complices. S'il opère au nom d'une quelconque loi du père, le psy est donc d'emblée supposé trompé et par-là même (c'est la conviction du pervers) trompé-trompeur, c'est-à-dire complice. Il faut donc désamorcer le piège et rester sourd à la supposition, à la révélation victorieuse (dont jouit le pervers) de la tromperie, en admettant que la loi a toujours déjà été trompée (mais non tromperie elle-même), pervertie (fût-ce par le père, mais non perversion comme telle), et c’est pourquoi elle doit opérer.

|
Scooped by
dm
December 1, 2024 12:48 PM
|
Dérives perverses en analyse
L'analyse convient-elle au cas du sujet pervers et peut-elle lui être utile ? N'y a-t-il pas, inhérent à la situation analytique, un risque de dérive perverse, dont le sujet pervers lui-même pourrait être la première victime ? Rappelons que si l'art psychanalytique consiste bien en une transmission de désir, de l'analyste à l'analysant, il faut supposer un désir spécifique, inhérent à la position de l'analyste. Selon Lacan, le désir de l'analyste est d'amener un sujet à produire le signifiant auquel il pourrait s'assujettir, afin de donner sens - jouis-sens, plus exactement - à son symptôme. Choisir son symptôme, l'assumer, l'affirmer - tel est ce qui motive en règle générale la demande du sujet pervers en analyse, et ce qui lui est le plus souvent proposé. Or cela ne peut être qu'une demi-solution, car dans le cas du pervers il ne s'agit pas de n'importe quel symptôme, il s'agit du fétiche. L'on ne peut que constater une analogie entre la fin de l'analyse, savoir y faire avec son symptôme, et le savoir-faire avec la jouissance qui caractérise le pervers. Le pervers et l'analyste ont ceci en commun d'occuper une position qui est celle de la cause, cause de la jouissance dans un cas et cause du désir dans l'autre. Mais dans les deux cas, pour parvenir à ces fins, il est nécessaire de provoquer une division du sujet. Or si la division du sujet par le signifiant ne laisse pas émerger, précisément, le signifiant du désir, le sujet pervers ne tardera par à profiter de la situation. Il faut comprendre qu'un pervers n'est pas seulement une personne (éventuellement) coutumière des passages à l'acte, mais que son acte pervers consiste bien plus souvent dans la mise en acte et en publicité de son fantasme dans son discours : la jouissance du dire apparaît ici sans limite, car une fois le pervers lancé dans le récit de ses fantasmes, dans le fil d'une cure, il est bien difficile de l'arrêter. Indépendant de la structure du sujet analysant, le risque de dérive perverse de la situation psychanalytique est inhérent à la nature même du transfert qu'elle met en place. Le transfert consiste en la supposition que le patient fait à son analyste de détenir un savoir répondant aux questions qu'il se pose. Or le savoir ne suscite aucun désir véritable (il n'y a pas de désir de savoir), mais seulement de l'amour, et l'on sait les dérives identificatoires que l'amour peut entraîner. Il serait donc extrêmement dommageable que l'analyste s'identifie ostensiblement à ce sujet supposé savoir ! Car un savoir, cela se jouit. La dérive perverse en analyse se produit lorsque, pour résoudre les symptômes du patient, pour annihiler l'angoisse que la situation analytique génère inévitablement, l'analyste se propose lui-même comme jouissant. Il peut alors, soit jouir de la division du sujet et faire jouir le grand Autre de la psychanalyse elle-même, soit partager cette jouissance avec le patient, lequel pensera alors avoir trouvé chez son analyste un modèle, un maître, un ami qui lui veut du bien, dans tous les cas dépositaire d'un savoir certain sur la jouissance. Bref l'analyste n'est pas censé jouir de la situation, ce n'est pas pour rien que son salaire (le prix de la séance) est là pour borner sa jouissance ! Dans le registre de la confusion du pathos et du logos, et comme exemple de dérive perverse de la psychanalyse, on ne peut pas ne pas évoquer le cas de Ferenczi. Celui-ci avait inventé un style d'analyse dont la finalité s'affichait clairement comme une volonté de tout dire, comme un épuisement du dire commun de l'analyste et de l'analysant - exactement comme dans le récit sadien, où le bourreau et la victime n'en finissent pas de jouir et de souffrir, sont perpétuellement rappelés à cette tâche. L'analyse selon Ferenczi est une véritable torture, aussi bien pour l'analyste que pour l'analysant, même si apparemment la cure prend une tournure plus compréhensive, voire franchement affective, entre les deux partenaires (Ferenczi va jusqu'à parler d'"analyse mutuelle"), qu'avec une cure freudienne classique. Il est clair que Ferenczi eut à souffrir de l'inachèvement de sa cure auprès de Freud et de l'"insensibilité" de ce dernier à l'égard d'une demande (d'analyse, d'amitié, etc.) devenue envahissante. Il est probable que son entêtement à innover dans une direction si manifestement opposée à celle du maître comportait une part de défi et aussi de dépit, à cause même de l'inflexibilité de Freud. Alors Ferenczi reproduit sans sa relation avec ses patients le complexe non résolu avec Freud, sur un mode sado-masochiste. Il se présente comme victime de ce dernier mais également se voudrait son bourreau en tentant de forcer son fantasme, en lui faisant avouer ce qui restait non-dit de son transfert inachevé avec Fliess. A l'égard de ses patientes, il adopte une attitude à la fois active et passive ; il éponge au maximum la souffrance de celles-ci, et, au nom d'un amour qui ne doit connaître aucune limite, qui se doit d'être pur et passionnel, se livre pratiquement à des abus sexuels sur leurs personnes. Ferenczi imagine que l'amour et la compassion sont des vertus essentiellement féminines, et il identifie l'analyste à cette faculté de recevoir la souffrance d'autrui et de la transmuer en jouissance mutuelle. L'analyste occupe la place première et fondamentale de la mère qui se laisse dévorer et sadiser par ses enfants ; au-delà, c'est également la place de l'enfant sadique et cannibale, puisque l'analyste selon Ferenczi ne doit pas lâcher l'analysant (avant la "guérison complète", et que "tout soit dit"), et donc va le disséquer à vie. On ne peut être plus éloigné de la conception lacanienne de la cure qui, s'appuyant sur la réalité de l'inconscient, tient à marquer le caractère indépassable du semblant qui caractère le signifiant et son usage. Si l'analyste doit occuper la place de l'objet (a), ce n'est certainement pas pour confondre celui-ci avec une présence venant combler tout manque, ce n'est pas pour le confondre avec la Chose maternelle. Il importe également de souligner le caractère irréductible du fantasme sous-tendant le désir de l'analyste, lequel ne saurait être un désir pur, et encore moins un désir de pureté. En réduisant la Chose à l'objet (a) comme plus-de-jouir, reste d'une jouissance mythique, Lacan-analyste adopte la position de la femme pas-toute, de la Femme en tant qu'elle n'existe pas, même si c'est sous le masque du Père - du "sinthome" selon le mot de Lacan - qu'est présentifiée l'incomplétude de la Femme.

|
Scooped by
dm
November 29, 2024 5:10 AM
|
L’écrivain, la mort et l’empereur
Chez certains sujets, l’approche ou plutôt l’évitement de la castration s’effectue par une série de rituels redoutablement précis destinés à célébrer la puissance autodestructrice du désir. Exceptionnellement, il arrive que le schéma sacrificiel fantasmatique soit exécuté dans le réel. L’on pense notamment au suicide spectaculaire et longuement prémédité de l’écrivain japonais Yukio Mishima qui, dans un comble de mise en scène et de théâtralité morbide (éventrement et décapitation), réalise en 1970 l’aboutissement logique d’un long processus tendant à réduire le sujet à un objet inerte, un objet cadavre. Cette mort, sacrifice suprême dédié au grand Autre (figuré par l’empereur), se veut la réalisation du désir absolu de celui-ci, et doit pour cela revêtir un masque phallique irréprochable, c’est-à-dire que sa seule justification réside dans sa perfection et sa beauté formelle. Représentation d’une virilité idéale et parfaite, incluant un authentique passage à l’acte. Car au-delà de la simple provocation, le suicide doit être réussi ; c’est par ce paradoxe que le sujet affirme sa virilité en se vouant à la gloire du grand Autre. Les motifs symbolisant le phallus sont ici le sabre, réellement planté dans les entrailles de l’homme se faisant hara-kiri, et enfin sa tête décapitée. Risquons un rapprochement avec l’œuvre célèbre de Jean Genet, Le Condamné à Mort, texte qui fait équivaloir la condamnation capitale par la guillotine à l’assomption de la virilité chez le héros. Dans l’attente de son exécution, celui-ci devient une sorte d’objet sacré, de repère absolu, à l’écart dans sa cellule. Il y a quand même une grande différence entre les deux écrivains, et ces deux manières de célébrer une virilité autonome et narcissique, loin du regard de toute féminité : chez Mishima, l’écrivain n’est point parvenu à métaphoriser le fantasme sacrificiel et le processus d’abjection, qui devaient donc conduire le samouraï (ou sa parodie) à l’incarner et le réaliser sur sa propre chair ; tandis que Genet est parvenu à faire de l’écriture une prison comparable à celle d’un condamné à mort, et a pu ainsi éviter le meurtre (selon son propre aveu), sur lui-même ou sur d’autres. Par son caractère ascétique et solitaire, l’écriture semble le dernier refuge d’une virilité aux abois, relayée ensuite par le théâtre comme métaphore d’un semblant encore plus universel. Néanmoins, qu’il s’affiche dans la réalité ou dans la fiction, le fantasme reste identique et induit la même stratégie existentielle : il s’agit de combiner une déchéance constituant la part réelle de jouissance, avec la quête d’une virilité idéale redonnant un semblant d’identité au sujet. Autant dire concilier « être le phallus » et « avoir le phallus ». On ne s’étonnera pas que le corps tout entier se trouve phallicisé, par exemple à travers le culte d’une musculature fantastique, ou bien qu’il soit le théâtre d’opérations sado-masochistes jouant sur le registre de l’imaginaire (plus ou moins réalisé) une castration impossible à établir dans le symbolique. Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 28, 2024 11:43 AM
|
"Se débarrasser de la psychanalyse" - Vraiment ?
Commentaire particulièrement abruti mais caractéristique de l'époque, en-dessous d'un message de ma part posté sur X (ça m'apprendra, en même temps !) où il était simplement question de psychanalyse, un monsieur écrit ceci : "La France est le seul pays au monde où la psychanalyse n'est pas complètement déconsidérée, et pourtant l'on ne parvient pas à s'en débarrasser." Outre que la première affirmation est factuellement fausse, cela méritait quand-même une petite réponse. Ceux qui aujourd'hui condamnent avec véhémence le discours psychanalytique, qui veulent littéralement sa mort, qui réclament notamment à cor et à cri son bannissement des institutions de soin et de santé "mentale"(*) au nom d'un nouveau scientisme incroyablement revanchard et servile comme jamais à l'égard des maîtres capitalistes (lobbies pharmaceutiques notamment), ceux-là sont très exactement dans la position des faux prêtres athéniens de la fin du Vè siècle avant J.-C - soi-disant gardiens des dieux de la cité mais surtout corrompus jusqu'à la moelle - qui ont fait condamner Socrate, qui ont saboté du même coup la démocratie parce que, par pur obscurantisme, ils ont voulu tuer dans l'oeuf le discours de l'individu (qui n'était autre que le discours de la raison). Socrate qui, tel le psychanalyste déposant son moi et se faisant objet-déchet, pour permettre l'éclosion de la parole de l'autre, affichait (malicieusement, lui) son non-savoir pour permettre à son interlocuteur d'articuler ses propres raisons. Toujours le même fascisme rampant, la même servilité irrationnelle de ceux à qui il faut un maître-sachant, et qui refusent d'entendre ce que l'autre, prétendument ignorant, aurait à dire. Ce maître, qui ne voit clairement aujourd'hui qu'il s'agit du discours capitaliste (croissez ! dépensez ! jouissez !) adossé au discours de la science (ou pire, son dernier avatar, sa créature infernale, le discours de l'IA) ? Or le drame du discours psychanalytique est de ne pouvoir lutter à armes égales contre ses adversaires. C'est que son éthique lui enjoint de taire sa raison, à un double titre : dans la conduite de la cure d'abord, où le savoir rationnel (théorique) est bien là côté analyste, guidant le procès, mais inexprimable comme tel pour laisser l'analysant déployer le sien propre ; dans le débat d'idées ensuite, il est retenu par une sorte de pudeur, car dans la sphère publique ce discours profondément "individuel" (voire intime) n'existe tout simplement pas en-dehors de la situation analytique. Par définition l'analyste ne peut pas rendre "publique" son expérience, ses procédures et ses résultats, les "preuves" "scientifiques" de son efficacité qu'on lui réclame à cor et à cri. Cela se fait certes, mais dans le cadre (là encore privé) du "contrôle" ou bien celui, restreint, des journées d'études entre pairs. Certes la théorie peut être exposée, à la manière universitaire, mais, malgré une cohérence que pourrait lui envier nombre de sciences humaines, malgré le niveau de qualification généralement élevé de ses écrivants et communicants (docteurs, agrégés, etc.), elle n'a aucun pouvoir de persuasion en tant que telle auprès de ceux qui sont convaincus par avance de son inanité. Enfin, si je ne risquais de heurter nombre de gens (à l'heure où l'Etat d'Israël est lui-même, aujourd'hui, aux mains d'une clique fascisante, et commet des crimes de masse impardonnables) faute d'avoir le temps de développer suffisamment, je pourrais dire pourquoi ce discours violemment anti-psychanalytique me parait évidemment en phase avec l'anti-sémitisme décomplexé qui revient et qui s'affiche un peu partout, dans tous les milieux, pas tant au sein d'une certaine gauche française - dite "radicalisée" par les radicalisés de droite ! - que précisément partout dans l'opinion commune, de façon larvée et dissimulée - ce pourquoi je n'hésitais pas à parler plus haut de fascisme ordinaire. Tant il est vrai que la psychanalyse est, au moins dans ses origines, une "affaire juive", mettant l'altérité au coeur de l'humain, une affaire qui n'a pas fini de rester en travers de la gorge des identitaires de tous poils, de tous les pays et de tous les milieux. (*) En raison des supposés "dégâts" qu'elle causerait, notamment auprès des enfants qu'elle aurait le vice de "sexualiser" à outrance, alors qu'à leur sujet elle parle de pulsions et non de sexe, qu'elle ne cesse de critiquer les représentations naïves du complexe d'Oedipe (non, l'enfant ne veut pas "coucher" avec sa mère, il n'a aucune idée de ce que ça peut vouloir dire !), ou bien auprès des autistes et de leurs familles qu'elle aurait le vice de "culpabiliser", vieille rengaine, alors qu'elle est la seule à proposer quelque chose en terme d'accompagnement, de conquête d'autonomie et de parole, et que son but a toujours été au contraire de responsabiliser pour justement éviter de culpabiliser. Mais bref, les critiques ignorent généralement tout de la théorie comme de la pratique psychanalytiques réelles, parfois ils ignorent même ou feignent d'ignorer son évolution considérable depuis Freud, car justement cela permet de la réduire à ces "freudaines" obsolètes...

|
Scooped by
dm
November 26, 2024 4:13 AM
|
Sublimité et nocivité de l’oeuvre
Que voulait dire Lacan en affirmant : "Toute œuvre est par elle-même nocive" (L'éthique de la psychanalyse p. 148) ? Sans doute s'agissait-il surtout d'accorder à une praxis la dignité d'un style, de montrer que si l'éthique de la psychanalyse consiste à "ne pas céder sur son désir", elle rejoint la création artistique sur le fait de ne pas céder à la jouissance de la Chose, tout en la provoquant dangereusement. La notion de "nocivité", pour négative qu'elle paraisse, évite le leurre des visées utilitaristes (où la demande émane de l'Autre social exclusivement) en articulant fermement l'Autre, le Sujet et la Chose. La Chose est l'objet originel du désir, le signifiant même de la jouissance (sauf qu'il est creux, comme la Chose matériellement est vide). Il vient en excès sur l'objet-cause proprement dit. Par exemple, pour l'amateur d'Opéra subjugué par la voix de la Diva, la Chose sera représentée par le point limite où la voix, au plus sublime du chant, pourrait céder, casser ou trébucher dans un paroxysme d'émotion. Le "plus-de-jouir" que produit pareille effraction dans le système de la représentation n'est que le pendant d'une version ou d'une modalité plus essentielle de la Chose : la perte de jouissance, imposée à qui parle, du fait de la résistance inéluctable d'une partie du vivant à la symbolisation, provoquant cette réserve libidinale qu'est la "Chose". La Chose prend donc subjectivement le statut d'un "intérieur exclu". Alors que se passe-t-il dans la création et dans la sublimation en général ? La sublimation, est-il dit, élève l'objet à la dignité de la Chose. Le terme de "dignité" révèle bien qu'il s'agit d'un leurre, d'une qualité et non d'une réalité : en effet l'objet (la beauté du chant ou du tableau) reste à jamais un substitut de l'inaccessible Chose. Où est donc la "nocivité" du procédé ? Dans le fait que toute création produit néanmoins un vide, une fêlure conjoncturelle branchée sur la division originelle du sujet. A la différence du fantasme, qui joue la place du corps propre dans l'imaginaire en tant qu'objet de jouissance de l'Autre, la sublimation fait représenter cette jouissance par des objets considérés comme sublimes, auquel le sujet doit pouvoir s'identifier - toujours dans l'imaginaire - au titre de sa propre image idéale. La sublimation impose ce passage de la libido d'objet à la libido narcissique, afin que le sujet se "réalise" (comme on dit) dans ses œuvres, ou dans la contemplation de celles d'autrui. Elle semble pervertie dès l'origine par cette volonté de recréer la Chose à travers une communion de l'artiste et de l'œuvre, narcissisme culturel dont participe également le public. Inévitable, mais aussi indispensable nocivité de l’oeuvre. Autre façon de rappeler que tout art est intrinsèquement, mais salutairement, subversif. Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 23, 2024 6:05 PM
|
Eloge de l'hystérique, politiquement et poétiquement incorrecte
L'hystérie est "perverse", non seulement parce qu'elle s'accompagne d'une part de fantasmes non négligeable, mais surtout dans le sens où elle met en scène une forme de transgression et une remise en cause de l'ordre social. C'est bien ce qui se passe dans la tragédie de Phèdre qui incarne presque l'archétype de la Passion féminine devenue passion pour la femme. Mais cette passion fait symptôme, comme on l'observe dès le 17è siècle, tant sur la scène théâtrale que sur la scène médicale. La Phèdre de Racine érige le symptôme, autre nom de la passion, à la dimension du tragique : cela a pour effet de muer une première faute impossible à symboliser, devenue symptôme, en une seconde transgression que constitue la puissance dévastatrice d'un certain langage, celui de la tragédie. Dans le même temps, en cette deuxième moitié du 17è siècle, les femmes "malades" de leur passion ne sont plus considérées comme des sorcières ou comme des possédées, responsables dans un cas, victimes dans l'autre, mais précisément comme des "hystériques" (le terme connaît alors un regain d'intérêt) dont le symptôme passionnel relève d'une relation perturbée entre l'âme et le corps. Le médecin anglais Sydenham trace un premier tableau clinique de cette maladie spécifiquement féminine qui se déclenche le plus souvent à l'occasion d'un "chagrin" : la catégorie des troubles "psychogénétiques" est née. Tout en détaillant les aspects somatiques, il insiste sur les manifestions psychiques et morales telles que l'abattement, le désespoir, la haine ou la jalousie… Dans le cas de Phèdre, la filiation féminine du mal semble avérée ; les symptômes physiologiques ainsi que la "dépression" mélancolique sont amplement restitués. C'est le corps qui se plaint et s'afflige, s'épuisant à soutenir le désir dans sa pureté d'origine, au-delà des mesquineries de la vie ("Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire"). Or ce désir et cette passion ne visent nullement leur satisfaction. La perversion réside dans ce détournement ou cette transgression, lorsque le dire - l'aveu - de la passion se substitue à la passion. L'Autre réel (Hippolyte), objet du désir, est surtout désigné comme cause de la passion et donc responsable des maux occasionnés. Le corps hystérisé et monstrueux de la passion se veut pure exhibition destinée à culpabiliser l'Autre. "Regarde ce que tu as fait de moi." En exhibant et en victimisant ce corps féminin, l'hystérique fait-elle autre chose que renvoyer à l'Autre l'image insupportable de la castration, pour le confondre et pour le posséder tout à la fois ? C'est sa propre haine de la castration, voire sa profonde misogynie qui la pousse, dans un parfait jeu de miroir, à castrer son partenaire en décochant sur lui les flèches de sa plainte. La parole qui exprime à ce point le désir est plus que pathétique, elle est tragique et transgressive, scandaleusement subjective, car elle perturbe l'ordre social et les règles du langage en faisant entendre un discours excessif, hors du commun. L'hystérique joue la passion incestueuse contre les échanges familiaux traditionnels, où la femme apparaît comme un bien symbolique dans le système patriarcal (incarné par Thésée). Elle apparaît monstrueuse dans ce système et révèle en même temps la monstruosité du système (la nouvelle de la mort de Thésée a pour effet de libérer la parole transgressive, l'annonce de son retour entraîne une répression hypocrite et injuste), dont elle ne peut pas s'affranchir complètement. Il faut bien admettre que ces aspects "politiquement incorrects" et surtout "mauvaise langue" de l'hystérie n'acquièrent leur pleine dimension que dans l'art et la littérature. La "passion" de la langue exhibée dans tous ses états remplace avantageusement les souffrances du corps réel. Encore faut-il, pour pouvoir parler de perversion et donc de transgression, que la fétichisation de la langue (ou plutôt de la "lalangue" du sujet, pour reprendre Lacan) soit suffisamment effective pour s'affranchir de toute expressivité ou représentativité "normales" à l'égard du réel. Aujourd'hui, ce n'est plus la tragédie mais la poésie (en tant qu'expression a priori absolument libre et abord résolument matérialiste du langage) qui peut supporter une telle fonction transgressive, car elle seule défait et repousse assez loin les codes sociaux de la jouissance. Et cela fait consensus : "La poésie est un chant dont on n'a pas l'habitude" disait le philosophe conservateur Pierre Boutang. Elle est même "inadmissible" proclamait l'écrivain avant-gardiste Denis Roche. De fait, aujourd'hui la poésie est devenue inaudible et inacceptable, spécialement la "contemporaine" (paradoxalement) et c'est bon signe. Elle suscite, presque viscéralement, la haine elle-même verbeuse du fasciste ordinaire. Nous pensons que la poésie la plus formellement et donc aussi la plus politiquement transgressive se manifeste concrètement dans les performances visuelles et sonores, la poésie-action. L'évanescence de cet art possède l'avantage considérable de laisser entendre, ou voir, que si le poème concret est jouissance - jouissance à lalangue - il ne saurait exister quelque part de jouissance - même esthétique - absolue. Le poème-fétiche - c’est souvent le corps du poète lui-même, dans la performance -, se présentant comme événement non pérenne, monument dérisoire, se substitue lui-même à ce fantasme, là où le poème littéraire classique, le poème-livre, fétichisé comme tel, tend à le faire perdurer. Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
November 19, 2024 12:17 PM
|
Singularités... sans subjectivité (humeur)
“ L’enfant est toujours responsable, et capable de faire des choix dès la naissance. Il en résulte qu'il n'y a ni de "bonne" ni de "mauvaise" mère (inventions de psychos à la manque), pour le père c'est itou, mais c'est plus difficile à expliquer. Responsable, stricto-sensu cela veut dire trouver des réponses. Pour ne pas rester fixé à des traumatismes dont on n'est pas la cause. C’est pourquoi je maintiens que l'enfant est responsable pour autant que cela signifie qu'il a des ressources que les dits "adultes" irresponsables ne veulent pas lui reconnaître. Il y en a cependant qui ne parviennent pas à s'en sortir, hélas. “ Patrick Valas, psychanalyste (extrait d’un échange sur ma page fb il y a 10 ans) J'aime beaucoup cette idée : se savoir responsable pour ne pas se croire coupable de traumatismes dont on n'est pas la cause. A part notre naissance, on est responsable de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est - mais pas de ce qu'on nous a fait, c'est là l'essentiel. Mais je crois que cette idée, notre époque (devenue foncièrement complotiste : nous serions manipulés de partout) n'en veut plus. Par un retournement spectaculaire, l'idée même d'autonomie (même et surtout sur la base de l'inconscient) est devenue plus haïssable encore que celle de la Maîtrise. A part la psychanalyse, qui ose tenir un discours de la responsabilité, qui ne soit pas culpabilisant ? Plus généralement je réalise à quel point l'époque actuelle, par contraste notamment avec le milieu du 20è qui fut si fécond dans tous les domaines, manque terriblement ...d'esprit ! C'est fascinant à quel point nos contemporains sont devenus à ce point imperméables, bouchés, voire franchement hostiles à toutes ces histoires de désir et d'oedipe, de sujet et d'inconscient, etc. et ne veulent tout simplement plus en entendre parler. Tout ce qui pourrait laisser entendre que, par sa subjectivité, l'individu serait partie prenante, a minima co-responsable (donc : capacité de trouver des réponses) des choses qui lui arrivent, le révulse et l'indigne, lui paraît injuste et scandaleux - tellement l'obsession victimaire a envahi toutes les sphères de la pensée commune. On revendique à outrance toutes sortes de "vulnérabilités" (c'est le terme clef) comme autant de singularités, jusqu'à s'auto-essentialiser (ce qui est pour le moins paradoxal), selon une nouvelle mode qui comme comme asexuel, qui comme hypersensible, qui comme autiste, etc. etc. On voit de plus en plus ces signifiants fonctionner comme autant de "statuts" permanents, et revendicatifs, sur les réseaux comme X ou Instagram, mais : sans la subjectivité ! C'est exclu, parce que subsisterait alors un zeste de responsabilité, ce dont on ne veut plus. Pour évoquer ma tendance à la procrastination, par exemple, je dirai "atteint de procrastination", car naturellement c'est une "maladie", donc en attendant les "progrès de la recherche scientifique" (qui finira par établir un lien entre le dysfonctionnement des amygdales et la procrastination - je dis ça complètement au hasard, j'en sais rien, tout est possible -, et de conclure que des labos (privés) ont bon espoir de trouver rapidement la pilule miracle), eh bien on se flatte de ces nouvelles singularités, on les revendique haut et fort, c'est une nouvelle forme de narcissisme. Pendant ce temps les sciences humaines et les sciences de l'interprétation en général ne jouissent plus d'aucun crédit, sont discrédités dans tous les sens du terme, et l'on s'énerve même beaucoup qu'elles puissent continuer d'exister. C'est le cas pour la psychanalyse, justement parce qu'elle refuse toutes ces étiquettes, ces pseudo-essences, ces mots de ralliement qui ne sont pas des concepts mais des concentrés d'ignorance et de confusion (le plus joli étant "pervers narcissique", qui ne veut absolument rien dire) ; la psychanalyse, ses propres catégories n'ont d'existence et de valeur que par rapport à des structures langagières, logiques, avérées comme telles - l'échange verbal étant la "réalité humaine" la plus difficilement contestable, me semble-t-il. Mais récemment sur X, un jeune diplômé en "philosophie de l'esprit" (à l'américaine) se réjouissait paradoxalement des avancées "fulgurantes" des "neurosciences" et annonçait, péremptoire, qu'on allait bientôt pouvoir SUPPRIMER la psychologie ! On croit rêver. Chacun est donc suspendu à ce que ces fameuses neurosciences pourront bien nous sortir de révolutionnaire (en réalité il n'en sort pas grand chose d'utile, et pour cause, du point de vue éthique de la conduite de la vie !), et ainsi nous dispenser de creuser par nous-même, c'est-à-dire en exploitant d'abord le formidable bagage littéraire, philosophique, artistique, religieux de l'humanité, mais d'abord et surtout notre propre trésor intime et personnel, notre propre histoire (à rebours de ces piteuses tentative d'auto-essentialisation que j'épinglais plus haut) - bref autant de savoirs inépuisables. Je n'ai rien contre la science, je crois volontiers en ses vérités... relatives et provisoires, mais justement il est d'autres dimensions du savoir qui m'importent tout autant, et qui m'apportent des vérités, comme dit Kierkegaard, "qui me concernent".

|
Scooped by
dm
November 9, 2024 5:32 PM
|
Le chant divin (diabolique ?) de la jouissance
La religion – en particulier chrétienne et islamique – a toujours vu dans la voix humaine un objet de fascination relevant tour à tour du divin et du diabolique, inspirant à la fois un profond respect et un sentiment d’horreur. C’est que derrière le lyrisme, avant la beauté musicale de la voix, se trouve la voix tranchante du Père et donc la loi entrant directement en concurrence avec la jouissance (réputée plus féminine, maternelle ?) du chant. Les religieux se partagent donc en deux écoles, car s’il faut célébrer Dieu avec le « cœur » (i.e. l’esprit), chanter ses louanges dans son cœur, la question se pose de savoir si la voix doit participer réellement, physiquement, de ce chant. Le camp qu’on pourrait appeler intégriste ou dogmatique ne veut « entendre » que la voix pure, purement intérieure et spirituelle, divine en fait, tandis que dans une tradition plus mystique (mais non moins intégriste sous certains aspects) on pratique le chant lyrique comme un moyen de « rejoindre » Dieu. On voit ainsi s’opposer le parti de la rigueur et celui de la transe, aussi bien chez les chrétiens (Saint Jérôme contre Saint Ambroise) que chez les islamistes (légalistes contre soufis). Évidemment, les partisans du lyrisme eux-mêmes n’ignorent pas les dangers inhérents à leur pratique, le risque de confondre transe mystique et possession démoniaque. Une position médiane (celle de Ghazali, par exemple) consiste à poser ensemble la voix divine et la visée du chant mystique dans la perspective d’un inaccessible silence, signifiant de la présence divine. Au pire, le lyrisme représente un adjuvant pour la méditation et la prière dont on peut se passer, au mieux il métaphorise la dimension d’excès de la parole et amorce une relation fusionnelle avec le divin. Les puristes, comme les partisans du lyrisme et de la transe, assimilent donc le chant et la jouissance du divin : l’amour de Dieu est chant et la foi se fait lyrisme. Bien plus, la musicalisation du divin correspond à sa féminisation : séduction diabolique pour certains, élévation vers la pureté et le mystère pour d’autres (ce qu’atteste, bien entendu, le culte marial chez les chrétiens). Le champ de la jouissance semble donc réellement porté par le chant comme jouissance féminine du divin. Si l’on rapporte au féminin la jouissance lyrique des mystiques (à laquelle n’est pas étrangère, dans un autre domaine, celle des amateurs d’Opéra, ces mystiques du lyrisme vénérant la Diva), à l’inverse la jouissance diabolique (méphistophélique) se signifie dans la parole réduite à son articulation pure – effet de la gravité extrême de la voix qui tend à mimer, de façon assez troublante, en ces confins mythiques où le père et la bête ne faisaient qu’un, l’énonciation de la loi.
Didier Moulinier
(Image : Joseph Fay, "Faust et Méphisto dans le cachot", 1848)
|






 Your new post is loading...
Your new post is loading...